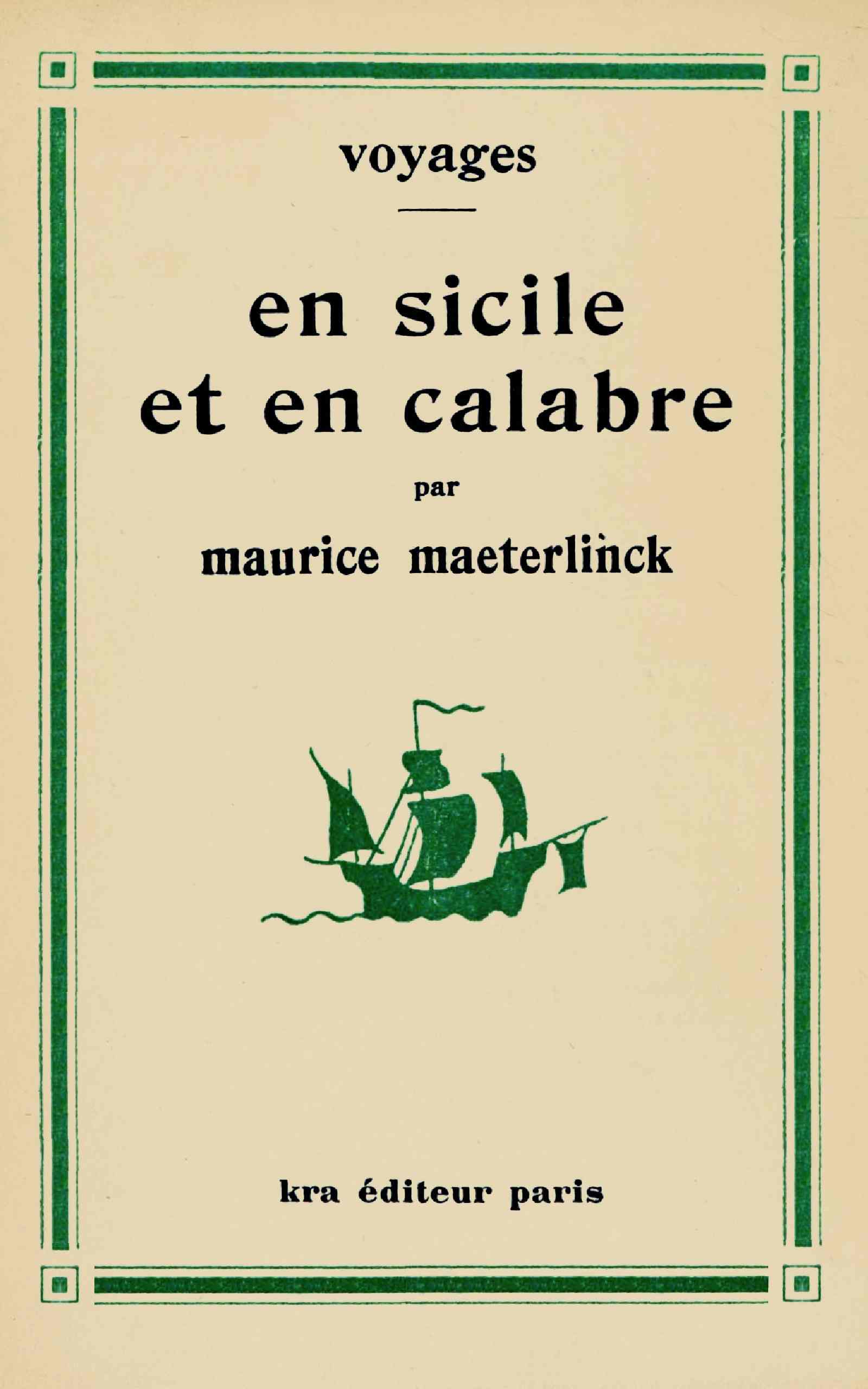
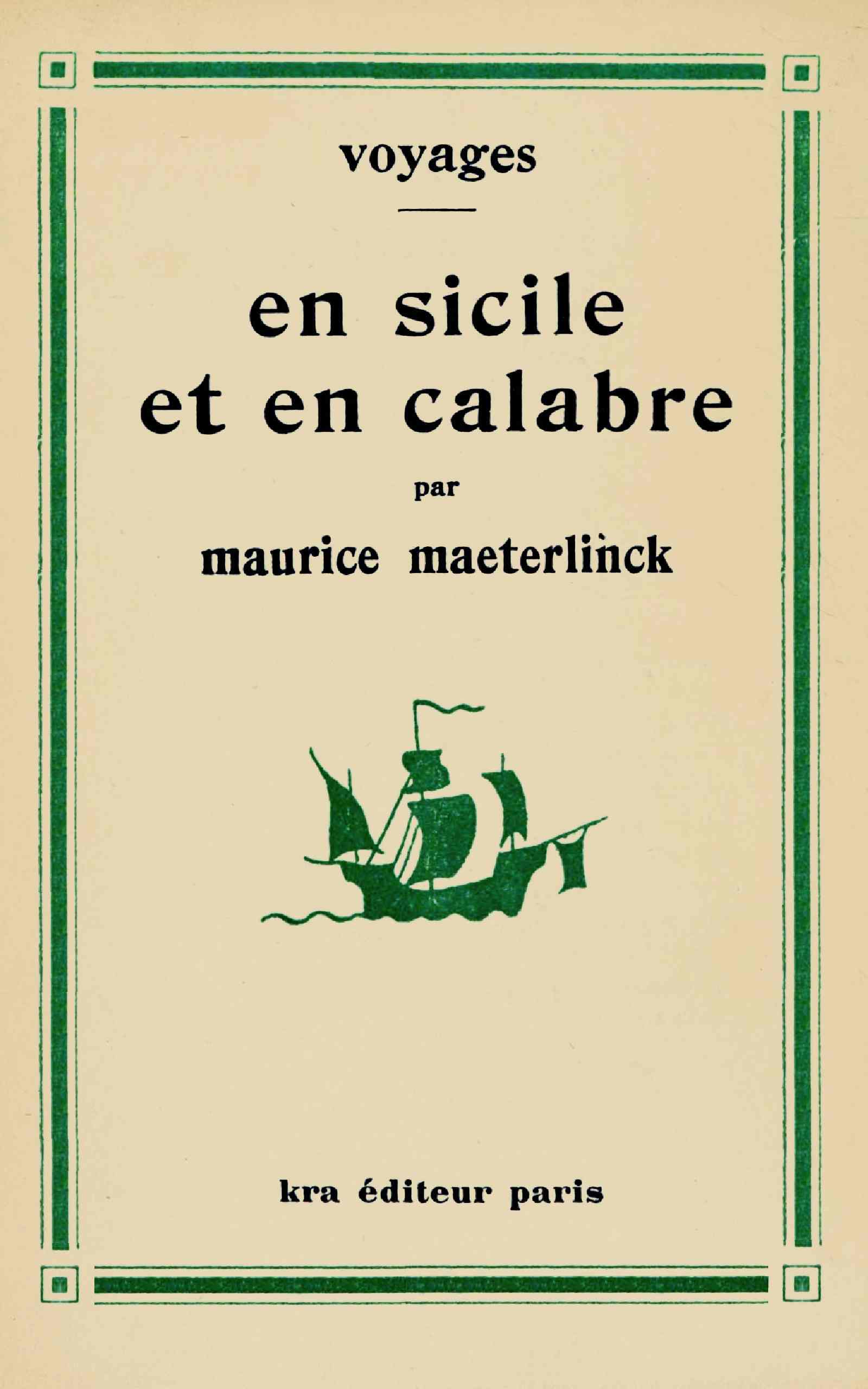
par
maurice maeterlinck
kra, éditeur, 6, rue blanche, paris
2e édition.
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE
50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE
PANNEKOEK NUMÉROTÉS DE 1 A 50
ET 950 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN OUTHENIN-CHALANDRE
NUMÉROTÉS DE 51 A 1.000
LE TOUT CONSTITUANT L’ÉDITION ORIGINALE
IL A ÉTÉ TIRÉ SPÉCIALEMENT
POUR LA SOCIÉTÉ “LES BIBLIOPHILES DU NORD”
15 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL
NUMÉROTÉS DE I A XV
Copyright by Maurice Maeterlinck, 1924.
Tous droits de reproduction, adaptation, traduction et représentation réservés pour tous pays.
Depuis longtemps, depuis les jours les plus lointains de ma jeunesse, la Sicile, la terre des idylles de Théocrite, qui du reste furent écrites à Alexandrie, le paradis du beau temps sans nuages et des plaisirs champêtres, hantait mes rêves de bonheur. Voici plus de vingt ans que j’habite l’un des plus beaux lieux de la terre, cette Côte d’Azur qui va d’Hyères à Menton, et se prolonge en Italie, de Vintimille, en passant par Gênes, jusqu’aux portes de Pise, Amalfi et Sorrente, ce point nuptial de l’Europe. J’ai vu les plages de l’Espagne et les lacs divins de la Lombardie. J’ai vu l’Égypte, la Grèce, la Syrie et le Bosphore. J’ai vu la Californie, dont quelques coins vaudraient presque certains golfes des rives liguriennes si elle avait derrière elle un passé moins informe, et surtout si on ne l’avait pas si lamentablement déboisée. Mais je ne sais pourquoi la Sicile me semblait infiniment plus désirable. L’imagination se crée ainsi des foyers de félicités, des réserves de songes ; et à qui me demanderait s’il convient de les entretenir ou de les détruire, je répondrais qu’il vaut mieux les détruire ; car plus on détruit de rêves, plus on approche de la vérité, qui est, à ce qu’affirment les grands sages, la seule forme du bonheur qui soit digne de l’homme.
Aussi, lorsqu’un de mes vieux amis vint me dire : « Je pars ces jours-ci pour faire en auto le tour de la « perle des îles », voulez-vous m’accompagner ? » nous ne prîmes, ma femme et moi, que les quelques heures nécessaires aux indispensables bagages et nous voilà sur la route, dans la 20 chevaux que conduit notre hôte, une Renault pas très jeune, manquant un peu de nerf dans les reprises et les côtes, mais solide, ayant fait ses preuves en Espagne, bien suspendue et de tout repos.
Je n’ai nullement la prétention de découvrir la Sicile, ni l’intention de vous la révéler. Mais il n’est pas mauvais, je pense, que de temps à autre un passant sans parti pris fixe l’image de l’un de ces grands pays légendaires qui sont les lieux de pèlerinage de l’humanité ; de même qu’il n’est pas inutile que les voyageurs qui, de plus en plus, trop souvent par snobisme ou sur la foi de relations conventionnellement idéalisées, s’y précipitent aveuglément, soient prévenus des inconvénients et des déceptions qui les attendent. C’est ce que je vais faire le plus simplement, le plus sincèrement possible dans ces notes de voyage jetées au jour le jour sur le papier.
A partir de Vintimille, nous longeons donc la Riviera italienne jusqu’à Pise. D’abord celle du Ponant, moins séduisante, plus aride, plus souillée par l’industrie que la Riviera française ; puis celle du Levant, à l’est de Gênes, beaucoup plus éclatante, plus verdoyante, plus pittoresque et plus fleurie. De Pise à Rome et de Rome à Naples, le voyage trop connu se poursuit sans incidents par des chemins moins redoutables que nous ne l’avions prévu. A Naples, nous constatons que la guerre et l’influence de Mussolini ont passé sur la racaille napolitaine comme la rosée du matin sur une statue de marbre. Elle est exactement ce qu’elle fut, ce qu’elle sera probablement toujours, et plus voleuse que jamais. C’est ainsi que sur la route de Naples à Pompéi, qui n’est qu’une rue grouillante, et donc avec la complicité manifeste de la foule, on me subtilisa, sur le toit de la voiture, une valise contenant un complet tout neuf et mon smoking. J’allai me plaindre à la police et l’on me demanda :
— Votre valise était-elle fixée au toit par une chaîne d’acier et un cadenas ?
— Non, elle était maintenue par une courroie.
— Alors, de quoi vous plaignez-vous ? me fut-il textuellement et tranquillement répondu. Il est tout naturel que l’on vous l’ait volée, « puisque » cela se fait tous les jours.
A Naples, le soir, nous embarquons l’auto sur le bateau qui doit nous porter en Sicile, où nous abordons le lendemain matin, après maintes chicanes et contestations au sujet de la voiture et au milieu d’une nuée d’aides inutiles qui réclament âprement leurs pourboires et nous révèlent que le Sicilien est aussi indiscret, aussi quémandeur, aussi agaçant que le Napolitain.
Palerme ! « Palermo la Felice ! » ville au nom magnifique que semblent éventer des palmes et qu’enguirlandent de somptueux prestiges !… En réalité, ce n’est qu’une cité assez banale, assez vulgaire, grisâtre sous l’ardent soleil, sans caractère, mal tenue, d’une richesse terne et pauvre. N’étaient les véhicules de toutes sortes, barbarement barbouillés, qui illuminent ses rues, on se croirait dans n’importe quelle préfecture du Midi de la France. Elle n’offre, du reste, avec sa Chapelle Palatine, son Palais Royal, sa Cathédrale, etc., que des curiosités de second, et même de troisième ordre. Seuls d’admirables vergers de citronniers, qui lui font une ceinture d’or, répondent à ce que l’imagination exigeait de la capitale actuelle de l’antique Trinacrie.
Passé les vergers de citronniers, la campagne palermitaine est minable, poussiéreuse, banlieusarde. On y fait connaissance avec le déplorable type d’habitation que l’on retrouve ensuite par toute la Sicile, aux abords des grandes et petites villes, et qui est la seule demeure que connaissent les villageois : un cube de pierrailles ou de plâtras écaillés, badigeonné de blanc, de rose, d’ocre ou de bleu sale. Il n’y a pas de fenêtres. Une grande porte ronde, toujours ouverte, éclaire seule l’unique pièce où, la nuit venue, se retire toute la famille en compagnie des poules, des chèvres et de petits cochons noirs ; car le jour, tout cela vit, grouille, mange, jacasse, se gratte et s’épouille à l’ombre des murs, sur la grand’route.
A quelques kilomètres de Palerme, une incroyable merveille : dans l’ancien couvent des Bénédictins, fondé au XIIe siècle par le Normand Guillaume II ou le Bon, le cloître de Monreale, l’un des plus grandioses, des plus beaux, des plus féeriques qu’on puisse voir. Mais ses arcades italo-romanes, ou plutôt sarrasines, supportées par 216 colonnes accouplées, couvertes de mosaïques multicolores où dominent les cubes d’or, et surmontées de chapiteaux qui varient à l’infini leurs sculptures et leurs ornements, tout cela, ainsi que sa délicieuse fontaine entourée d’arceaux, et ruisselante d’eaux vives, est beaucoup trop connu pour que je m’attarde à le décrire une fois de plus. Il est temps de pénétrer dans la campagne sicilienne, de voir l’île telle qu’elle s’étale et se comporte sous le soleil de Dieu et de parcourir des routes moins fréquentées.
Nous passons par Alcamo, ville d’une cinquantaine de mille habitants, sans intérêt, où nous déjeunons très mal, dans la meilleure auberge, qui est sordide, crasseuse, noirâtre et nauséabonde, comme toutes les auberges et tous les hôtels de Sicile, ceux de Palerme, de Girgenti, de Syracuse, de Taormina et de Messine exceptés, et nous partons à la recherche de Ségeste.
Mais il n’est pas facile de découvrir Ségeste. Rien ne l’indique, aucun chemin n’y mène. Nous faisons d’abord fausse route jusqu’à Calatafimi, où plane encore le souvenir de Samuel Butler, l’auteur d’« Erewhon », qui y séjourna, et dont le nom sert d’enseigne à une très mauvaise osteria. Une panne de l’auto, dont le carter a heurté une énorme pierre, nous oblige de nous y arrêter ; et nous prenons contact avec le Sicilien à l’état natif. C’est dimanche, personne ne travaille, c’est-à-dire que par je ne sais quel miracle, on parvient à rendre plus manifeste l’oisiveté générale et presque totale des jours ouvrables. La rue est pleine d’une foule non point nettoyée ou lavée, mais qui a joyeusement revêtu par-dessus la crasse héréditaire, des complets presque neufs. L’auto vient à peine de stopper que des centaines de gamins, sortis de terre comme des moucherons, assaillent la voiture, grimpent sur les ailes, sur les marchepieds, ouvrent les portières, tripotent les bagages. On se croirait dans un village de l’Afrique centrale, et je dois, tandis que mon ami s’occupe de l’avarie, tourner sans cesse autour de la voiture en distribuant d’inoffensifs coups de canne. Bientôt les adultes se joignent aux enfants ; tout ce monde s’approche sans vergogne, s’entasse autour de l’auto, nous empêche de remuer et de respirer, crie à tue-tête, jacasse sans arrêt, gesticule, donne son avis, veut à toute force intervenir et collaborer. Nulle malveillance, aucune méchanceté, mais une indiscrétion, une familiarité, une curiosité de négrillons ou de grands singes qui tiennent à tout voir de près, à toucher tout afin de se mieux rendre compte. A Naples, dans une pareille presse, nous aurions été lestement soulagés de nos montres et de nos portefeuilles ; ici non ; en revanche, le soir, nous constatons que nous avons été généreusement pourvus de puces, et même que l’un de nous a été gratifié de quelques insectes moins agiles mais plus répugnants.
J’ai noté un peu longuement cet incident, parce que, dans toutes les villes de la Sicile, hormis les trois plus grandes, au moindre arrêt, nous eûmes à subir des assauts analogues qui finissaient par devenir extrêmement énervants.
Enfin, nous repartons ; et après bien des tâtonnements, grâce aux indications plus précises que nous donne un paysan qui, comme beaucoup de Siciliens ayant été chercher fortune en Amérique, parle quelque peu l’anglais, nous parvenons à découvrir, non pas le chemin ou le sentier — il n’y en a point — mais les herbages incultes et déserts qui mènent à l’introuvable temple de Ségeste.
On traverse à gué un large ruisseau ; on monte durant une demi-heure le long d’une pente molle, ondulée et fleurie par le printemps, car nous sommes en avril ; puis, au détour d’un repli de terrain, posé bien d’aplomb, comme un objet un peu trapu et un peu lourd sur sa colline verte, et se détachant nettement sur un fond de rochers, à cinq ou six cents mètres de distance, dans une solitude illimitée et absolue, le temple se dresse devant nous. Il se présente de face, avec les six colonnes qui portent le fronton. Il semble intact. Il est du Ve siècle. Comme tous les monuments grecs de la bonne époque, il n’est pas très grand.
Ce serait, je le sens, le moment de refaire le traditionnel couplet sur l’harmonie souveraine, les proportions infaillibles, la pureté, la sûreté sans égales de l’architecture hellénique. J’avoue que le premier choc est assez mou. Notre œil, habitué à des constructions énormes, infiniment variées, infiniment complexes, est d’abord déconcerté. Le temple est sensiblement plus lourd, plus massif, plus bas, plus épais que ne le prévoyait notre rêve de grâce et de beauté. Il paraît têtu, borné et assez méchant. Il n’a pas du tout l’aspect heureux, souriant et serein, l’air en fête qu’on attendait. On dirait plutôt un bouledogue prêt à mordre.
En tout cas, nos édifices qui se croient grecs, la Bourse et la Madeleine, par exemple, sont à peu près à celui-ci ce qu’une « Jeanne d’Arc » de la rue des Saints-Pères est à la victoire de Samothrace.
Est-ce notre œil qui a tort ? C’est probable. Nous éprouvons une impression analogue devant les plus belles statues grecques du temps de Périclès. Les jambes des hommes nous semblent, en général, trop courtes et celles des femmes trop lourdes. Nos regards sont corrompus par tant de siècles de déformations, auxquelles il faut ajouter celles de l’art d’aujourd’hui, qui dépassent tout ce qu’on avait osé tenter, qu’ils ont perdu toute notion d’équilibre et de réalité. Il nous est donc impossible de comprendre de quelle façon les Grecs voyaient leurs temples, car nos yeux, en cette cause, sont à la fois juges et parties.
Mais les souvenirs redressent et grandissent la vision. Le temple recule dans le passé. Il porte le prestige et le poids de plus de vingt-trois siècles. Tout est mort autour de lui. De Ségeste qui le consacra à Cérès, il ne reste qu’un théâtre en ruines ; de Sélinonte, son ennemie, trois tas de gigantesques pierres. A cinq kilomètres à la ronde, excepté la masure du gardien, il n’y a plus une habitation humaine, plus un arbre, rien qu’une herbe rase et rare. L’illusion qui s’était affaissée remonte le long du monument et l’imagination le remet à sa place, au centre de la guerre du Péloponèse et de l’histoire de Thucydide. Autour de ces colonnes tourne un moment tout le destin d’Athènes ; car c’est à la prière des habitants de Ségeste, en guerre contre ceux de Sélinonte, que la rivale de Sparte décide la désastreuse et folle expédition de Sicile, qui est le commencement de son irréparable ruine. L’an 415 avant J.-C., les députés d’Athènes envoyés à Ségeste « pour vérifier l’existence des valeurs qu’on disait se trouver dans le trésor public ou dans les temples, et pour s’informer du point où en était la guerre avec Sélinonte »[1] gravirent ces degrés de pierre qui menaient à la Cella, encore inachevée, et firent à la déesse un sacrifice avant d’emporter « les soixante talents d’argent non monnayé, comme solde d’un mois pour soixante vaisseaux dont ils se proposaient de solliciter l’envoi »[2] ainsi que le dit textuellement Thucydide. Or, si ces députés revenaient aujourd’hui, à la distance d’où nous l’apercevons d’abord, ils reverraient le temple avec ses trente-six colonnes fauves, ses entablements et ses frontons, exactement tel qu’il était il y a deux mille trois cent quarante-huit ans, et se croiraient en proie à l’hallucination qui nous gagne quand nous contemplons l’unique et solitaire survivant d’un magnifique monde qui n’est plus…
[1] Thucydide, « Histoire de la guerre du Péloponèse ». L. VI, 6.
[2] Thucydide, « Histoire de la guerre du Péloponèse ». L. VI, 8.
Le soir de ce dimanche nous arrivons à Castelvetrano, ville de quelque vingt mille habitants, où notre entrée et notre arrêt devant le principal hôtel soulèvent la même émotion, la même curiosité indiscrète et encombrante, provoquent les mêmes attroupements, les mêmes bousculades qu’à Calatafimi. L’hôtel, le meilleur nous affirme-t-on de toutes parts, est franchement ignoble ; le dîner, servi sur une nappe répugnante, par un sourd-muet empressé, chevelu et crasseux qui, tout le temps, pousse des cris sauvages, est abominable. Et les lits sont tellement suspects que nous n’osons pas nous déshabiller. Mais comme nous avons oublié de convenir des prix, la note présentée le lendemain rivalise fièrement avec celles des plus nobles palaces.
De bon matin nous nous hâtons de fuir ces lieux que nous croyons — n’étant pas encore habitués aux hôtels et auberges de la Sicile normale — particulièrement inhospitaliers, et nous débouchons dans les basses plaines arides où, sur deux collines sablonneuses, s’élevaient les sept temples de Sélinonte.
Dans une solitude aussi vaste, un abandon aussi total que celui de Ségeste, dans un paysage de fin du monde, plat, blanchâtre, saupoudré de sable pâle et tout à fait stérile, on aperçoit tout d’un coup un immense désastre. D’énormes tronçons de colonnes encore debout, de formidables socles renversés, de monstrueux chapiteaux chavirés, de gigantesques fragments d’architraves, d’entablements et de frontons ont été, semble-t-il, ramassés en trois tas inégaux par le balai rapide et dédaigneux de quelque cataclysme sans mesure. Est-ce une catastrophe lunaire ou le plus insensé des cauchemars cubistes ? On s’approche troublé, intrigué, ahuri, déconcerté. On ne sait par quel bout prendre ce tohu-bohu cyclopéen, dont aucune autre ruine ne peut donner l’idée. Aucune puissance humaine, quand elle détruit, n’opère de cette façon, ne produit de semblables décombres. On pénètre dans le chaos, on escalade des blocs de pierre hauts comme des quartiers de rocs vierges ; et peu à peu on discerne un certain ordre dans cette prodigieuse confusion. Des files de colonnes sont étendues dans le sable, tombées en rang, toutes du même côté, comme si le temple avait été plié, puis couché d’un seul coup, à droite ou à gauche, par une force surnaturelle. C’est en effet, la vague horizontale d’un tremblement de terre, que la mémoire des hommes a oublié, qui acheva l’anéantissement de la rivale de Ségeste dont tous les habitants avaient été massacrés il y a vingt-trois siècles.
Contrairement aux habitudes des Grecs, dont l’architecture gardait toujours des proportions humaines, l’un de ces temples, consacré à Jupiter, était de dimensions colossales, le plus grand, avec un autre dont nous verrons les ruines à Girgenti, qu’ils aient édifié.
On a réuni, au Musée National de Palerme, les fragments d’architecture et de sculpture trouvés dans les temples. Les plus remarquables, qui comptent même parmi les plus précieux que nous ait légués l’antiquité, sont les fameuses métopes qui vont de l’an 627 à l’an 409 avant J.-C., ce qui permet de suivre l’évolution de l’art grec depuis la période archaïque, représentée par un Hercule hideux comme un anthropoïde qui porte deux cyclopes monstrueux, jusqu’au Jupiter et à la Junon, à l’Hercule et à l’Amazone, à la Diane et à l’Actéon, à la Pallas et au Géant Encelade, qui annoncent déjà les chefs-d’œuvre des grandes années.
De Sélinonte, en passant par Sciacca, nous allons à Girgenti, où nous arrivons dans l’après-midi ; Girgenti, l’Agrigente des Romains, la ville de Phalaris et d’Empédocle, est, comme on sait, la grande cité des temples. Elle en compte sept ou huit, dont quatre en assez bon état. Ils sont plus ou moins alignés sur le même plateau nu et désert, à quelque distance de la ville actuelle ; et quand on vient de voir le magnifique solitaire de Ségeste et les fantastiques débris de Sélinonte, la première impression n’est guère satisfaisante. Il y en a trop. Ils n’ont pas l’air sérieux. Ils semblent figurer dans une exposition universelle. On dirait qu’on les a brutalement arrachées à leur milieu, à leur atmosphère millénaire, au profit d’une exhibition mercantile et temporaire. Puis, à les voir en si grand nombre, on remarque que trop exactement ils se ressemblent tous ; et la remarque prend une force plus fâcheuse quand aux monuments de Girgenti on ajoute leurs trois répliques de Paestum. Ils sont très beaux mais paraissent interchangeables comme on dit aujourd’hui en mécanique. Ils ont l’air d’être fabriqués en séries sur un invariable gabarit. Leur architecture est évidemment le suprême triomphe de la logique, de la simplicité, de l’équilibre, mais à se répéter sans cesse, dans tout le monde grec, ce triomphe finit par devenir un peu monotone et par révéler une certaine indigence. Et quand, cet art très pur parce qu’il n’ose rien, parce qu’il se contente de quelques lignes qu’il retrace à satiété, on le compare à l’incroyable, à la folle hardiesse, à l’inépuisable diversité de notre moyen âge, où pas une cathédrale ne se permet de ressembler à une autre, on se demande si cette malheureuse architecture gothique, si décriée à cause de ses voûtes mal équilibrées, de ses arcs-boutants et de ses contreforts qui réparent de leur mieux les généreuses erreurs d’une imagination ardente, n’a pas été trop injustement sacrifiée sur l’autel sec et nu du sanctuaire païen.
Des divers temples de Girgenti, le mieux conservé est celui de la Concorde. Il est aussi complet que celui de Ségeste, auquel il ressemble comme un frère. Un autre, consacré à la Junon lacinienne, a vingt-cinq colonnes et l’architrave d’un de ses côtés presque intactes. Un peu plus loin, on relève les colonnes d’un temple dédié à Hercule. Ailleurs, un fragment de fronton dressé dans l’azur marque l’entrée du temple de Castor et Pollux. Mais le géant de tous les temples du monde grec répand ses ruines au nord de la porte Aurea. Il était consacré à Jupiter et comptait trente-huit colonnes, dont chacune avait 6m,50 de circonférence. Un homme peut se tenir debout dans les cannelures. Il n’en subsiste que des fragments énormes, probablement trop lourds, tout ce qui était transportable ayant été jeté à la mer pour construire le môle. On y trouve, étendu sur le sol, tronçonné mais complet, le cadavre de l’un des formidables Atlantes qui supportaient l’entablement. Il mesure près de huit mètres. Le visage rongé par plus de deux mille années est informe ; mais le corps est parfaitement reconnaissable, et le monstre presque préhistorique qui dort là, face au ciel, depuis tant de siècles, évoque l’image de ses mystérieux frères antédiluviens de la fabuleuse île de Pâques, l’une des plus grandes énigmes de ce globe.
Des splendeurs de l’antique Girgenti, « la plus belle ville des mortels », au dire de Pindare, et qui compta, paraît-il, huit cent mille habitants en y comprenant les esclaves, il ne reste qu’une pauvre rue étroite, sombre, escarpée et extrêmement malpropre. Mais du moins, grâce à un Suisse, probablement moins Helvète qu’Allemand, on y trouve un hôtel bien tenu, entouré d’un beau jardin de citronniers, de lauriers-roses et de camélias, et d’où l’on a, sur la mer et sur la campagne onduleuse, une vue délicieusement douce et paisible. De tels agréments sont si rares en Sicile qu’il importe de les signaler.
Le lendemain, le départ de Girgenti ne put se faire de bonne heure comme nous l’avions espéré. Il fallait réparer la chaîne de la magnéto. En tout pays civilisé, c’eût été l’affaire d’une trentaine de minutes. Il n’en va pas de même en Sicile, où d’abord trois ou quatre mécaniciens, tous ceux du patelin, s’assemblent autour de la pièce pour délibérer en fumant des cigarettes. Quand l’un d’eux, poussé par les pourboires prodigués, se décide enfin à mettre la main à la besogne, la meilleure partie de la matinée est déjà perdue. Nous ne quittons donc Girgenti que vers les onze heures ; nous déjeunons malproprement à Licata, sale petite ville à l’embouchure du Fiume Salso, des inévitables spaghetti, parcimonieusement arrosés d’une sauce tomates de conserve, et de la non moins inévitable tranche de veau coriace et fade, non pas frite mais bouillie dans l’huile rance, et après nous être trois ou quatre fois égarés car il n’y a jamais sur aucune route un seul poteau indicateur, au soir tombé, nous arrivons enfin, à travers des montagnes désertiques et par des routes épouvantables, à Palazzolo Acreïde. Nous avions l’intention d’y passer la nuit, mais à l’aspect de la meilleure auberge de l’endroit, qui compte cependant plus de quinze mille habitants, le courage, comme disait le vieux jardinier de mes parents, descend dans nos talons. Il est neuf heures ; mes compagnons meurent de faim, et, le dégoût dans l’âme et le cœur entre les dents, se résignent à chercher à dîner dans la nauséabonde masure. Pour moi, habitué aux jeûnes hygiéniques, grâce à la pratique de l’excellent système du docteur Guelpa, je renonce sans peine au repas du soir et, une trique à la main, je monte autour de la voiture une garde indispensable, car les gamins effrontés et pillards pullulent comme des moustiques. Ensuite, nous reprenons la route de Syracuse ; nous nous égarons encore, nous crevons dans le noir et la boue, pour arriver vers minuit dans la moderne et laide banlieue qui précède l’île d’Ortygie, cœur de l’antique cité.
Nous trouvons enfin bon gîte dans l’excellent hôtel qui domine les Latomies des Capucins, et le lendemain, du balcon de notre chambre, dans l’air bleu du matin, nous découvrons à peu près tout ce qui reste de la plus grande ville que bâtirent les Grecs.
Et d’abord, à nos pieds, formant le jardin de l’hôtel, les fameuses latomies, où, l’an 415 avant J.-C., à la suite du désastre de Nicias, périrent les prisonniers athéniens.
Les latomies de Syracuse sont, comme on sait, d’anciennes carrières, mais abandonnées depuis tant de centaines, il faudrait presque dire de milliers d’années, que toute trace de travail humain a complètement disparu. Les parois à pic, hautes de plus de cent mètres, les excavations informes, les voûtes disloquées, les énormes rochers en surplomb, dévorés par le temps, évoquent des gorges célèbres, les abîmes de grottes préhistoriques. C’est le décor rêvé pour quelque drame immémorial ; et c’est, en effet, entre ces terribles murs monolithes, à la fraîcheur desquels fleurissent aujourd’hui les citronniers, les mandariniers et les lauriers-roses que s’accomplit l’une des plus affreuses tragédies de l’antiquité. Poussés par la stupidité du plus grand nombre, qui finit toujours par mener au désastre les États démagogiques, sept mille citoyens d’Athènes, parmi ceux qui partirent un matin du Pirée « sur la plus superbe flotte et la plus magnifiquement équipée qui fût jamais sortie d’un même port »[3], sept mille prisonniers échappés à l’épouvantable carnage du fleuve Assiniros, furent entassés entre ces murs lisses et impitoyables. Écoutons maintenant Thucydide, car il ne convient pas de mêler des accents puérils ou excessifs à la grande et simple voix de l’histoire.
[3] Thucydide, « Histoire de la guerre du Péloponèse ». L. VI, 31.
« Parqués dans une enceinte creuse et resserrée, ils furent d’abord exposés sans abri à l’ardeur suffocante du soleil ; puis survinrent les fraîches nuits d’automne, et cette transition détermina des maladies. N’ayant pour se mouvoir qu’un espace étroit, et les cadavres de ceux qui succombaient à leurs blessures, aux intempéries ou à quelque accident, gisant pêle-mêle, il en résulta une infection insupportable, qu’aggravèrent encore les souffrances du froid et de la faim ; car durant huit mois on ne donna à chacun des prisonniers qu’un cotyle d’eau et deux cotyles de blé. Enfin, de tous les maux qu’on peut endurer dans une captivité pareille, aucun ne leur fut épargné. Pendant soixante-dix jours, ils vécurent ainsi tous ensemble ; ensuite, ceux qui n’étaient ni Athéniens, ni Grecs de Sicile ou d’Italie furent vendus »[4], ce qui veut dire que les autres périrent peu à peu, un à un, dans l’effroyable « in pace ».
[4] Thucydide, « Histoire de la guerre du Péloponèse ». L. VII, 87.
Dans une autre latomie, celle du Paradis, se trouve l’Oreille de Denys le Tyran, qui permettait à celui-ci, au dire de la légende, de saisir les moindres propos tenus par les prisonniers qu’il y accumulait. Quoi qu’il en soit, la longue grotte sinueuse, très pittoresque et plus haute qu’une cathédrale, amplifie si extraordinairement tous les bruits qu’on entend tout au fond, à cent mètres de distance, le crissement d’un morceau de papier déchiré près de l’entrée et que le claquement des mains s’y répercute en coups de canon.
Il y a encore à Syracuse un théâtre grec dont les ruines ne sont pas très remarquables ; des catacombes, que nous fit visiter un moine et qui sont assez peu impressionnantes parce que la lumière du soleil y pénètre de toutes parts ; la fameuse fontaine Aréthuse qui, depuis un tremblement de terre, ne verse plus, dans un bassin entouré de papyrus, qu’une eau salée ; il y a, enfin, la cathédrale, au milieu de l’île d’Ortygie, c’est-à-dire de la Syracuse d’aujourd’hui, laquelle n’est qu’une petite ville d’aspect médiéval, aux rues étroites et sombres. Ce qui domine tout ici, ce qui l’emporte sur tout, comme dans tous les lieux chargés d’histoire — et quel lieu, Athènes, Rome et Jérusalem exceptées, est plus chargé d’histoire que celui-ci ? — c’est ce qu’on n’y voit plus, ce sont quelques noms sonores que l’on répète sur des emplacements vides.
Nous quittons Syracuse dans l’après-midi et arrivons à Catane vers le soir. Catane, la plus grande ville de la Sicile après Palerme, est sans intérêt, commerçante, banale et laide. Nous nous empressons de la quitter, après une nuit médiocre dans le meilleur hôtel, à peine digne d’une sous-préfecture française. Nous sommes maintenant dans la région de l’Etna, dont nous contournons les puissantes assises. Mais le plus grand volcan de l’Europe n’est, en ce moment, qu’une montagne assez ordinaire, où achèvent de fondre quelques plaques de neige et qui envoie tranquillement vers le ciel une paisible colonne de fumée[5]. Malgré ses trois mille mètres, il n’encombre ni n’écrase le paysage, et se contente d’épauler paternellement la route peu remarquable qui nous conduit à Taormina.
[5] C’était le 3 mai, quelques jours après, le volcan devint menaçant, puis eut lieu l’éruption que l’on sait, dont l’importance, du reste, fut d’abord exagérée : car il n’y eut, somme toute, que des dégâts matériels assez restreints et facilement réparables.
Taormina, petite ville de luxe et de villégiature, tout en hôtels, possède, affirment les guides, le théâtre grec le plus beau et le mieux conservé que nous ait légué l’antiquité. A vrai dire, la réputation de ce théâtre semble un peu surfaite. D’abord il est bien plus romain que grec ; ensuite, des restaurations, qui datent de 1748 et de 1840, inspirent quelque méfiance. Mais le site, une magnifique proue rocheuse qui se dresse sur la mer, l’eau bleue de tous côtés, l’Etna à droite, la Calabre à gauche, est unique au monde. On se demande quel poème, quelle tragédie, fût-elle d’Eschyle ou de Sophocle, était capable de résister, de tenir tête à un tel horizon, de ne pas se dissoudre et s’évaporer dans une telle splendeur.
De Taormina à Messine, il n’y a qu’une cinquantaine de kilomètres, et nous voici parmi les baraquements, les chantiers et les décombres de la grande victime du tremblement de terre de 1908. Malgré le soleil qui l’illumine et la mer d’indigo qui la baigne, on dirait que, découragée, elle a renoncé à se relever de ses ruines. Elle n’est plus qu’une ville de bois et de ciment armé, basse, absolument grise et extraordinairement poudreuse, aussi totalement laide, aussi déprimante, aussi sinistre qu’une ville du Far-West américain. Aussi n’y séjournons-nous que le temps nécessaire à embarquer l’auto sur le bac à vapeur qui, de Messine, c’est-à-dire de Charybde en Scylla, les deux gouffres d’Homère, doit nous conduire en moins d’une heure à Villa S. Giovanni, en Calabre.
Nous avons maintenant fait le tour de la Sicile, la côte nord, de Messine à Palerme exceptée, qui de l’aveu de tous n’offre aucun intérêt. Nous l’avons, en outre, de Palerme à Sélinonte et Sciacca, traversée dans sa largeur et fait à l’intérieur, de Terranova, par Chiaramonte et Palazzolo, vers Syracuse, de nombreux crochets : il est donc probable, à moins que son centre ne recèle des merveilles dont ne parle aucun guide, que nous en avons une idée suffisante.
« Sicelides Musae ! » O Muses de Sicile ! idylles de Théocrite et rêves de Virgile, antres, forêts opaques, pâtres au front bouclé, sources claires, chèvres, brebis, pipeaux et bords mallarméens de calmes marécages, où êtes-vous ? L’île est à peu près nue, aride et déboisée. On roule durant des heures, par des chemins affreux, sans apercevoir une maison, un coin d’ombre, un ruisseau, un troupeau ou un arbre. La terre ondulée déroule monotonement ses mauvaises herbes printanières que l’été va bientôt calciner, ses champs de féverolles, de trèfle incarnat et de topinambours, que coupent çà et là quelques buissons de cactus ou d’agaves. Dès que la plaine s’élève de deux ou trois cents mètres au-dessus du niveau de la mer, surgit l’âpre rocher sans une touffe d’herbe, ou le morne désert de pierrailles. Hormis les alentours des grandes villes où sont les beaux vergers de citronniers et quelques jardins agréables, pas un bois, pas un boqueteau, pas une maison de campagne. Peu d’eau et de l’eau sans gentillesse ; sur tout notre parcours, je n’ai pas vu sourdre une source, sourire un petit lac ; je n’ai pas entendu murmurer un torrent, pleurer une cascade. Seuls, quelques maigres ruisseaux rampent péniblement dans les bas-fonds dénudés.
Les routes sont presque impraticables. Quand elles ne sont pas tout fondrières, elles ressemblent aux routes de France qu’on vient de recharger et qui attendent le rouleau compresseur. En moins de huit jours, elles dévorent un train de pneus. A intervalles réguliers, des deux côtés de ces chemins sans ombre, se rangent de longs villages ou de plus longues petites villes, identiquement sordides, où vient s’entasser, vers le soir, dans les masures que j’ai déjà décrites, de dix kilomètres à la ronde, toute la population rurale. Elle vit là, non point dans la tristesse ou la misère, car la misère est plus apparente que réelle, et, pour qui veut travailler, les salaires sont assez élevés, mais dans la saleté et l’ignorance satisfaites, l’incurie bruyante et la paresse volubile.
J’ai dit déjà un mot de la cuisine sicilienne. Dans les Palaces, notamment à Palerme et à Syracuse, on trouve la table banale et fade, propre à ce genre d’établissements, mais, bien que plus chère, fort inférieure à celle des Palaces français. Dans les grandes villes, il y a des restaurants convenables, mais assez grossiers. Partout ailleurs, la nourriture est franchement exécrable. Quant aux vins, qui devraient, semble-t-il, être excellents, les plus renommés, ceux de l’Etna, l’Isola bianco de Syracuse, etc., sont corsés, mais plats, sans bouquet, sans finesse. Je ne parle pas du Marsala, qui n’est qu’un vin fabriqué. Seul, le Moscato de Syracuse, proprement servi dans un verre lavé au citron, au seuil d’une buvette contiguë aux opulents ombrages de l’Oreille de Denys le Tyran, peut-être parce qu’il faisait très chaud et que j’avais grand’soif, m’a paru frais, généreux, naturel, moelleux, presque digne, en un mot, du soleil et des vignes que chanta Théocrite.
Étant données les habitudes siciliennes, après en avoir royalement payé le transport et saturé de pourboires une trentaine d’oisifs encombrants, avides et toujours mécontents, qui ont fait mine de vous aider, embarquer et débarquer une auto est beaucoup moins simple qu’on ne croyait. D’abord, il est défendu d’y laisser de l’essence, et comme il est à peu près certain qu’on n’en trouvera pas à Villa S. Giovanni, voilà le malheureux automobiliste coincé entre le mensonge qui délivre et la vérité qui immobilise. Il ne faut pas demander à la vertu de l’homme plus que le bon sens ne peut accorder ; aussi mon ami s’empressa-t-il de déclarer avec toute la solennité requise, que sa voiture ne contient plus une goutte de benzine. Mais durant le trajet, un inspecteur incrédule, fureteur et quelque peu maître-chanteur, ne tarde pas à découvrir, dissimulé sous les bagages, un bidon de dix litres. Esclandre, altercation sonore, amende de quatre cents lires infligée par le préposé que nous sommes sur le point de vivement houspiller à cause d’un propos malsonnant qu’il se permet contre la France, quand le capitaine du ferry-boat, un parfait gentleman qui parle fort bien français, intervient, remet l’inspecteur à sa place et, au débarquer, explique notre cas au chef de gare de San Giovanni, qui réduit aussitôt l’amende à quarante centimes.
A notre arrivée à Palerme, à cause d’une chicane sur le poids de la voiture, nous avions déjà été condamnés à verser entre les mains d’un autre inspecteur assez suspect, un millier de lires en sus du prix réglementaire ; et comme nous ne connaissions pas encore l’arbitraire et l’élasticité des amendes siciliennes, nous les avions intégralement et fort naïvement payées.
Échappés enfin aux nombreux désagréments de la grande île, que rachètent de rares beautés, après avoir déjeuné à San Giovanni, nous attaquons la Calabre par le bout de sa botte, pour remonter à travers la Basilicate et les confins de la Campanie, jusqu’à Naples. Ce sont régions qu’on ne visite guère ; car il est peu fréquent qu’un touriste s’aventure au delà de Castellemare ou de Salerne. Or, si la Sicile est bien surfaite, par contre, on ne rend pas justice à la Calabre. Les villes, les monuments, les œuvres d’art, les restes du passé, il est vrai, n’y sont pas remarquables, mais au rebours de ce qu’on attendait, — car je ne sais pourquoi, on se peint volontiers une Calabre aride, pierreuse, broussailleuse et désolée, — la nature y est d’une splendeur incomparable. Nulle part, soit en Italie, soit en Espagne ou dans le midi de la France, je n’ai vu plus beaux oliviers que ceux qui forment d’immenses vergers et bordent les routes, par miracle excellentes, à quelques kilomètres au delà de San Giovanni, jusqu’aux approches de Nicastro ; et rien au monde n’a un style plus pur, plus classique, plus monumental qu’un bois d’oliviers, non plus formé d’arbres-martyrs, rabougris, suppliciés, décharnés, comme ceux que nous avons accoutumé de voir, mais plantureux, élancés, bienheureux, aux troncs énormes et lisses, comme en auraient des hêtres millénaires, et au feuillage tendre et sain comme celui des saules au bord d’une eau courante. Ce ne sont partout qu’orangers, citronniers, haies de roses ; puis à mesure qu’on s’élève dans le pays, qu’on s’éloigne de la côte pour gagner la montagne, de profondes forêts de noyers et de châtaigniers, coupées de sources ruisselantes ; et, comme le disait déjà P.-L. Courrier, qui parcourut ces régions en 1806, et manqua plus d’une fois d’y perdre la vie, « en voyant ces rochers, partout couronnés de myrte et d’aloès, et ces palmiers dans les vallées, vous vous croyez au bord du Gange ou sur le Nil, hors qu’il n’y a ni pyramides ni éléphants ».
Aujourd’hui, il n’y a plus de brigands sur les routes. Ils sont tous dans les petites villes où ils ont pris patente et se sont spécialisés dans l’industrie hôtelière. La campagne, peu habitée, est paisible et heureuse ; et ce n’est partout que tableaux primitifs et champêtres : femmes à la fontaine, l’amphore sur la tête ou l’épaule, pâtres sous un chêne fendu ou sous un olivier géant, enfants nus chargés d’oranges ou de citrons, tels qu’on en voit encore sur les belles images dont on illustrait autrefois les grandes éditions de Virgile.
Nous arrivons le soir à Nicastro où précisément, il y a plus d’un siècle, des bandits tuèrent, à coups de fusil, trois hommes de l’escorte de P.-L. Courrier ; car nous voici au cœur de la Calabre montagneuse, « Calabria Ferox ». Notre arrivée, un samedi soir, soir de flânerie générale, excite une curiosité encore plus avide, provoque des attroupements encore plus compacts qu’en Sicile. Pour échapper aux étreintes d’une foule expansive et criarde, dont le fumet est un peu fort, nous nous réfugions dans l’hôtel, le seul de l’endroit, qui est tout ensemble abattoir, boucherie, café, tonnellerie, forge, et que sais-je encore. Bien que les chambres qu’on nous offre soient assez vastes, elles se révèlent naturellement sordides et délabrées, et s’ornent, en guise de toilette, d’une caisse d’emballage renversée, sur laquelle repose une cuvette grande comme une soucoupe. En prenant langue avec le patron, un jeune homme à la tignasse en auréole, nous ne tardons pas à constater qu’il est aux trois quarts fou et ne garde quelque suite dans les idées que lorsqu’il s’agit de célébrer le luxe de ses galetas et d’en tirer le prix qu’exigerait l’administration d’un Palace pour un appartement avec « tout le confort moderne ». Enfin, nous tombons à peu près d’accord, nous descendons à la salle à manger, qui est en même temps une boutique d’épicerie et une cordonnerie, et nous commençons de savourer les fatales spaghetti, en attendant la tranche de veau bouilli, quand notre homme s’attable avec nous et, jusqu’à la fin du repas, malgré notre accueil polaire, nos apartés significatifs et nos « bastas » énergiques, nous étourdit de son verbiage calabrais auquel nous n’entendons goutte.
Je monte me coucher ; à peine allais-je oublier, dans la première somnolence, les horreurs de mon gîte, qu’il frappe à ma porte pour me demander à quelle heure, le lendemain matin, il conviendra de me réveiller. Je hurle n’importe quoi, afin d’avoir la paix, je me rendors, il refrappe et me force à me lever pour m’indiquer certain endroit qu’il appelle pompeusement « Ritirata ». Contenant avec peine une colère qui bouillonne, je lui déclare qu’il n’était nullement nécessaire de me signaler l’endroit en question, attendu qu’il proclame hautement son existence à l’aide des émanations qu’il envoie par toute la maison. Troisième rentrée dans le sommeil, puis troisième appel à la porte, afin de me faire remplir les bulletins de la police qui, en Italie, sont encore plus méticuleux et plus stupides qu’en tout autre lieu. A ce dernier coup, une fureur totale m’envahit, je saisis mon hôte par le col, et d’une poussée dont je ne calcule pas la violence, je l’envoie, semant ses bulletins, la tête la première, dans sa « Ritirata », dont l’entrée se trouve tout juste en face de la chambre ; puis je verrouille l’huis sur un grand bruit de catastrophe, après quoi, la conscience tranquille, je jouis enfin d’un sommeil que seuls quelques moustiques osent encore troubler.
Le lendemain, c’est dimanche et jour de marché. De ma fenêtre, j’ai vue sur la rue principale et la grand’place où se pressent, avec leurs ânes, leurs bœufs, leurs chèvres, leurs agneaux et leurs petits cochons noirs, les paysans des alentours. La région qui s’étend de Catanzano à Nicastro est à peu près la seule, en Italie, où se soient conservés les costumes d’autrefois. Les hommes, il est vrai, ne portent plus le chapeau pointu, l’escopette ou le tromblon du brigand calabrais ; mais les plus vieux ont encore le bas de leur pantalon loqueteux, ficelé en losanges. Quant aux femmes, avec leur corselet de velours lâchement lacé sur la chemise blanche, leur jupon rouge-géranium, à volants noirs, sur lequel s’échancre une robe généralement mauve qui se relève sur les côtés pour former une sorte de vertugadin, leurs pieds toujours nus, leur sombre chevelure coiffée d’une amphore, d’une corbeille de citrons ou d’un paquet d’herbes, n’étaient l’âcre poussière et les mauvaises odeurs qui s’élèvent de la route, elles auraient l’air de figurantes d’opéra-comique ou de modèles de Léopold Robert. Tout cela jacasse plus qu’il ne grouille autour de poteries, de fruits, de cotonnades ; de lentes affaires se concluent après d’interminables marchandages. A mes pieds, au seuil de la boucherie-charcuterie-remise-abattoir-étable qui forme le rez-de-chaussée de l’hôtel, j’assiste ainsi à l’un des humbles drames qui se répètent à tous les coins de la place. Un vieux paysan, monté sur son vieil âne, s’approche de la porte et présente au boucher un agneau dont les quatre pattes sont réunies par un bout de ficelle. Le boucher soupèse dédaigneusement la petite bête et en offre un prix qui excite chez le vieux paysan une indignation stupéfaite. Il reprend l’agneau, fait mine de s’en aller. Le boucher le rappelle, ajoute probablement une ou deux lires à l’offre ; l’autre revient, l’air menaçant, comme s’il ne s’agissait plus de palabrer mais d’étrangler un ennemi mortel. Le boucher, à son tour indigné, rentre dans sa boutique, au seuil ténébreux de laquelle le paysan invective, attestant les dieux et les hommes qu’au prix qu’on ose lui proposer, il aime mieux jeter l’agneau sur le sol et le donner pour rien. Il fait comme il dit, remonte en selle et passe son indignation sur son âne qui s’éloigne dans une héroïque pétarade. Abandonné de tous, l’agneau gît sur le flanc, dans la poussière, et pleure comme un enfant. Peut-être voit-il aux crocs du mur, les cadavres de ses frères écorchés qui se balancent en l’attendant. Il tente quelques soubresauts impuissants ; puis, tout à coup, du plus profond de sa détresse, aperçoit, tombée d’une charrette, une touffe d’herbe pareille à l’herbe de sa montagne. Une stupeur heureuse coupe net ses sanglots. Ses lèvres parviennent à happer les brins verts ; il les attire, les grignote, les déguste lentement, avec de petits hochements de tête approbatifs et satisfaits ; les maux sont oubliés, le bonheur renaît sur la terre et de gras pâturages recouvrent la poussière…
Hélas ! comme un dieu nonchalant qui regarde de trop haut et a d’autres soucis, je sais que le drame tire à sa fin et je vois s’égoutter les dernières minutes d’une innocente vie. En effet, le destin hâte le pas. Le boucher reparaît sur le seuil et le paysan au coin de la ruelle. Ils se rapprochent, n’échangent que deux mots, quelques billets crasseux passent de l’un à l’autre, la conjonction des volontés fatales s’accomplit et l’ombre de la mort descend sur la victime. Elle ne pousse plus un cri, un peu de sang rougit une cuvette, le temps pour moi de détourner la tête ; et ce qui ce matin folâtrait dans la rosée, pend maintenant aux crocs de l’ignoble et puante masure.
De Nicastro à Castrovillari, par Cosenza, la route d’abord montagneuse, déserte et boisée, emprunte ensuite la profonde vallée du Crati. Elle devient du reste fort mauvaise. Dans la montagne, durant des kilomètres, nous ne rencontrons âme qui vive, hors un homme armé d’un fusil de chasse et suivi de son chien. Le chien se jette sous l’auto, et malgré les efforts du conducteur, se fait écraser. L’homme, furieux, brandit son arme, nous couche en joue, mais ne tire pas.
Après avoir tenté de déjeuner à Rogliano, où nous reculons devant l’horreur de la Trattoria, tapie au fond d’une ruelle qui ressemble à un égout, nous gagnons une petite ville plus importante dont je veux oublier le nom. A l’octroi, nous nous enquérons de la meilleure auberge ou du meilleur restaurant. A l’unanimité, avec des gestes de ravissement et des claquements de langue, les gabelous nous en indiquent un où nous trouverons, paraît-il, le déjeuner le plus succulent que nous puissions espérer à dix lieues à la ronde. Nous découvrons enfin ce lieu de délices qui se cache sous une voûte sombre. J’y pénètre en fourrier et n’y rencontre qu’un essaim de mouches. Je pousse une première, puis une deuxième porte qui s’ouvrent sur des couloirs de plus en plus malodorants et de plus en plus ténébreux ; enfin, devant la troisième, qui paraît être celle de la cuisine, car un grand feu rougeoie dans l’ombre, j’entrevois un gros homme accroupi qui se dresse avec calme sur ses courtes pattes, répare sans se hâter le désordre de sa toilette, et me demande tranquillement ce que je désire pour mon déjeuner. Je me retire en balbutiant, je rapporte euphémiquement l’aventure et nous décidons d’acheter n’importe quoi pour déjeuner n’importe où, en plein air, dans la montagne.
Nous couchons à Castrovillari, ville d’une dizaine de mille habitants, dont l’hôtel assez misérable est à peu près propre ; il n’y a rien à voir à Castrovillari, que la vie monotone et désœuvrée des petites cités de l’Italie méridionale. Avant de la quitter, comme il est trop tard pour qu’on puisse arriver à Salerne dans la soirée, nous demandons à notre hôte en quel gîte il nous conseille de passer la nuit. Il nous engage vivement à nous arrêter à la Sala Consilina, sous-préfecture, dans la Basilicate, où nous trouverons un hôtel excellent. Nous nous mettons en route par des chemins si déplorables que dans les côtes, nous sommes plus d’une fois obligés de mettre pied à terre, afin d’alléger la voiture dont les roues patinent dans la pierraille. Arrivés vers le soir à Sala, l’hôtel recommandé est tellement affligeant, que nous aimons mieux chercher fortune un peu plus loin, à Polla. A Polla, c’est pire : le bourg est situé au milieu de marécages qui sentent la malaria, et les chambres qu’on nous offre sont frangées de toiles d’araignées si noires et si vénérables qu’aucune lassitude ne saurait appeler le bienfaisant sommeil sous de semblables baldaquins. Malgré la fatigue de notre ami qui tient le volant et voudrait se reposer n’importe où, en le trompant sur le nombre de kilomètres à parcourir, nous le décidons à pousser jusqu’à Eboli, ville assez importante où l’on peut espérer un hôtel convenable.
Durant ces recherches et ces tâtonnements, la nuit est tout à fait tombée. On ne rencontre plus personne sur les routes pour s’enquérir de « la strada », nous nous égarons plus d’une fois et vers onze heures et demie, sur notre dernière chambre à air, nous pénétrons enfin dans l’Eboli tant attendu. Eboli est presque totalement endormi ; néanmoins, un bon bourgeois qui prend le frais sur le balcon de sa maison, nous indique le meilleur hôtel. Cet hôtel occupe le troisième étage d’une grande bâtisse délabrée. Il a pour tout domestique une pauvre vieille aux reins cassés. Pour parvenir aux chambres à coucher, on passe par la cuisine au milieu de laquelle, selon l’usage du pays, se trouve la « Ritirata ». Les lits sont formés de vieilles caisses démantibulées, au fond desquelles gît une paillasse graisseuse. Un jeune homme qui se dit le patron nous demande trente lires pour chacun des taudis à deux caisses qu’il nous offre d’un air satisfait. Nous ne réagissons plus. Il n’y a dans la maison ni vin, ni pain, ni quoi que ce soit de comestible. Heureusement, il nous reste quelques bribes du pique-nique que nous avons fait, à l’heure du déjeuner, dans la montagne. Je propose, la nuit étant tiède et claire, d’aller coucher à la belle étoile dans un bosquet d’oliviers que j’avais remarqué aux portes de la ville. Mais notre ami a le préjugé du toit ; et nous nous résignons à partager son sort dans la maison sinistre.
Le lendemain matin, comme nous nous disposons à la quitter sans regrets, nous trouvons dans l’escalier un long escogriffe sec, noir, borgne et velu qui se présente comme le seul et véritable patron de l’hôtel. Nous lui remettons les soixante lires convenues. Il en réclame quatre-vingts et prétend nous empêcher de sortir nos bagages. Nous le bousculons assez vivement ; il n’insiste pas et se contente de demander piteusement une petite « mancia » pour la vieille. Nous appelons celle-ci pour la lui remettre en mains propres ; et nous voici en route pour Paestum, que nous voulons visiter en faisant un crochet, avant de nous rendre à Naples par Salerne.
Les trois temples fameux de Paestum, quand on a vu ceux de Sicile, ne sont plus extrêmement impressionnants. Ils ont l’air de compléter l’exposition de Girgenti. Mais la plaine plate, sablonneuse et marécageuse, stérile, déserte, inhabitée, inhabitable, empoisonnée de malaria, la lande désolée où ne peuvent plus vivre que des buffles dont les mufles et les dos noirs émergent de l’eau des mares, le paysage de fin de terre et de malédiction où sont relégués et rangés côte à côte les trois sanctuaires, est vraiment un des plus tragiques, et malgré le soleil qui l’inonde, des plus lugubres qu’on puisse voir.
Arrivés à Naples, nous abandonnons assez lâchement notre ami et son auto ; et rassasiés de route, de poussière et de crasse, nous prenons passage sur « Le Lotus », des Messageries Maritimes, qui, venant de Beyrouth, doit nous débarquer le surlendemain à Marseille. Ce sont les dernières et, il faut bien le dire, les meilleures heures du voyage. A bord du bon bateau bien tenu, silencieux et calme, comme après un désagréable exil, nous retrouvons enfin l’air et les habitudes de la patrie, l’ordre, la propreté, la discipline, l’obligeance sans obséquiosité, la gentillesse et les mille petites choses qu’on n’aperçoit et qu’on ne goûte qu’après en avoir été privé. On est tout étonné de se voir soudain parmi de braves gens tranquilles qui ne tendent plus la main, qui ne vous harcèlent pas d’offres agaçantes et de récriminations incessantes, à qui l’on peut adresser la parole sans qu’ils vous réclament un pourboire, ou veuillent à toute force vous vendre un peigne d’écaille en celluloïd, un collier de corail synthétique ou des photographies obscènes.
Mais qu’on ne s’y méprenne point. Il ne s’agit pas du tout, dans ces petites notes, de dénigrer plus ou moins malicieusement notre sainte mère l’Italie ; car elle est un peu notre mère à tous. Nul plus que moi ne l’aime et ne l’admire, et je me souviendrai toujours de l’accueil touchant, généreux et fraternel qu’elle voulut bien me faire lorsqu’en 1914 et en 1915, je vins lui parler des malheurs de la Belgique. Mais n’est-ce pas lui prouver qu’on l’aime véritablement que de lui dire certaines vérités utiles et de ne pas lui cacher puérilement de petites fautes qui gâtent un peu une hospitalité qui serait si facilement délicieuse ? Jusqu’à Naples, le voyage est agréable et le confort presque parfait ; seul le prix de la vie, le « décalage », qui s’imposait à la suite de la hausse de la lire, ne s’étant pas encore fait sentir, est manifestement exagéré. A partir de Naples, et surtout en Sicile, on rencontre les inconvénients que je viens de signaler. Mais, pour ce qui concerne les auberges et les hôtels, n’oublions pas qu’il y a trente ans à peine, ceux de beaucoup de nos petites villes de province, sans aller jusqu’au dénuement, au délabrement et à la malpropreté des logis de la Calabre et de la Sicile, n’étaient pas bien séduisants. Ce que notre Touring-Club a pu faire, il n’y a aucune raison pour que le Touring-Club italien, également actif, ne le fasse pas. Et quand les hôtels seront meilleurs, afin de retenir plus longtemps le touriste dans l’île enchantée, il suffira d’apprendre peu à peu au Sicilien, qui n’est au fond ni malhonnête ni méchant, que tout voyageur n’est pas inévitablement un milliardaire imbécile uniquement sorti des mains de Dieu pour être indéfiniment exploité, rançonné, surtaxé, et, du matin au soir, faire pleuvoir à pleines mains, sur tout ce qui l’approche, les pourboires extravagants et ininterrompus.
ACHEVÉ D’IMPRIMER
LE 30 SEPTEMBRE 1927
POUR
LES ÉDITIONS KRA
6, RUE BLANCHE, A PARIS
SUR LES PRESSES
DE
R. ET P. DESLIS A TOURS