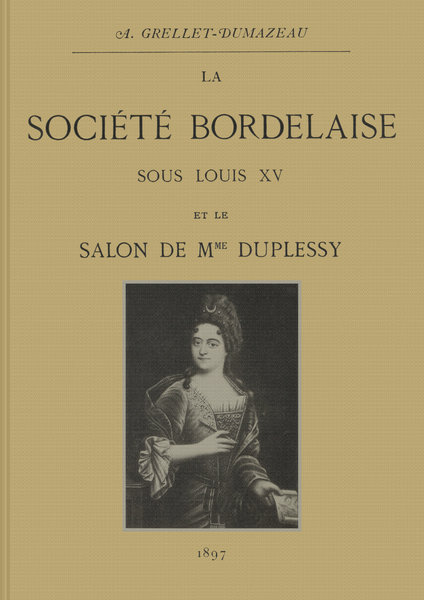
L’image de couverture a été réalisée pour cette édition
électronique.
Elle appartient au domaine public.
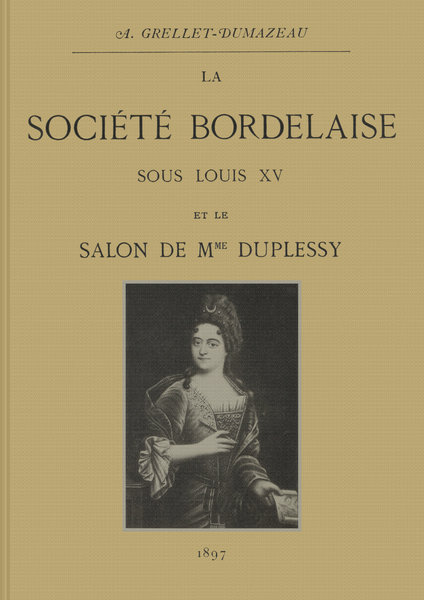
L’image de couverture a été réalisée pour cette édition
électronique.
Elle appartient au domaine public.
LA
SOCIÉTÉ BORDELAISE
SOUS LOUIS XV
Bordeaux.—Imp. G. Gounouilhou, rue Guiraude, 11.
A. GRELLET-DUMAZEAU
Portrait et Index
| BORDEAUX | PARIS |
| FERET ET FILS, ÉDITEURS | LIBRAIRES ASSOCIÉS, ÉDITEURS |
| 15, cours de l’Intendance | Rue de Buci, 13 |
1897

Dans une scène des Précieuses, la fille du seigneur Gorgibus exalte, en un jargon inoubliable, la supériorité de Paris sur la province: Paris, le bureau des merveilles, le refuge des manières galantes, l’académie du vrai mérite, le temple du bel esprit... Sur quoi, chiffonnant la dentelle de ses canons, le marquis de Mascarille laisse tomber cette parole qui a l’allure tranchante d’un arrêt: Hors de Paris, point de salut pour les honnêtes gens!
Cette sentence paraît excessive. On a peine à croire, avec Cathos et Madelon, que la culture intellectuelle, l’art de la conversation et le respect des bienséances furent, en un temps quelconque, l’apanage d’une coterie ou d’une ville, et que les pays d’outre-Seine—qui virent naître Montaigne, Pascal et Montesquieu—méritent d’être tenus pour chose négligeable.
Sans doute, dans l’œuvre de restitution à outrance [p. 6] que ce siècle expirant prend plaisir à édifier, Paris, dédaigneux et exclusif, s’est taillé la part du lion. Les monographies abondent sur les salons, ruelles, boudoirs, coulisses, cabarets, officines de tous genres qui, de Mme de Montespan à la Dubarry, donnèrent le ton à la capitale, régentèrent la mode et façonnèrent l’opinion. Chaque réunion éclose dans le rayon de Notre-Dame a trouvé ses historiens, chaque souper ses chroniqueurs, chaque mauvais lieu ses thuriféraires. Des équipes de chercheurs, poussant l’amour du document jusqu’aux limites extrêmes, ont su, à travers des nuages de poussière, exhumer la série des grandes dames et des bourgeoises, des courtisans et des laquais, des premiers rôles du théâtre et de la finance, des extravagants, des gens d’esprit et des sots, qui—ne fût-ce qu’une heure—éveillèrent la curiosité.
En dépit du dédain professé à son égard, la province ne s’est point émue. Moins tapageuse, mais aussi active, elle a, de son côté, bouleversé bibliothèques et rayons, démontrant, par de décisives publications, qu’en notre terre de France, après comme avant l’hôtel de Rambouillet, la politesse, le goût, le savoir-vivre constituèrent—avec la bravoure et la gaieté—un patrimoine commun, et que fût-on, à l’aide d’artifices, parvenu à emprisonner ces qualités nationales dans l’enceinte de Philippe-Auguste, elles eussent vite forcé bastilles et murailles pour s’épandre en liberté aux quatre vents du royaume.
Dans cette résurrection d’un passé qui appartient à [p. 7] tous, Bordeaux mérite une mention spéciale. Des initiatives individuelles, opérant sous l’égide de sociétés savantes, affirment chaque jour les gloires de la Guyenne, font revivre ses morts illustres, reconstituent ses monuments détruits, ses usages oubliés, ses institutions disparues. Les temps anciens, l’époque de la domination anglaise, le XVIe siècle, ont subi la main-mise de fureteurs sagaces. Le XVIIe et le XVIIIe, sans doute parce qu’ils sont plus près de nous, ont été moins explorés...
Et pourtant, quelles périodes attachantes! Du mouvement littéraire, politique et social qui en marqua le cours, Bordeaux n’eut garde de se désintéresser. Nulle part la vie ne fut plus intense, le choc des passions plus dramatique, le labeur plus fécond. Oh! le généreux pays. Ajoutons: l’aimable pays. Sur ce sol privilégié, le mérite coudoie l’élégance, la science fait bon ménage avec l’esprit gaulois, et les vers qu’on y improvise ne déparent point les recueils qui commencent à circuler.
Toutes proportions gardées, Bordeaux n’a rien à envier à Paris. Comme Paris, il eut ses ruelles galantes, ses cabarets où l’on soupait «à tant par teste», ses salons, ses friands de la lame, ses abbés, ses amazones. Les gens d’esprit surtout y abondèrent. Comment s’en étonner? La Gascogne, «cet arrière-coin de la France» dont Étienne Pasquier admirait les plumes vaillantes, n’est-elle point par excellence le pays du langage prime-sautier et pittoresque? Combien, si l’on prenait la peine de chercher, n’y trouverait-on pas de personnages supportant la comparaison avec [p. 8] les beaux diseurs de la place Royale! A ceux-ci on opposerait sans désavantage le premier président de Pontac, neveu de l’évêque de Bazas, un lettré délicat;—Louis Machon, l’auteur de l’Apologie de Machiavel[1];—l’avocat Martin Despois, dont un érudit de marque a révélé l’existence encore enveloppée de mystère[2];—Thibaud de Lavie, le tribun-diplomate;—le vieil avocat général Dusault, à la fois orateur, poète et soldat;—toute la pléiade des polémistes et des capitaines d’aventures dont l’épée et les satires firent merveilles contre le Mazarin;—Élie de Bétoulaud, un original non dépourvu de talent;—le président de Salomon-Virelade, le plus éclairé des critiques, dont la maison, organisée en académie, servit de rendez-vous littéraire à toute une génération[3]...
Les femmes n’occupent pas une place moins distinguée... Que de jolies bouches—depuis Mme de Lestonnac, sœur de Michel de Montaigne—lancèrent le trait, sur les bords de la Garonne, avec une verve qu’envieraient les rives de la Seine! Que de physionomies originales, de nature à retenir l’attention au même titre que Mme Cornuel, Angélique Paulet et la présidente Tambonneau! Citons-en quelques-unes:—Mlle Dupin, dont la causticité, devenue proverbiale, piqua au vif deux [p. 9] voyageurs célèbres, Chapelle et Bachaumont[4];—la première présidente de Pontac, qui tenait au monde savant par les deux Dupuy; à la cour par Mlle de Montpensier, sa cousine; à Port-Royal par les Arnauld, ses alliés; aux faiseurs de concetti par M. de Segrais, qui lui dédia sa Relation de l’Isle imaginaire;—Mmes Duval, de Gascq, de Volusan, d’Aulède, d’Espagnet,... tout un escadron de précieuses évoluant suivant les règles du bon ton, initiées à la gamme des soupirs, et, comme les caudataires de Julie d’Angennes, «poussant le doux, le tendre, le passionné»[5]...
La période du XVIIIe siècle ne comprend pas moins de personnalités marquantes. Le milieu où elles se meuvent n’a rien perdu de son originalité, bien que l’effort des esprits tende à un autre but. La femme, désormais, cherche autant à s’instruire qu’à plaire. L’homme, sous une apparente frivolité, s’est formé une idée plus haute du devoir. L’inconnu l’attire; les sciences exactes, jadis dédaignées, ne le laissent plus indifférent. Tandis que jansénistes et disciples de Molina se disputent la direction des âmes, l’économie politique jette ses premières racines, embrassant les spéculations financières, commerciales, agricoles, les rapports des contribuables avec le fisc, les réformes [p. 10] nécessaires au soulagement du peuple. Partout s’organisent des collections. L’Académie bordelaise, qui vient de se fonder, accroît sans cesse le nombre de ses prosélytes. Les travaux qu’on lui adresse se multiplient chaque année: astronomie, médecine, météorologie, physique, histoire naturelle, on remue tout... C’est l’heure où Montesquieu étudie les contractions péristaltiques des batraciens, la circulation du suc, l’origine du gui, la transparence des corps, la cause des échos...
Dans l’ordre littéraire, le mouvement n’est pas moins accentué. L’art si éminemment français de la conversation brille d’un éclat sans précédent. On cause, on disserte, on argumente à chaque tournant de rue, à la Bourse, au théâtre, au palais de l’Ombrière—rendez-vous quotidien des fines langues et des nouvellistes. C’est, dans tous les lieux fréquentés par le public, un chassé-croisé de saillies, d’anecdotes, d’épigrammes, de critiques assaisonnées de sel gascon. Partout, enfin, s’engagent des discussions passionnées sur la puissance nouvelle avec qui trônes et rois devront bientôt compter: l’esprit philosophique. Oh! le jeune dieu en est encore à ses premiers pas. Sa marche est incertaine, indécise sa parole, lointain et voilé le but qu’il poursuit. Quoique d’apparence débile, il n’en respire pas moins à pleins poumons, joyeux de vivre, prenant le vent et guettant l’avenir, honoré dans les meilleures compagnies, bienvenu des boudoirs comme des cabinets d’étude, caressé par des princes, choyé par des duchesses et bercé sur de nobles genoux.
[p. 11] La partie de nos annales qui correspond à cette époque—le règne de Louis XV—attend encore un historien jaloux de s’inspirer aux sources. A cette œuvre de demain, dont il est permis de prédire le succès, nous apportons, en manière de tribut, quelques notes sur la Société bordelaise et le Salon de Mme Duplessy... Superficielle comme la plupart des publications de ce genre, dépourvue d’ailleurs de prétention, cette étude n’a pas l’ambition de tout dire. A creuser les sujets multiples qu’elle effleure, il faudrait, avec des travaux de longue haleine, un contingent de plusieurs volumes. La tâche accomplie par nous est plus modeste. Des figures rencontrées au cours de nos investigations, nous offrons, non des portraits, mais des ébauches. De même, des faits qui servent à expliquer ces figures, nous rappelons sommairement les grandes lignes. Faits et figures nous ont semblé intéressants: puissent des érudits en possession de loisirs plus complets les produire en pleine lumière!
Un reproche nous sera peut-être adressé: celui d’attribuer à la note intime une part prépondérante... Nous confessons n’avoir qu’un goût restreint pour les généralités de commande, les éloges d’apparat, les discours officiels, les articles nécrologiques. Un écrivain moderne, dans une préface bien connue, déclare que la peinture vraie des mœurs et des caractères, assortie d’un choix d’anecdotes, constitue la partie attachante de l’histoire. Il ajoute qu’il donnerait volontiers Thucydide pour des mémoires authentiques [p. 12] d’Aspasie ou d’un esclave de Périclès[6]. Sur nous aussi, le document privé exerce une attraction particulière: nous n’hésitons pas à croire qu’un Journal de Mme Duplessy—dont on ne possède malheureusement qu’un paquet de lettres—en apprendrait autrement long sur la société bordelaise, ses tendances, son esprit, ses individualités marquantes, que le monceau de pièces de tous formats emmagasinées dans nos dépôts publics.
Nous ne saurions clore ces lignes sans adresser l’expression de notre gratitude à l’éminent conservateur de la Bibliothèque municipale, M. Raymond Céleste. C’est son érudition aussi sûre que judicieuse, aussi désintéressée que bienveillante, qui nous a guidé dans nos investigations. Nul ne possède mieux que lui les arcanes du vieux Bordeaux: bon nombre de manuscrits ayant trait à cette région n’occupent une place dans nos archives que grâce à son activité enthousiaste de fureteur. Il estime, en effet, au rebours du seigneur de Montaigne, que des choses de peu il y a moyen de faire des histoires... Si, par aventure, ce livre obtenait quelque estime, c’est beaucoup à M. Céleste qu’il en faudrait reporter l’honneur.
Nous avons aussi une dette à acquitter vis-à-vis de M. Dast de Boisville, dont les précieuses découvertes [p. 13] ont, de longue date, retenu l’attention du monde savant. Ce chercheur infatigable, qui dressa la nomenclature jusque-là inconnue des officiers du Parlement, n’a point dédaigné de soumettre à un contrôle minutieux l’orthographe des noms propres contenus dans ce volume: œuvre ardue et délicate dont l’importance n’échappera à aucun de ceux qui, dans la restitution du passé, apportent le souci de l’exactitude... Nous prions M. de Boisville de recevoir le témoignage de notre reconnaissance—avec nos excuses pour les erreurs peu graves, nous en avons l’espoir, qui pourraient se produire au cours de l’impression.
G.-D.

LA
SOCIÉTÉ BORDELAISE
SOUS LOUIS XV
M. de Chazot et la famille Duplessy.—Mariage de Mlle de Chazot: débuts de son salon.—L’hôtel du Jardin-Public: ses collections, sa bibliothèque.—Réception de Mme Duplessy à l’Académie des Arcades.—Élisabeth Duplessy.—Dom Galéas, l’ami Patience.—État des esprits.

Dans une lettre intime du 3 septembre 1742, Montesquieu écrit au président Barbot: «Mandez-moi à l’oreille si je pourrois vous envoyer un Temple de Gnide, bien relié en maroquin vert, pour en faire un hommage à Mme Duplessy...» Le châtelain de La Brède venait de publier une édition nouvelle—corrigée et augmentée—de son œuvre badine, une édition de luxe avec sept vignettes gravées par Watelet et Cochin. La personne à laquelle [p. 16] il destinait l’exemplaire annoncé était une jeune veuve comme se plut, avec un art exquis, à en former le XVIIIe siècle: aimable, pleine de charme, agréablement teintée de belles-lettres, d’une érudition peu commune et tenant bureau d’esprit... Elle s’appelait Jeanne-Marie-Françoise de Chazot.
Son père, Claude de Chazot, sieur d’Albuzy, se parait volontiers du titre de gentilhomme de la vénerie du roi. Mais sa principale, son unique occupation, était celle de receveur général des fermes—emploi dans lequel l’avait précédé le fastueux Montauron que le grand Corneille, dans une heure d’oubli, eut la faiblesse de comparer à l’empereur Auguste[7].
M. de Chazot ne chercha point à jouer les Mécènes. Sa fortune s’élevait à cent mille écus: une misère! En revanche, la médiocrité dans laquelle il eut la sagesse de se maintenir le marqua d’une note aussi rare que flatteuse: il eut l’honneur de ne pas figurer parmi le millier de traitants qui, à l’avènement de Louis XV, placés entre la vie et la bourse[8], furent tenus [p. 17] de rendre gorge. Arrivé au terme de sa carrière, il put, en toute sécurité de conscience, goûter le calme de la retraite au fond de sa terre de Puypéroux-Boisredon, située aux confins de la Saintonge.
Avant de faire ses adieux au monde, il prit le soin de marier sa fille à un officier de robe, messire Claude Duplessy, d’une famille originaire de Lorraine[9]. L’aïeul, Pierre Duplessy, était venu à Blaye, appelé par un frère de sa mère, le capitaine Michel, qui y commandait, sous les ordres du premier duc de Saint-Simon, un bâtiment attaché au port de cette place. Nommé [p. 18] architecte-ingénieur du roi au département de Guyenne, Pierre Duplessy ne tarda pas à attirer l’attention. Héritier de son oncle, dont il joignit le nom au sien, il se fixa à Bordeaux, y acquit droit de cité, et mourut durant la construction de la chapelle des Dominicains—aujourd’hui Notre-Dame—qu’on édifia sur ses plans.
L’existence laborieuse qu’il mena lui ayant permis d’accroître sa fortune, son fils acheta une charge de conseiller au Parlement—le rêve de tout bourgeois pourvu de rentes[10]. Ces offices, en effet, conféraient la noblesse et donnaient accès dans le meilleur monde. La haute juridiction—à la fois judiciaire, politique, financière et administrative—à laquelle ils ressortissaient, prenait une part active à la marche des affaires publiques: d’attachantes occupations pour les hommes voués à l’étude du droit, de la jurisprudence, des réformes législatives et des intérêts sociaux...
A Toulouse, à Rouen, à Paris, l’emploi était enviable. A Bordeaux où, depuis longtemps, la noblesse d’épée n’existait guère qu’à l’état de souvenir, il jouissait d’un relief exceptionnel. D’autant mieux que, par leur train de vie, les officiers [p. 19] de justice s’ingéniaient à rehausser encore la dignité dont ils étaient revêtus. La maison d’un président comprenait une nuée de clients et de serviteurs[11]. Les conseillers, quoique d’allures plus modestes, entretenaient aussi un domestique nombreux—sans compter le carrosse traditionnel qui, au dire des chroniques, révélait les hôtes du palais de l’Ombrière au même titre que la robe rouge et le bonnet carré[12].
Au XVIIIe siècle, tout parlementaire était doublé, sinon d’un lettré et d’un savant, au moins d’un curieux et d’un chercheur. Pierre Duplessy fut, à la fois, un chercheur, un savant et un lettré. L’admirable bibliothèque du premier président de Pontac ayant été mise en vente, il s’empressa de l’acquérir. Non seulement il la garda intacte; mais, procédant avec un soin religieux, il l’augmenta des meilleurs livres publiés sous le règne de Louis XIV[13].
Les fils de cet érudit, qui parlait couramment [p. 20] plusieurs langues, devaient, comme leur père, porter la robe. Tous deux furent pourvus d’offices de conseiller. Le cadet, qu’on nommait M. de Pauferrat, jurisconsulte de mérite en même temps que rimeur disert, prenait volontiers la parole aux assemblées des chambres[14]. L’aîné, Claude—l’heureux époux de Mlle de Chazot—passionné pour les recherches historiques, les spéculations de la science, les manifestations de l’art sous ses formes diverses, était appelé à briller d’un vif éclat. Une maladie lente l’emporta, en 1736, à la fleur de l’âge... Déjà, sa demeure servait de rendez-vous aux gens distingués de la province que son urbanité et les grâces de sa jeune femme savaient attirer et retenir.
Devenue veuve, Mme Duplessy n’eut garde de négliger l’œuvre commencée sous ces heureux auspices. Sa maîtrise, au contraire, s’affirma avec une autorité croissante; bientôt, il ne s’établit plus de renommée littéraire qui ne portât l’estampille de son salon, et Montesquieu lui-même accepta l’honneur de figurer au nombre de ses amis.
[p. 21] Le portrait annexé à ce volume date de cette époque[15]. A coup sûr, il n’est point vulgaire. La virtuose dont il reproduit l’image ne pouvait, nulle part, passer inaperçue: elle s’imposait à tous les yeux par la noblesse de sa démarche, l’élégance de ses manières, la distinction de sa physionomie. Un Bordelais qui plaida contre elle—dès lors non suspect de flatterie—assure qu’elle réunissait tout pour plaire... A ces avantages physiques, il faut joindre un esprit cultivé, sagace, d’une profonde sûreté de jugement et de goût. L’affectation lui est odieuse, et l’on est sûr de ne trouver chez elle ni précieuses ni raffinés... Mme Duplessy résume, dans un harmonieux ensemble, les qualités sérieuses du grand siècle et les grâces moins sévères du siècle nouveau—sans ce dualisme choquant observé chez la marquise de Lambert, laquelle, «dogmatisant le matin,» prêchait le soir la plus accommodante des morales[16].
Bien que ne répudiant pas cette pointe de galanterie qui constituait le fond de la politesse française, la maison était honnête. En dépit de la fantaisie du peintre, qui se plut à la représenter [p. 22] tenant à la main un amour battant de l’aile, la jeune veuve ne subit pas le joug du dieu malin. Le souci de sa dignité, une façon virile de comprendre ses devoirs, les occupations multiples qui absorbaient sa vie, la préservèrent de ces entraînements pour lesquels nos pères professaient tant d’indulgence.
Ce fut une de ces studieuses qui ne trouvent jamais de journée trop longue. A l’avidité de tout connaître, elle joignait la faculté de tout embrasser. Mais la pente de son esprit l’entraînait vers les sciences exactes. L’histoire naturelle surtout la captivait: son cabinet, le premier qu’on vit à Bordeaux, passait pour l’un des plus beaux de l’Europe... Poussons la porte du «sanctuaire», et, à la suite d’un contemporain qui veut bien nous servir de guide, visitons-en les curiosités...
Deux vastes pièces, ordonnées avec méthode, sont affectées aux collections. La première, garnie d’armoires, de tablettes, de vitrines, contient toutes les richesses de la conchyliologie[17]. La [p. 23] seconde rappelle les boutiques d’antiquaires, telles que certains romans se plaisent à les dépeindre, avec un appareil de réchauds, de cornues, d’instruments mystérieux, et toute une série d’animaux suspendus aux solives: chiens de mer, poissons volants, crocodiles, chauves-souris aux ailes déployées... Spectacle troublant pour les âmes délicates! Heureusement le regard ne tarde pas à se porter vers les parois de la muraille où apparaissent, rangés avec symétrie, les plumages multicolores des oiseaux des îles: un chatoiement de couleurs gaies allant du jaune de chrome au bleu d’azur, en passant par toutes les nuances de l’arc-en-ciel...
Du temple de l’ornithologie on accède à la bibliothèque, dont les mathématiques, la physique, l’astronomie se disputent les hauts rayons. L’histoire y occupe également une place importante. Au rebours de Mme du Châtelet qui regardait Tacite «comme une bégueule colportant les commérages de son quartier», Mme Duplessy a le [p. 24] culte des anciens. Chez elle, Tacite est traité avec autant d’égards qu’Agrippa d’Aubigné et l’honnête de Thou. L’éclectisme est, d’ailleurs, sa règle de conduite. Dans ce milieu épris de tolérance, Rome fait bon ménage avec les philosophes, et le chef-d’œuvre de Pascal avec les Maximes de saint Ignace. Droit, jurisprudence, poésie, rien n’est oublié. Quant à l’art, il est représenté par soixante in-folio d’estampes, une multitude d’eaux-fortes et des antiques de prix: cornalines gravées en creux, vermeilles, hyacinthes, jaspes, améthystes.
Nous voici à l’entrée des salons: Bordeaux n’en possède pas de plus brillants. Ce ne sont, partout, que tapisseries de haute lisse, fauteuils à larges dossiers, canapés, caquetoires, girandoles, glaces, laques et vernis..... Aux murs, des scènes de Téniers, des paysages de Berghem, des chasses de Wouvermans et quelques toiles que, de ses doigts légers, brossa la fée du logis. A droite, un pupitre chargé de musique; à gauche, un clavecin à ravalement; plus loin, un cabinet «d’Allemaigne» enrichi de cuivres dorés...
L’hôtel qui abrite ces merveilles est situé aux portes de la ville, dans un immense enclos compris entre le Jardin-Public[18]—avec lequel il [p. 25] communique au moyen d’une grille—et les rues Fondaudège et Saint-Laurent. Des plantes rares, une charmille admirable, des arbres séculaires constituent l’ornement du parc, où un réservoir, alimenté par des sources vives, entretient une exquise fraîcheur[19]. On ne trouverait pas en Guyenne un jardin plus vert; il n’en est pas non plus qui possède une plus riche variété de fleurs... Les fleurs! la passion de Mme Duplessy. Ce ne sont pas seulement les senteurs de l’œillet et l’épanouissement d’une touffe de roses qui la délectent. Elle éprouve une admiration sans bornes pour la nature: non cette petite-maîtresse pomponnée, frisée, enrubannée, que bientôt, à Trianon, on célébrera en vers alanguis, mais la mère féconde dont l’enfantement mystérieux soulève tant de problèmes. Admiration à la fois discrète et curieuse, où l’intuition poétique de Jean-Jacques s’allie aux données positives du parfait jardinier.
Des plantes aux animaux, il n’y a qu’un pas: Mme Duplessy aime toutes les bêtes. Elle les choie, les caresse et daigne les admettre à l’honneur de son intimité. Chats et chiens lui servent de cortège. Elle en parle en termes délicats où se glisse [p. 26] une note attendrie. «Vous avez bien fait, écrit-elle, de m’envoyer le nom de la petite chienne. Nous ne savions comment l’appeler et elle étoit tout étonnée. Elle est charmante. C’est la plus belle tête qu’on puisse voir... Quoiqu’elle soit encore triste, elle a un air mignard qui prévient en sa faveur. Le premier meuble qu’on lui a offert est un beau coussin garni d’étoffe de soie sur lequel elle ira se reposer lorsqu’elle sera lasse d’être caressée sur les genoux; et, comme elle laisse un peu traîner la queue, on lui donnera un laquais pour la porter.»—La marquise de Sévigné dans ses bons jours, n’eût pas trouvé de formule plus heureuse.
La femme d’esprit, l’artiste, la collectionneuse qu’était Mme Duplessy, reçut bientôt une distinction qui couronnait sa supériorité. La Société des Arcades—une académie qui, bien qu’ayant son siège à Rome, se délectait des bergeries de d’Urfé—lui faisait l’honneur de l’admettre dans ses rangs. Par décret, daté du bois sacré de Parrhase, au pays des Arcadiens, la nouvelle dignitaire était agréée en qualité de pastourelle, sous le vocable de Bérénice, et recevait, à titre d’apanage, la province d’Argolide[20].
[p. 27] Saluée, par delà les monts, du nom d’une reine déguisée en bergère, l’aimable veuve subissait, à Bordeaux, une nouvelle métamorphose. Les poètes du cru l’élevaient à la dignité de muse. Elle devint Uranie, celle des neuf déesses qui, préposée au département des sciences astronomiques, siège au sommet du Parnasse, vêtue d’azur, couronnée d’étoiles, portant, en guise de sceptre, le globe du monde.
Elle ne tardait pas, d’ailleurs, à partager sa gloire avec l’aînée de ses deux filles, Mlle Élisabeth. Celle-ci était une élégante personne, façonnée aux bonnes manières, de nature vaporeuse comme Mme d’Épinay, éprise de littérature, grande dévoreuse de livres, aimant la musique «à la folie», touchant du clavecin[21], peignant à ses heures, et ne résistant pas au désir de risquer quelques rimes... Elle aussi sera, un jour, gratifiée du diadème: on la représentera—la main droite tendue pour imposer silence—sous les traits de Polymnie, muse de la poésie lyrique.
Ces deux figures—mère et fille—semblent n’en former qu’une, tant est profonde la communauté de sentiments qui les unit... Mais voilà, attachée à leur ombre, une apparition fantastique [p. 28] qui, drapée dans les plis de la robe monacale, s’avance, majestueuse, la tête rejetée en arrière, agitant des bras d’une longueur invraisemblable, tantôt inclinés vers la terre, tantôt se dressant vers le ciel avec des attitudes inspirées... L’apparition n’est autre qu’une façon de Bénédictin répondant au nom de Dom Galéas: la grande utilité de la maison. Dom Galéas est le secrétaire, le factotum, le confident de ces dames. Il possède une cursive merveilleuse, copie avec intelligence la musique, fait le quatrième au whist et entretient un commerce suivi avec saint Médard—ce qui n’est point à dédaigner lorsque la sécheresse se fait sentir. A-t-on besoin d’une cuisinière? Nul ne s’entend comme lui à découvrir les cordons bleus... D’un aumônier? C’est son affaire... D’un ouvrage prohibé? Il a des ressources infinies. Toujours prêt à rendre service, il apparaît au moment du dîner, où sa fourchette demeure rarement inactive. Il s’emploie aux commissions, promène les étrangers, leur sert de cicerone, et circule avec une liberté qui déroute les idées actuelles: la discipline monastique ne semble pas l’atteindre... Peut-être a-t-il ses coudées franches comme placeur des vins du couvent. Son ordre, en effet, est propriétaire, dans les Graves, de vignes dont les produits sont recherchés—les [p. 29] bons religieux ne se livrant «à aucune des supercheries qu’en cette matière presque tout le monde se permet[22]...» Pour charmer ses loisirs, le Révérend élève des serins, apprivoise des angoras et dresse des barbets qu’il proclame supérieurs aux chiens du Bengale de l’infant Don Philippe[23]. Au demeurant, le meilleur compagnon du monde: on l’appelle l’ami Patience, un ami dont on abuse quelquefois, mais pour lequel, à l’occasion, on ne marchanderait ni peines ni sacrifices.
Ne croyez pas que le froc abrite en lui un de ces «moines ignares» que Voltaire s’ingénie à tourner en ridicule. Dom Galéas est pourvu de connaissances variées et parle congrûment en chaire. Sarrasin, qui occupait un emploi identique à l’hôtel de Rambouillet, avait, sans doute, plus de souplesse dans le talent. On lui disait: Sarrasin, prêchez comme un Carme!... Sarrasin, prêchez comme un Cordelier!... Sarrasin prêchait comme un Cordelier ou comme un Carme. On lui eût prescrit de prêcher comme Bourdaloue—si [p. 30] Bourdaloue eût prêché de son temps—qu’il eût prêché comme Bourdaloue[24]... Dom Galéas n’abdiquait point ainsi sa personnalité. Il restait toujours Dom Galéas et, quand il transportait l’auditoire par l’éloquence de ses périodes, personne ne se fût avisé de prétendre qu’il empruntait la langue de Bossuet ou celle de Mascaron.
Pourquoi faut-il qu’un travers—et quel travers!—accompagne tant de qualités! Le traître ne marche que les poches bourrées de sonnets, d’odes, de pièces fugitives. Malheur à l’imprudent qui se risque à lui donner audience. A l’heure néfaste où le manuscrit est exhumé des profondeurs de sa robe de bure, il se produit dans ce cœur candide d’étranges révolutions. Cet agneau a des acharnements de tigre: il assassine son monde à coups d’interminables déclamations... La Guyenne ne compte plus ses victimes.
Tels sont les hôtes; telle est la maison.—C’est sous ces frais ombrages où expirent les bruits de la ville, dans ces salons dont chacun ambitionne l’accès, au fond de cette bibliothèque ouverte à toutes les investigations, que l’Académie, au sortir de ses séances, vient chercher un délassement. [p. 31] Aux plus distingués de ses membres se joignent les autres célébrités locales, savants, artistes, femmes d’esprit: toute une phalange de personnes instruites, à la parole judicieuse et alerte, à la bonne humeur franche et communicative. Délivrées de l’oppression terrible de Louis XIV, dont les dragons, «violant, volant, tuant, incendiant,» firent, à Bordeaux, «onze cents maisons désertes»[25]; jalouses de proclamer l’autonomie littéraire de la province; en possession de cette autorité qui s’attache aux ardeurs convaincues—les langues se délient et effleurent les sujets les plus divers: réformes à l’ordre du jour, découvertes scientifiques, ouvrages en cours de publication, échos mondains, nouvelles de Versailles, jusqu’à ces riens, insaisissables et délicieux, qui défrayèrent le XVIIIe siècle.
A l’heure où commence cette étude, la Régence a achevé sa dernière folie. Le duc de Bourbon, premier ministre, vient lui-même d’abandonner son portefeuille. C’est le sage Fleury qui gouverne l’État, inaugurant une manière de trêve durant laquelle, comme le reste du royaume, la Guyenne a l’heureuse fortune de n’avoir pas d’histoire... Profitons du calme dont elle jouit [p. 32] pour lier commerce avec cette société bordelaise si peu connue et si digne de l’être, examinons les œuvres accomplies par elle, et jetons un coup d’œil rapide sur ses personnalités marquantes, en débutant par les intimes de l’hôtel Duplessy.

Les intimes de Mme Duplessy.—Jean-Jacques Bel et Le Nouveau Tarquin.—Le Père François Chabrol.—Un disciple d’Épicure: le président Barbot.—Querelle entre le Parlement et la Cour des Aides.—L’Ermite de Roaillan: M. de Lalanne.—MM. de Ségur, de Gascq, de Caupos, de Marcellus, de Navarre, de La Tresne, de Raoul...—Mme de Pontac-Belhade: ses rapports avec l’Académie.—Sœur du pot-au-feu: la duchesse d’Aiguillon.

Le premier qui se présente à nous est le conseiller Jean-Jacques Bel...
Un robin de taille exiguë, sec, fluet, aux mains grêles, à l’air vieillot. Le corps est penché en avant, le dos légèrement voûté, la tête à peine détachée des épaules. Tout, dans la figure, est affilé, sauf le menton dont la rondeur épaisse établit avec les autres traits un contraste saisissant. Que de vie, d’ailleurs, que de pénétration dans ces yeux menus d’où le regard s’élance tenace et chaud, tandis que la bouche, relevée aux commissures des lèvres, ébauche un sourire plein de finesse! Le côté dominant de cette physionomie, c’est, avec un mélange de bonté et de [p. 34] malice, le détachement de la matière: on sent que la pensée, affranchie des convoitises malsaines, s’élève sans effort aux plus nobles aspirations.
Il y a, dans ce petit homme, l’étoffe d’un organisateur. Grouper les intelligences d’élite; diriger les ardeurs non disciplinées; provoquer, au souffle fécond de l’émulation, les vocations qui sommeillent, tel est le but vers lequel ne cesse de tendre son amour du bien public. A peine sorti de l’école, il réunit ses camarades, fonde des conférences, institue un programme de travaux où chacun apporte son contingent. Pénétré de ce sentiment que tout ce qui favorise les associations scientifiques, littéraires et morales concourt à l’amélioration de l’humanité, son rêve—qu’il réalisera—est d’installer l’Académie dans son magnifique hôtel de l’Esplanade du Château-Trompette[26].
Il ne lui suffit pas de créer des œuvres ou d’assurer l’existence d’institutions anciennes. Cet esprit généreux est doublé d’un penseur et d’un écrivain: ajoutons d’un délicat, poussant jusqu’au fanatisme le culte du beau langage. Nourri des maîtres du grand siècle, son goût se révolte de l’affectation qui envahit les ouvrages nouveaux.
[p. 35] Le jargon des Précieuses, affirme-t-il, n’est rien auprès des mièvreries de la Régence. Et le malheur c’est que, des pièces de théâtre, des mercures, des journaux, la contagion s’étend aux livres de fonds et à l’éloquence judiciaire. La chaire elle-même ne tardera pas à être envahie pour peu que, dans sa clémence aveugle, le ciel épargne plus longtemps les arrière-neveux de Cathos et Madelon!...
Montesquieu assure que l’emphase fleurie est le propre des nations qui sortent de l’état barbare. Jean-Jacques Bel estimait, au contraire, qu’elle caractérise les peuples en voie de décadence... Ah! quelle vigoureuse campagne ce passionné de notre vieil idiome, si séduisant dans sa simplicité robuste, dirige contre les Scudérys passés et présents, les inventeurs de formules prétentieuses et
Les manieurs de mots l’un de l’autre étonnés,
auxquels, il assimile certains immortels convaincus de complaisances inavouables! Imprimées à Amsterdam, ses publications vengeresses eurent l’honneur d’amuser Paris; or, chacun sait qu’un auteur qui déride ses juges est bien près d’obtenir gain de cause[27].
[p. 36] Là ne se borne pas le bagage de Jean-Jacques Bel. Il faut y joindre certaine comédie qui parut, à La Haye, sous ce titre: Le Nouveau Tarquin. C’est, sous forme de parodie satirique, la mise en scène d’un drame judiciaire qui, en son temps, fit beau tapage: le procès de la Cadière et du Père Girard[28]. Sur ce sujet scabreux, le librettiste donne carrière à une fantaisie toute moderne. Lucrèce, devant un tribunal qui rappelle celui des Plaideurs, expose ses doléances sur des airs de vaudeville. Tarquin ébauche une défense émaillée de citations bouffonnes. Enfin, Brutus, juge du litige, flétrit le vice avec des aphorismes dignes de M. Prudhomme. Tout cela, dans un style parfois gaillard, toujours alerte et facile... L’éditeur affirme que, représentée dans un cercle d’intimes, la pièce obtint un succès de fou rire, et que trois sénateurs des plus austères—on nommait ainsi les officiers du Parlement—y perdirent leur gravité. Mais c’est surtout en Provence, sur le théâtre même de l’aventure, que le Nouveau Tarquin fut applaudi. Il y fit fureur: à ce point que, jugeant une réponse indispensable, [p. 37] les partisans du Père Girard improvisèrent un ballet-comédie qu’on exécuta en toute hâte dans les couvents de Toulon et de Marseille[29].
Dans l’intervalle de ces batailles, Jean-Jacques Bel n’a garde de demeurer inactif. Toute nouveauté l’attire et le captive. Mais c’est dans le commerce des philosophes que s’écoulent ses heures préférées. Les anciens n’ayant plus de secrets pour lui, ses investigations se concentrent sur les modernes. Justement, il en est un dont la doctrine, encore mal connue, lui échappe: ce philosophe, c’est Newton... Le petit homme fluet nourrit, sous sa perruque à longues boucles, le désir d’interroger les disciples du maître...
—Quand partons-nous? glisse-t-il à l’oreille de son voisin, un abbé à la mine avenante.
Et celui-ci, le cœur gros, de répondre:
—S’il ne dépendait que de moi!
Cet abbé, c’est le Père François Chabrol—le Père François, comme on l’appelle communément. Encore un familier du logis; nous allions dire, suivant le mot de Mme de Tencin, une autre de ses bêtes... Qualificatif qui ne saurait prêter à l’équivoque: la ménagerie de l’altière chanoinesse comprenait Duclos, Marmontel, d’Argental, Pont-de-Veyle...
[p. 38] Ce n’est pas que le Père François ait rien de commun avec l’école encyclopédique. Le supérieur des Récollets—tel est son titre—n’aspire pas à régenter le monde: son couvent lui suffit. C’est un savant qui s’est fait une spécialité de la physique, de l’algèbre, de l’astronomie, et qui a découvert, à ses moments perdus, une recette merveilleuse pour la préparation de l’hypocras... Son ordre, de nos jours, eût lancé une marque!
Les sciences exactes n’absorbent pas les loisirs du Père François. Érudit consommé et bibliophile sagace[30], c’est aussi un voyageur intrépide. Il a franchi les Alpes et parcouru l’Italie. La France n’attire pas moins sa curiosité. L’an dernier, il visitait la Bretagne, d’où il revint par le Périgord, consignant, au jour le jour, ses impressions de route. Rien de convenu ni d’apprêté dans sa correspondance, d’où se dégage, au contraire, le charme d’une humeur exquise[31]... L’honnête [p. 39] Récollet proclame—n’est-ce point de la sagesse?—que l’austérité empreinte sur le visage annonce moins le degré de la vertu que l’effort fait pour l’atteindre. Ses qualités, aussi remarquables que les produits de son alambic, sont appréciées partout. On se le dispute dans les meilleures sociétés, on le choie, on le dorlote, on garnit ses poches de friandises; mais, s’il prodigue volontiers son bon sourire, ses préférences le ramènent chez Mme Duplessy dont il partage tous les goûts. Comme elle, notamment, il adore les fleurs. Dès qu’apparaissent les beaux jours, il arrive chargé de pivoines ou d’anémones... Personne n’en médit: comme Fontenelle, le Père François possède les agréments du cœur sans en avoir les exigences.
Un personnage moins détaché de la matière, c’est le président Barbot, l’ami fidèle qui reçut, à titre de mandataire, le fameux Temple de Gnide relié en maroquin. Montesquieu, dont il fut le condisciple, en parle en termes engageants: «C’est un des hommes du monde que j’aime le plus. Il s’est toujours appliqué aux sciences, mais comme un gentilhomme. Il sait comme les savants et a de l’ardeur comme les Mécènes.» Ajoutons, pour achever le portrait, qu’on ne vit jamais de Gascon «aussi simplement simple».
A ces dons naturels, Barbot joignait une «vaste [p. 40] littérature». Mais, bien qu’il écrivît de façon à charmer les plus difficiles, il ne voulut jamais affronter les périls de la publicité. On eut beau lui prodiguer les encouragements, rien ne put triompher de ses répugnances: «J’ai lu, écrit l’auteur des Lettres persanes, votre dissertation sur l’Esprit. Personne, mieux que vous, ne peut traiter cette matière. C’est un meurtre que d’enfouir les jolies choses que vous faites. Il y a longtemps que je vous le dis, et cela ne vous corrige pas. Vous êtes toujours le même et je ne compte plus de vous punir de cette modestie. C’est une maladie incurable, qui prive malheureusement le public de vos bonnes productions.»
Appréciation pleine de justesse: tous les contemporains la confirment. Montesquieu, au surplus, ne ménageait pas, quand il les méritait, les épigrammes à son ami d’enfance. Chargé, comme secrétaire de l’Académie, d’en classer les archives, Barbot avait des distractions étranges, des oublis fâcheux, des négligences impardonnables. Lettres, mémoires, papiers de tous genres s’accumulaient au fond de son cabinet dans un désordre majestueux. Chercher un document dans ce fouillis, c’était une entreprise folle. Le châtelain de La Brède en gémissait... quand il n’en riait pas. Parfois même, sa raillerie, d’un flegme tout [p. 41] britannique, s’exerçait aux dépens des tiers... «Monsieur,» écrira-t-il à un candidat navré de la perte de ses manuscrits, «vous me surprenez beaucoup quand vous me dites que le président Barbot n’a égaré que deux de vos dissertations. Il vous en reste deux et j’admire votre bonheur. Il faut que le président ait changé ou qu’il ait des attentions pour vous: à un autre il les aurait égarées toutes quatre.»
Dans cette querelle de ménage, c’est le coupable qui eut le dernier mot. Sa vengeance fut, à la fois, d’un grand seigneur et d’un homme d’esprit. Cette bibliothèque où le livre cherché demeurait aussi introuvable «qu’une épingle dans une botte de foin», il en fit don à l’Académie: ce sont ses amis les persifleurs qui en durent débrouiller le chaos[32].
La modestie n’exclut ni l’entrain ni la verve. De l’une et de l’autre de ces qualités, Barbot possède à revendre. Nul ne lance comme lui, dans un cercle restreint, les reparties délicates. Nul ne conte avec autant d’humour ces gauloiseries inoffensives dont nos pères se délectaient. [p. 42] Sa mémoire emmagasine tout, le grave, le dramatique, le badin;—ce qui ne l’empêche pas de collectionner les œuvres les plus diverses, sans négliger celles que la police a reçu mission de pourchasser. Les pièces de vers circulant à l’état de manuscrits sont, par ses soins, consignées sur un énorme registre qu’on a eu la bonne fortune de préserver des flammes qui, après sa mort, consumèrent tous ses papiers. Dans ce précieux recueil—un sottisier, comme on disait alors—on trouve, côte à côte, odes, fables, épigrammes, poèmes de tous formats et de toute origine. Une chanson non expurgée de Montesquieu y fraternise avec des pamphlets contre les ministres, tandis qu’à d’incisives satires sur l’événement du jour, bordelais ou parisien, succède une série de bouquets à Chloris...
Un genre qui ne déplaît point au président. Les femmes raffolent de lui: la tradition assure qu’il ne leur tient pas rigueur. Il estime, en effet, que la vue d’un joli minois est un spectacle récréatif, et qu’on peut lire au fond de deux beaux yeux—quelle qu’en soit la couleur—des choses aussi intéressantes que dans «les plus renommés grimoires, chartes ou parchemins...» Ces sortes d’études, où se récréaient les meilleurs, ne tiraient pas toujours à conséquence. [p. 43] Témoin Mathieu Marais, qui confesse ingénument être bien revenu «du pays de la bagatelle» par cette bonne raison qu’il n’y pénétra jamais... Barbot avait également accompli le pèlerinage; mais on peut croire qu’il ne s’arrêta point à la porte du sanctuaire. L’Amour, en effet, lui apparaît comme «l’union délicieuse des esprits et des corps», et peu s’en faut qu’il ne pense, avec le Vert-Galant, que, pour mener à bien une aventure, rien ne vaut les témérités «d’une bonne effronterie»[33].
Cet aimable épicurien vivait dans une étroite intimité avec Jean-Jacques Bel: un conflit entre le Parlement et la Cour des Aides les mit un jour aux prises[34]. Le Parlement confia le soin de ses intérêts à l’auteur du Nouveau Tarquin, la Cour des Aides se fit représenter par Barbot, et une guerre épique s’engagea à coups de mémoires, [p. 44] de dissertations, de textes exhumés de la poudre des greffes. Durant plusieurs années, les presses ne cessèrent de gémir, tandis que tout Bordeaux, passionné pour cette lutte digne des héros d’Homère, battait des mains à chaque nouvel exploit. Il y eut, de part et d’autre, une dépense inouïe de talent, de ressources, de subtile érudition, de malice. «Ces deux grands hommes,»—assure un chroniqueur,—«en travaillant pour la gloire de leurs Compagnies, jetèrent les fondements de la leur[35]...» Le détail le plus remarquable de cette épopée, c’est que les sentiments des deux athlètes n’en subirent aucune atteinte. Le jour s’écoulait à forger des armes; le soir, on devisait de bonne amitié sous la charmille de Mme Duplessy.—Tels les paladins de nos vieilles légendes, après de vaillants corps-à-corps, vainqueurs et vaincus à tour de rôle, se passaient le baume merveilleux qui étanche les plaies et referme les estafilades[36].
[p. 45] Encore une figure sympathique: celle de l’Ermite de Roaillan. M. de Lalanne, que l’on désigne de la sorte, est le dernier représentant d’une famille qui figurerait parmi les plus illustres si une tache n’eût terni son blason[37]. Sarran II de Lalanne, le grand-oncle de celui-ci, également président à mortier et, de plus, lieutenant général de l’Amirauté, fut, sous le règne de Louis XIII, convaincu de fabrication de fausse monnaie. La condamnation prononcée contre lui, sa fuite au château de Villandraut, où ses complices—ils étaient légion—organisèrent la résistance contre les troupes royales; ses pérégrinations à travers l’Europe; sa réception par le Saint-Père; son retour en France après la mort de Richelieu; sa réintégration par Mazarin dans un siège de judicature souillé par ses crimes—constituèrent, à une époque si riche cependant en aventures invraisemblables, le plus étonnant et le plus mouvementé des drames!
[p. 46] Le Lalanne d’aujourd’hui n’a rien de commun avec ce bandit grand seigneur. Humain, charitable, ennemi de la fraude, chacun le tient en haute estime, et, comme il passe pour le plus grand épistolier du monde, c’est un honneur de figurer sur la liste de ses correspondants...
—Président, lui demande-t-on, combien de lettres ce mois-ci?
—Madame, répond-il, le mois est peu chargé: une centaine tout au plus.
—Y compris les billets doux? fait Barbot, d’un air narquois.
—Monsieur, réplique ce sage, les Essais proclament que l’Amour ne doit pas survivre à la jeunesse.
—Bah! riposte son interlocuteur, les Essais enseignent aussi qu’il est le centre où converge l’humanité, et certain proverbe, que je tiens pour excellent, assure qu’il est de toutes les saisons...
M. de Lalanne cumule les spécialités. En même temps qu’un écrivain, c’est un astronome résolu[38] [p. 47] et un chasseur infatigable: sa meute, dont les sujets de tête lui viennent des Bénédictins[39], jouit d’une célébrité au moins égale à celle des pâtés de bécasses préparés par son maître-queux[40]. Ses goûts champêtres ne l’empêchent pas, d’ailleurs, de trouver de l’attrait au commerce des dames: l’Ermite de Roaillan sait aussi bien composer un madrigal que tourner une lettre, lancer un daguet, ou prédire une éclipse.
Tels sont les amis de la première heure, auxquels il faudra bientôt ajouter le vieux président de Gascq, tout cousu de malice[41];—le conseiller de Caupos, le plus zélé des académiciens, surnommé le Misanthrope, sûrement par antiphrase[42];—le président de Ségur, l’heureux propriétaire de Château-Lafite et de Château-Latour, qu’on appelle le Roi des vins,... un prodigue incorrigible dont le carrosse ne coûte pas moins de onze mille livres;—le conseiller de Navarre, philosophe épris de poésie;—le comte de Marcellus, un [p. 48] original logé dans une cave où il tient bureau de nouvelles[43];—le président de La Tresne, à qui «son génie, joint à beaucoup de capacité et de droiture», eût permis d’aspirer à la première présidence[44];—le conseiller de Raoul, gazette vivante et généalogiste impitoyable, dont les tablettes, bourrées de détails inédits, constituent un régal de haut goût[45]... On en pourrait citer d’autres.
Longue aussi serait la liste des femmes qui firent les délices de ce monde de lettrés. L’une d’elles—Mme de Pontac-Belhade—est restée célèbre... «Ne m’oubliez pas auprès de la comtesse!» ne cessent de répéter les correspondances du temps. Belle? Elle l’était à ravir... Spirituelle? [p. 49] On citait ses mots... Érudite? Comment ne l’eût-elle pas été! Elle logeait à la source des lumières: dans l’hôtel de l’Académie. Les fenêtres de la docte assemblée s’ouvraient sur sa terrasse: une terrasse qui eut son heure de gloire! Que de précieux échos ne recueillit-elle pas! Savantes discussions, joyeux devis, vers lestement troussés, chansons badines... Une surtout provoquait des applaudissements unanimes lorsque arrivait ce couplet louangeur:
La comtesse ne rencontrait que des admirateurs. Si, comme il y a gros à parier, la tragi-comédie de Jean-Jacques Bel affronta chez Mme Duplessy les feux de la rampe, le rôle de la chaste Lucrèce lui fut confié tout d’une voix. Mais que de convoitises dut faire naître le rôle du séducteur! Celui qui en obtint la charge ne fut point un Tarquin à plaindre.
Quelque brillante que soit l’auréole de Mme de Pontac, elle n’en pâlit pas moins devant l’éclat [p. 50] répandu par la duchesse d’Aiguillon—celle-là même que les encyclopédistes, heureux de trouver chez elle le boire et le manger, adorèrent sous le vocable de Sœur du pot-au-feu: Anne-Charlotte de Crussol-Florensac, mariée en 1718 au marquis de Richelieu. Durant une période de trente années, la verve de la duchesse—fille de la Gaye France—s’épanouit autant sur les bords de la Garonne que dans les ruelles de Versailles ou les soupers littéraires de Paris...
Grande dame de naissance et d’éducation, philosophe par tempérament, femme d’esprit à toute heure, Charlotte de Crussol, en Guyenne, tenait état de plaideuse. La terre d’Aiguillon, érigée en duché-pairie «mâle ou femelle» par le premier ministre de Louis XIII, au profit de sa nièce, avec faculté—ce qui ne s’était jamais vu—d’en disposer à sa convenance, passa d’abord sur la tête d’une vieille fille que Saint-Simon nous montre provoquant, dans le plus grotesque des équipages, les huées de la valetaille[47]. A la mort de cette extravagante, le marquis de Richelieu hérita; mais Louis XIV, cédant à une cabale soutenue par le chancelier, défendit au légataire de prendre le titre, le rang et les honneurs de duc. Quand, [p. 51] plus tard, celui-ci obtint gain de cause, ses domaines étaient l’objet d’entreprises de tous genres dont il fallut saisir le Parlement de Bordeaux. La jeune duchesse se plut à suivre elle-même ses procès, à visiter ses juges, à stimuler procureurs et avocats... L’histoire a gardé le souvenir d’une question de franc-alleu qui lui tenait étrangement au cœur. Dès que l’affaire, grossie de quelque incident nouveau, revenait à l’audience, Mme d’Aiguillon partait en poste et s’installait au palais de l’Ombrière. Le jour, elle vivait de procédure. Le soir, oublieuse de la chicane, elle apportait aux réunions choisies de la ville l’appoint de sa gaîté prime-sautière, bizarre parfois, jamais banale.
Charlotte de Crussol parlait quatre langues, excellait dans les sciences économiques, tournait finement la phrase, avec force citations latines, et traduisait Pope de façon à ravir les plus exigeants. Le mot, chez elle, était toujours heureux, l’idée toujours originale... Regardez-la, disait un critique perspicace, elle ne pense pas d’après les autres! Le culte que le doux abbé de Saint-Pierre voua à cette virtuose allait jusqu’au fanatisme[48]. Quant à Voltaire, il la compare à Minerve descendue de l’Olympe... Au besoin, à Minerve il eût joint [p. 52] Vénus, car il proclame qu’Henri IV lui eût sacrifié la belle Gabrielle[49]: en quoi son affirmation ne risquait guère de recevoir un désaveu!
La marquise du Deffant témoignait moins d’enthousiasme. «La duchesse d’Aiguillon, écrit-elle, a la bouche enfoncée, le nez de travers, le regard fol et hardi, et, malgré cela, elle est belle. L’éclat de son teint l’emporte sur l’irrégularité des traits. Sa taille est grossière, sa gorge et ses bras sont énormes; cependant, elle n’a l’air ni pesant ni épais: la force, en elle, supplée à la légèreté...»
Peut-être pourrait-on tenir ce portrait pour ressemblant si l’amie de Walpole, qui ne pécha jamais par l’indulgence, ne le faisait suivre d’appréciations où se révèle une jalousie féroce,—appréciations qu’elle ne tarde pas, d’ailleurs, à démentir dans vingt endroits de sa correspondance. Mme du Deffant, dont la sécheresse égoïste, malgré les ridicules d’un amour sénile, ne fut un secret pour personne, ne possédait pas les qualités requises pour juger une femme qui vécut plus encore par le cœur que par l’esprit. Mme d’Aiguillon avait-elle, sous le coup d’impressions impétueuses, le regard que lui prête sa perfide [p. 53] amie? Le fait n’est guère vraisemblable. Mais ce qui est hors de doute, c’est qu’au repos c’était le plus bénin, le plus rassurant des regards. La douceur empreinte sur cette physionomie faisait vite oublier certains airs de brusquerie masculine et les éclats d’une voix un peu rude qui s’essaya avec succès dans l’art tragique. La charité était l’inaltérable vertu de Sœur du pot-au-feu. Sans parler des écrivains désemparés, il n’est pas de misérable qui frappât vainement à sa porte. Le peuple, dont les suffrages ne sont point à dédaigner, l’appelait la bonne duchesse.
Mme d’Aiguillon avait un autre mérite qui suffirait à nous la rendre chère: elle entoura d’une affection que n’entamèrent ni ses impatiences en matière allodiale, ni le temps, «ce grand fauteur de brouilleries,» ni de mesquines rivalités de salons, celui dont l’impérissable image emplirait, à elle seule, l’hôtel du Jardin-Public: le président de Montesquieu[50].

Montesquieu: sa jeunesse, ses condisciples à Juilly, son passage au Parlement.—Publication des Lettres persanes.—Voyages à Paris.—Succès féminins.—L’Académie lui est fermée.—Vente de son office.—Visite au cardinal Fleury.—Seconde élection.—Détracteurs et jaloux.—Premiers déboires.—Retours à Bordeaux.

Né au cœur de la Gascogne, Gascon jusques aux moelles, celui qu’on appela d’abord La Brède conserva toujours intacts l’empreinte et le culte de son pays. Sa jeunesse s’écoula à Bordeaux, d’où il ne s’éloigna que durant les années de collège. L’établissement de Juilly, tenu par les Oratoriens, était alors en grande vogue. C’est là qu’on le mit en pension avec bon nombre de ses amis d’enfance... Jean-Jacques Bel et Barbot, un peu plus jeunes, ne tardèrent pas à l’y rejoindre.
C’était, à cette époque, un voyage de longue durée, pénible, périlleux. Avant de boucler sa valise, on tâchait de se procurer des compagnons [p. 56] de route[51]. On se risquait seul dans les limites de la province; pour aller à Bayonne ou à Paris, on éprouvait le besoin de se sentir en forces.
Nul doute que la jeune colonie ne cheminât de concert et à frais communs: une carrossée exubérante de santé et de sève! Des figures nouvelles, comme les régions traversées, des embarras d’auberge, des mécomptes à la poste aux chevaux, des heurts, des ruades, des cahots, des essieux rompus, tels étaient les incidents ordinaires de ces lointaines expéditions. Aventures, dangers, plaisirs, privations, tout contribuait à augmenter la force d’un lien créé déjà par l’identité d’origine. Au collège, également, on sentait le besoin de se toucher les coudes. L’accès n’en était pas toujours facile à ces méridionaux transplantés sur une terre inconnue. Leur regard vif, mobile, ensoleillé, certaine tournure d’esprit familière et moqueuse, cet accent pittoresque confinant au comique, ces allures conquérantes, qui sont le propre des races de la Garonne, contrastaient étrangement avec les façons des écoliers du Nord. Les têtes à la d’Artagnan prêtaient aux railleries... Dieu sait si on les leur épargnait[52]!
[p. 57] Au cours de ces épreuves de l’adolescence—épopées inoubliables—se nouaient des affections robustes que, plus tard, resserrait encore un commerce de chaque jour. Comment La Brède n’eût-il pas chéri Bordeaux! C’est à Bordeaux que vivaient ses meilleurs amis et se concentraient ses plus chers souvenirs; à Bordeaux qu’il faisait son droit sous les deux Tanesse et le vieil Albessard[53]; qu’il entrait dans la robe; qu’il se mariait; qu’il voyait naître ses enfants; qu’il acquérait une situation considérable accrue par son élévation à la charge de président à mortier, héritage d’un oncle qui, avec son nom, lui léguait toute sa fortune[54].
[p. 58] Ce n’est qu’à la fin de la Régence, après le succès des Lettres persanes, qu’il se décida à visiter Paris. Inconnu, la veille, il devenait célèbre avec une soudaineté dont les annales littéraires ne mentionnent aucun exemple... Célèbre! nous disons bien, car, malgré l’anonymat du livre, on ne tarda pas à en connaître l’auteur. L’enivrement d’une notoriété au-dessus des plus beaux rêves, le désir légitime de cueillir les couronnes tressées à son intention, la volonté aussi de compléter le bagage nécessaire à d’autres travaux caressés de longue date, le déterminèrent à accomplir le voyage.
Ce fut une entrée triomphale: les femmes surtout en firent les frais. On l’accueillit avec transports dans les cercles à la mode. Mme de Tencin le sacra grand homme, la marquise de Lambert lui promit l’immortalité académique, Mme de Prie daigna lui sourire. L’engouement des boudoirs ne fut pas moindre: avec un peu de complaisance, l’oriental Rica eût goûté à Paris les joies capiteuses que, jusqu’alors, lui avait réservées son harem d’Ispahan.
Le premier nuage qui surgit à l’horizon se leva du côté de Versailles. L’écrivain avait frappé trop haut et trop juste pour que bien des gens ne se sentissent pas atteints. Les jugements irrévérencieux [p. 59] sur Louis XIV ne causèrent que peu d’ombrage, tant la décrépitude du grand roi avait semblé lourde à la nation entière; mais les attaques contre le pouvoir et ses ministres, les railleries à l’adresse de certains ordres religieux, les sarcasmes contre le corps des laquais, «ce séminaire de grands seigneurs,» les idées factieuses qui, sous une forme légère, aussi mordante que nouvelle, éclataient tout le long du livre comme une menace pour l’avenir, tout cela—en jetant le trouble en haut lieu—exaspérait une somme énorme de vanités et provoquait de formidables colères. La cour jugea opportun de tenir rigueur à cet impertinent: celui-ci, blessé dans son orgueil, se consola en répétant cette parole qu’à Versailles tout le monde est petit, tandis qu’à Paris tout le monde est grand!
Sa pensée ne tardait pas, d’ailleurs, à suivre une autre direction.—J’aimais encore, confesse-t-il, à l’âge de trente-cinq ans... Le cher président ne fait pas bonne mesure!... Quoi qu’il en soit, ce fut un sentiment tendre qui le décida à publier le Temple de Gnide, une œuvre anacréontique découverte—assurait l’éditeur—parmi les manuscrits d’un évêque arménien, et qui semblait avoir été écrite dans l’alcôve d’Aspasie... Le beau sexe lui fit un brillant accueil: toutes les femmes, mises [p. 60] en appétit par ce ragoût d’une saveur antique réclamèrent, malgré le carême, des professeurs de langue grecque[55].
Au cours de cette idylle, de nouveaux soucis allaient surgir, pour raison de candidature académique. Jugeant l’occasion propice, Mme de Lambert s’était mise en campagne. L’affaire ne laissa pas que d’être chaude. Les adversaires du président formulaient cette objection spécieuse: «Si vous êtes l’auteur des Lettres persanes, il y en a une contre la Compagnie à la porte de laquelle vous frappez. Si vous n’en êtes pas l’auteur, où sont vos titres?...» Les fidèles de la marquise, habilement dirigés, n’en parvinrent pas moins à emporter la place. Mais Versailles veillait: le vote fut cassé, sous prétexte que l’élu, attaché au Parlement de Guyenne, ne pouvait résider à Paris[56].
Montesquieu, piqué au vif, n’hésita pas. L’obstacle allégué, c’était son office: il résolut de s’en défaire. Aussi bien, ses fonctions lui pesaient-elles. Son génie, cependant, s’y était révélé un jour—le jour de la Saint-Martin 1725, où il [p. 61] prononça le discours de rentrée... Jamais les voûtes du palais de l’Ombrière n’entendirent de pensées aussi nobles formulées en un pareil langage. L’impression fut si grande que, chaque année, on réimprimait, pour la vendre dans la salle des Pas-Perdus, cette harangue mémorable.
En dehors de ce coup de maître, Montesquieu, en tant que robin, ne dépassait pas une médiocrité honnête. Les subtilités juridiques choquaient son intelligence toute de bon sens et de clarté. La chicane l’irritait. Son orgueil souffrait de ne point saisir les tactiques de procédure accessibles aux esprits les moins déliés. L’audience elle-même le fatiguait: il n’y allait qu’à contre-cœur et provoquait une sorte de révolution intestine en vue de se soustraire aux séances de relevée[57]. Ajoutons que, causeur exquis dans un cercle intime, il n’avait rien de l’éloquence nécessaire pour enlever les suffrages d’une assemblée. «Ma machine est tellement composée, déclare-t-il, que j’ai besoin de me recueillir dans toutes les matières [p. 62] un peu abstraites; sans cela, mes idées se confondent, et si je sens que je sois écouté, il me semble dès lors que toute la question s’évanouit devant moi...» C’est pourtant dans ces réunions solennelles, au cours de débats, souvent orageux, touchant aux plus hautes spéculations de la politique, de la religion, des finances, que s’établissaient les réputations judiciaires...
L’occasion était tentante d’abandonner une carrière où la nature de son esprit le condamnait à l’effacement. Montesquieu vendit son office[58] et, résolu à recommencer la lutte, alla prendre gîte dans un hôtel meublé de la rue Saint-Dominique.
Cette fois, la nomination devait être ratifiée, mais dans des conditions qui soumirent à une pénible épreuve la fierté du candidat. Le cardinal Fleury accueillit avec répugnance un choix qu’il jugeait déplorable à raison du flot montant de l’irréligion. Son hostilité s’accentua encore lorsque le confident de ses pensées, M. de Valincourt, lui eut soumis quelques passages de la correspondance d’Usbek. «Je suis effraié, déclarait-il, de l’extrait que vous m’avez envoyé, et, si je l’avois sçu plustôt, j’aurois arrêté l’élection. Cela me fait trembler pour le bureau de Mme de Lambert [p. 63] et je meurs de peur que ce ne soit une école d’impiété. J’écrivis hier au maréchal d’Estrées de tirer du candidat un écrit par lequel il désavoue authentiquement être l’auteur des détestables Lettres persanes, et de le lire tout haut à l’Académie, sinon de surseoir à l’élection... Ce qu’il y a de fâcheux, c’est que les choses sont bien avancées[59].» C’est sous l’empire de ces préoccupations qu’on pesa sur le récipiendaire pour qu’il se retirât de bonne grâce; on fit même miroiter à ses yeux l’appât d’une pension...
Montesquieu proféra-t-il, sous le coup de cette insulte, la menace de s’expatrier? Plusieurs de ses amis l’affirment[60]... La crainte d’un scandale décida Fleury à lui accorder audience. Gascon et cardinal se trouvèrent face à face: c’est le Gascon qui fut joué. On assure qu’il vint au rendez-vous, muni d’un exemplaire de son œuvre dextrement expurgé... La supercherie n’est rien moins que probable. Ce qui est hors de conteste, c’est qu’après avoir enguirlandé son homme de paroles doucereuses, l’Éminence avertit officiellement Messieurs du Palais Mazarin que la soumission de leur nouveau collègue venait d’être si entière [p. 64] que, désormais, toute équivoque sur ses sentiments devenait impossible. D’Alembert élève ce satisfecit à la hauteur d’une réparation: «Ce fut, dit-il, la justification de Socrate...» N’était-ce point plutôt, sous une forme perfide, la plus sanglante des exécutions?
Si celui qu’on ne cessa d’appeler le président affectionna jamais Paris, comme Montaigne, jusque dans ses taches et ses verrues, ce jour-là sa chaleur dut un peu se refroidir. Il ne tarda pas, d’ailleurs, à constater que, si la critique lui était sévère, certaines personnalités de son entourage ne l’épargnaient pas non plus. Que le Père Tournemine et les docteurs de Sorbonne l’injuriassent à dire d’experts, la chose ne tirait pas à conséquence. Mais trouver des détracteurs parmi ceux dont l’amitié paraît sincère, quelle découverte cruelle! Tel était pourtant le cas... Les Lettres persanes? «Puériles, du fretin, un piètre livre!...» Le Temple de Gnide? «L’Apocalypse de la galanterie!...» Grandeur et décadence des Romains? «Un sujet d’une importance extrême traité légèrement!...»
Voilà l’opinion dédaigneuse qui se manifeste «en chorus» chez Mmes du Deffant, de Graffigny, du Châtelet[61]. Helvétius, malgré un attachement [p. 65] prodigue de démonstrations, ne voit, dans le nouveau venu, qu’un homme d’esprit, digne fils assurément de l’auteur des Essais, mais sans élévation de vues, arriéré, rétrograde, imbu des idées fausses du grand seigneur et des préjugés du robin[62]. Voltaire, moins absolu, avait ses jours, comme les coquettes. Parfois, il porte aux nues le président; parfois aussi il relève, avec aigreur, ses lapsus, ses oublis, sa vanité... Comme alors il se rattrape! Il va jusqu’à lui reprocher l’impiété de ses écrits... Montesquieu ne sourcillait point quand l’abbé Gauthier[63] le traitait de bouc et de pourceau, mais cette dernière accusation, dans la bouche de celui qui, en feignant de croire en Dieu, ne crut jamais qu’au Diable[64], était faite pour exaspérer le plus débonnaire des Gascons.
Sans doute, des témoignages d’admiration, venus des quatre coins de la France et de l’étranger, vengeaient le pauvre grand homme de cette explosion de dénigrement. Il n’en dut pas moins regretter plus d’une fois sa paisible Guyenne, cette ville de Bordeaux, si hospitalière, où toutes [p. 66] ses affections se trouvaient réunies, et sa terre de La Brède qu’il ne revit jamais sans émotion... Dans ce coin heureux, où la nature apparaît sans voiles, «comme au saut du lit,» il peut, tout en se consacrant à l’étude, donner carrière à ses goûts champêtres, planter, défricher, ensemencer des prairies, converser avec ses vassaux, dont la tête ne lui semble pas moins solide que celle des philosophes... «L’air, écrit-il, les raisins, les vins des bords de la Garonne et l’humeur des Gascons sont d’excellents antidotes contre la mélancolie.» Nulle part, il n’oublie mieux les commérages, les petitesses, «l’ineptie et la folie» d’une capitale où les plaisirs n’ont d’autre résultat que de fatiguer l’esprit. Son château gothique, dont il a disposé les avenues à la mode anglaise, suffirait à son bonheur: si, par hasard, il s’en éloigne sans regrets, c’est que les défrichages restent stationnaires, que les braconniers se répandent partout, que les vagabonds font plus de mal aux vignes que les renards ou les blaireaux, que la misère touche à son comble et qu’il est dans l’impuissance de la soulager[65].
[p. 67] Quoi qu’il en fût, le penseur qui a dit: Je suis amoureux de l’amitié... ne pouvait oublier la petite phalange de fidèles occupés, sur les bords de la Seine, à rompre des lances en son honneur. Ce fut, en effet, l’homme le plus poli de France. Le seigneur de Montaigne ne ménageait point «les bonnetades, notamment en esté»: Montesquieu possède un chapeau qui se lève seul en toute saison. Aussi, quand il s’adresse à ses familiers de Paris, proteste-t-il contre toute pensée de retraite: il ne vit que par eux et ne cesse de soupirer après son petit appartement de la rue Saint-Dominique...
Peut-être était-il sincère. L’écrivain, non moins que l’ami, trouvait son compte à ces voyages périodiques qui coïncidaient toujours avec quelque publication nouvelle dont le sort le préoccupait au delà de toute raison. Il partait en bon ordre de bataille, annonçant très haut que les critiques ne l’effrayaient point, que l’attitude de la cour le laissait indifférent, et qu’il se sentait de taille à pulvériser cette Sorbonne qui, comme la mouche du coche, aspirait à tout régenter[66]... Au fond, sa bravoure n’était qu’à fleur de peau. [p. 68] A la façon des personnages de théâtre, il chantait fort pour se donner du cœur; mais peu s’en faut qu’il ne pensât comme le valet d’Amphitryon:
Jean-Jacques, après un séjour de quelques mois parmi les beaux esprits, n’aspirait qu’à la solitude au sein de la nature. Excédé de dissertations philosophiques, de lectures, de tragédies, de brochures, de clavecin, de bons mots, de minauderies, de jets d’eau en miniature, de bosquets enserrés entre quatre murailles, il se reprenait à vivre en lorgnant du coin de l’œil une haie, une grange, un pré, un simple buisson d’épines,—et envoyait au diable le rouge, l’ambre, les falbalas et les grandes dames[67]...
Il ne faut point jurer que, sur ce dernier chapitre, Montesquieu partageât les répugnances de Rousseau. J’imagine, en revanche, qu’en découvrant, à travers la brume, les coteaux du Blayais, les prairies verdoyantes de l’Entre-deux-Mers, les vastes plaines noires de pins qui viennent mourir aux bords de la Garonne, et ces vignes ensoleillées en faveur desquelles il partit en guerre contre [p. 69] l’arrêt du Conseil de 1725[68], le seigneur de La Brède respirait à pleins poumons, délicieusement bercé comme le maître genevois. Aucun doute, en effet, que, malgré le charme de ces flatteries dont le XVIIIe siècle fut si prodigue, il ne se rendît compte de ce qu’il y avait de convenu, de factice, de décevant dans les réunions littéraires qu’il fréquentait. Quand, au lieu de s’en tenir aux apparences, on pénètre au fond des choses, que d’étranges constatations! Quand, résistant à l’attrait de certaines figures et à la légende qui les protège, on juge les personnages d’après leur existence privée, et non sur ce que nos pères appelaient la piperie des écrits et des mots, que de petitesses, que de contradictions, que de parjures chez ceux-là mêmes qui eurent l’honneur de fondre le moule d’où sortit la société moderne! On rencontre, hélas! à chaque pas, des prôneurs attitrés de la tolérance réclamant en cachette l’embastillement d’un rival malencontreux; des apôtres de l’égalité sociale exigeant, sous peine des galères, le bénéfice de leurs droits féodaux; des partisans de la liberté auxquels, pour être des tyrans, il ne manqua qu’un trône[69]...
[p. 70] En Guyenne, les professions de foi étaient moins retentissantes. En revanche, les actes cadraient mieux avec les doctrines. La franchise, sans déclamation, y était de règle. Ce n’est point à l’hôtel du Jardin-Public qu’on encensait les gens pour les déchirer ensuite. Et l’Académie bordelaise—une honnête personne, bien qu’elle fît parler d’elle—n’exigeait de ses élus ni sacrifices d’opinion, ni capitulations de conscience, ni postures humiliées!
Que de charme dans ces retours! Quel empressement à la portière du carrosse poudreux! Tous les siens s’y donnaient rendez-vous: Mme de Montesquieu, une timide éprise d’effacement[70]; son fils, Jean-Baptiste de Secondat, héritier d’un nom qu’il porta dignement; ses deux filles, dont l’une, Denise, faite de grâce et de dévouement, sera bientôt transformée en Antigone; son frère Joseph, abbé de Faize et doyen de Saint-Seurin, le [p. 71] plus tendre des cadets[71]; enfin, tout un cortège de serviteurs et de familiers!... Après une série de vicissitudes, le voyageur reprenait, dans le calme et la sérénité, son existence ancienne, s’asseyait à sa propre table, reposait dans un fauteuil qui était le sien, et, courbé sur son pupitre, se retrempait dans l’œuvre interrompue...
Le soir venu, fidèle aux souvenirs du passé, sa hâte était grande de revoir ses camarades de jeunesse, unis à lui par le goût des lettres et par les liens plus forts de l’amitié. Précédé d’un laquais porteur du falot classique, évitant de son mieux fondrières et bourbiers, il contournait le charnier placé en face de sa maison[72], laissait à gauche la basilique de Saint-Seurin, à droite les ruines du Palais-Gallien, et, franchissant cette partie de la route du Médoc qui est devenue la rue Fondaudège, sonnait, le cœur empreint d’une émotion douce, à la grille de Mme Duplessy.

Montesquieu à l’hôtel Duplessy: sa tenue, ses manières, son langage dans l’intimité.—Venuti, abbé de Clairac.—L’abbé comte de Guasco: plaisanteries à son adresse.—Épigramme de Thémire contre les Agenais.—Impressions de voyage en Autriche, en Angleterre, en Italie: Souvenirs de Florence.

Ces jours-là sont jours de fête pour le logis du Jardin-Public. Les serviteurs, affairés, chuchotent à l’antichambre. Le salon, garni de plantes et de fleurs, brille, sous le feu des lumières, d’un éclat insolite.
Chacun des habitués est à son poste. Jean-Jacques Bel, isolé dans un coin, ébauche un sourire distrait. Marcellus lorgne un Téniers dont il connaît tous les détails. M. de Navarre, par manière de contenance, débite un madrigal à Mme de Pontac, qui l’écoute à peine. Dom Galéas promène sa silhouette fantasque. Le Père François, enveloppé dans sa douillette, médite sans succès un problème ardu. Élisabeth Duplessy se meurt d’impatience, tandis que sa mère, parée de [p. 74] sa robe de satin crème, donne un coup d’œil aux derniers préparatifs. Barbot, qui a assisté à l’arrivée du carrosse, fournit, pour la dixième fois, sur la santé du voyageur, des nouvelles accueillies avec une vive curiosité.
Enfin, il apparaît...
Démarche modeste, mise simple, vêtements d’étoffes communes, sans dorures, ni broderies: le mépris qu’il professe à l’égard des petits-maîtres égale son dédain des grands seigneurs... A ne juger que la tournure, tout l’air d’un bourgeois de province, vivant sur sa terre et ménager de son bien.
La tête, c’est autre chose. Hormis celle de Voltaire, il n’en est pas de plus curieuse. Mais quelle différence d’expression! Chez l’un, le génie est marqué au coin de l’impudence; chez l’autre, il est fait de douceur et de bonté... «Eh!—proclame le chevalier d’Aydie—qui n’aimeroit pas cet homme, ce bon homme, ce grand homme, original dans ses ouvrages, dans son caractère, dans ses manières, et toujours ou digne d’admiration ou adorable[73]?»—Adorable n’est pas trop fort, tant est puissante la séduction. L’œil, pénétrant et vif, bien que voilé par la myopie—cet [p. 75] œil méridional à qui rien n’échappe—recèle des trésors de caresses. De même, la bouche, fine, quelque peu sensuelle, d’une raillerie implacable pour le vice et les abus, s’éclaire, dans l’intimité, de sourires exquis... On a dit: un masque de médaille, un profil d’empereur romain. C’est cela même, avec un reflet de la grâce asiatique illuminée par l’esprit gaulois.
Comme, sous l’influence du ciel natal, cette figure, d’une étrange mobilité, s’épanouit! A part quelques privilégiés, on ne la connaît guère hors de Bordeaux. La nature de Montesquieu répugne aux exhibitions de commande. Son regard, qui plonge dans la lumière «avec une espèce de ravissement», voit trouble au milieu des fêtes. La timidité fut le fléau de sa vie: elle lie sa langue, met un nuage sur ses pensées, dérange ses expressions, obscurcit même ses organes... Il n’aime que les maisons où il peut se tirer d’affaire avec son esprit de tous les jours[74]. Ailleurs, il est distrait, soucieux, méditatif. S’il apporte quelque attention autour de lui, c’est qu’il poursuit un sujet d’étude. Le plus souvent, il se dérobe aux curieux, soit pour rester en tête-à-tête avec lui-même, soit pour s’entretenir, [p. 76] avec les étrangers, des goûts, des mœurs, des lois de leur pays... La duchesse de Chaulnes s’en plaignait comme d’un manque d’égards: cet homme, disait-elle, vient chez nous faire son livre!
En Guyenne, au contraire, les facultés brillantes de Montesquieu s’affirment sans réserve. Sa conversation est un feu roulant d’éloquence familière. Simple, dépourvue d’apprêt, d’une narquoise bonhomie, empruntant ses couleurs aux choses de la vie courante, sans jamais être triviale, elle éclate en traits audacieux. Aucun obstacle ne la paralyse, ni le défaut d’assurance, ni la connaissance incomplète des auditeurs, ni la crainte—instinctive chez les provinciaux de passage à Paris—d’une police toujours en éveil. Sa verve, en toute liberté, se donne carrière, gasconnant sans provoquer les sourires, se prêtant de bonne grâce au choc des interruptions, déroulant une liste interminable de menus faits recueillis durant les mois d’absence... Que de récits étincelants, d’anecdotes plaisantes, d’aperçus ingénieux, de jugements profonds, dans le goût de ces Lettres persanes qui s’étaient vendues «comme du pain», et auxquelles les libraires, à grands cris, sollicitaient une suite!
A vrai dire, il s’en fallait de beaucoup que la [p. 77] matière fût épuisée. Dans sa fulgurante satire, Montesquieu a souvent négligé le détail. On ne doit pas s’en étonner. Les premières lettres—presque d’un écolier—furent écrites, en manière de distraction, entre une leçon de droit romain et un chapitre de Cujas[75]. Les autres émanent d’un robin d’éclosion récente, que des fonctions sédentaires confinent au fond de sa province. Comment connaîtrait-il la capitale, ne l’ayant aperçue qu’à travers les rideaux du carrosse qui l’emmena chez les Oratoriens? Quant à Versailles, c’est à peine s’il en soupçonne l’existence. Personnellement, il n’a rien vu des platitudes dont la cour est le théâtre. Ses informations, il les tient des gazettes: le document direct lui manque. Aussi, après avoir frappé à la marque de son génie des pensées qui circulent parmi une élite audacieuse, a-t-il soin de laisser dans l’ombre ce qui exige des précisions. Si, par aventure, il se hasarde sur un terrain inexploré, l’exactitude s’en ressent. Veut-il peindre un courtisan, c’est-à-dire «l’une des personnes du royaume qui représentent le mieux»? il montre un petit homme si fier, humant avec tant de hauteur une prise de tabac, crachant avec tant de flegme, caressant ses chiens d’une manière si [p. 78] offensante pour ses semblables, qu’on ne peut se lasser de l’admirer[76]... Ce portrait, d’une forme piquante, est peut-être celui des gentillâtres de Gascogne; mais il est impossible d’y reconnaître le grand seigneur pompeux du règne de Louis XIV, pas plus que le roué, d’allures débraillées, des beaux jours de la Régence... L’imagination de l’artiste a suppléé au modèle qui lui faisait défaut[77].
Écrivant dix ans plus tard, Montesquieu eût, d’une main autrement sûre, accusé la ressemblance! C’est qu’alors la région habitée par ceux «qui voient le roi» n’avait plus de secrets pour lui... région étrange où donner la main à un galant homme de son espèce constitue une dérogeance, où le talent est gouverné par des valets, où le sort des peuples dépend d’une favorite, où les liens de famille sont rompus, où les races, ruinées par le luxe et les vices, se relèvent par des alliances qui jouent le rôle «du fumier dont on engraisse les terres montagneuses et arides...» Oh! ces puissants, heureux de le mortifier, ces gens en [p. 79] place dont la faveur va se refroidissant à mesure que grandit celle du public, les haines sottes, les jalousies mesquines, les compromissions scandaleuses! Quels chapitres admirables pour un second volume des Lettres persanes! Ces chapitres qui nous manquent virent sûrement le jour, sous forme de vibrantes improvisations... Seul, hélas! le salon de Mme Duplessy en goûta l’ironie vengeresse.
Montesquieu trouvait, à Bordeaux, des partenaires de taille à lui donner la réplique. En effet, le cénacle allait toujours croissant: étrangers visitant la Guyenne, gentilshommes se rendant à la cour d’Espagne, savants accomplissant leur tour de France,—sans compter les recrues acclimatées dans le pays.
De ce nombre était Philippe de Venuti, abbé de Clairac[78]. Littérateur, poète, numismate, archéologue, le nouveau venu ne négligea rien pour acquérir droit de cité dans la patrie d’Ausone. Il étudia ses monuments, s’appliqua à les décrire, rechercha leur origine, collectionna médailles et monnaies, ne laissa pas, sans le remuer, un coin [p. 80] de l’antique duché d’Aquitaine... Messieurs les antiquaires, s’écriait un jour le châtelain de La Brède, vous êtes tous des charlatans[79]!—Cette boutade ne visait pas Venuti, bien qu’au dire d’un juge éclairé[80], le docte collectionneur ne fût pas à l’abri de toute critique. Mais où il excellait sans conteste, c’est dans l’organisation des fêtes. Nul ne savait, comme lui, enguirlander de fleurs un sujet allégorique, préparer des inscriptions flatteuses, combiner emblèmes et devises. En 1745, lors du passage de la dauphine Marie-Thérèse, il accomplit des merveilles, avec l’assistance du chevalier Servandoni, peintre et architecte du roi. Les jurats, qui ne péchaient point par excès de largesses, lui offrirent une bourse remplie de jetons: le présent ne valait pas cent écus, mais c’était «celui d’une grande cité»[81].
Encore un Italien, également d’église: l’abbé comte de Guasco, accrédité par Mme d’Aiguillon[82], [p. 81] homme d’esprit autant que de science, écrivant le français avec pureté, traduisant, pour faire sa cour à la bonne duchesse, sa «muse favorite», les œuvres d’un prince russe, du nom de Cantimir. A Paris, très lancé dans le monde diplomatique où Mme Geoffrin, médisante à ses heures, affirme qu’il tend l’oreille avec trop d’attention. A Bordeaux, soignant son estomac, sa vue et ses poumons, buvant peu, se couchant tôt, recherchant le commerce des gens aimables, mais timide auprès des femmes dont sa candeur ne cesse de proclamer la nature séraphique... Montesquieu, qui en a fait son homme-lige, le plaisante de n’avoir, pour agrémenter ses rêves, d’autres pensées que celles de Pascal. Il lui prédit que le diable, tentateur du moine de la légende, prendra sa revanche, et assure que, ce jour-là, il suffira de la vue d’un soulier mignon pour mettre en déroute tout un passé de continence. Bientôt, poursuivant ses railleries, il lui reprochera de fantastiques déportements: vingt et une victimes en l’espace de quelques mois... Hercule sous le masque de Don Juan!
Ce séducteur malgré lui fait, en matière religieuse, profession d’un éclectisme remarquable... Catholique? Assurément; ce qui ne l’empêche pas de vivre en bonne harmonie avec la baronne [p. 82] de Montesquieu, une calviniste pratiquante; avec la maréchale d’Estrées, chez qui l’esprit d’intrigue n’exclut pas la galanterie; avec Mme du Châtelet, un apôtre résolu des doctrines matérialistes... Époque singulière, toute d’oppositions et de contrastes, de détachement plus que de tolérance, où, sans rougir, la vertu coudoie le vice, et où la foi fait bon ménage avec l’hérésie, le doute et l’athéisme!
Alimentées par ces hôtes de choix, les soirées s’écoulent rapides. Celui-ci risque une lecture, celui-là cisèle un mot. Mme de Pontac ébauche un quatrain, le Père François tente une expérience de physique. Quant à la duchesse, elle garde toujours en poche quelque anecdote inédite. Arrive-t-elle de Paris ou de Versailles, c’est une gazette de la cour et de la ville. Débarque-t-elle d’Agen où l’appelle aussi la sauvegarde de son franc-alleu, il est rare qu’elle n’ait pas en réserve quelque moquerie à l’adresse des gens du cru... Témoin celle-ci qu’elle débite avec un talent de diction auquel Mme du Deffant elle-même ne peut s’empêcher de rendre hommage.
Qu’on se la représente, droite dans sa haute stature, cambrée avec élégance, le buste rejeté en arrière à la façon des soubrettes délurées, entrecoupant d’explications préliminaires—comme [p. 83] Oronte en son sonnet—la pièce qui va jaillir de ses lèvres...
—Épigramme! C’en est une,... une épigramme d’Agenais... Je réclame l’indulgence... m’y voici:
La duchesse s’arrête:
—Chacun, murmure-t-elle, a reconnu Monseigneur de Chabannes[83]... Bien! je reprends:
La duchesse fait une nouvelle pause, et lançant un regard circulaire:
—Thémire, c’est votre humble servante...
Des bons mots et des petits vers, on passe aux récits de voyages: un sujet cher aux Gascons qui, de tout temps, épris de l’inconnu, eurent le goût des aventures lointaines. Quelle étude attrayante que celle des pérégrinations comparées de la pléiade d’hommes célèbres qui s’épanouirent sur les rives de la Garonne:—Montaigne, si précis dans ses constatations, si profond dans ses remarques, diseur plein d’humour appliquant à la rédaction de simples notes ce style vif, piquant, familier, naïf, qui est un charme et une joie;—Pibrac, dont les infortunes, en Pologne, participent du roman;—Paul de Foix, diplomate mâtiné de parlementaire et de philosophe, escorté, sur les grands chemins qui mènent à Rome, d’une phalange de disciples, observateur diligent durant le jour, et, le soir, barricadé dans l’un de ces coupe-gorge où gîtaient les voyageurs, expliquant, l’épée à la main, l’Organon d’Aristote, ou la République de Platon...
[p. 85] Dans cette galerie d’illustres, Montesquieu occupe une place à part. Nul ne poussa plus loin l’art de vivre dans les pays étrangers, de pénétrer leurs coutumes, leurs mœurs, leur esprit... Un art peu répandu.—Que de personnes, déclare-t-il, prennent des chevaux de poste, et combien peu savent voyager! On connaît l’histoire de ce gentilhomme qui, de son séjour à Naples, n’avait rapporté qu’un souvenir: celui d’un reître qui couchait tête nue et buvait dans ses bottes!... Quand Montesquieu quitte une région, il a tout vu, tout analysé, tout gravé dans sa mémoire: l’agriculture, l’industrie, le régime des impôts, les ports, les routes, l’endiguement des rivières, les arsenaux, les manufactures. Son esprit ne s’est point donné de trêve: il a fouillé les bibliothèques, inventorié les collections, interrogé citadins et campagnards, hommes politiques et boutiquiers...
Quelles admirables excursions il ménage à son monde! Tantôt c’est en Allemagne qu’il l’entraîne à sa suite, tantôt en Hongrie, en Autriche, en Hollande ou sur les côtes de la Grande-Bretagne, cette terre des libertés qu’il propose comme modèle. Mais c’est surtout de l’Italie qu’il se plaît à converser;—le Père François et Jean-Jacques Bel, qui la visitèrent en détail, lui donnent la réplique.
[p. 86] Ce qu’il admire, dans «la contrée sans rivale», ce ne sont ni ses institutions, ni ses peuples, ni ses princes. Partout, il constate la décadence; partout l’oisiveté, la débauche, la poltronnerie, la mendicité jointe aux prétentions, le brigandage, l’avarice. S’il se passionne, c’est pour les souvenirs glorieux, qui jaillissent du sol, et pour les manifestations de l’Art...
L’Art! une révélation... «Avant de franchir les Alpes, déclare-t-il, je n’en avois aucune idée!»... Mais l’initiation a été rapide, et il apporte, dans sa conception du beau, la maîtrise d’un homme habitué à observer la nature[85]. C’est en critique pénétrant, habile à découvrir le sublime d’une œuvre aussi bien que son point faible, qu’il énumère les merveilles dont son regard fut ébloui. Toutes les toiles des grands maîtres reçoivent son tribut d’hommages, mais ses dévotions ardentes s’adressent au divin Sanzio: «Il semble, s’écrie-t-il dans sa ferveur idolâtre, que Dieu, pour créer, se soit servi de la main de Raphaël[86]!»
Grisé par sa parole, il accumule les explications. Pas un tableau devant lequel il n’arrête son auditoire; pas une statue dont il ne fasse les [p. 87] honneurs!... Ce qui ne l’empêche point de passer au fil d’une implacable raillerie les villes qui recèlent ces trésors... Vérone? un mauvais lieu. Venise? un foyer de pestilence. Gênes, «où il s’ennuya à la mort?» une république dégénérée...
Seule, Florence trouve grâce à ses yeux. Avec ses jardins multicolores, sa ceinture d’orangers, ses palais de marbre, le prestige de ses légendes, ses galeries où le profane confondu avec le sacré attendrit les cœurs et exalte les âmes, la cité des Médicis exerce sur lui une invincible séduction. Le charme des habitants a achevé sa conquête. Leur simplicité le ravit. A Florence, affirme-t-il, point de luxe faux déguisant la misère; point d’édifices somptueux à l’extérieur et ruinés au dedans. La franchise y règne sans partage, alliée à la bonne grâce, à l’indulgence, à l’absence de toute recherche. Dans cette heureuse contrée, l’étiquette n’a pas de partisans, une perruque de travers n’indispose personne, et c’est à peine si, à leur équipage, on distingue le banquier opulent de son voisin le cardeur de laine... L’orateur qui, lui aussi, est un simple, se complaît dans ces détails. En contant que les anciens princes du pays allaient à pied par la ville, parapluie au dos et falot au poing, ses fibres bourgeoises tressaillent d’aise. Et c’est avec délices qu’il représente le [p. 88] premier ministre, marquis de Montemagno, prenant le frais devant sa porte, assis sur une chaise et «branlant les jambes» comme un modeste Rousselin, tandis que le grand-duc régnant devise, dans le jardin d’en face, avec les serviteurs de sa maison.
Lancé sur ce sujet, Montesquieu ne tarirait pas. Mais, pendant que Venuti, originaire de la Toscane, applaudit à tout rompre; que Guasco, un enfant du Piémont, réclame en faveur de Turin; que Barbot, né curieux, sollicite des éclaircissements sur les dames «très jolies, très gaies, très spirituelles» qui ouvrirent leurs boudoirs au voyageur, l’horloge, avec son carillon, rappelle celui-ci à la réalité...
—Neuf heures! s’écrie-t-il...
Et, feignant une terreur comique:
—Que dira mon frère le doyen, en apprenant cette débauche!
On l’entoure, on le presse, on le conjure d’achever son récit interrompu au meilleur moment... L’image du doyen grondeur semble lui donner des ailes. Suivi de l’auditoire qui proteste en vain, il passe dans l’antichambre, se drape de son manteau que lui tend un laquais à moitié endormi, en relève le col de crainte du serein, se coiffe de son chapeau «en castor d’Angleterre», et, sa [p. 89] lanterne d’une main, de l’autre «son ombrelle pour la pluie»:
—Mesdames, murmure-t-il, encore empreint du souvenir de Florence, c’est ainsi que le grand Cosme, rentrant en son palais, prenait congé de sa voisine[87]!
Sur quoi, tirant une révérence mi-sérieuse, mi-plaisante, humant l’air frais, et projetant dans la nuit le feu indécis de sa chandelle, le bonhomme, d’un pas alerte, s’engageait dans les rues solitaires aboutissant à Saint-Seurin.
L’esprit parlementaire à Bordeaux.—Sentiments politiques et religieux.—Le jansénisme n’y fait pas fortune.—Tendances de Montesquieu: détachement philosophique.—Influences qu’il subit.—Mise au point de ses œuvres.—Collaborateurs bordelais.—Guasco à La Brède.—Jean-Jacques Bel et Barbot, critiques littéraires.—L’Histoire véritable.—Lecture de l’Esprit des lois.

L’esprit qui dominait alors à Bordeaux et qui régnait exclusivement dans le salon de Mme Duplessy, c’était, avec des tendances philosophiques nettement caractérisées, le vieil esprit parlementaire—celui de la bourgeoisie, férue tout à la fois de fidélité au trône et de jalouse indépendance, fermement attachée aux anciennes franchises et résolue à accroître le champ de ses conquêtes. Tous ceux qui, de loin ou de près, tenaient à la grande Compagnie judiciaire, s’élevaient dans le culte de ces idées. Les autres corps de l’État, avec plus de réserve en apparence, professaient les mêmes doctrines. Quant à Messieurs de la Cour des Aides, bien que souvent en lutte avec leurs aînés du palais de l’Ombrière, ils n’auraient eu garde d’épouser une [p. 92] autre opinion. Barbot, qui leur servait d’oracle, demeurait inflexible sur les principes. Son livre de chevet, c’était cette correspondance de Guy Patin, dont la verve étincelante reflète avec tant de netteté l’opinion des gens de robe durant le cours du XVIIe siècle. Il ne se séparait pas du spirituel docteur, même quand celui-ci, se désolant de ne point siéger près des Blancmesnil et des Broussel, s’écriait d’un ton comique: «Il ne s’en est fallu que de cent mille écus dans mon patrimoine que je n’aie été conseiller de la Cour et frondeur aussi hardi que pas un[88]!»
C’est, en effet, un vent de fronde qui souffle aux parlementaires cette politique osée: affirmation des droits du pays dans le gouvernement de ses affaires, le contrôle des finances, le vote des édits fiscaux, l’enregistrement des lois,... tout un programme d’opposition qui, depuis la Régence, rallie l’unanimité du tiers-état. Personne encore ne vise l’édifice social. Peu ou point de plaintes contre l’organisation des citoyens en trois classes, dont deux emportent toutes les faveurs: les privilèges ne sont pas même discutés. Quant à l’affranchissement de la parole et de la plume, c’est à peine si on y aspire dans quelques cercles [p. 93] littéraires: les presses clandestines, qui ont atteint un développement prodigieux, suffisent à tous les besoins. Seul, avec l’horreur des impôts sans cesse grandissants, des corvées, des gabelles, des procédés vexatoires employés par les traitants, un désir immense se fait sentir de protéger biens et personnes contre l’arbitraire et le despotisme.
En matière religieuse, les aspirations ne sont pas moins nettes: dévouement aveugle aux libertés gallicanes et défiance résolue à l’égard de la cour de Rome. On vit en bonne intelligence avec le clergé séculier qui, fidèle à son origine plébéienne, s’obstine à repousser les prescriptions du concile de Trente. Au contraire, les congrégations inféodées au parti ultramontain sont tenues en mince estime: il n’est guère de lardons, de brocards, de nasardes qu’on ne prenne plaisir à leur décocher, à l’imitation du maître railleur dont Barbot faisait ses délices. Les robins de cette première moitié du XVIIIe siècle ont le verbe gouailleur: ce sont les descendants de ces bourgeois de la Ligue qui ne craignaient pas d’assimiler au voisinage toujours fâcheux d’une rivière, d’un avocat, ou d’une mauvaise femme, la proximité d’un couvent de moines[89].
[p. 94] Impiété? Non certes. Bien que, suivant le mot de Bayle, leur symbole ne soit pas chargé outre mesure, ils ne répudient aucun article de foi obligatoire... Moyennant quoi, ils traitent avec égards «l’orthodoxie du bon sens», laquelle, à beaucoup de consciences déjà, semble le fond de la sagesse. Depuis Montaigne et le vieux de L’Estoille, depuis Guy Patin lui-même, les esprits ont marché à pas de géant. Après la Régence, tout ce qui, dans la robe, ne se range pas sous le drapeau du jansénisme, incline vers le libre examen. Or, à Bordeaux—«le pays des croyances flottantes»—spécialement chez Mme Duplessy, le jansénisme ne fait que peu de ravages. On y défend encore unguibus et rostro ce beau livre des Provinciales qu’en 1660, sous l’inspiration du premier président de Pontac, la Compagnie judiciaire refusa de condamner[90]; mais le goût du beau style, le souci de la saine raison, l’influence philosophique et la haine séculaire des ingérences ultramontaines ont plus de part dans cette admiration tenace qu’une adhésion réfléchie aux doctrines de Port-Royal. Tandis que le Parlement de Paris se jette à corps perdu dans les querelles de la bulle Unigenitus, le Parlement de Guyenne préfère [p. 95] «le parti de se plaindre à celui de frapper»: attitude qui, sûrement, répondait au sentiment général. A plus forte raison, public et magistrats restent-ils insensibles aux disputes irritantes qui, comme celle des convulsionnaires de Saint-Médard, accusent une grossière superstition. «Dans cette Généralité, écrit l’intendant Boucher, on n’est pas fort crédule sur ce qu’on appelle miracles, à cause de la différence des religions, surtout à Bordeaux où il aborde un grand nombre d’étrangers, et même les églises y sont peu fréquentées[91].»
Montesquieu résumait en sa personne les tendances de ses compatriotes: même insouciance religieuse, avec une pointe marquée de scepticisme; même attachement aux traditions; même animosité à l’égard des princes ou des ministres—qu’ils se nomment Richelieu, Louvois ou Louis XIV—qui confisquèrent les libertés publiques et établirent sur les ruines du pays l’omnipotence du pouvoir royal.
S’il y a lieu à des réserves, c’est sur ses préférences politiques. Le douteur qui était en lui fut-il un parlementaire, dans le sens rigoureux du mot? Bien fin qui le saurait: il négligea d’allumer [p. 96] sa lanterne. Sans doute, il professe que des lois fondamentales, dont la garde sera confiée à l’ordre judiciaire, doivent tenir en bride la volonté capricieuse du maître. Sans doute aussi, il n’ose blâmer «les tribunaux d’un grand État de frapper sur la juridiction patrimoniale des seigneurs et sur l’ecclésiastique»; mais le madré se demande si ces façons de procéder sont bien correctes, étant donnée la constitution du royaume—sur laquelle, d’ailleurs, il n’a garde de fournir des précisions. Il constate, en même temps, que si le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, «autant il est convenable dans une monarchie, surtout celles qui vont au despotisme...» Une vraie formule de normand, ne prenant couleur ni pour ni contre, ménageant Rome et Versailles, sans rompre avec le Parlement. Que dire de ce langage, digne de l’oracle d’Éphèse, lorsqu’on le compare à la netteté de ces grandes remontrances «plus redoutables que le canon», et aux affirmations audacieuses des légistes du XVIe siècle qui, avec Étienne Pasquier, posèrent les bases de notre droit public!
Montesquieu gardait-il quelque dépit de son attitude effacée au palais de l’Ombrière? Cédait-il, malgré le libéralisme de son génie, aux préjugés de race qui le poussèrent à commander cette [p. 97] sotte chose—le mot lui appartient—qu’on appelle une généalogie? N’est-ce point plutôt que, voyageant à travers les âges, de peuple en peuple, de régime politique en dogme religieux, sa pensée, éprise d’idéal, dédaigna de s’astreindre aux réalités du présent?... A quoi il faudrait joindre une dose de cette crainte révérencielle qui, au dire de l’Écriture, est la marque de la sagesse. Les «juvenilia» des Lettres persanes hantaient sa mémoire, et il ne lui agréait point de s’exposer à de nouvelles tribulations: «Je veux, déclare-t-il, éviter toute occasion de chicane.»
Seul, l’instinct de la conservation, très développé chez lui, suffirait à expliquer son effacement dans les luttes incessantes que la robe soutenait contre la Couronne; mais parfois la malice se mêlait à sa tiédeur. Comment oublier la question qu’après la chute du Système il adressait à Law?
—Pourquoi, Monsieur, n’avoir pas, comme cela se pratique en Angleterre, essayé de séduire le Parlement?
Ce qui lui valut cette réplique:
—Monsieur, nos sénateurs ne sont pas de grands génies, mais on les sait incorruptibles.
D’empirique à robin la riposte était dure.—Il est vrai que ce railleur émérite devait, un jour, faire amende honorable. Arrivé au terme de sa [p. 98] carrière, il formulera en termes non équivoques sa respectueuse estime pour ceux dont jadis il avait partagé les travaux: Que serait devenue, s’écrie-t-il, la plus belle monarchie du monde sans les lenteurs, les plaintes, les prières de ses magistrats!...
Où Montesquieu subit sans conteste l’influence de son entourage, c’est dans le choix qu’il fit de ses premiers sujets d’étude: le souci des recherches scientifiques, alors très en vogue en Guyenne, devança chez lui le culte de la pensée. Plus tard, dans les retouches perpétuelles opérées à ses œuvres—il faisait des brouillons même pour ses billets doux[92]!—l’empire exercé par ses compatriotes se manifestera d’une façon plus saisissante encore... On aurait peine à découvrir un écrivain aimant à ce degré les corrections et les conseils. Rien ne le distrait de cette préoccupation qu’il faut se relire sans cesse sous le contrôle d’un ami. Elle passe avant ses affaires de famille, avant le soin de ses procès, avant les inquiétudes que lui cause sa vue, pour laquelle il devra, un jour ou l’autre, «ouvrir le volet de la fenêtre[93]...» La légende rapporte que Molière essayait sur sa [p. 99] gouvernante les effets dont il ne se sentait pas sûr: on peut gager que Montesquieu, à l’ombre de ses bois de pins, soumit à la même épreuve son factotum Léveillé.
A Paris, le nombre est incalculable de ceux qu’il consulta avant d’affronter le public: parmi les femmes, Mmes de Tencin, du Deffant, de Lambert, de Mirepoix et cette nymphe lascive qu’on nomme Mlle de Clermont; parmi les hommes, Helvétius, Silhouette, le président Hénault, le chevalier d’Aydie, Saurin, Fontenelle, Crébillon, bien d’autres encore. Il y en a de tous les pays, sans compter le Père Castel qui n’était d’aucun et dont la mission consistait à dégager les points de conscience. L’honnête Jésuite accomplissait sa besogne comme s’il eût siégé à la congrégation de l’Index; il changeait un mot par-ci, une phrase par-là, raturait, expurgeait, supprimait, sans rencontrer d’opposition. «Je ne connais rien de plus noble, s’écriait-il, que votre facilité à vous prêter à tous les tempéraments.» Éloge mérité: Montesquieu, sans doute en expiation de ses vieux péchés, se prêtait avec une complaisance inaltérable.
A part cette spécialité, dont le Révérend Père conserva le monopole, c’est à Bordeaux qu’étaient réunis ses censeurs les plus précieux: Barbot, Jean-Jacques Bel, l’abbé de Guasco...
[p. 100] Ce dernier n’ayant en France ni famille ni attaches, Montesquieu l’attirait facilement chez lui. C’est à La Brède qu’il prenait le plus de plaisir à le recevoir: «Je me fais une fête de vous mener à ma campagne où vous trouverez un château gothique, à la vérité, mais orné de dehors charmants, dont j’ai pris l’idée en Angleterre. Comme vous avez du goût, je vous consulterai sur les choses que j’entends ajouter à ce qui est déjà fait. Mais je vous consulterai surtout sur mon grand ouvrage qui avance à pas de géants depuis que je ne suis plus dissipé par les dîners et les soupers de Paris. Mon estomac s’en trouve aussi mieux, et j’espère que la société avec laquelle vous vivrez chez moi sera le meilleur spécifique contre vos incommodités.»
Il y aurait eu mauvaise grâce à refuser. D’autant mieux que le châtelain revenait à la charge, réfutant les objections, aplanissant les obstacles... L’éloignement? deux heures de Bordeaux. La fatigue? il n’est pas d’exercice préférable à celui du cheval... Montesquieu, avec le docteur Sydenham, estime que c’est une panacée infaillible contre les vapeurs et la faiblesse des poumons[94]. Il possède, d’ailleurs, une monture [p. 101] merveilleuse qui est «comme un bateau sur un canal tranquille, comme une gondole de Venise, comme un oiseau qui plane dans les airs.» Et lorsque l’abbé s’est, une première fois, rendu à ses instances, comment se dispenser de revenir! La Brède s’est transformée d’après ses conseils: c’est le plus beau lieu qu’on puisse voir. Les prairies ont réussi au delà de toute attente, le papillon a brisé sa chrysalide, et Léveillé, son régisseur fidèle, ne cesse de s’écrier: Boudri bien que M. l’abbé bis aco!
Oh! les heures ne restent pas inoccupées dans la vaste bibliothèque, dont la porte—étroite et basse—est surmontée de cette devise: Hic mortui docent vivos mori. Heures délicieuses! Le président a des coquetteries adorables, des flatteries enveloppantes, des inflexions de voix irrésistibles en leur saveur gasconne... L’abbé, j’ai envoyé votre anacréontique à ma fille: une pièce exquise!.. L’abbé, j’ai lu votre épître à la comtesse: c’est du dernier galant!... L’abbé, je vous sacre poète!—Il le présente à tous comme un grand homme, applaudit à ses succès, le coiffe de couronnes, l’accable de lauriers...
Après quoi, il le gratifie de dissertations sur les Grecs et les Romains, l’histoire de Pachymère, Carthage, Babylone, Alexandrie, répandant sur [p. 102] le monde antique des torrents de lumière. On passe ensuite aux manuscrits. On lit tout, de la première à la dernière ligne, sauf à relire encore quand les retouches seront mises au net. Le grand ouvrage absorbe le plus clair des soirées; mais on n’a garde d’oublier les travaux moins sévères, car tout, dans cet esprit, est matière à préoccupations. Il n’est pas jusqu’aux critiques qui ne l’inquiètent. Décèlent-elles une plume janséniste ou huguenote? il est sur des charbons ardents. Tournent-elles à sa louange? Le souci n’est pas moins vif, car chacun, lui semble-t-il, aura cette impression que l’admiré conniva avec l’admirateur.
Quelque profondes que fussent ses sympathies pour Guasco, l’intimité était autrement grande avec Jean-Jacques Bel et Barbot: des amis de vieille date et des correcteurs à toute épreuve. Ce n’est point un simple avis qu’il sollicite d’eux, mais un examen confinant à la collaboration. «Je vous dirai, écrit le président, que Mademoiselle[95] m’obligea, il y a quelque temps que j’étois chez elle, à lui lire un petit roman. Je voudrois bien vous l’envoyer pour savoir ce que vous en pensez. Mme de Mirepoix, à qui je le [p. 103] montrai, et qui a prodigieusement de goût, me fit quatre ou cinq critiques très bonnes et dont je profitai. Il faudroit donc, si je vous l’envoie, que vous en jugeassiez sans flatterie, car je sais bien que vous ne me jugerez pas avec sévérité, que votre cœur sera pour; mais je voudrois que votre esprit fût contre...» Et, précisant la nature de la mission confiée, il spécifie en ces termes: «Il faudroit que le jugement portât sur le tout et sur les parties, même sur les fautes de style[96].»
Ainsi dit, ainsi fait....
Les publications récentes du baron de Montesquieu en fournissent une preuve décisive. L’éditeur des Mélanges a cru devoir—il faut l’en louer—joindre à l’une des productions inédites de son ancêtre, intitulée Histoire véritable, la critique qu’en fit Jean-Jacques Bel: un travail qui révèle, chez son auteur, les plus hautes qualités de discernement, d’érudition, de tact. Jamais oracle du Lundi ne fit preuve d’une plus grande maîtrise: douze pages de remarques sur les transformations du héros de cette aventure, lequel n’est autre qu’un métempsycosiste, tour à tour valet fripon, sauterelle, éléphant, galant trompeur, mari [p. 104] trompé, escroc, petit-maître, eunuque, courtisan, courtisane... Parfois Jean-Jacques Bel s’écrie: Admirable! En quoi, il a raison. Mais, quand l’occasion s’en présente, il ne craint pas de dire: ceci est bas, cela manque de goût, ce passage est de trop, cet autre ne vaut guère... Il met chaque paragraphe au point, et, finalement, conclut de la façon suivante: moi, je recommencerais!... Telle était la confiance inspirée par lui que l’Histoire véritable resta enfouie au fond d’un tiroir.
Barbot procédait de la même manière... La tradition assure que quelques-unes des Lettres persanes émanent de lui. N’en retenons qu’un enseignement, c’est qu’on le jugea capable de les écrire; mais le bijou littéraire tiré des épanchements de Rica et d’Usbek marque trop d’unité pour que deux plumes aient pu s’y confondre. Le rôle de Barbot, pour être plus modeste, n’en fut pas moins utile; c’était celui du jardinier qui, à l’heure où la plante entre en travail, dirige ses efforts, facilite les poussées de sève, élague les frondaisons parasites, contribue, en un mot, à l’épanouissement de la fleur et du fruit.
Ce lettré, doublé d’un penseur, suivit avec amour la gestation de l’Esprit des lois: pas une idée, pas une formule n’échappa à son contrôle. La dette contractée vis-à-vis de lui était lourde: [p. 105] c’est dans sa demeure, en signe de reconnaissance, que le manuscrit vit le jour pour la première fois. Le 10 février 1745, Montesquieu écrivait à Guasco: «Je serai en ville après-demain. Ne vous engagez pas à dîner pour vendredi. Vous êtes invité chez le président Barbot. Il faudra y être arrivé à dix heures précises du matin pour commencer la lecture du grand ouvrage...»
Elle eut lieu, à l’heure dite, cette lecture mémorable. Quelles personnes y assistèrent? Montesquieu n’avait annoncé que son fils et Guasco[97]; mais on peut tenir pour certain que d’autres amis furent convoqués... Durant trois jours, la voix chaude du Président se fit entendre: quelques critiques, suivies aussitôt de corrections, quelques éclaircissements, fournis d’une humeur parfaite, tels furent les seuls incidents de cette scène digne du pinceau d’un maître. Et ce fut une admiration sans mélange quand l’auditoire découvrit l’enchaînement du corps de doctrines qui allait devenir le guide des législateurs de tous les pays!
Combien différent devait être l’accueil de Paris! Le cénacle qui eut la primeur de l’Esprit des lois ne comprenait pourtant que lettrés et philosophes: [p. 106] Hénault, Saurin, Crébillon, Fontenelle... Leur arrêt fut aussi dur qu’inattendu: ces juges perspicaces insinuèrent qu’il serait sage de jeter le manuscrit au feu...
Helvétius ne se montra pas moins cruel. Pour lui, Montesquieu faisait sa cour aux préjugés comme l’adolescent en use à l’égard des coquettes hors d’âge; il pactisait avec l’erreur et sacrifiait à la flatterie. «Passe pour les prêtres, déclarait-il! En faisant votre part de gâteau à ces cerbères de l’Église, vous les faites taire sur votre religion; sur le reste, ils ne vous entendent pas. Nos robins ne sont en état ni de vous lire, ni de vous juger. Quant à nos aristocrates et à nos despotes de tous genres, s’ils vous entendent, ils ne doivent pas trop vous en vouloir: c’est le reproche que j’ai toujours fait à vos principes...» Critique judicieuse, formulée en termes heureux!—C’est ce que ce pédant, à l’esprit étroit, appelait «envelopper son jugement de tous les égards de l’intérêt et de l’amitié...»
Quel fut, après cette seconde lecture, l’état d’âme de Montesquieu? Sa foi dans l’œuvre capitale de ses veilles ne subit-elle aucune atteinte? On peut croire, étant donnée sa nature inquiète, qu’il fut touché au cœur... Heureusement, ses fidèles de Guyenne veillaient. Barbot ne cessait de répéter:
[p. 107] —Président, ils ne vous comprennent point. Laissez-les dire; imprimez: vous irez plus loin qu’eux...
Parole réconfortante dont la conviction finit par s’imposer... Qui sait! sans cet encouragement suprême, peut-être le genre humain, qui avait perdu ses titres, eût-il attendu encore un siècle avant de les retrouver.
Renaissance littéraire.—Nouveaux salons bordelais.—Mmes de La Chabanne et Desnanots.—Brevets de la calotte.—S. de Lagrange et son poème.—Mme Duplessy auteur.—Denise de Montesquieu: hommage poétique de Guasco.—Publication de l’Esprit des lois.—Mort de Montesquieu.

Quand on étudie le Bordeaux de cette époque, on est saisi du contraste qui existe entre la ville et ses habitants.
La vieille capitale de l’Aquitaine est encore telle que la créèrent les exigences du moyen âge: rues obscures, étroites, malpropres, obstruées de puits à larges margelles et de dépôts de fumier; logis humides et délabrés, même ceux des personnes de distinction—lesquelles considèrent comme une preuve de noblesse la vétusté de leur hôtel patrimonial. Les spectacles répugnants surgissent à chaque pas: ici, des charniers garnis de débris hideux; là, les appareils sanglants de la justice royale; partout, des bandes de loqueteux étalant au soleil l’interminable série des infirmités humaines. Ce ne sont, le long des cloaques impurs, [p. 110] que portes mystérieuses, venelles et culs-de-sac transformés le soir en autant de coupe-gorge, qu’enchevêtrements bizarres d’arêtes vives, d’angles, de pignons en pointe bravant le ciel et déchiquetant la nue, que bastions branlants et murailles menaçant ruine, autour desquelles s’étendent les fossés garnis d’une eau verte qui décompose tout ce qu’elle reçoit et ne cesse d’exhaler la peste... C’est le passé, avec ses tares, ses infections, ses souvenirs sinistres.
Au rebours de la cité même, le Bordelais de cette première partie du XVIIIe siècle semble ne vivre que dans l’avenir. Impatient de briser le moule où se frappa l’image des aïeux, il a soif de liberté, d’air, de lumière. Toute nouveauté l’attire, tout progrès le ravit. Jamais le goût des lettres et des sciences ne fut plus vif. C’est par charretées que se débitent mappemondes, plans, instruments de physique et d’astronomie, livres, journaux... Les poésies succèdent aux mémoires, les essais historiques aux pièces de théâtre[98]. Des conférences se fondent[99], [p. 111] les lectures se multiplient, les manuscrits circulent, les presses gémissent, la fièvre est générale... C’est la renaissance de la pensée sous ses formes les plus diverses.
Qu’on ouvre, pour ne citer que ce recueil, la collection du Mercure de France[100]: on trouve, côte à côte, un article de Venuti, le dialogue de Sylla et d’Eucrate et des notes de M. de Raoul sur un ruisseau inflammable, en même temps que des vers de l’avocat Daçarq à l’adresse de Lefranc de Pompignan et de Mgr Mongin, évêque de Bazas[101].
Continuons à feuilleter... Voici une polémique entre un Bordelais, qui ne dit point son nom, et l’illustre Jean-Jacques. Celui-ci, par l’humeur même qu’il manifeste, rend hommage au talent de son adversaire: «Qu’un bel esprit de Bordeaux, déclare-t-il, m’exhorte gravement à laisser les discussions politiques pour faire des opéras, attendu que lui, le bel esprit, s’amuse plus à la représentation du Devin du village qu’à la lecture du Discours sur l’inégalité, il a raison [p. 112] sans doute s’il est vrai qu’en écrivant aux bourgeois de Genève je sois obligé d’amuser les bourgeois de Bordeaux[102].»—Peu s’en faut que, dans son dépit misanthropique, le cavalier servant de Mme d’Houdetot ne rompe en visière à toute la Gascogne.
La Gascogne, dans une guerre à coups d’écrits, n’eût pas fait mauvaise figure. Une armée nombreuse de volontaires—robe, clergé, commerce même—se rangeait sous les drapeaux des chefs dont nous avons parlé. Il faut y joindre un escadron d’amazones en mesure d’affronter toutes les luttes... Mmes Duplessy, de Pontac, d’Aiguillon, n’étaient pas seules à rêver de lauriers: beaucoup de femmes—ne doutons point qu’elles ne fussent jolies—avaient à cœur de marcher sur leurs traces.
Parmi ces ambitieuses s’en trouvent deux qu’il faut mettre hors de pair: Mmes de La Chabanne et Desnanots: la première, femme d’un trésorier de France, propriétaire du marquisat de Dune; la seconde, mariée à un conseiller au Parlement, seigneur de la terre de Conas. L’une et l’autre tiennent salon ouvert, rivalisant de séductions pour attirer les beaux esprits. Prévenances délicates, compliments hyperboliques, table somptueuse, [p. 113] rien ne leur coûte. On assure même qu’afin d’imprimer plus d’éclat à leurs fêtes, elles recrutent, par l’entremise d’émissaires expédiés en avant-garde, les étrangers de distinction débarqués dans la ville. Peu s’en faut qu’on ne les représente, comme sœur Anne, fouillant, à l’aide d’une longue-vue, les rues, les quais, les places publiques, pour découvrir des phénomènes littéraires.
Le procédé prêtait au rire. Or c’était le temps des brevets de la Calotte, contresignés du dieu Momus et de son prophète, le garde du corps Aymon:—une manière de satires devant lesquelles aucun ridicule ne trouvait grâce. La duchesse d’Aiguillon et Mme de Pontac excellaient dans ce genre d’écrits moqueurs. Enrôler Mmes Desnanots et de La Chabanne dans la confrérie des mystifiés leur parut œuvre pie... Le conseiller de Navarre ne craignit point de se joindre à elles. De cette collaboration à trois naquirent deux brevets qui, répandus sous le voile de l’anonyme, défrayèrent la province.
Mise en scène avec son époux, lequel ne comptait guère dans la maison, Mme de La Chabanne subit la première attaque:
Mme Desnanots ne fut pas mieux accommodée. Certaine allusion au dictionnaire de Furetière et Bacholet—les Littrés de l’époque—constitue [p. 115] une ironie cruelle à l’adresse de ses visées pédagogiques. Par contre, plus heureux que M. de La Chabanne, le conseiller Desnanots—le sage Desnanots, comme l’appelait Lagrange-Chancel[104]—ne fut point pris à partie:
Jalousée par ces rivales, Mme Duplessy triomphait sans combat: beaucoup, à cause de son mérite; peut-être également parce qu’elle n’affichait aucune prétention. Elle aussi, en effet, s’oubliait à écrire «certaines bagatelles». Elle s’en expliquera, quarante ans plus tard, dans les termes suivants: «J’ai trouvé, en cherchant mes cahiers d’arithmétique, un petit ouvrage d’imagination, [p. 117] qui n’a jamais été lu que par deux personnes et qui vous amusera peut-être. Je l’écrivis tel qu’il est, d’un trait de plume, et je l’avois très parfaitement oublié. Au reste, ce n’est point par mystère, mais par oubli qu’il n’a été vu que par le président Barbot, lequel vouloit me l’enlever pour l’envoyer au Mercure, et par votre cousine qui trouva un jour le petit cahier sur ma table... Vous verrez que c’est l’esquisse d’un badinage qui peut être lu par tout le monde.»—Péché de jeunesse, confessé avec autant de grâce que de modestie...
Loin de décocher des épigrammes à Uranie-Bérénice, les beaux esprits ne songeaient qu’à chanter ses talents. L’un deux—il signe S. de Lagrange[106]—les célèbre dans un poème édité à La Haye, chez Jacob Brito, imprimeur de nosseigneurs les États de Hollande, à l’enseigne de la Pomme d’or. Bordeaux, tel est le titre de cette œuvre: une apothéose de l’antique cité d’Ausone et de la ville nouvelle édifiée par Tourny. Ses monuments, ses avenues, son jardin public peuplé de faunes, de sylvains et d’hamadryades, son fleuve puissant, le port de la Lune avec ses maisons flottantes,
De l’empire des mers orgueilleux ornements,
[p. 118] ses quais, ses places, ses ruines, font l’objet d’enthousiastes descriptions. Après avoir porté aux nues ce séjour heureux, où la terre est féconde et le commerce riant, le barde gascon énumère les personnes qui en sont l’honneur. Montesquieu figure en tête. Jean-Jacques Bel et Barbot viennent après, confondus dans une strophe admirative:
L’Académie, ainsi que le Parlement, a son couplet dans cette revue qui s’ingénie à n’oublier personne. Élisabeth Duplessy, elle-même, y occupe un bon rang, après sa mère:

[p. 119] Seul, Dom Galéas n’est pas mentionné. Silence cruel: il dut en faire une maladie... Le pauvre homme dont les inspirations, agrémentées de gestes olympiens, ne passaient jamais inaperçues, méritait au moins une allusion discrète...
C’est la période glorieuse de l’hôtel du Jardin-Public. Le renom de l’aimable femme qui préside à ses destinées s’étend au delà des limites de la région. On la cite comme l’émule de Mme Geoffrin, les gens de lettres la consultent, les philosophes la prennent pour arbitre, et il n’est pas de savant égaré en Gascogne qui ne sollicite l’honneur de lui être présenté.
A cette époque, Montesquieu, quoique sexagénaire, possède encore une grande activité. Il voyage volontiers, allant de La Brède à Clairac, où le châtelain du lieu, le chevalier de Vivens, lui fait fête[109]; poussant même jusqu’en Languedoc chez son frère le chanoine de Saint-Seurin, devenu abbé de Nizor; revenant ensuite au sol natal «jouir des douceurs de ses amis et de sa patrie». Bordeaux, c’est le calme: il le goûte avec délices... Il n’en continue pas moins son [p. 120] rude labeur, dirigeant avec sollicitude les travaux de cette Académie dont les lettres d’établissement lui semblent des titres de famille[110]. Mais si son courage reste entier, sa vue, affaiblie de longue date, lui refuse maintenant tout office. Qu’importe! N’a-t-il pas à ses côtés un secrétaire intime qui ne répugne à aucune lecture, quelle qu’en soit l’aridité? Ce secrétaire, c’est la plus jeune de ses filles, Denise de Montesquieu...
Une chaste apparition, toute de grâce, d’esprit, de tendresse: un rayon de lumière dans ce ciel obscurci. Guasco lui adresse un respectueux hommage en vers italiens traduits par Lefranc de Pompignan:
Montesquieu acclamait cette inspiration heureuse, éclose dans les bois de La Brède, et, ravi [p. 121] de la voir reproduite dans le Mercure de France, feignait une désolation comique. Que n’avait-il connu plus tôt ce galant sonnet! Comme il l’eût constitué en dot à la pieuse Antigone, que, justement, il venait de marier à Godefroy de Secondat[112]!
Hélas! la publication de l’Esprit des lois allait troubler ces joies domestiques... Où la faire? En Hollande? On n’y doit pas songer... En Angleterre? Moins encore: une ennemie avec laquelle il ne faut lier commerce qu’à coups de canon... A Genève, alors? à Bâle? à Soleure? Grave problème.—Même souci pour le nombre des volumes, leur composition, leur format...
Toutes ces questions résolues, et l’ouvrage enfin lancé dans le monde, que d’angoisses! «J’ai la maladie de faire des livres, confesse le président, et d’en être honteux quand je les ai faits...»
Dans l’espèce, ses craintes n’étaient point chimériques. Dût-il en coûter à l’amour-propre national, il faut bien l’avouer: sauf de rares exceptions, l’impression première fut défavorable. D’Alembert le constate avec la réserve qui sied aux discoureurs académiques: l’Esprit des lois, dit-il, fut traité légèrement jusqu’au jour où «la partie du public qui enseigne dicta à la partie [p. 122] qui écoute ce qu’elle devoit penser et dire». L’opinion agressive d’Helvétius prévalut dans les cercles littéraires... Collé s’en explique nettement: les gens, assure-t-il, qui ont un peu de philosophie dans la tête, prétendent que c’est un mauvais ouvrage, sans ordre, sans liaison, sans enchaînement d’idées, sans principes: le portefeuille d’un homme d’esprit, voilà tout[113]... Fontenelle persistait dans ses hésitations, malgré Mme de Tencin, une admiratrice de la première heure. Saurin ne déguisait pas ses sentiments hostiles. Quant à Voltaire, il avait, comme toujours, deux faces et deux langages... A un mot louangeur, devenu historique[114], succédait une parole de dénigrement: «L’Esprit des lois, c’est l’esprit sur les lois, je n’ai pas l’honneur de le comprendre...» Il ne prenait même pas la peine de déguiser sa mauvaise humeur: quand Mme d’Aiguillon lui demande quelques vers en manière de préface pour le chef-d’œuvre du XVIIIe siècle, il s’excuse sur les imperfections de notre langue qui se [p. 123] prête mal au style lapidaire, sur l’inutilité d’une pareille exhibition en faveur d’un livre qui n’y gagnera rien, sur l’épuisement de sa veine poétique... A Thiériot, il disait crûment: la duchesse m’a commandé quatre vers comme on commande des petits pâtés, mais mon four n’est point chaud.—A ce moment, l’Esprit des lois avait eu plus d’éditions que n’en atteignit jamais la Pucelle[115]!
Traité de la sorte par ceux qui entretenaient avec lui commerce d’amitié, Montesquieu était, de la part de ses ennemis, l’objet d’attaques déchaînées. Les frelons bourdonnant à ses oreilles se faisaient légion. Les détracteurs étaient innombrables, depuis le futile de la Porte jusqu’au pesant financier Dupin. La Sorbonne revenait à la charge; les jansénistes, dans les Nouvelles ecclésiastiques, jetaient feu et flammes; la Compagnie de Jésus en appelait au tribunal de l’index qui, en dépit des assurances du Père Castel et malgré les satisfactions offertes par l’auteur, n’hésitait pas à déchaîner ses foudres[116].
Le pauvre homme! Il n’en fallait pas tant pour [p. 124] l’émouvoir. Dès la première alerte, il gagne précipitamment Paris et s’efforce, avec l’aide de quelques intimes, de tenir tête à l’orage,—encouragé, d’ailleurs, par les témoignages enthousiastes venus de l’étranger. Le matin, il répond aux pamphlets éclos la veille, fournit des éclaircissements, amende certains chapitres perpétuellement retouchés... Le soir, il promène sa figure spirituelle dans les salons influents. Oh! l’habile diplomate, l’enjôleur irrésistible! Sa bonne grâce est inépuisable, comme sa gaieté, ses saillies, ses prévenances. Il décoche un madrigal à Mme de Mirepoix, se proclame le philosophe de Mme du Deffant, entre en galanterie avec Mme Duchâtel, dépose ses hommages aux pieds de Mme de Pompadour... Il fait sa cour à toutes les femmes. Les femmes! ce furent elles—principalement Mmes d’Aiguillon et de Tencin—qui, retournant l’opinion, élevèrent un autel à son génie[117].
Ses déboires, malgré tout, ne diminuaient guère. Le poids de l’âge aussi se faisait sentir. Les veilles le fatiguaient; les soupers—surtout ceux de l’hôtel de Brancas «où l’on se crevoit»—mettaient [p. 125] son estomac en déroute... Je ne suis plus fait pour ce pays, murmurait-il! Et, soupirant le mot du poète—o rus, quando te aspiciam!—il reprenait, meurtri, le chemin de sa chère Gascogne.
Combien changée, hélas! De nombreux vides s’étaient produits dans les rangs de ses fidèles. Jean-Jacques Bel, épuisé par le travail, avait disparu, laissant d’ineffaçables regrets[118]. Le vieux président de Gascq s’était retiré du monde, ainsi que M. de Marcellus dont le testament était l’objet de toutes les conversations[119]. M. de Navarre, oublieux des brevets de la Calotte, donnait, tête baissée, dans la métaphysique. Venuti, nommé prévôt de Livourne, venait de quitter la Guyenne, suivi par l’abbé de Guasco[120]. Il n’est pas jusqu’à la comtesse de Pontac qui n’eût fui vers d’autres climats! Cette sirène qui, comme Ninon, découvrit le secret d’une éternelle jeunesse, contractait, sur le tard, de nouveaux liens... une déplorable union, dans le genre de [p. 126] celle du chevalier Citran, lequel, s’étant marié aux îles pour s’enrichir, reçut en dot—tout bien liquide—«sept barriques de sucre une fois payées!» Pauvre comtesse: le souvenir de sa déconvenue est le dernier qui reste d’elle.
Des soucis d’un autre genre attendaient Montesquieu à La Brède. Une série de récoltes mauvaises, succédant à l’épouvantable famine de 1748, avait achevé la ruine du pays. Le sort du riche faisait pitié, celui du pauvre arrachait des larmes... Pouvait-on se divertir en présence de pareilles misères! Le président consacrait ses loisirs à soulager les infortunes, ouvrant largement sa bourse et ses greniers; mais, comment suffire à tout!
Dans son impuissance à remédier au mal, l’idée le hanta de retourner à Paris. Ses amis s’attendaient d’autant moins à le voir réaliser ce projet que sa vue devenait de plus en plus précaire. Rien ne l’arrêta. Vers le milieu de décembre 1754, il quitta La Brède pour se rendre à Bordeaux où il séjourna jusqu’à la fin du mois. En janvier, il prenait gîte chez Mlle Betti, la logeuse de la rue Saint-Dominique: c’est là qu’il expira, le 10 février...
Chacun connaît la relation adressée à Suard, par Mme Dupré de Saint-Maur, sur les derniers [p. 127] moments du président. La duchesse d’Aiguillon qui, elle aussi, avec un soin jaloux, veilla à son chevet, en rendit compte à Guasco dans un billet dont, sûrement, une reproduction, plus détaillée peut-être, fut transmise au cénacle de Bordeaux: «Je n’ai pas eu le courage, Monsieur l’abbé, de vous apprendre la maladie, encore moins la mort de M. de Montesquieu. Ni le secours des médecins, ni la conduite de ses amis, n’ont pu sauver une tête si chère. Je juge de vos regrets par les miens. Quis desiderio sit pudor tam cari capitis! L’intérêt que le public a témoigné pendant sa maladie, le regret universel, ce que le roi en a dit publiquement que c’étoit un homme impossible à remplacer, sont des ornements à sa mémoire, mais ne consolent point ses amis: je l’éprouve. L’impression du spectacle, l’attendrissement se passeront avec le temps; mais la privation d’un tel homme dans la société sera sentie à jamais par ceux qui en ont joui... Je ne l’ai pas quitté jusqu’à l’instant qu’il a perdu connaissance, dix-huit heures avant sa mort.»—Hommage suprême venu du cœur, allant au cœur: en ce jour néfaste, l’hôtel du Jardin-Public perdait la plus glorieuse de ses illustrations.
Au moment où cette foudroyante nouvelle [p. 128] parvenait à Bordeaux, la ville était en proie à de vives émotions. Depuis quelques années déjà, la période calme du règne de Louis XV avait pris fin, laissant le champ libre aux agitations les plus diverses. Plus que toute autre région, la Guyenne devait subir le contre-coup du malaise général: deux hommes, restés légendaires à des titres différents—M. de Tourny et le maréchal de Richelieu—allaient la bouleverser de fond en comble. Sous l’action exercée par eux, la société bordelaise, de pacifique et recueillie qu’elle était, devient irritable, frondeuse, militante, et part en guerre contre le pouvoir, dans la personne de ses représentants...
C’est sûrement l’époque la plus curieuse de l’histoire locale, en même temps que l’une des moins connues. Essayons, en nous restreignant, d’en dégager les grandes lignes.

M. de Tourny: son origine, ses qualités, ses défauts.—Rapports des intendants avec la société parlementaire.—MM. de Foullé et Boucher.—Débuts conciliants du nouvel intendant: ses rêves d’embellissement de la ville.—Querelle avec l’Académie.—Rupture avec le Parlement: affaires des grains, du théâtre et du terrier de Guyenne.—Le président Le Comte de La Tresne.—M. de Grissac: quatrain en son honneur.—MM. Le Blanc père, Le Blanc de Mauvezin, Dudon, de Carrière.—Intervention de d’Aguesseau.—Reprise des hostilités: MM. de Cazeaux, de Combabessouse, de Sallegourde, Drouilhet, Vayssière de Maillat.—Sentiment de d’Argenson.—Opinion publique, d’après M. de Lamontaigne.

Que M. de Tourny eût, un jour, franchi les grilles de l’hôtel du Jardin-Public, la question n’est pas douteuse. Qu’il y ait eu son couvert, côte à côte avec les habitués, on peut affirmer que non. L’administrateur distingué qui, à l’exemple de cet empereur romain célébré par l’histoire, laissa une superbe capitale là où il n’avait trouvé qu’un amas de masures, était, en sa qualité de représentant du pouvoir royal, l’objet d’une défiance insurmontable...
Les intendants, en effet, disposaient d’une puissance telle qu’on pouvait tout craindre d’eux. [p. 130] Vers la fin du règne de Louis XIV, leurs attributions absorbent l’intégralité des services publics: organisation municipale, agriculture, police, enrôlement des troupes, marine, haras, Université, librairie, commerce, assiette et recouvrement des impôts, voirie, justice... Les gouverneurs eux-mêmes—de grands seigneurs pour la plupart—ne remplissent plus qu’un rôle de parade: on n’a recours à leur autorité qu’en cas de troubles ou de guerre. En fait, la charge dont ils sont investis s’efface devant celle de l’intendant passé à l’état de maître souverain et, parfois aussi, de censeur indiscret. Le maréchal de Richelieu s’en plaindra amèrement: «Je n’en finirois pas, écrit-il, si je voulois tracer ici toutes les tracasseries auxquelles, de ce côté, est exposé le gouverneur le plus heureux du monde.»
Seul le pouvoir judiciaire, s’appuyant sur l’opinion, résistait à cet envahissement. A Bordeaux, le Parlement ne courba jamais la tête: ce fut la cause principale de sa popularité. Il n’y eut guère, en effet, en Guyenne comme ailleurs, d’intendant qui ne se fît le serviteur docile du caprice royal. Personne, au XVIIIe siècle, n’avait perdu la mémoire de l’un d’eux, M. de Foullé, seigneur de Prunevault, dont les procédés pour la levée des tailles dépassent ce que l’histoire [p. 131] enregistre de plus odieux[121]. Tous, sans doute, n’usèrent pas de pareils moyens; mais il n’en est aucun qui, pour faire triompher les entreprises de la Couronne, ne recourût à l’arbitraire et à la force brutale.
En dépit des services qu’ils rendaient, lorsque l’intérêt du roi n’était pas en opposition directe avec celui de ses sujets—opposition, hélas! trop fréquente,—ces despotes au petit pied ne rencontraient partout qu’une hostilité souvent irréductible. Le discrédit attaché à leur personne était si profond qu’un des esprits les plus modérés de son temps, M. de Lamontaigne, trace d’eux le portrait suivant: «Un homme arrive en poste dans une province. Il dit: J’ai tout pouvoir sur vous, soit dans ce qui regarde la police, soit dans ce qui regarde la justice ou les finances. Je suis votre maître, votre juge. Fléchissez: l’obéissance doit être votre partage. Le prince vous soumet à mon empire: je viens ici tenir sa [p. 132] place et vous me devez la soumission... Il dit. Il faut le croire, et malheur à qui osera lui déplaire dans tous les ordres où il va prostituer le nom du prince, le plus souvent pour commettre les plus grandes injustices et les vexations les plus criantes[122].»
Exagérée ou non, cette appréciation dominait, sans réserves, dans le monde parlementaire, dont une indépendance frondeuse, poussée jusqu’à la révolte, constituait la règle de conduite. L’irritation vis-à-vis des intendants y était d’autant plus vive que la plupart d’entre eux avaient appris le maniement des affaires publiques au sein des grandes Compagnies judiciaires: le jour où ils se séparaient d’elles, on les considérait comme des transfuges désertant les traditions libérales de la magistrature pour grossir le nombre des courtisans et «des suppôts ministériels».
C’est dire qu’entre officiers de justice et délégués royaux, on se traitait de Turc à More. Rivalités de personnes et conflits d’attributions éclataient à tout propos. De part et d’autre, on ne négligeait aucun prétexte à picoteries. L’intendant ne se faisait point faute d’humilier la [p. 133] robe, des rangs de laquelle il sortait. De son côté, la robe ne manquait pas de payer l’intendant de la même monnaie. C’est ainsi que le prédécesseur de Tourny, M. Boucher, dut subir, pour se faire recevoir au Parlement, la mortification de recommencer ses visites, les premières, faites par simples billets—nous dirions aujourd’hui par cartes—étant jugées insuffisantes[123].
Deux camps existaient donc, nettement tranchés. Les parlementaires, entourés de sympathies et de respect, voyaient s’ouvrir devant eux toutes les portes. Au contraire, l’intendant en était réduit à un petit groupe composé des trésoriers de France, presque aussi impopulaires que les traitants[124], des candidats aux prébendes officielles et de quelques notabilités du commerce heureuses de se rehausser au contact du représentant de la Couronne.
[p. 134] M. de Tourny—un passionné sous des dehors doucereux—possédait-il les qualités requises pour mettre un terme à ces divisions? On en peut douter. D’une part, après avoir longtemps porté l’épitoge, il était passé à l’ennemi avec armes et bagage[125]. D’autre part, l’origine de sa fortune prêtait matière à la critique. Ce personnage, qu’on représente volontiers sous les traits d’un grand seigneur, était issu d’une famille de partisans—les Aubert—enrichie dans la maltôte. Entre cette catégorie de «dévorants» et les détrousseurs de grands chemins, le public faisait peu de différence. De bons esprits, parmi lesquels des membres du haut clergé, soutenaient même qu’à leur mort c’était l’État, dépouillé par eux, qui devait hériter. Celui-ci ne poussait pas aussi loin la rigueur; mais, à chaque changement de règne, il provoquait, sous le contrôle de chambres ardentes, dites chambres de justice, des restitutions dont le chiffre accuse le génie des agents des fermes dans l’art de se faire des rentes. C’est ainsi qu’en 1716 Crozat l’aîné payait, rubis sur l’ongle, la somme de six millions six cent mille livres à laquelle on évalua le montant de ses déprédations; [p. 135] ce qui ne l’empêcha point de rester Crozat le riche... Or, sur cette liste des traitants condamnés à rendre gorge, figure toute la tribu des Aubert, dont l’un—président en la Chambre des comptes de Rouen—dut rembourser quatre cent mille écus. François Aubert, père de l’intendant, s’en tira à meilleur compte: on le tint quitte pour sept cent dix mille cent vingt-cinq livres[126]... Malgré ce formidable accroc, il n’en trouvait pas moins les ressources nécessaires pour acheter le marquisat de Tourny, la baronnie de Salongey, les seigneuries de Pressaigny, Mercey, Lafalaise, Carcassonne et quelques autres!
Tout en usant de façon fort honorable de richesses ainsi acquises, le fils de cet habile homme ne pouvait en faire oublier la source. Ajoutons que certains de ses défauts augmentaient encore les difficultés de sa tâche. Administrateur intègre, travailleur diligent et capable de grandes vues, il avait l’ambition de «tout tirer à lui». Policier par nature, il s’ingéniait à pénétrer les secrets de famille... On le voyait intervenir dans des questions de l’ordre le plus intime, faire enlever des servantes accusées de complaisance pour leur maître, morigéner de grands parents [p. 136] trop débonnaires, laver la tête à de vieilles filles soupçonnées de jansénisme sur la foi de leur curé...
C’est surtout sur le Parlement—dont il avait sollicité la première présidence[127]—que se manifestaient ses idées dominatrices. Ce corps, d’ordinaire si prompt à prendre la mouche, s’en expliquait avec une modération digne de remarque. «M. de Tourny, disait-il dans un rapport au chancelier, pense sans doute qu’une justice, dégagée des formalités ordinaires, tendant à faire le bien avec plus de promptitude, y arrive aussi plus sûrement, et il se persuade que le plus grand avantage qu’il puisse procurer aux peuples de sa Généralité est de réunir dans ses mains toute espèce de pouvoir[128]...»
La formule est heureuse, le but poursuivi nettement déterminé. Pour l’atteindre, M. de Tourny déployait des ressources considérables de pénétration, de finesse, d’à-propos: tel, Mazarin premier ministre. Sa ténacité savait, d’ailleurs, se prêter aux événements: hautaine avec les inférieurs, elle était, vis-à-vis des gens à ménager, souple, humble, obséquieuse.
Ses débuts furent accueillis avec faveur. Aussi [p. 137] bien, les circonstances lui venaient-elles en aide. La Guyenne traversait une de ces crises économiques qui, sous le règne de Louis XV, constituèrent un état presque normal. «J’ay été excessivement surpris, écrivait le nouvel intendant, de l’air malaisé que j’ay vu cet hyver dans Bordeaux à tout ce qui n’est point commerçant, et cela en un temps où le goût du plaisir a coutume de déguiser le mauvais état de la fortune. L’opéra, quoique nouvellement établi et assez bon, a presque toujours été désert. Point de jeux, point de bals, point d’assemblées, point de soupers... Vous diray-je, Monsieur, qu’il n’y a eu de ces derniers plaisirs que ceux que j’ai donnés? Encore ai-je été obligé de les commencer un peu tard dans le carnaval, la nécessité d’épargner ayant fait que la plupart du monde n’est revenu que dans le cours de janvier[129].»
En ces temps calamiteux, M. de Tourny trouva le secret de plaire. Il ne se borna point à récréer son monde; il sollicita des diminutions de taxes, accorda des atermoiements, protesta contre l’élévation du dixième[130]. Ses bonnes grâces s’étendirent jusqu’à Messieurs du palais de l’Ombrière: il [p. 138] affirma que son prédécesseur M. Boucher,—l’homme aux doubles visites—les avait imposés de façon à rendre impossible toute surtaxe. «Je n’exagère pas, déclarait-il, en disant que je vois la moitié des officiers du Parlement dans cette situation, sans un sac de mille livres ou chez eux ou prêt à y entrer, étant aux expédients de tous côtés pour trouver de l’argent qui les fasse vivre et fournir à la culture de leurs vignes[131]...»
Hanté par ses rêves de transformations, M. de Tourny ménageait la bourse de ses administrés. Mais les projets, à l’accomplissement desquels il voulait attacher son nom, laissaient la cour fort insensible.—Qu’est-ce que cela peut faire à Sa Majesté! s’écriait ironiquement M. Trudaine[132]... Le nouvel intendant ne tarda pas à comprendre que la politique, toujours à court d’argent, de Mme de Pompadour ne pouvait s’accommoder de raisons dépourvues de numéraire. Ses instincts de courtisan, joints aux principes autoritaires qui constituaient le fond de sa nature, l’entraînèrent bien vite. La lune de miel prit fin: elle n’avait brillé, dans un ciel sans nuage, que l’espace d’un quartier.
C’est l’Académie—une puissance!—qui subit [p. 139] le premier choc. La cause de la dispute? Une langue de terrain au-devant de la maison léguée par Jean-Jacques Bel. Trente toises environ: c’en fut assez pour révolutionner la ville...
Barbot, dans un factum incisif, retrace les péripéties de ce drame héroï-comique. Il représente, avec un luxe de détails, le proconsul s’agitant à la tête de ses brigades d’ingénieurs, d’architectes, de maçons; changeant sans cesse de projets; toujours sur le qui-vive; ne signant—de peur de se compromettre—ni billets, ni plans, ni mémoires; déchaînant, par sa fureur de la pierre, une hausse énorme des salaires et des matériaux. «M. de Tourny, écrit-il, a un atelier à la porte des Capucins, à la porte Saint-Germain, à la porte Dauphine, à la porte Dijeaux, à la porte Saint-Julien, à deux rues qu’il veut faire aux Cordeliers, à deux autres qu’il veut faire aboutir à la place Royale. Il fait travailler à un attérissement sur les quais, à son jardin, à la continuation des allées du côté de la Manufacture. On lui compte vingt-deux travaux publics commencés dans la ville. Il commence tout et n’achève rien. Il trace des places dont il bâtit une ou deux maisons. Il prend mal ses mesures et est obligé de refaire ce qui avoit coûté beaucoup, témoin ces allées autour de la ville qui [p. 140] étoient si mal nivelées. Vous avez vu, avant de partir de Bordeaux, qu’il a été obligé d’ôter dix ou douze pieds de terre dans l’allée qui va de la porte Dauphine à la porte Saint-Germain et d’en faire replanter les arbres qui se meurent asture (sic)... Aux dépens de qui fait-il toutes ces dépenses?»—Et l’honnête narrateur de lever les bras au ciel en s’écriant que si ses collègues n’obtiennent pas justice du roi, ils protesteront devant toutes les académies du monde et feront—entreprise audacieuse—appel à tous les moyens de publicité!
Montesquieu, chargé de suivre l’affaire, n’épargna ni ses soins ni sa peine. Il poussa même la condescendance jusqu’à s’inviter à la table de M. de Tourny. Celui-ci l’accueillit avec des paroles mielleuses, mais n’en persista pas moins dans ses vues, démolissant, ouvrant des tranchées, se livrant à des travaux qui eussent suffi à sauver Berg-op-Zoom des attaques de l’armée française...
Après des années de luttes, le président, à bout de patience, éclata en reproches contre les coquetteries de son adversaire, ses manques de parole, sa duplicité, ses trahisons. Plus d’amitié, plus de commerce entre eux. Il intrigue et s’épuise en efforts diplomatiques, tandis que M. de Tourny, réprimandé par son ministre, expédie des émissaires [p. 141] à Versailles et accomplit lui-même le voyage[133]. Quand, enfin, l’Académie obtient gain de cause, ce cri, d’une éloquence à méditer, s’échappe de la bouche de Montesquieu: «C’est une terrible chose que de plaider contre un intendant; mais c’est une chose bien douce que de gagner un procès contre un intendant...»
Les contestations avec le Parlement présentaient plus de gravité. La première surgit à propos de la famine de 1748, durant laquelle le commerce bordelais, quoique très éprouvé, fit preuve d’un remarquable esprit de sacrifice[134]. A en juger d’après les dossiers de l’Intendance, il semble que Messieurs de la robe n’eussent d’autre but que de paralyser les efforts du pouvoir administratif... Il y a gros à parier que l’impression serait différente si l’on s’en référait aux documents émanés du palais de l’Ombrière. Peut-être, les officiers de justice—qui distribuèrent aux pauvres deux mille francs par mois[135]—parviendraient-ils à établir [p. 142] que leur intervention fut motivée par le souci de mettre un terme aux fausses manœuvres, aux accaparements, aux rapines, et de calmer l’émotion populaire toujours prête à dégénérer en émeute... Malheureusement, si les pièces abondent d’un côté, elles sont fort clairsemées de l’autre. On ne possède, en fait d’écrits émanés du Parlement, que ceux dont M. de Tourny avait intérêt à se munir; si bien que tout jugement éclairé devient difficile. A défaut de la réserve commandée par cet état de choses, on risque de faire fausse route: c’est ainsi qu’une publication récente aboutit à cette conclusion inattendue qu’en Guyenne parlementaires et jurats, «toujours prêts à empêcher le bien par routine ou par humeur,» furent les véritables auteurs de toutes les disettes[136].
Entre la Compagnie judiciaire, réduite à ses propres forces, et l’Intendance, sûre de l’appui du roi, le duel n’était pas égal: l’avantage resta à l’Intendance. Son premier soin fut de marquer sa victoire par l’exil de quatre magistrats tenus pour «ennemis de l’ordre»: M. Leblanc, sous-doyen de la Grand’Chambre; M. Leblanc de Mauvezin, son fils; M. de Grissac, son gendre, et l’avocat général Dudon...
[p. 143] Il eût semblé juste de frapper de la même peine l’un des amis de cœur de Mme Duplessy, le président de La Tresne, qui, publiquement, s’était mis à la tête de la cabale. Mais ce magistrat, dont chacun proclamait les hautes lumières, l’intégrité et la sagesse, jouissait à Versailles d’un crédit important... M. de Tourny s’appliqua à diminuer ses torts. Sans doute, déclarait-il dans une dépêche confidentielle, M. de La Tresne s’était constitué le chef de l’opposition, mais comment lui tenir rigueur à lui «la candeur et la vertu même»?... Pour ne point l’épargner, il eût fallu être un barbare[137].
L’intendant se rattrapait sur MM. Leblanc de Mauvezin, à qui personne ne s’intéressait en haut lieu. Mais le plus maltraité de la famille était le gendre, M. de Grissac. Les rapports officiels font de ce parlementaire batailleur—l’un des membres les plus goûtés de l’Académie, en même temps que le plus savant des juges[138]—un portrait qui ne manque point de pittoresque. «On ne peut, écrit M. de Tourny, refuser à celui-là d’avoir beaucoup d’esprit, mais esprit pétri d’une bile sombre qu’il porte jusque sur sa physionomie. Il ne dit, il ne fait rien qui ne [p. 144] s’en sente. Trouver à blâmer est pour lui un plaisir, et le plus grand, c’est d’avoir à s’élever contre quelque chose qui lui est supérieur. Il croit, en cela, montrer une force et un courage qui doivent lui faire honneur. Il y emploie avec ostentation le talent de parole qu’il a reçu de la nature. C’est par ses discours vides de sens, mais colorés de nuances de vertus et de grands sentiments, qu’il est venu à bout d’en imposer à la jeunesse des Enquêtes[139].»
N’en déplaise à M. de Tourny, la population ne ratifiait point la partie défavorable de ce jugement. M. de Grissac jouissait, dans toute la province, d’un prestige indiscuté. C’était une façon d’âme antique que Mme de Motteville eût rangée dans cette catégorie de robins qui, faisant profession de n’aimer que les misérables, «haïssent toujours les heureux et les puissants»[140]. Magistrat sous la Fronde, M. de Grissac eût fait le coup de feu contre le Mazarin. Les temps ne se prêtant plus à ces sortes d’épopées, il se bornait, aux assemblées des chambres, à tonner contre les [p. 145] abus. S’inspirant du célèbre abbé Pucelle, dont Rigaud nous a transmis l’admirable tête de tribun[141], il critiquait sans relâche l’augmentation des taxes, suggérant à ses collègues les décisions les plus hardies, poussant même la témérité jusqu’à faire rendre un arrêt défendant aux contribuables de payer l’impôt du dixième et aux receveurs de l’exiger: une campagne d’autant plus dangereuse pour la Couronne que, de l’aveu de d’Argenson, le Parlement, dans cette circonstance, «ne prenait que le parti du peuple»[142]. L’intendant avait beau déchaîner contre ce boute-feu les colères de Versailles, l’entêté ne désarmait pas. Si bien que, dans le monde de la robe, on finit par associer son nom à celui du célèbre agitateur qu’il s’était donné pour modèle:
[p. 146] Cependant, le chancelier d’Aguesseau, estimant que ces grands coupables n’étaient point indignes d’indulgence, émettait l’avis qu’il y avait lieu d’entrer dans la voie des négociations. Intervention inopportune qui avait le tort de mettre aux prises l’autoritaire qu’était M. de Tourny avec le courtisan dont, en lui, se doublait l’autoritaire... C’est le courtisan qui l’emporta: il répondit, le sourire aux lèvres, que, la clémence étant la plus noble des vertus, il ne négligerait rien pour amener les rebelles à résipiscence...
Ses efforts furent-ils pressants? Il serait téméraire de l’affirmer. Quoi qu’il en soit, MM. Le Blanc de Mauvezin, de Grissac et Dudon repoussèrent toutes les ouvertures. S’humilier! On les connaît mal... De pardon! Ils n’en veulent point... Le crime qu’on leur impute! Ils s’en tiennent pour honorés... Et les voilà qui, bouclant leur valise, prennent, aux applaudissements de tous, le chemin des villes qu’on leur a assignées pour résidence. L’expiation devait être proportionnée à la faute: elle dura sept mois. Elle eût duré bien davantage [p. 147] si l’on avait attendu une marque de repentir. «On leur a insinué de demander leur grâce, rapporte d’Argenson, ils ont refusé de supplier[143].»
A peine, d’ailleurs, ces belliqueux robins avaient-ils repris leur place aux assemblées des Chambres que les hostilités éclataient de nouveau. Cette fois, il s’agissait du terrier de Guyenne dont le Trésor, afin d’augmenter ses recettes, réclamait le redressement[144]. A cet effet, on prescrivait une revision générale qui devait produire des résultats merveilleux, à condition, toutefois, que les réclamations des intéressés fussent soumises à des juges dociles. C’est pourquoi, bouleversant l’ordre des juridictions, le ministère conférait le droit de statuer en dernier ressort, sur ces sortes de litiges, au Bureau des trésoriers, dont la présidence fut confiée à l’intendant lui-même, avec pouvoir de diviser ses auxiliaires «en pelotons» et de choisir des rapporteurs à sa convenance[145]...
Cette nouvelle fut accueillie par un murmure général. L’irritation augmenta encore quand, grisé de son importance, le nouveau tribunal émit la prétention de juger non seulement les [p. 148] procès intéressant l’État, mais aussi ceux débattus entre particuliers[146]. Cet excès de zèle, désavoué plus tard à Versailles, souleva des polémiques ardentes dans lesquelles les provinces limitrophes ne tardèrent pas à prendre parti. L’effervescence touchait à son comble lorsqu’un second conflit, s’enchevêtrant dans le premier, associa la population entière aux revendications de la robe.
La salle de spectacle venait d’être la proie des flammes[147]. M. de Tourny, qui ne se montrait plus que l’équerre et le compas en mains, jugea urgent de la reconstruire. Ses plans ne laissaient rien à désirer, mais le devis sembla d’autant plus inquiétant qu’aux vingt-deux chantiers énumérés par Barbot se joignaient maintenant une foule d’autres,—non compris les équipes réunies à l’hôtel de l’Intendance que l’on réédifiait dans des conditions luxueuses[148]. Sans doute, parmi ces entreprises, beaucoup présentaient un caractère d’utilité manifeste; mais beaucoup aussi ne répondaient [p. 149] qu’à des exigences purement somptuaires. Tels les portes de ville et les arcs de triomphe élevés, en manière de flatterie, à l’occasion de la naissance des princes de la famille royale...
Le moment, d’ailleurs, était mal choisi pour engager de nouvelles dépenses. A peine relevée de la disette de 1748, la Guyenne succombait sous le poids des charges imposées par la guerre de Sept ans. L’agriculture et le commerce subissaient une crise sans précédents. En possession de récoltes anciennes, achetées à bas prix, les Anglais rebutaient les vins nouveaux. Les colonies elles-mêmes, encombrées de marchandises, ne voulaient plus recevoir aucun envoi. On ne parlait que de faillites, et quarante navires, faute d’acquéreurs, étaient dépecés pour servir de bois de chauffage[149]... Situation lamentable, dont une rupture avec nos voisins d’outre-Manche allait encore accroître l’acuité. En l’espace de quelques semaines, les Château-Lafite et les Château-Latour, de dix-huit cents livres le tonneau, tombaient à deux cent soixante. Quant aux Château-Margaux, vendus vingt-cinq écus, on les débitait à la bouteille «en cabaret»!
Réduits, depuis longtemps, au rôle de commis, [p. 150] les jurats ne cessaient de protester. Certes, leur orgueil prenait plaisir à contempler les superbes édifices qui jaillissaient du sol comme sous une baguette magique; mais ils estimaient que tant d’œuvres à la fois, fussent-elles menées avec économie, finiraient par consommer la ruine générale. On n’avait pas recours, en effet, à ces combinaisons d’ordre financier qui permettent de favoriser l’avenir sans surcharger outre mesure le présent. Pas d’emprunts remboursables par les générations appelées à jouir de ces gigantesques travaux: on procédait par levées de taxes successives qui, se greffant sur les impositions normales et les impositions de guerre, accablaient la population urbaine et même se répercutaient sur les campagnes.
Toutes leurs doléances demeurant sans effet, les officiers municipaux osèrent un jour prescrire le renvoi des ouvriers... Impassible dans son omnipotence, M. de Tourny brisa leur décision: volontiers eût-il laissé entendre, avec un contemporain, que les Bordelais étaient des barbares et que, seule, la force pouvait leur inspirer le goût du progrès et du beau[150]! Les actes accompagnaient les paroles, et, au moment même où le roi, poursuivant [p. 151] ses velléités fiscales, installait le Bureau des finances dans l’emploi de judicature souveraine, l’intendant, tranchant du Louis XIV, édictait, pour la salle de spectacle, une contribution nouvelle.
Un défi à l’opinion publique!... Sollicités par la Jurade frémissante sous l’affront, saisis de plaintes émanant d’une ligue de particuliers, implorés par le peuple dont l’indignation menaçait de tourner à l’émeute, Messieurs du Parlement citèrent le proconsul à leur barre. Lancèrent-ils contre lui, sur son refus de comparaître, un décret de prise de corps? Barbier l’affirme, dans un récit fort détaillé[151]... L’intendant traîné devant les juges, comme un vulgaire tire-laine, quelle aventure de haut goût! M. de Tourny ne voulut point procurer cette joie à ses administrés. Redoutant encore plus les violences de la foule que celles de la Grand’Chambre, il jugea opportun de quitter la ville... A défaut du maître, la Compagnie judiciaire dirigea ses rigueurs contre ceux que l’on nommait ses valets: les trésoriers de France, dont plusieurs s’empressaient de prendre la fuite...
La riposte ne se fit pas attendre. Le 15 mai 1756, un ordre du roi déposait de ses fonctions [p. 152] le greffier rédacteur de l’arrêt et ordonnait l’emprisonnement des huissiers chargés de le signifier[152]. Les conseillers de Grissac et de Carrière recevaient des lettres de cachet les exilant, le premier à Issoire, le second à Bourges. Enfin, leurs collègues, MM. de Cazeaux, de Combabessouze, Sallegourde, Drouilhet et Vayssière de Maillat, étaient invités à se rendre à la suite de la cour, c’est-à-dire à se présenter chaque matin dans l’antichambre du garde des sceaux, quel que fût l’endroit—Versailles, Compiègne, Fontainebleau, Marly—où les fantaisies de la maîtresse en titre pouvaient conduire le chef suprême de la magistrature[153].
Il y avait dans ces désignations, sinon une cruauté qu’il répugne d’admettre, au moins une légèreté inconcevable. M. de Cazeaux, atteint de cécité, ne mettait plus les pieds au Palais. M. de Sallegourde gardait le lit depuis six mois, achevant, dans de cruelles souffrances, une carrière [p. 153] des plus accidentées[154]. M. de Vayssière de Maillat était tombé en enfance, et son vieil ami M. de Combabessouze ne valait guère mieux, en dépit des souhaits de Lagrange-Chancel:
Nestor Combabessouze allait doubler le siècle; mais, sa tête déménageant, on ne comptait plus son vote aux assemblées des chambres. Ajoutons—qui le croirait!—qu’aucun de ces magistrats n’avait pris part aux décisions dont on leur faisait un grief[155]...
C’était le comble du ridicule. M. de Tourny [p. 154] s’en rendit compte. A ces invalides inoffensifs, il s’empressa de substituer d’autres magistrats, en même nombre et de même rang, choisis parmi les plus anciens dans l’ordre du tableau: «Tout ceci, déclare d’Argenson, se mène avec une grande violence, et je doute que le roi touche au repos qu’il aimeroit tant. Nos ministres réveillent la discorde et le cas de désobéissance par des bagatelles où ils compromettent le roi. Le gouvernement despotique avoit pris l’habitude d’entreprises irrégulières que les Cours supérieures toléroient; mais ils sont montés aujourd’hui sur le ton de ne plus rien passer aux ministres. Le Parlement de Paris leur donne un exemple de fermeté qui en fait un ennemi bien dangereux pour l’autorité royale[156].»
Le départ des exilés eut l’éclat d’un triomphe. La Compagnie, en corps, vint leur donner l’accolade. La ville entière se porta à leurs logis, et «tous les bons citoyens», plongés dans la consternation, les accompagnèrent de saluts respectueux.
François de Lamontaigne fut le témoin attristé de cet exode. Déjà il représentait M. de Tourny comme un courtisan dévoré d’ambition, ivre de [p. 155] l’autorité despotique, imbu de l’esprit de finance, gouvernant la province avec un empire odieux... Ce coup de force, assure-t-il, «acheva de mettre en horreur cet intendant qui fesoit un abus si révoltant du crédit que ses intrigues lui ménageoient auprès des ministres[157].»
M. de Tourny ne se dissimulait pas la malveillance dont il était l’objet. Il en parle, en termes non équivoques, dans un rapport relatif à l’aventure du terrier et à un nouvel accroissement de l’impôt du vingtième. Ces deux choses réunies, explique-t-il, «s’aigrirent l’une l’autre. On m’en crut voir l’auteur, et quoique, dans la première, je ne fis que remplir le dû de mon ministère, encore avec beaucoup de ménagements, et que je n’eus de part à la seconde que d’être chargé de l’exécution des ordres du roi—dont il me faschoit beaucoup,—les esprits passionnés et turbulents, qui ordinairement donnent le ton aux autres, me surent le même mauvais gré que si, visiblement, ç’avoit été des productions de ma pure volonté[158].»
M. de Tourny établit mal son compte: il oublie [p. 156] l’affaire de l’Académie, celle du théâtre et une foule d’autres dont la responsabilité ne saurait incomber qu’à lui... Ces abus de pouvoir, quoi qu’il en puisse dire, n’avaient pas contribué, dans une faible mesure, à accroître son irrémédiable impopularité.

Impopularité de M. de Tourny.—Fédération des Parlements.—Rejet des édits fiscaux et cessation du cours de la justice.—Capitulation du roi.—L’aumônier des condamnés à mort.—Représailles de la Jurade contre les trésoriers de France.—Le comte d’Hérouville et Mlle Lolotte.—L’affaire du prieur d’Auriac de Boursac.—Révocation de M. d’Hérouville.—Remplacement de M. de Tourny par son fils: un singulier intendant.

Sept magistrats partant ensemble pour l’exil, cela se voyait couramment à Paris. Bordeaux n’était point encore blasé sur ce genre de spectacle. D’autant mieux que, cette fois-ci, les ministres se montraient inexorables. Loin de diminuer la rigueur du châtiment, ils prenaient plaisir à l’aggraver, internant au fond de villages dépourvus de ressources ceux-là mêmes qu’ils s’étaient bornés d’abord à mettre à la suite de la cour. Mais si partout, dans la société bordelaise, l’émotion fut vive, à l’hôtel du Jardin-Public elle atteignit les proportions d’un véritable deuil. En effet, plusieurs des exilés entretenaient avec la maîtresse du logis d’étroites relations: M. de Grissac lui était même uni par des [p. 158] liens de parenté... On peut croire que le petit cénacle ne manqua point d’appuyer l’intègre Lamontaigne dans ses imprécations contre l’intendant.
Infortuné Tourny! L’ostracisme dont il était l’objet s’étendit aux personnes de son entourage. Son fils l’abbé—bien qu’il eût lui-même été victime de l’arbitraire royal[159]—se vit fermer toutes les portes. Quant au satrape de Guyenne, il succombait sous le poids des satires, des chansons, des quolibets. C’est de cette époque que date le couplet suivant:
L’affaire, cependant, prenait un développement inattendu. Purement locale, à son origine, elle affectait bientôt le caractère d’une manifestation ayant son retentissement dans tout le royaume.
C’est l’heure la plus critique du règne de [p. 159] Louis XV. L’agitation religieuse atteint son apogée, grâce au désarroi du ministère qui frappe, à tour de rôle, les évêques et les officiers de justice. La question financière n’est pas moins aiguë. Lasse d’exigences toujours croissantes, d’impôts sur le revenu—dixième ou vingtième—assujettissant nobles et roturiers à une odieuse inquisition, de dons gratuits imposés à l’amour des peuples qui doivent les offrir «avec une sorte d’élan»[161], la Nation dresse la tête et fait entendre de formidables murmures. Gardiens de ses espérances, les Parlements redoublent d’audace et proclament, à grand renfort de publicité, les principes, jugés factieux à Versailles, qui régissaient l’ancienne monarchie... Et comme, isolément, leurs efforts demeurent stériles, ils s’unissent en une vaste fédération s’inspirant des mêmes idées, poursuivant le même but, obéissant à un mot d’ordre commun[162].
En vertu de cet accord, le Parlement de Paris, prenant fait et cause pour les magistrats de Bordeaux, adressait, en leur faveur, des remontrances à Sa Majesté, avec menace de suspendre le cours de la justice[163]. Au palais de l’Ombrière, l’agitation [p. 160] n’était pas moindre. La Compagnie ne cessait de réclamer le retour des exilés, accumulait mémoires sur protestations, refusait le vote des édits fiscaux, abandonnait l’exercice de ses fonctions et finissait par forcer la main au roi qui, humilié, battu, amoindri, révoquait les pouvoirs conférés au Bureau des finances et restituait à l’amour des justiciables les cinq parlementaires envoyés à la suite[164].
MM. de Grissac et de Carrière—des chefs de meute—furent toutefois exceptés de l’amnistie: en 1758, ils subissaient encore leur peine[165]. M. de Grissac, incarcéré au fond de l’Auvergne, put à loisir aiguiser ces maximes de droit public dont son éloquence, aussi mordante que désintéressée, tirait des armes si redoutables. Quant à M. de Carrière, convaincu qu’il y avait plus de justice à attendre du ciel que de Versailles, il se décidait à entrer dans les ordres. Parti conseiller laïc, il revint conseiller clerc: on put voir, à tour de rôle, ce père de famille siégeant sur les fleurs [p. 161] de lys, en costume ecclésiastique, et célébrant la messe à Sainte-Eulalie, sa paroisse, en robe rouge de parlementaire[166]. Ce ne fut point sa seule originalité. Ne pouvant, en qualité de prêtre, participer au jugement des affaires criminelles, il s’astreignit à visiter «les pauvres prisonniers», à leur prodiguer des consolations et à soulager leurs misères. Bientôt, les condamnés à mort ne voulurent plus d’autre confesseur. Son inaltérable bonté ne crut pas pouvoir se soustraire à cette tâche, et ce fut un officier de Grand’Chambre, qui, monté avec eux sur la sinistre charrette, les conduisit à l’échafaud[167].
En dehors de ces lutteurs impénitents, il est d’autres victimes qu’on ne peut oublier: nous voulons parler des trésoriers de France, dont la docilité à l’égard du pouvoir central avait exaspéré le peuple. La Jurade n’hésita pas à user contre eux de représailles... Représailles cruelles! Elle les raya de la liste de ses invités aux jours de réjouissances publiques: plus de rang dans le cortège, plus de part aux ragoûts municipaux! Ce n’était pas seulement la punition classique—l’eau claire et le pain sec; c’était l’exclusion dans toute sa rigueur, officielle, publique, avec son caractère de flétrissure: une de ces humiliations que, jadis, [p. 162] on ne digérait pas! Réduits au désespoir par cet affront inattendu, Messieurs les trésoriers portèrent leurs doléances jusqu’aux genoux du roi, suppliant Sa Majesté de les réintégrer d’office aux agapes de l’Hôtel de Ville. Le Grand Conseil dut être saisi du litige; malheureusement l’Histoire, dont on ne saurait trop déplorer la réserve, ne mentionne pas la solution donnée à cette étrange requête[168].
Il semble qu’après de pareils exploits—Achille lui-même respirait entre deux combats—les belligérants dussent éprouver le besoin de reprendre haleine... D’intendant à robin, toute trêve eût paru une défaillance. Comment s’y résoudre, alors surtout que la victoire demeurait incertaine! Si, en effet, Messieurs du Parlement forçaient la Couronne à capituler, M. de Tourny n’avait pas dit son dernier mot pour la salle de spectacle,—celle que l’on édifiait à l’angle de la porte Dauphine et des Fossés de l’Intendance ne présentant qu’un caractère provisoire[169].
[p. 163] Bien que d’un ordre plus intime, le dernier engagement des pouvoirs rivaux ne manque pas d’intérêt: il amena la révocation du premier dignitaire de la province, lequel commit la rare imprudence d’intervenir dans le débat.
Ce personnage n’est autre que le successeur, dans le commandement de la Guyenne, des maréchaux de Montrevel, de Berwick et de Duras—Jacques-Antoine de Ricouard, comte d’Hérouville de Claye[170]. Ingénieur aussi distingué que brave soldat, M. d’Hérouville était, en outre, au dire de Voltaire, «un bon citoyen.» Lieutenant-général dès 1738, il avait fait de nombreuses campagnes, et, après la journée de Fontenoy, obtenu la capitulation d’Ostende. Le roi, qui connaissait son mérite, s’entoura de ses conseils lorsqu’il caressa le rêve d’une descente en Angleterre[171].
Rompu aux exercices de son métier, M. d’Hérouville était un piètre courtisan. Sa nomination à Bordeaux excita d’autant plus de surprise que [p. 164] ses relations avec les philosophes et sa collaboration à l’Encyclopédie—à laquelle il fournissait des articles militaires—n’étaient un secret pour personne. On s’ingénia à en découvrir la cause: peut-être l’ignora-t-il lui-même. Il n’en remercia pas moins Sa Majesté, le 13 décembre 1754, et alla prendre possession de son poste,... en compagnie d’une personne qu’il n’avait point encore promue à la dignité de comtesse d’Hérouville[172]...
Les cœurs de vieux guerriers ne sont pas à l’abri de ces faiblesses: celle-là ne manquait pas d’excuses. «L’objet» réunissait toutes les séductions. L’ambassadeur d’Angleterre, lord Albermale, avait aimé à la folie cette enchanteresse qui, de son vrai nom, s’appelait Louise Gaucher, et, de son nom de théâtre, Mlle Lolotte. Un soir que, rêveuse, elle s’oubliait dans la contemplation des étoiles, Milord murmura à son oreille ces mots qui valent un poème: «Ne les regardez pas ainsi, mignonne, je ne saurais vous les offrir!...» Peut-être, à défaut des astres que sa main ne [p. 165] pouvait atteindre, ce diplomate grand seigneur eût-il glissé aux doigts de la belle l’anneau nuptial. Une mort malencontreuse l’en empêcha... C’est M. d’Hérouville qui, plus tard, régularisa, par un mariage légitime, ce qu’il y avait d’incorrect dans son cas et dans celui du de cujus.
Bordeaux, à en croire Marmontel, abrita, en la personne de Mlle Lolotte, une seconde Ninon. Aux facultés les plus brillantes, attestées par tous ceux qui eurent la bonne fortune de la connaître, elle alliait, assure l’auteur des Incas, la majesté du cèdre et la souplesse du peuplier... Comparaison hardie, mais un peu vague, complétée par ces indications plus précises que, douée d’une imagination vive et d’une raison solide, Mlle Gaucher était imprégnée de l’esprit de Montaigne, qu’elle en parlait la langue et en possédait la naïveté, la couleur, l’abandon, l’expression juste, le tour incisif[173]. Après le curé et le tabellion, Ninon-Lolotte eût fait les délices de la Guyenne: M. de Tourny ne lui en laissa pas le temps.
Entre le gentilhomme libre d’idées, expansif, généreux, de morale accommodante qu’était le comte d’Hérouville, et l’intendant, austère, [p. 166] défiant, cauteleux, jaloux, il n’y avait aucune affinité. Par suite de ses goûts, M. d’Hérouville devait être porté vers le monde de l’Académie. Il le trouva tout ému d’un incident de date encore récente. La docte assemblée travaillait depuis quelque temps à une histoire de la ville de Bordeaux—entreprise immense, en vue de laquelle on s’était, suivant les aptitudes, distribué les rôles—lorsque se produisit le procès relatif aux trente toises de l’Esplanade. Outré de son échec, M. de Tourny enleva brusquement, à ceux qu’il regardait comme ses adversaires, les moyens de continuer leurs recherches, et leur substitua des membres de la congrégation de Saint-Maur à la tête desquels se trouvait dom Devienne. Mais voilà que bon nombre de familles refusèrent aux religieux l’entrée de leurs archives. Les années s’écoulaient sans que le travail avançât. Saisi de la question, M. d’Hérouville se livra à une enquête, constata que les Bénédictins n’avaient pas dépassé la période préparatoire et suspendit la pension de quinze cents livres qui leur était allouée sur les ressources municipales... Il n’en fallait pas tant pour exciter les rancunes de l’ennemi juré de l’Académie.
Sur ces entrefaites—août 1756—une main inconnue déposait, chez le portier de l’Intendance, [p. 167] un pli d’aspect mystérieux. Il contenait une lettre, moitié en clair, moitié en chiffres, portant l’adresse du duc de Cumberland—celui-là même qui, après s’être fait battre à Fontenoy et à Lawfeld, allait clore la série de ses revers par une capitulation honteuse. Un général aussi maltraité par la Fortune devait éprouver le besoin d’une revanche: son correspondant lui en offrait l’occasion. Il suffisait, disait-il, de débarquer trois mille Anglais sur la côte du Médoc; une armée de neuf mille huguenots français se joindrait à eux. Le plan de campagne était simple: il consistait à brûler arsenaux et dépôts de guerre; ce qui permettrait d’avoir facilement raison des troupes échelonnées sur le littoral... Et, afin qu’on ne pût se méprendre sur son identité, l’auteur de cette trahison avait soin d’apposer, au bas de l’écrit, la plus lisible des signatures: c’était celle d’un Prémontré, le prieur d’Auriac de Boursac[174].
Quelle gloire de déjouer un pareil complot! Désireux de se faire valoir, l’intendant n’avait garde d’en restreindre la gravité. Il ne se borna pas à s’assurer de la personne du conspirateur: il sollicita du roi les pouvoirs nécessaires pour [p. 168] diriger lui-même ce procès—sans, d’ailleurs, être surpris que neuf mille protestants, montés, armés, prêts à faire campagne, pussent un jour surgir des grèves de la Gironde comme Minerve du cerveau de Jupiter.
Avisé de l’arrestation, le Parlement avait dressé l’oreille. L’affaire, constituant un crime, était de son ressort. Les prétentions de l’intendant, non encore établies par la production des pouvoirs sollicités, semblaient d’autant moins admissibles que le débat, au premier interrogatoire de l’accusé, rappelait l’aventure de la montagne accouchant d’une souris; en effet, l’honnête religieux démontrait, sans effort, qu’il n’entretenait aucun commerce avec le duc de Cumberland, qu’il ne célait ni Anglais ni huguenots dans les plis de sa soutane, et que tout se réduisait à une mystification ourdie par un faussaire désireux de le perdre... «Quelle apparence, s’écrie d’Argenson, qu’un tel projet ait passé dans la tête de ce prieur? Il passe pour honnête homme, et a des ennemis...»
M. de Tourny, qui s’était posé en Dieu sauveur, n’en persistait pas moins à soustraire le prisonnier à ses juges naturels. Ce que voyant, ceux-ci portèrent plainte au commandant de la province. En arbitre consciencieux, M. d’Hérouville se dit: A l’intendant, les choses administratives; au Parlement, [p. 169] celles de la justice... Moyennant quoi, il tranchait le litige au profit du Parlement et ordonnait le dépôt du prétendu coupable dans les prisons de la Conciergerie.
C’était compter sans les rancunes de M. de Tourny, dont la dévotion ombrageuse ne pardonnait pas à ce gêneur ses rapports avec la secte encyclopédique. Le moment, pour le discréditer en cour, était opportun. Mme de Pompadour, inaugurant une manière nouvelle, faisait ses délices du Père de Sacy, soumettait sa maison à des pratiques rigoureuses et proscrivait le nu dans son entourage. Louis XV, lui-même, pris d’un zèle qui ne devait pas durer, ne manquait point une homélie, se montrait sans pitié pour le libertinage, espaçait ses rendez-vous galants et faisait l’édification de la reine.
Absorbé par les charmes de sa compagne, M. d’Hérouville ne daigna pas apercevoir les attaques dont il était l’objet. Aussi bien se refusait-il à croire qu’un intendant pût tenir en échec le commandant de la province... Une lettre de cachet lui apprit, un beau matin, qu’ayant cessé de plaire, on le révoquait de ses fonctions[175].
Ce disgracié méritait un souvenir... M. de [p. 170] Lamontaigne lui consacre quelques lignes émues: «Philosophe aimable et poli, homme sage, plein de justice et d’équité, ami de l’ordre et des règles, il se fit aimer de tous les citoyens et de toutes les compagnies. Il sut s’attirer les égards dus à sa place; ils ne coûtèrent rien parce qu’on savoit qu’on les rendoit au mérite... M. de Tourny se servit vraisemblablement des protections sourdes et cachées qu’il avoit su se ménager par ses intrigues pour rendre M. d’Hérouville suspect à la cour par son attachement pour les peuples et le Parlement. Celui-ci eut le mal au cœur de se voir rappelé et dépouillé de sa charge. Depuis longtemps, une maladie opiniâtre l’avoit rendu languissant: le chagrin qu’il eut de sa destitution augmenta son mal. Il partit au mois de juin 1757 pour céder sa place à son successeur et aller tâcher de se rétablir à Bagnères. Il regretta la ville en la quittant. Il s’y seroit attaché; il sentoit qu’il y étoit aimé. La ville le regretta: elle sentoit qu’elle eût été heureuse sous son gouvernement[176].»
La maladie opiniâtre à laquelle le chroniqueur [p. 171] fait allusion provenait d’une fontaine, bouchée depuis plusieurs années, que M. d’Hérouville crut devoir faire ouvrir. Les eaux, altérées par l’oxydation des conduits, empoisonnèrent neuf personnes sur les trente qui composaient sa maison. Mlle Lolotte elle-même fut atteinte. Elle survécut, hélas! pour subir les insolences d’un monde dont, avec une autre origine, elle eût constitué la grâce et l’ornement. Un jour que, devenue comtesse en titre, on l’annonça chez la marquise de Mauconseil, il se produisit une manière de scandale. Les duchesses d’Uzès, de La Vallière et de Châtillon poussèrent les hauts cris. Mmes de Coislin, de Beauvau et de Rohan sortirent sans saluer. Quant à «cette peste» de Mme de Puisieux, elle détacha, de sa mule de satin, un coup de pied à la levrette du logis, avec ces mots impertinents: Allez vous cacher, Lolotte![177]... La malheureuse femme ne tardait pas à succomber sous la cruauté de l’affront. Fidèle à son souvenir, Marmontel la fit revivre dans sa Bergère des Alpes; mais qui, maintenant, se soucie de la Bergère des Alpes, quand, elles-mêmes, les œuvres de Voltaire et de Rousseau sommeillent, inexplorées, sous la poudre des rayons[178]!
[p. 172] M. de Tourny quitta Bordeaux, à cette même époque, pour entrer au Conseil d’État. Était-ce une disgrâce? Tout porte à croire que la cour, lasse des difficultés soulevées par lui, accueillit avec empressement les sollicitations de Richelieu qui, appelé au gouvernement de la Guyenne, désirait en éloigner un collaborateur aussi impopulaire[179]...
C’est ainsi qu’achevait sa militante carrière l’administrateur dont il suffit de prononcer le nom pour évoquer le souvenir des grands travaux accomplis sous Louis XV. Il n’entre pas dans le cadre de ce travail de rechercher s’il en fut le véritable inspirateur, ou si, comme l’indiquent de récentes découvertes, il se borna à exécuter des plans conçus de longue date et mis au point par ses prédécesseurs. Qu’il nous soit permis seulement d’exprimer le regret que cette partie très intéressante de notre histoire locale n’ait pas eu la bonne fortune de tenter quelques fureteurs. Des investigations approfondies amèneraient, croyons-nous, de piquantes révélations: spécialement sur [p. 173] les conditions économiques dans lesquelles s’effectuèrent les embellissements de la cité. Il n’est pas rare d’entendre dire que ces transformations ne coûtèrent rien à personne, si ce n’est pourtant à M. de Tourny lui-même: une légende habilement répandue à Versailles, mais qui, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, ne rencontra, en Guyenne, que d’énergiques protestations. On sait quelles charges énormes subirent les contribuables bordelais. De son côté, la Ville ne laissait pas que d’être obérée. Lors de la retraite du plus illustre de ses intendants, sa dette—presque triplée—s’élevait à deux millions deux cent soixante-douze mille huit cent trente-huit livres treize sols et onze deniers. La fortune publique était, d’ailleurs, si profondément atteinte que lorsqu’il fallut, quelques années plus tard, contracter un nouvel emprunt, la Jurade se trouva dans l’obligation—tel un fils de famille s’adresse aux usuriers—de solliciter le concours de banquiers génois[180]...
M. de Tourny fut sûrement un personnage de valeur, et l’on comprend que le Bordeaux moderne qui, sans bourse délier, bénéficie de son administration féconde, lui dresse des statues. Mais il nous semblerait peu équitable, sur la foi [p. 174] de panégyristes trop zélés, de condamner ceux de ses contemporains qui eurent le redoutable honneur de croiser le fer avec lui. La passion les égara-t-elle dans leurs jugements à son égard? Il serait téméraire de l’affirmer. Ce furent, ne l’oublions pas, les meilleurs et les plus intègres de la cité, en même temps que les plus renommés pour leur savoir.
En perdant son poste, M. de Tourny recevait une compensation. On lui donnait comme successeur son fils, Claude-Louis, alors avocat général au Grand-Conseil: un petit homme, de figure maladive, qui eut tous les défauts de son père sans avoir ses qualités. Ses débuts furent marqués par un pas de clerc. Installé au Parlement, le 5 septembre 1757, il prononça un discours hautain, assurant la Compagnie de sa protection; ce qui lui attira cette réponse du premier président que la Compagnie n’avait cure de ses services[181]. Prit-il cette leçon pour une offense? On serait tenté de le croire, car, peu de temps après, trois officiers de justice, MM. d’Estignols de Lancre, de Mauvezin et de Paty furent mis à la suite de la cour...
Claude-Louis de Tourny passa en Guyenne [p. 175] comme un météore. Il eut le temps, toutefois, de se signaler par une invention fiscale qui donne la mesure de sa valeur. Persuadé que les protestants de l’Ouest entretenaient des intelligences avec la Grande-Bretagne, le ministère avait prescrit qu’on les désarmât... L’ordre était clair, mais l’exécution était délicate: tant de huguenots, pour se soustraire à la persécution, affichaient des sentiments catholiques! Afin d’éviter toute erreur, l’intendant désarma la population entière... Mais le trait de génie consista à obliger, sous peine d’une amende de dix livres, les malheureux qui n’avaient ni épées, ni fusils, à en acheter pour satisfaire aux réquisitions: on ne vit jamais l’arsenal si bien fourni[182].
M. de Tourny fils ne fut une ressource ni pour le monde des lettres, ni pour la société bordelaise. Ses habitudes n’étaient pas moins bizarres que ses procédés administratifs. Il avait les allures et le rigorisme d’un moine. Les couvents et les églises absorbaient le plus clair de son temps: il prenait, à les faire visiter, un plaisir ineffable. L’excès des pratiques religieuses auxquelles il se [p. 176] livrait ne tarda pas à obscurcir sa raison. Voulant étouffer en lui l’aiguillon de la chair, il se ficela le corps «comme une carotte de tabac»[183]; si bien que des plaies nombreuses, avivées par la gangrène, envahirent tous ses membres... Bénissant Dieu de ses souffrances, il acheva en 1760 une vie plus misérable que celle du patriarche Job.

Bordeaux vers 1760.—État de la ville.—Moyens de communication: voitures privées et publiques, poste aux lettres, courriers.—L’Ordinaire, le Carrosse, les Messageries.—Signalements de la police.—Distractions: bals, combats d’animaux, théâtres.—Mlle Clairon: révolution dans l’art dramatique.—La place du Palais, la place Royale, la Bourse, la porte Dauphine.—Prétentions nobiliaires.—Les Annonces-Affiches.—Le fort du Hâ.

La Guyenne, dès cette époque, attirait un grand concours de voyageurs. De quelque côté qu’on y parvînt, sauf du côté des Landes, les abords étaient affriolants. Angoulême, depuis Louis Guez de Balzac, passait à juste titre pour un pays de chère succulente. Périgueux, outre ses truffes, offrait un cénacle de gens lettrés dont le nombre atteignait presque la douzaine. Venait-on de l’Agenais, la vallée plantureuse de la Garonne suffisait à mettre le cœur en liesse. Quant à Saintes, le point de rencontre des Angevins et des Bretons, c’était un lieu de délices «qui ne pouvoit être l’antichambre de la Gascogne sans avoir de l’esprit»[184].
[p. 178] Mais c’est à la vue de Bordeaux qu’éclatait l’enthousiasme. Quand, remontant la rivière, après avoir doublé les Chartrons, on débouchait en face du Château-Trompette, le regard découvrait—à travers une nuée de mâts, de cordages, de voiles multicolores—la longue enfilade des quais, le palais de la Bourse, la place Royale où se dressait la statue de Louis XV, la porte du Cailhau si harmonieuse de lignes, la flèche de Saint-Michel se détachant en sombre sur un ciel lumineux, et enfin, perdues dans une buée indécise, les tours qui, derrière Sainte-Croix, terminaient le mur d’enceinte. A gauche, la rade sillonnée de navires. A droite, la masse énorme de la ville dont les toitures se profilaient en fines arabesques: clochetons, tourelles, encorbellements, pignons, lucarnes, belvédères... Le spectacle de l’Esplanade, celui des Fossés du Chapeau-Rouge et des voies spacieuses tracées par le compas de M. de Tourny, augmentait encore l’admiration, bien qu’on n’y rencontrât ni œuvre d’art ni monument architectural. C’est surtout du côté de l’Ouest que s’étaient opérées les plus grandes transformations. Culbuté le mur d’enceinte qui servit «de cuirasse» aux vieilles franchises; disparus «les ravelins flanquants» et «les remparts terrassés» dont parle le poète de Brach; démolie la porte Saint-Germain; [p. 179] annexés les faubourgs et le vaste espace qui s’étend au delà du Jardin-Public! Tout cela constituait un ensemble merveilleux: les gens qui se piquaient d’avoir fait le tour du globe affirmaient qu’à part Constantinople il n’existait rien de comparable au monde.
A ce brillant tableau il y a pourtant une ombre. En dépit de son caractère grandiose et de son aspect aristocratique, le Bordeaux de 1760 ne brille ni par l’entretien ni par les soins qu’il prend de sa personne. Comme ces filles de l’Orient qui consacrent tous leurs efforts à la parure extérieure, la perle de l’Aquitaine néglige ses dessous. Ce ne sont, de toutes parts, dans les avenues des quartiers neufs, aussi bien que dans les ruelles de la vieille ville, qu’immondices de toutes provenances, fondrières barrant le passage, cloaques infranchissables, avec une boue drue, épaisse, nauséabonde, qui brûle les étoffes et chagrine l’odorat. Buffon s’en explique avec sa malice bourguignonne: il représente les Bordelais sautant, de pierre en pierre, sur la pointe de leurs souliers, et sans cesse contraints, pour paraître avec décence, de recourir à l’office du décrotteur[185]... Volontiers s’écrierait-il, avec certain voyageur anglais: Je [p. 180] me sens prodigieusement enclin à aimer ce pays; mais je voudrais pouvoir le laver à grande eau!
M. de Tourny n’avait en rien porté remède à cet état de choses. Malgré une subvention annuelle de vingt-sept mille livres attribuée aux bourriers, la cité continuait à être aussi malpropre «que si elle avait payé pour cela»[186]: absorbé par le souci d’ériger des arcs de triomphe, l’intendant ne s’attachait point à ces détails. Après sa retraite, le Parlement revint à la charge, exposant qu’il n’était plus possible «de marcher dans les rues à pied ni en équipage, à cause du grand désordre du pavé»[187]; ses objurgations, faute d’argent, demeurèrent stériles... Si bien qu’Arthur Young, en 1787, reproduira les critiques formulées, en 1731, par l’auteur de l’Histoire universelle, et constatera spécialement que le côté le mieux tenu des quais est encombré de vase, d’ordures et de pierres. Ajoutons, pour clore cet exposé, qu’à la même époque il existait dans le quartier Fondaudège des bourbiers si profonds que, pour pénétrer en ville, les équipages venant du Médoc devaient faire le tour par l’allée des Noyers[188]...
[p. 181] Le propre de la philosophie est de s’accommoder des maux auxquels on ne peut se soustraire. Pour braver les souillures de la rue, le peuple use de sabots, les gens riches se servent du carrosse... Durant le cours du XVIIIe siècle, tout gentilhomme, tout parlementaire, tout bourgeois de marque ne sort qu’en voiture. Les calèches mollement suspendues, que Mme de Pompadour vient de mettre à la mode, n’eussent pas résisté aux cahots: on est demeuré fidèle au carrosse antique, «le carrosse à deux fonds, garni de cuir, coussins et rideaux doublés par dedans de veloux noir, et monté sur son train de quatre roues»—un édifice massif, pesant, de force à défier tous les heurts... Majestueusement installé dans le vestibule de l’hôtel patrimonial, il y fraternise avec la chaise à bras, élégamment capitonnée, à laquelle on recourt pour se rendre au bal ou à la comédie.
Chaises et carrosses publics ont pris, de leur côté, un développement considérable. Les premières stationnent carrefours Saint-Projet et Sainte-Colombe, place de l’Hôtel-de-Ville et rue du Chapeau-Rouge. Aux seconds on affecte, à partir de 1765, les places Royale, du Mai, du Médoc et le port des Chartrons, vis-à-vis la rue Borie... Le tarif est de vingt sous l’heure et de quinze sous la course.
[p. 182] Tels sont les modes de locomotion à l’intérieur. Pour communiquer avec l’extérieur, on a la poste aux voyageurs et la poste aux lettres...
Cette dernière colporte les correspondances dans un char-à-bancs, fermé de cadenas, qu’on appelle l’Ordinaire. C’est, à peu de chose près, l’organisation créée par Louis XI. L’Ordinaire ne passe, en effet, que deux fois par semaine, venant de Paris et se dirigeant sur Auch, Condom et Pau[189]. L’État administre cet important service par l’entremise de fermiers qui excellent à tourner le règlement et à grossir le montant des taxes. Mais la plaie contre laquelle chacun murmure, c’est le cabinet noir. Aussi ne jette-t-on «à la boëte» que les écrits ne tirant pas à conséquence. Les nouvelles politiques s’expédient secrètement, sous forme de feuilles manuscrites qu’on nomme des gazettes à la main.
Quant au transport des voyageurs, il s’opère au moyen de deux courriers, le Carrosse et les Messageries, ayant l’un et l’autre leur point [p. 183] d’attache à Blaye: d’où la nécessité d’aller, la veille du départ, coucher dans cette ville.
Le Carrosse ne met qu’une semaine pour faire le trajet de Paris à Bordeaux. Le prix est de soixante-douze livres par personne, non compris la nourriture et «les cinq sols par livre de bagages». A côté de ces places—les places bourgeoises—il y en a d’autres à l’usage du commun «dans le panier, sur le devant». Elles ne coûtent que trente-six livres; mais on y est incommodé par la poussière, la boue et les ruades des chevaux.
Les Messageries constituent la concurrence... Bonnes messageries, gardiennes des traditions de l’ancienne France, de la France studieuse du XVe et du XVIe siècle! Placées jadis sous le patronage de l’Université, elles voituraient les étudiants de province attirés à Paris par les leçons des maîtres en renom. Affectées maintenant au public, elles ont conservé leur allure patriarcale, cheminant avec une sage lenteur, fermant les yeux aux infractions commises en cours de route, et marquant de temps d’arrêt leur passage dans chaque agglomération de quelque importance. En revanche, elles «portent et nourrissent» leur monde moyennant trente-quatre écus, et accordent dix livres pesant pour valises ou sacs de nuit.
Côte à côte avec les courriers, circulent, chaque [p. 184] jour plus nombreux, les cabriolets, chaises de poste, berlines, désobligeantes, que chacun, au taux fixé par le tarif, a le droit de mettre en mouvement: un luxe de grand seigneur et de fermier général... Aux abords de la ville, les cavaliers constituent le plus gros appoint: cadets de Gascogne à la recherche d’un emploi; campagnards de l’Entre-deux-Mers, désireux de vendre leur récolte; Périgourdins en quête d’aventures et prêts à perdre une métairie à la masse aux dés; marchands de dentelles du Velay; fabricants de soieries venus des bords du Rhône; Agenais, Saintongeois, Chalossiens, gens de l’Armagnac et du Quercy, soucieux de suivre leurs procès en appel...
Mais la voie du fleuve fournit, à elle seule, autant que tous les grands chemins[190]. Des navires, venus des quatre coins du globe, débarquent sans cesse une foule de passagers: Danois, Anglais, Moscovites, Américains vidant leur bourse sans retenue, sauf à retourner l’emplir de nouveau[191], Portugais, Asiatiques, jusques à des Turcs risquant une infidélité aux ports méditerranéens: tout un [p. 185] monde bruyant, tapageur, heureux de racheter, par l’abus des plaisirs, l’ennui d’interminables traversées.
La police avait fort affaire avec cette invasion de figures inconnues: rien, assure-t-on, ne ressemble plus à un honnête homme que le masque d’un coquin. Chaque arrivant était l’objet d’une enquête confiée aux soins des dizeniers[192]... Chose bizarre! ce ne sont point les visages exotiques qui excitent les plus vives défiances: elles visent surtout les voyageurs terrestres, et, parmi ceux-ci, s’adressent de préférence aux cavaliers. Comme il est constant que chacun, à la faveur d’un déguisement, peut se rendre méconnaissable, c’est le signalement des montures—incapables de supercheries—qu’on s’applique à retenir: âge, robe, taille, tares, système de ferrures, tout est consigné sur un registre spécial... Ce qui n’empêche point, en dépit des patrouilles bourgeoises, du guet à cheval que la Jurade vient d’établir, et des investigations des commissaires de police[193], les rues [p. 186] d’être peu sûres durant la nuit: les mauvaises rencontres y sont fréquentes, surtout dans les quartiers neufs—les emplacements non construits servant de refuge aux voleurs et aux coupe-jarrets[194].
En dépit de ses boues, des escrocs et des spadassins, Bordeaux jouit d’une renommée exceptionnelle. C’est la ville de l’élégance. Les modes lui viennent de Paris: mêmes coupes de vêtements, mêmes étoffes, mêmes bijoux, mêmes joncs à pomme d’or, mêmes boucles de souliers, rondes ou ovales, parsemées de pierres brillantes ou entremêlées de chiffres, mêmes coiffures et mêmes perruques: dans le monde des petits maîtres, la Brigadière succède à la Naissante, le Catogan fait échec à la Carrée, et la Bourse détrône la Retombante à double queue. Toujours à la façon de Paris, Bordeaux dîne entre une heure et deux, soupe après la comédie, fait une énorme consommation de rouge, de poudre, de mouches, et distribue, au premier janvier, outre des bonbons [p. 187] achetés dans les boutiques en plein vent de l’Esplanade, des colifichets de toute nature, spécialement des tabatières à la Ramponneau...
La comparaison pourrait être poussée plus loin. La jeunesse bordelaise excelle, en effet, à dresser un menu, à organiser des fêtes, à meubler de petites maisons pour des Vénus à la ceinture facile, à jeter l’or par les fenêtres. Rien ne manque à ses parties fines, ni le parasite égayant la galerie, ni l’abbé de cour amoureux de vers rimés après boire, ni le traitant enrichi dans les fermes... Des traitants, on n’en rencontre que trop! A cette époque, il est grandement question de l’un d’eux qui, en l’espace de quelques années, grâce à d’inexorables saisies pratiquées en Médoc, a acquis deux terres, un hôtel et trois offices de finance, sans parler d’une avance de cent mille écus consentie au roi[195]!... Il est vrai que la Cour des Aides lui demande compte de ses exactions et que le Parlement signale à Sa Majesté les économies de ce genre de personnages «comme des caisses d’amortissement destinés par la loi au paiement des dettes de l’État»[196].
Les distractions se multiplient sous les pas des visiteurs. En hiver, des bals publics, agrémentés [p. 188] de jeux, se succèdent sans relâche. Dès l’apparition des beaux jours, on organise des fêtes champêtres, des promenades en rivière, des feux d’artifice avec figures variées et apothéoses[197], des luttes athlétiques et des combats d’animaux qui attirent une foule de spectateurs avides d’émotions. C’est là, s’écrie un nourrisson des muses,
Mais le plaisir le plus cher aux Bordelais, c’est le théâtre. Le prix varie suivant les genres. Pour l’opéra, on paie: cinq livres les fauteuils sur la scène, trois livres les premières loges et l’amphithéâtre, trente sous les secondes loges, vingt-quatre sous le parterre. La comédie coûte meilleur marché: quarante-huit sous les premières loges et l’amphithéâtre, trente sous les secondes loges, dix-huit sous le parterre.
Le beau monde occupe encore, le long des coulisses, une double rangée de chaises et de [p. 189] bancs. De leur côté, les acteurs continuent à se vêtir avec une fantaisie digne des beaux jours du carnaval: le vieil Horace ne craint pas de se poudrer à blanc, Tibère dicte ses lois en perruque Louis XIV, et Phèdre brûle de mille feux sous les paniers d’une tunique à falbalas. Cependant, la réforme, déjà accomplie sur quelques scènes, est à la veille de s’opérer à Bordeaux. Les novateurs accablent de railleries
Ce qui leur attire, d’ailleurs, de la part des gens restés fidèles à la mode ancienne, cette réplique déconcertante:
Quoique d’allures un peu provinciales, le spectacle n’est cependant pas dépourvu de charme. Parfois même, l’imprévu lui imprime une saveur particulière... Certain jour d’été, au cours d’un violent orage, le public éclate de rire: c’est l’ours de la pièce les Chasseurs et la Laitière qui, [p. 190] terrifié par un coup de foudre, se dresse sur ses pattes et, oublieux de son personnage, ébauche le signe de la croix en murmurant un oremus[200]... Une autre fois, le parterre assiste à une vraie bataille: des dragons en goguette, éconduits par les danseuses, envahissent la scène pendant le ballet, éteignent les chandelles, et, se ruant «sur ce qu’ils peuvent attraper à la faveur des ténèbres», renouvellent l’exploit accompli par les Romains sur les Sabines[201].
De temps à autre, la présence d’étoiles parisiennes donne aux représentations un véritable cachet artistique. Les Bordelais appartenant à cette génération rappellent, non sans orgueil, que c’est à leur instinct du beau qu’est due la renaissance de la diction dramatique... Mlle Clairon, hantée du désir de substituer à la vieille méthode déclamatoire une méthode nouvelle dont la sincérité serait la base, résolut de tenter l’aventure dans la capitale de la Guyenne. Ayant choisi Phèdre pour ses débuts, elle joua le rôle des deux façons, afin qu’on pût juger en connaissance de cause. Le premier soir, se conformant à la tradition, [p. 191] elle eut «les éclats, l’emportement, la déraison» qu’on applaudissoit à Paris et que tant d’ignorants appeloient la belle nature[202]...» L’auditoire la trouva superbe. Le lendemain, elle représenta Phèdre, telle que la concevaient son cœur, son âme, son génie. Plus de saccades ni de gestes désordonnés, mais une passion dont l’ardeur, pour être contenue, n’en était pas moins saisissante... Déconcertés, les spectateurs restèrent froids durant le premier acte. Puis, la lumière éclata, et bientôt, bouleversés par la puissance de cette interprétation, ils portèrent aux nues la grande tragédienne... Grâce à la sagacité du public bordelais, la victoire du vrai sur le convenu était acquise.—Désormais, Voltaire pourra dire de Clairon: «Elle a créé son art, elle est unique!»
Durant l’été, la ville se dépeuple. On va aux eaux: au Mont-d’Or ou à Vichy, mais de préférence à Bagnères, Barèges ou Cauterets. Quelquefois les malades séjournent successivement dans deux de ces stations, sauf à entreprendre ensuite, pour chasser les humeurs peccantes,... une cure de lait: rien de nouveau sous le soleil.
L’automne, aux fécondes clartés, est le moment de la villégiature. Gentilshommes et parlementaires [p. 192] vont veiller à leurs vendanges. Le bourgeois, de son côté, s’installe dans sa maison des champs, à Talence, Caudéran, Pessac, ou sur les coteaux de Lormont: d’aimables vide-bouteilles où se reflète encore l’influence de Paris. En un temps où toute brebis bien apprise porte un collier de rubans roses, les jardins subissent une toilette spéciale. Bustes, statues, guirlandes en forment l’ornement, avec des ifs en boules de quilles, des buis allégoriques, des boulingrins reproduisant les signes du zodiaque. Ni ombre ni verdure: des arbres mutilés, amputés, taillés au cordeau—le massacre des innocents[203]!
Avec le retour des frimas, Bordeaux reprend sa vie normale,—une vie qui lui est propre, et dont la relation détaillée ne laisserait pas que d’être curieuse. Un tableau général nous entraînerait trop loin: bornons-nous à visiter quelques quartiers...
D’abord, la place du Palais, avec ses maisons en bois, ses pignons pointus et la masse énorme, flanquée de tours et de contreforts, où réside la justice royale. Déserte depuis deux mois, elle a retrouvé ses hôtes habituels, les gens de loi, en nombre incalculable... Seuls, les avocats [p. 193] inscrits au tableau atteignent le chiffre de cent quatre-vingt-six! Autour d’eux s’agitent une nuée de sergents, d’huissiers, de procureurs armés de sacs à procès et suivis de leurs clients, la comtesse de Pimbêche et M. de Chicaneau. A peine peut-on se frayer un passage au milieu des carrosses de Messieurs du Parlement et à travers leur valetaille, munie de la livrée réglementaire afin d’éviter toute confusion avec bourgeois ou gentilshommes[204]. En face, vers la partie nord, se dressent les appareils du bourreau: ici, la roue aux rayons sanglants; là, le gibet dont la corde graisseuse attend le supplicié; à gauche, sous un hangar béant, l’échafaud destiné aux exécutions de parade; à droite, la pierre, en forme de piédestal, où l’on expose, coiffés d’un bonnet vert, les débiteurs faillis[205]... Ce côté de la place présente un caractère sinistre. Les autres, au contraire, par un contraste saisissant, respirent la gaieté et la vie. C’est, le long des boutiques [p. 194] ventrues, un passage continuel de gens affairés et d’oisifs marchandant des objets de toilette, dévisageant la belle parfumeuse, envahissant l’officine du barbier qui rase, frise, accommode et saigne moyennant un petit écu par mois. Mais la foule se presse surtout sous l’auvent des frères Labottière, les libraires en vogue. C’est chez eux que se débitent et parfois se forgent les nouvelles qui, le soir même, alimenteront la ville. Jurisprudence, politique, histoire, littérature, chasse,... on aborde tous les sujets, sauf pourtant la question religieuse. Bordeaux—qui le croirait!—est renommé pour sa pondération en cette irritante matière. Tandis que, aux quatre coins du royaume, chacun dispute sur la Grâce, le Gascon demeure insensible aux querelles jansénistes. Le scepticisme inhérent à sa race n’est point étranger à cet heureux résultat; mais il faut aussi en reporter l’honneur au prélat plein de prudence qui préside aux destinées du diocèse. Monseigneur de Lussan—un ancien dragon décoré de la croix de Saint-Louis—a cueilli trop de lauriers sur les champs de Bellone pour aspirer à de nouveaux exploits accomplis à coups de crosse et d’anathèmes.
Franchissons la porte du Cailhau, longeons la berge du fleuve—que bordent à cet endroit les [p. 195] échoppes des ferblantiers[206],—saluons l’hôtel des Fermes, et débouchons sur la place Royale... Le changement de décor est complet. Plus d’antiques logis accumulés les uns sur les autres et recevant à peine le jour par leurs croisées étroites; mais de monumentales constructions avec un horizon baigné d’air et de lumière. Tout le long de la Garonne, le mouvement tient du prodige. Ce ne sont que haquets attelés de chevaux, que traîneaux tirés par des bœufs, que portefaix gesticulant, criant, se dépensant en efforts surhumains. Tandis que les colporteurs alignent leurs étalages; que les matelots, jambes nues, transportent les passagers de la rive aux bateaux; qu’aubergistes et hôteliers harcèlent les arrivants; que les sergents recruteurs surprennent la signature des cadets en goguette; que moines et loqueteux sollicitent l’aumône d’un ton nasillard,—la Bourse, aux arceaux sonores, est le théâtre d’une agitation fébrile. Jadis jugée trop vaste, elle pèche maintenant par son exiguïté. Le va-et-vient y est incessant: commis des douanes et des fermes, veilleurs guettant l’arrivée des navires, courtiers offrant les produits des îles contre les vins de la [p. 196] région... Autour de la grande salle, une rangée de tréteaux, couverts d’ustensiles et d’étoffes, attire les chalands. Ici, les marchands d’estampes et d’images; là, les horlogers parqués dans des guérites; plus loin, les fabricants de cordes à boyaux, violes, basses et mandolines. C’est, surtout à l’époque des foires, un bazar universel où se trouvent toutes les marchandises connues, même les ouvrages pourchassés par la police. Demandez plutôt à l’intendant: il assure que, sous le regard bienveillant de l’autorité consulaire, on y débite, comme du sucre ou de l’indigo, la série des libelles—Dieu sait s’ils pullulent!—imprimés contre le roi[207].
Poursuivons notre promenade, laissons à leurs exercices les cavaliers qui paradent aux abords du Château-Trompette, et, échappant au contact de cent industries diverses, remontons jusqu’au sommet des Fossés de l’Intendance, au point où ils aboutissent à la place Dauphine. Nous voilà à l’entrée de la salle de spectacle—celle-là même dont l’édification amena une hécatombe parlementaire. C’est là que la jeunesse dorée se donne rendez-vous. Le lieu est bien choisi. Toute l’après-midi, on y voit circuler les sujets de la troupe: [p. 197] Célimène drapée dans ses grands airs, Marton la délurée, Agnès moins timide dans la rue qu’à la scène, les reines de tragédie et d’opéra, les nymphes du ballet qui, plus expertes que leurs sœurs de la fable en l’art d’amorcer les gens, n’ont garde de s’enfuir derrière les saules.
Le soir, vers cinq heures, quand s’allument les chandelles de la rampe, commence le défilé des dames venues pour occuper leurs places[208]: l’intendante en robe à paniers d’une nuance délicate; présidentes et conseillères luttant d’élégance; bourgeoises à prétentions qui grilleraient d’avoir des pages si la mode n’en était passée; robustes beautés et jolis minois avec lesquels il s’échange plus d’un coup d’œil à travers les glaces de la chaise ou les rideaux de l’antique carrosse.
Le personnel qui affectionne ce quartier se compose d’officiers infatués de leur mine, de petits-maîtres tenus pour savants parce qu’ils ont lu Candide, de fils de famille en rupture de comptoirs et en débauche de bonnes façons... Une avalanche d’habits blancs, roses et bleus, galonnés de tresses d’or larges d’un doigt, avec des boutons d’acier, des poches en long et l’épée poignardant le ciel. Un double lien unit ces éléments [p. 198] divers: l’amour du plaisir et le besoin de paraître. Cette dernière faiblesse est le péché mignon des Bordelais. Tous nobles, tous comtes ou marquis! s’écrie, non sans malice, un contemporain... Nobles, tous? c’est discutable, bien que la Gascogne soit le pays de France où s’écoule le plus de savonnettes à vilain; il n’est guère, en effet, assure Bernadau, de bourgeois enrichi qui ne s’offre cette satisfaction, sinon par vanité, au moins pour se conformer à l’usage. Mais les titres dont la plupart s’affublent, n’existent guère que dans leurs rêves. Point de seigneur sans terre, disait le vieil adage... Les terres de la province ne suffiraient pas à justifier le quart des couronnes ou tortils qui s’épanouissent sur les rives de la Garonne.
Une particularité digne de remarque, c’est la facilité avec laquelle, vrais ou faux, ces titres nobiliaires s’accommodent avec l’esprit de négoce inhérent à la race bordelaise. Il n’est pas de baron, si glorieux qu’il soit, qui, dans les communs de l’hôtel héréditaire, ne débite son vin en fût, en baril, voire à la bouteille. De même, on peut tenir pour certain que les gentillâtres chartronnais attelés au char de la grande coquette s’efforcent, entre deux tirades amoureuses, de placer quelques barriques de palus. L’exemple le plus [p. 199] frappant de cet éclectisme est fourni par certaine bourgeoise de la rue du Parlement, enrichie dans le commerce des blés, l’armement et la banque. Devenue, très légitimement, comtesse de Lasserre et marquise de Pouy-Roquelaure, investie en cette qualité du droit de haute et basse justice, disposant de neuf paroisses dont les curés doivent lui offrir l’encens, elle n’en continue pas moins à trafiquer avec les îles, à jouer sur la hausse des farines, à prêter ses fonds à six pour cent et à tenir ses comptes en partie double. Ajoutons, à l’honneur de sa descendance, que, dépossédée du marquisat, elle en quitta le nom et le titre... On assure que bon nombre de Gascons, se trouvant dans le même cas, oublièrent de se conformer à cette règle.
Achevons ce tableau rapide par quelques mots sur une puissance qui bientôt régentera le monde: nous voulons parler de la presse... Elle vient de faire sa première apparition, oh! avec un format et un qualificatif modestes: les Annonces-Affiches. C’est un recueil qui, à partir du 1er août 1758, est publié le jeudi de chaque semaine. On y trouve la nomenclature des maisons à louer ou à vendre, la liste des objets perdus, la date d’arrivée ou de départ des navires et toute une série de propositions engageantes. Un Bordelais désire-t-il se [p. 200] rendre à Paris ou à Toulouse? Il demande un compagnon pour partager la voiture, le gîte et la table. Procureurs, notaires, conseillers, voulant se défaire de leurs offices, font aussi appel à la publicité. L’élément littéraire, sous forme de contes, d’odes, de critique théâtrale, de mémoires historiques, ne tarde pas à apparaître: c’est dans les Annonces-Affiches que l’abbé Baurein insère ses premiers travaux, à côté d’articles de Louis-Sébastien Mercier, le futur conventionnel, alors professeur au Collège de la Madeleine. Voici, enfin, quelques indications succinctes sur les événements qui s’accomplissent en France et à l’étranger; mais pas une appréciation, pas un jugement. Cela s’appellerait de la politique, et toute incursion dans ce domaine est rigoureusement défendue. Il en coûterait gros de se risquer... En tant que grilles et verrous, le fort du Hâ—encore une ressemblance avec Paris—ne le cède en rien à la Bastille!
Nomination de Richelieu.—Campagne de Mme d’Aiguillon en sa faveur.—On le chansonne à Paris.—Hostilité de Mme de Pompadour.—Arrivée en Guyenne.—Spontanéité de la joie publique.—Succès mondains du maréchal.—Le jeu à Bordeaux.—Aventure de Mme Caillou.—Le tripot du duc de Duras.—Lésinerie de Richelieu.—Appréciation à son égard de la marquise de Créquy.—La cabane de Philémon.

Durant cette première partie du XVIIIe siècle, la société bordelaise subit dans ses idées, ses goûts, ses mœurs, l’empreinte puissante de Montesquieu. A cette influence féconde allait en succéder une autre, moins heureuse, qui ne prit fin qu’avec le règne—trop long, hélas!—de Louis XV: celle du maréchal de Richelieu. Après le philosophe dont la parole éclaira le monde, l’homme de cour qui résume le mieux les vices et l’opprobre de son temps.
Nommé gouverneur de la Guyenne le 4 décembre 1755, Richelieu ne prit possession de son poste que dans le courant de 1758. Dès que son départ fut résolu, il chargea sa cousine, Mme d’Aiguillon, de préparer le terrain.
[p. 202] Depuis la mort de son vieil ami le président, la bonne duchesse espaçait ses visites. Elle n’en restait pas moins fidèle à ses affections, entretenant avec les hôtes de Mme Duplessy une correspondance piquante, dont quelques spécimens ont survécu: vrai régal de gourmet. Avec son esprit narquois, la Sœur du pot est une conteuse émérite: le récit des scandales de Versailles prend, en passant par sa plume, l’allure la plus alerte. Parfois, sous cette forme légère, apparaît la note philosophique, avec le souci de l’avenir gros de tempêtes préparé par l’inconscience des cervelles et des cœurs. Que de préoccupations, quelle appréciation sévère dans ce simple paragraphe d’une facture bien féminine: «Des victoires! Nous n’y sommes pas accoutumés depuis quelque temps. La situation critique des affaires et la misère n’empêchent pas que les choses n’aillent le même train. On se marie, on donne des étrennes, le cavagnol se soutient, on achète des habits pour Marly, et l’on prépare des mascarades. Mesdames donnent un grand bal masqué: nous n’en serons pas quittes pour cela... Après Marly, nous en aurons d’autres[209].»
En même temps que l’étoffe d’un moraliste, [p. 203] Mme d’Aiguillon possédait les facultés maîtresses du diplomate: elle les utilisa au profit de son noble cousin—celui-là même que Voltaire, dans son jargon obséquieux, qualifiait de mon héros.
Mon héros n’avait rien gardé de l’adolescent qui jouait, sous le feu roi, les chérubins près de la duchesse de Bourgogne. Quoique d’allure encore gaillarde, il supportait le poids de soixante-deux hivers masqués imparfaitement par des artifices de courtisane. Moins aveugle que le beau sexe, la Fortune commençait à lui battre froid. Ses succès d’alcôve se maintenaient, mais le général était moins haut coté que le séducteur. On admettait volontiers que ses conquêtes les plus glorieuses étaient celles qui se paraient de mouches et de rouge.
L’expédition de Minorque lui avait valu cependant un regain de célébrité. Ce fut, à Bordeaux, un déluge de poésies latines, françaises et patoises, sortant des presses de la veuve Brun, imprimeur ordinaire de l’Hôtel de Ville. Le nom de Port-Mahon circulait sur toutes les lèvres: on l’attribua à une rue, à une hôtellerie, à un gâteau d’amandes[210]... Chacun récitait l’ode fameuse où, en vers [p. 204] bons à siffler, le patriarche de Ferney compare le triomphateur à son grand-oncle:
La réflexion aidant, l’épopée apparut bientôt comme une étourderie favorisée par le hasard[211]. L’engouement fit place à la tiédeur, la tiédeur au dénigrement, et les quolibets pleuvaient, dru comme grêle, quand survint la campagne de Hanovre.
Le rôle de Richelieu, dans cette affaire, ne laissait pas que d’être louche. Substitué par des intrigues de boudoir au maréchal d’Estrées, dont la tactique savante allait déterminer la capitulation de Closter-Seven en vertu de laquelle l’armée anglaise mettait bas les armes, le favori de Louis XV empochait le profit sans avoir été à la peine. Les uns rappelèrent la fable où un animal naïf tire de la cendre les marrons que croque son camarade. Les autres applaudirent à une caricature qui représentait le général disgracié fouettant son adversaire britannique avec [p. 205] des branches de laurier dont le petit père La Maraude[212] ramassait les feuilles en courbant l’échine. Enfin—symptôme plus caractéristique encore—on chansonnait à cœur-joie celui qui, si souvent, avait fait rire des autres:
Une diversion était nécessaire. Richelieu, qu’on allait maintenant jusqu’à accuser de corruption, jugea opportun de frapper un grand coup en venant prendre le commandement de la Guyenne. Que des instructions secrètes fussent adressées aux jurats pour rehausser le faste de cette cérémonie, [p. 206] la chose n’est pas douteuse. Ceux-ci, d’ailleurs, ne se firent pas tirer l’oreille. Appelés, en vertu de privilèges anciens, à se partager les reliefs de ce genre de fêtes—velours, satins, étoffes d’or et d’argent—rien ne leur semblait trop cher... Il leur en coûte si peu! proclame un poète du temps[214]. Madame de Pompadour, alors en guerre ouverte avec «le grand tripotier», en conçut une vive irritation. Sollicités par elle, les ministres ordonnèrent plus de mesure dans les dépenses, assurant que les superfluités luxueuses n’ajoutaient rien à la dignité de celui qu’elles avaient pour but d’honorer[215].
On se demande jusqu’où—à défaut de [p. 207] recommandations—ces dépenses seraient montées. Seule, la note du tapissier s’éleva, en velours de Gênes, moquette cramoisie, taffetas, galons, franges, graine d’épinards, écussons en or riche:—à 16,718 livres trois sous dix deniers pour la maison navale;—à 7,876 livres deux sous huit deniers pour la tribune aux harangues;—à 2,042 livres un sou trois deniers pour le baldaquin;—à 4,867 livres cinq sous six deniers, pour le dais... Le reste à l’avenant: les contribuables avaient bon dos[216].
A dire vrai, ces prodigalités ne leur plaisaient guère. Un habitant de la rue Neuve, alors à Paris, ne craignait pas d’écrire qu’un vent de folie soufflait sur ses compatriotes,
A quoi son correspondant—un honorable ecclésiastique—répond qu’il ne faut s’étonner de rien, que les préparatifs s’effectuent par ordre, et que tout, jusqu’à l’heure des offices, est changé «par rapport à ce Monsieur[217]...».
Ce Monsieur n’était autre que le maréchal... Mme d’Aiguillon ne se méprenait pas sur la [p. 208] spontanéité de la joie publique. «Si nous arrivions de Minorque, écrivait-elle, cela seroit plus aisé; mais nos lauriers sont fanés...» Il fallait les rajeunir. L’intendant—M. de Tourny fils—désireux de plaire, s’ingéniait dans ce but. Richelieu lui-même ne demeurait pas inactif. Il prenait connaissance des projets de discours, y opérait des modifications et affirmait qu’on ne pouvait, sans lui faire injure, passer sous silence ses exploits militaires en Hanovre[218].
Toutes choses réglées comme pour un souverain, il se trouva en mesure de partir. La route lui fut légère. Il possédait une voiture dont le confort eût excité l’admiration d’un prince des Mille et une nuits. Sa dormeuse—ainsi l’appelait-il—contenait un lit de petite-maîtresse. Bien au chaud pendant l’hiver, bien au frais durant l’été, mollement bercé en toute saison, l’illustre guerrier se couchait à Paris pour ne se lever qu’au terme du voyage[219].
Ainsi arriva-t-il à Blaye, frais, dispos, gaillard. [p. 209] Un coup de fer à sa perruque, une combinaison savante de parfums, deux doigts de rouge sur les pommettes, quelques coups d’ongle au lobe de l’oreille pour lui imprimer la nuance rose à la mode—le dieu pouvait s’offrir à l’amour de ses peuples.
Ceux-ci ne marchandèrent pas le tribut exigé de leur zèle: de tout temps, les Gascons se grisèrent au feu des lampions comme à celui de la poudre! La Jurade n’avait, d’ailleurs, rien épargné: mousquetades appuyées par le canon du Château-Trompette, harangues des Corps de la cité, vaisseaux pavoisés, édifices tendus de tapis et d’étoffes, Te Deum chanté par l’archevêque, musiques, illuminations, pots d’artifice, distribution d’aumônes, bal, réjouissances publiques...
Jamais, depuis l’entrée fameuse de Dunois, Bordeaux n’avait offert un pareil spectacle. La foule fut satisfaite. Un dîner de quatre cents couverts[220], des festins se succédant sans trêve, de la bonne grâce et de l’esprit comptant, un système adroit de flatteries avec l’art de s’emparer des gens en favorisant leurs vices, achevèrent l’œuvre de séduction.
Nous touchons ici à une question délicate: [p. 210] celle des succès mondains du maréchal... La légende qui s’attache à son nom, créée par quelques adulateurs avec une inconscience voisine de la complicité, propagée, non sans calcul, par des Mémoires d’une exactitude discutable, a porté une atteinte sérieuse à la réputation des Bordelaises d’autrefois. Rappelle-t-on ces souvenirs lointains, chacun de hocher la tête avec des allusions où apparaît, comme en un miroir magique, toute une série d’évocations graveleuses: les fantaisies libertines de Richelieu, toujours satisfaites; la promiscuité de ses fêtes où la ritournelle du menuet mettait face à face grandes dames et impures tarifées; ses soupers avec un essaim de beautés aristocratiques, plus soucieuses de devancer les désirs de l’amphitryon que de résister à ses attaques...
Il faut se défier des impressions qui, basées sur un fait, aboutissent à une synthèse généralisatrice. Pour si grand séducteur qu’on le tienne, Richelieu commit sans doute moins de péchés qu’il n’en confessa. Le courtisan qui dut sa fortune politique au récit de ses succès d’alcôve peut, non sans raison, être soupçonné de broderies utiles à sa gloire. Au dire de ses familiers, la conviction qu’il était irrésistible l’amena parfois à enregistrer des victoires là où il n’y eut pas même de rencontres. Fallût-il, [p. 211] d’ailleurs, ajouter foi aux vanteries de ce Céladon hors d’âge, on devrait se garder de croire que, chassée par lui, la Pudeur eût émigré vers d’autres rivages. Pas plus à cette époque qu’à toute autre, Bordeaux ne mérite une place à part dans les annales de la galanterie. A côté des pécheresses—souvent si séduisantes—qui alimentèrent la malignité publique, il y eut les honnêtes femmes, dont personne ne parle: ces dernières, de tout temps, furent la majorité.
Jetons un voile sur ce genre d’aventures, d’une banalité courante, et dont Lyon, Rouen ou Marseille auraient pu aussi bien devenir le théâtre: tant de sujets, plus dignes d’intérêt, sollicitent l’attention!
Parmi les passions que se plut à surexciter le nouveau gouverneur, il en est une qui trouva en Guyenne un terrain admirablement préparé: la passion du jeu. Sous les auspices du premier magistrat de la province, elle fut poussée au delà de toute mesure... Pourquoi ne pas le dire? Les femmes étaient les premières à sacrifier au démon tentateur...
Homère enseigne que la blanche Nausicaa, fille du roi Alcinoüs, emportait des osselets dans son char quand elle se rendait à la fontaine pour laver les hardes paternelles, et que, le travail [p. 212] achevé, servantes et princesse s’oubliaient, à l’ombre des saules, dans de longues parties. A la place de Nausicaa, une Gasconne de jadis aurait interverti les rôles, donnant le pas à la récréation sur la mise en œuvre du battoir: moyennant quoi, les tuniques de Sa Majesté phéacienne eussent couru grand risque de rester à l’état de linge sale.
Pour ne point remonter à l’Odyssée, les traditions locales n’en sont pas moins probantes. Témoin l’aventure de la gente trésorière, qu’un poème, d’une saveur naïve, reproduit sous ce titre affriolant: Stances contenant l’histoire de Caillou et de sa femme et les maux que le jeu cause tant aux femmes qu’aux hommes qui l’ayment par excès et non par déduict[221]...
Caillou, c’était le trésorier: un financier du temps des Valois, qui, loin de combattre le goût de sa jeune épouse pour les cartes, ne résistait à aucune de ses fantaisies. Caillou! s’écrie le chantre bordelais,
[p. 213] Le désastre fut, en effet, irréparable. La maison du trésorier devint le rendez-vous d’aigrefins parmi lesquels «l’un des plus asseurés pipeurs de France». Une partie de lansquenet, dans l’atmosphère capiteuse du tête-à-tête, eut raison de la trésorière. Argent, perles, bijoux, chaînes, ses plus riches habits, tout y passa, jusqu’à l’anneau de mariage. Il ne restait à la malheureuse que sa vertu. Elle la joua, perdit, paya... et fut mise à mort par l’époux outragé. Sur quoi, l’auteur des Stances formule toute une gamme d’imprécations contre le jeu, favori de la débauche, boute-feu des discordes, compagnon des «bourses flasques», et termine par un choix de conseils savoureux: Mesdames, soyez prudentes; tirez le verrou du gynécée; ajustez votre fantaisie aux préceptes de la loi Oppia[222]; rapiécez pourpoints et chausses, et ne manquez pas, au retour de la messe, de quitter vos souliers de ville pour ne les reprendre que le lendemain!
Hélas! ni ces exhortations salutaires, ni le souvenir de Mme Caillou ne devaient refréner le goût des Bordelaises. Du temps du roi Henri, la rage était la même: on ne parlait que de «rendez-vous au brelan». Sans doute, des deux cent quatorze [p. 214] jeux familiers à Gargantua, ces dames ne possédaient qu’un petit nombre; mais comme elles usaient de ceux-là! Loin de vaquer aux soins de leur maison, demoiselles et bourgeoises risquaient leur avoir sur un coup de dé, quitte à vendre les chemises de leur mari—«chose, assure un contemporain, qui causa infinies riotes, querelles et soupçons dans plusieurs ménages, jusques à séparation de corps et de biens[223]...»
Les hommes, au surplus, tenaient tête aux femmes. Ils avaient même des ressources spéciales pour parer aux caprices de la Fortune: les rogneurs de pistoles et les faux-monnayeurs qui, durant le règne de Louis XIII, infestèrent la Guyenne, se recrutaient surtout parmi les joueurs de condition... Les vices sont des maîtres impérieux: ne faut-il pas les satisfaire! On jouait partout, dans les boudoirs et sur les fonds de barriques, à visage découvert ou sous le masque... Dans ce dernier cas, chacun apportait ses dés[224]. Ajoutons que les mises étaient énormes. Les raffinés du XVIIe siècle ne se bornaient point à risquer quelques louis: un poète du cru, Martin Despois, assure
Qu’ils couchent cent escus à tout coup sur la carte[225].
[p. 215] Et voilà que cette passion, exaspérée par de perpétuels stimulants, allait trouver sa consécration officielle dans les salons du gouverneur, accessibles au premier venu, pourvu qu’il fût porteur de fortes sommes[226]! Ce fut une frénésie inimaginable qui atteignit la noblesse entière, bon nombre de bourgeois et une partie du haut commerce. A ce spectacle inouï, Marmontel, qui cependant ne s’étonnait guère, éprouva un véritable saisissement. Il s’en explique dans ces termes: «Un fatal jeu de dés, dont la fureur les possédoit, noircissoit leur esprit et absorboit leur âme. J’avois, tous les jours, le chagrin d’en voir quelqu’un navré de la perte qu’il avoit faite. Ils sembloient ne dîner et ne souper ensemble que pour s’entr’égorger au sortir de table. Et cette âpre cupidité, mêlée aux jouissances et aux affections sociales, étoit pour moi quelque chose de monstrueux[227].»
Bientôt, des régions élevées, la contagion s’étendit au monde de la basoche, au petit commerce et même aux artisans. Le nombre des tripots s’accrut dans des proportions incroyables, grâce à la tolérance de la municipalité[228]. La ville [p. 216] ne suffisant pas, le vice franchit les barrières, au delà desquelles il avait ses coudées franches. On ne vit plus, après la porte Saint-Julien que maisons louches où les naïfs, amorcés par l’enseigne de bals champêtres, étaient dévalisés en cadence. Le plus renommé de ces mauvais lieux fut celui que le duc de Duras, besogneux et dépourvu de préjugés, installa à Talence, dans sa belle propriété de Peixotte[229]... Un trafic de grand seigneur! A Paris, ces sortes de prébendes faisaient l’objet d’ardentes convoitises: personne n’ignore que les hôtels de Gesvres et de Soissons, transformés en coupe-gorge où défilait successivement la clientèle entière de l’abbé Gallande, confesseur des pendus, rapportaient, grâce au pharaon et au biribi, cent vingt mille livres par an... M. de Duras se contentait d’un moindre bénéfice: à Peixotte, le droit d’entrée était de deux écus par tête.
Le maréchal n’eut-il pas, lui aussi, la tentation d’exploiter cette mine? Ce ne fut point sans doute l’envie qui lui manqua. Sous des apparences de grand seigneur, il cachait les instincts d’un traitant de bas étage. Toute générosité ne tournant [p. 217] point à sa gloire lui était inconnue. Ce prodigue par vanité liardait, dans son particulier, à rendre Harpagon jaloux. «M. de Richelieu, rapporte un témoin digne de foi, ne paye pas un sou dans sa maison; on n’y voit jamais la couleur de son argent. Je sais un gouverneur de son fils chassé de chez lui, qui n’a pas encore reçu un sou et qui meurt de faim[230].» Ses scrupules, d’ailleurs, égalaient ceux de Mascarille: les tripotages de la campagne de Hanovre en donnent la mesure... Rien ne démontre, cependant, qu’il exigeât de sa clientèle le double louis qu’on payait, à l’entrée des académies parisiennes, pour avoir le droit de s’asseoir autour du tapis vert et de prendre part à un souper où ne manquaient ni les vins généreux ni les beautés faciles. Seuls, chez lui—à en croire la chronique—les valets de service bénéficiaient de la partie: dans l’espace d’un carnaval, ils se partagèrent quarante mille livres sur lesquelles, suivant l’usage, ils durent solder les cartes et la chandelle... Nous ne jurerions point que M. le Gouverneur ne laissât à leur charge d’autres menues dépenses, celle de la buvette, par exemple, et les gages des laquais!
[p. 218] L’hôtel de la rue Porte-Dijeaux[231] ne s’ouvrait pas cependant qu’à la mauvaise compagnie. Ce logis étrange comprenait deux bâtiments distincts, assortis de morales différentes. A côté des salons ouverts au jeu et à la galanterie, il y avait le réduit des philosophes: on l’appelait la cabane de Philémon[232]. Là, se réunissait, dans des soupers intimes consacrés à l’art et à la littérature, un noyau de Bordelais: des penseurs, comme Barbot; des gens d’esprit, comme M. de Gascq[233]; des érudits, comme MM. de Lalanne et de La Tresne...
Qu’on ne s’étonne pas de voir de pareils hommes entretenir des relations suivies avec le petit père La Maraude. La vieille amitié qui les liait à Mme d’Aiguillon leur en faisait presque un devoir. Celui-ci, au surplus, n’était point un causeur à dédaigner. La vivacité de son intelligence et une teinte superficielle de toutes choses, même des matières ecclésiastiques, suppléaient à [p. 219] son ignorance. Si le fond laissait à désirer, les dehors étaient brillants—ce que la marquise de Créquy traduisait de la façon suivante: il manque de chemises, mais possède une ample provision de manchettes... Comédien merveilleux, il avait le don d’enguirlander son monde. Les formules délicates abondaient sur ses lèvres... M. de La Tresne? le plus adorable des amis... Barbot? le miroir du grand président défunt... M. de Lalanne? un Socrate inimitable dont il se désolait de ne pouvoir être l’Alcibiade, et auquel—tour à tour louangeur, caressant, ému—il ne cessait de reprocher son humeur chasseresse, ses goûts sylvestres, ses occupations de marguillier qui le tenaient éloigné de Bordeaux. C’était, assure un de ses biographes, un caméléon qui, pour plaire, changeait à chaque instant de couleur et de forme...
Malgré ses talents multiples, Richelieu—l’avenir le démontrera—ne fût point parvenu à réduire certaines répugnances s’il n’eût eu la bonne fortune de trouver un appui dans la plus parfaite de ses œuvres: nous avons nommé sa fille, la comtesse d’Egmont, une sirène venue à sa suite et à qui la population entière, dont elle ne tarda pas à devenir l’idole, ne sut jamais rien refuser.

La comtesse d’Egmont.—Son séjour à Bordeaux.—La fête de M. Lafore.—Le consul de Suède, M. Harmensen.—L’orme de la bonne duchesse.—La Bordelaise sous Louis XV.—L’Anglais à Bordeaux, de Favart.—La guerre de 1758.—Voyage de Richelieu à Bayonne: campagne en faveur de la danse.—Les Volontaires d’Egmont.

Lorsque, dans les galeries de Versailles, apparaissaient Mmes d’Egmont, de Brionne et de Duras, chacun songeait aux trois déesses du mont Ida. Mme de Brionne figurait Minerve; Mme de Duras, Junon; Mme d’Egmont, Vénus... non la Vénus classique, immobile et glacée dans sa correction sculpturale, mais une Vénus animée, palpitante, joignant à l’attrait des lignes la séduction plus puissante de la pensée et de la vie. Une légère imperfection, célébrée par les poètes, prêtait à sa beauté un caractère étrange. Ses sourcils étaient trop courts; on eût dit que l’artiste chargé de les tracer se fût arrêté à moitié route, ébloui par l’éclat de deux yeux, tantôt bruns, tantôt noirs, tantôt gris, d’une magie irrésistible. Tout contribuait à un ensemble [p. 222] d’une saisissante originalité; mais ce qui constituait son plus grand charme, c’est un parfum de mélancolie qui se dégageait de la personne entière et l’enveloppait d’une sorte d’auréole... Mme d’Egmont se définissait ainsi: j’ai l’esprit gai, mais le cœur triste.
La cause de cette tristesse, personne ne l’ignorait. Au cours de son enfance, écoulée à l’abbaye du Trésor, Mlle de Richelieu avait partagé les jeux d’un jeune garçon qui devait être un jour le plus beau et le plus brave des gentilshommes. On le nommait le comte de Gisors. C’était le fils du maréchal de Belle-Isle, petit-fils lui-même de Nicolas Fouquet. La sympathie, entre les adolescents, ne tarda pas à se changer en un sentiment plus tendre... Ils avaient compté sans la morgue du vainqueur de Port-Mahon, grisé par son second mariage avec une princesse de Lorraine. Quand M. de Belle-Isle fit la demande, un refus hautain lui fut opposé...
—On discute trop l’ancienneté de ma noblesse, s’écria le maréchal, pour que je puisse m’allier à une maison de robe!
Vainement on lui représenta que les jeunes gens s’adoraient:
—Bah! répliqua-t-il cyniquement, ils se retrouveront dans le monde...
[p. 223] Ils ne se retrouvèrent pas. M. de Gisors se faisait tuer à Crevelt, tandis que Mlle de Richelieu épousait le plus puissant seigneur des Pays-Bas: le comte d’Egmont, duc de Bisaccia, de Gueldres et d’Agrigente, prince de Clèves, grand d’Espagne de première classe et chevalier de la Toison d’or... La jeune femme n’en resta pas moins fidèle à l’inclination de son cœur: malgré les mérites de l’époux choisi par les siens, elle n’éprouva jamais pour lui que de l’estime.
Cette belle désolée avait, au sortir du couvent, été recueillie par sa tante, Mme d’Aiguillon. La bonne duchesse l’entoura d’une affection toute maternelle. Elle veilla à son éducation littéraire et lui imprima cette note philosophique qui dominait dans son salon. L’élève n’eut pas de peine à égaler le maître. Tout la poussait vers les idées nouvelles: l’amitié de Mme de Tencin, qui l’avait bercée sur ses genoux; le contact des hommes appelés à vivre à ses côtés; les exemples qu’on plaçait sous ses yeux; l’air qu’elle respirait; les livres qui tombaient sous sa main... A seize ans, elle savait par cœur les dix chants de la Henriade et, comme un docteur de Sorbonne, commentait l’Esprit des lois.
Son éducation mondaine n’était pas l’objet d’une moins grande sollicitude. Elle chantait en [p. 224] s’accompagnant de la guitare, touchait du clavecin, excellait dans la peinture sur vélin et sur ivoire. Mlle Clairon, avec l’art des révérences, lui avait enseigné les principes de la déclamation. Quant aux manières, elle possédait celles de l’hôtel de Brancas, le refuge, sous la Régence, du savoir-vivre et du bon ton.
C’est au lendemain de son mariage, après sa présentation à Versailles, mais avant les succès qu’elle y obtint plus tard, que Mme d’Egmont, en l’absence de son mari retenu à l’armée, vint rejoindre le maréchal. Elle achevait à peine sa dix-huitième année et n’avait point encore donné la mesure de ses talents; c’était presque un début...
Il eut lieu sous les auspices de la bonne duchesse, qui tint à accompagner la voyageuse. Celle-ci n’eut pas plus tôt mis pied à terre que «tous les cœurs voloient vers elle». De toutes parts, on s’ingénia à lui plaire. La société parlementaire, Mme Duplessy en tête, se l’arracha. Le petit clan de la noblesse d’épée se mit aussi en dépense. Il n’est pas jusqu’au monde du négoce qui ne voulût témoigner son admiration pour la belle des belles.
Parmi les grands seigneurs de l’armement, à côté des Nairac, des Gradis et, plus tard, des Bonnaffé, il en est un qu’il faut mettre hors de [p. 225] pair: il se nommait M. Lafore. C’était, en même temps que l’oracle de la Bourse, un patriote éclairé, un enjôleur des foules, un prodigue incomparable. M. Lafore, voulant fêter dignement Mme d’Egmont, sut trouver de l’inédit: une réception grandiose à bord d’un navire en partance[234]. Ses hôtes? La fleur de la Rousselle et des Chartrons, les officiers de la Jurade, le gouverneur et sa suite, les représentants des nations étrangères, parmi lesquels le consul de Suède, M. Harmensen,
Un carrosse à quatre chevaux conduisit l’illustre invitée à la façade de la Bourse où elle apparut, à tous les yeux, comme la déesse chantée par le poète...
Qu’on se la représente, en sa beauté juvénile, suivant un tableau célèbre conservé au musée du Louvre[235]. Teint délicat, fraîcheur exquise, regard voilé par une douce réserve, taille cambrée dans une pose pleine de charme et de naturel. Le [p. 226] costume, en dépit de sa simplicité, accuse une rare élégance: chapeau de paille à larges revers, robe gris pâle d’une nuance indéfinissable, ornée, au corsage et aux manches, de nœuds de velours héliotrope. Pour faire honneur à ses hôtes, elle s’est parée de quelques-uns de ses bijoux—ceux dont elle a reçu la garde le jour de son mariage: un bracelet garni d’hyacinthes de la plus belle couleur capucine; une aigrette avec pendeloques «d’un orient merveilleux»; enfin, un collier de perles, valant plus de quatre cent mille écus, lequel, dans la maison d’Egmont, «étoit substitué à perpétuité, ni plus ni moins qu’un majorat de Castille ou qu’une principauté de l’Empire[236].»
Un brigantin, servi par des matelots en casaque rouge et argent, munis d’avirons aux armes du maréchal, vint prendre les héros de la fête qu’escortèrent des centaines de barques avec leurs voiles multicolores et leurs pavillons enrubannés: «C’est, dit le chroniqueur, au milieu de la mer, sur le tillac d’un navire, que furent présentées ce grand nombre de femmes aimables que le commerce retient à Bordeaux...»
Durant le cours de la visite, des instruments variés—tambourins, violes, cors de [p. 227] chasse—alternèrent avec des salves d’artillerie. Puis, vint une collation digne de la table des Dieux. Le programme portait ensuite un bal champêtre. Il devait avoir lieu au quai des Chartrons, sous l’orme de la bonne duchesse, un orme gigantesque qui jouait un rôle considérable dans la vie des Bordelais, si l’on en juge par ce couplet, d’une note émue:
[p. 228] La seconde Athènes, ce beau soir, se pressait tout entière sur les rives de la Garonne. L’encombrement fut tel que les hôtes de M. Lafore ne purent se frayer un passage jusqu’à l’arbre tutélaire. Il fallut renoncer aux danses en plein vent; mais la fête n’y perdit rien. Comme sous la baguette d’une fée, vingt salons s’éclairèrent soudain dans vingt maisons différentes, et autant d’orchestres convièrent la compagnie à de joyeux ébats. Au lieu d’un bal, ce fut une série de bals improvisés que Mme d’Egmont, semblable à une abeille qui voltige de fleur en fleur, honora tous de sa présence... Aucune cité au monde—si ce n’est celles qu’on voit en rêve—n’eût pu accomplir un pareil tour de force...
Cette soirée devait être décisive. Portée aux nues, la fille de Richelieu, par une juste réciprocité, voua à la ville de Bordeaux l’affection la plus tendre,... affection qui s’explique sans peine. Le Bordelais rachète, par tant de qualités, les défauts de sa race! Quant à la Bordelaise, si séduisante à travers les âges, quel charme ne répand-elle pas à une époque dont les raffinements exquis s’harmonisent à souhait avec les dons qu’elle reçut du ciel! Déjà, cent ans plus tôt, un voyageur émerveillé s’en expliquait ainsi: «Je n’ai jamais rien vu d’aussi charmant que les [p. 229] dames de Bordeaux, lesquelles vont à l’envy à qui rendra plus de civilité aux estrangers et prennent tant de soin à paroistre généreuses à leur égard[239]...»
Ces qualités natives d’élégance, d’urbanité, de politesse, se sont encore affinées sous le règne de la poudre et des mouches; la Bordelaise du XVIIIe siècle peut, sans crainte, affronter la comparaison avec ses rivales les mieux douées. L’air accueillant, le sourire aux lèvres, gracieuse en ses moindres gestes, elle a dans le regard comme un reflet mutin... On la représenterait volontiers sous les traits de Rosine, telle que la dépeint l’impertinence de Figaro, fraîche, accorte, agaçant l’appétit, pied furtif, taille droite et élancée, avec des mains, une bouche, des yeux... Oh! les yeux!... et un nez, comme on disait alors «tourné à la friandise». L’esprit—une fleur qui pousse en pleine terre sous le soleil de Gascogne—lui a été dévolu avec largesse; comme Rosine, elle saurait, le cas échéant, briser grilles et verrous... Dieu merci, l’effort de son intelligence a trouvé un emploi plus profitable. Mondaine, elle l’est [p. 230] dans toute la force du mot; mais elle sait allier le plaisir aux choses de la pensée. Les lettres lui sont chères et l’art ne la laisse pas insensible. Mme Duplessy a fait école. Autour d’elle se meut un essaim de jeunes femmes, curieuses de nouveautés, se passionnant pour les questions à l’ordre du jour, causant philosophie entre deux ritournelles, et lisant, après les émotions du bal... le Système de la nature, du baron d’Holbach, ou l’Histoire ancienne, de l’honnête Rollin[240].
Cette dualité étrange qui n’est, en somme, que la marque distinctive du caractère français, est nettement mise en relief dans une pièce représentée, le 14 mars 1763, par les comédiens de Sa Majesté. Elle a pour titre l’Anglais à Bordeaux et, pour auteur, Charles Favart, célèbre à la fois comme écrivain et comme mari; celui-là même que le maréchal de Saxe congédiait quand il allait voir sa femme, et à qui Collé attribua le surnom de Racine du vaudeville. L’intrigue, quoique simple, ne manque pas d’originalité. Milord Brumton a été battu et fait prisonnier par le capitaine Darmant, un armateur bordelais élevé dans le culte de l’Encyclopédie. Celui-ci ne se borne [p. 231] pas à loger l’insulaire dans sa maison, il le comble, en secret, de soins, de prévenances, de bienfaits. Grand émoi de Milord, qui se débat comme un diable, repousse la main de son vainqueur et accable de malédictions la nation frivole dont il a le malheur de subir le joug. S’il a horreur de la France en général, Bordeaux, avec ses jeux, ses ris, ses danses, ses concerts, lui est particulièrement odieux... Impudents! s’écrie-t-il, doubles traîtres!
Quel triomphe d’apprivoiser ce puritain!... Une entreprise bien féminine. La marquise, sœur de Darmant et veuve par le plus fortuné hasard, ne craint pas de tenter l’aventure. Qu’elle ait, comme la pupille du seigneur Bartholo, la tête un peu légère, cela ne fait point doute; mais aussi que de vaillance, de décision, de bon sens même, sous son enveloppe de petite-maîtresse! Vainement cherche-t-on à la dissuader: nous verrons, s’écrie-t-elle,
Et l’enjôleuse de citer Locke et Swift, de formuler d’ingénieux aperçus sur l’injustice qu’il y a à [p. 232] juger les gens d’après leurs masques, de prêcher la concorde entre les peuples et d’émailler sa péroraison de sentences humanitaires que ne désavouerait pas le patriarche de Ferney... Si bien que, ébloui de tant de grâce et de raison, Milord dépose aux pieds de l’enchanteresse son orgueil, ses préjugés et son amour...
Là où un sujet de Sa Majesté britannique se déclarait vaincu, comment Mme d’Egmont n’eût-elle point été sous le charme!
L’Anglais à Bordeaux était une pièce de circonstance, improvisée en l’honneur de la paix. Or, à l’arrivée du maréchal et de sa fille, la guerre sévissait encore. Bordeaux présentait l’aspect d’une ville assiégée. Des régiments nombreux y tenaient garnison, sous le commandement de MM. de Lorges, lieutenant général, de Narbonne et de Jonzac, maréchaux de camp, et de plusieurs brigadiers. Les troupes régulières se doublaient de compagnies recrutées dans la province et placées sous les ordres d’anciens officiers dont l’accoutrement, parfois bizarre, ne laissait pas que de jeter une note gaie sur cet appareil belliqueux. Ce n’étaient que défilés de milices bourgeoises, que parades tambours en tête, que travaux exécutés en vue d’une défense problématique. Le Château-Trompette, qui n’eût pas tenu [p. 233] vingt-quatre heures, recevait une ceinture de palissades; mais l’effort principal se concentrait sur le Médoc où l’on redoutait une descente. De nombreuses batteries s’échelonnaient entre la pointe de Grave et l’embouchure de la Dordogne, sous la garde de quatre-vingts capitaines de vaisseaux marchands. Ce n’était point assez que de prendre des mesures contre l’ennemi du dehors, il fallait aussi se prémunir contre les traîtres de l’intérieur. Dans ce but, on expulsait tous les Anglais établis dans la ville et même les Irlandais qui, ayant obtenu des lettres de naturalisation, ne conservaient de leur ancienne origine que le nom, l’accent et «les boucles de soulier»... Enfin, par surcroît de précaution, on organisait sur le littoral un système de guetteurs avec des feux pour donner l’alarme... Moyennant quoi, on vécut perpétuellement sur le qui-vive; dès qu’un navire apparaissait au large, sa présence était signalée, et, sur-le-champ, la nouvelle se répandait que l’armée britannique marchait sur Bordeaux, au nombre de vingt ou trente mille hommes[241]!
Prenant texte de ces inquiétudes, Richelieu proposa la création d’un camp retranché dans le voisinage de Lesparre... Au dire des sceptiques, [p. 234] ce souci de rassurer son monde n’aurait eu d’autre cause que le désir d’augmenter les émoluments du gouverneur commandant en chef[242]. Le ministre de la guerre, M. de Belle-Isle, flaira sans doute le piège. Toujours est-il que l’autorisation fut refusée[243]... Ce que voyant, le maréchal, qui déjà avait visité l’Aunis et la Saintonge, résolut d’inspecter les côtes de l’Océan jusqu’à la frontière d’Espagne.
Quand Louis le Grand daignait prendre le commandement de ses armées, les historiographes de France marchaient à sa suite, l’écritoire au poing, en vue d’enregistrer les hauts faits qui allaient s’accomplir. C’est ainsi que Nicolas Boileau célébra les exploits dont le Rhin—fleuve à la barbe limoneuse—fut le témoin attristé... A l’exemple du Roi-Soleil, le duc de Richelieu avait son thuriféraire en titre. On l’appelait Carloman de Rulhière: un nom qui ne tardera pas à figurer sur la liste des membres de l’Académie française...
Attaché à la personne de Mme d’Egmont plus qu’à celle du maréchal, dont il avait reçu un brevet d’aide de camp, le futur immortel possédait l’art de charmer la jeune comtesse par un [p. 235] choix de bons mots, d’anecdotes plaisantes, de vieux contes finement rajeunis... Un emploi dangereux pour une tête de son âge: comment l’amour n’eût-il pas réclamé ses droits?... Mme d’Egmont, toujours mélancolique, répondait aux prévenances du galant officier par une confraternité affectueuse dont celui-ci faisait ses délices. Chaque matin voyait poindre des œuvres de sa façon, petits vers ou bouts rimés. En habile courtisan, il ne se bornait pas à célébrer les grâces d’une Muse devenue sa protectrice: il savait également flatter le gouverneur, dont le crédit ne lui devait point non plus être inutile. Tantôt, il chantait les splendeurs «de son royaume d’Aquitaine»; tantôt, il lui adressait, sous le masque, devant un auditoire d’élite, des madrigaux dans le goût de celui-ci:
Quant à la bonne duchesse, Rulhière la régalait de récits, moitié prose, moitié vers, à l’instar de sa lettre sur la fête Lafore.
C’est ce même genre qu’il adopta pour transmettre à la postérité le souvenir du voyage à Bayonne. Le sujet, à vrai dire, était de nature à [p. 236] tenter une plume alerte; presque autant que le projet—prêté par Voltaire au maréchal—de dessaler l’Océan[244]... Nonchalamment étendu dans sa dormeuse, le vainqueur de Port-Mahon ne se contente pas de jeter un coup d’œil d’aigle sur les fortifications élevées le long de la route, de morigéner les ingénieurs auxquels il condescend à apprendre leur métier, de rêver une restauration du port de Saint-Jean-de-Luz... Turenne se fût contenté de l’œuvre militaire: Richelieu voit plus loin et plus haut. En lui le guerrier se double d’un philosophe... L’Adour à peine franchi, son regard découvre un point faible: le pays basque est plongé dans le marasme
Eh! quoi, proscrire le culte de Terpsichore! O clergé fanatique!... Le vice-roi d’Aquitaine s’empresse de proclamer la liberté des entrechats et ordonne qu’un tambourin demeurera désormais attaché à chaque paroisse... Les hommes à grands chapeaux durent se soumettre: Richelieu, par [p. 237] manière de représailles, eût mis à leur place des maîtres de ballet!
A dater de ce jour mémorable, le voyageur reçut l’accueil réservé aux conquérants. Chapitres, Présidiaux, Corps de villes, déversèrent autour de sa dormeuse des torrents d’éloquence. On le compara à une foule d’hommes illustres, «jusque-là que le consul de Tartas l’appela Pindare.» Le cortège passa à Dax, où il fut hébergé par un évêque «qui menoit une vie très douce entre ses oiseaux et ses fleurs», à Mont-de-Marsan, à Bazas, et s’arrêta à Roaillan, où l’attendait
Plus loin, se présentait un escadron de jolies femmes qui, luttant de prévenances, escortèrent le héros du jour jusqu’à son palais de la rue Porte-Dijeaux, où, suivant toutes vraisemblances, l’attendaient des arcs de triomphe...
Mme d’Egmont n’avait point pris part à cette glorieuse promenade. D’importantes occupations la retenaient à Bordeaux. Aux troupes régulières destinées à tenir campagne, le patriotisme bordelais [p. 238] avait joint des bataillons de volontaires. Ainsi s’étaient formées les compagnies de Guyenne et de Fronsac, dont les costumes bariolés excitaient l’admiration. La belle comtesse ne voulut pas demeurer en reste. Elle provoqua l’enrôlement d’une troisième compagnie, sous le titre de Volontaires d’Egmont... L’uniforme tirait l’œil: rouge, avec parements de velours noir, aiguillettes d’argent, plumet et cocarde aux couleurs de France... A chaque engagé, elle offrait, de sa mignonne main, la cocarde et le plumet[245].
Les cadres furent vite remplis. Ils comprirent: un commandant, deux lieutenants, un aide-major, trois sergents, trois caporaux, trois anspessades et cinquante-quatre volontaires,—sans compter la colonelle qui ne cédait à personne l’honneur de guider ses recrues[246]. En la voyant défiler à leur tête, l’épée au poing, merveilleusement jolie sous son costume militaire, chacun fredonnait, sur l’air Belle brune que j’adore, ces couplets louangeurs:
La tradition rapporte qu’à la fin du règne de Louis XV, les officiers de carrière prenaient plaisir à faire de la tapisserie. Les Volontaires d’Egmont, d’allures moins féminines, passaient leurs journées en exercices et en patrouilles... Les Anglais n’avaient qu’à se bien tenir! Par contre, la Guyenne pouvait dormir en paix... C’est pourquoi les spectacles, les concerts, les fêtes reprirent leur train accoutumé—si tant est, d’ailleurs, qu’ils eussent jamais été interrompus!

Mme d’Egmont à l’hôtel Duplessy.—Le culte de Rousseau.—Rulhière et le marquis de Saint-Marc.—MM. de Lamontaigne, Risteau, Pelet d’Anglade, de Lamothe, Baritault de Soulignac, d’Albessard, etc...—Le président de Lavie et ses œuvres.—Paul-Marie-Arnaud de Lavie.—Joseph Vernet.—Hommage de Barbot à Thémire.—Un cénacle de jeunes femmes: satire anonyme.—Économistes et savants: le chevalier de Vivens, M. de Romas et ses expériences, l’abbé Baudeau à la recherche de sa voie.—Une lecture de Dom Galéas.

La marquise du Deffant assure qu’il y a trois moyens de remplir la vie: l’occupation du cœur, le travail du corps, l’exercice de l’esprit. Ces moyens, Mme d’Egmont les employait tous trois, en consacrant au dernier le plus clair de ses loisirs: l’étude—au retour de la parade—l’absorbait durant le jour; le soir, elle soupait chez Mme Duplessy[248].
On voit, dans cet étonnant XVIIIe siècle, d’étranges liaisons entre grandes dames ou petites-maîtresses. On s’y adore à première vue parce que de part et d’autre—coïncidence providentielle!—on a eu l’idée de se mettre une assassine [p. 242] à la naissance du sourcil, ou qu’on porte «un ruban de même couleur de rose»...
L’affection qui unit Mmes d’Egmont et Duplessy avait des causes moins futiles. Toutes deux, malgré la différence d’âge, sentaient et pensaient de même. Toutes deux, éprises des sciences positives, aimaient la nature, non avec l’affectation d’élégantes asservies à la mode, mais «en sincères campagnardes». Un autre sentiment devait encore resserrer les liens existant entre elles: leur dévotion commune à Jean-Jacques Rousseau... On ne peut, aujourd’hui, se rendre compte de l’influence exercée par le citoyen de Genève. Du culte qu’il inspira à ses contemporaines naquit une sorte de franc-maçonnerie dont les ramifications s’étendaient au loin. Le nombre des femmes qui, sous prétexte de musique à copier, allèrent s’imprégner du parfum du maître, est incalculable. Mme Duplessy accomplit-elle le pieux pèlerinage? Ce ne fut sûrement point l’envie qui lui manqua... Son admiration pour le dieu résulte suffisamment de la pièce suivante que, par une exception significative, elle consigna, de sa propre main, sur le sottisier de l’ami Barbot:
La ferveur de Mme d’Egmont n’était pas moins profonde. Elle datait de sa sortie du couvent. Richelieu, après Fontenoy, voulant éblouir Paris par l’éclat de ses fêtes, en confia la partie musicale à Rousseau qui eut dès lors ses grandes entrées dans la maison. La jeune pensionnaire recueillit les premiers échos du Devin du village: ils la bercèrent comme un rêve. De son côté, Jean-Jacques fut attiré par cette intelligence en voie de formation... Toujours aux petits soins, il herborisa pour elle, lui dévoila les secrets de la nature, composa des romances à son intention, l’éleva à la dignité de confidente... Le cœur du maître se prit-il aux charmes de l’élève? Mme Necker l’affirme, dans une phrase sèche comme sa personne. La beauté de Mme d’Egmont, assure-t-elle, est un paradoxe: il n’est pas étonnant que Rousseau en soit amoureux... A cet amour—si tant est qu’il existât—répondit la plus fidèle admiration[249].
[p. 244] Mme Duplessy ne pouvait offrir à sa séduisante amie le commerce du cher philosophe; les ressources qu’elle mit à sa disposition n’étaient point pourtant à dédaigner. Ses salons avaient vu peu à peu, malgré une sélection jalouse, augmenter le nombre des fidèles: la présence de Mme d’Egmont leur imprima un caractère mondain auquel, vingt ans plus tôt, on ne songeait guère... Il est facile, par un travail de restitution semblable à ceux dont on usa pour faire revivre la société de Mmes de Tencin et de Lambert, de passer en revue le personnel qui, à cette époque, fréquenta l’hôtel du Jardin-Public. Ouvrons cette porte que jadis poussa la main de Montesquieu, pénétrons dans le salon d’honneur et jetons un coup d’œil rapide sur l’assemblée qui s’y presse...
Deux officiers s’offrent à nos regards: l’un dans le costume sévère des gendarmes du roi, l’autre avec l’habit bleu brodé d’argent des gardes-françaises... La maréchale d’Estrées, qui savait apprécier les jolis hommes, eût hésité entre eux.
Le premier, Claude-Carloman de Rulhière, nous est connu. Figure intéressante: nez au vent, légèrement pointu comme le nez des malicieux, front haut, bouche narquoise, œil d’une rare pénétration: un beau ténébreux qui ne plaît [p. 245] pas moins aux femmes par ses hardiesses que par ses madrigaux. Il réussit peu, en revanche, auprès des hommes: certains jugements portés sur lui poussent la sévérité jusqu’à l’injustice. De la campagne de Hanovre, où il suivit Richelieu en rêveur plus qu’en soldat, Rulhière a rapporté un poème dont il ne craint pas, sous le couvert de l’éventail, de réciter quelques passages. Les Disputes, tel en est le titre. «Lisez-les; c’est du bon temps!» en dira Voltaire qui, dans ses exagérations de vieille coquette aussi facile à prodiguer la louange qu’avide de la recevoir, n’hésite pas à comparer ce badinage aux chefs-d’œuvre de La Fontaine et de Molière. Ce qui vaut mieux que les Disputes, ce sont les travaux que, devenu diplomate, le jeune officier, mettant le sceau à sa réputation, édifiera sur l’histoire de Russie et de Pologne.
Son compagnon, Jean-Paul-André des Razens, marquis de Saint-Marc, est un Gascon de bonne mine, au sourire railleur, au regard fin, à l’abord séduisant, à l’imagination féconde: on sent que le soleil du Midi chauffa cette tête aristocratique. Sa bravoure est proverbiale: à quinze ans, n’étant encore qu’enseigne, il se distinguait de telle sorte que Louis XV l’embrassait en présence de l’armée entière. Maintenant, il sert dans les gardes-françaises—un [p. 246] régiment renommé pour ses bonnes fortunes... M. de Saint-Marc célèbre les siennes en strophes légères où apparaissent parfois d’heureuses inspirations:
Les beaux yeux sont pour moi ceux où je lis qu’on m’aime!
explique-t-il avec une fatuité qui révèle son talon rouge et donne un avant-goût de la manière voluptueuse de Musset. La verve anacréontique de ce conquérant n’est pas toujours inoffensive: témoin l’épigramme qu’il décocha à Mme de Staal-Delaunay, coupable, à son gré, d’avoir exclu de Mémoires exquis plus d’une aventure galante dont elle fut l’héroïne.—Pouvais-je agir différemment! lui fait-il confesser,
.... Je ne me suis peinte qu’en buste!
A ce menu bagage littéraire, il faut joindre un lot d’épîtres et de fables où perce un scepticisme malin, deux comédies-ballets, une tragédie lyrique, Adèle de Ponthieu, représentée à l’Opéra et remise trois fois à la scène... N’est-ce point suffisant pour la célébrité d’un soldat-gentilhomme, à une époque où tant de poètes attitrés furent de simples ajusteurs de rimes? Néanmoins, l’oubli—frère jumeau de la mort—eût emporté, comme tant d’autres, le nom de Saint-Marc sans un impromptu récité [p. 247] dans l’inoubliable soirée du 30 mars 1778, où Paris, en délire, couvrit de fleurs le cénobite de Ferney. Quelques vers du triomphateur, en réponse à son confrère de Gascogne, firent plus, pour la gloire de ce dernier, que ses titres académiques. Il le confesse ingénument:
En ce moment, une douce griserie absorbe le jeune poète, dont les regards suivent avec persistance la silhouette de Mme d’Egmont. Rulhière le rappelle à la réalité:
—Marquis, murmure-t-il à son oreille, n’êtes-vous pas de la maison?
—Sans doute, en qualité de neveu d’un vieil ami, le conseiller Jean-Jacques Bel.
—Alors, faites-moi la grâce de mettre un nom sur les visages qui nous entourent.
Déférant à ce désir, M. de Saint-Marc désigne d’un mot chacun des personnages qui évoluent sous leurs yeux:—le négociant Risteau, dont la plume agile se signala au service d’une cause juste[250];—M. de Baritault de Soulignac, qui s’est [p. 248] fait une spécialité de l’étude des fossiles;—M. Balan, de la Cour des Aides, naturaliste renommé;—les frères de Lamothe, Alexis et Delphin, jurisconsultes éminents, à la veille de publier leur commentaire sur les coutumes en vigueur dans le ressort du Parlement de Guyenne;—François Cazalet, leur émule au Barreau, dont la fin tragique rappellera celle de Sénèque[251];—Guillaume Brochon, un autre avocat de race, le modèle des dialecticiens;—le sculpteur Claude Francin, sur le point d’achever ses travaux de la place Royale;—le mélomane Sarrau de Boynet, sans lequel il n’est pas de bonne fête musicale;—le docteur Grégoire, aussi beau parleur qu’habile praticien;—M. Journu, dont la précieuse collection enrichira un jour la Ville[252];—M. Ansely, «un philosophe anglais d’un caractère vénérable...» Sa fille vient de faire la conquête de Marmontel qui, pour lui plaire, composa la romance de Pétrarque, dont raffolent les salons[253].
Des officiers de robe leur succèdent:—François de Lamontaigne, qui eut l’honneur de prononcer à l’Académie l’éloge de l’auteur des Lettres [p. 249] persanes;—l’avocat général Dudon, l’un des esprits d’élite auxquels l’humanité devra l’abolition de la question préparatoire;—le président Antoine-Alexandre de Gascq, à qui l’on commence à reprocher sa trop grande liaison avec le maréchal;—Jean-Baptiste de Secondat, agronome et naturaliste, digne fils d’un père illustre;—Jacques Pelet d’Anglade, encore sous le charme de la conversation de Voltaire[254];—M. d’Albessard, le plus spirituel des officiers du ministère public, lequel, assure-t-on, prépare ses harangues dans la chaise qui le transporte au bal...
—Monsieur, lui demande une dame qui vient de se le faire présenter, il me semble vous avoir vu quelque part...
—En effet, réplique-t-il, j’y vais quelquefois...
Le mot, depuis, a fait fortune[255].
Quittons cet aimable plaisant pour aborder le président de Lavie, dont le visage austère se profile à l’extrémité de la bibliothèque[256]... [p. 250] Physionomie fruste et bourrue, Jean-Charles de Lavie est un apôtre des idées nouvelles. Mais, au rebours d’une foule de néophytes, il conforme sa conduite à ses doctrines. La simplicité de ses goûts est légendaire: il se nourrit de cruchade, en guise de brouet noir, et ne circule qu’à pied pour ne point humilier les gens dépourvus de carrosse...
Ce Spartiate n’est pas seulement un citoyen honnête, c’est aussi un écrivain de talent. Ses Réflexions sur les grands hommes de Plutarque dénotent une connaissance profonde de l’histoire ancienne. Mais son œuvre capitale a pour titre: Des Corps politiques et de leurs gouvernements. Ce n’est, à vrai dire, qu’une imitation de la République, de Bodin[257]; mais, si l’auteur épouse, en les accommodant aux mœurs modernes, des idées professées avant lui, la part qui lui revient en propre est digne d’examen. Elle augmente à chaque édition—il y en eut quatre—et finit par constituer une œuvre personnelle d’une valeur indiscutable[258].
[p. 251] Paris vient de faire, au traité des Corps politiques, l’accueil le plus flatteur. Fréron, dont la plume ne brille point par l’indulgence, lui consacre une longue étude où l’éloge n’est pas ménagé. «Je ne crois pas, dit-il, que, depuis l’Esprit des lois, nous ayons eu une meilleure production de ce genre. Peut-être même cet ouvrage est-il plus utile que l’Esprit des lois, parce qu’il est rempli d’une infinité de vues patriotiques qui l’emportent sur la théorie du célèbre président. C’est partout le philosophe éclairé, le législateur zélé sans enthousiasme, ne s’écartant jamais de la vérité et de la simplicité des moyens, ne sacrifiant jamais à l’amour de l’hypothèse, ne s’égarant point dans ces rêves d’un homme de bien qui ne peuvent se réaliser. C’est un habile médecin qui proportionne les remèdes au tempérament de ses malades, et qui, cependant, les met sur le chemin de la santé[259]»
[p. 252] Ce jugement n’implique-t-il pas quelques réserves? Si certaines doctrines de Jean-Charles de Lavie peuvent aujourd’hui prêter matière à discussion, les chapitres qu’il consacre au duel, à l’indépendance du magistrat, au droit de vie et de mort, à la liberté du commerce, à la dépopulation des campagnes—dont les habitants, «aimant mieux être exacteurs qu’essuyer l’exaction,» s’enrôlent parmi les agents du fisc,—au régime des corvées, pour lesquelles, en termes émus, il sollicite un adoucissement; toutes ces pages, où le style reste toujours à la hauteur de la pensée, témoignent d’une âme généreuse éprise d’un ardent amour de l’humanité... Peut-être cet oublié, qui se recommanda par ses vertus civiques autant que par ses écrits, mériterait-il d’être rappelé au souvenir de ses concitoyens autrement que par la plaque d’une rue où les honnêtes gens ne peuvent s’aventurer...
D’autant mieux que le nom de Lavie ne cessera point, jusqu’au commencement de ce siècle, d’être porté dignement. Voici, en effet, Paul-Marie-Arnaud, fils de Jean-Charles, comme lui président au Parlement, comme lui aussi pratiquant un sage [p. 253] libéralisme. Député de la noblesse aux États-Généraux, il sera des premiers à joindre son suffrage à ceux des représentants du Tiers... En vue de se préparer aux luttes politiques, il étudie, il médite, il voyage. L’an dernier, il parcourait l’Angleterre. Bientôt, il visitera la Suisse «pour voir des hommes libres et jouir du spectacle d’une nation indépendante au milieu de l’Europe»[260]. L’égalité, que chacun commence à prôner, n’est pas pour lui une formule vaine. Hier, il adoptait un jeune nègre qu’il associe aux études, à l’éducation, aux jeux de ses propres enfants. Demain, il offrira un refuge aux vieillards et aux orphelins. Partout, il prodigue les trésors d’une bienfaisance inépuisable... Le souvenir de ces actes de philanthropie suffira pour arracher son acquittement au Tribunal révolutionnaire, devant lequel un farouche sans-culotte, s’improvisant son défenseur, ne craindra pas de rendre hommage à ses sentiments patriotiques, aussi bien qu’aux traditions libérales du Parlement défunt[261].
Mais voilà que, derrière lui, apparaît un personnage [p. 254] de petite taille, au visage ouvert, au teint hâlé, à l’œil brillant, aux traits d’une vivacité méridionale. C’est le peintre Joseph Vernet, depuis dix-huit mois à Bordeaux, où, par ordre de Sa Majesté, il travaille à des vues de la rade. Deux de ses tableaux—deux chefs-d’œuvre—viennent d’être exposés à la Bourse. Versailles les réclame; mais la Guyenne a la bonne fortune d’en conserver plusieurs autres[262]. Quelque considérable que soit le nombre de ces toiles, Vernet n’a pu, cependant, satisfaire tout le monde; aussi annonce-t-il que celles qui représentent le Château-Trompette seront incessamment gravées par Cochin et Le Bas, afin de permettre à tous ses amis de garder un souvenir de son passage. A cette déclaration, des cris éclatent de toutes parts:
—Monsieur Vernet, portez-moi sur votre liste!... Monsieur Vernet, ne m’oubliez pas!...
Il inscrit à la hâte: l’abbé de Laneufville, MM. Pic frères, M. Morel, M. de Richon, le marquis de Roally... Puis, se voyant débordé:
—Messieurs, s’écrie-t-il, ne vous préoccupez pas; j’enverrai chez Labottière un ballot qui permettra de faire droit à toutes les demandes...
[p. 255] Alors, aux applaudissements de l’assemblée, la comtesse d’Egmont s’avance, escortée de Mme Duplessy, et fait hommage au grand artiste d’une tabatière en or qu’il accepte les larmes aux yeux[263].
Durant le cours de cette scène, Mme d’Aiguillon devise avec Barbot. L’âge, hélas! commence à se faire sentir. La figure s’empâte, la taille s’épaissit, la voix devient plus sonore, bien que ce ne soit pas—comme se plaît à le dire Mme du Deffant—la trompette du jugement dernier. Ce qui, en revanche, n’a pas changé, ce sont les délicatesses de cœur de l’excellente femme, toujours avenante, toujours charitable, toujours spirituelle... A-t-elle vraiment vieilli? On en peut douter: apprenez, disait Mme de Chaulnes, qu’une grande dame reste toujours jeune...
C’est ce que Barbot, avec une complaisance galante, s’efforce de démontrer...
—Flatteur, murmure-t-elle; trêve de menteries!
Et comme le président proteste, jurant que, le matin même, il a transcrit sur ses tablettes des vers en l’honneur de la duchesse...
—Une ode? demande-t-elle...
—Non, Madame, un madrigal.
—Voyons: cela me reportera de vingt ans en [p. 256] arrière, à l’époque où, séducteur, vous serriez de près certaine comtesse et lui enseigniez l’art de choisir un amant...
—Et où, réplique Barbot, vous nous disiez des chansons gauloises telles que la Béquille du père Barnabas[264]!
—Ce temps-là n’est plus, Barbot: on ne sait plus rire en France.
—A qui le dites-vous, duchesse! Maintenant, au lieu d’épîtres amoureuses, j’écris... je vous le donne en cent!... une dissertation sur saint Barnabé[265].
—Voyons le madrigal.
—M’y voici:
—Eh! mais, s’écrie Mme d’Aiguillon, l’idée est délicate et la chute jolie: Thémire aurait mauvaise grâce à n’être point satisfaite...
[p. 257] A ce moment, M. de La Tresne, après quelques paroles avec M. de Secondat, vient faire sa révérence à la duchesse...
—Je gage, assure-t-il, que Barbot vous récite les Quand et les Pourquoi décochés à notre ami Pompignan.
—Non certes; que signifie?...
—Que Pompignan, avec son orgueil démesuré, est en train de devenir la fable de Paris. Voltaire, qu’il n’a pas craint d’attaquer en face, vient d’entrer en lice... Ah! Madame, quelle volée de bois vert!
—Vous ne m’en disiez rien, Barbot...
—C’est ce matin, duchesse, que je reçus le paquet[266]; justement, j’ai la pièce sur moi...
Et le bonhomme de fouiller dans des poches gigantesques où foisonnent pêle-mêle journaux, lettres, brochures, papiers de tous formats; mais ses efforts demeurent vains... A sa mine déconfite, Mme d’Aiguillon ne peut réprimer un rire retentissant...
—M. de Montesquieu, insinue-t-elle, estimait que, dans l’ordre des choses difficiles, il en est deux devant lesquelles il faut s’avouer impuissant: [p. 258] découvrir une épingle dans un char de foin, et retrouver un manuscrit confié à votre vigilance... Je commence à croire qu’il avait raison.
—Madame, réplique sentencieusement Barbot, M. de Montesquieu, quand il prenait la peine de juger son monde, ne se trompait jamais... Aussi bien, ma mémoire peut-elle suppléer au désordre qu’il vous plaît de relever en ces termes sévères...
Et il se met à réciter la satire dont Bordeaux, après Paris, allait faire des gorges chaudes...
Laissons Lefranc de Pompignan sous la férule, et passons dans le salon voisin où, pour causer à l’aise, s’est réfugiée une troupe de jeunes et jolies femmes. C’est le coin des minois espiègles, des yeux éveillés, des épaules troublantes. On devise, on rit, on chuchote à travers un nuage de poudre, des flots de parfums, une avalanche de gazes, de plumes et de fleurs: le fouillis le plus pittoresque en même temps que le plus harmonieux...
Élisabeth Duplessy, debout, dans la pose d’une prêtresse d’Apollon, prononce quelques paroles qui éveillent vivement la curiosité, car les caquetages cessent comme par enchantement, les chaises se rapprochent, et l’on n’entend plus que le choc des éventails, uni au frémissement des jupes de satin.
—Vous avez cette liste? demandent à voix basse dix bouches inquiètes.
[p. 259] —Ici même, dans la paume de mon gant.
—Elle comprend?
—De nombreuses personnes de notre monde. Au nom de chacune d’elles correspond, en manière d’ironie ou de critique, le titre d’une comédie.
—Quel oubli des convenances!
—Oh! l’allure générale n’est point pour effrayer... En désire-t-on un spécimen? Je prends au hasard parmi les dames... Les Folies amoureuses: Mlles de Pile... La Fausse Prude: la première présidente... Les Précieuses ridicules: Mlles de Sallegourde... Que dire encore! La sentencieuse Mme Boyer figure la comtesse d’Escarbagnas; Mlle de Ségur tient l’emploi des Bélise, et votre humble servante est représentée sous les traits de Philaminte, l’épouse méconnue du bonhomme Chrysale...
—Lisez, lisez, chère belle! s’écrie-t-on de toutes parts.
Rassurée par ce concert unanime, Mlle Duplessy commence une lecture bientôt entrecoupée de Oh! de Ah! de rires étouffés, d’indignations de commande... Et quels ébats, quelles discussions, que de commentaires après cette revue épigrammatique où le Tout-Bordeaux mondain reçoit un coup de griffe! La jeune troupe est maintenant [p. 260] aussi bruyante que, naguère, elle était silencieuse[267]... Mais ce tumulte ne parvient pas à troubler la sérénité d’un groupe de causeurs réfugiés dans l’embrasure de la fenêtre: le chevalier de Vivens, M. de Romas, l’abbé Baudeau, le président de Lavie, le Père François...
Le chevalier de Vivens est un vieillard allègre, le type de ces gentilshommes du XVIIIe siècle qui, initiés au culte d’une philosophie humanitaire, immolèrent, sur ses autels, loisirs, fortune, ambition. Son existence se résume dans cette maxime digne de Socrate: C’est le lot des âmes communes de ne songer qu’à soi! Durant le cours de sa [p. 261] longue carrière, M. de Vivens ne cessa de s’effacer devant les autres, poursuivant, avec ténacité, la recherche de ce qui, dans l’ordre matériel ou dans l’ordre moral, peut accroître le bonheur de nos semblables... On trouve, chez cet obstiné, un mélange de Buffon et de Florian. Au premier, il emprunta son goût pour les sciences d’observation, l’histoire naturelle, la physique, la minéralogie, l’économie rurale; du second, il possède l’amour des choses champêtres, le naturel et l’exquise sensibilité. Peut-être pourrait-on dire de lui, comme de l’abbé de Saint-Pierre, à propos de ses Rêves d’un homme de bien, qu’il fut plus [p. 262] propre à faire un ministre dans la République de Platon qu’un secrétaire d’État dans les conseils d’une monarchie absolue; mais le caractère utopique de certaines de ses aspirations n’est point de nature à lui aliéner les cœurs... Montesquieu, qui se délectait à son château de Clairac, où l’on prétend qu’il écrivit plusieurs passages des Lettres persanes, éprouvait une vive tendresse pour M. de Vivens.
Le personnage avec lequel, en ce moment, converse le chevalier, mérite une mention toute spéciale. C’est M. de Romas: un robin de petite ville, à la veille de prendre rang parmi les gloires de la Gascogne[268]. Il vient, en effet, en même temps que le grand physicien du nouveau monde, peut-être même avant lui, d’arracher au ciel le secret de la foudre. Qu’on ne lui dispute pas le mérite de sa découverte: «Il est aujourd’hui démontré, écrit un savant moderne, que de Romas n’a rien emprunté à Franklin, et que l’originalité de sa belle expérience ne saurait lui être contestée[269]...»
Cette expérience, sur les résultats de laquelle l’Académie était fixée depuis longtemps, l’inventeur [p. 263] brûlait de l’exécuter sous les yeux de la multitude. A cet effet, il installait ses appareils dans un coin du Jardin-Royal,—juste au moment où un tremblement de terre d’une violence inouïe jetait la panique dans la cité[270]... L’occasion lui sembla propice pour démontrer que, nouveau Jupiter, il pouvait à son gré diriger les fluides électriques. Fatale inspiration! Convaincu que «ces maléfices» n’étaient point étrangers à la catastrophe qui plongeait la ville dans le deuil, le public ne lui laissa pas le loisir d’achever. Jupiter fut hué, menacé, poursuivi: c’est à peine si ses machines purent échapper aux fureurs populaires, et le triomphe entrevu se changea en la plus cruelle des déceptions... Six mois se sont écoulés depuis ce désastre, et le cœur du malheureux robin en est encore meurtri.
L’abbé Baudeau, qui lui prodigue ses consolations, appartient à la race, nouvellement éclose, des économistes. Ses études, à vrai dire, ne l’ont guère préparé à l’apostolat qu’il va poursuivre de concert avec Quesnay et le marquis de Mirabeau. Professeur de théologie à l’abbaye de [p. 264] Chancelade, il s’adonna d’abord à des travaux d’histoire et à des traductions pour le compte du Saint-Siège. Bientôt, les horizons du Périgord lui parurent étroits. L’Académie bordelaise faisant célébrer, tous les ans, une messe pour la Saint-Louis, il sollicita l’honneur d’y prêcher le sermon[271]. Le Père François appuya sa demande, assurant que le jeune orateur s’acquitterait de sa tâche à la satisfaction générale: «Il a du feu dans l’imagination, écrivait-il, un bon langage, beaucoup d’esprit et les dehors d’un prédicateur[272].» La docte assemblée n’étant pas riche, on marchanda un peu; enfin, grâce à Mme Duplessy, on finit par tomber d’accord. Le prône annoncé dut satisfaire l’auditoire, car l’abbé ne retourna point à Chancelade. C’est à Bordeaux qu’il trouva sa voie, entassant, au cours de consciencieuses recherches, les matériaux qui devaient lui permettre «d’élever le temple de la félicité humaine»[273]... Nul doute que le milieu rencontré à l’hôtel du Jardin-Public n’ait contribué, dans une large mesure, au développement de cette vocation.
Précisément, c’est de science économique qu’on [p. 265] s’entretient autour de lui. M. de Vivens, qui s’en est fait une spécialité, professe que la décadence du royaume est due à l’abandon de l’agriculture, à l’accroissement excessif des villes et des colonies, aux privilèges, aux monopoles[274]... Les monopoles surtout excitent ses doléances. Qui le croirait! Au siècle dernier, Bordeaux prohibe encore la consommation des vins qui ne sont point récoltés par ses habitants. L’entrée du port est également interdite aux bateaux de certaines régions: c’est ainsi que la Haute-Guyenne, n’ayant licence d’expédier ses produits que durant l’hiver, se voit exclue du marché du monde[275]!
Ses critiques ne sont pas moins vives relativement aux céréales: une question palpitante... C’est l’heure où la nation, «rassasiée de tragédies, de romans, d’opéras et de disputes sur la Grâce, se met à raisonner sur les blés.» Comment n’en raisonnerait-on point à Bordeaux, où les disettes sont fréquentes par suite de l’extension donnée à la culture de la vigne!... Chacun des discoureurs déplore les entraves apportées à la circulation, non seulement à [p. 266] l’intérieur, mais aussi au dehors. Le Père François fait cependant quelques réserves:
—En temps de guerre, dit-il, la liberté doit prendre fin: on ne peut admettre qu’en nourrissant nos ennemis, nous leur fournissions des armes.
—Eh! Monsieur, réplique le président de Lavie, les Anglais n’ont manqué ni de pain ni de biscuit en 1757 et 1758... Cela posé, il était plus utile à la France de leur en fournir que d’abandonner ce profit à l’étranger. Lorsque je vends du blé à mon ennemi, je prends de lui de l’argent qui me sert à lui faire la guerre. Je ne livre qu’une chose qui périrait pour moi et qu’il trouverait ailleurs: l’avantage est de mon côté[276]...
M. de Lavie, prôneur du libre-échange, devançait de vingt ans Turgot[277]!
A ce moment, un bruit confus et monotone, que l’on comparerait volontiers au murmure d’un ruisseau roulant sur des cailloux, attire l’attention de l’assemblée. Suivons les curieux et marchons à la découverte...
[p. 267] Dans le cabinet d’histoire naturelle, au milieu des poissons volants, des chiens de mer, des crocodiles attachés au plafond, un personnage, sur lequel ces spécimens d’une science qui confine à la nécromancie jettent un reflet étrange, ébauche de la main droite un geste noble, tandis que la main gauche tient suspendu, à la hauteur de l’œil, un manuscrit volumineux... C’est Dom Galéas, qu’un admirateur trop zélé a convié à lire la dernière de ses œuvres. Le regard inspiré, la perruque en désordre, oublieux des autres et de lui-même, le Révérend tantôt amincit, tantôt enfle sa voix, et, tour à tour mordant ou onctueux, encense la vertu ou flagelle le vice... Le monde s’écroulerait sans interrompre sa lecture!...
Sous la menace d’un poème en douze chants que ce barde infatigable a tiré de sa poche, chacun cherche à s’esquiver. L’exemple est salutaire: hâtons-nous de le suivre.

L’inoculation en Guyenne.—Épreuve tentée par Mme d’Egmont: son départ de Bordeaux.—Reconstitution du théâtre.—Société d’actionnaires.—Les débuts de Mlle Émilie.—Chansons contre le maréchal: incarcérations au fort du Hâ.—Le cadet des Labottière.—Albouis-Dazincourt.—Procédés de Richelieu.—Fêtes en son honneur: la Belle Jardinière.—Représentations offensantes pour la morale: le Galant Escroc.

Madame d’Egmont touchait au terme de son séjour: les circonstances dans lesquelles il prit fin méritent d’être mentionnées...
Chaque époque eut ses fléaux particuliers expédiant, avant l’âge, les gens dans l’autre monde. Le XVIIIe siècle en compta deux: l’indigestion et la petite vérole. Ceux qui résistaient à celui-ci succombaient à celui-là. Pour le premier, il existait un remède préventif, la sobriété, dont on usait le moins possible. Pour le second, il n’y en avait aucun: les malades mouraient dru comme mouches.
C’est alors qu’on importa d’Asie, où il se pratiquait de temps immémorial, le système de l’inoculation. La Grande-Bretagne l’essaya tout d’abord; [p. 270] il franchit ensuite la Manche, et, après avoir élu domicile à Genève, pénétra en France. Grâce à l’initiative de quelques grands seigneurs, il y rencontra bientôt un certain nombre d’adeptes. Mais si le procédé sembla louable aux esprits dépourvus de préjugés, la majeure partie de la nation estima que c’était tenter Dieu que de soumettre ses créatures aux atteintes d’une épidémie dont sa bonté pouvait leur épargner l’épreuve[278]. Soucieux d’éclairer le public, le Parlement de Paris se décida à saisir de la question les Facultés de médecine et de théologie.
La province n’attendit point cette consultation pour entrer en lice. A Bordeaux, l’inoculation faisait grand tapage. Non contents de disputer avec les savants du dehors, les médecins du pays engageaient entre eux des polémiques acharnées. Le docteur Grégoire, qui jouissait d’un grand renom «pour la hardiesse de ses traitements couronnés de succès inouïs»[279], fut attaqué avec violence par son confrère Lamontagne. De part et [p. 271] d’autre, on se jeta à la face le vocabulaire des Diafoirus et des Purgon, tandis que la ville se divisait en deux camps: les inoculés, rares encore, déposant en faveur du traitement auquel ils s’étaient soumis; les gens hostiles, assurant qu’il était indigne du patriotisme français d’user d’un système venu en droite ligne de l’Angleterre, et qui, d’ailleurs, exposait à de fâcheuses conséquences[280]... Justement, on ne parlait depuis quelques semaines—Dieu sait avec quelle ironie!—que d’un échec éprouvé par les innovateurs dans la personne du fils du receveur des tailles d’Agen, M. de Latour...
Ce mécompte, qui augmentait le trouble des esprits, dut paraître cruel aux habitués de l’hôtel du Jardin-Public acquis, de longue date, au principe de l’inoculation. Montesquieu, avec Mme d’Aiguillon, avait figuré parmi les premiers prosélytes. Guasco, dès 1750, faisait à Londres une conférence en faveur de la méthode nouvelle et poursuivait à Paris son apostolat, en dépit des quolibets de la duchesse du Maine. Les convictions du Père François n’étaient pas moins robustes[281]. Quant à Mme d’Egmont, elle savait, par la [p. 272] correspondance de Voltaire, les succès de Tronchin qui, non content de ressusciter une fois les gens, comme le faisait Esculape, leur assurait «la perpétuité de vie»...
Une victoire retentissante devenait indispensable pour regagner le terrain perdu; la jeune comtesse, avec sa crânerie habituelle, s’offrit à la lancette de l’opérateur... Ce ne fut, de toutes parts, qu’un cri d’admiration mêlée de crainte. La muse de Rulhière s’empressait de calmer ces inquiétudes... Non, s’écriait-elle,
Et le versificateur, dans une période où l’enthousiasme supplée à l’inspiration, montrait la troupe [p. 273] des amours veillant, attendrie, près du chevet de l’héroïne.
L’opération eut lieu[282]. Un bras aux lignes sculpturales subit la piqûre de l’acier imprégné de virus humain. Suprême angoisse! On chantait victoire, quand une fièvre putride se déclara, mettant en péril les jours de la malade... La science, heureusement, eut le dessus, et Bordeaux éclata en applaudissements frénétiques[283].
Mme d’Egmont n’en était pas moins gravement atteinte. On lui recommanda les eaux de Forges... Son départ, regretté de tous, fut sûrement l’objet d’une de ces manifestations où l’exubérance méridionale aime à se donner carrière. A l’hôtel du Jardin-Public, les témoignages, pour être discrets, n’en furent pas moins vifs. Que de bouches amies soupirèrent ce quatrain:
[p. 274] Séparé de sa fille et abandonné à ses instincts, Richelieu reprit sa vie de libertinage. Les fêtes, le jeu, les aventures galantes recommencèrent de plus belle; chaque réunion nocturne s’achevait par un second souper où, bravant l’indigestion, il se gorgeait des mets les plus fins, assurant qu’à l’exemple de M. de Pourceaugnac il ne dormait jamais mieux que lorsqu’il avait fortement mangé[285]. En même temps, il s’ingéniait à satisfaire ses penchants pour le théâtre, guidé moins par l’amour de l’art que par celui de ses prêtresses.
En qualité de premier gentilhomme de la Chambre, préposé aux menus plaisirs de Sa Majesté, le maréchal avait la haute main sur les scènes de Paris. C’est lui qui fixait l’ordre des représentations, arrêtait l’affiche, signait les engagements, ordonnait les débuts, expédiait au For-l’Évêque les acteurs récalcitrants et donnait le dernier coup d’œil au maillot des nymphes du ballet: une fonction qu’il accomplissait avec le zèle d’un calculateur qui y trouve son profit...
Se ménager à Bordeaux les mêmes jouissances, procéder au recrutement des grandes coquettes et des ingénues, régner sur ce personnel facile, comme il régnait à la Comédie-Française et à [p. 275] l’Académie de musique, tel fut le but poursuivi. Une transformation aussi complète exigeait de fortes avances. Richelieu—en grand capitaine mâtiné de Turcaret—eut une idée géniale: constituer une société qui se chargerait des frais de l’entreprise. Les actions, émises à mille écus, furent souscrites par ses courtisans... Moyennant quoi, une troupe appropriée aux désirs du maître se trouva prête dès l’automne de 1760.
Cette célérité était d’un heureux présage. On s’attendait à des merveilles... La montagne accoucha d’une souris. Il apparut bien vite que les premiers sujets manquaient d’éclat, que l’ensemble ne dépassait point une moyenne tolérable, et que, au cours du divertissement, évoluaient des danseuses aussi ignorantes des ronds de jambe que de l’art des pointes et des entrechats[286]. Le public constata surtout l’insuffisance de la grande coquette, également chargée des rôles tragiques, laquelle, à ces emplois absorbants, joignait encore ceux de directrice de la scène et de maîtresse en titre du maréchal; on la nommait Mlle Émilie. C’était, assure Collé, une grande fille assez bien faite, mais laide et maigre, sans voix, sans grâce, [p. 276] sans intelligence, que les abonnés de la Comédie-Française avaient refusée par acclamation[287]...
Bien des lèvres éprouvèrent ce que Fréron appelle la démangeaison du sifflet. La prudence ferma toutes les bouches. Mais, hors de la salle, loin des sentinelles placées aux portes du parterre, la critique reprit ses droits sous forme de chansons. On en composa de sanglantes, une notamment où les tenanciers du tripot comique,
«se trouvoient peints au naturel». Chacun des actionnaires y était passé au fil d’une implacable raillerie:—M. de Gascq, déserteur du Palais au profit du théâtre;—le marquis de Montferrand, grand sénéchal de Guyenne, devenu le compère du souffleur[288];—le jeune Duvigier, [p. 277] «pieds légers et cerveau lourd»;—les jurats, toujours prêts à s’humilier devant le maître;—le maréchal lui-même qui, la menace aux lèvres,
Ces fredons firent si bien le tour de la ville qu’ils arrivèrent aux oreilles des intéressés. Grande rumeur, investigations de la police et, finalement, arrestation d’une demi-douzaine d’ajusteurs de rimes. On leur adjoignit le cadet des frères Labottière, pauvre garçon faible d’esprit, dont le crime consistait à avoir livré les couplets satiriques à des filles de la Comédie... Comme il était le moins coupable de la bande, on ne le retint au fort du Hâ que l’espace de quatre mois[289]!
Pauvre maréchal! L’heure de l’expiation avait sonné. Ridé, flétri, grotesque en ses coquetteries d’éphèbe, paré comme une châsse et huché sur des talons dont la hauteur augmente à mesure que le dos accentue sa courbe, le «Pacha de Guyenne» dégage, sous le fard, des relents de courtisane en [p. 278] retraite. Quand, à cette époque, Walpole parle de décrépitude, c’est Richelieu qu’il prend pour terme de comparaison. Ce n’est plus, déclare-t-il, qu’un vieux portrait du général Churchill, bien qu’il affecte, comme ce dernier, d’avoir des Bootbies... Et il ajoute: Hélas! pauvres Bootbies[290]!... Voltaire n’a pas la dent moins dure. Si, par devant, il encense encore, comme il se rattrape par derrière! Mon héros, dans sa correspondance intime, a, peu à peu, fait place à la vieille poupée...
Pour achever la déroute de l’idole déchue, il ne manquait que le dédain et les affronts du beau sexe: l’épreuve ne lui fut pas épargnée...
Les bourgeois inoccupés qui, deux fois par semaine, assistaient à l’arrivée du fourgon de Toulouse, en virent descendre, certain jour, un Provençal de bonne mine: bouche rieuse, regard expressif, physionomie avenante, visage irrégulier mais pétillant d’esprit. Si, à ces qualités physiques, on ajoute de la finesse, de l’entrain, des réparties heureuses, on conviendra que Joseph Albouis—ainsi se nommait le nouveau venu—avait de quoi faire son chemin. Particularité intéressante: ce descendant des Phocéens semblait [p. 279] né pour le théâtre. Il jouait, non sans éclat, les premiers rôles de tragédie et déployait une verve endiablée dans l’emploi des Crispins...
Richelieu, qui désirait mettre en ordre les souvenirs de sa vie, s’attacha ce prodige en qualité de secrétaire. Fixa-t-il des appointements? C’est probable; mais, fidèle à sa méthode de promettre toujours sans jamais tenir, il n’eut garde d’offrir au jeune homme les satisfactions de l’émargement. Cependant, la fréquentation du beau monde et la nécessité de déplacements continuels imposaient à celui-ci de lourdes dépenses. Albouis contracta des dettes. Ayant fait flèche de tout bois, il dut, après trois ans de services impayés, réclamer le montant de sa créance... Richelieu, pour défendre sa bourse, possédait, comme Mazarin, quatorze manières de faire la sourde oreille: il manœuvra si bien que le pauvre secrétaire en demeura pour ses frais d’éloquence. Réduit à déserter, Albouis se réfugia à Bruxelles, entra au théâtre, et, sous le nom de Dazincourt, qu’il ne devait plus quitter, inaugura la série des succès dramatiques qui allaient le placer au premier rang dans la maison de Molière... Mais, en Marseillais vindicatif, il eut soin, avant de partir, de souffler au plus ladre des gouverneurs la plus chère de ses Bootbies... Richelieu en posture de Sganarelle, [p. 280] quelle revanche pour les rimeurs emprisonnés au fort du Hâ[291]!
Le vice-roi se consolait de ces misères par une étude approfondie de la scène bordelaise, où il régnait en maître—à ce point que le public devait se morfondre à la porte jusqu’à son arrivée, quelque tardive qu’elle pût être[292]. Il faisait brosser des décors, ordonnait la représentation de pièces nouvelles, obtenait de l’auteur des Scythes des changements à cette tragédie, améliorait le personnel, ne négligeait rien, en un mot, pour la réussite d’une entreprise devenue sienne... Entreprise aléatoire, il faut le reconnaître. Bien que les sujets de talent n’eussent pas alors des exigences excessives—on avait une haute-contre pour deux cents francs par mois—les directeurs ne faisaient jamais fortune, leurs calculs se trouvant sans cesse déjoués par des guerres, des famines ou des pestes qui éloignaient les étrangers et vidaient la bourse des indigènes. Si, par hasard, ces fléaux les épargnaient, un deuil de cour suffisait pour anéantir les plus belles espérances. On avait beau multiplier les efforts, recourir à l’attrait d’étoiles de passage, organiser des tournées dans la province, pousser jusqu’à Toulouse, ou même [p. 281] jusqu’à Marseille, c’est par la banqueroute que s’achevaient les campagnes les mieux combinées.
Grâce à la main-mise de Richelieu et à la réclame des sociétaires, le spectacle, peu suivi jusqu’alors, devint le rendez-vous des élégances équivoques et de la galanterie en quête d’aventures. Caraccioli, dans son Voyage de la Raison en Europe, s’en explique de la façon suivante: «Il n’étoit pas flatteur pour les femmes qui tiennent un rang distingué de se voir en quelque sorte effacées par des filles entretenues qui affichent la magnificence et qu’on montre au doigt. Les gens raisonnables en murmuroient, les petits-maîtres en rioient, mais l’usage avoit prévalu: la coutume est un terrible tyran[293]...» La coutume avait du bon, au gré des commanditaires. En dépit de la médiocrité de troupes recrutées un peu partout, et allant de l’ancien substitut Hacher au futur conventionnel Collot d’Herbois, le montant des recettes annuelles dépassa le chiffre de deux cent mille livres. De détestable qu’elle était jadis, l’affaire devenait excellente: si bien que chaque actionnaire, lors de la dissolution opérée en 1770, toucha vingt mille livres de bénéfices[294].
Comment ne pas couvrir de fleurs ce [p. 282] distributeur de dividendes! Sociétaires et comédiens n’avaient garde d’y manquer. Chaque année, le 24 août, veille de la Saint-Louis, le théâtre célébrait la fête de son protecteur. Bouquets au naturel ou allégoriques, harangues versifiées, cantates en clef de sol ou en clef d’ut, aucune platitude n’était ménagée. Parfois, l’adulation se donnait carrière sous forme de comédies mêlées de danses et d’intermèdes musicaux. C’est ainsi qu’en 1767 la population était admise au spectacle de la Belle Jardinière, pièce de circonstance, émaillée des flatteries les plus grossières. L’armée y célébrait la gloire du vainqueur de Port-Mahon, la magistrature ses vertus, le peuple sa charité et son attachement au bien public. Une mère, jeune encore, lui offrait—symbole inattendu—une branche d’oranger fleuri, tandis que sa fille, une vierge à son aurore, ébauchait le récit d’un rêve de nature à faire illusion «au héros aussi heureux en amour qu’en guerre»... Hâtons-nous de déclarer, pour l’honneur de la cité bordelaise, que cette œuvre honteuse n’est imputable à aucun de ses enfants[295].
Ces manifestations n’étaient point du goût de tout le monde. Aussi bien, depuis le départ de [p. 283] Mme d’Egmont, l’opinion jugeait-elle sévèrement «le directeur de conscience des nymphes du ballet». Bientôt la bonne compagnie, spécialement la robe, refusa de paraître dans ses salons. Seuls, la noblesse d’épée, perdue de dettes, et quelques négociants vaniteux lui demeurèrent fidèles. Le maréchal eut beau renouveler les splendeurs qui marquèrent sa prise de possession, augmenter l’éclat de son cortège, se faire précéder à l’église de hautbois et de violons, entourer son prie-Dieu d’un escadron de gardes, s’offrir, comme Louis XIV, aux regards de la foule lorsqu’il s’asseyait à une table d’apparat, le charme s’était dissipé: à l’admiration des premiers jours succédait un insurmontable dégoût.
Il semble qu’à partir de ce moment, Richelieu se soit attaché à répondre par le scandale aux sentiments dont il se sentait l’objet. C’est surtout à l’égard du sexe faible que s’exerce l’impertinence de ses rancunes. Tantôt, par des indiscrétions calculées, il flétrit un groupe d’imprudentes qui se fièrent jadis à son honneur. Tantôt, il range toutes les femmes de la ville dans la catégorie des filles non repenties. Il ne cesse, d’ailleurs, de leur tendre des pièges et prend un malin plaisir à offenser leurs yeux et leurs oreilles. A cet effet—heureux d’accroître son œuvre démoralisatrice—il [p. 284] ordonne la représentation de comédies d’un libertinage éhonté...
—Ainsi, demande-t-il un jour, le Galant Escroc, avec ses indécences, fait faire la grimace aux dames bordelaises?
—Oh! monseigneur, assure son interlocuteur—un des sujets de la troupe—elles l’ont trouvé d’une force... d’une force...
—Tant mieux! réplique-t-il, elles y reviendront; jouez-le souvent...
«Et moi», ajoute Collé, qui reproduit cette conversation, «je n’en reviens pas qu’on tolère une pareille pièce sur un théâtre public!...» La pruderie du chroniqueur ne saurait être suspecte: le Galant Escroc est de lui[296].
Vis-à-vis des hommes, Richelieu emploie d’autres procédés. D’une séduction irrésistible, quand il veut se mettre en frais, il est aussi passé maître dans l’art de l’insolence. Les premiers personnages de la ville subissent ses algarades. Il n’est pas jusqu’à l’archevêque à qui il ne joue des tours pendables, le faisant suivre de flûtes traversières au moment où le prélat désirerait le plus conserver son incognito. Quant à ceux des jurats qui n’ont pas la bonne fortune de lui plaire, il [p. 285] les traite comme des laquais. Mais c’est surtout la bourgeoisie et le petit monde qu’il s’ingénie à molester[297]. Un système d’espionnage à domicile lui permet de pénétrer les secrets des gens: il en abuse avec délices, écartant toute plainte par la menace de lettres de cachet, dont, assure l’auteur de ses Mémoires, il avait toujours les poches pleines...
Richelieu, comme le répétaient ses courtisans, pouvait se croire investi de l’héritage des princes d’Aquitaine, lorsqu’une voix troubla sa quiétude. Cette voix, que ne parvinrent à étouffer ni l’arbitraire ni les violences, qui raffermit les cœurs et releva les courages, c’était celle-là même dont le peuple aimait à suivre les inspirations, que les puissants n’écoutaient pas sans trouble, et qu’Henri III, durant la Ligue, disait à elle seule valoir toute une armée:... la voix grondeuse du Parlement!
Les parlementaires bordelais.—Opinion d’Henri IV.—Conflits entre ce prince et la Compagnie judiciaire.—Gages et épices au XVIIIe siècle.—Origine des fortunes de la robe.—Composition du Parlement.—Éléments anciens et éléments jeunes.—Débats politiques et financiers.—André-François-Benoît Le Berthon: son fils Jacques-André-Hyacinthe.—Luttes contre le maréchal de Richelieu.—Le Bureau de la grande police.

Il n’est pas, depuis le XVIe siècle, dans les annales de la Guyenne, une seule page où ne figurent des officiers du Parlement. On les rencontre partout, non seulement au palais de l’Ombrière, où s’agitent les grands intérêts locaux, mais aussi dans la rue, à l’Hôtel de Ville, aux remparts;—mêlés aux manifestations les plus diverses de la vie quotidienne; en contact permanent avec le peuple qui les a investis de sa confiance; constituant, dans l’ordre privé comme dans l’ordre politique, l’élément social prédominant... A ce point que l’histoire des parlementaires, c’est l’histoire de Bordeaux, et que, à défaut des parlementaires, Bordeaux serait bien près de n’avoir pas d’histoire.
[p. 288] Quels étaient ces hommes qui, sous les Valois et les Bourbons, exercèrent une influence si grande sur les destinées de leur pays? Portés aux nues par quelques écrivains, ils ne mériteraient, au dire de certains autres, ni le respect, ni la reconnaissance dont on les entoura de leur vivant. Cupides, égoïstes, vénaux, prévaricateurs, subordonnant, sous les dehors du patriotisme, l’intérêt général à leur intérêt propre, tels s’attache à les dépeindre l’école qui leur est hostile. Quelques plaisanteries passées à l’état de légende, un choix de récits dénigrants, des informations inexactes ou mal comprises, servent de base à cette opinion...
Parmi les anecdotes qu’elle se plaît à recueillir, il en est une qui fait merveilles. Une députation du Parlement ayant représenté à Henri IV que la création d’offices nouveaux, décidée par lui, allait augmenter la misère publique, le bon roi, contrarié dans ses velléités fiscales, se répandit en invectives, reprochant à ses interlocuteurs d’opprimer les justiciables, de prendre à l’un sa vigne, à l’autre sa gentilhommière, de porter le désordre dans Bordeaux, d’y entretenir la peste et de prononcer des arrêts tellement odieux que—lorsqu’il était prince de Navarre—il n’osait s’aventurer sur les rives du Peugue qu’à la faveur [p. 289] d’un déguisement... D’où cette conclusion qui semble s’imposer: les parlementaires tenaient à la fois du procureur rapace et du bandit de grands chemins[298].
Pour acerbe qu’elle fût, cette catilinaire était loin d’être décisive. Elle manquait, en tout cas, de logique et de finesse.
De logique: comment, au lieu de supprimer les malfaiteurs qu’Elle injuriait, Sa Majesté, alors toute-puissante, jugeait-Elle opportun d’en accroître le nombre? Oh! le singulier pasteur, qui, loin de chasser le loup de la bergerie, s’applique à lui conduire du renfort!
De finesse: parce qu’en se mettant personnellement en scène, le discoureur royal, d’ordinaire mieux inspiré, laisse apercevoir le bout de l’oreille...
Gouverneurs quasi héréditaires de la Guyenne, les souverains du Béarn ne possédaient point l’art de s’en faire bien venir. La noblesse les tenait à distance, la bourgeoisie gouaillait leur mine famélique, le Parlement, avec qui ils vivaient en guerre ouverte, les jugeait, dans leurs litiges, [p. 290] comme de simples boutiquiers. Henri IV en dut faire l’expérience. Vantard, glorieux, aimant à paraître, il avait un goût marqué pour les beaux accoutrements. Commander de riches habits le gênait peu. Payer, c’était une autre affaire; et, quand il se trouvait en conflit avec le pourpointier ou le marchand de panaches, les juges de Guyenne avaient sans doute—comme les juges de Pau—l’impertinence d’oublier sa qualité[299]. Quelles humiliations n’avait-il pas subies sous les voûtes de l’antique monument où la justice royale tenait ses assises! Un jour, l’avocat chargé de ses intérêts y était pris à partie pour avoir traité son client de Majesté, titre dont, au dire de Loisel qui occupait le siège du ministère public, aucun souverain étranger ne pouvait être investi sur le territoire du royaume. L’affront, il est vrai, émanait de la Chambre de justice expédiée en Gascogne pour une mission temporaire; mais on peut tenir pour certain que Messieurs de Bordeaux, gardiens non moins scrupuleux des prérogatives nationales, s’associèrent sans hésitation aux susceptibilités de leurs confrères de Paris[300].
[p. 291] Ces souvenirs suffiraient à rendre suspecte l’algarade du Béarnais. Mais il ne tardait pas à s’infliger lui-même le moins équivoque des démentis, en formulant cette déclaration: Si je n’étais roi de France, je voudrais être conseiller en ma Cour de Bordeaux[301]!... Vœu irréalisable: heureusement pour cette Cour si décriée! Henri IV, en effet, alliait à ses qualités politiques certains travers privés qu’on n’excuse que chez les princes. Outre sa façon asiatique d’appliquer la morale, il avait l’instinct du vol, comme Antoine de Bourbon, son père[302], et glissait dans ses chausses tout ce qui lui semblait de bonne prise...
—J’étais né pour la potence, déclarait-il dans ses heures de sincérité[303].
Pendu! Il l’eût été peut-être, si la couronne ne l’avait protégé contre les rigueurs du nœud coulant... Quel surcroît de discrédit pour les robins de l’Ombrière si, à tous les concussionnaires de la bande, on eût joint ce maître fripon[304]!
[p. 292] Laissons de côté les contradictions du plus hâbleur des méridionaux, et, à des commérages inspirés par le dépit, substituons les données, moins sujettes à caution, du raisonnement...
On se demande comment, durant trois siècles, la faveur du peuple et de la bourgeoisie aurait pu s’égarer sur des magistrats qui en eussent été complètement indignes, surtout alors que le pouvoir royal ne négligeait rien pour retourner contre eux l’opinion publique! Une fidélité qui s’affirme avec cette constance ne saurait faire fausse route.—Aussi bien, lorsqu’on pénètre au fond des choses, découvre-t-on que les «sénateurs» bordelais méritaient quelque estime, qu’on ne les rencontrait pas, la nuit, déguisés en tire-laine, que les gentilshommes se ruinaient sans leur aide, et que la peste décimait la ville, même au temps où, relégués loin du port de la Lune, ils siégeaient à Marmande, La Réole ou Condom...
[p. 293] Est-ce à dire que leur vertu, à travers la défaillance universelle, ait résisté à toutes les atteintes? Ce serait ne tenir compte ni des entraînements, ni des passions de la nature humaine[305]. La robe ne s’isolait pas du monde au point d’en éviter les promiscuités honteuses. Dans les rangs du personnel, sans cesse renouvelé, qui s’y succéda[306], on trouve des âmes peu scrupuleuses, des consciences pactisant avec les abus, des aigrefins, des meurtriers et jusqu’à trois faux-monnayeurs. Ajoutons, pour compléter ce tableau poussé au noir, que certains conseillers—quelque peu batailleurs aux assemblées des Chambres—affichaient au dehors une morgue qui, assure-t-on, était devenue la marque des officiers de judicature, comme l’insolence le privilège des gens titrés et la pédanterie l’apanage des docteurs.
Ces réserves—qu’explique suffisamment le mot de notre vieux Montaigne: l’espèce est ainsi—n’enlèvent rien à la valeur morale de la grande majorité des parlementaires, parmi lesquels abondent les citoyens intègres, les penseurs, les érudits, [p. 294] les bienfaiteurs de la cité. Que si, procédant par voie de comparaison, on jette un regard sur les autres éléments sociaux—noblesse, finance, église—on acquiert la conviction que tout ce que la province comptait de meilleur et de plus distingué, occupait une place au palais de l’Ombrière.
Au nombre des vertus qui y fleurissaient, il en est une à laquelle on ne pourrait, sans injustice, refuser une mention spéciale: le désintéressement.—Quelques explications, sur un sujet si peu connu, ne seront peut-être pas inutiles. Deux sortes de rémunérations étaient allouées aux titulaires des charges: les gages et les épices...
Les gages—que l’on soldait souvent avec plusieurs années de retard—s’élevaient, pour les simples conseillers, c’est à dire pour la Compagnie presque entière, à un chiffre dérisoire. Encore la Couronne, invariablement à bout de ressources, mais ingénieuse à s’en procurer, ne tarda-t-elle pas à découvrir un stratagème qui lui permit d’acquitter sa dette sans se mettre en dépense. Elle fixa la capitation spéciale aux gens de robe à une somme équivalente aux gages, et opéra d’office le retranchement. Tout compte fait, les conseillers au Parlement de Paris touchaient un reliquat variant entre treize livres [p. 295] quatorze sous et dix écus[307]. Ceux de Bordeaux n’étaient pas mieux traités: leurs appointements annuels de 375 livres—soit 31 livres 2 sous et 2 deniers par mois—se trouvaient aussi presque intégralement absorbés par les retenues du Trésor... C’est un élément qui ne doit pas entrer en ligne de compte[308].
Restent les épices, dont la perception donnait lieu à de si légitimes critiques. Quoi de plus choquant, en effet, qu’une taxe laissée à l’arbitraire du juge, en vue de le rémunérer de ses peines! Mais ce que l’on ignore trop, c’est que, répartie entre une quantité considérable de charges multipliées dans un intérêt fiscal, cette redevance—dont [p. 296] l’entière responsabilité incombait à la Couronne—ne constitua jamais une source de profits. Elle ne couvrait même pas les intérêts du prix avancé par le titulaire, lequel, loin de trouver dans ses fonctions un instrument de lucre, devait, pour l’honneur de les remplir, s’imposer le plus lourd des sacrifices[309].
Riches, les parlementaires l’étaient presque tous; mais pour des causes différentes. Les Compagnies judiciaires avaient, dès le XVIe siècle, acquis une telle influence, leur prestige était si indiscuté, la considération dont on les entourait [p. 297] si universellement admise, que la possession d’un siège de conseiller devint le couronnement des ambitions bourgeoises. Il n’est pas de Gascon ayant fait fortune dans le négoce qui ne rêvât cette dignité pour l’aîné de ses enfants, quelque onéreuse qu’elle pût être. «Dès qu’un marchand a de quoy, enseigne un vieux dicton, il pousse ses hoirs dans la robe!» La liste serait longue des officiers de justice dont l’aïeul, simple courtaud de boutique, était parti en sabots de son village et arrivé à Bordeaux pedibus albis. Chez beaucoup, d’ailleurs, l’acquisition—si vivement reprochée [p. 298] par le Vert-Galant—d’une gentilhommière avait précédé celle de l’office. Michel Eyquem, dont les ancêtres vendirent du poisson salé à la Rousselle, était, depuis longtemps, seigneur de Montaigne quand il vint siéger sur les fleurs de lis. De même, les Secondat, enrichis dans la finance, possédaient la baronnie de Montesquieu bien avant de coiffer le mortier...
L’immobilisation d’un capital, énorme pour l’époque, ne laissait pas que d’entraîner parfois la gêne. Les propriétaires d’offices maintenaient leur situation—quand ils ne l’accroissaient pas—à l’aide de mariages opulents. Michel de l’Hospital le constatait lors de son passage à Bordeaux: «Quand on sait quelque héritière, disait-il, c’est pour Monsieur le Conseiller[310].» S’il arrivait alors, comme en témoigne l’illustre chancelier, que certaines de ces unions fussent contractées contre le gré des familles, les fortunes s’offraient d’elles-mêmes, durant le cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Trop heureux le négociant appelé à l’honneur de faire souche de robins! Le plus riche de la ville, M. Saige, divisait ses millions en deux parts: l’une pour son fils qu’il pourvoyait d’un emploi d’avocat général; l’autre [p. 299] pour sa fille qu’il mariait au président de Cazeaux[311].—Il serait facile de multiplier les exemples...
Possesseurs de fortunes bien assises, titrés grâce à l’achat de terres seigneuriales, ne devant rien à la faveur du prince qui, au contraire, avait beaucoup à leur demander, violentés chaque fois que, d’accord avec l’opinion publique, ils élevaient la voix contre l’arbitraire des ministres et les dilapidations de la cour, les parlementaires constituaient la plus redoutable des oppositions. Louis XV ne l’ignorait pas. Ces Robes longues, s’écriait-il avec terreur... des républicains[312]! C’est pourquoi gouverneurs et intendants recevaient l’ordre de «leur rogner les ongles». On s’efforçait, en même temps, de les contenir par un choix judicieux du chef placé à leur tête. Ce ne sont plus, comme autrefois, les plus dignes que l’on élève à la première présidence, mais ceux qui, par leur influence personnelle et leur habileté, paraissent le mieux en situation de rendre des services, de prévenir les desseins hostiles, d’enlever—but suprême de tous les efforts—l’enregistrement des édits fiscaux... Les premiers [p. 300] présidents de Paris, faits de la main de Louis XV, ne rappellent que de loin les Simon de Bucy, les Harlay et les Mathieu Molé!
Par un heureux concours de circonstances, le Parlement de Bordeaux se trouvait mieux partagé. L’investiture de son chef, André-François-Benoît Le Berthon, remontait au ministère du cardinal Fleury, c’est-à-dire à la période vertueuse du règne. Ame droite et fière, cœur charitable et généreux, caractère loyal et probe, M. Le Berthon était imbu des grandes traditions. La dignité du magistrat s’alliait en lui à la fidélité au Trône. Le pouvoir royal ne négligeait rien, d’ailleurs, pour se concilier ses bonnes grâces. En dehors d’une pension de trois mille six cents livres[313] qu’on lui servait en sus de ses gages, il était l’objet des prévenances les plus flatteuses: à la suite d’un incendie qui consuma son hôtel, en 1741, une somme de cent mille livres lui fut attribuée à titre de don gracieux[314]. Ces libéralités n’étaient point de nature à enchaîner son indépendance. Seuls, parmi ses collègues, quelques impatients murmuraient de sa longanimité à l’égard des [p. 301] ministres; mais tous tombaient d’accord pour rendre hommage à la haute intégrité de celui que d’Aguesseau jugea digne de le remplacer à la Chancellerie[315].
Ce n’était pas, du reste, une tâche facile que de diriger une grande Compagnie jalouse de ses prérogatives et dont l’esprit de soumission ne constituait pas la qualité dominante. Saisie des graves problèmes qui agitaient l’opinion, elle apportait à leur examen une liberté de jugements et de paroles égale à celle de nos assemblées modernes. Mais ce sont surtout les questions financières, les demandes de subsides, la création de taxes nouvelles rendues nécessaires par les exigences de Versailles, qui avaient le privilège de mettre les cervelles en ébullition. Les jours où s’engageaient ces débats irritants, le Palais présentait une animation insolite. Chaque officier se tenait à son banc comme à un poste de combat. Les ardents répandaient une odeur de poudre, les pacifiques prenaient des attitudes de lion en courroux, les têtes chenues elles-mêmes subissaient l’entraînement général.
Que de soucis pour maintenir dans une exacte discipline ce personnel mobile et passionné qui [p. 302] ne comprenait pas moins de cent soixante membres, en comptant les honoraires[316]! Sans doute, les pères de famille—Catons en perruque longue, attachés au foyer domestique—représentaient le principal appoint. Mais, à leur suite, évoluait la petite troupe des recrues, dont les allures juvéniles contrastaient avec la sévérité majestueuse des anciens. L’État, percevant un impôt—le marc d’or—sur les transmissions d’offices, n’hésitait pas à investir de charges de présidents et de conseillers, bien avant l’heure où le règlement leur permettait d’en exercer la fonction, des étudiants à peine sortis de l’école[317]. Simples stagiaires de fait et ne prenant aucune part aux décisions, ils n’en figuraient pas moins sur le tableau, portaient la robe rouge et occupaient une place dans les cérémonies publiques où ils servaient de point de mire à plus d’un joli minois. C’était l’élément mondain, remuant, turbulent même, du Palais, un élément ne résistant guère—comment en être surpris!—à l’attrait des petits vers, de la [p. 303] comédie de société, de la galanterie courante... Grand sujet de préoccupations pour un premier président soucieux de prévenir toute confusion entre ces adolescents—les magistrats de l’avenir—et leurs confrères en exercice que la faveur publique gratifiait du titre de Romains.
Durant de longues années, M. Le Berthon avait suffi à la peine. L’âge ayant paralysé ses forces, il s’était fait adjoindre, comme coadjuteur avec succession future, son fils Jacques-André-Hyacinthe, lequel, avec moins d’acquis et de clairvoyance, possédait cependant des qualités éminentes. C’était un libéral, suivant l’antique formule: c’est lui qui, aux États-Généraux, demandera que Sa Majesté abandonne le titre de roi de France, attentatoire aux droits de la nation, pour reprendre celui de roi des Français[318]... La vie entière de cet homme de bien, mêlé à toutes les agitations de la fin du XVIIIe siècle, se résume dans cette déclaration formulée, non sans orgueil, au terme d’une longue carrière: «Depuis que je suis à la tête du Parlement, j’ai reçu vingt-huit lettres de cachet, presque toutes portant exil; ce sont autant de lettres de noblesse que je léguerai à ma famille[319]...»
[p. 304] Telle était—soldats et capitaines—la cohorte judiciaire avec laquelle Richelieu allait se mesurer. Il y eut, à vrai dire, un moment où chacun fit un effort pour maintenir la bonne intelligence. Les parlementaires ne se bornèrent pas, lors de l’arrivée du maréchal, à le couvrir de fleurs: ils refusèrent de percevoir le droit de cinq cents livres dû pour l’enregistrement de ses provisions[320]. C’était le prendre par son faible. La campagne menée contre la Société de Jésus, l’expulsion de ces religieux, les condamnations prononcées contre les écrits des évêques qui tentèrent leur défense, n’étaient pas non plus pour déplaire à ce sceptique. Aussi mettait-il quelques ménagements dans ses premières attaques. Messieurs de l’Ombrière! «de braves gens qu’il adoroit en gros et révéroit en détail...» Et il s’étonnait qu’on pût en menacer les gentilshommes «comme on fait aux enfants de la grande beste!...» Au fond, il éprouvait, à l’égard de la canaille fourrée d’hermine, un souverain mépris, encore avivé par sa condamnation récente dans un procès que le jurisconsulte Voltaire lui disait imperdable[321].
[p. 305] Ce dernier, en pareille occurrence, se vengeait comme un gamin des rues:—Passez, Monsieur le président, murmurait-il chapeau bas, lorsqu’un âne se trouvait sur son chemin... Richelieu en usait d’autre sorte. Chaque fois que le Parlement repoussait des édits, il venait parader au Palais et faisait, manu militari, enregistrer les volontés du roi. Dieu sait avec quelle arrogance de bon ton, quelles railleries de grand seigneur, quels airs de capitan! Et si quelque discours sentant la révolte parvenait à ses oreilles, comme il faisait jeter le factieux dans un carrosse et l’expédiait, entre quatre dragons, à l’autre bout du royaume[322]!
Hanté par le souvenir du vieux d’Épernon, «mon héros» ne se contentait pas des griefs que lui fournissait Versailles. Il s’appliquait aussi à faire naître les occasions, recourant, quand il ne trouvait pas mieux, à des chicanes de procédure. Il découvre, un jour, que la Grand’Chambre a statué dans une affaire qui n’a point été soumise au premier degré de juridiction... Vite, il défère l’arrêt au Conseil, le fait casser et obtient—sanglante injure!—qu’on ordonne la restitution des [p. 306] épices... Richelieu n’avait pas eu la main heureuse. Le litige, dont le Parlement s’était constitué l’arbitre, présentait des complications d’un ordre tel que les magistrats inférieurs avaient reculé devant la tâche. Loin de se plaindre, les parties se félicitaient d’une solution aussi rapide, et même celle qui avait succombé se déclarait prête à acquitter les frais, bien que la décision du Conseil l’en déchargeât... L’intendant en fut réduit à témoigner en faveur de Messieurs. Ils s’étaient, affirma-t-il, conformés à l’usage et avaient agi dans l’intérêt de la justice: il fallait se hâter, en leur donnant satisfaction, de clôturer cette regrettable affaire[323].
Les parlementaires, de leur côté, ne s’en tiennent pas à la défensive. Ils attaquent avec vigueur, livrant sous main au public leurs décisions les plus acerbes[324]. Tantôt, ils tonnent contre les lettres de cachet et proclament le principe de la liberté individuelle. Tantôt, rappelant d’anciennes prescriptions de police, ils prononcent [p. 307] de sévères arrêts contre le jeu[325]. Hier, ils lançaient de malicieuses allusions aux sociétaires du théâtre[326]; aujourd’hui, ils s’insurgent contre les enregistrements effectués l’épée au poing et les déclarent nuls, «comme destructifs des lois primitives de la monarchie et des constitutions fondamentales de l’État...» Bientôt, ils s’attaqueront au maréchal lui-même dans la personne de ses subordonnés les plus compromis. Le brigandage, en effet, règne dans tous les services. Chacun pille impunément: le traitant rapace, les agents des douanes et des postes, les fermiers des greffes, les receveurs des tailles... Réduits à l’impuissance, les officiers municipaux ferment les yeux—quelques-uns même pêchent en eau trouble!—tandis que les magistrats des juridictions seigneuriales, par crainte ou déférence, laissent impunis malversations et attentats.
Dans ce désarroi général—après avoir sans succès représenté au roi «le cri de la misère de son peuple et son désespoir»[327]—le Parlement [p. 308] prenait une résolution qui procède de l’esprit révolutionnaire: il instituait, sous le titre de Bureau de la grande police, une Commission permanente chargée de rechercher les abus, de prévenir les vexations, de poursuivre les crimes[328]. Aussitôt, les plaintes d’affluer, les dépositions d’éclater vengeresses, les mesures réparatrices de se succéder. Vainement le gouverneur s’efforça-t-il d’accumuler les obstacles et de prendre sous son égide les prévaricateurs, l’effet produit n’en fut pas moins immense: la conscience publique se sentit soulagée...
Sans cesse sur la brèche, la Commission englobait dans son programme les sujets les plus divers: voirie, police, hygiène, octrois, tailles, corvées, timbre, contrôle, institutions de bienfaisance et économiques, réformation de la justice—«matière essentielle au bien de l’État»[329]... Elle examinait tout, ne s’en rapportant pas plus aux documents d’ordre financier qu’aux rapports administratifs: «d’autant»—mentionne un procès-verbal, qui constitue une sanglante critique des [p. 309] agissements royaux—«que la Compagnie n’aura jamais de confiance en ce que les intendants pourroient fournir eux-mêmes.....» Quatre cahiers, découverts par hasard au milieu du fouillis où sommeillent inexplorés des monceaux de pièces émanant du palais de l’Ombrière, témoignent du zèle, du courage, de l’acharnement—serions-nous tenté de dire—de ces hardis redresseurs de torts[330].
Tenu en échec par cette troupe de robins, Richelieu ne décolérait pas. La plupart d’entre eux devinrent pour lui des ennemis personnels, et il conçut contre le Parlement «une haine irréconciliable»: le coup d’État du chancelier Maupeou allait lui permettre de l’assouvir.

État de la Guyenne.—Procédés fiscaux.—Maupeou et ses réformes.—Opposition du Parlement de Bordeaux: sa dissolution.—Efforts pour le reconstituer: l’intendant Esmangart et M. de Maillebois.—Le premier président de Gascq et ses nouveaux collègues.—Exil de soixante-cinq officiers de robe.—Rôle joué par les femmes.—Mmes de Gourgue et d’Allogny: lettres de cachet décernées contre elles.—Institution du nouveau Parlement.—Liste des exilés et des Restants.

Cette période de notre histoire n’était point pour accroître le prestige de la Couronne. Avec des généraux comme Soubise, Clermont, Contades, nos armes avaient subi d’humiliants revers. La diplomatie ne faisait pas meilleure figure, et, malgré les efforts de Choiseul, l’on en devait passer par le traité de Paris qui dépouillait la France de ses colonies les plus prospères. Nos finances, enfin, étaient un sujet de joie pour les Anglais: on marchait tout droit à la banqueroute. Quant à Sa Majesté, son crédit personnel était tombé si bas que la négociation de sa signature s’effectuait avec 40 % de perte.
[p. 312] La mort de Mme de Pompadour donna une lueur d’espoir; on put supposer que les mœurs implantées par ses créatures disparaîtraient avec elle, et que l’on en reviendrait aux dilapidations d’une décence relative qui marquèrent le début du règne. L’erreur fut vite dissipée. Louis XV ne se tint point pour satisfait des amours de passage que lui procurait le zèle de serviteurs habitués à y trouver leur compte. Lebel, invité à faire mieux, découvrit Mlle Lange, «un composé céleste»... Il en forma la Dubarry. Stylée par Richelieu qui lui apprit le catéchisme de la cour, Cotillon II ne tardait pas à pousser jusqu’au délire la passion du vieux roi. Versailles s’inclina devant ce choix inattendu, et l’on put voir, à l’heure du petit lever, le successeur de d’Aguesseau jouant à colin-maillard avec le négrillon de la nouvelle favorite.
Celle-ci, comme sa devancière, était douée d’un appétit formidable. Les ministres, soumis à ses exigences, ne surent bientôt où donner de la tête. Ce n’est pas que l’ingéniosité leur fît défaut. Jamais, au contraire, l’art d’exploiter le contribuable n’atteignit un pareil degré de perfection. A côté des taxes obligatoires, il y avait les redevances gracieuses, laissées—semblerait-il—au bon vouloir de chacun... En fait, ces dons spontanés constituaient le moyen le plus commode de [p. 313] détrousser les gens. L’intendant dressait, rue par rue, une liste des notables—bourgeois, artisans, boutiquiers—et l’expédiait à domicile «avec invitation à la bourse de ne point rester sourde aux élans du cœur». Si, d’aventure, la souscription paraissait insuffisante, vite il mandait le récalcitrant. Alors, dans le tête à tête du cabinet, se jouait une scène analogue à celle de Don Juan et de M. Dimanche. Le représentant royal, déployant toutes ses grâces, assurait le visiteur de son estime, s’enquérait de sa fille Claudine, donnait un souvenir au tambour du petit Colin, n’avait garde d’oublier le chien Brusquet, grand dévoreur de jambes, et, finalement, inscrivait d’office la somme arbitrée par sa haute sagesse[331].
Au double jeu de l’impôt par contrainte et de l’impôt par persuasion, la fortune publique s’était évanouie. C’est une vérité, s’écrie Chamfort, qu’il y a en France sept millions de mendiants et douze millions de personnes hors d’état de leur faire l’aumône! La Guyenne n’était pas mieux [p. 314] partagée que le reste du pays. Sans doute, le négoce bordelais, jouant de bonheur dans ses expéditions lointaines, réalisait d’énormes bénéfices; mais cette prospérité, hélas! ne s’étendait ni aux paysans, ni aux propriétaires terriens, ni à ceux, quels qu’ils fussent, qui ne participaient point aux opérations commerciales de l’au delà des mers[332]. En dehors des armateurs et des marchands, la situation était lamentable: «Il est étrange combien la misère est grande, écrit un habitant de la rue Neuve; mais c’est à la campagne qu’elle se voit au naturel; elle fait frémir.» Et il ajoute, après quelques détails de nature à lever tous les doutes: «Les impôts vont être perçus, à ce qu’on croit, avec rigueur, M. le Maréchal étant arrivé pour faire enregistrer les édits et devant se transporter demain au Palais. Bien des gens pourront s’appliquer ces vers de Regnard dans le Joueur:
C’est à cette époque même que se réfère l’anecdote suivante reproduite par Mme Campan...
[p. 315] Louis XV, chassant dans les bois de Viroflay, rencontre des villageois portant un cercueil:
—Est-ce un homme? demande le roi.
—Un homme.
—De quoi est-il mort?
—De faim, répondent les porteurs d’une voix farouche.
De faim! Le nombre de ceux qui en mouraient était considérable. Chaque jour, en effet, augmentait l’âpreté du fisc. Aux taxes de tous genres, démesurément grossies, s’étaient joints—en vue de la guerre—le doublement des capitations et un troisième vingtième... Si bien qu’un pamphlet pourra dire, non sans apparence de raison, que le Bien-Aimé avait, à lui seul, plus grevé ses peuples que ses soixante-cinq prédécesseurs réunis[334]!... Et voilà que, la paix faite, ce surcroît de charges menaçait de s’éterniser...
L’opposition parlementaire avait beau jeu. Unie dans une résistance approuvée par la Nation entière, elle redoubla d’efforts, tant en province qu’à Paris, livrant à tous les échos de la publicité d’audacieuses doléances qui firent le tour de l’Europe. Louis XV répondit par un haussement d’épaules—digne pendant du mot: Après moi [p. 316] le déluge!—et poursuivit le cours de ses prodigalités... Une solution violente, peut-être une révolution, était inévitable, lorsque le chancelier prit le parti de dissoudre les Parlements.
L’affaire fut bien menée. «Souple et rampant par essence,» Maupeou débuta par des feintes habiles, des excitations occultes, des provocations ayant pour but de pousser ses adversaires à des imprudences dont il espérait tirer profit. Après quoi, il essaya de donner le change à l’opinion en plaçant ses projets sous le couvert de réformes désirées de tous: la gratuité de la justice et la suppression de la vénalité des charges. Cela fait, il monta à l’assaut de l’édifice judiciaire, résolu à substituer une troupe de valets à l’ancien personnel intègre, instruit, populaire, mais passé à l’état de gêneur incorrigible...
C’est le Parlement de Paris qui, le premier, succomba sous ses coups. Les magistrats qui le composaient furent dépossédés de leurs charges et brusquement exilés, quelques-uns dans des conditions d’une rigueur confinant à la barbarie[335].
Le même sort attendait les robins de Guyenne. [p. 317] La Compagnie se prépara à mourir dignement. Les chambres se réunirent et, dans un calme solennel, commencèrent la rédaction de remontrances destinées au roi, mais qui, passant par-dessus sa tête, devaient avoir un retentissement immense au delà même du royaume.
Ce sang-froid inattendu rassura l’intendant Esmangart, arrivé depuis peu à Bordeaux[336]. Le soulagement qu’il ressentit affecta même une forme railleuse voisine du dédain... Le travail de Messieurs, écrivait-il, n’est pas près de toucher à sa fin, car ils remontent aux lois ripuaires[337]!... Pour laborieuse qu’elle fût, la besogne s’acheva, et M. Esmangart put constater que le recueillement n’avait rien enlevé aux parlementaires bordelais de la liberté de langage dont ils se faisaient gloire. Leur protestation, renouvelée à trois reprises, était un acte de foi dans la grandeur des institutions monarchiques, telles que les pratiqua la vieille France à l’époque où, la main dans la main, souverains et légistes poursuivaient une lutte de géants contre la puissance féodale. Puis, s’inclinant devant la volonté du roi, semblables au gladiateur antique—Ave, Cæsar, morituri te [p. 318] salutant—ils adressaient, du haut de leurs sièges, à celui dont ils se déclaraient les serviteurs, un dernier et suprême avertissement...
En même temps, ils perçaient à jour les artifices du chancelier. Que parlait-il d’épices? La robe ne cessait de gémir sur cette rémunération dégradante que l’État lui avait imposée... De justice gratuite? C’était le vœu de tous... De modifications aux lois sur la procédure? On les attendait avec impatience... De la vénalité des charges? A qui la responsabilité, sinon à la monarchie elle-même qui, depuis trois siècles, ne vivait que d’expédients! Et pourquoi en prenait-elle ombrage aujourd’hui, si ce n’est parce que, cédant à des intrigues d’alcôve, au goût de l’arbitraire et à l’esprit de cupidité, il lui tardait d’asservir la robe par des choix honteux[338]!... Ah! le chancelier avait beau arborer le drapeau des réformes; sa duplicité ne trompait personne. Un seul point était en litige: il s’agissait de savoir si, affranchie de tout [p. 319] contrôle, la royauté traditionnelle «s’érigerait en tyrannie»!...
Sur quoi, les remontrances abordaient la question, insoluble faute de textes, des droits que la Nation s’était réservés, développaient les arguments qui faisaient la base de ces sortes d’écrits, et terminaient par une mise en demeure retentissante de convoquer les États-Généraux.
C’était braver la foudre: elle ne tarda pas à éclater. Le 3 septembre 1771, Richelieu recevait, dans sa terre de Fronsac, les lettres patentes portant dissolution du Parlement. Il partit pour Bordeaux, crevant ses chevaux de poste afin d’arriver plus vite, et, à peine descendu de voiture, fit exécuter un ordre d’exil concernant MM. Le Berthon et Dupaty: le premier, chef de la Compagnie et le seul homme dont il eût peur[339]; le second, investi, en qualité de doyen des avocats généraux, du droit de porter la parole dans l’assemblée des chambres. Malgré la discrétion de ses [p. 320] agents, la nouvelle se répandit avec une incroyable rapidité. Quand parut le carrosse des prisonniers, la population se précipita à la portière pour leur adresser un suprême adieu, puis se rendit à l’hôtel du Gouvernement dont les hôtes éprouvèrent les plus vives inquiétudes[340]. Mon héros s’était récemment, par manière de raillerie, enquis du cérémonial en usage quand on pendait un gouverneur[341]... Sans doute craignit-il qu’on ne lui fournît, sur cette question d’étiquette, ce qu’on nomme aujourd’hui une leçon de choses, car il manda en toute hâte les troupes placées sous son commandement. En même temps, il convoquait, pour le lendemain, en assemblée générale, présidents, conseillers et gens du roi...
Ceux-ci s’étaient déjà réunis d’office pour consigner, sur les registres du greffe, une dernière protestation. Quand, le 4, ils se rendirent à la sommation de Sa Majesté, les rues étaient occupées militairement. Des escouades du guet à cheval faisaient la patrouille l’épée au poing, tandis que les grenadiers du régiment de Bretagne, baïonnette au fusil, campaient dans les salles du palais de l’Ombrière. Des batteries d’artillerie, habilement disposées, complétaient [p. 321] ces mesures formidables: ce qui n’empêcha point le maréchal, pour traverser la ville, de se faire escorter de la maréchaussée et de gardes armés jusqu’aux dents[342].
A tenir ainsi, face à face, impuissante et anéantie, cette troupe de Robes longues, jadis si prompte à châtier son insolence, Richelieu dut éprouver une joie indicible. Saint-Simon, qui eut un jour la même bonne fortune, nous révèle les jouissances féroces que pouvait, en semblable occurrence, ressentir un grand seigneur haineux. Altéré de vengeance, lançant jusqu’aux moelles de ses adversaires le mépris, l’insulte, le triomphe, celui que, chez Mme de Tencin, on nommait le Boudrillon, faillit succomber à l’excès de son délire[343]... Ainsi en fut-il du maréchal qui, n’ayant point à sa disposition la langue chaude, acérée, cuisante de son ancien collègue à la pairie, déclarait simplement que cette heure avait été l’une des plus douces de son existence.
Tout, cependant, ne lui fut pas rose. Après avoir démoli, il fallait reconstruire. Besogne délicate, si l’on en juge par ce qui se passait à Paris. [p. 322] Lorsque Maupeou chercha des magistrats nouveaux, les gens de bonne moralité répondirent par des refus. C’est à peine si, à force de frapper aux portes, il composa une liste où figuraient des robins de province en rupture de ban, des avocats tarés et mis en quarantaine, des chanoines de Notre-Dame commandés par l’archevêque, des dragons en retraite, un neveu de Voltaire et quelques faméliques dont on s’assura le concours en les prenant au collet. Seul, de l’ancien personnel, Joli de Fleury consentit à garder son siège... Ce fut, dans le royaume, une hilarité générale et une avalanche de quolibets.
Allait-on, en Guyenne, éprouver une pareille déconvenue? On y expédia, en toute hâte, le comte de Maillebois, un intrigant sans scrupules, avec mandat de recruter des adhérents au sein de la Compagnie[344]: ses efforts, joints à la diplomatie de M. Esmangart, demeurèrent stériles[345]. Après eux, le maréchal se mit lui-même à l’œuvre, résolu à réussir coûte que coûte. Il importait, avant tout, de trouver un chef à la nouvelle [p. 323] magistrature: son choix se porta sur le doyen des présidents à mortier, M. de Gascq, seigneur et baron de Portets, dont le dévouement lui était acquis.
Antoine-Alexandre de Gascq appartenait à une ancienne famille de robe, honorablement connue dans la province. Lui-même, depuis trente ans, portait l’hermine avec distinction. Investi de sa charge à un âge où le règlement ne lui permettait pas de siéger, il avait vécu à Paris, mêlé au mouvement littéraire et fréquentant le bon monde. Un goût marqué pour la musique l’amena à se lier avec Jean-Jacques Rousseau qui lui donna des leçons d’harmonie[346]. C’était un exécutant de première force: le meilleur archet du Parlement, disait-on non sans malice[347]. Beau parleur, d’esprit délié, ne reculant pas devant les récits graveleux, il avait des saillies irrésistibles. Le sexe aimable le choyait, et l’on assure qu’il le payait de retour. Au désir de plaire, il joignait la plus tenace des volontés et une pointe d’ambition habilement dissimulée sous le masque du détachement philosophique... Rentré à Bordeaux, il s’était mis résolument à la tâche, émerveillant ses confrères [p. 324] par son assiduité à l’étude et son indépendance dans les questions touchant aux libertés publiques. Émule des Grissac, des Carrière, des Dupaty, il bravait avec intrépidité les rigueurs du ministère qui, en 1756, jugea opportun de l’exiler.
La nomination de Richelieu au Gouvernement de la Guyenne refroidit ce beau zèle. M. de Gascq qui, de longue date, connaissait le maréchal, devint son familier le plus intime. Bientôt, leur amitié rappela celle du couple célébré au cinquième chant de l’Énéide. Le président, resté célibataire, s’installa dans l’hôtel du gouverneur, travailla aux côtés d’Albouis-Dazincourt[348], participa aux affaires de la Comédie, veilla avec un soin jaloux à la satisfaction des fantaisies du maître, et partagea avec lui des soupers restés fameux où «ces connaisseurs émérites donnaient un heureux baptême aux divers crus du Médoc»[349]. Il n’en demeurait pas moins exact aux réunions du Parlement, et même figurait dans les rangs de la Commission chargée de la réforme des abus. Mais ses collègues, devenus soupçonneux, le tenaient à distance, et le public, sévère jusqu’à [p. 325] l’injustice, fredonnait sur son passage ces couplets cruels, dont l’auteur eut le loisir—à l’ombre du fort du Hâ—de retoucher les rimes:
Nul doute que, pour complaire à son puissant ami, M. de Gascq n’eût, avant même la dissolution, accepté la charge de premier président. Le sacrifice lui ayant semblé lourd, on le gratifia de nombreux avantages: une pension de vingt mille livres et le remboursement de son office... Ce qui, avec les quinze mille livres de gages attachés à sa [p. 326] nouvelle fonction, l’investissait, en un tour de main, de cinquante mille livres de rente.
Il ne pouvait pourtant, à lui seul, suffire aux travaux de la Grand’Chambre... Le maréchal alla voir chacun des membres du Parlement dissous, jouant, à tour de rôle, de la séduction, des promesses, des menaces, faisant appel aux sentiments les plus bas: vanité, jalousie, rancunes, avarice. Rien ne lui coûtait; l’argent, moins que le reste, les caisses publiques ayant reçu l’ordre de suspendre tous paiements, pour lui permettre d’y puiser à l’aise[350]. Il y eut de superbes résistances, justifiant ce vers pompeux du vieux Combabessouze:
Thémis, ainsi que Mars, enfante des héros!
Spécialement, le beau sexe—dont l’influence ne fut jamais plus grande—se couvrit de gloire... Quelques explications peuvent ici paraître nécessaires...
Dans cette merveilleuse boîte à surprises qu’on appelle le XVIIIe siècle, la femme demeure indéfinissable en ses multiples transformations. Tour à tour précieuse avec Marivaux, sceptique avec Fontenelle, sentimentale avec Jean-Jacques, elle [p. 327] prêtera bientôt l’oreille aux fourberies de Mesmer et du comte de Saint-Germain. Mais, avant de faire la chaîne autour du baquet mystérieux, elle se livre tout entière... à quoi? à la politique: un goût venu en droite ligne de la Grande-Bretagne, avec le whist et les œuvres de Richardson...
On comprend l’émoi que la révolution parlementaire dut produire dans ces cervelles surchauffées. Ce fut l’unique objet des conversations. Les réunions de plaisir cessèrent comme par enchantement, et les salons se transformèrent en états-généraux où, derrière l’éventail, éclataient de singulières hardiesses[351]. Les boudoirs s’arrachèrent brochures et in-folio traitant des matières à l’ordre du jour. Les remontrances firent prime, et le précis de droit public de Michau de Montblin, «une véritable encyclopédie politique,» devint le livre de chevet des mondaines[352].
Ce ne sont pas seulement les femmes de robins qui gémissent sur les malheurs de la patrie: les bourgeoises de toutes provenances ont acquis une érudition étonnante sur les points les plus controversés de notre histoire constitutionnelle[353]. Bientôt, la contagion s’étend aux grandes dames [p. 328] de Versailles. Mme d’Egmont, toujours portée aux idées généreuses, figure parmi les plus ardentes. Dédaigneuse des rancunes de la Dubarry dont le crédit la fait exclure des divertissements de la cour, répudiant toute solidarité avec son cousin d’Aiguillon, bravant la colère du maréchal qui la chasse de sa présence et lui interdit tous rapports avec la bonne duchesse, elle dirige l’état-major des révoltées, et, épuisée, fiévreuse, déjà atteinte par un mal qui ne pardonne pas, organise la résistance «contre la tyrannie»...
—Vous êtes des républicaines! s’écrie son ami de cœur, Gustave III, de passage en France sous le titre de comte de Gothland[354].
A quoi elle réplique:
—Qu’on nous donne des rois comme Henri IV, vous verrez si nous aimons la monarchie!
Le mot de République n’était point pour effrayer les Bordelaises. Déjà, sous la Fronde, il circulait sur bien des lèvres. On le prononçait même sous le règne du Grand roi, et l’intendant Boucher écrivait un peu plus tard: «Il est certain que l’esprit républicain règne dans cette ville et qu’on y abhorre toute autorité[355].» On ne [p. 329] s’étonnera pas que l’influence de Mme d’Egmont se fît sentir jusqu’en Guyenne, où elle trouvait un terrain merveilleusement préparé. Mères, filles, épouses de parlementaires y témoignaient d’une fermeté à toute épreuve, réconfortant les indécis, gourmandant les faibles, exaltant les résolus, prêtes à tous les sacrifices de bien-être et de fortune. Gardiennes des traditions morales qu’à Versailles on foulait aux pieds, rien n’égalait leur mépris pour les Maupeou, les Terray et autres suppôts de la favorite. Une étude réfléchie du litige qui bouleversait le royaume les confirmait dans leur opposition. Elles estimaient—avec Mmes de Mesmes, d’Egmont, de Boufflers, de Luxembourg, de Croy, de Brionne, avec la bourgeoisie entière et tous les écrivains patriotes[356]—qu’à défaut d’une constitution écrite il fallait s’en référer au droit naturel et à l’usage, «lesquels, en France, ne tolérèrent jamais le despotisme;» que la Nation était au-dessus des rois comme l’Église au-dessus des papes; et que, si les Parlements n’avaient reçu d’elle aucun des pouvoirs auxquels ils prétendaient, il y avait lieu de faire sans retard appel aux États-Généraux!—Tous les cœurs [p. 330] féminins battaient à se rompre au seul nom de la liberté...
Quand Richelieu se mit en campagne pour son œuvre de reconstitution, les premiers obstacles auxquels il se heurta vinrent des femmes. Campées résolument dans l’antichambre, le poing sur la hanche et le dédain aux lèvres, elles lui barrèrent le passage[357]... Le vainqueur de Port-Mahon put se remémorer cette parole de Mazarin, sur les Bordelaises de la Fronde, que, pour les réduire, il fallait «plus de canon que de cypre, et d’armures d’acier que de gants de Rome»...
Cinglé, en plein visage, des plus dures apostrophes, le maréchal redoubla d’énergie. Dans la nuit du 4 au 5 septembre, il expédia des ordres d’exil à trente-cinq parlementaires, jugés irréductibles, et à un certain nombre de citoyennes—le mot devenait à la mode[358]—qui l’avaient contraint de tourner les talons. Deux nous sont connues: la présidente de Gourgue[359] et Marie-Henriette Le Berthon, marquise d’Allogny, sœur du premier président[360], deux vaillantes dont les [p. 331] annales de Guyenne doivent, avec respect, conserver le souvenir.
Le 5 septembre, gouverneur et intendant reprenaient leurs démarches dans un état d’esprit confinant à la fureur. Partout, sur leur passage, des groupes hostiles; partout, des manifestations injurieuses. Ici, un couplet vengeur prenant son vol du haut d’une lucarne; là, une affiche annonçant que le peuple ne reconnaîtra point le successeur de M. Le Berthon; plus loin, l’avis que le Barreau s’est mis en grève, avec cette remarque ironique que tout finirait bien si l’on découvrait le secret de faire taire les femmes et parler les avocats! La journée s’acheva par la proscription d’une trentaine de parlementaires nouveaux aussi intraitables que ceux de la veille... Et les carrosses de rouler toute la nuit, chacun des exilés—on les nomme les mauvais sujets dans l’entourage du maréchal—devant rejoindre sur l’heure le lieu fixé pour son internement, d’où seule les tirera la mort du roi, survenue quatre ans plus tard[361].
Richelieu, cependant, n’avait pas subi que des [p. 332] échecs. Certaines défaillances s’étaient produites, entraînées par la crainte de violences dont on ne pouvait prévoir la fin, par le bouleversement qui en résultait dans les familles et la nécessité de sacrifices pécuniaires auxquels tout le monde n’était point en mesure de faire face. Les avantages accordés à la nouvelle magistrature ne laissaient pas non plus que d’exercer une action débilitante. Quelle tentation, après avoir payé pour rendre la justice, d’y trouver désormais une source de profits[362]!
[p. 333] Les adhésions recueillies comprenaient: M. de Pichard de Saucats, qui, moyennant une gratification de six mille livres, consentait à ne point déserter son siège du grand banc[363]; MM. de Bacalan, Duroy et Jean-Maurice Dusault, promus, de simples conseillers, au grade de présidents à mortier[364], et le procureur général Dudon, dont on obtint le concours au prix d’une pension de deux mille écus et de la nomination de son fils, Dudon de Lestrade, à une charge d’avocat général...
Les autres résistaient encore, «refusant leur part de paradis...» Le maréchal eut une idée triomphante: il expédia à chacun des quarante-six membres restants, dont il avait besoin pour réorganiser la Compagnie, des lettres de cachet ainsi conçues: «Monsieur, je vous fais cette lettre pour vous ordonner de continuer votre service à mon Parlement de Bordeaux, sans que, sous aucun prétexte, vous puissiez le quitter. Le tout, à peine de désobéissance...» Prisonnier au fort du Hâ ou au palais de l’Ombrière, il fallait faire son choix. L’écrit était, d’ailleurs, en règle: il portait la signature du roi et celle du ministre Bertin[365].
[p. 334] A quelles manifestations les femmes des nouveaux dignitaires, transformés en juges comme Sganarelle en médecin, eurent-elles recours pour marquer leur désespoir? Allèrent-elles, à l’exemple des matrones toulousaines, crier, sous les fenêtres du gouverneur, qu’elles aimaient mieux leurs maris morts que déshonorés? Se vengèrent-elles, dans l’intimité du foyer conjugal, de condescendances auxquelles, pour leur part, elles ne se fussent jamais résignées? Les esprits étaient montés à un tel point qu’aucune hypothèse n’est inadmissible.
Quant aux infortunés qui furent enrôlés de la sorte, si quelques-uns subirent sans trop de répugnance leurs chaînes dorées, d’autres ne cessèrent de gémir. Tel M. Dumas de Fombrauge qui exhalait sa douleur dans le billet suivant: «On a été obligé de recourir à la force pour composer un nouveau tribunal. En sorte que le sort de ceux qu’on a retenus est infiniment plus cruel que celui de nos exilés. Des lettres de cachet, multipliées à chaque pas, nous laissent à peine la faculté de nous plaindre. J’espère qu’un traitement aussi peu fait pour une nation libre ne sera pas d’une longue durée, et qu’en mettant fin aux humiliations qui nous ont été prodiguées ou nous laissera maîtres de faire [p. 335] ou de ne faire pas un métier qui n’a que des dangers pour ceux que n’y portent pas le vœu de leur cœur[366].»
Le 7 septembre 1771 eut lieu l’installation du Parlement Maupeou[367]. Les magistrats qui le composaient furent, sur leur passage, salués des noms de manants et de jean-f..., lardés de quolibets, accablés de chansons satiriques[368]. A peine, malgré une double haie de soldats, purent-ils arriver jusqu’au Palais. Là, une séance fut tenue en [p. 336] présence du maréchal et de l’intendant, ce dernier «en robe de satin, rabat plissé et bonnet quarré»[369]. M. Esmangart, en un langage pompeux, célébra les bienfaits de la nouvelle organisation judiciaire, exalta le mérite des officiers qui en faisaient partie, les somma de prêter serment de fidélité au Trône et exigea d’eux l’engagement écrit de ne point quitter leur poste pour quelque cause que ce fût... Moyennant quoi, Richelieu convia l’assemblée entière à un dîner qu’il donna le lendemain. Il se trouva—ô fragilité humaine!—trente-deux trembleurs qui répondirent à son appel.
Pendant qu’on fêtait, la coupe en mains, ce dénouement inattendu, les mauvais sujets, dépouillés de leurs robes qu’ils jugeaient ne pouvoir être portées à l’avenir que par des laquais, suivaient, avec femmes et enfants, sous les ardeurs d’un soleil torride, les grands chemins de la province. Quelle posture pour les Restants[370]! Comment laisser partir ces frères malheureux sans une parole de condoléance! M. Dudon, dans sa harangue d’installation, leur adressa un souvenir attendri. De son côté, l’avocat général Saige rappela avec douleur que, parmi les absents, se [p. 337] trouvaient M. de Verthamon, son beau-père, M. de Cazeaux, son beau-frère, et plusieurs de ses proches... C’était le cas de tous ses collègues... Parents contre parents! s’écriait, en battant des mains, le philanthrope de Ferney.
Émue jusqu’aux larmes d’une situation aussi cruelle, la nouvelle Compagnie supplia le roi de rendre à la liberté ceux que la France acclamait comme des modèles de vertus civiques. Mais ses efforts ne touchèrent pas plus Sa Majesté qu’elles n’amollirent le cœur des soixante-cinq. Ceux-ci et leurs compagnes ne pardonnèrent jamais aux Restants ce qu’ils appelaient leur trahison devant le despotisme.
Cette division, si audacieusement opérée au sein de la robe, entretenue ensuite avec une rare perfidie, fut le plus bel exploit du maréchal. Elle brisa l’unité parlementaire, introduisit la discorde dans cette société bordelaise si détestée de lui, la désorganisa d’une façon irrémédiable et, finalement, en consomma la ruine.
Ruine de Mme Duplessy.—Procès avec M. de Pauferrat: mémoires judiciaires.—Installation rue du Cahernan.—Nouvelles habitudes.—M. et Mme de Cursol à Fonchereau.—Vie d’un gentilhomme campagnard.—Correspondance de Mme Duplessy.—Une petite-fille de Montaigne.—Personnages divers.

Désintéressée dans ce débat héroïque, Mme Duplessy n’eut point à en subir les meurtrissures. Mais, au moment même où il se déroulait, d’autres épreuves bouleversaient son existence.
L’aîné de ses fils, François-Sabin, était, comme ses pères, entré au Parlement. Un mariage d’inclination, contracté avec une personne sans fortune, ne lui permit pas de conserver des fonctions aussi peu lucratives: il se retira d’abord en Médoc, puis à Paris, où il devint secrétaire perpétuel de la Société des Sciences[371].
Mise en demeure de fournir des comptes de [p. 340] tutelle, Mme Duplessy se trouva fort dépourvue. Les revenus de ses terres n’avaient cessé de décroître, tandis que ses dépenses allaient en augmentant... Les frais d’un salon, au siècle dernier, n’étaient point chose négligeable. Poètes et philosophes, quelque dégagés qu’ils fussent de la matière, ne faisaient point fi des menus savoureux: la légende de Scarron, remplaçant le rôt par un choix d’anecdotes, est de celles qui prêtent à la controverse... En vue de soutenir son train de maison, Mme Duplessy avait dû vendre quelques terres et contracter des dettes[372].
Pour comble de malheur, ce premier litige ne tarda pas à se compliquer d’un second, soulevé par son beau-frère, M. de Pauferrat, lequel, condamné par la retraite à ne plus trancher les différends des autres, s’ingéniait à faire de la procédure pour son compte, afin de n’en point perdre «l’heureuse accoutumance»: un adversaire redoutable, rompu à la chicane et prenant un malin plaisir à multiplier les attaques.
L’usage était alors de publier des mémoires [p. 341] contenant, avec des vérités bonnes à retenir, un flot d’indiscrétions, de perfidies, parfois même d’injures. Le factum de M. de Pauferrat, empreint d’une ardeur sénile, constitue un des spécimens les plus curieux de ce genre de littérature. Assorti de lardons et d’épigrammes, tantôt en prose, tantôt en vers, latins ou français, il dut mettre en belle humeur les perruques de la Grand’Chambre[373]. L’exorde, emprunté à la langue de Corneille, rappelle la prospérité des ancêtres, la situation brillante de l’auteur commun, les vertus de sa vénérable compagne... Comment—s’écrie l’émule de Petit-Jean—cette digne matrone procédait-elle pour accroître le bien familial?
[p. 342] C’est Bélise traitée de belle manière par un Chrysale retors, hargneux et jaloux d’amuser la galerie. Mlle Élisabeth n’est point oubliée dans ce flot d’outrages: elle se voit reprocher la foule de soupirants, de flatteurs, de parasites qui lui font cortège... On va même jusqu’à mettre en doute son honneur et sa probité. Tout cela pour réclamer «une portion légitimaire»[374]!
Au milieu de ces déboires, l’aimable femme trouvait le moyen d’assurer l’avenir de ses enfants. Le plus jeune, Claude-François, était pourvu d’un emploi sur la flotte. Sa fille cadette, Jeanne-Marie-Victoire, épousait un avocat de talent, M. de Lamontaigne, frère du conseiller[375]. Enfin, l’aînée, encore meurtrie des traits lancés par un oncle barbare, se décidait à accorder sa main à un gentilhomme de bonne maison, M. Méric de Cursol, l’arrière-neveu de Michel de Montaigne[376]. Ces mariages ne purent se réaliser [p. 343] qu’au prix de lourds sacrifices, dont le plus dur fut la vente de l’hôtel du Jardin-Public... Partagés, les meubles artistiques provenant de la succession de M. de Chazot! Dispersées, les collections qui faisaient la joie des connaisseurs! Délaissés, les instruments de physique qui excitaient la verve railleuse d’un adversaire impitoyable! Il ne resta de ces richesses à celle qui, si longtemps, les mit en œuvre, que ses livres préférés—parmi lesquels le Temple de Gnide bien relié en maroquin vert—et quelques toiles de choix: les Téniers, les Berghem, les Wouwermans... De la vie large, mondaine, agrémentée des jouissances de l’esprit, on passait à l’existence modeste, parfois gênée, d’une petite bourgeoise.
C’est rue du Cahernan, dans une maison du procureur Aumailley, tout proche son ami M. Buhan, avocat et jurat[377], que nous retrouvons Mme Duplessy[378]. Plus de laquais galonnés: son personnel se réduit à une camériste, Suzette, et à «une petite cuisinière servante»—que ferait-elle d’une grande!—sachant préparer un bouillon, mettre à la broche un rôt et mijoter une [p. 344] blanquette. Deux autres personnages, l’un à plume, l’autre à poil, complètent cet intérieur: une poule, aux ailes irisées, qui pond chaque matin un œuf exquis, et Circé, une bête de race, qui répond au signalement suivant... «Robe de couleur puce tirant sur l’écureuil, de jolies oreilles bien portantes, un fouet qui monte jusqu’aux épaules, les quatre pieds et l’estomac blancs, la tête mignonne, le museau fin, et toutes les grâces de l’enfance, car elle n’a pas encore deux mois et n’est guère plus grosse que le poing.»
La maîtresse du logis a maintenant dépassé l’âge des succès personnels et atteint celui où, d’après la duchesse de Brancas, il faut quitter les mouches pour la coiffe, la comédie pour le sermon, les parties fines pour le directeur de conscience, et les galants pour les amis «plus capables de soins que d’entreprises»... S’il est vrai, comme l’assure Larochefoucauld, que la vieillesse soit l’enfer des femmes, il est permis de croire que la règle souffre des exceptions. Mme Duplessy en est la preuve. Cette jeunesse qui l’a fuie, elle la contemple d’un œil ému, mais sans amertume. Même humeur, même sérénité, mêmes goûts qu’autrefois, et même confiance en l’avenir...
Vieille, cette septuagénaire? L’est-elle bien?... [p. 345] Voyez-la passer, dans sa robe de taffetas d’Espagne, mollement appuyée sur la canne d’ébène qu’elle acheta à la dernière foire. Sans doute, ses cheveux ont blanchi, sa bouche s’est plissée aux coins, les rides sillonnent son visage... Mais que de verdeur encore dans tout son être, que de grâce en ce sourire, que de charme au fond de ces yeux doux et pénétrants! Quant au cœur, il est resté chaud et généreux, en dépit de certain scepticisme inhérent à l’âge: une pensée noble le transporte, la contemplation d’une œuvre d’art le trouble, et la vue d’une touffe de roses ensoleillées le rend rêveur comme à vingt ans.
La fidélité s’impose à l’égard de ces natures d’élite «faites d’atomes accrochants»[379]. Mme Duplessy n’a perdu aucun de ses adorateurs. Barbot est demeuré son confident; le président de Lalanne lui fait une cour assidue; le Père François, dont les châteaux se disputent l’alerte vieillesse, est plus empressé que jamais. Quant à Dom Galéas, l’ami Patience, il continue son rôle de factotum, sans d’ailleurs y perdre une rime, une tirade déclamatoire, un coup de dents. Rien de changé pour lui dans la maison, si ce n’est la table devenue plus frugale. Mais lorsque «la petite [p. 346] cuisinière servante» a préparé, pour unique rôt, un plat de morue blanche, on mène le Révérend dîner chez quelque intime du voisinage... De la morue! s’écrie Mme Duplessy, jugez si c’est un mets de Bénédictin!
Ses relations féminines ne sont pas moins nombreuses. Elles comprennent tout un monde de douairières parmi lesquelles Mmes Le Berthon, de Brach, de Pontac, de Secondat, Dartigaut, de Saint-Angel, et un bouquet de jolies femmes où brillent, au premier rang, la comtesse de Reigniac et la captale de Buch, délicieuse malgré sa toilette extravagante et son chapeau à bords relevés comme celui que portait la Grande Mademoiselle. Partout, l’académicienne des Arcades est la bienvenue. Les réunions auxquelles on la convie n’ont rien des assemblées littéraires qu’elle présida jadis; mais on trouve encore, dans quelques salons, des causeries variées avec une partie de brelan, de piquet ou de whist à dix sous la fiche. On use—disons-le tout bas—de cartes de contrebande, et l’on se retire satisfait quand on gagne la course de ses porteurs ou le montant d’un billet de loterie, dont le prix est de trois livres.
Mais les heures préférées de Mme Duplessy sont celles qu’elle consacre à la série de lettres [p. 347] familières dont la bibliothèque de la Ville a reçu le dépôt[380]. Leur destinataire est sa fille, Mme de Cursol, confinée aux champs avec son mari... Quelques mots sur ce couple, uni de fraîche date, donneront une idée des hobereaux de village, en plein XVIIIe siècle, à la porte même de Bordeaux.
M. de Cursol, qui s’intitulait seigneur des maisons nobles de Talence et de Fonchereau, venait de quitter le service avec la croix de Saint-Louis. C’est dans ce dernier domaine—paroisse de Montussan—qu’il s’installa avec sa jeune femme. Le logis n’avait rien de remarquable: une bâtisse vulgaire environnée de communs où gîtaient serviteurs et paysans. Ni luxe, ni confort. L’été, on se garait de la chaleur; l’hiver, il était difficile de lutter contre le froid.
Le pays étant giboyeux, surtout riche en lièvres, M. de Cursol passe ses journées à la chasse. Il s’occupe aussi de ses terres, fauche ses prés, échenille ses bois et veille à la culture de ses vignes dont il tire, les bonnes années, jusqu’à cent tonneaux de vin. Le beau militaire d’autrefois néglige un peu sa toilette. Habits de velours, culottes de soie, vestes de satin ne lui font pas [p. 348] défaut; mais il donne la préférence à des vêtements que son meunier dédaignerait pour ses dimanches, et fait sa compagnie habituelle d’une meute de chiens courants gratifiés de noms pompeux: Daphnis, Cyrus, Chloé, voire Alexandre... Au demeurant, le meilleur époux du monde, aux petits soins pour sa femme, et adorant sa belle-mère qui ne lui ménage ni tendresses ni friandises.
Mme de Cursol s’accommode moins bien des occupations champêtres. Elle préside à la confection du confit, élève des poissons rouges et dresse des servantes qu’elle paie vingt écus par an[381]. Au besoin, elle battrait le beurre, cet exercice étant à la mode depuis que la dauphine, Marie-Antoinette, fut surprise dans cette posture, manches retroussées jusqu’aux épaules. La surveillance du potager, un peu de musique, beaucoup de lectures—et l’on parvient à atteindre le soir.
A l’heure du souper, les seigneurs du domaine s’adjoignent l’abbé, une façon de chapelain à la tonsure récente, qui pleure à chaudes larmes lorsque ses chefs, pour l’appeler à un vicariat, l’arrachent à cette sinécure. C’est que la maison est bonne; elle prit ce séminariste maigre et dépourvu d’orthographe; elle le rend gras et [p. 349] parlant français... Le repas expédié, les servantes desservent, et, dans cette même pièce, encore imprégnée du parfum des sauces, on lit en commun les journaux de la semaine: les Gazettes à la main, venues clandestinement de Paris; l’Iris de Guyenne, une nouvelle publication bordelaise[382], et les Annonces-Affiches, en échange desquelles M. de Brach, lorsqu’il séjourne à Montussan, envoie le Mercure de France[383]. Puis, chacun se recueille; l’abbé tire son bréviaire et rêve qu’une riche abbaye lui tombe du ciel; Madame, en proie à ses vapeurs, absorbe un bouillon de grenouilles mélangé de jus d’herbes et de fleurs de sureau; et Monsieur, après avoir craché en parabole, comme le grand seigneur des Lettres persanes, s’endort côte à côte avec sa chienne favorite, tandis que ce coquin de Daphnis—une bête insupportable—s’étend en rond sur les chenets.
Des visites? c’est chose rare. Sans doute, trois lieues, à peine, séparent Fonchereau du porche [p. 350] de Saint-André, mais quelles lieues! A pied ou à cheval, on en vient à bout dans une matinée; en voiture, elles sont infranchissables. On ne se fait pas une idée de l’état des chemins dans ce coin de l’Entre-deux-Mers; partout, rampes ardues, fondrières en façon de précipices, marais où l’on demeure embourbé. C’est en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, et avec une envie folle de se jeter à bas de la charrette à bœufs qui la transporte, que Mme Duplessy accomplit le voyage. Aussi ne se risque-t-elle qu’une fois l’an, à l’époque des vendanges, et il n’est pas improbable qu’avant de tenter l’aventure elle ne mette ordre à ses affaires, comme si elle s’embarquait pour Jérusalem ou Constantinople.
Triste existence, en somme, que cette réclusion au milieu des boues. Mme de Cursol, malgré l’attachement qu’elle porte à son mari, ne laisse pas que de s’en apercevoir. D’où la correspondance presque quotidienne qui s’échange entre les deux femmes. On s’écrit souvent par la petite poste, une création récente due à l’initiative du sieur Loliol, secrétaire général de la cavalerie du roi[384]. Mais la petite [p. 351] poste n’est pas plus sûre que la grande... Les paquets s’y égarant avec une facilité prodigieuse, on communique par messagers toutes les fois qu’il s’agit de choses confidentielles.
Que Mme de Cursol, au fond de sa solitude, attende avec impatience les lettres maternelles, cela se conçoit sans peine. Ces lettres sont, en effet, de nature à la distraire. Il y est question de tout, des nouvelles du jour, du mariage en perspective, des baptêmes et des enterrements, des fortunes qui s’élèvent et de celles qui périclitent, du parvenu en quête de savonnettes à vilains et du traitant enivré de ses écus, des plaideurs pourchassant leurs juges, des intrigues de théâtre et des scandales mondains. A une appréciation touchant l’ouvrage qui vient de paraître succèdent des détails sur l’étoffe à la mode: aujourd’hui le Palais-Royal, une sorte de gaze légère, demain l’Alexandrine brillantée, dont la nuance est rose tendre. Après quoi, on passe aux recettes de cuisine et aux méthodes de jardinage, pour revenir de nouveau à la silhouette des gens en vue[385].
[p. 352] Oh! la mine est inépuisable, car Bordeaux fourmille de figures bizarres...
N’en est-ce point une curieuse que cette comtesse de Béarn qui, malgré les pleurs de tous les siens, consentit à servir de marraine à Mme Dubarry pour sa présentation à la cour? Tenez! La voilà qui débarque de Versailles, après ce scandale retentissant: «Mme la comtesse de Béarn est ici, toujours pour ses procès. Ce n’est plus cette dame que nous avons vue mise si simplement et dont les manières étoient assorties à la parure. Elle a un ton de cour bien fait pour elle, et beaucoup de rouge. Sa fille vient de faire un très grand mariage. Elle a épousé M. de Pontchartrain, frère unique de M. de Maurepas, lequel n’a point d’enfants. Il est vrai qu’il a soixante ans et qu’elle n’en a que vingt-neuf; mais c’est une fortune immense. C’est M. le duc d’Aiguillon qui a fait ce mariage. Deux autres filles qu’a Mme de Béarn sont chanoinesses à Metz.»
Des honneurs, des alliances, des prébendes: c’est dans l’ordre... La bénéficiaire ne se montre pas ingrate. Devenue riche par un coup du sort, elle s’applique à faire de sa protectrice le plus touchant portrait... Mme Dubarry, assure-t-elle, est une calomniée: pour un peu, elle dirait un dragon de vertu!... Mais le piquant, c’est [p. 353] que—cousine de M. de Cursol—la comtesse de Béarn descend en droite ligne de l’auteur des Essais: on peut croire que, malgré son scepticisme, le seigneur de Montaigne n’eût point vu sans déplaisir les complaisances de sa petite-fille[386].
Et le défilé continue, pour le plus grand amusement de Mme de Cursol, dont ces récits dissipent les vapeurs... Voici encore quelques silhouettes tracées à son intention:—le chanoine Boier, un horticulteur habile dans l’art de créer des variétés de fleurs;—le financier Beaujon, escorté de son sérail dont plus d’un sujet, recruté dans le bon monde, naquit sur les rives du Peugue[387];—l’actrice Mlle Dix-Neuf, qu’on admire dans son carrosse à quatre chevaux, un présent de l’ambassadeur du Maroc;—des jeunes filles qui se résignent à épouser des vieillards cacochymes;—des folles de soixante ans conduisant à l’autel des éphèbes à peine hors de page;—un conseiller, dont le père vendait du poisson salé, et qui, féru de noblesse, essaie de se rattacher à Guillaume [p. 354] le Conquérant; d’où une hilarité formidable à la barbe de l’intéressé, lequel, finalement, a le bon esprit de rire plus fort que la galerie... Gardez-vous de douter de ces menus faits. Mme Duplessy ne verse que du bon coin: «J’en puis parler savamment, déclare-t-elle, j’y étois!»
Tout cela coule de source. Ce n’est ni l’apprêt de grande dame, ni le raffinement d’élégance, ni l’enjouement voulu de Mme de Sévigné. Mais, peut-être, plus justement que la spirituelle marquise, l’épistolière bordelaise a-t-elle le droit de dire que, chez elle, l’expression vole sur le papier et que sa pensée a toujours la bride sur le cou. A peine se permet-elle, de loin en loin, une modeste entrée en matière: «Je vais vous faire une histoire, et, pour cela, je change de plume, car vous voyez bien que celle-ci est trop usée...» Et la plume neuve de courir en zigzags pittoresques où le naturel, assaisonné de sel gascon, le dispute à la fantaisie de l’orthographe.
On épuise ainsi tous les sujets, sans lasser la châtelaine de Fonchereau, dont la curiosité réclame toujours un nouvel aliment. «Mes gazettes vous amusent, réplique Mme Duplessy, c’est tout ce que je demande. Débitez-les, mais ne les donnez pas à lire. Elles ne sont écrites que pour vous. Si je croiois qu’elles dussent passer par d’autres [p. 355] mains, cela me gêneroit dans mes narrations[388].» Et comme prix de la discrétion qu’elle sollicite, l’excellente femme joint à son envoi des flacons d’eau de senteur, des pastilles de chocolat, des bonbons de jurade[389], pour sa vaporeuse correspondante—sans compter tout un lot d’oranges, de pistaches de Verdun, de macarons, destinés au plus gâté des gendres.
Après quoi, elle se remet en campagne, jetant un regard curieux sur tout ce qui l’environne... Justement, la voilà qui rentre, après de fructueuses investigations. Elle tend sa canne à Suzette, quitte le point-du-jour drapé sur ses épaules, détache son voile de guipure qu’elle porte à la modestie, respire le parfum des fleurs qui garnissent sa cheminée, va clore la fenêtre d’où elle adresse un salut amical au bon M. Buhan, et s’assied à sa petite table...
Respectons son recueillement, et, mettant ses notes à profit, reprenons le cours de cette étude.
Bordeaux durant l’exil des parlementaires.—Mme de Gourgue de Thouars.—Établissements de plaisir.—Le Vauxhall, le Colisée, Bardineau.—Une fin de règne: la grande souberne, épizooties, famine de 1773.—Le socialisme dans les campagnes.—Satires et pamphlets.—Mort de Louis XV: comment Bordeaux porte le deuil.

En ce temps-là, Bordeaux présentait l’aspect des républiques italiennes du moyen âge lorsqu’un tyran ombrageux en avait proscrit les têtes les plus illustres. A chaque pas, dans les quartiers aristocratiques, on rencontrait des maisons fermées: non seulement les logis des parlementaires, mais encore ceux de leurs parents tenus aussi pour suspects. Un contemporain assure que les rues étaient désertes, que les riches vêtements avaient disparu, et que tout «annonçoit une catastrophe»[390].
Dispersée et fugitive, la haute société courait les grands chemins, ou se claquemurait dans ses [p. 358] manoirs. Vainement, les commensaux du gouverneur, attristés de cette émigration, insistaient-ils pour ramener les châtelaines élégantes. Ils s’attiraient des réponses dans le goût de celle-ci: «Il y a, Monsieur, des époques où les tracassiers et les délateurs jouent leur rôle avec assurance. Il est, je crois, prudent de s’en tenir éloigné. Je ne suis ni haineuse ni vindicative, mais nous aimons notre tranquillité, et, en ne faisant ni ne disant de mal de personne, nous serions très mortifiées qu’on nous pût mettre dans des pétoffes qui sont traitées ensuite comme des affaires sérieuses[391].»
Les pétoffes étaient d’autant plus à craindre que le maréchal ne désarmait pas. Non content de disperser les mauvais sujets aux quatre vents du ressort, il s’appliquait à leur désigner, comme lieu d’internement, les villes ou les bourgs les plus préjudiciables à leurs intérêts[392]. Quelques-uns, grâce à de puissantes démarches, purent obtenir des adoucissements; mais à tous l’approche de Bordeaux demeura défendue. Aux ennuis d’un campement dépourvu de confort se joignaient de rigoureuses interdictions, notamment celle de découcher...
En leur qualité de Romains, bon nombre [p. 359] d’exilés se faisaient la tête impassible du vieux Caton: le monde se serait écroulé sur eux sans qu’ils daignassent s’en apercevoir. Les femmes pouvaient, sans déshonneur, montrer moins de stoïcisme. Certes, parmi elles, les Cornélies abondaient. Mais d’autres, éloignées de toutes leurs affections, se sentaient à bout de forces. Telle Mme d’Estignols de Lancre, confinée dans un village de douze feux, sans même la compagnie du plus menu des prestolets. Telle aussi la présidente de Gourgue, réduite aux beaux jours de Langon... Langon, presque une ville; mais la plus belle ville du monde a tout l’air d’une prison quand on n’en peut franchir le périmètre. Persuadé qu’il ne reverrait plus son superbe château de Thouars, situé à une lieue de Bordeaux, M. de Gourgue l’échangea contre la terre de Roaillan, laquelle présentait l’avantage de se trouver à sa portée[393]... Mais voilà que, l’échange accompli, l’infortuné n’en put jouir, par suite de l’obligation de répondre à l’appel du soir. La présidente se désolait: «Si vous saviez, écrit-elle, quelle pauvre vie je mène, vous en seriez touché. C’est en vain que j’ai porté des livres et des crayons: on ne me laisse pas le temps d’en [p. 360] faire usage[394]...» Et elle aspirait à la solitude des bois de pins dont les émanations eussent été salutaires à sa poitrine. Pauvre petite présidente! Sa plus grande distraction fut de broder une robe qu’elle préparait pour le jour de la délivrance. Lorsque ce jour vint à luire, elle toussait de façon à ne plus laisser d’espoir, et sa vue était irrémédiablement compromise. On attribua ce dernier mal aux fatigues de la broderie; mais les larmes sûrement entraient en ligne de compte[395].
Le bonhomme La Fontaine assure que la tristesse s’envole sur les ailes du Temps. Bordeaux ne poussait pas aussi loin l’indépendance du cœur. Toutefois, sans oublier ses défenseurs dans l’infortune, il ne dédaigna point les consolations qui vinrent le solliciter. A défaut de salons se mettant en frais, il se créa des lieux de réunion ouverts à tous moyennant finances: le Vauxhall, construit sur les terrains de l’archevêché avec les capitaux des actionnaires du Théâtre, et dont la licence ne tarda pas à éloigner les honnêtes gens; le Colisée qui, plus circonspect, s’adjoignit une scène dont [p. 361] les acteurs, âgés de douze à quinze ans, attiraient un public nombreux[396]...
Mais le cabaret le plus en vogue est celui que Bardineau installa dans l’ancien hôtel de Mme Duplessy. Là où s’épanouirent tant de célébrités, au fond des vastes pièces jadis enrichies de collections, sous l’ombre de cette charmille où Montesquieu devisa de l’Esprit des lois avec Jean-Jacques Bel, un traiteur en veste blanche offre des pique-niques agrémentés de flons-flons, des bals, des soupers, des concerts, des distractions de tous genres, voire des tirs à l’arbalète. La maison, d’ailleurs, refuse les masques et n’accueille qu’un monde choisi... Est-ce à dire que la galanterie en [p. 362] soit exclue? Ce serait mal connaître le XVIIIe siècle. Mais celle-là seule est tolérée qui se réclame du bon air, porte avec distinction l’assassine ou la majestueuse
Qui rehausse d’un teint la blancheur naturelle
et révèle la grande dame ou la bourgeoise de qualité. Pour les personnes de cette catégorie, le premier tourne-broche de la ville n’hésite pas à bouleverser ses fourneaux, à mijoter ses courts-bouillons, à décoiffer ses bouteilles de réserve. On assure même qu’à la façon des anciens baigneurs il détourne les yeux quand des couples assortis s’égarent dans son labyrinthe ou poussent le verrou du Cabinet des Muses. Ce qui n’empêche pas les princes de passage d’accepter chez lui des repas et des fêtes. Dans ces circonstances solennelles, la cuisine du maître atteint une perfection à rendre jalouses les réputations les mieux établies. Nul, en effet, ne possède comme lui les vingt-huit recettes de messire Taillevent, rôtisseur de Sa Majesté Charles V, sans parler de certaine sauce à l’alose dont il cèle, à l’égal d’un secret d’État, l’élaboration savante... Particularité remarquable: dans ce temple gastronomique, l’addition ne s’élève point aux hauteurs qu’elle atteint à Paris. Il suffit, du reste, pour obtenir des prix de faveur, [p. 363] de se recommander de Mme Duplessy: Mme Bardineau n’est autre que son ancienne femme de chambre.
Malgré ces engageantes attractions, Bordeaux n’en tourne pas moins à la nécropole, et Libourne, Périgueux ou Agen n’ont rien à lui envier... Aucun personnage attirant l’attention; pas un événement digne d’intérêt—à moins de faire entrer en ligne de compte le voyage manqué du dieu Voltaire[397], et l’installation, en qualité de Primat d’Aquitaine, de Son Altesse le prince de Rohan-Guéménée[398]...
Les recherches les plus minutieuses ne révèlent que des sinistres. Oh! à ce point de vue, les annales sont fécondes. Il semble que tous les fléaux se soient ligués pour désoler cette fin de règne... D’abord, une inondation sans précédents, restée fameuse sous le nom de grande souberne, durant laquelle la rivière dépassa l’étiage de trente pieds. Les récoltes détruites, dix mille [p. 364] têtes de bétail perdues; seize cents maisons renversées, depuis Toulouse jusqu’à Bordeaux; un grand nombre de noyés; des désastres incalculables dans le port; la ville envahie à ce point que l’on se rendait en bateau au palais de l’Ombrière... Tel en fut le bilan[399].—Puis, des épizooties sévissant sur les campagnes, et des maladies contagieuses décimant les populations agglomérées. Enfin, comme couronnement, une disette rappelant celles du XVIe siècle, où, suivant un chroniqueur, «une infinité de peuple mouroit par les rues, mangeant des herbes mortifères, mesme les charognes aussi[400]...»
En 1773, la famine se double de l’émeute. De tous côtés partent les cris: du pain, du pain! Les milices prennent les armes. La noblesse se joint à la bourgeoisie. Les troupes régulières sont mises en mouvement. Placé en face d’une bande de misérables, un officier du Château-Trompette commande le feu: ses soldats tournent leurs mousquets contre lui et le contraignent à demander grâce[401]. Bientôt, l’agitation se répand dans les hameaux les plus reculés. L’inquiétude devient si [p. 365] vive que l’on mande en toute hâte le régiment de Condé-cavalerie, en garnison à Saintes.
Informé de ces événements, le premier président de Gascq qui, pour fuir les visages moroses, avait, en compagnie de Richelieu, planté sa tente sur les bords de la Seine, s’empressa de rentrer en Guyenne. La foi des Bordelais dans les parlementaires était si profonde que chacun s’écria: c’est Dieu qui le fait revenir! Quelques paroles, appuyées d’une taxe sur les riches, lui valurent des acclamations frénétiques. Mais le vent ne tarda pas à tourner. Les menaces succédèrent aux bénédictions, et la foule se rua au pillage des boulangeries. Jurats et intendant, en proie à une frayeur extrême, en furent réduits à se faire garder «au dehors et au dedans»[402].
Mme Duplessy n’ignore rien de ces faits. Elle sait que la ville est occupée militairement, que l’on tient sous les verrous des malheureux qui seront pendus «pour n’avoir pas eu la patience de mourir de faim», que partout la sédition se déchaîne: à Toulouse, à Albi, dans le Poitou[403]...; [p. 366] mais elle garde le silence pour ne pas accroître l’affolement de Mme de Cursol, sans défense au milieu de populations réduites au désespoir. Elle confesse que le pain mis en vente est de mauvaise qualité et peut engendrer bien des maladies; mais elle affirme qu’on va envoyer de Versailles du blé, de l’argent et des troupes... Des troupes, c’est certain. Les ministres, en effet, se félicitent de pouvoir, à la faveur des troubles dont elle est le théâtre, dépouiller la capitale de l’Aquitaine de ses droits immémoriaux à se garder elle-même[404].
Et comme Mme de Cursol représente l’Entre-deux-Mers en feu, les paroisses soulevées, les greniers mis à sac, les paysans prêchant la révolte et le partage des terres[405], Mme Duplessy s’efforce d’établir que tout danger a disparu, grâce aux sacrifices du commerce bordelais auquel le gouvernement n’a pu refuser plus longtemps l’autorisation [p. 367] de faire entrer des grains[406]. Quant à ceux que le roi se décide à expédier, on n’en augure rien de bon: ils se sont avariés à la Rochelle où on les gardait, depuis quatre mois, «en vue de les faire filer...» Allusion transparente au bruit fort répandu que Sa Majesté affame ses sujets afin de tirer profit de la hausse. «Ceci entre nous, recommande l’épistolière, car il ne faut rien dire qui puisse animer le peuple...» Bernadau—moins réservé—écrira plus tard: «Cette disette était l’effet des spéculations coupables faites par certains hommes puissants qui produisirent une famine factice pour en profiter au gré de leur cupidité.» Telle était aussi l’appréciation du Parlement reconstitué, lequel, pressé par l’opinion publique de dénoncer les monopoles, ne craignait pas de représenter au roi que les auteurs des calamités de la province «résidoient près du trône»[407]... Pensa-t-on à Versailles que cette accusation était inspirée par les magistrats proscrits? On serait tenté de le croire. Toujours est-il qu’on [p. 368] y répondit en rejetant sur eux la responsabilité des attentats commis dans l’Entre-deux-Mers[408].
La lutte organisée contre les mauvais sujets se poursuit, d’ailleurs, avec une implacable méthode. Maupeou, disposant de toutes les plumes vénales, répand dans la circulation des milliers de brochures; mais il ne parvient pas à retourner l’opinion. Toute attaque de sa part amène une riposte. Aux violences de ses «aboyeurs», le public répond par un déluge de lazzi, de chansons, de caricatures tournant en ridicule Sa Majesté elle-même. La Guyenne est inondée de pamphlets. Il en débarque de partout, de Paris et de Genève, de la Hollande et de la Grande-Bretagne, par la route de terre, mais surtout par la voie de l’Océan. Les libraires n’osant guère se risquer, de peur de perdre leur privilège, on a recours à des dépôts secrets. Quant aux campagnes, elles sont envahies par des nuées de colporteurs dont les balles recèlent la collection des écrits défendus... La police ne sait où donner de la tête, et l’intendant Esmangart, dans des rapports découragés, en est réduit à confesser son impuissance[409].
[p. 369] Soudain, au cours de cette agitation, une rumeur envahit la ville: le roi est atteint de la petite vérole, le mal s’aggrave d’heure en heure! Un courrier de cabinet envoyé en Espagne confirme la nouvelle... Oh! les regrets ne sont pas profonds. Le Bien-aimé est, depuis longtemps, devenu le Bien-haï, ainsi qu’il le déclare lui-même. Mme Duplessy, comme la population entière, semble se soucier médiocrement du royal malade. Justement, on répare Fonchereau dont la toiture est à nu: la crainte d’une pluie inopportune tient plus de place dans ses préoccupations que le bulletin médical de Versailles.
Bientôt, tout espoir a disparu. On ferme le théâtre, on ordonne des prières publiques, et le Saint-Sacrement est exposé dans les églises. Alors, les commentaires d’aller leur train sur la place du Palais, aux allées de Tourny, à la Bourse et le long de l’Intendance; le décès du «vieil esclave de la Dubarry» peut, en effet, changer la face du royaume. Néanmoins, les confidences s’échangent à voix basse, tant est vive la frayeur du fort du Hâ. «Vous me demandez des nouvelles, répond Mme Duplessy à sa fille; on en débite de toutes les couleurs et l’on ne peut compter sur la vérité d’aucune. Ainsi, quant à présent, il faut s’en tenir aux gazettes et aux manuscrits. [p. 370] Les lettres particulières des gens prudents n’en apprennent pas, de peur qu’elles ne soient ouvertes. On dit que l’on a mis ici plusieurs personnes des Chartrons en prison pour en avoir débité. Le jeune Jourgniac écrit de Nancy à son père qu’on y en a arrêté quatre pour la même raison...»
Enfin, on annonce officiellement la mort du prince que Duclos, le moins flatteur des philosophes, représentait «comme supérieur à la gloire même»... Un soupir de délivrance s’exhale de toutes les poitrines, comme en 1715, lorsque la France apprit la disparition du Roi-Soleil[410]!
Bordeaux marqua sa douleur suivant les règles du cérémonial: catafalque, cierges, service funèbre auquel assistèrent tous les corps de l’État. On oublia, cependant, de mettre en branle les cloches des paroisses qui, d’après l’usage, devaient sonner pendant quarante jours[411]. En revanche, la noblesse prit le deuil: le grand deuil, d’abord, en crépon et pleureuses, garnitures d’étamine, bas de soie noire, souliers et boucles bronzés; puis, le petit deuil, blanc ou noir, avec gazes brochées, [p. 371] bijoux et diamants... La bonne compagnie s’exécuta d’une façon si rigoureuse que les étoffes d’ordonnance enchérirent du double. Les gens parcimonieux ne purent s’en tirer à moins de vingt écus. C’est juste ce que dépensa Mme Duplessy, y compris la cire noire qui, à dater de ce jour, remplaça sur ses lettres la cire rouge du cachet... Il faut bien, explique-t-elle, faire comme tout le monde!
Telle est l’oraison funèbre qu’elle consacre au monarque disparu. Cette formule détachée en dit plus long, sur l’état d’esprit de la province, que toutes les satires du temps.
Disgrâce de Richelieu et de ses amis.—MM. Du Hamel, Ferrand, d’Arche, de Métivier, Tranchère, de Lautrec...—Le maréchal de Mouchy et Mme l’Étiquette.—Modes nouvelles: la couleur ventre de la reine.—La franc-maçonnerie en Guyenne: Montesquieu franc-maçon.—Opinion de Jean-Charles de Lavie.—L’ordre des avocats: Me Polverel.—Poussée de l’opinion en faveur du Parlement.—Nouvelle grève du Barreau.

Richelieu n’avait pas quitté le chevet de Louis XV; moins par attachement à sa personne que par calcul de courtisan, pour le cas où le prince viendrait à se rétablir. On le vit, durant plusieurs jours, liant sa fortune à celle de la Dubarry, protester contre toute pratique religieuse, menacer le curé de Versailles de le jeter par la fenêtre s’il parlait de confession, et traiter l’archevêque de Paris de j... f... quand ce prélat récita la formule de repentir imposée à son pénitent. Après le dénouement, le plus vif chagrin de cet ami fidèle fut de ne pouvoir, par suite de son contact avec le moribond, présenter ses hommages au nouveau monarque[412].
[p. 374] Quand il fut admis en présence de Louis XVI, celui-ci lui posa la question suivante:
—Monsieur le maréchal, vous qui vécûtes sous trois règnes, que dites-vous des choses d’aujourd’hui?
—Sire, répliqua-t-il, un détail me frappe. Sous Louis XIV, on se parlait avec les yeux; sous Louis XV, on se parlait à l’oreille; sous Votre Majesté, on parle tout haut...
Si haut, en effet, que le cri de l’indignation publique étant parvenu jusqu’à Versailles, le maréchal fut sacrifié. Rentré à Bordeaux le 22 juin 1774, il y promena la mine déconfite d’un valet que l’on congédie, mit en ordre ses affaires et repartit, pour ne plus revenir, avec meubles et équipages. On peut croire qu’en franchissant, pour la dernière fois, les murs de son ancienne capitale, il entendit siffler à ses oreilles ce couplet qui, alors, faisait fureur:
[p. 375] On ne poussa pas la sévérité jusqu’à déposséder de ses fonctions de gouverneur celui que Mme Geoffrin appelait «une épluchure de tous les vices»; mais on lui infligea l’humiliation d’en faire remplir l’emploi par son neveu, le comte de Noailles, bientôt duc de Mouchy[414].
Ses amis ne tardaient pas à partager son sort. Exilé, M. Du Hamel, le lieutenant de maire. Exilé aussi, M. Ferrand, inspecteur des maréchaussées. En disgrâce à Caen, l’intendant Esmangart qui, malgré des qualités sérieuses, avait fini par s’aliéner la population entière. Rendus au calme de la retraite, MM. d’Arche et de Métivier, qu’un caprice du maître avait élevés à la dignité de jurats à vie. Acceptée, la démission du procureur-syndic Tranchère. Mis en demeure de rendre des comptes, certains personnages d’importance qu’on soupçonnait de brigues intempestives appuyées de pots-de-vin—un mot et une chose qui ne datent pas d’hier. Conduit à Sainte-Marguerite, dans une voiture aux portières grillées, le lieutenant général comte de Lautrec, accusé de violences rappelant trop le temps du bon plaisir[415]!...
[p. 376] Bordeaux a recouvré sa liberté. Il en use avec délices, gouaillant, frondant, chantant à gorge déployée. Parfois même, il va jusqu’à la licence: c’est ainsi que, du haut de la chaire de Saint-Remi, un prédicateur n’hésite pas à flétrir les gens de qualité qui, spéculant sur le vice, se sont faits les tenanciers de l’Opéra et de la Comédie[416]. Quel changement, en l’espace de quelques mois, aussi bien chez les officiers royaux que chez les agents du fisc! Partout, la bonne grâce est à l’ordre du jour; partout, il souffle un vent de vertu. Jusqu’à l’hôtel du gouverneur, tenu à juste titre pour un mauvais lieu, qui va se transformer en temple des bienséances.
M. de Mouchy était, en effet, l’antipode de son oncle. Scrupuleux, timoré, dévot, il avait des pudeurs de vierge. L’impression qu’il éprouva, en prenant possession de sa nouvelle demeure, fut sûrement pénible. Dans le salon, dont les dessus de porte représentaient des amours égrillards, il [p. 377] baissa les yeux et se signa. Arrivé à la chambre, encore empreinte de senteurs voluptueuses, il ouvrit les fenêtres et brûla du sucre... Il s’empressait, du reste, de proclamer la séparation de l’État et du Théâtre, de moraliser les coulisses, de réglementer la police de la salle et d’interdire l’accès de la scène aux spectateurs.
Le corps de ballet l’ignora toujours. En revanche, il s’affiliait à toutes les confréries de la province, tour à tour membre du Saint-Sacrement, pénitent bleu, pénitent blanc, pénitent de toutes les couleurs... Chaque matin lui apportait une dignité nouvelle. A la première, il donna six louis; à la seconde, quatre; à la troisième, deux. Ensuite, il ferma sa bourse: la fortune des Noailles y eût d’autant moins suffi que l’abbé Graves, «qui le faisait tourner comme un pantin,» l’initiait à une foule d’autres œuvres... D’ailleurs, excellent homme, quoique court d’idées, et ne reculant, en vue de plaire, devant aucun sacrifice. Non seulement il offre des séries de dîners où figurent, quatre par quatre, des négociants de la Rousselle et des Chartrons; mais, ayant appris que Richelieu accordait aux jolis minois la faveur d’un baiser, il prend le parti héroïque d’embrasser toutes les femmes, belles [p. 378] ou laides, vieilles ou jeunes: sa candeur ne distingue pas[417].
Mme de Mouchy complétait dignement cet étrange personnage qu’elle dépassait autant par la supériorité de sa taille que par l’éclat de son génie. Air sévère, maintien roide, port majestueux, elle représentait—moins la grâce et la beauté—une reine de l’Olympe. L’Europe l’appelait Madame l’Étiquette... «L’étiquette, rapporte Mme Campan, était pour elle une sorte d’atmosphère. Au moindre dérangement de l’ordre consacré, on eût dit qu’elle alloit étouffer[418].» La Dauphine, à qui, à son entrée en France, on l’imposa en qualité de dame d’honneur, ne pouvait à sa guise ni saluer, ni ouvrir la bouche, ni pincer de la guitare, ni porter retombantes les barbes de sa coiffure lorsqu’elle était lasse de les avoir retroussées: un supplice de chaque instant, exaspéré par l’allure à la fois hautaine et respectueuse de sa camerera mayor. Aussi, à peine investie de la couronne, le premier soin de Marie-Antoinette fut-il de conquérir sa liberté... au prix d’une pension de soixante mille [p. 379] livres[419]! Moyennant quoi, la Guyenne fut initiée aux splendeurs d’une science dont la stricte observation constituait «la parure et la grandeur des trônes». Bordeaux ne s’étonna point de ces airs superbes. Parfois même il s’en égaya; témoin le jour où Mme de Mouchy, pour éviter le contact des manants préposés à la descente des bateaux, faillit se laisser choir dans la rivière:
«Avez-vous su, raconte Mme Duplessy, que la maréchale, qui partoit mardi, pensa tomber à l’eau? Des dames de cette importance ne peuvent pas donner la main à des matelots pour entrer dans leur brigantin. En conséquence, M. de Verteuil et un autre la soutenoient. Le pied lui glissa sur les planches. Elle fut retenue et ne tomba point. On la rapporta au Gouvernement, et, vite, une visite du chirurgien nommé Métivier qui décida d’abord qu’elle avoit les os cassés, ensuite l’épaule démise; et tout s’est réduit à une contusion qui eût été peu de chose si elle n’étoit pas si grande dame. On donne à sa porte trois bulletins par jour... M. de Mouchy est plus malade qu’elle d’une colique [p. 380] pour laquelle on ne laisse pas que de le saigner[420].»
Une pécore! avaient, un jour, murmuré des lèvres qu’on disait être celles de Marie-Antoinette... Les Bordelaises ratifièrent ce jugement d’autant plus volontiers que la reine faisait alors tourner toutes les têtes. Son ton, ses goûts, ses attitudes servaient de modèle aux élégantes. Des milliers de petits vers célébraient ses louanges, et les modes qu’elle daignait approuver étaient presque aussitôt suivies à Bordeaux qu’à Paris.
Ah! le deuil de Louis XV fut lestement porté sur les bords de la Garonne! Jamais l’art d’accommoder étoffes, perruques et visages ne fut poussé plus loin qu’à ce commencement de règne. Qu’on en juge par cet aperçu des toilettes du jour expédié de la rue du Cahernan à la châtelaine de Fonchereau:
«Les femmes se coiffent toujours très haut, le toupet en avant, les racines des cheveux coupées en vergettes. La pointe qui fait le toupet s’appelle physionomie. Les boucles qui l’accompagnent sont très grosses et séparées de celles d’en bas qui doivent être pendantes.
[p. 381] »On porte des bonnets fort grands, garnis de fleurs et de rubans anglais. Derrière le bonnet est un assemblage de panaches de différentes couleurs, soutenu par un anneau de diamant. Le nombre des bonnets à la mode est fort considérable. On en compte jusqu’à deux cents de différentes espèces, depuis la somme de dix jusqu’à cent livres. Les panaches sont d’une grandeur prodigieuse, et, lorsqu’ils sont blancs, on met une plume de la couleur de la robe, ou une noire.
»Les robes de la couleur la plus à la mode sont celles de la couleur des cheveux de la reine: châtain foncé[421]. Après, vient la couleur puce. On porte ces robes-là garnies de la même étoffe. Le satin paille, à boyaux, est fort en vogue: on le garnit de différentes façons, soit en gazette, soit en dentelles ou fourrures. Après, viennent les satins peints et brochés qui ont chacun un nom. Les plus en vogue sont ceux que l’on appelle: couleur de soupirs étouffés. Les vert-pomme, rayés de blanc, ont aussi un grand succès: on les nomme vive bergère. Voici les noms de quelques garnitures: les plaintes [p. 382] indiscrètes, la grande réputation, l’insensible au désir manqué, la préférence, aux vapeurs, au doux sourire, à l’agitation, aux regrets, à la composition honnête...
»Les paniers sont petits, mais épais et larges d’en haut.
»Les souliers sont constamment couleur de puce ou de cheveux de la reine. C’est la grande magnificence des dames. Ils sont brodés en diamants, et c’est presque là seulement qu’elles en portent. Aussi bien rien n’est aussi beau, à présent, que le pied d’une femme, quand elle ne seroit pas jolie. Les dames n’oseroient se montrer sans avoir les pieds comme un écrin... Les souliers sont étroits et longs; la raie de derrière est garnie d’émeraudes: on l’appelle le venez-y-voir.
»Les mantes sont bannies. On porte, pour fichu, une palatine de duvet de cygne que l’on appelle un chat. Chaque femme a un chat sur le col, derrière les épaules, et, de plus, autour du col, une machine de dentelle, de gaze ou de blonde, fort plissée, que l’on appelle des archiduchesses ou médicis. Les rubans les plus à la mode s’appellent attention marquée, désespoirs, œil battu, conviction, soupirs de Vénus...»
Après les généralités, voici l’application. C’est [p. 383] une déesse de la danse qui est offerte, comme modèle du goût nouveau, à la fashion bordelaise enrichie par le commerce des îles...
«Mlle Duthé—que l’on dit être la maîtresse du comte d’Artois—étoit dernièrement à l’Opéra avec une robe de soupirs étouffés, ornée de regrets superflus, avec un point, au milieu, de candeur parfaite, garnie de plaintes indiscrètes avec des rubans en attention marquée, des souliers cheveux de la reine brodés en diamants et le venez-y-voir en émeraudes irisées, peu de poudre, en sentiments soutenus et coup perfide, avec un bonnet conquête assurée, garni de plumes volages et de rubans œil battu, ayant sur les épaules un chat couleur de gens arrivés, derrière une médicis montée en bienséance, avec un désespoir d’Éole et un manchon d’agitation momentanée.»
Quelles fadaises! s’écrie la narratrice, au bout de sa tirade. Mais, comme Fonchereau se délecte de ces menus détails, elle ne cesse de revenir à la charge, émaillant ses descriptions de remarques humoristiques sur l’insensible au désir manqué de la petite de Buch ou les soupirs de Vénus de Mme l’intendante... Comment, d’ailleurs, garder pour soi certains épisodes dont la ville est pleine? Il en est de si piquants! Écoutez cette aventure, [p. 384] éclose dans quelque boutique de la rue Saint-James, à moins que ce ne soit sur les Fossés de l’Intendance...
Un étranger de distinction entre chez le marchand de soieries en vogue.
—Que désire Monseigneur?
—De quoi faire un habit.
—L’étoffe?
—Du satin.
—La couleur?
L’embarras de l’étranger est grand. On lui a dit cheveux de la Reine; mais le premier mot ne lui revient pas, et, à la place, il lui en arrive un autre...
—Couleur? dit-il... ventre de la reine...
Une couleur inédite pour le marchand; mais qui peut se flatter de prendre un Gascon sans vert! Convaincu que le corps de Sa Majesté rivalise d’éclat avec la neige, celui-ci étale ses satins les plus blancs... Huit jours après, il ne se vendait que des étoffes blanches: «Le ventre de la reine, comme il est juste, l’emportoit sur ses cheveux[422]!»
Est-ce à dire que Bordeaux, envahi par le goût du luxe et de la toilette, repoussât désormais l’empire de la raison? Gardons-nous de le croire. [p. 385] Oublieux? Il ne l’était pas davantage, et sa pensée se reportait sans cesse vers les absents. Ceux-ci avaient, dans toutes les classes, des amis résolus, en tête desquels il convient de placer une puissance qui, à cette époque, gouvernait la province: nous voulons dire la franc-maçonnerie...
Son implantation en Guyenne date des années qui suivirent la Régence. En 1742, ses rameaux s’étendaient assez loin pour que l’intendant Boucher crût devoir en aviser le roi: «La nouveauté, qui plaît infiniment dans ce pays-ci, déclarait-il, a déterminé nombre d’honnêtes gens à entrer dans cette confrérie, même des officiers du Parlement[423].» Aux représentants de la robe, il eût pu ajouter les membres de l’Académie: «Je vois, écrit Montesquieu, que notre assemblée se change en société de francs-maçons, excepté qu’on n’y boit ni qu’on n’y chante.»—Personnellement, le châtelain de La Brède figurait parmi les adeptes de la première heure: ce qui lui attira une verte semonce du ministre Fleury, heureux de chercher noise à celui qu’il ne cessait de considérer comme un danger public[424].
[p. 386] Depuis la mort du cardinal, la nouvelle association s’étalait au grand jour. Ses règlements étaient connus, et Jean-Charles de Lavie ne craignait pas—dans son traité des Corps politiques—d’en célébrer les mérites: «S’il faut croire, rapporte-t-il, ce qu’on publie des francs-maçons, cette confrairie n’a d’autre principe que de resserrer l’union et la charité mutuelles que l’humanité devroit inspirer à tous les hommes. Si, dans les festins qui sont la base de leur union, tout excès, comme on dit, toute médisance, toute parole indécente sont, non seulement défendus, mais punis, ils sont dignes de louanges. Peut-on leur en donner assez s’ils remplissent les obligations et les vues de leur établissement[425]!»
C’était une consécration publique, dont l’autorité devait paraître d’autant plus grande que l’auteur des Corps politiques remplissait les fonctions de censeur de l’imprimerie[426]—A la fin du règne de Louis XV, toute la haute magistrature, une partie de la noblesse, les membres distingués du [p. 387] commerce, les personnages en vue de la ville et de la province, font partie des loges maçonniques. Il faut y joindre de nombreux prêtres séculiers et des religieux de tous les ordres: Augustins, Carmes, Cordeliers, Récollets, Bénédictins—ces derniers représentés par deux illustrations, Dom Devienne, l’auteur de l’Histoire de Bordeaux, et l’inoubliable Dom Galéas. Peut-être même conviendrait-il de grossir cette liste des noms d’un certain nombre de femmes. Le beau sexe, en effet—si l’on en juge par certains documents—avait accès dans le sanctuaire, en suivait les débats, et même prenait une part active aux délibérations.
Une autre cohorte, également dévouée aux parlementaires, c’était l’ordre des avocats. Maniant avec dextérité cette arme redoutable qu’on nomme la parole, ses membres entretenaient au fond des cœurs le souvenir de la grande Compagnie à l’ombre de laquelle ils s’étaient formés. Le Parlement, aux yeux de tous, figurait l’arche sainte de la magistrature, tandis que le Barreau en était «le séminaire». D’où des liens étroits que resserrait encore une communauté d’origine, de sentiments et de goûts. Les Lamothe, les de Sèze, les Brochon, les Garat, les Buhan, les Cazalet—dont chacun admirait les mérites et le caractère-vivaient [p. 388] dans une étroite intimité avec les Le Berthon, les Lavie, les Gourgue, les Dupaty...
Pour unie que fût «la famille judiciaire», des brouilleries ne laissaient pas que d’éclater entre robes rouges et robes noires. Tel, le conflit de 1748, à la suite duquel les avocats, retirés sous leur tente, refusèrent de plaider[427]. Leur mutisme dura vingt-sept mois, bien que les estomacs criassent famine. Les anciens, surtout, pâtirent d’une résolution jugée par eux inopportune. Aussi montrèrent-ils une réserve prudente lorsque, en 1771, M. de Maupeou anéantit le Parlement.
Cependant, un groupe d’avocats, composé de patriotes jeunes et ardents, avait prêché la résistance, assurant qu’on ne pouvait, sans déshonneur, survivre à la magistrature proscrite. A la tête de ce parti figurait une des lumières de l’ordre, Me Polverel, dont l’ardeur généreuse se doublait de l’éloquence d’un tribun. Convaincu que le coup d’État du chancelier préparait à la France une ère de servitude, ce précurseur des Girondins avait déployé une activité infatigable pour faire échec aux projets de Richelieu. Mais [p. 389] sa parole, qui avait électrisé conseillers et présidents, échoua devant la logique de ses confrères. La majorité, estimant qu’une retraite collective, d’une durée illimitée, dépasserait les forces de l’ordre, s’était prononcée pour la soumission et avait, à contre-cœur, porté ses compliments à M. de Gascq[428].
Au fond, l’unanimité des suffrages était acquise aux exilés. Dupaty ayant, du fond de sa prison, sollicité son inscription au tableau, fut, en 1773, choisi comme syndic. La ligne de conduite de Maupeou ne pouvait qu’entretenir ces sentiments; le Barreau ne tardait pas à voir que les réformes annoncées à grand fracas demeuraient lettre morte. Partout, la substitution du choix du prince à la vénalité aboutissait à des nominations indignes. Quant à la suppression des épices, les justiciables, ruinés déjà par les banqueroutes de Terray, savaient à quoi s’en tenir: la création d’une taxe spéciale et une surélévation énorme des anciens droits faisaient amèrement regretter le temps où la robe—de ses doigts crochus—percevait elle-même son [p. 390] salaire[429]. L’indignation devint si vive que M. de Gascq et ses collègues, faisant preuve d’une indépendance à laquelle on était loin de s’attendre en haut lieu, remontrèrent à Sa Majesté que sa volonté était méconnue «en ce sens que, dans le moment même où la gratuité de la justice étoit annoncée, les droits de greffe, de contrôle et autres avoient été si prodigieusement augmentés, notamment par les huit sous pour livre, que les frais de justice excédoient de beaucoup ce qu’il en coûtoit auparavant la suppression des épices et vacations[430].»
Ces constatations n’étaient point de nature à diminuer le prestige des «mauvais sujets». Chaque heure qui s’écoule augmente, avec la faveur attachée à leurs personnes, le crédit de l’opposition parlementaire. Autour d’elle se groupent, en un redoutable faisceau, le peuple, la bourgeoisie, les patriotes de tous ordres, la fraction du clergé affranchie des influences ultramontaines, et cette élite qu’on nomme le Barreau [p. 391] bordelais—non seulement la génération ancienne renommée pour son attachement au trône, mais celle-là même qui, imbue des idées nouvelles professées par les Guadet, les Vergniaud, les Grangeneuve, se recueille pour les luttes de l’avenir. Et cette fidélité, aussi ardente que respectueuse, aussi éclairée que convaincue, qui se perpétue depuis deux siècles, durera jusqu’au jour où, lasse d’efforts stériles, la Nation renoncera, pour l’anéantir, à améliorer l’antique constitution du royaume[431].
C’est donc dans un état de fièvre générale que Bordeaux attendait la décision du jeune roi. Celui-ci, à vrai dire, était animé de dispositions fâcheuses. Élevé dans les idées de son père, qui avait été le chef du parti dévot, il «abhorrait l’ancienne magistrature». On put croire, durant quelques mois, que, donnant cours à ses répugnances, il maintiendrait l’organisation Maupeou. Le silence glacial de la foule, à son premier voyage à Paris, lui fit comprendre qu’à ce jeu il risquait sa popularité et peut-être sa couronne. Déconcerté par cette leçon, il s’empressa de rétablir [p. 392] le premier Parlement du royaume. Mais il résistait encore pour celui de Guyenne, convaincu que ses anciens officiers, M. Le Berthon spécialement, ne jouissaient d’aucune sympathie: un éclat suscité par le Barreau allait démontrer le contraire...
C’est Me Polverel qui en fut l’instigateur... Ayant, un jour, à discuter une sentence des deux jurats amis de Richelieu, il ne craignit pas de la qualifier d’infâme. Sur quoi, la Grand’Chambre devant laquelle il plaidait, l’interdisait pendant trois ans.
Il n’en fallut pas davantage pour révolutionner la ville. Les avocats, à la suite d’un vote unanime, cessèrent l’exercice de la plaidoirie: une grève nouvelle qui, menée avec résolution par les illustres de l’ordre, menaçait de s’éterniser. De son côté, le peuple se livrait à de bruyantes protestations, huait les magistrats Maupeou, et, avec cette ténacité méridionale qui ne laisse échapper aucun prétexte, réclamait le rappel des exilés.
Il était dans la destinée du jeune roi de vivre et de mourir de concessions. Il céda encore une fois, et la Guyenne apprit avec délire que «les proscrits» lui allaient être rendus. Leur retour, assure un publiciste, devait représenter l’image du jugement dernier «où, la vérité reprenant ses droits, [p. 393] l’oppresseur est couvert d’ignominie, tandis que l’opprimé jouit de la gloire du triomphe».
Pour pompeuses que soient ces paroles, elles ne donnent qu’une faible idée de l’exaltation des têtes à ce moment inoubliable... Qu’on nous permette un rapide récit: c’est la dernière manifestation de l’esprit bordelais, tel que le façonnèrent les ardeurs du règne de Louis XV. Ne serait-ce qu’à ce titre, l’événement mérite d’être noté.
Le retour des exilés.—Manifestations populaires.—L’arc de triomphe du Béquet.—Députations et harangues.—M. Le Berthon et Gensonné.—Les dames du marché et les bouquetières de la place Sainte-Colombe.—Rétablissement de l’ancienne Compagnie judiciaire.—Service religieux des francs-maçons.—Cizos-Duplessis.—Retraite de M. de Gascq.—Querelles persistantes entre Restants et Revenants: insuccès de M. de Mouchy.

Bordeaux est sûrement l’une des villes de France qui reçurent le plus de têtes couronnées. Deux entrées royales notamment—celles de Charles IX et de Louis XIII—ont laissé dans ses fastes des souvenirs ineffaçables. Mais, quel que soit l’éclat dont elles furent entourées, ni l’une ni l’autre de ces solennités n’atteignit le caractère grandiose de l’accueil fait aux mauvais sujets... C’est que, ce jour-là, le peuple, en proie à une émotion profonde, obéissait non à des ordres, mais à des inspirations venues du cœur.
Les campagnes furent les premières à manifester... Partout où passent les Revenants—villages ou hameaux—la joie éclate, spontanée [p. 396] et bruyante. L’un d’eux, s’étant arrêté à Cambes, pour visiter des amis, est entouré de paysans qui lui offrent une sérénade de violons, de fifres, de tambourins, et l’escortent sur deux rangs, en agitant des branches de laurier.
Quant au président Le Berthon, on lui décerne des honneurs à rendre jalouse l’ombre de Louis XIV. Parti de son château d’Aiguilhe, où l’a trouvé la bonne nouvelle, il est l’objet d’ovations interminables. A Castillon, on le harangue. A Saint-Émilion, on le porte en triomphe. A Libourne, il est reçu par une députation des trois ordres, avec des salves d’artillerie... C’est à peine s’il peut parvenir à Virelade où il doit prendre, en compagnie de ses collègues, la route de Bordeaux.
La ville, à ce moment, présente un aspect inoubliable. Dans les quartiers de Sainte-Croix, de Saint-Michel, de Sainte-Eulalie, l’effervescence touche à son comble. Les ouvriers des Chartrons se dépensent en efforts laborieux, et les bourgeois de Saint-André accomplissent des prodiges de décoration. Il n’est pas de pauvre maison qui ne cherche à se parer... Feuillages, draps de lit, étoffes suspendues aux fenêtres, forment le plus pittoresque effet.
Mais l’œuvre la plus remarquable est l’arc de [p. 397] triomphe que les francs-maçons—le vieux de Lavie en tête—ont élevé près de la chapelle du Béquet[432]. L’édifice, de formes monumentales, dissimule de vastes appentis où s’organisent les préparatifs d’une collation. Sur le devant, une estrade munie de sièges, avec balustres pour contenir la multitude. A droite, des tréteaux destinés aux musiciens. A gauche, une rangée de neuf pièces de canon[433].
C’est le 28 février 1775 qu’eut lieu la cérémonie. Le début en fut marqué par une scène d’une grandeur imposante: la rencontre des exilés qui, depuis leur disgrâce, se revoyaient pour la première fois... Que de changements dans la petite troupe parlementaire! Rides et cheveux gris s’étaient accumulés. Ceux-ci étaient partis agiles qui revenaient podagres; ceux-là dans la force de l’âge qui revenaient vieux... Sans compter les victimes que la mort avait touchées de son aile! Sur la liste des disparus figuraient [p. 398] non seulement des hommes, mais aussi des femmes—parmi lesquelles la présidente de Gourgue, dont la robe de bal, brodée au prix de ses yeux, demeurait sans emploi[434]... Il est vrai que certains vides s’étaient comblés par suite de mariages. Des filles courageuses, bravant la colère du maréchal, étaient allées, dans de lointains villages, offrir leur main à de jeunes conseillers et partager leur infortune: telles, Mlle Godefroy, devenue Mme Castelnau d’Essenault, et Mlle de Lacolonie, devenue Mme de Conilh...
Se retrouver ainsi, brusquement, face à face, sous un ciel gris d’hiver, au carrefour de quatre chemins boueux... quel sujet d’attendrissement! Il y eut d’abord chez ces robins altiers, aussi surpris qu’émus, comme un effort de cette dignité solennelle qui était la marque de l’ancienne magistrature. Puis, cette poussée d’orgueil se fondit, des pleurs jaillirent de tous les yeux, et l’on échangea de longs embrassements. Après quoi, réduits au chiffre de trente-cinq[435], les mauvais [p. 399] sujets remontèrent dans leurs carrosses et, suivant l’ordre du tableau, accompagnèrent le premier président, dont la voiture était jonchée de fleurs.
Celui-ci continuait à subir le feu d’innombrables harangues, chaque paroisse ayant tenu à se mettre en frais de députés. A Portets, la Compagnie des procureurs vint faire ses offres de service. Au Boucaut, l’Ordre des avocats lui adressa ses hommages, par l’organe de Me Garat, le Linguet du Barreau bordelais. Plus loin, ce furent les clercs de la basoche, bannière déployée, les étudiants en droit, les élèves de l’Université venus à cheval pour prendre rang dans l’escorte...
Cependant, de Bordeaux au Pont-de-la-Maye, la foule grossissait de façon à inspirer des inquiétudes—deux cents carrosses, autant de chaises, de cabriolets, de désobligeantes, de carabas, de véhicules de tous genres, ne cessant de circuler... Enfin, à deux heures, le cortège apparut. Les bravos éclatèrent, violents, tenaces, infatigables. Mouchoirs et chapeaux volèrent au-dessus des têtes, tandis que les cris de Vive Le Berthon! couverts par des salves d’artillerie, alternaient avec ceux de Vive le Roi!
Le premier président fut conduit à un fauteuil disposé au-dessous de cette inscription: Vivant [p. 400] senatores religiosissimi!... Quand le public aperçut, au milieu de ses collègues, ce petit homme à la mine bienveillante, digne sans apprêt, simple dans sa tenue, vêtu d’un habit de campagne d’une modestie confinant à la rusticité, étanchant ses larmes d’une main, saluant de l’autre, les trépignements redoublèrent, et l’on put croire que le sol allait s’affaisser. Alors défilèrent, dans un pêle-mêle inexprimable, confréries, sociétés, corporations, et les discours succédèrent aux accolades.
Parmi les députations venues au-devant des parlementaires, celle du collège de Guyenne mérite d’être notée. Vingt-cinq jeunes gens la composaient. L’un d’eux, élève de philosophie, s’approcha, et, d’une voix chaude, récita un compliment débutant par ces mots: Catonis virtus linguâ Catonis hodiernâ die celebranda. M. Le Berthon écouta, sans perdre des yeux l’orateur, séduit par le charme de la physionomie, la pureté de l’accent, la hardiesse de l’intelligence. Le morceau achevé, le vieillard s’adressa au jeune homme:
—Monsieur, demanda-t-il, comment vous nomme-t-on?
—Monseigneur, répliqua celui-ci, je m’appelle Gensonné.
Leurs regards se croisèrent, affectueux chez l’un, reconnaissant chez l’autre: ce fut le point de [p. 401] départ de l’attachement qui unit désormais au chef de la vieille famille judiciaire le futur représentant de la Gironde[436].
Après quelques minutes de halte à une table où s’assirent deux cents convives, les voyageurs reprirent leur marche triomphale. A la porte d’Aquitaine, des gens de Saint-Michel voulurent dételer la chaise du premier président: il eut toutes les peines du monde à les empêcher de le traîner à bras. Enfin, accablé de fleurs et de bénédictions, il arriva à son hôtel de la rue du Mirail. Les assistants y étaient si nombreux que le duc de Mouchy, pour parvenir jusqu’au héros de la fête, dut arborer à son chapeau les lettres-patentes qui l’accréditaient auprès du Parlement... Le pauvre homme ne s’expliquait pas ces transports frénétiques: Richelieu avait si fidèlement dépeint l’état des esprits qu’il s’attendait à une réception froide, sinon hostile.
Ce n’était que le début d’une série de réjouissances auxquelles se livra la population entière. Une joie indicible éclatait partout. On s’embrassait dans les rues, on dansait dans les carrefours, on chantait la chanson des Revenants, dont les [p. 402] rares amis de Richelieu, par mesure de précaution, croyaient devoir fredonner le refrain... C’étaient ceux-là mêmes qui, un an plus tôt, gouaillant les exilés, demandaient avec ironie: «Les chapons doivent être gras depuis le temps qu’on les tient en mue?»
Le soir, une musique exécuta, dans le jardin du premier président, des cantates suivies d’un Te Deum. A la même heure, la ville s’embrasait d’illuminations qui allaient se renouveler plusieurs jours, «quoique les jurats ne l’eussent point ordonné»: un élan général, que Mme Duplessy ne fut pas la dernière à suivre...
—Et moi aussi, s’écrie l’excellente femme, j’ai brûlé mes chandelles à la croisée!
En quoi, elle a quelque mérite; car ses deux gendres étant, l’un frère, l’autre cousin de conseillers restants, ses sympathies allaient de préférence à ces derniers[437].
Le lendemain, l’enthousiasme trouvait un aliment nouveau dans la reconstitution de l’ancien [p. 403] Parlement, où chacun devait reprendre sa place d’autrefois. «M. Le Berthon, rapporte Mme Duplessy, sortit précédé de tous les clercs du Palais, habillés proprement de noir et gantés de blanc. Ils se sont formés sur deux lignes à la tête de son carrosse, un brin de laurier à la main. Il a trouvé, de plus, huit étudiants en droit qui lui ont demandé la permission de l’escorter et se sont mis en marche, quatre de chaque côté des portières, l’épée nue d’une main et le brin de laurier de l’autre. Son passage a été également jonché de lauriers. Au marché, il a été arrêté par des femmes... L’une d’entre elles avoit fait un bouquet énorme et très beau, car on dit qu’il y avoit au moins pour cinquante écus de fleurs. Elle devoit haranguer à sa façon; mais, au premier mot, elle fut si interdite qu’elle demeura muette...—Donne, donne, dit une autre, je parlerai, moi!... Alors, s’avançant à la portière, qui fut ouverte, elle dit en gascon: Monseigneur, notre cœur l’a fait, permettez que nous le placions sur le vôtre!—Les cris de joie [p. 404] et les battements de mains l’applaudirent...» Puis, ce fut le tour des bouquetières de la place Sainte-Colombe qui s’ingénièrent à faire mieux encore. Une couronne, descendue d’un édifice élevé par leurs mains, vint s’abattre sur M. Le Berthon, qui faillit en être écrasé... Enfin, le carrosse arriva au Palais, aux acclamations de la foule, aux éclats du canon, aux fanfares des trompettes, que remplacèrent ensuite des symphonies de flûtes et de hautbois[438].
A conter tout par le menu, il faudrait un volume; ce serait excessif. Et pourtant il y a, dans cet ensemble d’incidents, de curieux détails de mœurs. Le spectacle des Revenants, confits dans leur triomphe et conservant sous globe le feuillage dont on les coiffa, ne manque pas de piquant. La meilleure part de ce succès prodigieux revenait à la franc-maçonnerie. Au bout d’un mois, elle entretenait encore la ville dans sa fièvre patriotique, au moyen d’une messe commémorative.
[p. 405] C’est l’église de Talence qu’on choisit pour cette solennité. Il est à peine besoin de dire qu’elle fut trop petite. Au cours du service, le prêtre qui officiait donna la Paix au grand-maître de l’ordre et à un autre dignitaire placé en face de lui. Au même instant, tous les Frères s’embrassèrent... On entonna ensuite un Te Deum, après lequel les affiliés, levant la main droite, crièrent à trois reprises: Vive le Roi! Vive l’honneur! Il ne fut pas exécuté de musique, mais des mélopées de plain-chant qu’accompagnèrent des religieux de divers ordres et plusieurs prêtres séculiers, également francs-maçons. Un festin généreux, que Dom Galéas honora de sa présence, termina cette fête.—«Un bon gueuleton,» proclame Mme Duplessy qui manque de tendresse pour les manifestants, est la fin nécessaire de ces sortes de cérémonies!
La satisfaction des avocats n’était pas moins vive. En effet, le premier soin du Parlement reconstitué avait été d’anéantir l’arrêt condamnant Me Polverel[439]. Aussi, la harangue prononcée par Me Garat fut-elle suivie de plusieurs autres [p. 406] qu’on débitait dans la rue comme, sous la Fronde, les Mazarinades. Une brochure, notamment, obtint un grand succès: c’était l’œuvre du stagiaire Cizos-Duplessis, un virtuose également doué pour la carrière dramatique et celle du Palais. A quinze ans, ce phénomène écrivait une tragédie avec du sang tiré de ses veines,—à défaut d’encre que lui refusait sa famille[440]; à vingt-deux, il faisait le panégyrique du Parlement en homme que la politique n’intimide pas. Son langage, sous un respect de parade, révèle le factieux. L’épigraphe, à elle seule, constitue une profession de foi. C’est un distique de l’Honnête Criminel:
Le coupe-gorge, dont parle le jeune maître, n’est autre que la cour des rois—«centre des révolutions et des infamies humaines, où la jalousie, la débauche et la fausse gloire déploient à l’envi leurs coupables excès...» L’écrivain s’est nourri de la moelle des philosophes; mais, au rebours de quelques-uns d’entre eux, son admiration est acquise aux robins chassés de leurs sièges. L’autre magistrature—celle de Maupeou—lui apparaît [p. 407] comme l’ombre de l’ancienne: peut-être a-t-elle aussi la haine des coupables; mais, n’étant point investie de la confiance publique, elle doit suivre le sort du régime détesté qui lui donna naissance[441].
Infortunés Restants! Aucun outrage ne leur fut épargné, si ce n’est que les décrotteurs bordelais n’allèrent pas, comme ceux de Toulouse, réclamer la licence de briser leurs fenêtres à coups de cailloux. En revanche, les sociétés musicales ne les ménagèrent point. Après les aubades aux Revenants, elles exécutaient devant leurs portes des charivaris accompagnés de Libera, de Requiem, de De Profundis. Lorsque les malheureux sortaient dans la rue, on les accablait de huées, de brocards, d’avanies... Jusqu’aux domestiques qui refusaient de rester chez eux, afin de n’être point exposés au mépris de leurs camarades!—Seul, M. Le Berthon se montrait bienveillant vis-à-vis de tous et n’avait pas une parole amère...
Déchu de la première présidence, M. de Gascq accepta gaillardement sa mésaventure.
—Reprenez votre place au grand banc, lui disaient ses amis.
[p. 408] —J’aimerais mieux, assurait-il, m’aller faire laquais en Suisse.
—Alors, demandez un dédommagement.
—Comment, répliquait-il, l’attendre d’ennemis grisés par le triomphe!... Supposez Quesnel investi de la feuille des bénéfices; croyez-vous qu’il eût fait un pont d’or aux disciples de Loyola?
Il n’en obtint pas moins une pension de dix mille livres, au grand scandale des «bons citoyens», et, dégagé de tous soucis, donna libre carrière à son goût pour la table... La vie sans les passions, disait-il après Diderot, m’apparaît comme un roi dépourvu de sujets[442].
Traités de Turc à More par la population, les Restants ne recevaient pas meilleur accueil de leurs collègues réintégrés. Ceux-ci, sous le coup d’une irritation qui couvait depuis quatre ans, leur tournaient résolument le dos. Non contents de donner gain de cause aux avocats, ils allaient jusqu’à refuser toutes poursuites contre les auteurs des charivaris. La scission fut si profonde, qu’on assurait que de deux perruques mises en contact—l’une d’un Revenant, l’autre d’un Maupeou—il se dégageait des étincelles électriques!
[p. 409] Il entrait dans le rôle de M. de Mouchy de prévenir ces velléités guerrières; mais le jugement n’était point le fait de ce grand capitaine. Étourdi par les bravos de la foule, il affecta de partager ses dédains à l’égard des malheureux qui avaient suivi la fortune de M. de Gascq.—Je ne vous connais pas, Messieurs, déclarait-il!... Et il ne cessait de leur infliger des humiliations, jusqu’à reprocher à l’un d’eux, dont les ancêtres s’étaient enrichis à la Rousselle, de sentir la morue[443].
Sa diplomatie était, d’ailleurs, aussi dépourvue d’entêtement que de malice. Quand on lui fit remarquer qu’il allait à l’encontre des désirs du roi, il n’hésita point à modifier sa ligne de conduite. Une idée illumina alors ce vaste cerveau: il manda à son hôtel les confesseurs des Revenants les plus intraitables et les pria d’user de leur influence pour rétablir la paix. Mme Duplessy se livre, à ce propos, à une hilarité que l’on s’explique... «Cherchez, dit-elle, dans certain manuscrit, un couplet qui commence de la sorte:
Les Noailles sont imbéciles...
Vous verrez que le sang transmet tout.»
[p. 410] Quelque ingénieuse que fût la combinaison, elle n’avait aucune chance d’aboutir. M. de Mouchy s’était trompé d’adresse. Seuls, les directeurs de conscience de ces dames eussent pu lui apporter un concours efficace. Et encore! L’exaltation des femmes dépassait de beaucoup celle de leurs seigneurs et maîtres... La scission était irrémédiable; elle ne prendra fin qu’avec la chute du Parlement[444]. M. de Mouchy, ballotté de l’un à l’autre, chansonné, tourné en ridicule, égara le peu de cervelle que la nature lui avait départi. Un jour vint où, ayant épuisé tous les moyens de conciliation, il jeta le manche après la cognée:
—Ma voix, écrivait-il à Versailles, s’est, comme celle du prophète, perdue dans le désert!
Cette campagne mémorable ne lui était pas moins comptée comme un titre de gloire; c’est à ce moment précis que la cour lui expédiait le bâton de maréchal... Sans le gouvernement, disait Chamfort, on ne rirait plus en France!
Fin de la société parlementaire.—Un mot des survivants de l’hôtel du Jardin-Public.—Le dernier exploit de Dom Galéas.—Réception du duc de Chartres par les loges maçonniques.—Formation d’une société nouvelle.—État des esprits.—Mort de Mme Duplessy.

Atteinte dans ses sources vives, la vieille société bordelaise—si fine, si polie, si riche en originaux de tous genres—était frappée à mort: elle ne se releva point...
En effet, aux divisions funestes fomentées par Richelieu se joignaient d’autres causes de décadence. Mme Duplessy n’avait point fait d’élèves. Elles-mêmes, Mmes de La Chabanne et Desnanots avaient disparu sans laisser de successeurs... Il manquait, à ce milieu de délicats, une main experte en l’art de grouper dans un accord commun des penseurs, des philosophes, des artistes, séparés par l’origine, l’éducation, les préjugés, les intérêts. L’absence des éléments nécessaires à un salon de quelque envergure commençait aussi à se faire sentir. Certes, les [p. 412] gens de mérite n’étaient point devenus rares; mais les esprits suivaient une orientation nouvelle, et ce ne sont ni les épigrammes du jeune de Marcellus, ni la verve indigeste d’Henri de Gaufreteau, ni le bagage pesamment édifié des savants que possédait encore l’Académie, qui pouvaient remplacer ce trio illustre: Montesquieu, Barbot et Jean-Jacques Bel... A cette fin du XVIIIe siècle, les premiers sujets, ainsi que le metteur en scène, faisaient également défaut.
En même temps, s’éteignaient les derniers survivants de l’hôtel du Jardin-Public...
Barbot disparut le premier. Il mourut[445], comme il avait vécu, dans un désordre indescriptible. Ayant abandonné ses livres à l’Académie, il s’était reconstitué une bibliothèque à l’aide d’emprunts. C’est le Père François qui se chargea de débrouiller ce chaos. Grâce à ses recherches, Mme Duplessy ne perdit qu’une trentaine de volumes. Le Révérend ne fut pas non plus à plaindre: il retrouva une sphère de Copernic, un niveau d’eau, un tuyau électrique, et le Traité des Sensations, de Condillac; mais il dut faire son deuil d’un Zabarella, d’un Pomponace et d’un Traité de la Baguette divinatoire, reliés à la [p. 413] marque de son couvent[446]... Pauvre Barbot! Que n’eût-on pas sacrifié pour conserver, quelques années encore, ce compagnon chéri des beaux jours d’autrefois[447]!
Puis, ce fut le tour de M. de Grissac, de M. de La Tresne, du président de Lalanne, «regretté de tous ceux qui avoient le bonheur de le connoître[448],» celui enfin du président Charles de Lavie... Bizarrerie du sort! Parvenu à cette heure où chacun «doit trousser ses bribes et plier bagaige», ce penseur plein de sagesse fut privé de sa raison et devint un tyran domestique. En revanche, donnant cours à ses sentiments de philanthropie, il distribuait à ses voisins pauvres des lambeaux de sa fortune: à celui-ci ses prairies d’Eysines, à celui-là ses vignes de Blanquefort, à cet autre ses pignadas des Landes...
Morte, également, Mme d’Aiguillon... La [p. 414] marquise du Deffant qui, jadis, prenait plaisir à la déchirer, reconnaissait, depuis longtemps, ses grandes qualités de cœur: «Hélas! hélas! s’écrie-t-elle, rien n’est si vrai que notre grosse duchesse mourut lundi dernier d’apoplexie en une demi-heure. Elle étoit à Ruel et dans un bain. C’est une très grande perte pour moi: il m’en reste bien peu à faire[449].» Les dernières pensées de Sœur du pot-au-feu furent pour cette terre de Guyenne à laquelle tant de souvenirs la rattachaient. L’ouvrage de Dom Devienne venait de paraître... Elle n’abordait personne sans demander: Avez-vous lu l’Histoire de Bordeaux?
Mme d’Egmont la suivit de près. Au moment de la disparition de la bonne duchesse, elle prenait à Spa «des bains de poumons». Au cours de ce traitement, la toux devint plus rude, la fièvre plus opiniâtre. Une pâleur livide imprima à son visage, d’une beauté si étrange, un caractère séraphique. Après un semblant de convalescence, elle expirait, le 14 octobre 1773, à l’âge de trente-trois ans, fidèle encore, assure-t-on, à l’amour chaste qui berça son enfance.
Seuls des habitués de l’origine, le Père François et Dom Galéas restent debout.
[p. 415] Le Père François touche au «seizième lustre» sans que l’âge ait rien enlevé de son humeur charmante et de son culte pour les fleurs. Vers la fin de l’hiver, un accès de goutte a failli lui être fatal...
—Je vous en aurais toujours voulu, gronde sa vieille amie, de partir sans prendre congé de moi.
—Madame, réplique-t-il en déposant à ses pieds une gerbe d’anémones, ne me croyez pas capable de cette inconvenance; je ne suis point un oublieux.
Dom Galéas, encore plus alerte, est, sur le tard, devenu un personnage d’importance. Hier, il prononçait, sous les auspices de l’Académie, le panégyrique de saint Louis; demain, il prêchera aux Jacobins. Entre temps, il tient boutique de poésie. Veut-on des odes, des épîtres, des chansons, au besoin des logogriphes? Il exécute sur commande et trouve encore moyen, à ses heures perdues, de produire des charades pour les Annonces-Affiches... Mondain? Il n’a pas cessé de l’être. On le reçoit à l’hôtel du Gouvernement où Mme de Mouchy le consulte pour ses bals de jeunes filles. On le rencontre aussi à la Grand’Chambre, chaperonnant des bataillons de dames attirées par les causes «chafriolantes». Il n’y a guère que le théâtre où ne se faufile pas sa [p. 416] prestigieuse personne; mais certaines gens prétendent—oh! la calomnie!—qu’il a de l’accès auprès des comédiennes[450]... Gardez-vous de le croire. Ce cœur de moine est d’une immatérialité qui confine à celle des archanges. Comme l’abbé Sabathier[451], accusé également de bonnes fortunes, il peut répondre victorieusement:
Dom Galéas passait à l’état de demi-dieu quand une déconvenue vint se mêler à ses triomphes. En avril 1776, les Loges maçonniques des Chartrons, l’Amitié et la Française réunies, offraient un banquet à un haut dignitaire, Son Altesse Monseigneur le duc de Chartres[452]. Comme toujours, les affiliés bordelais avaient royalement fait les choses: les fauteuils d’honneur, occupés par le duc et la duchesse, étaient placés au centre de cinq tables de dames en toilettes d’apparat. Après les crus célèbres du Médoc, on sablait le [p. 417] champagne, quand surgit, sous le feu éclatant des lustres, une ombre en forme de spectre. L’ombre avança à pas comptés, frôlant au passage le satin des épaules et la poudre des chevelures, s’arrêta en face du prince, salua d’une inclinaison olympienne et se campa de la façon avantageuse qui sied à une ombre consciente de sa valeur...
A ce spectacle inattendu, il se fit un silence mêlé d’angoisse. Sur quoi, fier de son effet, Dom Galéas—car c’était lui—tira de sa poche quelques douzaines d’alexandrins et commença à lire, en agitant ses bras gigantesques... A la première strophe, les invités royaux se regardèrent. A la seconde, ils s’appliquèrent un mouchoir sur la bouche. A la troisième, ils éclatèrent, entraînant avec eux l’unanimité des assistants... Force fut bien à l’orateur de se rendre à l’évidence: sa muse demeurait incomprise. Il coupa court, ébaucha une révérence qui accrut l’hilarité générale, et, digne sous l’affront, se retira sans perdre une ligne de sa taille.—Tel fut le dernier exploit du plus fécond des Bénédictins[453].
Pendant que la franc-maçonnerie s’agite, en habits de gala, Mme Duplessy, accoudée à sa fenêtre, [p. 418] continue à voir défiler les gens: un emploi dont l’intérêt ne fait que s’accroître... Mais que de mélancolie au fond de son regard, et aussi que de surprise! Des modifications si profondes se sont produites, en l’espace de quelques années, au sein de la cité qui lui est chère!
Tandis qu’aigries et endettées les familles parlementaires se tiennent à l’écart, cherchant, sous le couvert de bouderies irréductibles, à réparer les brèches de leur patrimoine[454], un élément de formation récente, riche, élégant, jaloux de briller et ne regardant point à la dépense, opère, à travers les débris de la société ancienne, une trouée victorieuse.
Il se compose d’une fraction du haut négoce—non le négoce patient, économe, patriarcal, qui fit l’honneur de la Rousselle; mais celui de l’armement, où parfois l’esprit d’aventure supplée au labeur quotidien, et que de téméraires navigations enrichissent ou ruinent en l’espace de quelques mois.
[p. 419] Le premier, par ses tendances, ses goûts et de longues traditions de vertus domestiques, se rapproche de la robe qui, le plus souvent, tire de lui son origine et sa fortune. Le second vise plus haut: c’est la noblesse d’épée qu’il s’est offerte pour modèle. Richelieu, à vrai dire, l’aida de tout son pouvoir, heureux d’opposer à l’aristocratie parlementaire la puissance déjà irrésistible de l’argent[455]. Grâce à ses incitations malsaines, ces marchands affinés figurent proprement—sans titres ni blason—des manières de grand seigneur, menant un train de princes, installés dans des demeures superbes, aimant le luxe, favorisant les arts, semant l’or avec d’autant plus de désinvolture qu’il leur coûte moins à gagner; mais, en même temps, protecteurs de la galanterie vénale, habitués des soupers équivoques, fervents adeptes de la masse aux dés: à ce point que, pour mettre fin à leurs parties furieuses, M. de Clugny, le nouvel intendant, devra faire démolir la salle de jeu où ils s’éternisent malgré lui[456].
[p. 420] Ces mœurs relâchées, imitées de Versailles, ne sont point pour inspirer le respect. Le peuple se transforme en juge d’autant plus rigoureux que les doctrines égalitaires lui ouvrent un nouvel horizon. Les gentilshommes perdent chaque jour de leur prestige, tandis que le clergé cesse de paraître infaillible. Au besoin, on s’insurge contre lui... Pour la procession du Jubilé, le curé de Sainte-Eulalie veut faire revivre les anciennes classifications: les pauvres en tête, puis la plèbe, la bourgeoisie, et, près des officiants—à la place d’honneur—les gens de qualité. Grand tumulte à cette nouvelle. On crie, de toutes parts, que Dieu ne distingue pas... Et voilà artisans et artisanes qui, cherchant noise aux coiffures haut montées des dames, se mettent en mesure d’écraser «toutes ces grecques»: il ne faut rien moins que l’intervention [p. 421] des troupes pour sauver les perruques aristocratiques[457].
De la noblesse et de ceux qui la copient, la désaffection s’étend à la personne du roi, sinon à la royauté elle-même. Au lendemain de la rentrée triomphale du Parlement, se célèbrent les fêtes du sacre—jadis une occasion de réjouissances publiques. Malgré le mot d’ordre, Bordeaux ne témoigne que de l’indifférence. Quelques «petits fagots» brûlés devant l’Hôtel de Ville, avec les salves réglementaires et une rangée de lampions alignés par la Jurade: là se borne le tribut officiel de la Guyenne. Les particuliers se mettent encore moins en frais. En dehors des juifs et de certains négociants, personne ne bouge. Sans l’appoint des francs-maçons qui organisèrent, aux Carmes, un service fort goûté, tout se serait «passé bien pauvrement»[458].
Les campagnes n’échappent pas à la contagion. Ce n’est que par un reste d’habitude qu’elles pratiquent encore l’obéissance. La crise de 1773 est féconde en révélations sur le travail qui s’opère dans leur sein. Maintenues par la force, elles se résignent—jusqu’à l’heure de l’explosion. En attendant, le sentiment qui les domine est celui [p. 422] de la défiance: une défiance résolue, persistante, invincible... Vienne le jour où l’on substituera un impôt presque bénin au scandale des corvées, le paysan se soulèvera, convaincu que la réforme n’est qu’un leurre et que les corvées reparaîtront, avec leur cortège d’abus, dès que l’impôt destiné à en tenir lieu sera lui-même acclimaté... Faut-il le dire? Le paysan n’est pas seul à penser de la sorte: la bourgeoisie et le Parlement éprouvent les mêmes inquiétudes... Les tours de passe-passe de Terray datent d’hier, et chacun sait que les Calonne suivent de près les Necker et les Turgot!
Pendant que l’État court à sa perte, Bordeaux se divertit. Les modes vont leur train, remplaçant les panaches enrubannés au désespoir d’Éole par les chapeaux corvette bonne brise. Le tripot du duc de Duras, qui se moque de la police et des règlements, ajoute un nouveau jeu—le loto!—à la liste déjà longue de ceux à l’aide desquels il dépouille les gens. Bardineau, chez qui le beau monde afflue, inaugure des séries de fêtes durant lesquelles, au fond de chambres reculées, on fait aussi danser l’or et l’argent. M. de Mouchy multiplie les glaces pour y mirer ses insignes de maréchal de France et son manteau ducal si ample «qu’il en a la charge d’un mulet». Madame l’Étiquette, enfin, passe ses nuits à [p. 423] élucider la grave question de savoir si présidentes et conseillères peuvent être admises à l’honneur de saluer les princesses du sang[459].
Mme Duplessy avait plus de clairvoyance. Elle estimait, avec bien d’autres, que si Dieu n’y mettait ordre, on finirait par la culbute. Les débuts du règne de Louis XVI calmèrent un peu ses craintes. Comme tout son entourage, elle applaudit à l’expulsion de l’ancien personnel, fit crédit aux bonnes intentions du jeune prince, marqua un vif enthousiasme pour l’œuvre de Turgot dont, au prix de mille efforts, elle se procura l’image[460]... Ce ne furent, hélas! que des espérances sans lendemain, après lesquelles les mieux disposés cédèrent au découragement. Chez elle, une pointe d’amertume se mêle à la déception quand elle relève les réformes non accomplies, les taxes maintenues, les pensions persistantes en dépit de la détresse publique. Le roi, dit-elle, a signé une déclaration par laquelle il paraît qu’il veut s’occuper du bonheur de ses peuples!... Elle ajoute, non sans ironie: Croyez-vous que les impôts en diminueront?
[p. 424] Bientôt, avec le détachement empreint de fatalisme qui fut la grâce d’état de cette génération consciente d’un danger imminent, mais impuissante à le prévenir, elle revient, en badinant, à sa chronique quotidienne. Quoique affaiblie et réduite au lait de chèvre relevé de deux doigts d’alicante, elle a encore l’œil bon, la plume agile, parfois même la dent mordante...
A l’en croire, les Mouchy ont pour leur bourse des tendresses d’Harpagon. Marraine d’un navire, la grande prêtresse du cérémonial se laisse couvrir de fleurs sans offrir un denier aux matelots de l’équipage... En pareille circonstance, s’écrie la narratrice, Mme d’Egmont avait vidé ses poches et emprunté dix louis à M. d’Estissac!
Le théâtre, fort mal en point depuis le départ de l’impresario en titre, l’intéresse toujours[461]. On y fait maintenant, avec un chanteur célèbre, auquel on donne cinq cents francs par représentation, de la musique dans le goût étranger... Adieu, soupire l’excellente femme, la musique nationale si bien assortie à notre langue et à notre caractère: on l’anéantit, sera-t-elle jamais remplacée?... Mais [p. 425] voilà qu’un jour on reprend la classique tragédie. La tentation est trop forte: Mme Duplessy n’y résiste pas... Vite, sa robe de taffetas d’Espagne, son point du jour à gros grains, sa guipure à la modestie, et elle court au spectacle: «Si quelqu’un, écrit-elle, vous dit m’avoir vue à la Comédie et veut parier, ne pariez pas, car j’y fus samedi. Il y a là une excellente actrice, nommée Mlle Sainval, que votre sœur avoit envie de voir; mais, ne pouvant y aller seule de femme, elle me proposa de l’accompagner... On donnoit Didon. Vous pouvez vous rappeler que nous l’avons vu jouer à Mlle Clairon; mais je crois que celle-ci rend ses rôles plus intéressants et que ses mouvements sont plus vrais et plus expressifs...»
Ce fut sa dernière débauche. Pourtant elle vivait encore à l’ouverture de la nouvelle salle, que l’on inaugura par une représentation d’Athalie. Fidèle à son amour des lettres, Mme Duplessy occupa cette soirée à relire, au fond de sa bergère, le chef-d’œuvre de Racine. Vainement le corps s’affaiblissait, l’esprit demeurait intact. Quant à sa philosophie, elle restait également la même, insensible aux petitesses du monde, et—quoique désabusée—bienveillante, sereine, s’ingéniant à n’attrister personne...
[p. 426] Après une existence aussi laborieuse, l’heure du repos allait enfin sonner pour elle.
Sa dernière lettre, d’une écriture un peu tremblée, est datée du 5 novembre 1782: elle expira le 13, emportant dans la tombe, avec les secrets d’un passé glorieux, l’âme d’une génération demeurée sans rivale[462].
Ainsi achevait sa carrière, rue du Cahernan, chez le procureur Aumailhey, celle qui, tour à tour Bérénice de l’Académie des Arcades et Uranie du poème de Lagrange, occupa une si grande place au sein de la cité bordelaise. Jusqu’à la fin du siècle, son souvenir fut pieusement gardé. Il s’effaça ensuite dans le tourbillon révolutionnaire, à peine défendu contre l’oubli par quelques lignes de Montesquieu, des notes éparses dans la poussière et un nom—mal orthographié—sur la plaque d’une rue[463]...
A Mme Duplessy, à ses hôtes, au milieu dans lequel ils vécurent, au mouvement littéraire, [p. 427] politique et social qui s’accomplit autour d’eux, il manquait «un témoin pour leur donner vie et mémoire»... Puisse cette étude tenir lieu des registres et rooles sans lesquels, au dire de notre vieux Montaigne, «les fortunes de plus de la moitié du monde s’esvanouissent sans durée!»

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
[1] Voir, sur Louis Machon, sa vie et ses œuvres, les travaux de M. Raymond Céleste.
[2] Publication des Bibliophiles de Guyenne, II: Étude de M. Reinhold Dezeimeris.
[3] Ce fut, suivant toutes vraisemblances, l’origine de l’Académie fondée en 1712.
[5] Les Précieuses ridicules, scène V.
[6] Chronique de Charles IX, par Prosper Mérimée.
[7] Montauron, à qui Tallemant des Réaux a consacré une de ses plus piquantes historiettes, avait reçu le surnom d’Éminence gasconne. Il joua un rôle considérable en Guyenne à l’occasion des poursuites, pour fabrication de fausse monnaie, dirigées de 1638 à 1644 contre un grand nombre de gentilshommes et trois parlementaires.
[8] Lettres persanes: XCIXe lettre.
[9] «L’an 1724 et le 16e du mois de juin, après la célébration des fiançailles, faites le 3e de ce mois entre messire Claude Duplessy-Michel, conseiller au Parlement de Bordeaux, fils de feu messire Pierre Duplessy-Michel, conseiller audit Parlement, et de dame Jeanne Giron, de la paroisse de Saint-Projet, d’une part;
»Et demoiselle Jeanne-Marie-Françoise Chazot, fille de messire Claude Chazot, écuyer, sieur d’Albuzy, gentilhomme de la grande vénerie et receveur général des fermes de la province de Guienne, et dame Élisabeth François, de cette paroisse, d’autre part;
»Après la publication d’un ban fait dans ces deux paroisses, sans opposition ni empêchement, la dispense des deux autres accordée par MM. les vicaires généraux, en date de ce jour, et les autres formalités prescrites exactement observées, je soussigné, prêtre, ay reçu leur mutuel consentement et leur ay imparti la bénédiction nuptiale du consentement de M. le curé de Saint-Rémy, en présence des soussignés qui, informés des peines portées par les déclarations du Roy contre ceux qui attestent faux sur les faits de mariage, ont déclaré connaître les époux pour être anciens catholiques, libres à contracter mariage, et habitants des dites paroisses.» Suivent les signatures.—Extrait des registres de mariage de l’église Saint-Rémy.
[10] En 1692. Il portait également le prénom de Pierre.
[11] Voici quel était, en 1715, le personnel du premier président: un secrétaire, un maître d’hôtel, une demoiselle suivante, un sommelier, deux valets de chambre, un cuisinier, un garçon de cuisine, un portier, deux cochers, deux servantes, un postillon, six laquais. L’état des autres présidents ne différait pas sensiblement de celui-ci.—Archives départementales, C. 2697.
[12] Chronique de Gaufreteau, I, p. 291.
[13] M. Duplessy s’en rendit acquéreur, le 15 septembre 1707, de M. le marquis de La Tresne. Plus tard, elle passa entre les mains d’un sieur Bergeret qui la revendit en détail.
[14] Parfois même il la prenait avec une véhémence qui n’était pas du goût de ses confrères. Les Registres secrets du Parlement (Bibliothèque municipale, 369 bis, fo 215) le représentent, à la date du 21 décembre 1740, «assis au bas-bout du bureau,» et censuré pour quelques écarts de langage.
[15] L’original appartient à M. Fauraytier qui, avec beaucoup de bonne grâce, en a autorisé la reproduction.
[16] Mémoires du président Hénault. Dentu, 1855, p. 102.
[17] «Elle renferme les lithophytes, éventails, madrépores, coraux, coralloïdes, mousses marines, éponges, fossiles de différents lieux, marbres, pierres de Florence, géodes, congellations, etc... Le coquillier est placé vis-à-vis de la cheminée. C’est une armoire de six pieds de haut, compartie en tiroirs divisés en des cartons peints en jaune, où reposent les coquilles, parmi lesquelles on remarque de beaux nautillés papiracés, des limaçons de toute espèce, le fuseau, la tiare, la mitre, les spectres, les draps d’or, les porphyres, les araignées, la musique, le bois veiné, des casques de différentes formes, des bécasses épineuses, l’Argus, la carte géographique, la mère-perle exacte dans ses deux vulves, la feuille, la pelure d’oignon, la crête de coq, quelques épineuses, l’écritoire chinoise, la vieille ridée, la concha Veneris, la moule de Magellan, l’arche de Noé, la Thuillière, le chou et le bucardium spinosum, le manteau ducal, les oursins de la mer Rouge, etc.» (Conchyliologie, de Dézallier d’Argenville, édition de 1757, I, p. 138.)
[18] Alors le Jardin-Royal.
[19] Ce réservoir se trouvait sur l’emplacement de la rue qui porte ce nom.
[20] La ceinture frangée d’or que, dans son portrait, Mme Duplessy porte autour de la taille, était la marque distinctive des membres de l’académie des Arcades.
[21] Elle eut pour maître le sieur Giraud, organiste d’abord à Saint-Seurin, et plus tard à Saint-André.
[22] Archives municipales: lettre du président de Lalanne.
[23] L’élevage de ces animaux était-il passé, dans certains couvents, à l’état d’habitude? On serait tenté de le croire, si l’on en juge par de nombreuses indications. On verra plus loin que le supérieur des Bénédictins fournissait de chiens courants le président de Lalanne. (Archives municipales: Lettres missives.)
[24] Œuvres de Segrais. Édition de 1755, II, p. 78.
[25] Histoire de Bordeaux, par Camille Jullian, p. 506.
[26] La première assemblée eut lieu le 19 février 1739.
[27] L’ouvrage porte le titre de Dictionnaire néologique. On en attribua la paternité à l’abbé Desfontaines; à tort sûrement, car M. de Lamontaigne et Bernadau déclarent que Jean-Jacques Bel en est l’auteur.
[28] Ce procès eut à Bordeaux, comme dans tout le royaume, un grand retentissement. Il y est fait de piquantes allusions dans une satire manuscrite intitulée: La Gamme de la Société ou les Cent une turlurettes, chantée sur la rivière de Garonne, etc. (Bibliothèque de la Ville, 713, 43, p. 591 et suiv.)
[29] La Comédie satirique au XVIIIe siècle, par Desnoiseterre, p. 50. Voir aussi le Journal de Mathieu Marais, IV, p. 282.
[30] Il fut le bibliothécaire de l’Académie, qui l’admit dans son sein le 17 mars 1739.
[31] Le 10 novembre 1757, il adressait de Brantôme le billet suivant: «Ici, la perspective est jolie de toutes parts, l’on est très philosophe, la compagnie assez bonne, et, si l’on veut promener, il y a force monde à voir. On y mange en repos sa perdrix et son chapon. On rit, on se réjouit, avec un quadrille de cinq sols et un brelan de six, comme à un gros va-le-tout. On s’y chauffe bien, on peut s’y procurer des livres, et l’esprit n’y manque pas. J’y ai même trouvé un fort beau télescope de deux pieds, mais un mauvais horizon et mes maux de tête ne m’ont point permis de suivre la comète.» (Papiers de l’Académie, no 828, 20, fo 65.)
[32] Ce chaos réservait des surprises agréables, car Barbot ne reculait pas devant les sacrifices pour se procurer des ouvrages de prix. Il parle, dans une lettre, d’un volume qui lui coûta 460 livres. (Catalogue des manuscrits de l’Académie, p. 341.)
[33] Les archives de l’Académie renferment quelques lettres dans cet ordre d’idées. Elles sont piquantes, mais d’une reproduction difficile.
[34] La Cour des Aides réclamait le droit de statuer elle-même sur le sort de ses officiers, en matière criminelle, et de soumettre au Grand Conseil leurs litiges civils. La question valait la peine d’un débat; mais des futilités poussaient parfois les deux Compagnies à entrer en lutte. C’est ce qui arriva en 1723. Les présidents à mortier ayant contracté l’habitude de s’agenouiller, à l’église, sur des carreaux de velours, Messieurs de la Cour des Aides émirent la prétention d’avoir des carreaux pareils; c’est Montesquieu, alors à Paris, qui fut chargé de soutenir les droits de ses collègues du palais de l’Ombrière. (Archives départementales. C. 3622.)
[35] Discours prononcé à la Saint-Yves de 1758.—Ce document figure dans les papiers inédits de MM. de Lamothe, auxquels nous ferons de fréquents emprunts. Nous en devons la communication à la courtoisie de M. Pierre Meller qui, avec sa rare compétence, a su en mettre en lumière le haut intérêt.
[36] Les Registres secrets du Parlement font connaître que, pour suivre cette affaire, Jean-Jacques Bel passa vingt-six mois à Paris. La Cour des Aides envoya également un député qui, suivant toutes vraisemblances, devait être Barbot. Une déclaration royale du 1er septembre 1734 régla enfin le litige.—Jean-Jacques Bel était le mandataire habituel du Parlement, car on le retrouve à Paris, en 1738, soutenant ses intérêts dans un conflit avec la Jurade. Il logeait alors rue du Gros-Chenet, en y entrant du côté de la rue de Cléry. Le président Le Berthon, qui entretenait avec lui une correspondance régulière, lui écrit à la date du 12 juillet 1738: «Vous ne me dites rien de votre santé. Ainsy, je la croy telle que je la désire. Ménagez-la, Monsieur, pour vous, pour le public et pour vos amis.» (Bibliothèque de la Ville: Collection Delpit.)
[37] La maison de Lalanne était originaire de Saint-Justin, «lieu assez incognu des Lannes». L’un de ses membres fut nommé, par Henri IV, garde des sceaux de France: il mourut avant d’avoir pris possession de son poste. Au dix-septième siècle, cette famille possédait, par elle-même ou par ses alliés, de nombreuses terres en Guyenne: la vicomté de Pommiers, le marquisat d’Uzeste, les baronnies de Roaillan, de Villandraut, de Roquetaillade, etc. L’ami de Mme Duplessy était Jean-Baptiste de Lalanne, marquis d’Uzeste, baron de Roaillan, seigneur de Tustal et autres lieux.
[38] On l’avait surnommé le Visionnaire.
[39] Archives municipales: Lettres missives.
[40] Tous les ans, rapporte M. Raymond Céleste, il expédiait au maréchal de Richelieu un pâté de quatre perdrix rouges sortant, non plus de ses fourneaux, mais de l’officine du plus habile praticien de Périgueux, Villereynier de la Gâtine. (Voyage du maréchal de Richelieu à Bayonne, par Raymond Céleste, p. CXV.)
[41] Antoine de Gascq, l’un des fondateurs de l’Académie et son premier directeur.
[42] Jean-Baptiste de Caupos, vicomte de Biscarosse et de Castillon, baron de Lacanau.—Voir la Biographie de Feret.
[43] Rue du Puits-Baigne-Cap. Laboubée rapporte que c’est chez lui que se tinrent les conférences qui précédèrent la création de l’Académie.
[44] Jean-Baptiste Le Comte, chevalier, marquis de La Tresne. Il comptait parmi ses ancêtres une femme de grand esprit qui, lors du passage de Louis XIV en Guyenne, fit la conquête du duc de Bourgogne. Ce prince ayant dit à Mme de La Tresne qu’il se plaisait tant à Bordeaux qu’il ne partirait pas tant qu’il pleuvrait, cette dame composa des vers que le comte d’Ayen mit en musique et que tout le monde chantait. (Voyage du duc de Richelieu à Bayonne, par Raymond Céleste, p. XXIX.)
[45] M. de Raoul a laissé deux manuscrits d’un rare intérêt: 1o un sottisier contenant quelques pièces émanant de plumes bordelaises; 2o une revue, sous forme de dictionnaire, des personnages de marque ayant vécu à la fin du XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe. Ils appartiennent à M. Édouard Feret qui, avec beaucoup de complaisance, les a mis à notre disposition.
[46] Sottisier de Raoul.
[47] Mémoires de Saint-Simon, année 1704, chap. X.
[48] Confessions de J.-J. Rousseau, livre IX, 2e partie, année 1756.
[49] Correspondance de Voltaire, édition Beuchot, vol. LI, p. 467.
[50] Il existe, au château de La Brède, dans la chambre du président, un portrait de la duchesse d’Aiguillon.
[51] Jusqu’à la Révolution, les Annonces-Affiches contiennent, dans chaque numéro, des offres et des demandes de cette nature.
[52] Montesquieu avait un accent formidable. Il disait: «C’est grand dommagé: qué dé génie dans cette têté-là!» D’Argenson assure qu’il trouvait au-dessous de lui de rien changer à sa prononciation. (Loisirs d’un ministre. Liège, 1777, II, p. 63.)
[53] C’étaient les professeurs du temps. M. de Raoul fait d’eux un portrait assez piquant: Pierre Tanesse, déclare-t-il, connaissait par cœur le texte de toutes les lois, mais ne savait point les appliquer. Son fils, Étienne, appelé en 1704 aux honneurs de la Jurade, brillait surtout comme buveur. Quant à Jacques Albessard, tour à tour greffier au Sénéchal de Fronsac, précepteur chez un cordonnier de la rue Sainte-Catherine, puis avocat et docteur, il n’avait pas trouvé le secret de plaire à ses confrères du Barreau qui s’égayaient parfois à ses dépens. L’un d’eux composa sur lui une pièce de vers qui débutait de la façon suivante:
[54] Montesquieu, à cette époque, monta sa maison qui se composait d’un valet, d’une femme de chambre, d’un cuisinier, de quatre laquais et de deux servantes. (Archives départementales, C. 2748.)
[55] Journal de Mathieu Marais, édition Lescure, III, p. 313.
[56] La même mésaventure, pour une cause identique, était arrivée à Corneille. On lui préféra le président de Salomon-Virelade, un Gascon de mérite, aux dépens duquel Tallemant des Réaux prend plaisir à aiguiser sa verve. Corneille, comme Montesquieu, ne tarda pas à obtenir réparation.
[57] Le Parlement tenait, chaque jour, deux audiences, l’une de grand matin, l’autre l’après-dîner. Montesquieu prétendit que les présidents n’étaient pas obligés d’assister à cette seconde audience, même quand leur présence devenait nécessaire pour compléter la Cour. Ce fut la cause d’un conflit entre les magistrats de ce grade et les simples conseillers qui finirent par avoir gain de cause. (Histoire du Parlement, par Boscheron des Portes, II, p. 248.)
[58] Le 8 juillet 1726, à M. d’Albessard, moyennant 130,000 livres.
[59] Revue des Autographes, publiée par M. Eugène Charavay, numéro de mars 1896, p. 19.
[60] Notamment d’Alembert et Voltaire.
[61] Lettres de Mme de Graffigny, édition Asse, p. 123 et 126.—Lettres de Mme du Châtelet, édition Asse, p. 24.
[62] Œuvres de Montesquieu, édition Laboulaye, III, p. XIII.
[63] Jean-Baptiste Gauthier, auteur des Lettres persanes convaincues d’impiété.
[64] Confessions de J.-J. Rousseau, chapitre II, livre IX, année 1756.
[65] «Il chérit toujours ses tenanciers et, je le lui ai ouï dire quelquefois, une de ses jouissances les plus pures étoit de les revoir. On le devinoit aisément à l’air de satisfaction qui se peignoit sur son visage chaque fois qu’il revenoit de Paris.» (Baurein, Variétés bordeloises.)
[66] «J’achèverai de l’ensevelir!» disait-il, faisant allusion à un ouvrage, attribué à Voltaire, qui parut sous ce titre: Le Tombeau de la Sorbonne.
[67] Confessions, 2e partie, livre IX, année 1756.
[68] Mélanges inédits de Montesquieu, p. 249.—Voir également les notes de MM. Barckhausen et Dezeimeris, p. 275 et 276.
[69] Il n’est pas jusqu’au sensible Helvétius qui ne versât dans le travers féodal. Une publication récente assure que, pour un lièvre pris au collet, il n’épargnait aucune rigueur à ses vassaux. Diderot usait, à cet égard, d’euphémismes délicats: «Ce bon Helvétius, écrit-il, a des ennuis sur sa terre: il se querelle avec ses paysans pour la chasse.» (Mémoires d’une inconnue, p. 53.)—Il serait facile de multiplier les exemples.
[70] Le mariage de Montesquieu avec Mlle de Lartigue eut lieu le 30 août 1715. M. de Raoul rapporte cette particularité—inédite, croyons-nous—qu’il venait de rompre des projets d’union avec la fille d’un sieur Denis, lequel faisait, à Bordeaux, le commerce des vins.
[71] De 1725 à 1754, le président occupa, chez son frère, un appartement dépendant du doyenné de Saint-Seurin. Auparavant, il avait demeuré rue Margaux; en dernier lieu, il logea rue Porte-Dijeaux. (Note de M. Raymond Céleste dans Deux Opuscules de Montesquieu, p. 70.)
[72] Le doyenné de Saint-Seurin, aujourd’hui allées Damour, no 31.
[73] Lettre à Mme du Deffant, du 28 janvier 1754.
[74] Œuvres de Montesquieu, pensées diverses.
[75] Œuvres de Montesquieu, édition Laboulaye, VII, p. 405, note de Guasco.
[76] Lettres persanes, LXXIVe lettre.
[77] Un contemporain, appartenant aussi à la robe, a dressé d’un fâcheux de sa connaissance, un croquis que l’on croirait calqué sur ce passage des Lettres persanes. Le fâcheux en question prend du tabac d’un air d’importance, se mouche complaisamment, crache en parabole, profère avec dédain des paroles qu’il affecte de traîner... C’est, non point un grand seigneur, mais un abbé de mauvais ton étalant ses grâces dans une ville de province.
[78] L’abbaye de Clairac dépendait du chapitre de Saint-Jean-de-Latran qui, en 1729, en confia la direction à Venuti. Celui-ci se fixa plus tard à Bordeaux et remplaça le président Barbot en qualité de secrétaire de l’Académie.
[79] Œuvres de Montesquieu, édition Laboulaye, VII, p. 384.
[80] François de Lamontaigne, conseiller au Parlement.
[81] Lettre de Montesquieu à Mme de Pontac, de 1745.
[82] Elle le présentait au président de Lalanne dans les termes suivants: «Dès que vous connaîtrez l’abbé de Guasco, il n’aura plus besoin de protection auprès de vous. Ce n’est donc que pour le premier moment que je lui offre la mienne, je souhaite qu’elle soit aussi bonne qu’elle doit être, si vous avez égard aux sentiments avec lesquels j’ay l’honneur d’être votre très humble et obéissante servante.» (Archives municipales: Lettres missives.)—Guasco logea d’abord chez Mme de Pontac.
[83] Joseph-Gaspard-Gilbert Rochon de Chabannes, évêque et comte d’Agen; il fit partie de l’Académie de Bordeaux.
[84] Sottisier du président Barbot, p. 735.
[85] Éloge de Montesquieu, par Marat.
[86] Ces détails et ceux qui suivent sont empruntés aux publications récentes de la famille de Montesquieu.
[87] Voyages de Montesquieu, p. 171, et lettre du 26 décembre 1728.
[88] Lettres de Guy Patin, édition de 1725, I, p. 76.
[89] Chronique de Gaufreteau, II, p. 25.
[90] Archives départementales, C. 3295. Voir aussi Port-Royal, de Sainte-Beuve, 4e édition, III, p. 212.
[91] Archives départementales, C. 3772.
[92] Causeries du lundi, de Sainte-Beuve, VII, p. 59.
[93] On sait qu’il fut longtemps menacé de l’opération de la cataracte.
[94] Montaigne, d’après Pline et Platon, le déclarait salutaire «à l’estomach et aux joinctures».
[95] Sans doute Mlle de Clermont.
[96] Il écrira de même à la duchesse d’Aiguillon: «Je vous apporterai les chapitres et vous les corrigerez, et vous me direz: je n’aime pas cela. Et vous ajouterez: il falloit dire ainsi.»
[97] Il ne put se rendre à l’invitation.
[98] Le Sottisier de M. de Raoul en contient deux ayant pour titre, l’une La Grille de fer, l’autre La Querelle des médecins et des chirurgiens. L’auteur y met en scène des Bordelais bien connus.
[99] Dès 1745, un groupe de jeunes gens se réunissaient dans ce but. MM. de Lamothe, Darche, de Lamontaigne, Maignol, Pelet d’Anglade, Saint-Savin, l’abbé Malromé en faisaient partie. (Papiers inédits de MM. de Lamothe.)
[100] A cette époque, le Mercure de France comptait à Bordeaux soixante et un abonnés.
[101] Daçarq est l’auteur d’une Grammaire française philosophique et d’une Balance philosophique. Il alla se fixer à Paris et y publia un recueil sous ce titre: Mon portefeuille hebdomadaire. Il faisait partie des académies d’Arras et de La Rochelle, et entretenait avec M. de Lamontaigne une correspondance suivie. A Bordeaux, il s’était signalé par des conférences sur l’histoire sacrée.
[102] Mercure de France, numéros de janvier et mars 1756.
[103] Sottisier du président Barbot.
[104] Lagrange-Chancel avait fait ses études à Bordeaux. Parlant d’un voyage effectué dans cette ville en 1746, il s’exprime de la sorte:
[105] Sottisier du président Barbot.—Les brevets de la calotte n’épargnaient pas davantage les membres du clergé, même ceux qui portaient la mitre et appartenaient à l’Académie française. Monseigneur Mongin, évêque de Bazas, en fit la cruelle expérience. Après avoir exalté, sur le mode ironique, ses mérites littéraires, le Grand-Maître de la Calotte lui faisait hommage de
[106] On ne possède aucun renseignement sur lui.
[107] Allusion aux attributions financières de la Cour des Aides, dont le président Barbot faisait partie.
[108] Jean-Jacques Bel.
[109] Le chevalier de Vivens «fut le fondateur et l’inspirateur du petit cénacle de savants bordelais qui se réunissaient souvent dans son château de Clairac», le baron de Secondat, le docteur Raulin, les frères Dutilh, M. de Romas, etc. (Biographie de Feret.)
[110] Discours de Montesquieu à sa réception à l’Académie.
[111] Ces vers, avec le texte italien, ont été publiés dans le Mercure de France du mois de février 1745, sous signature de Lefranc de Pompignan. C’est donc à tort que dans ses éditions des œuvres de Montesquieu (VII, p. 274), M. Laboulaye les attribue au duc de Nivernois.
[112] C’est cette union qui a perpétué le nom de Montesquieu.
[113] Journal de Collé, I, p. 57.—Tel était aussi le jugement de d’Argenson. «Je crains, disait-il, que l’ensemble ne manque et qu’il n’y ait plus de chapitres agréables à lire, plus d’idées ingénieuses et séduisantes que de véritables et utiles instructions sur la façon de rédiger et d’entendre les lois.» (Loisirs d’un ministre, Liège, 1787.)
[114] «Le genre humain avoit perdu ses titres: Montesquieu les a trouvés et les lui a rendus.»
[115] En moins de deux ans, il y en eut vingt-deux.—Montesquieu ne se faisait pas d’illusions sur les sentiments de Voltaire à son égard. «Quant à Voltaire, écrivait-il, il a trop d’esprit pour m’entendre. Tous les livres qu’il lit, il les fait; après quoi il approuve ou critique ce qu’il a fait.» (Lettre à Guasco, du 8 août 1752.)
[116] La condamnation fut prononcée le 3 mars 1752.
[117] Mme de Tencin fit réimprimer secrètement l’Esprit des lois, forçant chacun de ses amis à verser entre ses mains une somme de vingt-quatre livres, montant de la souscription. Elle prit elle-même de nombreux exemplaires qu’elle distribua généreusement.
[118] Il mourut à Paris le 15 août 1738.
[119] Au moment où il dictait ses dispositions dernières, M. de Marcellus entendit un jeune mendiant qui demandait l’aumône: il lui fit un legs de cent pistoles. (Notes de Laboubée.)
[120] Venuti n’oublia pas la France qui l’avait si bien reçu. Il acquitta sa dette par la publication d’un poème: Il trionfo litterario della Francia, où il exalte nos écrivains. Quant à Guasco, il donnait, en 1767, la première édition des Lettres familières de Montesquieu.
[121] M. de Foullé procédait au recouvrement des tailles avec le concours de gens de guerre auxquels il attribuait licence de raser, démolir, brûler partout où ils rencontreraient du mauvais vouloir, et de prescrire, contre les paroisses récalcitrantes, les rigueurs ci-après: descente des cloches, bannissement des curés, interdiction de cultiver les terres, condamnation à mort de dix notables, «sans les nommer dans l’instance ou la dispositive.» (Bibliothèque municipale: 8921, no 45.)—Voir aussi l’Histoire de France de Dupleix, édition de 1644, VI, p. 205.
[122] Papiers de M. de Lamontaigne.—Ces sentiments étaient ceux de Mme Duplessy: «Les intérêts de MM. les intendants vous seraient-ils chers? demande-t-elle... J’ai peine à le croire.»
[123] M. Boucher séjourna à Bordeaux de 1720 à 1743. Il avait épousé une dame Leblanc qui mourut le 26 novembre 1732 «pour avoir pris dans un jour cent trente gobelets d’eau de chicorée». (Manuscrit de M. de Raoul.)
[124] Le Bureau des trésoriers constituait une importante juridiction placée sous la dépendance de l’intendant, qui, se sachant en droit de compter sur son zèle, ne négligeait aucun prétexte pour étendre ses attributions. Elle se composait de vingt-six trésoriers, d’un procureur du roi, de deux greffiers, de six procureurs et de huit huissiers. Les charges de trésorier valaient de quarante à quarante-cinq mille livres. Les gages étaient de 2,614 livres, non compris le casuel qui pouvait atteindre deux cents écus.—Archives départementales, C. 2404.
[125] M. de Tourny avait tour à tour été conseiller au Châtelet, conseiller au Parlement de Paris et maître des requêtes au Conseil d’État.
[126] Vie privée de Louis XV, I, p. 173.
[127] Le Parlement de Bordeaux, par Communay, p. 142.
[128] Archives départementales, C. 1399.
[129] Archives départementales, C. 3214.
[130] Le dixième était un impôt de 10% sur le revenu, affectant tous les biens, nobles et roturiers.
[131] Archives départementales, C. 3214.
[132] Mémoires du marquis d’Argenson, édition Rathery, VIII, p. 257.
[133] Archives départementales, C. 2297 et 2298.
[134] «Voilà, depuis quinze jours, huit grosses banqueroutes à Bordeaux, dont la moindre est de cinq cent mille livres. Il n’y a bientôt plus ni blé, ni argent, ni hommes.» (Journal du marquis d’Argenson, édition Rathery, V, p. 202, 376, 411.)—Cette triste situation n’empêcha point le ministère de frapper la province d’une nouvelle imposition de 160,000 livres pour se faire rembourser le prix de grains achetés, mais non parvenus à destination.
[135] Registres secrets, sous la date du 16 février 1748.
[136] Revue historique, 1891, p. 286.
[137] Archives départementales, C. 1399.
[138] Correspondance de MM. de Lamothe.
[139] Archives départementales, C. 1399.—Les dépêches qui figurent dans cette liasse ne furent certainement pas les seules échangées entre l’intendant et les ministres. Il y a tout lieu de croire que M. de Tourny a dû écrire également des billets confidentiels dont il n’a eu garde de laisser des copies dans ses cartons.
[140] Mémoires de Mme de Motteville, édition Riaux, I, p. 179.
[141] Conseiller de Grand’Chambre au Parlement de Paris, l’abbé Pucelle, qui est resté célèbre par une chanson des Dames de la Halle, exerça, pendant trente ans, une influence considérable sur ses collègues et sur les masses.
[142] «Le Parlement se fonde sur ce que le roi avoit promis de faire cesser cette imposition trois mois après la paix. Voilà une révolte formelle, que fera-t-on? Des punitions sans doute, des troupes en Guyenne, un commandant, des veniat pour les officiers du Parlement, des exils, les foudres du despotisme... Mais qu’on y prenne garde, cette démarche insolente ne commence pas sans qu’on ait médité sur ses suites de la part de ceux qui la font. Cela pourroit être suivi d’une révolte populaire, car ici le Parlement ne parle pas pour ses droits et pour ses hautaines prérogatives, mais pour le peuple qui gémit de la misère et des impôts.» (Journal du marquis d’Argenson, édition Rathery, V, p. 410.)
[143] Journal du marquis d’Argenson, édition Rathery, V, p. 410.
[144] Les terriers étaient des recueils d’actes constatant les prestations de foi et d’hommage, les aveux, etc., consentis par les vassaux à leur seigneur.
[145] Archives départementales, C. 2297.
[146] Là encore on retrouve la main de M. de Tourny. En effet, ces empiétements étaient l’œuvre de son agent habituel, M. de Commarieu, procureur du roi au Bureau des trésoriers, lequel s’empressait d’usurper les galons et le titre de procureur général.
[147] Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1755.
[148] La partie des bâtiments comprise entre les deux tours fut consumée le 2 février 1756. M. de Tourny avait déjà édifié une salle de concerts qu’il mettait à la disposition de la Société philharmonique dont il secondait les efforts.
[149] Mémoires du marquis d’Argenson, édition Rathery, VI, pp. 328 et 332.
[150] Archives municipales: lettre du président de Gascq.
[151] Journal de Barbier, VI, p. 305. Voir aussi sur l’incident le Journal du marquis d’Argenson et les Mémoires du duc de Luynes.
[152] L’huissier Piet, un innocent intermédiaire, demeura plus de trois mois sous les verrous.
[153] Ce châtiment, présentant quelque analogie avec la surveillance de la haute police, impliquait une locomotion qui, pour ne point manquer d’imprévu, n’en devenait pas moins pénible et onéreuse. Il est vrai que la Compagnie à laquelle appartenaient les victimes se cotisait pour subvenir à leurs dépenses,—par où, rapporte Barbier, elle subissait elle-même une part de la peine... Le président d’Augeard fut, sous Louis XIV, l’objet d’une mesure de ce genre: elle dura sept ans!
[154] Le manuscrit de M. de Raoul fait de ce parlementaire le portrait le plus piquant. Il le représente, dans son adolescence, composant et représentant des pièces de théâtre, tirant des feux d’artifice, s’habillant en femme, «courant les cochons par la ville...» D’ailleurs, garçon d’esprit, poli, dévot, très charitable. Un tuteur indélicat, fort de l’appui de l’archevêque et de l’intendant Boucher, obtint contre cet écolier inoffensif une lettre de cachet en vertu de laquelle on l’incarcéra d’abord à Perpignan, puis au château d’Angoulême. Il ne fut rendu à la liberté qu’en 1733.
[155] M. de Combabessouze mourut peu de temps après, laissant des dispositions testamentaires où se révèlent, à côté des sentiments religieux les plus profonds, cette hostilité à l’égard de certaines congrégations qui fut la marque de l’école janséniste.—Comme beaucoup de ses collègues, M. de Combabessouze faisait des vers, dont quelques-uns, non dépourvus de mérite, ont été recueillis par M. de Lamontaigne.
[156] Mémoires du marquis d’Argenson, IX, p. 269.
[157] Papiers inédits de M. de Lamontaigne.
[158] Archives départementales, C. 3019.—D’Argenson rapporte (IX, p. 158) qu’il fut grandement question, à cette époque, «d’envoyer à Bordeaux quelque commandant militaire et tyrannique comme fut M. de Fougères, il y a trois ans, au Parlement de Rouen».
[159] «L’abbé de Tourny, fils de l’intendant de Bordeaux, jeune ecclésiastique résidant au séminaire de Saint-Sulpice, vient d’être enlevé et mis à la Bastille, même au secret, pour avoir envoyé par la poste, avec une lettre signée de lui, les vers qui ont couru contre le roi.» (Journal du marquis d’Argenson, édition Rathery, V, p. 392.)
[160] Papiers de MM. de Lamothe.
[161] Archives départementales, C. 2838.
[162] Cette association prit le nom de Classes.
[163] Journal de Barbier, édition Charpentier, VI, pp. 337, 341, 342.
[164] La Compagnie avait suspendu le service le 16 juin 1756. Mise en demeure de le reprendre, elle répondit, le 24 août, qu’elle n’en ferait rien tant qu’on n’aurait pas rendu à la liberté les magistrats proscrits et ceux «qui étoient retenus dans une espèce de réat à la suite du Conseil du roi». Ce n’est qu’à la fin de septembre, après la soumission du ministère, que Messieurs rentrèrent au Palais. La Gazette de Hollande—numéro du 24 septembre 1756—applaudit à ce dénouement en termes flatteurs pour le Parlement de Guyenne.
[165] Journal de Barbier, édition Charpentier, VII, p. 9.
[166] Correspondance de Mme Duplessy.
[167] Correspondance de MM. de Lamothe.
[168] Archives départementales, C. 2404.
[169] Le nouveau théâtre fut construit en bois. «La salle de spectacle, écrit M. de Lamothe, est au bout des Récollets, sur la main droite, avant que de sortir par la place Dauphine. Elle occupe toute la largeur de la rue de la Corderie et s’étend depuis l’alignement des maisons sur la façade jusqu’au bord le plus reculé de la première tour qui est presque d’abord après le mot rue. Jusque-là, c’est un massif de bâtiments. Ensuite, depuis cette tour jusqu’à une ligne près de la seconde, ce sont des appartenances de la salle.»
[170] Les commandants de province étaient chargés de remplacer les gouverneurs qui, le plus souvent, résidaient à Versailles. A cet effet, ils étaient investis des mêmes droits et des mêmes prérogatives que le grand seigneur dont, en fait, ils exerçaient la fonction. Le commandant de la Guyenne siégeait au Parlement entre le premier et le deuxième président, et recevait vingt-quatre mille livres d’émoluments.—La province sous l’ancien régime, par Alfred Babeau, I, pp. 313 et 318.
[171] Mémoires du duc de Luynes, VII, p. 200.
[172] M. d’Hérouville arriva à Bordeaux le 19 juin 1755. Parmi les honneurs dont on le gratifia, figurait une représentation au Collège de Guyenne à laquelle assistèrent les jurats, le grand sénéchal et de nombreuses personnes appartenant à la noblesse, à l’Université et au Barreau. Le commandant n’ayant pu s’y rendre, les orateurs récitèrent leurs discours de bienvenue en face «du fauteuil de vellours cramoisy sur lequel M. le comte d’Hérouville se seroit placé s’il avoit été présent.» (Registres de la Jurade, BB. 1755.)
[173] Mémoires de Marmontel, édition Barrière, p. 162.
[174] Sur l’événement et ses suites, consulter les Mémoires du duc de Luynes, XV, pp. 212, 214, 270. Voir également le Journal du marquis d’Argenson, IX, pp. 326 et 359.
[175] Il fut remplacé par le maréchal de Thomond.
[176] Papiers de M. de Lamontaigne.—L’Académie avait, en 1755, reçu M. d’Hérouville dans ses rangs. Celui-ci n’oublia jamais ses amis de Guyenne. Plusieurs d’entre eux, notamment M. Risteau, qu’il fit entrer à la Compagnie des Indes, eurent à se louer de ses services.
[177] Souvenirs de la marquise de Créquy, édition Garnier, V, p. 240.
[178] Mémoires de Marmontel, édition Barrière, p. 162.
[179] Voir l’Éloge de Tourny, par Jouannet, p. 81.—Depuis un certain temps, les ministres tranchaient, sans consulter M. de Tourny, d’importantes questions du ressort de sa Généralité. Celui-ci se plaignait amèrement de procédés qui impliquaient une véritable défaveur: un mémoire signé de lui, dont la minute nous a été communiquée par M. Raymond Céleste, contient à ce sujet de curieuses indications.
[180] Archives nationales, II. 92.
[181] Papiers inédits de M. de Lamontaigne.
[182] Correspondance de MM. de Lamothe.—Il y eut, à cette époque, un redoublement de rigueurs contre les protestants. Certains d’entre eux furent vivement sollicités par leurs coreligionnaires étrangers de quitter le royaume.
[183] Mémoires de Durfort de Cheverny, I, p. 198, confirmés par les notes du président Barbot.
[184] Voyage de la Raison en Europe, par le marquis Caraccioli.
[185] Correspondance de Buffon, I, p. 6.
[186] Archives départementales, C. 1077.
[187] Bureau de la grande police, par Brives-Cazes, p. 23.
[188] Enquête sur le fait des corvées, p. 126.
[189] D’autres services existaient dans les directions suivantes: 1o Saintes, La Rochelle et Nantes, trois départs par semaine;—2o Agen et Toulouse, deux départs;—3o Mont-de-Marsan, Dax et Bayonne, deux départs;—4o Limoges et Périgueux, un départ;—5o Libourne, deux départs;—6o Blaye, un départ chaque jour, à l’heure de la marée;—7o le Médoc, un départ chaque jour, à sept heures du matin.
[190] La Généralité de Guyenne était alors traversée par trois grandes routes de poste, auxquelles se rattachaient cinquante embranchements divers; le tout comprenait cinq cent vingt lieues de longueur.—Archives départementales, C. 76.
[191] Voyage de la Raison en Europe.
[192] La fonction des dizeniers consistait à relever les contraventions de police et à dresser les rôles de la capitation et du dixième. Il y avait généralement un dizenier par rue.
[193] Il y avait douze commissaires de police; mais il est permis de croire qu’ils se bornaient à exercer une surveillance générale, car plusieurs d’entre eux étaient en même temps marchands ou procureurs. Leurs appointements s’élevaient à quatre cents livres.—Les espions de police ne furent créés que plus tard.
[194] Les premiers essais d’éclairage remontent à 1697, mais ce fut seulement vers le milieu du XVIIIe siècle que ce service s’améliora. En 1750, les négociants des Chartrons firent venir à leurs frais de Rotterdam cinquante lanternes d’un système nouveau, avec leurs fers et assortiments. Enfin, par délibération prise en 1758, la Jurade substitua aux anciens appareils deux mille quatre cents lanternes imitées de celles de Paris.
[195] Collection Delpit: Correspondance.
[196] Arrêté du 7 septembre 1763.
[197] Ces sortes de représentations avaient lieu d’ordinaire «à la vieille corderie, derrière la salle de spectacle».
[198] Pastorales héroïques, de Nau-Dumontet.—Les arènes affectées aux combats d’animaux étaient généralement établies dans la rue Couet, aujourd’hui rue de la Course.
[199] L’apothéose de Molière, chez la veuve Calamy, imprimeur du spectacle.—Collection de M. Roborel de Climens.
[200] Paris, Versailles et les provinces, II, p. 72.
[201] Cet événement fait l’objet d’une lettre fort curieuse publiée dans le numéro du 14 novembre 1750 d’un journal de La Haye, la Bigarrure, et reproduite dans l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux du 28 février 1894.
[202] Mémoires de Mlle Clairon, édition Barrière, p. 50.
[203] Lettres d’Horace Walpole, édition Didier, pp. 28 et 53.
[204] Un règlement du 5 août 1713 obligeait tous les serviteurs, portiers, laquais, porteurs de chaises, cochers, postillons, palefreniers, frotteurs, etc..., à se munir «de galons de livrée de couleur apparente». Toute contravention était punie d’un mois de prison, et, en cas de récidive, des peines du carcan et du bannissement. Lorsqu’il y avait port de l’épée, le juge prononçait les galères.—Archives départementales, C. 1077.
[205] Cette pierre existait encore en 1770; il est probable qu’elle fut enlevée à l’époque de la démolition du palais de l’Ombrière.
[206] Chaque corps d’état avait, pour ainsi dire, un quartier attitré. Les ferblantiers habitaient presque tous le long du quai, depuis l’hôtel des Fermes jusqu’à la porte de la Monnaie.
[207] Archives départementales, C. 3313.
[208] Le lever du rideau fut fixé à cinq heures et demie par ordonnance du 11 septembre 1755.
[209] Archives municipales: Lettres missives.
[210] Souvenirs de la rue Neuve, par Charles Marionneau.
[211] Caractères et portraits, de Chamfort.
[212] C’est le sobriquet que l’on donna à Richelieu à raison de ses déprédations durant cette campagne. Elles lui permirent, assurait-on, de payer plus d’un million de dettes et de faire construire l’hôtel baptisé par les Parisiens du nom de pavillon de Hanovre.
[213] Allusion à l’habitude qu’avait Richelieu de s’inonder de parfums.
[214] Les jurats, aux termes d’un arrêt du Conseil enregistré en 1758, recevaient deux mille livres de gages. Là ne se bornaient point leurs profits. En dehors des redevances en nature, touchées dans certains cas, notamment des personnes investies de lettres de bourgeoisie, ils avaient droit à des jetons de présence. Jusqu’en 1780, ces jetons furent du poids de trois livres; à partir de cette date, on les éleva à trois livres douze sols; les premiers étaient ronds, les seconds furent carrés. La remise en était faite dans une bourse valant elle-même vingt-quatre livres. Les jurats qui ne tenaient point aux jetons avaient la faculté de les échanger contre une somme de six cents livres.—Correspondance de Mme Duplessy.
[215] Une curieuse correspondance fut échangée, sur cette question, entre le ministre, M. de Saint-Florentin, et l’intendant, M. de Tourny fils. Elle se termina par l’ordre à ce dernier de faire mettre en dépôt—à l’abri des atteintes de la Jurade—les velours, étoffes, galons, franges d’or et d’argent achetés par elle, pour qu’on pût s’en servir plus tard dans des occasions analogues.—Archives départementales, C. 3633.
[216] Archives départementales, C. 3633.
[217] Correspondance de MM. de Lamothe.
[218] Archives municipales: Lettres missives.
[219] «Une cuisinière, faite avec art, attachée sous sa voiture, faisoit cuire doucement, par le moyen de briques rouges, les viandes qu’il désiroit. Et, à la poste, avant le temps désigné pour manger, un cuisinier adroit s’emparoit de la machine et couroit à toute bride préparer le repas de Monseigneur, de façon qu’en arrivant il n’attendoit pas.» (Vie privée du maréchal de Richelieu, par Faur, II, p. 155.)
[220] «Le public fut admis à circuler autour du banquet et la table livrée ensuite au peuple dont les acclamations se mêlaient au bruit des orchestres.» (La comtesse d’Egmont, par Mme d’Armaillé, p. 70.)
[221] Chronique de Gaufreteau, I, p. 118.
[222] La loi Oppia imposait des bornes au luxe des femmes et leur interdisait de porter sur elles plus d’une demi-once d’or.
[223] Chronique de Gaufreteau, II, p. 111.
[224] Correspondance de Buffon, I, p. 6.
[225] Publication des bibliophiles de Guyenne, II, p. 10.
[226] Correspondance de MM. de Lamothe.
[227] Mémoires de Marmontel, édition Barrière, p. 268.
[228] On citait des membres de la Jurade qui, moyennant espèces, délivraient des autorisations. La sœur de l’un d’eux prélevait une rétribution quotidienne de dix-huit livres, savoir douze livres pour elle-même, et six livres pour sa nièce âgée de sept ans.—Correspondance de Mme Duplessy.
[229] Correspondance de Mme Duplessy.
[230] Journal du marquis d’Argenson, édition Rathery, VI, p. 2.
[231] L’hôtel du Gouvernement—jadis l’hôtel de Nesmond, aujourd’hui l’Archevêché—occupait une grande partie des terrains compris entre les rues Montméjan, du Temple, Saint-Paul et Porte-Dijeaux. C’est dans la rue Porte-Dijeaux que se trouvait l’entrée principale; il y en avait une autre, plus discrète, dans la rue Saint-Paul, aujourd’hui rue des Facultés.
[232] Lettre de Richelieu au président de Lalanne.
[233] Antoine-Alexandre de Gascq, né le 20 décembre 1712, conseiller en 1730, président à mortier en 1739. Son nom reviendra souvent dans le cours de ce récit.
[234] Le compte rendu de cette fête, qui eut lieu le 6 août 1758, fut fait par Rulhière sous la forme d’une lettre à la duchesse d’Aiguillon. Cette lettre, avec quelques variantes, trouva place dans l’Année littéraire, de Fréron, 1758, VII, p. 186.
[235] Le thé à l’anglaise chez le prince de Conti, par Olivier.
[236] Souvenirs de la marquise de Créquy, édition Garnier, III, p. 4.
[237] M. de Tourny.
[238] La duchesse d’Aiguillon.
[239] Les Délices de la France, avec une description des provinces et des villes de France, par Savinien d’Alquié. Paris, 1670, II, pp. 184 à 189. L’auteur ajoute qu’à Bordeaux «tous les plaisirs de l’esprit et du corps se trouvent réunis dans toute leur pureté».
[240] Carraccioli a dit fort justement que, chez les femmes de cette époque, le bon sens et l’érudition s’alliaient parfois avec les mouches et le rouge.
[241] Correspondance de MM. de Lamothe.
[242] Les émoluments du gouverneur de la Guyenne s’élevaient à 99,708 livres, non compris le logement, le chauffage et une foule d’autres profits.—La province sous l’ancien régime, par A. Babeau, I, p. 332.
[243] Papiers inédits de M. de Lamontaigne.
[244] Correspondance de Voltaire: lettre du 21 juillet 1764.
[245] Correspondance de MM. de Lamothe.
[246] Les noms des volontaires, qui, presque tous, appartenaient au commerce, sont rapportés dans l’Almanach historique de Guyenne, année 1760, p. 198.
[247] Iris de Guyenne, I, p. 42.
[248] La comtesse d’Egmont, par Mme d’Armaillé, p. 73.
[249] Mme d’Egmont fit partie du petit cénacle auquel Jean-Jacques offrit la primeur de ses Confessions: «J’achevai ainsi ma lecture, écrit-il, et tout le monde se tut. Mme d’Egmont fut la seule qui me parut émue. Elle tressaillit visiblement, mais elle se remit bien vite et garda le silence, ainsi que toute la compagnie.»
[250] On a de lui une Réponse aux observations sur l’Esprit des lois. C’est d’après ses indications que le sculpteur Cessy modela le buste de Montesquieu. M. Risteau était le père de Mme Cottin.
[251] Laboubée rapporte que Cazalet s’ouvrit les veines dans un bain, pour se soustraire aux fureurs révolutionnaires.
[252] On en trouvera une description détaillée dans la Conchyliologie, de Dézallier d’Argenville, p. 136.
[253] Mémoires de Marmontel, édition Barrière, p. 269.
[254] Collection Delpit: lettre des frères Labottière.
[255] Note de Laboubée.
[256] Jean-Charles de Lavie, chevalier, comte de Belhade, baron de Nontron, du Bourdeix, de La Roque du Taillan et autres lieux, naquit à Bordeaux le 23 septembre 1694. Il fut élu à l’Académie le 22 juillet 1738.—La maison de Lavie comptait, depuis deux siècles, toute une lignée de parlementaires. Bernard de Lavie, bisaïeul de Jean-Charles, occupait la charge de premier président à Pau. Son aïeul, Thibaut de Lavie, qui joua, durant la Fronde, un rôle des plus actifs, fut, par une faveur sans exemple, premier président à Pau en même temps qu’avocat général à Bordeaux.
[257] L’ouvrage porta d’abord ce titre: Abrégé de la république de Bodin.
[258] Les attaques ne furent pas épargnées à Jean-Charles de Lavie. Plagiaire de Montesquieu, pour quelques-uns, il fut regardé, par d’autres, comme son détracteur. Accusations contradictoires également injustes. Discutant sur le droit public, Lavie suivait le même chemin que son illustre devancier. Les rencontres ne pouvaient qu’être fréquentes: elles furent toujours loyales. Quant au reproche de dénigrement, il y a lieu de s’en étonner. Lavie n’abdique point son droit de critique, mais il en use avec une déférence d’où l’admiration n’est pas exclue: Bodin, déclare-t-il, est plus abondant en faits et en maximes puisées dans les anciens auteurs qu’élevé dans ses réflexions; Montesquieu est riche de son propre fonds: l’un écrit, l’autre pense.
[259] Année littéraire, 1764, II, p. 315.—Une étude comparative des Corps politiques et de l’Esprit des lois serait d’autant plus curieuse que Charles de Lavie et Montesquieu vécurent dans le même monde et, suivant toutes vraisemblances, entretinrent ensemble des rapports fréquents. Il est étrange qu’aucun des biographes du châtelain de La Brède n’ait songé à opérer un rapprochement entre les œuvres des deux écrivains.
[260] Lettre de Dupaty à Voltaire par laquelle il lui recommande son ami de Lavie. «Son père, dit-il, doit vous être connu. C’est à lui que la République des lettres doit une refonte de Bodin et des réflexions sur la vie de Plutarque...» Voltaire mentionne la visite de M. de Lavie dans une lettre du 15 octobre 1776.
[261] Archives de la Cour d’appel: dossier de la Commission militaire.
[262] M. de Ségur figure, sur les notes de Vernet, pour une toile de douze cents livres; M. Journu, pour quatre marines; le marquis de Saint-Marc, pour un sujet gracieux en marine ou en paysage; le riche M. Imbert, pour trois tableaux; Mme d’Egmont, pour trois tableaux aussi, dont un petit représentant un clair de lune, etc.
[263] Il la revendit onze cents livres en 1779.
[264] Archives municipales: lettre du 1er janvier 1744.
[265] Table historique de l’Académie, p. 305.
[266] Marmontel, de passage à Bordeaux, reçut de Barbot communication de ces pamphlets.—Mémoires de Marmontel, édition Houssaye, p. 270.
[267] Voici la liste en question, découverte dans les papiers de MM. de Lamothe:—La Famille extravagante: les Guyonnet;—Les Plaideurs: Citran et Guyac;—L’Avare: M. de Combabessouze;—Le Grondeur: Labadie;—L’Indiscret: Bellegarde;—Le Babillard: Marbotin;—Le Chevalier à la mode: La Chabarine;—L’Homme à bonnes fortunes: Montferrand;—L’Important: Marcellus;—Le Médisant: Portets;—Ésope à la ville: Gourgue;—Le Tartufe: de Gascq;—Le Bourgeois gentilhomme: Pelet;—Les Précieuses ridicules: Mlles de Sallegourde;—L’Enfant prodigue: M. de Sallegourde;—Le Joueur: Somières;—Le Dissipateur: Mirat;—Le Menteur: Ségur;—Le Mariage forcé: Leberthon;—La Mère coquette: Mme de Pontac;—Le Fat puni: Montazet;—L’Esprit de contradiction: Mme de Labadie;—La Fille de village: les Paret;—Le Bourgeois à la mode: Dupin et Paran;—Les Bourgeoises de qualité: les demoiselles Peyronnet;—La Vie est un songe: Tortaty;—Le Glorieux: Carrière;—Le Misanthrope: Caupos;—L’avocat Pathelin: Poussart;—La Veuve: Mme de Dunes;—Pourceaugnac: d’Arville;—Georges Dandin: Le Doux;—Le roi de Cocagne: Lascombes;—L’Extravagant: La Capelle;—L’Ami de tout le monde: Aquart;—La Coquette: Mme Dusault;—Le Mécontent: Tombebœuf;—Les Femmes savantes: Mlles Duplessy et de Ségur;—Le Français à Londres: Laburthe;—Les Fâcheux: Denis et Parrant;—La Fausse Prude: la première présidente;—L’Étourdi: Montbalen;—Jodelet: Dupin;—Crispin médecin: Séris;—L’Amour médecin: Cazaux;—Le Malade imaginaire: Labadie fils;—Le Distrait: Montesquieu;—La Mère confidente: Mme de Cressac;—La comtesse d’Escarbagnas: Mme Boyer;—L’École des amants: Bigot;—La Fille capitaine: Mlle Châteauneuf;—Le Chevalier Massacre: Baignères;—Arlequin poli par l’Amour: La Colonie;—La Comtesse d’Orgueil: Mme Lassalle;—Les Amants réunis: Piis et sa femme;—Le Petit-Maître corrigé: Budos;—La Matrone d’Éphèse: Mme de Ségur-Cabanac;—Le Procureur arbitre: Duvigier père;—Le Flatteur: Duvigier fils;—Le Magnifique: Mirambeau;—L’Amoureux: Senault;—Le Dépit amoureux: Mlle de Belhade;—La Femme d’intrigue: Mme Robillard;—Le Sicilien: le chevalier Malvin;—Crispin musicien: Sarrau;—Les Folies amoureuses: Mlle de Pile;—Le Légataire universel: Sause;—Les Fourberies de Scapin: Vincent, doyen;—Le Complaisant: Desaigues de Fais;—Colin Maillard: Dupont-Rolland;—Crispin bel-esprit: le président Rolland;—Les Visionnaires: Lalanne et Montaigne;—Je ne sçais quoi: Le Blanc, père;—La Réconciliation normande: le premier président et l’intendant.
[268] Il était assesseur au Présidial de Nérac.
[269] Les Grandes Inventions modernes, par Figuier. Hachette, 1873, p. 343.
[270] Le 10 août 1759.—M. de Lamontaigne, qui fournit des détails précieux sur cet événement, rapporte, d’après des témoins dignes de foi, que la secousse éprouvée à Bordeaux fut, sinon aussi longue, au moins aussi forte que celles ressenties à Lisbonne, lors du tremblement de terre de 1755 qui renversa cette ville de fond en comble.
[271] C’était une messe en musique que dirigeait, le plus souvent, l’académicien Sarrau de Boynet.
[272] Papiers de l’Académie, no 828, 20, p. 65.
[273] Correspondance de Voltaire, édition Beuchot, t. LXIX, p. 253.
[274] Observations sur l’agriculture, par le chevalier de Vivens, I, p. 111.
[275] Cet état de choses se perpétua jusqu’en 1791: c’est Gensonné, en qualité de procureur de la Commune, qui en provoqua l’abolition.
[276] Extrait des Corps politiques, livre VII, chapitre II, édition de 1766, II, p. 67.
[277] Le Parlement de Guyenne ne cessa de professer, à l’égard de l’illustre intendant du Limousin, des sentiments de haute estime. On en trouve l’expression dans un remarquable arrêt du 17 janvier 1770.—Archives départementales, 1514 B.
[278] Mémoires du chancelier Pasquier, I, p. 3.—Mémoires du duc de Luynes, XIV, p. 470.—L’inoculation était regardée comme un acte de rébellion contre la volonté divine.
[279] Liste chronologique des ouvrages des médecins et chirurgiens de Bordeaux, an VII, p. 22.—Les succès du docteur Grégoire n’eurent pas le privilège de l’enrichir. Traqué par ses créanciers, il fut réduit, en 1765, à solliciter le bénéfice d’un sauf-conduit.—Archives départementales, C. 3437.
[280] Les Annonces-Affiches prenaient part à la polémique, et, dans le numéro du 13 mars 1760, se prononçaient en faveur de l’inoculation.
[281] Le 10 novembre 1757, il écrivait à Barbot, à l’occasion de la mort du fils unique de M. de La Tresne: «Si l’inoculation de la picotte étoit pratiquée autant qu’elle le mérite, peut-être qu’elle eût évité bien des regrets à l’infortuné M. de La Tresne. J’ai bien pris part à sa perte. Les amis de Mme Duplessy n’en seront pas si affligés que moi.»—Papiers de l’Académie, 828, 20.
[282] Par les soins d’un médecin nommé Chaumont dont le nom ne figure point parmi les docteurs exerçant à Bordeaux ou à Paris.
[283] Le docteur Grégoire dédiait à la comtesse une étude sur la petite vérole et la remerciait, au nom de la Faculté, d’avoir, par une fermeté d’âme sans pareille, «fourni des armes victorieuses aux défenseurs de l’inoculation».
[284] Œuvres de Rulhière. Paris, 1819, VI, p. 445.
[285] Correspondance de M. de Gascq.—Lettre, du 28 janvier 1769, à M. d’Arche.
[286] Correspondance de MM. de Lamothe.—Parmi les danseuses engagées se trouvaient les sœurs Boscarel que le maréchal honorait d’une bienveillance particulière et à qui il faisait donner leurs premières leçons, aux frais des actionnaires.
[287] Journal historique de Collé, I, p. 174.—Après quelques années passées à Bordeaux, Mlle Émilie se rendit à Saint-Pétersbourg où «elle mourut de froid». (Manuscrit de M. de Raoul.)
[288] Voici l’un des couplets qui le concernent:
[289] Correspondance de MM. de Lamothe.—M. de Raoul, au contraire, rapporte que le jeune Labottière était encore en prison le 25 juin 1763, plus de deux années après l’incident.
[290] Correspondance de Walpole, édition Didot, p. 51 et 55.—Mistress Bootbie passait pour être la maîtresse du général Churchill.
[291] Mémoires de Dazincourt, édition Barrière, p. 197.
[292] Histoire des théâtres de Bordeaux, par Detcheverry, p. 152.
[293] Voyage de la Raison en Europe, p. 367.
[294] Annales de Bernadau, p. 210.
[295] Elle porte la signature d’un des comédiens de la troupe, le sieur Caprez; la musique était de Beck.—Collection de M. Roborel de Climens.
[296] Journal de Collé, III, p. 188.—Le Galant Escroc avait été représenté sur le théâtre du duc d’Orléans, à Bagnolet.
[297] «C’était toujours sur la classe inférieure que son despotisme frappait avec le moins de ménagement. Il fit enfermer plusieurs personnes qui avaient seulement osé blâmer sa conduite.»—Vie privée du maréchal de Richelieu, II, p. 196.
[298] Il faut reconnaître que le Parlement s’était, dans cette circonstance, montré quelque peu agressif; il n’avait pas craint, en effet, de reprocher au roi l’élévation croissante des impôts, celui-ci «ayant faict plus d’édicts puis la paix qu’il n’en avoit faict pendant la guerre». (Chronique d’Étienne de Cruseau, II, p. 39.)
[299] Ces derniers, si l’on en croit la légende, furent, à maintes reprises, obligés de le condamner.
[300] La Chambre de justice de Guyenne en 1583-1584, par Brives-Cazes, p. 51.—Marguerite de Valois, sœur de François Ier, n’avait pas été plus heureuse dans ses démêlés avec les Robes longues. Il lui plut, un jour, d’enlever les riches héritières du bordelais pour les marier aux nobles ruinés de sa cour: la Grand’Chambre, par de vigoureuses décisions, coupa court à cette entreprise renouvelée de l’aventure des Sabines.—Le Parlement et la Cour des Commissaires de 1549, par Brives-Cazes.
[301] Chronique de Gaufreteau, I, p. 321.
[302] La Société et les Mœurs en Béarn, p. 156.
[303] Tallemant des Réaux, édition Garnier, I, p. 93.
[304] Le dernier tour d’Henri IV à ses amis du Parlement vaut la peine d’être conté. Jadis payeur récalcitrant, le Béarnais, avec l’âge, était devenu franchement avaricieux. Son neveu, le prince de Condé, ayant jugé bon de prendre femme, Sa Majesté se fût volontiers affranchie du cadeau de noces. Mais l’épousée était cette Charlotte de Montmorency pour l’amour de laquelle le Vert-Galant accomplissait une série d’extravagances qui le couvrirent de ridicule. Lésiner n’eût point été le fait d’un Céladon. Henri IV, qui avait le génie des solutions économiques, trouva le moyen de faire grand sans délier les cordons de sa bourse. Il glissa dans la corbeille... un brevet de conseiller à Bordeaux. Bon gré, mal gré, la Compagnie dut acquitter le montant de cette lettre de change... Combien d’autres du même genre n’eut-elle pas à payer!
[305] «Comment le Parlement eût-il pu résister seul aux entraînements corrupteurs créés par le despotisme de François Ier et de ses successeurs!»—Le Parlement de Bordeaux et la Cour des Commissaires, par Brives-Cazes, p. 164.
[306] La liste dressée et publiée par M. Dast de Boisville comprend plus de seize cents noms.
[307] Journal historique de la révolution opérée dans la Constitution de la monarchie française, II, p. 232.—Maupeouana, III, p. 30.
[308] La capitation variait suivant les besoins du fisc. En 1721, elle était de 1,500 livres pour le premier président, de 450 livres pour les présidents à mortier, de 225 livres pour les présidents à bonnet et les conseillers, de 35 livres pour les avocats. On ne tarda pas à l’augmenter et à y joindre un impôt de quatre sols pour livre.
Un relevé de compte présenté par le payeur des gages au conseiller de Pichon fournit sur cet état de choses des précisions intéressantes. Ce compte, qui s’étend de 1713 à 1724, constitue M. de Pichon créancier d’une somme totale de 4,200 livres, pour onze années de gages à 375 livres, soit 4,125 livres, et pour deux années à la Tournelle donnant lieu à un supplément de 37 livres dix sols, chacune. Au débit figurent: 1o l’impôt du dixième sur les gages, 420 livres; 2o l’impôt de la capitation, 3,307 livres 15 sols... Reste un boni de 473 livres 5 sols, affecté à des fournitures de bureau. En définitive, M. de Pichon se trouve redevable de 10 livres 11 sols 6 deniers.—Archives départementales, C. 852.
[309] La démonstration est facile. En 1770, le Parlement de Bordeaux se composait de dix présidents à mortier et de cent présidents à bonnet ou conseillers. On ne peut évaluer à moins de 120,000 livres la valeur des offices de président à mortier, soit 1,200,000 livres pour les dix. Les offices de président à bonnet et de conseillers, après avoir valu 60,000 livres, étaient descendus à 40,000; soit quatre millions, pour les cent; en tout, cinq millions deux cent mille livres déboursés par les membres de la Compagnie, non compris ceux du Parquet. Or, le montant des épices réellement perçues—à l’exclusion des épices pro rege, pro urbe, pro Deo—n’atteignait pas, à beaucoup près, le revenu qu’eût pu donner cette somme. Un dépouillement consciencieux démontre qu’à cette époque elles ne s’élevaient pas à 40,000 livres, pour un ressort de 2,200,000 justiciables (à Rouen elles étaient de 20,000 livres seulement). Réparties sur un capital de cinq millions deux cent mille livres, ces 40,000 livres constituaient un intérêt de moins de 1%. Encore négligeons-nous l’impôt de la Paulette lequel, étant alors fixé au centième du prix de l’office, absorbait et au delà toutes les sommes perçues.—En fin de compte, les épices allaient, sous des formes diverses, se déverser dans les coffres de l’État, et l’on peut affirmer que les parlementaires payaient chèrement les privilèges qui leur étaient attribués. Ce qui, dans une certaine mesure, peut faire illusion, c’est que les épices se répartissaient d’une façon inégale. La plus forte part était réservée aux rapporteurs de la Grand’Chambre, tandis que les officiers des Enquêtes et des Requêtes ne touchaient à peu près rien. Ces derniers, spécialement, étaient taxés à une redevance fixe de six écus par audience, laquelle, partagée entre dix magistrats, portait à trente-six sous par audience le profit de chacun d’eux... Étienne de Cruseau fournit, sur cette délicate question des épices, un renseignement précieux. Devenu conseiller de Grand’Chambre, il clôture l’année 1608 par cette exclamation, unique dans sa longue carrière: «Dieu m’a donné mille escus de mon estat; à vous, mon Dieu, gloire et honneur et grâces!» Cette satisfaction bruyante de l’un des rapporteurs les plus zélés du Parlement démontre le caractère insolite de ce revenu, qui n’était, d’ailleurs, que l’intérêt à 5% du capital de la charge. Gaufreteau complète cette indication par la réflexion suivante: «Quel advantage peuvent avoir ceux qui achepteront des offices de crue, attendu que, après qu’ils auront baillé quinze ou vingt mille escus pour leurs offices, ils demeureront près de vingt ans avant gagner l’eau qu’ils boiront»: une boutade qui n’est, en somme, que l’expression fidèle de la vérité.—Ajoutons qu’une rémunération aussi illusoire des emplois de judicature peut, seule, expliquer la facilité avec laquelle les magistrats de l’ancien régime, pour forcer la main au roi, abandonnaient, parfois pendant des années, l’exercice de leurs fonctions.
[310] Œuvres de Michel de l’Hospital, édition Dufey, II, p. 111.
[311] L’avocat général Saige épousait lui-même Mlle de Verthamon d’Ambloy, fille du président aux Enquêtes, dont la fortune était considérable—ce qui fait dire à M. de Lamontaigne: «C’est le Pactole qui va fertiliser les mines du Pérou.»
[312] Mémoires de Mme du Hausset, édition Barrière, p. 72.
[313] Archives départementales, C. 3623.
[314] Archives départementales, C. 3585.—Sur l’emplacement de sa maison incendiée, M. Le Berthon fit construire le bel hôtel, rue du Mirail, qu’occupent aujourd’hui les services du Mont-de-piété.
[315] Il paraît certain que les Sceaux furent offerts à M. Le Berthon et qu’il les refusa pour ne point quitter Bordeaux.
[316] Dix présidents à mortier en exercice et deux honoraires, deux chevaliers d’honneur, six présidents à bonnet, quatre-vingt-quatorze conseillers en exercice, vingt-deux honoraires, vingt-six officiers du parquet ou greffiers.—Aux processions de Saint-André, le gros du cortège stationnait encore dans la rue du Loup quand la tête franchissait le seuil de la Primatiale.
[317] Les conseillers n’avaient voix délibérative qu’à vingt-cinq ans, les présidents qu’à trente ans.
[318] Mémoires de Bailly, III, p. 130.
[319] Tablettes de Bernadau: V. p. 177.
[320] Cette cérémonie eut lieu le 23 mars 1756, deux ans avant la prise de possession effective. Le maréchal y fut représenté par le marquis de Montferrand, grand sénéchal de Guyenne.
[321] Lettre de Voltaire du 12 septembre 1755.
[322] Tel fut le sort de l’avocat général Dupaty à qui une rigoureuse incarcération à Pierre-Encise rappela les dangers d’une indépendance intempestive. Le fougueux orateur fut, de là, transféré à Roanne où il écrivit ses Imitations de Properce et de Tibulle.
[323] Archives départementales, C. 2623.—L’intendant était alors M. Boutin, un homme aimable et distingué dont les correspondances privées font fréquemment l’éloge. Sa femme—une Chauvelin—s’attira toutes les sympathies par ses manières et sa bonne grâce. Très bien accueillie dans la société bordelaise, elle donna elle-même des fêtes qui eurent un grand éclat.
[324] Le roi fut obligé d’interdire toute publication de ce genre.—Archives départementales, C. 3623.
[325] La décision ne fut pas rendue à l’unanimité, si l’on s’en réfère à la correspondance de MM. de Lamothe. Un certain nombre de jeunes conseillers, pour qui la masse aux dés avait des charmes, votèrent contre.
[326] A l’occasion de l’établissement du Vauxhall: Archives historiques de la Gironde, XXIV, p. 428.
[327] Registres secrets, sous la date du 7 septembre 1763.
[328] Elle se composait de MM. de Gascq, de Gourgue (Laurent-Marc-Antoine), de Grissac, de Baritault, de La Colonie, de Favars, de Filhol, de Prunes, de Gourgue de Thouars, de Verthamon d’Ambloy, d’Arche de La Salle, de Lamontaigne, de Rauzan, de Poissac.
[329] Une étude sur la réforme de la justice fut, en effet, préparée par un des Messieurs.
[330] M. Brives-Cazes a publié dans une intéressante brochure—Le Parlement de Bordeaux: Bureau de la grande police—un résumé des travaux de la Commission. Les registres retrouvés par lui n’embrassent qu’une période de quatre années à partir de 1763; mais nous ne serions pas surpris que le Bureau eût fonctionné jusqu’en 1771. Les remarquables arrêts rendus en 1770 sur la vente des grains et l’établissement d’assemblées de paroisses en vue de soulager la misère publique, ont sûrement été inspirés par le Bureau de la grande police.
[331] Les choses se passèrent ainsi, en 1762, au sujet d’un navire offert au roi par la Ville. La correspondance de MM. de Lamothe atteste que l’intendant faisait venir chez lui les habitants, les sollicitait de s’exécuter de bonne volonté, et, au besoin, augmentait le chiffre de leur souscription.—Il est juste de dire que, dans certaines circonstances, Sa Majesté, trouvant excessives quelques-unes des libéralités ainsi obtenues, en opéra elle-même la réduction.
[332] Voir, page 138, ce qu’en disait Tourny.
[333] Correspondance de MM. de Lamothe.—Sur l’état économique de la Guyenne, sous le règne de Louis XV, on consultera avec fruit l’Ancien Régime, de Taine, p. 60 et suivantes.
[334] Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 28.
[335] Bien que la correspondance de Mme Duplessy avec sa fille embrasse cette période, il ne se trouve qu’une lettre faisant allusion aux événements de cette époque: il est permis de croire que les autres ont été détruites sur sa demande.
[336] Charles-François-Hyacinthe Esmangart.
[337] Archives départementales, C. 3623.—Lettre à M. de Sartine, du 19 février 1771.
[338] Il était admis par les esprits impartiaux que, déplorable en principe, la vénalité des charges constituait, en fait, la garantie la plus sûre de l’intégrité et de l’indépendance du juge. Montesquieu se prononce en faveur de la vénalité; Charles de Lavie également: il estimait que le choix du prince n’avait jamais équivalu en France qu’à la plus dangereuse des vénalités, la vénalité clandestine.—Peut-être n’est-il pas hors de propos de rappeler que l’affaissement des consciences au sein des Parlements coïncida presque toujours avec l’attribution accordée au Souverain du choix des représentants de la justice. L’admirable magistrature en fonctions à Paris, lors de la mercuriale de 1559 qui se termina par la mise en jugement de huit officiers de judicature, dont un brûlé en Grève et un autre étranglé dans son cachot, s’était recrutée elle-même en toute liberté; celle, au contraire, qui siégeait au moment de la Saint-Barthélemy, et dont l’attitude a été l’objet de vives critiques, devait son investiture au choix des Guises.
[339] Le Barreau de Bordeaux, par Henri Chauvot, p. 41. Le premier président d’alors était Jacques-André-Hyacinthe Le Berthon, dont le père était décédé en 1766.
[340] Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 132.
[341] Correspondance de Voltaire: lettre du 24 janvier 1766.
[342] Il n’était rien moins que rassuré: «Bordeaux, écrit Walpole, résista un jour ou deux, au grand effroi de Richelieu qui se retira précipitamment en demandant des troupes.»—Lettres de Walpole, édition Didier, p. 255.
[343] Mémoires de Saint-Simon, édition Hachette, XVI, p. 52.
[344] Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 109.
[345] Le 29 avril 1771, par une délibération prise à l’unanimité, les officiers du Parlement s’étaient engagés à n’accepter aucune place dans les juridictions nouvelles. Cette décision fut renouvelée le 3 septembre; à cette date, il y eut une dizaine d’opposants.—Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 147.
[346] Confessions de Jean-Jacques Rousseau: année 1741.
[347] Il concourut, avec M. de Sarrau et quelques autres personnes à la fondation de l’Académie de musique.
[348] Mémoires de Dazincourt, édition Barrière, p. 197.—Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 138.
[349] Le Barreau de Bordeaux, par H. Chauvot, p. 40.
[350] Le chancelier Maupeou et les Parlements, p. 456.—Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 143.
[351] Mémoires de Besenval, II, p. 180 et 181.
[352] Michau de Montblin était conseiller au Parlement de Paris.
[353] Le chancelier Maupeou et les Parlements, p. 424.
[354] La comtesse d’Egmont, par Mme d’Armaillé, p. 159.
[355] De Lurbe écrit, de son côté: «Les Bordelais sont de leur naturel avides de liberté.» (Chronique bourdeloise: année 1548.)—Le maréchal de Richelieu faisait lui-même, dans sa correspondance, une constatation identique.
[356] Le chancelier Maupeou et les Parlements, p. 480.
[357] Le chancelier Maupeou et les Parlements.—Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 139.
[358] L’Ancien Régime, par H. Taine, p. 386.
[359] Sans doute Angélique de Mathieu, femme de Laurent-Marc-Antoine de Gourgue, président à mortier.
[360] En reproduisant ces détails, M. Flammermont désigne la sœur du premier président comme étant Mme de Pontac. C’est une erreur que nous avons cru devoir rectifier.
[361] Les mauvais sujets, au nombre de soixante-cinq, étaient MM.: Le Berthon de Gourgue (Laurent-Marc-Antoine), de Cazeaux, de Spens d’Estignols de Lancre (Joseph), Arnaud de Lavie, de Spens d’Estignols de Lancre (François), Montalier de Grissac, de Conilh, Le Blanc de Mauvezin, de Sallegourde, Pelet d’Anglade, d’Arche de La Salle, de Lalande, de Ragueneau (Pierre), Desnanots, d’Augeard, d’Augeard de Virazel, de Verthamon d’Ambloy (Jean-Baptiste), de Lacolonie, de Labat de Savignac, de Ragueneau (Jean-Joseph), de Meslon (Nicolas), de Basterot, de Fonteneil, Desmoulins de Maspérier, Duluc (Laurent), de Loyac, Pocquet de Lislette, Dalon, de Piis, de Thilorier, de Gourgue de Thouars, de Brivazac, de Féger, de Mons de Saint-Pauly, Souc du Plancher, de Lamolère, de Jaucen de Poissac, Basquiat de Mugriet, de Prunes du Vivier, de Lagubat, Duval, de Gobineau, de Marbotin du Mirail, de Raigniac, de Verthamon d’Ambloy (Martial-François), Jean-Luc d’Arche, de Richon, de Paty du Rayet, de Gères de Louppes, Pérès d’Artassan, Dumas de La Roque, Martin de La Salle, de Conilh fils, Barthélemy de Filhot, de Sentout, Bienassis, Leydet, de Meslon (Jean-André), de Biré, Roche, Bouquier, Mercier-Dupaty, de Castelnau d’Essenault.—Ce dernier figure sur la liste officielle de la nouvelle Compagnie judiciaire, mais on se ravisa sans doute après l’avoir épargné, car une correspondance faisant partie de la collection Delpit établit qu’il fut soumis à un exil rigoureux.
[362] Les appointements étaient ainsi fixés: premier président, 15,000 livres; présidents à mortier, 6,000 livres; présidents à bonnet, 4,000 livres; conseillers de grand’chambre, 3,000; conseillers aux enquêtes, 2,000; procureur général et avocats généraux, 6,000; substituts, 1,000.—Le doyen des conseillers laïcs recevait une pension supplémentaire de 1,500 livres, et le doyen des conseillers clercs une pension supplémentaire de 1,000 livres.
[363] Archives départementales, c. 3631.
[364] M. de Bacalan était titulaire de deux chaires à la Faculté de droit; il désigna pour son successeur Delphin de Lamothe.—Archives départementales, C. 3631.
[365] Journal historique de la révolution Maupeou, II, p. 175.
[366] Le chancelier Maupeou et les Parlements, p. 458.
[367] Les combinaisons de Richelieu avaient abouti au résultat ci-après: premier président, M. de Gascq;—présidents à mortier, MM. de Pichard de Saucats, Duroy, de Bacalan, Jean-Maurice Dusault;—présidents à bonnet, MM. Loret et Rolland;—conseillers clercs, MM. Geneste de Malromé, Monforton, de Meslon (Antoine), Barbeguière;—conseillers laïcs, MM. Dusault père, de Baritault, de Cursol, Drouilhet de Sigalas, Dubergier de Favars, Fauquier, Pelet, de Lamontaigne, Marbotin, Fonteneil, Domenge de Pic de Blais, de Navarre, Maignol, Durand de Naujac, d’Alphonse, Delpy de Laroche, d’Albessard, Chimbaut de Filhot, Chaperon de Terrefort, de Lorman, Dubarry, Amanieu de Ruat de Buch, Laliman, de Lascombes, Garat, Maignol de Mataplane, Dumas de Fombrauge, Taffard, de Boucaud, de Minvielle, Cajus, Chanseaulme, Baritault de Soulignac, Barret, Montalier, Moreau de Montcheuil, de Laroze fils;—avocats généraux, Saige et Dudon de Lestrade;—procureur général, Dudon;—substituts, Bourgade, Duvergier, Laloubie.
[368] Celle qui, au dire de Bernadau, eut le plus de succès, débutait ainsi:
[369] C’était le costume des intendants quand ils venaient au Parlement.
[370] C’est ainsi qu’à l’avenir on désignera les magistrats du nouveau Parlement.
[371] Il se qualifiait écuyer, seigneur de la maison noble de Terrefort, et mourut en 1809.—Laboubée donne sur ses ouvrages et sur lui-même quelques indications intéressantes.
[372] Ajoutons qu’elle s’était imposé des sacrifices au moment de la guerre de 1759. Elle figure, avec MM. de Lalanne, de Gascq, de Tourny, de Montferrand, le maréchal de Richelieu, les Bénédictins de Bordeaux et ceux de La Sauve, etc., sur la liste des personnes qui firent au roi l’abandon de leur vaisselle d’argent.—Gazette de France, février et mars 1760.
[373] On trouve aussi des vers latins dans l’un des mémoires rédigés par Montesquieu à l’occasion de son procès avec la ville de Bordeaux, pour la délimitation des landes de Martillac. Signalons également, à titre de curiosité du même genre, le procès que Lagrange-Chancel, l’auteur des Philippiques, soutint contre son fils, vers 1745. A cette occasion, il adressa un placet en vers à Messieurs du Parlement, une ode à son avocat, Me Boucquier, et divers morceaux de poésie à ceux qui, de près ou de loin, connurent de l’affaire. Son fils répondit également dans la langue des dieux.—Tablettes des bibliophiles de Guyenne, III, p. 8 et suivantes.
[374] C’est en 1778 que se termina le procès de Mme Duplessy avec son fils. Celui qu’elle eut avec M. de Pauferrat, soumis à deux arbitres, MM. de Verthamon Saint-Fort et de Baritault, reçut une solution plus prompte.
[375] M. Alexis de Lamontaigne fut nommé syndic des avocats en 1778, jurat en 1779, clerc de ville en 1784.
[376] Il descendait, par les Lestonnac, de Jeanne de Montaigne, sœur de l’auteur des Essais.
[377] Jean-Laurent Buhan.—Voir la Biographie de Feret.
[378] Elle avait d’abord fixé sa résidence chez son gendre, M. de Lamontaigne. Des difficultés d’ordre intime la décidèrent bientôt à vivre séparément.
[379] Correspondance de Mme du Deffant, édition de Lescure, I, p. 169.
[380] Ces lettres, découvertes par M. Raymond Céleste, qui en a reconnu tout l’intérêt, ont été offertes à la Bibliothèque municipale par M. Rappet, propriétaire du domaine de Fonchereau.
[381] A Bordeaux, une servante coûtait le double.
[382] L’Iris de Guyenne fut fondé en 1763 par un ancien officier nommé Leclerc. Le succès ne couronna pas ses efforts, et il dut cesser sa publication. Une nouvelle tentative, faite en 1773, ne fut pas plus heureuse: l’Iris de Guyenne fut interdit par ordre du roi.—Archives départementales, C. 61.
[383] Pierre-François de Brach, descendant du poète, chevalier d’honneur au Parlement. Il possédait une superbe bibliothèque.
[384] La petite poste, fondée en 1767, avait pour but de desservir Bordeaux et la banlieue. Le tarif des lettres était de deux sous pour la ville, de trois sous pour la campagne. Le port des billets de visite et de cérémonies, non cachetés, n’était que d’un sou. Bordeaux eut sept distributions par jour. Dans la banlieue, il n’y en avait aucune: les gens qui attendaient des lettres devaient aller s’enquérir au bureau.—La paroisse de Montussan était desservie par Saint-Loubès.
[385] Le plus souvent la lettre accompagne un déshabillé contenant une cargaison d’objets disparates: éventails, bourses à la petite-maîtresse, se fermant par un anneau, pantoufles, médecines, oignons de tulipe, tabac d’Espagne, lunettes d’approche, perruques, caracos, etc.
[386] «Votre parenté avec elle, écrit Mme Duplessy, c’est qu’elle descend de la fille de Montaigne. C’est son avocat qui me l’a dit: il connaît très bien sa généalogie.»—Voir Michel de Montaigne, par M. Malvezin, p. 194.
[387] Beaujon avait recueilli dans son magnifique hôtel quatre des plus jolies femmes de Bordeaux. Mme Duplessy fournit, sur ces dames et les splendeurs dont elles étaient entourées, de curieux renseignements.
[388] La recommandation ne fut que trop fidèlement observée, car beaucoup de gazettes, ne faisant pas corps avec les lettres, ont disparu, déchirées sans doute par la destinataire.
[389] Les jurats recevaient, dans certains cas, des contributions en nature dont ils se montraient fort jaloux. C’est ainsi qu’en échange de ses lettres de bourgeoisie, tout nouveau promu devait adresser à chacun des membres de la Jurade cinq livres de café, seize livres de sucre et cinq livres de bougie.—Correspondance de Mme Duplessy.
[390] Histoire poétique du Parlement, par Cizos-Duplessis.—On peut juger de la dépopulation de Bordeaux d’après celle de Paris, où l’on calcula que plus de cent mille personnes s’étaient retirées à la campagne.—Lettres de Walpole, édition Didier, p. 257.
[391] Collection Itié: lettre de Mme Du Lyon de Campet.
[392] Voyage du duc de Richelieu à Bayonne, p. C.
[393] Cet échange fut effectué avec le président de Lalanne.
[394] Collection Itié.
[395] Mme Duplessy rapporte le fait dans les termes suivants: «La présidente de Gourgue est ici, fort malade. Elle a perdu un œil et l’on craint qu’elle ne perde l’autre. On l’attribue à une robe qu’elle a voulu broder pour s’amuser dans son exil... La pauvre femme paie bien cher l’ambition qu’elle a eue d’être présidente.»
[396] Bordeaux marchait sur les traces de Paris où un Wauxhall et un Colisée venaient d’être installés sous le patronage du roi. M. de Gascq, au nom des actionnaires, poussa avec ardeur à l’établissement de ces nouveaux lieux de plaisir, qui avaient l’avantage de retenir les étrangers. Il s’expliquait dans les termes suivants à propos du Wauxhall: «Si la ville avait donné deux millions à un entrepreneur pour mettre à exécution une pareille idée, il n’eût pas été assez payé en proportion des avantages qu’il lui en revaudra. Le Bordelais est trop réprobateur des nouveautés sans les examiner. Il faut les embellir et leur faire du bien malgré eux. Il y a quarante ans que celui qui a établi en Saxe la manufacture de porcelaine, voulut s’établir auparavant à Bordeaux. Les jurats de ce temps-là traitèrent cet homme comme le valet du tambourineur par complaisance pour M. Hustin qui faisait des pots de chambre de faïence et qui avait de la jalousie de ce particulier qui a enrichi la ville de Dresde. Vous savez les belles réflexions d’un de vos notables qui ont privé la ville d’un jeu de paume. Au lieu de lui mettre des manches pendantes avec des oreilles d’âne, on eut la faiblesse d’adhérer à ses misérables remontrances.» (Correspondance de M. de Gascq: lettre à M. d’Arche, du 26 novembre 1769.)
[397] Depuis longtemps, il nourrissait le projet de visiter la Guyenne. Le 11 juillet 1773, il écrivait à Richelieu: «J’ai toujours été tenté de venir passer un hiver avec vous, je n’ai pu exécuter ce dessein.» Un an plus tard, il manifestait le même regret: «J’ai connu, disait-il, que le ciel s’opposoit à mon voyage de Bordeaux, et qu’il falloit que je mourusse dans mon trou.»
[398] Le prince-archevêque fut, à son arrivée, le 22 juin 1772, reçu chez le jurat, M. d’Arche. On y chanta, en son honneur, une cantate mise en musique par le sieur Faiseau, organiste de Saint-André.
[399] Mme Duplessy fournit, dans diverses lettres, les renseignements les plus détaillés sur ce sinistre. De son côté, M. de Lamontaigne a recueilli, sur ce même événement, de précieuses indications dont on trouvera la nomenclature à la page 384 de la Table historique de l’Académie.
[400] Chronique de Gaufreteau, II, p. 171.
[401] L’officier promit de ne pas les dénoncer; mais il ne tint pas son serment. Trois des mutins furent arrêtés; les autres désertèrent.—Journal historique de la révolution Maupeou, IV, p. 186.
[402] Correspondance de Mme Duplessy.
[403] Des habitants de cette province envoyèrent à Mme Dubarry un échantillon du pain, moitié son et moitié avoine, dont ils étaient contraints de se nourrir.
[404] On envoya, en effet, le régiment de Condé-cavalerie, dont la ville paya chèrement les services, si l’on en juge par la lettre suivante: «Le régiment de Condé-cavalerie est toujours ici, bien qu’il n’y soit plus utile. Le prince a donné ordre aux officiers de se faire défrayer: ils demandent cinquante mille francs par mois. L’intendant veut faire supporter cette charge par la ville. Cependant le régiment reste toujours jusqu’à ce que la contestation soit finie, et les frais augmentent.» (Journal de la révolution Maupeou, IV, p. 283.)
[405] «On ne parloit, dans les campagnes, de rien moins que du partage des terres. Deux chefs d’attroupement furent pris et condamnés à être fouettés et mis au carcan sur la place de Créon. Ils furent ensuite envoyés aux galères.» (Annales de Bernadau, p. 218.)
[406] Le blé étant encore trop cher pour les petites bourses, la Jurade fit vendre le pain au-dessous de sa valeur et s’engagea à payer la différence aux boulangers. En vue de pourvoir à ces dépenses, elle dut contracter, à Gênes, un emprunt de six cent mille livres.—Archives nationales, H. 92.
[407] Mémoires secrets de Bachaumont: supplément, sous la date du 9 novembre 1773.
[408] «Il court ici un bruit fâcheux sur les exilés. On prétend qu’ils soufflent l’esprit de révolte par des propos indiscrets. Les honnêtes gens n’en croient rien; mais est-ce le plus grand nombre?» (Correspondance de Mme Duplessy.)
[409] Archives départementales, C. 3313.
[410] Louis XV s’éteignit le 10 mai 1774.
[411] «C’est, dit Mme Duplessy, le premier exemple qu’elles aient resté muettes en pareil cas. On assure qu’à la mort de Louis XIV, elles furent toutes en mouvement à l’arrivée du courrier qui l’annonça, et pendant quarante jours.»
[412] Lorsqu’un prince décédait d’un mal épidémique, ceux qui l’avaient approché ne pouvaient, avant l’expiration de six semaines, paraître devant son successeur.
[413] Journal de Collé, III, p. 29.
[414] M. de Noailles avait été, en 1768, nommé lieutenant général de la Basse-Guyenne. En 1775, on l’investit du commandement en chef de la province, en l’absence de Richelieu. Les lettres-patentes qu’il reçut furent présentées par M. de Ségur et «plaidées» par Romain de Sèze.
[415] «Voici de quoi on l’accuse. Il étoit à Limoges avec son régiment auquel il voulut faire exercer quelque police au détriment des juges de cette ville, lesquels s’adressèrent à un chanoine pour porter plainte à M. Turgot dont il étoit connu et aimé. Il écrivit, en effet. M. de Lautrec, ayant été réprimandé et ayant su que c’étoit le chanoine qui avoit écrit, aposta, pour le rosser de coups de bâtons, quatre hommes qui lui obéirent si bien qu’il est mort vingt-quatre heures après.» (Correspondance de Mme Duplessy.)
[416] Il y a un an, s’écrie Mme Duplessy, le maréchal l’aurait fait interdire.
[417] Le haut négoce se hâta de lui rendre ses politesses. La Bourse offrit un souper à vingt francs par tête; puis, ce fut le tour de la Chambre de commerce qui donna un dîner, un bal et une représentation théâtrale exécutée par des amateurs.
[418] Mémoires de Mme Campan, édition Barrière, p. 71.
[419] Sa remplaçante, la duchesse de Villars, reçut elle-même une augmentation de gages de quarante mille livres. «Tout cela épouvante, constate Bachaumont, et prouve que l’économie projetée ne se réalise nullement.»
[420] «Je ne sais, dit ailleurs Mme Duplessy, si sa cour sera nombreuse, mais on est bien prévenu sur ses hauteurs. Pour moi, peu m’importe, car j’ai bien renoncé aux grandeurs. Mme de Secondat me disoit hier—car elle dîna avec nous—qu’elle n’ira point la voir.»
[421] On vit un prélat élégant mettre son équipage et ses harnais en harmonie avec la couleur «cheveux de la reine». (Mémoires du comte de Paroy, p. 6.)
[422] Correspondance de Mme Duplessy.—Nous ne jurerions point que cette anecdote n’eût vu le jour à Paris.
[423] Archives historiques de la Gironde, XXVI, p. 203.
[424] Fleury, le 12 avril 1737, s’en expliquait dans ces termes avec l’intendant Boucher: «J’ay reçu, Monsieur, votre lettre du 6 de ce mois au sujet de la Société qu’on nomme francs-maçons, dans laquelle M. de Montesquiou (sic) s’est fait recevoir. Il ignore sans doute que le roi a fort désapprouvé cette association et qu’il ne s’en fait plus icy. Vos réflexions sur cela sont très justes. Vous avez très bien fait de défendre par provision à M. de Montesquiou de s’en mesler, et je vous prie de lui faire savoir en particulier les intentions de Sa Majesté.» (Archives historiques de la Gironde, XXVI, p. 202.)
[425] Des Corps politiques, édition de 1766, II, p. 10.
[426] Archives départementales, C. 3314.
[427] Un avocat, du nom de Cailhavet, fut la cause de cette dispute que marquèrent les péripéties les plus curieuses. Elle ne prit fin qu’après une menace adressée par le garde des sceaux d’incorporer les récalcitrants dans les patrouilles de la ville.
[428] Le débat avait été fort vif. Me Buhan parla dans le même sens que Me Polverel. Me de Sèze, dans une remarquable harangue rapportée par Henri Chauvot, soutint l’opinion contraire, malgré son attachement à une magistrature, «entourée du respect des peuples, qui avoit toutes ses sympathies.» (Le Barreau de Bordeaux, p. 47.)
[429] Détail intéressant: on avait supprimé les épices, mais on maintenait les taxes au clerc du rapporteur... Un changement de nom; mais la redevance restait la même.
[430] Le chancelier Maupeou et les Parlements, p. 482.—En dehors des droits en question, le ressort de Bordeaux devait payer chaque année 274,700 fr., soit pour gages, soit pour annuités: on était loin des 40,000 livres d’épices.
[431] On peut dire que jusqu’à la Révolution, le Barreau bordelais resta uni au Parlement. En 1785, il faisait, en l’honneur de la Compagnie judiciaire, une manifestation éclatante à la suite de laquelle les deux syndics, MMes Plassan et Buhan, furent exilés, l’un à Mézin, l’autre à Mont-de-Marsan. (Le Barreau bordelais, par H. Chauvot, p. 69.)
[432] M. Le Berthon, comme beaucoup de ses collègues, appartenait à la franc-maçonnerie. Il était vénérable d’honneur perpétuel de la loge de Saint-Jean, connue sous le titre de la Française élue Écossaise. Le vénérable en exercice était le comte de Béarn, capitaine de haut bord et lieutenant de maire, et l’ex-maître était M. Le Berthon de Virelade, président à mortier. (Les Loges maçonniques de l’Angoumois, de la Saintonge et de l’Aunis, par Jules Pellisson, p. 24.)
[433] Durant l’exécution des travaux, le Béquet fut transformé en lieu de pèlerinage où défila tour à tour la population entière.
[434] Elle mourut à Bagnères en août 1774.
[435] C’est l’indication fournie par Mme Duplessy. Quelques-uns des exilés, pressés par le besoin ou cédant aux menaces, avaient consenti à se laisser liquider, c’est-à-dire à recevoir le prix de leur charge, moyennant la remise de leur démission. Les esprits étaient si montés qu’on leur fit un grief d’une décision à laquelle la plupart n’avaient pu se soustraire, et qu’on les traita d’une façon presque aussi cruelle que les simples Restants.
[436] C’est sur les conseils de M. Le Berthon que Gensonné se décida à embrasser la carrière du Barreau. (Le Barreau de Bordeaux, par Henri Chauvot, p. 166.)
[437] Les illuminations continuaient encore à la date du 2 mars. Le 3, Mme Duplessy s’exprime en ces termes: «Vous ai-je dit qu’hier soir toute la ville fut illuminée? Les vitriers furent occupés tout le jour à faire des lanternes de papier, sur le devant desquelles étoient peintes les armes de M. Le Berthon, c’est-à-dire une aiguille couronnée, et, en bas, en grosses lettres: Vive Le Berthon, premier président. Je les ai vues, mais je n’en ai pas fait l’emplette. Elles se vendent douze sols pièce. J’ai été dîner chez ma cousine, et j’ai passé rue du Loup, sous un arceau de laurier qui tenoit d’un côté de la rue à l’autre. Au milieu étoit une espèce de tambour blanc, aussi entouré de lauriers, où étoit écrit d’un côté: Vive le Roi et Le Berthon, premier président, et, de l’autre côté: Vive le Parlement et Noailles. On m’a dit qu’il y en avoit une grande quantité dans les autres rues.»
[438] La réouverture du Parlement eut lieu le 2 mars 1775, non au palais de l’Ombrière, abandonné depuis deux ans, mais au collège de la Madeleine, devenu libre par suite de l’expulsion de la Compagnie de Jésus. On y avait également installé la Cour des Aides et le Bureau des finances. Quelque temps après son retour, M. Le Berthon, gêné par le voisinage des prisonniers, qu’on avait également transférés dans la rue du Mirail, rétablit l’ancien ordre de choses.
[439] Me Polverel quitta plus tard le Barreau de Bordeaux, «où il était très renommé, et alla se fixer à Paris. C’est lui qui, en 1793, fut envoyé à Saint-Domingue par la Convention nationale, et que la voix publique a accusé d’être le premier moteur des troubles qui ont désolé cette colonie durant la Révolution.» (Annales de Bernadau, p. 220.)
[440] Notes de Laboubée.
[441] Cizos-Duplessis est une des figures les plus curieuses de l’ancien Bordeaux. Tour à tour comédien, journaliste, avocat, auteur dramatique, chirurgien, magistrat, il eut une vie aussi mouvementée qu’extraordinaire.
[442] M. de Gascq ne survécut pas longtemps à sa disgrâce. Il partagea sa fortune entre M. Valdec de Lessart, le ministre de 1791, et Mmes de Piis et d’Escoussan.
[443] Ce qu’il y a de piquant, c’est que cette boutade se produisit en pleine assemblée des Chambres.
[444] La querelle redoubla de violence à l’époque où M. Dudon de Lestrade fut appelé à remplacer son père dans la charge de procureur général. Les Mémoires secrets de Bachaumont fournissent divers renseignements à cet égard.
[445] Le 13 septembre 1771.
[446] Papiers de l’Académie: lettre du Père François du 18 octobre 1771.
[447] Un contemporain annonce son décès dans les termes suivants: «Le pauvre président Barbot n’est plus. Il mourut vendredi, il fut enterré hier, l’Académie fit les honneurs de ses funérailles. Vous imaginerez sans peine combien il est généralement regretté, parce que vous savez combien il méritoit de l’être...» (Table historique de l’Académie, p. 345.)
[448] M. de Lalanne mourut le 14 juillet 1774. «C’est, dit Mme Duplessy, d’un coup de sang qui lui ôta la parole au premier moment, et il ne l’a point recouvrée; je le regrette beaucoup. Il avoit bien du mérite, comme vous savez, et de l’amitié pour moi.»
[449] Correspondance de Mme du Deffant, édition de Lescure, II, p. 266.
[450] Correspondance de Mme Duplessy.
[451] Conseiller-clerc au Parlement de Paris.
[452] Il était vénérable de la loge la Candeur.—On profita de son passage pour lui faire poser la première pierre de la loge l’Amitié. (Annales de Bernadau, p. 229.)
[453] La fête offerte par les francs-maçons au duc de Chartres coûta 14,630 livres. Le banquet fut compris, dans la dépense, pour une somme de 4,656 livres. (Victor Louis, par Charles Marionneau, p. 279.)
[454] Ainsi que nous l’avons fait connaître, les propriétaires-terriens sur lesquels, en définitive, rejaillissait la majeure partie des taxes, étaient depuis longtemps fort éprouvés. L’exil avait été aussi une cause de dépenses, beaucoup de familles ayant conservé leur personnel de ville pendant qu’elles résidaient hors de Bordeaux. Les habitudes de luxe introduites par Richelieu ne devaient pas non plus être étrangères à cet état de choses. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’on voit, à la fin du règne de Louis XV, décliner, dans des proportions considérables, les fortunes des parlementaires.
[455] C’est Richelieu qui, le premier, appela les femmes du négoce à figurer auprès des femmes de la noblesse et de la robe.
[456] Pour le passage du duc de Chartres, M. de Clugny donna une fête qui lui coûta cinquante mille livres: une douzaine de poires y figurèrent pour cinquante écus. On installa dans le jardin de l’Intendance un édifice en bois dans lequel on joua pendant deux jours. Quelques Chartronnais avaient, dans ce but, constitué une bourse de trois cent mille livres pour se mesurer «décemment» avec Son Altesse Sérénissime. Ce sont les suites de cette partie, où furent risquées des sommes folles, qui donnèrent lieu à l’incident auquel nous venons de faire allusion. Mme Duplessy en rend compte dans les termes suivants: «L’intendant, dont la fête a été, de l’aveu de tout le monde, la plus belle et la mieux ordonnée, avoit résolu de laisser subsister ses décorations jusqu’à dimanche pour satisfaire la curiosité du public; mais voyant qu’il ne pouvoit pas faire cesser le jeu, dont les acteurs augmentoient même à chaque instant, lundi il les fit prier fort honnêtement de se retirer au moins à six heures—ce dont ils ne tinrent compte. Et comme il vit que les pelotons de joueurs se multiplioient sans cesse, il prit le parti, après six heures, de faire mettre par M. Louis, architecte, les ouvriers nécessaires pour tout abattre; ce qui força les joueurs et joueuses d’abandonner la partie, peut-être en jurant contre un homme que leur indiscrétion forçoit à détruire sa maison pour les en chasser.»
[457] Avril 1776.
[458] Correspondance de Mme Duplessy.
[459] Le problème fut résolu en faveur des deux états—robe et épée.
[460] L’enthousiasme pour Necker n’était pas moins vif: ses Comptes, imprimés à un grand nombre d’exemplaires, furent enlevés en moins de quatre jours.
[461] «On me dit hier que les actionnaires avoient fait mettre à la porte de la Comédie un tronc avec ces mots: pour les pauvres, et qu’un mauvais plaisant avoit ajouté au-dessous: actionnaires... On fait courir contre eux des vers, des libelles..., etc.»
[462] «Le 13 novembre 1782, est décédée, dans la communion des fidèles, rue du Cahernan, dame Marie Chazot, veuve de messire Duplessy-Michel, conseiller au Parlement, âgée d’environ quatre-vingts ans, et a été inhumée le lendemain dans l’église Saint-Projet où elle avoit sa sépulture. Présents, les bénéficiers.—De Roullier, vicaire.»
Mme de Cursol mourut à Fonchereau le 24 frimaire an XIII.
[463] Duplessis, au lieu de Duplessy.

| Introduction | 5 à 13 |
| Chapitre I | 15 à 31 |
| M. de Chazot et la famille Duplessy.—Mariage de Mlle de Chazot: débuts de son salon.—L’hôtel du Jardin-Public: ses collections, sa bibliothèque.—Réception de Mme Duplessy à l’Académie des Arcades.—Élisabeth Duplessy.—Dom Galéas, l’ami Patience.—État des esprits. | |
| Chapitre II | 33 à 53 |
| Les intimes de Mme Duplessy.—Jean-Jacques Bel et Le Nouveau Tarquin.—Le Père François Chabrol.—Un disciple d’Épicure: le président Barbot.—Querelle entre le Parlement et la Cour des Aides.—L’Ermite de Roaillan: M. de Lalanne.—MM. de Ségur, de Gascq, de Caupos, de Marcellus, de Navarre, de La Tresne, de Raoul...—Mme de Pontac-Belhade: ses rapports avec l’Académie.—Sœur du pot-au-feu: la duchesse d’Aiguillon. | |
| Chapitre III | 55 à 71 |
| Montesquieu: sa jeunesse, ses condisciples à Juilly, son passage au Parlement.—Publication des Lettres persanes.—Voyages à Paris.—Succès féminins.—L’Académie lui est fermée.—Vente de son office.—Visite au cardinal Fleury.—Seconde élection.—Détracteurs et jaloux.—Premiers déboires.—Retours à Bordeaux. | |
| [p. 444] Chapitre IV | 73 à 89 |
| Montesquieu à l’hôtel Duplessy: sa tenue, ses manières, son langage dans l’intimité.—Venuti, abbé de Clairac.—L’abbé comte de Guasco: plaisanteries à son adresse.—Épigramme de Thémire contre les Agenais.—Impressions de voyage en Autriche, en Angleterre, en Italie: Souvenirs de Florence. | |
| Chapitre V | 91 à 107 |
| L’esprit parlementaire à Bordeaux.—Sentiments politiques et religieux.—Le jansénisme n’y fait pas fortune.—Tendances de Montesquieu: détachement philosophique.—Influences qu’il subit.—Mise au point de ses œuvres.—Collaborateurs bordelais.—Guasco à La Brède.—Jean-Jacques Bel et Barbot, critiques littéraires.—L’Histoire véritable.—Lecture de l’Esprit des lois. | |
| Chapitre VI | 109 à 128 |
| Renaissance littéraire.—Nouveaux salons bordelais.—Mmes de La Chabanne et Desnanots.—Brevets de la calotte.—S. de Lagrange et son poème.—Mme Duplessy auteur.—Denise de Montesquieu: hommage poétique de Guasco.—Publication de l’Esprit des lois.—Mort de Montesquieu. | |
| Chapitre VII | 129 à 156 |
| M. de Tourny: son origine, ses qualités, ses défauts.—Rapports des intendants avec la société parlementaire.—MM. de Foullé et Boucher.—Débuts conciliants du nouvel intendant: ses rêves d’embellissement de la ville.—Querelle avec l’Académie.—Rupture avec le Parlement: affaires des grains, du théâtre et du terrier de Guyenne.—Le président Le Comte de La Tresne.—M. de Grissac: quatrain en son honneur.—MM. Le Blanc père, Le Blanc de Mauvezin, Dudon, de Carrière.—Intervention de d’Aguesseau.—Reprise des hostilités: MM. de Cazeaux, de Combabessouze, de Sallegourde, Drouilhet, Vayssière de Maillat.—Sentiment de d’Argenson.—Opinion publique, d’après M. de Lamontaigne. | |
| Chapitre VIII | 157 à 176 |
| Impopularité de M. de Tourny.—Fédération des Parlements.—Rejet des édits fiscaux et cessation du cours de la justice.—Capitulation du roi.—L’aumônier des condamnés à mort.—Représailles de la Jurade contre les trésoriers de France.—Le comte [p. 445] d’Hérouville et Mlle Lolotte.—L’affaire du prieur d’Auriac de Boursac.—Révocation de M. d’Hérouville.—Remplacement de M. de Tourny par son fils: un singulier intendant. | |
| Chapitre IX | 177 à 200 |
| Bordeaux vers 1760.—État de la ville.—Moyens de communication: voitures publiques et privées, poste aux lettres, courriers.—L’Ordinaire, le Carrosse, les Messageries.—Signalements de la police.—Distractions: bals, combats d’animaux, théâtres.—Mlle Clairon: révolution dans l’art dramatique.—La place du Palais, la place Royale, la Bourse, la porte Dauphine.—Prétentions nobiliaires.—Les Annonces-Affiches.—Le fort du Hâ. | |
| Chapitre X | 201 à 219 |
| Nomination de Richelieu.—Campagne de Mme d’Aiguillon en sa faveur.—On le chansonne à Paris.—Hostilité de Mme de Pompadour.—Arrivée en Guyenne.—Spontanéité de la joie publique.—Succès mondains du maréchal.—Le jeu à Bordeaux.—Aventure de Mme Caillou.—Le tripot du duc de Duras.—Lésinerie de Richelieu.—Appréciation à son égard de la marquise de Créquy.—La cabane de Philémon. | |
| Chapitre XI | 221 à 239 |
| La comtesse d’Egmont.—Son séjour à Bordeaux.—La fête de M. Lafore.—Le consul de Suède, M. Harmensen.—L’orme de la bonne duchesse.—La Bordelaise sous Louis XV.—L’Anglais à Bordeaux, de Favart.—La guerre de 1758.—Voyage de Richelieu à Bayonne: campagne en faveur de la danse.—Les Volontaires d’Egmont. | |
| Chapitre XII | 241 à 267 |
| Mme d’Egmont à l’hôtel Duplessy.—Le culte de Rousseau.—Rulhière et le marquis de Saint-Marc.—MM. de Lamontaigne, Risteau, Pelet d’Anglade, de Lamothe, Baritault de Soulignac, d’Albessard, etc.—Le président de Lavie et ses œuvres.—Paul-Marie-Arnaud de Lavie.—Joseph Vernet.—Hommage de Barbot à Thémire.—Un cénacle de jeunes femmes: satire anonyme.—Économistes et savants: le chevalier de Vivens, M. de Romas et ses expériences, l’abbé Baudeau à la recherche de sa voie.—Une lecture de Dom Galéas. | |
| [p. 446] Chapitre XIII | 269 à 285 |
| L’inoculation en Guyenne.—Épreuve tentée par Mme d’Egmont: son départ de Bordeaux.—Reconstitution du théâtre.—Société d’actionnaires.—Les débuts de Mlle Émilie.—Chansons contre le maréchal: incarcérations au fort du Hâ.—Le cadet des Labottière.—Albouis-Dazincourt.—Procédés de Richelieu.—Fêtes en son honneur: la Belle Jardinière.—Représentations offensantes pour la morale: le Galant Escroc. | |
| Chapitre XIV | 287 à 309 |
| Les parlementaires bordelais.—Opinion d’Henri IV.—Conflits entre ce prince et la Compagnie judiciaire.—Gages et épices au XVIIIe siècle.—Origine des fortunes de la robe.—Composition du Parlement.—Éléments anciens et éléments jeunes.—Débats politiques et financiers.—André-François-Benoît Le Berthon: son fils Jacques-André-Hyacinthe.—Luttes contre le maréchal de Richelieu.—Le Bureau de la grande police. | |
| Chapitre XV | 311 à 337 |
| État de la Guyenne.—Procédés fiscaux.—Maupeou et ses réformes.—Opposition du Parlement de Bordeaux: sa dissolution.—Efforts pour le reconstituer: l’intendant Esmangart et M. de Maillebois.—Le premier président de Gascq et ses nouveaux collègues.—Exil de soixante-cinq officiers de robe.—Rôle joué par les femmes.—Mmes de Gourgue et d’Allogny: lettres de cachet décernées contre elles.—Institution du nouveau Parlement.—Liste des exilés et des Restants. | |
| Chapitre XVI | 339 à 355 |
| Ruine de Mme Duplessy.—Procès avec M. de Pauferrat: mémoires judiciaires.—Installation rue du Cahernan.—Nouvelles habitudes.—M. et Mme de Cursol à Fonchereau.—Vie d’un gentilhomme campagnard.—Correspondance de Mme Duplessy.—Une petite-fille de Montaigne.—Personnages divers. | |
| Chapitre XVII | 357 à 371 |
| Bordeaux durant l’exil des parlementaires.—Mme de Gourgue de Thouars.—Établissements de plaisir.—Le Vauxhall, le Colisée, Bardineau.—Une fin de règne: la grande souberne, épizooties, [p. 447] famine de 1773.—Le socialisme dans les campagnes.—Satires et pamphlets.—Mort de Louis XV: comment Bordeaux porte le deuil. | |
| Chapitre XVIII | 373 à 393 |
| Disgrâce de Richelieu et de ses amis.—MM. Du Hamel, Ferrand, d’Arche, de Métivier, Tranchère, de Lautrec...—Le maréchal de Mouchy et Mme l’Étiquette.—Modes nouvelles: la couleur ventre de la reine.—La franc-maçonnerie en Guyenne.—Montesquieu franc-maçon.—Opinion de Jean-Charles de Lavie.—L’ordre des avocats: Me Polverel.—Poussée de l’opinion en faveur du Parlement.—Nouvelle grève du Barreau. | |
| Chapitre XIX | 395 à 410 |
| Le retour des exilés.—Manifestations populaires.—L’arc de triomphe du Béquet.—Députations et harangues.—MM. Le Berthon et Gensonné.—Les dames du marché et les bouquetières de la place Sainte-Colombe.—Rétablissement de l’ancienne Compagnie judiciaire.—Service religieux des francs-maçons.—Cizos-Duplessis.—Retraite de M. de Gascq.—Querelles persistantes entre Restants et Revenants: insuccès de M. de Mouchy. | |
| Chapitre XX | 411 à 427 |
| Fin de la société parlementaire.—Un mot des survivants de l’hôtel du Jardin-Public.—Le dernier exploit de Dom Galéas.—Réception du duc de Chartres par les loges maçonniques.—Formation d’une société nouvelle.—État des esprits.—Mort de Mme Duplessy. | |
| Index alphabétique | 429 à 441 |
Bordeaux—Imprimerie G. Gounouilhou, rue Guiraude, 11.
Au lecteur.
L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée, mais quelques erreurs clairement introduites par le typographe ou à l'impression ont été corrigées. Ces corrections sont soulignées en pointillés dans le texte. Placez le curseur sur le mot pour voir l'orthographe originale.
La ponctuation a été tacitement corrigée à quelques endroits.