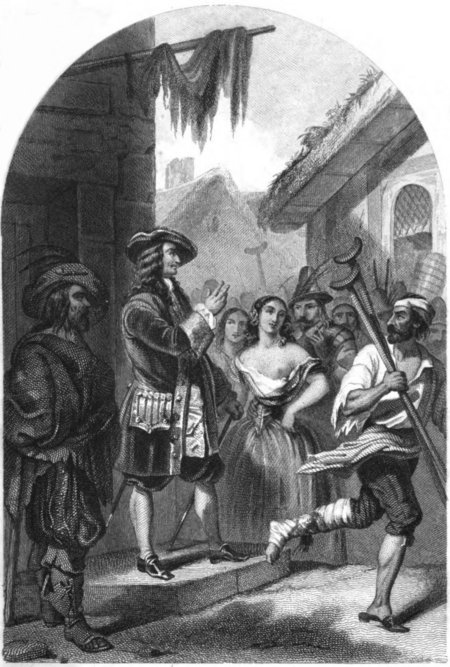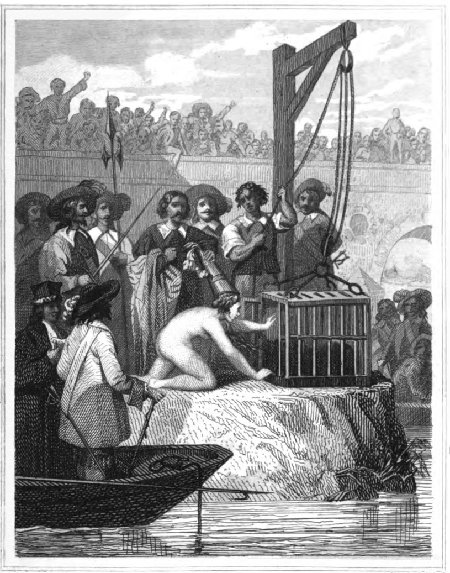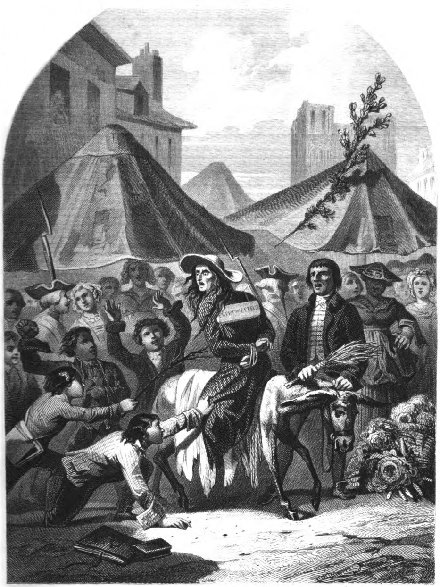*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 43772 ***
Note de transcription:
Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été
corrigées. Il y a une note plus détaillée
à la fin de ce livre.
La Table des matières se trouve ici.
HISTOIRE
DE LA
PROSTITUTION
CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE
DEPUIS
L’ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU’A NOS JOURS,
PAR
PIERRE DUFOUR,
Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes
françaises et étrangères.
ÉDITION ILLUSTRÉE
Par 20 belles gravures sur acier, exécutées par les
Artistes les plus éminents.
TOME QUATRIÈME
PARIS.—1853.
SERÉ, ÉDITEUR, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 52;
ET CHEZ MARTINON, RUE DE GRENELLE-SAINT-HONORÉ, 14.
TYPOGRAPHIE PLON FRÈRES,
RUE DE VAUGIRARD, 36, A PARIS.
HISTOIRE
DE LA
PROSTITUTION
CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE
DEPUIS
L’ANTIQUITÉ LA PLUS RECULÉE JUSQU’A NOS JOURS,
PAR
PIERRE DUFOUR,
Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes
françaises et étrangères.
TOME QUATRIÈME.
PARIS—1852
SERÉ, ÉDITEUR, 5, RUE DU PONT-DE-LODI,
ET
P. MARTINON, RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ, 4.
FRANCE.
HISTOIRE
DE
LA PROSTITUTION.
Sommaire.—Le roi des ribauds.—Recherches sur les prérogatives,
le rang et la charge de cet officier de la maison royale.—Définition
de ses attributions.—Analogie des ministeriales palatini
de Charlemagne avec les rois des ribauds.—Attributions
des ministeriales palatini.—Ribaldus ou ribaud.—Philippe-Auguste
organise les ribauds en corps de troupes soldées.—Témoignages
de bravoure et d’intrépidité de ces hordes pillardes
et débauchées.—Le roi des ribauds.—Avantages honorifiques
et lucratifs de cette charge.—Nu comme un ribaud.—Diminution
successive d’importance de la royauté des ribauds.—La
ribaudie.—Appréciation de la charge du roi des ribauds dans
l’intérieur de la maison du roi.—Recherches sur les gages du
roi des ribauds.—Crasse Joë, roi des ribauds de Philippe le
Long.—Jean Guérin, roi des ribauds du duc de Normandie et
d’Aquitaine, fils de Charles V.—Droits d’exécution et d’aubaine
du roi des ribauds sur certains patients.—Jean Boulart et Pernette
la Basmette.—Le roi des ribauds devait être un fidèle et
incorruptible défenseur de la personne du roi.—Coquelet.—Preuves
de dévouement de Jean Talleran, seigneur de Grignaux,
roi des ribauds de François Ier.—Redevance hebdomadaire des
vassales du roi des ribauds.—Dernière transformation de l’office
du roi des ribauds à la cour de France.—Les dames des
[8]
filles de joie suivant la cour.—Olive Sainte.—Cécile de Viefville.—Des
rois des ribauds relevant de celui de l’hôtel du roi.—Colin-Boule,
roi des ribauds de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.—Le
curé de Notre-Dame d’Abbeville, roi des ribauds.—Balderic,
roi des ribauds de Henri II, roi d’Angleterre et duc
de Normandie.—Attributions des rois des ribauds des villes de
province.—Antoine de Sagiac, commissaire du roi des ribauds
de Mâcon, et Colette, femme de Pierre Talon.
C’est ici que nous avons à faire comparaître un singulier
personnage, que l’histoire ne nous montre pas,
du moins sous son nom caractéristique, avant le règne
de Philippe-Auguste, et qui pourrait bien être contemporain
de Charlemagne. Le roi des ribauds, rex
ribaldorum, fut évidemment, dès l’origine, le souverain
juge de la Prostitution à la cour des rois de
France. Un grand nombre de savants, depuis Jean
Dutillet jusqu’à Gouye de Longuemare, se sont
livrés à de doctes recherches et à d’ingénieuses dissertations,
pour préciser quels étaient les prérogatives,
le rang et la charge de ce bizarre officier de la
maison royale; ils ont cité des textes d’ordonnances,
exhumé des faits nouveaux, fait parler le Trésor des
Chartes, et cherché la vérité au milieu d’un amas de
preuves contradictoires; mais ils ne sont pas tombés
d’accord sur le véritable caractère du roi des ribauds,
à force de vouloir systématiquement l’exalter ou le
ravaler dans ses fonctions, aussi complexes qu’étendues,
aussi bizarres que terribles. Nous allons nous
occuper, après tant de travaux d’érudition et de critique
consacrés à éclaircir ce sujet obscur, de l’office
[9]
du roi des ribauds, que nous regardons comme le
précurseur solennel des commissaires de police d’aujourd’hui.
Nous croyons pouvoir, à ce titre, donner
d’assez longs développements historiques à une sorte
d’enquête sur cet ancien office de cour, qui se rattache
intimement à l’histoire de la Prostitution en
France.
Presque tous les auteurs qui ont parlé du roi des
ribauds, et qui ont essayé de définir ses attributions,
se sont plus ou moins trompés dans la conclusion de
leurs recherches, parce qu’ils n’ont considéré qu’une
des faces de ce personnage et de son office. Ainsi,
Jean Boutillier, qui écrivait sa Somme rurale vers 1460,
représente le roi des ribauds comme l’exécuteur des
sentences et commandements des maréchaux et de leurs
prévôts, à la suite du roi; Jean le Ferron en fait le
premier sergent des maîtres d’hôtel du roi; Carondas,
le sergent ou le commissaire du prévôt de l’hôtel;
Claude Fauchet, le concierge du palais royal; Belleforest,
le prévôt de l’hôtel du roi; Ragueau, le grand
maître des filles publiques; Étienne Pasquier, le bailli
ou le sénéchal des ribauds. Chacun donne au roi des
ribauds une physionomie particulière, un pouvoir
plus ou moins restreint, une dignité plus ou moins
considérable, sans tenir compte des changements
successifs que le temps apporta dans une institution
qui comprenait des devoirs très-divers et très-multiples.
La réunion, par ordre chronologique, de tous
les sentiments des historiens et des jurisconsultes,
[10]
à l’égard de la mystérieuse charge du roi des ribauds,
prouverait que pas un d’entre eux ne s’est expliqué
le rôle que jouait cet officier du palais, à l’époque de
sa création, et la décadence que son emploi a dû
subir, à mesure que d’autres officiers se sont établis,
dans la maison du roi, aux dépens de ses priviléges
et de ses droits. Le roi des ribauds a cessé d’exister,
quand sa qualification est devenue honteuse, quand
son ancienne autorité a passé en plusieurs mains, et
quand ses compétiteurs, portant des noms honorables,
se sont partagé, de son vivant, la succession de sa
charge, tombée en discrédit plutôt qu’en désuétude. Ce
dernier roi des ribauds, à la cour de France, après
avoir vu les plus beaux fleurons de sa couronne disputés
et enlevés par le prévôt de l’hôtel, le concierge
du palais, le prévôt des maréchaux, et d’autres officiers,
de fondation plus récente que la sienne, eut
le chagrin de voir, à l’avénement de François Ier, le
reste de sa vieille suprématie, celle qu’il exerçait sur
la Prostitution suivant la cour, passer entre les mains
d’une dame des filles de joie; c’est ainsi que son
sceptre tomba tout à fait en quenouille.
Nous avons dit, en citant un capitulaire de Charlemagne
sur la police intérieure des domaines royaux
(tome III, p. 319), que les officiers du palais (ministeriales
palatini), préposés à la surveillance et à la
garde de ces domaines, avaient beaucoup d’analogie
avec les rois des ribauds, que nous retrouverons,
quatre siècles plus tard, exerçant la même surveillance
[11]
dans l’hôtel du roi. En effet, ces ministeriales
palatini, parmi lesquels les grands officiers de la couronne
ont pris naissance, devaient avoir l’œil et la
main à expulser des résidences royales tout individu
suspect, homme ou femme, qui y aurait pénétré:
c’étaient surtout les vagabonds (gadales) et les prostituées
(meretrices), qui redoutaient la juridiction du
ministérial palatin; lequel jugeait souverainement les
causes de cette nature et faisait battre de verges les
délinquants. Voilà bien le premier office du roi des
ribauds, et l’on peut dire, avec toute apparence de
raison, que, s’il ne fut nommé ainsi que sous Philippe-Auguste,
il remplissait déjà sa charge sous Charlemagne.
Il est tout naturel que cette charge ait été
instituée d’abord dans ces vastes fermes (villæ) ou
centres d’exploitation agricole et manufacturière, que
les rois francs possédaient sur divers points de leur
empire, et dont les revenus composaient la principale
richesse du fisc royal. Les serfs et les serves, soumis
à certaines lois de police et d’administration, n’étaient
maîtres ni de leurs corps ni de leur temps; on avait
soin d’éloigner d’eux toute influence d’oisiveté et de
Prostitution: leur travail, leur santé et leurs mœurs
se trouvaient de la sorte protégés par une prévoyance
paternelle. Il était donc très-important que des inconnus
ne s’introduisissent pas dans les gynécées et
les dortoirs; la régularité de la vie commune aurait
souffert du contact malfaisant des femmes de mauvaise
vie, et il n’eût fallu que la présence d’un lépreux,
[12]
d’un débauché, d’un larron ou d’un mendiant,
pour répandre la contagion, physique ou morale,
parmi la paisible population de ces retraites
séculières, qui rassemblaient sur un même point
plusieurs milliers d’esclaves des deux sexes. L’officier
à qui appartenait spécialement le soin d’interdire
aux intrus l’entrée et le séjour d’une villa royale,
paraît être le concierge; et son office, en ce temps-là,
équivalait à ceux de grand bouteiller, de grand
camérier et de grand sénéchal. Il n’y eut qu’un nom
à changer pour faire le roi des ribauds.
Les rois mérovingiens et carlovingiens, accompagnés
d’une suite nombreuse d’officiers et de serviteurs,
se portaient sur un domaine ou sur un autre,
pour y faire résidence, et la multitude de personnes,
qu’ils traînaient partout après eux, se grossissait inévitablement
de quantité de femmes étrangères, qu’attirait
l’appât du gain et que la débauche mettait à sa
solde. Il fallait donc une autorité permanente et spéciale
pour maintenir l’ordre parmi cette masse de
gens et pour rendre des arrêts qui exigeaient une
exécution prompte et irrévocable, soit que le roi fût
en voyage ou en chevauchée, soit qu’il se reposât dans
ses terres. De là l’établissement d’un officier ou ministérial
du palais, ayant droit de vie et de mort sur
tout individu qui causait du trouble ou du désordre
dans la maison du roi. Aimoin (liv. V, ch. 10) rapporte
que Louis le Débonnaire chassa du palais une
immense troupe de femmes qui se disaient attachées
[13]
au service de la reine et des sœurs du roi (omnem
cœtum fœmineum, qui permaximus erat, palatio excludi
indicavit), et l’on n’excepta de cette mesure
qu’un petit nombre de suivantes qu’on jugea indispensables
aux besoins du service royal. Mais, sans
doute, cette affluence féminine ne tarda pas à reparaître,
et la cour des rois, des reines et des princes
devint le but de toutes les ambitions faméliques, de
tous les vices intéressés, de toutes les basses domesticités.
On conçoit aisément que la justice expéditive du
roi des ribauds était en pleine vigueur, avant que son
nom eût caractérisé ses attributions ordinaires, et indiqué
l’espèce de gens qui relevaient plus directement
de son tribunal sans appel. Ce nom qualificatif
ne paraît pas antérieur au règne de Philippe-Auguste.
Ce fut sous ce règne, que le mot ribaldus ou ribaud,
dont nous avons ailleurs étudié l’étymologie, fit son
apparition dans la langue vulgaire, et y figura dès
lors en mauvaise part. On désignait ainsi, dans le
principe, les gens sans aveu de l’un et de l’autre sexe,
que nous trouvons errant et butinant autour de l’ost
ou de la chevauchée du roi, et vivant de Prostitution,
de vol, de jeu et d’aumône. Cette tourbe dégradée
s’était prodigieusement accrue avec le prétexte des
croisades, et dans une armée, le nombre des goujats
et valets suivant la cour pouvait être bien supérieur
à celui des combattants. Parmi ces goujats, toujours
prêts au pillage, il y avait des femmes qui entretenaient
l’incontinence et l’impudicité sous l’oriflamme du roi
[14]
et sous les bannières de ses vassaux. Philippe-Auguste
imagina de faire tourner à son profit un mal
nécessaire: au lieu de chercher à se débarrasser du
fléau de la ribaudie par des supplices et des menaces,
ce qu’il avait peut-être essayé inutilement, il
organisa en corps de troupes soldées ces hordes
parasites, qui étaient moins nuisibles à l’ennemi lui-même
qu’à l’armée qu’elles suivaient comme une
nuée de sauterelles dévorantes. Les historiens se
taisent sur la manière dont il enrôla ces enfants
perdus, et dont il les retint, en les disciplinant, à son
service militaire: mais on peut supposer qu’il leur
laissa en partie leurs habitudes pillardes et débauchées,
qu’il ferma les yeux sur leurs excès détestables,
et qu’il ne les empêcha pas d’emmener à la
guerre autant de femmes qu’ils en pouvaient recruter
sur leur passage. Quoi qu’il en soit, cette bande de
ribauds, composée de la lie d’une soldatesque vagabonde
et forcenée, se distingua par de tels faits
d’armes, par de si merveilleux coups de main, par
de si nombreux témoignages de bravoure et d’intrépidité,
que Philippe-Auguste en fit un corps d’élite,
et l’attacha particulièrement à la garde de sa personne.
Les chroniqueurs disent que le roi avait à se
garantir du poignard des assassins, que le Vieux de
la Montagne envoyait sans cesse contre lui, et qui
venaient l’un après l’autre se jeter sur les épées nues
des ribauds du roi très-chrétien. Ces ribauds accompagnent
partout Philippe-Auguste dans ses guerres,
[15]
où ils n’épargnent pas leur sang, animés qu’ils
sont par l’ardeur du pillage. Guillaume le Breton,
qui se plaît à décrire leurs prouesses dans sa Philippide,
les dépeint comme des héros indomptables qui
ne reculent devant aucun péril, et qui ne daignent
pas même se couvrir d’une armure:
Et ribaldorum nihilominus agmen inerme,
Qui nunquam dubitant in quævis ire pericla.
Ailleurs, le poëte nous les montre tout chargés
de butin:
Nec munus armigeri, ribaldorumque manipli,
Ditati spoliis, et rebus, equisque subibant.
Quand Philippe-Auguste vint assiéger Tours, après
avoir subjugué le Poitou, c’est un capitaine ribaud
(duce ribaldo) qu’il choisit pour chercher un gué dans
la Loire; le gué trouvé miraculeusement (quasi per
miracula) par ce capitaine, l’armée traversa le fleuve,
et les ribauds du roi (ribaldi regis, dit Rigord), qui
ont coutume de monter les premiers à l’assaut (qui
primos impetus in expugnandis munitionibus facere
consueverunt), coururent aux échelles, et la ville n’attendit
pas qu’elle fût prise et mise à sac, pour ouvrir
ses portes au roi.
D’après ces passages et beaucoup d’autres du
même genre, il est certain que les ribauds de Philippe-Auguste
formaient une milice très-redoutable,
mais peu disciplinée et capable de toutes les violences.
Le roi, en faveur de leurs services, n’exigeait
[16]
pas d’eux la même soumission et les mêmes devoirs
disciplinaires, que de la part des autres milices; néanmoins,
comme il n’était pas possible, à cause du
mauvais exemple, de laisser tous les crimes impunis
dans cette troupe désordonnée, qui reconnaissait à
peine la voix de ses chefs, et qui, quand elle ne se
battait pas, n’avait pas d’autre occupation que de
faire la débauche, de jouer aux dés, de s’enivrer
et de blasphémer, le roi confia le commandement
suprême de ces indomptables ribauds à un des grands
officiers de sa maison, à celui qui était chargé de la
police intérieure du logis et de l’ost royal, et qui exerçait
traditionnellement une redoutable autorité sur
les auteurs des délits de toute nature commis dans le
domaine de sa juridiction. Cet officier du palais se
présentait ainsi, entouré d’un antique prestige de
respect et de terreur; car il se faisait suivre partout
d’un geôlier et d’un bourreau; il ne mettait pas d’intervalle
entre la condamnation et l’exécution; il prononçait
la peine de mort aussi facilement que des
peines légères, qu’il ne séparait jamais d’une amende
à son profit. La charge de roi des ribauds devint très-lucrative,
tant à cause de ces amendes criminelles,
que des redevances qu’il prélevait sur les brelans,
les tavernes et les filles publiques. Il avait aussi sa
part dans le butin que les ribauds rapportaient de
leurs expéditions, et il s’attribuait même un droit
sur les prisonniers de guerre. On lit, dans la liste des
chevaliers qui furent pris à la bataille de Bouvines,
[17]
en 1214: Rogerus de Wafalia. Hunc habuit Rex Ribaldorum,
quia dicebat se esse servientem. Ce passage
important, cité par Ducange, prouve que le roi des
ribauds prenait la qualité de sergent d’armes du roi,
en temps de guerre; mais il ne nous permet pas de
décider si cet officier de la couronne de France avait
à remplir un rôle actif dans les batailles, et s’il combattait
à la tête de sa bande, comme les autres capitaines.
On pourrait le supposer, d’après une fiction
du Roman de la Rose, composé au treizième siècle
par Guillaume de Lorris, qui fait du roi des ribauds
un capitaine, lorsque le Dieu d’amour rassemble son
armée pour délivrer Bel-accueil de sa prison; mais
le choix qu’il fait de Faux-semblant, pour conduire
la ribaudaille à l’assaut, témoigne assez que la mauvaise
réputation des soldats rejaillissait sur leur
chef. Voici les vers du Roman de la Rose, où le Dieu
d’amour interpelle Faux-semblant, en lui traçant
la conduite qu’il doit tenir:
Faux-semblant, par tel convenant,
Tu seras à moy maintenant,
Et à nos amis aideras,
Et point tu ne les greveras,
Ains penseras les enlever
Et tous nos ennemis grever.
Tien soit le pouvoir et le baux,
Car le roy seras des ribaux.
Il est clair que, dans cette citation, comme le fait
observer Pasquier, le roi des ribauds est représenté
sous la figure d’un capitaine d’armes, et non pas
[18]
avec le caractère d’un magistrat. On a lieu pourtant
de supposer qu’il pouvait être l’un et l’autre, quand on
imagine ce que c’était que les ribauds de Philippe-Auguste,
lors même qu’ils furent organisés en gardes
du corps du roi. Un chef qui n’aurait pas eu la prépondérance
d’un juge, ne fût jamais venu à bout de
discipliner ce ramas de misérables que la crainte
seule pouvait retenir dans le devoir. Tous les historiens
de cette époque sont pleins de sinistres portraits,
qui nous initient à la pénible et dangereuse
mission du roi des ribauds. Écoutons Guillaume de
Neubrige (liv. V, chap. II): «Certains enfants-perdus
de cette espèce d’hommes qui s’appellent ribauds.»
Écoutons Mathieu Pâris: «Des voleurs,
des bannis, des fuyards, des excommuniés, que la
France confond vulgairement sous le nom de ribauds.»
Mais nulle part le genre de vie des ribauds
n’est mieux décrit que dans la Chronique de Longpont,
où le prieur de l’abbaye demande à Jean de
Montmirel ce qu’il comptait faire dans le monde:
«Je veux être ribaud!» répond fièrement le jeune
homme, qui devait devenir un saint canonisé. «Est-il
bien vrai!» s’écrie le prieur stupéfait; «aspirez-vous
donc à faire partie de ces vilaines gens, qui
sont aussi méprisables devant Dieu que devant les
hommes? Est-ce que, pour vous mettre sur le pied
de pareils scélérats, il ne faudra point jurer comme
eux, vous parjurer sans cesse, jouer aux dés, porter
un écriteau (tabellam comportare), traîner avec
[19]
vous une concubine (pellicem circumducere), et être
constamment pris de vin?» On conçoit sans peine
que les rixes et les meurtres étaient fréquents parmi
de tels bandits, et que le roi des ribauds devait
souvent intervenir pour mettre le holà entre ces forcenés,
qui nous apparaissent partout escortés de
leurs ribaudes, aussi rapaces, aussi turbulentes,
aussi incorrigibles qu’eux-mêmes. Il est probable
que la compagnie des ribauds du roi fut licenciée
après la mort de Philippe-Auguste, peut-être à la
suite de quelque révolte; car, si les ribauds figurent
encore dans toutes les croisades, dans toutes les
guerres, dans toutes les chevauchées, ils ne diffèrent
plus des goujats d’armée; ils sont mal armés,
mal vêtus, si bien que le proverbe, nu comme un
ribaud, avait cours dès l’année 1230, suivant une
ancienne Chronique manuscrite dont Ducange a
extrait quelques vers. Guillaume Guiart, qui met en
scène les ribauds dans son poëme historique des
Royaux lignages, les dépeint sous les couleurs les
plus misérables, tantôt:
Bruient soudoiers et ribaus,
Qui de tout perdre sont si baus;
Tantôt:
Ribauz, qui volentiers oidivent,
Par coustume d’antiquité,
Queurent aux murs de la cité.
Tantôt:
Ribaus, qui de l’ost se departent,
Par les chans çà et là s’espardent:
[20]
Li uns une pilete porte;
L’autre, croc ou massue torte.
Enfin, ce ne sont plus des troupes régulières ni
soldées, ce sont des pillards qui dévorent le pays
sur le passage de l’ost royal, et qui, se recrutant de
toutes parts, forment ces bandes redoutables d’aventuriers,
de routiers, de cottereaux, de brabançons,
que la France vit se multiplier avec leurs horribles
excès jusqu’au règne de Charles V: «Tels gens,» dit
une vieille Chronique française, inédite, citée par
Ducange, «tels gens comme cottereaux, brigands,
gens de compagnie, pillards, robeurs, larrons, c’est
tout un, et sont gens infâmes, et dissolus, et excommuniez.»
Le roi des ribauds avait donc beaucoup à faire
avec ces gens-là, surtout quand l’armée du roi était
aux champs; il rendait une justice expéditive, et
présidait quelquefois aux exécutions, pour leur
donner un caractère plus solennel et inspirer plus
de terreur à ses détestables sujets. Mais sa royauté
diminua d’importance, à mesure que le tribunal des
maréchaux augmenta la sienne; car, le roi des ribauds
étant attaché personnellement à l’hôtel du roi,
on ne le voyait figurer que dans les chevauchées où
le roi se trouvait en personne. Partout ailleurs, dans
les expéditions militaires, dans les camps et dans
les garnisons, la connaissance et le jugement de tous
les crimes et délits revenaient de droit aux prévôts
des maréchaux, qui s’emparèrent peu à peu de l’autorité
[21]
du roi des ribauds. Cet officier fut même supplanté
par le grand prévôt des maréchaux, dans
l’ost ou chevauchée du roi, vers la fin du quatorzième
siècle; ce qui faisait dire à Jean Boutillier, que le roi
des ribauds était chargé de l’exécution des jugements
rendus par le prévôt des maréchaux: «Et
s’il advenoit, ajoute-t-il, que aucun forface qui
soit mis à exécution criminelle, le prévost, de son
droit, a l’or et l’argent de la ceinture du malfaiteur,
et les maréchaux ont le cheval et les harnois et tous
autres outils, se ils y sont, reservé le drap et les
habits, quels qu’ils soient, et dont ils soient vestus,
qui sont au roy des ribaux qui en fait l’exécution.»
A l’époque où Boutillier rédigeait sa Somme rurale,
le roi des ribauds n’était plus qu’une ombre, en comparaison
de ce qu’il avait été; son titre même prêtait
à sa déconsidération, et les revenus de sa charge ne
servaient pas trop à l’honorer: «Le roi des ribaux,
ajoute Boutillier, a, de son droit, à cause de son
office, connoissance sur tous jeux de dez, de berlan,
et d’autres qui se font en ost et chevauchée du roy.
Item, sur tous les logis des bourdeaulx et des femmes
bourdellières, doit avoir deux sols la sepmaine.» Ce
n’est pas tout: le pouvoir du roi des ribauds de
l’hôtel du roi était circonscrit dans les limites de sa
juridiction, hors de laquelle agissaient, chacun dans
son centre, une foule d’autres rois des ribauds, préposés
à la police des mœurs, et nommés par les seigneurs
ou par les villes, ou même par les ignobles
[22]
suppôts de leur triste royauté. Là où était une ribaudie,
il y avait naturellement un roi des ribauds.
Cette qualification de roi appartenait coutumièrement
au chef ou à l’élu d’une corporation, notamment
à ceux qui régissaient plusieurs communautés distinctes,
ou qui réunissaient sous leur sceptre un grand
nombre d’individus de professions diverses. Ainsi,
on ne nommait pas de rois, chez les pelletiers, les
épiciers, les boulangers et les autres états, qui n’élisaient
que des maîtres jurés, parce qu’ils ne renfermaient
que des confrères du même ordre et des travaux
de même nature; mais il y avait un roi des
jongleurs, un roi des ménétriers, un roi des arbalétriers,
et enfin, un roi des ribauds. La royauté des
jongleurs ou des poëtes rassemblait, en une seule
corporation, les genres et les talents les plus variés:
les poëtes royaux et les vielleux; les ménétriers, qui
succédèrent aux jongleurs, ou qui les englobèrent
dans les statuts d’une grande confrérie, comptaient
parmi eux, non-seulement les musiciens et les poëtes,
mais encore les baladins, les danseurs et les
mimes. Quant aux arbalétriers, ils se recrutaient
indifféremment dans tous les corps d’état, pour en
composer un qui nommait un roi, choisi par le sort
ou désigné comme le plus adroit tireur d’arbalète.
La ribaudie, composée également d’individus de
toute espèce, vivant d’une foule de métiers malhonnêtes,
tels que filles de joie, courtiers de Prostitution,
débauchés, joueurs, brelandiers, gueux,
[23]
vagabonds et autres de même qualité, la ribaudie,
en un mot, était bien digne d’avoir aussi son roi. Le
roi des ribauds de la cour exerçait assurément, du
moins dans certaines occasions, une suprématie
quelconque sur le commun des rois de la ribaudie.
Claude Fauchet, dans son premier livre des Dignités
et magistrats de la France, nous donne une
appréciation assez juste de la charge du roi des
ribauds dans l’intérieur de la maison du roi: «Celuy,
dit-il, qu’on appelloit roy des ribaux, ne faisoit
pas l’estat du grand prevost de l’hostel, comme aucuns
ont cuidé; ains estoit celuy qui avoit charge de
bouter hors de la maison du roy ceux qui n’y devoient
manger ni coucher; car, au temps passé,
ceux qui estoient délivrez de viandes (qui est ce
que depuis on a dit avoir bouche en cour), après la
cloche sonnée, se trouvoient au tinnel, ou salle commune
pour manger, et les autres estoient contraints
de vuider la maison; et la porte fermée, les clefs
estoient apportées sur la table du grand maistre,
parce qu’il estoit défendu, à ceux qui n’avoient leurs
femmes, de coucher en l’hostel du roy; et aussi,
pour voir si aucuns estrangers s’estoient cachez ou
avoient amené des garces, ce roy des ribaux, une
torche au poing, alloit, par tous les coings et lieux
secrets de l’hostel, chercher ces estrangers, soit larrons
ou autres de la qualité susdite.» Fauchet, qui
était presque contemporain du dernier roi des ribauds,
le représente, dans l’exercice de ses fonctions,
[24]
tel qu’on l’avait vu encore à la cour de
Louis XII; mais Fauchet n’envisage pas cet officier
sous toutes ses faces, et il ne nous le montre pas, à
toutes les époques de sa grandeur et de sa décadence.
Étienne Pasquier a extrait cet article, d’un mémorial
de la Chambre des comptes, sous l’année
1285: «Item, le roi des ribaux a six deniers de
gages, et une provende, et un valet à gages, et
soixante sols pour robbe par an.» Comme, avant
le susdit article, les deux portiers en parlement,
quand le roy n’y est, sont appointés chacun à deux
sols de gages pour toute chose, on a conclu, de ce
rapprochement, que le roi des ribauds, n’ayant que
six deniers de gages, occupait un rang inférieur à
celui de portier; mais il y a peut-être une erreur
dans cet extrait, car le roi des ribauds, outre ses
six deniers de gages et sa provende (ou provision
d’avoine pour son cheval), a soixante sols pour robbe
par an, ce qui ne permet pas de douter que ses
gages de six deniers ne fussent journaliers et en
dehors des revenus de son office. Dans un Compte
de l’hôtel du roi, sous l’année 1312, son valet à
gages est nommé son prévot: Præpositus regis ribaldorum,
qui duxit IV valletos qui vulnaverant, etc. Ce
prévôt commandait évidemment une troupe d’archers
ou de sergents, puisque nous le voyons conduire
en prison quatre valets accusés d’avoir blessé
un homme. Dans un autre Compte de l’hôtel du roi
[25]
Philippe le Long, en 1317, on voit reparaître le roi
des ribauds, en qualité de chef suprême de la police
du palais; après l’énumération des huissiers de salle,
des portiers, des valets de porte, avec leurs gages,
provendes et profits, on lit cet article: «Item,
Crasse Joë, roy des ribaux, ne mangera point à
cour et ne vendra (viendra) en salle, s’il n’y est
mandé; mais il aura six deniers tournois de pain et
deux quartes de vin, une pièce de chair et une
poule, et une provende d’avoine et treize deniers
de gages, et sera monté par l’Escuerie, et se doit
tenir tousjours hors la porte et garder illec qu’il n’y
entre que ceux qui doivent entrer.» Un autre article
du même Compte nous montre le roi des ribauds
en exercice, aux heures des repas, et cet
article est assez conforme à l’idée que Fauchet nous
donne des attributions de cet officier dans l’intérieur
de l’hôtel du roi: «Item, assavoir est que les
huissiers de salle, si tost comme l’en aura crié: Aux
Queux! feront vuider la salle de toutes gens, fors
ceux qui doivent mangier, et les doivent livrer, à
l’huys de la salle, aux varlez de la porte, et les
varlez de porte aux portiers, et les portiers doivent
tenir la cour nette et les livrer au roy des ribaux, et
le roy des ribaux doit garder que il n’entre plus à
la porte, et cil qui sera trouvé défaillans sera pugny
par le maistre d’hostel qui servira à la journée.»
Ainsi, sous le règne de Philippe le Long, le roi des
ribauds se voyait déjà déchu de ses anciens priviléges,
[26]
au point de n’avoir pas bouche en cour, et
d’être subordonné aux maîtres de l’hôtel du roi.
Cette prééminence des maîtres de l’hôtel apparaît
surtout dans un arrêt du parlement du 16 mars
1404, qui nous apprend «que les vallets du roy
des ribaux ne portoient verges, comme faisoient les
huissiers de la salle et portiers de l’hostel du roy,
et que les maistres de l’hostel du roy avoient juridiction
sur lesdits vallets du roy des ribaux.» La
décadence progressive de l’office du roi des ribauds
est encore mieux constatée, par la diminution de ses
gages: un Compte de l’hôtel du roi les fixe à vingt
sous, en 1324; ils ne sont plus que de 5 sous par jour,
en 1350, d’après une ordonnance de Philippe de Valois;
en 1386, une ordonnance de Charles VI porte:
«Le roy des ribaux, quatre sols parisis par jour,
quand il sera à cour, pour toutes choses.»
Cet office de la couronne, malgré sa décadence,
conserva un certain relief jusqu’à ce qu’il fut supprimé
tout à fait, au commencement du seizième
siècle. Dutillet dit «qu’il a esté longuement remply
de gentilshommes de bonne maison et grand
service, l’authorité desquelz contenoit les familles des
princes, seigneurs et autres suyvans la cour du
roy, de bien vivre et payer leurs hostes.» Cependant
l’histoire fait mention d’un roi des ribauds,
qui fut dégradé et mis au pilori avec son prévôt,
pour avoir probablement forfait dans l’exercice de
sa charge. Un Compte de l’hôtel du duc de Normandie
[27]
et d’Aquitaine, fils de Charles V, en 1388,
signale en ces termes ce fait remarquable: «Jean
Guérin, roi des ribaux, pour les despens de lui et
de trois autres, en allant de Corbeil à Sedane mener
Guillet, naguère roi des ribaux, et le Picardiau,
son prévost, pour faire mettre iceux au pilory.» On
pourrait supposer que le roi des ribauds, qu’on menait
de la sorte au pilori, n’avait pas été en charge
dans la maison du roi, mais plutôt dans quelque ville
dépendant de la juridiction du roi des ribauds de
l’hôtel royal. Ce dernier avait droit d’exécution et
d’aubaine sur certains patients qui lui étaient livrés,
après jugement, par les tribunaux ordinaires de
l’hôtel du roi, comme il en est fait mention dans les
registres de la Chambre des comptes, sous l’année
1330: «Les gens des requestes du palais imposent
silence perpétuel à deux femmes qui s’estoient pourveues
contre un arrest de la Chambre, à peine
d’estre livrées au roy des ribaux et d’estre punies
comme infâmes.» Dans un Compte de l’hôtel du
roi, en 1396, soixante-huit sous parisis sont payés,
par la main du roi des ribauds, à l’exécuteur qui
avait pendu un malfaiteur, nommé Jean Boulart, et
fait enterrer vive une femme, nommée Pernette la
Basmette, pour vol de vaisselle de cour au château
de Compiègne. Un roi des ribauds avait fort à faire
dans l’hôtel du roi, quand il voulait remplir exactement
les devoirs de sa charge: il n’assistait pas sans
doute en personne aux exécutions qui lui étaient
[28]
confiées, et son prévôt le suppléait d’ordinaire en
ces désagréables commissions, mais il payait lui-même
le bourreau, et il répondait de la besogne,
que ses valets laissaient à d’autres mains. Ceux-ci,
de même que leur maître, portaient des hoquetons à
l’enseigne de l’épée, dit Dutillet, pour rappeler que
le roi des ribauds avait autrefois exercé la justice
criminelle dans l’hôtel du roi.
Ce personnage devait être un serviteur éprouvé
de la royauté, un fidèle et incorruptible défenseur
de la personne du roi, puisque la garde des portes
et la police intérieure du palais, pendant les repas
et après le couvre-feu, lui étaient spécialement attribuées.
Aussi, n’est-on pas surpris de voir un roi des
ribauds, nommé Coquelet, mourir subitement d’émotion,
au sacre de Charles VI, en 1380. Celui qu’on
regarde comme le dernier titulaire de cette charge,
Jean Talleran, seigneur de Grignaux, fit preuve de
dévouement à la couronne, en conseillant au jeune
duc d’Angoulême, qu’il voyait fort épris de Marie
d’Angleterre, de ne pas s’exposer à donner un héritier
direct au vieux roi Louis XII; ce fut là, pour
ainsi dire, le testament de cette étrange royauté,
qui ne survécut pas à ce conseil de prévoyance politique,
devant lequel le jeune prince, qui fut François
Ier, sentit se refroidir et s’éteindre son imprudent
amour. Le roi des ribauds ne sortait pas trop de
ses attributions officielles, lorsqu’il conseillait de la
sorte son futur souverain, car il n’était point étranger
[29]
aux questions d’adultère; et, selon plusieurs érudits,
il exigeait cinq sous d’or de toute femme mariée, qui
avait un commerce illicite avec un autre homme
que son mari. Mais il est probable que le roi des
ribauds de la cour ne participait point aux priviléges
locaux des autres rois de la ribaudie. Nous avons
peine à lui appliquer, par exemple, ce que dit, de
l’amende des cinq sous sur toute femme adultère, l’auteur
anonyme de l’Histoire des inaugurations (Bévy):
«Si elle refusoit de payer, il avoit droit de saisir sa
selle,» c’est-à-dire probablement sa chaire, ou siége
d’honneur, qu’elle occupait habituellement. Que les
femmes bordelières suivant la cour lui payassent
patente, c’est une circonstance qui n’a rien de contraire
aux us et coutumes du droit féodal, où chaque
feudataire était tenu à des redevances envers son
seigneur. La redevance hebdomadaire des vassales
du roi des ribauds aurait été de deux sous d’or, si
l’on en croit Boutillier et Ragueau. Jean le Ferron,
qui représente cet officier comme gardant la chambre
du roi, n’hésite pourtant pas à l’avilir, en prétendant
qu’il logeait chez lui et hébergeait les filles publiques
à l’usage de la cour. Cette nouvelle attribution,
dont s’enrichit la royauté des ribauds de l’hôtel du
roi, ne nous semblera pas si dénuée de vraisemblance,
quand nous verrons tout à l’heure s’établir,
sur les ruines de cette charge, celle de dame des
filles de joie suivant la cour, charge analogue, qui
fut en plein exercice pendant la majeure partie du
[30]
seizième siècle. Enfin, Dutillet ajoute aux redevances
de ces filles de cour, envers leur roi des ribauds,
qu’elles étaient tenues de faire son lit pendant tout
le cours du mois de mai.
La royauté des ribauds étant tombée en quenouille
après la mort du bon seigneur de Grignaux,
«ce fut une dame, et une grande dame quelquefois,
dit M. Rabutaux, qui resta chargée de la police des
femmes de la cour.» En 1535, elle se nommait
Olive Sainte, et recevait de François Ier un don de
quatre-vingt-dix livres «pour lui aider, et aux susdites
filles, à vivre et supporter les despenses qu’il
leur convient faire à suivre ordinairement la cour.»
(Voy. le Glossaire de Ducange et Carpentier, au
mot MERETRICALIS vestis.) On a conservé plusieurs ordonnances
du même genre rendues entre les années
1539 et 1546, et ces ordonnances font foi que chaque
année, au mois de mai, toutes les filles suivant
la cour étaient admises à l’honneur de présenter au
roi le bouquet du renouveau ou du valentin, qui annonçait
le retour du printemps et des plaisirs de
l’amour. Le 30 juin 1540, François Ier ordonne à
Jean du Val, trésorier de son épargne, de «payer
comptant à Cécile de Viefville, dame des filles de
joie suivant la cour, la somme de 45 livres tournois,
faisant la valeur de 20 escus d’or, à 45 sols
la pièce: dont il lui fait don, tant pour elle que pour
les autres femmes et filles de sa vacation, à despartir
entre elles ainsi qu’elles adviseront, et ce, pour
[31]
le droit du moys de mai dernier passé, ainsi qu’il
est accoustumé faire de toute ancienneté.» Nous ne
sommes pourtant pas de l’avis de M. Rabutaux, qui
confond Cécile de Viefville avec une duchesse de
l’ancienne maison de la Vieuville, qui n’eut des
marquis que sous Henri III, et des ducs que sous
Louis XIV. M. Champollion-Figeac, en publiant cette
remarquable ordonnance dans ses Mélanges historiques
(t. IV, p. 479), n’a eu garde de voir la noble
épouse d’un duc et pair dans l’héritière collatérale
du roi des ribauds de l’hôtel du roi! Cette honteuse
charge subsistait encore en 1558, puisque Gouye
de Longuemare a découvert une ordonnance de
Henri II, en date du 13 juillet de cette année-là, qui
réforme les abus de l’institution: «Il est très-expressément
enjoint et recommandé à toutes filles de joie
et autres, non estant sur le roole de ladicte dame
desdites filles, vuider la cour incontinent après la
publication (de l’ordonnance), avec deffenses à
celles estant sur le roole de ladicte dame, d’aller par
les villages, et aux chartiers, muletiers et autres, les
mener, retirer ni loger, jurer et blasphémer le nom
de Dieu, sur peine du fouet et de la marque; et injonction,
par mesme moyen, auxdictes filles de joie,
d’obéir et suivre ladicte dame, ainsi qu’il est accoustumé,
avec deffense de l’injurier, sous peine du
fouet.» Telle fut la dernière transformation de l’office
du roi des ribauds à la cour de France.
Quant aux autres rois des ribauds, qui relevaient
[32]
certainement de celui de l’hôtel du roi, on les retrouve
partout dans l’histoire municipale des villes,
et aussi dans l’histoire particulière des maisons princières.
Il y avait ainsi, à la cour de Bourgogne, un
roi des ribauds dont les fonctions étaient réglées sur
celles de son confrère de la cour de France. Colinboule
était en charge sous le duc Philippe le Bon,
et ce nom-là n’annonce pas un personnage de haute
distinction. En 1423, il est vrai, le titre de roi des
ribauds avait perdu beaucoup de son éclat, et le curé
de Notre-Dame d’Abbeville ne devait pas être très-flatté
de s’entendre qualifier de roi des ribauds, parce
que les jongleurs, dits ribauds, lui rendaient hommage
et redevance pour leurs représentations scéniques.
On comprend que cette qualification n’était pas
faite pour inspirer du respect à qui savait les excès
des ribauds, que leur roi ne gouvernait qu’à force
de sévérité. Cet officier avait été, dans l’origine,
bien plus considéré et bien plus puissant, car la ribaudie
ne lui avait point encore imprimé la tache de
son nom. Dans une charte de Henri II, roi d’Angleterre
et duc de Normandie, qui régnait en 1154
(voy. Ducange, au mot PANAGATOR), il est question
évidemment de la charge du roi des ribauds; et le
sergent du roi, qui remplit cette charge, Balderic,
fils de Gillebert, honoré des grâces de son maître, et
institué grand prévôt des maréchaux dans la province
de Normandie, est appelé «gardien des filles
publiques qui se prostituent dans le lupanar de Rouen
[33]
(custos meretricum publice venalium in lupanar de
Roth.).»
Dans les villes de province, le roi des ribauds
était tantôt juge, tantôt exécuteur de la justice criminelle
sur le fait de ribauderie. Un ancien registre
de l’hôtel de ville de Bordeaux constate que tout
condamné était «livré au roy des ribauds, pour le
faire courir par la ville, avec bonnes verges et bonnes
glèbes.» Metz avait aussi son roi des ribauds, qui
ne faisait pas un personnage plus relevé. Le roi des
ribauds de la ville de Laon ne vivait pas toujours en
bonne intelligence avec le bailli de Vermandois: en
1270, son prévôt, nommé Poinsard (Poinçardus,
præpositus ribaldorum), fut décrété d’accusation au
tribunal du bailli, pour avoir, de complicité avec les
nommés Jean le Croseton et Wiet Lipois, commis
des actes de violence contre l’abbaye de Saint-Martin
de Laon et son abbé (voy. les Olim, publiés par le
comte Beugnot, t. I, p. 813). Cette affaire motiva
sans doute la suppression de l’office de roi des ribauds
à Laon; car Philippe III, dans une ordonnance
de 1283, ordonne au bailli de Vermandois de ne
pas souffrir que cet office subsiste, sous aucun prétexte,
soit publiquement, soit en cachette (quod, clam
vel palam vel sub aliquo simulato colore, non permittat,
regem ribaldorum in villa Laudunensi). Cette interdiction
d’office ne s’étendait pas à toutes les localités;
car, en 1483, la ville de Saint-Amand avait un «roi
des filles amoureuses,» nommé Jacob de Godunesme.
[34]
Le bourreau de Toulouse prenait le titre de
roi des ribauds, comme pour discréditer encore davantage
cette pauvre royauté. Enfin, la Coutume de
Cambrai définit, sans réticence, les priviléges de son
roi des ribauds: «Ledit roy doit avoir, prendre et
recepvoir, sur chacune femme qui s’accompagne de
homme carnelement, en wagnant son argent, pour
tout, tant qu’elle ait terme ou tiegne maison à louage
en la cité: cinq sols parisis pour une fois. Item, sur
toutes femmes qui viennent en la cité, qui sont de
l’ordonnance, pour la première fois: deux sols tournois.
Item, sur chacune femme de ladite ordonnance
qui se remue (déménage) et va demeurer de maison
ou estuve en autre, ou qui va hors de la ville et
demeure une nuit: douze deniers, touttes fois que le
cas y esquiet. Item, doit avoir une table et brælang
à part luy, sur un des fiefs du palais, ou en telle
place qu’au bailli plaira ordonner.»
Ces articles de la Coutume de Cambrai nous font
connaître d’une manière précise la redevance que le
roi des ribauds de cette ville exigeait non-seulement
des femmes publiques qui étaient à demeure, mais
encore de celles qui ne faisaient que passer sur son
domaine. Cette redevance et toutes celles de même
nature ne s’acquittaient pas toujours sans difficulté,
et les agents du roi des ribauds rencontraient parfois
une terrible opposition. C’est ainsi qu’un certain
Antoine de Sagiac, qui se disait commissaire du roi
des ribauds de Mâcon et suppôt de l’ordre de l’État
[35]
des goliards, ou des bouffons de cette ville, périt
dans une rixe, en 1380, au village de Beaujeu, où
il avait voulu taxer à cinq sous d’amende une femme
mariée, qu’il accusait d’avoir commis un adultère.
Pierre Talon (Calcis), mari de cette femme, nommée
Colette (Cola), et son frère Étienne intervinrent
pour prendre la défense de leur épouse et belle-sœur.
Antoine de Sagiac était un ribaud de la pire espèce,
qui hantait les cabarets et qui vivait aux dépens des
malheureuses qu’il mettait à contribution, sous prétexte
de ribaudie, de goliardie et de bouffonie, en les
menaçant de la prison. Il s’adressait mal cette fois,
et Colette, forte de son innocence, soutint qu’elle
n’avait pas couché avec un autre homme que son
mari; celui-ci se porta garant pour elle de son innocence,
et comme le ribaud voulait se saisir de la
prétendue adultère et la mener à Mâcon, Pierre Talon
et son frère l’assommèrent sur place. Le bailli de
Mâcon instruisit l’affaire contre les meurtriers et
Colette qui était cause du meurtre; mais l’enquête
démontra que le défunt avait accusé à tort Colette de
s’être abandonnée à un autre homme que son mari
(contra veritatem imponens quod ipsa cum alio quam viro
occubuerat), et que ce ribaud (se gerens pro ribaldo et se
dicens de ordine seu de statu goliardorum seu buffonum)
menait la vie la plus scandaleuse dans les tavernes
et les mauvais lieux, en abusant de la simplicité des
femmes les plus honnêtes, qu’il taxait au nom du roi
des ribauds. On sollicita et on obtint des lettres de
[36]
rémission en faveur des prévenus, qui ne furent
pas inquiétés davantage au sujet de la mort
d’Antoine de Sagiac; mais, dans ces lettres, qui
justifiaient Colette, il n’était pas dit d’une manière
formelle que le roi des ribauds de Mâcon n’eût pas
le droit de taxer à cinq sous d’amende chaque femme
mariée convaincue d’adultère (super qualibet muliere
uxorata adulterante, sibi competere et posse exigere
quinque solidos et pro eisdem dictam talem mulierem de
suo tripede pignorare). Le roi de France semblait,
au contraire, reconnaître implicitement cette vieille
redevance de la Prostitution (de talique et alio vili
quæstu), que s’arrogeait la ribaudie de Mâcon.

Sommaire.—État de la Prostitution après l’ordonnance de 1254.—Institution
de la police des mœurs.—Les confrairies des
filles publiques.—Ordonnance de 1256.—Assimilation des
tavernes aux bordeaux.—Les taverniers.—Organisation des
filles publiques par Louis IX.—Les juifs.—Ordonnances
somptuaires concernant les femmes de mauvaise vie.—Statuts
des barbiers.—Les baigneurs-étuvistes.—Statuts des bouchers.—Mort
de saint Louis.—Philippe le Hardi.—Ordonnance
de 1272.—Les aiguillettes et les ceintures dorées.—L’enseigne
des filles publiques de Toulouse.—Bonne renommée
vaut mieux que ceinture dorée.—Courir l’aiguillette et courir
le guilledou.—Les trois brus de Philippe le Bel.—La tour de
Nesle.—Philippe et Gautier de Launay.—Jean Buridan.—L’âne
de Buridan.—État des mœurs après les croisades.—Hic
et hoc.—Les Templiers.
Louis IX avait témoigné de sa candeur et de sa
prud’homie en essayant de supprimer la Prostitution
[38]
dans le royaume de France. L’ordonnance de
1254, dans laquelle il prononçait le bannissement
général des femmes de mauvaise vie, ne fut jamais
rigoureusement exécutée, parce qu’elle ne pouvait
pas l’être. Pour échapper aux sévères prescriptions
de la loi, ces malheureuses femmes n’exercèrent
plus qu’en secret leur méprisable métier, et elles se
couvrirent de tous les masques, pour n’être pas reconnues;
elles recoururent à toutes les ruses, pour
n’être pas surprises en flagrant délit. Sans doute, leur
nombre diminua considérablement, et les débauchés
rencontrèrent plus d’obstacles pour donner satisfaction
à leurs passions honteuses; mais la Prostitution
n’en continua pas moins dans l’ombre ses hideux
travaux, et elle réussit presque toujours à tromper la
surveillance des baillis, des prévôts et de juges. Ce
n’était plus, il est vrai, dans les lieux de débauche
publics qu’elle régnait à certaines heures, sous l’empire
de certains règlements de police; elle se cachait
partout, depuis qu’elle n’avait plus le droit de se
montrer nulle part, et elle existait, avec des apparences
honnêtes et même respectables, au milieu des
villes et dans l’intérieur des maisons particulières,
au lieu de se voir reléguée dans des quartiers déserts
et dans des clapiers infâmes. Les créatures qui s’obstinèrent
à désobéir à l’ordonnance du roi étaient et
devaient être les plus vicieuses, les plus corrompues,
les plus incorrigibles. La nécessité de dissimuler
leur dépravation les obligea, pour ainsi dire, à se
[39]
pervertir davantage, en s’armant d’hypocrisie et de
mensonge; elles ne pouvaient se mettre à l’abri du
soupçon, qu’en affectant des dehors honorables et en
se parant d’une vertu feinte; elles fréquentaient donc
les églises, et ne paraissaient dans les rues qu’un
voile sur le visage et un chapelet entre les doigts.
Quelques-unes, privées de leur impure industrie,
entrèrent dans des communautés religieuses, sous
prétexte de pénitence, et n’améliorèrent pas les
mœurs des couvents.
Mais on s’aperçut bientôt que la Prostitution légale
entraînait moins d’inconvénients que la Prostitution
occulte et illicite; on se convainquit aussi qu’on ne
réussirait jamais à la détruire, et que c’était même
lui donner de nouvelles forces provocatrices, que de
l’obliger à emprunter tous les noms et tous les déguisements.
Les libertins de profession savaient toujours
où trouver les moyens de livrer carrière à leurs
scandaleuses habitudes; ils connaissaient les retraites
de leurs complices, et ils s’y rendaient impunément
à toute heure; ils ne manquaient pas non
plus d’un tact spécial, pour distinguer entre mille
une femme qui faisait trafic de son corps; mais souvent
ils feignaient de se méprendre, et ils s’adressaient
à des femmes d’honneur, qui s’enfuyaient,
indignées d’être en butte à de telles insultes. Les
jeunes gens novices s’abusaient plus naïvement sur
la condition des femmes qu’ils rencontraient seules
et poursuivaient de propos indécents. «Ce fut
[40]
alors, dit Delamare dans son Traité de la Police, et
par ce motif, que l’on changea pour la première
fois de conduite dans ce point de discipline. On prit
donc le parti de tolérer ces malheureuses victimes
de l’impureté; mais, en même temps, de les faire
connoître au public et de les montrer, pour ainsi
dire, au doigt. On leur désigna des rues et des lieux
pour leur demeure, les habits qu’elles pouvoient
porter, et les heures de leur retraite.» Ce passage
du Traité de la Police est très-remarquable, en ce qu’il
fixe une date à cette institution de la police des
mœurs, lorsque cette date n’est établie par aucun
témoignage contemporain, par aucune ordonnance
royale ou municipale; mais le savant Delamare avait
compulsé les anciens monuments de notre jurisprudence,
les registres du parlement, ceux du Châtelet,
ceux de la prévôté de Paris, et il n’eût pas
avancé un fait de cette nature, s’il n’en avait eu sous
ses yeux la preuve: elle résultait probablement des
Statuts de la corporation des femmes folles de leur
corps, Statuts que Sauval cite positivement, et qui
furent rédigés, à cette époque où chaque métier recueillait
avec soin ses vieux priviléges, et les faisait
enregistrer dans les archives du prévôt de Paris.
Nous avons bien l’ordonnance de 1256 (et non de
1254, comme le dit Delamare) qui rétablit l’exercice
de la Prostitution légale; mais, dans cette ordonnance,
il n’est nullement question des rues et
des lieux affectés à la demeure des filles publiques,
[41]
ni de leurs habits ou livrées, ni de leurs heures de
retraite. Néanmoins, comme il appert des ordonnances
postérieures que ces différents détails de
police avaient été réglés avec beaucoup de précautions,
il est tout naturel d’attribuer à saint Louis,
ou plutôt à Étienne Boileau, cette réglementation,
qui se rattache à celle des métiers de Paris. Étienne
Boileau ne fut nommé garde de la prévôté qu’en
1258; mais il jouissait bien auparavant de l’estime
du roi, qui réclamait souvent ses conseils, et qui,
l’ayant choisi pour reconstituer la prévôté, venait
s’asseoir quelquefois à ses côtés, quand Boileau rendait
la justice au Châtelet. «Ce fut ce sage prévôt
de Paris, dit Delamare, qui rangea tous les marchands
et tous les artisans en différents corps ou
communautés, sous le titre de confrairies, selon le
commerce ou les ouvrages qui les distinguoient entre
eux; ce fut lui qui donna à ces marchands les
premiers statuts pour leur discipline.» N’est-il pas
tout simple de comprendre les filles publiques dans
cette vaste organisation des métiers, où le législateur
s’est appliqué à protéger les droits de chacun et à
définir clairement les professions selon leurs coutumes
traditionnelles?
Louis IX consentit donc à modifier son ordonnance
de 1254: en y ajoutant quelques mots qui ne la changeaient
pas beaucoup au premier coup d’œil, il lui
fit dire le contraire de ce qu’elle disait précédemment;
c’était une manière détournée d’admettre à
[42]
tolérance la Prostitution. Voici l’article qui mit à
néant celui de l’ordonnance de 1254: «Item, que
toutes foles femmes et ribaudes communes soient
boutées et mises hors de toutes nos bonnes citez et
villes; especiallement, qu’elles soient boutées hors
des rues qui sont en cuer desdites bonnes villes, et
mises hors des murs et loing de tous lieux saints,
comme églises et cimetières; et quiconque loëra maison
nulle esdites citez et bonnes villes, ès lieus à ce
non establis, à folles femmes communes, ou les recevra
en sa maison, il rendra et payera, aux establis
à ce garder de par nous, le loyer de la maison d’un
an.» C’est en vertu de cette ordonnance, datée de
Paris, que la Prostitution légale, qui avait disparu
pendant deux ans seulement, reprit son existence
régulière sous la protection des officiers royaux; et
toutes les ordonnances qui depuis intervinrent relativement
à la Prostitution, se fondèrent sur cette ordonnance
de saint Louis, qui avait, sinon créé, du
moins réformé la police des mœurs. Les articles qui
précèdent, dans l’ordonnance de 1256, celui que
nous avons cité, ne sont pas tout à fait étrangers à
notre sujet, puisqu’ils placent au rang des débauchés
les joueurs de dés et les blasphémateurs, en assimilant
la Prostitution au jeu de dés et au blasphème.
Le saint roi défend donc à ses sénéchaux, baillis et
autres officiaux et servicials, de quelque état ou condition
qu’ils soient, de dire aucune parole qui tourne
au mépris de Dieu, de la Vierge ou des saints et
[43]
saintes: «Et se gardent, ajoute-t-il, du jeu de dez,
de bordeaux et de tavernes.» Il défend ensuite la
forge des dez par tout son royaume, et ordonne que
tout homme qui sera trouvé jouant aux dés, communément
ou par commune renommée, fréquentant taverne
ou bordel, soit réputé infâme et ne puisse témoigner
en justice. Ces articles de loi prouvent que, sous
ce règne, les tavernes n’étaient pas mieux famées
que les bordeaux; et l’on peut apprécier par là
l’espèce d’hommes et de femmes qui se réunissaient
dans ces repaires de débauche, où l’on n’entrait pas
sans se déshonorer.
C’était un souvenir de la loi romaine que les jurisconsultes
commençaient à étudier, et qui avait
frappé de réprobation les tavernes (tabernæ), où l’on
donnait à boire, à manger, à coucher et à jouer.
Cependant, au moment même où une ordonnance
du roi déclarait infâme quiconque serait convaincu
de fréquenter ces mauvais lieux, le prévôt de Paris
publiait les statuts des taverniers, dans lesquels il
ne s’occupait, il est vrai, que de la vente du vin à
la criée; mais, le premier venu pouvant être tavernier,
pourvu qu’il eut de quoi et qu’il payât les redevances
au roi et à la ville, la corporation, qui se
composait ainsi de toutes sortes de gens, ne devait
pas prétendre à l’estime des gens de bien. Ces taverniers
étaient seulement tenus de mesurer le vin à
loial mesure; ils pouvaient, d’ailleurs, se mêler des
commerces les plus malhonnêtes, en ouvrant leurs
[44]
portes aux ribaudes et aux ribauds, qui passaient la
journée à s’enivrer, à jouer aux dés, à blasphémer
et à commettre les actions les plus coupables. Dans
ce court intervalle de temps où la Prostitution fut
contrainte de se cacher, les tavernes remplacèrent les
bordeaux, et ceux-ci devinrent des tavernes, quand
ils furent rétablis par une ordonnance du même roi,
qui les avait fait fermer avant de s’être rendu compte
de leur utilité. Delamare prétend que ce fut pendant
l’interrègne de la Prostitution légale, qu’on commença
de qualifier en notre langue les filles publiques par
des «noms particuliers et odieux qui désignoient
l’ignominie de leur débauche.» Il semble croire que
ces noms-là furent inventés exprès pour inspirer plus
d’horreur et de mépris à l’égard des créatures qui
méritaient ces injurieuses qualifications: «On eut
sans doute en vue, dit-il, qu’en les faisant ainsi
connoître, la pudeur, si naturelle à leur sexe, viendrait
au secours des loix, et que les hommes auraient
honte eux-mêmes d’être reçus dans des lieux
et avec des créatures notées de tant d’infamie.»
Nous en sommes réduits à des conjectures au sujet
de l’organisation des filles publiques par Louis IX,
ou du moins sous le règne de ce saint roi; mais il
est indubitable que cette organisation a existé, et
qu’elle s’est perpétuée sous les règnes suivants sans
être modifiée d’une manière radicale; car, ce sont
toujours les ordonnances de saint Louis qu’invoquent
les rois ses successeurs, en réglementant la Prostitution
[45]
légale. Nous essaierons, dans un autre chapitre,
de découvrir quelles étaient les rues bourdelières
de Paris, à cette époque. Nous n’avons retrouvé aucun
texte historique qui prouve que les femmes de
mauvaise vie fussent dès lors distinguées des femmes
honnêtes, soit par une marque infamante comme
celle des juifs, soit par des vêtements d’une certaine
couleur caractéristique. Il y a pourtant tout lieu de
croire que Louis IX, qui avait voulu que les juifs
ne fussent pas confondus avec les chrétiens, prit les
mêmes précautions à l’égard des prostituées et les
obligea de porter une marque analogue. C’est en
1269 que les juifs, dont le séjour n’était toléré en
France qu’à des conditions aussi onéreuses que
déshonorantes, se virent obligés, sous peine de
prison et d’amende arbitraire, de coudre sur leur
robe, devant et derrière «une pièce de feutre ou
de drap jaune, d’une palme de diamètre et de
quatre de circonférence,» qu’on appelait rouelle
en français, et rota ou rotella en latin. Depuis, cette
rouelle perdit graduellement sa forme et sa dimension;
elle devint triangulaire et fut nommée billette;
quand elle fut supprimée tout à fait, elle n’était pas plus
grande qu’un écu; mais les juifs versèrent de grosses
sommes dans le trésor de Philippe le Long pour être
délivrés de cette marque d’infamie, que leurs pauvres
conservèrent seuls jusqu’au règne du roi Jean, sous
lequel fut rétablie la rouelle, mi-partie de rouge et
de blanc, de la grandeur du sceau royal. N’est-il
[46]
pas présumable que les filles de joie furent astreintes
également à porter une marque du même genre? Nous
prouverons que cette marque fut en usage dans plusieurs
provinces de France. Nous avancerons, avec
plus de probabilité encore, que, dès ce temps-là, les
ordonnances somptuaires avaient interdit aux femmes
dissolues certaines étoffes, certaines fourrures, certains
joyaux. La première ordonnance connue, où
il soit question d’un règlement de cette espèce, date
de l’année 1360, et se trouve dans le Livre vert ancien
du Châtelet, renfermant les actes de la prévôté
de Paris. Dans cette ordonnance, qui n’est sans
doute que la confirmation d’une autre plus ancienne,
le prévôt de Paris défend «aux filles et femmes de
mauvaise vie, et faisant péchez de leur corps, d’avoir
la hardiesse de porter sur leurs robes et chaperon
aucun gez ou broderies, boutonnières d’argent,
blanches ou dorées, des perles, ni des manteaux
fourrez de gris, sur peine de confiscation.» Il leur
ordonne de quitter ces ornements, dans un délai de
huit jours, après lequel tous sergents du Châtelet
qui les trouveraient en contravention pourront les
arrêter, excepté dans les lieux consacrés au service
de Dieu, et les dépouiller des susdits ornements,
en exigeant cinq sous parisis pour chaque femme
en cas de contravention.
Le prévôt de Paris, Étienne Boileau, confident
des vertueuses intentions de saint Louis, se chargea
sans doute de les mettre en œuvre et de réprimer
[47]
tous les excès de la Prostitution dans la capitale du
royaume. Son Livre des métiers, dans lequel il s’occupe
particulièrement de la constitution industrielle
de chaque corps d’état, ne nous présente, il est
vrai, aucun passage où il se pose en réformateur des
mœurs; mais, comme les statuts des corporations
d’arts et métiers remontent à cette époque, bien
qu’ils n’aient été confirmés par les rois de France
que sous des dates bien postérieures, nous voyons,
dans les statuts et priviléges rédigés par les prud’hommes
et les anciens de chaque industrie, que
la police des mœurs avait été l’objet de l’attention
du prévôt de Paris, qui donna d’abord sa sanction
officielle à cette loi de famille que les rois approuvèrent
plus tard et reconnurent par lettres patentes.
Dans les Statuts des barbiers, confirmés en 1371, il
est interdit aux maîtres du métier d’entretenir des
femmes de mauvaise vie dans leur maison et de favoriser
le commerce infâme de ces malheureuses, sous
peine d’être privés de leur office et de perdre en
même temps tous leurs outils: siéges, bassins, rasoirs
et autres choses appartenant audit métier, qui
seraient vendus au profit du roi et de la boîte (caisse)
de la communauté. Les barbiers, qui étaient souvent
à la fois baigneurs-étuvistes, ne tenaient pas
toujours compte de l’interdiction, et les bénéfices
que leur procurait la Prostitution et le maquerelage
les encourageaient à braver des peines pécuniaires
qu’il fallait sans cesse remettre en vigueur par de
[48]
nouvelles ordonnances. Dans les Statuts des bouchers
de Paris, confirmés en 1381, il est interdit aux
apprentis du métier d’épouser une femme qui aurait
été fille publique ou qui le serait encore: «Item,
se aucun prend femme commune diffamée, sans le
congé du maistre et des jurez, il sera privé de la
Grant Boucherie à tousjours, que il ne puisse taillier
ne faire taillier, soit à luy, soit à autre,
sans les chairs perdre; mais il pourra taillier à un
des étaux du Petit-Pont, tel comme le maistre ou les
jurez lui bailleront ou asserront.» Enfin, d’après les
Statuts des lingères, les femmes diffamées par leurs
mauvaises mœurs ne pouvaient être reçues dans la
corporation; et celles qui avaient réussi à s’y faire
admettre par fraude ou autrement, devaient en être
chassées, à la suite d’une enquête: pour constater
leur expulsion ignominieuse, Sauval (t. II, p. 147)
dit qu’on jetait dans la rue les marchandises que ces
impures avaient touchées.
Tous les efforts de saint Louis et de ses ministres,
pour imposer à la Prostitution un frein salutaire, ne
paraissent pas avoir eu le succès qu’on en attendait;
car le pieux roi, sur la fin de sa vie, s’était repenti
d’avoir laissé au vice une carrière restreinte sous
la protection des lois, et il revint à son premier projet
d’effacer entièrement dans ses États la souillure
des mauvaises mœurs. Lorsqu’il se disposait à s’embarquer
pour la seconde croisade, dans laquelle il
mourut, l’horreur qu’il avait de l’impureté lui inspira
[49]
le désir de mettre à exécution ce grand projet
de réforme. Le 25 juin 1269, il écrivit, d’Aigues-Mortes,
à Mathieu, abbé de Saint-Denis, et au comte
Simon de Nesle: «Nous avons ordonné, d’ailleurs,
de détruire tout à fait les notables et manifestes
prostitutions (notoria et manifesta prostibula) qui
souillent de leur infamie notre fidèle peuple, et qui
entraînent tant de victimes dans le gouffre de la
perdition; nous avons ordonné de poursuivre ces
scandales dans les villes, ainsi que dans les campagnes,
et de purger absolument notre royaume
(terram nostram plenius expurgari) de tous les hommes
débauchés et de tous les malfaiteurs publics
(flagitiosis hominibus ac malefactoribus publicis).»
Cette lettre renfermait un ordre positif que la mort
du roi ne permit pas d’exécuter. Les femmes dissolues
et leur méprisable cortége continuèrent d’exercer
leur métier, en raison des précédentes ordonnances,
et il ne fut donné aucune suite aux vertueux
desseins de Louis IX, qui aurait échoué encore une
fois dans son plan d’épuration des mœurs publiques.
On peut penser cependant qu’il remit à ses fils le
soin de tenter cette réforme qu’il n’avait pas eu le
temps d’exécuter, car il semble y faire allusion dans
les Enseignements écrits de sa main, qu’il laissa en
mourant à Philippe, son fils aîné et son successeur:
«Garde-toy de fere chose qui à Dieu deplese, disait-il
dans ce testament moral, c’est à savoir,
péchié mortel... Maintiens les bonnes coustumes de
[50]
ton royaume et les mauvèses abesses... Fui et
eschieve (évite) la compaingnie des mauuez... Aime
ton preu (prochain) et son bien, et hai touz maux
où que ils soient. Nulz ne soit si hardi devant toy,
que il die parole qui atraie et émeuve pechié.» Philippe
le Hardi voulut se conformer aux instructions
de son glorieux père.
Au parlement de l’Ascension, en 1272, ce roi
rendit une ordonnance prohibitive contre les blasphèmes,
les lieux de débauche et les jeux de dés,
que saint Louis confondait dans sa réprobation. Nous
n’avons plus que la lettre missive adressée à tous
les baillis, pour «qu’ils fassent garder en leurs bailliages
et en la terre aux barons ladite ordonnance
de défendre les vilains serments, les bordeaux communs,
les jeux de dez: la poine d’argent, disait le roi,
pourra estre muée en peine de corps, selon la qualité
de la personne et quantité du méfait.» La perte
de l’ordonnance, que cette lettre missive annonçait,
témoigne, ce nous semble, qu’elle ne fut jamais
exécutée, et qu’on l’oublia peut-être avant que Philippe
le Bel eût succédé à Philippe le Hardi. Cette
extermination générale des bordeaux était chose
impossible et dangereuse; on s’en tint à la tolérance
tacite qui les avait épargnés jusque-là, et qui n’avait
mis d’obstacle qu’à leur multiplication immodérée.
Il est à croire que, dans ce temps-là, on se
bornait à soumettre la Prostitution aux sévères règlements
d’une police de surveillance, et qu’on assurait
[51]
ainsi la sécurité des femmes de bien. Nous rapporterons
donc au règne de Philippe le Hardi deux
usages que Pasquier rappelle dans ses Recherches de
la France, sans leur assigner une date précise, mais
en les plaçant aux environs du temps de saint Louis.
C’est vraisemblablement à cette époque, qu’on défendit
aux prostituées de porter des ceintures dorées,
et qu’on leur ordonna, au contraire, de ne pas se
montrer en public sans avoir une aiguillette sur
l’épaule. Cette aiguillette devait varier de couleur,
selon les villes dans lesquelles une ribaude commune
avait droit d’exercice et de séjour. Nous verrons,
en parlant des us et coutumes de la Prostitution
dans les différentes villes de France, que les filles
publiques de Toulouse avaient, au lieu d’aiguillette
sur l’épaule, une enseigne ou jarretière au bras, et
que cette enseigne était toujours d’une autre couleur
que la robe, pour mieux frapper les regards et proclamer
la condition vile de la personne. «Ceux qui
succédèrent à ce sage roi (Louis IX) dit Pasquier au
chap. XXXV de son livre VIII, encores qu’ils ne permissent
par leurs loix et édicts les bordeaux, si les
souffrirent-ils par forme de connivence; estimans que
de deux maux il falloit eslire le moindre, et qu’il estoit
plus expedient tolérer les femmes publiques, qu’en ce
défaut donner occasion aux meschans de solliciter les
femmes mariées, qui doivent faire profession expresse
de chasteté. Vray qu’ils voulurent que telles
femmes qui en lieux publics s’abandonnent au premier
[52]
venant, fussent non-seulement réputées infâmes
de droict, mais aussi distinctes et séparées d’habillement
d’avec les sages matrones; qui est la cause
pour laquelle on leur deffendit anciennement en la
France de porter ceintures dorées, et, pour ceste
mesme occasion, l’on voulut anciennement que telles
bonnes dames eussent quelque signal sur elles,
pour les distinguer et recognoistre d’avec le reste
des preudes femmes: qui fut de porter une esguilette
sur l’espaule.»
C’est à ces deux anciens usages que Pasquier
rapporte deux proverbes qui s’étaient popularisés
dès le treizième siècle, et qui n’ont point assez
vieilli pour qu’on ait cessé de les employer dans le
nôtre. On disait, on dit encore qu’une femme court
l’aiguillette, et que bonne renommée vaut mieux
que ceinture dorée. Ce fut, en effet, sous le règne
de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel que la mode
importa d’Orient en France ces ceintures de cuir
doré ou de tissu d’or, que les ordonnances somptuaires
interdirent aux femmes de petite condition,
et, par conséquent, aux ribaudes, qui, à l’instar
des mérétrices de Rome, n’avaient pas la permission
de porter sur elles or ou argent. L’interdiction d’un
objet de toilette devait paraître intolérable aux bourgeoises
et aux femmes de métier, qui se trouvaient
par là presque assimilées aux folles femmes, elles se
vengèrent donc de l’édit prohibitif, en opposant
leur bonne renommée au luxe des dames de la cour,
[53]
qui ne menaient pas toujours une vie irréprochable.
Il y eut néanmoins de fréquentes infractions à l’ordonnance
somptuaire, et bien des femmes se parèrent de
ces ceintures dorées, qu’elles n’avaient pas le droit
de porter. Le prévôt de Paris avait beau les menacer
de confiscations et d’amendes, elles s’obstinaient à
braver la poursuite des sergents et à jouer le rôle
des dames à ceintures dorées. Les ribaudes n’étaient
pas les moins hardies à prendre cet ornement prohibé,
au risque de la prison et du fouet. Nous n’avons
pas besoin de réfuter les écrivains qui ont
avancé, sans raison, que la ceinture dorée avait été
attribuée, comme une marque distinctive, aux
femmes de mauvaise vie, et que les femmes honnêtes,
qui n’osaient pas se confondre avec elles en
leur empruntant cette parure compromettante, se
consolaient hautement d’en être privées en faisant
valoir les avantages de leur bonne réputation.
Quant à l’aiguillette, elle ne figura pas longtemps
sur l’épaule des prostituées de Paris, quoique
Pasquier ait vu de ses propres yeux, vers la fin du
seizième siècle, cette coutume pratiquée à Toulouse
par les pensionnaires du Châtel-Vert. Courir l’aiguillette
signifiait, selon Pasquier, «prostituer son
corps à l’abandon de chacun.» Il est probable
qu’on avait entendu d’abord désigner des femmes
qui couraient les rues l’aiguillette sur l’épaule. On
ne tarda pas à défigurer cette expression pittoresque,
faute d’être instruit du fait qui y avait donné lieu:
[54]
le peuple l’avait corrompue, sans le savoir et sans en
changer le sens primitif, lorsqu’il prit l’habitude de
dire courir le guilledou. Nous ne chercherons pas à
convaincre d’erreur certains philologues qui ont
voulu démontrer que les ribaudes courant l’aiguillette
s’adressaient surtout aux chausses des gens
qu’elles accostaient, attendu que ces chausses étaient
attachées et retenues à leur place par un lacet ou
aiguillette. Ces philologues ont fait un anachronisme
dans l’archéologie des chausses, et ils se sont abusés
par le rapprochement malencontreux qu’ils ont
fait de deux espèces d’aiguillettes.
Quoi qu’il en soit, sous les successeurs de saint
Louis, la Prostitution, si bien réglementée qu’elle
fût, avait impudemment étendu son domaine, et les
mœurs étaient si relâchées, que les trois brus de
Philippe le Bel, Marguerite, reine de Navarre,
Jeanne, comtesse de Poitiers, et Blanche, comtesse
de la Marche, furent accusées d’adultère à la fois,
et enfermées, par ordre du roi, dans la même prison,
au Château-Gaillard. On leur fit leur procès à
huis clos, et rien ne transpira des prodigieux débordements
qu’on leur imputait; seulement, l’une
d’elle, Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe,
comte de Poitiers, se vit transférée dans le château
de Dourdan, où son mari l’alla chercher pour lui
rendre la liberté, sinon l’honneur. Marguerite, quoique
moins coupable que ses sœurs, périt étranglée
dans sa prison, et Blanche ne sortit de la sienne, que
[55]
pour se voir répudiée et conduite au couvent de
Maubuisson. La voix publique attribuait à ces trois
sœurs une monstrueuse complicité de débauches et
de crimes; on racontait qu’elles s’étaient logées à
dessein dans l’hôtel de Nesle, situé hors de l’enceinte
de Paris, au bord de la Seine, sur l’emplacement
actuel du palais de l’Institut de France, et qu’elles
attiraient dans cet hôtel, appartenant à Jeanne, comtesse
de Poitiers, les jeunes écoliers qu’elles avaient
distingués à leur bonne mine, parmi ceux qui fréquentaient
le Pré-aux-Clercs. Ces écoliers, après
avoir satisfait la lubricité des trois princesses, étaient
empoisonnés ou poignardés, et jetés ensuite dans la
rivière, qui ensevelissait les tristes victimes de la
tour de Nesle. Deux officiers de la maison de ces
princesses, Philippe et Gautier de Launay, qui
étaient frères, furent jugés à Pontoise, en 1314, et
condamnés à être écorchés vifs, ce qui fut exécuté,
et leurs corps restèrent exposés sur un gibet, comme
ceux des plus vils criminels. Une conformité de
nom enveloppa un moment dans l’accusation la
reine elle-même; mais Jeanne de Navarre, qui
n’avait jamais habité l’hôtel de Nesle, n’eut pas de
peine à se justifier vis-à-vis des juges. L’impudicité
de ses belles-filles n’en rejaillit pas moins sur
elle; et une tradition injurieuse, perpétuée dans le
peuple, fit d’elle l’héroïne sanglante des débauches
de l’hôtel de Nesle: «Suivant cette tradition erronée,
dit Robert Gaguin dans son Compendium de
[56]
l’histoire de France, cette reine avait fait partager
sa couche à plusieurs écoliers (aliquot scholasticorum
concubitu usam), et pour cacher son crime, après
les avoir fait tuer, elle les jetait de la fenêtre de sa
chambre dans la rivière. Un seul de ces écoliers,
Jean Buridan, échappa par hasard à ce guet-apens;
c’est pourquoi il publia ce sophisme: Reginam interficere
nolite, timere bonum est.» Ce sophisme célèbre,
qui peut s’entendre et s’expliquer de plusieurs façons,
est une énigme assez peu digne du fameux
Jean Buridan, que l’Université de Paris cite avec
honneur parmi ses professeurs de philosophie au
quatorzième siècle. Ce dernier, qui était recteur de
l’Université en 1320 (voy. la Bibl. belg. de Valère
André, p. 471), n’aurait pu être un simple écolier,
six ou sept ans auparavant. Quant au sophisme dont
il serait l’auteur, nous croyons pouvoir le rétablir
dans le sens de son origine, en l’écrivant ainsi:
Reginam interfodere nolite, timere bonum est. Nous
mettons à la place du verbe interficere, qui ne veut
rien dire ici, interfodere, interferire, interferre, ou tout
autre verbe ayant une signification érotique, et nous
traduirons alors: «N’allez pas coucher avec une
reine; il est bon de craindre ce dangereux honneur.»
La tradition attachée à la tour de Nesle, qui a
subsisté jusqu’à la fin du dix-septième siècle, était
si généralement répandue dans le peuple de Paris,
que Brantôme en fait mention dans ses Dames galantes:
«Cette reine, dit-il, se tenoit à l’hôtel
[57]
de Nesle à Paris, laquelle faisant le guet aux passans,
et ceux qui lui revenoient et agréoient le plus,
de quelque sorte de gens que ce fussent, les faisoit
appeler et venir à soy, et, après en avoir tiré ce
qu’elle en vouloit, les faisoit précipiter du haut de
la tour, qui paroist encore, en bas, en l’eau, et les faisoit
noyer. Je ne veux pas dire que cela soit vray,
mais le vulgaire, au moins la pluspart de Paris,
l’affirme; et n’y a si commun, qu’en luy monstrant
la tour seulement et en l’interrogeant, que de luy-mesme
ne le die.» Avant Brantôme, Villon avait
rappelé aussi cette tragique histoire, en disant dans
sa Ballade des dames du temps jadis:
Semblablement où est la reine
Qui commanda que Buridan
Fût jeté en un sac en Seine!
Mais la légende historique se trouvait singulièrement
affaiblie, et au lieu de trois princesses libertines se
disputant et se partageant les caresses de beaux et
robustes écoliers qu’elles renouvelaient toutes les
nuits, on ne voyait, dans les récits du vulgaire,
qu’une reine de France amoureuse de Buridan. Remarquons
encore que ce Buridan avait pu faire
allusion à son aventure de la Tour de Nesle, en
inventant une allégorie qui était devenue proverbiale,
et qu’on appelait l’âne de Buridan: il avait
représenté un âne affamé et mourant de faim entre
deux boisseaux d’avoine, plutôt que d’opter entre
l’un ou l’autre. Cet âne n’est-il pas Buridan lui-même
[58]
entre deux ou trois princesses également belles,
également impatientes de plaisir?
Au reste, si les femmes, si les princesses elles-mêmes
se montraient si empressées de courir après
les hommes, c’était peut-être que les hommes faisaient
mine de les dédaigner et ne s’occupaient plus
d’elles. Un horrible libertinage s’était glissé dans
toutes les classes de la société depuis les croisades,
et le vice contre nature, que le séjour des Français
en Palestine avait acclimaté en France, menaçait
encore, en dépit de la chevalerie, d’infecter les
mœurs et de corrompre la population tout entière.
Nous avons cité ailleurs un passage de l’Histoire
occidentale, de Jacques de Vitry, qui fait un effrayant
tableau de la perversité de ses contemporains. Un
poëte français de la même époque, Gautier de
Coincy, quoique prieur de l’abbaye de Saint-Médard
de Soissons, représente la vie des cloîtres sous des
couleurs aussi honteuses dans son Fabliau de sainte
Léocade:
La Grammaire hic à hic accouple;
Mais Nature maldit le couple.
La mort perpétuel engenre
Cil qui aime masculin genre
Plus que le féminin ne face,
Et Diex de son livre l’efface.
Nature rit, si com moi semble,
Quand hic et hoc joignent ensemble.
Mais hic et hic, chose est perdue,
Nature en est tost esperdue.....
Cet abominable vice s’était multiplié à ce point,
[59]
que la Prostitution légale méritait alors d’être encouragée
comme un remède, ou du moins comme
un palliatif à une pareille turpitude. L’existence de
la société elle-même pouvait paraître menacée, lorsque
Philippe le Bel, qui ne manquait ni de résolution,
ni d’énergie, se proposa d’arrêter les progrès
de la sodomie, en frappant de terreur ceux qui donnaient
l’exemple de cette criminelle aberration des
sens: telle fut la principale cause du procès des
Templiers. La lecture attentive des pièces authentiques
de ce procès nous a prouvé que Philippe le Bel
n’avait poursuivi, dans cet ordre religieux et militaire,
que le sacrilége et la débauche arrivés au
dernier degré de l’audace et du scandale. «Quelque
opinion qu’on adopte sur la règle des Templiers et
l’innocence primitive de l’ordre,» dit l’illustre historien
Michelet effrayé des imposants témoignages
qu’il mettait au jour pour la première fois et qui
tous confirment notre opinion, «il n’est pas difficile
d’arrêter un jugement sur les désordres de son dernier
âge, désordres analogues à ceux des ordres
religieux.» La publication des documents originaux
prouve d’une manière irrécusable que l’ordre du
Temple était infecté tout entier de la plus exécrable
dépravation. Philippe le Bel, d’accord avec le pape
Boniface VIII, eut le courage d’attaquer le mal dans
son foyer, et tenta de l’étouffer sous les débris de
l’ordre du Temple, qui l’avait propagé en le couvrant
de son manteau blanc. Nous ne savons quelle
[60]
chronique impute à la vengeance d’une femme l’accusation
infamante qui s’éleva contre les Templiers
en 1307, et qui alluma bientôt leurs bûchers par
toute l’Europe. L’interrogatoire que le grand maître
et deux cent trente et un chevaliers ou frères servants
subirent à Paris, en présence des commissaires pontificaux,
«fut conduit lentement,» dit Michelet,
«et avec beaucoup de ménagement et de douceur,»
par de hauts dignitaires ecclésiastiques, et malgré
les dénégations systématiques des accusés, il reste
avéré que la plupart des charges relatives aux mœurs
déshonnêtes de l’ordre n’étaient que trop réelles. La
nature même du supplice infligé aux condamnés
prouve assez la nature des crimes que la rumeur publique
leur attribuait depuis longtemps, avant qu’une
enquête minutieuse en eût caractérisé l’ignominie.
Les Templiers étaient universellement décriés;
leurs principaux vices, leur orgueil, leur avarice,
leur ambition, leur ivrognerie, leur méchanceté,
avaient passé en proverbe; mais si l’on disait dans
le peuple: boire, jurer, se gorgiaser comme un Templier;
si les poëtes satiriques se plaisaient à énumérer
les vices de ces moines soldats, on ne savait
pas les monstrueuses infamies qui se pratiquaient
dans le sein de l’ordre du Temple, devenu une secte
odieuse, vouée à la plus ignoble Prostitution. D’après
les dépositions des premiers témoins qui s’étaient
présentés spontanément pour accuser les Templiers,
on dressa une série de questions sur lesquelles on
[61]
interrogea séparément tous les accusés, et, de leurs
réponses plus ou moins évasives, on put conclure
avec certitude que, dans la cérémonie de réception
des frères, celui qui était reçu et celui qui le recevait
se baisaient mutuellement sur la bouche, au
nombril ou sur le ventre, à l’anus ou au bas de
l’épine du dos, et quelquefois sur le membre viril
(aliquando in virga virili); que le récipiendaire, ordinairement,
se voyait seul soumis à ce mode de baisers
impurs, après avoir renié Jésus-Christ et craché
sur la croix; que son parrain lui défendait
d’avoir commerce avec les femmes, mais l’autorisait
à s’abandonner avec ses confrères aux plus
horribles excès d’impudicité. Un grand nombre de
Templiers, fidèles à leurs serments réciproques, se
renfermèrent dans une fière protestation contre ce
qu’ils appelaient de ridicules calomnies. Plusieurs,
intimidés ou gagnés, en vinrent promptement à des
aveux circonstanciés, et les autres se contentèrent
de déclarer qu’ils n’avaient participé à aucun acte
répréhensible, tout en constatant les obscénités de
la réception des chevaliers, selon les statuts de l’ordre.
Au reste, ces statuts ne furent expliqués par
personne, et l’on n’essaya pas même de justifier
leurs étranges et mystérieuses horreurs. Huguet de
Baris raconta que, pendant la cérémonie de sa réception,
lorsqu’il se fut dépouillé de ses vêtements,
excepté de sa chemise, le frère chargé de le recevoir,
l’ayant aidé à se vêtir de la robe et du manteau
[62]
de l’ordre, lui leva ses habits par devant et par
derrière (frater P. levavit ipsi testi vestes ante et
retro) et le baisa brusquement sur la bouche, au
nombril et à la chute des reins. Mathieu de Tilley
dit, au contraire, que le frère qui l’avait reçu, après
lui avoir fait renier Jésus-Christ et cracher sur la
croix, lui ordonna de le baiser sur sa chair nue, et
se découvrit la cuisse, où le récipiendaire appliqua
ses lèvres (præcepit quod oscularetur eum in
carne nuda, et discoperuit se circa femur, et ipse fuit
osculatus eum in anca circa illum); puis, le frère receptor
ajouta: Et devant! en retroussant sa robe, ce
qui fit supposer au récipiendaire qu’il devait se prêter
à une odieuse pratique (quod deberet eum osculari
ante circa femoralia); mais on ne lui en demanda pas
davantage, et il en fut quitte pour la honte d’avoir
entendu la vilaine injonction qu’on lui adressait.
Jean de Saint-Just, ayant été sommé de baiser à
l’anus le frère qui le recevait (præcepit ei quod oscularetur
eum in ano), répondit avec indignation qu’il
ne se soumettrait jamais à cette infamie.
Beaucoup de Templiers avouèrent que, lors de
leur réception, ils avaient été invités et autorisés à
se prostituer avec leurs frères en religion; mais ils
soutinrent tous qu’ils n’en avaient rien fait, et qu’ils
croyaient même la sodomie aussi rare dans l’ordre
du Temple que dans tout autre ordre monastique.
Voici la déposition de Jean de Saint-Just: Deinde
dixit ei quod poterat carnaliter commisceri cum fratribus
[63]
ordinis et pati quod ipsi commiscerentur cum eo;
hoc tamen non fecit, nec fuit requisitus, nec scit, nec
audivit quod fratres ordinis committerent peccatum
prædictum. La déposition de Rodolphe de Taverne
est plus explicite encore, puisque, en exigeant de lui
le vœu de chasteté à l’égard des femmes, on lui
conseilla d’éteindre autrement les feux de son ardeur
naturelle: Deinde dixit ei quod, ex quo voverat
castitatem, debebat abstinere a mulieribus, ne ordo infamaretur;
verumtamen, secundum dicta puncta, si
haberet calorem naturalem, poterat refrigerare, et carnaliter
commisceri cum fratribus ordinis, et ipsi cum eo:
hoc tamen non fecit, nec credit quod in ordine fieret.
La déposition de Gérard de Causse ne fut pas moins
circonstanciée, quoique elle offrît une contradiction
évidente. Ainsi, selon lui, tout chevalier du Temple
qui se rendait coupable de sodomie (si essent convicti
de crimine sodomitico) était condamné à la prison
perpétuelle, et les frères, redoutant à cet égard
les tentations du démon, entretenaient de la lumière
dans leurs dortoirs durant la nuit (et quod tenerent lumen
de nocte in loco in quo jacerent, ne hostis inimicus
daret eis occasionem delinquendi); cependant, lorsque
Gérard de Causse avait été reçu chevalier, un des
frères assesseurs lui avait dit que, s’il ne pouvait résister
aux entraînements de la convoitise charnelle,
il ferait mieux, pour l’honneur de l’ordre, de pécher
avec ses compagnons, que de s’approcher des femmes
(dixit eis quod si haberent calorem et motus carnales,
[64]
poterant ad invicem carnaliter commisceri, si volebant,
quia melius erat quod hoc facerent inter se, ne
ordo vituperaretur, quam si accederent ad mulieres). Ce
Templier ne manqua pas de protester, comme les
autres, qu’il n’avait jamais vu ni appris que ce précepte
infâme eût été suivi par ses confrères.
Les conséquences de ce procès furent terribles:
une foule de Templiers périrent dans les supplices.
L’ordre du Temple, aboli et anathématisé, ne disparut
pourtant pas tout à fait, et il se perpétua dans
l’ombre, avec les mêmes mœurs, si l’on en croit certains
témoignages qui n’ont pas toute la valeur d’une
preuve historique. Mais, après avoir lu et comparé
les pièces de ce procès mémorable, qui nous montre
une secte de sodomites et d’impies couverts d’un
habit religieux, et se livrant, en face des autels, à
d’exécrables désordres, on est forcé de chercher les
causes de la corruption de cet ordre, qui s’était fait
longtemps respecter par ses mœurs régulières et par
ses vertus: ces causes, on les trouve dans le long
séjour des Templiers en Orient, où le vice contre
nature est presque endémique, et où la crainte de la
lèpre, du mal des ardents et de diverses affections
cutanées ou organiques, est toujours attachée au
commerce des femmes. Les Templiers, de peur de
devenir lépreux et méseaux, avaient souillé leur
âme et leur corps, en acceptant, en approuvant la
plus honteuse de toutes les prostitutions.

Sommaire.—Les mauvais lieux de Paris.—Topographie de la
Prostitution parisienne au moyen âge.—La rue de la Plâtrière.—La
rue du Puon.—La rue des Cordèles.—La petite ruellette
de Saint-Sevrin.—La rue de l’Ospital.—La rue Saint-Syphorien.—La
rue de la Chaveterie.—La rue Saint-Hilaire.—Le
clos Burniau.—La rue du Noyer.—La rue du Bon-Puits.—La
rue de l’École.—La rue Cocatrix.—La rue Charoui.—La
ruelle Sainte-Croix.—La rue Gervese-Laurens.—La rue du
Marmouset.—La rue de Chevez.—Le Val d’amour.—La rue
Saint-Denis de la Chartre.—La rue des Lavandières.—La
place aux Pourceaux.—La rue Béthisy.—La rue de l’Arbre-Sec.—La
rue de Maître-Huré.—La rue Biaubourc, etc.
Nous avons très-peu de renseignements sur l’histoire
des mauvais lieux de Paris, et c’est à peine si
nous pouvons établir d’une manière positive leur
situation locale, à certaines époques antérieures au
[66]
seizième siècle. Cependant, à partir du treizième siècle,
nous les trouvons nommés dans les actes (instrumenta)
publics de la prévôté, dans les cartulaires
des paroisses et des couvents, dans les papiers terriers,
dans les comptes de différentes juridictions et
même dans les vieilles poésies. Il nous est donc permis,
à l’aide de ces autorités, de constater, pour
ainsi dire, la topographie de la Prostitution parisienne
au moyen âge. Malheureusement, en relevant
avec peine cette carte routière des rues malfamées
de la capitale, nous sommes dans l’impossibilité d’y
joindre des détails pittoresques et de curieuses particularités,
qui viendraient fort à propos distraire le
lecteur au milieu d’une monotone dissertation d’antiquaire.
Ces particularités et ces détails nous manquent
absolument, et si nous savions quelles rues et
quelles ruelles avaient alors la triste destination que
plusieurs d’elles ont conservée jusqu’à nos jours,
nous ne savons pas quel était l’aspect extérieur de
ces séjours de débauche, quels étaient leurs noms
et leurs enseignes, du moins pour le plus grand
nombre, quel était le système ordinaire de leur organisation
impudique, quelle était enfin leur physionomie
intérieure. Tout, sur ce chapitre, est livré
au domaine de l’imagination, qui a le soin de chercher
dans Rabelais et même dans Regnier les couleurs
appropriées à la peinture des bordeaux de nos
ancêtres. Mais, néanmoins, quoique nous n’ayons
que des notions très-vagues et très-imparfaites sur
[67]
les mystères d’un pareil sujet, nous croyons utile et
intéressant de dresser l’inventaire archéologique de
ces repaires, que nous verrons s’éloigner graduellement
du centre de la cité et qui semblent avoir été
les fiefs de dame Vénus et de son fils Cupidon, que
le moyen âge français n’entourait guère de réminiscences
mythologiques.
Dans ces temps de priviléges et de traditions, chaque
métier possédait en propre certains quartiers et
certaines rues, auxquels il attachait son nom: là
étaient les ouvroirs, les fenêtres, les étaux des maîtres
de ce métier; là seulement ils concentraient leur
industrie et leur commerce. La Prostitution, qui se
régissait comme un de ces métiers, n’aurait pu se
confiner dans un seul quartier ni occuper quelques
rues attenantes l’une à l’autre; car il était de son essence
et de son intérêt de diviser ses forces et de
rayonner dans tous les quartiers à la fois, pour être
plus à même d’étendre partout ses filets et d’y faire
tomber plus de victimes. La police, qui la réglementait,
s’opposa toujours à cette diffusion du libertinage
sur tous les points de la ville, et elle travailla
constamment à restreindre le domaine impur qu’elle
concédait aux femmes communes. Telle est la
lutte que nous présente, pendant plusieurs siècles,
la Prostitution qui tient tête tour à tour à l’autorité
de l’archevêque de Paris, à celle du prévôt, à
celle du parlement, même à celle du roi. Ses empiétements,
ses obstinations, ses audaces résistent
[68]
aux ordonnances, aux arrêts et aux sergents;
elle ne cède que de guerre lasse un terrain qui lui
plaît et que la tradition lui attribue; elle y revient
sans cesse, après en avoir été chassée, et ne l’abandonne
jamais entièrement; elle n’est pas difficile,
d’ailleurs, sur le choix des lieux où elle se fixe: elle
se rend justice, en adoptant de préférence les rues les
plus sombres, les plus étroites, les plus sales, les
plus infectes; c’est une habitude qu’elle garde encore,
comme si elle n’osait pas sortir de son repaire,
comme si l’air que respirent les honnêtes gens était
malsain pour elle. De même que les juifs qui n’avaient
pas le droit de mettre le pied hors de leur juiverie
et qui s’y voyaient enfermer la nuit à l’instar
des lépreux dans leurs ladreries, les ribaudes et leur
infâme sequelle ne dépassaient pas les limites de leur
résidence, sous peine de s’exposer au fouet, à la prison
ou à l’amende; mais, depuis que leur existence légale
était réglée par les ordonnances de saint Louis,
elles n’avaient plus besoin de se cacher, pour vaquer
à leur profession obscène, pourvu qu’elles se conformassent
aux prescriptions et aux statuts de la ribaudie.
Le plus ancien document dans lequel nous trouvons
une nomenclature des mauvais lieux de Paris,
c’est un poëme ou un monologue en vers, composé
au treizième siècle par un certain Guillot, qui ne
nous est connu que par son Dit des Rues de Paris.
Ce poëme fut publié pour la première fois en 1754
[69]
par l’abbé Lebeuf, d’après un manuscrit qu’il avait
découvert à Dijon et qu’il déposa dans la bibliothèque
de l’abbé Fleury, chanoine de Notre-Dame. Depuis
cette époque, on a souvent réimprimé l’ouvrage de
Guillot et l’on s’en est servi surtout pour fixer la topographie
parisienne au treizième siècle; car on peut
dater de 1270 ce catalogue rimé, où l’acteur parle
de Dom Sequence, chefecier de Saint-Merry, comme
d’un contemporain; or ce personnage vivait encore en
1283. Les critiques, qui ont cité le Dit des Rues, auquel
Guillot a donné la forme d’un itinéraire commençant
à la rue de la Huchette, dans le quartier de l’Université,
n’ont pas pris garde que le poëte ou plutôt le
rimeur, en accumulant des noms de rues et de ruelles
qu’il se plaît à faire rimer ensemble le plus naïvement
du monde, semble n’avoir eu d’autre préoccupation
que la recherche et le signalement des endroits
consacrés à la débauche. Nous ne voulons pas
dire cependant que cet honnête Guillot, qui a peut-être
vu son nom passer en proverbe avec l’épithète
de songeur, se soit préoccupé de cette recherche
dans un but honteux; mais il est toutefois remarquable
que, dans ces trois cents rimes nomenclatives,
les principales digressions du poëte soient relatives
à la Prostitution; sur cette matière, du moins, il se
relâche de l’aridité de son catalogue onomastique et
il y ajoute complaisamment quelques images qui ne
sont pas du meilleur goût. Chaque fois que Guillot
rencontre sur son chemin un de ces clapiers que la
[70]
police urbaine environnait d’une mystérieuse tolérance,
il a l’air de s’y arrêter, ne fût-ce que pour en
marquer la place et en constater l’existence. Comme il
désigne plus de 20 rues suspectes dans les trois grandes
divisions de Paris, comprises sous les dénominations
d’Université, de Cité et de Ville, on a lieu de
supposer qu’il fut appelé Guillot le songeur, par les
femmes bordelières qui lui reprochaient d’avoir
mentionné des bordeaux qui n’existaient que dans
son imagination.
Le premier qu’il croit reconnaître sur son passage,
à partir du Petit-Pont, en remontant dans le quartier
de l’Université, c’est dans la rue de la Plâtrière,
qui paraît être celle qu’on a nommée depuis rue du
Battoir:
La maint (demeure) une dame loudière
Qui maint chapel a fait de feuille.
L’abbé Lebeuf, que la pudeur égare sans doute,
explique le mot loudière par faiseuse de couvertures,
mais, dans la vieille langue française, loudière signifiant
couverture au propre, équivalait au figuré
à prostituée, et il n’était pas autrement question de
couvertures. Cette loudière, que Guillot ne se fût
pas permis de qualifier ainsi au hasard, pouvait bien,
dans les loisirs que lui laissait son vilain métier,
s’occuper à faire des chapeaux de fleurs ou de verdure,
que les confrères des corporations portaient
aux fêtes patronales, dans les processions et en diverses
circonstances solennelles. Nous ne sommes
[71]
pas éloigné de croire que ces chapels, dont la fabrication
était une industrie assez importante à Paris,
figuraient sur la tête des fiancés, des épouses et des
amoureux, aux repas de famille. Guillot ne s’arrête
pas longtemps rue de la Plâtrière, quels que fussent
les charmes de la dame; il poursuit sa route, dit-il,
par la rue du Paon, qu’il appelle Puon:
Je descendi tout bellement
Droit à la rue des Cordèles:
Dame i a: le descord d’elles
Ne voudroie avoir nullement.
Cette rue des Cordèles est maintenant la rue des
Cordeliers, qui devait son nom au couvent des
Grands-Cordeliers, que la Révolution a détruit. Il est
probable que Guillot a remplacé Cordeliers en Cordèles
pour les besoins de la rime et aussi par allusion
aux affaires de cœur qui se traitaient dans cette rue-là.
Les dames qui y demeuraient n’étaient sans doute
pas d’une humeur accorte et facile, puisque le poëte
ne craint rien tant que d’avoir un débat (descord)
avec elles. Cela prouve que de tout temps les femmes
de plaisir ont été très-promptes à la dispute et très-ardentes
dans leurs colères. Guillot, pour rencontrer
d’autres femmes de la même espèce, est obligé
d’aller jusqu’à la rue des Prêtres-Saint-Severin, qu’il
appelle la petite ruellette de Saint-Sevrin, où
.... Mainte meschinete
S’y louent souvent et menu,
Et font batre le trou velu
Des fesseriaux, que nus ne die.
[72]
Nous n’entreprendrons pas de dégager des voiles
du vieux langage le métier scandaleux des meschinetes,
que Guillot met en scène avec beaucoup d’indulgence.
Nous le suivrons plutôt dans la rue de
l’Ospital, qu’on a nommée ensuite rue Saint-Jean-de-Latran,
en mémoire des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,
qui y avaient une maison. Guillot
tombe au milieu d’une querelle de femmes qui s’injuriaient
et se battaient en pleine rue, malgré le
voisinage des pères hospitaliers; le texte est ici
moins obscur que corrompu:
Une femme i d’espital (despita),
Une autre femme folement
De sa parole moult vilment.....
Guillot s’enfuit, sans attendre la fin de la dispute,
et il craignait si fort de s’y voir mêler, qu’il ne fit
que traverser la rue Saint-Syphorien, aujourd’hui
rue des Cholets, où il connaissait pourtant une fille
nommée Marie, qui devait être à la fois égyptienne
(tireuse d’horoscope) et loudière:
La rue de la Chaveterie (à présent rue Chartière)
Trouvay. N’allay pas chez Marie,
En la rue Saint-Syphorien,
Où maignent li logiptien.
En passant dans la rue Saint-Hilaire, qui a conservé
son nom, il se rappelle qu’une dame débonnaire
y demeure, mais il n’a pas le temps de faire
une pose chez cette dame de bonne volonté, qu’il
nomme Gietedas, sobriquet où il serait aisé de découvrir
[73]
un sens obscène. Le voilà dans le clos Bruneau
(Burniau), où l’on a rosti maint bruliau, dit-il;
mais, par bruliau, il n’entend pas certainement parler
des fagots qu’on y aurait brûlés. Le clos Bruneau
était au centre des écoles, et les écoliers, qui, du
temps de Rabelais, y allaient faire leurs ordures,
s’y rendaient auparavant pour y faire chere-lie avec
leurs meschines. Guillot a donc raison de dire que l’on
a rôti maint bruliau dans ce repaire sombre et infect.
Nous disons encore dans le même sens rôtir le balai.
Près de là se trouve la rue des Noyers, où il y avait
alors autant de femmes de mauvaise vie qu’on en
rencontrerait de nos jours dans tout le quartier:
Et puis la rue du Noyer,
Où plusieurs dames, por louier
Font souvent battre leurs cartiers.
Guillot, dans la rue du Bon-Puits, qui devait son
nom à une allusion gaillarde, n’oublie pas d’enregistrer
les hauts faits d’une commère, femme d’un
charpentier, fameuse par le nombre d’hommes qu’elle
a envoyés de son lit au cimetière, suivant une interprétation
hasardée de ces deux vers:
La maint la femme à un chapuis
Qui de maint homme a fait ses glais.
Leduchat ou Lenglet Dufresnoy, en expliquant le
second vers, y verrait sans doute une figure érotique
empruntée à la sonnerie des cloches que l’on ébranle
lentement pour tinter le glas des morts. Guillot, qui
[74]
connaît tous les bons endroits, comme on disait
dans la langue familière du siècle dernier, pousse
un soupir en traversant la rue de l’École, où demeure
dame Nicole. Cette rue de l’École, qui est devenue
la rue du Fouarre, à cause de la paille ou
feurre qu’on y étendait pour y amortir le bruit des
pas, renfermait les grandes Écoles de l’Université,
et en même temps plus d’une école de Prostitution.
Voilà pourquoi Guillot dit avec malice:
En celle rue, ce me semble,
Vent-on et fain et feurre ensemble.
Guillot n’a plus rien à apprendre dans ces écoles;
il se sauve par la rue Saint-Julien-le-Pauvre, et il
invoque ce saint-là, qui nous gard de mauvais lieu.
Saint Julien était le protecteur des voyageurs; il les
garantissait des mauvais pas et des mauvaises rencontres.
Guillot entre donc sain et sauf dans la Cité,
et la première rue où il éprouve l’attrait de la concupiscence,
c’est la rue Cocatrix:
Où l’on boit souvent de bons vins
Dont maint homs souvent se varie.
Il n’y avait pas, à cette époque, de cabaret qui ne
fût un lieu de débauche. Guillot mentionne encore
une bonne taverne dans la rue Charoui, qui s’étendait
depuis l’entrée du cloître Notre-Dame jusqu’à la
rue des Trois-Canettes. Ces tavernes et leurs dépendances
étaient fréquentées probablement par les
chantres et les écolâtres de la cathédrale. Guillot,
[75]
sans doute, leur fait raison en passant; espérons,
pour son honneur, qu’il ne fait que passer aussi dans
la ruelle Sainte-Croix, où l’on chengle (cingle) souvent
des cois (cuisses), et dans la rue Gervais-Laurent,
qu’il appelle Gervese Laurens,
Où maintes dames ignorent
Y mesnent, quis de leur guiterne.
Nous ne pensons pas que les habitantes de cette
rue mal famée attirassent les innocents aux sons de
la guiterne (guitare), et nous attribuons plutôt au
mot guiterne un sens figuré que la pudeur nous défend
d’approfondir. Nous ne nous arrêterons pas
davantage à une rencontre étrange que Guillot fait
dans la rue des Marmousets, alors du Marmouset,
où un quidam lui adresse une infâme proposition:
Trouvay homme qui m’eut fet
Une musecorne belourde.
Dans la rue du Chevet-Saint-Landry, Guillot n’a
plus affaire qu’aux femmes débauchées, dont il définit
la profession d’une manière peu compréhensible:
Femmes qui vont tout le chevez
Maignent en la rue de Chevez.
Guillot s’enfonce de plus en plus dans le domaine
héréditaire de la Prostitution; il est en plein Glatigny,
qu’on appelait le Val d’amour:
En bout de la rue descent.
De Glateingni où bonne gent
Maignent et dames au cors gent
Qui aux hommes, si com moy semblent,
[76]
Volontiers charnelment assemblent.
Il échappe peut-être au péril de la tentation, et se
jette dans la rue du Haut-Moulin, qui se nommait
rue Saint-Denis de la Chartre, à cause de l’église
qu’on y voyait et qui n’a été démolie qu’à l’époque
de la Révolution. Le mauvais lieu que Guillot signale
dans cette rue, devait être un des plus considérables
de Paris, et les femmes qu’il renfermait ne sortaient
jamais de cette abbaye lubrique,
Où plusieurs dames en grant chartre
Ont maint v.. en leur c.. tenu,
Comment qu’ilz y soient contenu.
Ce passage et beaucoup d’autres prouveraient que
le Dit des Rues eût été intitulé, avec non moins d’à
propos, le Dit des Bordeaux de Paris. Guillot en avait
fini avec ceux de la Cité; il traversa le Grand-Pont
ou le Pont-au-Change, et il continua dans la Ville son
enquête pornographique.
Dans la rue des Lavandières, où il a maintes lavendières,
il nous fait entendre que ces filles ne se
bornaient pas à rincer du linge à la rivière. De tout
temps, les blanchisseuses ont eu la même réputation,
et la reine qu’elles élisaient chaque année avait des
pouvoirs analogues à ceux du roi des ribauds, mais
seulement dans ses États et sur ses sujettes. Guillot
ne se laisse pas retenir par ces joyeuses ribaudes;
il poursuit sa route, à travers les rues fangeuses du
quartier des Halles; il entre un moment, pour se rafraîchir,
[77]
chez un tavernier de la place aux Pourceaux,
qui devint ensuite la place aux Chats, puis
la fosse aux Chiens, parce qu’on y entassait des
charognes et des immondices: c’est le carrefour
formé par la jonction des rues Saint-Honoré, des
Déchargeurs et de la Lingerie. Guillot, qui se plaint
ici de n’avoir point de bonheur (Guillot, qui point
d’heur bon n’as), dit pourtant qu’il trouva sa trace,
son chemin ou plutôt ce qu’il cherchait, la piste de
quelque jolie galloise, avec laquelle il vida un pot de
clairet ou de muscadet. Dans la rue Béthisy, il ne
fut pas étonné de se heurter contre un homme qui
tenait conférence avec une ribaude, sans se soucier
de faire rougir les passants:
Un homs trouvai en ribaudez,
En la rue de Bethisi
Entré: ne fus pas éthisi.
Guillot ne se déferrait pas pour si peu. Il était
arrivé dans la rue de l’Arbre-Sec, et il n’avait garde
d’oublier un petit cul-de-sac, qui existe encore sous
le nom de Cour Baton, et qui avait autrefois le nom
malhonnête de Coul de Bacon. Il est bien certain
que, dans cette dénomination locale, il ne faut pas
attribuer au mot bacon le sens de chair de porc salée,
ni même chercher dans ce mot une image plus
ou moins rapprochée de ce sens primitif. C’était une
cour de ribaudie, avec son puits, autour duquel les
femmes d’amour tenaient leurs assises. Guillot ne se
fait pas scrupule de dire:
Trouvai et puis Col de bacon
[78]
Où l’on a trafarcié maint c...
Il y aurait à faire sur ce vers une curieuse dissertation
philosophique, que nous recommandons à
l’ombre de Leduchat, et qui permettra de rétablir la
véritable acception du vieux verbe trafarcier ou
trafarcer, que le Complément du Dictionnaire de
l’Académie française traduit assez mal par traverser.
Guillot suit le bord de la rivière et arrive à l’entrée
d’une grande rue qui conduit à la porte du Louvre;
le voisinage de la rivière caractérise assez les dames
qu’il rencontre et qui vendaient leurs denrées à un
prix trop élevé pour sa bourse:
Dames i a gents et bonnes;
De leurs denrées sont trop chiches (ou riches).
Il ne perd pas son temps à marchander ce qu’il
ne peut acheter, et il se dirige vers la rue Saint-Honoré.
Auprès d’une rue de Maître-Huré, rue dont
il n’est plus possible de déterminer la position,
quoiqu’elle avoisinât la rue des Poulies, il eut sans
doute à se louer de la politesse de certaines dames
qui lui souhaitèrent la bienvenue:
La rue trouvai-je maistre Huré,
Lez lui séant dames polies.
En faisant de maître Huré un personnage vivant,
au lieu d’un nom de rue, on serait forcé de l’accuser
d’un odieux métier que desservaient les dames polies
dont il paraît entouré. Guillot ne remarque rien qui
[79]
soit relatif à la Prostitution dans les deux rues de la
Truanderie, où il n’omet pourtant pas de nous
montrer le fameux Puits d’Amour: le puits le carrefour
despart, dit-il seulement; mais il se ravise dans
la rue Mauconseil:
Une dame vi sur un seil,
Qui moult se portoit noblement:
Je la saluai simplement,
Et elle moi, par saint Loys!
Les habitudes de cette dame ne différaient pas de
celles de ses pareilles que nous voyons, dans les
mêmes rues, exercer le même manége qu’autrefois,
attendre et guetter leur proie sur le seuil des maisons,
à l’entrée de sombres allées, en appelant ou
invitant les passants. Guillot, qui jure par saint Louis
lorsqu’il répond à cet appel libidineux, pourrait bien
avoir voulu rappeler à cette ribaude les ordonnances
du saint roi. Quand il fut dans la rue Saint-Martin,
il entendit chanter l’office de Notre-Dame de Saint-Martin-des-Champs,
et il s’arma de continence pour
achever sans encombre son voyage à la recherche
des lieux impurs. Il traversa rapidement la rue Beaubourg,
qui lui eût offert de quoi satisfaire tous les
genres de débauche:
Alai droitement en Biaubourc,
Ne chassoie chievre ne bouc.
De la rue des Étuves, il s’aventura dans une rue
Lingarière, qui ne peut être que la rue Maubué, un
des fiefs les plus anciens de la Prostitution:
Là où leva mainte plastrière
[80]
D’archal mise en œuvre pour voir,
Plusieurs gens pour leur vie avoir.
Ces gens-là, qui levaient des grillages en fil
d’archal pour regarder dans la rue, étaient, sans
contredit, les hôtes ordinaires de cette rue Maubué,
dans laquelle il y avait autant de clapiers que de
maisons, autant de filles et d’hommes dissolus que
d’habitants. Les rues voisines se ressentaient de ce
honteux voisinage. Guillot se contente de nommer
la rue Quincampoix (Qui qu’en poit), la rue Aubry-le-Boucher,
et le Conreerie, dont la modestie du quinzième
siècle avait fait la Corroierie, et qui est cachée
à présent dans la rue des Cinq-Diamants, par allusion
à ses impudiques origines. Il craint qu’un
malheur ne lui advienne, en approchant de la rue
Trousse-Vache, qui avait tiré son nom ignoble des
mœurs plus ignobles encore de sa population ordinaire.
La rue Amaury de Roussi
Encontre Troussevache chiet,
Que Dieu garde qu’il ne nous meschiet!
Guillot approchait du terme de ses pérégrinations;
il était si fatigué, qu’il s’assit, pour prendre quelques
instants de repos, dans la rue des Arcis; il reprit
bientôt sa course et négligea sans doute de désigner
certaines rues comme affectées spécialement
à la Prostitution. Ainsi, en passant dans la rue
de l’Étable-du-Cloistre, qui ne peut être que la rue
du Cloître-Saint-Merry, il est surpris de n’y pas rencontrer
[81]
de femmes bordelières, comme il en avait vu
à une autre époque, et il reconnaît que cette rue
est maintenant honestable; mais, quand il va de Saint-Merry
en Baillehoe, où je trouvai beaucoup de boe,
dit-il; cette rue Baillehoé, dont le nom n’était qu’un
hideux sobriquet et qui prit celui de Brisemiche,
qu’elle a gardé jusqu’à nos jours, ne lui représente
aucune réminiscence de libertinage, et il s’en éloigne,
sans l’avoir qualifiée comme elle le méritait. Il s’avance
dans le Marais, et donne un coup d’œil à la
rue du Plâtre:
Où maintes dames leur emplastre
A maint compagnon ont fait battre,
Ce me semble pour eux esbattre.
Guillot est inépuisable pour trouver des périphrases
plus libres que naïves, qui caractérisent les
endroits qu’il cherche. Au carrefour Guillori, dont
le nom équivaut à celui de Jean-de-l’Épine, qu’il a
porté plus tard, et que le savant De l’Aulnaye n’eût
pas manqué de mettre en évidence avec toute l’obscénité
que ce nom-là peut offrir, Guillot ne sait plus
à qui entendre:
Li un dit ho! l’autre hari.
Nous croyons qu’il était aux prises avec deux
meschines qui voulaient l’entraîner chacune de son
côté; mais il leur résista: Ne perdis pas mon essien,
dit-il, et il débouche dans la rue Gentien, maintenant
rue des Coquilles, où demeurait un biau varlet
qui lui inspira peut-être une coupable pensée. Il ne
[82]
se hasarda pas dans la rue de l’Esculerie, qui était
le cul-de-sac de Saint-Faron, et qui n’avait pas un
honnête homme parmi ses locataires; il longea rapidement
la rue de Chartron ou des Mauvais-Garçons,
près de Saint-Jean en Grève:
Où mainte dame en chartre ont
Tenu maint v.. pour se norier (nourrir).
C’est la seconde fois que Guillot nous montre en
chartre les méprisables artisanes de la Prostitution: il
est clair que leur clôture n’était pas volontaire et
qu’elle ne dépendait que des règlements de police.
Dans la rue du Roi de Sicile, Guillot se souvint d’une
nommée Sedile, qui logeait dans la rue Renaut-Lefèvre,
où elle vend et pois et febves, dit-il dans le langage
figuré auquel il a recours pour exprimer les mystères
de l’impudicité. Il s’engage ensuite, avec précaution,
dans la rue de Pute-y-musse, dont le nom significatif
ne permet pas de doute à l’égard de sa destination:
cette rue bordelière, que le peuple avait baptisée,
conserva toujours traditionnellement ce nom indécent,
quoiqu’on eût essayé de le modifier en Petit-Musc
et de le changer en Cloche-Perche, qu’elle porte
encore sur son écriteau. La vertu de Guillot avait
échappé à bien des dangers, quand il entra dans la
rue Tyron, où il alla voir dame Luce:
Y entrai dans la maison Luce
Qui maint en la rue Tyron:
Des dames hymnes vous diron.
Nous ne pensons pas, avec l’abbé Lebeuf, qu’il
[83]
s’agisse ici des cantiques et des chants religieux qui
pouvaient s’élever d’un couvent de filles pénitentes.
La maison Luce a toute la physionomie d’un mauvais
lieu, et les hymnes qu’on y chantait s’adressaient
évidemment à Vénus. Telle est l’abbaye galante que
nous persistons à voir dans cette rue, où les archéologues
ont imaginé de placer un logis appartenant
à l’abbé de Tiron. Guillot, au terme de son excursion,
se donne du bon temps; dans la rue Percée,
une des cinq rues qui portaient alors ce nom, indiquant
une ancienne impasse transformée en rue,
il se repose et se rafraîchit:
Une femme vi destrecié
Pour soi pignier, qui ne donna
De bon vin.....
Cette femme, qui se peigne ou qui s’ajuste en
versant du vin à Guillot, ne peut être qu’une fille
publique. Mais Guillot ne se lasse pas: il va de la
rue des Poulies-Saint-Paul dans la rue des Fauconniers,
Où l’on trouve bien, por deniers,
Pour son cors solacier.
Il ne nous dit pas s’il a usé de la recette qu’il
donne à ses lecteurs. Puis, dans la rue aux Commanderesses,
qui est aujourd’hui la rue de la Coutellerie,
Guillot fait un retour sur lui-même, en disant:
Où il a maintes tencheresses (querelleuses)
Qui ont maint homme pris au brai (à la pipée).
Enfin, la tâche de Guillot est achevée; il a ramassé
[84]
la boue de toutes les rues de Paris, et il se glorifie
de son Dit, rimé en leur honneur, sans craindre
de dédier cette œuvre, pleine d’impuretés, au doux
Seigneur du firmament et à sa très-douce chiere mère.
Nonobstant cette dédicace, qui n’épurait pas les
rimes de Guillot, un autre poëte anonyme, qui vivait
à la fin de quatorzième siècle, eut l’idée de
s’approprier le Dit des Rues, en lui ôtant son cachet
obscène et en rajeunissant le style de cette pièce de
vers, dans laquelle on ne reconnaissait plus les rues
qui avaient changé de nom. C’est Henri Geraud
qui a publié ce nouveau Dit, d’après un manuscrit
des Archives nationales, et qui l’a placé à la suite
de la Taille imposée sur les habitants de Paris en 1292,
dans son ouvrage intitulé Paris sous Philippe-le-Bel.
Remarquons, à ce propos, que le rôle de la taille ne
contient aucun détail particulier qui se rattache à la
Prostitution: ce qui prouverait que les femmes folles
de leurs corps ne participaient point, du moins sous
cette désignation, aux tailles extraordinaires, et que
leur indignité les exemptait de payer un droit proportionnel.
Le poëte qui a voulu refaire le poëme de
Guillot et qui ne fait souvent que le reproduire en
l’abrégeant, s’est attaché surtout à en ôter ce qui lui
donnait un caractère libertin ou ordurier. Cet anonyme,
au lieu de nous représenter Guillot allant de
rue en rue à la découverte des mauvais lieux, a inventé
une fable assez amusante: il se met en scène
lui-même, nouvellement débarqué à Paris, où il
[85]
n’était jamais venu, et il parcourt cette capitale, en
cherchant de rue en rue sa femme, qu’il avait perdue
près de Notre-Dame; rien ne peut le distraire
de ses recherches, qui sont infructueuses, et toutes
les femmes qu’il rencontre à chaque pas ne lui font
pas oublier la sienne, jusqu’à ce qu’il ait terminé sa
poursuite conjugale à travers 310 rues, qu’il a pris
soin d’énumérer; il s’écrie alors:
Tant l’ay quise, que j’en suis las!
Or la quiere qui la voudra:
Jamais mon corps ne la querra.
Dans cette nomenclature de rues, il ne parle que
des chambrières qu’on louait dans la rue des Lavandières,
et des trusseresses de la rue aux Commanderesses;
mais il cite, d’ailleurs, les rues les plus
malfamées, sans faire même allusion à la nature de
leur mauvaise renommée.
Depuis le Dit des Rues de Guillot, il y a un intervalle
de près d’un siècle jusqu’à la première ordonnance
du prévôt de Paris, qui fixe les endroits où la
Prostitution pouvait avoir cours sans être exposée à
une pénalité quelconque. Cette ordonnance rapportée
par Delamare est du 18 septembre 1367. On pressent
déjà l’influence moralisatrice du règne de Charles
V. Dans cette ordonnance, le prévôt enjoint à
toutes les femmes de vie dissolue d’aller demeurer
dans les bordeaux et lieux publics qui leur sont destinés;
savoir: «à l’Abreuvoir Mâcon, en la Boucherie,
en la rue du Froidmantel, près du Clos Bruneau,
[86]
en Glatigny, en la Cour Robert-de-Paris, en Baillehoe,
en Tyron, en la rue Chapon, en Champ-fleury.»
Ce sont les mêmes lieux à peu près que Guillot avait
désignés dans le Dit des Rues, mais leur nombre est
infiniment plus restreint et l’on doit en conclure que
la police prévôtale s’efforçait de diminuer les effets
déplorables de la débauche, en lui disputant le terrain
où elle était autorisée à se produire. Le prévôt
de Paris fait défenses, en outre, à toutes personnes
honorables de louer des maisons aux femmes de
mauvaise vie en aucun autre endroit, sous peine de
perdre le prix du loyer; il défend aussi à ces femmes
d’acheter des maisons hors des rues réservées à leur
métier, sous peine de perdre ces maisons. Celles
qui seraient trouvées faisant leur commerce infâme
en d’autres lieux, pourraient être, sur la réquisition
de deux voisins, arrêtées par les sergents et amenées
prisonnières au Châtelet. Après constatation du
fait, on les chasserait hors de la ville, en prenant
sur leurs biens huit sols parisis par chacune d’elles,
pour le salaire des sergents. Il y a toute apparence
que cette mesure de police fut exécutée avec une
extrême rigueur.
Les asiles de tolérance que le prévôt de Paris
accordait à la Prostitution étaient des espèces de
cours plutôt que des rues entières; nous verrons
plus tard s’ouvrir de la même façon les cours des
Miracles, qui renfermaient les gueux et les mendiants,
les voleurs et les autres malfaiteurs, comme
[87]
les cours de ribaudie réunissaient les femmes publiques
et les hommes dissolus, leurs ignobles complices.
L’Abreuvoir Mâcon était, au quatorzième
siècle, un groupe de masures environnant une ruelle
putride qui descendait à la rivière près du pont
Saint-Michel, au coin de la rue de la Huchette. Cet
abreuvoir, que les titres de 1272 nomment Aquatorium
Matisconense et Adaquatorium comitis Matisconensis,
tirait son nom du voisinage de l’hôtel des
comtes de Mâcon, situé dans la rue qui porte encore
leur nom. Ce mauvais lieu s’est perpétué au même endroit
jusqu’à nos jours: il avait une horrible célébrité
au seizième siècle, et les libertins lui faisaient honneur
des impures analogies de son nom, qu’ils s’obstinaient
à prononcer d’une façon déshonnête. Ce fut
sans doute à cause de cette grossière équivoque,
qu’on essaya de débaptiser l’Abreuvoir mâconnais et
d’en faire l’Abreuvoir du Cagnart, soit parce qu’il
servait de repaire nocturne aux cagnardiers, rôdeurs
de rivière, soit plutôt parce que les habitants du
bord de l’eau y élevaient des canards. En tout cas,
il y avait là bien des cagnardiers, vagabonds dangereux,
qu’on appelait ainsi, selon Pasquier, à cause
de leur genre de vie, car, à l’exemple des canards,
«ils vouoient leur demeure à l’eau.» Borel, au
contraire, veut que cagnardier dérive de canis et dénote
des gens qui vivent en chiens.
Il est difficile de préciser l’endroit que le prévôt
appelle la Boucherie, sans autre désignation; mais,
[88]
quoique plusieurs boucheries eussent établi leurs
étaux dans différents quartiers de la capitale, nous
présumons qu’il est question de la Grande Boucherie
de l’Apport de Paris, qui existait depuis le dixième
siècle vis-à-vis du Châtelet, et qui s’était agrandie
successivement, de manière à former une sorte de
bourg au milieu de la ville. C’était là qu’on tuait et
dépeçait les bêtes dont la viande se détaillait ensuite
dans tout Paris. On comprend que la prévôté autorisât
le séjour des ribaudes au milieu d’une population
de ribauds, tels que les bouchers, les écorcheurs
et les équarrisseurs; il y eut, à toutes les époques et
dans tous les pays, une marque d’infamie attachée
à ces professions qui respiraient l’odeur du sang des
animaux. Cependant on exigeait certaines conditions
de moralité chez ceux qui touchaient aux viandes
et qui les taillaient aux étaux de la Grande Boucherie.
Le Clos Bruneau, dont Guillot avait déjà fixé la
réputation, ainsi que pour les rues de Glatigny, de
Baillehoé et de Tyron, comprenait encore, au quinzième
siècle, un vaste espace rempli de jardins et de
vergers, quoique les rues Saint-Jean-de-Beauvais et
Saint-Hilaire eussent été prises sur le terrain de ce
clos: les bordes des femmes de mauvaise vie s’étaient
répandues de toute ancienneté aux environs du clos
Brunel, et peut-être, dans son enceinte, derrière
les haies et parmi les vignes. La rue Froidmantel,
qu’on a nommée alternativement Frementel, Fresmantel,
[89]
Fremanteau, etc., en latin Frigidum mantellum,
et qui est devenue la rue Fromentel, au mépris
de son étymologie, dut certainement son nom
primitif à une comique allusion aux ordonnances de
saint Louis qui dépouillaient de leur manteau et de
leur peliçon les femmes convaincues de Prostitution;
celles qui habitaient cette rue de prostituées étaient
donc naturellement privées de manteau: de là leur
surnom de dames de Froidmantel.
Le fief de Glatigny, qui appartenait en 1241 à
Robert et à Guillaume de Glatigny, avait donné son
nom à un labyrinthe de ruelles étroites et malpropres
que la Prostitution occupait par privilége et dont elle
avait fait le fameux Val d’amour: Guillot, qui s’y
engagea en plein jour, y avait vu des dames au
corps gent qu’il ne craignait jamais de rencontrer sur
son chemin. La destination impudique de Glatigny
a persisté jusqu’au dix-septième siècle, où les rues
adjacentes furent rebâties et mieux habitées. Sauval
et ses continuateurs ne nous disent pas en quel
quartier était située la Cour Robert-de-Paris, et le
nom sous lequel cette Cour est désignée ne nous
aiderait pas à retrouver sa situation, si la Taille de
1292 ne fixait pas notre incertitude à cet égard.
Cette Cour, qui devait être fort petite, puisque le
rôle de la taille n’y compte que treize personnes imposables,
attenait à la rue Baillehoé, qui lui servait
de corollaire et qui rassemblait la même sorte d’habitants.
Henri Geraud prétend que la rue du Renard-Saint-Merry
[90]
a été percée sur l’emplacement de
la Cour Robert-de-Paris. La rue Chapon, qui n’a pas
changé de nom, l’avait pris au treizième siècle d’un
de ses habitants, Robert Beguon, ou Begon, ou
Capon, que nous supposons avoir été un roi des
truands, un maître gueux, car begon ou beguon
semble dérivé de beguinus, qui veut dire originairement
quêteur ou mendiant, en anglais begging; capon,
qui vient de capus, oiseau de proie ou faucon,
était synonyme de beguon. Nous ne pensons pas que
l’on ait attribué, par antiphrase, le nom de Chapon
à une rue qui se trouvait affectée spécialement à la
débauche. Enfin, la rue de Champfleury, qui, sous
le nom de rue de la Bibliothèque, conserve toujours
religieusement ses traditions bordelières, avait été
ouverte depuis peu d’années sur l’emplacement du
parc du Louvre, car, dans la Taille de 1292, elle ne
figure que pour quatre contribuables. Cette rue de
Champ-fleury ne se composait donc que de quelques
petites maisons, encloses de haies et ombragées d’arbres,
dans lesquelles la Prostitution n’avait rien à
redouter du regard curieux des passants, qui ne
venaient là que pour y trouver ce qu’ils y cherchaient.

Sommaire.—Le cabaret du Char doré.—La rue de Glatigny.—La
rue du Fumier.—La rue d’Enfer.—La cour Ferry.—La
maison de Cocatrix.—Le Caignard.—Les voûtes de la Calandre
et du Marché-Palu.—L’île de Gourdaine.—Le Terrain ou la
Motte aux Papelards.—Les faubourgs.—Le Champ Gaillard.—Les
quatre tavernes méritoires.—Le Château-de-Paille.—La
taverne de la Mule.—Les lupanaires de l’Université.—Le
Champ-d’Albiac.—La rue Gracieuse.—Les Champs de la
Boucherie, Petit et de l’Allouette.—La rue de l’Aronde.—La rue
Gît-le-Cœur.—La rue Sac-à-Lie.—La rue Bordet.—Les
Cours des Miracles.—Etc., etc.
Nous continuons notre voyage pornographique
dans le vieux Paris, en nous attachant à signaler
[92]
les rues suspectes qui ne sont pas mentionnées
comme telles dans le poëme de Guillot, ni dans les
ordonnances du Châtelet. L’ancien nom de ces rues
est presque toujours l’enseigne de leur caractère
particulier. D’abord, dans la Cité, nous constaterons
que, malgré l’usage général qui éloignait du centre
des villes les femmes de mauvaise vie, pour les
rejeter au delà des murs et, pour ainsi dire, hors
de la vie commune, la Prostitution s’était maintenue
en plusieurs rues autour de Saint-Denis-de-la-Châtre,
qui avait vu se former la première confrérie de la
Madeleine, comme nous l’avons rapporté d’après
les traditions recueillies par Dubreul et Sauval. Il
était tout naturel que le voisinage du Val d’Amour
de Glatigny fût envahi de préférence par les ribaudes,
qui y allaient commettre le péchié, suivant les termes
des anciens édits. On peut donc affirmer que la
plupart de ces horribles ruelles, qui ont disparu
depuis peu d’années dans les grands travaux de
voirie exécutés à travers la vieille cité lutécienne,
étaient au moyen âge le théâtre permanent de la
débauche, quoique les règlements de police municipale
eussent essayé de la circonscrire dans son
sanctuaire de Glatigny. Les rues des Marmousets,
Cocatrix, d’Enfer, de Perpignan et d’autres, qui
formaient un labyrinthe de maisons entassées l’une
sur l’autre, privées de jour et d’air, convenaient
merveilleusement aux habitudes bordelières. Nous
savons, par exemple, que la rue de Perpignan
[93]
s’était nommée rue Charoui, à cause d’un cabaret
du Char doré (de carro aurico); Guillot a parlé de ce
cabaret:
En Charoui,—bonne taverne achiez ovri.
Toute taverne devenait, au besoin, un lieu de Prostitution.
Cette taverne de Charoui devait être accompagnée
d’un jardin planté de roses, puisque la rue
prit successivement les noms significatifs de Champrousiers,
de Champflory et de Champrosy. Ce champ
de roses n’était peut-être qu’une image du plaisir
qu’on allait chercher dans ce cabaret, qui fut remplacé
par un jeu de paume, d’où la rue tira son dernier
nom de Panpignon ou Perpignan.
Le nom de Val d’Amour s’appliquait plus particulièrement
à l’entrée fort étroite de la rue de Glatigny,
qui descendait vers la rivière et qui menait au port
Saint-Landry. Le long de ce petit port, où venaient
atterrir quelques barques chargées de bois et de blé,
régnait une ceinture de maisons qui, accrochées
l’une à l’autre et se soutenant à peine, baignaient
dans l’eau leurs pieds vermoulus; ces maisons appartenaient
de droit à la plus abjecte Prostitution, que
nous verrons partout se réfugier aux bords des fleuves.
La rue humide et ténébreuse, que ces hideuses masures
formaient par derrière, se nommait tantôt rue du
Port-Saint-Landry-sur-l’Yeau, et tantôt rue du Fumier.
La famille des Ursins ne craignit pas d’y faire bâtir un
hôtel où demeura un des membres les plus illustres
[94]
de cette famille, Juvénal des Ursins, prévôt des marchands
et chancelier de France sous Charles VI. La
présence de ce grave personnage dans une rue si mal
famée ne servit qu’à lui faire changer de nom, elle
se nomma dès lors rue des Ursins; mais son extrémité
inférieure (via inferior) fut appelée rue d’Enfer, par
allusion à la damnable vie que menaient ses habitants.
Nous avons déjà hasardé une conjecture,
peut-être téméraire, à l’endroit de la rue des Marmousets,
que Guillot semble nous représenter comme
fréquentée par des ribauds, plus encore que par des
ribaudes. Cependant, une liste des rues de Paris,
que l’abbé Lebeuf estime avoir été dressée en 1450,
enregistre cette rue sous le nom de rue des Marmouzètes.
Nous savons aussi qu’un grand logis, dit maison
des Marmousets (domus Marmosetarum), auquel
on montait par des degrés extérieurs, y a existé jusqu’au
seizième siècle. Ce logis renfermait-il une cour
de ribaudie? Près de là, il y avait un lieu de cette
espèce nommé la cour Ferry, qui avait donné son
nom à la rue des Trois-Canettes. Faut-il encore
reconnaître un lieu analogue dans la maison de Cocatrix
(domus Coquatricis), qui attenait à celle des
Marmousets et portait le nom de la rue où il était
situé? Cette rue, que les archéologues de Paris prétendent
honorée du nom d’un bourgeois qui l’habitait
au treizième siècle, pourrait plutôt, à cause de
son vilain renom, offrir un champ curieux à l’étymologie.
Ainsi, dans notre vieille langue, cocatre signifie
[95]
un chapon châtré à demi; cocatrix est, au propre, un
lézard qui s’engendre dans les puits et les citernes;
au figuré, c’est une fille de joie qui fait des coues et
des coqs, suivant l’expression facétieuse d’un vieux
conteur. Dans la Verba erotica de son édition de Rabelais,
le docte De l’Aulnaye définit Cocquatris, une
prostituée. A l’appui de cette définition, et pour ne
laisser aucun doute sur les anciennes franchises de
la rue Cocatrix, les auteurs de la grande Histoire de
Paris, Félibien et Lobineau, ont extrait des registres
du parlement les premières lignes d’un arrêt qui
commence ainsi: «Du mardi, 15e jour de juin 1367,
entre Jehanne la Peltiere, appelante, d’une part,
maistre Jehan d’Alcy et les autres habitants de la
rue des Marmouzets, d’autre part. L’appelante dict
qu’elle demeure en la rue Coquatrix, qui est foraine,
où il y a eu bordel, de si longtemps, qu’il n’est
mémoire du contraire, etc.» Ce passage prouve,
en outre, que les rues où il y avait bordel étaient
regardées comme foraines, c’est-à-dire étrangères au
régime et au droit commun de la voirie ordinaire.
A l’opposite des mauvais lieux de Glatigny, on
trouvait encore dans la Cité d’autres asiles de Prostitution
connus seulement des plus vils vagabonds.
C’étaient le Caignard et les voûtes de la Calandre et
du Marché-Palu. Quoique l’aspect de ces lieux-là
soit encore aujourd’hui aussi triste que répugnant,
on se ferait difficilement une idée de ce qu’ils étaient
aux treizième et quatorzième siècles, lorsqu’ils servaient
[96]
de repaire nocturne à la débauche la plus immonde.
La rue de la Calandre, par son nom emprunté
à une petite alouette babillarde, caractérisait
les assemblées de femmes, qui s’y tenaient du matin
au soir, et qui ne faisaient que jargonner et débattre,
quand elles ne péchaient pas. Cette rue, pleine de
boues et d’immondices, conduisait au Marché-Palu,
dont le nom annonce un étang ou marais (palus),
et qui n’était qu’un cloaque, un trou punais, comme
on disait en ce temps. Mais ce n’étaient que roses auprès
des ruelles qui y aboutissaient et qui ne furent
fermées qu’au milieu du dix-septième siècle. Une de
ces ruelles, qui, du temps de Sauval, existait encore
en partie entre les premières maisons du Petit-Pont et
quelques maisons du Marché-Neuf, s’appelait le Caignard,
«à cause, dit Sauval (t. I, page 174), qu’elle
servoit de passage aux hommes et aux femmes de
mauvaise vie, qui y passoient, en se retirant, la nuit,
sous les logis du Petit-Pont, où ils menoient une
étrange vie.» Enfin, la Prostitution errante avait encore
dans la Cité deux champs de foire nocturne, l’un
sous les saussaies d’une petite île, qui, nommée l’île
de Gourdaine au quinzième siècle, et l’île aux Vaches
trois siècles auparavant, forma depuis la pointe occidentale
de l’île de la Cité, et l’autre, sur un monticule
qui s’élevait à l’extrémité orientale et qui s’est
toujours nommé le Terrain. Ce monticule, que les décombres
provenant de la reconstruction de Notre-Dame
avaient exhaussé dans le lit de la rivière, et
[97]
que le chapitre de la cathédrale s’était approprié sans
en tirer parti, devenait tous les soirs le rendez-vous
des débauchés et de leurs méprisables instigateurs:
on l’avait surnommé, pour cette raison, dès l’année
1258, la Motte aux Papelards (Motta Papelardorum.)
Une citation, tirée d’un sermon de Robert de Sorbon,
sur la Conscience, nous fera comprendre dans quel
sens équivoque le peuple employait ici le mot Papelards
pour désigner les honteux poursuivants des
femmes perdues: Imo propter hoc dicuntur papelardi,
quia frequentant confessiones. Il est remarquable que
le sermon de Robert de Sorbon, où Ducange a pris cette
citation singulière, est presque contemporain du baptême
de ce terrain ou terrail (terrale), où les Papelards
trouvaient à qui parler. Quant à l’île de la Gourdaine,
qui avait été l’île aux Vaches, suivant d’anciens
titres que les archéologues n’ont pas tenté d’expliquer,
son nom a des analogies ou des accointances
avec goudine, gourgandine et gordane, qui étaient
synonymes de prostituée. Cette île-là, d’ailleurs, dans
laquelle furent brûlés les Templiers sous le règne de
Philippe le Bel, paraît avoir été un lieu de supplice
consacré particulièrement à la punition des crimes
obscènes, parce qu’on voulait tenir à distance du
peuple les coupables qui s’étaient souillés de cette
espèce de crime et qui pouvaient être un objet de
scandale à leurs derniers moments.
Dans le quartier de l’Université, qui renfermait tant
de rues désertes, tant de clos et de champs inhabités,
[98]
tant de bordes et de tavernes, la Prostitution
avait une foule de retraites que les sergents du Châtelet
et n’osaient pas violer et dans lesquelles affluait jour
et nuit la gent écolière. La définition que fait de la
vie des faubourgs une ordonnance de Henri II, en
1548, peut être appliquée à l’état de ces mêmes lieux,
deux ou trois siècles auparavant: «Plusieurs des
maisons desdits faubourgs ne sont que retraites de
gens malfaisants, taverniers, jeux et bourdeaux, et
la ruine d’un grand nombre de jeunes gens qui, alléchez
et attirés d’oisiveté, consument et perdent
là profusément leur jeunesse.» Il est aisé d’imaginer
les besoins de débauche qui dominaient cette population
universitaire, composée de robustes compagnons
ayant la plupart âge d’homme et souvent pervertis
par la fainéantise et la misère. Les ordonnances
de saint Louis n’avaient autorisé que deux asiles de
ribaudes, l’Abreuvoir Mâcon et Froidmantel, près le
clos Bruneau, dans l’Université; mais Guillot nous a
signalé six ou sept rues où s’exerçait ouvertement
la Prostitution. Les écrivains du même temps, Jacques
de Vitry surtout, nous apprennent que chaque
maison du quartier des Écoles contenait au moins
un mauvais lieu. Alain de l’Ile, le docteur universel,
disait des écoliers de son temps, qu’ils aimaient mieux
contempler les beautés des jeunes filles que les beautés
de Cicéron. Ce sont les Flamands que Jacques de
Vitry représente comme plus corrompus que les autres:
«Ils sont prodigues, dit-il, aiment le luxe,
[99]
la bonne chère et la débauche, et ont des mœurs
très-relâchées.» Il fallait une quantité prodigieuse
de femmes de bonne volonté, pour satisfaire les passions
de cette jeunesse indisciplinée, qui s’en allait
par bandes à ses plaisirs comme à ses études. Rabelais,
dans son Pantagruel, en nous racontant les exploits
de Panurge, nous apprend que la police municipale
n’avait pas encore d’action, au seizième siècle,
sur les franchises de l’Université, et que l’ombre
d’un écolier mettait en fuite les sergents du guet: il
résulte de là que les femmes dissolues se trouvaient
placées sous la sauvegarde des écoliers, qui les tenaient
hors de la portée des règlements du Châtelet.
Outre les rues de la Plâtrière, des Cordeliers, du
Bon-Puits, des Noyers, des Prêtres-Saint-Séverin, etc.,
où l’auteur du Dit des Rues de Paris confesse avoir
rencontré mainte meschinète, nous sommes surpris
qu’il n’en ait pas trouvé davantage au Champ-Gaillard
et au Champ-d’Albiac. Le Champ-Gaillard était
une place ou plutôt un préau qui s’étendait le long
des murs de l’enceinte de Philippe-Auguste, depuis
la porte Saint-Victor jusqu’à la porte Saint-Marcel;
la rue qu’on ouvrit sur ce terrain au treizième siècle
prit le nom de rue des Murs, à cause de sa situation;
on l’appela ensuite rue d’Arras, lorsqu’on y fonda
un collége, ainsi nommé, en 1332; mais le peuple
qui l’avait qualifié de Champ-Gaillard, pour exprimer
sa destination nocturne, ne lui retira pas ce
nom, que justifiait d’ailleurs l’établissement d’une ribaudie
[100]
fréquentée surtout par les écoliers. Ce mauvais
lieu avait encore assez de célébrité au seizième
siècle, pour que Rabelais, qui n’en parlait pas vraisemblablement
par ouï-dire, l’ait cité, seulement avec
trois autres, pour caractériser les désordres des écoliers
de Paris: c’est dans le chapitre VI du second
livre, où le Limousin qui contrefaisait le langage
français raconte les faits et gestes de ses pareils: «Certaines
diecules, nous invisons les lupanaires de
Champ-Gaillard, de Matcon, de cul-de-sac de Bourbon,
de Hueleu, et, en ceste ecstase venereique, inculcons
nos veretres ès penetissimes recesses des
pudendes de ces meretricules amicabilissimes.» Le
langage de l’écolier limousin, qui écorchait le latin
et croyait pindariser, est assez inintelligible, par bonheur,
pour qu’on ose le rapporter comme un monument
de la grammaire érotique de l’Université.
Dans le même chapitre de Rabelais, il est aussi
question de quatre cabarets qui devaient être aussi
mal famés que les bourdeaux, puisque nous savons,
par plusieurs ordonnances de la prévôté, que la plupart
des caves et tavernes où l’on donnait à boire
étaient tenues par des femmes publiques ou par leurs
maquignons, ou courratiers. «Puis, nous cauponisons,
dit l’écolier à Pantagruel, ès tabernes méritoires
de la Pomme-de-Pin, du Castel, de la Maddelaine
et de la Mulle.» Voilà bien les tabernæ
meritoriæ des historiens romains, notamment de Suétone,
qui nous prouve par là que le mot meretrix a
[101]
été tiré du verbe mereri et du substantif meritum.
Mais nous ne chercherons pas à fixer, au moyen d’une
dissertation archéologique, l’emplacement de ces
quatre tavernes méritoires, et nous nous bornerons
à faire remarquer que leurs noms semblent concorder
avec ceux des rues où elles étaient sans
doute situées; ainsi la rue de la Madeleine et la rue de
la Pomme dans la Cité, sont devenues depuis le quatorzième
siècle la rue de la Licorne et la rue des Trois-Canettes,
tout en conservant leurs cabarets à l’enseigne
de la Madeleine et de la Pomme-de-Pin; la
rue du Châtel ou du Château-Fètu se composait d’une
partie de la rue de la Ferronnerie, aboutissant à la rue
de l’Arbre-Sec, et une maison, dite le Château-Fètu
ou Château-de-Paille, dont l’origine n’est pas connue,
a subsisté longtemps entre l’église de Saint-Landri
et la rivière: la place n’était-elle pas bien choisie
pour y mettre un cabaret et le reste? Quant à la taverne
de la Mule, il faut aller la chercher jusque
dans la rue du Pas-de-la-Mule, que la fondation de
la place Royale n’a pas débaptisée de son vieux nom,
en lui imposant celui de rue Royale qu’elle n’a pas
gardé. Nous ne craignons donc pas de comprendre,
dans l’inventaire des mauvais lieux de Paris, ces
quatre cabarets fameux, qui sont mentionnés souvent
par les poëtes et les conteurs du seizième siècle.
Mais cette digression sur les cabarets nous a un peu
écarté des lupanaires de l’Université, que nous n’avons
pas la prétention de connaître tous. La rue Gracieuse,
[102]
qui a porté d’abord le nom de rue d’Albiac,
avait été bâtie sur un terrain qu’on appelait le Champ-d’Albiac,
et qui était, de temps immémorial, consacré
à la Prostitution: les asiles qu’elle y avait occupés
par droit héréditaire, ne furent détruits qu’en 1555,
comme nous le verrons sous cette date. Les antiquaires
étymologistes ont trouvé, dans les Comptes de Paris,
le nom d’une famille d’Albiac et celui d’une famille
Gracieuse, qu’ils nous donnent pour les parrains
rivaux de cette même rue, si mal habitée à toutes
les époques; mais, si nous hasardons une conjecture
plus analogue au caractère de ce lieu-là, nous aimons
mieux reconnaître dans le nom d’Albiac une allusion
aux Albigeois (Albiaci et Albigenses), qui étaient des
hérétiques, non-seulement en religion, mais encore
en amour, suivant l’opinion populaire qui confondait
sous la dénomination d’Albigeois et d’Albiacs tous les
débauchés perdus de vices et souillés d’impuretés.
Le Champ-d’Albiac devait donc être le champ de
foire de ces impuretés, et la rue qui s’ouvrit sur ce
repaire, sans le purifier, fut surnommée Gracieuse,
par moquerie ou par antinomie.
Il y avait d’autres champs où les ribaudes tenaient
leurs bouticles au péché, tels que le champ de la Boucherie,
près de la rue des Mauvais-Garçons; le champ
Petit, près de la rue du Battoir; le champ de l’Allouette,
etc. Le mot champ désigne ordinairement
un endroit où l’on vend et où l’on achète. Mais, en
nous renfermant dans la catégorie des rues et ruelles
[103]
impures, nous ne pouvons oublier la rue de l’Aronde
ou de l’Hirondelle, voisine de l’Abreuvoir Mâcon,
que Rabelais, peu avare d’étymologies ordurières,
appelle Matcon. Cette rue de l’Hirondelle, qui se
cache noire et infecte derrière les maisons du quai
Saint-Michel, avait tiré son nom de l’enseigne d’un
lieu de débauche. Près de là, il serait facile de découvrir
une équivoque très-significative dans le nom
de la rue Gît-le-Cœur, qui a été appelée tour à tour,
par corruption malicieuse ou involontaire, Villequeux,
Guillequeux, Gilles-Queux, Gui-le-Comte, etc.
A peu de distance de cette rue (à propos de laquelle
il faut sous-entendre la spirituelle parenthèse de
Boufflers: Je dis LE CŒUR, par bienséance), on avait
encore la rue Pavée, que les bonnes langues nommaient
tout au long rue Pavée-d’Andouilles. Les rues
voisines, dont les anciens noms accusent l’ancienne
industrie, furent également infestées de femmes de
mauvaise vie; la rue Sac-à-Lie, sobriquet donné à
ces sortes de femmes, est devenue rue Zacharie; la
rue de l’Éperon se nommait rue de Gaugai (Gautgay,
plaisir gai) et annonçait ainsi le genre de passe-temps
qu’on y trouvait. Enfin, c’est dans ce dédale
de ruelles, qui avaient remplacé le vignoble de Laas
ou Liaas, où la Prostitution errante promenait ses
amours; c’est entre la rue de Hurepoix et la rue
Poupée, que nous voudrions retrouver le lupanaire
du cul-de-sac de Bourbon, que les commentateurs de
Rabelais transportent près du Louvre. En un mot, le
[104]
quartier de l’Université était plus riche en lieux de
débauche, ou du moins, plus peuplé de filles de
joie, que tous les autres quartiers de Paris; et cela
n’a pas besoin de preuves, si l’on considère les habitudes
licencieuses des écoliers, qui ne sortaient
guère des limites de leur domaine et qui avaient
chez eux assez de chière-lie, comme ils disaient,
pour n’en point chercher ailleurs. Mais les savants
qui ont écrit sur les rues de Paris se sont attachés à
les réhabiliter dans leurs vieux noms et dans leurs
vieilles traditions pornographiques; ils n’ont pas
remarqué que ces noms de rues, nés la plupart d’une
boutade populaire, avaient passé aux hommes plutôt
que des hommes aux rues, et ils n’ont presque
jamais tenu compte de l’autorité de l’étymologie.
Ainsi, quand ils veulent étudier l’origine du nom de
la rue Bordet, qui part de la fontaine Sainte-Geneviève
et monte jusqu’à la rue Mouffetard, à l’endroit
même où était la porte Bordelle, qui lui a légué son
nom, ils prétendent qu’un personnage, nommé Pierre
de Bordelles (de Bordelis), demeurait dans cette
rue au douzième siècle, et qu’il y a naturellement
laissé un nom qu’on ne saurait interpréter à mal.
«C’est une erreur populaire, disent les auteurs du
Dictionnaire historique de la ville de Paris, de croire
qu’à cause de la ressemblance de nom, cette rue ait
été autrefois affectée à la débauche.» Il est certain
pourtant que Pierre de Bordelles avait été qualifié
ainsi dans les actes, parce qu’il possédait une maison
[105]
dans cette rue, qui fut nommée Bordelles, Bourdelle
et Bordel, en raison de son usage primitif et des nombreuses
bordes que l’enceinte de Paris avait comprises
dans ses murs. La rue Bourdelle, qui conduisait à la
porte du même nom, ne fit rien pour donner un démenti
à ce nom malhonnête, que confirmait encore
le voisinage d’un Champ Gaillard, qui se changea en
Chemin-Gaillard, lorsqu’on y perça une rue, et qui
est maintenant la rue Clopin, nom moderne où se
reflète encore la tradition des mauvaises mœurs de
toutes ces rues attenantes aux murs d’enceinte et
aux portes de la ville.
- Marckl Del.
- Imp. de Drouart, r. du Fouarre, 11, Paris.
- Outhwaite, sc.
La Cour des Miracles de Paris.
Il ne nous reste plus qu’à indiquer la place topographique
de certaines cours de ribaudie, qu’on qualifiait
de Cours des Miracles, parce que les gueux,
qui s’y rassemblaient et qui simulaient les plus hideuses
infirmités pour émouvoir la commisération
publique, sortaient de là boiteux, culs-de-jattes,
aveugles, manchots, lépreux et couverts d’ulcères,
et rentraient le soir ingambes, joyeux et dispos, pour
faire la débauche toute la nuit. Ces cours des miracles
renfermaient une population de voleurs, de
mendiants, de vagabonds, de ladres et de créatures
abjectes qui n’avaient conservé de la femme que le
nom qu’elles déshonoraient. La plus ancienne de ces
cavernes d’infamie était celle de la Grande-Truanderie,
qui envoya des colonies dans tous les quartiers
de Paris où la police prévôtale leur permit
d’ouvrir une cour. Les deux grandes succursales de
[106]
la Truanderie furent les petites maisons du Temple,
ou les loges des Aumônes dans la rue des Francs-Bourgeois
au Marais, et la Cour des Miracles, par
excellence, près des Filles-Dieu, entre les rues Saint-Denis
et Montorgueil. On comptait, en outre, plus
de vingt cours ou repaires de la même famille, où
l’on menait la même vie de désordre et de turpitude.
Il suffira de citer la Cour de la Jussienne, dans
la rue Montmartre, à côté de la chapelle des prostituées,
dédiée à sainte Marie l’Égyptienne; la Cour
Gentien, dans la rue des Coquilles; la Cour Brisset,
dans la rue de la Mortellerie; la Cour de Bavière,
dans la rue Bordet; la Cour Sainte-Catherine et la
Cour du roi François, dans la rue du Ponceau; la
Cour Tricot, dans la rue Montmartre; la Cour Bacon,
dans la rue de l’Arbre-Sec, etc. Sauval dit, en parlant
des hôtes dangereux de la rue des Francs-Bourgeois:
«A toute heure, leur rue et leur maison
étoient un coupe-gorge et un asile de débauche
et de prostitutions.» Sauval fait encore un tableau
plus effrayant de la principale Cour des Miracles,
qu’il avait pu voir dans toute sa splendeur, lorsqu’elle
servait de refuge à tout ce qu’il y avait de
plus criminel, de plus impur, de plus ignoble dans
le peuple de Paris. C’était là que la Prostitution, à
l’ombre de l’impunité, atteignait le dernier degré
du vice.
Cette Cour des Miracles avait eu autrefois une
étendue considérable; mais elle se trouva insensiblement
[107]
resserrée entre la rue Montorgueil, le couvent
des Filles-Dieu et la rue Neuve-Saint-Sauveur;
elle ne se composait plus que d’une place irrégulière
et d’un cul-de-sac boueux et puant: «Pour y
venir, dit Sauval, il se faut souvent égarer dans de
petites rues, vilaines, puantes, détournées; pour y
entrer, il faut descendre une assez longue pente de
terre, tortue, raboteuse, inégale. J’y ai vu une
maison de boue à demi-enterrée, toute chancelante
de vieillesse et de pourriture, qui n’a pas quatre
toises en carré, et où logent néanmoins plus de cinquante
ménages chargés d’une infinité de petits enfants
légitimes, naturels et dérobés.» Sauval, qui a
recueilli des détails si curieux sur les habitants des
cours des Miracles, ne nous apprend rien malheureusement
des femmes que le royaume argotique enrôlait
sous le gouvernement du grand Coesre. On
regrettera davantage de n’avoir pas un portrait
physique et moral de ces sujettes du roi des gueux
et des argotiers, en sachant une étrange particularité
de leur infâme métier. «Des filles et des femmes,
raconte Sauval, les moins laides se prostituoient pour
deux liards, les autres pour un double, la plupart
pour rien. La plupart donnoient souvent de l’argent à
ceux qui avoient fait des enfants à leurs compagnes,
afin d’en avoir comme elles, et de gagner par là de quoi
exciter la compassion et arracher les aumônes.»
Le tarif des prostituées de la grande Cour des Miracles
était sans doute le plus humble qu’une femme
[108]
pût demander pour prix de ses honteuses complaisances;
mais il faut faire observer que deux liards
du temps de Sauval valaient environ dix sous de
notre monnaie, et que le double denier tournois représentait
les deux tiers d’un liard, c’est-à-dire trois
sous au cours actuel. Nous doutons que le taux de
la Prostitution soit jamais descendu plus bas.
On comprend que cette espèce de Prostitution
était tout à fait hors de l’action de la police du Châtelet.
Les malheureuses qui l’exerçaient, protégées
par les franchises des cours des Miracles, appartenaient
à la race cosmopolite des gueux et des voleurs
qui peuplaient ces asiles du crime. Elles
étaient couvertes de haillons et squalides de malpropreté;
la plupart, qui avaient du sang de cagot ou
de bohémien dans les veines, se distinguaient par
leur laideur repoussante, leur teint basané, leurs
cheveux crépus et leur odeur infecte; celles dont la
peau était blanche et la chevelure blonde, passaient
pour jolies, et servaient, comme telles, d’amorce aux
étrangers que leur mauvaise étoile égarait à la nuit
tombante aux environs d’une cour des Miracles. La
belle, dressée à cette espèce de chasse, aiguillonnait
la convoitise de la proie qu’elle guettait au coin
d’une rue: tantôt elle se montrait en larmes et inventait
une fable propre à exciter la compassion de
celui qui l’interrogeait; tantôt elle allait à la rencontre
de l’imprudent qui s’offrait à elle, et sous mille
prétextes elle l’entraînait à sa suite; tantôt elle lui
[109]
adressait des injures et des provocations, pour le
forcer à entrer en débat avec elle et pour avoir une
occasion de crier au secours: alors, ses complices,
père, frères, amis, accourant à sa voix, se jetaient
sur l’homme qu’elle accusait d’une insulte imaginaire
et qu’on dépouillait sous ses yeux, en le maltraitant,
en l’assassinant même, s’il cherchait à se
défendre. Le même sort attendait l’infortuné, quand
il s’était laissé séduire par cette sirène de carrefour
et qu’il avait eu le courage de la suivre dans son
bouge: c’était encore un père, un mari, un frère
qui venait lui demander compte d’une séduction
qu’on ne lui donnait pas toujours le temps d’accomplir,
et de gré ou de force il devait payer une rançon,
dans laquelle on comprenait tout ce qu’il portait
sur lui, sans excepter ses vêtements. Heureux si on lui
permettait de s’en aller en chemise, sain et sauf! Il
n’est pas besoin de dire que, quant aux ruses et à
la théorie de cette pipée amoureuse, le père les enseignait
à sa fille, le mari à sa femme, le frère à sa
sœur. Les enfants, dès leur bas âge, étaient livrés
à la merci de la plus exécrable corruption; ils faisaient
de leur corps une pâture, vendue, abandonnée,
sacrifiée à la lubricité de leurs parents ou de
leurs maîtres; ils n’avaient aucune notion du bien
et du mal, surtout dans les choses qui intéressent la
pudeur: fille ou garçon, leur premier pas dans la
vie les menait à la Prostitution la plus éhontée, et ils
ne sortaient plus de cette fange, quand ils y avaient
[110]
mis le pied. C’était là, de tout temps, la pépinière
des prostituées, qui en sortaient pour chercher fortune
et qui y rentraient quand elles étaient devenues
vieilles sous le harnois. Elles continuaient leur métier,
à vil prix, et si elles ne trouvaient plus même
deux liards ou un double pour salaire, elles se résignaient
à changer d’industrie, et, selon leur degré
de capacité, elles tiraient des horoscopes, lisaient
l’avenir dans les lignes de la main, préparaient des
breuvages d’amour, des philtres, des amulettes, ou
vendaient de la graisse et des cheveux de pendus,
pour les maléfices et les opérations magiques.
Il ne faut pas croire que les propriétaires des maisons
d’une rue affectée au service de la débauche
publique fussent très-empressés à se soustraire à cette
honteuse servitude qui leur procurait de grands bénéfices.
Nous voyons, au contraire, d’après les actes
d’un procès souvent renouvelé à l’occasion de la rue
Baillehoé, que la destination même d’une rue de ce
genre constituait un privilége fort avantageux en
faveur de ses propriétaires ou de ses locataires, qui
se montraient toujours jaloux de le défendre et de
le conserver. Ce procès, dont nous retrouvons les
traces çà et là dans les registres du parlement, dura
plus d’un siècle et se renouvela sous toutes les formes
entre les parties intéressées, qui étaient, d’une
part, certains bourgeois, possesseurs des maisons de
cette rue infâme, et d’autre part, le curé et les chanoines
de Saint-Merry. Le prévôt de Paris et le roi,
[111]
alternativement, intervenaient dans le débat et l’embrouillaient
davantage par des édits et des ordonnances
contradictoires. Le parlement, saisi de l’affaire
à son tour, ménageait les uns et les autres,
prononçait des arrêts, ordonnait des enquêtes et ne
se sentait pas le courage d’anéantir des droits fondés
par la législation de saint Louis et confirmés par un
long usage. Un arrêt du 24 janvier 1388, rapporté
dans les preuves de l’Histoire de Paris, par Félibien
et Lobineau (t. IV, p. 538), nous fait connaître l’état
de la question et les prétentions réciproques des
parties en litige. Le chevecier, le curé et les chanoines
avaient obtenu des lettres royaux qui supprimaient
définitivement la Prostitution dans la rue
Baillehoé, et une ordonnance du prévôt de Paris,
nouvellement élu, Jean de Folleville, enjoignit aux
femmes publiques qui habitaient cette rue de vider
les lieux sur-le-champ; comme ces femmes se
voyaient soutenues par les propriétaires des maisons
qu’elles occupaient, elles ne se pressaient pas d’obéir
à l’ordonnance de l’expulsion: le prévôt envoya des
archers qui les firent sortir de vive force et des maçons
qui murèrent l’entrée de leurs logis. Les propriétaires
lésés dans leurs intérêts et indignés de
cet abus d’autorité, portèrent plainte devant le parlement
et mirent en cause le chevecier, le curé et
les chanoines de Saint-Merry, qu’ils accusaient d’avoir
trompé la religion du roi et du prévôt. Ces honnêtes
propriétaires avaient remis leurs pleins pouvoirs
[112]
à trois d’entre eux, Jacques de Braux, dit
Jacobin, Philippe Gibier et Guillaume de Nevers.
Voici les arguments que chaque partie faisait valoir
en faveur de sa cause, qui fut sans doute plaidée à
fond en audience solennelle par les meilleurs avocats
du barreau de Paris.
Le chevecier, le curé et les chanoines disaient
que le roi saint Louis avait ordonné que les ribaudes
ne demeurassent point en lieux et rues honnêtes; le
prévôt de Paris, qui était alors en charge, décida
que la rue Baillehoé était dans les conditions d’honnêteté
prescrites par l’ordonnance, et il chassa de
cette rue les ribaudes, en condamnant à l’amende,
c’est-à-dire au quadruple du louage, les seigneurs des
maisons louées à ces femmes dissolues: «La rue,
ajoutent les défendeurs, est près de belles et grandes
rues notables, où il demeure plusieurs bourgeois et
plusieurs bourgeoises et les chanoines et chapelains
de ladite église. En outre, plusieurs inconvénients
s’en sont ensuis et pourroient plusieurs plus grands
inconvénients ensuir; car, se aulcun houillier ou ribault
tuoit un homme, il seroit près de l’église où il
pourroit se retraire; et est la rue belle et honneste
pour aller à Saint-Merry et pour aller d’icelle rue en
la Verrerie; et en telles rues si honnestes ne doivent
demeurer femmes folieuses. Item, que la rue est près
du moustier, et près du moustier telles femmes ne
doivent point demourer, et c’est le chemin par lequel
les chanoines et chapelains doivent aller à l’église.»
[113]
Les demandeurs répondaient «qu’il est expédient
que telles femmes soient emprès les rues publiques,
que en forsbourgs, et y sont faits moins de maux
et inconvénients que en rues foraines; que la rue est
estroicte et n’est bonne que à ce mestier et n’y a
que petites bouticles, et s’aucun y faisoit aucun delict,
il ne s’en pourroit fouir que par grande rue et
honneste, et seroit plustost prins que se tel delict
estoit faict loing de grande rue: et de tout tems
telles femmes ont demouré en ladite rue; et anciennement
y souloit avoir une porte, et, pour un inconvénient
qui advint dans ladite rue, la porte fut
abattue, et depuis tousjours y ont demeuré.» Ils
rappelaient, à cet égard, que sous le règne de Charles
V, Hugues Aubriot, prévôt de Paris, ayant visité
les bordiaux, en supprima plusieurs et laissa subsister
celui de Baillehoé, par cette raison que les gens
honteux oseroient mieux y aller que dans d’autres.
Ils prétendaient que l’église de Saint-Merry avait
intérêt même à ce que la destination de la rue ne
fût pas changée, «pour les rentes qui en vallent
mieux, et ce dit raison escripte, que: in virorum
honestorum domibus sæpe lupanaria exercentur, etc.
Dieu mercy, oncques mal ne fut fait en Baillehoé!» Ils
arguaient des ordonnances de saint Louis qui avait
voulu qu’il y eût bourdel en Baillehoé, comme en
Glatigny et en la Cour Robert-de-Paris: «par ainsi
volt que près de la Verrerie eust telles femmes, et
maintenant n’en a plus aucunes en la Cour Robert-de-Paris;
[114]
par conséquent, il est expédient qu’elles
demeurent en Baillehoé.» Ils objectaient, de plus,
que cette petite rue n’était pas le passage naturel
pour aller à l’église, et que la grande rue Saint-Merry
y conduisait plus directement; on pouvait aussi,
se dispenser d’y faire passer le corps de Nostre-Seigneur,
quand on le portait aux malades, quoiqu’on
ne fît pas scrupule de le porter souvent par la rue
Tiron, qui n’était pas plus honnête «et est expédient,
concluaient-ils, que le bordiau soit près de
l’église, car combien de telles femmes pèchent, elles
ne sont point du tout damnées, et est expédient
qu’elles voisent aucune fois à l’église: ce qu’elles font
plustost quand elles sont près que si elles estoient
loing. Et n’est pas inconvénient que bordiaux soient
près de l’église, car nous veons que Glatigny est
proche de Saint-Denis de la Chartre, l’une des plus
dévotes églises de cette ville et aussy près de Saint-Landry.»
Les défendeurs, dans leur réplique, évitèrent
de toucher à une question aussi épineuse que
celle de la convenance du voisinage des églises et
des bordiaux; ils se bornèrent à dire que la lettre
de l’ordonnance de saint Louis s’opposait à ce que
les femmes de mauvaise vie demeurassent auprès des
églises, et ils citèrent un texte de loi romaine à l’appui
de cette décision: Deterius est quod penès sacrosanctas
ædes morentur. «Et de droit naturel, ajoutaient-ils
avec tristesse, il n’est si petit en ceste ville, qui ne
puet requérir et faire vuider icelles femmes d’auprès
[115]
sa maison; par plus forte raison, le chevecier
qui est curé: qui fault aller à matines et aux autres
heures, et aller à toutes heures pour baptiser enfants
et anulleer malades et porter corpus Domini, c’est le
plus droict chemin d’aller de l’église Saint-Merry ez
rue de la Brille (sans doute la rue du Poirier) et Simon-le-Franc,
et de venir les bourgeoises à l’église
par Baillehoé.»
Nous ne savons pas positivement à quelle époque
se termina le procès, et nous devons regarder comme
un de ses derniers épisodes l’ordonnance de Henri VI,
roi d’Angleterre et de France, qui se déclara, en
1424, pour le curé et le chapitre de Saint-Merry. Il
est probable néanmoins que, malgré toutes les ordonnances
royales ou prévôtales, la Prostitution n’abandonna
jamais une rue dont elle avait joui et usé
par tel et si long temps, que ne est mémoire du contraire.
Mais le curé de Saint-Merry se vengea, dit-on, d’un
des seigneurs de cette rue, qu’il avait eu pour adversaire
dans l’affaire des bouticles au péché, et il le fit
condamner, par l’officialité, à faire amende honorable,
un dimanche après la messe, devant la porte de l’église,
comme coupable d’avoir mangé de la viande
un vendredi. Ce n’est pas tout; le chapitre, ayant
enfin triomphé des oppositions judiciaires, changea
le nom indécent de la rue, qui fut alors confondue
avec sa voisine la rue Brisemiche, et qui perdit de la
sorte son vieux caractère d’ignominie; car, en prononçant
Baillehoé, le peuple ajoutait une pantomime
[116]
et une grimace malhonnêtes, qui n’avaient plus de
sens à l’égard de la rue Taillepain ou Brisemiche.
Toutes ces étymologies de Baillehoé étaient également
significatives, soit qu’on l’écrivît Baillehoue ou
Baillehore ou Baillehort, soit qu’on préférât adopter
l’ancienne orthographe de Baillehoc ou Baillehoche;
car le verbe baille variait d’acception, suivant le
mot qu’on y accolait, et ce mot emportait toujours
avec lui une valeur obscène: houe, c’est un instrument
de labour; hore, c’est une fille publique; hort,
c’est un choc violent; hoc, c’est cela; hoche, c’est
une entaille, etc. En un mot, il y avait constamment
une image indécente attachée aux différents noms
de cette rue, qui, en perdant ses noms équivoques,
ne devint pas plus honnête, puisque dans le dernier
siècle les filles de la rue Brisemiche avaient encore
une célébrité proverbiale.
Le document, que nous avons analysé en parlant
du procès de la fabrique de Saint-Merry contre les
seigneurs de Baillehoé, nous permet de fixer certains
points d’archéologie pornographique. Nous pouvons
presque, avec certitude, constater que les rues
affectées à la Prostitution avaient été autrefois fermées
la nuit avec des portes; que ces rues, hantées par
les ribauds et gens dissolus, étaient souvent le théâtre
de rixes, de meurtres et d’inconvénients graves; que
néanmoins les maisons s’y louaient plus cher qu’ailleurs
et y produisaient de bons revenus à leurs propriétaires
ou tenanciers; que les femmes folieuses avaient
[117]
l’entrée libre dans les églises, où elles allaient, moins
pour prier, que pour chercher aventure; enfin, que
la présence d’un bordiau était avantageuse à la paroisse
en raison des aumônes que ses pensionnaires
payaient au curé et à la fabrique. Remarquons, en
outre, que dès lors un usage de droit coutumier, qui
s’est maintenu jusqu’à nos jours, autorisait chaque
bourgeois à porter plainte contre toute femme de
mauvaise vie, qu’il voulait faire expulser, de sa maison
ou de son voisinage, par les sergents du Châtelet
chargés de la police des prostituées et des lieux
de débauche.

Sommaire.—Le livre de la Taille de Paris.—Le roi des ribauds
de la royne Marie.—Ysabiau l’Espinète.—Jehanne la Normande.—Edeline
l’Enragiée.—Aaliz la Bernée.—Aaliz la
Morelle.—La Baillie et la Perronnelle-aux-chiens.—Perronèle
de Sirènes.—Anès l’Alellète.—Jehanne la Meigrète.—Marguerite
la Galaise.—Geneviève la Bien-Fêtée.—Jehanne la
Grant.—Ysabiau la Camuse.—Maheut la Lombarde.—Marguerite
la Brete.—Ysabiau la Clopine.—Anès la Pagesse.—Juliot
la Béguine.—Jehanne la Bourgoingne.—Maheut la Normande.—Gile
la Boiteuse.—Mabile l’Escote.—Agnès aux
blanches mains.—Jehanette la Popine.—Ameline la Petite.—Ameline
la Grasse.—Marie la Noire.—Anès la Grosse.—Jehanne
la Sage, etc., etc.
Nous avons dit que le livre de la Taille de Paris,
pour l’an 1292, ne présentait aucun fait relatif à la
[120]
Prostitution; mais, après avoir examiné de nouveau
ce livre si précieux pour l’histoire de Paris à cette
époque, nous croyons pouvoir modifier un peu ce jugement,
qui, pour être vrai au premier coup d’œil,
mérite de n’être accepté qu’avec certaines réserves;
car si, en effet, on ne trouve nulle part dans les
quêtes de la taille une désignation précise des femmes
communes qui exerçaient le métier de ribauderie, on
est tenté de les reconnaître çà et là sous des sobriquets
qui les caractérisent. Il est certain, toutefois, que ces
femmes ne payaient aucun impôt, dans les tailles
extraordinaires levées au profit du roi, en qualité de
ribaudes; mais elles payaient à titre de locataires
des maisons qu’elles habitaient en ville, hors de
leurs bouticles au péchié. Nous ne savons rien, par
malheur, sur les conditions de l’assiette des taxes; et,
par exemple, il nous est impossible de comprendre
pourquoi Paris, qui renfermait, sous Philippe le
Bel, une population de 400,000 âmes environ, ne
fournit que 15,200 contribuables, suivant les calculs
du savant Henri Geraud, payant ensemble 12,218 livres
et 14 sous. Ces contribuables ne sont pas certainement
les plus riches habitants, que les priviléges
de bourgeoisie exemptaient de la taille; ce ne sont
pas aussi les plus pauvres, comme nous le voyons
par les différences de fortune que semblent accuser
les variations de la taille. Il ne faut pas se fier aux
étranges suppositions de Dulaure, qui veut que le
nombre des tailles indique le nombre des feux; si
[121]
cela était, le rôle de la Taille ne mentionnerait pas,
avec une taxation spéciale, les enfants, les valets, les
chambrières, les ouvriers compagnons des personnes
imposées. Nous hasarderons une conjecture, qui ne
repose pas sur des preuves écrites, en disant que la
taille n’atteignait que les individus logés au rez-de-chaussée,
ayant ouvroir, ou fenêtre, ou issue de plain-pied
sur le pavé du roi. Cette conjecture, que rien,
d’ailleurs, ne contredit, a l’avantage d’expliquer
naturellement la singulière disproportion qui existe
entre le nombre des habitants et celui des contribuables,
parmi lesquels les femmes ne comptent pas
pour la dixième partie.
La Taille de 1292 nous permettra de constater un
fait que confirment plusieurs ordonnances postérieures
de la prévôté de Paris: c’est que les rues affectées
à la débauche publique ne recevaient les femmes de
mauvaise vie, qu’à certaines heures du jour, dans des
bordeaux ou clapiers où elles exerçaient librement
leur abjecte profession. Nous verrons qu’elles ne
logeaient pas la nuit dans ces mêmes rues, comme
si le législateur avait voulu qu’elles respirassent l’air
de la vie honnête en sortant de l’atmosphère de leur
infamie. Nous ne les rencontrerons donc que dans
les rues voisines, et nous n’aurons pas de peine à
les reconnaître à leurs surnoms populaires et à l’uniformité
de leur taxe. Avant d’aller à leur recherche
dans les paroisses où elles cachaient leur existence
souvent chrétienne et presque honorable en apparence,
[122]
puisqu’elles étaient quelquefois mariées et
avaient un ménage, nous devons extraire du livre
de la Taille une particularité très-bizarre, que l’éditeur
a laissée passer inaperçue et qui se rattache à
l’histoire de la Prostitution. Dans la quête des menues
gens qui résidaient au quartier Saint-Germain-l’Auxerrois
et qui furent tous taxés indifféremment à
1 sol ou 12 deniers par tête, on est étonné de trouver
le roy des ribaus de la royne Marie (voy. p. 5 du
Livre de la Taille, publié avec des commentaires par
H. Geraud). Quel est ce roi des ribauds qui avait
sa demeure dans la rue d’Osteriche, aujourd’hui rue
de l’Oratoire, vis-à-vis du Louvre? A coup sûr, il
ne s’agit pas ici d’un officier de la maison du roi de
France; et la misérable quotité de sa contribution
témoigne assez de sa condition infime. Ce n’est pas le
roi des ribauds de la cour de France, qui eût payé au
fisc la même redevance que Adam le cavetier, Jehan
menjuepain (mendiant) et Helissent, ferpiere de linge.
Il y avait, comme nous l’avons dit, un roi des
ribauds élu dans chaque cour de ribaudie, et cette
espèce de portier, chargé de maintenir l’ordre dans
le clapier, n’était qu’une piètre caricature du roi des
ribauds de l’hôtel du roi. Celui de la rue d’Osteriche
appartenait à la plus pauvre ribaudie de la ville, et ce
titre pompeux, dont il se décorait, ne l’empêchait
pas de n’être qu’un truand de piteuse espèce. Quant
à cette royne Marie, dont il se déclarait l’officier et le
ministre, ce ne peut être qu’une ribaude ou quelque
[123]
vieille entremetteuse qui aurait été intronisée reine
par ses sujettes ou par ses compagnes. Il n’y a pas
d’autre conclusion à tirer de cette qualification de
reine appliquée à une femme du nom de Marie, qui
avait un roi des ribauds taxé à 12 deniers; et il est
inutile de démontrer que ce chétif roi des ribauds
ne pouvait, en aucun cas, appartenir à la reine Marie
de Brabant, veuve de Philippe le Hardi, laquelle
vivait encore à cette époque. Nous sommes fondé à
croire, d’après cette simple indication, que, du
moins dans certaines ribaudies, les femmes publiques
se donnaient une reine, comme d’autres corporations
de femmes, notamment les lavandières,
les lingères, les harengères, etc. Cette reine devait
avoir naturellement un roi des ribauds, chargé de la
police particulière du mauvais lieu où régnait son
impudique maîtresse. Peut-être, aussi, attribuait-on
le nom de reine à la gouvernante d’une cour de
ribaudes. Nous avons vu cependant, à la suite des
rois de France, au seizième siècle, une gouvernante
de cette espèce, à qui les ordonnances de François
Ier et de Henri II n’accordent pas les honneurs
d’une indécente royauté. En général, le clapier étant
honoré du titre comique d’abbaye, dans le langage
pittoresque du peuple, la directrice d’une semblable
abbaye se disait abbesse ou prieure. On pourrait encore
supposer que la reine Marie était l’élue d’une
de ces joyeuses associations de fous, de conards, de
jongleurs, etc., qui simulaient un gouvernement
[124]
avec une burlesque imitation des offices de la royauté.
Venons-en à notre enquête sur les femmes sans
profession, que la Taille de 1292 nous montre logées
dans les rues suspectes et aux environs des rues
consacrées à la Prostitution. Nous remarquons d’abord,
parmi les menues gens de la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois,
imposés chacun à 12 deniers,
Florie du Boscage, qui demeurait en dehors de la
porte Saint-Honoré et, par conséquent, sur le fossé
de la ville; Ysabiau l’Espinète, dans la rue Froidmantel
du Louvre, qui vient à peine de disparaître
avec ses vieux repaires de débauche; Jehanne la
Normande, dans la rue de Biauvoir, qui existait
encore il y a quarante ans sous le nom de rue de
Beauvais; Edeline l’Enragiée dans la rue Riche-Bourc,
qui est à présent la rue du Coq-Saint-Honoré;
Aaliz la Bernée, au coin de l’abreuvoir qui était à
l’entrée de la rue des Poulies; Aaliz la Morelle, dans
la rue Jehan Evrout, qui n’a pas laissé de traces; la
Baillie et Perronnelle-aux-chiens, dans la rue des
Poulies; Letoys, fille d’Aaliz-sans-argent, dans la rue
d’Averon, qui est la rue Bailleul. Il est assez bizarre
que les rues sombres et fétides où résidaient ces
filles, dont le sobriquet indique assez la profession,
n’ont jamais cessé d’être habitées par le rebut de la
population. Parmi les menues gens du quartier Saint-Eustache,
nous trouvons Perronèle de Serènes (ou
sirène), Anès l’Alellète (l’alouette), Jehanne la Meigrète,
Marguerite la Galaise, Geneviève la Bien-Fêtée,
[125]
Jehanne la Grant, etc. Les mêmes sobriquets
se sont conservés traditionnellement parmi le monde
de la Prostitution populaire.
Dans les mêmes quartiers et les mêmes rues, la
Taille de 1292 signale encore par des sobriquets
analogues un nombre de femmes qui pouvaient vivre
également de leur corps, mais qui en tiraient meilleur
profit, puisqu’elles sont imposées à 2, à 3 et
même à 5 sous. Telles étaient, en dehors de la Porte-Saint-Honoré,
Ysabiau la Camuse et Maheut la Lombarde;
dans la rue Froidmantel, Marguerite la Brete
et Ysabiau la Clopine; dans la rue Biauveoir, Anès
la Pagesse; dans la rue Richebourg, Juliote la Beguine,
Jehanne la Bourgoingne, Maheut la Normande,
Gile la boiteuse, etc. Il faut faire observer que les rues
pauvres et malfamées, qui acceptaient de pareilles
habitantes, n’étaient occupées, d’ailleurs, que par des
artisans de la plus vile espèce: pêcheurs, passeurs,
savetiers, fripiers, etc. Dans les rues plus passagères
et mieux habitées, on ne remarque pas souvent une
seule femme dont la condition semble équivoque.
Nous rencontrons seulement ces femmes suspectes
aux alentours des rues bordelières, où elles ne logeaient
pas, comme nous le prouverons plus loin.
Ainsi, dans la rue de Glatigny, où la débauche avait
son plus fameux atelier, on ne voit pas sans doute
figurer des personnes bien honorables: ce sont Margue
la crespinière, Jean le pastéeur, Héloys la chandelière,
Jaque le savetier, etc. Mais, en voyant au
[126]
nombre des locataires de cette rue infâme un certain
Jeharraz, qui paye 22 sols de contribution, Guibert
le Romain, qui en paye 25, la femme de Nicolas le
cervoisier et ses deux filles, qui payent ensemble
38 sols, et Giles Marescot, 36; nous sommes tenté de
prendre ces individus pour des fermiers de mauvais
lieux, et nous allons chercher leurs pensionnaires
dans les rues voisines. Elles nous présentent Mabile
l’Escote (ou l’Écossaise), Perronèle Grosente, de Gervoi;
Lucette, Lorencete, Agnès aux blanches mains,
Jehannette la Popine et d’autres que nous reconnaissons
pour des femmes d’amour. Dans un centre de
Prostitution, non moins actif que le Val d’amour, en
Baillehoe et en Cour Robert-de-Paris, nous ne comptons
que quatre femmes sans profession entre trente-huit
contribuables, dont le plus imposé, il est vrai,
ne paye que 5 sols: ce sont Ameline Beleassez,
Ameline la Petite, Anès la Bourgoingne et Maheut la
Normande, qui sont taxées chacune à 2 sols; la
chambrière de Maheut est taxée de même que sa
maîtresse, dont elle partageait apparemment les travaux
et les bénéfices. Mais, dans les rues adjacentes,
il y a des femmes que leur surnom nous fait reconnaître,
et qui appartenaient sans doute à la ribaudie
de Baillehoé, quoiqu’elles eussent leur domicile en
honnête mesgnie. Citons seulement Chrétienne et
Marie, sa sœur, dans la rue Neuve-Saint-Merry;
Juliane et Anès, sa nourrice, dans la même rue;
Ameline la Grasse, dans le cloître; Marie la Noire,
[127]
Marie la Picarde, Anès la Grosse, Jehanne la Sage,
dans la rue Simon-le-Franc, etc. Ce n’était pas là,
certainement, tout le personnel de la Prostitution
dans ces quartiers populeux; et nous sommes fort
en peine d’apprécier le motif qui faisait comprendre
telle ribaude plutôt que telle autre sur les listes de
la taille.
Il faut admettre aussi que toutes les prostituées
n’étaient pas vouées exclusivement à leur honteuse
profession et que la plupart d’entre elles se trouvaient
réparties dans diverses catégories de métiers. Il paraît
ressortir de l’esprit des ordonnances de saint
Louis, qui régissaient toujours la Prostitution, que
toute femme était libre de son corps et pouvait en
faire trafic à son gré, pourvu qu’elle ne s’abandonnât
au péché que dans les anciens bordeaux et rues à
ce ordonnées d’ancienneté. Selon les termes de plusieurs
arrêts du parlement, Delamare, qui avait sous les yeux
tous les monuments de la législation du Châtelet, n’a
pas jugé autrement l’état des femmes publiques, qui
n’avaient cette condition infamante que dans l’exercice
de leur scandaleuse industrie, et qui, hors de là,
retrouvaient presque la qualité de femme honnête. Il
résulterait de cette distinction singulière dans l’une
et l’autre phase de leur genre de vie, que l’autorité
municipale n’avait rien à voir dans les désordres secrets
des femmes qui se conformaient scrupuleusement
aux ordonnances et qui ne devenaient ribaudes
communes qu’en mettant le pied dans les endroits
[128]
consacrés à cette Prostitution transitoire et locale.
Celle qui venait de se prostituer en un mauvais lieu,
se purifiait, pour ainsi dire, dès qu’elle en était
sortie. On s’explique de la sorte un jugement des
magistrats de Bordeaux qui condamnèrent au gibet
un homme coupable d’avoir violé une fille publique.
Ce jugement mémorable est rapporté par Angelo-Stefano
Garoni, dans son Traité de jurisprudence intitulé:
Commentaria in titulum de meretricibus et lenonibus
Constit. Mediol. «Les lieux infâmes de Prostitution,
dit Delamare dans son Traité de la Police,
étoient communs à plusieurs de ces femmes publiques
et leurs demeures en étoient séparées. C’étoit
un lieu d’assemblée, où elles avoient la liberté de se
rendre pour leur mauvais commerce, et qui leur étoit
marqué, pour les faire davantage connoître et en
éloigner celles qui étoient encore susceptibles de
quelque pudeur. Il leur étoit défendu (selon le livre
vert ancien du Châtelet, fol. 159) de commettre le
vice partout ailleurs, non pas même dans les lieux
de leurs demeures particulières, sous les peines portées
par les règlements. Elles crurent éluder ces sages
précautions, en se rendant si tard dans ces lieux publics
qu’elles n’y seroient point connues et que les
voisins ne les y verroient point entrer.»
On réglementa dès lors les heures d’entrée et de
sortie dans les bordeaux et clapiers qui ne s’ouvraient
qu’au point du jour et se fermaient au coucher du
soleil. On ne voit pas néanmoins que les femmes qui
[129]
y venaient pour pécher, fussent soumises à une inscription
quelconque; mais on peut prétendre, à coup
sûr, qu’elles étaient tenues d’acquitter un droit fixe qui
figurait dans la recette de la ville ou qui faisait partie
des revenus du roi des ribauds de l’hôtel du roi. Le
prévôt de Paris rendit une ordonnance, le 17
mars 1374, portant que: «toutes femmes qui s’assemblent
ès rues Glatigny, l’Abreuvoir Mâcon, Baillehoé,
la Cour Robert-de-Paris, et autres bordeaux,
soient tenues de s’en retirer et de sortir de ces rues,
incontinent après dix heures du soir sonnées, à peine
de vingt sous parisis d’amende pour chaque contravention.»
Le taux de l’amende, qui équivalait à
plus de vingt francs de notre monnaie, prouve, ce
nous semble, que le salaire d’une journée de péché
n’était pas inférieur à cette amende, qui revenait
probablement pour moitié aux sergents du Châtelet;
elle fut laissée depuis à l’arbitraire du juge,
et, par conséquent, doublée ou quadruplée, ce qui
permettrait de supposer que des femmes de haut rang
ne craignaient pas quelquefois d’affronter les hasards
impudiques de ces lieux infâmes et se souciaient peu
de l’amende, pourvu qu’elles achetassent par là l’impunité
et le secret de leur vie dissolue. Le 30 juin
1395, le prévôt de Paris fit défense à toutes filles et
femmes de joie, «de se trouver dans leurs bordeaux
ou clapiers, après le couvre-feu sonné, à peine de prison
et amende arbitraire.» Delamare, qui rapporte
cette ordonnance d’après le livre rouge ancien du
[130]
Châtelet, ajoute une particularité qu’il a vérifiée
sur les registres de la prévôté: «Les ordonnances
étoient renouvelées tous les ans deux fois, et cette
retraite leur étoit marquée à six heures en hiver, et
à sept heures en été, qui est l’heure que l’on sonne
le couvre-feu.»
Telle était la force de l’usage, tel était l’empire de
l’habitude au bon vieux temps, qu’il fallut plusieurs
siècles pour enlever à la Prostitution une des rues que
Louis IX lui avait spécialement affectées. Lorsque
l’ordonnance du prévôt de Paris, du 18 septembre
1367, eut renouvelé et confirmé la destination
de ces rues malhonnêtes, l’évêque de Mâcon adressa
des représentations au roi Charles V, pour obtenir
que la rue Chapon fût soustraite à cette impure servitude.
Les évêques, comtes de Châlons, possédaient
depuis plusieurs siècles un grand hôtel, situé
dans la rue Transnonain, appelée alors Troussenonain,
entre les rues Chapon et Court-au-vilain, maintenant
rue de Montmorency. Les femmes de mauvaise
vie s’étaient emparées de toutes ces rues, mais elles
s’assemblaient tous les jours dans leur asile de la rue
Chapon, et là, leurs chants, leurs rires, leurs altercations,
leurs indécences, troublaient sans cesse la
vue, les oreilles et la conscience des pieux habitants
de l’hôtel de Châlons. L’évêque, qui était membre
du conseil privé du roi, employa tout son crédit pour
éloigner de sa demeure, et, en même temps, du cimetière
de Saint-Nicolas-des-Champs, l’odieux voisinage
[131]
qui semblait insulter à la fois les vivants et les
morts. Charles V rendit une ordonnance, datée du
3 février 1368 (nouveau style, 1369), dans laquelle
il remettait en vigueur le premier édit de saint Louis
contre la Prostitution en général. Pour en venir non
pas à l’exécution complète de cet édit, mais pour
l’appliquer seulement à la rue Chapon, les conclusions
qu’il tirait de l’ordonnance prohibitive de 1254
n’étaient ni justes ni motivées; car, après avoir rappelé
l’ancienne ordonnance qui expulsait de la ville
(de villâ) les femmes publiques (publicæ meretrices)
et qui confisquait tous leurs biens, jusqu’à la cote
et au péliçon (usque ad tunicam vel pelliceam), il
ordonnait aux propriétaires et aux locataires de la
rue Chapon qui auraient loué leurs maisons à des
ribaudes, de les mettre dehors sur-le-champ et de
ne faire aucun bail avec elles à l’avenir, sous peine
de perdre le loyer d’une année, afin, disait l’édit, que
ces viles créatures ne logent plus dans ladite rue et
n’y tiennent plus leurs assemblées (quod ibidem sua
lupanaria ulteriùs de cetero non teneant); cela, pour
l’honneur de l’évêque et dans l’intérêt des personnes
honnêtes qui habitaient aux environs de cette rue ou
même dans cette rue, où l’on n’osait plus passer. L’ordonnance
a l’air d’attribuer au nom de la rue Chapon
une origine que démentent des titres plus anciens
(saltem metu pene dictus viens). Sauval affirme que
les femmes publiques résistèrent aux ordres du roi,
en se fondant sur leurs priviléges confirmés par
[132]
saint Louis, et prouvèrent que la rue Chapon leur
avait été concédée comme un lieu d’asile par Philippe-Auguste,
avant que cette rue fût enfermée dans
l’enceinte de Paris. Les évêques de Châlons eurent
beau se plaindre et s’autoriser de l’ordonnance de
Charles V pour se débarrasser de leurs scandaleuses
voisines: ils n’y réussirent pas, tant la législation de
saint Louis avait conservé d’autorité, tant la coutume
avait de pouvoir dans l’administration municipale.
«Les ribaudes tinrent bon, dit Sauval, et elles ne sortirent
de la rue Chapon qu’en 1565, lorsque les asiles
de femmes publiques furent ruinés de fond en comble
à Paris.»
Les ordonnances des rois n’étaient pas mieux exécutées,
il est vrai, lorsqu’elles avaient pour objet de
s’opposer aux envahissements de la Prostitution dans
les rues de Paris auxquelles ce fléau n’avait pas été
infligé par droit d’ancienneté. Une fois que les femmes
publiques envahissaient une rue ou un quartier, elles
s’y enracinaient et y pullulaient, sans qu’il fût possible
de les en chasser, malgré toutes les menaces d’amende
et de prison. Elles avaient, on le voit, une
répugnance invincible à se rendre dans les lieux qui
leur étaient attribués et qui leur imprimaient sans
doute une marque particulière d’infamie; elles préféraient
s’exposer aux rigueurs de la loi et pratiquer
leur métier en cachette, dans des rues où l’œil de la
police n’était pas toujours ouvert sur elles. En 1381,
Charles VI réclama l’exécution des ordonnances de
[133]
saint Louis contre ceux qui loueraient des maisons
ou des logements à des femmes de mauvaise vie dans
certaines rues qu’elles avaient accaparées et qui n’étaient
pourtant pas comprises dans le nombre de leurs
lieux d’asile. Charles VI adressa des lettres patentes,
le 3 août, au prévôt de Paris, qu’il chargeait d’en
faire exécuter la teneur; il s’appuyait sans raison sur
les anciennes ordonnances de saint Louis qui expulsaient
de la ville et des champs (tam de campis quant
de villis) les femmes de vie dissolue et qui prohibaient
absolument la Prostitution; mais, en vertu de
ces ordonnances, il n’exigeait que l’expulsion des
prostituées qui avaient élu domicile dans les rues
Beaubourg, Geoffroy-l’Angevin, des Jongleurs, Simon-le-Franc,
ainsi qu’aux alentours de Saint-Denis-de-la-Châtre
et de la fontaine Maubué. De même
que dans l’édit de Charles V, les propriétaires et locataires
de ces rues et de ces carrefours, qu’on voulait
délivrer de leurs hôtes incommodes, étaient
sommés de ne passer aucun contrat de loyer avec
des femmes suspectes, sous peine d’avoir à payer
une année de loyer au bailli du lieu ou au juge du
Châtelet. On est fondé à croire que le prévôt de Paris
fit d’abord diligence pour que les commandements
du roi fussent observés: il y eut des propriétaires
mis à l’amende, des femmes expulsées et emprisonnées;
mais, en dépit des sergents, la Prostitution se
maintint dans le nouveau domaine qu’elle avait conquis.
Toutes ces rues, excepté le cloître de Saint-Denis-de-la-Châtre,
[134]
avaient fait partie du hameau
de Beaubourg, que Philippe-Auguste réunit à la
ville, en l’entourant de murailles; ce Beaubourg était
donc naturellement occupé par des ribaudes qui s’y
perpétuaient par tradition. La fontaine Maubué,
environnée de chétives bicoques, faisait le centre
de cette ribaudie qui s’annonçait assez par le nom
même de sa fontaine (Maubué, malpropre, mal
lessivé). L’établissement des ribaudes autour de l’église
de Saint-Denis-de-la-Châtre, dans la Cité, remontait
à une antiquité encore plus reculée, car nous
avons prouvé que la confrérie de la Madeleine avait
eu d’abord son siége dans cette paroisse: il était
tout simple que les joyeuses commères qui composaient
cette confrérie se groupassent aux abords de
leur église patronale et regardassent ce quartier comme
un ancien fief de leur corporation.
Le prévôt de Paris, en publiant les lettres patentes
du 3 août 1381, destinées à protéger l’honnêteté de
certaines rues, crut devoir rappeler, en même temps,
que d’autres rues avaient été particulièrement affectées
à la Prostitution; mais, de peur de se mettre
en contradiction avec quelque ordonnance du roi,
telle que celle qui avait voulu réhabiliter la rue Chapon,
il évita de désigner ces rues; il fit défense aux
femmes déshonnêtes «de ne eux tenir, héberger ne
demeurer ès bonnes rues de Paris, mais qu’ils vuident
eux et leurs biens hors desdites bonnes rues et
voisent (aillent) demeurer ès moiens bordeaux et ès
[135]
rues et lieux ad ce ordonnés, sur peine de bannissement.»
Cet avis, que Ducange a tiré du livre vert
nouveau du Châtelet, gardait le silence sur les lieux que
la prévôté attribuait nominativement au marché de la
débauche; aussi, les prostituées tirèrent avantage de
ce silence, pour se répandre dans tous les quartiers
de Paris et pour y fonder une multitude de lieux infâmes.
Le prévôt eut besoin d’expliquer l’avis amphibologique
de 1381, par un nouvel édit plus explicite,
que Ducange, dans son Glossaire (au mot
GYNÆCEUM), rapporte, sous la date de 1395, comme
emprunté du livre noir du Châtelet: «Item, l’on
commende et enjoint à toutes femmes publiques bordelières
et de vie dissolue, à présent demeurans ès
rues notables de Paris..., qu’elles vuident incontinent
après ce présent cry, et se retraient, et qu’elles
facent leur demeure ès bordeaux et autres lieux et
places publiques, à eux ordonnez d’ancienneté pour
tenir leurs bouticles au péchié devant dit, c’est assavoir
ès rues de l’Abreuvoir de Mascon, de Glatigny,
de Tiron, de Court Robert de Paris, Baillehoé,
la rue Chapon et la rue Palée, sur peine d’estre mises
en prison et d’amende volontaire.» Ce cri, ou proclamation,
qui fut fait à son de trompe par les crieurs
jurés dans les carrefours de Paris, présente cette singularité,
qu’on n’y a point égard à l’ordonnance du
roi relative à la rue Chapon; peut être, un arrêt du
parlement était-il venu suspendre l’effet de cette ordonnance.
Parmi les lieux réputés infâmes, on ne
[136]
trouve plus la rue de Champ-Fleuri, mais on voit
qu’elle a été remplacée par la rue Palée, qu’on
nomma depuis ruelle Saint-Julien et plus tard rue de
la Poterne ou Fausse-Poterne, parce qu’elle était à
peu de distance de la poterne Saint-Nicolas-Huidelon.
Cette rue, qui tient à la rue Beaubourg et qui s’appelle
aujourd’hui rue du Maure, renfermait une cour
de ribaudie, dite la Cour du More, dénomination que
nous rapprocherons du sobriquet de certaines filles,
qui devaient être moresses ou sarrasinoises, puisque
la Taille de 1292 les qualifie de morelles. C’était là
un des principaux repaires de la Prostitution, quoique
nous ne cherchions pas à retrouver cette rue Palée
dans la rue du Petit-Hurleur, où Géraud, Jaillot,
Lebeuf, ont essayé de la placer. La grande rue Palée
(il y en eut deux de ce nom) était, selon nous, le lieu
d’asile des filles de la rue Beaubourg et des rues
voisines.
Il y avait encore dans Paris une quantité de mauvais
lieux non autorisés; mais il semble que la prévôté
ait négligé de s’en occuper jusqu’en l’année 1565,
où Charles IX les enveloppa dans une mesure générale
de prohibition. Mais, avant cette mesure, nous
pouvons citer deux essais de réforme au sujet de
deux rues, dont l’une appartenait traditionnellement
à la Prostitution, et dont l’autre en avait été
infectée à une époque bien postérieure. Une ordonnance
de Charles VI, du 14 septembre 1420, pendant
l’occupation de Paris par les Anglais, avait
[137]
renouvelé les anciennes défenses aux femmes dissolues,
de loger ailleurs que dans les rues de l’Abreuvoir-Macon,
de Glatigny, de Tyron, la Cour Robert-de-Paris,
Baillehoé et la rue Palée, à peine de
prison. (Delamare a lu rue Pavée, dans le registre
noir du Châtelet, où il copia ce document.) Mais,
quatre ans après, Charles VI étant mort, Henri VI,
roi d’Angleterre, qui s’intitulait roi de France, prêta
l’oreille aux suppliques des marguilliers et paroissiens
de l’église de Saint-Merry, qui demandaient
la suppression des honteuses franchises de Baillehoé;
«auquel lieu de Baillehoé, disent les lettres patentes
de Henri VI, datées du mois d’avril 1424, et délivrées
à Paris dans le conseil du roi; siéent, sont et
se tiennent continuellement femmes de vie dissolue
et communes que on dit bordelières, lesquelles y
tiennent clappier et bordel publique: qui est chose
très-mal séant et non convenable à l’honneur qui
doit être déféré à l’Église et à chacun bon catholique;
de mauvais exemple, vil et abominable,
mesmement à gens notables, honorables et de bonne
vie.» En conséquence, pour satisfaire au vœu des
exposants et de leurs femmes, que scandalisait le
spectacle de ces impudicités, le roi anglais défendit
«qu’il y eust dorénavant aucune prostituée en la rue
de Baillehoé, ni aux abords de l’église Saint-Merry,
attendu qu’il y avoit dans la ville moult d’autres
lieux et places ordonnées à ce, et mesmement assez
près d’icelle, comme au lieu que l’on dit la Cour
[138]
Robert, et ailleurs, plus loing de l’église, pour retraire
lesdites femmes, qui sont comme non habités.»
Il était enjoint au prévôt de Paris de faire exécuter
cet édit irrévocable, et d’expulser sur-le-champ
les femmes perdues qui logeaient dans la rue Baillehoé.
Il est probable que cette ordonnance n’eut
pas plus de valeur effective que les précédentes, car
la rue Baillehoé resta consacrée au vice. Nous remarquons
pourtant, dans les lettres de Henri VI, que
les lieux de tolérance étaient comme non habités;
tandis que la proclamation du prévôt de Paris, faite
à cor et à cri en 1395, ordonne aux prostituées de
faire leur demeure dans ces mêmes lieux qui leur
avaient été attribués d’ancienneté. Nous conclurons
de ces deux pièces, presque contemporaines, que la
législation relative aux femmes de mauvaise vie
avait changé sur ce point: qu’elles étaient forcées de
loger sur le théâtre même de leurs désordres, et
qu’elles n’avaient plus la liberté de cacher leur domicile
dans tous les quartiers, pourvu qu’elles y
vécussent honnêtement. Il résulte aussi de l’ordonnance
de Henri VI, que, nonobstant des injonctions
réitérées, les femmes dissolues refusaient de s’agglomérer
dans les bordeaux et clapiers, qui restaient
déserts et abandonnés. Un arrêt du parlement, du
14 juillet 1480, cité par Sauval, nous prouve avec
quelle obstination cette espèce de femmes s’éloignait
des rues réservées à leur commerce déshonorant,
pour se jeter, comme des harpies, sur des rues
[139]
qu’elles souillaient de leurs débauches. Cet arrêt ordonne
de faire déloger les femmes de vie déshonnête,
de la rue des Cannettes et des autres rues voisines,
et enjoint à ces femmes «d’aller demeurer ès
anciens bordeaux» (Antiquités de Paris, t. III,
p. 652). On ne peut pas douter, d’après les termes
de l’arrêt, que la prévôté de Paris n’eût reconnu la
nécessité de confondre le logement des femmes publiques
avec l’asile de leurs impudicités, et que les
lieux de tolérance ne fussent devenus de la sorte la
demeure permanente de ces femmes, qui dans l’origine
n’y venaient qu’à certaines heures du jour et
n’y restaient jamais la nuit.
Il faut maintenant chercher à découvrir, dans la
topographie du vieux Paris, les rues dont la Prostitution
errante avait fait la conquête, et que cependant
les ordonnances des rois, les arrêts du parlement
et les mandements de la prévôté ne nous
signalent pas nominativement. Ces rues, où s’exerçait
en secret la coupable industrie des putes libres,
étaient en assez grand nombre, et le nom souvent
obscène qu’elles devaient à la malice du populaire les
désignait à la réprobation des honnêtes gens, qui
s’en écartaient avec prudence. Outre les cours des
Miracles, qui englobaient dans la même fange les
voleurs et les prostituées de la dernière classe, on
compterait aisément une vingtaine de rues aussi mal
famées que celles dont saint Louis avait livré entièrement
le séjour à la débauche publique. Nous avons
[140]
déjà remarqué plus haut que ces rues étaient ordinairement
voisines d’un centre de Prostitution.
Ainsi, la rue Transnonain dépendait, pour ainsi dire,
de la rue Chapon; la rue Bourg-l’Abbé, de la rue du
Hueleu; la rue Cocatrix, de la rue Glatigny. Dès les
premiers temps, les ribaudes avaient choisi leur résidence
auprès du lieu de leurs assemblées, afin de
pouvoir s’y rendre à toute heure sans être exposées
aux insultes et aux huées de la populace. La rue
Bourg-l’Abbé, qui fut ouverte hors de l’enceinte de
Philippe-Auguste, sur le territoire de l’abbaye Saint-Martin-des-Champs,
participait à la mauvaise réputation
de la rue ou plutôt du cul-de-sac de Hueleu,
qui formait l’entrée de la rue actuelle du Grand-Hurleur.
Sauval (t. Ier, p. 120) rapporte une locution
proverbiale qui nous fait connaître quels étaient les
habitants de cette rue: «Ce sont gens de la rue
Bourg-l’Abbé, disait-on; ils ne demandent qu’amour
et simplesse.» Quant à la rue de Hueleu, exclusivement
réservée à la Prostitution, depuis son origine
jusqu’à nos jours, elle ne devait pas son nom, comme
l’a dit l’abbé Lebeuf, à un chevalier, nommé Hugo
Lupus (en vieux français, Hue-leu), lequel vivait au
douzième siècle et fit plusieurs donations à l’église
de Saint-Magloire; mais bien aux huées qui accompagnaient
alors les gens simples ou crédules que le
hasard amenait dans ce lieu infâme. Cette étymologie,
conforme à l’esprit du baptême des rues de
Paris, est confirmée par le nom des Innocents, que la
[141]
rue a porté aussi vers la même époque; on l’appelait
encore rue du Pet. On lui donna depuis le nom de
Grand-Hueleu, pour la distinguer de la rue du Petit-Hueleu,
sa voisine, qui avait été d’abord la petite
rue Palée, et qui mérita d’être comparée plus tard à
celle de Hueleu, pour la honteuse destination qu’elle
avait prise: «Dès qu’on voyoit entrer un homme
dans l’une ou l’autre de ces rues, disent les auteurs
du Dictionnaire historique de la ville de Paris, on
devinoit aisément ce qu’il y alloit faire, et l’on disoit
aux enfants: Hue-le, c’est-à-dire, crie après lui,
moque-toi de lui!» Quoi qu’il en soit, de tous les
bourdeaux de Paris, celui de Hueleu fut celui qui
conserva la plus horrible renommée; ce fut lui surtout
qui détermina les sévères mesures de répression
que Charles IX étendit à tous les mauvais lieux de
sa capitale. On pourrait soutenir, par de bonnes autorités,
que les enfants avaient l’habitude de crier au
loup et, par corruption, houloulou, quand un homme
accostait une femme débauchée dans la rue, ou
quand une de ces malheureuses osait se montrer en
plein jour avec le costume de son état.
Les rues qui conduisaient à la rue Chapon n’étaient
pas mieux habitées qu’elle. La rue Transnonain
a longtemps servi de prétexte aux grossiers
jeux de mots du peuple, qui l’appelait tantôt Trousse-Nonain
ou Tasse-Nonain et tantôt Trotte-Putain et
Tas-de-Putain. La rue Ferpillon, dans le nom de laquelle
on a cru retrouver le nom d’un de ses premiers
[142]
habitants, fut d’abord nommée Serpillon,
vieux mot qui correspond à torchon. La rue de Montmorency,
où les seigneurs de Montmorency eurent
autrefois un hôtel avec des dépendances considérables,
n’était connue que sous le nom de Cour au
vilain, à cause d’une espèce de cour des Miracles
qu’elle renfermait. La plupart des rues situées hors
des murs ou le long de cette enceinte de remparts
construits par Philippe-Auguste, étaient dévolues à
la Prostitution libre, qui y bravait en paix les ordonnances
de la prévôté et la police des sergents du
Châtelet. Ainsi, la rue des Deux-Portes, la rue Beaurepaire,
la rue Renard, la rue du Lion-Saint-Sauveur,
la rue Tireboudin, appartenaient de droit
aux ribaudes du plus bas étage. La rue des Deux-Portes,
qui prit son nom de ses deux portes qu’on
fermait pendant la nuit, avait été inévitablement
un lieu de débauche, ce que prouve assez le sobriquet
de Gratec.., qu’elle a porté jusqu’au quinzième
siècle. C’est sous ce nom obscène, qu’elle est désignée
dans une liste des rues de Paris, publiée par l’abbé
Lebeuf d’après un ancien manuscrit de l’abbaye de
Sainte-Geneviève (Hist. de la ville et du diocèse de
Paris, t. II, p. 603). Dans le Compte du domaine de
Paris, pour l’année 1421 (Sauval, t. III, p. 273), le
receveur de la ville déclare avoir reçu de Jean Jumault
«les rentes d’une maison, cour et estables,
ainsi que tout se comporte, séant à Paris dans la rue
Gratec.., près de Tirev.., où pend l’enseigne de l’Escu
[143]
de Bourgogne estant en la censive du roi.» La rue
Tirev.., dont il est question dans ce Compte, a gardé
son infâme dénomination jusqu’au seizième siècle,
où la reine Marie Stuart, femme de François II,
passant par là, s’avisa de demander le nom de cette
rue à un de ses officiers et donna lieu à l’altération du
nom primitif. Quoi qu’il en soit de cette anecdote,
que Saint-Foix prétend avoir empruntée à la tradition
locale, on eut l’étrange idée, en 1809, d’inscrire le
nom de Marie Stuart sur l’écriteau de la rue Tireboudin.
Les noms de rues, inventés et corrompus par le
peuple, qui se plaisait aux équivoques les moins décentes,
suffiraient presque pour nous faire découvrir
les traces de la Prostitution publique et secrète dans
le vieux Paris. Sans sortir des nouveaux quartiers
qui composaient la Ville et qui rayonnaient au nord
de la Cité sur la rive droite de la Seine, en deçà et
au delà de l’enceinte de Philippe-Auguste, nous
trouvons, dans les vieux inventaires, les rues de la
Truanderie, du Puits-d’Amour, de Poilec.., de Merderel,
de Putigneuse, de Pute-y-musse, etc. Ces noms-là
disent eux-mêmes ce qu’étaient les rues qui les
portaient. Celle de la Truanderie, la seule qui ait
gardé son nom à travers plus de six siècles, offrait
un asile non-seulement aux prostituées errantes, mais
encore aux gueux, aux voleurs, aux vagabonds,
en un mot, aux truands. La rue du Puits-d’Amour,
qui est maintenant la rue de la Petite-Truanderie,
[144]
avait un puits célèbre, dont nous avons parlé déjà et
que les femmes amoureuses connaissaient bien: ce
puits, dont le souvenir se lie à plusieurs chroniques
d’amour, existait au centre de la petite place de l’Ariane,
dont le nom primitif semble avoir été place de
la Royne, peut-être à cause d’une reine de ribaudie
ou d’amour, qu’on sacrait avec l’eau de ce puits. La
rue de Poilec.., qui est encore reconnaissable sous
son nom moderne de rue du Pélican, qu’une maladroite
pruderie avait métamorphosée en rue Purgée
au commencement de la Révolution; cette vilaine
rue n’a jamais changé d’emploi et l’on y rencontre
toujours les mêmes mœurs. La rue Merderel ou Merderet
ou Merderiau s’est un peu nettoyée, depuis
qu’on en a fait une rue Verderet, puis Verdelet, mais
elle a maintenu en partie ses vieux us d’impureté
et la Prostitution s’y promène, comme autrefois, dans
la boue et les immondices. La rue Putigneuse, au
faubourg Saint-Antoine, est à présent rue Geoffroy-Lasnier.
La rue Pute-y-Musse (c’est-à-dire, fille s’y
cache) a pris un air honnête, en devenant rue du
Petit-Musc. Guillot indique, dans son itinéraire, une
autre rue de Pute-y-Musse ou Pute-Musse, que l’abbé
Lebeuf a cru reconnaître dans la rue Cloche-Perce ou
de la Cloche-Percée. Il n’est pas besoin de dire que ces
rues ou ruelles, hantées par les femmes de mauvaise
vie et leurs impudiques satellites, furent remarquables,
entre toutes, par leur saleté et leur puanteur;
c’est dans cet état d’ignominie, qu’elles nous apparaissent
[145]
encore au milieu du dix-septième siècle, lorsque
les commissaires voyers firent une enquête de salubrité
dans les rues de la capitale et constatèrent, dans
la plupart des rues bordelières, la présence de cloaques
infects qui empestaient l’air et de hideuses carognes
qui affligeaient les regards autant que l’odorat.
La Prostitution, comme on en peut juger par là,
ne se piquait pas des délicatesses et des recherches
sensuelles que lui inspira plus tard l’exemple d’une
cour galante et voluptueuse.

Sommaire.—Ordonnances somptuaires de Philippe-Auguste.—Législation
des rois de France contre la dissolution et la superfluité
des habillements.—Les reines de ribaudie.—Défenses des
prévôts de Paris et arrêts du parlement.—Arrêt du 26 juin 1420.—Ordonnance
du roi Henri VI, roi d’Angleterre.—Arrêt du
parlement du 17 avril 1426, prohibant les ornements que portent
les damoiselles.—Les reines et princesses d’amour.—L’Ordinaire
de Paris.—Jehannette veuve de Pierre Michel, Jehannette
la Neufville et Jehannette la Fleurie.—Les ceintures d’argent.—Inventaires
des défroques de Marguerite, femme de Pierre
de Rains, et de damoiselle Laurence de Villers, femme amoureuse.—Jehanne
la Paillarde et Agnès la Petite.—Ordonnance de
Henri II.—Jehanneton du Buisson.—De ceux et celles qui vivaient
du produit du maquerellage, tenaient bordiaux, louaient
bouticles au péché, ou gouvernaient clapier de filles publiques.—Le
marché aux Pourceaux.—Supplice des gueuses.
Nous avons vu que le prévôt de Paris, par son
ordonnance de 1360, avait fait défense aux filles
[148]
et femmes de mauvaise vie, sous peine de confiscation
et d’amende, de porter sur leurs robes ou sur
leurs chaperons «aucuns gez ou broderies, boutonnières
d’argent blanches ou dorées, ni des perles,
ni des manteaux fourrez de gris.» Cette ordonnance,
la plus ancienne que nous connaissions qui soit relative
à la police somptuaire des prostituées, avait
été certainement précédée de quelques autres qui
n’ont pas été conservées dans les archives du Châtelet
de Paris. Philippe-Auguste fut le premier roi
qui s’occupa de corriger le luxe des habits ou plutôt
qui, sous prétexte de le réformer dans l’intérêt de
bien public, fit servir le costume à établir la hiérarchie
sociale, selon la naissance, le rang et la fortune.
On peut donc supposer que, dès les premiers
règlements de Philippe-Auguste, à l’égard des habits,
des étoffes et des joyaux, les prostituées de
profession se trouvèrent dépossédées du privilége
d’être vêtues comme des dames et des châtelaines; mais
il n’est resté qu’un souvenir des lois somptuaires de
Philippe-Auguste. Celles de Philippe le Bel, qui n’étaient
sans doute que la répétition et la confirmation
des précédentes, n’ont pas éprouvé le même sort; et
nous pouvons dater de 1294 la législation des rois
de France contre la dissolution et la superfluité des
habillements. Dans cette ordonnance de 1294, il
n’est pas question sans doute des femmes publiques
et des livrées qui leur appartiennent; mais on doit
croire qu’elles n’étaient pas plus privilégiées que les
[149]
bourgeois et bourgeoises, qui ne devaient plus porter
ni vair, ni gris, ni hermine, ni or, ni pierres
précieuses, ni couronnes d’or ou d’argent, et qui
étaient tenus de se délivrer, dans le cours de l’année,
des fourrures et des joyaux qu’ils auraient acquis
antérieurement à l’ordonnance. L’exécution d’une
pareille ordonnance n’était pas chose facile, et parmi
les désobéissances les plus obstinées, on rencontra
celle des reines de ribaudie, qui ne manquèrent pas
de soutenir qu’un édit concernant les bourgeoises
ne les atteignait pas, et que le roi de France n’avait
pu les déshonorer au point de vouloir les contraindre
à ne faire que des robes à 12 sols l’aune.
L’ordonnance de Philippe le Bel fut le point de
départ de toutes les ordonnances du même genre,
qui ne firent que la renouveler et la compléter, en
y ajoutant des prescriptions qui variaient avec les
modes et les usages. Plusieurs de ces ordonnances
ont dû être publiées, avant celle de 1367, qui, seulement
destinée aux habitants de Montpellier, surtout
aux femmes de cette ville, est pleine de détails minutieux
sur la forme des vêtements et la qualité des étoffes.
Il est difficile de croire que plusieurs règlements
somptuaires, aussi détaillés au moins, n’aient pas été
appliqués aux femmes de Paris, dans le long espace
de temps qui s’est écoulé entre le premier édit de 1294
et celui de 1367, lequel n’avait force de loi que dans
la ville de Montpellier. On ne trouve cependant que la
proclamation du prévôt de Paris, datée de 1360,
[150]
que nous avons citée et dont les femmes communes
étaient seules l’objet. Il y eut certainement d’autres
proclamations analogues, sans compter celle qui
concernait exclusivement les ceintures dorées et que
la tradition nous indique d’une manière certaine,
quoique le texte original ne soit pas parvenu jusqu’à
nous. Ce texte, d’ailleurs, n’était qu’une paraphrase
explicative d’un article de l’ordonnance de Philippe
le Bel. Mais on a lieu de croire que les filles publiques
de Paris se montrèrent peu dociles aux avis de la prévôté
et se mirent peut-être en révolte ouverte contre
ses agents chargés de faire exécuter la loi, car nous
voyons, dans le cours du quinzième siècle, reparaître
à plusieurs reprises, et toujours avec un
surcroît de sévérité, les défenses que le prévôt adressait
à ses humbles sujettes et que des arrêts du parlement
ne cessaient de venir corroborer. Par son
ordonnance du 8 janvier 1415, entièrement relative
à la Prostitution, le prévôt défendit de nouveau à
toutes femmes dissolues d’avoir la hardiesse de porter,
à Paris ou ailleurs, de l’or et de l’argent sur leurs
robes et chaperons, des boutonnières d’argent
blanches ou dorées, des perles, des ceintures d’or
ou dorées, des habits fourrés de gris, de menu
vair, d’écureuil ou d’autres fourrures honnêtes, et
des boucles d’argent aux souliers, sous peine de
confiscation et d’amende arbitraire. On leur accordait
huit jours pour quitter ces ornements et pour
s’en défaire; après quoi il était enjoint aux sergents,
[151]
qui les trouveraient en contravention, de les arrêter
en quelque lieu que ce fût, excepté dans les églises,
et de les mener en prison au Châtelet, pour que là,
leurs habits ayant été enlevés et arrachés, elles fussent
punies suivant l’exigence des cas. Cette ordonnance
fut renouvelée et criée à son de trompe dans
les rues et carrefours de Paris, en 1419, ce qui
prouve qu’elle n’avait pas été trop bien observée
par les intéressées et que la persistance des rebelles
avait découragé la surveillance des sergents.
Le parlement, malgré la guerre civile, la peste et
la famine qui désolaient alors la capitale et plusieurs
provinces du royaume, regarda comme assez importante
la question somptuaire, en tant que relative
aux filles et femmes de mauvaise vie, pour
rendre un arrêt le 26 juin 1420, par lequel défenses
étaient faites à ces impures, «de porter des robes
à collets renversez et à queue traînante, ni aucune
fourrure de quelque valeur que ce soit, des ceintures
dorées, des couvre-chiefs, ni boutonnières en
leurs chaperons,» et cela, sous peine de prison, de
confiscation et d’amende arbitraire, après un délai
de huit jours donné aux contrevenantes pour se
conformer à la loi. L’arrêt du parlement ne trouva
pas plus d’obéissance chez les ribaudes, que l’ordonnance
du prévôt de Paris; et il fallut que ce dernier,
cinq ans après, recommençât ses publications, qui
furent souvent répétées avec aussi peu de succès.
Les damoiselles de la Prostitution ne voulaient pas
[152]
renoncer à leurs affiquets de toilette, et elles éludaient
sans cesse l’ordonnance, en modifiant quelque
chose dans les inventions de la mode et en renchérissant
sur le luxe des femmes de bonne vie.
Il paraîtrait que la saisie des habits et joyaux défendus
formait encore, à cette époque, une assez
bonne aubaine, puisque le prévôt de Paris se l’appropriait
comme un des revenus de sa charge; mais
Henri VI, roi d’Angleterre, qui était maître de Paris
en 1424, ne souffrit pas que cette source impure
de profits fût détournée des coffres du roi, et par une
ordonnance en date du mois de mai de cette année-là,
il enjoignit au prévôt, «que dorénavant il ne preigne
ou applique à son prouffit les ceintures, joyaux,
habitz, vestemens ou autres parements defenduz aux
fillettes et femmes amoureuses ou dissolues.» (Voy.
le recueil des Ordonn. des rois de la 3e race.)
Un nouvel arrêt du parlement prohiba, le 17 avril
1426, «les ornements que portent les damoiselles,»
les robes traînantes, les collets renversés, le drap
d’écarlate en robes ou en chaperons, les fourrures de
petit-gris et les riches autres fourrures, soit en colets,
poignets, porfils ou autrement. Le même arrêt leur
défendait aussi «de porter aucunes boutonnières en
leurs chaperons, des ceintures en tissus de soye ni
des fourrures d’or ou d’argent, qui sont les ornements
des femmes d’honneur.» Ces arrêts réitérés
prouvent l’obstination des femmes publiques à enfreindre
les ordonnances: elles ne pouvaient pas
[153]
se persuader qu’elles fussent soumises, comme les
petites bourgeoises, à la législation somptuaire, qui
devenait de plus en plus rigoureuse, à mesure que
le luxe s’accroissait et que la mode tendait sans
cesse à établir son niveau frivole dans toutes les
classes de la société. Pendant le quinzième et le seizième
siècle surtout, les rois de France, qui donnaient
eux-mêmes l’exemple d’une prodigalité excessive
dans leurs dépenses de toilette, défendaient
pourtant, sous les peines les plus sévères, tout ce qui
semblait appartenir à la dissolution des vêtements;
ils ne permettaient pas même à leurs gentilshommes
et aux dames de leur maison l’usage de certaines
étoffes réservées aux princes et princesses; ils refusaient
à toutes manières de gens l’emploi de certaines
broderies, de certaines pourfilures, de certains passements
en or ou argent, en velours et en soie;
mais les femmes de plaisir, qui s’intitulaient reines
et princesses d’amour, ne tenaient aucun compte des
édits et continuaient à porter sur elles, dans leurs
rues privilégiées, toutes ces superfluités défendues.
On doit supposer qu’elles ne s’aventuraient pas dans
les rues honnêtes avec cette parure, qui les eût fait
remarquer aussitôt et qui aurait certainement ameuté
contre elles les passants indignés. Nous avons dit
que le peuple ne leur était nullement sympathique
et que souvent, à leur passage, on les injuriait, on
leur jetait de la boue, on allait jusqu’à les battre.
Il fallait, de temps à autre, donner satisfaction à la
[154]
vindicte populaire, en punissant une de ces femmes
effrontées qui se mettaient à tout propos en contravention
avec les lois. On arrêtait donc en pleine rue
quelques malheureuses que la voix publique dénonçait
comme ribaudes de profession et qui étaient
trouvées nanties d’objets prohibés. Ces arrestations
n’atteignaient jamais les plus coupables, qui, étant
les moins pauvres, avaient toujours en poche de
quoi rendre aveugles les sergents, lors même qu’on
les eût rencontrées dans toute leur pompe, comme
on disait à cette époque; il y en avait même qui
payaient à ces débonnaires sergents une redevance
mensuelle ou hebdomadaire pour n’être jamais inquiétées,
quels que fussent leurs accoutrements et ornements.
Celles qui se voyaient menées en prison et
qui perdaient leurs hardes n’avaient souvent que
des guenilles sur le corps et ne laissaient pas même
au Châtelet une dépouille suffisante pour solder les
honoraires des sergents. Ainsi, Sauval et Delamare
ont tiré des Comptes du Domaine de Paris plusieurs
articles curieux en ce qu’ils nous montrent la pauvreté
des victimes ordinaires du Châtelet. L’extrait
de l’Ordinaire de Paris, au chapitre des Forfaitures,
Espaves et Aubaines, pour l’année 1428, mérite
d’être rapporté tel que Sauval l’a recueilli dans les
Preuves de ses Antiquités de Paris: «De la valeur
et vendue d’une houpelande de drap pers, fourrée
par le collet de penne de gris, dont Jehannette,
vefve de feu Pierre Michel, femme amoureuse, fut
[155]
trouvée vestue et ceinte d’une ceinture sur un tissu
de soie noire, boucle, mordant et huit clous d’argent,
pesant en tout deux onces et demie; auquel
estat elle fut trouvée allant à val la ville, outre et
par-dessus l’ordonnance et défense sur ce faite, et
pour ce fait emprisonnée, et ladite robe et ceinture déclarées
appartenir au roi, par confiscation, en ensuivant
ladite ordonnance, et délivrée en plein marché
le dixième jour de juillet 1427; c’est à sçavoir ladite
robe le prix de sept livres douze sols parisis,
dont les sergents qui l’emprisonnèrent eurent le
quart pour ce; pour le surplus, etc.—De la valeur
d’une autre ceinture sur un viel tissu de soie noire,
où il y avoit une platine et huit clous d’argent,
boucle et mordant de fer-blanc, trouvée en la possession
de Jehannette la Neufville, pour ce emprisonnée,
etc.—De la valeur d’une autre ceinture,
ferrée de boucle et mordant sur un tissu de soie noire
à huit clous d’argent, et d’un collet de penne de
gris, trouvés en la possession de Jehannette la Fleurie,
dite la Poissonnière, pour ce emprisonnée, etc.»
Nous remarquons, dans cet extrait, plusieurs circonstances
qu’il importe de signaler comme détails
de mœurs. On n’arrêtait, on n’emprisonnait que les
femmes qui se trouvaient sur la voie publique avec
des habits qu’elles ne devaient pas porter; d’où il
résulte qu’elles étaient libres de se vêtir à leur guise
dans l’intérieur de leurs maisons et même dans l’enceinte
des lieux affectés à l’exercice de leur scandaleux
[156]
métier. Les femmes amoureuses, que la police
du Châtelet n’astreignait à aucune déclaration préalable,
et qui échappaient de la sorte à l’ignominie
de leur condition, pouvaient, par leur naissance et
par leur état civil, conserver une apparence de
bourgeoisie et cacher leur véritable profession, jusqu’à
ce qu’un hasard malheureux fût venu trahir le
secret de leur existence honteuse. Ainsi, Jehannette,
veuve de Pierre Michel, n’avait aucun surnom qualificatif
qui fît reconnaître le scandale de sa conduite;
Jehannette la Neufville portait un nom notable parmi
les bons bourgeois de Paris; quant à Jehannette la
Fleurie, ou la Poissonnière, elle avait deux sobriquets
pour un, et le dernier semble indiquer qu’elle
se consacrait alternativement à la Prostitution et à la
vente du poisson. Nous avons, au reste, constaté, dans
un chapitre précédent, que le quartier actuel que
traversent les rues Poissonnière et Montorgueil était
entièrement occupé par les habitants des cours des
Miracles et par la clientèle de la débauche foraine.
Nous ajouterons que les marchands de poisson, qui
avaient besoin d’être présents à l’arrivage de la marée,
se logèrent d’abord sur le chemin appelé Val larroneux,
qui devint alors le chemin et rue des Poissonniers
et des Poissonnières. On devine tous les motifs
qui avaient pu faire attribuer le surnom de Poissonnière
à une femme amoureuse qui fréquentait la poissonnerie
ou qui était entourée de marchands de poisson.
Le nom de Jehannette n’était pas, comme le
[157]
pense M. Rabutaux, commun et générique pour désigner
une fille de joie. N’oublions pas de faire remarquer
encore que les objets contraires à l’ordonnance
trouvés en la possession des femmes amoureuses
étaient assimilés aux objets perdus sur la voie
publique, lesquels appartenaient au Domaine, quand
ils n’avaient pas été réclamés en temps utile: après
un délai de 40 jours, on vendait les uns et les autres
en plein marché, et le produit de la vente, qui était
bien minime, se distribuait entre le roi, la ville et
les sergents, à titre d’épaves.
Sauval n’a pas analysé toutes les ventes de cette
espèce que lui ont offertes les Comptes de l’Ordinaire
de Paris; mais il en a pris note, et l’on voit qu’elles
étaient fort rares, puisque Sauval mentionne plusieurs
années qui n’en présentent pas une seule, du
moins dans les registres de la prévôté. Le Compte
de 1446 contient cet article: «Vente d’une petite
ceinture, boucle, mordant et quatre petits clous
d’argent, trouvée en la possession de Guyonne la Frogière,
femme amoureuse, déclarée appartenir au roy
par confiscation, etc.» C’est surtout aux ceintures
d’argent ou ornées d’argent, que les sergents font la
guerre, peut-être pour justifier le proverbe. Les amendes
auxquelles donnait lieu le port illégal de ces ceintures,
sont enregistrées dans les Comptes des années
1454, 1457, 1460, 1461 et 1464. Depuis cette dernière
époque, les poursuites ont l’air de se ralentir,
et l’on croirait volontiers que les ceintures sont mises
[158]
hors de cause. L’extrait du chapitre des Forfaitures de
1457 est ainsi conçu: «Plusieurs ceintures à usage de
femme, ferrées de boucle, mordant et clous d’argent,
déclarées appartenir au roy par confiscation
de plusieurs femmes amoureuses qui portoient lesdites
ceintures parmi Paris contre les ordonnances
sur ce faites.» Dans le Compte de 1459, on voit l’inventaire
de la défroque de deux femmes amoureuses
qui, l’une et l’autre, portaient un nom noble, mais
qui étaient vêtues bien différemment. La première
accusait, par son costume délabré, la misère où le
vice l’avait fait tomber, sans que les charmes de sa
personne lui procurassent les moyens de s’en relever;
elle devait donc être vieille et laide pour avoir
été arrêtée en pareil équipage: «Une robe courte de
drap gris sur le tenné (tanné, étoffe de soie brune),
fourrée, de penne (fourrure) blanche, fort usée,
avec vieilles chausses rempiécées de drap violet et
un pourpoint de fustaine tel quel, dont Marguerite,
femme de Pierre de Rains, avait été trouvée vestue
et habillée, déclarée appartenir au roy, etc.» On
est tout surpris de rencontrer une femme amoureuse
avec pourpoint et chausses, comme si elle voulût se
faire passer, au besoin, pour un homme. La seconde
délinquante, qui fut sans doute arrêtée au sortir de
l’église sur la dénonciation du populaire, valut une
meilleure aubaine aux sergents qui l’amenèrent au
Châtelet: «Une ceinture, ferrée de boucle, mordant
et clous d’argent doré, pesant deux onces et demie,
[159]
avec une surceinte (double ceinture fort large), aussi
ferrée de boucle, mordant et clous d’argent doré, un
Pater noster (chapelet) de corail, tels et quels à boutons,
et un Agnus Dei d’argent, des heures à femme
telles quelles, à un fermoir doré, et un collet de satin
fourré de menu-vair tel quel, advenus au roy nostre
sire, par la confiscation de damoiselle Laurence de
Villers, femme amoureuse, constituée prisonnière
pour le port d’icelles, etc.» Voilà bien une damoiselle,
noble qui est qualifiée femme amoureuse, et qui
laisse au roi les objets de luxe qu’elle n’avait pas le
droit de porter sur elle, même dans un but de dévotion.
Cette Laurence de Villers savait lire, puisqu’elle
s’en allait à l’église avec un livre d’heures,
ce qui devait être une exception parmi les femmes de
mauvaise vie. Dans le Compte de 1460, les amendes
pour port d’habits et de ceintures en contravention
paraissent avoir été plus nombreuses, mais ces
amendes, comme toujours, ne sont pas d’un grand
profit pour le roi, la ville et les sergents. Ici, c’est
«une robe de drap gris retourné, doublée de blanchet,
de laquelle Jehanne la Paillarde, femme amoureuse,
avait été trouvée vestue et pour icelle emprisonnée;»
car les bourgeoises elles-mêmes n’avaient
pas le droit de doubler leurs robes ou de les garnir
en étoffe de soie. Là, c’est une «ceinture appartenant
à Agnès la Petite, qui, combien qu’elle fût mariée,
est de vie dissolue, et comme telle a esté plusieurs
fois emprisonnée, de laquelle ceinture elle a esté
[160]
trouvée ceinte et la portant parmi Paris.» Ce dernier
article prouve, comme nous l’avons avancé, que
souvent des femmes mariées exerçaient l’état de prostituée.
Le port de ceintures étant à cette époque
l’objet de poursuites spéciales, nous pensons qu’une
ordonnance particulière avait motivé ce redoublement
de poursuites, qui amenaient toujours l’emprisonnement
des ribaudes arrêtées en contravention.
Ces sortes de femmes étaient incorrigibles, lorsqu’il
s’agissait de toilette; elles avaient toutes plus
ou moins la passion des joyaux, et elles ne craignaient
pas de s’exposer à la prison et à l’amende
pour se donner la satisfaction de porter un bijou d’or,
ou d’argent, ou même d’étain argenté. Ce n’était pas
qu’elles voulussent par là déguiser leur profession
déshonorante et se confondre avec les dames et damoiselles
d’honneur. Elles ne se révoltaient donc
pas contre l’esprit des ordonnances, par lesquelles
on avait voulu remédier à la confusion des classes
sociales entre hommes et femmes de tous états, lesquels,
dit une ordonnance de Henri II, par ce moyen,
on ne peut choisir ne discerner les uns d’avec les autres.
Les ribaudes de profession, au contraire, n’avaient
garde de prétendre passer pour ce qu’elles
n’étaient pas, mais elles prenaient plaisir à se parer
et à s’attifer, pour attirer les regards, et pour faire
entre elles assaut de magnificence. Comme les colliers,
bracelets et bagues leur étaient interdits, elles
se dédommageaient de cette interdiction, en portant
[161]
des joyaux de sainteté, des chapelets d’orfévrerie,
des médailles, des croix et des anneaux bénits;
mais les sergents n’étaient pas tous assez dévots,
pour fermer les yeux sur ces contraventions pieuses,
et ils attendaient les délinquantes à la porte des
églises pour les conduire au Châtelet à travers les
huées de la populace. Il paraîtrait que Louis XI,
qui faisait pour son propre compte un grand abus
de médailles, et de chapelets, et d’Agnus Dei, ordonna
un surcroît de sévérité contre les femmes
amoureuses qu’on saisirait nanties de ces mêmes
objets: non-seulement on confisquait au profit du
roi les bijoux que leur caractère de dévotion ne
mettait nullement hors de l’atteinte de la loi, mais
encore on condamnait à l’amende la femme qui les
avait portés. En 1463, Jehanneton du Buisson fut
condamnée en quinze sols quatre deniers parisis (environ
25 francs de notre monnaie) pour le port illégal
de deux patenostres en vermeil. Louis XI fit punir
aussi avec rigueur les ribaudes qui étaient trouvées
en habits d’homme dans les rues de Paris; on lit
dans le chapitre des Forfaitures et Espaves de l’Ordinaire
de Paris en 1471: «De la vente d’une
robe noire sangle, à usage d’homme, d’un chapeau
et d’une cornette, tout vielz, dont Jehanne la Thibaude
fut trouvée saisie et vestue, et en cet estat
amenée prisonnière au Chastelet de Paris, le 21 may
dernier, déclarés acquis et confisqués au roy.»
Nous n’osons pas émettre de conjecture au sujet de
[162]
ce déguisement masculin, qui semble avoir eu, parfois
du moins, un but malhonnête dans les actes de
la Prostitution.
A côté des ribaudes, il y avait toujours des courtiers
de débauche, qui, malgré les terribles menaces
de la législation contre eux, s’adonnaient assez
tranquillement à leur infâme commerce; ils étaient
rarement poursuivis et plus rarement encore jugés
et condamnés. D’ordinaire, quand les plaintes de
leurs voisins ou de leurs victimes avaient obligé la
justice à sévir ou à faire une démonstration publique
de sévérité, on arrêtait, on emprisonnait les
prévenus, mais tout se terminait par une composition
en argent, par une confiscation d’immeubles
et par le bannissement. Dans bien des cas, le coupable
était renvoyé absous, après le payement d’une
forte amende que compensait bientôt le produit de
son maquerellage. Ceux et celles qui tenaient des
bordiaux et qui louaient des bouticles au péché; qui
gouvernaient un clapier de filles publiques; qui leur
prêtaient à usure, soit de l’argent, soit des meubles,
soit des hardes; qui vivaient, en un mot, aux dépens
de la Prostitution légale; étaient tolérés, sinon protégés,
et l’on reconnaissait dans leur ignoble intervention
une influence salutaire sur l’exercice de la débauche.
Les femmes consacrées à ce hideux emploi avaient
besoin d’une autorité qui leur traçât une règle de
conduite, et qui les maintînt sous une surveillance
continuelle: on ne les empêchait donc pas d’avoir
[163]
un ribaud pour gouverneur, ou une ribaude pour
gouvernante. Ces chefs de ribaudie se couvraient
généralement d’un nom décent et d’un masque
d’honnêteté: tantôt c’était un portier, tantôt une
chambrière, tantôt un hôtelier, tantôt un marchand
forain; mais toujours, homme ou femme, c’était
une personne d’un âge mûr, même d’une vieillesse
respectable, au maintien austère, à la parole grave,
à l’air solennel; ce qui n’empêchait pas cette digne
personne d’être sans cesse exposée aux mésaventures
de la prison, du fouet, du pilori et de l’exil,
suivant les traditions de la loi romaine. La loi française
prononçait la peine de mort contre les maquereaux
avérés; mais cette pénalité n’était presque
jamais appliquée, quoiqu’elle demeurât, comme un
épouvantail, dans le code criminel. Au reste, l’opinion
des jurisconsultes n’a pas varié à l’égard d’un
crime qui ne rencontrait la même tolérance au point
de vue moral, que dans l’application de la loi.
«Macquereaux et macquerelles, dit le célèbre Josse
de Damhoudère dans sa Pratique judiciaire ès causes
criminelles, qui servait de formulaire à tous les magistrats
du seizième siècle; macquereaux et macquerelles
qui aydent les preudes et honnestes femmes
à trébucher, sont, de droit, punis corporellement,
et, de coustume, par le bannissement ou autre arbitraire
punition, selon la diversité des pays et des
villes.»
Les anciens criminalistes ne font que se répéter
[164]
sur ce point, et tombent d’accord que la peine a été
laissée dans la loi comme une précaution utile pour
arrêter les excès du libertinage, en opposant à ses
agents les plus audacieux une barrière légale. Le
docte Jean Duret, dans son Traité des peines et
amendes (édit. de Lyon, 1583, in-8o, fol. 105), est
aussi explicite que J. de Damhoudère à cet égard:
«Ceux qui louent et prestent maisons pour exercer
maquerelages, dit-il, perdent leur droit de propriété,
condamnés d’abondant à dix livres d’or
d’amende. De faict, nos praticiens, suivant les peines
ordonnées de droict, les punissent capitalement et
de mort.» On citerait cependant plus d’un exemple
de supplice capital, infligé à des coupables des deux
sexes, en raison des circonstances particulières de
leur crime. Ainsi, Duret ajoute ce paragraphe, qui
nous apprend en quels cas la peine de mort était
requise contre les instigateurs de la débauche:
«Que si c’est le père, mère, frère, sœur, oncle,
tante, tuteur ou curateur qui livre ainsi sa fille, parente
ou mineure, ou que le maquerelage soit pour
induire à adultère, la seule mort est peine suffisante.
Les servantes et nourisses de tel estat doivent perdre
la vie.» Un autre jurisconsulte de la même
époque, Claude Lebrun de la Rochette, dans son
traité pratique intitulé les Procez civil et criminel
(édit. de 1647, in-4o), emploie un chapitre entier
pour établir les différents degrés du maquerellage,
et il conclut que la paillardise, fille de l’oisiveté et
[165]
dudit maquerellage, produit la fornication, l’adultère,
le rapt, l’inceste et la sodomie. «Soit donc,
dit-il, que les exécrables bourreaux des consciences
tiennent les paillardes dont ils sont courratiers, en
leurs maisons; soit que par allèchements, blandices,
promesses et artifices, ils les y attirent, ou qu’ils
conduisent vers elles les hommes débordez, ils ne
sont en rien dissemblables de ceux qui proprio corpore
quæstum faciunt, comme le décide Ulpian en la
loi Palam. § Lenocinium; ff. De ritu nupt. l. Athletas,
§ 1, ff. De his qui not. infam.»
Claude Lebrun de la Rochette constate ensuite
l’indulgence des tribunaux français sur le fait de
maquerellage: «Et estoit encor anciennement, dit-il,
puny du dernier supplice, s’il estoit veriné (avéré) que
le maquereau fust coustumier de suborner les filles et
femmes qu’il traînoit à perdition; qu’il les y eust induites
par présent ou paroles persuasives, et que,
par ce moyen, il les eust rendues obéyssantes à sa
volonté et à la Prostitution qu’il en désiroit faire,
pour tirer gain de telle turpitude.... Toutefois, les
Cours souveraines des parlements de ce royaume,
et les inférieures, les punissent plus doucement, se
contentant du bannissement ou de la fustigation par
les carrefours des villes où ils exercent leurs courtages
et où ils sont apprehendez.» Nous croyons que
la tolérance envers les proxénètes ne s’appliquait
pas à ceux qui travaillaient à corrompre la jeunesse
et l’innocence, mais seulement aux maîtres et maîtresses
[166]
des mauvais lieux. On distinguait ceux-ci
des vils et abominables tentateurs, qui, à l’instar
des démons, battaient en brèche la pudicité et conspiraient
contre l’honneur du sexe féminin: «Que
si bien ils évitent icy la punition divine, disait de
ces corrupteurs l’honnête Lebrun de la Rochette; ils
n’éviteront pas la divine qui paye toujours au meschant
avec usure le salaire de sa meschanceté.»
Quant aux seigneurs et dames des bordeaux, on leur
accordait partout une protection tacite, et on se servait
d’eux à titre d’intermédiaires officieux pour
l’exécution des règlements de police. C’étaient des
vieilles, qu’on autorisait de préférence à diriger les
établissements de débauche, et qu’on qualifiait de
maquerelles publiques. Ducange cite un document
daté de 1350, qui confirme cette qualification: in
domo cujusdam maquerellæ publicæ in villa Valentianis,
etc. Il est à peu près certain que la maquerelle
publique existait et pratiquait son métier, sous la tolérance
de la loi municipale.
Cependant les ordonnances des rois, les arrêts du
parlement et les proclamations du prévôt de Paris
avaient, à plusieurs reprises, flétri, prohibé et condamné
le maquerellage en général, sans faire aucune
réserve, sans admettre aucune circonstance atténuante.
Dans une ordonnance de 1367, analysée
par Delamare, le prévôt de Paris fit défense «à
toutes personnes de l’un et de l’autre sexe, de s’entremettre
de livrer ou administrer femmes, pour
[167]
faire péché de leur corps, à peine d’être tournées au
pilori et brûlées (c’est-à-dire marquées d’un fer
chaud), et ensuite chassées hors de la ville.» Cette
ordonnance, on le voit, comprenait indistinctement
les personnes qui administreraient une ribaudie de
femmes folles de leur corps. Toutes les ordonnances
relatives à la location des maisons, touchaient indirectement
la question de maquerellage, et les honteux
auteurs de cette vilainie ne pouvaient la pratiquer
sous la qualité de propriétaire ou de locataire
principal. L’ordonnance prévôtale du 8 janvier 1415,
renouvelée textuellement en 1419, tout en s’occupant
d’interdire aux femmes débauchées la location
des maisons «en rues honnêtes,» fait aussi «défenses
à toutes personnes de se mesler de fournir des filles
ou femmes pour faire péché de leur corps, sous
peine d’estre tournées au pilori, marquées d’un fer
chaud et mises hors la ville.» Tel était le châtiment
le plus fréquent qu’on leur infligeait, quand ces instruments
de Satan, comme les appelle Lebrun de la Rochette,
avaient prêté la main à quelque scandale
public. On les condamnait quelquefois à être fustigés
et à avoir les oreilles coupées; il semblerait même
que certaines maquerelles furent enfouies vives. Ces
condamnations entraînaient sans doute, en plusieurs
cas, la confiscation, la suppression et la démolition
des logis qui avaient été le théâtre du
crime. C’est, du moins, ce que nous permet de supposer
ce passage des Comptes de l’Ordinaire de Paris
[168]
pendant l’année 1428: «De Nicolas Sandemer
et Isabeau, sa femme, pour les ventes d’une place
vuide où souloit avoir maisons, quatre bordeaux et
édifices à présent abattus, assis à Paris, en la Cité,
en Glatigny, tenant d’une part,... et de l’autre part
faisant le coin d’une ruelle, par laquelle on descend
à la rivière de Seine, du costé devers Grand-Pont.»
On sait que, d’après un usage qui remonte à l’antiquité
la plus reculée, on rasait une maison qui
avait été souillée par un crime, et on en laissait l’emplacement
vide pendent un laps de temps déterminé
par la sentence, comme pour purifier l’endroit
maudit. Nous croyons, en outre, qu’une maison où il
y avait eu longtemps un mauvais lieu, n’était pas
occupée par des gens d’honneur, sans avoir été rebâtie.
On verra, dans le chapitre suivant, consacré à rassembler
les faits épars de la Prostitution en différentes
villes, que le châtiment infligé aux proxénètes
subissait quelques variantes suivant les pays.
Parmi les exécutions qui ont eu lieu à Paris, nous
n’en trouvons pas une seule où il soit question d’un
patient qualifié de maquereau, mais, en revanche, les
maquerelles ne manquent pas. Sauval nous apprend
(t. II, p. 590) qu’une maquerelle qui juroit vilainement,
en 1301, fut mise au pilori, à l’échelle de
Sainte-Geneviève. Il y avait à Paris 20 à 25 justices
particulières avec échelle, où les maquereaux et maquerelles
pouvaient être fouettés, piloriés, essorillés.
[169]
L’évêque de Paris lui-même avait son échelle de
justice sur le parvis de Notre-Dame, et les jugements
de l’official, qui remplissait les fonctions de bailli de
l’évêché, atteignaient souvent des femmes dissolues,
ce qui prouve que la Prostitution n’était pas bannie
entièrement du territoire de la justice épiscopale. En
1399, l’official de l’évêque de Paris, pour punir une
femme qui avait «recepté et retrait plusieurs hommes
et femmes mariées et à marier, et les avoit envoyé
querir par certains messages,» la condamnèrent
à être «pilorisée, les cheveulx bruslez, bannie
de la terre dudit évesque, et tous ses biens confisquez.»
(Voy. le Glossaire de Ducange et Carpentier, au
mot Capilli.) Une autre exécution du même genre
avait eu lieu auparavant à l’échelle du parvis: une
certaine Isabelle, qui avait vendu une jeune fille à un
chanoine de la cathédrale, fut exposée sur cette
échelle et là tourmentée et brûlée avec une torche
ardente; après quoi on la bannit à perpétuité. Mais,
en 1357, cette Isabelle obtint des lettres de rémission
du roi, probablement par l’entremise du chanoine,
qui ne paraît pas avoir été poursuivi par le bras séculier.
La torche ardente, qui figure dans le supplice
de cette courtière de débauche, servait, si l’on peut
employer ici une expression de cuisine, à flamber la
patiente et à brûler tout ce qu’elle avait de poil sur
le corps. Ces espèces d’exécutions attiraient plus de
monde que toutes les autres. Dans le Compte de l’Ordinaire
pour l’année 1416 (Preuves des Antiq. de
[170]
Paris, t. III), on lit que les sergents du châtelet
achetèrent une douzaine de boulaies neuves (baguettes
de bouleau), pour faire serrer le peuple et «pour
assister à la justice qui fut faite des maquerelles qui
furent menées par les carrefours de Paris, tournées,
brûlées, oreilles coupées au pilori.» On trouve,
dans les mêmes Comptes, plusieurs maquerelles menées
au pilori avec pareil cérémonial et pareille distribution
de coups de boulaies aux spectateurs. Le
pilori, où l’on exposait habituellement les maquerelles,
était celui des Halles qui avait été construit
à la place même du puits Lori (c’est-à-dire, sans
doute, puits de l’oreille). Auparavant, au moment des
exécutions, on élevait au-dessus de ce puits un échafaudage
surmonté d’une cage tournante, dans laquelle
étaient pratiquées des ouvertures où les patients
passaient la tête et les mains, pour rester ainsi
exposés aux regards curieux de la foule durant tout
un jour de marché. Le bourreau qui présidait à ce
supplice devait présenter successivement aux quatre
points cardinaux les coupables qu’il avait mis au
pilori, après avoir rempli les prescriptions de la
sentence, coupé une ou deux oreilles, administré le
fouet, etc. En général, les maquerelles qui subissaient
cette peine infamante étaient assaillies d’injures,
de huées, de boue et d’ordures. Tous les piloris
n’étaient pas mobiles comme celui des Halles de Paris,
il n’y avait souvent qu’une échelle dressée contre un
gibet; le pilorié, attaché au sommet de l’échelle,
[171]
dans une position fort incommode, annonçait lui-même
aux passants la nature de son délit, par l’écriteau
qu’il portait au dos, ou sur la poitrine ou même
sur le front. Dubreul raconte qu’il se souvenait
d’avoir vu, à l’échelle du parvis Notre-Dame, appartenant
à la justice de l’évêque et de son official,
un vilain prêtre qui avait au dos cette inscription:
Propter fornicationes.
La fustigation et l’exposition des maquerelles furent
de tout temps un divertissement pour le peuple
de Paris; on se portait en foule sur leur passage et
on leur faisait cortége jusqu’au pilori. Toutes les
filles publiques et tous les débauchés prenaient un
singulier plaisir à voir la punition de ces indignes
femmes qui s’étaient souvent enrichies aux dépens
de leurs nombreuses victimes. Les exécutions de cette
espèce, toujours accompagnées de la même affluence
et de la même gaieté, se reproduisaient assez rarement,
néanmoins, à cause du scandale qu’elles causaient
dans la ville. On en citerait pourtant des exemples
dans le dix-septième siècle: Lebrun de la
Rochette parle, dans le Procez criminel, de la punition
d’une célèbre maquerelle de Paris, nommée la Dumoulin,
qui fut ainsi fustigée dans les carrefours, sous
le règne de Louis XIII, et ensuite bannie du royaume
à perpétuité; mais on lui laissa toutefois les
oreilles intactes. On découvrirait sans doute dans les
registres du parlement un grand nombre d’arrêts et
d’exécutions du même genre; quelques-unes de ces
[172]
exécutions offriraient probablement un spectacle plus
tragique. Ainsi, dans les Comptes de la Prévôté de
Paris en 1440, nous attribuerons volontiers à un fait
de maquerellage renforcé de vols et d’exactions criminelles,
cet extrait des Forfaitures rapporté par
Sauval: «De la vente des biens meubles de feues
Jeannette la Bonne-Valette et Marion Bonne-Coste,
n’aguerre enfouyes vives lez la justice de Paris pour
leurs démérites, etc., dont ont esté ostés, distraits
et rendus à plusieurs personnes plusieurs desdits
biens, comme à eux appartenans, et qui mal pris
et emblés leur avaient esté par lesdites femmes.»
C’était ordinairement au marché aux Pourceaux,
sur la butte Saint-Roch, que s’opérait l’enfouissement
des femmes condamnées à être enterrées vives,
supplice fort usité, avant qu’on se fût décidé à les
pendre comme les hommes. La première que l’on
pendit à Paris était une misérable qui exerçait tous
les métiers inhérents à la Prostitution; ce fut en 1449,
suivant les historiens du temps de Charles VII, qu’on
pendit deux gueux et une gueuse, «qui suivoient
les pardons et les fêtes,» dit Sauval, et qui n’en
furent pas moins convaincus de toutes sortes de
crimes. Un de ces coquins fut pendu à la porte Saint-Jacques;
l’autre, avec sa femme, à la porte Saint-Denis:
«quoique tous deux fussent le mari et la
femme, ajoute Sauval, néanmoins ils vivoient ensemble
comme s’ils n’eussent point été mariés;» ce
qui signifie que le mari prostituait sa femme et que
[173]
celle-ci favorisait également les turpitudes de son
mari. Sauval ajoute des détails curieux à cette
histoire patibulaire: «Or, comme en France on
n’avoit point encore vu pendre de femme, tout Paris
y accourut. Elle y alla tout échevellée, vestue d’une
longue robe et liée d’une corde au-dessus des genoux.
Les uns disoient qu’elle avoit demandé à estre
exécutée ainsi, parce que c’étoit la coutume du pays.
D’autres voulurent que ce fût par l’ordre des juges,
afin que les femmes s’en souvinssent plus longtemps.»
La potence néanmoins ne fut pas dès lors
exclusivement adoptée pour le supplice des gueuses,
car Sauval a extrait, des Comptes de la Prévôté,
en 1457, ces deux articles qui se rapportent peut-être
à des maquerelles: «Une nommée Ermine Valencienne,
condamnée à être enfouie toute vive sous
le gibet de Paris (c’est-à-dire à Montfaucon), pour ses
démérites.—Une nommée Louise, femme de Hugues
Chaussier, enfouie audit lieu, et l’on faisoit
une fosse de sept pieds de long à cet effet.» La peine
de mort entraînait d’autres manières de supplice,
suivant le bon plaisir du juge, qui ordonnait parfois
l’expiation du crime par le feu ou par l’eau. Parmi
les femmes qui furent brûlées vives à Paris ou jetées
à l’eau et noyées sous le Pont-au-Change, on peut
supposer, sans craindre de se tromper, que plusieurs
avaient souillé leur corps et pratiqué des actes détestables,
que la jurisprudence du moyen âge enveloppait
dans la catégorie des péchés contre nature:
[174]
«Quant aux femmes qui se corrompent l’une l’autre,
que les anciens nommoient tribades, dit l’austère
auteur du Procez criminel, il n’y a point de doute
qu’elles ne commettent entre elles une espèce de sodomie...
Et est ce crime digne de mort, comme
remarque M. Boyer en ses Décisions.»
Nous ne recourrons pas au témoignage de Nicolas
Boyer, auteur des Decisiones Burdigalenses, pour démontrer
que les parlements et les tribunaux inférieurs
étaient toujours impitoyables à l’égard des
femmes de mauvaise vie qui comparaissaient devant
eux sous le poids d’une accusation criminelle. Nous
donnerons les raisons de cette sévérité, en citant ce
passage du livre de Lebrun de la Rochette, qui consigne
en ces termes l’opinion unanime des gens de
loi sur les auxiliaires infâmes de la Prostitution:
«Quant aux maquereaux et maquerelles, ils sont du
tout insupportables comme ennemis de l’honnesteté,
traistres de la pudicité conjugale et virginale, assassins
de la sainte société humaine, proditeurs de la
légitime succession des vrais héritiers, tisons de
l’enfer et vrais truchements de l’esprit immonde, qui
n’ont jamais esté soufferts en aucune république bien
instituée, pour ne ressentir que le paganisme ou
l’athéisme, comme l’on peut recueillir des Constitutions
de Justinian, novella 14. Aussi, tous les jurisconsultes
et les docteurs ont tenu que: Lenocinium
gravius et majus est crimen adulterio, quia adulter in
se tantum et in unam fœminam peccat; leno autem peccat
[175]
in se, et duos pariter peccare facit.» Cependant un
des premiers codes écrits en français, le Livre de
jostice et de plet, contenant les coutumes de France
mêlées à une traduction littérale du Digeste, ne prononce
que la peine du bannissement et de la confiscation
contre les courtiers de débauche: «Cil qui
fet desloyaus assemblées de bordelerie doivent perdre
la ville et leurs biens sont le roi (liv. XVIII,
ch. 24).» Cet article des paines se trouvait complété
par le suivant, qui ordonne la fustigation avant le
bannissement: «Li maquerel de femes doivent estre
fusté et gesté (fustigé) hors de la vile, et leurs biens
sont le roi.»

Sommaire.—État de la Prostitution légale dans les provinces de
l’ancienne France.—Coutumes du Beauvoisis.—La Prostitution
dans le duché d’Orléans.—Le Livre de jostice et de plet.—Les
provinces du Nord.—Organisation de la débauche publique
à Toulouse, Montpellier, Narbonne, etc.—Coutume de
Bayonne.—Coutume de Marseille.—Coutume du comté de
Montfort, de Rodez, de Nîmes, de Beaucaire, etc.—Les
femmes légères de Bagnols et de Saint-Saturnin.—Bordeaux.—Supplice
de l’accabussade.—Marseille.—Sisteron.—Avignon.—Lyon.—Genève.—Coutumes
diverses.—Les Lombards
et les prostituées.—Troyes, Amiens, Laon, Meaux, etc.—Rues
sans chef affectées à la Prostitution légale.
L’ordonnance de Louis IX, relative à la Prostitution,
était donc toujours la base unique de la
[178]
jurisprudence sur cette matière, que les autres rois
de France semblaient à peine avoir osé toucher
après le saint roi, qui ne craignit pas d’y porter les
mains pour la renfermer dans de sages limites; mais
les légistes et les magistrats, tout en adoptant l’ordonnance
de 1254, ou plutôt celle de 1256, en
altérèrent parfois le texte, et l’interprétèrent aussi
de différentes manières, selon les besoins de la
cause; ils y ajoutèrent, en outre, comme corollaires
indispensables, certaines dispositions de la loi romaine,
qui était en vigueur dans les tribunaux, et
qui se mêlait plus ou moins aux traditions coutumières,
derniers vestiges des usages et des codes
barbares. C’étaient ces coutumes qui changeaient à
l’infini l’état de la Prostitution légale dans chaque
province, et même dans chaque ville. Il faudrait
passer en revue l’histoire particulière de ces villes
et de ces provinces, il faudrait surtout faire un
examen attentif de leur législation locale, pour
constater toutes les bizarreries qui s’attachaient à la
tolérance de la Prostitution, et surtout à la pénalité
qu’elle comportait en certains cas. Nous ne pouvons
que glaner dans un sujet si abondant et si complexe,
dont les matériaux se trouvent dispersés dans une
multitude de volumes que nous n’aurions pas la
patience de feuilleter, et qui ne nous offriraient
peut-être qu’un prodigieux amas de redites inutiles.
On jugera, toutefois, d’après un rapide extrait de
nos notes, qu’il serait possible d’établir, ville par
[179]
ville, et même village par village, une véritable
pornographie de l’ancienne France, appuyée sur
des textes authentiques.
Remarquons, une fois pour toutes, que la Prostitution
n’a jamais de titre spécial dans les corps
de lois, d’ordonnances ou de coutumes: elle se
trouve reléguée dans plusieurs titres, où elle figure
parmi des faits hétérogènes qui ne tiennent pas à
elle, et qui lui sont parfaitement étrangers. Il y a
même des coutumiers généraux où elle ne se montre
nulle part, comme si la pudeur du jurisconsulte
l’avait éliminée à dessein. Ainsi, dans les célèbres
Coutumes du Beauvoisis, qui furent la principale
source du droit français pendant quatre siècles, on
cherche inutilement une décision qui ait rapport à
la débauche publique. On dirait que le savant Philippe
de Beaumanoir ait voulu la bannir de son
livre, comme il eût souhaité l’exclure de la république.
Le caractère personnel du jurisconsulte,
l’austérité de ses mœurs et la modestie de son langage
s’opposaient sans doute à ce qu’il admît, dans
le formulaire des coutumes de son pays, le scandaleux
chapitre de la Prostitution. L’auteur anonyme
du Livre de jostice et de plet, rédigé dans le même
temps aux écoles de Décret d’Orléans, ne se montre
pas si réservé dans les choses et dans les mots. Il
commence par paraphraser l’ordonnance de saint
Louis sur la réformation des mœurs, et il traduit,
dans son patois orléanais, l’article concernant la
[180]
Prostitution: «Adecertes, les foles femes communes,
de chans et de viles, seent getées hors; et
quant l’en lor aura ce admonesté et devéé, li juge
d’icels leur prangnent lor biens, ou autres, par l’autorité
de cels, jusque à la cote ou le pelicon. Ensorque
tot qui loera meson à fole feme commune ou
recevra bordeaus en sa meson, et soit tenue souder
au baillif dou leu, ou au prevost, ou au juge, tant
comme la pension de la meson vaudra en un an.»
On voit que l’École de droit d’Orléans maintenait
force de loi à la première ordonnance de Louis IX,
qui avait aboli la Prostitution, et non pas à la
seconde, qui deux ans après l’avait autorisée sous
un régime de tolérance.
En vertu de ce principe fondamental enregistré dans
le Livre de jostice et de plet, nous avons vu, dans
le chapitre précédent, de quelles peines étaient punis
li maquerel de feme et cil qui fet desloyaus assemblée
de bordelerie. Celui-ci n’était qu’un industriel recevant
bordiaus en sa meson, et en tirant un lucre
infâme; l’autre, qui pouvait cumuler en fait de
maquerellage, cherchait à corrompre à son profit les
filles et les femmes qu’il entraînait au vice. Ce dernier
proxénète était bien plus coupable que le simple
bordeler, qui comme tel se trouvait mis au
niveau du larron, du toleor et du tricheor; et qui
restait noté d’infamie avec qualification de mau-renomez
(livre III, ch. 1er). Parmi les entremetteurs
et les entremetteuses de la pire espèce, le Livre de
[181]
jostice et de plet
ne signale pourtant pas, en se fondant
sur la loi romaine qu’il invoque sans cesse,
l’ignominie des taverniers et des tavernières, qui
généralement ne se bornaient pas à donner à boire
aux passants, et qui leur offraient aussi un transon
de chiere lie, pour nous servir de l’expression consacrée
dans ces endroits-là. L’ordonnance de saint
Louis, placée en tête du Livre de jostice, renferme
seulement cet article, que la traduction de l’auteur
anonyme rend assez obscur: «Nus ne soit receuz a
fere demore en tavernes, se il n’est trespassanz ou
se il n’a aucun estage en icelle taverne.» On peut
comprendre de diverses façons la fin du paragraphe,
dans lequel nous voyons qu’une taverne ne devait
être en aucun cas transformée en hôtellerie, et
qu’elle se composait uniquement d’une boutique
sans annexe de domicile et sans étages supérieurs
destinés à y coucher. Un passage de la vieille traduction
du Digeste (Ms. de la Bibl. Nation.) confirme
la mauvaise opinion qu’on avait des taverniers,
et surtout des tavernières, en France comme chez
les Romains: «Se feme est tavernière et ele a en sa
taverne fole feme que ele abandonne por gaaigner,
ele doit estre tenue pour houlière (maquerelle).»
L’ancien droit français diffère radicalement avec le
droit romain sur tous les points où le christianisme
avait modifié; ainsi, quoique le bordelier soit réputé
mau-renomez, la femme de mauvaise vie ne
partage pas avec lui cette marque d’infamie, et cela,
[182]
par cette raison de charité évangélique qui donnait
toujours à la femme pécheresse la faculté de se repentir
et de reprendre un train de vie honorable. Il
n’était pas rare alors, que, pour racheter une âme à
Dieu, un bon chrétien allât chercher une femme
légitime dans un repaire de Prostitution. C’est donc
en s’appuyant d’une décrétale de Clément III, que
le rédacteur du Livre de jostice et de plet a pu dire:
«L’en establit que toz cex qui tréront puteins de
bordel pour prendre à femme et qui les prendront,
que ce soit en remission de lor péchiez. Note que
c’est ovre de charité de apeler à voie de vérité celui
qui foloie.» Il se pose néanmoins un cas de
conscience à l’égard d’un mariage de cette sorte, et,
pour le résoudre, il s’empare d’une décrétale d’Innocent
III, intitulée Significasti: «Un prist une putain
et lessa sa feme; il en fut ecomunié (excommunié):
quant sa feme fut morte, il la prist. L’on
demande s’il poent (peuvent) se manoir ensemble?
Et l’on dit que, s’il n’ont porchassé la mort la feme,
ou s’il ne fiança la putain du vivant de sa feme, et
li hom soit asos (absous), s’il le requiert.»
Le Livre de jostice et de plet, dans lequel le chapitre
du mariage est traité avec une impudente
liberté d’expressions, que nous n’osons pas reproduire,
n’accorde cependant aucune indulgence aux
femmes qui se prostituent et aux hommes qui aident
leur Prostitution. Ceux-ci n’avaient pas le droit de
tester en justice et ne pouvaient obtenir des juges:
[183]
«Li rois puet faire, par inquisition de mauvese renomée,
justice de ceux qui tiennent les bordeaux.»
Celles qui exerçaient le même métier, ou qui tenaient
des tavernes, étaient également frappées d’incapacité:
«L’on defant que feme ne soit tavernière ne
bordelière; et s’ele est, ele n’est obligée de rien.»
Ces deux passages, qui semblent contredire ceux
que nous avons cités plus haut, prouveraient l’existence
permise ou tolérée de certains bordeaux,
tenus ou administrés par des hommes et des femmes,
qui, de même que les Juifs, consentaient à
vivre sous la menace permanente de la loi, qu’ils
conjuraient au moyen de contributions secrètes.
Malgré cette tolérance, nécessaire à la vie publique
des grandes cités, la police des mœurs était toujours
soumise à des lois austères, qui réprimaient
au besoin les excès et les scandales. Ainsi, la fornication,
tout impunie qu’elle fût ordinairement,
avait un article pénal dans le code coutumier: «Li
fornicateur doivent estre chatié atrampéement (modérément)
de poine de cors.» Il est bien certain
que le châtiment n’atteignait pas souvent les fornicateurs,
à moins de circonstances exceptionnelles.
Quant à la femme qui se séparait de son mari pour
forniquer, elle perdait son douaire. Mais le rapt, le
viol, l’adultère, la sodomie étaient rigoureusement
punis par commun jugement, c’est-à-dire que chacun
devait en provoquer la punition: «La loi que
li empereres (l’empereur Justinien) fit des avotires
[184]
(adultères) est des communs jugements, par coi non
pas tant solement cel qui bannissent aucun mariage
sont puni par glaive, mès cil qui font lor desléal
tricheries ô homes; et par cele meisme loi est puniz
li vices, quant aucun compoigne charnelment à
virge ou a veve.» Les sodomites des deux sexes
n’étaient pourtant condamnés à mort, qu’après avoir
subi deux condamnations corporelles pour le même
fait: «C’il qui sont sodomite prové doivent perdre
les c..... Et se il le fet segonde foiz, il doit perdre
menbre; et se il le fet la tierce foiz, il doit estre ars.
Feme qui le fet doit à chascune fois perdre menbre;
et la tierce, doit estre arsse. Et toz leur biens sont
le roi.» Telles étaient les peines concernant la police
des mœurs dans le duché d’Orléans.
Cette pénalité, que le code Justinien avait fournie
au législateur français, se retrouvait à peu près partout
avec des nuances d’application, que le caractère
local des habitants variait à l’infini. Les provinces
du nord avaient à cet égard plus d’indulgence que
celles du midi: la Prostitution y régnait sans contrainte,
et le régime des mœurs, abandonnées à leurs
instincts natifs, n’avait qu’à se maintenir dans les
limites assez étendues d’une facile tolérance. Toulouse,
Montpellier, Narbonne et d’autres villes du
Languedoc avaient une organisation de débauche
publique, plus régulière encore que celle qui existait
alors à Paris. Cependant Charles d’Anjou, comte
de Provence et roi des Deux-Siciles, s’était efforcé,
[185]
à l’exemple de son frère Louis IX, d’expulser de
ses États la Prostitution légale; il ne réussit pas
mieux que le roi de France dans ce dessein, plus
pieux que politique, et il dut renoncer à faire la
guerre aux ribaudes, qui ne tenaient aucun compte de
ses ordonnances. Il se rejeta sur le lenocinium, ou
lenoine, qu’il regardait avec raison comme l’élément
le plus dangereux de la Prostitution, qui avait
échappé à toutes les mesures de rigueur. En confirmant
les Coutumes de Provence, il ordonna que tous
ceux qui s’entremettaient pour corrompre ou prostituer
les femmes ou filles, seraient chassés du comté,
sans forme de procès; que si, dix jours après la publication
de cette ordonnance, il se trouvait encore
quelque misérable qui osât exercer cet art impie, la
justice informerait et le coupable serait puni de peines
corporelles, outre la confiscation de ses biens et
le bannissement. Charles d’Anjou défendait aussi à
tous ses officiers de donner asile en leurs maisons à
aucune femme de mauvaise vie, sous peine de privation
de leurs offices et d’une amende de cent livres
couronnes (voy. la Biblioth. du droit françois, par Bouchel,
t. II, p. 610). Le Languedoc néanmoins n’avait
garde de se réformer, à l’instar des provinces
voisines, où la Prostitution se voyait comprimée par
des lois et coutumes qui tendaient à la détruire tout
à fait. La Coutume de Bayonne, rédigée sans doute
sous l’influence des Constitutions espagnoles, prononçait
la peine du fouet et du bannissement contre
[186]
les maquerelles; mais, en cas de récidive, si elles
avaient rompu leur ban, on les condamnait à mort
(Coutumier général, t. IV, tit. 25). La Coutume de
Marseille n’était pas moins terrible à l’égard des
proxénètes, quoique les ribaudes communes fussent
tolérées dans certaines rues de cette ville où la présence
de tant d’étrangers et de gens de mer rendait indispensable
la libre pratique des mauvais lieux.
Toutefois les ribaudes qui exerçaient sur le port de
Marseille devaient s’abstenir de porter des vêtements
ou ornements de couleur écarlate, sous peine d’amende;
et, en cas de récidive, elles encouraient la
fustigation. Nous ferons, dans le chapitre suivant,
l’historique des abbayes obscènes de Toulouse, de
Montpellier et d’Avignon.
Recherchons les traces de la Prostitution dans
quelques autres villes du Languedoc. A Narbonne,
quoique siége archiépiscopal, les consuls de la ville
possédaient le privilége d’avoir, dans la juridiction
du vicomte, une rue chaude (carreria calida), où
les officiers de ce seigneur n’avaient aucun droit de
justice, et les femmes amoureuses qui habitaient
cette rue sous les auspices de l’autorité consulaire
avaient la liberté d’exercer leur commerce impur
dans toute la vicomté, sans être molestées ni inquiétées
par personne (voy. l’Hist. générale du Languedoc,
par dom Vie et dom Vaissette, t. IV, p. 509). A
Pamiers, résidence d’un évêque, les filles de joie
ne séjournaient pas dans l’intérieur de la ville; suivant
[187]
les Coutumes du comté de Montfort, confirmées
en 1212, ces pécheresses ne pouvaient ouvrir leurs
bordiaus, qu’en dehors de l’enceinte des villes murées
et à certaine distance des portes (voy. Thes. nov.
anecdot., publ. par Martene, t. I, col. 837). A
Rodez, qui avait aussi un évêché, la Prostitution
existait pourtant, ce semble, en dedans des murs,
car l’évêque de cette ville, qui se nommait Pierre
de Pleine-Chassaigne, en 1307, défendit aux habitants
de recevoir dans leurs maisons les femmes publiques
(nec recipient in hospitiis suis publicas meretrices),
dont il règle d’ailleurs la livrée, de telle sorte
que ce costume ne diffère pas de celui des femmes
honnêtes: il défend donc aux prostituées de porter
des capes, des manteaux, des voiles et des robes à
queue; il veut que leurs robes descendent jusqu’aux
chevilles seulement (voy. ces règlements de l’évêque
seigneur de Rodez, dans les Documents inédits
tirés des Mss. de la Biblioth. Nation. par Champollion-Figeac,
t. III, p. 17). A Nîmes, où l’évêque était
également seigneur temporel, la Prostitution avait
été confiée à une gouvernante des filles (magistra),
laquelle affermait ce commerce impudique et recevait
ses pleins pouvoirs des consuls, qu’elle allait
complimenter à des époques fixées, en leur apportant
un présent d’investiture appelé osculum ou osclage
(voy. le Supplément au Glossaire de Ducange, au
mot Osculum). Beaucaire, qui du moins n’avait pas
d’évêché et qui attirait à ses foires célèbres une
[188]
multitude de marchands forains, ne pouvait se passer
d’un mauvais lieu privilégié, qui s’ouvrait en
même temps que la foire de Sainte-Madeleine et qui
se fermait en même temps qu’elle. Ce mauvais lieu
était placé sous la dépendance d’une gouvernante,
qu’on appelait l’abbesse, et qui n’obtenait cette charge
lucrative que sous certaines conditions singulières.
Il ne lui était pas permis, par exemple, d’accorder
l’hospitalité pour plus d’une nuit aux passants qui
voudraient loger dans son hôtel. En 1414, une
abbesse du nom de Marguerite reçut chez elle le
nommé Anequin, et fut si contente de lui, qu’elle
oublia son devoir et le garda pendant six nuits; elle
se vit accusée pour ce cas de contravention, et elle
dut payer 10 sols tournois d’amende au châtelain de
Beaucaire. C’est M. Rabutaux qui a consigné ce fait
curieux dans son mémoire sur la Prostitution en
Europe; mais il a négligé de nous dire la source où
il l’a puisé. Les revenus que la Prostitution fournissait
aux villes de Nîmes et de Beaucaire avaient été
sans doute très-considérables dans le temps où la
foire de Beaucaire fut la plus fréquentée; mais, au
seizième siècle, quand les guerres de François Ier et
de Charles-Quint eurent empêché les commerçants
étrangers de se rendre à cette foire renommée, les
joyeuses abbayes, que leur générosité faisait prospérer
naguère, étaient à peu près désertes; car, dans
les Comptes de la recette ordinaire dressés en 1530,
Antoine Boireau, receveur de la trésorerie de
[189]
Nîmes et de Beaucaire, ne fait figurer qu’une somme
de quinze sols, pour les droits perçus pendant trois
ans sur les deux abbayes de cette localité (de emolumento
duorum hospitiorum in quibus fit lupanar).
Outre ces deux hôtelleries malfamées, tenues à
ferme par un nommé Louis Clucher, il en existait
une troisième qui ne donnait aucun revenu à la ville
de Beaucaire, parce qu’elle était presque toujours
inoccupée (voy. le Traité de la police, t. I, p. 525).
Il n’y avait peut-être pas de petite ville en Languedoc,
qui n’eût, sinon son abbaye, du moins ses
femmes légères. Celles de Bagnols ne pouvaient porter,
sans s’exposer à une punition, des chapels de
fleurs, des voiles, des fourrures d’hermine, des
capuchons ouverts, ornés de boutons, etc. (Voy. le
Supplément au Glossaire de Ducange, au mot Mulier
levis.) Celles de Saint-Saturnin devaient chômer les
jours de fête, les quatre-temps et vigiles: en 1414,
Isabelle la Boulangère fut condamnée à une amende
de dix sols, pour avoir reçu, le jour de Pâques, un
nommé Georges, qui pourtant était son amant en
titre. (Ibid., au mot Meretricalis vestis.) Ces mœurs
languedociennes, que l’hérésie des Albigeois ou
Cantares n’avait pas peu relâchées, débordèrent
dans les provinces voisines. Toutefois, la ville de
Bordeaux, qui se distingua entre toutes par la sévérité
de sa police des mœurs, paraît avoir quelquefois
noyé les ribaudes et les entremetteurs incorrigibles,
en leur baillant la cale. Ducange, au mot
[190]
Accabussare, nous apprend que ce supplice était en
usage à Bordeaux, où le bas peuple sans doute
prononçait la sentence et dirigeait l’exécution: le
patient ou la patiente étaient renfermés dans une cage
de fer, que l’on plongeait dans la mer, et qu’on n’en
retirait pas toujours avant que l’asphyxie fût complète.
Ducange dit positivement que les victimes de
la cale étaient noyées (Subtus navim denuò submerguntur).
Il ajoute que la même pénalité punissait
les blasphémateurs, à Marseille, quand ils n’avaient
pas 12 deniers pour se racheter de la cabussa, ou
culbute dans l’eau salée; ils en buvaient plus qu’ils
ne voulaient, aux huées de la canaille, qui s’amusait
de leurs grimaces. Un châtiment analogue attendait
aussi, à Toulouse, les jureurs, les entremetteurs,
et «quelquefois, dit Lafaille, les femmes prostituées»
qui avaient contrevenu aux règlements de
police. Jousse, dans son Traité de la justice criminelle
de France, publié en 1771, décrit l’accabussade
telle qu’on la pratiquait encore de son temps
pour le plus grand divertissement des amateurs. On
conduisait à l’hôtel de ville la malheureuse qui avait
été condamnée pour quelque méfait de prostitution;
l’exécuteur lui liait les mains, la coiffait d’un bonnet
fait en pain de sucre, orné de plumes, et lui
attachait sur le dos un écriteau portant une inscription
qui faisait connaître la nature du délit. Cette
inscription était ordinairement: Maquerelle. Une foule
railleuse et tracassière accompagnait la condamnée,
[191]
devant laquelle on criait son arrêt. On la menait
ainsi processionnellement jusqu’au pont qui traverse
la Garonne; une barque la recevait avec l’exécuteur
et ses aides, pour la transporter sur un rocher situé
au milieu de la rivière. Là, on la faisait entrer dans
une cage de fer, faite exprès, que l’on plongeait dans
l’eau par trois fois: «On la laisse pendant quelque
temps, dit Jousse, de manière cependant qu’elle ne
puisse être suffoquée; ce qui fait un spectacle qui
attire la curiosité de presque tous les habitants de
cette ville.» Ensuite, on transférait la pauvre femme,
à moitié noyée, dans le quartier de force, à l’hôpital,
où elle devait passer le reste de ses jours, à moins
qu’elle n’obtînt sa grâce et ne retournât à son premier
métier. Nous nous rappelons avoir lu qu’on
infligeait un pareil traitement aux filles publiques
accusées et convaincues d’avoir communiqué une
maladie vénérienne à quelques débauchés, qui se
portaient parties civiles, et qui réclamaient la visite
médicale de leurs empoisonneuses; mais nous ne
saurions dire en quel endroit ni à quelle époque on
faisait subir cette ablution infamante aux dangereuses
ennemies de la santé publique.
- A. Cabasson del.
- Drouart Imp.
- Alp. Leroy et F. Lefman. Sc.
COUTUME DE TOULOUSE
Nonobstant les ordonnances de Charles d’Anjou
contre la Prostitution en général, la Provence n’avait
jamais été entièrement délivrée d’un fléau que le
tempérament chaud et pétulant de ses habitants devait
naturellement propager et qui mettait obstacle
aux désordres des passions et des sens. On comprend
[192]
que la Prostitution légale ne pouvait pas avoir un
cours régulier et patent dans un pays où la chevalerie
et la poésie avaient idéalisé les rapports des
deux sexes entre eux, où le culte de la femme s’était
en quelque sorte dégagé de toute souillure matérielle,
et où les Cours d’Amour, égarées dans les
abstractions du sentiment, semblaient avoir pris à
tâche de tuer l’homme dans l’homme et d’annihiler
le corps au profit de l’âme. Nous avons vu plus haut
cependant que la Prostitution existait ouvertement
à Marseille pour l’usage des marins et des étrangers,
qui avaient besoin de trouver dans un port
de mer les moyens de se distraire des ennuis d’une
longue traversée. Il y avait des femmes de plaisir
dans la plupart des grandes villes; mais elles déguisaient
leur profession honteuse sous des noms et
des apparences honnêtes. Elles n’en étaient pas
moins en butte aux persécutions continuelles de la
police municipale et de l’autorité ecclésiastique: on
les arrêtait, on les emprisonnait, on les mettait à
l’amende sous le plus frivole prétexte. A Sisteron,
par exemple, le sous-viguier de la ville faisait incarcérer,
par un odieux excès de pouvoir, les femmes
étrangères qui venaient se fixer dans cette cité
épiscopale, et qui y arrivaient accompagnées de leurs
amants (cum eorum amicis): ce sous-viguier accusait
de débauche ces femmes sans appui, et il les
forçait à payer une contribution pour recouvrer leur
liberté et pour vivre en paix (ut pecunias extorquatur
[193]
eorumdem vexaciones redimendo). Les habitants
se plaignirent de ces extorsions iniques, et, par lettres
en date du 20 avril 1380, Foulques d’Agoust,
sénéchal des comtes de Provence et de Forcalquier,
enjoignit au sous-viguier de ne plus tourmenter les
femmes étrangères qui voudraient résider dans la
ville avec leurs amis (saltem cum amicis prædictis), à
condition qu’elles y vivraient honnêtement (dum tamen
vitam honestam teneant). M. Edouard de Laplane,
qui rapporte cette pièce dans son Histoire de Sisteron
(t. I, p. 527), nous apprend que les magistrats de
Sisteron, pour obvier sans doute aux fâcheuses
erreurs que le séjour de ces étrangères avait causées
dans la ville, résolurent d’acquérir aux frais de la
commune un hôtel destiné à recevoir les filles de
joie et à les héberger seulement à leur passage. Cette
acquisition avait été décidée en 1394, et dix ans
plus tard elle n’était point encore faite; ce ne fut
qu’en 1424 que les femmes amoureuses trouvèrent
un refuge à Sisteron, sans craindre d’y être emprisonnées
et mises à l’amende. Celles qui arrivaient
toutefois par le pas de Peipin étaient soumises, de
même que les juifs, à un péage fixe de 5 sols, au
profit du couvent des dames de Sainte-Claire. Ces
religieuses devaient sans doute expier par leurs
prières les péchés que la Prostitution errante venait
apporter dans les murs de Sisteron, ou du moins
sur son territoire; car la maison de refuge des
ribaudes n’était pas dans la ville. L’établissement
[194]
de cette maison à Sisteron nous semble confirmer
tout ce que la tradition rapporte d’un établissement
analogue dans la cité d’Avignon. Nous traiterons à
part cette question d’archéologie historique, qui mérite
d’être examinée sans idée préconçue.
Il est incontestable que les mœurs italiennes s’acclimatèrent
avec les papes dans le comtat d’Avignon;
et l’on peut soutenir que la ville papale ne
changea rien aux habitudes des meretrices romaines,
auxquelles le chapeau rouge des cardinaux ne
faisait pas peur. D’Avignon à Lyon, la Prostitution
n’avait eu qu’à remonter le Rhône; et cette grande
ville renfermait trop d’habitants pour que la police
ne fût pas tolérante à l’égard des mœurs. Guillaume
Paradin, dans ses Mémoires de l’histoire de Lyon
(édit. de 1573, in-fol., ch. 58), a consigné un règlement
municipal de 1475 qui rappelle les ordonnances
de la prévôté de Paris sur la même matière.
Il était enjoint, par cet arrêté, aux filles publiques
de Lyon d’abandonner les bonnes et honorables rues,
et de se retirer dans deux maisons d’asile où elles
exerceraient leur misérable métier sous la surveillance
des consuls: chacune de ces maisons n’avait qu’une
seule issue, pour que les ribauds qui commettraient
un délit dans ces lieux de débauche, ne pussent
s’enfuir par derrière, au moment où l’on crierait à
l’aide. Cette ordonnance réglait de plus le costume des
femmes dissolues, à qui défenses étaient faites, sous
peine de confiscation, d’employer à leur parure les
[195]
corroyes garnies d’argent, les fourrures de penne gris,
menu vair, laitistes, peau noire ou blanche d’aigneaux,
excepté tant seulement un pelisson de noir ou de blanc,
et enfin les chaperons de femme de bien; elles
étaient tenues à porter, sous peine de prison et de
60 sous d’amende, «continuellement chascune au
bras senestre (gauche), sur la manche de leurs robes,
trois doigts au-dessous de la joincture de l’espaule,
une esguillette ronge, pendant en double du long
du bras, demy pied.» La marque (enseigne) des
femmes de mauvaise vie ne se voyait que dans les
villes où la Prostitution était tolérée et avouée. Malgré
ces complaisances de la loi en faveur du vice,
la lenoine ou la houllerie ne participait pas au bénéfice
de la tolérance: maquereaux ou maquerelles
étaient toujours laissés en dehors du droit commun.
On les fouettait, on les emprisonnait, on les chassait
en confisquant leurs biens, «Quelquefois l’entremetteuse,
dit Muyart de Vouglans, était montée sur
un âne, le visage tourné vers la queue, avec un
chapeau de paille et un écriteau.» On la promenait
ainsi à travers la ville, au milieu des insultes de la
populace, puis, après avoir été fouettée par l’exécuteur,
elle était expulsée du pays ou enfermée
dans un hôpital. Voilà ce qui se passait à Lyon et à
Genève, où le coupable, «mitré, fouetté publiquement,
banni perpétuellement sous peine de perdre
la vie,» suivant l’auteur du Traité des peines et
amendes, entraînait dans son châtiment le complice
[196]
qui s’était associé au délit en prêtant ou en louant
sa maison. Cette maison confisquée, le complice
payait d’abondant une amende de 10 livres d’or.
Jean Duret, en se plaignant de l’indulgence d’une
telle législation, nous donne à entendre que la peine
de mort était encore appliquée, de son temps, en certains
cas. Les villes qui ne possédaient pas de ribaudes
à demeure se contentaient de celles que le
hasard leur amenait et qui couraient le pays en cherchant
fortune: elles n’avaient pas la permission de
séjourner plus de vingt-quatre heures dans les endroits
habités où elles s’arrêtaient avec leurs ruffians.
Généralement, elles logeaient alors dans les faubourgs
ou hors des murs, souvent dans une borde
isolée, quelquefois dans un lieu de refuge réservé
pour elles, et même à la belle étoile, derrière une
haie ou bien parmi les blés. Un accord, intervenu
en 1513, à la suite d’une contestation qui divisait
le seigneur et les habitants des communes de la
Roche de Glun et d’Alenson (Drôme), interdit aux
habitants de ces communes de loger chez eux, pendant
plus d’une nuit, les ribaudes publiques et leurs
ruffians qui traversaient le pays: «Que dengune
persone non deia logar ribaudes publicques audit
luoc, plus haut que una nuech, ni ruffians, sur la
pena de ung chescun et de chescune fois de sinc
soulz.» (Voy. les Doc. histor. inédits, publiés par
Champollion-Figeac, t. IV, p. 352.) Cette citation,
que nous pourrions étayer de plusieurs autres analogues,
[197]
prouve l’existence de ces prostituées vagabondes,
qui s’en allaient de ville en ville faire trafic
de leur corps, et qui avaient d’ordinaire, pour compagnons
ou amis des ribauds qu’elles nourrissaient
des ignobles produits de leur impudicité. Ces ribauds
n’étaient pas inutiles parfois à leurs dames et
maîtresses pour les protéger contre les violences auxquelles
ces malheureuses étaient constamment exposées
de la part du premier venu. Rien ne fut plus
fréquent que ces lâches violences, qui restaient presque
toujours impunies. Les lois pourtant n’étaient
pas désarmées à cet égard, et le viol d’une femme
de mauvaise vie avait été assimilé à celui d’une
honnête femme par les jurisconsultes. Dans les priviléges
que le seigneur de Chaudieu octroya, en
1389, aux bourgeois d’Eyrien, près de Valence, priviléges
confirmés la même année par Charles VI, il
est dit que quiconque aura violé une femme dissolue
ou toute autre appartenant à un lieu de débauche
(Si quis mulierem diffamatam aut aliam de lupanari
violenter coegerit) payera 100 sous d’amende.
Une portion de cette amende revenait, de droit,
à la personne qui avait éprouvé le dommage, que
la législation considérait moins comme une injure
que comme un vol accompli avec menaces et violence.
(Ordonn. des rois de France, t. VII, p. 316.)
Si le législateur se posait quelquefois en protecteur
des femmes déshonorées, que leur flétrissure ne
livrait point à la merci de toutes les insultes, il protégeait
[198]
également ceux qui avaient à se prémunir contre
les complots de ces femmes astucieuses et de leurs
vils auxiliaires. Ainsi, une des spéculations les plus
ordinaires et les plus faciles, c’était d’accuser de
violence un homme qui n’avait fait que passer un
marché amiable et prendre livraison de la marchandise
qu’il pensait acheter. Les riches Lombards, banquiers
juifs ou italiens, dans les mains desquels se
concentrait tout le commerce de l’argent, se voyaient
sans cesse exposés à des entreprises de cette nature:
une femme s’introduisait chez eux à titre de servante
ou autrement; puis elle portait plainte en justice,
et prétendait avoir été mise à mal contre sa volonté:
le serment déféré à cette débauchée, elle n’hésitait pas
à le prêter sur l’Évangile; et l’imprudent étranger n’en
était jamais quitte à moins d’une amende énorme,
dans laquelle la femme et ses complices avaient la
plus grosse part. Cette manière d’exploiter la fortune
et la position délicate des Lombards était devenue si
fréquente à la fin du quatorzième siècle, que les Lombards
ne voulurent plus établir de banque dans les
villes de France, sans que leur honneur et leur
bourse fussent mis à l’abri des embûches de la
Prostitution. En conséquence, on remarque cette
clause, à peu près identique, dans les lettres des rois
Charles V et Charles VI, qui accordaient à des associations
de Lombards le privilége d’ouvrir une banque
et de prêter de l’argent dans les villes de Troyes,
de Paris, d’Amiens, de Nîmes, de Laon et de
[199]
Meaux: «Item, se aucunes femmes renommées de
foie vie estoient dedens les maisons desdiz marchans,
qui voulsissent dire et maintenir, par leur cautelle
et mauvaistié, estre ou avoir été efforciées par lesdiz
marchans ou aucuns d’eulz; que, à ce proposer, ycelles
femmes ne fussent point reçues, ne lesdiz marchans ne
aucuns d’eulz, pour ce, empeschez en corps ou en
biens.» Grâce à ce paragraphe de leurs priviléges,
les Lombards n’avaient rien à redouter de la malice
des femmes qu’ils recevaient dans leurs maisons et
qui n’avaient pas d’autre but que de se dire violentées
par leurs patrons. Cette clause de précaution
nous apprend, en outre, que ces Lombards se trouvaient,
comme étrangers, dispensés de se conformer
aux ordonnances ecclésiastiques et civiles qui défendaient
aux gens d’honneur de loger dans leurs
maisons une femme débauchée pendant plus d’une
nuit. Ce séjour d’une prostituée, dans leur demeure,
n’avait aucune conséquence défavorable pour eux,
et ils n’encouraient par là ni prison, ni amende, ni
blâme.
Toutes ces ordonnances relatives aux banques ou
comptoirs d’escompte de Paris, de Troyes, d’Amiens,
de Laon, de Meaux, etc., constatent la présence
fréquente ou habituelle des femmes amoureuses
dans ces différentes villes, et les tentatives de séduction
qu’elles renouvelaient sans cesse contre les Lombards
et les Italiens. Ceux-ci pouvaient, d’ailleurs,
se permettre impunément tous les désordres que la
[200]
loi eût atteints et châtiés dans la conduite des nationaux,
sujets du roi. Le sage et vertueux Charles V
le dit clairement dans les priviléges qu’il accorda
en 1366 aux marchands italiens établis à Nîmes: ces
marchands ne pouvaient être inquiétés et punis pour
le cas de simple fornication, à moins qu’ils ne fussent
convaincus de rapt ou d’adultère (nec pro lubrico
carne aliquis eorum punietur). Il est donc présumable
que la licence des mœurs de ces étrangers
influait sur l’état moral de la population qui les
entourait et qui se corrompait à leur exemple, sinon
à leur contact; car ils avaient auprès d’eux un cortége
de femmes dissolues et de libertins, qui menaient
joyeuse vie et qui se pervertissaient mutuellement.
Nous n’attribuerons pourtant pas à leur
installation dans la ville de Troyes, en 1380, l’établissement
des bouticles, que les filles de joie cloistrières,
ou femmes communes, tenaient d’ancienneté
dans plusieurs endroits de cette ville, comme nous
le savons d’après cet article d’un document antérieur,
cité par les continuateurs de Ducange au mot
Clausuræ: «Item, que toutes filles de vie cloistrière,
ou femmes communes diffamées, voisent tenir,
tiennent et fassent leurs bouticles ès lieus à ce ordonnés
d’ancienneté dans ladite ville.» Les villes
voisines de Paris et qui se trouvaient dans le rayon,
pour ainsi dire, de la cour du roi, se faisaient un
point d’honneur d’obéir les premières aux ordonnances
royales et d’imiter scrupuleusement l’organisation
[201]
de la police parisienne, comme elles imitaient
les mœurs, les modes, les usages et le jargon
de la capitale. L’imitation ne restait pas en défaut
dans les choses du libertinage et, pour n’en citer
qu’une particularité bizarre, nous pencherions à
croire qu’un bon compagnon de province, qui avait
vu son Paris et qui s’était amusé des rues Tirev..,
Trousse-Putain et autres aussi malhonnêtes de nom
que de séjour, fut le parrain narquois de la rue
Pousse-Penil, à Issoudun, et de la rue Retrousse-Penil,
à Blois, et de toutes les rues sans chef affectées
à la Prostitution légale.

Sommaire.—Provinces centrales de la France.—La Champagne.—La
Touraine.—Le Berry.—Le Bourbonnais.—Le
Poitou.—L’Orléanais.—Les femmes mariées de Montluçon
assimilées aux prostituées.—L’Adveu de la terre du Breuil.—Servitudes
bouffonnes et facétieuses.—La chaussée de l’étang
de Souloire.—Le seigneur de Poizay et les denrées des filles
amoureuses.—Le roi de France et les ribaudes de Verneuil.—Les
femmes folles de Provins, etc., etc.
Les provinces centrales de la France étaient celles
où la Prostitution rencontrait le moins d’entraves,
[204]
et trouvait les conditions les plus favorables. On lui
laissait le champ libre, pourvu qu’elle se soumît
aux coutumes locales et qu’elle se tînt à l’écart,
sans causer de trouble ni de contents. On ne punissait
chez elle que le scandale et les contraventions.
Il faut remarquer que ces provinces étaient aussi
celles où la civilisation avait le mieux adouci les
mœurs: si la débauche publique y vivait en bonne
intelligence avec l’autorité des seigneurs et des
communes, la gaieté et la douceur du caractère des
habitants les éloignaient naturellement de tous les
crimes et de toutes les violences que le libertinage
entraîne trop souvent après lui. La Prostitution avait
donc droit de cité dans chaque ville de la Champagne,
de la Touraine, du Berry, du Bourbonnais,
du Poitou et de l’Orléanais; elle devait seulement,
dans chaque endroit où elle passait ou se fixait à sa
convenance, payer les redevances féodales et se
conformer aux usages, qui souvent n’étaient point
écrits dans les coutumiers du pays, mais que la
tradition maintenait de siècle en siècle. Parmi ces
redevances, il en était de fort singulières, que nous
ne comprenons plus aujourd’hui, et qui n’ont peut-être
jamais eu de sens raisonnable. Ainsi, Sauval
a tiré des Archives de la Chambre des Comptes un
document de l’année 1498, lequel constate que la
coutume de Montluçon assimilait aux prostituées les
femmes mariées qui battaient leurs maris; mais les
unes et les autres ne rendaient pas un hommage de
[205]
même nature à la châtellenie de Montluçon. Toute
femme qui avait frappé son mari était tenue d’offrir
au châtelain ou à la châtelaine un escabeau ou un
bâton. Toute prostituée qui arrivait dans le pays
pour y faire vilain commerce, devait payer, une fois
pour toutes, quatre deniers au seigneur; et, de plus,
à titre de vassale, aller publiquement sur le pont
du château, s’y accroupir et y faire entendre un
bruit malhonnête, qu’elle n’avait garde d’étouffer
sous ses jupes. Voici le texte latin de l’Adveu de la
terre du Breuil, rendu par très-haute, très-noble et
très-puissante dame Marguerite de Montluçon, le
27 septembre 1498: «Item in et super qualibet
uxore maritum suum verberante, unum tripodem.
Item in et super filiâ communi, sexus videlicet viriles
quoscumque cognoscente, de novo in villa Montislucii
eveniente, quatuor denarios semel, aut unum bombum
sive vulgariter PET, super pontem de castro Montislucii
solvendum.»
Les commentateurs, qui se fourrent partout, et de
préférence dans les endroits les plus malsonnants,
n’ont pas manqué de battre les buissons à l’occasion
de cette sale redevance. Les uns ont prétendu que
les filles folles de leur corps ne pouvaient donner
au seigneur de Montluçon plus qu’on ne les estimait
généralement; ils ont rapproché de la taxe
indécente que ce seigneur exigeait d’elles un dicton
proverbial, qu’on employait jadis à l’égard des
prostituées: «La belle ne vaut pas un pet.» D’autres
[206]
archéologues se sont souvenus, à ce propos,
d’un passage inexpliqué des livres de Pantagruel,
où Rabelais nous montre comment les pets engendrent
les petits hommes; les vesnes ou vesses, les
petites femmes. Ce qui fit les deux proverbes:
Glorieux comme un pet et Honteux comme une vesse.
Il serait aisé de compiler un gros volume sur le pet
des ribaudes de Montluçon. Nous préférons clore la
discussion sur ce sujet délicat, en rappelant que, d’après
les habitudes du droit féodal, l’hommage et la
redevance dépendaient du genre de service que le
vassal rendait au seigneur et à ses tenanciers. L’histoire
des fiefs est remplie de servitudes bouffonnes
et facétieuses, entre lesquelles la part de la Prostitution
n’est pas la moins étrange. Dans les aveux et
dénombrements, faits en 1376 et autres années, par
les seigneurs des comtés d’Auge, de Souloire et de
Béthisy en Normandie; le seigneur de Béthisy déclare
à sa suzeraine, Blanche de France, veuve du
duc d’Orléans, que les femmes publiques qui viennent
à Béthisy ou y demeurent lui doivent 4 deniers
parisis, et que ce droit, qui lui valait autrefois
10 sols parisis tous les ans (ce qui supposait la venue
annuelle de trente ribaudes), ne lui rapportait plus
que 5 sols, «à cause qu’il n’y en venoit plus tant,»
dit Sauval (t. II, p. 465). Le seigneur de Souloire
déclare, à son tour, que toutes ces femmes-là, qui
passent sur la chaussée de l’étang de Souloire, laissent
entre les mains de son juge la manche du bras
[207]
droit ou 4 deniers ou autre chose. Pour comprendre
cette autre chose, il faut ouvrir, à la page 110, les
Réponses de J. Boissel, Bordier et Joseph Constant
sur différentes questions relatives à la Coutume du
Poitou (1659, in-fol.): le seigneur de Poizay, dans
la paroisse de Verruye, se réservait formellement,
en 1469, le droit de prélever, sur chaque fille amoureuse
arrivant dans la paroisse, la taxe ordinaire de
4 deniers, ou de prendre ses denrées, ce qui fixe à
4 deniers le salaire obscène de ces malheureuses. Il
paraît, du reste, que, dans la plupart des fiefs, le seigneur
avait droit à cette taxe uniforme de 4 deniers
sur chaque femme de mauvaise vie, qui entrait sur les
terres du fief et qui annonçait l’intention d’y vivre
de son industrie. Mais souvent le seigneur rougissait
de recevoir la dîme de la Prostitution; et il remplaçait
cette taxe pécuniaire par quelque redevance
ridicule, qui maintenait du moins ses priviléges
féodaux. Le roi de France se montrait plus insouciant
de l’origine des impôts qui tombaient dans
ses coffres; car, en 1283, suivant un document recueilli
dans le Glossaire de Ducange (au mot Putagium,
dans la dernière édit.), il recevait encore le
tribut des ribaudes de Verneuil, à 4 deniers par tête.
La Prostitution, dans ces pays de la langue d’oil, n’avait
pas le cachet d’infamie qu’elle imprimait aux personnes
qui vivaient à ses dépens dans les provinces de
la langue d’oc. Les fabliaux et les romans des trouvères
normands, champenois, poitevins et tourangeaux,
[208]
sont remplis de détails empruntés à la vie amoureuse
des femmes communes et débauchées; les jongleurs,
qui les fréquentaient sans doute et qui souvent
couraient le pays avec elles, n’éprouvaient aucune
répugnance à faire figurer dans leurs vers ces
joyeuses compagnes de leur existence vagabonde.
M. Bourquelot, dans sa belle Histoire de Provins
(t. I, p. 273), nous apprend que les femmes folles
de cette ville étaient célèbres par leurs charmes et
leur volupté. Elles habitaient dans plusieurs rues
dont les noms malhonnêtes accusent l’ancienneté et
qui furent autrefois pavées de ribaudes, selon l’expression
locale qui s’est conservée et qui rappelle la
rue Pavée-d’Andouilles de Paris. Le Fabliau de Boivin
de Provins (Ms. de la Bibl. Nation., no 7,218) caractérise
ainsi une des rues déshonnêtes de la ville:
Porpensa soi que à Provins
A la foire voudra aller,
Et vint en la rue aus putains.
Ces rues affectées spécialement au domicile des
femmes de mauvaise vie témoignent pourtant de la
démarcation profonde, qui séparait du reste de la
population les prostituées et les empêchait de se
confondre avec les femmes d’honneur. Celles-ci ne
possédaient ni la beauté, ni la séduction des impudiques,
mais elles étaient si jalouses de leur bonne
renommée, qu’elles ne croyaient pas qu’il y eût une
pénalité assez grande contre la médisance ou la calomnie
[209]
qui osait porter atteinte à leur réputation. Elles
avaient donc obtenu des comtes de Champagne appui
et protection, dans le cas où l’une d’elles serait injuriée
par une autre et traitée de pute en présence de
témoins. Celle qui se permettait une pareille injure,
sans raison et sans preuves, devait payer 5 sous d’amende
et suivre la procession en chemise, comme les
pénitentes, en portant une pierre qu’on nommait la
pierre du scandale, tandis que la femme qu’elle
avait insultée marchait derrière elle et lui piquait les
fesses avec une aiguille. Voici le texte d’une charte,
datée de 1287, dans laquelle se trouve relatée cette
bizarre coutume, que Ducange n’accompagne d’aucun
commentaire, en la tirant des archives de la
Champagne: «La fame qui dira vilonnie à autre, si
come de putage, paiera 5 sols, ou portera la pierre,
toute nue, en sa chemise, à la procession, et celle la
poindra après, en la nage (nates, fesses), d’un aguillon,
et s’elle disoit autre vilonnie qui atourt à honte
de cors, ele paierait 3 sols, et li homs ainsin.»
Il est évident que c’étaient les femmes publiques
qui se rendaient coupables ordinairement de cette
espèce d’injure à l’égard des femmes honnêtes, et la
loi prenait la défense de celles-ci, qui eussent été
fort empêchées de répondre dans le même style à
ces effrontées. La Coutume de Champagne s’occupe
particulièrement de ce délit d’injure. L’homme ou
la femme qui outrageait ainsi une femme de bien,
lui devait l’escondit (l’excuse), outre l’amende de
[210]
5 sous, et «s’il avenoit, ajoute la Coutume (article 45),
que la femme à qui l’on diroit le lait (l’offense) eust
mary, ceste amende chiet à la volonté du seigneur,
jusque soixante sols.» Les Coutumes de Cerny en
Laonais et de la Fère, octroyées par Philippe-Auguste,
autorisaient tout homme de bien qui entendrait
injurier une honnête femme par une femme de
mœurs scandaleuses à se faire d’office l’avocat et
le vengeur de l’insultée, en adressant à l’insulteuse
deux ou trois bons coups de poing (colaphi), pourvu
qu’il ne fût pas dirigé lui-même par une vieille rancune
à l’égard de celle qu’il maltraitait au nom de
l’honnêteté publique. La Coutume de Beauvoisis ne
particularise pas les injures et vilenies, qui valaient
5 sous d’amende pour un vilain et 10 sous pour un
gentilhomme; elle dit seulement que le plus grand
méfait, après le cas de crime, c’est de prétendre, vis-à-vis
d’un homme marié, con a geu o sa feme carnelment,
et, là-dessus, Philippe de Beaumanoir raconte
que, sous le règne de Philippe-Auguste, un
homme ayant dit à un autre: «Voz estes coz (cocu)
et de moi meismes!» celui à qui s’adressait cette
injure tira son couteau et en frappa le provocateur.
Emprisonné et mis en jugement, il fut acquitté, par
le roi et son conseil, comme ayant agi en cas de légitime
défense. Les femmes de mauvaise vie, autrefois
comme toujours, étaient promptes à l’injure et
capables des plus indignes procédés pour intimider
les gens de bien, qui tremblaient de se commettre
[211]
avec elles. Une de leurs tactiques les plus ordinaires
consistait dans l’odieux usage qu’elles faisaient de
la qualité de femme mariée, lorsqu’elles menaçaient
d’une plainte en adultère l’imprudent qui les
avait fréquentées et qui se voyait alors obligé d’acheter
leur silence. C’était pour exercer ces manœuvres
criminelles, et pour exploiter à leur profit les
remords du libertinage, qu’elles cachaient soigneusement
leur condition de femme mariée et qu’elles
ne la révélaient qu’après avoir commis un adultère
intéressé. La loi étant formelle et n’admettant pas
l’excuse d’ignorance dans un pareil crime, il fallut
que le droit coutumier vînt atténuer, en ce cas d’exception,
les rigueurs du droit commun. De là cet
article des Franchises de la Perouse en Berry, qui
remontent à l’année 1260 et qui émanaient de la justice
seigneuriale: «Si fem mariée commaner venoet
à la Paerose par putage, hom qui n’auroet feme qui
gueroet ob li, n’en est tengut vers le segnor.»
Les femmes amoureuses, qui, étant libres de leur
corps, n’avaient pas un mari à produire comme un
épouvantail d’adultère, se livraient souvent à un
genre de spéculation analogue, en menaçant de dénonciation
les gens mariés qu’elles faisaient tomber
dans le péché. C’était encore un genre d’adultère
que la loi féodale punissait autant que l’autre: un
homme marié qui avait eu des relations coupables
avec une fille publique, pouvait être accusé
et condamné. On évitait sans doute d’appliquer
[212]
cette rigoureuse jurisprudence, et l’on fermait les
yeux sur les délits de cette nature; mais, quand il
y avait plainte ou dénonciation, le juge était bien
forcé de poursuivre le délinquant, qui se trouvait
heureux d’en être quitte pour une amende, car la
pénalité la plus fréquente en pareil cas, celle qui
donnait satisfaction au sentiment de la vindicte populaire,
c’était la fustigation des deux complices,
courant tout nus par la ville et recevant leur châtiment
des mains de tous les spectateurs, qui devenaient
bourreaux en cette circonstance. Nous retrouvons,
dans ce vieil usage, établi, du moins en
principe, par toute la France du moyen âge, une
tradition des peines afflictives de Rome antique, à
l’égard des adultères, des courtisanes et des débauchés.
Les Coutumes d’Alais, rédigées au milieu du
treizième siècle, et publiées pour la première fois à
la suite des Olim (1848, t. IV, p. 1484), formulent
en ces termes la pénalité de l’adultère: «Encoras
donam que, si deguns hom que aia moller o femina
que aia marit son pris en aulterii, que amdui coron
ins per la villa e sian ben batutz, et en al ren non sian
condempnat; e’l femena an primieiran.» Les deux
coupables couraient donc ensemble; mais la femme
allait la première à travers les coups de verges. Le
même recueil des Olim nous offre plusieurs applications
de cette course des battus. En 1273, le
prieur de l’abbaye de Charlieu fit courir ou fouetter
par la ville (fecisset currere seu fustigare per villam)
[213]
plusieurs personnes qui avaient été surprises en
adultère sur les terres de l’abbaye. Les habitants de
la ville se plaignirent au bailli de Mâcon, en prétendant
que le prieur s’était arrogé un droit de justice
qu’il n’avait pas dans leur cité (quod novam et inconsuetam
justitiam faciebat in villa); et le bailli revendiqua
ce droit de justice au nom du roi. Mais le
prieur, se fondant sur d’anciens priviléges de l’abbaye,
ne persista pas moins à faire courir et fustiger
les adultères qu’il pouvait saisir en flagrant délit.
Les justices seigneuriales, enchevêtrées les unes
dans les autres, se disputaient sans cesse entre elles
le terrain légal, surtout dans les questions de police
des mœurs. A Amiens, l’évêque soutenait, en 1261,
qu’il avait droit de justice sur les sodomites dans la
banlieue de la ville d’Amiens; les bourgeois de cette
ville disaient, au contraire, que ce droit de justice
leur appartenait depuis la fondation de leur commune:
le débat ayant été soumis au conseil du roi,
Louis IX ordonna que la ville serait maintenue dans
son droit de justicier corporellement les sodomites:
justiciandi corpora sodomiticorum (voy. les Olim,
t. I, p. 136). A Saint-Quentin, l’abbé et les moines,
d’une part, le mayeur et ses échevins, d’autre part,
se disputaient, en 1304, le droit de basse justice
dans les faubourgs de la ville: l’abbé et ses moines
voulaient arrêter, chasser et emprisonner les femmes
folles (fatuas mulieres) qui avaient envahi les alentours
de l’abbaye; le mayeur et ses échevins voulaient
[214]
que ces femmes vécussent en paix, dans la
saisine abbatiale. Le conseil du roi décida que l’abbé
et ses moines étaient maîtres de se débarrasser de
ce voisinage malhonnête, mais que le mayeur et ses
échevins pourraient à leur tour arrêter, chasser et
emprisonner les femmes folles sur tout le territoire
de la commune (voy. les Olim, t. III, p. 151). Il y
eut probablement entre les parties une transaction
qui réglementa dans les faubourgs d’Amiens l’exercice
de la Prostitution.
Ces règlements étaient à peu près les mêmes partout,
car ils avaient toujours le même but: sévir
contre les entremetteurs, confiner la débauche dans
certaines rues ou dans certains lieux, noter d’infamie
les prostituées et les empêcher de se confondre avec
les femmes honnêtes. Jean de Bourgogne, comte de
Nevers, par ordonnance du 5 mars 1481, enjoignit
à toutes les femmes débauchées de porter sur la
manche droite une aiguillette rouge ou vermeille; il
leur défendit d’aller par la ville ou les faubourgs,
sans cette marque, à peine de prison, et leur interdit
de demeurer ailleurs qu’entre les deux fontaines,
«qui est de tout temps leur demeure ordinaire,»
et de fréquenter les étuves de la ville. (Archives de
Nevers, par Parmentier, 1842, t. I, p. 185.) Les
contraventions aux règlements étaient punies de bien
des manières. Abbeville se distinguait par le singulier
pilori qu’on avait inventé exprès pour les filles publiques
qui se laissaient surprendre en faute: c’était
[215]
un cheval de bois, appelé le chevalet, dressé sur la
place Saint-Pierre. Après les avoir copieusement
fouettées on les plaçait à califourchon sur le chevalet,
dont le dos tranchant ne leur offrait pas une
monture très-commode. Ensuite, dans quelques circonstances
graves, on les bannissait au son de la
cloche; et si l’une d’elles rompait son ban et revenait
dans la ville pour y trafiquer de son corps, on
lui coupait un membre et on la bannissait de nouveau.
(Hist. d’Abbeville, par Louandre, 1845, t. II,
p. 213 et 286.) Les proxénètes qui étaient convaincus
du crime de maquerellage dans cette même
ville, recevaient un châtiment plus exemplaire que
partout ailleurs: on les promenait, mitrés, dans
un tombereau rempli d’ordures; on les menait au
pilori, où le bourreau leur coupait et brûlait les
cheveux; après quoi on les expulsait à toujours,
et, en cas de rupture de ban, on les condamnait au
bûcher. En 1478, Belut Cantine d’Abbeville, «pour
avoir voulu atraire Jehannette, fille Witace de
Queux, à soy en aler en la compagnie de ung nommé
Franqueville, homme d’armes de la garnison d’icelle
ville,» fut «menée, mitrée, en ung benel, par les
carrefours, et ses cheveux bruslez au pilory; et ce
fait, bannye de ladite ville et banlieue, sur le feu, à
tousjours.» Au reste, la peine capitale, comme nous
l’avons dit, était écrite dans la loi; mais on ne
l’exécutait qu’en cas de récidive et même en raison
de causes aggravantes. «La punition des macquereaux,
[216]
suivant les priviléges parcidevant de la ville
de Gand, dit J. de Damhoudère, estoit le bannissement,
et les macquerelles le nez coupé; mais ils
n’usent plus du nez, come bien du ban, pillori, eschelle
ou eschafaut.» Le docte auteur de la Pratique
judiciaire ès causes criminelles ajoute cette remarque
relative à la jurisprudence de Bruges en semblable
matière: «Moy, qui ay esté plusieurs ans au
Conseil de la ville de Bruges, n’ay oncques veu punir
corporellement les macquereaux, ou macquerelles,
ou adultères, ains seulement, au dessoubz de
la mort, par bannissement hors et dedans la ville
ou pays, par le pillory ou eschaffaut, par fustigation
ou autres peines semblables.»
- Cabasson del.
- Drouart imp., r. du Fouarre, 11, Paris.
- Roze, sc.
LA CHEVAUCHÉE DE L’ANE.
Cette jurisprudence, qui était celle du parlement
de Paris, s’établit de proche en proche dans
tous les parlements de France; mais la coutume
locale se réserva presque toujours de donner à
l’exécution un caractère différent, qui dépendait des
mœurs du pays. Ici, l’amende était considérable,
comme dans le ressort du parlement de Rennes, qui
punissait d’une amende de 1,000 livres tournois les
vendries de poupées ou filleries; là, on frappait de
confiscation les biens meubles et immeubles des
condamnés. Tantôt la maquerelle était coiffée d’une
mitre ou bonnet conique en papier jaune ou vert;
tantôt on lui mettait sur la tête un chapeau de
paille, pour indiquer que son corps attendait toujours
un acheteur; tantôt on la marquait de la lettre
[217]
M ou de la lettre P, soit au front, soit au bras,
soit aux fesses; on promenait la condamnée sur un
âne galeux, sur un tombereau, sur une charrette,
sur une claie; on la fustigeait avec des verges, avec
des lanières de cuir, avec des cordes à nœuds, avec
des baguettes. Ce supplice, quel qu’il fût, était une
fête pour la population, qui y prenait part en accompagnant
de ses huées et de ses insultes la malheureuse
qu’on lui livrait comme un jouet. «C’est
surtout dans la répression de ces sortes de délits,
dit Sabatier dans son Histoire de la législation sur les
femmes publiques et les lieux de débauche, que nos
pères s’attachèrent à déployer une rigueur infamante
et des châtiments dont le mode blessait et les principes
de l’humanité, et la décence qu’on se proposait
de venger.» Mais le peuple était avide de
voir la course des adultères et d’y jouer son rôle
en poursuivant et en battant les coupables; quelquefois
il se passait de la sentence du juge pour faire
courir tout nus ceux qu’il avait surpris en flagrant
délit, et qu’il regardait comme appartenant à sa
justice. Aussi, dans la plupart des priviléges que
les communes obtenaient de leurs seigneurs, elles
avaient soin de faire confirmer le droit qu’elles
s’attribuaient de punir les adultères, et il fallut
que les seigneurs et les rois de France eux-mêmes
restreignissent ce droit à certains cas particuliers,
en laissant toujours aux délinquants la faculté de se
racheter au moyen d’une amende. Dans les priviléges
[218]
de la ville d’Aiguesmortes, reconnus par le roi
Jean en 1350, la course des adultères fut admise
en principe, mais les coupables pouvaient la compenser
par le payement d’une contribution que fixait
le magistrat. Si cette course avait lieu, les deux
coureurs n’étaient pas fustigés; et la femme, quoique
nue, à l’instar de son complice, devait couvrir
son sexe: Sine fustigatione currant nudi, copertis pudendis
mulierum; dit l’ordonnance du roi Jean, qui,
par le même sentiment de pudeur, défendait de
mettre en prison les hommes avec les femmes. (Voy.
les Ordonn. des rois de France, t. Ier.) Il arrivait souvent
que la populace d’une ville, impatiente de se
donner le spectacle d’une course aussi peu décente,
accusait d’adultère les couples d’amants qu’elle
avait trouvés à l’écart, et taxait de flagrant délit
une simple conversation amoureuse. Il était donc
nécessaire que la loi expliquât clairement ce que
c’était que le flagrant délit qui entraînait la pénalité
de l’adultère. Un malentendu n’était plus possible
en face des détails minutieux que présente à
cet égard le code des coutumes, libertés et franchises
accordées par les comtes de Toulouse aux
habitants de Moncuc, et confirmées très-sérieusement
par Louis XI dans ses lettres patentes du 30 novembre
1465: «Si omne mollierat era trobat per
bayle ab femyna maridada en adultero tug sols nut
e nuda en leg, o en autra loc sospechos, l’omme
sobre la femyna, baychadas los bragas, o ce isera
[219]
nut, o, sinon portara, la femyna nuda o sas vestimendas
levadas tro a l’enbouilh.....»
La Normandie fut, à toutes les époques, aussi
avancée que Paris en fait de Prostitution. Nous
avons parlé de ce mauvais lieu que possédait la ville
de Rouen, dans la seconde moitié du douzième siècle,
et que le duc de Normandie, Henri II, roi
d’Angleterre, avait placé sous la surveillance spéciale
d’un de ses officiers, nommé Balderic. Ce personnage
portait le titre de gardien de toutes les
femmes publiques exerçant à Rouen (Custos meretricum
publice venalium in lupanar de Roth), et il réunissait
à ce titre bizarre celui de maréchal du roi-duc,
pendant son séjour à Rouen, avec les fonctions
de garde de la porte de la prison du château,
valant 2 sous de gages par jour, la perception du
droit de glandée dans les bois voisins, etc. (Glossaire
de Ducange, au mot Panagator.)
Ce mauvais lieu, qui existait à Rouen dès le
temps des premiers ducs de Normandie, et qui tenait
sans doute ses priviléges de Guillaume le Conquérant,
fut probablement le théâtre des prédications
de Robert d’Arbrissel. On sait que le pieux
fondateur de l’ordre de Fontevrault s’en allait, pieds
nus, sur les places publiques et dans les carrefours,
pour amener les pécheresses au repentir et à la pénitence
(ut fornicarias ac peccatrices ad medicamentum
pœnitentiæ posset adducere). «Un jour qu’il était venu
à Rouen, raconte la Chronique, il entra dans le lupanar
[220]
et s’assit au foyer pour se chauffer les pieds.
Les courtisanes l’entourent, croyant qu’il était entré
pour commettre le péché (fornicandi causâ); lui, il
prêche les paroles de vie et promet la miséricorde
du Christ. Alors, celle des ribaudes qui commandait
aux autres lui dit: «Qui es-tu, toi qui tiens de tels
discours? Sache que voilà vingt ans que je suis
entrée dans cette maison pour y servir au péché
(ad perpetranda scelera), et qu’il n’y est jamais venu
personne qui parlât de Dieu et de sa miséricorde. Si
pourtant je savais que ces choses fussent vraies...»
A l’instant, il les fit sortir de la ville et les conduisit,
plein de joie, au désert: là, leur ayant fait faire
pénitence, il les fit passer du démon au Christ.»
L’abbaye de Fontevrault, que le pieux Robert
avait fondée pour y recueillir de préférence les femmes
perdues, ne le mit pas à l’abri des tentations
du diable et des calomnies du siècle. Il se soumit,
dit-on, à d’étranges épreuves pour vaincre la chair,
cette chair qui le torturait et l’enchaînait aux vanités
du monde. On l’accusait de partager le lit de
ses religieuses et de s’échauffer à leur contact, pour
avoir ensuite la gloire de dompter ses sens. L’abbé
de Vendôme, Geoffroy, lui écrivit une lettre de reproches
à ce sujet: Feminarum quasdam, ut dicitur,
nimis familiariter tecum habitare permittis, et cum
ipsis etiam et inter ipsas noctu frequenter cubare non
erubescis. Hoc si modo agis vel aliquando egisti, novum
et inauditum sed infructuosum martyrii genus
[221]
invenisti. Robert se vantait de n’avoir jamais succombé
à ce martyre d’un nouveau genre; et, dans
une lettre de Marbode, évêque de Rennes, publiée
par J. de la Mainferme dans son Clipeus ordinis
nascentis Fonterbaldensis, il est dit positivement que
la plupart des religieuses de Fontevrault devinrent
grosses des œuvres de leur abbé: Taceo de juventis,
quas sine examine religionem professas, mutata
veste, per diversas cellulas protinus inclusisti. Hujus
igitur facti temeritatem miserabilis exitus probat:
aliæ enim, urgente partu, fractis ergastulis, elapserunt,
aliæ in ipsis ergastulis pepererunt. On voit, par ce
curieux passage, que la maison du bienheureux Robert
ne se distinguait d’un mauvais lieu que par la
scandaleuse fécondité de ses habitantes.
Chaque ville de la Normandie avait aussi son lupanar,
sinon un garde-noble des femmes amoureuses,
et l’on peut dire, avec apparence de raison,
que les maquereaux et les maquerelles qui figurent
dans les anciennes Coutumes normandes furent baptisés
de ce sobriquet au bord de la Manche. Nous
ne voyons pas cependant que les ducs de Normandie
se soient montrés aussi favorables à la Prostitution
légale, que Guillaume IX, duc d’Aquitaine et
comte de Poitiers, qui avait établi ou voulait établir
à Niort une maison de débauche sur le plan des
monastères de femmes. Guillaume de Malmesbury
(voy. le recueil des Hist. des Gaules, t. XIII, p. 20)
a consigné ce fait singulier dans sa Chronique, et il
[222]
ajoute qu’après avoir construit l’édifice destiné à ce
monastère lubrique, le duc se proposait d’en confier
l’administration aux plus fameuses prostituées de
ses États: Apud Niort habitacula quædam quasi monasteriola
construens, abbatiam pellicum ibi positurum
delirabat, nuncupatus illam et illam quacumque femosioris
prostibuli essent, abbatissam et priorem, cæteras
vero officiales instituturum cantitans. Ce duc d’Aquitaine,
qui fut un galant troubadour et un libertin
effréné, aurait été déterminé par des raisons de police,
dit M. Weiss dans la Biographie universelle, à
former un pareil établissement, qui eut depuis son
analogue dans plusieurs villes de France, d’Italie et
d’Espagne. On ne sait si ce fut pour s’expliquer sur
ce fait que le pape Calixte II cita Guillaume au concile
de Reims, en 1129. Quoi qu’il en soit, le duc ne
se dérangea pas et continua de chanter l’amour, en
donnant à ses sujets l’exemple d’une joyeuse vie.
Les femmes de plaisir normandes, poitevines et
angevines avaient beaucoup fait, sans doute, pour
mériter leur renommée; celles d’Angers l’emportaient
sur toutes, comme le prouve ce dicton proverbial
qui avait cours au quinzième siècle: «Angers,
basse ville et hauts clochers, riches putains,
pauvres écoliers.» Le bas peuple de l’Anjou avait
lui-même composé son blason: Angevin, sac à vin;
Angevine, sac à .... (Le Livre des Proverbes français,
par le Roux de Linci, t. Ier, p. 203.)
Le voisinage de l’Anjou et du Poitou n’avait pas
[223]
réussi à pervertir la chaste Bretagne, où la Prostitution
n’eut jamais qu’une existence cachée, timide,
que le hasard révélait parfois aux bonnes
âmes bretonnes. Ainsi, vers la fin du quatorzième
siècle, dans l’enquête ouverte pour la canonisation
de Charles de Blois, un témoin, nommé Jean du
Fournet, homme d’armes de la paroisse de Saint-Josse,
au diocèse de Dol, raconta aux commissaires
ecclésiastiques comment le saint duc avait converti
une pécheresse. Le jour du jeudi saint de l’année
1357, Charles de Blois se rendant de la ville de
Dinan au château de Léon, accompagné d’Alain du
Tenou son argentier, de Godefroi de Ponblanc
son maître d’hôtel, du chevalier Guillaume le Bardi
et de quelques gens d’armes, aperçut une femme
assise au bord du chemin; il lui demanda ce qu’elle
faisait là, et celle-ci, s’étant levée, répondit qu’elle
gagnait son pain à la sueur de son corps (quod panem
suum isto modo, per publicationem sui corporis,
lucrabatur). Le duc, prenant à part son argentier,
lui ordonna de s’approcher de cette femme et de
l’interroger sur le genre de métier qu’elle exerçait,
car le bon seigneur n’avait pas compris la réponse
de la pauvre créature, qui avoua tristement qu’elle
était au service de l’impureté publique (quod erat
mulier publica), et que la misère l’avait obligée à
faire ce vilain métier. Le duc, entendant cela, dit à
cette malheureuse qu’elle devrait au moins s’abstenir
de pécher de la sorte pendant la semaine sainte.
[224]
Elle répliqua que si elle avait vingt sous, elle s’en
abstiendrait bien jusqu’à la fin du mois. Charles de
Blois mit la main à sa bourse, qui n’était pas trop
garnie (modicam bursam suam), et en tira 40 sous,
qu’il offrit à cette femme. Elle promit, en les recevant,
de rester vingt jours sans commettre le péché
de fornication. Godefroi de Ponblanc voulait qu’elle
s’engageât, par serment, à cette pénitence, de quarante
jours; mais le duc ne permit pas qu’elle s’exposât
à un parjure, et il la quitta en l’exhortant à
persévérer dans la bonne voie. Cette prostituée, qui
se nommait Jehanne du Pont, tint sa promesse et
n’oublia pas les conseils de Charles de Blois. Elle
renonça pour toujours à la vie dissolue, et, avec
ses 40 sous, qui lui faisaient une petite dot, elle
épousa un garçon du pays, fils de Mathieu Ronce de
Pludilhan, et ne retomba plus dans le péché. (Hist.
de Bretagne, par Lobineau, t. II, p. 551.) On peut
induire, de cette aventure, que Jehanne du Pont,
comme femme de champs et de haies, ne gagnait pas
plus d’un ou deux sous par jour en attendant les
chalands sur le bord du chemin ainsi que les prostituées
étrangères dans la Judée et telles que nous
les représentent les saintes Écritures.
Les provinces occidentales, où les mœurs franques
s’étaient conservées dans toute leur impureté,
furent de tout temps le théâtre des plus grands débordements
de la Prostitution. Il y avait en Lorraine
et en Alsace comme ailleurs des coutumes et
[225]
des ordonnances qui punissaient les excès de la débauche,
surtout quand elle portait atteinte à la considération
du clergé, qui s’y livrait avec emportement;
mais, dans chaque ville, l’impudicité publique
trouva des institutions protectrices, s’il est permis
d’employer cette expression pour caractériser l’organisation
du vice au point de vue de la police édilitaire.
M. Rabutaux, après avoir décrit l’état de la
Prostitution dans les climats du midi, «où nous
voyons, dit-il, sans étonnement, des passions fougueuses
produire leur naturelle conséquence,» s’étonne
de ne pas rencontrer des mœurs plus sévères
dans les pays du nord: «Si nous portons notre attention,
ajoute-t-il, sur des pays qu’un ciel moins
brûlant semblait disposer à une conduite plus grave,
nous y retrouvons les mêmes excès, empreints peut-être
d’un caractère plus grossier.» L’explication de
ce fait doit ressortir, à notre avis, d’une cause historique
et de certaines conditions d’économie politique.
La population austrasienne, d’une part, avait
gardé ses habitudes de luxure féroce, et, d’autre
part, la législation nationale n’avait rien fait pour
dompter ces appétits brutaux, que l’abus des boissons
fermentées, de la bière ou cervoise, de l’hydromel
et des vins du Rhin, exaltait jusqu’au délire. La
Prostitution est donc admise comme loi de nécessité,
pour sauvegarder l’honneur des femmes mariées,
qui, malgré cela, ne se préservaient pas toujours
des outrages et des attentats de la sensualité masculine.
[226]
Le législateur ne recherche et ne condamne
que les méfaits qui découlent de cette source impure.
Ainsi le maquerellage est châtié plus rigoureusement
que le viol; mais toute fille et toute femme n’en a
pas moins le droit de se vendre elle-même, en se
soumettant toutefois à diverses formalités de police
municipale. La loi n’était sévère contre elles, que dans
le cas où elles se prostituaient aux gens d’église.
Charles III, duc de Lorraine, résume l’ancienne jurisprudence
dans son ordonnance du 12 janvier
1583, qui condamne au fouet «les femmes et
filles notoirement notées et diffamées de paillardise,
qui hantent les maisons des gens d’église, et chez
lesquelles ils se retirent pour en abuser.» Quant aux
règlements de la Prostitution légale, ils ne différaient
guère, quoique plus larges et moins austères,
de ceux que des raisons d’utilité, de morale et de
prudence, avaient fait adopter dans les grandes villes
du midi. Les femmes de mauvaise vie se trouvaient
comme retranchées de la société; elles habitaient
des quartiers et des rues infâmes; elles ne pouvaient
vaquer ailleurs à leur ignoble métier; elles portaient
un costume spécial ou une marque distinctive à
l’instar des Juifs; elles payaient une redevance au
fisc; elles se gouvernaient entre elles d’après les
statuts d’une association régulière, analogue à celles
des corps de métier.
A Strasbourg, des ordonnances municipales de
1409 et 1430 constatent que les femmes publiques
[227]
étaient reléguées dans les rues Bieckergass, Klappergass,
Greibengass, et derrière les murs de la
ville, où ces sortes de femmes avaient demeuré
de tout temps, disent les ordonnances, qui furent
renouvelées plusieurs fois dans le cours du quinzième
siècle. (Voy. dans les Mém. de l’Institut, Sciences
morales et politiques, les Observations de M. Koch
sur l’origine de la maladie vénérienne et sur son introduction
en Alsace et à Strasbourg.) On conserve,
en effet, dans les archives de cette ville, les règlements
et statuts accordés, le 24 mars 1455, par le
magistrat de Strasbourg, à la communauté des filles
établies dans la rue et maison dites Picken-gaff. Ces
règlements, composés de treize articles, renferment
les mesures de police auxquelles étaient soumis les
lieux de débauche. (Dict. des sciences médicales,
t. XLV, art. Prostitution.) Ces mauvais lieux se
multiplièrent tellement, que, vers la fin du quinzième
siècle, les officiers publics chargés de les surveiller
et d’y recueillir l’impôt lustral, en comptaient plus de
cinquante-sept dans six rues différentes; en outre, la
seule rue dite Undengassen renfermait dix-neuf de ces
maisons de paillardise; il y en avait une foule dans
la petite rue vis-à-vis du Kettener, et plusieurs derrière
la maison appelée Schnabelburg. Koch a eu
sous les yeux le rapport de police qui prouve que la
Prostitution légale comptait une centaine de bordiaux
dans la ville archiépiscopale de Strasbourg. Les entrepreneurs
de ces harems ouverts à la lubricité alsacienne
[228]
envoyaient leurs agents et leurs courtiers
jusque dans les pays étrangers pour y faire provision
de belles jeunes filles, qui louaient leur corps par
contrat, et qui, une fois prisonnières dans les clapiers
(klapper) de Strasbourg, se voyaient réduites
à une condition pire que l’esclavage. Enfin, vers le
commencement du seizième siècle, les maisons publiques
ne suffisaient plus pour contenir toutes les
femmes de vie dissolue, qui affluaient de tous côtés,
et qui, n’ayant pas de gîte, envahirent les clochers
de la cathédrale et des autres églises. «Pour ce qui
est des hirondelles ou ribaudes de la cathédrale, dit
une ordonnance de 1521, le magistrat arrête qu’on
les laissera encore quinze jours; après quoi, on leur
fera prêter serment d’abandonner la cathédrale et
autres églises et lieux saints. Il sera nommément enjoint
à celles qui voudront persister dans le libertinage
de se retirer au Rieberg (hors la ville, près de
la porte des Bouchers) et dans d’autres lieux qui
leur seront assignés.» Quinze ans plus tard, grâce
au protestantisme, qui, selon la remarquable expression
dont se sert M. Rabutaux, «rendit quelque
dignité à la vie privée,» il n’y avait plus dans tout
Strasbourg que deux maisons de Prostitution. A
cette époque, les femmes débauchées portaient encore
l’enseigne que le magistrat de Strasbourg leur
avait imposée en 1388: c’était un haut bonnet conique,
noir et blanc, posé par-dessus leur voile;
c’était, à la couleur près, ce hennin qu’Isabeau de
[229]
Bavière introduisit à la cour de France, au grand
scandale des prudes femmes. (Voy. les Observat. de
M. Koch, citées déjà.)
La Prostitution ne régnait pas avec moins de fureur
dans le pays Messin qu’en Alsace, et, à Metz
comme à Strasbourg, les moines et les ecclésiastiques
se mêlaient à ses désordres les plus scandaleux.
Dans un atour ou ordonnance des magistrats, de
l’année 1332, défense est faite aux gens d’église
«d’aller de nuc et de jor, en place commune, en
nosses, en danses et en autres leus qui ne sont mie
à dire.» Cet atour constate «la grant dissolucion qui
estoit en moines de Gorze, de Saint-Arnoul, de Saint-Clément,
de Saint-Martin, devant Mès, etc.,» lesquels
couraient les rues pendant la nuit, brisaient les
portes des maisons, fréquentaient les tavernes et les
lieux infâmes. Cet état de choses ne fit qu’empirer
vers la fin du seizième siècle, et le chroniqueur Philippe
de Vigneulles attribue ces monstrueux excès
à l’affluence des gens de guerre que la ville avait
pris à sa solde: «On ne voyoit par les rues, que ribaudes,
dit-il, et pource que les choses estoient si
fort diffamées,» on fit des huchements sévères (proclamations),
sur la pierre Bordelesse, en présence de
tous les Treze (magistrats de la ville). Cette pierre
Bordelesse devait être le pilori ou la justice de Metz.
Un de ces huchements, en date du 6 juillet 1493, est
rapporté dans la Chronique inédite de Philippe de Vigneulles:
«Que touttes femmes mariées, estant arrière
[230]
de leurs mairits, et les filles qui se pourveoient mal, allaissent
aux bordeaulx, comme en Anglemur (cul-de-sac
voisin des murs de la ville), et en les aultres rues
accoustumées où telles femmes et filles doibvent demeurer
au bas Mets, si elles ne se voulloient retireir
et vivre comme femmes de bien emprès de leurs
mairits. Et que nulz manans de Mets ne les soustenissent
et ne leur louaissent maisons en bonnes rues,
sus peine de quarante sols d’amende. Et que lesdites
femmes et filles ne se trouvaissent en nulles festes,
ne à nulles danses, aux nopces ne aux festes, qui se
feroient aval la cité, et que nulz ne les menaissent
danser, sur la somme de dix solz d’amende.»
Metz avait plusieurs rues affectées, depuis une
époque très-reculée, à la demeure des femmes dissolues,
et celles de ces rues qui n’ont pas disparu
avec la vieille ville gardent toujours leur destination
primitive. Près du cul-de-sac d’Anglemur, qui était
le principal foyer de la débauche urbaine, se trouvait
la rue des Bordaux ou du Bordel, qui a été fermée,
et qui aboutissait autrefois à la muraille d’enceinte,
parallèlement avec la rue Stancul. Celle-ci, qui
monte sur le versant oriental de la colline Sainte-Croix,
où était situé le palais des rois d’Austrasie,
est étroite, sombre et puante, comme toutes les rues
de son espèce. Les femmes de mauvaise vie s’engageaient,
moyennant certaine pension fixée par contrat,
à servir corporellement dans les maisons de tolérance,
que des ribaudes tenaient à bail et à ferme
[231]
sous la mainburnie des magistrats. Ainsi, toute fille
non mariée qui causait esclandre par ses mœurs dépravées,
était menée honteusement au bourdel, et livrée
aux ribaudes, qui trafiquaient de son corps, si
on ne leur payait une bonne rançon, supérieure à la
somme qu’elles croyaient pouvoir retirer de cette
nouvelle marchandise. Philippe de Vigneulles raconte,
à ce sujet, une touchante histoire qu’il date de 1491:
Une garse, allant à la cathédrale le jour des Rameaux,
rencontra son ami par amour, qui la prit avec lui et
l’emmena en son logis, au lieu de l’accompagner à
la messe. La chose fut sue, et les magistrats mandèrent
à leur tribunal l’auteur de ce scandale: on le
condamna seulement à 40 sous d’amende; mais la
fille, qu’on jugea remplie de malvaise voulenté, fut
enfermée dans une maison de débauche. «Son ami
s’en alla après, dit le naïf chroniqueur, et la racheta
des mains des ribaudes, en payant quinze solz, et
la ramena en son hostel, et vendist tous ses biens, et
s’en alla demourer dehors.» Un autre chroniqueur,
le doyen de Saint-Thiébaut, nous fournit un renseignement
précis sur le salaire de la Prostitution,
dans un temps, il est vrai, où l’abondance des femmes
communes ne faisait pas compensation à la
disette du blé. En 1420 on avait quatre femmes pour
un œuf, dit M. Émile Bégin (Histoire des sciences
dans le pays Messin, p. 311) d’après l’autorité de ce
chroniqueur: «car un œuf coustoit un gros, et une
femme quatre deniers; encores les a-on meilleur marchié.»
[232]
Le maquerellage ne formait pas néanmoins un
commerce peu lucratif, et malgré les dangers d’un
jugement criminel, malgré le fréquent exemple des
châtiments infligés aux maquerelles, il ne manquait
pas de honteuses femmes qui vivaient du trafic de
leurs propres enfants. «Eut une femme les oreilles
coupées, rapporte Philippe de Vigneulles (sous l’année
1480), pour tant qu’elle avoit fait beaucoup de
larrecins, et qu’elle avoit aussy mené une jeune fille
qu’elle avoit, qui estoit sa fille, au bourdel et mis à
honte.» Un siècle plus tard, pour le même fait, elle
eût subi la peine capitale.
L’histoire particulière de toutes les villes de la
Lorraine et de l’Alsace nous offre une multitude de
faits analogues qui démontrent l’unité de la jurisprudence
en matière de Prostitution. Nous consignons
seulement ici deux singularités relatives aux villes
de Saint-Dié et de Montbéliard. Dans cette dernière
ville, un ribaud, qui parcourait la ville en habits de
femme (1539), fut «appréhendé au corps, mis ès mains
du maître de la haute justice, pour estre placé sur
une eschelle, avec deux quenouilles ès costés, puis
fouetté et chassé à toujours des terres du seigneur
de Montbéliard.» Il est probable que ce ribaud faisait
un assez détestable usage de son déguisement
féminin. Nous avons vu qu’on arrêtait aussi à Paris
les ribaudes qui descendaient en habits d’homme dans
la rue; mais, ordinairement, on se contentait de confisquer
ces habits qui n’appartenaient pas à leur sexe.
[233]
A Saint-Dié, les femmes de mauvaise vie, qui habitaient
les rues Destord et Nozeville, pouvaient se
vanter d’être d’un tempérament très-prolifique, puisque
quatre villages voisins: Pierpont, Sainte-Hélène,
Bult et Padoux, appelés les villes mâleuses,
avaient été peuplés par leurs enfants mâles, qui s’y
mariaient, et qui devenaient sujets du chapitre de la
cathédrale de Saint-Dié, de même que les impurs
habitants de la basse rue de Destord et de Nozeville.
(Voy. dans les Arrêts de la Chambre royale de Metz,
un dénombrement fourni à la Chambre le 7 janvier
1681.)

Sommaire.—Influence des mœurs et des usages de l’Italie sur
la Provence et le Languedoc au moyen âge.—La Grant-Abbaye
de la rue de Comenge, à Toulouse.—Enseigne des pensionnaires
de la Grant-Abbaye.—Le quartier des Croses.—La
maison du Châtel-Vert.—Vicissitudes de la Prostitution légale
à Toulouse jusqu’à la fin du seizième siècle.—Hospice de
la Prostitution légale à Montpellier.—Les entrepreneurs du
Bourdeau de Montpellier.—Clare Panais.—Guillaume de la
Croix et les deux fils de Clare Panais.—La maison de Paullet
Dandréa.—Le bourdeou privilégié d’Avignon.—Statuts de
Jeanne de Naples.—De la Prostitution à Avignon antérieurement
aux statuts de 1347.—Etc., etc.
Il y a trois villes de France dans chacune desquelles
l’histoire de la Prostitution légale peut constater
[236]
l’existence d’un lieu de débauche établi en vertu
d’un privilége royal et affermé au profit de la cité.
Ces trois villes sont: Avignon, Toulouse et Montpellier;
où l’on trouve, dans l’intérêt des bonnes
mœurs, l’institution d’une abbaye obscène, que l’autorité
municipale administrait comme un établissement
d’utilité publique. Nous croyons que les annales
de ces trois établissements méritent d’être écrites
et rapprochées dans le même chapitre, pour faire
comprendre l’influence des mœurs et des usages de
l’Italie sur la Provence et le Languedoc au moyen
âge.
«De toute ancienneté, dit une ordonnance de
Louis XI que nous avons déjà citée, est de coustume
en notre pays de Languedoc et espéciallement
ès bonnes villes dudit pays, estre establie une maison
et demourance, au dehors des ditesvilles, pour
l’habitation et résidence des filles communes.» En
effet, à Toulouse, du temps de ses premiers comtes,
une maison de débauche avait été ouverte aux frais
de la ville, qui en tirait un gros revenu, et qui
assurait par là le repos des femmes honnêtes: cette
abbaye était située dans la rue de Comenge. L’hérésie
des Cathares, ou Albigeois, qui ne pouvaient
avoir de commerce charnel avec aucune femme,
contribua probablement à faire déchoir pour un
temps le règne de la Prostitution à Toulouse, et,
pour employer la belle expression dont se sert
M. Mignet en analysant la doctrine de ces austères
[237]
hérétiques (Journal des Savants, mai 1852), «le dieu
de la matière qui dominait sur les régions ténébreuses
des corps souillés» fut impuissant à défendre
son temple. Une ordonnance des capitouls, de l’an
1201, purifia la rue de Comenge, et transféra dans
le faubourg Saint-Cyprien l’établissement impur qui
la déshonorait. Ce mauvais lieu autorisé sembla encore
trop voisin du cœur de la ville; et on le transféra
plus tard hors des murs, près de la porte et dans
le quartier des Croses (voy. les Mém. de l’hist. du
Languedoc, de Catel, et l’Hist. de Toulouse, par Lafaille).
Si l’on eût fermé les portes de cette maison
publique, qu’on appelait la Grant-Abbaye et qui renfermait
non-seulement les ribaudes de la ville, mais
encore celles qu’amenait à Toulouse le caprice de
leur métier vagabond, les écoliers de l’Université et
les débauchés ou goliards du pays se fussent révoltés
pour maintenir ce qu’ils nommaient leurs antiques
priviléges. La Ville et l’Université avaient donc
d’intelligence fait les frais d’installation des fillas
communes, et partageaient, bono jure et justo titulo,
comme propriétaires, les profits de l’exploitation impudique.
Les prostituées, qui logeaient à demeure
ou de passage dans la Grant-Abbaye, étaient astreintes
à porter un chaperon blanc avec des cordons
blancs, pour enseigne de leur honteuse profession.
Elles ne se soumettaient qu’avec peine à ce règlement
somptuaire, qui les empêchait de se vêtir et
assegneir à leur plaisir: car ce chaperon, de couleur
[238]
éclatante, refusait de s’associer avec d’autres couleurs
à la mode et gênait toujours, dans les questions
de toilette, la communauté impure de la Grant-Abbaye.
Les magistrats cependant se montraient inflexibles
observateurs des anciennes ordonnances,
et punissaient rigoureusement toute contravention à
la règle des chaperons et cordons blancs.
Au mois de décembre 1389, le roi Charles VI,
visitant les bonnes villes de son royaume, fit son entrée
triomphante dans la capitale du Languedoc, où
il fut reçu avec pompe et où il résida quelques jours.
La population tout entière avait pris part aux fêtes
de cette entrée, et les recluses de la Grant-Abbaye
étaient allées à la rencontre du roi, avec des présents
de confitures, de vins et de fleurs, pour lui présenter
une supplique; elles lui demandaient, en don de
joyeux avénement, de les délivrer des injures, vitupères
et dommages que leur attiraient souvent les
chaperons blancs et les cordons blancs qu’une vieille
ordonnance attribuait à leur confrérie. Il paraîtrait
que le cri: Au chaperon blanc!... dans les rues de
Toulouse faisait sortir des maisons et des boutiques
une foule d’enfants qui poursuivaient avec des huées
la malencontreuse coiffure, en lui jetant de la boue et
des pierres. Les femmes de la Grant-Abbaye se plaignaient
de ce que les ordonnances sur leurs robes et
autres vestures avaient été faites par les capitouls,
sans la grâce et licence du roi; elles conjuraient donc
ce prince de les mettre hors d’une telle servitude.
[239]
L’affaire fut portée devant le conseil des requêtes et
débattue en présence de l’évêque de Noyon, du vicomte
de Melun et de messires Enguerrand Deudin
et Jean d’Estouteville. Charles VI, qui n’était pas
encore en démence, prit un intérêt tout paternel à la
supplication des filles de joie du Bourdel de la ville
de Toulouse, et, selon les termes de l’ordonnance
qu’il rendit en cette occasion, «désirans à chascun
faire grâces et tenir en franchise et liberté les habitans
conversans et demeurans en son royaume,» il
octroya aux suppliantes «que doresnavant elles et
leurs successeurs en ladite Abbaye portent et puissent
porter et vestir telles robes et chaperons et de
telles couleurs comme elles vouldront tenir et porter,
parmi ce qu’elles seront tenues de porter, entour
l’un de leurs bras, une ensaigne ou différence d’un
jarretier ou lisière de drap, d’autre couleur que la
robe qu’ils auront vestue ou vestiront, sans ce
qu’elles en soient ou puissent estre traitiées ne approchiées
pour ce en aucune amende; nonobstant
les ordonnances ou deffenses dessusdictes ne autres
quelconques.» Les sénéchal et viguier de Toulouse
et tous autres justiciers et officiers étaient chargés,
en conséquence, de protéger à l’avenir les dames
de l’Abbaye et de les faire jouir paisiblement et perpétuellement
de l’octroi de cette grâce, sans les molester
et sans souffrir qu’elles fussent molestées au
sujet de leur habillement (voy. les Ordonn. des rois
de France, t. VII, p. 327).
[240]
Les filles de la Grant-Abbaye eurent lieu de se
repentir d’avoir été exceptées, par grâce spéciale
du roi, de la servitude des chaperons et cordons
blancs. La population de Toulouse s’indigna de ce
que ces créatures s’étaient permis de quitter leur
enseigne, en vertu de l’ordonnance du mois de décembre
1389, et ce fut un mot d’ordre général d’injurier
et de maltraiter toutes celles qui se montreraient
par la ville sans chaperons et cordons blancs.
Le sénéchal et viguier de Toulouse ferma les yeux
sur les avanies qu’on leur faisait subir journellement,
et les justiciers et officiers royaux refusèrent
de recevoir leurs plaintes. Ne pouvant obtenir justice
et protection, les ribaudes, plutôt que de
renoncer au bénéfice de l’ordonnance qui les affranchissait
d’une servitude infamante, se tinrent renfermées
dans leur asile (hospitium) et ne s’exposèrent
plus à paraître en public avec la simple
jarretière ou lisière de drap d’autre couleur que
leur robe; mais elles ne se firent pas oublier de
leurs persécuteurs, qui venaient les tourmenter jusque
dans la Grant-Abbaye. Ces persécutions éloignèrent
successivement les habitués du lieu, lesquels
procuraient à la ville un revenu considérable
(commodum magnum), qui était consacré à des dépenses
d’utilité publique. Ce revenu baissa continuellement;
et le trésorier du Capitole, qui le percevait
chaque année sur les femmes communes et
sur leurs fermiers (arrendatoribus), alla se plaindre
[241]
aux capitouls, qui s’émurent de la perte d’une recette
si facile et si sûre. On fit une enquête, et l’on
apprit que les habitantes de l’Abbaye n’étaient plus
en sûreté chez elles; que des bandes de mauvais
garçons et de libertins (ribaldi, lenones et malevoli)
venaient jour et nuit fondre sur le couvent impur,
et y commettaient des désordres inouïs; que ces
méchants, qui ne craignaient ni Dieu, ni justice, et
qui semblaient inspirés du malin esprit (non verentes
Deum, neque justitiam, cum sint imbuti maligno
spiritu), brisaient les portes, pénétraient dans l’intérieur
de la maison, et, pour atteindre les malheureuses
qui se barricadaient dans leurs chambres,
démolissaient la muraille ou perçaient la toiture;
ensuite, ils maltraitaient, frappaient et outrageaient
de la manière la plus atroce (vituperose et atrociter)
les pauvres victimes de leur furieuse et cruelle
lubricité. Celles-ci, pour échapper à ces oppressions,
à ces violences, à ces injures, s’enfuyaient avec
leurs servantes et leurs domestiques (familiares), et
la Grant-Abbaye n’était plus qu’une ruine abandonnée.
Les capitouls essayaient inutilement de
porter remède au mal et de ramener les fugitives
au bercail, en leur promettant appui et protection;
l’habitude était prise, et, malgré les injonctions
des capitouls, malgré les efforts de la garde
urbaine, le siége de l’Abbaye recommençait sans
cesse avec les mêmes épisodes de violence et de
scandale. Les capitouls, en désespoir de cause,
[242]
s’adressèrent au roi pour le supplier de venir en
aide à leur pouvoir bravé et méconnu; Charles VII,
qui ne régnait que sur quelques provinces de son
royaume, parcourait alors le Languedoc pour y
réchauffer le zèle de ses partisans: il se rendit à
Toulouse, il examina dans son conseil la requête
des capitouls, il se souvint que son père avait octroyé
un don de joyeux avénement aux filles de
joie de Toulouse, et, par lettres patentes du 13 février
1425, il menaça de toute sa colère les auteurs
des excès qui s’étaient reproduits plusieurs fois
dans la Grant-Abbaye; il enjoignit à ses officiers de
protéger cet établissement, qu’il prenait sous sa
garde spéciale, et il fit planter devant la porte
dudit lieu des poteaux fleurdelisés (baculos cum floribus
lilii depictos), en signe de protection royale
(voy. le Recueil des Ordonnances des rois de France,
t. XIII, p. 75).
Les armes de France imposèrent peu aux perturbateurs,
qui renouvelaient de temps en temps leurs
attaques nocturnes contre l’Abbaye; ils se réservaient
ainsi l’excuse de n’avoir pas vu les fleurs
de lis, mais les pauvres pécheresses avaient beau
sonner la cloche d’alarme, appeler au secours et
demander merci, elles se trouvaient heureuses d’en
être quittes pour un viol. Enfin, elles abandonnèrent
tout à fait l’Abbaye qui les livrait sans défense
à leurs bourreaux; et elles rentrèrent dans le
quartier des Croses, où elles furent moins exposées
[243]
aux insolences des perturbateurs. Les capitouls
virent alors s’élever à l’ancien taux les revenus
obscènes de la ville, et cette grave considération
leur fit fermer les yeux sur l’envahissement de la
débauche publique dans l’enceinte des murailles de
Toulouse. Les fillas communes restèrent près d’un
siècle dans les ruelles voisines de la porte des Croses;
elles n’émigrèrent qu’en 1525, lorsque l’Université
s’empara des maisons qu’elles occupaient et
y construisit des bâtiments à son usage. On les relégua
de nouveau hors de la cité; et l’on acheta
pour elles, aux frais de la ville, une grande maison,
située hors des murs dans un lieu appelé le Pré-Moutardi,
appartenant à M. de Saint-Pol, maître
des requêtes. Cette maison de Prostitution, qui fut
surnommée le Château-Vert ou Châtel-Vert, n’avait
plus à redouter les assauts des mauvais garnements
et elle offrait une retraite paisible à ses pensionnaires,
qui travaillaient toujours de leur infâme
métier pour le compte de la ville; mais des règlements
sévères régissaient, à cette époque, l’institution
du Château-Vert. En 1557, la peste s’étant
déclarée à Toulouse, ordre avait été donné aux
femmes amoureuses de demeurer enfermées dans
leur fort et de n’y admettre personne jusqu’à la
cessation du fléau; quelques-unes désobéirent à cet
ordre de police et furent fouettées sur la place du
marché, les autres s’enfuirent et passèrent dans des
villes où la peste n’était pas. Elles reparurent à Toulouse
[244]
en 1560, quand l’amélioration de la santé
publique leur rouvrit les portes du Château-Vert.
Leur retour fut joyeusement fêté, mais les capitouls,
offensés des railleries que leur valait la direction
suprême de ce bourdel municipal, sachant aussi
qu’on les accusait d’acheter leurs robes avec l’impôt
du Château-Vert, cédèrent cet impôt aux hôpitaux
de la ville. Les hôpitaux n’en jouirent que six ans,
après lesquels ils rendirent à la ville un privilége
aussi onéreux: les bénéfices produits par l’exploitation
du Château-Vert se trouvaient absorbés, et
au delà, par les charges attachées aux redevances de
ce domaine déshonnête; car les hôpitaux étaient tenus,
en compensation, de recevoir et de soigner les
malades qui sortaient du Château-Vert. Or, depuis
six ans, ces malades avaient été plus nombreux que
jamais et le traitement vénérien coûtait fort cher.
Un conseil solennel s’assembla au Capitole; on y
agita la question qui préoccupait en ce temps-là
tous les magistrats du royaume: l’abolition radicale
de la Prostitution. Les notables de la cité assistaient
à cette réunion, et ils opinèrent la plupart pour la
suppression du Château-Vert; mais l’avis de l’abbé
de la Casedieu l’emporta de concert avec celui du
premier président du parlement, qui conseillait de
remettre cette suppression à un moment plus opportun.
En effet, il n’y avait pas de ville où la Prostitution
légale fût plus nécessaire qu’à Toulouse: les
[245]
mœurs y étaient fort relâchées, et les passions, sous
l’influence du climat, y éprouvaient des besoins
impérieux qu’il fallait satisfaire dans de certaines
limites. C’était le seul moyen d’éviter des scandales
et d’assurer la sécurité des femmes honnêtes. Deux
faits récents prouvaient que l’autorité des magistrats
de la ville ne pouvait exercer trop de surveillance
sur les filles de joie, que le Château-Vert ne
renfermait pas même assez strictement. En 1559,
on avait trouvé quatre de ces malheureuses dans le
couvent des Grands-Augustins; elles s’y étaient cachées
sous la robe monastique et elles servaient aux
débauches de toute la communauté. Trois de ces
faux moines de perdition furent pendus aux trois
portes du couvent, et un véritable moine, leur principal
complice, fut envoyé, les fers aux pieds, à son
évêque. En 1566, trois autres femmes de cette espèce
s’étant glissées dans le couvent des Béguines,
on les pendit sans forme de procès. Le Château-Vert
conserva donc encore ses attributions et ses
franchises jusqu’en 1587. Cette année-là, on remit
en vigueur les mesures de salubrité que réclamait
le règne d’une épidémie à Toulouse: le Château-Vert
fut évacué et l’on en scella les portes; mais les
prostituées, en sortant de leur repaire, ne changèrent
pas leur genre de vie, et en dépit de la peste, qui
ne les effrayait pas, elles exerçaient en plein champ
leur dangereuse industrie. Un des capitouls, que
la peur de la peste avait forcé de quitter son poste
[246]
et de se réfugier à la campagne, fut témoin des débauches
vagabondes qui avaient lieu autour de la
ville. Lorsque la peste eut cessé et que ce capitoul
eut repris ses fonctions, il raconta, dans le conseil
de ville, les honteux spectacles qu’il avait eus sous
les yeux dans les vignes et dans les champs qui
avaient remplacé le Château-Vert. On ne songea
point à rouvrir ce dernier, et l’on donna la chasse à
toutes les ribaudes qui avaient mené une vie si
désordonnée pendant la peste. Elles furent enfermées
dans les prisons de la ville, et on les attachait à des
tombereaux pour le nettoiement des rues (voy. les
Annales de la ville de Toulouse, par Lafaille, t. II,
p. 189, 199 et 280).
Telles furent les vicissitudes de la Prostitution
légale à Toulouse jusqu’à la fin du seizième siècle.
L’histoire des mauvais lieux de Montpellier ne remonte
pas à une date aussi reculée, du moins les
documents authentiques qui nous la racontent ne
sont pas antérieurs au quinzième siècle; mais, à
Montpellier comme à Toulouse, nous voyons que,
suivant l’usage établi de toute ancienneté dans les
principales villes du Languedoc, la Prostitution
légale avait son hospice hors des murs de la cité et
sous la garde des magistrats, qui percevaient un
impôt sur les femmes communes et sur leurs fermiers
privilégiés. Au commencement du quinzième siècle
ce privilége malhonnête appartenait à un nommé
Clare Panais, qui avait établi le centre de ses affaires
[247]
dans une maison située hors des murs de la ville en
un lieu appelé communément le Bourdeau: «C’est
là, disent les lettres patentes de Charles VIII qui
confirment l’ancien privilége de Panais, c’est là
que les filles communes et publicques ont accoustumé
de faire leur demourance et y résider de
jour et de nuit.» Clare Panais jouissait paisiblement
de son privilége et s’enrichissait, en payant des
droits énormes à la ville. Il avait deux fils, Aubert
et Guillaume, qu’il faisait élever avec beaucoup de
soin, et qui devaient être des jeunes gens de famille
accomplis. Cet excellent père mourut, et les deux
fils héritèrent du privilége attaché à la maison du
Bourdeau. Comme ce privilége rapportait beaucoup
d’argent, ils ne pensèrent pas à s’en dessaisir; mais
ils en cédèrent une partie à Guillaume de la Croix,
changeur, qui était d’une bonne noblesse de Montpellier,
et qui comptait parmi ses ancêtres le fameux
patron des pestiférés, saint Roch. Depuis lors, la propriété
indivise du Bourdeau demeura entre les
mains de Guillaume de la Croix et des deux frères
Panais, qui devinrent changeurs et banquiers, sans
cesser d’exploiter la ferme de la Prostitution légale
à Montpellier. Ils n’en furent pas plus déshonorés
que le conseil de ville, qui touchait les deniers de
l’impôt et qui avait la haute direction du Bourdeau.
Le mayeur et les magistrats qui composaient le
conseil voulurent empêcher les femmes de mauvaise
vie d’entrer dans la ville, même avec l’aiguillette sur
[248]
l’épaule, et, pour leur ôter tout prétexte de fréquenter
les étuves et les bains publics, où elles
exerçaient en cachette leur ignoble profession, ils
proposèrent aux fermiers de la débauche urbaine
de faire construire des étuves et des bains dans la
maison du Bourdeau. Aubert Panais et son frère
Guillaume, ainsi que leur associé Guillaume de la
Croix, consentirent à faire ces grandes et somptueuses
dépenses, qui avaient pour objet de rendre tout à
fait sédentaires les habitantes du Bourdeau; mais
ils profitèrent d’une si belle occasion, pour faire renouveler
et confirmer l’ancien privilége de cette
maison de tolérance, en vertu duquel, moyennant
la somme de cinq livres tournois payée annuellement
au roi ou à son lieutenant, «dès lors en avant,
nulles personnes, de quelque estat ou condicion
qu’ils soient ou feussent, ne pourroient faire ou
faire faire, en la part antique de Montpellier, nul
bourdeau, cabaret, hostellerie, ne autres estuves,
pour loger, retraire ne estuver lesdites filles communes,
sur peine de perdre et confisquer lesdites
maisons, bourdeau, cabaret ou estuves.» Le conseil
de ville, à qui l’on représenta l’instrument public
fait et passé entre les parties intéressées,
approuva de nouveau les clauses du contrat, et
augmenta les avantages des fermiers du Bourdeau.
Mais ceux-ci furent bientôt troublés dans la jouissance
de leur privilége: un des associés, Aubert
Panais, ayant cédé sa part à sa fille Jaquète, qui
[249]
l’apporta en dot à Jacques Bucelli, qu’elle épousa
vers 1465, un nommé Paullet Dandréa, habitant la
même ville, se crut autorisé à poursuivre la déchéance
du privilége des Panais. Il agissait ainsi
par envie ou autrement, et il était sans doute soutenu
par le recteur ou le bailli de la vieille ville. Il
commença donc par «retirer et accueillir lesdites
filles communes en une sienne maison située en
dedans de la ville en la partie de la Baillie.» Mais
l’existence d’un lieu de débauche à l’intérieur de la
cité était une infraction à tous les vieux us du Languedoc,
et les habitants du voisinage, prêtres et
bourgeois, se plaignirent aux consuls et protestèrent
contre l’audacieuse entreprise de Paullet Dandréa:
car ils voyaient «la chose estre au grant vitupere
et deshonneur et très-mauvais exemple des femmes
mariées, bourgeoises et autres, et de leurs filles et
servantes, et mesmement pour les scandales et inconvéniens
qui s’en pouvoient avenir.» Dandréa
tint bon; et, probablement avec l’appui secret de
certains débauchés qui trouvaient leur profit à l’établissement
de cette maison centrale, il continua d’y
tenir une cour amoureuse, et il y attira souvent les
dames du Bourdeau. Mais Guillaume de la Croix et
Guillaume Panais étaient riches et puissants, le premier
surtout; ils sommèrent le gouverneur de la
ville de faire fermer la maison de Dandréa, ouverte
contrairement aux ordonnances des rois et au privilége
de Clare Panais; ils ne rougirent pas de se déclarer
[250]
propriétaires et entrepreneurs du Bourdeau,
en portant plainte au roi. Charles VII envoyait justement
aux états du Languedoc, comme ses commissaires,
le sire de Montaigu, sénéchal de Limousin,
et maîtres Jean Hébert et François Halle, conseillers
du roi, qui se rendirent à Montpellier, où les états
s’assemblèrent au mois de décembre 1458. Ces trois
personnages furent saisis de l’affaire par une requête
que Guillaume de la Croix et ses associés
adressèrent aux états, qui ne dédaignèrent pas de
s’en occuper. Les commissaires du roi firent comparaître
les parties devant eux, et, après les avoir
entendues en présence du procureur de la ville,
défendirent à Dandréa, sous peine d’une amende
de dix marcs d’argent, de loger ni de recevoir dans
sa maison aucune femme publique. Le procureur
de la ville et le sénéchal de Beaucaire furent avertis
d’avoir l’œil et la main à l’exécution de cet arrêt,
conforme aux antiques coutumes de Montpellier.
Quant aux héritiers et successeurs de Clare Panais,
ils furent confirmés dans la jouissance de leur privilége
moyennant la redevance annuelle de cinq sols
tournois au profit du roi: «sans qu’aucun puisse
doresnavant édiffier ne establir autre maison ou lieu
publicque pour l’habitation desdites filles communes,
soit en la Rectorie ou Baillie de la ville ou ailleurs.»
Les associés, non satisfaits du gain de leur procès,
demandèrent au roi la confirmation de l’arrêt, en
1469, et cette confirmation leur fut accordée moyennant
[251]
finance. Vingt ans plus tard Guillaume de
la Croix était devenu conseiller du roi et trésorier
de ses guerres, mais il n’avait pas renoncé, pour
cela, à sa part d’entrepreneur du Bourdeau de Montpellier.
Comme il ne résidait pas habituellement à
Montpellier, et que Guillaume Panais ne s’occupait
plus guère de l’administration de leur propriété indivise,
il craignit de voir reparaître la concurrence
fâcheuse que Dandréa leur avait faite naguère:
«Doubtant que aucuns leur voulsissent, en la jouissance
des choses dessus déclarées, donner destourbier
et empeschement,» il sollicita de Charles VIII
la confirmation des lettres patentes qu’il avait obtenues
de Louis XI, et qui contenaient la teneur des
priviléges du Bourdeau de Montpellier. Charles VIII
s’empressa d’accorder à son amé et féal conseiller,
«pour le bien et interest de la chose publique,»
l’ordonnance qui maintenait ses droits sur la Prostitution
de Montpellier, ainsi que ceux de Guillaume
Panais et de Jaquète, femme de Jacques Bucelli,
tous habitants honorables de cette ville.
De même que Montpellier, Toulouse et les principales
villes du Languedoc et de la Provence, Avignon
avait aussi son bourdeou privilégié, établi et
constitué en vertu d’ordonnances royales et municipales,
et ce mauvais lieu, le plus célèbre de tous
ceux de la France à cause des statuts qui le régissaient,
semble avoir été organisé sur le modèle des
maisons publiques de l’Italie. L’authenticité de ces
[252]
statuts, que le savant médecin Astruc publia pour la
première fois en 1736 dans la première édition de
son traité De Morbis venereis, nous paraît incontestable,
malgré la spécieuse réfutation que M. Jules
Courtet a fait paraître dans la Revue archéologique
(2e année, 3e livraison). Selon M. Jules Courtet,
Astruc aurait été la dupe d’une plaisante mystification
et les statuts apocryphes, attribués à la reine
Jeanne de Naples, seraient l’œuvre de M. de Garcin
et de ses amis. C’est dans une note anonyme, écrite
à la main sur un exemplaire de la Cacomonade de
Linguet, que se trouve racontée l’histoire de cette
mystification, dans laquelle on fait intervenir comme
complice un Avignonnais, M. Commin, qui a vu le
jour dix ans après le livre d’Astruc. On sait ce que
vaut, en général, une note tracée sur la garde d’un
livre, et nous sommes surpris que la critique ait
fondé sur une pareille note la négation d’un fait
historique qui a traversé le dix-huitième siècle, ce
siècle sceptique et railleur, sans être démenti ni
même mis en doute. A coup sûr, si des mystificateurs
d’Avignon avaient pu s’amuser de la sorte aux dépens
d’un savant aussi renommé que l’était Astruc,
l’Europe entière eût retenti d’un immense éclat de
rire, et le traité De Morbis venereis, dans lequel la
pièce en question fut imprimée pour la première
fois, n’eût point échappé aux conséquences d’une
telle mystification; car le but de toute mystification
est la publicité satirique. Dans tous les cas, la facétie
[253]
de M. de Garcin et de ses amis eût transpiré, du
moins à Avignon, et Astruc se fût bien gardé de
conserver les statuts apocryphes dans la seconde
édition de son ouvrage, corrigée et augmentée, en
1740. Cet ouvrage, d’ailleurs, traduit en français
par Jault, et en plusieurs langues, aurait rencontré
plus d’un contradicteur sur le fameux chapitre du
bourdeou d’Avignon. Il est démontré, au contraire,
que la tradition locale à l’égard de cette maison de
Prostitution était constante et très-répandue lorsque
Astruc écrivit à une personne d’Avignon (vers 1725
ou 1730) pour obtenir, s’il était possible, une copie
de l’original des statuts de 1347.
M. Jules Courtet dit que cette copie a été faite
d’après un prétendu original que de malins faussaires
ont intercalé dans un beau manuscrit du
treizième et du quatorzième siècle, intitulé Statuta
et privilegia reipublicæ Avenionensis. Ce manuscrit,
qui a fait partie de la magnifique bibliothèque du
marquis de Cambis Velleron, est entré depuis au
Musée Calvet, où M. Jules Courtet a pu l’examiner.
Les Statuta prostibuli civitatis Avenionis, que M. Jules
Courtet regarde comme «une imitation, une
contrefaçon maladroite, non-seulement du style,
mais encore de l’écriture du quatorzième siècle,»
sont transcrits sur une feuille de parchemin, «dont
le second verso portait déjà la copie d’une bulle du
pape Grégoire, écriture du seizième siècle.» Cette
circonstance seule prouverait qu’on n’a voulu tromper
[254]
ici personne, et que l’ancien possesseur du manuscrit,
au seizième siècle sans doute, s’est ingéré
de le compléter lui-même en y ajoutant une copie
faite sur une autre plus ou moins fautive qu’il était
parvenu à se procurer. Le marquis de Cambis, qui
était d’Avignon et qui se trouvait ainsi à la source
de tous les bruits relatifs à cette affaire, n’eût pas
manqué de faire disparaître les feuillets qui déshonoraient
son manuscrit, au lieu de mentionner dans
son Catalogue les singuliers statuts «qui, dit-il
(page 465), sont en langue provençale telle qu’on
la parlait alors, et qui diffère peu de celle d’aujourd’hui.»
Il est probable que l’original existait ou
avait existé dans les archives du palais des papes
ou dans celles des comtes de Provence, et qu’un
curieux en avait fait une transcription à sa manière,
en altérant et modernisant le texte provençal, peut-être
même en traduisant dans cette langue le texte
latin. Ce qui paraît certain, c’est que l’existence de
ces statuts n’a jamais été douteuse; et que leur authenticité
est, d’ailleurs, confirmée par leur contexte,
qui est d’accord avec tout ce que nous savons sur le
régime de la Prostitution dans la Provence au
moyen âge. Quant à toutes les considérations morales
qui ont été mises en avant pour accuser de grossière
invraisemblance ces statuts donnés ou plutôt consentis
par une jeune reine, elles n’ont pas de valeur
pour quiconque étudie la police des mœurs à cette
époque: Jeanne de Naples, comtesse de Provence,
[255]
n’a rien innové en ce genre; elle n’a fait que sanctionner
de son autorité souveraine les mesures d’administration
urbaine que les magistrats d’Avignon
avaient prises dans l’intérêt de la chose publique, suivant
les motifs qui dictèrent à Charles VIII une ordonnance
et des lettres royaux sur une matière
analogue.
La dissertation de M. Jules Courtet nous aidera
du moins à montrer qu’antérieurement aux statuts
de 1347, la Prostitution s’était installée à la mode
italienne dans la ville papale d’Avignon. Au concile
de Vienne, tenu en 1311-1312, le pieux et savant
évêque de Mende, Guillaume Durandi, demanda la
répression sévère des excès de la débauche; il
s’indigna que le maréchal de la cour d’Avignon eût
pour tributaires les femmes communes et leurs scandaleux
complices; il voulait que l’on reléguât dans
les quartiers les moins fréquentés ces pestes publiques,
qui s’exposaient en foire aux portes des
églises, devant les hôtels des prélats et jusque sous
les murs du palais des papes; il voulait aussi que
le maréchal de la cour renonçât aux infâmes redevances
de la Prostitution (voy. Vitæ pap. Aven.,
publ. par Baluze, t. I, fo 810). Tous les Pères du
concile firent écho aux plaintes de l’évêque de
Mende, mais on ne s’arrêta point à un projet de réforme
qui aurait nui à bien des intérêts particuliers;
et le maréchal de la cour du pape continua de toucher
les revenus impurs de sa charge, qui avait
[256]
plus d’un rapport avec celle du roi des ribauds de
la cour de France. Les ribaudes se multipliaient et
se répandaient par toute la ville. «Il n’y avait
point, dit M. Jules Courtet, de lieu, quelque sacré
qu’il fût, à l’abri de leur incroyable audace.» Pétrarque,
qui résidait dans cette ville en 1326,
s’étonne du dérèglement des mœurs, que la translation
du saint-siége semblait avoir favorisé, comme
si le pape et les cardinaux avaient emmené de
Rome un cortége de femmes et d’hommes dépravés:
«Dans Rome la grande, dit Pétrarque, il n’y avait
que deux courtiers de débauche; il y en a onze
dans la petite ville d’Avignon.» (Cum in magna Roma
duo fuerint lenones, in parva Avenione sunt undecim.
Voy. les Œuvres latines de Pétrarque, édit. de
Bâle, fo 1184.) On comprend que la Prostitution,
livrée à elle-même, avait besoin d’un règlement,
semblable à celui qui en faisait une institution de
prévoyance et d’utilité publique dans les autres
villes de la Provence. La reine Jeanne, menacée
dans son royaume de Naples par l’armée de son
beau-frère Louis de Hongrie, venait de déposer sa
couronne teinte du sang de son mari; elle s’était
réfugiée sur les terres de France, et, après avoir
épousé en secondes noces son cousin et son amant
Louis de Tarente, elle se préparait à vendre au
pape le comtat d’Avignon pour acheter l’absolution
de son crime et l’appui de la papauté. Ce fut en présence
de ces graves événements, que la reine, qui
[257]
devait être à Aix, rédigea ou plutôt confirma les
statuts de la Prostitution légale à Avignon, comme
Charles VII et Louis XI confirmèrent ceux du même
genre pour les villes de Toulouse et de Montpellier.
Ces statuts (et le premier article en fait foi) furent
dressés par les consuls ou gouverneurs de la ville, dans
la forme ordinaire de tous les priviléges des mauvais
lieux, et la jeune reine ne fit que les signer, sans les
lire, sur la foi de son chancelier, qui les avait approuvés.
On peut avancer avec certitude, que le premier
à qui l’on concéda l’exploitation de ces priviléges,
étant le plus intéressé à les obtenir, n’épargna
pas l’argent, pour s’assurer ainsi l’approbation de la
reine, et pour faire reconnaître ses droits, avant la
cession du Comtat au saint-siége apostolique.
Nous ne pouvons que reproduire le texte provençal
des statuts tel qu’Astruc l’a donné, et nous regrettons
que M. Jules Courtet n’ait pas collationné
ce texte avec celui que renferme le manuscrit du
Musée Calvet, et qui est rempli de ratures et de
surcharges. Ce seul fait doit exclure toute idée de
supercherie, de la part du copiste ou du traducteur
de la pièce originale. Nous allons donc, sans y rien
changer, donner ce texte provençal, et nous le ferons
suivre d’une version française, plus littérale que
celle qui figure dans la traduction du livre d’Astruc,
et qui a été mal à propos répétée avec ses erreurs et
ses périphrases incolores.
I. L’an mil très cent quaranto et set, au hueit dau
[258]
mès d’avous, nostro bono Reino Jano a permès lou
Bourdeou dins Avignon; et vel ques toudos las fremos
debauchados non se tengon dins la Cioutat,
mai que sian fermados din lou Bourdeou, et que
per estre couneigudos, que portan uno agullietto
rougeou sus l’espallou de la man escairo.
II. Item. Se qualcuno a fach fauto et volgo continuâ
de mal faire, lou clavairé ou capitané das sergeans
la menara soutou lou bras per la Cioutat, lou
tambourin batten, embé l’agullieto rougeou sus l’espallo,
et la lougeora din lou Bordeou ambé las autros;
ly defendra de non si trouba foro per la villo à
peno das amarinos la premieiro vegado, et lou foué
et bandido la secundo fès.
III. Nostro bono Reino commando que lou Bourdeou
siego à la carriero dou Pont-Traucat, proché
lous Fraires Augoustins, jusqu’au Portau Peiré; et
que siego une porto d’au mesmo cousta, dou todos
las gens intraran, et sarrado à clau per garda que gis
de jouinesso non vejeoun las dondos sensou la permissieou
de l’abadesso ou baylouno, qué sara toudos
lous ans nommado per lous Consouls. La baylouno
gardara la clau, avertira la jouinessou de n’en
faire gis de rumour, ni d’aiglary eis fillios abandonnados;
autromen la mendro plagno que y ajo,
noun sortiran pas que lous sargeans noun lous menoun
en prison.
IV. La Reino vol que toudos lous samdès la baylouno
et un barbier deputat das Consouls visitoun
[259]
todos las fillios debauchados, que seran au Bourdeou;
et si sen trobo qualcuno qu’abia mal vengut
de paillardiso, que talos fillios sian separados et lougeados
à part, afin que non las counongeoun, per
evita lou mal que la jouinesso pourrié prenre.
V. Item. Sé sé trobo qualco fillio, que siego istado
impregnado din lou Bourdeou, la baylouno n’en
prendra gardo que l’enfan noun se perdo, et n’avertira
lous Consouls per pourvesi à l’enfan.
VI. Item. Que la baylouno noun perméttra à ges
d’amos d’intra dins lous Bourdeou lou jour Vendré
et Sandé san, ni lou benhoura jour de Pasques, à
peno d’estré cassado et d’avé lou foué.
VII. Item. La Reino vol que todos las fillios debauchados,
que seran au Bourdeou, noun sian eu
ges de disputo et jalousié; que noun se doranboun,
ne battoun, mai que sian como sorès; qué quand
qualco quarello arribo, que la baylouno las accordé
et que caduno s’en stié à ce que la baylouno n’en
jugeara.
VIII. Item. Se qualcuno a rauba, que la baylouno
fasso rendré lo larrecin à l’amiable; et se la
larrouno noun lou fai, que ly sian donnados las
amarinas per un sargean dins uno cambro, et la
secundo lon foué per lou bourreou de la Cioutat.
IX. Item. Que la baylouno noun dounara intrado
à gis de Jusious; que se per finesso se trobo que
qualcun sie intrat, et ago agu conneissencé de calcuno
[260]
dondo, que sia emprisonnat per avé lou foué
per touto la Cioutat.
I. L’an mil trois cent quarante-sept, au huit du
mois d’août, notre bonne reine Jeanne a permis le
bordel dans Avignon. Elle veut que toutes les femmes
débauchées ne se tiennent plus dans la cité, mais
qu’elles soient renfermées dans le bordel, et que,
pour être reconnues, elles portent une aiguillette
rouge sur l’épaule gauche.
II. Si quelque fille a fait une faute et veut continuer
de mal faire, le garde des clefs de la ville ou
le capitaine des sergents l’amènera, par-dessous le
bras, à travers la cité, tambour battant, avec l’aiguillette
rouge sur l’épaule, et la logera dans le
bordel avec les autres, et lui défendra de se trouver
dehors par la ville, à peine d’amende pour la première
fois, et du fouet et du bannissement pour la
seconde.
III. Notre bonne reine commande que le bordel
ait son siége dans la rue du Pont-Traucat, près les
frères Augustins, jusqu’à la porte Peiré, et qu’il y
ait une porte du même côté par où tout le monde
entrera, mais qui sera fermée à clef pour empêcher
qu’aucun jeune homme puisse voir les femmes sans
la permission de l’abbesse ou baillive, qui sera tous
les ans nommée par les consuls. La baillive gardera
la clef et avertira la jeunesse de ne faire aucun tumulte,
et de ne pas maltraiter les filles abandonnées;
autrement, à la moindre plainte qu’il y aurait contre
[261]
les auteurs du désordre, ils ne sortiraient de là que
pour être menés en prison par les sergents.
IV. La reine veut que tous les samedis la baillive
et un barbier, délégué par les consuls, visitent
toutes les filles débauchées qui seront au bordel; et,
s’il s’en trouve quelqu’une qui ait mal, venu de paillardise,
que cette fille soit séparée des autres et
logée à part, afin qu’on ne l’approche pas, pour
éviter le mal que la jeunesse pourrait prendre.
V. Item, s’il advenait que quelque fille devînt
grosse dans le bordel, la baillive prendra garde que
l’enfant ne soit détruit et avertira les consuls, qui
pourvoieront à la naissance de cet enfant.
VI. Item, la baillive ne permettra à aucun
homme d’entrer dans le bordel le jour du saint Vendredi,
le jour du Samedi saint et le bienheureux
jour de Pâques, sous peine d’être cassée et d’avoir
le fouet.
VII. Item, la reine veut que toutes les filles débauchées
qui seront au bordel ne soient en cas de
dispute et de jalousie; qu’elles ne se volent, ni ne
se battent, mais qu’elles vivent comme sœurs; si
une querelle arrive, la baillive doit les accorder
entre elles, et chacune s’en tienne à ce que la baillive
décidera.
VIII. Que si quelqu’une a dérobé, la baillive lui
fasse rendre à l’amiable l’objet volé, et si la voleuse
refuse de faire cette restitution, qu’elle soit fustigée
par un sergent dans une chambre, et, en cas de récidive
[262]
qu’elle ait le fouet, de la main du bourreau
de la ville.
IX. Item, que la baillive ne donna accès dans le
bordel à aucun juif, et s’il se trouve que quelque
juif y soit entré par ruse et y ait connu quelque
femme, qu’il soit emprisonné pour avoir le fouet
par toute la cité.
Astruc, en rapportant ces statuts tels qu’on les lui
avait envoyés d’Avignon, dit qu’ils avaient été copiés
sur les registres de Me Tamarin, notaire et
tabellion apostolique en 1392; mais il ne put avoir
aucun renseignement sur ce Tamarin et sur son manuscrit,
à l’exception d’un extrait des mêmes registres,
constatant qu’un juif de Carpentras, nommé
Doupedo, fut fouetté publiquement à Avignon en
1408, pour être entré en secret dans le Bordeou et y
avoir connu une des filles. Un fait analogue est
relaté dans l’Appendix Marcæ-Hispanicæ, où le savant
Pierre de Marca cite un acte de l’an 1024,
dans lequel il est dit qu’un juif, nommé Isaac, eut
ses biens confisqués, et fut puni corporellement,
pour avoir commis adultère avec une chrétienne.
Astruc, qui a recueilli ce précieux détail de mœurs
(Traité des maladies vénér., t. I, p. 210), ajoute peu
de réflexions aux statuts de la reine Jeanne; il se
borne, suivant son système, à prétendre que le mal
vengut de paillardiso ne pouvait être une maladie
vénérienne. M. Jules Courtet dit que «cet article,
qui fait douter le grave Merlin de l’authenticité des
[263]
statuts, suffirait aux yeux de beaucoup de gens
pour invalider le prétendu original.» Nous verrons,
en faisant l’histoire de la Prostitution en Angleterre,
que les statuts des mauvais lieux de Londres défendaient,
en 1430, de garder dans une maison
publique «aucune femme infectée du mal de l’arsure.»
En résumé, et après un sérieux examen de
la question, nous croyons que, si nous ne possédons
pas le texte original des statuts du Bordeou d’Avignon,
nous en avons du moins les règlements, qui
semblent conformes à ceux que la tolérance municipale
avait mis en vigueur dans les villes du Midi.
N’oublions pas de remarquer, en passant, que le
vieux refrain populaire
Sur le pont d’Avignon,
Tout le monde y passe,
pourrait bien être une allusion joyeuse à la mauvaise
renommée de la rue du Pont-Traucatou-Troué.
Cette rue avait des étuves si malfamées, qu’un
synode, tenu à Avignon le 17 octobre 1441, défendit
aux ecclésiastiques et aux hommes mariés, de
fréquenter ce lieu de Prostitution, considerantes quod
stuphæ Pontis-Trouati præsentis civitatis sint prostibulosæ
et in eis meretricia prostibularia publice et
manifeste committantur. Ceux qui osaient braver
cette défense et l’excommunication que le synode y
attachait, étaient tenus de payer, au profit de l’évêque,
dix marcs d’argent, si on les surprenait
[264]
sortant de ces étuves en plein jour, et vingt marcs
s’ils y allaient la nuit. Le viguier d’Avignon, Jean
Blanchier, fut chargé de faire exécuter ces statuts
synodaux et de veiller à la police intérieure des
étuves publiques (voy. le Thesaurus novus anecdotorum
de Martenne, t. IV, col. 585). Peu d’années
après, en 1448, le Conseil de ville s’occupa aussi
des étuves de la Servelerie, qui n’étaient que des
repaires de Prostitution comme les stuphæ Pontis-Trouati.
M. Jules Courtet cite encore, d’après les
petites archives de la mairie d’Avignon (Ier vol. des
Délibérations du Conseil, séance du 4 novembre
1372), une mesure de police relative aux femmes
dissolues de cette ville. Le viguier fit crier, à son de
trompe, dans les carrefours, qu’aucune de ces malheureuses
ne se hasardât point à porter en public un
manteau ni un voile, ni un chapelet d’ambre, ni un
anneau d’or, sous peine d’une amende et de confiscation
des objets. Vers le même temps, on faisait un
cri et proclamation semblable dans la ville de Paris,
et cette injonction aux filles publiques de se conformer
aux lois somptuaires prouve suffisamment
qu’elles ne pouvaient se départir de leur caractère
infâme, une fois qu’elles avaient fait profession dans
une abbaye d’impureté. Nous retrouverons plus loin,
à Naples, dans les usages de la débauche publique,
l’origine traditionnelle du Bordeou d’Avignon, cette
étrange fondation d’une jeune reine belle et galante.
Au reste, si les abbayes obscènes étaient des établissements
[265]
de fondation royale ou municipale dans
la plupart des villes de la Provence, les femmes
perdues qui se consacraient à la Prostitution n’avaient
nulle part l’autorisation d’exercer leur honteuse
industrie hors de l’asile qui leur était assigné.
On considérait partout comme une enfreinte aux
règlements de police leur présence dans les rues
avec le costume des femmes de bien. Un article des
statuts d’Arles, dressés en 1454, nous prouve que
ces règlements de police, en usage dans cette ville,
ne différaient pas de ceux que nous voyons établis
à Avignon vers la même époque.
Voici l’article des statuts, rapporté par Millin dans
son Essai sur la langue et la littérature provençales:
«Toutes femmes publiques, putan, catoniere ou
tenen malo vido et inhonesto, demourant en carriere
de las femmes de ben, que porte mantel, vel en la
testa, subre son col ou espalles, hoplecho, garlandes
ou annel d’or ou d’argent, sie condamnade, per
chascune cause, en 50 sols coronas et en perdamen
de las causas susdiches.» Ce passage de la législature
arlésienne nous paraît constater que l’on distinguait,
des femmes de mauvaise vie reconnues
(putan), et en quelque sorte patentées, les coureuses
de nuit (catoniere) et les débauchées qui logeaient
dans des rues honnêtes. Quant aux objets de toilette
qu’elles ne devaient pas porter, ce sont les mêmes
qui étaient interdits aux fillios abandonnados d’Avignon.
[266]
Nous n’avons pas trouvé de document qui nous
permette d’estimer le prix courant du Bourdeou de la
reine Jeanne, mais on est fondé à croire que ce prix
était très-modique dans une province où, suivant
le proverbe populaire, la meilleure femme ne valait
pas quinze sous: Qui perde sa fremo eme quinze
sous es grand dommagi de l’argent. Les proverbes
sont, il est vrai, si hostiles aux femmes dans tous
les pays du monde, qu’il faut bien supposer que
ces proverbes se font sans elles: Ombre d’home vau
cen fremos, disait-on à Arles ainsi qu’à Avignon.

Sommaire.—La Prostitution légale et la Prostitution libre.—De
l’influence de la Chevalerie sur l’honnêteté publique.—L’Enfant
d’honneur de la Dame des Belles-Cousines.—Le vrai chevalier,
destructeur de la corruption.—L’envoi de la Camise.—Le
châtelain de Coucy et la dame de Fayel.—Principalia amoris
præcepta de maître André, chapelain de Louis VII.—Les Cours
d’amour et les Parlements de gentillesse.—La jurisprudence
amoureuse.—Arrêts d’amour.—Le maire des Bois-Verts, le
baillif de Joye, le viguier d’amours, etc.—Les Jongleurs, etc.
Nous avons constaté, en étudiant les moralistes
et les poëtes du moyen âge, que la Prostitution
légale était en horreur au peuple, à la bourgeoisie
et à la noblesse, qui la considéraient comme une
souillure secrète de la société, et qui d’un commun
accord l’empêchaient de se produire au grand jour
[268]
et d’affliger par un scandale éclatant les yeux, les
oreilles et la pensée des honnêtes gens. Cette Prostitution
n’en était pas moins solidement établie sur
une large échelle, pour l’usage d’une classe dangereuse
et suspecte, qui vivait en dehors de la décence
publique, et qui se composait des ribauds et des
débauchés de toutes les catégories, depuis les vagabonds
ou batteurs d’estrade, depuis les truands et
les gueux, jusqu’aux jongleurs, aux ménétriers et
aux mauvais garçons. Il fallait que chaque ville
offrît au moins un asile de débauche à cette population
flottante, qui se renouvelait sans cesse, et qui
échappait constamment à l’action régulière de la police
municipale. C’était une sauvegarde permanente
contre les entreprises de ces enfants perdus, comme
on les appelait partout, redoutables aux femmes de
bien et à leurs maris, mais heureusement détournés
de leurs méchants instincts de rapt et de violence,
quand on leur permettait de hanter la compagnie
des folles femmes et de se divertir avec elles. Il y
avait ainsi beaucoup de ces créatures qui couraient
le pays accompagnées de leurs goliards et de leurs
amants, et ceux-ci faisaient bombance, aux dépens
du trafic obscène qui s’exerçait sous leurs yeux,
dans les cours de ribaudie où ils s’arrêtaient avec
leurs infâmes compagnes; mais on peut dire que ces
impuretés ne transpiraient pas hors des lieux qui en
étaient le théâtre ordinaire et ce qui se passait dans
le mystère du bordeou provençal ou du clapier normand
[269]
ne laissait aucune trace de désordre dans les
mœurs de la famille et de la cité.
Ces mœurs n’en étaient pas souvent plus austères;
mais, si relâchées qu’elles fussent, elles n’avaient
pas de rapport intime ni de contact apparent avec
les choses de la Prostitution légale, car les femmes
communes qui étaient au service de cette Prostitution,
ne communiquant qu’avec certains hommes
malfamés qui participaient à la honte d’une pareille
vie: ribaudes et ribauds, formaient une sorte de corporation
impudique retranchée du sein de la société.
Celle-ci, toutefois, en se tenant à l’écart de la ribauderie,
n’en menait pas une conduite plus exemplaire
et ne se faisait pas faute de donner satisfaction au
vice de l’incontinence; la fornication et l’adultère
entraient, d’ailleurs, dans toutes les maisons et y
étaient les bienvenus: le seigneur dans son château
avait un sérail de servantes et de pages; le
moine dans son couvent cachait les plus criminelles
accointances; le marchand dans sa boutique convoitait
la femme de son voisin; le pauvre ouvrier ou
mécanique ne se refusait pas des plaisirs qui ne lui
coûtaient rien; mais, nulle part, au milieu de ce débordement
d’immoralité, la Prostitution proprement
dite n’exerçait une influence pernicieuse, et ne venait
en aide à la corruption générale; elle aurait plutôt
attiré à elle les éléments impurs de la vie sociale, si
elle n’eût pas été frappée d’un sceau de réprobation,
si ses misérables sujettes eussent conservé quelque
[270]
prestige aux yeux du monde, si l’opinion n’eût pas
flétri du même déshonneur les hommes qui osaient
pénétrer dans la retraite des folles femmes. La Prostitution
ainsi constituée manquait donc en partie son
but fondamental, puisqu’elle ne servait pas à épurer
les mœurs et qu’elle laissait subsister hors de son
domaine de tolérance une autre Prostitution libre,
plus active, plus audacieuse, plus épidémique en
un mot. On peut dire, nous le répétons, que pendant
plusieurs siècles en France ces deux espèces
de Prostitution n’eurent entre elles aucun lien, aucune
relation, même indirecte, aucune similitude
dans les actes et dans les personnes. L’autorité
civile ne s’inquiétait, ne s’occupait que d’une seule
de ces Prostitutions; quant à l’autre, qui n’avait ni
livrée, ni enseigne, ni maisons spéciales, ni règlements
de police, elle se promenait à visage découvert
dans tous les rangs sociaux, et elle répandait
son venin à travers les généreuses et brillantes
institutions de la chevalerie. Ce fut surtout pour
réformer les mœurs, pour leur imposer un frein
salutaire, pour les retremper à la source de l’honneur
et de la vertu, qu’un sage législateur, un philosophe
inconnu, un grand politique créa la chevalerie,
qui vint à propos, au milieu d’une société
dépravée et gangrenée, pour réhabiliter l’esprit en
face de la matière et pour porter un défi, en quelque
sorte, à toutes les Prostitutions de l’âme et du corps.
La chevalerie n’était qu’une forme attrayante, donnée
[271]
à la philosophie, à la morale et à la religion;
elle protégea, elle sauva l’honnêteté publique, malgré
les inévitables excès des croisades et les influences
démoralisatrices de la poésie des jongleurs.
Nous ne croyons pas que la chevalerie ait été
encore appréciée à ce point de vue, comme l’ennemie
implacable de toute espèce de Prostitution,
comme la sauvegarde des mœurs: elle opposa les
nobles et pures inspirations de l’amour métaphysique
aux grossières et avilissantes tyrannies de
l’amour matériel; elle créa les Cours d’amour, ces
gracieux tribunaux de galanterie et de gentillesse,
pour abolir les cours de ribaudie; elle dompta et
pacifia les passions avec les sens; elle fonda la
vertu sur le respect de soi et des autres; elle fit,
pour ainsi dire, un piédestal de tendre admiration
et un trône d’honneur, pour y placer la femme.
C’est là évidemment le principe de la chevalerie:
elle affranchit un sexe que la Prostitution avait soumis
à la plus dégradante servitude. Ici, la femme
était esclave et humiliée de son rôle indigne; là,
elle est reine, et sa souveraineté repose encore sur
l’amour; mais ce n’est plus l’amour charnel, dont
les coupables jouissances étouffent l’instinct du bien
et prédisposent le cœur à tous les vices; c’est l’amour
parfait, c’est l’amour héroïque, qui prend sa
source dans les plus beaux sentiments et qui s’exalte
par l’imagination en se dégageant des entraves de
la nature physique. Les premières leçons que recevait
[272]
un page, varlet ou damoiseau, qui se destinait
au métier de la chevalerie, regardaient uniquement
l’amour de Dieu et des dames, c’est-à-dire, suivant
Lacurne de Sainte-Palaye, la religion et la galanterie.
C’étaient les dames elles-mêmes qui se chargeaient
ordinairement d’apprendre aux jeunes gens
le catéchisme et l’art d’aimer. «Il semble, dit le savant
auteur des Mémoires sur l’ancienne chevalerie, il
semble qu’on ne pouvoit, dans ces siècles ignorants
et grossiers, présenter aux hommes la religion sous
une forme assez matérielle pour la mettre à leur portée,
ni leur donner en même temps une idée de l’amour
assez pure, assez métaphysique, pour prévenir
les désordres et les excès dont étoit capable une nation
qui conservoit partout le caractère impétueux
qu’elle montroit à la guerre.» Lacurne de Sainte-Palaye
n’a fait qu’entrevoir les causes philosophiques
de l’institution de la chevalerie, qui fut, dans
l’origine, une barrière morale et religieuse contre
l’athéisme et la Prostitution.
Pour se rendre bien compte de l’esprit de la chevalerie,
il faut lire, dans la charmante Histoire et plaisante
chronique du petit Jehan de Saintré, les admonitions
que lui adresse la Dame des belles cousines,
lorsqu’il fut attaché au service de cette princesse en
qualité d’enfant d’honneur et de page. La dame, qui
parle latin comme un Père de l’Église, lui fait une
édifiante instruction sur les sept péchés mortels.
Voici en quels termes elle lui conseille d’éviter le
[273]
péché de luxure: «Vraiement, mon amy, lui dit-elle,
ce péchié est, au cueur du vray amant, bien
estaint; car tant sont grandes les doubtes (craintes)
que sa dame n’en preigne desplaisir, qu’un seul
deshonneste penser n’en est luy; dont, par ainsi, il
ensuit le dict de saint Augustin qui dict ainsi:
Luxuriam fugias, ne vili nomine fias;
Carni non credas, ne Christum nomine ledas.
C’est à dire, mon amy: Fuy luxure, à ce que tu ne
sois brouillé en deshonneste renommée; aussi, ne
croys point ta chair, affin que par péchié tu ne
blesses Jesus Christ. Et, à ce propos, encores se accorde
saint Pierre l’apostre, en sa première épistre
où il dict: Obsecro vos, tamquam advenas et peregrinos,
abstinere vos à carnalibus desideriis qui militant
adversus animam. C’est à dire, mon amy: Je vous
prie, comme estrangers et pellerins, que vous vous
absteniez des delits carnels, car ils bataillent jour et
nuyt à l’encontre de l’âme. Et, à ce propos, dict
encore le philosophe:
Sex perdunt vere homines in muliere:
Ingenium, mores, animam, vim, lumina, vocem.
C’est à dire, mon amy, que homme qui hante les
folles femmes pert six choses, dont la première est
que pert l’âme, la seconde l’engin, la troisième les
bonnes mœurs, la quatriesme la force, la cinquiesme
sa clarté, et la sixiesme sa voix. Et, pour ce, mon
amy, fuy ce péchié et toutes ses circonstances.» La
[274]
dame des Belles Cousines termine son sermon sur la
luxure, par cette citation empruntée à Boëce: «Luxuria
est ardor in accessu, fœdor in recessu, brevis
delectatio corporis et animæ destinctio. C’est à dire,
mon amy, que luxure est ardeur à l’assembler,
puantise au despartir, briefve delectation du corps,
et de l’âme destruction.» Il est certain qu’Antoine
de la Salle, en écrivant l’Histoire du petit Jehan de
Saintré, pour l’amusement de la cour de Charles VII,
a puisé les matériaux de cette histoire dans une
chronique de la cour du roi Jean et a tiré d’un livre
de chevalerie beaucoup plus ancien les enseignements
moraux de la dame des Belles Cousines.
Les cérémonies de la création d’un chevalier
prouvent encore mieux, que la chevalerie était instituée
pour corriger les mœurs et abolir la Prostitution.
Le novice se préparait à entrer dans l’ordre de
la chevalerie, par des pratiques d’austérité et de dévotion,
qui auraient pu introduire un moine dans un
ordre monastique. C’étaient des jeûnes rigoureux,
des nuits passées en prières dans une église, des
sermons dogmatiques sur les principaux articles de
la foi et de la morale chrétiennes, des bains et des
ablutions, qui figuraient la pureté nécessaire dans
l’état de la chevalerie, des habits blancs, qui étaient
le symbole de cette pureté chevaleresque; c’était
enfin une promesse solennelle, au pied des autels,
de mener une bonne vie devant Dieu et devant les
hommes. «Celuy qui veut entrer en un ordre, soit
[275]
en religion, ou en mariage, ou en chevalerie, ou en
quelque estat que ce soit, dit un des personnages
du roman de Perceforest, il doit premièrement son
cœur et sa conscience nettoyer et purger de tous
vices et remplir et aorner de toutes vertus.» Les
nombreux écrits, en vers et en prose, qui traitent des
mœurs de la chevalerie, répètent à l’envi que le vrai
chevalier doit être le destructeur de la corruption. La
chevalerie était donc une sorte de clergie, qui prêchait
d’exemple pour rendre le peuple meilleur et
vertueux, pour maintenir le bon ordre dans la société
et pour en expulser tous les vices: «Nul ne
doit estre reçu à la dignité de chevalier, dit le respectable
chevalier de la Tour, dans son Guidon des
guerres, si on ne scet qu’il ayme le bien du royaume
et du commun, et qu’il soit bon et expert en l’ouvrage
batailleux, et qu’il veuille, suivant les commandements
du prince, apaiser les discords du
peuple, et soy combattre pour oster, à son povoir,
tout ce qu’il scet empescher le bien commun.» La
Prostitution ne trouva jamais grâce devant la chevalerie,
qui ne parvint pas néanmoins à la détruire.
Cependant la chevalerie n’employait pas de moyen
plus efficace que l’amour des dames, pour exciter au
bien commun la jeune noblesse, qui, dès l’âge le
plus tendre, avait été dressée à cette école de galanterie:
«Les préceptes d’amour, dit Lacurne de
Sainte-Palaye, répandoient dans le commerce des
dames ces considérations et ces égards respectueux,
[276]
qui, n’ayant jamais été effacés de l’esprit des François,
ont toujours fait un des caractères distinctifs
de notre nation. Les instructions que ces jeunes
gens recevoient, par rapport à la décence, aux
mœurs, à la vertu, étoient continuellement soutenues
par les exemples des dames et des chevaliers
qu’ils servoient.» Le premier acte de chevalerie
était le choix d’une dame ou damoiselle à aimer et
à servir; le page, varlet ou damoiseau, commençait
ainsi son devoir de courtoisie, et c’était à cette dame
de ses pensées qu’il rapportait dès lors toutes ses
emprises et tous ses faits d’armes. C’était pour se
faire distinguer par elle et pour se faire aimer aussi,
qu’il se montrait preux et vaillant, honnête et courtois,
loyal et vertueux. Le nom et les couleurs de
cette dame lui tenaient lieu de talisman dans les
circonstances les plus difficiles de sa vie; il l’invoquait
comme une sainte patronne au milieu des
combats, et, s’il était frappé à mort, il exhalait son
dernier soupir en pensant à elle et en l’honorant.
Rien ne ressemblait moins à l’amour matériel, que
cette profonde et délicate dévotion amoureuse à
l’égard d’une seule dame, qui souvent ne récompensait
pas même d’un chaste baiser un sentiment si
exalté; mais ce sentiment, pur et ardent à la fois,
trouvait en soi une force invincible qui s’augmentait
sans cesse par l’idée fixe et par l’extase: il s’attachait,
en quelque sorte, comme une ombre, à la femme
qui l’avait inspiré et qui n’y répondait pas toujours,
[277]
et il persistait à travers les temps et les distances,
sans s’affaiblir et sans s’arrêter, à moins que son
objet n’eût cessé d’être digne de lui. «Plus vous me
témoignerez d’amour et plus vous me verrez fidèle!»
disait à sa dame Albert de Gapensac, qui fut à la fois
troubadour et chevalier. Dans le langage de la chevalerie,
on se souhaitait mutuellement, entre écuyers
et chevaliers, les bonnes grâces et les faveurs de sa
dame: ces bonnes grâces, d’ordinaire, se bornaient
à un sourire, à un doux regard, à un simple baiser;
ces faveurs, au don d’une coiffe, d’une manche,
d’un ruban, à l’envoi d’une camise (chemise). Olivier
de la Marche termine, par un souhait de cette
espèce, une lettre qu’il écrit au maître d’hôtel du
duc de Bretagne: «Je prie Dieu qu’il vous doint
(donne) joye de vostre dame et ce que vous desirez»
(liv. II de ses Mémoires). C’est dans le même sens,
que la reine dit à Jehan de Saintré: «Dieu vous
doint joye de la chose que plus desirez!» Ce que
Jehan de Saintré désirait le plus, c’était de rester
seul avec sa maîtresse: «Là furent les baisiers donnés
et baisiers rendus, tant qu’ilz ne s’en pouvoient
saouller, et demandes et responses telles qu’amours
vouloient et commandoient. Et en celle tres plaisante
joye furent jusques à ce que force leur fut de
partir.» Malgré ces baisers donnés et rendus, malgré
ces longs entretiens d’amour, jamais Jehan de
Saintré et sa dame ne dépassèrent les limites de la
vraie courtoisie et ne se fourvoyèrent dans le bourbier
[278]
de l’incontinence. On eût dit que les amants prenaient
plaisir à surexciter leurs désirs, afin de
prouver jusqu’à quel point ils pouvaient les combattre
ensuite et les vaincre; en cherchant le péril
et en s’y exposant avec une sorte d’orgueil, on peut
croire qu’ils y succombaient quelquefois. Cet amour
presque mystique, qui se permettait tout, excepté
la dernière expression de ses vœux les plus brûlants,
ne craignait pas de satisfaire dans une certaine mesure
ses appétits sensuels; on croirait voir souvent
ces assauts, que le démon de la chair livrait aux
saints et aux saintes, dans la légende, et qui ne
servaient qu’à leur procurer une victoire nouvelle,
après de nouveaux efforts que soutenait la pensée
du Rédempteur ou de sa divine Mère. Les chevaliers
et leurs dames ne fuyaient pas la tentation,
parce qu’ils se plaisaient à en triompher, et tout en
imposant à leurs sens une barrière infranchissable
au delà de l’amour décent et vertueux, ils ne se refusaient
pas quelques compensations de libertinage
métaphysique. Ainsi, le fameux châtelain de Coucy,
étant à la croisade, envoya une chemise, qu’il avait
portée, à la dame de Fayel, qui aimait de pur amour
ce beau chevalier, quoiqu’elle fût en puissance de
mari et qu’elle n’eût garde d’être adultère de fait,
sinon d’intention. Cette chemise, la dame s’en revêtait
pendant la nuit, lorsque l’amour l’empêchait de
dormir, et elle s’imaginait, en touchant le linge, sentir
sur sa chair nue les baisers de son amant. Ce sont les
[279]
paroles mêmes de la dame de Fayel dans les chansons
du châtelain de Coucy:
Sa chemis qu’ot vestue
M’envoia pour embracier.
La nuit, quant s’amour m’argue,
La met delez moi couchier,
Toute la nuit à ma char, nue,
Por mes mals assolacier.
Tout n’était qu’amour dans la chevalerie, mais
amour loyal et discret, dont maître André, chapelain
de Louis VII a rédigé le code, sous le titre de
Principalia amoris præcepta. Il n’est pas une seule
des lois de ce code, qui n’ait été écrite sous l’inspiration
des plus nobles sentiments, et de la morale
la plus respectable; on en peut juger par les maximes
suivantes: «Ne recherche pas l’amour de celle
que tu ne peux épouser.—Ne cherche pas à arracher
les faveurs qu’on te refuse (in amoris exercendo
solatio, voluntatem non excedas amantis).—Même
dans les plus vifs emportements de l’amour, ne t’écarte
jamais de la pudeur (in amoris præstando solatio
et recipiendo, omnis debet verecundiæ rubor adesse).»
Il y a loin de là sans doute à l’Art d’aimer
d’Ovide. Maître André, tout chapelain qu’il fût, n’était
pas novice en amour, mais la définition qu’il
donne de l’amour, tel qu’on doit le pratiquer honnêtement,
ne semble pas condamner les mœurs du
digne clerc: «Le pur amour, dit-il, est celui qui
unit absolument les cœurs de deux amants par les
[280]
liens d’une tendresse intime. Mais cet amour consiste
dans la contemplation spirituelle et dans une ardente
passion. Il peut aller jusqu’au baiser, jusqu’à l’embrassement
et même jusqu’au contact de la chair
nue, en s’interdisant toutefois le dernier soulas de
Vénus (procedit autem usque ad oris osculum, lacertique
amplexum et ad incurrendum amantis nadum tactum,
extremo Veneris solatio prætermisso). Cette législation
d’amour n’était pas une lettre morte. La
chevalerie avait établi, dans chaque province, et
notamment dans celles du Midi, des Cours d’amour et
des Parlements de gentillesse, aréopages féminins, devant
lesquels se débattaient toutes les causes d’amour.
Ces assises de dames se tenaient, le soir, sous
l’ombrage d’un ormeau séculaire; le tribunal était
présidé par un chevalier de distinction, qu’on appelait
le prince d’amour et quelquefois prince de la jeunesse,
élu par les dames qui composaient la Cour et
qui avaient pour assesseurs plusieurs hauts personnages
de la noblesse et du clergé. La forme des jugements
et des arrêts était la même que dans les
tribunaux de justice royale et seigneuriale; mais
les sentences avaient toujours un caractère métaphysique
et ne soumettaient les amants à aucune punition
corporelle ou pécuniaire. C’était l’opinion, en
quelque sorte, qui se chargeait du châtiment des
coupables. Ces Cours d’amour, où siégeaient les plus
nobles dames et les plus honorées par leur prud’homie,
remplissaient une mission plus délicate encore,
[281]
lorsqu’elles répondaient doctoralement aux questions
d’amour qu’on venait leur soumettre. «Enfin, dit
Papon, dans son Histoire de Provence, la galanterie
étoit tellement l’esprit dominant de ce siècle d’ignorance,
qu’elle se mêloit à tout: elle faisoit le sujet
ordinaire des entretiens. Les dames, les chevaliers
et les troubadours s’exerçoient à disputer sérieusement
sur cette importante matière; il n’y avoit
aucun sentiment du cœur, quelque finesse qu’on lui
suppose, qui put échapper à leur sagacité; tous les
cas imaginables étoient prévus et décidés.» Ce fut
surtout l’affaire des Cours d’amour, de se prononcer
dans ces questions ardues et minutieuses, que les
avocats des deux parties discutaient avec d’incroyables
recherches d’éloquence et de science amoureuse.
On comprend quelle influence devait avoir une
pareille jurisprudence, contre la Prostitution; aussi,
dans les arrêts d’amour qui sont parvenus jusqu’à
nous, ne remarque-t-on pas des circonstances
graves qui accusent la conduite licencieuse de l’une
ou l’autre des parties mises en cause. Jamais un
acte de débauche ne vient souiller les oreilles et
l’esprit des juges; jamais l’amour, qui est l’âme
de tous les procès, ne se jette dans une voie obscène.
Ce sont des peccadilles d’amants, ce sont
des bagatelles de galanterie raffinée; ou bien la
cause est sérieuse, et la Cour d’amour devient un tribunal
d’honneur. Un secrétaire, envoyé auprès d’une
dame, oublie ses devoirs d’intermédiaire de confiance
[282]
et supplante son maître, en priant d’amour
pour son propre compte la dame auprès de laquelle
il devait servir et défendre les intérêts d’autrui. La
comtesse de Flandres, assistée de soixante dames,
condamne le coupable et sa complice, en les déclarant
exclus de la compagnie des dames et des cours
plénières de chevaliers. Maître André cite cet autre
exemple de jurisprudence amoureuse: un amant
avait quitté sa maîtresse pour en prendre une nouvelle;
il se lassa bientôt de celle-ci et voulut retourner
à la première, qui l’accueillit avec mépris et dénonça
son procédé à la vicomtesse de Narbonne. La Cour
d’amour, présidée par la vicomtesse, décida que
l’amant volage et trompeur perdrait en même temps
l’affection de ses deux maîtresses et ne serait plus
digne à l’avenir de posséder le cœur d’une femme
honnête (nullus probæ feminæ debet ulterius amore
gaudere). Condamner avec tant de rigueur l’inconstance
frauduleuse d’un amant, c’était ne promettre
aucune indulgence à la Prostitution. L’infidélité chez
une femme était condamnée plus sévèrement encore,
car une dame, dont l’amant guerroyait en Palestine
depuis deux ans, fut traduite au tribunal de la comtesse
de Champagne et accusée d’avoir voulu faire
nouvel ami. Cette dame allégua pour sa défense, qu’elle
s’était conformée aux lois d’amour qui ordonnent
de pleurer deux ans un amant défunt, et que l’absent,
qui ne donne pas de ses nouvelles, peut être
assimilé à un mort «sans lui faire injure;» mais la
[283]
comtesse de Champagne décida en principe qu’une
amante ne doit jamais abandonner son amant pour
cause d’absence prolongée. Les Cours des dames
étaient inexorables pour tout ce qui ressemblait à
une Prostitution du cœur ou du corps. Un chevalier
avait comblé de dons une dame qu’il aimait et qui
ne lui accordait aucune faveur en échange: il alla
se plaindre à la reine Éléonore de Guyenne, femme
de Louis VII. Cette belle reine, qui se connaissait
en galanterie, rendit cet arrêt mémorable: «Il faut
qu’une femme refuse les présents qu’on lui offre
dans une intention amoureuse, ou bien elle doit
consentir à les payer par l’abandon de sa personne;
mais, en ce cas, elle se place dans la catégorie des
courtisanes.» (Voy. l’Histoire des mœurs et de la
vie privée des Français, par E. de la Bédollière,
t. III, p. 324 et suiv.) Robert de Blois, dans son
poëme du Chastoiement des dames, a reproduit cette
maxime fondamentale du droit d’aimer, sur la question
des joyaux qu’une femme reçoit d’un homme
qui la courtise:
Et bien sachiez, s’ele les prent,
Cil qui li donc chier li vent;
Quar tost lui coustent son honor
Li joiel doné par amour.
Les Arrêts d’amour que Martial d’Auvergne a recueillis
et rédigés vers la fin du quinzième siècle, et
qu’un autre jurisconsulte aussi gravement facétieux
a commentés dans le style du Palais, ne sont pas
[284]
d’une morale aussi sévère, et quelques-uns paraissent
dictés par une galanterie assez relâchée. Nous
croyons donc qu’ils n’émanent pas des anciennes
Cours d’amour de la Provence, et qu’ils ont été rendus,
du temps même de Martial d’Auvergne, dans
quelque assemblée de dames et de gentilshommes
tenant parlement à l’instar des grands jours de Pierrefeu,
de Signes et de Romanin. Ce n’est plus la
doctrine naïve et austère de la chevalerie primitive,
qui ne plaisantait pas avec l’amour; c’est une galanterie
encore raffinée, mais malicieuse et libertine:
on sent que l’amour se matérialise, et on le voit
d’ailleurs passer sans trop de scrupule, au dernier
soulas. Le tribunal diffère aussi des véritables Cours
d’amour, en ce qu’il prononce des amendes, parfois
considérables, et des peines corporelles, contre les
délinquants, qui ont en perspective le fouet à recevoir
de la main des dames et quelque bonne somme
à employer en banquets et en herbe verde. Les causes
se plaident devant des juges de différents ressorts,
tels que le maire des bois verts, le baillif de joye,
le viguier d’amours, etc. Les surnoms allégoriques
de ces magistrats laissent soupçonner que cette justice-là
n’était qu’un jeu. Parmi les arrêts bizarres
que Martial d’Auvergne a réunis avec une gaieté
sournoise, nous en choisirons deux qui permettront
d’apprécier le mérite des autres. Dans le XIe arrêt,
c’est une dame qui se plaint de son ami devant le
maistre des forestz et des eaues sur le faict du gibier
[285]
d’amours; elle accuse son ami de l’avoir fait choir
dans une rivière tout exprès pour lui mettre la main
sur les tetins; en conséquence, elle demande que
cet audacieux amant soit très grievement puny de
punition publique. L’amant répondait qu’il était tombé
dans l’eau avec elle, mais que, «cheyant, il ne l’avoit
ni tastée ni pincée, ne n’eut pas le loisir de ce
faire, pour l’eau dont il estoit tout esblouy.» Néanmoins,
«le procureur d’amours dessus le faict des
eaues et des forestz, disoit que par les ordonnances
il est deffendu de ne point chasser à engins, par
lesquels on puisse prendre testins en l’eaue,» et concluait
à ce que l’amant fût condamné à une grosse
amende. Celui-ci répliquait que si sa main, à son
insu, avait touché les tetins de sa dame, ce n’aurait
été qu’en tombant: «Et estoit force qu’il se
soustint à quelque chose.» Le tribunal admit cette
excuse, mais il décida que l’amant donnerait à la
maîtresse une robe neuve, de couleur verte, en dédommagement
de la robe que l’eau avait gâtée.
Dans le IVe arrêt, c’est encore une dame qui se
complaint de son ami, en disant «qu’il lui avoit baisé
sa robe si rudement, qu’il l’avoit cuydé affoler (blesser)
et qu’en cheyant, sa gorgerette estoit dépecée, et
en avoit-on peu voir le bout de sa chemise.» Elle
requérait qu’il fût défendu à cet amoureux brutal,
«de ne plus se jouer ny toucher plus à elle, sans
son congié.» Cette requête de la dame eut plein
succès, et l’amant eut beau en appeler, la sentence
[286]
fut confirmée, en dernier ressort, par le maire des
bois verts.
Les jugements des Cours d’amour n’étaient pas
les seuls qui atteignissent les mauvaises mœurs des
personnes appartenant à la juridiction de la chevalerie:
l’opinion avait à se prononcer aussi, et ses
arrêts n’épargnaient ni la naissance, ni le rang, ni
la richesse, quand ils s’adressaient à des actions
honteuses et répréhensibles. La bonne renommée
était une condition essentielle pour les hommes ainsi
que pour les femmes qui voulaient qu’on leur fît
honneur, et les plus puissants seigneurs, les plus
grandes dames, ne se trouvaient pas au-dessus du
blâme des petites gens. «Les dames qui se respectant
elles-mêmes vouloient être respectées, dit Lacurne
de Sainte-Palaye, étoient bien sûres qu’on ne
manqueroit point aux égards qu’on leur devoit, mais
si, par une conduite opposée, elles donnoient matière
à une censure légitime, elles devoient craindre
de trouver des chevaliers tout prêts à l’exercer.»
Le chevalier de la Tour racontait à ses filles, en 1371,
qu’un modèle de chevalerie, nommé messire Geoffroy,
s’était voué à la répression de l’inconduite
des dames: «Quant il chevauchoit par les champs
et il véoit le chasteau ou manoir de quelque dame,
il demandoit toujours à qui il estoit, et quant on
lui disoit: il est à telle, se la dame estoit blasmée
de son honneur, il se fust avant tort d’une demi-lieue,
qu’il ne feust venu jusques devant la porte, et là
[287]
prenoit un petit de croye (craie) qu’il portoit, et notoit
cette porte et y fesoit un signet et l’en venoit (l’on vessait).
Et, aussi, au contraire, quant il passoit devant
l’hostel de dame ou damoiselle de bonne renommée,
se il n’avoit trop grant haste, il la venoit veoir et
huchoit: «Ma bonne amie, ou ma bonne dame ou
damoiselle, je prie Dieu que en ce bien et en cest
honneur il vous veuille maintenir au nombre des
bonnes, car bien devez estre louée et honorée.»
Et, par cette voie, les bonnes se craignoient et se tenoient
plus fermes de faire chose dont elles pussent
perdre leur honneur et leur estat.» Nous ignorons
quel pouvait être ce signet, que le chevalier Geoffroy
marquait à la craie sur la porte des dames malfamées,
et qui invitait les passants à saluer d’un pet
la maîtresse du lieu, en signe de mépris, ce que les
gens du peuple ne manquaient jamais de faire lorsqu’ils
rencontraient une fille publique sur leur passage.
Cependant, si la moralité publique, grâce à la chevalerie,
faisait des progrès journaliers dans toutes
les classes de la société et descendait par degrés
jusqu’aux plus infimes, la Prostitution, tout en se
cachant au fond de ses repaires, continuait à déshonorer
le langage usuel et à s’ébattre dans les poésies
des trouvères. Ces poëtes de la langue d’oil n’étaient
pas, comme les troubadours, des chevaliers et des
écuyers nourris dans les Cours d’amour et formés de
bonne heure aux leçons de la fine galanterie; les
trouvères, sortis du peuple pour la plupart, conservaient
[288]
dans leurs œuvres la tache originelle et appliquaient,
à des compositions pleines de verve, de
gaieté et de malice, la langue crue et grossière qu’ils
avaient apprise dans la maison de leurs parents; ils
appelaient chaque chose par son nom et ils employaient
de préférence l’expression la plus populaire,
qui était toujours la plus pittoresque. Leurs
premiers auditeurs avaient été des villageois, des
mechaniques, des marchands, des vilains en un mot,
et si ces juges-là se connaissaient en bonne plaisanterie
et en franche joyeuseté, ils ne trouvaient rien
de trop gros ni de trop obscène dans les détails ou
dans les mots. Ce n’est pas tout, les trouvères, qui
avaient quitté la charrue ou la navette pour rimer
des romans, des chansons, des lais et des fabliaux,
embrassaient une vie vagabonde et désordonnée;
ils devenaient presque tous ivrognes et débauchés,
en vivant avec les jongleurs, jongleors et canteors,
qui passaient à bon droit pour les plus dépravés des
hommes. Ces jongleurs, du moins ordinairement, ne
composaient pas eux-mêmes les vers qu’ils chantaient
ou récitaient; ils ne faisaient que les dire
avec plus ou moins de savoir faire et d’intelligence;
ils accompagnaient leur débit ou leur chant, de
pantomimes, de danses et de tours d’adresse. Il
arriva sans doute que le même acteur réunissait les
métiers distincts du trouvère et du jongleur, mais
ce ne fut jamais qu’une exception, d’autant plus
rare que les trouvères n’étaient point aussi méprisés
[289]
que les jongleurs et les ménestrels. Ces derniers, en
effet, méritaient bien le mépris qu’on leur accordait
partout: ils s’adonnaient à tous les vices, et surtout
aux plus infâmes; ils ne reconnaissaient aucune loi
sociale; ils erraient de ville en ville, de château en
château, traînant avec eux un troupeau de jongleresses
et d’enfants; ils tenaient école de Prostitution.
Pourtant, ils n’en étaient pas plus riches; on les
voyait errer demi-nus, n’ayant pas souvent robe
entière, comme les dépeint un poëte du treizième
siècle, sans sorcot et sans cotelle, les souliers pertuissés,
et couverts de vermine. Ces malheureux, on le
pense bien, avaient été tous élevés dans les Cours
des Miracles; leurs mœurs et leur langage en gardaient
la souillure, et c’étaient eux, qui, courant le
pays, corrompaient à la fois le langage et les mœurs.
Ils s’étaient glissés d’abord dans les assemblées honnêtes,
dans les festins d’apparat, dans les fêtes
chevaleresques, lorsqu’ils récitaient des chansons de
geste, les épopées féeriques de la Table-Ronde et de
Charlemagne; ils excitaient alors l’enthousiasme de
leur auditoire, composé de seigneurs et de dames,
qui ne se lassaient pas d’entendre parler d’armes et
d’amour. Il y avait toutefois çà et là, dans ces vieux
romans rimés, quelques scènes assez libres et quelques
termes licencieux, mais l’intention du poëte
était toujours irréprochable, et le jongleur n’ajoutait
pas, par son jeu et ses grimaces, à l’indécence du
tableau. Alors il était généreusement payé, on lui
[290]
donnait des robes et des manteaux neufs; on l’hébergeait,
lui, ses valets et ses animaux (car il montrait
aussi des chiens, des singes et des oiseaux
dressés à divers exercices); on le logeait au château,
et, quand il partait, l’escarcelle bien garnie, on l’invitait
à revenir, en lui offrant le coup de l’étrier.
Ce paradis de la jonglerie se changea en enfer,
sous le règne de saint Louis: les trouvères faisaient
encore des chansons de geste contenant douze à vingt
mille vers, mais les jongleurs ne les apprenaient
plus par cœur et ne les récitaient plus; un changement
notable s’était opéré dans le goût; on n’aimait
plus à écouter, à table, les gestes merveilleux des
preux du roi Arthus et de l’empereur Charlemagne;
on préférait les lire dans le silence du retrait ou cabinet.
Les jongleurs se prêtèrent volontiers à ce caprice
de la mode, qui subissait l’influence des croisades;
ils allégèrent leur bagage et ne récitèrent
plus que des contes gaillards et dévots. Les trouvères,
ceux du moins qui puisaient leurs inspirations
dans le peuple, répondirent avec empressement au
bon accueil qu’on faisait à leurs fabliaux, et ils en
inventèrent un grand nombre, plus joyeux les uns
que les autres, qui se répandirent, aux sons de la
vielle et de la rote, dans toutes les compagnies où le
rire gaulois avait encore accès. Mais l’abus ne tarda
pas à faire condamner et proscrire ce genre de divertissement;
les trouvères ne mettaient plus de
bornes à la licence de leurs compositions, et les jongleurs
[291]
en exagéraient encore l’obscénité; on considéra
jongleurs et trouvères comme des suppôts du
démon et on leur imputa, peut-être avec justice, un
nouveau développement de la Prostitution. Le pieux
Louis IX avait pourtant protégé la ménestrandie,
puisque, après son dîner et avant d’ouïr les grâces, il
donnait audience aux menestriers, qui jouaient de la
vielle devant lui; mais ces encouragements ne s’adressaient
qu’à la musique et non aux fabliaux,
car, suivant un texte ancien adopté dans plusieurs
éditions de Joinville, «il chassa de son royaume tous
basteleurs et autres joueurs de passe-passe, par lesquels
venoient au peuple plusieurs lascivités.» Ces
lascivités ne déplaisaient pas à certains nobles, qui,
en dépit des chastes enseignements de la chevalerie,
se montraient partisans passionnés de la gaie science
et ne fermaient jamais la porte de leurs manoirs aux
jongleurs les plus libertins; mais, en général, les pauvres
ménestrels étaient bannis des châteaux, ainsi
que les lépreux, et le son de leurs instruments, annonçant
leur présence au bord des fossés d’une
résidence seigneuriale, n’avait pas d’autre résultat
que de faire aboyer les chiens. Selon un apologue
facétieux, écrit en latin à cette époque (voy. les
Fabliaux de Legrand d’Aussy, t. IV, p. 357), Dieu,
en créant le monde, y plaça trois espèces d’hommes,
les nobles, les clercs et les vilains. Il donna aux
premiers les terres, aux seconds les dîmes et les
aumônes, et aux derniers le travail avec la misère;
[292]
mais, le partage étant fait ainsi, les ménétriers et
les ribauds présentèrent simultanément leur requête
à Dieu, pour lui demander de fixer leur sort et de
leur assigner de quoi vivre: «Le Seigneur, dit
l’auteur de l’apologue, chargea les nobles de nourrir
les ménétriers, et les prêtres d’entretenir les catins.
Ceux-ci ont obéi à Dieu, et rempli avec zèle la
loi qui leur est imposée; aussi seront-ils sauvés incontestablement.
Quant aux gentilshommes qui n’ont
eu nul soin de ceux qu’on leur avait confiés, ils ne
doivent attendre aucun salut.» Les jongleurs, n’étant
plus reçus dans les châteaux, oublièrent tout
à fait les chansons de geste et la poésie honnête; ils
avaient trouvé un public plus facile à divertir et
moins scrupuleux sur la nature de ses plaisirs; ils
allaient frapper à la porte des bourgeois et des marchands;
ils venaient s’asseoir dans les tavernes et
chez le bon populaire qui les recevait avec joie et
qui ne riait pas du bout des lèvres aux contes licencieux
qu’on lui contait après boire.
Ces contes, monuments précieux de l’imagination
et de la gaieté de nos ancêtres, forment un recueil
considérable, dont une partie seulement a été publiée
en original par Barbazan, et traduite par Legrand
d’Aussy. C’est dans ce graveleux répertoire que Boccace,
Arioste, la Fontaine et mille autres poëtes et romanciers
modernes ont puisé des sujets et des idées
comiques, qu’ils n’ont fait que remettre en œuvre
et rajeunir de forme. «Le recueil des fabliaux, dit
[293]
M. Émile de la Bédollière, abonde en saillies piquantes,
en inventions drôlatiques, en traits d’une
gaieté communicative, mais il est souvent d’une
dégoûtante obscénité: les mots les plus sales de la
langue française y semblent prodigués à plaisir; les
fonctions les plus vulgaires de la machine humaine
y sont le sujet de grossières plaisanteries; les parties
les plus secrètes du corps y sont nommées en termes
dont rougiraient les prostituées d’aujourd’hui.» Et,
à l’appui de cette appréciation générale des fabliaux
du treizième et du quatorzième siècle, l’ingénieux
auteur de l’Histoire des mœurs et de la vie privée des
Français cite les titres de quelques-uns, qu’il choisit
dans l’édition de Barbazan: Fabliau de la m....;
une femme pour cent hommes; de Charlot le juif qui
chia en la pel dou lievre; du Chevalier qui fesoit parler
les c... et les c...; de l’anel qui fesoit les v... grands et
roides; du vilain à la c..... noire; d’une pucelle qui
ne pooit oïr parler de f....., qu’elle ne se pasmast, etc.
Barbazan a laissé, dans les manuscrits où ils reposent
encore inédits, plusieurs fabliaux dont les titres
promettent des histoires plus ordurières encore, s’il
est possible; M. de la Bédollière enregistre quelques-uns
de ces titres, d’après le Ms. coté 1830, Bibl. Nationale:
de la male vieille qui conchia la preude feme;
du fouteor; du conin; d’après le Ms. 7,218: du c.. et
du c..; de honte et de puterie; du v.. et de la c.....; du
c.. qui fut fait à la besche, etc. Pour avoir idée de
cette littérature joyeuse, il faut lire les contes les
[294]
plus libres de la Fontaine, qui se délectait à la lecture
des trouvères; mais on ne se rendra compte des
monstrueuses libertés du langage de ces poëtes, qui
avaient leur Cour des Muses dans un mauvais lieu,
qu’en comparant leurs œuvres badines avec celles
de Grécourt, de Piron et de Robbé, ces effrontés
trouvères du dix-huitième siècle.
«Il est évident, dit encore M. de la Bédollière
(t. III, de l’ouvrage cité, p. 341), que nos ancêtres
prononçaient, sans sentir leur pudeur effarouchée,
des mots que nous avons proscrits; mais ils n’étaient
pas étrangers à la délicatesse, et les contes scandaleux
inspiraient un juste dégoût aux honnêtes gens.»
En effet, dans le Jeu de Robin et Marion, petite comédie
mêlée de chants, représentée au treizième
siècle, et dont l’auteur, Adam de la Hale, était un
des trouvères les plus estimés de son temps, un des
personnages de la pièce, nommé Gauthier, sous prétexte
de réciter une chanson de geste, entonne un
refrain ordurier; Robin l’interrompt, en lui disant
d’un ton de reproche:
Ah! Gauthier, je n’a voiel plus; fi!
Dites, serez-vous toujours teus (tel)?
Vous estes un ord (sale) menestreus!
Les ménétriers et les jongleurs avaient concouru
à propager la langue déshonnête, en débitant et en
chantant les poésies des trouvères; et ceux-ci, que
leur réputation littéraire recommandait comme des
[295]
modèles dans l’art de rithmer et de bien dire, exerçaient
une funeste influence sur la langue écrite
comme sur la langue parlée: car quiconque écrivait
en prose ou en vers s’autorisait de leur exemple
pour se servir des mots les plus indécents, et pour
étaler avec complaisance les images les plus impudiques.
Les trouvères, dans les compositions du
genre le plus relevé, ne se défendaient pas de cette
mauvaise habitude de mêler à la langue poétique
l’idiome des tavernes et des bordiaux. L’auteur du
roman célèbre de Partenopex de Blois fait une peinture
qui serait mieux à sa place dans un fabliau:
Il li a les cuisses ouvertes,
Et quant les soles i a mises,
Les flors del pucelage a prises.
L’auteur du roman de Garin le Lehorain n’attribue
pas un langage plus décent à ses chevaliers; l’un
d’eux s’écrie dans un accès de convoitise lubrique:
Si la tenoie, par mon chief à naisil,
La demoisel coucheroie avec mi!
Quelquefois le trouvère abordait un sujet de sainteté,
et il ne changeait pas pour cela de vocabulaire;
ainsi, dans les Miracles de Nostre-Dame, le poëte traducteur,
que ce sujet édifiant n’avait pas purifié, se
complaît à retracer les épisodes d’une nuit de noces,
où, par la grâce de la Vierge immaculée, l’époux
ne joua qu’un triste rôle:
La nuit première, en son beau lit,
Faire en cuida tout son delit,
[296]
Li espoux, es c... de sa fame;
Mais si la garda Nostre-Dame....
Chascune nuit que il anuite,
Touz fois revient à la meslée,
Mais la porte est si fort peslée
Si fort serrée et si fort close,
Qu’entrer ne puet pour nule chose.....
Les poëtes et les écrivains qui n’avaient pas bouche
en cour, c’est-à-dire qui ne mangeaient point à
la table des rois et des princes, savaient mal faire
la distinction du langage honnête et de celui qui ne
l’était pas; ils ignoraient la valeur réelle des mots, et
ils ne soupçonnaient pas que la langue eût plusieurs
espèces de style appropriées chacune au caractère
de l’œuvre. Le sentiment de la décence littéraire
ne les touchait pas même lorsqu’ils passaient d’un
sujet profane à un sujet sacré. Un de ces trouvères
sans doute fut chargé assez mal à propos de traduire
la Bible en français, pour l’usage d’un prince de
France. Il exécuta ce travail avec toute la conscience
dont il était capable et il ne se fit aucun scrupule
d’introduire dans sa traduction littérale une foule
de mots, qui, pour avoir été employés en hébreu
par Moïse, n’étaient point admissibles dans les saintes
Écritures faites françoises; cependant cette étrange
traduction fut écrite sur vélin par un scribe, ornée
de miniatures et couverte d’une belle reliure. Ce fut
en cet état qu’elle arriva dans les mains des rois
de France, qui, pendant plusieurs générations,
lisaient la Bible dans ce beau manuscrit et ne se
[297]
scandalisaient pas d’y rencontrer, à chaque page,
des énormités semblables à celles-ci, que M. Paulin
Paris a extraites dans son excellent Catalogue des
manuscrits français de la Bibliothèque du Roi: «Et
autres foys dist Dieu à Abraam: Chacun masle de
vous sera circumsis, et vous circumsizerez la char
de votre v..; que ce soit en signe de lien entre moy
et vous. Lors mena Abraham Ismael son fils, et touz
les frankes mesmes de sa maison, et tous les masles
de tous les bouviers de sa maison, et il circumsiza la
char de leur v.. (ch. 17, vers. 10 et 23). Notre-Seigneur,
a de certes, se remembra de Rachel, et
overi son c..; laquelle conceust et enfanta un fils
(ch. 30, vers. 22). Si se courroucèrent pour le despucelage
de leur sorour... et ils répondirent: Dussent-ils
avoir usé nostre sorour pour putage (ch. 34,
vers. 13 et 31)!» Cette Bible françoise est conservée,
sous le no 6,701, parmi les manuscrits de la
Bibliothèque Nationale, et l’on s’étonne, en la lisant,
qu’elle n’ait pas été translatée pour l’usage des clapiers
de Glatigny, de Tyron et de Brisemiche, plutôt
que pour servir aux dévotions des Rois Très-Chrétiens.
Au reste les moralistes et les sermonnaires, qui
s’adressaient souvent au peuple, et qui lui parlaient
son langage, n’étaient pas plus réservés dans le
choix de leurs expressions, qu’ils ramassaient dans
la fange pour les mêler à des choses saintes ou édifiantes.
Saint Bernard croyait encore prêcher en latin
quand il disait énergiquement dans un de ses sermons:
[298]
«Vieille femme menant pute vie de corps est
putain!» Un autre sermonnaire du même temps,
dans un discours sur l’humilité, prenait pour texte
ces paroles du roi-prophète: Laus mea sordet eo quod
sit in ore meo; et il les interprétait ainsi: «Ma
louange n’est que merde et conchiure!» Le langage
de la Prostitution avait débordé partout et jusque
dans L’Église, qui eut la sagesse d’interdire aux
fidèles la lecture des livres saints travestis indécemment
en style vulgaire.

Sommaire.—Les mœurs publiques et privées à partir du onzième
siècle.—Jean Flore, évêque d’Orléans.—Le Goliath de
la Prostitution.—Excentricités licencieuses du duc d’Aquitaine.—Les
Croisades et les Croisés.—Les trois cents femmes franques.—Les
concubines de l’ost du roi.—L’arrière-garde des
armées en campagne.—Les mille prostituées du capitaine
Garnier.—Jeanne d’Arc à Sancerre.—Ordonnance de cette
héroïne contre les ribaudes de la milice.—Comment la chevalerie
entendait l’hospitalité.—Décadence des mœurs chevaleresques.—Abominations
du règne de Charles VI.—Anne Piedeleu.—Indulgence
d’Ambroise de Loré, prévôt de Paris, pour
les prostituées, etc.
La chevalerie avait certainement réprimé les excès
de la Prostitution, qu’elle ne put néanmoins faire
[300]
disparaître. A partir du douzième siècle, une amélioration
heureuse se fit sentir dans les mœurs publiques
et privées, malgré l’action toujours corruptrice
de la poésie populaire, qui devait finir par
remplacer la poésie héroïque. Il y a encore sans
doute bien des désordres chez les nobles et dans le
bas peuple; mais, ordinairement, les premiers ne donnent
plus au commun l’exemple de la perversité la
plus abominable. Ainsi, quoique les habitudes de
l’Orient se fussent introduites dans l’armée des croisés,
le vice contre nature n’est plus aussi fréquent
qu’il l’était à la cour de Normandie en 1120. Selon
Guillaume de Nangis, un prélat n’ose plus afficher
effrontément ses turpitudes, comme cet évêque d’Orléans,
nommé Jean, qui en 1092 se faisait appeler
Flore par ses mignons (concubii), et qui entendait, sur
les places et dans les carrefours, d’infâmes adolescents,
voués à la débauche masculine, chanter le
soir les hideuses chansons composées en son honneur
(quidam enim sui concubii, dit le vénérable
Ives de Chartres dans une lettre adressée au pape
Urbain II, appellant eum Floram, multas rhythmicas
cantilenas de eo composuerunt, quæ a fœdis adolescentibus,
sicut nostis miseriam terræ illius, per urbes
Franciæ, in plateis et compitis, cantitantur). Ces écrivains
satiriques ne font pas grâce sans doute aux
vices de leur époque; ils accusent l’avarice, l’orgueil,
la cruauté, la gourmandise des seigneurs,
mais ils ne leur reprochent pas, à l’instar des historiens
[301]
du onzième siècle, de vivre dans le gouffre
de l’impudicité (impudicitatis barathrum). Orderic
Vital s’écriait, en gémissant, «que la licence ne connaissait
plus de bornes, et qu’on s’était écarté des
traces des héros pour se livrer à la Prostitution la
plus effrénée;» il ne se lassait pas de maudire l’iniquité
de son temps (sevitia iniqui temporis, dit-il
dans le livre III de sa Chronique); et pourtant, au
milieu de la licence effroyable du onzième siècle,
l’Église travaillait activement à la réforme des ordres
monastiques, et la chevalerie, dont l’institution
est attribuée à un vieil ermite descendu d’un trône
(cette tradition n’était probablement qu’un symbole),
commençait à régénérer la noblesse en corrigeant ses
mauvaises mœurs.
C’est à l’influence salutaire de la chevalerie, qu’il
faut rapporter la conversion du plus grand pécheur
que le onzième siècle ait produit. Entre tant de fils
du diable, comme on les nommait, Guillaume, neuvième
du nom, duc d’Aquitaine et comte de Poitiers,
fut le Goliath de la Prostitution, pour nous
servir d’une figure biblique qui caractérise les
énormes débauches de ce prince, que M. Émile de
la Bédollière qualifie de Joconde du onzième siècle.
Suivant le jugement d’un troubadour contemporain
(Choix de poésies orig. des Troubadours, t. V,
p. 115), il fut le plus grand trompeur de femmes et
le plus fieffé libertin, dont la réputation ait parcouru
le monde (si fo uns dols maiors trichadors de dampnas
[302]
et anet lonc temps per lo mon per enganar las domnas).
Tout lui était bon, pourvu que ce fût une conquête
à faire; il ne dédaignait pas de tendre ses lacs à ses
plus humbles vassales, et il avait un goût particulier
pour les religieuses, qu’il allait séduire dans
leurs couvents. Nous avons déjà mentionné son projet
de mauvais lieu, constitué sur le modèle des
abbayes, et destiné à renfermer une congrégation de
filles publiques sous la direction des plus grandes
dévergondées du Poitou. On ne sait ce qui l’empêcha
de mettre ce plan à exécution, lorsqu’il eut fait
élever l’édifice abbatial. Il s’était épris de la belle
comtesse de Châtellerault, nommée Malborgiane, et
il vivait en concubinage avec elle, après avoir congédié
sa femme légitime. Il avait fait peindre sur
son bouclier le portrait de sa maîtresse, en disant
qu’il voulait la porter dans les combats, comme elle
le portait lui-même dans le lit (dictitans se illam velle
ferre in prælio, sicut illa portabat eum in triclinio).
Guillaume de Malmesbury, qui raconte dans sa Chronique
les excentricités licencieuses du duc d’Aquitaine,
nous laisse entendre que ce terrible fornicateur
ne se piquait pas d’être fidèle à la vicomtesse, qu’il
aimait pourtant avec passion. La nuit du samedi
saint, il était dans une église où l’on prêchait sur la
résurrection de Jésus: «Quelle fable! quel mensonge!
s’écria-t-il en éclatant de rire.—Si telle est
votre opinion, lui dit vivement le prédicateur,
pourquoi restez-vous ici?—J’y reste, repartit
[303]
l’impie, pour regarder les jolies femmes qui viennent
faire la veillée de Pâques.» Un jour, il tomba
malade; et un moine qui le soignait lui conseilla de
se préparer à faire une bonne mort: «Tu voudrais,
je le vois, lui répondit le moribond, que je donnasse
mes biens aux parasites, c’est-à-dire aux prêtres!
ils n’en auront pas une obole. Quant à mes
débauches, je n’ai pas à m’en repentir: beaucoup
de gens, qui te surpassent en savoir, m’ont assuré
que toutes les femmes devaient être communes,
et que se livrer à leurs caresses était un péché sans
conséquence.» Il ne mourut pas dans l’impénitence
finale, car, sous les auspices de la chevalerie, il passa
subitement du culte de la matière à la contemplation
spirituelle, de l’incrédulité à la foi, et du scandale
de sa vie immonde aux pratiques édifiantes de l’ascétisme:
il se fit soldat du Christ, et il expia ses
péchés par un éclatant repentir. Il était vieux alors,
et il n’aurait pu continuer le train d’amour qu’il
menait dans sa jeunesse, même en ayant recours à
ces excitations factices que le charlatanisme médical
offrait aux vieillards libertins et dont le docte Arnauld
de Villeneuve a recueilli la recette sous ce
titre: Ad virgam erigendam. Guillaume d’Aquitaine,
dans son bon temps, avait poussé fort loin la recherche
sensuelle, et la renommée lui faisait honneur
de diverses inventions érotiques, qu’on trouve aussi
dans les œuvres d’Arnauld de Villeneuve, qui a eu
la pudeur de les traduire en latin (Ut desiderium
[304]
et dulcedo in coitu augmentetur.—Ut mulier habeat
dulcedinem in coitu....).
Les croisades furent le plus beau moment de la
chevalerie, et pourtant on ne peut pas nier que ce
prodigieux rassemblement d’hommes de tous âges,
de tous rangs et de tous pays n’ait réchauffé dans
son sein les germes corrupteurs de la Prostitution.
L’abbé Fleury, parlant de ces armées innombrables
qui venaient fondre sur l’Orient, dit avec raison
qu’elles étaient pires que les armées ordinaires:
«Tous les vices y régnoient, et ceux que les pèlerins
avoient apportés de leurs pays, et ceux qu’ils
avoient pris dans les pays étrangers.» Nous avons
rapporté, d’après le témoignage de Joinville, que,
dans la première croisade de saint Louis, ses barons
tenoient leurs bordeaux autour de la tente royale. Ce
devait être pis dans les croisades précédentes, dans
la première surtout, qui bouleversa l’Europe, avant
de mettre sens dessus dessous tout l’Orient. «Les
croisés, dit Albert d’Aix, se conduisirent en gens
grossiers, insensés et indomptables dès que l’amour
charnel éteignit en eux la flamme de l’amour
divin; ils avaient dans leurs rangs une foule de
femmes portant des habits d’hommes, et ils voyageaient
ensemble, sans distinction de sexe, en se confiant
au hasard d’une affreuse promiscuité.» L’auteur
des Gesta Urbani II se borne à constater le fait:
Innumerabiles feminas secum habere non timuerunt,
quæ naturalem habitum in virilem nefarie mutaverunt,
[305]
cum quibus fornicaverunt (Histor. des Gaules, t. XIV,
p. 684). Albert d’Aix ajoute quelques détails qui
nous permettent d’en deviner de plus scandaleux:
«Les pèlerins ne s’abstinrent point des réunions illicites
et des plaisirs de la chair; ils s’adonnèrent sans
relâche à tous les excès de la table, se divertissant
avec les femmes mariées ou les jeunes filles, qui
n’avaient quitté leurs foyers que pour se livrer aux
mêmes folies et se jeter imprudemment dans toute
espèce de vanités.» Pour s’expliquer de quelle sorte
de vanités le chroniqueur voulait parler, il faut voir
ce ramas de vagabonds, de fanatiques violer les filles
et déshonorer l’hospitalité qu’ils reçurent en Hongrie
(puellis eripiebatur, violentiâ ablata, virginitas; dehonestabantur
conjugia). Ce ne fut pas sans cause que
la main de Dieu s’étendit sur ces misérables qui
«avaient péché sous ses yeux, en se vautrant dans
toutes les souillures de la chair.» Il n’y eut pas le
tiers de ces hordes indisciplinées et souillées de crimes
qui arrivât en Palestine.
Les Cours des Miracles et les lieux de Prostitution
avaient fourni leur impur contingent à l’armée des
croisés, dans laquelle les ribauds, les pékins (piquichini),
les truands (trudennes) et les thafurs (vagabonds)
formaient des bandes redoutables, grossies
de filles perdues qui avaient pris la croix avec leurs
amants. Au reste, toutes les armées du moyen âge
étaient invariablement suivies d’une tourbe de gens
sans aveu, de goujats et de ribaudes, qui accompagnaient
[306]
les bagages et qui les pillaient en cas de déroute.
Le soldat ou soudoyer ne pouvait se passer de
ce cortége embarrassant et inquiétant à la fois: les
femmes servaient à ses passe-temps, les hommes se
rendaient utiles dans l’occasion en portant des fardeaux
et en ravageant le pays sur le passage des
troupes. Les croisés ne renoncèrent pas aux mœurs
militaires, en se vouant à la délivrance du saint
sépulcre; et quand les femmes leur manquèrent en
Palestine, où la religion mahométane s’opposait à tout
commerce illicite avec les chrétiens, on fit venir
d’Europe un renfort de chrétiennes qui concoururent,
à leur manière, au triomphe de la croisade. Un historien
arabe, Ém-ad-Eddin, rapporte que pendant le
siége de Saint-Jean-d’Acre, en 1189, «trois cents
jolies femmes franques, ramassées dans les Iles, arrivèrent
sur un vaisseau pour le soulagement des
soldats francs, auxquels elles se dévouèrent entièrement;
car les soldats francs ne vont point au combat,
s’ils sont privés de femmes.» Le même historien,
cité par Hammer dans son Histoire de l’empire ottoman,
ajoute que l’exemple des Francs fut contagieux
pour leurs ennemis, qui voulurent aussi avoir
des femmes de joie dans leur armée, où pareil déréglement
n’avait jamais été toléré auparavant. Cette
multitude de femmes se trouva constamment à la
suite des armées françaises jusqu’à la fin du seizième
siècle. Geoffroy, moine du Vigeois, estime à quinze
cents le nombre des concubines qui suivaient l’ost du
[307]
roi en 1180, et les parures de ces courtisanes royales
(meretrices regiæ) avaient coûté des sommes immenses
(quarum ornamenta inestimabili thesauro comparata
sunt). Ce chroniqueur ne veut parler sans doute
que des femmes qui relevaient directement du roi
des ribauds, et qui n’exerçaient leur vil métier qu’en
payant une redevance à cet officier de l’hôtel du roi.
Quant aux ribaudes libres et non autorisées, leur
nombre devait être vingt fois plus considérable, surtout
dans les armées irrégulières comme celles des
croisades, comme ces Grandes Compagnies qui se mettaient
à la solde de quiconque pouvait les payer et leur
promettre du butin. Le moine du Vigeois énumère
les différentes espèces de soudoyers qui à la fin du
douzième siècle ravageaient, à l’instar d’une nuée
de sauterelles, le pays qu’ils traversaient: Primo
Basculi, postmodum Theuthonici, Flandrenses; et, ut
rustice loquar, Brabansons, Hannuyers, Asperes,
Pailler, Nadar, Turlau, Vales, Roma, Cotarel, Catalan,
Arragones, quorum dentes et arma omnem Aquitaniam
corroserunt. Chacune de ces bandes dévorantes
traînait après elle une masse de prostituées,
qui se grossissait sans cesse et qui prenait part au
pillage des villes mises à feu et à sang.
On rencontre partout dans l’histoire militaire de
la France et des autres nations de l’Europe cette
affluence de femmes débauchées dans les armées en
campagne; l’arrière-garde se composait toujours de
ces sortes de femmes et de leurs compagnons, ribauds
[308]
et goujats, pour qui, suivant une expression consacrée,
rien n’était trop chaud ni trop pesant lorsqu’il
s’agissait de piller. Cette arrière-garde, incommode
et malfaisante, était souvent presque aussi nombreuse
que le reste de l’armée. On lit, dans la Chronique
de Modène, écrite par Jean de Bazano (voy.
le grand recueil de Muratori, t. XV, col. 600), qu’un
capitaine allemand nommé Garnier, qui envahit, à la
tête de trois mille cinq cents lances, le territoire de
Modène, de Reggio et de Mantoue, au commencement
de l’année 1342, était accompagné de mille
prostituées, mauvais garçons et ribauds (mille meretrices,
ragazii et rubaldi). Les chefs de guerre et
les capitaines, si preux chevaliers qu’ils fussent, ne
pouvaient rien contre cette Prostitution des camps;
ils auraient vu leurs troupes se révolter et refuser de
servir sous une bannière qui n’eût pas protégé aussi
les folles femmes destinées au soulas du soldat.
Jeanne d’Arc seule, qui avait en horreur les femmes
de mauvaise vie, quoique les Anglais la nommassent
la putain des Armignats (voy. Hist. de France de
Michelet, t. V, p. 75), puisa dans sa mission divine
assez d’autorité pour expulser de l’armée du roi
toutes ces méprisables créatures. Elle ordonna d’abord
que les soldats se confessassent, «et leur fit oster
leurs fillettes,» dit l’auteur anonyme des Mémoires,
qui concernent cette chaste héroïne. «Il est à sçavoir,
raconte Jean Chartier dans son Histoire de Charles VII,
que, après la journée de Patay, ladite Jehanne
[309]
la Pucelle fit faire un cry, que nul homme de
sa compagnie ne tînt aucune femme diffamée ou
concubine.» Néanmoins l’usage fut plus fort que sa
volonté, et quelques-unes de ces femmes, qui se
sentaient appuyées par leurs amants, essayèrent de
braver les ordres de la Pucelle. Celle-ci, dans une
revue que Charles VII passait à Sancerre avant son
départ pour Reims, aperçut «plusieurs femmes
desbauchées qui empeschoient aucuns gens d’armes
de faire diligence au service du roy,» elle tira son
épée de Fierbois et courut sur ces misérables, qu’elle
frappa de si bon cœur, que l’épée se brisa en éclats
sur leurs épaules. Charles VII fut très-chagrin de
cet accident, et il dit à Jeanne qu’elle aurait mieux
fait de prendre un bâton pour frapper dessus, plutôt
que de perdre ainsi une épée qui lui était venue
par miracle. La Pucelle comprenait que la présence
d’une femme nuisait à la discipline dans l’armée, et
elle s’était vêtue en homme pour ne pas exciter la
concupiscence charnelle de ses compagnons d’armes.
«Me semble, disait-elle, qu’en cet estat je
conserverai mieux ma virginité de pensée et de fait.»
Sa virginité, en effet, ne reçut pas d’atteinte, quoique
plusieurs grands seigneurs fussent «deliberez de
sçavoir se ilz pourroient avoir sa compagnie charnelle;»
mais, quand ils se présentaient à elle, gentiment
habillée, «toute mauvaise volonté leur cessoit.»
L’ordonnance de Jeanne d’Arc contre les ribaudes
[310]
de la milice ne pouvait pas lui survivre; et ce ne
fut qu’une exception dans la vie des gens de guerre,
qui ne se séparèrent plus de leurs concubines. Il est
possible que cette quantité de femmes dissolues attachées
au service permanent d’une armée eut quelquefois
une influence favorable sur les conséquences
ordinaires d’une prise de ville, car le soldat, ayant
sa maîtresse parmi les filles publiques de l’armée,
se montrait moins ardent à outrager et à violer ses
prisonnières. Quoi qu’il en soit, le nombre des femmes
amoureuses, enrôlées, pour ainsi dire, sous le
drapeau d’un capitaine, diminuait ou augmentait
en raison des succès ou des revers de l’expédition.
Dans un temps où le pillage était une condition inévitable
de la guerre, ces prostituées attiraient à elles
la meilleure part du butin. Plus une armée était
bien équipée, bien approvisionnée, bien payée,
plus la Prostitution y affluait de toutes parts. Aussi
la belle armée que Charles-le-Téméraire, duc de
Bourgogne, conduisit en personne dans le pays des
Suisses, en 1476, était-elle amplement fournie de
renfort féminin, et, après la défaite de Granson, les
vainqueurs trouvèrent dans le camp du duc, raconte
Philippe de Comines, «grandes bandes de valets,
marchands et filles de joyeux amour;» mais
les Suisses furent peu sensibles à ce genre de capture:
car, ajoute Comines, «les messieurs des Ligues
ramassèrent, chacun son saoul, piques, coulevrines,
armures, preciosetés; et pour ce qui regarde les
[311]
deux mille courtisanes, joyeuses donzelles, délibérant
que telles marchandises ne bailleroient pas
grand profit aux leurs, si les laissèrent courir à travers
champs.» Malgré cette indifférence pour les
courtisanes flamandes et bourguignonnes, les Suisses
ne menaient pas sous les drapeaux une vie plus
austère que leur ennemi; car, en temps de paix, on
entretenait dans les villages, aux frais de la commune,
un certain nombre de filles de joie, qui, en
temps de guerre, étaient attachées corporellement
aux compagnies et aux bandes de chaque Canton.
(Rec. d’édits et d’ordonn. royaux, par Neron et Girard,
1720, in-f., t. I, p. 643.)
Revenons à la chevalerie, qui ne donnait pas
toujours l’exemple de la chasteté et de la continence.
Les chevaliers, qui filaient le parfait amour avec
les dames et damoiselles, et qui n’en obtenaient
que des dons honnêtes, des baisers quelquefois,
mais rarement ce qu’on appelait le don d’amour en
sa merci, se dédommageaient de ces privations avec
des servantes et des fillettes. C’était même un usage
d’hospitalité que de garnir la couche d’un chevalier
qui demandait asile dans un château. Lacurne de
Sainte-Palaye cite, à propos de cet usage courtois,
un extrait fort curieux d’un fabliau (Ms. du Roi,
no 7,615, fol. 210), dans lequel une dame qui a
reçu chez elle un chevalier ne veut pas s’endormir
sans lui envoyer une compagne de lit.
Et la comtesse à chief se pose,
[312]
Apele un soun (sienne) pucelle,
La plus cortoise et la plus belle;
A consoil (en secret) li dis: Belle amie,
Alez tost, ne vous ennuit mie!
Avec ce chevalier gesir (coucher)...
Si le servez, s’il est metiers (besoin).
Je isa lassa volontiers,
Que ja ne laissasse pour honte,
Ne fust pour monseigneur le conte
Qui n’est pas encore endormiz....
La dame châtelaine était sans doute peu rigoriste,
et la lecture de l’Art d’amour, composé par le trouvère
Guiart (Ms. du Roi, no 7,615, fol. 178 et s.),
ce poëme qui contient les leçons d’amour les plus
dissolues avait pu façonner la dame à ce genre de
complaisance. On peut présumer que de pareilles
coutumes hospitalières ne se rencontraient pas dans
tous les châteaux. Un poëte du treizième siècle nous
sert de garant à cet égard, et la manière dont il
attaque la Prostitution des villes nous permet de
supposer qu’il la comparait tacitement à la décence
des mœurs chevaleresques. Voici ce passage intéressant,
que Lacurne de Sainte-Palaye a tiré d’un
Ms. de la Bibliothèque Nationale (Fonds du Roi,
no 7,615, fol. 140).
Qui reson voudroit faire! l’on devroit, par saint Gille!
Riche femme qui sert de baval et de guile (tromperie),
Et qui pour gaignier vent son corps et aville (avilit),
Chacier hors de la ville aussi com un mesel (lépreux),
S’en souloit (si on avait coutume) maintes femmes, par maintes achoisons,
Chacier hors de la ville, c’estoit droiz et resons:
[313]
Or est venu le temps et or est la resons.
Plus a partout bordiaux qu’il n’a autres mesons.....
Les lois municipales mirent un frein à la Prostitution,
comme nous l’avons dit, et la noblesse, que
la chevalerie avait généralement amendée, se distingua
du peuple et de la bourgeoisie par des mœurs
plus régulières et plus honnêtes, du moins en apparence.
Mais la bourgeoisie et le peuple s’amendèrent
à leur tour, pendant que la chevalerie tombait en
décadence et que les nobles s’abandonnaient à tous
les désordres qu’ils avaient évités jusque-là; ils se
piquaient toutefois d’être aussi bons chevaliers que
leurs prédécesseurs. Ce fut sous le règne de Charles
VI que commença cette décadence des mœurs
chevaleresques. Un poëte de ce règne, Eustache
Deschamps, compare la conduite des anciens preux
à celle de ses contemporains:
Les chevaliers estoient vertueux
Et pour amours plains de chevalerie,
Loyaux, secrez, frisques et gracieux:
Chascuns avoit lors sa dame, s’ amie,
Et vivoient liement (joyeusement);
On les amoit aussi très loyalment,
Et ne jangloit (jasait), ne mesdisoit en rien.
Or m’esbahy quant chascun jangle et ment,
Car meilleur temps fut le temps ancien!
Les plaintes d’Eustache Deschamps n’étaient que
trop justes en présence des orgies de la cour, où
Charles VI et son frère, le duc d’Orléans, qui se
vantaient de maintenir la vraie chevalerie, semblaient
[314]
en avoir oublié les préceptes vertueux. Les
tournois célébrés en 1389 à Saint-Denis en l’honneur
du roi de Sicile et de son frère, qui furent armés
chevaliers, se terminèrent par une hideuse saturnale,
dont l’abbaye fut le théâtre. Le religieux
de Saint-Denis, dans sa Chronique de Charles VI,
n’a pas cru devoir passer sous silence les désordres
de la quatrième nuit: «Les seigneurs, dit-il, en
faisant de la nuit le jour, en se livrant à tous les
excès de la table, furent poussés par l’ivresse à de tels
déréglements, que, sans respect pour la présence du
roi, plusieurs d’entre eux souillèrent la sainteté de
la maison religieuse et s’abandonnèrent au libertinage
et à l’adultère (ad inconcessam venerem et adulteria
nefanda prolapsi sunt).
Les maisons religieuses, à cette époque, avaient
des mœurs aussi mauvaises que la cour du roi et
des princes; l’Église était tombée au même degré
de décadence que la chevalerie, et la société tout
entière semblait aller à sa dissolution. Nous ne voulons
pénétrer dans les couvents que pour soulever
le voile qui couvrait les vices des moines et des
nonnains. La Prostitution s’était emparée de la maison
du Seigneur, comme de la maison des grands de la
terre. Les prédicateurs, en ce temps-là, répétaient
souvent ces paroles de l’ange dans l’Apocalypse:
«Venez, je vous montrerai la condamnation de la
grande prostituée qui est assise sur les grandes
eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont corrompus,
[315]
et qui a enivré du vin de la Prostitution
les habitants de la terre.» Rien ne peut rendre, en
effet, les abominations du règne de Charles VI, où
le clergé, la noblesse et le peuple luttaient de perversité
et de turpitude. Que devait être la vie de
cour, lorsque la vie des couvents était aussi déplorable
que nous la dépeint Nicolas de Clémenges, archidiacre
de Bayeux, dans son traité De corrupto
statu ecclesiæ: «A propos de vierges consacrées au
Seigneur, dit ce philosophe chrétien, il nous faudrait
retracer toutes les infamies des lieux de Prostitution,
toutes les ruses et l’effronterie des courtisanes,
toutes les œuvres exécrables de la fornication
et de l’inceste; car, je vous prie, que sont aujourd’hui
(vers 1400) les monastères de femmes, sinon
des sanctuaires consacrés non pas au culte du vrai
Dieu, mais à celui de Vénus; sinon d’impurs réceptables
où une jeunesse effrénée s’abandonne à
tous les désordres de la luxure, de telle sorte que
c’est maintenant la même chose de faire prendre le
voile à une jeune fille ou de l’exposer publiquement
dans un lieu d’abomination!» Nicolas de Clémenges
pousse ici jusqu’à l’hyperbole la critique des mœurs
monacales, mais la démoralisation des ecclésiastiques
n’était que trop éclatante, et l’on ne saurait
dire si c’était l’Église qui démoralisait la chevalerie,
ou la chevalerie qui démoralisait l’Église. Dulaure,
dont le témoignage est généralement suspect, s’appuie
sur des autorités respectables pour esquisser ce
[316]
tableau des mœurs cléricales et chevaleresques:
«Les prélats et les prêtres subalternes étaient ordinairement
vêtus en habits séculiers, portaient l’épée,
joutaient dans les tournois, fréquentaient les cabarets,
entretenaient des concubines. Les prêtres et les
curés occupaient des emplois judiciaires, prêtaient
à usure, s’adonnaient à la débauche et aux excès de
la table. Dans certains diocèses, les grands vicaires
recevaient la permission de commettre l’adultère
pendant l’espace d’une année; dans d’autres, on pouvait
acheter le droit de forniquer impunément dans
tout le cours de sa vie: l’acheteur en était quitte
en payant chaque année à l’official une quarte de
vin; et lorsque l’âge le rendait incapable d’user de ce
privilége, il n’en était pas moins tenu de payer la
taxe.» C’était dans les décrétales des papes, que
l’officialité trouvait le pouvoir étrange qu’elle s’arrogeait
sur le péché d’impureté; le canon De dilectissimis
exhorte les chrétiens à la pratique de cet axiome:
Tout est commun entre amis; même les femmes,
ajoute-t-il. On eut l’audace de présenter requête au
pape Sixte IV pour obtenir la permission de commettre
le péché infâme pendant les mois caniculaires,
et Sixte IV écrivit au bas de la requête: Soit fait
ainsi qu’il est requis (Hist. de France, par l’abbé
Velly, t. V, p. 10 et suiv.)!
Il est vraiment remarquable que jamais les ordonnances
royales et municipales contre la Prostitution
ne furent plus fréquentes ni plus sévères que pendant
[317]
cette période de déréglement. On se montrait
sans pitié pour les filles publiques, lorsque la décence
et la pudeur semblaient bannies des mœurs,
lorsque les vêtements dissolus étaient seuls à la
mode, en dépit des édits somptuaires. On avait repris
avec les souliers à la poulaine ces ornements
obscènes qui les décoraient au douzième siècle, à la
cour de Normandie, suivant Orderic Vital, et les ornements
en question s’étaient allongés et mieux caractérisés.
Les femmes n’osèrent pas, il est vrai, adopter
les accessoires de cette vilaine chaussure; mais,
en revanche, elles eurent des robes fendues ou relevées
qui laissaient entrevoir la jambe, et même la
cuisse nue: quant à la gorge, elles la découvraient
jusqu’au bout du sein. L’auteur du Chastoiement des
dames, Robert de Blois, leur reproche ces modes
impudiques.
Aucune lesse differmée
Sa poitrine, pource c’on voie
Comme fetement sa chair blanchoie;
Une autre lesse tout de gré
Sa chair apparoir au costé:
Une ses jambes trop descuevre.
Prud hom ne loe pas cette œvre.
Les cérémonies de l’Église, les processions surtout,
participaient à cette immodestie des vêtements.
On voyait figurer, dans les processions et les pénitences
publiques, des hommes et des femmes entièrement
nus: «Parmi ces pénitents, dit le partial
auteur de l’Histoire de Paris, les uns portaient dans
[318]
leurs chemises des pierres enchaînées; les autres,
sans chemises, étaient flagellés ou piqués aux fesses
avec des aiguillons.» Ici Dulaure n’invente rien,
n’exagère rien, et il peut renvoyer son lecteur avec
confiance au Glossaire de Ducange et Carpentier
(aux mots penitentiæ, processiones, villaniæ, lapides
catenatos ferre, putagium, naticæ, etc.). Nous supposons
que les pénitentes qui suivaient les processions,
dans un état complet de nudité, et qui se faisaient
piquer avec des aiguillons, devaient être des
prostituées, ainsi que celles qui portaient des pierres
dans leur chemise. C’étaient là, en effet, les châtiments
habituels que la justice séculière prononçait à
l’égard des adultères et des femmes de mauvaise
vie. Dulaure nous en fournit un exemple mémorable
qu’il emprunte aux registres criminels du parlement
de Paris (registre VIII). Anne Piedeleu, femme amoureuse,
tenait un lieu de débauche dans la rue Saint-Martin,
elle était donc en contravention avec les
ordonnances de la prévôté; et le prévôt qui était en
charge alors (1373), le fameux Hugues Aubriot,
faisait exécuter les ordonnances avec beaucoup de
vigueur. Les bourgeois du voisinage allèrent dénoncer
Anne Piedeleu à la prévôté, et aussitôt les sergents
firent déloger cette femme, en usant d’indulgence
pour elle, puisqu’elle ne fut pas même menée
en prison. Elle se sentait sans doute soutenue par
quelque personnage capable de tenir tête au prévôt,
car elle porta plainte contre ce magistrat en l’accusant
[319]
de plusieurs crimes et en produisant de faux
témoins pour le perdre. Le parlement, au mois de
février 1374, sur les conclusions de l’avocat du roi,
condamna Anne Piedeleu à être promenée par la
ville, toute nue, ayant sur la tête une couronne
de parchemin où était écrit ce mot: faussaire. On
la conduisit en cet état au pilori des Halles, où
elle fut exposée deux heures aux regards du peuple;
elle ne sortit de prison que pour être bannie de
Paris et du royaume. Les promenades de ce genre
devaient être assez fréquentes, et la populace y
courait avec un joyeux empressement. Comme les
ribaudes et les maquerelles qu’on livrait de la sorte
à l’indécente curiosité des badauds de Paris grelottaient
de froid et toussaient souvent en marchant
toutes nues dans la boue à travers les intempéries
de la saison, les spectateurs, et surtout les enfants,
avaient coutume de chanter une chanson composée
pour la circonstance. Cette chanson ordurière, qui
se conserva longtemps dans la mémoire du bas
peuple, finissait par ce refrain, que rapporte le
Journal du Bourgeois de Paris:
Votre c.. a la toux, commère,
Votre c.. a la toux, la toux!
Il était tout simple que les plus impudentes de
ces femmes qu’on menait au pilori répondissent aux
chanteurs par des injures, entre lesquelles n’étaient
point épargnées les imprécations et les malédictions.
[320]
Aussi quand une toux épidémique se répandit dans
la population parisienne, durant l’hiver de l’année
1413, ceux qui n’avaient point encore gagné cette
toux cruelle ou qui en étaient guéris raillaient ceux
qu’ils entendaient tousser à se «rompre les génitoires,»
et leur disaient par esbattements: «En as-tu?
Par ma foi! tu as chanté: Votre c.. a la toux,
commère.» On faisait ainsi allusion aux maux de
toute espèce, tel que le mal saint-main, la lèpre,
la gale, la toux, etc., que souhaitaient aux mauvais
plaisants les malheureuses qu’on ne plaignait pas
de voir s’enrhumer au pilori. On n’avait aucune
compassion pour ces pécheresses, comme nous l’avons
fait observer, et les petits enfants étaient les
plus acharnés à les persécuter. L’autorité croyait se
conformer au sentiment unanime, en n’accordant
pas la moindre indulgence à ces pauvres filles. Cependant
il y eut un prévôt de Paris qui les prit sous
sa protection et qui leur donna peut-être trop d’appui.
Ce fut Ambroise de Loré, baron de Juilly, qui
fut nommé prévôt en 1436 et qui mourut en 1445
dans l’exercice de sa charge. Le peuple de la capitale
ne lui pardonna pas d’avoir favorisé la Prostitution,
en laissant tomber en désuétude les anciens
règlements qui la régissaient. Tant que dura son
administration, les prostituées furent à peu près
libres; elles s’habillaient à leur guise et logeaient
partout dans la ville. Ambroise de Loré, à son lit
de mort, se repentit d’avoir été si paterne pour ces
[321]
créatures, et il essaya de réparer le désordre qui
s’était introduit dans la police des mœurs. «La semaine
devant l’Ascension, raconte le Bourgeois de
Paris dans son Journal, fut crié parmy Paris, que
les ribaudes ne porteroient plus de sainctures d’argent,
ne de collez renversés, ne pennes de gris en
leurs robes, ne de menuvair, et qu’elles allassent
demourer ès borderaulx, ordonnez comme ils estoient
au temps passé.» Cette satisfaction tardive donnée
à l’opinion ne fit pas oublier les scandales qui l’avaient
précédée, et quand Ambroise de Loré mourut
peu de jours après, le Bourgeois de Paris se chargea
de son oraison funèbre, et le représenta comme
«moins aimant le bien commun, que nul prévost
que devant luy eust esté puis quarante ans.» Le
Bourgeois ajoute que ce prévôt avait une des plus
belles et des plus honnêtes femmes du monde, mais,
néanmoins, «il estoit si luxurieux, qu’on disoit, pour
vray, qu’il avoit trois ou quatre concubines qui
estoient droites communes, et supportoit partout les
femmes folieuses, dont trop avoit à Paris, par sa
lascheté, et acquit une très-mauvaise renommée
de tout le peuple; car à peine povoit-on avoir droit
des folles femmes, tant les supportoit et leurs maquerelles.»
Ambroise de Loré, avant d’être prévôt de Paris
et de lâcher la bride aux femmes folieuses, était un
des plus braves chevaliers de l’ost de Charles VII,
mais ses prouesses d’armes ne l’avaient point rendu
[322]
plus vertueux, quoiqu’il fût contemporain de plusieurs
bons chevaliers, de vie exemplaire et de
mœurs honnêtes. Il avait passé sa jeunesse à la
cour de Charles VI, où l’on faisait consister la chevalerie
en tournois et en mascarades; il n’appartenait
pas à cette famille de chevaliers chastes et continents,
qui, comme le maréchal de Boucicaut,
pensaient que «luxure est plus que chose du monde
contraire à vaillant homme d’armes.» Le bon messire
Jehan le Maingre, dit Boucicaut, ne se départit
même pas de sa continence, lorsqu’il fut gouverneur
de Gênes, où les occasions de plaisir venaient sans
cesse le chercher: «Les vertus qui sont contraires
à lubricité sont en luy,» disait son biographe
secrétaire; il ne songeait guère à débaucher les
Génoises, «car plus de semblant n’en fait, que si
pierre estoit, nonobstant que les dames y soyent
bien parées et bien attifées, et que moult de belles
en y ait.» Un jour qu’il chevauchait avec ses gentilshommes
dans la ville de Gênes, une dame, qui peignait
ses cheveux blonds, se mit à la fenêtre pour
le voir passer; il n’y prit pas garde; mais un de ses
écuyers la remarqua et ne put s’empêcher de dire:
«Oh! que voilà beau chef!» Le maréchal eut l’air
de ne pas entendre; mais, comme l’écuyer se retournait
encore pour regarder la dame, il lui dit avec
un regard glacial: «C’est assez fait!» Le biographe
qui a recueilli les faits de Boucicaut ajoute cette
réflexion: «Ainsi, de fait et de semblant, le mareschal
[323]
est net de celuy vice de charnalité et de
toute superfluité, qui est parfait signe de sa continence.»
Boucicaut, il est vrai, avait été nourri à la cour
de Charles V, qui, entre toutes les vertus, dit son
historiographe, Christine de Pisan, «amoit celle de
chasteté, laquelle estoit de luy gardée en fait, en
dict, et en pensée.» Charles V, si sévère à cet égard
pour lui-même, l’était également pour ses serviteurs,
et voulait qu’ils fussent chastes, «tant en
continences comme en habits, parolles, et faits et
toutes choses.» Lorsqu’il apprenait qu’un de ses
officiers avait déshonoré femme, fût-ce son favori, il
le chassait de sa présence et le dispensait à toujours
de son service. Cependant il ne manquait pas de
charité chrétienne pour les pécheurs, et, «considérant
la fragilité humaine,» il ne consentit jamais à
ce qu’un mari «emmurast sa femme à pénitence
perpétuelle, pour meffaict de son corps;» il permettait
seulement de la tenir enfermée dans une
chambre, si elle était trop déshonorée, afin qu’elle
ne fît pas honte à son époux et à ses parents. Il défendait
que des livres déshonnêtes fussent introduits
et lus à la cour de la reine et des princes. On lui
rapporta, un jour, qu’un chevalier de la cour avait
instruit le dauphin à amour et vagueté: il renvoya
ce chevalier, et lui défendit de jamais paraître devant
sa femme et ses enfants. Christine de Pisan,
qui a consigné ces particularités dans le Livre des
[324]
faits et bonnes mœurs du feu roi Charles, nous apprend
qu’il ne souffrait pas à sa table les gouliars de
bouche, aportant paroles vagues, et qu’il regardait les
jeux des ménétriers comme des introductions à la
luxure; il répétait souvent la parole de saint Paul,
dans une épître aux Corinthiens: «Les parolles
maulvaises corrompent les bonnes mœurs.» Le
règne de Charles VI et une partie de celui de Charles
VII furent souillés de tous les vices et de tous
les crimes que Charles V avait essayé de faire disparaître
de son royaume; et la Prostitution, que
ce sage roi réprimait surtout par son exemple, ne
connut plus de barrières ni de limites.
Pour se rendre compte du degré de perversité
auquel étaient parvenus quelques nobles, quelques
grands seigneurs, qui s’abandonnaient à toutes les
aberrations de la débauche, il faut lire, dans les
archives de Nantes, le procès criminel de Gilles de
Retz, maréchal de France, condamné au feu en 1440.
Gilles de Retz était un des plus puissants seigneurs
de la Bretagne; il avait vaillamment servi Charles VII
pendant la guerre des Anglais; il avait combattu,
avec Dunois et Lahire, sous la bannière de Jeanne
d’Arc; il était docte et lettré. Mais la lecture de Suétone
l’avait excité à imiter les monstrueuses débauches
des empereurs romains: comme Tibère et Néron,
il se passionna pour le sang mêlé à l’ordure;
il n’eut plus d’autre passe-temps que de flétrir de ses
abominables caresses les pauvres enfants qu’il faisait
[325]
enlever de tous côtés: quand ils étaient beaux
et joliets, il les attachait à sa personne ou il les
égorgeait de ses propres mains. La superstition et la
magie étaient les auxiliaires de ses cruautés et de
ses souillures: il avait une chapelle magnifique,
avec des chantres et des chanoines qu’il nourrissait
bien, et, en même temps, il avait des sorciers et des
magiciens à sa solde, avec lesquels il faisait des invocations
au diable. Cet exécrable homme, qui eut
plus d’une analogie avec un autre scélérat que nous
verrons plus tard (le marquis de Sade), fut enfin
déféré à la justice, arrêté avec les principaux agents
de ses forfaits et jugé par un tribunal extraordinaire,
nommé à cet effet par le duc de Bretagne, son cousin.
L’enquête révéla des horreurs que confirmèrent
les dépositions des témoins. On trouva, dans les souterrains
des châteaux de Chantocé, de la Suze, d’Ingrande,
etc., les ossements calcinés et les cendres
des enfants que le maréchal de Retz avait assassinés,
après avoir abusé d’eux. Il ne tarda pas à tout
avouer lui-même, et, ne pouvant espérer sa grâce
du tribunal des hommes, il demanda pardon au Juge
éternel devant lequel il allait comparaître.
Les dépositions des complices de Gilles de Retz
nous initient aux scènes horribles dont le vieux château
de Chantocé était le théâtre. Henriet, chambellan
du maréchal, déclare «que Gilles de Sillé et Pontou
ont livré plusieurs petits enfans audit sire de Rais
en sa chambre: desquels petits enfans il avoit habitation,
[326]
et s’y eschauffoit, et rendoit nature sur leur ventre,
et y prenant sa plaisance et délectation, qu’il
n’avoit habitation de l’un desdits enfans que une
fois ou deux, et que, après, celui sire, aucunes
fois de sa main leur coupoit la gorge, et aucunes
fois, Gilles de Sillé, Henriet et Pontou la leur coupoient,
en la chambre dudit sire: dont le sang cheoit
à la place, qui après estoit nettoyée; et que ceux
enfans, ainsi morts, estoient ars en ladite chambre
dudit sire, après qu’il estoit couché, et la poudre
d’eux jettée, et que celui sire prenoit plus grande
plaisance à leur couper la gorge, qu’à avoir habitation
d’eux.» Henriet, interrogé derechef sur ces
infâmes mystères, compléta ses premiers aveux par
de nouveaux détails; il raconta «avoir ouï dire audit
sire de Rais, qu’il estoit bien aise de voir séparer
la teste des enfans, après avoir eu habitation sur le
ventre, ayant les jambes entre les siennes, et autrefois
se seoir sur le ventre desdits enfans quand on
séparoit la teste de leurs corps, et par autre fois les
inciser sur le cou par derrière pour les faire languir,
où il prenoit grande plaisance, et en languissant,
avoit aucune fois habitation d’eux jusques à la mort,
et aucune fois après qu’ils estoient morts, tandis
qu’ils estoient chauds; et y avoit un braquemart à
leur couper la teste, et quant aucune fois ceux enfans
n’étoient beaux à sa plaisance, il leur coupoit
la teste, de luy-mesme, avec ledit braquemart, et
après avoit aucune fois habitation d’eux. Il disoit
[327]
qu’aucun homme en la planète ne pouvoit savoir ou
faire ce qu’il faisoit. Aucune fois celui sire faisoit
desmembrer lesdits enfans par les aisselles et prenoit
plaisance à en voir le sang.
»Item, celui sire, affin de garder lesdits enfans de
crier quand il vouloit avoir habitation d’eux, leur
faisoit, par avant, mettre une corde au cou et les pendre,
comme à trois pieds de haut, à un coin de sa
chambre, et avant qu’ils fussent morts, les descendoit
ou les faisoit descendre, disant qu’ils ne sonnassent
mot et qu’ils eschauffoient son membre, le tenant
en la main; et, après, leur rendoit nature sur le ventre,
et ce fait, leur faisoit couper la gorge et séparer
la teste de leurs corps.» Ces effrayants aveux
furent confirmés par Estienne Cornillaut, dit Pontou,
le favori du maréchal et un de ses complices. Pontou
n’attendit pas qu’il fût appliqué à la question pour
confesser les crimes de son maître et les siens; il
ajouta quelques faits nouveaux à ceux que Henriet
avait dénoncés. Ainsi, le sire de Retz donnait deux
ou trois écus par chaque enfant qu’on lui procurait;
quelquefois, il choisissait lui-même les enfants et les
faisait entrer secrètement dans un de ses châteaux.
«Il prenoit aucune fois de petites filles, desquelles
il avoit habitation sur le ventre, ainsi que des enfans
mâles, disant qu’il y prenoit plus grande plaisance
et moins de peine qu’à le faire esdites filles en leur
nature. Quant on lui menoit deux enfans ensemble,
afin que l’un pour l’autre ne criât, après s’estre esbattu
[328]
avec l’un, il gardoit l’autre jusqu’à ce que son
appétit fut venu.» Gilles de Retz, après des dépositions
si explicites, n’avait plus rien à faire, qu’à en
constater la sincérité. Il avoua donc avoir abusé des
enfants, «pour son ardeur et délectation de luxure,
et les avoir fait tuer par ses gens, soit en leur coupant
la gorge avec dagues et couteaux, en séparant
la teste de leurs corps, ou leur rompant les testes à
coups de baston, ou autres choses; et aucune fois leur
enlevoit ou faisoit enlever des membres, les fendoit
pour en avoir les entrailles, les faisoit attacher à un
croc de fer, pour les estrangler et les faire languir;
comme ils languissoient à mourir, avoit habitation
d’eux, et aucune fois après qu’ils estoient morts en
les baisant, et prenoit plaisir et délectation à voir
les plus belles testes desdits enfans, lesquels, en
après, estoient ars.» On lui demanda quand et comment
il s’était avisé de ces atrocités inouïes pour la
première fois; il répondit «qu’il commença ce train
de vie, à Chantocé, l’année que son aïeul le sire de
la Suze alla de vie à trespas, et, de lui mesme et de sa
teste, sans conseil d’autrui, il prist imagination de
ce faire, seulement pour la plaisance et délectation
de luxure, sans autre intention.»
En écoutant ces aveux prononcés de l’air le plus
calme, les juges tressaillaient sur leurs siéges et se
signaient à chaque instant. Ce monstre fut condamné
avec ses complices, mais il ne se troubla pas, et il les
encouragea paternellement à faire une bonne mort,
[329]
pour qu’ils pussent se revoir tous en la grant joie du
paradis. Il subit sa peine le 26 octobre 1440, dans
une prairie située au-dessus des ponts de Nantes; et
dès qu’il eut été étranglé sur le bûcher allumé, on
rendit son corps à sa famille, et des damoiselles de
grand estat vinrent chercher ce corps souillé, le mirent
dans le cercueil et le portèrent solennellement à
l’église des Carmes, où il fut enterré, en laissant
parmi les spectateurs de son supplice le souvenir de
sa repentance et de sa fin chrétienne.

Sommaire.—Apparition des maladies vénériennes en France.—Origine
de la syphilis ou mal français.—Ses progrès effrayants
vers la fin du quinzième siècle.—Marche du mal vénérien à
travers le moyen âge.—Ses noms différents.—L’éléphantiasis
et les autres dégénérescences de la lèpre.—La mentagre et les
dartres sordides.—Lues inquinaria ou inguinaria.—Pèlerinages
dans les lieux saints.—L’église de Notre-Dame de Paris.—Le
feu sacré.—Vice des Normands.—Le mal des ardents.—Ses
ravages effrayants.—Le mal de saint Main et le feu de
saint Antoine.—Invocations à saint Marcel et à sainte Geneviève.—La
syphilis du quinzième siècle.—Les lépreux et les
léproseries.—Les croisés et la mésellerie.—Rigoureuse police
de salubrité à laquelle on soumit les lépreux.—Du caractère
le plus général de la lèpre, d’après Guy de Chauliac, Laurent
Joubert, Théodoric, Jean de Gaddesden, etc., etc.
L’apparition ou plutôt le développement des maladies
vénériennes en France, comme dans toute
l’Europe, changea en quelque sorte la face de la
Prostitution légale et faillit amener sa ruine définitive.
[332]
En voyant ces terribles maladies attaquer dans
son principe la société tout entière, les hommes les
plus éclairés et les plus libres de préjugés purent
croire que la débauche publique était l’unique cause
d’un pareil fléau, tandis que les esprits prévenus et
crédules regardaient ce fléau comme une punition du
ciel, frappant l’incontinence dans ce qu’elle avait
de plus cher. Alors les magistrats se repentirent
d’avoir autorisé et organisé l’exercice du péché qui
entraînait de si fatales conséquences, et le premier
remède qu’ils opposèrent à l’invasion de cette nouvelle
peste fut la suspension des règlements de tolérance,
en vertu desquels il y avait dans chaque ville
un foyer permanent d’infection morbide. Mais on
jugea bientôt inutile d’arrêter le cours régulier de
la Prostitution, quand on eut reconnu que la source
du mal n’était pas seulement dans les mauvais lieux.
On prit toutefois des mesures de police sanitaire que
la nécessité n’avait pas encore prescrites, et l’on
soumit à l’enquête des médecins la vie dissolue des
femmes communes. Ce fut une amélioration notable
dans le régime de la tolérance pornographique, et,
depuis cette époque, l’administration municipale eut
à se préoccuper sérieusement de la santé publique
dans toutes ces questions délicates qui n’avaient
intéressé jusqu’alors que la morale et l’ordre public.
Nous devons traiter ici de l’origine de la syphilis,
puisque les circonstances ont fait que le nom de
mal français lui fut donné au moment de son explosion
[333]
en Europe, et puisque ce nom se rattache, en
effet, aux événements qui accompagnèrent son entrée
en France; mais nous nous proposons d’abord de
poursuivre une thèse que nous avons déjà soutenue
sur l’ancienneté des maladies vénériennes. Sans
doute, ces maladies, de même que la plupart des
épidémies et des contagions, subirent une foule de
métamorphoses, notamment dans leurs symptômes,
en raison de la variété des conditions locales atmosphériques
et naturelles qui présidaient à leur naissance;
sans doute, ce hideux fléau, que la science,
après trois siècles et demi d’études approfondies,
considère toujours comme un protée insaisissable,
n’avait pas, avant l’année 1493 ou 1496, les caractères
effrayants, et surtout le virus propagateur,
qu’on observa pour la première fois à cette époque,
où les cas d’exception devinrent des cas généraux.
Toutefois, le mal vénérien existait, le même mal,
depuis la plus haute antiquité, comme nous l’avons
démontré, et l’on ne se fût pas inquiété de lui plus
que de toute autre maladie chronique, si une réunion
de circonstances imprévues et inappréciables
ne lui avait communiqué tout à coup les moyens de
se répandre, de se multiplier, de s’aggraver avec
une sorte de fureur. Nous avons prouvé, d’après le
témoignage de Celse, d’Arétée et des plus illustres
médecins grecs et romains, que la véritable syphilis,
qu’on s’obstine à faire contemporaine de la découverte
de l’Amérique, n’avait pas tardé à suivre à
[334]
Rome la lèpre et les maladies cutanées qui furent
apportées d’Asie et d’Afrique avec les dépouilles
des peuples conquis. Il n’était pas difficile de faire
comprendre, en remontant à ces prémices morbifiques,
que l’épouvantable débauche romaine avait
réchauffé dans son sein les germes de toutes les
affections vénéréiques, et que leur impur mélange
avait créé des maux inconnus qui retournaient sans
cesse à leur source en la corrompant toujours davantage.
Nous persistons à croire, cependant, que la
transmission du virus n’était pas aussi prompte ni
aussi fréquente qu’elle l’est devenue dans les temps
modernes, et il est probable, en outre, que les anciens
qui possédaient plus de cinq cents espèces de collyres
pour les maux d’yeux avaient autant de
recettes curatives pour les infirmités de l’amour.
Nous allons, à travers le moyen âge, signaler la marche
éclatante du mal vénérien sous des noms différents,
jusqu’à ce qu’il soit arrivé à sa dernière
transformation avec le nom de grosse vérole.
Ce mal obscène a toujours existé à l’état chronique
chez des individus isolés; il s’est reproduit
par contagion, avec une grande variété d’accidents
résultant du tempérament des malades et dérivant
d’une foule de circonstances locales qu’il serait impossible
d’énumérer ou de caractériser; mais il prenait
toujours son germe dans un commerce impur,
et il ne se développait pas de lui-même, sans cause
préexistante d’infection, au milieu de l’exercice
[335]
modéré des rapports sexuels. La Prostitution était le
foyer le plus actif de cette lèpre libidineuse, qui se
répandait avec plus ou moins de malignité suivant
le pays, la saison, le sujet, etc. Il n’y avait que
les débauchés qui allassent se gâter à cette honteuse
source, et le mal restait en quelque sorte circonscrit
et confiné parmi ces êtres dégradés qui n’avaient
aucun contact avec les honnêtes gens. Cependant,
à certaines époques, et par suite d’une
agrégation de faits physiologiques, la maladie
s’exaspérait et sortait de ses limites ordinaires, en
s’associant à d’autres maladies épidémiques ou contagieuses;
elle se multipliait alors avec les symptômes
les plus affreux, et elle menaçait d’empoisonner
la population tout entière qu’elle décimait;
après avoir fait des ravages manifestes et cachés
elle s’arrêtait, elle s’assoupissait tout à coup. Ce
n’était jamais la médecine qui s’opposait à sa marche
occulte et qui la combattait en face par des remèdes
énergiques, c’était la religion, qui ordonnait des
pénitences publiques et qui éloignait ainsi les périls
de la contagion, en faisant la guerre au péché qui
en était la cause immédiate. La privation absolue
des joies de la chair, pendant un laps de temps assez
considérable, était le remède le plus efficace que le
clergé ou plutôt l’épiscopat français, si prévoyant
et si ingénieux à faire le bien du peuple, eût imaginé
contre les progrès du fléau pestilentiel. Durant
ces longues crises de la santé publique, il faut dire
[336]
que la Prostitution légale disparaissait complétement:
les mauvais lieux étaient fermés; les femmes
communes devaient, sous peine de châtiment arbitraire,
s’interdire leur dangereux métier, et la police
municipale avait des prescriptions si sévères à cet
égard, que dès le début d’une épidémie au seizième
siècle, on chassait ou l’on emprisonnait toutes les
femmes suspectes, et on les tenait enfermées jusqu’à
ce que le mal eût disparu.
N’oublions pas de constater que le climat de la
Gaule n’était que trop favorable aux maladies pestilentielles
et à toutes les affections de la peau. D’immenses
marécages, des forêts impénétrables, entretenaient
sur tous les points du territoire une humidité
putride et malsaine, que les chaleurs de l’été chargeaient
de miasmes délétères et empoisonnés. Le
sol, au lieu d’être assaini par la culture, dégageait
incessamment des émanations morbides. La nourriture
et le genre de vie des habitants ne s’accordaient
guère, d’ailleurs, avec les préceptes de l’hygiène: ils
couchaient par terre, sur des peaux de bêtes, sans
autre abri que des tentes de cuir ou des cabanes de
branchages; ils mangeaient peu de pain et beaucoup
de viande, beaucoup de poisson, beaucoup de
chair salée, car ils nourrissaient de grands troupeaux
de porcs noirs sur la lisière des bois druidiques.
On ne s’étonnera donc pas que l’éléphantiasis
et les autres hideuses dégénérescences de la
lèpre fussent déjà bien acclimatées dans les Gaules
[337]
au deuxième siècle de l’ère moderne. Le savant
Arétée, qui paraît avoir écrit sous Trajan le traité
De Curatione elephantiasis, dit que les Celtes ou
Gaulois ont une quantité de remèdes contre cette
terrible maladie, et qu’ils emploient surtout de petites
boules de nitre avec lesquelles ils se frottent le
corps dans le bain. Marcellus Empiricus, qui exerçait
la médecine à Bordeaux du temps de l’empereur
Gratien, rapporte que le médecin Soranus avait entrepris
de guérir, dans la province Aquitanique
seulement, deux cents personnes attaquées de la
mentagre et de dartres sordides qui se répercutaient
par tout le corps. Nous avons prouvé que le mal vénérien
n’était qu’une forme de la lèpre contractée
dans l’habitude des rapports sexuels. Nous avons
laissé entendre comment d’abominables aberrations
des sens avaient pu, en cas exceptionnel, centupler
les forces du virus, en le portant dans les parties de
l’organisme les moins propres à le recevoir; nous
avons enfin appliqué aux origines de l’éléphantiasis
les suppositions que nous verrons remettre en avant,
par les médecins du quinzième siècle, à l’occasion du
mal de Naples, dans lequel on voulut reconnaître
les monstrueux effets des désordres du crime contre
nature.
Ce fut pendant le sixième siècle que le mal vénérien
sévit en France avec les apparences d’une épidémie:
on le nomma lues inquinaria ou inguinaria.
Selon la première dénomination, ce mal était une
[338]
souillure, peut-être une gonorrhée, telle que les
livres de Moïse l’ont décrite (Lévitiq., ch. 15); selon
la seconde qualification de ce mal, que Grégoire
de Tours signale souvent sans indiquer sa nature,
c’était une inflammation des aines, où se formait un
ulcère malin qui causait la mort, après des souffrances
inouïes. Dom Ruinart, dans son édition de
l’Histoire de Grégoire de Tours, note que cet ulcère
inguinal tuait le malade à l’instar d’un serpent
(lues inguinaria sic dicebatur, quod, nascente in inguine
vel in axilla, ulcere in modum serpentis interficeret),
Le Glossaire de Ducange a bien recueilli, dans
l’édition des Bénédictins, les deux noms de cette
pestilence, qui fit sa première apparition en 546
et qui revint plusieurs fois à la charge sur des
populations adonnées aux hideux égarements de la
débauche antiphysique. Mais les doctes éditeurs ont
négligé de faciliter l’interprétation de ces deux
noms, attribués à la même maladie, par le rapprochement
lumineux des passages où il est question
d’elle dans les chroniqueurs contemporains. L’origine
infâme de cette maladie nous paraît assez indiquée
par l’horreur qu’elle inspirait et qui ne résidait
pas seulement dans la crainte de la mort, car ceux
qui en étaient atteints semblaient frappés de la main
de Dieu, à cause de leurs souillures: l’enflure et la
purulence des organes de la génération, les bubons
des aines, le flux de sang des intestins, les abcès
[339]
gangréneux aux cuisses, en disent assez sur la nature
de cette contagion obscène.
Elle reparut avec de nouveaux symptômes en
945, après l’invasion des Normands, qui pourraient
bien n’y avoir pas été étrangers. Flodoard s’abstient
néanmoins de toute conjecture impudique à cet
égard: «Autour de Paris et en divers endroits des environs,
dit-il dans sa Chronique, plusieurs hommes
se trouvèrent affligés d’un feu en diverses parties
de leur corps, qui insensiblement se consumoit jusqu’à
ce que la mort finît leur supplice; dont quelques-uns,
se retirant dans quelques lieux saints,
s’échappèrent de ces tourments; mais la plupart
furent guéris à Paris, en l’église de la sainte mère
de Dieu, Marie, de sorte qu’on assure que tous
ceux qui purent s’y rendre furent garantis de cette
peste, et le duc Hugues leur donnoit tous les jours
de quoi vivre. Il y en eut quelques-uns qui, voulant
retourner chez eux, sentirent rallumer en eux ce
feu qui s’étoit éteint, et, retournant à cette église,
furent délivrés.» Sauval, qui nous fournit cette traduction
naïve, ajoute que, «comme les remèdes ne
servoient de rien, on eut recours à la Vierge, dans
l’église Nostre-Dame, qui servit d’hospital dans cette
occasion.» On trouve, en effet, dans le grand Pastoral
de cette église, sous l’année 1248, une charte
capitulaire relative à six lampes ardentes, qui éclairaient
nuit et jour l’endroit où gisaient pêle-mêle
les pauvres moribonds, affligés de cette vilaine maladie,
[340]
qu’on appelait le feu sacré (ubi infirmi et morbo,
qui ignis sacer vocatur, in ecclesiâ laborantes, consueverunt
reponi).» La plupart des auteurs qui ont
parlé de cette horrible maladie, dit le savant compilateur
du Mémorial portatif de chronologie (t. II,
p. 839) se sont accordés à lui attribuer les mêmes
symptômes et les mêmes effets: son invasion était
subite; elle brûlait les entrailles ou toute autre partie
du corps, qui tombait en lambeaux; sous une
peau livide, elle consumait les chairs en les séparant
des os. Ce que ce mal avait de plus étonnant,
c’est qu’il agissait sans chaleur et qu’il pénétrait
d’un froid glacial ceux qui en étaient atteints, et
qu’à ce froid mortel succédait une ardeur si grande
dans les mêmes parties, que les malades y éprouvaient
tous les accidents d’un cancer.» Nous pensons
que les hommes du Nord avaient laissé sur leur
passage cet impur témoignage de leurs mœurs dépravées,
car le mal abominable qui était leur ouvrage
ne s’adressait généralement qu’au sexe masculin.
Le feu sacré ne fut arrêté dans ses progrès que
par les sages conseils de l’Église, qui s’efforça de
guérir les malades qu’elle avait absous; mais le vice
des Normands s’était invétéré dans les provinces
qu’ils avaient envahies. L’année 994 vit renaître
le mal des ardents, avec les causes criminelles qui
l’avaient allumé la première fois, et ce mal, transmis
par la débauche la plus infecte, passa promptement
de la France en Allemagne et en Italie. Le
[341]
dixième siècle n’était, d’ailleurs, que trop propice
à tous les genres de calamités qui pouvant frapper
l’espèce humaine. On croyait que l’an 1000 amènerait
la fin du monde, et, dans cette prévision, les
méchants, qui se jugeaient destinés aux flammes de
l’enfer, jouissaient de leur reste, en se livrant avec
plus de fureur à leurs détestables habitudes. Les
pluies continuelles, les froids excessifs, les inondations
fréquentes vinrent en aide aux épidémies pour
dépeupler la terre. Les champs, qu’on ne cultivait
plus, se convertirent en bruyères, en étangs, en
marais, dont les émanations infectaient l’air. Les
poissons périssaient dans les rivières, les animaux
dans les bois, et tous ces cadavres putrides
exhalaient des vapeurs empestées qui engendrèrent
une foule de maladies. Le mal des ardents recommença
ses moissons d’hommes à travers la France.
Le roi de France, Hugues Capet, y succomba lui-même,
victime des soins tout paternels qu’il avait
administrés aux malades. Ceux-ci mouraient presque
tous, lorsqu’ils avaient laissé au mal le temps de
s’enraciner dans leurs organes atrophiés. Cette affreuse
contagion, contre laquelle l’art se déclarait
impuissant, parce que le vice lui disputait toujours
le terrain, avait reçu le nom de mal sacré, à cause
de son origine maudite; car, dit le livre de l’Excellence
de sainte Geneviève, «dans le système de la
formation des noms, on impose souvent à une chose
le nom qui veut dire le contraire de ce qu’elle comporte
[342]
(morbus igneus, quem physici sacrum ignem
appellent eâ nominum institutione, quâ nomen unius
contrarii alterius significationem sortitur). Il est certain
que l’opinion publique, sans trop se rendre compte de
ce que ce mal pouvait être, en attribuait l’invasion
à un châtiment du ciel et la guérison à l’intercession
de la Vierge et des saints. Ce furent sans doute
les ecclésiastiques qui débaptisèrent le mal sacré,
pour lui imprimer, comme un sceau de honte, le
nom de mal des ardents, que le peuple changea depuis
en mal de saint Main et en feu de saint Antoine,
parce que ces deux saints avaient eu l’honneur
de guérir ou de soulager beaucoup de malades. Le
pape Urbain II, informé des miracles que les fidèles
rapportaient à l’intercession de saint Antoine, fonda
sous l’invocation de ce saint un ordre religieux, dont
les pères hospitaliers prenaient soin exclusivement
des victimes du mal des ardents. N’oublions pas, à
propos de cette fondation, de rappeler que le porc,
qui est sujet à la lèpre et dont la chair donne aussi
la lèpre quand on ne se sert pas d’autre aliment,
devint vers cette époque l’animal symbolique de
saint Antoine. Enfin, une simple imprécation, qui
s’était conservée dans le vocabulaire du bas peuple
jusqu’au temps de Rabelais, lequel l’a recueillie, nous
dispensera de prouver que le feu Saint-Antoine avait
la plus infâme origine; le peuple et Rabelais disaient
encore au seizième siècle: «Que le feu Sainct-Antoine
vous arde le boyau culier!»
[343]
Il y eut encore plusieurs recrudescences mémorables
de cette impureté, notamment en 1043 et en
1089; la dernière semble avoir été celle de 1130,
sous le règne de Louis VI: «Il courut une estrange
maladie par la ville de Paris et autres lieux circonvoisins,
raconte Dubreul, laquelle le vulgaire surnommoit
du feu sacré ou des ardents pour la violence
intérieure du mal, qui brusloit les entrailles
de celuy qui en estoit frappé, avec l’excès d’une
ardeur continuelle dont les médecins ne pouvoient
concevoir la cause et par conséquent inventer le
remède.» Saint Antoine n’eut pas, cette fois, le privilége
exclusif des prières, des offrandes et des
guérisons. Sainte Geneviève, la bonne patronne
de Paris, et saint Marcel s’interposèrent d’intelligence
pour faire cesser le fléau. Depuis cette époque,
la petite chapelle de la sainte, dans la Cité,
fut transformée en église avec le titre de Sainte-Geneviève-des-Ardents,
qu’elle garda longtemps
après que la maladie eut été restreinte à des cas isolés.
Remarquons, toutefois, que les premiers malades
de la syphilis du quinzième siècle prirent tout naturellement
le chemin de cette vieille église pour y
chercher des miracles curatifs. La tradition reconnaissait
dans ces nouveaux invocateurs de sainte
Geneviève les héritiers directs du mal des ardents;
par la même loi d’hérédité, les autres saints, tels que
saint Antoine, saint Main, saint Job, etc., qu’on
avait invoqués pour la guérison des maladies
[344]
lépreuses et galeuses dès les plus anciens temps,
maintinrent leurs attributions à l’égard de la maladie
vénérienne proprement dite, qui n’était pas
nouvelle pour eux. Mais, à partir du douzième siècle
jusqu’à l’installation du mal de Naples, toutes
les maladies honteuses, nées ou aggravées dans un
commerce impur, se trouvèrent absorbées et enveloppées
par l’hydre de la lèpre, qui se dressait de
toutes parts et qui se multipliait sous les formes les
plus disparates. La lèpre du douzième siècle, qu’elle
eût ou non une origine vénérienne, devait surtout
à la Prostitution les progrès menaçants qu’elle fit à
cette époque, et que tous les gouvernements arrêtèrent
à la fois par des mesures analogues de police
et de salubrité. Nous ne craignons pas d’avancer
que le relâchement et la suppression de ces mesures
enfantèrent la syphilis du quinzième siècle.
Il ne faut pas induire du silence des annales de la
médecine pendant cinq ou six cents ans, que la lèpre,
décrite pour la dernière fois par Paul d’Égine
au sixième siècle, ait disparu en Europe jusqu’au
onzième siècle, où nous la voyons éclater de nouveau
avec fureur. L’histoire de la vie privée au
moyen âge serait un monument irrécusable de l’existence
continue de l’éléphantiasis (puisque les causes
qui produisent cette lèpre mère existaient alors au
plus haut degré), si les écrivains ecclésiastiques n’étaient
remplis de témoignages qui viennent confirmer
ce fait: le recueil des Bollandistes et les cartulaires
[345]
des églises et des monastères font souvent
mention des lépreux. Grégoire de Tours dit qu’ils
avaient à Paris une sorte de lieu d’asile où ils se
nettoyaient le corps et où ils pansaient leurs plaies.
Le pape saint Grégoire, dans ses écrits, représente
un lépreux que le mal avait défiguré, quem densis
vulneribus morbus elephantinus defœdaverat. Ailleurs,
il raconte que deux moines gagnèrent le
même mal, pour avoir tué un ours, qui les gâta de
telle sorte, que leurs membres tombèrent en pourriture.
Dans le huitième siècle, Nicolas, abbé de Corbie,
fit construire une léproserie, ce qui démontre
suffisamment que les lépreux étaient en assez grand
nombre. La loi de Rotharis, roi des Lombards, datée
de 630, faisait le fonds de toutes les législations sur
la matière. Partout, le lépreux était retranché du
sein de la société, qui le tenait pour mort; et si la
misère le forçait à vivre d’aumônes, il ne s’approchait
de personne et il annonçait sa présence par le
bruit d’une cliquette de bois. Malgré ces précautions
législatives, les lépreux parvenaient quelquefois
à cacher leur triste état de santé et à contracter
mariage avec des personnes saines; de là le capitulaire
de Pepin pour la dissolution de ces mariages,
en 737. Un autre capitulaire de Charlemagne, en
789, défend aux lépreux, sous des peines très-sévères,
de fréquenter la compagnie des gens sains.
On comprend sans peine que les relations sexuelles
étaient le plus dangereux auxiliaire de la contagion,
[346]
qui ne se propageait pas trop, grâce à l’horreur
générale qu’inspiraient les lépreux, grâce surtout à
l’intervention préventive de la police municipale.
Mais, comme nous l’avons déjà fait observer,
c’était l’influence ecclésiastique qui avait le plus
d’action sur les mœurs et sur leurs conséquences: la
pénitence se chargeait bien souvent d’une sorte de
régime hygiénique, et la confession remplaçait les
consultations médicales. Le prêtre s’occupait de la
santé physique de ses ouailles comme de leur santé
morale, et il ne les maintenait parfois dans la bonne
voie qu’en les menaçant de ces maux hideux que
la punition de Dieu envoyait comme une marque de
réprobation aux libertins et aux infâmes. Il est à
constater que les épidémies coïncidaient toujours
avec des temps de corruption sociale, et que le déréglement
des mœurs publiques entraînait avec lui
la perte de l’économie sanitaire. Les classes honnêtes
se voyaient avec stupeur atteintes des maux impurs
qui devaient être endémiques parmi l’immense
tourbe des vagabonds, des mendiants, des débauchés
et des filles perdues, errant dans les champs ou
relégués dans les cours des Miracles. C’était là que
la maladie vénérienne puisait, dans la débauche et
la misère, ses symptômes les plus caractérisés et ses
plus hideuses métamorphoses. Jamais un mire ou un
physicien n’avait pénétré dans ces repaires inabordables,
pour y étudier les maladies sans nom qui les
habitaient et qui se combinaient avec les plus monstrueuses
[347]
variétés, en se mêlant sans cesse, en se dévorant
l’une par l’autre. Il est certain que les misérables
que réunissait cette vie truande n’avaient
aucun contact avec la population saine et honnête,
excepté à des époques de crise et de débordement,
après lesquelles le flot impur rentrait dans son lit et
laissait au temps, à la religion et à la police humaine,
le soin d’effacer ses traces. C’est ainsi que la
lèpre se répandit tout à coup, comme un torrent qui
a rompu ses digues, à travers le corps social, qu’elle
aurait empoisonné, si la prudence et l’énergie du
pouvoir n’eussent élevé une barrière contre les envahissements
de la contagion. Les croisades avaient
réuni, pour ainsi dire, toutes les fanges de la
société, et mélangé dans un étrange bouleversement
la noblesse avec le peuple. Les règlements de
police ne soutinrent pas le choc de cette armée de
pèlerins qui s’en allaient mourir ou chercher fortune
en Orient. La Prostitution la plus audacieuse gangrena
ces hordes indisciplinées. A leur retour, après
les aventures de la Palestine, tous les pauvres croisés
étaient plus ou moins suspects de lèpre ou de
mésellerie; les uns ladres verts, les autres ladres
blancs, la plupart rapportant avec eux les fruits
amers de la débauche orientale: on peut assurer
que la maladie vénérienne n’était alors qu’une des
formes de la lèpre.
Il fallut soumettre les lépreux à une rigoureuse
police de salubrité, qui fut renouvelée trois siècles
[348]
plus tard contre les vérolés, et qui avait pour but
d’empêcher la contagion de se répandre davantage.
De même que dans le code de Rotharis, le lépreux
était censé mort, du moment où il entrait dans la
léproserie, accompagné des exorcismes et des funérailles
d’usage. Le curé lui jetait trois fois de la
terre du cimetière sur la tête, en lui adressant ces
lugubres injonctions: «Gardez-vous d’entrer en
nulle maison que votre borde. Quand vous parlerez
à quelqu’un, vous irez au-dessous du vent. Quand
vous demanderez l’aumône, vous sonnerez votre
crécelle. Vous n’irez pas loin de votre borde, sans
avoir votre habillement de bon malade. Vous ne
regarderez ni puiserez en puits ou en fontaine, sinon
les vôtres. Vous ne passerez pas planches ni ponceau
où il y ait appui, sans avoir mis vos gants,» etc.
On lui défendait, en outre, de marcher nu-pieds, de
passer par des ruelles étroites, de toucher les enfants,
de cracher en l’air, de frôler les murs, les
portes, les arbres, en passant; de dormir au bord
des chemins, etc. Quand il venait à mourir, il n’avait
pas même de sépulture au milieu des chrétiens, et
ses compagnons de misère étaient requis de l’enterrer
dans le cimetière de la léproserie. Jamais un
lépreux ne pouvait, fût-il guéri, rentrer dans le
cercle de la loi mondaine et vivre dans l’intérieur
de la ville sous le régime de la vie commune. Il y
avait pourtant bien des degrés dans la maladie, qui
n’était pas absolument incurable, et qui ne se montrait
[349]
pas toujours en signes apparents; mais, comme
elle affligeait de préférence la classe la plus pauvre,
les médecins ne songeaient pas plus à la traiter, que
les malades à se faire soigner. Ceux-ci, qu’ils le
fussent de naissance ou par accident, se regardaient
comme voués irrévocablement à la lèpre et se
livraient en proie aux ravages de cette affreuse
infirmité, qui, faute de soins, ne faisait que s’accroître
et s’exaspérer jusqu’à ce qu’elle eût détruit
tous les organes vitaux. Quelquefois, le mal était
stationnaire, et quoique son principe subsistât dans
l’individu, ses effets se trouvaient paralysés ou assoupis
par une bonne constitution ou par quelque cause
inappréciable. Tout commerce avec les lépreux de
profession fut interdit aux personnes saines par le
dégoût et l’effroi qu’ils excitaient plutôt encore que
par la loi qui les tenait à l’écart sous peine de mort.
Mais, en compensation, les lépreux communiquaient
entre eux librement; ils avaient des femmes, des
enfants, des ménages; ils ne se croyaient étrangers
à aucun des sentiments qui poussent l’homme à se
reproduire, et c’est ainsi que leur race se perpétuait
au milieu d’une population qui évitait leur vue et
leur approche; c’est ainsi que la lèpre passait de
génération en génération et gâtait l’enfant dès le
ventre de la mère. Cependant les lépreux ne se multipliaient
pas comme on aurait pu le croire, car le germe
de mort qu’ils portaient en eux-mêmes les décimait
sans cesse, après les avoir changés en cadavres ambulants.
[350]
Le fils d’un lépreux était ordinairement
plus lépreux que son père, et le mal, en se transmettant
de la sorte, prenait de nouvelles forces, au lieu
de s’affaiblir; la famille la plus nombreuse s’éteignait,
en se consumant, dans l’espace d’un siècle. Voilà
pourquoi la lèpre disparut presque avec les lépreux
au bout de quelques siècles, quoique la plupart des
ladres fussent très-ardents et très-aptes à procréer
leurs semblables.
Le caractère le plus général de la lèpre était une
éruption de boutons par tout le corps, notamment au
visage; mais ces boutons, qui se renouvelaient sans
cesse, se distinguaient par la variété de leurs formes
et de leurs couleurs: les uns, durs et secs; les autres,
mous et purulents; ceux-ci, croûtelevés;
ceux-là, crevassés; blancs, rouges, jaunes, verts,
tous hideux à la vue et à l’odorat. Quant aux signes
uniformes de la maladie, le célèbre Guy de Chauliac
en compte six principaux, que Laurent Joubert définit
en ces termes, dans sa Grande chirurgie, au chapitre
de la ladrerie: «Rondeur des yeux et des
oreilles, dépilation et grossesse ou tubérosité des
sourcils, dilatation et toursure des narilles par dehors
avec étroitesse intérieure, laideur des lèvres,
voix rauque comme s’il parloit du nez, puanteur
d’haleine et de toute la personne, regard fixe et horrible.»
Guy de Chauliac, qui vivait au quatorzième
siècle, avait eu sous les yeux une foule de sujets,
que ne fut pas à même d’observer Laurent Joubert,
[351]
qui écrivait sur la ladrerie à la fin du seizième siècle,
lorsqu’elle n’existait plus guère que de nom.
Les signes équivoques de la lèpre étaient au nombre
de seize: «Le premier est dureté et tubérosité de la
chair, spécialement des jointures et extrémités; le
second est couleur de Morphée et ténébreuse; le
troisiesme est cheute des cheveux et renaissance de
subcils; le quatriesme, consomption des muscles, et
principalement du poulce; cinquiesme, insensibilité
et stupeur, et grampe des extrémitez; sixiesme, rogne
et dertes, copperose et ulcérations au corps; le
septiesme est grains sous la langue, sous les paupières
et derrière les oreilles; huitiesme, ardeur et
sentiment de piqueure d’aiguilles au corps; neuviesme,
crespure de la peau exposée à l’air, à mode
d’oye plumée; dixiesme, quand on jette de l’eau
sur eux, ils semblent oingtz; unziesme, ils n’ont
guères souvent fièvre; douziesme, ils sont fins,
trompeurs, furieux, et se veulent trop ingérer sur le
peuple; treiziesme, ils ont des songes pesans et
griefs; quatorziesme, ils ont le poulx débile; quinziesme,
ils ont le sang noir, plombin et ténébreux,
cendreux, graveleux et grumeleux; seiziesme, ils
ont les urines livides, blanches, solides et cendreuses.»
Nous verrons plus tard que ces symptômes
sont presque identiques avec ceux de la grosse vérole,
qui ne fut qu’une renaissance de la lèpre, sous
l’influence des guerres d’Italie.
La lèpre avait, d’ailleurs, une infinité d’autres
[352]
caractères particuliers, que déterminaient les circonstances
locales et climatériques. Par exemple, le mal
des ardents, qui avait dégénéré en gonorrhée virulente,
provenait encore de la cohabitation avec une
personne lépreuse. Dans cette maladie, qu’on nommait
l’ardeur, l’arsure, l’incendie, l’échauffaison (en
anglais brenning), les parties génitales étant attaquées
de phlogose, d’érysipèle, d’ulcérations, de phlyctènes,
etc., le malade éprouvait de vives douleurs
en urinant. Un savant médecin du treizième siècle,
nommé Théodoric, dit textuellement dans le livre VI
de sa Chirurgie, que quiconque approche une femme
qui a connu un lépreux contracte un mauvais mal.
Dans un traité de Chirurgie attribué à Roger Bacon,
qui écrivait à la même époque, on trouve une description
des maux horribles qui pouvaient suivre un
commerce impur de cette espèce. Plusieurs médecins
anglais contemporains ont étudié ce genre d’affection
vénérienne, qui régnait à Londres aux treizième
et quatorzième siècles, comme nous aurons lieu de
le raconter en parlant de l’Angleterre. Un de ces
médecins, Jean de Gaddesden, consacre un chapitre
de sa Practica medicinæ seu Rosa anglicana aux accidents
qui résultent de la fréquentation impudique
des lépreux et des lépreuses. «Celui, dit-il, qui a
couché avec une femme à laquelle un lépreux a eu
affaire, ressent des piqûres entre cuir et chair, et
quelquefois des échauffements par tout le corps.»
Les médecins anglais de ce temps-là nous fournissent
[353]
sur la lèpre vénérienne plus de renseignements,
que les médecins italiens et français, parce que les
lois contre les lépreux étaient beaucoup moins rigoureuses
en Angleterre que partout ailleurs; aussi,
les cas de contagion lépreuse y furent-ils plus communs
et plus graves que dans tout autre pays.
Grâce aux mesures énergiques et générales qui
furent prises dans toute l’Europe, excepté peut-être
en Angleterre, pour arrêter les progrès de la lèpre
et des maladies qui en dépendaient, on put conserver
saine et sauve la majeure partie de la population.
Du temps de Matthieu Paris, qui écrivait au
milieu du treizième siècle, il y avait plus de dix-neuf
mille léproseries en Europe. Deux siècles plus
tard, les léproseries de la France étaient en ruines et
abandonnées, faute de malades. Elles furent accaparées
successivement par des parasites, au moyen de
la suppression des titres de fondation et des contrats
de rente; en sorte que, par son ordonnance de
1543, François Ier provoqua presque inutilement la
recherche de ces chartes et titres perdus ou dérobés.
Il est donc certain que, dans l’intervalle de deux
ou trois siècles, la grande lèpre ou éléphantiasis
avait à peu près disparu avec les malheureux qui
en étaient atteints et qui n’avaient pas réussi à se
perpétuer au delà de trois ou quatre générations.
Quant à la petite lèpre et à ses dérivatifs, ils se déguisaient
sous des dehors moins inquiétants, et ils
allaient toujours s’affaiblissant dans leurs symptômes
[354]
extérieurs, quoique le germe du mal fût toujours
vivace dans un sang qui l’avait reçu de naissance
ou par transmission contagieuse. La société, qui
avait rejeté de son sein les lépreux, se trouva donc
de nouveau envahie par eux, ou du moins par
leurs enfants, et la lèpre; en perdant une partie de
ses hideux phénomènes, recommença sourdement à
travailler la santé publique. Ce fut par la Prostitution
que cette infâme maladie rentra dans les classes
abjectes et se glissa jusqu’aux plus élevées, à la faveur
de ses secrètes métamorphoses. Nous ne doutons
pas que le mal de Naples, qui n’était autre
qu’une résurrection de la lèpre combinée avec d’autres
maux, a fait silencieusement son chemin dans
les lieux de débauche et dans les mystères de l’impudicité,
avant d’éclater au grand jour, sous le nom
de grosse vérole, par toute l’Europe à la fois.
Nous parlions plus haut de l’arsure qui avait infecté
les mauvais lieux de Londres, tellement qu’il
fallut, en 1430, faire des lois de police pour empêcher,
sous peine d’amende, de recevoir dans ces
maisons aucune femme atteinte de l’arsure, et pour
faire garder à vue celles qui seraient attaquées
de cette détestable maladie (infirmitas nefanda, disent
ces lois sanitaires, citées par Guillaume Beckett dans
le tome XXX des Transactions philosophiques). Voici
maintenant les témoignages de quelques médecins
et chirurgiens, qui ne nous permettent pas de croire
que les maladies vénériennes fussent seulement contemporaines
[355]
de la découverte de l’Amérique. Guillaume
de Salicet, médecin de Plaisance au treizième
siècle, n’oublie pas dans sa Chirurgie, au chapitre
intitulé De Apostemate in inguinibus, le bubon ou
dragonneau, ou abcès de l’aine, qui se forme quelquefois,
dit-il, «lorsqu’il arrive à l’homme une corruption
dans la verge, pour avoir eu affaire à une
femme malpropre.» (Traité des Malad. vénér., par
Astruc, trad. par Louis, t. Ier, p. 134 et suiv.) Le
même praticien, dans un autre chapitre, traite des
pustules blanches et rouges, de la dartre miliaire
et des crevasses qui viennent à la verge ou autour
du prépuce, et qui sont occasionnées «par le commerce
qu’on a eu avec une femme sale ou avec une
fille publique.» Lanfranc, fameux médecin et chirurgien
de Milan, qui vint se fixer à Paris vers
1395, développe la même doctrine sur les maladies
des parties honteuses, dans son livre intitulé Practica
seu ars completa chirurgiæ: «Les ulcères de la
verge, dit-il, sont occasionnés par des humeurs
âcres qui ulcèrent l’endroit où elles s’arrêtent, ou
bien par une conjonction charnelle avec une femme
sale qui aurait eu affaire récemment à un homme
attaqué de pareille maladie.» Bernard Gordon, non
moins célèbre médecin de la Faculté de Montpellier,
qui dut survivre à Lanfranc, professe les mêmes
opinions à l’égard des maladies de la verge (de passionibus
virgæ), dans son Lilium medicinæ: «Ces
maladies sont en grand nombre, dit-il, comme les
[356]
abcès, les ulcères, les chancres, le gonflement, la
douleur, la démangeaison. Leurs causes sont externes
ou internes: les externes, comme une chute,
un coup et la conjonction charnelle avec une femme
dont la matrice est impure, pleine de sanie ou de
virulence, ou de ventosité, ou de semblables matières
corrompues. Mais, si la cause est interne, ces
maladies sont alors produites par quelques humeurs
corrompues et mauvaises qui descendent de la verge
et aux parties inférieures.» Jean de Gaddesden, médecin
anglais de l’université d’Oxford; Guy de
Chauliac, de l’université de Montpellier; Valesius de
Tarenta, de la même université, et plusieurs autres
docteurs qui faisaient leurs observations dans différents
pays durant le quatorzième siècle, reconnurent
tous que le commerce impur engendrait des maladies
virulentes qui étaient contagieuses et qui devaient
être ainsi vénériennes.
Dans ces diverses maladies, la lèpre jouait inévitablement
le principal rôle, avant comme après l’apparition
du mal de Naples. Les praticiens, qui ont
étudié la lèpre et qui ont publié leurs recherches à
ce sujet, sont tombés d’accord que la lèpre se communiquait
par les relations sexuelles plutôt que par
toute autre voie. Ces relations étaient fort rares entre
les personnes saines et les lépreux; mais l’imprudence
ou la dissolution les déterminait parfois, au
grand préjudice de la personne saine, qui devenait
lépreuse à son tour. Bernard Gordon, que nous
[357]
avons cité plus haut, raconte qu’une certaine comtesse
qui avait la lèpre vint à Montpellier, et qu’il
la traita sur la fin de sa maladie. Un bachelier en
médecine, qu’il avait mis auprès d’elle pour la soigner,
eut le malheur de partager son lit: elle devint
enceinte, et, lui, lépreux. (Lilium medicinæ,
part. 1, ch. 22.) On trouverait quantité de faits analogues
dans les écrits de Forestus, de Paulmier, de
Paré, de Fernel, etc., qui écrivaient sur l’éléphantiasis
ou la lèpre, d’après le sentiment unanime des
écoles de médecine et de chirurgie. Jean Manardi
de Ferrare résume ainsi la question, au commencement
du seizième siècle, sans s’apercevoir qu’il confond
la lèpre et les maladies vénériennes: «Ceux,
dit-il dans ses Epistolæ médicinales, publiées en
1525, ceux qui ont commerce avec une femme,
laquelle a eu affaire un peu auparavant à un lépreux,
tandis que la semence reste encore dans la
matrice, gagnent quelquefois la lèpre et quelquefois
d’autres maladies, plus ou moins considérables, selon
qu’ils sont eux-mêmes disposés, aussi bien que
le lépreux qui a infecté la femme.» Dans toutes ces
citations, nous reproduisons la traduction que Louis,
traducteur et annotateur d’Astruc, pour ne pas altérer
le sens médical du savant auteur du traité De
Morbis venereis, avait cru pouvoir établir dans l’intérêt
de son système; mais ces citations mêmes nous paraissent
souvent tout à fait contraires à ce système. En
examinant ce passage de Jean Manardi, par exemple,
[358]
il est impossible de ne pas reconnaître les maladies
vénériennes dans ces autres maladies plus ou moins
considérables, engendrées par un commerce plus ou
moins imprudent avec une personne plus ou moins
lépreuse. Au reste, un commerce de cette nature,
qui eût entraîné la peine de mort, en certains cas,
pour le lépreux, avait sans doute été jugé impossible
par le législateur, qui ne l’a prévu nulle part
dans le droit criminel.
Le droit coutumier règle seulement tout ce qui
concerne l’institution des léproseries, dans lesquelles
la lèpre était mise en charte privée, pour ainsi
dire. Selon la Coutume du Boulenois, quand on découvrait,
après la mort d’un homme, qu’il était
ladre et qu’il avait néanmoins vécu en compagnie de
gens sains, ceux-ci devaient être considérés comme
ses complices; et tout le bétail à pied fourchu, appartenant
aux habitants du lieu où ce ladre venait de
mourir, était confisqué au profit du seigneur. Chaque
paroisse se trouvait de la sorte responsable de ses
ladres: elle était tenue de les nourrir, après les
avoir vêtus d’une espèce de livrée et confinés dans
des bordes, où il y avait un lit, une table et quelques
menus ustensiles de bois et de terre. (Traité de la Police,
par Delamare, t. I, p. 636 et suiv.) Les ladres,
qui regardaient leurs maladies comme des
tombes anticipées, cherchaient sans cesse à rentrer
dans le sein de la société, et celle-ci les expulsait
sans cesse avec horreur. Chaque fois que l’incurie
[359]
de la police permettait à ces malheureux de dissimuler
leur triste condition et de participer à la vie
commune, il y avait dans les villes un réveil de la
lèpre, qui forçait les magistrats à remettre en vigueur
les anciennes ordonnances. En 1371, le prévôt de
Paris fit publier les lettres patentes que lui avait
adressées Charles V, pour enjoindre à tous les ladres
de quitter la capitale dans le délai de quinze jours,
«sous de très-grosses peines corporelles et pécuniaires.»
En 1388, il défendit aux lépreux d’entrer
dorénavant dans Paris, sans permission expresse
signée de lui. En 1394 et 1402, mêmes défenses
aux ladres, «sur peine d’estre pris par l’exécuteur et
ses valets à ce commis, et détenus prisonniers pendant
un mois, au pain et à l’eau, et ensuite bannis
du royaume.» Ces défenses étaient toujours éludées
à cette époque, et la population saine se relâchait
de ses terreurs à l’égard des lépreux, qui vivaient
parmi elle, comme s’ils n’étaient pas affectés d’un
mal contagieux, car la lèpre diminuait tous les
jours, ou du moins ses signes extérieurs devenaient
moins manifestes. Le parlement de Paris rendit un
arrêt, en date du 11 juillet 1453, contre un lépreux
qui avait épousé une femme saine. Cette femme,
que la lèpre n’avait pas encore atteinte, à ce qu’il
paraît, fut séparée de son mari, et défenses lui furent
faites de converser avec lui, sur peine d’être
mise au pilori et bannie ensuite. On la laissa toutefois
habiter dans l’intérieur de la ville, mais on lui
[360]
ordonna de cesser d’y vendre des fruits, de peur
qu’elle ne communiquât à quelqu’un la contagion
de la lèpre.
Cet arrêt est très-significatif; il prouve que les règlements
concernant la lèpre étaient mal observés au
quinzième siècle, et que les lépreux pouvaient résider
hors des léproseries. La conséquence de ce relâchement
de sévérité devait être le retour de la lèpre et
des maladies qui en résultaient. En effet, peu d’années
avant que le mal vénérien eût été signalé en Italie
et en France, les ladres avaient de nouveau multiplié
et ravivé le venin de l’éléphantiasis, et la santé
publique avait subi une atteinte profonde, par l’intermédiaire
de la Prostitution, où lépreux et lépreuses
osèrent apporter leur hideux concours. Par ordonnance
du prévôt de Paris, datée du 15 avril
1488, il fut enjoint «à toutes personnes attaquées
du mal abominable, très-périlleux et contagieux, de
la lèpre, de sortir de Paris avant la feste de Pâques
et de se retirer dans leurs maladreries aussitost après
la publication de ladite ordonnance, sur peine de
prison pendant un mois, au pain et à l’eau; de perdre
leurs chevaux, housses, cliquettes et barillets,
et punition corporelle arbitraire; leur permet néanmoins
d’envoyer quester pour eux leurs serviteurs et
servantes estant en santé.» Ces ladres, qui avaient
des chevaux et des housses, des serviteurs et des
servantes en bonne santé, faisaient évidemment une
effrayante diffusion de la lèpre dans la partie saine
[361]
de la population qu’ils fréquentaient; et cette lèpre
sourde, transmise de proche en proche par les
plaisirs vénériens, corrompait physiquement ce que
le vice avait gâté de sa souillure morale. Ce n’était
déjà plus la lèpre proprement dite, c’était la lèpre
de l’incontinence et des mauvais lieux; c’était une
maladie horrible que la Prostitution avait portée
dans ses flancs et qu’elle réchauffait sans cesse en
son sein; c’était la grosse vérole, que les Français
nommèrent dès sa naissance le mal de Naples, et
que les Italiens, par contradiction, appelèrent le
mal français.

Sommaire.—Noms scientifiques de la syphilis, morbus novus,
pestilentialis scorra, pudendagra, etc.—Ses surnoms populaires.—Les
saints qui avaient le privilége de la guérir.—Coïncidence
de son apparition en Italie avec l’expédition de
Charles VIII.—Quelle est la date précise de cette apparition?—Les
médecins et les historiens ne sont pas d’accord.—Traditions
relatives à son origine.—Les conjonctions de planètes.—Le
vin empoisonné avec du sang de lépreux.—Boucheries
de chair humaine.—La bestialité punie par elle-même.—La
jument et les singes.—La syphilis d’Europe n’est pas venue
d’Amérique.—Les médecins refusent d’abord de traiter cette
maladie.—Manardi, Mathiole, Brassavola et Paracelse disent
que l’infection vénérienne est née de la lèpre et de la Prostitution.
Il nous paraît démontré jusqu’à l’évidence, par le
simple rapprochement de quelques dates, que la
maladie vénérienne n’avait pas attendu la découverte
de l’Amérique, pour s’introduire en Europe et
[364]
pour y faire de terribles progrès. Cette maladie,
comme nous avons cherché à le prouver par des
faits et par des inductions, existait de toute antiquité;
mais elle s’était successivement combinée
avec d’autres maladies, et surtout avec la lèpre,
qui lui avait donné une physionomie toute nouvelle.
Ce fut la Prostitution, qui, dans tous les temps et
dans tous les pays, servit d’auxiliaire énergique à ce
fléau, que la police des gouvernements s’appliquait
à entourer, pour ainsi dire, d’un cordon sanitaire.
Quand ce cordon sanitaire fut rompu et tout à fait
abandonné, le mal prit son essor et retrouva sa
puissance dans le sein de la Prostitution légale.
Voilà comment la lèpre vénérienne éclata en même
temps, avec la même fureur, en France, en Italie,
en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, au moment
où Christophe Colomb était à peine de retour
du premier voyage qu’il fit à l’île Espagnole. Nous
n’aurons pas de peine à établir que la grosse vérole,
ou du moins un mal analogue, avait été signalée en
Europe dès l’année 1483; que ce mal, ou tout autre,
de même nature et de même origine, subsistait antérieurement
aux Antilles et n’y produisait pas les
mêmes accidents que sous les latitudes tempérées;
que l’expédition de Charles VIII en Italie concourut
peut-être à répandre et à envenimer cette affreuse
maladie, mais que l’Italie et la France, qui se renvoyaient
l’une à l’autre la priorité de l’infection,
n’eurent rien à s’envier sur ce point, et se donnèrent
[365]
réciproquement ce qu’elles avaient de longue
date, dans un échange de contagion mutuelle; enfin,
que, depuis son apparition constatée, la maladie
changea souvent de symptômes, de caractères et de
noms.
Parmi ces noms, qui furent très-multipliés et qui
eurent chacun une origine locale, il faut distinguer
les noms populaires des noms scientifiques. Ceux-ci
étaient naturellement latins dans tous les livres et
les recipe (ordonnances) de médecine, mais ils disparurent
l’un après l’autre, en cédant la place à
celui que Fracastor inventa pour les besoins de sa
fable poétique, dans laquelle le berger Syphile est
atteint le premier de cette vilaine maladie, parce
qu’il avait offensé les dieux. La plupart des médecins
italiens ou allemands, qui écrivirent à la fin
du quinzième siècle sur le mal nouveau (morbus
novus) que les guerres d’Italie avaient fait sortir
de son obscurité, Joseph Grundbeck, Coradin Gilini,
Nicolas Leoniceno, Antoine Benivenio, Wendelin
Hock de Brackenaw, Jacques Cataneo, etc., se servirent
de la dénomination usuelle de morbus gallicus
(mal français). Cependant, comme s’ils eussent été
peu satisfaits d’admettre dans la langue médicale
une erreur et une calomnie à la fois, plusieurs d’entre
eux forgèrent des noms plus dignes de la science
et moins éloignés de la vérité historique. Joseph
Grundbeck, le plus ancien de tous, ajouta au surnom
de mala de Frantzos la périphrase de gorre pestilentielle
[366]
(pestilentialis scorra) et la qualification de
mentulagra (maladie de membre viril); Gaspard
Torrella, qui, comme Italien, se piquait de savoir
latiniser mieux qu’un Allemand, adopta pudendagra
(maladie des parties honteuses); Wendelin Hock
préféra mentagra, parce qu’il crut reconnaître dans
ce prétendu mal français la mentagre ou lèpre du
menton, décrite par Pline (Hist. nat., lib. XXVI, c. 1);
Jean Antoine Roverel et Jean Almenar se servirent
du mot patursa, sans que la véritable signification de
ce mot leur fût connue: ce qui permet de supposer
que c’était le nom générique de la maladie dans l’Amérique.
Chaque nation se défendait d’avoir engendré
cette maladie, en lui attribuant le nom de la nation
voisine à laquelle l’opinion populaire attribuait le
principe du mal. Ainsi, les Italiens, les Allemands
et les Anglais, qui accusaient la France d’avoir été
le berceau de la grosse vérole, l’appelaient mal français:
mal francese, frantzosen ou frantzosichen pocken,
french pox; les Français s’avisèrent plus tard
de se revancher, en l’appelant mal napolitain; les
Flamands et les Hollandais, les Africains et les
Maures, les Portugais et les Navarrais maudissaient
le mal espagnol ou castillan; mais, en souvenir
de cet odieux présent que chaque peuple
refusait de croire émané de son propre sein, les
Orientaux le nommaient mal des chrétiens; les Asiatiques,
mal des Portugais; les Persans, mal des Turcs;
[367]
les Polonais, mal des Allemands, et les Moscovites, mal
des Polonais (voy. le Traité d’Astruc, De Morbis venereis,
lib. I, cap. 1). Les divers symptômes de la
maladie lui imposèrent aussi différents noms, qui
rappelaient surtout l’état pustuleux ou cancéreux de
la peau des malades; ainsi, les Espagnols appelaient
ce mal las bubas ou buvas ou boas; les Génois, lo
malo de le tavele; les Toscans, il malo delle bolle; les
Lombards, lo malo de le brosule, à cause des pustules
ulcéreuses et multicolores qui sortaient de toutes les
parties du corps chez les individus atteints de cette
espèce de peste. Les Français la nommèrent grosse
vérole, pour la distinguer de la petite vérole, qu’on
avait classée, de temps immémorial, parmi les maladies
épidémiques, et qui, moins redoutable que sa
sœur cadette, lui ressemblait cependant par la variété
des pustules et des ulcérations de la face; de là,
son nom générique de vérole ou variole, formé du
latin varius et du vieux mot vair, qui signifiait une
fourrure blanche et grise, et qui s’entendait aussi
d’un des métaux héraldiques, composé de pièces
égales, ayant la forme de cloches et disposées symétriquement.
On prétend que cette disposition des
pièces du vair avait quelque analogie d’aspect avec
la peau bigarrée et crevassée d’un malheureux
variolé. Enfin, on mit en réquisition tous les saints
qui passaient pour guérir la lèpre, et qu’on invoquait
comme tels; on les invoqua aussi contre les
maux vénériens, et on ne se fit pas scrupule d’appliquer
[368]
leurs noms respectés à ces maux déshonnêtes
qu’on plaçait de la sorte sous leurs auspices.
Il y eut alors entre la lèpre et la grosse vérole une
confraternité avouée, qui se manifesta par les noms
de saints attachés indistinctement aux deux maladies,
qu’on appela mal de saint Mein, de saint Job,
de saint Sement, de saint Roch, de saint Évagre, et
même de sainte Reine, etc. Il suffisait qu’un saint fût
réputé comme ayant quelque influence pour la guérison
des plaies et des ulcères malins: les vérolés
s’adressaient à lui et se disaient ses malades privilégiés.
Les médecins et les historiens, qui ont parlé les
premiers de l’épidémie vénérienne des dernières
années du quinzième siècle, sont à peu près d’accord
sur ce point, que la maladie ne s’est déclarée
avec éclat qu’à la suite de l’expédition de Naples;
mais ils rapportent presque tous à l’année 1494
cette expédition, qui n’eut lieu qu’en 1495. Cette
contradiction de dates ne constitue pourtant pas une
erreur historique; car, avant Charles IX, l’année
commençait à Pâques, selon la manière de dresser le
calendrier en France. Les écrivains, qui ont fait un
rapprochement d’époque entre l’invasion de Charles
VIII en Italie et celle de la grosse vérole en Europe,
n’ont pas hésité à ranger ces deux faits hétérogènes
sous la même année 1494. Suivant eux, la
maladie vénérienne aurait été signalée dès le commencement
de cette année-là; mais le roi de France
[369]
ne fit son entrée à Naples, où il trouva cette horrible
maladie glorieusement installée avant lui, que le
22 février 1495, qui tombait en 1494, puisque la
fête de Pâques ne devait marquer la nouvelle année
qu’au 19 avril. Il faudrait donc, pour justifier la
date de 1494 enregistrée par les médecins et les
historiens qui ont voulu préciser le moment où le
fléau éclata, il faudrait que ce mal français fût né à
Naples entre le 22 février et le 19 avril 1495. On
objectera difficilement que les autorités qui fixent à
l’année 1494 l’apparition de la maladie ont pu faire
erreur d’une année; cette erreur n’est pas probable,
quand il s’agit d’un fait si récent et si remarquable.
Ajoutons encore que les premiers qui ont
établi cette date de 1494, sont Italiens, et que l’année
en Italie commençait au premier janvier et non à
Pâques comme en France. Il résulte de ces contradictions,
que ç’a été un parti pris chez les Italiens
d’accuser l’aventureuse expédition des Français en
Italie, d’un fléau qu’elle développa et aggrava peut-être,
mais qu’elle n’apporta point avec elle. «Les
médecins de notre temps, écrivait en 1497 Nicolas
Leoniceno dans son traité De Morbo gallico, n’ont
point encore donné de véritable nom à cette maladie,
mais ils l’appellent communément le mal français,
soit qu’ils prétendent que sa contagion a été apportée
en Italie par les Français, ou que l’Italie a été en
même temps attaquée par l’armée française et par
cette maladie.» Gaspard Torrella, dans son traité De
[370]
Dolore in pudendagra, est plus explicite encore: «Cette
maladie, dit-il, fut découverte lorsque les Français
entrèrent à main armée en Italie, et surtout après
qu’ils se furent emparés du royaume de Naples et
qu’ils y eurent séjourné. C’est pourquoi les Italiens
lui donnèrent le nom de mal français, s’imaginant
qu’il était naturel aux Français.» Jacques Cataneo
dans son livre De Morbo gallico, qui parut en 1505,
se borne à rappeler le même fait: «L’an 1494 de
la Nativité de Notre-Seigneur, au temps que Charles VIII,
roi de France, s’empara du royaume de
Naples, et sous le pontificat d’Alexandre VI, on vit
naître en Italie une affreuse maladie qui n’avait
jamais paru dans les siècles précédents et qui était
inconnue dans le monde entier.» Jean de Vigo fait
coïncider aussi avec le passage de Charles VIII en
Italie l’irruption subite de cette maladie, qu’on
n’avait jamais vue ou du moins jamais observée
auparavant.
L’antipathie nationale des Italiens contre leurs
vainqueurs ne manqua pas de fortifier et de propager
cette opinion erronée, qui resta dans le peuple avec
d’injustes ressentiments. Les Français furent moins
empressés de se plaindre des vaincus et de répandre
la vérité qui les justifiait eux-mêmes, en les montrant
comme des victimes du mal de Naples; car les
premiers auteurs français qui ont parlé de ce mal
ne disent rien de son origine, et n’incriminent pas
même les délices de Naples conquise par Charles VIII.
[371]
Il y eut cependant en Italie et en Allemagne plusieurs
hommes de l’art et plusieurs historiens plus
impartiaux, qui n’hésitèrent pas à proclamer l’innocence
des Français dans cette affaire, et à se rapprocher
ainsi d’une vérité que la science et l’histoire
ne devaient pas envelopper d’un nuage. Les uns
infirmèrent la date de 1494 attribuée à la naissance
de la peste vénérienne (lues venerea); les autres
firent remonter beaucoup plus haut son origine ou
plutôt ses premiers ravages; quelques-uns, moins
bien instruits que les autres ou peut-être feignant
une ignorance calculée à ce sujet, reportèrent à
l’année 1496 la première invasion de la maladie,
qu’ils faisaient venir d’Espagne, et, par conséquent,
d’Amérique. «L’an de notre salut 1496, écrivait
Antoine Benivenio en 1507, une nouvelle maladie
se glissa, non-seulement en Italie, mais encore dans
presque toute l’Europe. Ce mal, qui venait d’Espagne,
s’étant répandu de tous côtés, premièrement
en Italie, ensuite en France et dans les autres pays
de l’Europe, attaqua une infinité de personnes.»
Voilà le pauvre Charles VIII bel et bien innocenté
d’une injuste accusation qui le mettait au ban de
l’Europe maléficiée. Les historiens viennent ici à
l’appui de la justification des Français. Antoine
Coccius Sabellicus, qui savait ce que c’était que la
grosse vérole puisqu’il l’avait gagnée (voy. les Élogia
de Paul Jove), dit fermement dans son recueil
historique publié à Venise en 1502: «Dans le
[372]
même temps (1496), un nouveau genre de maladie
commença à se répandre par toute l’Italie, vers la
première descente que les Français y avaient faite
dès l’année précédente (1495), et il est probable que
c’est par cette raison qu’on la nomma le mal français,
car, comme je vois, on n’est pas sûr d’où est
venue d’abord cette cruelle maladie qu’aucun siècle
n’avait éprouvée jusque-là.» Si la date de 1496
avait pu être établie et prouvée, la provenance du
mal eût été tout naturellement renvoyée à la découverte
de l’Amérique. Dans tous les cas, la date de
1496 se rapporterait évidemment à l’extension rapide
et formidable de l’épidémie vénérienne.
Mais, pour les savants qui ne suivaient pas aveuglément
la tradition populaire, il n’était pas douteux
que le mal français et le mal de Naples avaient
précédé la triomphante expédition de Charles VIII.
«Les Français, dit judicieusement François Guicciardin
dans l’Histoire de son temps, ayant été
attaqués de cette maladie pendant leur séjour à
Naples, et s’en retournant ensuite chez eux, la
répandirent par toute l’Italie; or, cette maladie, absolument
nouvelle ou ignorée jusqu’à nos jours dans
notre continent, excepté peut-être dans les régions
les plus reculées, a sévi si horriblement durant plusieurs
années, qu’elle semble devoir être transmise
à la postérité comme une des calamités les plus funestes.»
Guicciardin était dans le vrai, en attribuant
seulement à l’armée du roi de France la propagation
[373]
du mal par toute l’Italie. Il est clair que ce
mal hideux avait pris racine à Naples, avant l’arrivée
des Français. Ulrich de Hutten, docte écrivain
allemand qui avait fait lui-même une triste expérience
de la contagion vénérienne, assigne à ses
commencements la date de 1493, qu’il ne pouvait
apprécier que par ouï-dire, puisqu’il rédigeait à
Mayence en 1519 son livre intitulé De morbi gallici
curatione: «L’an 1493 ou environ, de la naissance
de Jésus-Christ, dit-il, un mal très-pernicieux
commença à se faire sentir, non pas en France, mais
premièrement à Naples. Le nom de cette maladie
vient de ce qu’elle commença à paraître dans l’armée
des Français qui faisaient la guerre dans ce pays-là
sous le commandement de leur roi Charles.»
Puis, il ajoute cette intéressante particularité qui
nous explique comment on n’est pas d’accord sur la
date précise de l’invasion du mal: «On n’en parla
point pendant deux années entières, à compter du
temps qu’il avait commencé.» Ulrich de Hutten
partageait l’opinion des praticiens allemands qui
regardaient la maladie comme bien antérieure à la
conquête de Naples par les Français; ainsi, Wendelin
Hock de Brackenaw, qui avait fait ses études médicales
à l’université de Bologne, répète bien ce
qu’il avait entendu dire en Italie sur l’époque primitive
du mal de Naples: «Depuis l’an 1494 jusqu’à
la présente année 1502, dit-il, une certaine
maladie contagieuse, qu’on nomme le mal français, a
[374]
fait assez de ravages;» mais, ailleurs, dans le même
ouvrage, il déclare ce que savaient à cet égard tous
ses confrères d’Allemagne: «Ce mal, dit-il, qui avait
commencé, pour parler juste, dès l’an 1483 de
Notre-Seigneur,» par suite des conjonctions de plusieurs
planètes, au mois d’octobre de cette année-là,
annonçait «la corruption du sang et de la bile, et
la confusion de toutes les humeurs, ainsi que l’abondance
de l’humeur mélancolique tant dans les
hommes que dans les femmes.» Les plus habiles
médecins allemands, Laurent Phrisius, Jean Benoist,
etc., se rangèrent du côté de ce système, et
voulurent voir la cause de la maladie dans les révolutions
planétaires et dans les désordres atmosphériques
de l’année 1483.
Ce ne fut pas la seule cause ni la plus invraisemblable
que supposèrent les historiens; ils se firent,
en général, les échos du vulgaire qui a toujours, en
Italie surtout, une histoire prête, pour créer une
origine merveilleuse à tout ce qu’il ne comprend
pas. Le mal français, plus que toute autre chose,
exerça l’imagination des Napolitains et se prêta naturellement
aux inventions les plus bizarres, à travers
lesquelles pourtant il ne serait pas impossible
de découvrir quelque fait réel, enveloppé de fables
ridicules. Gabriel Fallope, qui écrivait longtemps
après l’événement qu’il rapporte (1560), soutient
que, dans le cours de la première guerre de Naples,
une garnison espagnole qui défendait le passage
[375]
abandonna la nuit les retranchements confiés
à sa garde, après avoir empoisonné les puits et conseillé
aux boulangers italiens de mêler du plâtre et
de la chaux à la farine avec laquelle ils feraient du
pain pour l’armée française. Ce plâtre et l’eau empoisonnée
auraient produit l’infection vénérienne,
selon le récit de Gabriel Fallope. André Cœsalpini
d’Arezzo, qui fut médecin de Clément VIII, prétend
que l’empoisonnement des Français fut exécuté avec
d’autres procédés, et il assure que des témoins oculaires
lui avaient raconté le fait: «Après la prise de
Naples, les Français assiégèrent la petite ville de
Somma, qui avait une garnison d’Espagnols; ceux-ci
sortirent de la place pendant la nuit, en laissant à
la disposition des assiégeants plusieurs tonnes d’excellent
vin du Vésuve, où l’on avait mêlé du sang
fourni par les lépreux de l’hôpital Saint-Lazare.
Les Français entrèrent dans la ville sans coup férir,
et s’enivrèrent avec ce vin empoisonné; ils furent
aussitôt très-malades, et les symptômes de leur maladie
ressemblaient à ceux de la lèpre.» On peut
déjà entrevoir la vérité sous les voiles qui la couvrent
ici d’une manière assez transparente. Viennent
ensuite d’autres traditions qui s’exagèrent et renchérissent
l’une sur l’autre en s’écartant toujours davantage
de l’opinion la plus répandue et la moins
déraisonnable. Fioravanti, dans ses Capricci medicinali
qu’il publia en 1564, raconte une singulière
histoire qu’il disait tenir d’un certain Pascal Gibilotto
[376]
de Naples, encore vivant à l’époque où il écrivait,
et garant des faits qu’il révélait le premier.
Pendant cette expédition de Naples, qui est partout
complice de la maladie qu’elle vit commencer, les
vivandiers napolitains, qui approvisionnaient les
deux armées, manquèrent de bétail, et eurent l’infernale
idée d’employer la chair des morts en guise
de viande de bœuf ou de mouton; ceux qui mangèrent
de la chair humaine, que la mort et la corruption
avaient empoisonnée, furent bientôt attaqués
d’une maladie qui n’était autre que la syphilis.
Fioravanti ne dit pas quel fut le théâtre de ces épouvantables
scènes d’anthropophagie; mais comme il
place dans son récit les Espagnols en présence des
Français, il faut croire que ce fait isolé aurait eu lieu
durant le siége de quelque petite ville de la Calabre
occupée par une garnison espagnole. On sait que
toute chair corrompue est capable de produire l’effet
d’un empoisonnement, mais il n’y a pas possibilité
de croire, avec Fioravanti, que des animaux nourris
de la chair des animaux de même espèce soient exposés
à gagner par là une maladie analogue au mal
de Naples. C’était un préjugé enraciné au moyen
âge, qui voulait que l’usage de la chair humaine
causât des maladies aiguës, épidémiques et pestilentielles.
L’illustre philosophe François Bacon, baron
de Verulam, tout bon physicien qu’il était, n’a
point balancé à répéter dans son Histoire naturelle
l’horrible récit de Fioravanti: «Les Français, dit-il,
[377]
de qui le mal de Naples a reçu son nom, rapportent
qu’il y avait au siége de Naples des coquins de marchands
qui, au lieu de thons, vendaient de la chair
d’hommes tués récemment dans la Mauritanie, et
qu’on attribuait l’origine de la maladie à un si horrible
aliment. La chose paraît assez vraisemblable,
ajoute l’auteur de tant de lumineux traités sur les
sciences, car les cannibales des rades occidentales,
qui vivent de chair humaine, sont fort sujets à la
vérole.»
Trouver dans l’anthropophagie l’origine du mal de
Naples, ce n’était point encore attacher assez d’horreur
aux causes de ce mal hideux, qu’on s’accordait
à considérer comme un fruit monstrueux du
péché mortel. Deux savants médecins du seizième
siècle, qui n’avaient observé pourtant que les effets
décroissants de cette terrible contagion, lui jetèrent,
pour ainsi dire, la dernière pierre, en essayant de
démontrer, avec plus de raison que de succès, qu’il
fallait peut-être attribuer le mal vénérien à la sodomie
et à la bestialité: «Un saint laïque, dit Jean-Baptiste
van Helmont dans son Tumulus pestis, tâchant
de deviner pourquoi la vérole avait paru au
siècle passé et non auparavant, fut ravi en esprit et
eut une vision d’une jument rongée du farcin, d’où
il soupçonna qu’au siége de Naples, où cette maladie
parut pour la première fois, quelque homme
avait eu un commerce abominable avec une bête de
cette espèce attaquée du même mal, et qu’ensuite,
[378]
par un effet de la justice divine, il avait malheureusement
infecté le genre humain.»
Plus tard, en 1706, un médecin anglais, Jean
Linder, ne craignit pas, en cherchant à démêler les
causes secrètes de la syphilis américaine, d’avancer
que «cette maladie provenait de la sodomie exercée
entre des hommes et de gros singes, dit-il, qui
sont les satyres des anciens.» Il est important de
constater que, dans tous les récits et les observations
des médecins qui étudièrent les premiers le mal de
Naples, soit en Italie, soit en France, soit en Allemagne,
on ne fait nullement mention de la maladie
que Christophe Colomb aurait rapportée des Antilles,
et qui, en tout cas, ne pouvait gagner de vitesse un
mal analogue né et acclimaté en Europe avant que
la découverte de l’Amérique eût porté ses fruits
amers. Christophe Colomb, revenant de l’île Espagnole
qu’il avait habitée pendant un mois à peine,
aborda au port de Palos en Portugal, le 13 janvier
1493, avec quatre-vingt-deux matelots ou soldats
et neuf Indiens qu’il ramenait avec lui. La
santé de son équipage pouvait être en mauvais
état, mais les historiens n’en parlent pas; et l’on
sait seulement qu’il se rendit à Barcelone avec
quelques-uns de ses compagnons de voyage, pour
rendre compte de sa navigation à Ferdinand le
Catholique et à Isabelle d’Aragon. «La ville de Barcelone,
dit Roderic Diaz dans son traité Contra las
bubas, fut bientôt infectée de la vérole, qui y fit des
[379]
progrès étonnants.» Le 25 septembre de la même
année, Christophe Colomb repartait avec quinze
vaisseaux chargés de quinze cents soldats et d’un
grand nombre de matelots et d’artisans; quatorze de
ces vaisseaux revinrent en Espagne l’année suivante,
pendant laquelle Barthélemy Colomb, frère
de Christophe, partit avec trois vaisseaux qui ramenèrent
en Espagne, vers la fin de 1494, Pierre Margarit,
gentilhomme catalan, gravement atteint de la
syphilis. Probablement, il n’était pas le seul qui se
trouvât malade de la même maladie; mais le journal
du bord n’en cite pas d’autre. L’année 1495 multiplia
les rapports maritimes entre les Antilles et
l’Espagne. Aussi, lorsque Christophe Colomb, accusé
de crimes imaginaires, retournait chargé de
chaînes dans le vieux monde, le navire où il était
prisonnier transportait avec lui deux cents soldats
attaqués de la vérole américaine. Ces deux cents
pestiférés débarquèrent à Cadix, le 10 juin 1496.
Neuf mois après, le parlement de Paris publiait déjà
une ordonnance relative aux malades de la grosse
vérole.
On pourrait, sans tomber dans un excès de paradoxe,
soutenir que c’est l’Europe qui a doté
l’Amérique d’une maladie à laquelle le climat des
Antilles convenait mieux que celui de Naples; on
pourrait mettre en avant d’assez bonnes raisons
pour démontrer que les aventuriers espagnols qui
avaient pris du service dans l’armée du roi de Naples
[380]
retournèrent dans leur patrie gâtés par la contagion
vénérienne, et s’embarquèrent pour les Antilles,
sans avoir été guéris. On sait quelle terrible influence
a toujours eue le changement d’air et d’habitudes
sur cette maladie inexplicable, que la chaleur
endort et que le froid réveille avec un surcroît de
fureur. Enfin, il restera probable, sinon avéré, que
le mal vénérien, tel qu’il éclata en Europe vers 1494,
n’était qu’un infâme produit de la lèpre et de la
débauche. Tous les médecins reconnurent très-tard
que le mal n’était peut-être pas aussi nouveau qu’on
l’avait cru d’abord, et ils jugèrent que la lèpre, et
surtout l’éléphantiasis, avait plus d’une similitude
avec cette affection virulente qui s’entourait de
symptômes inusités, mais dont le principe ne variait
pas. La voix populaire parlait assez haut d’ailleurs,
pour que la médecine l’entendît. On doit s’étonner
de ce que les plus hardis fondateurs de la science se
soient bornés à répéter les bruits qui circulaient sur
les origines syphilitiques, sans en déduire tout un
système qu’il eût été facile d’appuyer sur des preuves
et sur des expériences. Mais, dans les premiers
temps de cette épidémie, qu’on regardait comme
une plaie envoyée du ciel et odieuse à la nature (ce
sont les termes dont se sert Joseph Grundbeck, qui
fit le plus ancien traité qu’on possède sur cette matière),
les médecins et les chirurgiens se tenaient à
l’écart et refusaient de soigner les malades qui réclamaient
des secours: «Les savants, dit Gaspard
[381]
Torrella, évitaient de traiter cette maladie, étant
persuadés qu’ils n’y entendaient rien eux-mêmes.
C’est pourquoi les vendeurs de drogues, les herboristes,
les coureurs et les charlatans se donnent encore
aujourd’hui pour être ceux qui la guérissent
véritablement et parfaitement.» Ulrich de Hutten
s’exprime avec plus de vivacité encore, en avouant
que le mal fut abandonné à lui-même et à ses forces
mystérieuses, avant que la médecine et la chirurgie
eussent repris courage: «Les médecins, dit-il,
effrayés de ce mal, non-seulement se gardèrent bien
de s’approcher de ceux qui en étaient attaqués,
mais ils en fuyaient même la vue, comme de la
maladie la plus désespérée.... Enfin, dans cette consternation
des médecins, les chirurgiens s’ingérèrent
à mettre la main à un traitement si difficile.» Ces
circonstances expliquent suffisamment pourquoi les
premières périodes de la lèpre vénérienne sont demeurées
si obscures et si mal étudiées dans tous les
pays où ce mal apparut presque à la fois.
On tenait pourtant la clef de l’énigme, et il n’aurait
fallu que consulter les traditions des Cours des
Miracles et des lieux de débauche, pour apprendre
de quelle façon s’engendrait et se décuplait, sous
l’influence de la Prostitution, le monstre, le Protée de
la syphilis. La vérité scientifique se trouvait sans
doute renfermée dans ces anecdotes, que de grands
médecins ne dédaignèrent pas de ramasser parmi
les carrefours où elles avaient traîné. Jean Manardi,
[382]
de Ferrare, dans une lettre adressée vers 1525 à
Michel Santanna, chirurgien qui se mêlait de traiter
les vénériens, lui dit que l’opinion la plus ancienne
et la mieux établie place le commencement de la vérole
à l’époque où Charles VIII se préparait à la
guerre d’Italie (vers 1493): «Cette maladie, dit-il,
éclata d’abord à Valence en Espagne, par le fait
d’une fameuse courtisane qui, pour le prix de cinquante
écus d’or, accorda ses faveurs à un chevalier
qui était lépreux; cette femme, ayant été gâtée,
gâta à son tour les jeunes gens qui la voyaient, et
dont plus de quatre cents furent infectés en peu de
temps. Quelques-uns d’eux ayant suivi le roi
Charles en Italie, y portèrent celle cruelle maladie.»
Manardi se borne à rapporter le fait, de même que
le savant médecin naturaliste Pierre-André Mathiole,
qui ne fait que changer les personnages et le lieu de
la scène: «Quelques-uns, dit-il, ont écrit que les
Français avaient gagné ce mal par un commerce
impur avec des femmes lépreuses, lorsqu’ils traversaient
une montagne d’Italie (voy. son traité De
Morbo gallico).» L’identité de la syphilis avec la lèpre
était clairement indiquée dans ces simples réminiscences
du bon sens populaire; mais les hommes de
l’art les recueillaient, en fermant les yeux devant ces
renseignements lumineux qui leur montraient la
route. Un autre médecin de Ferrare, Antoine Musa
Brassavola, admettait probablement la préexistence
des maux vénériens et du virus qui les communique,
[383]
quand il raconte le fait suivant, dans son livre sur le
Mal français: «Au camp des Français devant Naples,
dit-il, il y avait une courtisane très-fameuse et
très-belle, qui avait un ulcère sordide à l’orifice de la
matrice. Les hommes qui avaient commerce avec
elle, contractaient une affection maligne qui ulcérait
le membre viril. Plusieurs hommes furent bientôt
infectés, et ensuite beaucoup de femmes, ayant habité
avec ces hommes, gagnèrent aussi le mal, dont
elles firent à leur tour présent à d’autres hommes.»
Ainsi, selon Antoine Musa Brassavola, le mal de
Naples n’était qu’une complication accidentelle du
mal vénérien qui aurait existé isolément chez quelques
individus, avant d’être épidémique et d’avoir
acquis sa prodigieuse activité.
Enfin, un des plus grands hommes qui aient porté
le flambeau dans les ténèbres de l’art médical,
Théophraste Paracelse, décréta toute une doctrine
nouvelle au sujet des maladies vénériennes, quand
il proclama leur affinité avec la lèpre, dans sa Grande
Chirurgie (liv. I, ch. 7): «La vérole, dit-il avec
cette conviction que le génie peut seul donner, a pris
son origine dans le commerce impur d’un Français
lépreux avec une courtisane qui avait des bubons
vénériens, laquelle infecta ensuite tous ceux qui eurent
affaire à elle. C’est ainsi, continue cet habile
et audacieux observateur, c’est ainsi que la vérole
provenue de la lèpre et du bubon vénérien, à peu
près comme la race des mulets est sortie de l’accouplement
[384]
d’un cheval et d’une ânesse, se répandit par
contagion dans tout l’univers.» Il y a, dans ce passage
de la Grande Chirurgie, plus de logique et plus
de science que dans tous les écrits des quinzième
et seizième siècles, concernant la maladie vénérienne,
dont aucun médecin n’avait deviné la véritable
origine. Paracelse considérait donc la vérole
de 1494 comme un genre nouveau dans l’antique
famille des maladies vénériennes.
FIN DU TOME QUATRIÈME.
- A. Cabasson del.
- Drouart Imp.
- A. Leroy Scul.
COUTUME DU BERRY (XVe Siècle)
TABLE DES MATIÈRES
DU QUATRIÈME VOLUME.
FRANCE.
CHAPITRE VIII.
Sommaire.—Le roi des ribauds.—Recherches sur les prérogatives,
le rang et la charge de cet officier de la maison royale.—Définition
de ses attributions.—Analogie des ministeriales palatini
de Charlemagne, avec les rois des ribauds.—Attributions
des ministeriales palatini.—Ribaldus ou ribaud.—Philippe-Auguste
organise les ribauds en corps de troupes soldées.—Témoignages
de bravoure et d’intrépidité de ces hordes pillardes
et débauchées.—Le roi des ribauds.—Avantages honorifiques
et lucratifs de cette charge.—Nu comme un ribaud.—Diminution
successive d’importance de la royauté des ribauds.—La
ribaudie.—Appréciation de la charge du roi des ribauds dans
l’intérieur de la maison du roi.—Recherches sur les gages du
roi des ribauds.—Crasse Joë, roi des ribauds de Philippe le
Long.—Jean Guérin, roi des ribauds du duc de Normandie et
d’Aquitaine, fils de Charles V.—Droits d’exécution et d’aubaine
du roi des ribauds sur certains patients.—Jean Boulart et Pernette
la Basmette.—Le roi des ribauds devait être un fidèle et
incorruptible défenseur de la personne du roi.—Coquelet.—Preuves
de dévouement de Jean Talleran, seigneur de Grignaux,
roi des ribauds de François Ier.—Redevance hebdomadaire des
[386]
vassales du roi des ribauds.—Dernière transformation de l’office
du roi des ribauds à la cour de France.—Les dames des
filles de joie suivant la cour.—Olive Sainte.—Cécile de Viefville.—Des
rois des ribauds relevant de celui de l’hôtel du roi.—Colin-Boule,
roi des ribauds de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.—Le
curé de Notre-Dame d’Abbeville, roi des ribauds.—Balderic,
roi des ribauds de Henri II, roi d’Angleterre et duc
de Normandie.—Attributions des rois des ribauds des villes de
province.—Antoine de Sagiac, commissaire du roi des ribauds
de Mâcon, et Colette, femme de Pierre Talon.
CHAPITRE IX.
Sommaire.—État de la Prostitution, après l’ordonnance de 1254.—Institution
de la police des mœurs.—Les confrairies des
filles publiques.—Ordonnance de 1256.—Assimilation des
tavernes aux bordeaux.—Les taverniers.—Organisation des
filles publiques par Louis IX.—Les juifs.—Ordonnances
somptuaires concernant les femmes de mauvaise vie.—Statuts
des barbiers.—Les baigneurs-étuvistes.—Statuts des bouchers.—Mort
de saint Louis.—Philippe le Hardi.—Ordonnance
de 1272.—Les aiguillettes et les ceintures dorées.—L’enseigne
des filles publiques de Toulouse.—Bonne renommée
vaut mieux que ceinture dorée.—Courir l’aiguillette et courir
le guilledou.—Les trois brus de Philippe le Bel.—La tour de
Nesle.—Philippe et Gautier de Launay.—Jean Buridan.—L’âne
de Buridan.—État des mœurs après les croisades.—Hic
et hoc.—Les Templiers.
CHAPITRE X.
Sommaire.—Les mauvais lieux de Paris.—Topographie de la
Prostitution parisienne au moyen âge.—La rue de la Plâtrière.—La
rue du Puon.—La rue des Cordèles.—La petite ruellette
de Saint-Sevrin.—La rue de l’Ospital.—La rue Saint-Syphorien.—La
rue de la Chaveterie.—La rue Saint-Hilaire.—Le
clos Burniau.—La rue du Noyer.—La rue du Bon-Puits.—La
rue de l’École.—La rue Cocatrix.—La rue Charoui.—La
[387]
ruelle Sainte-Croix.—La rue Gervese-Laurens.—La rue du
Marmouset.—La rue de Chevez.—Le Val d’amour.—La rue
Saint-Denis de la Chartre.—La rue des Lavandières.—La
place aux Pourceaux.—La rue Béthisy.—La rue de l’Arbre-Sec.—La
rue de Maître-Huré.—La rue Biaubourc, etc.
CHAPITRE XI.
Sommaire.—Le cabaret du Char doré.—La rue de Glatigny.—La
rue du Fumier.—La rue d’Enfer.—La cour Ferry.—La
maison de Cocatrix.—Le Caignard.—Les voûtes de la Calandre
et du Marché-Palu.—L’île de Gourdaine.—Le Terrain ou la
Motte aux Papelards.—Les faubourgs.—Le Champ Gaillard.—Les
quatre tavernes méritoires.—Le Château-de-Paille.—La
taverne de la Mule.—Les lupanaires de l’Université.—Le
Champ-d’Albiac.—La rue Gracieuse.—Les Champs de la
Boucherie, Petit et de l’Allouette.—La rue de l’Aronde.—La rue
Gît-le-Cœur.—La rue Sac-à-Lie.—La rue Bordet.—Les
Cours des Miracles.—Etc., etc.
CHAPITRE XII.
Sommaire.—Le Livre de la Taille de Paris.—Le roi des ribauds
de la royne Marie.—Ysabiau l’Espinète.—Jehanne la Normande.—Edeline
l’Enragiée.—Aaliz la Bernée.—Aaliz la
Morelle.—La Baillie et la Perronnelle-aux-chiens.—Perronèle
de Sirènes.—Anès l’Alellète.—Jehanne la Meigrète.—Marguerite
la Galaise.—Geneviève la Bien-Fêtée.—Jehanne la
Grant.—Ysabiau la Camuse.—Maheut la Lombarde.—Marguerite
la Brete.—Ysabiau la Clopine.—Anès la Pagesse.—Juliot
la Béguine.—Jehanne la Bourgoingne.—Maheut la Normande.—Gile
la Boiteuse.—Mabile l’Escote.—Agnès aux
blanches mains.—Jehanette la Popine.—Ameline la Petite.—Ameline
la Grasse.—Marie la Noire.—Anès la Grosse.—Jehanne
la Sage, etc., etc.
CHAPITRE XIII.
[388]
Sommaire.—Ordonnances somptuaires de Philippe-Auguste.—Législation
des rois de France contre la dissolution et la superfluité
des habillements.—Les reines de ribaudie.—Défenses des
prévôts de Paris et arrêts du parlement.—Arrêt du 26 juin 1420.—Ordonnance
du roi Henri VI, roi d’Angleterre.—Arrêt du
parlement du 17 avril 1426, prohibant les ornements que portent
les damoiselles.—Les reines et princesses d’amour.—L’Ordinaire
de Paris.—Jehannette, veuve de Pierre Michel, Jehannette
la Neufville et Jehannette la Fleurie.—Les ceintures d’argent.—Inventaires
des défroques de Marguerite, femme de Pierre
de Rains, et de damoiselle Laurence de Villers, femme amoureuse.—Jehanne
la Paillarde et Agnès la Petite.—Ordonnance de
Henri II.—Jehanneton du Buisson.—De ceux et celles qui vivaient
du produit du maquerellage, tenaient bordiaux, louaient
bouticles au péché, ou gouvernaient clapier de filles publiques.—Le
marché aux Pourceaux.—Supplice des gueuses.
CHAPITRE XIV.
Sommaire.—État de la Prostitution légale dans les provinces de
l’ancienne France.—Coutumes du Beauvoisis.—La Prostitution
dans le duché d’Orléans.—Le Livre de jostice et de plet.—Les
provinces du Nord.—Organisation de la débauche publique
à Toulouse, Montpellier, Narbonne, etc.—Coutume de
Bayonne.—Coutume de Marseille.—Coutume du comté de
Montfort, de Rodez, de Nîmes, de Beaucaire, etc.—Les
femmes légères de Bagnols et de Saint-Saturnin.—Bordeaux.—Supplice
de l’accabussade.—Marseille.—Sisteron.—Avignon.—Lyon.—Genève.—Coutumes
diverses.—Les Lombards
et les prostituées.—Troyes, Amiens, Laon, Meaux, etc.—Rues
sans chef, affectées à la Prostitution légale.
CHAPITRE XV.
Sommaire.—Provinces centrales de la France.—La Champagne.—La
Touraine.—Le Berry.—Le Bourbonnais.—Le
[389]
Poitou.—L’Orléanais.—Les femmes mariées de Montluçon
assimilées aux prostituées.—L’Adveu de la terre du Breuil.—Servitudes
bouffonnes et facétieuses.—La chaussée de l’étang
de Souloire.—Le seigneur de Poizay et les denrées des filles
amoureuses.—Le roi de France et les ribaudes de Verneuil.—Les
femmes folles de Provins, etc., etc.
CHAPITRE XVI.
Sommaire.—Influence des mœurs et des usages de l’Italie sur
la Provence et le Languedoc au moyen âge.—La Grant-Abbaye
de la rue de Comenge, à Toulouse.—Enseigne des pensionnaires
de la Grant-Abbaye.—Le quartier des Croses.—La
maison du Châtel-Vert.—Vicissitudes de la Prostitution légale
à Toulouse jusqu’à la fin du seizième siècle.—Hospice de
la Prostitution légale à Montpellier.—Les entrepreneurs du
Bourdeau de Montpellier.—Clare Panais.—Guillaume de la
Croix et les deux fils de Clare Panais.—La maison de Paullet
Dandréa.—Le bourdeou privilégié d’Avignon.—Statuts de
Jeanne de Naples.—De la Prostitution à Avignon antérieurement
aux statuts de 1347.—Etc., etc.
CHAPITRE XVII.
Sommaire.—La Prostitution légale et la Prostitution libre.—De
l’influence de la Chevalerie sur l’honnêteté publique.—L’Enfant
d’honneur de la Dame des Belles-Cousines.—Le vrai chevalier,
destructeur de la corruption.—L’envoi de la Camise.—Le
châtelain de Coucy et la dame de Fayel.—Principalia amoris
præcepta de maître André, chapelain de Louis VII.—Les Cours
d’amour et les Parlements de gentillesse.—La jurisprudence
amoureuse.—Arrêts d’amour.—Le maire des Bois-Verts, le
baillif de Joye, le viguier d’amours, etc.—Les Jongleurs.—Etc.,
etc.
CHAPITRE XVIII.
Sommaire.—Les mœurs publiques et privées à partir du onzième
siècle.—Jean Flore, évêque d’Orléans.—Le Goliath de
la Prostitution.—Excentricités licencieuses du duc d’Aquitaine.
[390]
—Les Croisades et les Croisés.—Les trois cents femmes franques.—Les
concubines de l’ost du roi.—L’arrière-garde des
armées en campagne.—Les mille prostituées du capitaine
Garnier.—Jeanne d’Arc à Sancerre.—Ordonnance de cette
héroïne contre les ribaudes de la milice.—Comment la chevalerie
entendait l’hospitalité.—Décadence des mœurs chevaleresques.—Abominations
du règne de Charles VI.—Anne Piedeleu.—Indulgence
d’Ambroise de Loré, prévôt de Paris, pour
les prostituées, etc.
CHAPITRE XIX.
Sommaire.—Apparition des maladies vénériennes en France.—Origine
de la syphilis ou mal français.—Ses progrès effrayants
vers la fin du quinzième siècle.—Marche du mal vénérien à
travers le moyen âge.—Ses noms différents.—L’éléphantiasis
et les autres dégénérescences de la lèpre.—La mentagre et les
dartres sordides.—Lues inquinaria ou inguinaria.—Pèlerinages
dans les lieux saints.—L’église de Notre-Dame de Paris.—Le
feu sacré.—Vice des Normands.—Le mal des ardents.—Ses
ravages effrayants.—Le mal de saint Main et le feu de
saint Antoine.—Invocations à saint Marcel et à sainte Geneviève.—La
syphilis du quinzième siècle.—Les lépreux et les
léproseries.—Les croisés et la mésellerie.—Rigoureuse police
de salubrité, à laquelle on soumit les lépreux.—Du caractère
le plus général de la lèpre, d’après Guy de Chauliac, Laurent
Joubert, Théodoric, Jean de Gaddesden, etc., etc.
CHAPITRE XX.
Sommaire.—Noms scientifiques de la syphilis, morbus novus,
pestilentialis scorra, pudendagra, etc.—Ses surnoms populaires.—Les
saints qui avaient le privilége de la guérir.—Coïncidence
de son apparition en Italie avec l’expédition de
Charles VIII.—Quelle est la date précise de cette apparition?—Les
médecins et les historiens ne sont pas d’accord.—Traditions
relatives à son origine.—Les conjonctions de planètes.—Le
vin empoisonné avec du sang de lépreux.—Boucheries
de chair humaine.—La bestialité punie par elle-même.—La
jument et les singes.—La syphilis d’Europe n’est pas venue
d’Amérique.—Les médecins refusent d’abord de traiter cette
[391]
maladie.—Manardi, Mathiole, Brassavola et Paracelse disent
que l’infection vénérienne est née de la lèpre et de la Prostitution.
FIN DE LA TABLE.
Note de transcription détaillée:
En plus des corrections des erreurs clairement introduites par le
typographe, les erreurs suivantes ont été corrigées:
- p. 7 et 385, «François 1er» harmonisé en «François Ier»,
- p. 7, «des» corrigé en «de» («seigneur de Grignaux»),
- p. 71, «ia» corrigé en «i a» («Dame i a»),
- p. 111, suppression d’une virgule après «Les propriétaires lésés» comme dans les éditions suivantes du livre,
- p. 116, «archéologique» corrigé en «archéologie» («archéologie pornographique»),
- p. 132, «envahissemens» corrigé en «envahissements» («aux envahissements de la Prostitution»),
- p. 138, suppression d’une virgule après «cette espèce de femmes s’éloignait»,
- p. 177 et 299, «Sommaire:» harmonisé en «Sommaire.»,
- p. 205, «tuum» corrigé en «suum» («maritum suum verberante»),
- p. 258, «bayouno» corrigé en «baylouno» («lous samdès la baylouno»),
- p. 331, «solides» corrigé en «sordides» («les dartres sordides»),
- p. 331 et 351, «Gaddesen» corrigé en «Gaddesden» («Jean de Gaddesden»),
- p. 358, «Delamarre» corrigé en «Delamare».
Quand il subsistait un doute sur l’orthographe ou l’accentuation de
l’époque, celle-ci n’a pas été corrigée: Champ Gaillard / Champ-Gaillard,
maquerelage / maquerellage, Bois-Verts / bois verts,
Colin-Boule / Colinboule, ...
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 43772 ***