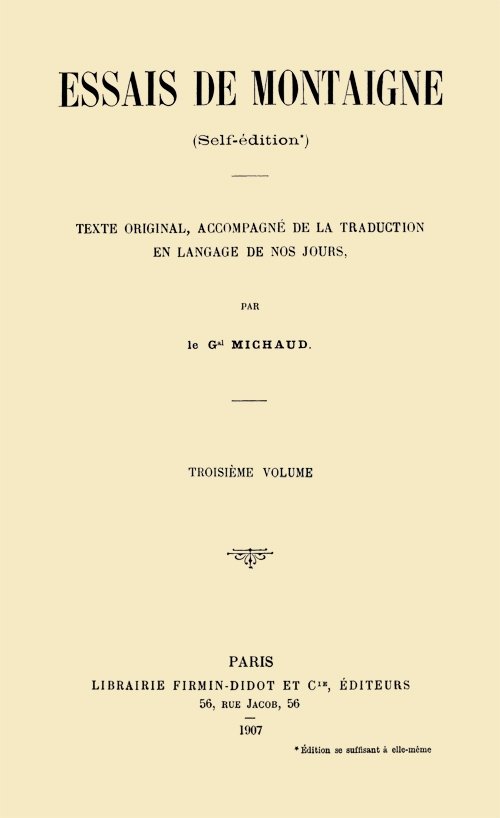
The Project Gutenberg EBook of Essais de Montaigne (self-édition); v. III, by Michel de Montaigne This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Essais de Montaigne (self-édition); v. III Author: Michel de Montaigne Translator: Général Michaud Release Date: February 1, 2019 [EBook #58801] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ESSAIS DE MONTAIGNE; VOLUME III *** Produced by Claudine Corbasson and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/American Libraries.)
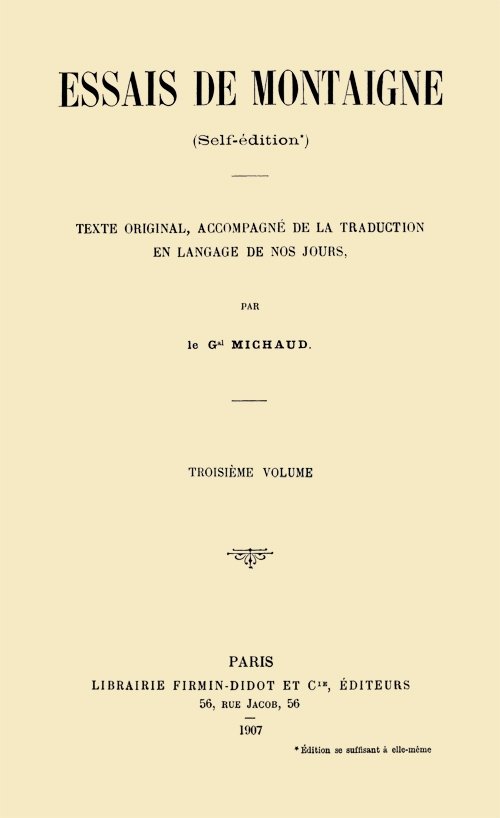
Cet ouvrage se compose de quatre volumes, comprenant:
1er VOLUME.—Avertissement, table générale des chapitres, texte et traduction du commencement au chapitre 6 inclus du livre II.
2e VOLUME.—Texte et traduction du chapitre 7 inclus du livre II au chapitre 35 inclus de ce même livre.
3e VOLUME.—Texte et traduction du chapitre 36 du livre II jusqu’à la fin.
4e VOLUME *.—Notice sur Montaigne, etc.; sommaire des Essais, variantes, notes, lexique, etc.
ILLUSTRATIONS:
1er vol.—Portrait de l’auteur, armoiries et signature.
2e vol.—Plan du domaine et perspective du manoir de Montaigne.
3e vol.—Vue de la tour de Montaigne et plan des étages.
4e vol.—Fac-similé d’une page du manuscrit de Bordeaux.
Voir sur ces illustrations, la notice insérée à cet effet au quatrième volume, en tête des Notes.
* Ce volume, indépendant des autres, est susceptible par sa contexture d’être aisément utilisé avec n’importe quelle édition des Essais ancienne ou moderne, moyennant un simple tableau de concordance de pagination facile à établir soi-même.

ESSAIS
DE
MICHEL SEIGNEVR
DE MONTAIGNE
CIↃ IↃ XCV
TEXTE ET TRADUCTION
(suite)
10
78
136
288
394
480
482
484
518
526
546
560
620
630
11
Si on me demandait de choisir entre tous les hommes venus à ma connaissance, je crois possible d’en trouver trois que je placerais au-dessus de tous les autres.
Prééminence d’Homère sur les plus grands génies; estime que l’on en a faite dans tous les temps.—L’un est Homère, non qu’Aristote ou Varron, par exemple, n’aient pas été aussi savants que lui, ni encore que, dans son art même, Virgile ne puisse lui être comparé, je laisse à juger de ce dernier point à ceux qui les connaissent tous deux; moi, qui n’en connais qu’un, je ne puis que dire, dans la mesure où je suis à même de me prononcer, que je ne crois pas que les Muses elles-mêmes puissent surpasser le poète latin: «Il chante sur sa lyre savante des vers pareils à ceux qu’Apollon lui-même module sur la sienne (Properce).» Toutefois, en jugeant ainsi, ne faudrait-il pas oublier que c’est surtout d’après Homère que Virgile s’est formé, qu’il l’a pris pour guide, pour maître d’école, et qu’un seul passage de l’Iliade a suffi à fournir le sujet et les développements de cette grande et divine Énéide. Mais ce n’est pas ainsi que je calcule, je tiens compte des particularités diverses qui font qu’Homère est admirable et presque au-dessus des conditions humaines; et, en vérité, je m’étonne souvent que lui, dont le génie a créé et mis en faveur de par le monde un certain nombre de divinités, n’ait pas été lui-même élevé au rang des dieux. Il était aveugle, indigent et vivait avant que les sciences eussent été codifiées et que les observations d’où elles sont nées eussent acquis de la certitude; il les a, nonobstant, tellement connues que tous ceux qui, depuis, ont entrepris d’organiser l’administration d’un état, diriger des guerres, écrire sur la religion, sur la philosophie, quelle que fût la secte dont il s’agissait, sur les arts, ont usé de lui comme d’une autorité très sûre par ses connaissances en toutes choses, et 13 de ses livres comme d’une bibliothèque suffisant à tout: «Il nous dit, bien mieux et plus clairement que Chrysippe et Crantor, ce qui est honnête ou ce qui ne l’est pas; ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter (Horace).» Il est, comme l’exprime un autre: «La source intarissable où les poètes viennent tour à tour s’enivrer des eaux sacrées du Permesse (Ovide).» Un autre dit: «Ajoutez-y les compagnons des Muses, parmi lesquels Homère tient le sceptre (Lucrèce)»; un autre: «Source abondante qui a coulé avec profusion dans les vers de la postérité, fleuve immense divisé en mille petits ruisseaux; héritage d’un seul, qui profite à tous (Manilius).»
C’est contre l’ordre de la nature qu’il a produit la meilleure des œuvres que puisse enfanter l’esprit humain: d’ordinaire toutes choses à leur naissance sont imparfaites, elles augmentent et se fortifient au fur et à mesure qu’elles croissent; par lui, la poésie, dès son enfance, est apparue mûre, accomplie, et avec elle diverses autres sciences. C’est pour cela qu’on peut le nommer le premier et le dernier des poètes; parce que, suivant ce beau témoignage que l’antiquité nous a laissé de lui: «Il n’y a eu personne avant lui qu’il ait pu imiter et personne après lui n’a pu l’imiter lui-même.» Ses expressions, suivant Aristote, sont uniques pour peindre le mouvement et l’action, tous ses mots sont significatifs.—Alexandre le Grand, ayant remarqué dans les dépouilles de Darius un riche coffret, ordonna qu’on le lui réservât pour y placer son Homère, disant que c’était son meilleur et plus fidèle conseiller en art militaire.—«C’est pour cette même raison, parce qu’il est très bon maître dans les questions afférentes à la conduite des guerres, disait Cléomène fils d’Anaxandridas, qu’il est le poète des Lacédémoniens.»—Plutarque lui décerne également cet éloge bien rare et qui lui est personnel, c’est qu’«il est le seul auteur au monde, qui n’ait jamais fatigué ni dégoûté ses lecteurs, auxquels il se montre toujours sous un jour nouveau, leur apparaissant sans cesse avec des grâces nouvelles».—Alcibiade, toujours porté aux excentricités, ayant demandé un exemplaire d’Homère à quelqu’un faisant profession de cultiver les lettres, lui donna un soufflet parce qu’il n’en avait pas, chose aussi condamnable, selon lui, qu’un de nos prêtres qui serait trouvé sans son bréviaire.—Xénophane se plaignait un jour à Hiéron, tyran de Syracuse, d’être si pauvre qu’il n’avait pas de quoi entretenir deux serviteurs: «Eh quoi, lui répondit Hiéron, Homère, qui était beaucoup plus pauvre que toi, en entretient bien plus de dix mille, tout mort qu’il est.»—Quel hommage rendu à Platon par Panétius, quand il le nommait «l’Homère des philosophes»!—Outre cela, quelle gloire peut se comparer à la sienne? Rien n’est plus dans la bouche des hommes que son nom et ses ouvrages; rien n’est plus connu, rien n’est plus admis que Troie, Hélène et ses guerres qui peut-être n’ont jamais existé; nos enfants portent encore des noms qu’il a imaginés il y a plus de trois mille ans. Qui ne connaît Hector et Achille? Ce ne sont pas seulement quelques races particulières qui 15 font remonter leur origine aux personnages qu’il a inventés, la plupart des nations s’en réclament: Mahomet II, empereur des Turcs, n’écrivait-il pas à notre pape Pie II: «Je m’étonne que les Italiens se liguent contre moi; ne descendons-nous pas, vous et moi, des Troyens; et n’avons-nous pas un intérêt commun à venger le sang d’Hector sur les Grecs? cependant vous les soutenez contre moi!»—N’est-ce pas une œuvre d’imagination pleine de noblesse, que celle qui crée une scène sur laquelle rois, peuples et empereurs vont jouant toujours les mêmes rôles depuis tant de siècles, et à laquelle l’univers entier sert de théâtre?—Sept villes se sont disputé laquelle lui a donné naissance: «Smyrne, Rhodes, Colophon, Salamine, Chio, Argos et Athènes (Aulu-Gelle)»; son obscurité même lui a valu ce regain d’honneur.
Alexandre le Grand; ses belles actions pendant sa vie si courte; il est préférable à César.—Le second de ces trois hommes supérieurs, c’est Alexandre le Grand. Considérez en effet à quel âge il a commencé ses conquêtes; le peu de moyens dont il disposait pour une si glorieuse entreprise; l’autorité qu’il sut acquérir, encore adolescent, sur ces capitaines qui le suivaient et qui étaient les plus grands et les plus expérimentés qu’il y eût au monde; les succès extraordinaires dont la fortune favorisa et gratifia ses exploits, parmi lesquels s’en trouvèrent de si hasardeux, pour ne pas dire téméraires: «Il renversait tout ce qui faisait obstacle à son ambition et aimait à s’ouvrir un chemin à travers les ruines (Lucain).» Quelle grandeur d’avoir, à l’âge de trente-trois ans, parcouru en vainqueur toute la terre habitée à cette époque, et, dans une moitié de vie humaine, être parvenu au plus haut degré auquel peuvent atteindre tous les efforts de l’homme; si bien, que vous ne pouvez imaginer ce qui serait arrivé, si cette existence eût eu une durée normale et, si se prolongeant jusqu’au terme qui lui est d’ordinaire assigné, sa valeur et sa fortune étaient allées croissant sans cesse. N’est-ce pas déjà quelque chose au-dessus de ce qu’il est donné à l’homme d’accomplir, que d’avoir fait ses soldats souches de tant de maisons royales; d’avoir laissé à sa mort le monde en partage à quatre successeurs simples capitaines de son armée, dont les descendants se sont si longtemps maintenus sur leurs trônes?—Que de vertus de premier ordre étaient en lui: justice, tempérance, générosité, fidélité à sa parole, amour pour les siens, humanité vis-à-vis des vaincus! Ses mœurs semblent en vérité n’avoir été entachées d’aucun reproche, et quelques-uns de ses actes personnels ont été extraordinaires et se voient rarement. Mais il est impossible de conduire des masses pareilles en de semblables circonstances, sans jamais s’écarter des règles de la justice; et les gens qui, comme lui, en ont la charge, sont à juger d’une façon générale, d’après l’idée maîtresse qui a présidé à leurs actions. Malgré cela, la ruine de Thèbes, les meurtres de Ménandre et du médecin d’Héphestion, de tant de prisonniers perses mis à mort à la fois; de cette troupe de soldats indiens, envers lesquels sa 17 parole avait été engagée; des Cosséiens, dont on extermina jusqu’aux enfants en bas âge, sont des mouvements d’égarement qui s’excusent mal. Pour ce qui est du meurtre de Clitus, la réparation en a dépassé la faute, et ce fait témoigne, autant que tout autre, de la bonté excessive qui était le fond de son caractère auquel, par tempérament, il était porté à s’abandonner; c’est avec autant d’esprit que de vérité qu’on a dit de lui qu’«il tenait ses vertus de la nature et ses vices de la fortune». Il aimait un peu trop la louange, et était un peu trop sensible à la critique; ses armes, les mangeoires et les mors de ses chevaux semés dans les Indes, tout cela semble pouvoir être excusé par son âge et son étrange prospérité.—Considérez aussi ses qualités militaires si nombreuses: sa diligence, sa prévoyance, sa patience, son respect de la discipline, sa sagacité, sa magnanimité, sa décision, son bonheur qui en ont fait le premier des hommes de guerre, lors même qu’Annibal, avec l’autorité qui s’attache à lui, ne l’eût lui-même proclamé tel; considérez sa beauté exceptionnelle et ses qualités physiques qui dépassaient tout ce qu’on pouvait imaginer, son port et son maintien qui commandaient le respect, alors que son visage apparaissait jeune, vermeil et flamboyant, «semblable à l’astre brillant du matin, astre que Vénus chérit entre tous les feux du firmament, lorsque, baigné des eaux de l’Océan, il s’élève majestueux et dissipe les ténèbres de la nuit (Virgile)»; son savoir et sa capacité qui embrassaient tout; la durée et la grandeur de sa gloire pure, nette, sans tache, que l’envie n’a pas effleurée; que longtemps après sa mort, une foi superstitieuse voulait que ses médailles portassent bonheur à ceux qui les avaient sur eux; que ses hauts faits ont été rapportés par plus de rois et de princes qu’il n’y a d’historiens pour reproduire ceux de tout autre grand de la terre quel qu’il soit; enfin, qu’encore maintenant, les Mahométans, qui méprisent toutes les légendes, acceptent et honorent la sienne, faisant exception pour lui seul.—Tout cela, dans son ensemble, amène à reconnaître que j’ai raison de le préférer même à César, qui seul pouvait me faire hésiter dans le choix que j’ai fait; car on ne peut nier que la personnalité de celui-ci a eu plus de part dans ses exploits, tandis qu’Alexandre dans les siens doit davantage à la fortune; égaux sous bien des rapports, César l’emporte peut-être à certains égards. Ce furent deux incendies, deux torrents qui, en des contrées diverses, ravagèrent le monde: «Tels des feux allumés en différents points d’une forêt pleine de broussailles et de lauriers secs et pétillants, ou tels des torrents qui tombent avec fracas du haut des montagnes et courent en bouillonnant à la mer, après avoir tout dévasté sur leur passage (Virgile).» Mais en admettant même que César ait apporté plus de modération dans son ambition, elle a causé tant de malheurs, aboutissant à ce triste résultat d’avoir amené la ruine de son pays, et de par le monde une dépravation universelle, que, tout réuni et mis en balance, je ne puis m’empêcher de pencher en faveur d’Alexandre.
19
Épaminondas est le meilleur de tous; il l’emporte sur Alexandre et César, mais son théâtre d’action a été plus restreint; il réunissait en lui toutes les vertus que l’on trouve éparses chez d’autres.—Le troisième, et pour moi le meilleur de tous, c’est Épaminondas. Il n’a pas, à beaucoup près, autant de gloire que bien d’autres; mais ce n’est pas là un point essentiel en la matière; et, en fait de résolution et de vaillance, non de celles qu’aiguillonne l’ambition, mais de celles que la sagesse et la raison font naître dans une âme bien pondérée, il en avait autant qu’on peut se l’imaginer. De ces vertus, il a, à mon sens, donné des preuves autant qu’Alexandre lui-même et que César; et, bien que ses exploits guerriers ne soient ni si nombreux, ni si importants, ils ne laissent cependant pas, à bien les considérer, eux et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, d’être aussi sérieux, de difficultés d’exécution aussi grandes que les leurs, témoignant d’autant de hardiesse et de capacité militaire. Les Grecs lui ont fait l’honneur de le nommer le premier d’entre eux, et cela, sans qu’il se soit trouvé de contradicteur; or être le premier en Grèce, c’était facilement être le premier du monde. Quant à son intelligence, il nous reste, à ce sujet, ce jugement porté sur lui par ses contemporains: «Jamais personne ne sut tant et ne parla si peu», car il appartenait à la secte de Pythagore. Chaque fois qu’il a parlé, nul n’a jamais mieux dit; il était excellent orateur et avait le don de persuasion. Pour ce qui est de ses mœurs et de sa conscience, il a surpassé de beaucoup sous ce rapport tous ceux qui ont participé à la gestion des affaires publiques; car, sur ce point essentiel pour nous à considérer, parce que seul il donne la mesure réelle de notre valeur, et qu’à lui seul il fait équilibre à tous les autres réunis, il ne le cède à aucun philosophe, pas même à Socrate. Chez lui, l’innocence est une qualité maîtresse, inhérente à sa nature, constante, uniforme, incorruptible, qui est telle qu’elle paraît; mise en parallèle avec celle d’Alexandre, on reconnaît que chez ce dernier elle ne vient qu’en seconde ligne, est incertaine, a des inégalités, n’est pas ferme et n’apparaît que par ci, par là.
L’antiquité a estimé, en soumettant à une critique minutieuse ses grands capitaines pris un à un, que chez chacun des autres on découvre quelque qualité spéciale à laquelle il doit son illustration; chez Épaminondas seul, la vertu et la capacité sont en tout et partout constamment pleines et pareilles à elles-mêmes; en n’importe quelle circonstance de la vie humaine, elles ne laissent rien à désirer en lui, qu’il s’agisse d’affaires publiques ou d’affaires privées, qu’on soit en paix ou en guerre, que ce soit pour vivre ou pour mourir avec grandeur et gloire; je ne connais aucune autre fortune humaine, sous quelque forme que je l’envisage, que j’honore et aime autant.
Je trouve, il est vrai, empreinte de trop de scrupule son obstination à vouloir demeurer pauvre, et ses meilleurs amis pensaient de même; ce sentiment, pourtant si élevé et si digne d’admiration, 21 est le seul point en lui qui me semble, par son exagération, prêter à la critique; et je ne souhaiterais pas pour moi-même être en cela porté à l’imiter à ce même degré.
Scipion Émilien pourrait lui être comparé; ce qu’on peut dire d’Alcibiade.—Scipion Émilien, s’il avait eu une fin aussi héroïque et superbe que la sienne et une connaissance aussi approfondie et universelle des sciences que celle qu’Épaminondas possédait, est le seul homme qui eût pu entrer en balance avec lui. Combien je regrette que le parallèle établi par Plutarque, dans lequel il jugeait comparativement les deux vies précisément les plus nobles dont il se soit occupé, celles de ces deux personnages qui, d’une voix unanime, furent, l’un le premier des Grecs, l’autre le premier des Romains, soit des premiers d’entre ceux qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous! Quel magnifique sujet et quel metteur en œuvre sans pareil!
Pour un homme qu’on ne saurait mettre au rang de ces exceptions, mais qui est de ceux que nous disons être des hommes honorables, dont les mœurs ont été convenables sans rien offrir d’extraordinaire, bien doué, sans être d’un génie transcendant, la vie d’Alcibiade, tout bien considéré, me semble, d’entre celles que je connais, la plus riche de celles vécues en ce monde, comme on dit communément, par les phases remarquables et des plus enviables qu’elle a présentées.
Bonté, équité et humanité d’Épaminondas.—Pour témoigner de l’excellence d’Épaminondas, j’indiquerai encore ici quelques-unes de ses manières de voir. La plus grande satisfaction de toute sa vie a été, d’après lui-même, le plaisir que par lui son père et sa mère ont éprouvé de sa victoire de Leuctres; il est particulièrement touchant de le voir mettre leur contentement au-dessus de celui que lui-même devait si justement et si complètement ressentir d’un haut fait aussi glorieux.—«Il ne croyait pas permis, même pour rendre la liberté à son pays, de mettre à mort quelqu’un sans l’avoir au préalable mis en jugement»; c’est ce qui fit qu’il se montra si peu empressé à se joindre à Pélopidas, son ami, dans la conjuration ourdie pour la délivrance de Thèbes.—Il estimait encore que «dans une bataille il fallait éviter de se rencontrer avec un ami qui se trouverait dans les rangs opposés, et l’épargner».—Son humanité à l’égard des ennemis eux-mêmes le rendit suspect aux Béotiens, lorsque, ayant, par miracle, contraint les Lacédémoniens à lui ouvrir les défilés qui, près de Corinthe, ferment l’entrée de la Morée et qu’ils avaient entrepris de défendre, il s’était contenté de leur passer sur le corps, sans les poursuivre à outrance. Pour ce fait, il fut déposé de sa charge de capitaine-général: révocation qui l’honore au plus haut point en raison de la cause qui l’a amenée, si bien que ceux qui l’avaient prononcée, eurent la honte de se trouver dans l’obligation de le replacer dans ces fonctions, reconnaissant que de lui dépendaient leur salut et leur gloire, la victoire le suivant comme son ombre 23 partout où il portait ses pas. A sa mort, de même qu’elle était née par lui, avec lui mourut la prospérité de la patrie.
Comment Montaigne faisait son livre; il n’y travaillait que dans ses moments de loisir.—Je ne mets la main à cette sorte de fagotage qu’est ce livre formé de tant de pièces diverses, que lorsque je n’ai absolument rien autre à faire et que je suis chez moi; aussi, s’est-il fait à différentes reprises et par intervalles, les circonstances faisant que je demeure parfois absent plusieurs mois consécutifs. Du reste, je ne substitue jamais de nouvelles idées aux premières; il peut m’arriver de changer un mot pour varier mes expressions, mais non de les modifier. Je cherche à représenter le cours de mes pensées et voudrais qu’on les saisisse chacune à son origine; je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt, de manière à pouvoir suivre leurs transformations successives. Un valet que j’employais à les écrire sous ma dictée, s’est imaginé faire un beau coup, en me volant quelques fragments de mon ouvrage, qu’il a eu soin de choisir; je m’en console en pensant qu’il n’y gagnera pas plus que je n’y ai perdu.
Il y a sept ou huit ans qu’il a commencé à l’écrire, et depuis dix-huit mois il souffre d’un mal qu’il avait toujours redouté, de la colique.—Depuis que j’ai commencé, je suis devenu plus vieux de sept ou huit ans; ce n’a pas été sans faire quelque acquisition nouvelle, j’y ai gagné notamment des coliques néphrétiques que m’a values la libéralité des ans, car leur commerce et leur compagnie, en se prolongeant, ne se passent guère sans qu’on en recueille quelque fruit de ce genre. J’aurais bien voulu que parmi les présents divers dont ils peuvent gratifier ceux qui les fréquentent longtemps, ils en eussent choisi pour moi un autre plus à ma convenance; ils ne pouvaient m’en donner un que j’aie plus en horreur, et cela depuis mon enfance; car c’est précisément, de tous les accidents de la vieillesse, celui que je redoutais le plus.
Combien les hommes sont attachés a la vie! il commence a s’habituer à cette cruelle maladie.—Maintes fois, à part moi, j’ai pensé que j’allais trop de l’avant dans le sentier de la vie; qu’à force de faire un si long chemin, je ne devais pas manquer de finir par une mauvaise rencontre; je le sentais et je protestais, me disant qu’il était l’heure de partir, qu’il faut interrompre l’existence, en tranchant dans le vif, quand on est encore sain de corps, comme font les chirurgiens lorsqu’ils ont à couper 25 quelque membre; me répétant qu’à celui qui ne rend pas à temps la vie qu’elle lui prête, la nature se fait d’ordinaire payer avec une bien rigoureuse usure. Et cependant, il s’en fallait tellement qu’à ce moment je fusse prêt pour ce départ que, depuis dix-huit mois ou à peu près que je suis en ce déplaisant état, je commence déjà à m’en accommoder; je me fais à ces douleurs qui sont devenues les compagnes inséparables de mon existence, j’y trouve des sujets de consolation et d’espérance; les hommes sont tellement acoquinés à leur misérable vie, qu’il n’est si rude condition qu’ils n’acceptent pour la conserver. Écoutez Mécène: «Que je ne puisse faire usage de mes mains, de mes pieds, que je sois cul-de-jatte, que j’aie perdu mes dents, qu’importe! tout est bien, du moment que je vis encore.»—C’était de la part de Tamerlan masquer, sous les dehors d’une sotte humanité, la cruauté étrange dont il usait à l’égard des lépreux qu’il faisait mettre à mort, dès qu’il lui en était signalé, «afin, disait-il, de les délivrer de l’existence si pénible qu’ils menaient»; comme si tous, sans exception, n’eussent pas préféré être trois fois lépreux et continuer à vivre.—Antisthène le cynique, étant fort malade, criait: «Qui me délivrera de mes maux?» Diogène, qui était venu le voir, lui présenta un couteau, en lui disant: «Ceci et de suite, si tu le veux.—Je ne demande pas, répliqua Antisthène, à être délivré de la vie, mais seulement de mes maux.»—Les souffrances qui n’affectent que l’âme ont beaucoup moins de prise sur moi que sur la plupart des autres hommes: partie, par un effet de ma raison, le monde tenant certaines choses pour si horribles, qu’elles lui semblent à éviter même au prix de la vie, tandis qu’elles me sont à moi à peu près indifférentes; partie, par un effet de ma constitution qui fait que je ne comprends pas les accidents et y demeure insensible, quand ils ne se manifestent pas par la douleur, disposition que je considère comme une des meilleures choses qui soient en moi. Pour ce qui est des souffrances auxquelles notre corps est réellement en butte et dont nous ne pouvons nous défendre, j’y suis excessivement sensible; et pourtant, jadis, les envisageant d’un regard mal assuré, par trop sensible et amolli par l’effet d’une heureuse santé, dont il m’a été donné de jouir longtemps, et de la tranquillité que Dieu m’a accordée durant la plus grande partie de mon existence, je les avais, par la pensée, conçues si intolérables, qu’en vérité j’en avais plus de peur que je n’en ai ressenti de mal; ce qui vient encore à l’appui de cette croyance que la plupart des facultés de l’âme, telles que nous en usons, apportent plus de trouble en notre vie qu’elles ne nous rendent service.
Je suis actuellement en proie à la pire de toutes les maladies, la plus soudaine, la plus douloureuse, la plus mortelle, celle pour laquelle les médecins sont le plus impuissants. J’en ai déjà subi cinq ou six accès bien longs et bien pénibles; et cependant, ou je me flatte, ou je crois que, malgré tout, il est encore possible de les endurer pour celui dont l’âme est dégagée de la crainte de la mort 27 et ne prête pas attention aux menaces, conclusions et conséquences que les médecins nous mettent en tête; la douleur n’a pas, à elle seule, une acuité tellement violente et vive, qu’un homme calme doive en concevoir de la rage et du désespoir. Ces coliques ont eu au moins pour moi cet avantage, qu’elles me détermineront à ce que je n’ai encore pu prendre sur moi, d’être tout à fait prêt et familiarisé avec l’idée de la mort; car plus elles me presseront et m’importuneront, plus je parviendrai à moins redouter d’en finir. J’en étais déjà arrivé à ne tenir uniquement à la vie, que parce que je vis; elles dénoueront cet attachement qui demeure encore; et Dieu veuille que, si finalement leur violence venait à excéder mes forces, elles ne me rejettent pas dans l’extrême opposé, non moins condamnable, d’aimer et de désirer mourir! «Ne craignez ni ne désirez votre dernier jour (Martial).» Ce sont là deux passions à redouter; mais le remède est plus à notre portée pour l’une que pour l’autre.
Il n’est pas de ceux qui réprouvent que l’on témoigne par des plaintes et des cris les souffrances que l’on ressent.—Au surplus, j’ai toujours estimé de pure représentation, ce précepte qui ordonne * si rigoureusement et si positivement de faire bonne contenance et d’affecter le dédain et le calme devant la souffrance que nous cause le mal. Pourquoi la philosophie, qui ne tient compte que de ce qui est réel et de ses conséquences, va-t-elle s’amuser à ces apparences extérieures? Qu’elle laisse donc ce soin aux farceurs et à ceux qui professent la rhétorique et attachent une si grande importance à nos gestes; qu’elle concède franchement, lors même qu’elle ne part ni du cœur, ni de l’estomac, cette faiblesse qui se décèle par la voix, et qu’elle range * ces plaintes qu’on pourrait contenir, dans la catégorie des soupirs, des sanglots, des palpitations, des pâleurs que la nature a faits indépendants de notre volonté; et, pourvu que le courage soit sans effroi, nos paroles sans désespoir, qu’elle se déclare satisfaite; qu’importe que nous nous tordions les bras, pourvu que nous ne tordions pas nos pensées. C’est pour nous, et non pour autrui, que la philosophie nous forme; pour que nous soyons et non pour que nous paraissions être; qu’elle se borne à exercer son action sur notre entendement qu’elle s’est appliquée à dresser; qu’aux efforts de la colique, elle maintienne notre âme à même de se reconnaître, de suivre son train accoutumé, de combattre la souffrance et d’y résister, au lieu de se prosterner honteusement à ses pieds; elle peut être émue, échauffée par la lutte qu’elle a à soutenir, elle ne doit en être ni abattue ni renversée; elle doit demeurer capable, dans une certaine mesure, de conserver ses relations, de converser, de vaquer aux autres occupations qui lui sont dévolues. Dans d’aussi extrêmes accidents, c’est cruauté d’exiger de nous une attitude si hors nature; si notre âme est en bon état, c’est peu que nous ayons mauvaise mine; si ce doit être pour le corps un soulagement que de se plaindre, qu’il se plaigne; si l’agitation lui plaît, qu’il se tourne et 29 se retourne, qu’il se démène à sa fantaisie; s’il s’imagine trouver une sorte de dérivatif à son mal (ainsi que certains médecins disent que cela vient en aide aux femmes enceintes, au moment de leur délivrance) en vociférant autant qu’il est en lui, si cela doit le distraire de ses souffrances, qu’il crie à tue-tête. Ne commandons pas ces manifestations, mais permettons-les. Non seulement Épicure pardonne au sage de crier au milieu des tourments, mais il le lui conseille: «Les lutteurs font de même; tout en frappant l’adversaire, tout en agitant leurs cestes, ils font entendre des gémissements; c’est que, sous l’effort de la voix, tout le corps se raidit et que le coup est asséné avec plus de vigueur (Cicéron).»—Le mal nous donne par lui-même assez de travail, sans encore nous embarrasser de règles superflues.
Pour lui, il parvient assez bien à se contenir et, même dans les plus grandes douleurs, il conserve sa lucidité d’esprit.—Ce que j’en dis, c’est pour excuser ceux qu’on voit d’ordinaire tempêter lorsqu’ils sont aux prises avec cette maladie et qu’ils ont à en soutenir les assauts; car pour moi, jusqu’à cette heure, j’ai réussi à faire un peu meilleure contenance, me contentant de gémir sans jeter les hauts cris; non que je me mette en peine pour conserver ce decorum extérieur, car je prise peu un semblable mérite et fais au mal toutes les concessions qu’il veut; mais parce que, ou mes douleurs ne sont pas aussi excessives que les leurs, ou que j’y apporte plus de fermeté que la plupart d’entre eux. Je me plains, je me dépite quand ces piqûres aiguës me pressent trop, mais il en est «qui crient, qui gémissent, qui font retentir l’air de voix lamentables (Attius)»; moi, je n’en arrive pas à un pareil désespoir. Je me palpe au plus fort de mes crises, et toujours j’ai constaté que je ne cesse dans ces moments d’être capable de parler, de penser, de répondre aussi raisonnablement qu’à tout autre, non cependant d’une façon aussi suivie, la douleur troublant et coupant mon attention. Quand on me croit le plus abattu, que les assistants me ménagent en ne me parlant pas, pour éprouver mes forces je leur tiens souvent de moi-même des propos qui n’ont pas le moindre rapport avec mon état. En somme, je demeure capable de tout par un effort momentané, mais qu’il ne faut pas prolonger. Que n’ai-je la chance de ce rêveur que nous présente Cicéron, qui, en songe, lutinant une fille de joie, se trouva débarrassé de la pierre qui lui obstruait le canal de l’urèthre et qui vint se perdre dans les draps! Ce sont des jouissances de tout autre nature que me causent les pierres qui se forment en moi. Dans les intervalles de douleur excessive, lorsque mon mal fait trêve, je me retrouve aussitôt dans mon état normal, d’autant que mon âme ne s’en alarme pas, elle ne fait que recevoir le contre-coup des sensations douloureuses qu’éprouve le corps, ce dont je suis certainement redevable au soin avec lequel je me suis raisonné à propos de ces accidents: «Maintenant, aucune peine, aucun danger ne sauraient me surprendre; j’ai tout prévu, je suis préparé à tout 31 (Virgile).» Et cependant, pour un apprenti, je suis soumis à une assez rude épreuve; la transition a été bien prompte et bien dure, étant passé tout à coup d’une vie très douce et très heureuse, à un état des plus douloureux et des plus pénibles qui se puissent imaginer; outre que cette maladie est fort redoutable par elle-même, elle a eu chez moi des débuts beaucoup plus aigus et difficiles qu’ils ne sont d’ordinaire, et les accès me reviennent si souvent que ma santé m’en paraît atteinte à tout jamais. Je suis toutefois parvenu jusqu’ici à me maintenir dans une situation d’esprit telle que, si elle ne s’altère pas, je me trouverai avoir encore une existence en meilleures conditions que mille autres, qui ne souffrent ni de la fièvre, ni d’autre mal que celui qu’ils se donnent à eux-mêmes parce que leur jugement est en défaut.
Ce qui l’étonne et ne peut s’expliquer, ce sont ces transmissions physiques et morales, directes et indirectes des pères, aïeux et bisaïeuls aux enfants.—Il est un genre d’humilité fort adroite, qui naît de la présomption: c’est de reconnaître notre ignorance en certaines choses et d’avouer courtoisement que dans les œuvres de la nature, il y a des qualités et des conditions que nous ne pouvons saisir, dont nous sommes impuissants à découvrir les moyens et les causes. Par cette honnête et consciencieuse déclaration, nous espérons gagner qu’on nous croira aussi, quand nous parlerons de choses que nous disons comprendre. A quoi bon faire un triage parmi les miracles et les choses échappant à notre entendement qui ne nous touchent pas! il me semble que parmi celles que nous avons continuellement sous les yeux, il y en a de si étrangement incompréhensibles, qu’elles surpassent tous les miracles, par la difficulté que nous avons de les expliquer. Quelle chose prodigieuse n’est-ce pas, que cette goutte prolifique qui nous engendre et qui porte avec elle des empreintes, non seulement de la constitution physique de nos pères, mais aussi de leurs pensées et de leurs penchants? Où se loge, en cette goutte d’eau, ce nombre infini de formes embryonnaires? Comment ces germes de ressemblance sont-ils disposés en elle, pour que, par une progression singulière et qui échappe à toute règle, un arrière-petit-fils tienne de son bisaïeul, un neveu de son oncle? Dans la maison des Lépide, à Rome, trois membres de cette famille, non de père en fils, mais avec des intervalles dans la filiation, sont nés avec des taies sur le même œil. A Thèbes, il y avait une lignée où chacun, alors qu’il était encore dans le sein de la mère, portait une empreinte de fer de lance, si bien que ceux qui ne l’avaient pas, étaient tenus pour illégitimes. Aristote dit que chez un peuple où les femmes étaient en commun, on attribuait aux pères leurs enfants, par la ressemblance des uns avec les autres.
Il pense tenir de son père ce mal de la pierre dont il est affligé, comme aussi il a hérité de lui son antipathie pour les médecins.—Il est à croire que je dois à mon père cette 33 disposition à la pierre; car il est mort d’un calcul de forte dimension qu’il avait dans la vessie et dont il souffrait considérablement. Il ne s’est aperçu de son mal que dans sa soixante-septième année; jusque-là, il n’avait rien éprouvé de nature à le mettre sur ses gardes, rien ressenti ni dans les reins, ni dans le côté, ni ailleurs; il avait vécu jusqu’alors en parfaite santé et n’était pas sujet aux maladies; celle-ci dura encore sept ans, durant lesquels il mena une fin d’existence des plus douloureuses. J’étais né vingt-cinq ans, et même davantage, avant que le mal ne se déclarât, alors que sa santé était dans son meilleur état; par ordre de naissance, j’étais le troisième de ses enfants. Où, pendant tout ce temps, a couvé cette propension à cette infirmité; et, alors que mon père était si loin d’en souffrir, comment cette si faible émanation de lui-même, d’où je suis sorti, a-t-elle été, pour sa part, impressionnée au point que je n’ai commencé à la ressentir que quarante-cinq ans après, et que, jusqu’ici, de tant de frères et de sœurs, tous issus de la même mère, je sois le seul dans ce cas? Celui qui m’éclairera à cet égard, peut être assuré que je le croirai dans les explications qu’il me donnera sur tous autres miracles qu’il voudra, pourvu qu’il ne me paie pas, comme cela arrive d’ordinaire, d’une théorie beaucoup plus fantastique et difficile à admettre que la chose elle-même.
Que les médecins excusent un peu ma liberté de langage; mais cette infusion, cette insinuation œuvre de la fatalité, m’ont également communiqué la haine et le mépris que je porte à leurs doctrines; cette antipathie pour leur art m’est héréditaire. Mon père a vécu soixante-quatorze ans; mon aïeul, soixante-neuf; mon bisaïeul, près de quatre-vingts; tous, sans avoir pris aucun remède d’aucune sorte, et, pour eux, tout ce qui n’était pas d’usage ordinaire, était considéré comme drogue. La médecine s’est formée d’observations et d’expérience; il en a été de même de ma manière de voir. Cette longévité n’est-elle pas un fait d’expérience des mieux établi? Je ne sais si tous les médecins réunis pourraient relever sur leurs registres trois cas pareils d’hommes nés, élevés et morts au même foyer, sous le même toit, ayant vécu autant grâce à leur intervention. Ils seront bien obligés d’avouer que si, en cela, la raison n’est pas pour moi, j’ai du moins de mon côté le hasard; or, chez eux, le hasard est un bien plus grand maître que la raison. Qu’ils ne tirent pas avantage de ma situation présente, qu’ils ne me menacent pas; atterré comme je le suis, ce ne serait pas loyal. A dire vrai, les exemples tirés de ma propre famille, me donnent assez avantage sur eux, bien qu’ils s’arrêtent là; mais les choses humaines persistent rarement aussi longtemps, et il ne s’en faut que de dix-huit ans, que celle-ci ait déjà une durée de deux cents ans, la naissance de mon bisaïeul remontant en effet à l’an mil quatre cent deux; il ne serait donc pas étonnant que cette expérience commençât à tourner autrement. Qu’ils ne me reprochent pas les maux qui m’assaillent à cette heure; j’ai vécu pour 35 ma part quarante-sept ans en parfaite santé, n’est-ce pas suffisant? Si ma vie prenait fin à ce moment, elle serait encore des plus longues.
Mes ancêtres, par une tendance qui était dans leur nature, et qui chez eux était irraisonnée, appréciaient peu la médecine; la seule vue des drogues faisait horreur à mon père. Le sieur de Gaviac, mon oncle paternel, homme d’église, était maladif depuis sa naissance; il n’en a pas moins vécu, avec sa santé débile, jusqu’à soixante-sept ans. Ayant été pris jadis d’une forte et violente fièvre continue, les médecins décidèrent de lui déclarer que s’il ne voulait pas s’en remettre à leurs soins (ils appellent soins ce qui le plus souvent nous empêche de guérir), il était infailliblement perdu. Le bon homme, fort effrayé de cette horrible sentence, leur répondit: «Alors, c’en est fait, je suis un homme mort»; mais Dieu ne tarda pas à mettre ce pronostic en défaut. Ils étaient quatre frères; seul, le sieur de Bussaguet, qui était le plus jeune et de beaucoup, eut recours à eux; je suis porté à croire que c’était en raison des rapports qu’il avait avec les personnes d’autres professions, car lui-même était conseiller au parlement. Mal lui en prit, car bien que paraissant le plus robuste de constitution des quatre, il mourut longtemps avant les autres; un seul, le sieur de Saint-Michel, l’avait précédé au tombeau.
Motif du peu d’estime en laquelle il tient leur science; elle fait plus de malades qu’elle n’en guérit.—Il est possible que je tienne d’eux cette aversion naturelle pour la médecine; mais, s’il n’y eût eu que cette seule considération, j’aurais essayé de la surmonter, car tous ces partis pris qui naissent en nous sans raison, sont mauvais; c’est une sorte de maladie qu’il faut combattre. Peut-être était-ce une prédisposition, mais, depuis, la raison est survenue qui, l’appuyant et la fortifiant, a déterminé l’opinion que j’en ai, car je hais également de se déclarer contre cet art en raison de ce que ses procédés ont de désagréable. Ce serait contraire à ma disposition d’esprit qui me porte à trouver que la santé vaut d’être conservée au prix de toutes les incisions et cautérisations, si pénibles qu’elles soient; car si, d’accord avec Épicure, les voluptés qui ont pour conséquence des douleurs trop grandes me semblent à éviter, les douleurs qui ont pour résultat des voluptés qui les excèdent me paraissent à rechercher.—C’est une chose précieuse que la santé, la seule qui, en vérité, mérite qu’on y emploie pour se la procurer, non seulement le temps, la sueur, la peine, les biens dont on dispose, mais la vie elle-même; d’autant que, sans elle, l’existence nous devient * pénible et à charge; sans elle, la volupté, la sagesse, la science, la vertu elle-même se ternissent et s’évanouissent. Aux raisonnements les plus fermes et les plus serrés par lesquels la philosophie pourrait chercher à nous prouver le contraire, il suffit d’opposer l’impossibilité dans laquelle Platon, supposé frappé d’un accès d’épilepsie ou d’une attaque d’apoplexie, se serait trouvé de tirer la moindre aide des riches 37 facultés de son âme. Tout chemin qui mènerait à la santé, ne serait pour moi ni rude, ni coûteux; mais j’ai certaines raisons, au moins apparentes, qui font que je me défie étrangement de toutes les assertions des médecins. Je ne dis pas que la médecine n’ait quelques données sérieuses; que, parmi tant de productions de la nature, il n’y en ait pas qui soient propres à la conservation de notre santé, cela est certain: je sais qu’il y a des herbes qui provoquent la transpiration, d’autres qui l’arrêtent; je sais, par expérience, que le raifort produit des vents, et que les feuilles de séné amènent un relâchement du ventre; plusieurs autres faits d’observation me sont connus, tout comme je sais que le mouton est nourrissant et que le vin réconforte; Solon ne disait-il pas que manger est un médicament comme un autre, que c’est le remède qui s’emploie contre la maladie de la faim. Je ne désavoue pas que nous mettions à profit les productions de ce monde, et ne doute pas de la puissance et des ressources de la nature, ni de la possibilité de la faire servir à nos besoins; je vois combien les brochets et les hirondelles se trouvent parfaitement de s’en remettre à elle; mais je me défie des inventions de notre esprit, de notre science, de notre art, pour lesquelles nous l’avons abandonnée elle et ses règles, et que nous ne savons contenir dans de sages limites.—De même que nous décorons du nom de justice un fatras des premières lois venues, mises en vigueur et appliquées dans des conditions souvent fort ineptes et fort iniques, et que ceux qui critiquent un pareil système et le dénoncent, n’entendent pourtant pas condamner cette noble vertu dont il a emprunté le nom, mais seulement l’abus et la profanation de cette appellation si respectable; de même, dans la médecine, j’honore son nom glorieux, ce qu’elle se propose, ce qu’elle nous promet de si grande utilité pour le genre humain; mais ce à quoi nous l’appliquons, quand nous en parlons, je ne l’honore, ni l’estime.
En premier lieu, l’expérience m’a appris à redouter les médecins; car, à ma connaissance, il n’est pas de gens si tôt malades, si tard guéris, que ceux qui se mettent entre leurs mains; leur santé elle-même est altérée et compromise par les régimes qu’on leur impose. Les médecins ne se contentent pas de régenter la maladie, ils vont jusqu’à rendre la santé malade, afin qu’en aucun moment on ne puisse échapper à leur autorité; d’une santé qui, jamais, ne laisse rien à désirer, ne concluent-ils pas qu’elle est l’indice d’une maladie grave qui surviendra dans l’avenir? J’ai été assez souvent malade et, sans avoir recours à eux, mes maladies, et j’en ai eu, je puis dire, de toutes sortes, ne m’ont pas plus fait souffrir et ont été aussi courtes que chez n’importe quel autre, sans que j’y aie mêlé l’amertume de leurs ordonnances. Quand je suis en santé, j’en agis complètement à ma guise, sans m’imposer de règle, ne tenant compte que de mes habitudes et de mon plaisir. Si je voyage, tout lieu m’est bon pour y stationner, parce que lorsque je suis malade, je n’ai pas besoin d’un régime autre que celui que j’observe étant 39 bien portant, par suite je ne m’inquiète pas de me trouver sans médecin, sans apothicaire, sans secours, ce dont j’en vois qui se tourmentent plus que de leur mal. Du reste, par leur état de santé et la durée de leur vie, les médecins sont-ils eux-mêmes un témoignage déjà si probant de bons effets de leur science?
La plupart des peuples, entre autres les Romains, ont longtemps existé sans connaître les médecins.—Il n’est pas de peuple qui ne soit demeuré plusieurs siècles sans médecins; et ces siècles, les premiers de leur existence, en furent les meilleurs et les plus heureux. Encore à cette heure, la dixième partie des gens de par le monde n’en use pas; nombre de nations où on vit en meilleure santé et plus longtemps qu’ici, ne les connaissent pas; et, parmi nous, le bas peuple s’en passe et s’en trouve bien. Les Romains sont demeurés six cents ans avant de les admettre, et, après en avoir essayé, les ont chassés de leur ville, à l’instigation de Caton le censeur, qui montra comment il pouvait aisément s’en passer en vivant quatre-vingt-cinq ans, et faisant vivre sa femme jusqu’à l’âge le plus avancé, non sans le secours de la médecine, mais bien sans celui des médecins, car ce nom de médecine se peut appliquer à tout ce qui est susceptible de concourir à la conservation de notre santé. Il maintenait sa famille bien portante, dit Plutarque, en lui faisant manger force lièvres, je crois; comme les Arcadiens qui, au dire de Pline, guérissaient toutes les maladies avec du lait de vache, et les Libyens qui, d’après Hérodote, jouissent en général d’une santé exceptionnelle grâce à la coutume qu’ils ont de cautériser, en y appliquant le feu, les veines du cou et des tempes à leurs enfants, quand ils ont atteint l’âge de quatre ans, coupant court par là, pour toute leur vie, à toute production de rhume. Dans mon pays même, les gens de la campagne n’emploient, pour tous les accidents, que du vin aussi fort qu’il se peut, mêlé à quantité de safran et d’autres épices; et ils en usent avec un égal succès dans tous les cas.
L’utilité des purgations imaginées par la médecine n’est rien moins que prouvée; sait-on du reste jamais si un remède agit en bien ou en mal, et s’il n’eût pas mieux valu laisser faire la nature?—Et à vrai dire, à quels autres but et effet, tend, après tout cette diversité d’ordonnances confuses, si ce n’est à vider le ventre, ce que peuvent faire mille herbages que nous avons constamment sous la main? et puis, je ne sais trop si cette pratique est aussi utile qu’on le dit, et si notre nature n’a pas besoin que les excréments demeurent dans une certaine mesure, tout comme la lie du vin est nécessaire à sa conservation. Ne voit-on pas souvent des hommes en bonne santé avoir, sous l’effet d’un accident n’affectant pas cette partie du corps, des vomissements et des flux de ventre, et évacuer une grande quantité d’excréments, sans qu’avant l’accident ils en eussent besoin, et sans qu’après ce leur soit bon, en éprouvant même des inconvénients et une aggravation 41 de leur état. C’est du grand Platon que j’ai appris naguère que des trois sortes de perturbations qu’il nous est possible de provoquer en nous, la dernière et la pire est celle occasionnée par les purgations auxquelles nul homme, à moins qu’il ne soit fou, ne doit avoir recours qu’à la dernière extrémité. On va ainsi troublant et éveillant le mal par ce qu’on lui oppose et dont les effets sont contraires, alors qu’il faudrait que ce soit uniquement notre genre de vie qui, peu à peu, l’alanguisse et l’amène à prendre fin. Les combats violents que se livrent la drogue et le mal sont toujours à notre préjudice, puisqu’ils se passent en nous et que la drogue ne nous est que d’un secours auquel nous ne pouvons nous fier; que, par elle-même, elle n’est pas favorable à notre santé et qu’elle n’a accès en nous que parce que nous ne sommes pas en bon état. Laissons un peu faire la nature; l’ordre par lequel elle assure la conservation des puces et des taupes, assure de même celle des hommes, lorsque avec la même patience qu’y mettent les puces et les taupes ils se laissent gouverner par elle. A cet ordre, nous avons beau crier: Bihorre (Allons vite)! nous arriverons à nous enrouer, mais non à activer sa marche que rien ne trouble ni infléchit; notre crainte, notre désespoir, loin de l’inciter à nous prêter son aide, l’en dégoûte et le lui fait différer; il doit assurer au mal aussi bien qu’à la santé de suivre leur cours, il ne saurait se prêter à favoriser l’un au détriment de l’autre, et il ne le fera pas, parce qu’il ne serait plus l’ordre, il serait le désordre. Suivons-le, de par Dieu! suivons-le; il dirige ceux qui le suivent; ceux qui ne le suivent pas, il les entraîne et, avec eux, leur rage et leur médecine, le tout ensemble. Faites-vous ordonner une purgation pour votre cervelle, elle sera de meilleur effet que pour votre estomac.
On demandait à un Lacédémonien à quoi il devait d’avoir vécu si bien portant et si longtemps: «A ce que je ne sais pas ce que c’est que se droguer,» répondit-il.—L’empereur Adrien, lors de sa mort, répétait sans cesse que l’affluence des médecins l’avait tué.—Un mauvais lutteur s’était fait médecin: «Courage, lui dit Diogène, tu as raison; tu vas pouvoir maintenant mettre en terre, ceux qui t’y ont mis autrefois.»—«Ils ont cette heureuse chance, disait Nicoclès, que le soleil éclaire leurs succès et que la terre cache leurs fautes.»
Les médecins se targuent de toutes les améliorations qu’éprouve le malade, et trouvent toujours à excuser le mauvais succès de leurs ordonnances.—En outre, ils ont une façon bien avantageuse de faire tourner à leur profit les événements quels qu’ils soient: Si le hasard, la nature ou toute autre cause (et le nombre en est infini) à laquelle ils sont étrangers, ont sur vous une action favorable et salutaire, c’est leur privilège de se l’attribuer; à eux revient le mérite de toutes les améliorations que ressent le patient qui s’est mis entre leurs mains; ce qui m’a guéri, moi et mille autres qui n’appelons pas les médecins à notre aide, ils s’en font honneur auprès de ceux qu’ils traitent. Quant aux accidents 43 fâcheux qui leur arrivent, ou ils les désavouent complètement et les imputent à la faute de leur malade, en invoquant des raisons si futiles, qu’ils ne peuvent manquer d’en trouver bon nombre à donner: Il a découvert son bras; il a entendu le bruit d’une voiture, «le bruit de chars embarrassés au détour de rues étroites (Juvénal)»; on a entr’ouvert sa fenêtre; il s’est couché sur le côté; il lui est passé par la tête des idées pénibles. En somme, une parole, un songe, un regard de quelqu’un ayant le mauvais œil leur semblent une excuse suffisante pour se décharger de leur faute. Ou encore, si cela leur convient mieux, ils se servent de cette aggravation au mieux de leurs intérêts, en s’y prenant de la manière suivante, qui ne peut jamais leur donner de mécompte: lorsque la maladie redouble par l’effet de leur médicamentation, ils nous en dédommagent en affirmant que, sans leurs remèdes, c’eût été bien pire, et que celui dont ils ont transformé un refroidissement en un accès de fièvre passagère eût été, sans eux, atteint de fièvre continue. Peu leur importe de ne pas réussir, le dommage étant tout profit pour eux. Ils ont vraiment bien raison de requérir de leurs malades une confiance aussi optimiste, et il la faut en vérité à ceux-ci bien entière et bien souple, pour en arriver à accepter tout ce que leurs médecins imaginent, si peu croyable que ce soit. Platon disait avec juste raison que les médecins peuvent mentir en toute liberté, puisque notre salut dépend de la frivolité et de la fausseté des assurances qu’ils nous donnent.—Ésope, cet auteur d’un talent exceptionnel, dont peu de gens sont en état de discerner la grâce, est plaisant quand il nous décrit l’autorité tyrannique qu’ils usurpent sur ces pauvres esprits affaiblis et abattus par le mal et la crainte. Il conte qu’un malade, questionné par son médecin sur l’effet produit par des médicaments qu’il lui a fait prendre, lui répond: «J’ai beaucoup transpiré.—Cela est bon,» dit le médecin. Une autre fois, lui ayant demandé comment il s’était comporté depuis qu’il ne l’avait vu: «J’ai eu excessivement froid, lui répond le malade, et de violents frissons.—Très bien,» fait aussitôt le médecin. Une troisième fois, s’enquérant encore comment il se portait: «Je me sens, répond-il, enfler et devenir bouffi, comme si j’étais hydropique.—Voilà qui est parfait,» réplique le médecin. Un des domestiques du patient venant, après cette dernière visite, s’informer auprès de lui de son état: «Je vais bien, mon ami, lui dit-il, si bien qu’à force d’aller bien, je me meurs.»
Loi des Égyptiens rendant les médecins responsables de l’efficacité du traitement de leurs malades.—Il y avait en Égypte une loi fort juste, qui déchargeait le médecin de toute responsabilité pendant les trois premiers jours, quand un malade se confiait à lui; durant ce temps, son client était traité à ses propres risques et périls; mais, ces trois jours écoulés, le médecin devenait responsable et le traitement passait à sa charge. Esculape, leur patron, a bien été frappé de la foudre pour avoir ramené 45 Hippolyte de la mort à la vie: «Jupiter, indigné qu’un mortel eût été rappelé de la nuit infernale à la lumière du jour, frappa de la foudre le fils d’Apollon, l’inventeur de cet art audacieux, et le précipita dans le Styx (Virgile)», pourquoi ses successeurs, qui font passer tant d’âmes de vie à trépas, seraient-ils indemnes? L’un d’eux vantait à Nicoclès l’autorité considérable à laquelle son art était parvenu: «C’est bien mon sentiment, dit Nicoclès, puisqu’il peut tuer tant de gens impunément.»
Le mystère sied à la médecine; le charlatanisme que les médecins apportent dans la confection de leurs ordonnances, leur attitude compassée auprès des malades, en imposent; ils devraient aussi ne jamais discuter qu’à huis clos et se garder de traiter à plusieurs un même malade.—Si j’avais été admis à donner mon avis, j’aurais voulu pour eux des traditions où la divinité et le mystère eussent eu plus de part; ils avaient bien commencé, mais ils n’ont pas poursuivi. C’était un bon point de départ que d’avoir fait émaner leur science des dieux et des démons, d’avoir pris un langage à part, une écriture à part, quoi qu’en pense la philosophie qui estime que c’est folie de vouloir donner en termes inintelligibles des conseils à un homme qui a à en faire son profit: «Comme si, pour conseiller à un malade d’avaler un escargot, un médecin lui ordonnait de prendre un enfant de la terre, marchant dans l’herbe, dépourvu de sang et portant sa maison sur son dos (Cicéron).»—C’était une bonne règle pour leur art, qu’on retrouve du reste dans tous les arts * fantastiques qui ne sont pas sérieux et qui ont pour base le surnaturel, que celle qui pose que la foi du patient, par l’espérance et l’assurance qu’elle engendre en lui, doit seconder l’action du médecin et en faciliter l’effet; cette règle, chez eux, va jusqu’à établir que le praticien le plus ignorant, le plus grossier, si l’on a confiance en lui, est préférable au plus expérimenté, si celui-ci est inconnu.—Le choix même de leurs drogues a quelque chose de mystérieux et de sacré: le pied gauche d’une tortue, l’urine d’un lézard, la fiente d’un éléphant, le foie d’une taupe, du sang tiré de dessous l’aile droite d’un pigeon blanc, et, pour nous autres, atteints de coliques néphrétiques (est-ce assez abuser de nos misères), des crottes de rat pulvérisées et telles autres prescriptions bizarres qui tiennent plus des enchantements de la magie que d’une science sérieuse. Je laisse de côté ces autres singularités: que les pilules sont à prendre en nombre impair; qu’il faut, pour les prendre, faire choix de certains jours et fêtes de l’année; que les herbes entrant dans leurs ingrédients sont à cueillir à des heures déterminées; enfin l’air rébarbatif et réfléchi, dont se moque Pline lui-même, qu’ils apportent dans leur attitude et leur contenance. Seulement, avec de si beaux débuts, ils ont, dirais-je, commis la faute de ne pas avoir ajouté que leurs assemblées et leurs consultations auraient un caractère religieux et seraient secrètes; qu’aucun profane n’y aurait accès, pas plus que lorsqu’on célèbre les mystères du culte d’Esculape; 47 de cette faute, il arrive que leurs irrésolutions, la faiblesse de leurs raisonnements sur ce qu’ils croient deviner et qui sert de base à leurs discussions si acrimonieuses, pleines de haine, de jalousie, de considérations personnelles, venant à être révélées à tout un chacun, il faut être étonnamment aveugle, pour ne pas se sentir bien aventuré quand on se remet entre leurs mains.—Qui a jamais vu un médecin confirmer tout simplement l’ordonnance d’un confrère, sans y rien ajouter ou retrancher? ils trahissent par là l’inanité de leur art, et nous font voir qu’ils se préoccupent plus de leur réputation et par suite de leurs profits, que de leurs malades. Celui-là de leurs docteurs a été le plus sage qui, anciennement, leur a recommandé de n’être qu’un à s’occuper d’un même malade; s’il ne fait rien qui vaille, la faute d’un seul ne sera pas de grande importance pour le bon renom de la corporation; et une grande gloire rejaillira sur tous, si, au contraire, il vient à bien rencontrer. Quand ils sont plusieurs à s’occuper d’un même cas, ils décrient continuellement le métier, d’autant qu’il leur arrive de faire plus souvent mal que bien. Ils devraient se contenter du perpétuel désaccord qui existe dans les opinions des principaux maîtres et auteurs de leur science dans l’antiquité, désaccord que connaissent seuls les gens qui sont versés dans les lettres, sans laisser voir au vulgaire les controverses et les changements d’idées qui continuent à abonder en eux et à les diviser.
Sur la cause même des maladies que d’opinions diverses!—Voulons-nous un exemple des débats de la médecine, aux temps anciens? Hiérophile attribue à nos humeurs la cause originelle de nos maladies; Érasistrate, au sang des artères; Asclépiade, aux atomes invisibles qui pénètrent par nos pores; Alcméon, à une surabondance ou à un affaiblissement des forces corporelles; Dioclès, à une inégalité dans la proportion des éléments dont se compose le corps, ainsi qu’à la qualité de l’air que nous respirons; Straton, à un excès, à une difficulté d’assimilation et à une corruption des aliments que nous prenons; Hippocrate l’attribue aux esprits. Un de leurs amis, qu’ils connaissent mieux que moi, dit à ce propos que «la science la plus importante pour nous, celle qui a charge de notre conservation et de notre santé, est, par malheur, la plus incertaine, la plus confuse, la plus agitée par les changements qui s’y produisent». Il n’y a pas grand mal à ce que nous fassions erreur dans la mesure de la hauteur du soleil, non plus que dans la résolution de quelque calcul astronomique; mais ici, où il y va de tout notre être, il n’est pas sage de nous abandonner à la merci de l’agitation produite par tant de vents contraires.
Époque à laquelle la médecine a commencé à être en crédit et fluctuations qu’ont, depuis cette origine, subies les principes sur lesquels elle repose.—Avant la guerre du Péloponèse, il n’était guère question de cette science; Hippocrate la mit en crédit. Toutes les règles qu’il en posa, furent postérieurement 49 modifiées par Chrysippe; Érasistrate, petit-fils d’Aristote, renversa tout ce que Chrysippe en avait écrit. Après eux, vinrent les Empiriques qui appliquèrent à cet art une méthode toute différente de celle suivie jusqu’alors. Quand le crédit de ces derniers commença à vieillir, Hérophile fit application d’une médecine toute autre, contre laquelle Asclépiade, qui vint après, s’éleva et dont il triompha à son tour. Les opinions de Thémisson, puis celles de Musa * vinrent plus tard faire autorité; puis encore après, celles de Vectius Valens, fameux par ses relations intimes avec Messaline. Au temps de Néron, Thessalus tint le sceptre; il abolit et condamna tout ce qui avait été admis jusqu’à lui. Sa doctrine fut renversée par Crinas de Marseille qui introduisit à nouveau de régler toutes les opérations médicales d’après les tables astronomiques et le cours des astres; de manger, boire et dormir aux heures qui plaisaient à la Lune et à Mercure. Son autorité ne tarda pas à être supplantée par celle de Charinus, médecin de cette même ville de Marseille, qui non seulement combattit les procédés de la médecine ancienne, mais encore l’usage des bains chauds que tout le monde pratiquait et qui, depuis tant de siècles, étaient passés dans les habitudes: il faisait baigner les gens dans l’eau froide, même en hiver, et plongeait ses malades dans l’eau telle qu’on la puisait dans les ruisseaux.—Jusqu’au temps de Pline, aucun Romain n’avait encore daigné exercer la médecine; elle se faisait par les étrangers et les Grecs, comme cela a lieu chez nous Français, où elle se fait par des gens baragouinant le latin; car, ainsi que le dit un très grand médecin, nous n’acceptons pas aisément la médecine que nous comprenons, pas plus que la drogue que nous cueillons nous-mêmes. Si, dans les contrées d’où nous tirons le gaiac, la salsepareille et le bois d’esquine, il y a des médecins, combien y doit-on faire fête à nos choux et à notre persil, en raison de la vogue dont jouissent les produits qui sont étrangers, rares et chers, personne n’osant faire fi de choses qu’on a été chercher si loin, en s’exposant aux risques d’un long et périlleux voyage?—Entre ces transformations de la médecine dans les temps anciens et notre époque, il y en a eu d’autres en nombre infini; le plus souvent, elles ont été radicales et universelles, comme celles introduites de notre temps par Paracelse, Fioravanti et Argentarius, qui ne changent pas seulement une recette mais, à ce que l’on m’a dit, tout ce qui fait loi en médecine, ainsi que les conditions mêmes dans lesquelles elle s’exerce, accusant d’ignorance et de charlatanisme tous ceux qui, avant eux, ont exercé cette profession. Je vous laisse à penser ce que, dans tout cela, devient le pauvre patient.
Rien de moins certain que les médicaments ne fassent pas de mal s’ils ne font pas de bien; en outre, les méprises sont fréquentes; la chirurgie offre une bien plus grande certitude.—Si encore, quand ils se trompent, nous étions assurés que si nous n’en retirons profit cela du moins ne nous nuit pas, ce serait un compromis honorable que d’avoir chance de nous 51 bien porter, sans risquer de courir à notre perte. Ésope, dans ses contes, nous dit que quelqu’un ayant acheté un esclave maure et croyant que la couleur de sa peau était le fait d’un accident et provenait de mauvais traitements que lui aurait fait endurer son premier maître, lui fit suivre, avec grand soin, un régime comportant bains et tisanes qui eut pour effet de ne modifier en rien le teint basané du Maure, mais altéra complètement sa santé excellente auparavant.—Combien ne voyons-nous pas les médecins s’imputer les uns aux autres la mort de leurs patients? J’ai souvenance d’une maladie très dangereuse, souvent mortelle, atteignant surtout les basses classes, qui, il y a quelques années, sévit dans les villes de mon voisinage. L’épidémie passée après avoir fait un nombre considérable de victimes, un des plus fameux médecins de la contrée publia sur la matière un ouvrage dans lequel il critiquait l’usage qui avait été fait de la saignée pour combattre cette maladie, confessant que c’était là l’une des principales causes des pertes qui avaient été faites. Il y a mieux, ceux d’entre eux qui écrivent, conviennent qu’il n’y a pas de médicament qui n’ait un effet nuisible; si ceux mêmes qui nous sont d’un effet utile, nous nuisent d’une façon ou d’une autre, que doivent produire ceux qu’on nous fait absorber hors de propos? Quand ce ne serait que cela, j’estime que pour ceux auxquels en répugne le goût, c’est un effort dangereux qui peut leur être préjudiciable, que de les leur faire prendre ainsi à contre-cœur, à pareil moment; je crois que c’est soumettre le malade à une bien rude épreuve, alors qu’il a tant besoin de repos; sans compter qu’à considérer les incidents si légers, si insignifiants qui, d’après les médecins, sont ordinairement cause de nos maladies, j’en arrive à conclure qu’une fort petite erreur dans l’administration de leurs drogues peut nous nuire considérablement. Or, si l’erreur d’un médecin est dangereuse, nous sommes en bien mauvaise situation, car il lui est bien difficile de ne pas y retomber souvent; il a besoin de trop de documents, d’examens, d’être au fait de trop de circonstances, pour asseoir judicieusement ses résolutions; il faut qu’il connaisse le tempérament du malade, sa température, son humeur, ses dispositions, ses occupations et même ce qu’il pense et ce qu’il rêve; il faut qu’il se rende compte des conditions ambiantes, de la nature du lieu, de l’air, du climat, où en sont les planètes de leur révolution et leurs influences; il doit savoir les causes de la maladie, les caractères sous lesquels elle se présente, ses effets, les jours critiques; de la drogue dont il fera emploi, il a à connaître le poids, l’action, le pays d’où elle vient, son aspect, à quelle époque elle remonte pour juger de sa force, les quantités à ordonner; et, toutes ces conditions envisagées, il faut qu’il sache les proportionner les unes aux autres, de manière à ce qu’elles s’harmonisent parfaitement. Pour peu qu’il se méprenne, que de tant d’éléments divers, un seul agisse à contre-temps, en voilà assez pour que nous soyons perdus; et Dieu sait de quelles difficultés est la connaissance 53 de ces diverses particularités! Comment, par exemple, déterminer le caractère propre de la maladie, chacune se présentant sous une infinité de formes? Que de débats et de doutes soulèvent chez les praticiens les déductions à tirer de l’examen des urines! Sans ces difficultés, ils ne seraient pas, comme nous les voyons, en continuelles discussions sur le diagnostic du mal, et quelles excuses auraient-ils pour cette faute qu’ils commettent si souvent de prendre une martre pour un renard? Quand je les ai consultés sur mes propres maux, pour peu que le cas présentât quelque difficulté, je n’en ai jamais trouvé trois qui aient pu se mettre d’accord. Naturellement, mes remarques à cet égard se portent plus particulièrement sur les faits qui me touchent: dernièrement, à Paris, un gentilhomme, sur une consultation de médecins, se soumit à l’opération de la taille; on ne trouva pas plus de pierre dans sa vessie que dans sa main. Ici même, un évêque, avec lequel j’étais fort lié, avait été instamment conseillé par la plupart des médecins qui l’avaient examiné, de se faire opérer pour cette même maladie; je m’étais même entremis pour l’y décider, convaincu que j’étais, sur la foi d’autrui, qu’il y avait lieu; lorsqu’il fut mort et qu’on fit son autopsie, on trouva qu’il n’avait que mal aux reins. Les médecins, quand il s’agit de cette maladie, sont moins excusables qu’en toutes autres, parce que là le mal est pour ainsi dire palpable.—C’est en quoi la chirurgie me semble être une science qui offre beaucoup plus de certitude, parce qu’on y voit et sent ce qu’on fait, il y a moins à conjecturer et à deviner; tandis que les médecins n’ont pas de speculum leur permettant d’examiner le cerveau, les poumons, le foie comme ils sont à même de le faire pour la matrice.
Comment ajouter foi à des médicaments complexes, composés en vue d’actions différentes et parfois opposées?—Nous ne pouvons même pas ajouter foi aux assurances qu’ils nous donnent, car lorsqu’ils ont à pourvoir à divers accidents produisant des effets contraires qui nous oppressent simultanément et ont entre eux des rapports presque inévitables, comme dans le cas où nous éprouvons de la chaleur au foie et du froid à l’estomac, ils vont nous persuadant que de leurs ingrédients, ceci réchauffera l’estomac, cela refroidira le foie; l’un doit aller droit aux reins, voire même jusqu’à la vessie, sans faire sentir son action sur d’autres parties de nous-mêmes, et, durant ce long parcours plein d’embarras, doit conserver ses forces et sa vertu jusqu’à ce qu’il soit parvenu au point où il doit agir par ses propriétés occultes; un autre asséchera le cerveau, celui-là humectera le poumon; et ayant mêlé le tout ensemble pour en constituer le breuvage qu’il va falloir absorber, n’est-ce pas en quelque sorte rêver que d’espérer qu’alors, dans ce mélange confus, chacune de ces diverses propriétés, se triant d’elle-même, se séparera des autres et ira satisfaire à celui de ces divers offices qui lui est dévolu? Aussi je crains fort qu’elles ne s’égarent ou que, se trompant de destination, ne 55 viennent à porter le trouble là où elles ont affaire. N’est-il pas également à appréhender que dans ce pêle-mêle liquide, elles ne se corrompent, ne se confondent, ne s’altèrent les unes les autres? Enfin, c’est à un autre que celui qui l’a formulée, qu’incombe l’exécution de cette ordonnance, à la foi, à la merci de laquelle nous nous abandonnons, et dont, je le répète, dépend notre vie!
Chaque maladie devrait être traitée par un médecin distinct qui s’en serait spécialement occupé.—Nous avons, pour nous habiller, des gens qui ne confectionnent que des pourpoints, tandis que d’autres ne font que des chausses; et nous sommes d’autant mieux servis que chacun d’eux ne se mêle que de ce qui le regarde et que son talent s’exerce dans des limites plus restreintes, mieux que nous ne le serions par un tailleur qui fait le tout. Pour ce qui est de la nourriture, les grands, pour la préparation de leurs aliments, ont avantage à avoir des gens qui préparent les potages et d’autres les rôtis; un cuisinier qui a charge des uns et des autres ne parvient pas à les réussir tous aussi bien. C’est une idée analogue qui faisait qu’avec raison, les Égyptiens n’admettaient pas qu’en ce qui touche l’art de guérir, le médecin fût universel: ils spécialisaient les différentes branches de cette profession; chaque maladie, chaque partie du corps avait son spécialiste; de la sorte, chacun ne s’occupant que d’elle, chacune était beaucoup mieux traitée et plus suivant ce qui lui convenait. Les médecins de nos jours ne réfléchissent pas que qui pourvoit à tout, ne pourvoit à rien, et que s’occuper de toutes les affaires de ce petit monde qu’est le corps humain, dépasse leurs moyens. En craignant d’arrêter la dyssenterie chez un ami à moi, qui valait mieux qu’eux tous tant qu’ils sont, pour ne pas lui causer de fièvre ils me l’ont tué. Ils rendent leurs oracles au poids, sans tenir compte des maux qu’ils ont à combattre; et, pour ne pas guérir le cerveau au préjudice de l’estomac par leurs drogues aux qualités discordantes qui agissent d’une façon désordonnée, ils rendent malade l’estomac et aggravent la maladie du cerveau.
Faiblesse et incertitude des raisonnements sur lesquels est fondé l’art de la médecine; l’un condamne ce que l’autre approuve.—Quant à la faiblesse et à la diversité des raisonnements qu’ils nous tiennent, elles sont, dans cet art, plus apparentes que dans tout autre. Ils vous disent, tantôt que les substances apéritives conviennent à un homme en proie à la colique, parce qu’ouvrant et dilatant les conduits internes, elles entraînent vers les reins cette matière gluante génératrice de la gravelle et de la pierre, et précipitent en contre-bas ce qui commence à s’amasser et à durcir dans les reins; tantôt que ces mêmes substances sont dangereuses pour un homme en proie à cette affection, parce qu’ouvrant et dilatant ces conduits, elles acheminent vers les reins cette matière qui se transforme en gravier, que cet organe saisit d’autant mieux que cela rentre dans ses fonctions, et expose à ce qu’il en retienne beaucoup sur la quantité 57 qui lui arrive; ajoutant que, si par hasard il se rencontre un corps tant soit peu plus gros qu’il ne faut pour pouvoir traverser tous ces canaux étroits qui lui restent à franchir pour être expulsé au dehors, entraîné par ces substances apéritives, il y pénètre et, s’il vient à les obstruer, occasionne inévitablement la mort et une mort très douloureuse.—Leurs conseils sur le régime qu’il convient que nous suivions, n’ont pas plus de fixité: tantôt ils disent qu’il est bon d’uriner fréquemment, parce que l’expérience nous montre qu’en lui donnant le loisir de croupir, l’urine se décharge des excréments qui s’y trouvent en suspension, lesquels constituent une sorte de lie qui sert à la formation des calculs dans la vessie; tantôt qu’il est bon de ne pas uriner souvent, parce qu’autrement, en raison de leur poids, ces éléments que l’urine charrie, ne seront point entraînés si le jet n’est pas d’une force suffisante, l’expérience montrant qu’un torrent au cours impétueux fait place nette partout où il passe, bien plus qu’un ruisseau coulant lentement et insensiblement.—De même, ils nous disent tantôt qu’il est bon d’avoir des rapports fréquents avec la femme, parce que cela ouvre les conduits et fait circuler le gravier et le sable; tantôt que c’est mauvais, parce que cela échauffe les reins, les lasse et les affaiblit. Tantôt encore que les bains chauds sont bons, parce qu’ils détendent et rendent plus souples les organes où séjournent le sable et la pierre; tantôt qu’ils sont mauvais, parce que l’action de cette chaleur externe sur les reins, les aide à cuire, durcir et pétrifier la matière prête à cette transformation.—A ceux qui prennent les eaux thermales, ils vont disant qu’il convient de manger peu le soir, afin que les eaux qu’ils doivent boire le lendemain matin, aient plus d’action, l’estomac étant vide et n’étant pas contrarié dans ses fonctions; à moins toutefois qu’ils ne leur disent le contraire: qu’il vaut mieux manger peu au repas de midi, pour ne pas troubler l’action de l’eau qui n’est pas encore complètement achevée, ne pas charger l’estomac aussitôt après l’effort qu’il vient de faire et reporter le principal travail de la digestion à la nuit qui s’y prête mieux que le jour où le corps et l’esprit sont perpétuellement en mouvement et en action. Voilà comment les médecins raisonnent constamment, faisant des boniments et se jouant à nos dépens; ils ne sauraient émettre une seule proposition, à laquelle je ne puisse en opposer une absolument contraire et de même valeur. Qu’on ne crie donc pas contre ceux qui, devant de telles contradictions, se laissent doucement aller à ce que leur dictent leurs penchants et les conseils de la nature, s’en remettant à la fortune qui préside aux destinées de tous.
Quoique Montaigne n’ait confiance en aucun remède, il reconnaît que les bains sont utiles; peut-être aussi les eaux thermales. Diversité dans les modes d’emploi de ces eaux.—J’ai eu occasion de visiter, dans mes voyages, presque toutes les stations balnéaires de la chrétienté, et depuis quelques années j’en fais usage, parce que d’une façon générale j’estime que 59 les bains sont chose hygiénique et crois que nombre d’affections d’une certaine gravité, tiennent à ce que nous avons perdu l’habitude de nous laver le corps tous les jours, ainsi que cela était dans les coutumes de presque toutes les nations des temps passés et que cela s’est encore maintenu chez plusieurs; je n’arrive pas à m’imaginer que nous ayons avantage à tenir ainsi nos membres encroûtés et nos pores bouchés par la crasse. Pour ce qui est de prendre ces eaux en boisson, la fortune a fait d’abord que cela n’est aucunement contraire à mes goûts, en second lieu que c’est chose naturelle et simple qui du moins, si elle n’est utile, n’est pas dangereuse, ce que me permet d’affirmer ce nombre infini de gens de toutes sortes et de tous tempéraments qui s’y rendent. Bien qu’encore je n’aie pas constaté qu’elles aient produit aucun résultat miraculeux ou extraordinaire, et qu’en m’informant d’un peu plus près qu’on ne le fait d’habitude, j’aie trouvé faux et dénués de fondement tous les bruits de faits de cette nature qui se répandent en ces lieux et auxquels on ajoute foi (le monde se trompe si aisément sur ce qu’il désire); par contre, je n’ai guère vu de personnes dont ces eaux aient empiré l’état. On ne peut, sans parti pris, leur refuser qu’elles éveillent l’appétit, facilitent la digestion et nous rendent pour ainsi dire plus guillerets, si on n’y va pas à bout de forces, ce que je déconseille bien; impuissantes à relever d’une ruine imminente, elles peuvent venir en aide dans le cas d’un léger ébranlement, ou parer à la menace d’une altération prochaine. Qui y vient sans être en disposition suffisante pour pouvoir jouir de la compagnie qui s’y trouve, des promenades et des excursions auxquelles nous convie la beauté des lieux où se trouvent la plupart de ces eaux, perd indubitablement le meilleur et le plus efficace de leurs effets. Aussi ai-je toujours, jusqu’à présent, fait choix, pour y séjourner et en faire usage, des localités les plus agréables par leurs sites et qui, en même temps, offrent le plus de commodité sous le rapport du logement, de la nourriture et de la société, comme sont: en France, les bains de Bagnères; sur les confins de l’Allemagne et de la Lorraine, ceux de Plombières; en Suisse, ceux de Bade; en Toscane, ceux de Lucques, et en particulier ceux «della Villa», dont j’ai usé le plus souvent et en diverses saisons.
Chaque nation a ses idées particulières sur le mode d’emploi des eaux et les conditions dans lesquelles elles doivent être prises, lesquelles sont fort variables; quant à leur effet, il est, d’après ce que j’en ai éprouvé, à peu près le même partout. En Allemagne, on ne les boit jamais; pour toutes les maladies, on les prend sous forme de bains et on passe tout son temps à barboter dans l’eau, presque d’un soleil à l’autre. En Italie, quand on boit pendant neuf jours, on se baigne pendant trente au moins; l’eau se boit d’ordinaire additionnée d’autres drogues qui en secondent l’action. Dans certaines stations, on vous ordonne de vous promener pour la bien digérer; dans d’autres, on la prend au lit que l’on garde jusqu’à ce 61 qu’on l’ait rendue, et, durant ce temps, on entretient, en les chauffant, une chaleur continue à l’estomac et aux pieds. Les Allemands ont de particulier que la plupart se font, dans le bain, appliquer des ventouses scarifiées. Les Italiens pratiquent les douches, qui se donnent au moyen de conduites qui amènent cette eau chaude dans des espèces de gouttières, d’où elle tombe; on la reçoit ainsi pendant une heure le matin et autant l’après-dîner, un mois durant, soit sur la tête, soit sur l’estomac, soit sur toute autre partie du corps à laquelle on veut en faire l’application. Il y a une infinité d’autres coutumes propres à chaque contrée ou, pour mieux dire, il n’y a presque aucune ressemblance entre ce qui se fait chez les uns et ce qui a lieu chez les autres. Voilà comment cette partie de la médecine, la seule que je me sois laissé aller à pratiquer, bien que constituant le moins artificiel des procédés dont elle use, a cependant, elle aussi, sa bonne part de la confusion et de l’incertitude qui se voient partout ailleurs dans cet art.
Les poètes traitent avec plus d’emphase et de grâce que nous, tous les sujets qu’ils abordent, témoin ces deux épigrammes: «Hier, le médecin Alcon a touché la statue de Jupiter; et, quoique de marbre, le dieu a éprouvé le pouvoir du médecin. Aujourd’hui, on le tire de son vieux temple et on va l’enterrer, tout dieu et pierre qu’il est (Ausone).»—Andragoras s’est baigné hier avec nous, puis a soupé gaiement; ce matin, on l’a trouvé mort. Veux-tu savoir, Faustinus, la cause d’un trépas si subit? Il a vu en songe le médecin Hermocrate (Martial).»—Sur ce même sujet, je voudrais rapporter deux contes.
Conte assez plaisant contre les gens de loi et les médecins.—Le baron de Caupène en Chalosse et moi, avons en commun le droit de patronage sur un bénéfice du nom de Lahontan, qui est de grande étendue et situé au pied de nos montagnes. Il en est des habitants de ce coin de terre, comme l’on dit être de ceux de la vallée d’Angrougne: ils avaient une vie à part, des façons, des vêtements, des mœurs à part; étaient régis et administrés suivant des institutions et des coutumes particulières qui se transmettaient de père en fils et qu’ils observaient, sans y être autrement obligés que par le respect qu’ils portaient à un ordre de choses établi. Ce petit état s’était, de tous temps, maintenu dans de si heureuses conditions, qu’aucun juge du voisinage n’avait eu à s’occuper de ses affaires, aucun avocat n’avait eu à y donner de consultations, aucun étranger n’y avait été appelé pour mettre fin aux querelles qui s’y élevaient; jamais on n’avait vu quelqu’un du pays se livrer à la mendicité; on y fuyait les alliances et les rapports avec le monde du dehors pour ne pas altérer la pureté des institutions. Cela dura, ainsi qu’ils le content eux-mêmes, le tenant de la mémoire de leurs pères, jusqu’à ce que l’un d’eux, l’âme piquée d’une noble ambition, s’avisa, pour mettre son nom en relief et acquérir de la réputation, de faire d’un de ses enfants un maître Jean, ou un maître Pierre, autrement dit un personnage, 63 et, lui ayant fait apprendre à écrire dans quelque ville voisine, arriva à en faire un beau notaire de village. Celui-ci, devenu grand, commença par dédaigner les anciennes coutumes de sa vallée et à monter la tête à son entourage, en lui faisant miroiter ce que les régions voisines avaient de beau. Au premier de ses compères auquel on écorna une chèvre, il conseilla de s’adresser aux juges royaux, dont ils relevaient, pour obtenir réparation; de celui-ci, il passa à un autre, jusqu’à ce qu’il eût tout gâté.—A la suite de ce premier germe de corruption, ajoutent-ils, il se produisit presque aussitôt un autre fait qui eut de plus fâcheuses conséquences encore: il prit envie à un médecin d’épouser une de leurs filles et de venir s’établir parmi eux. Ce médecin commença par leur apprendre le nom des fièvres, des rhumes, des abcès; où se trouvent le cœur, le foie, les intestins, science dont, jusqu’alors, ils n’avaient pas la moindre connaissance; et, au lieu de l’ail qui leur servait pour se débarrasser de tous les maux, si pénibles et si graves qu’ils fussent, il les amena à faire usage pour une toux, un refroidissement, de mixtions composées de substances exotiques et se mit à spéculer non seulement sur leur santé, mais encore sur leur mort. Ils jurent que ce n’est que depuis cette époque qu’ils se sont aperçus que le serein cause des lourdeurs de tête, qu’on peut attraper mal en buvant quand on a chaud, que les vents d’automne sont plus malsains que ceux du printemps, et que, depuis que la médecine a été introduite chez eux, accablés d’une légion de maladies qu’ils ne connaissaient pas, ils constatent une décadence générale dans leur vigueur physique et une réduction de moitié dans la durée de leur vie. C’est là le premier de mes contes.
Autre conte concernant la médecine.—Voici le second. Avant que je ne fusse atteint de la gravelle, ayant entendu quelques personnes faire cas du sang de bouc comme d’une manne céleste envoyée, en ces siècles derniers, pour reconstituer et assurer la conservation de la vie humaine, et entendant des gens raisonnables en parler comme d’une drogue admirable, d’une réussite infaillible, moi, qui toujours ai pensé que je pouvais être atteint de tous les accidents qui peuvent survenir à tout autre homme, j’eus l’idée de me pourvoir, alors que j’étais en pleine santé, de ce baume miraculeux. Je commandai donc, chez moi, qu’on élevât un bouc selon la recette donnée: il faut que ce soit pendant les mois les plus chauds de l’été qu’on le mette au régime; on ne lui donne plus alors à manger que des herbes purgatives et on ne lui fait plus boire que du vin blanc. Par hasard, j’étais chez moi le jour où on devait le tuer; on vint me dire que le cuisinier sentait dans sa panse deux ou trois grosses boules mobiles se heurtant l’une l’autre au milieu des aliments qui la garnissaient. La curiosité me fit dire qu’on m’apportât ses entrailles, et je fis ouvrir devant moi cette grosse et large peau. Il en sortit trois corps assez volumineux, légers comme des éponges au point qu’ils paraissaient creux, durs à la surface, fermes, teintés de diverses couleurs mortes: l’un était 65 absolument rond et de la grosseur d’une petite boule; les deux autres, un peu moins gros, étaient imparfaitement arrondis, mais devaient tendre également à former boule. Ayant fait prendre des renseignements auprès de ceux qui ont l’habitude de dépecer ces animaux, j’appris que c’était là un accident inusité, se produisant rarement. Il est vraisemblable que ces corps sont des pierres proches parentes des nôtres; s’il en est ainsi, c’est une espérance bien vaine que celle que l’on donne aux graveleux de pouvoir guérir en buvant le sang d’une bête en passe de mourir d’un mal semblable, car on ne saurait dire qu’il n’y a là aucune chance de contagion et que la nature du sang de cet animal ne s’en trouve pas altérée. Il y a plutôt lieu de croire que rien ne s’engendre dans un corps, sans que toutes ses parties, solidaires les unes des autres, n’y coopèrent; à la vérité, certaines plus que d’autres, suivant la nature de l’opération, mais toutes y participent; et il y a apparence que dans toutes celles de ce bouc il y avait quelque disposition à la production de ces concrétions calcaires. Ce n’était pas tant la crainte de ce qui pouvait en advenir pour moi-même qui m’avait rendu si curieux de cette expérience, que parce que je craignais qu’il n’arrivât chez moi ce qui a lieu dans bien des maisons où les femmes, en vue de secourir les pauvres gens, amassent force drogues insignifiantes qu’elles font servir pour cinquante maladies diverses, auxquelles elles ne s’appliquent nullement et qui pourtant réussissent dans quelques heureuses circonstances.
Ce n’est que leur science que Montaigne attaque chez les médecins et non leur personnalité; limite dans laquelle il se confie à eux; combien peu, au surplus, font usage pour eux-mêmes des drogues qu’ils prescrivent à autrui.—Quoi qu’il en soit, j’honore les médecins, non suivant le précepte parce qu’ils sont nécessaires (à ce passage de l’Ecclésiaste, on en oppose un autre du prophète qui blâme le roi Asa d’avoir eu recours aux médecins), mais par affection pour leur personne, en ayant vu beaucoup qui sont d’honnêtes gens et dignes d’être aimés. Ce n’est pas à eux que j’en veux, mais à leur art; et je ne leur fais pas grand reproche de tirer profit de notre sottise, parce que la plupart du monde est ainsi faite; combien, en effet, de professions moins honorables ou qui le sont plus que la leur, ne subsistent et ne prospèrent qu’en abusant le public. Je les mande près de moi, quand je suis malade; s’ils se trouvent là à point pour répondre à mon appel, je leur demande qu’ils s’occupent de moi, et je les paie comme font les autres. Je leur permets de m’ordonner de me tenir chaudement, lorsque je préfère qu’il en soit ainsi qu’autrement; je leur donne toute latitude pour me faire faire le bouillon que je dois prendre, à leur choix avec des poireaux ou avec des laitues, et me prescrire, suivant ce qui leur plaît, du vin blanc ou du vin clairet, et ainsi de toutes choses pour lesquelles je n’ai pas une préférence marquée et dont l’usage m’est indifférent. En cela, j’entends bien ne leur faire aucune concession, d’autant qu’il est de l’essence 67 même de la médecine, que tout ce dont elle fait emploi se distingue par son mauvais goût et son étrangeté. Pourquoi Lycurgue ordonnait-il le vin aux Spartiates quand ils étaient malades, si ce n’est parce qu’ils ne pouvaient le souffrir quand ils étaient bien portants? C’est pour cette même raison qu’un gentilhomme, qui est mon voisin, s’en sert contre ses fièvres, comme d’une drogue d’un excellent effet, parce que, dans son état normal, il en a le goût en horreur.—Combien ne voyons-nous pas de médecins être dans mes idées, dédaigner la médecine pour eux-mêmes et vivre comme ils l’entendent, et d’une façon absolument contraire à celle qu’ils ordonnent aux autres? Qu’est-ce que cela, sinon abuser ouvertement de notre simplicité? Car enfin, leur vie et leur santé ne leur sont pas moins chères que les nôtres à nous-mêmes, et ils accommoderaient certainement leurs actes à leur doctrine, si de celle-ci, ils ne reconnaissaient eux aussi la fausseté.
C’est la crainte de la douleur, de la mort, qui fait qu’on se livre si communément aux médecins.—C’est la crainte de la douleur, de la mort, l’impatience du mal, une soif ardente et sans mesure de guérison, qui nous aveuglent à ce degré; c’est pure lâcheté de notre part, si nous avons une confiance si facile à capter et si élastique. Pourtant, la plupart d’entre nous ne s’abusent pas autant qu’ils ne tolèrent et laissent faire; je les entends, en effet, se plaindre et parler comme nous faisons nous-mêmes, pour finir par dire: «Alors, que faire?» comme si l’impatience par elle-même était un meilleur remède que la patience! Parmi tous ceux qui se sont laissés aller à subir cette misérable sujétion, y en a-t-il un seul qui ne soit également prêt à accepter les impostures de toutes sortes et ne se mette à la merci de quiconque a l’impudence de lui donner l’assurance qu’il guérira?—Les Babyloniens exposaient leurs malades sur les places publiques; le médecin c’était tout le monde: chacun qui passait s’informait par humanité et par civilité de leur état et, suivant son expérience, donnait un avis plus ou moins salutaire. Nous ne faisons guère autrement: il n’est pas simple femmelette dont nous n’employions les marmottages destinés à conjurer le mal et les amulettes; si mon humeur se prêtait à en accepter, j’accepterais plus volontiers celles provenant de cette source que de toute autre, au moins ne craindrais-je pas d’en éprouver de dommages. Homère et Platon disaient des Égyptiens qu’ils étaient tous médecins; ne pourrait-on en dire autant de tous les peuples? Il n’est, de fait, personne qui ne se vante de posséder une recette quelconque, et ne se hasarde à l’essayer sur son voisin si celui-ci s’y prête. J’étais, l’autre jour, en compagnie, lorsque je ne sais qui, atteint de la même affection que moi, annonça l’apparition d’une sorte de pilule nouvelle dans la composition de laquelle, tout compte fait, entraient cent et tant d’ingrédients; cette information produisit une émotion et un soulagement singuliers; quel rocher, se disait-on, résistera aux efforts d’une pareille concentration de moyens d’action? Il m’est revenu depuis, par ceux qui en 69 ont essayé, que pas la moindre parcelle de gravier n’a daigné s’en émouvoir.
Sur quoi, du reste, la connaissance que les médecins prétendent avoir de l’efficacité de leurs remèdes, est-elle fondée?—Je ne puis quitter mon papier, sans dire encore un mot sur ce que les médecins nous donnent comme garantie de l’efficacité de leurs drogues, savoir l’expérience qu’ils en ont faite. La plupart, peut-être plus des deux tiers des vertus médicinales des médicaments, proviennent de la quintessence des simples, sur les propriétés cachées desquelles l’usage seul nous renseigne; or, la quintessence d’une chose n’est autre que la qualité maîtresse qui lui est propre et qui échappe à notre raison, laquelle n’arrive pas à en découvrir la cause. Parmi ces preuves d’efficacité, il en est, disent-ils, qui leur ont été révélées par quelque démon; quand ils parlent ainsi, je me contente de les écouter, car, pour ce qui est des miracles, je ne les discute jamais. D’autres ressortent de l’usage même que, pour d’autres considérations, nous faisons des choses; comme dans le cas où la laine, par exemple, dont nous usons d’habitude pour nous vêtir, aurait été, par accident, reconnue posséder quelque propriété cachée dessiccative, qui guérisse les mules qui auraient mal au talon; ou dans celui où on aurait constaté une action purgative au raifort qui compte parmi nos aliments.—Galien raconte qu’un lépreux a été guéri pour avoir bu du vin d’un vase dans lequel s’était, par hasard, glissée une vipère; c’est là un fait susceptible d’effet et qui permet d’admettre l’expérience comme vraisemblablement acquise; de même de toutes celles que les médecins nous donnent comme résultant d’exemples fournis par certains animaux; mais, dans la plupart des expériences autres, auxquelles ils ont été conduits, disent-ils, par leur bonne fortune, sans autre guide que le hasard, je trouve que les déductions qu’ils en tirent ne s’imposent pas. Imaginons l’homme embrassant du regard le nombre infini des choses, plantes, animaux, métaux qui sont autour de lui, je me demande par où, en pareil cas, commenceront ses essais? Supposons que sa fantaisie fasse que, tout d’abord, ce soit par la corne d’un élan; ce choix, ainsi né de son caprice, ne peut être admis que par une confiance bien souple et bien accommodante, et le même embarras se reproduira quand il s’agira d’en tirer parti. Il se trouve, en effet, en présence de tant de maladies et de tant de circonstances qui interviennent, que l’esprit humain s’y perd avant d’arriver à être certain du point auquel, pour être concluants, doivent s’arrêter les résultats de l’expérience qu’il a entreprise: ne lui faut-il pas déterminer au préalable que, de cette infinité de choses sur lesquelles peuvent porter ses recherches, c’est précisément cette corne d’élan qui convient; que parmi cette multitude de maladies, c’est à l’épilepsie qu’il y a lieu d’en faire application; que parmi tant de tempéraments divers, c’est à celui qui est porté à la mélancolie; que sur tant des saisons, c’est en hiver qu’il faut opérer; que parmi tant de nations, c’est sur le 71 Français que cela aura action; parmi tant de gens d’âges différents, sur le vieillard; que de tant de moments marqués par le mouvement des corps célestes, la conjonction de Vénus et de Saturne est celui qui présente le plus de chances de réussite; qu’enfin parmi tant de parties du corps sur lesquelles on peut agir, c’est au doigt qu’il faut s’adresser. Si on considère que, dans tout cela, il n’a, pour le guider, ni argument, ni conjecture, ni faits antérieurs, ni inspiration divine; que c’est la fortune seule qui le conduit, il faudrait vraiment, pour qu’il arrivât juste, que ce soit une fortune issue d’un art qui ait atteint la perfection, qui ait des règles et une méthode précises. Et puis, admettons la guérison: comment avoir l’assurance que le mal n’était pas à son terme? qu’elle n’est pas due au hasard, ou l’effet d’autre chose que le malade aurait mangée, bue ou touchée ce jour-là? ou encore, qu’elle n’a pas été accordée au mérite des prières d’une grand’mère? Bien plus, alors même que le fait serait prouvé, combien de fois s’est-il renouvelé? Y a-t-il là une longue série de résultats prévus, de constatations avérées, se tenant les uns les autres, nécessaires pour en tirer une conclusion? Et cette conclusion, à qui incombe-t-il de la prendre? De tant de millions d’hommes se livrant à ces expériences, il n’y en a que trois qui se soient donné la tâche d’enregistrer celles qu’eux-mêmes ont tentées; le hasard aura-t-il fait que ce soit l’un des trois qui, à point nommé, ait relevé celle-ci? Et puis un autre, cent autres n’ont-ils pu faire des expériences qui aient abouti à des résultats contraires? Peut-être serions-nous plus éclairés, si les jugements et les raisonnements de tous nous étaient connus; mais admettre que trois témoignages apportés par trois docteurs suffisent pour régenter le genre humain, n’est pas raisonnable; il faudrait, pour qu’ils aient une telle autorité, qu’ils eussent été choisis et délégués par lui, et que, par procuration expresse, nous les ayons constitués nos mandataires.
A Madame de Duras,
Elle lui a entendu exposer ses idées sur la médecine; elle les retrouvera dans son ouvrage, où il se peint tel qu’il est.—«Madame, lorsque, dernièrement, vous êtes venue me voir, vous m’avez trouvé occupé à écrire les lignes qui précèdent. Il se peut que ces inepties vous tombent quelquefois sous la main; je veux que, dans ce cas, elles témoignent aussi combien je suis honoré de la faveur que vous leur ferez en les lisant. Vous y reconnaîtrez les mêmes idées et la même manière de les exprimer que lorsque nous en causions ensemble. Alors même qu’il m’eût été possible d’y employer un autre langage que celui dont j’use d’ordinaire et une forme plus honorable et meilleure, je ne l’eusse pas fait, parce que je ne veux pas que ces lignes me rappellent à votre mémoire autrement que je ne suis. Ces observations et les considérations dont 73 elles découlent, que vous avez entendues et admises, Madame, avec plus de courtoisie et en leur faisant plus d’honneur qu’elles n’en méritent, je veux, sans toutefois les altérer ni les modifier, les consigner dans un ouvrage qui me survive quelques années ou quelques jours, où vous les retrouverez, quand il vous plaira de vous les remémorer, sans prendre autrement la peine de les conserver dans votre souvenir; du reste, elles n’en valent pas la peine. Je désire que vous veuillez bien me continuer la faveur de votre amitié, en raison de ces mêmes qualités que vous avez cru reconnaître en moi et qui me l’ont value.
«Je ne me propose nullement qu’on m’aime et qu’on m’estime davantage mort que vivant; la manière de faire de Tibère, qui avait plus souci de la renommée qu’il laisserait après lui que de se rendre agréable à ses contemporains et d’acquérir leur estime, est ridicule, quoique se rencontrant communément. Si j’étais de ceux auxquels le monde puisse devoir des louanges, je l’en tiendrais quitte de moitié, s’il voulait me payer d’avance; je voudrais ces louanges immédiates, m’enveloppant comme une sorte d’atmosphère plutôt dense qu’étendue, bien fournie plutôt que de longue durée, sauf à ce qu’elle se dissipe subitement en même temps que je cesserai d’être et que ce son si doux ne pourra plus arriver à mes oreilles. Ce serait une sotte idée que d’aller, à cette heure où mes rapports avec les hommes sont sur le point de se rompre, me montrer à eux sous un jour plus favorable que celui sous lequel ils m’ont connu. Je tiens comme non avenus les biens dont je n’ai pu user de mon vivant. N’importe comme je suis, tel je veux être en tout et pour tout et non pas seulement sur le papier; j’ai employé tout mon art et toute mon industrie à m’améliorer; mes études ont eu pour objet de m’apprendre non à écrire mais à devenir ce que je suis; tous mes efforts ont tendu à faire ma vie, cela a été mon métier et mon œuvre; je me suis moins occupé à faire des livres, qu’à toute autre besogne. J’ai désiré être un homme capable, en vue des avantages essentiels que j’en retire pour le présent, et non pour mettre mes capacités en magasin et en faire bénéficier mes héritiers. Celui qui a du mérite, c’est pour qu’il se manifeste dans ses mœurs, dans les propos qu’il tient d’ordinaire, quand il fait l’amour, qu’il a des querelles, au jeu, au lit, à table, dans la conduite de ses affaires et la * gestion de sa maison; ceux auxquels je vois faire de beaux livres et qui ont des vêtements en mauvais état, eussent d’abord, s’ils m’avaient cru, commencé par remettre de l’ordre dans leur tenue. Demandez à un Spartiate s’il préfère être un bon rhétoricien plutôt qu’un bon soldat, mais ne me le demandez pas à moi qui aimerais mieux être un bon cuisinier si je n’en avais pas un à mon service. Dieu! que je haïrais, Madame, d’acquérir par mes écrits la réputation d’être un habile homme et de n’être, en dehors d’eux, qu’un homme sans valeur et un sot; si cela était, j’aimerais mieux encore être tout à la fois un sot dans mes écrits et dans la vie ordinaire que d’avoir aussi mal 75 choisi à quoi employer ce que je puis valoir. Aussi, il s’en faut tant que je m’attende à ce que ces sottises me soient de quelque honneur, que ce sera beaucoup si je n’y perds pas partie du peu que j’en ai acquis, parce que cette peinture morte et muette de moi-même, qui se retrouve dans mon ouvrage, n’est pas à mon avantage; elle a trait non à l’époque de mon existence où j’étais en mon meilleur état mais à celle où, bien déchu de ma vigueur primitive et de mon entrain, je commence à me flétrir et à sentir le rance; j’approche du fond du vase et suis sur le point d’en toucher la partie inférieure et la lie.
Du reste, s’il a parlé si mal de la médecine, ce n’a été qu’à l’exemple de Pline et de Celse, les seuls médecins de Rome ancienne qui aient écrit sur leur art.—«Au surplus, Madame, je n’eusse pas osé fouiller si hardiment les mystères de la médecine, vu le crédit dont cet art jouit auprès de vous et de tant d’autres, si je n’y eusse été incité par ceux-là mêmes qui l’ont exercé. Je crois que parmi les anciens latins, il n’y en a eu que deux, Pline et Celse, qui aient en outre écrit sur la matière; si quelque jour vous les lisez, vous verrez qu’ils en parlent bien plus rudement que moi; je ne fais que pincer, eux égorgent. Pline se moque, entre autres choses, de ce que les médecins, à bout d’expédients, aient inventé cette belle défaite de renvoyer les malades, qu’ils ont agités et tourmentés avec leurs drogues et les régimes auxquels ils les ont soumis et cela pour n’arriver à rien, les uns faire des vœux et implorer des miracles, les autres aller prendre les eaux thermales (ne vous courroucez pas, Madame, il ne parle pas de celles de ces sources qui sont de ce côté-ci de la Garonne, que vous et votre maison patronnez et qui sont dépendance des de Grammont). Ils ont encore une troisième corde à leur arc: pour nous éloigner d’eux et s’éviter les reproches que nous pourrions leur adresser du peu d’amélioration qu’ils ont apporté à nos maux, dont ils se sont si longtemps occupés qu’ils n’ont plus de quoi nous leurrer, ils nous envoient dans une autre contrée, chercher un air meilleur.
«En voilà assez, je pense, Madame, pour que vous me permettiez de reprendre le fil de mon sujet dont je me suis détourné pour causer avec vous.»
Il se peut que lui-même en arrive à se remettre entre les mains des médecins; c’est qu’alors, comme tant d’autres, il sera gravement atteint et ne jouira plus de la plénitude de ses facultés.—C’est Périclès, ce me semble, auquel on demandait comment il se portait, qui répondit en montrant les amulettes attachées à son cou et à son bras: «Vous pouvez en juger par cela!» Il voulait indiquer par là, qu’il était bien malade, pour en être arrivé à avoir recours à pareille inutilité et s’être laissé équiper de la sorte.—Je ne dis pas qu’il ne m’arrivera pas un jour de céder à cette idée commune, si ridicule, de remettre ma vie et ma santé à la merci et à la direction des 77 médecins; peut-être tomberai-je en pareille faiblesse, je ne puis répondre de ma fermeté dans l’avenir; mais alors aussi, si quelqu’un vient à s’enquérir auprès de moi de ma santé, je pourrai lui dire comme Périclès, montrant ma main enveloppée et enduite d’un onguent quelconque: «Vous pouvez en juger par là.» Ce sera bien là le signe évident d’une maladie grave; si l’impatience et la frayeur m’ont gagné au point que mon jugement en soit aussi étonnamment désemparé, on pourra en conclure que j’ai l’âme en proie à une bien forte fièvre.
J’ai pris la peine de plaider cette cause que j’entends assez mal, pour justifier un peu et affermir en moi la répulsion que je tiens de mes ancêtres et que, d’instinct, j’éprouve contre les drogues et les pratiques de la médecine telle qu’elle s’exerce de nos jours; et cela, afin que ce ne soit pas de ma part le fait d’une idée préconçue et irraisonnée, qu’elle revête une forme tant soit peu précise, que ceux qui me voient si rebelle aux exhortations et aux menaces qu’on me fait quand la maladie m’oppresse, ne s’imaginent pas que c’est par pur entêtement, * ou encore qu’un de ces individus, qui prennent tout par le mauvais côté, ne juge pas que ce soit par gloriole; et vraiment, ce serait un désir bien singulier que de vouloir me faire honneur d’une action qui m’est commune avec mon jardinier et mon muletier! Certes, je n’ai pas le cœur si bouffi d’orgueil que j’aille échanger une satisfaction comme la santé, si sérieuse, de si grande importance, si douce à posséder, pour une autre imaginaire, immatérielle, éthérée comme la gloire. Fût-elle celle des quatre fils Aymon, elle serait achetée trop cher, par un homme dans mes idées, au prix de trois violents accès de colique: Par Dieu! la santé, la santé, avant tout.—Ceux qui aiment la médecine de notre époque, peuvent aussi avoir pour cela leurs raisons bonnes, grandes et fortes; je ne hais pas les idées en contradiction avec les miennes; il s’en faut même tant que je m’offusque de la divergence qui peut exister entre ma manière de voir et celle des autres, et cela m’empêche si peu de m’accommoder de la société de gens qui pensent et agissent autrement que moi, que je considère, au contraire, comme étant bien moins fréquent encore qu’il y ait en nous-mêmes accord entre nos humeurs et nos desseins; la variété, du reste, est une des propriétés les plus inhérentes à la nature et se retrouve plus encore dans les esprits que dans les corps, les premiers étant plus souples et plus susceptibles de transformations. Il n’y a jamais eu au monde deux opinions identiques, non plus que deux poils ou deux grains qui l’aient été. De toutes les qualités, la plus universelle c’est la diversité; on la retrouve en toutes choses.
79
FIN DU LIVRE SECOND. (TRADUCTION)
Personne n’est exempt de dire des niaiseries, le mal est d’y mettre de la prétention: «Cet homme va probablement nous dire avec emphase quelques grosses sottises (Térence).» Ce second point ne me touche pas; je ne prends pas garde, plus que cela ne vaut, aux balivernes qui m’échappent; et c’est heureux pour elles, car je les désavouerais immédiatement, si elles devaient me coûter quoi que ce soit; je ne les achète, ni les vends au delà de leur valeur; j’écris comme je parle au premier venu que je rencontre; pourvu que je demeure dans la vérité, cela me suffit.
La perfidie est si odieuse, que les hommes les plus pervers ont parfois refusé de l’employer, même quand ils avaient intérêt à le faire.—Qui ne doit détester la perfidie, puisque Tibère lui-même refusa d’y avoir recours, alors qu’il avait grand intérêt à en user? On lui mandait d’Allemagne que s’il le trouvait bon, on le débarrasserait d’Arminius par le poison. C’était l’ennemi le plus puissant qu’eussent les Romains; il avait fort malmené leurs troupes commandées par Varus et, seul, il faisait obstacle à ce qu’ils étendissent leur domination sur ces contrées. Tibère répondit que le peuple romain avait coutume de se venger ouvertement de ses ennemis, les armes à la main, et non traîtreusement et à la dérobée; et il renonça à ce qui lui eût été utile pour faire ce qui était honnête. «C’était un effronté», me direz-vous. Je le crois, mais des faits semblables ne sont pas rares chez des gens en sa situation, et la reconnaissance de la vertu par la bouche de qui la hait, a son importance; d’autant que c’est la vérité qui le contraint à cet aveu et que s’il ne veut pas la pratiquer, au moins cherche-t-il à s’en couvrir pour s’en parer.
L’imperfection de la nature humaine est si grande, que des vices et des passions très blâmables sont souvent nécessaires à l’existence des sociétés; c’est ainsi que la justice recourt souvent, et bien à tort, à de fausses promesses 81 pour obtenir des aveux.—Le monde que nous habitons, envisagé à quelque point de vue que ce soit ou pris dans son ensemble, est plein d’imperfections; cependant rien n’est inutile dans la nature, pas même les inutilités; rien n’existe dans cet univers qui n’y occupe la place à laquelle il convient. Notre être est une agglomération de qualités qui sont autant de maladies: l’ambition, la jalousie, l’envie, la vengeance, la superstition, le désespoir ont élu domicile en nous et cela si naturellement, que nous en retrouvons des traces même chez les animaux. La cruauté elle-même, ce vice si contre nature, y a place, car, en même temps que nous sommes pris de compassion, nous éprouvons en nous-mêmes je ne sais quel sentiment aigre-doux de volupté malsaine au spectacle des souffrances d’autrui; les enfants eux-mêmes le ressentent: «Il est doux, pendant la tempête, de contempler du rivage les vaisseaux luttant contre la fureur des flots (Lucrèce).» Celui qui arracherait du cœur de l’homme le germe de ces mauvais sentiments, détruirait en lui les conditions essentielles de la vie.—Dans tout gouvernement il y a de même des charges nécessaires, qui non seulement sont abjectes mais encore vicieuses; le vice y tient son rang et s’emploie à souder les éléments divers dont se compose la société, comme le poison à la conservation de notre santé. S’il devient excusable, parce qu’il fait besoin et que son emploi, nécessaire à l’intérêt commun, en efface sa véritable qualification, il faut en laisser la pratique aux citoyens plus énergiques et mieux trempés que les autres, que n’arrête pas la crainte de sacrifier leur honneur et leur conscience pour le salut de leur pays, comme jadis ces héros de l’antiquité qui lui sacrifiaient leur vie; nous autres, qui sommes de caractère plus faible, n’abordons que des rôles plus faciles et présentant moins de risques. L’intérêt public veut qu’on trahisse, qu’on mente, qu’on tue, chargeons de ces missions des gens plus obéissants et plus souples que nous ne sommes.
J’ai vu souvent, avec dépit, des juges provoquer par fraude les aveux des criminels, en leur donnant de fausses espérances de faveur ou de pardon, y employant la tromperie et l’impudence. Il siérait mieux à la justice, et même à Platon qui prône ces errements, d’user de moyens se rapprochant davantage de ce que j’en pense. Une justice pareille est dans une mauvaise voie, et j’estime qu’elle se fait ainsi autant de tort par elle-même, que lui en font ceux qui la critiquent.
Dans le peu d’affaires politiques auxquelles Montaigne a été mêlé, il a toujours cru de son devoir de se montrer franc et consciencieux.—Il n’y a pas longtemps, je répondais à quelqu’un que j’aurais grand’peine à trahir les intérêts du prince pour servir un particulier, et que je serais très désolé de trahir les intérêts d’un particulier pour la cause du prince; je ne déteste pas seulement tromper, je hais de même qu’on se trompe sur moi et ne veux en donner ni sujet, ni occasion; aussi, dans les quelques négociations entre nos princes auxquelles j’ai été employé au cours 83 des divisions de nuances si diverses qui nous déchirent aujourd’hui, ai-je évité avec soin qu’on se méprît sur mon compte et qu’on ne se fourvoyât en me prenant pour ce que je ne suis pas. Les gens du métier se découvrent le moins qu’ils peuvent: ils se présentent feignant la neutralité la plus complète et être d’idées aussi rapprochées que possible de celles de ceux avec lesquels ils traitent; moi, je ne cache pas mes opinions, si tranchées qu’elles soient, et me montre tel que je suis: un négociateur naïf et inexpérimenté, qui préfère échouer dans ma mission, que de me manquer à moi-même. Pourtant, jusqu’ici, j’ai été si heureux dans ce rôle, où la fortune a assurément très large part, que peu d’hommes se sont entremis en éveillant moins les soupçons et ont été accueillis avec plus de faveur et de bienveillance. J’ai une façon ouverte de traiter avec les gens, qui fait que je m’insinue aisément auprès d’eux et, dès nos premières relations, me gagne leur confiance. La franchise et la vérité, en quelque siècle que ce soit, sont encore de mise et opportunes; et puis, on ne soupçonne pas et on ne se formalise pas de la liberté d’allure de ceux qui négocient sans intérêt personnel et peuvent répondre comme Hypéride aux Athéniens qui se plaignaient de la rudesse de son langage: «Ne prêtez pas attention, Messieurs, à ma liberté de parole; mais seulement si j’en use sans rien m’approprier, ou en tirer profit dans mon propre intérêt.»—Mon franc parler m’a épargné le soupçon de dissimulation, d’abord, parce que je m’exprimais avec énergie, n’hésitant jamais sur ce qui était à dire, si sévère et si dur que ce fût (eussé-je été loin des gens auxquels je m’adressais, que je n’aurais pas dit pis); et ensuite, en raison de la naïveté et de l’indifférence apparentes que j’y apportais. Dans ce que je fais, je ne prétends à aucun autre résultat que d’agir, et je le fais sans méditer longuement à l’avance sur les conséquences comme sans parti pris; chacun de mes actes vise un objet déterminé: il réussit ou ne réussit pas, j’ai fait pour le mieux.
Je n’ai ni sentiment de haine, ni de profonde affection pour les grands; ma volonté n’est influencée ni par les mauvais procédés dont j’aurais été victime, ni par les obligations personnelles que j’aurais pu contracter. J’ai pour nos rois l’attachement légitime que je leur dois comme citoyen; je ne suis ni porté vers eux, ni détourné d’eux par aucun intérêt personnel, ce dont je me félicite; je ne suis que modérément attaché à la cause à laquelle le plus grand nombre est rallié, bien que j’estime que le bon droit lui appartienne; elle ne me passionne pas. Je ne suis pas enclin à donner prise sur moi, en prenant des engagements personnels et absolus. La colère et la haine n’ont rien à voir avec la justice; ce sont des passions auxquelles peuvent seuls s’abandonner ceux chez lesquels le devoir ne prévaut pas, parce que «seul, celui-là qui ne peut maîtriser sa raison, se laisse aller aux mouvements désordonnés de l’âme (Cicéron)». Toutes les intentions légitimes * et équitables sont par elles-mêmes acceptables * et modérées, sinon elles deviennent séditieuses et illégitimes; 85 c’est ce qui fait que partout je marche la tête haute, le visage et le cœur à découvert. A la vérité, et je ne crains pas de l’avouer, s’il le fallait, je porterais facilement, comme fit la vieille, un cierge à saint Michel et un autre au dragon, prêt à suivre, jusqu’à la dernière extrémité, le parti qui a le bon droit, mais jusque-là exclusivement, si cela m’est possible. Que Montaigne sombre en même temps que la fortune publique, si besoin en est, je m’y résigne; mais si ce n’est pas indispensable, je saurai gré à la fortune de l’épargner et, autant que mon devoir m’en donne la possibilité, je m’efforce d’assurer sa conservation. N’est-ce pas Atticus qui, attaché au parti qui avait pour lui la justice et qui eut le dessous, fut sauvé par sa modération dans ce cataclysme universel qui s’abattit sur le monde, et occasionna tant de bouleversements et de changements de situations? Semblable attitude est plus aisée pour les hommes qui, comme lui, ne sont pas investis de fonctions publiques; je trouve, du reste, que dans de pareils tourmentes, on a raison de n’avoir pas l’ambition d’y être mêlé et de ne pas s’y engager de soi-même.
Quelque danger qu’il y ait à prendre parti dans les troubles intérieurs, il n’est ni beau ni honnête de rester neutre.—Demeurer hésitant et partagé entre les deux partis, ne marquer aucune sympathie ni propension, ni pour l’un ni pour l’autre, quand le trouble règne dans votre pays et le divise, je ne trouve cela ni beau ni honnête; «ce n’est pas suivre un chemin intermédiaire, c’est n’en prendre aucun; c’est attendre l’événement pour passer du côté de la fortune (Tite Live)». Cela peut être permis quand il s’agit des affaires de ses voisins: Gélon, tyran de Syracuse, indécis sur le parti à embrasser lors de la guerre des Barbares contre les Grecs, avait à Delphes une ambassade munie de présents, qui se tenait en observation pour voir de quel côté inclinerait la fortune, afin de saisir l’occasion à point nommé et se concilier le vainqueur. Ce serait une sorte de félonie, que d’en agir ainsi dans ses propres affaires domestiques, où il faut nécessairement prendre parti * de propos délibéré; cependant, ne pas s’en mêler, quand on n’a ni charge ni commandement qui vous y obligent, je le trouve plus excusable, quoique ce ne soit pas mon fait, que dans le cas de guerres étrangères, auxquelles pourtant, d’après nos lois, qui le voudrait ne peut s’éviter de participer. Toutefois, ceux-là mêmes qui s’y donnent tout entiers peuvent le faire dans des conditions de modération telles que, lorsque grondera l’orage, il passera au-dessus de leurs têtes, sans les atteindre; n’en a-t-il pas été ainsi, comme nous l’espérions avec juste raison, de feu le sieur de Morvilliers évêque d’Orléans? J’en connais, parmi ceux qui, à cette heure, travaillent avec ardeur au triomphe de leur cause, qui sont de mœurs si pondérées ou si douces, qu’il faut espérer qu’ils demeureront debout, quels que soient les fâcheux changements et la chute que le ciel nous prépare. Je tiens que c’est aux rois à régler eux-mêmes leurs différends avec les rois, et je raille ces esprits qui, de gaîté de cœur, se mêlent à des querelles si disproportionnées 87 pour eux; on n’est pas personnellement en querelle avec le prince, parce qu’on marche contre lui ouvertement et courageusement pour satisfaire honorablement à son devoir; en pareil cas, s’il ne vous aime pas, il fait mieux, il vous estime; et quand, en particulier, c’est pour le maintien des lois, pour la défense de l’ancien état de choses, il arrive toujours que ceux mêmes qui, dans un intérêt personnel, ont excité les troubles, excusent, lorsqu’ils ne les honorent pas, ceux qui défendent ce qu’eux-mêmes veulent renverser.
Mais il ne faut pas appeler devoir, comme nous le faisons tous les jours, cette âpreté, cette rudesse qu’engendrent en nous notre intérêt et nos passions personnelles; une conduite empreinte de trahison et de mauvais sentiments, n’est pas davantage du courage. Les gens chez lesquels il en est ainsi, qualifient zèle leur penchant à la méchanceté et à la violence; ce n’est pas la cause qui les excite, mais l’avantage qu’ils y trouvent; ils attisent la guerre, non parce qu’elle est juste, mais parce que c’est la guerre.
Quel que soit le parti que l’on embrasse, la modération est à observer à l’égard des uns comme des autres.—Rien n’empêche qu’on puisse se comporter convenablement et loyalement entre hommes qui sont devenus ennemis. Témoignez à chacun des adversaires une affection qui, si elle n’est pas la même pour tous (elle peut comporter des degrés divers), soit au moins tempérée et ne vous engage envers personne au point de donner à quelqu’un le droit de tout exiger de vous; contentez-vous d’avoir part dans une mesure moyenne aux bonnes grâces des uns et des autres, et de naviguer en eau trouble, sans vouloir y pêcher.
Il est des gens qui servent les deux partis à la fois; ils sont à utiliser, mais en se gardant du mal qu’ils peuvent vous faire.—Quant à cette autre manière qui consiste à s’offrir tout entier aux uns et aussi aux autres, c’est plus encore de l’imprudence qu’un manque de conscience. Celui auprès duquel vous en trahissez un autre, a beau vous accueillir parfaitement, ne sait-il pas que son tour viendra où vous en agirez de même contre lui? Il vous tient pour un méchant homme, tout en usant de vous pendant qu’il vous a, faisant servir votre déloyauté à avancer ses affaires; car les gens à double visage sont utiles par ce qu’ils vous apportent, seulement il faut veiller à ce qu’ils n’emportent que le moins qu’il se peut.
Quant à Montaigne, il disait à tous les choses telles qu’il les pensait et ne cherchait à pénétrer les secrets de personne, ne voulant être l’homme lige de qui que ce fût.—Je ne dis rien à l’un, que je ne puisse, à son heure, dire à l’autre, le ton changeant seul un peu; je ne leur rapporte que les choses qui sont ou indifférentes, ou connues, ou qui les servent tous deux à la fois. Il n’est rien qui soit si utile que, pour y atteindre, je me permette de leur mentir. Ce sur quoi le silence m’est recommandé, je le cache religieusement: mais je n’accepte que le 89 moins que je puis ce qu’il me faut cacher; les secrets des princes sont gênants à garder, pour qui n’en a que faire. Je leur mets volontiers ce marché en main: Qu’ils me confient peu de chose, mais qu’ils se fient complètement à moi sur ce que je leur apporte. J’en ai toujours su plus que je ne voulais. Un langage ouvert fait qu’on vous parle de même, sans réticences, produisant le même effet que le vin et l’amour. Philippide répondit sagement, suivant moi, au roi Lysimaque, qui lui demandait quelles indications il voulait qu’il lui communiquât sur sa situation: «Ce que tu voudras, pourvu que ce ne soit rien de tes secrets.» Je vois chacun se révolter, quand on lui cache le fond des affaires auxquelles on l’emploie, ou qu’on ne lui en a pas révélé quelque arrière-pensée; moi, je suis content qu’on ne m’en dise pas plus qu’on ne veut pour la mission que j’ai à remplir, et ne désire pas que ce que j’en puis connaître excède ce que j’ai à dire et m’oblige à m’observer quand je parle. Si je dois servir à tromper quelqu’un, qu’au moins ma conscience soit sauve; je ne veux pas qu’on me regarde comme un serviteur si affectionné, si loyal, que l’on me trouve bon à m’engager dans une trahison; qui n’est pas disposé à tout pour soi-même, est excusé de ne pas l’être davantage vis-à-vis de son maître.—Il y a des princes qui n’acceptent pas les hommes qui ne se donnent à eux qu’à moitié, et méprisent les serviteurs qui posent des bornes et des conditions à leurs services; à cela, il n’y a pas de remède; à eux comme aux autres, j’indique franchement dans quelles limites j’entends les servir, car je ne veux être esclave que de la raison et encore je n’y arrive que bien difficilement. Quant à eux, ils ont tort d’exiger une telle sujétion d’un homme qui est indépendant, et de lui imposer des obligations, comme ils feraient à quelqu’un qui est leur créature et qu’ils ont acheté, ou dont la fortune est attachée à la leur d’une façon particulière et absolue.—Les lois m’ont épargné de graves difficultés; elles ont décidé le parti que j’avais à suivre, ce sont elles qui m’ont donné mon maître; toute autre raison, d’ordre si élevé soit-elle et quelles que soient les obligations qui en sont résultées, s’efface devant celle-là et devient caduque; c’est pourquoi, lors même que mon affection me porterait vers le parti opposé, cela ne veut pas dire que je m’y joindrais immédiatement; notre volonté et nos désirs ne reçoivent de loi que d’eux-mêmes, tandis que nos actes ont à la recevoir des règles qui président à l’ordre public.
Cette manière de faire n’est pas celle que l’on pratique d’ordinaire, mais il était peu apte aux affaires publiques, qui exigent souvent une dissimulation qui n’est pas dans son caractère.—Ma manière de faire n’est guère en harmonie avec ce qui se pratique et n’aurait chance d’avoir ni grand effet, ni durée; l’innocence elle-même ne saurait, à notre époque, s’entremettre, sans recourir à la dissimulation, ni négocier sans être obligée de mentir; aussi les occupations de la vie publique ne sont-elles pas mon fait; ce que ma profession exige à cet égard, j’y satisfais sous la forme la moins officielle que je puis. Quand j’étais 91 jeune, on m’y a plongé jusqu’aux oreilles; j’étais destiné à en faire ma carrière, je m’en suis défait de bonne heure. Depuis, j’ai souvent évité d’y être mêlé à nouveau; je l’ai rarement accepté et ne l’ai jamais recherché; tournant le dos à l’ambition, non à la façon des gens qui manient l’aviron et avancent ainsi à reculons, et cependant, si je suis parvenu à m’y soustraire, je le dois plus à ma bonne fortune qu’à ma résolution, car il y a dans cette partie des voies assez en rapport avec mes goûts et à ma portée; et si j’eusse autrefois été appelé à prendre part aux affaires publiques et à me faire une situation dans le monde en les suivant, je serais certainement demeuré sourd à la voix de la raison et m’y serais engagé.—Ceux qui, malgré ce que j’en dis, vont répétant que ce que j’appelle franchise, simplicité et naïveté de mœurs est, chez moi, de l’art et de la finesse; que c’est prudence, plus que bonté; que j’ai de l’adresse plus que du naturel, du bon sens plus que du bonheur, me font plus d’honneur qu’ils ne m’en ôtent. Ils me prêtent assurément plus d’astuce que je n’en ai; et à celui d’entre eux qui m’aurait suivi et épié de près, je donnerais gain de cause, s’il ne confessait que son école n’a rien qui l’emporte sur cette manière de faire qui nous permet, tout en demeurant nous-mêmes et sans paraître abdiquer notre liberté et notre indépendance, de toujours marcher droit et à même allure par les routes si tortueuses et si diverses par lesquelles il nous faut aller et où toute notre attention et notre ingéniosité ne peuvent nous diriger sûrement. La voie de la vérité est une et simple; celle que nous font suivre notre intérêt personnel et la commodité des affaires dont nous avons la charge est double, inégale, sujette à des chances variables. J’ai souvent vu user de ces libertés contrefaites et factices, mais toujours sans succès; elles rappellent volontiers l’âne d’Ésope qui, voulant rivaliser avec le chien, vint tout gaîment mettre ses deux pieds sur les épaules de son maître; mais tandis que, pour ce témoignage d’affection, le chien recevait des caresses, le pauvre âne reçut en place deux fois autant de coups de bâton: «Ce qui sied le mieux à chacun, c’est ce qui lui est le plus naturel (Cicéron).» Je ne veux cependant pas refuser à la tromperie le rang qu’elle mérite, ce serait ne pas connaître le monde; je sais qu’elle a souvent rendu des services, qu’elle est nécessaire pour pouvoir remplir la plupart des charges qui incombent à l’homme; il y a des vices légitimes, comme il y a des actions qui sont ou bonnes, ou excusables, ou illégitimes.
Il y a une justice naturelle, bien plus parfaite que celles spéciales à chaque nation qui autorisent parfois des actes condamnables lorsque le résultat doit en être utile.—La justice par elle-même, considérée en son état naturel et s’appliquant à l’universalité des êtres, a des règles différentes et plus élevées que celles de cette autre justice spéciale qui est inhérente à chaque pays et qui tient compte des besoins de son gouvernement: «Nous ne possédons point de modèle solide et positif du véritable droit et d’une justice parfaite, nous n’en avons qu’une ombre 93 et qu’une image (Cicéron).» C’est ce qui faisait qu’entendant le récit des vies de Socrate, de Pythagore et de Diogène, le sage Dandamis les jugeait de grands hommes sous tous les autres rapports, mais observateurs trop respectueux des lois, que la vraie vertu ne peut accepter et appuyer qu’en se relâchant beaucoup de la rigidité qui est son principe essentiel; car, non seulement les lois permettent des actes condamnables, mais encore nous y incitent: «Il est des crimes autorisés par les sénatus-consultes et les plébiscites (Sénèque).» Je pense comme on parle communément, distinguant entre les choses utiles et celles qui sont honnêtes et qualifiant de déshonnêtes et de malpropres, certains actes naturels, non seulement utiles, mais encore nécessaires.
La trahison, par exemple, est utile dans quelques cas; elle n’en est pas plus honnête, et on ne saurait nous imposer d’en commettre.—Reprenons pour exemple la trahison.—Deux prétendants au royaume de Thrace, se le disputaient; l’Empereur les empêcha de poursuivre leurs revendications à main armée. Alors l’un d’eux, feignant de vouloir, dans une entrevue, conclure un accord à l’amiable, convia son concurrent à venir chez lui sous prétexte de lui faire fête, et le fit emprisonner puis mettre à mort. La justice aurait voulu que les Romains punissent ce forfait; mais il était difficile de recourir aux voies ordinaires, et ils se résolurent à faire, par trahison, ce qui ne pouvait légitimement s’obtenir sans courir les risques d’une guerre. Ce qu’ils ne pouvaient faire honnêtement, ils le firent en ne se préoccupant que de l’utilité, ce à quoi se trouva propre un certain Pomponius Flaccus. Celui-ci, par des paroles et des assurances trompeuses, ayant attiré notre homme dans ses filets, au lieu des honneurs et des faveurs qu’il lui avait promis, l’envoya à Rome pieds et poings liés. Un traître en trahit un autre, ce qui n’est pas commun, parce qu’ils sont fort défiants et qu’il est malaisé de les surprendre en usant de leurs propres subterfuges; témoin la fatale expérience que nous venons d’en faire.
Ce rôle de Pomponius Flaccus, le prendra qui voudra et assez le voudront; quant à moi, ma parole et la confiance que je puis inspirer appartiennent, comme le reste de moi-même, à la société dont je fais partie; c’est employées à les servir, qu’elles peuvent avoir le meilleur effet; cela, je l’admets comme ne faisant pas doute; mais, de même que si on me commandait de prendre la direction du palais de justice et des audiences, je répondrais: «Je n’y entends rien»; que je dirais, si on m’imposait de surveiller le travail des pionniers: «Je suis fait pour exercer un emploi plus relevé»; de même à qui voudrait m’employer à mentir, à trahir, à me parjurer en vue d’un service d’une certaine importance sans même aller jusqu’à assassiner, à empoisonner, je dirais: «Plutôt que de faire que je vole ou dépouille quelqu’un, envoyez-moi aux galères.» Il est toujours loisible, en effet, à un homme d’honneur de parler comme firent les Lacédémoniens traitant avec Antipater 95 qui venait de les vaincre: «Vous pouvez nous imposer autant qu’il vous plaira de charges qui nous écrasent et nous soient préjudiciables, mais vous perdez votre temps à vouloir exiger de nous des choses honteuses et déshonnêtes.» Chacun doit s’être juré à soi-même ce que les rois d’Egypte faisaient solennellement jurer à leurs juges: qu’ils ne dévieraient pas de ce que leur ordonnerait leur conscience, quelque ordre qu’eux-mêmes leur donneraient.—A de telles commissions, est attaché un stigmate évident d’ignominie et une condamnation. Qui vous les donne, vous accuse; et, en vous les donnant, vous impose, si vous vous en rendez bien compte, une charge et du même coup vous frappe d’une peine. Autant les affaires publiques bénéficieront de votre exploit, autant les vôtres y perdront; vous vous ferez d’autant plus de tort que vous ferez mieux; bien plus, ce ne sera pas chose nouvelle si vous êtes ruiné par celui-là même pour lequel vous aurez fait cette besogne, on sera même porté à trouver que c’est justice.
Si elle est excusable, ce n’est qu’opposée à une autre trahison sans que, pour cela, le traître cesse d’être méprisé et parfois puni par ceux-là mêmes qu’il a servis.—S’il est des cas où la trahison peut être excusable, c’est seulement lorsqu’elle est employée à châtier et à trahir un traître. On voit souvent la perfidie, non seulement repoussée, mais encore punie par ceux-là mêmes dans l’intérêt desquels elle a été conçue; chacun connaît la mesure prise par Fabricius contre le médecin de Pyrrhus. Il arrive aussi que tel qui l’a ordonnée, la venge ensuite cruellement, en sévissant contre celui qui l’a servi, se déniant en quelque sorte à lui-même une autorité et un pouvoir si effréné, et désavouant chez celui qu’il a employé un servage et une obéissance si passifs et si lâches.—Jaropelc, duc de Russie, gagnant un gentilhomme de Hongrie, l’avait déterminé à trahir Boleslas, roi de Pologne, soit en le faisant mourir, soit en donnant aux Russes le moyen de lui causer des dommages importants. Le traître s’y prit en habile homme: il déploya tout le zèle imaginable pour le service du roi, parvint à être de son conseil, et compta bientôt parmi ses partisans les plus fidèles. Grâce à la confiance qu’il avait captée, profitant d’un moment rendu opportun par l’absence de son maître, il livra aux Russes Visilicie, grande et riche cité qui fut entièrement saccagée puis incendiée par eux; la population de tout sexe et de tout âge fut tout entière massacrée et, avec elle, un grand nombre de nobles des alentours que le Hongrois y avait rassemblés en vue de ce qui arriva. Jaropelc, après avoir assouvi sa vengeance et sa colère qui n’étaient pas sans motif (Boleslas l’avait gravement offensé en agissant envers lui de semblable façon), repu des résultats de cette trahison, se rendant compte de sa laideur à ne considérer que le fait même, l’envisageant sans parti pris et non plus sous l’empire de la passion, en éprouva de tels remords et un tel dégoût, qu’il fit crever les yeux, couper la langue et les parties génitales au traître qui l’avait commise.
97
Antigone avait persuadé au corps des Argyraspides de lui livrer Eumène, leur capitaine général, avec lequel il était en compétition. A peine l’eut-il en son pouvoir, qu’il le fit tuer; et, s’instituant ministre de la justice divine pour le châtiment d’une si détestable trahison, il écrivit au gouverneur de la province, lui intimant l’ordre exprès de perdre ceux qui l’avaient commise et de les exterminer de quelque manière que ce fût, si bien que du grand nombre qu’ils étaient, pas un ne revit jamais la Macédoine; mieux il en avait été servi, plus il jugea leur conduite mauvaise et punissable.
L’esclave qui révéla l’endroit où se cachait P. Sulpitius son maître, fut affranchi comme Sylla s’y était engagé dans son édit de proscription; mais, pour donner satisfaction à la conscience publique, tout libre qu’il était devenu, on le précipita du haut de la roche tarpéienne.
Clovis, l’un de nos rois, au lieu des armes d’or qu’il leur avait promises, fit pendre les trois serviteurs du roi Cannacre qui, à son instigation, avaient trahi leur maître. On les pendit avec, attachée au cou, la bourse contenant le prix de leur méfait; de telle sorte, qu’après avoir fidèlement rempli les engagements particuliers pris envers eux, il fut satisfait ensuite à la moralité publique qui prime toute autre considération.
Mahomet II voulant se défaire de son frère dont il redoutait la compétition au trône, ce qui est fréquent chez les Ottomans, y employa un de ses officiers qui étouffa sa victime, en lui ingurgitant de force une grande quantité d’eau à la fois. Le crime accompli, Mahomet livra en expiation celui qui l’avait exécuté à la mère du mort (ils n’étaient frères que de père). Celle-ci fit, en sa présence, ouvrir la poitrine au meurtrier et, alors qu’il palpitait encore, y fouillant de ses mains, en arracha le cœur qu’elle jeta à manger aux chiens. Il est si doux, à ceux mêmes qui n’ont que de mauvais sentiments, de pouvoir, après avoir recueilli le fruit d’une de ces actions abominables, y rattacher, sans avoir désormais à en souffrir, quelque trait de bonté et de justice en compensation en quelque sorte de leur complicité et de soulager ainsi leur conscience; d’autant qu’ils ne cessent de voir en ceux qui les ont assistés dans l’exécution de leur forfait, des gens qui les leur reprochent, et qu’ils cherchent à étouffer, par leur mort, la connaissance qu’ils en ont eue et la preuve de leur participation.
Si vous êtes, par hasard, récompensé de pareils services, pour que la société ne soit pas empêchée d’user de cette ressource extrême et désespérée qui lui est indispensable, celui qui vous en remet le prix, ne laisse pas de vous tenir, si lui-même n’est pas tel, pour un misérable et un maudit. Il vous considère avec plus de mépris encore que ne fait celui que vous avez trahi, parce qu’il sait le peu que vous valez, qu’il vous a vu à l’œuvre, sans protestation, sans désaveu de votre part; il vous emploie tout comme on fait de ces hommes perdus dont se sert la justice pour les exécutions capitales, 99 charge aussi utile que peu honorable.—Outre ce que de semblables commissions ont de vil, elles déshonorent. La fille de Séjan ne pouvant, d’après la législation romaine, être mise à mort, parce qu’elle était encore vierge, fut, pour permettre l’application de la loi, violée par le bourreau, avant qu’il ne l’étranglât; l’office que celui-ci remplissait dans l’intérêt public, réclama de lui, en cette circonstance, qu’il avilît et sa main et son âme.
Ceux qui consentent à être les bourreaux de leurs parents et de leurs compagnons méritent la réprobation publique.—Amurat I, pour aggraver le châtiment de ceux de ses sujets qui avaient appuyé la rébellion de son fils * contre lui et s’étaient faits complices de ce parricide, ordonna que leurs plus proches parents prêteraient la main à leur exécution. Je trouve très honorable le refus qu’opposèrent certains d’entre eux qui préférèrent être considérés à tort comme complices du forfait commis par un autre, plutôt que de se rendre eux-mêmes coupables d’un crime semblable en s’associant à l’œuvre de la justice.—Dans quelques bicoques qui ont été prises d’assaut dans les guerres de notre temps, j’ai vu des coquins qui, pour sauver leur vie, acceptaient de pendre leurs amis et alliés; je les tiens de pire condition que les pendus.—On dit que Witolde, prince de Lithuanie, établit dans cette nation que tout criminel condamné à mort devrait se détruire lui-même, trouvant étrange qu’un tiers, innocent de la faute, fût employé à commettre un homicide et en eût charge.
Les princes sont quelquefois dans la nécessité de manquer à leur parole; on ne saurait les en absoudre que s’ils se sont trouvés dans l’impossibilité absolue d’assurer autrement les intérêts publics dont ils ont charge.—Le prince qu’une circonstance urgente et quelque accident violent et inopiné inhérent à sa position obligent à manquer à sa parole et à la foi qu’il a donnée, ou qui encore le jettent en dehors de ce qui est ordinairement son devoir, doit considérer cette nécessité dans laquelle il est placé, comme une épreuve que Dieu lui impose. Chez lui, ce n’est pas vice; sa raison est contrainte de céder à une autre plus puissante que la sienne et qui s’étend sur tout; mais c’est certainement un malheur. A quelqu’un qui me demandait quel remède pouvait y être apporté: Il n’y en a pas, ai-je répondu, si véritablement ce prince est pressé entre ces deux partis extrêmes: «mais surtout qu’il se garde bien de chercher des prétextes à son parjure (Cicéron)»; il a ainsi agi, parce qu’il s’y trouvait obligé; mais s’il a satisfait sans regret à cette nécessité, s’il ne lui en a pas coûté de manquer à sa foi, c’est signe que sa conscience est véreuse.—S’il s’en trouvait un de conscience si scrupuleuse que nulle nécessité ne lui parût justifier un si grave remède, je ne l’en estimerais pas moins; on ne saurait perdre ses états d’une façon plus excusable et plus honorable. Nous ne pouvons tout; aussi faut-il souvent nous en remettre au ciel de 101 la direction de notre navire; la protection divine est notre dernière ancre de salut. Quelle nécessité justifie davantage qu’il s’adresse à elle? Est-il quelque chose à quoi un prince puisse moins consentir, qu’à ce qu’il ne peut faire qu’aux dépens de sa foi et de son honneur qui, dans certaines circonstances, doivent lui être plus chers que son propre salut, * oui assurément, et même que le salut de son peuple? Quand, les bras croisés, il appellerait simplement Dieu à son aide, n’a-t-il pas à espérer que la bonté divine ne lui refusera pas, à lui dont la cause est juste et bonne, la faveur d’un appui auquel tout est possible? Ce sont là de dangereux exemples qui sont des dérogations rares et malsaines aux règles naturelles; il faut y céder, mais avec une grande modération et beaucoup de circonspection; nul intérêt privé ne mérite que nous fassions à notre conscience une pareille violence, qui dans l’intérêt public est admissible, lorsque l’utilité en est bien apparente et qu’elle est d’importance capitale.
Comment le sénat de Corinthe s’en remit à la fortune du jugement qu’il avait à porter sur Timoléon, qui venait de tuer son propre frère.—Timoléon se préserva de la réprobation que son acte étrange était susceptible de soulever contre lui par les larmes abondantes que lui fit répandre la pensée constante que c’était lui, son frère, qui avait tué le tyran; et c’est justice si sa conscience a souffert de ce qu’il avait été dans l’absolue nécessité de sacrifier à l’intérêt public sa rectitude de mœurs. Le sénat lui-même, qu’il avait ainsi délivré, n’osa se prononcer nettement sur un fait de cette importance et se trouva hésitant entre ces deux considérations, toutes deux d’un si grand poids. Les Syracusains vinrent fort à propos, à ce moment, solliciter des Corinthiens leur protection et l’envoi d’un chef capable de rendre à leur ville son ancienne splendeur et de purger la Sicile de l’oppression de plusieurs petits tyrans. Le sénat leur envoya Timoléon, en prenant avec lui-même cet arrangement de nouvelle sorte: Selon qu’il s’acquitterait bien ou mal de la mission qu’on lui confiait, l’arrêt que ce corps politique avait à rendre, lui serait, ou favorable ne considérant en lui que le libérateur de son pays, ou défavorable ne l’envisageant que comme le meurtrier de son frère. Cette singulière conclusion s’explique par le danger résultant d’un semblable exemple et la gravité d’un acte si en dehors de ce qui se voit d’ordinaire; les Corinthiens eurent raison de ne pas s’en rapporter à leur propre jugement et de faire intervenir, pour trancher la question, des considérations tirées d’un autre ordre de faits. La conduite de Timoléon dans cette mission éclaira rapidement sur ce qu’il fallait penser de lui tant il se comporta, sous tous rapports, avec dignité et vertu; le bonheur avec lequel il se tira des grosses difficultés qu’il eut à surmonter dans sa tâche, sembla lui avoir été envoyé pour sa justification par les dieux conspirant en sa faveur.
Acte inexcusable du sénat romain revenant sur un traité qu’il avait ratifié.—Le but qui avait fait agir Timoléon l’excuse, 103 autant qu’un acte de cette nature peut être excusé. Mais le bénéfice que retira le trésor public et qui fut le prétexte dont usa le Sénat romain en la circonstance, n’est pas suffisant pour faire admettre une injustice comme celle qu’il commit dans cette affaire malpropre que je vais rapporter: Certaines villes s’étaient rachetées à prix d’argent et avaient recouvré leurs franchises sur ordonnances rendues par le Sénat, qui avait ratifié cette mesure prise par Sylla. Celui-ci mort, le Sénat, saisi à nouveau de la question, replaça ces villes sous le régime de la taille et décida que l’argent qu’elles avaient payé pour leur rachat, ne leur serait pas rendu. Les guerres civiles produisent souvent d’aussi vilains exemples: nous punissons les particuliers de ce qu’ils nous ont crus, quand nous étions autres que nous ne sommes devenus; le magistrat fait porter la peine du changement qui s’est produit en lui, à qui n’en peut mais; le maître d’école fouette son écolier pour avoir été trop docile; le clairvoyant, l’aveugle auquel il sert de guide. Quelle horrible image de la justice cela nous donne!
L’intérêt privé ne doit jamais prévaloir sur la foi donnée; ce n’est que si on s’est engagé à quelque chose d’inique ou de criminel, que l’on peut manquer à sa parole.—Il y a en philosophie des règles qui sont fausses et par trop élastiques. L’exemple ci-après qu’on nous propose comme un cas où l’intérêt particulier peut primer la foi engagée, ne tire pas des circonstances mêmes que l’on indique, une autorité suffisante: Des brigands se sont emparés de vous, et vous ont rendu la liberté après vous avoir fait jurer de leur payer comme rançon une somme déterminée; est-on fondé à prétendre qu’un homme de bien, une fois hors de leurs mains, est dégagé de son serment, s’il ne paie pas? Non; ce que la crainte m’a fait vouloir, je dois le vouloir encore, lorsque je n’ai plus à craindre; et lors même que c’est cette crainte qui a contraint ma langue à prononcer ce que ma volonté ne ratifiait pas, je suis encore tenu d’observer exactement ma parole.—Chez moi, quand parfois la parole a été inconsidérément plus loin que la pensée, je ne m’en suis pas moins fait un cas de conscience de ne pas me désavouer; autrement, de degré en degré, nous arriverions à abolir tout droit qu’un tiers peut fonder sur nos promesses et * nos serments: «La violence peut-elle quelque chose sur un homme de cœur (Cicéron)?» L’intérêt privé ne peut être pour nous une excuse de manquer à nos promesses que dans le cas où nous aurions promis une chose mauvaise et injuste par elle-même, parce que les droits de la vertu doivent l’emporter sur tous autres dont nous avons contracté l’obligation.
Chez Épaminondas l’esprit de justice et la délicatesse de sentiments ont toujours été prédominants; son exemple montre qu’il est des actes qu’un homme ne peut se permettre même pour le service de son roi, même pour le bien de son pays.—J’ai, plus haut, mis Épaminondas au premier rang des hommes les meilleurs; je ne m’en dédis pas. A 105 quelle hauteur ne plaçait-il pas ce qu’il considérait comme son devoir personnel, lui qui ne tua jamais un homme qu’il avait vaincu; qui, même dans le but au plus haut point estimable de rendre la liberté à son pays, se faisait conscience de tuer, en dehors des formes de la justice, un tyran ou ses complices; qui jugeait méchant, si bon citoyen qu’il fût, celui qui, dans une bataille, n’épargnait dans les rangs ennemis ni son ami, ni son hôte! Voilà une âme richement composée: dans l’accomplissement des actes les plus rudes et les plus violents de l’humanité, il demeurait bon et humain, et cela dans les conditions les plus délicates que conçoive l’enseignement de la philosophie. Ce courage si grand, si manifeste, si opiniâtre contre la douleur, la mort, la pauvreté, est-ce à la nature ou à l’art qu’il devait de l’avoir attendri au point d’en être arrivé à cette extrême douceur et à cette bonté qui s’étaient incarnées en lui? Horrible sous le fer et le sang qui le couvrent, il va fracassant, rompant une nation invincible pour tous, sauf pour lui, et, au milieu des plus effroyables mêlées, se détourne s’il se trouve en présence d’un hôte ou d’un ami! En vérité, celui-là commandait bien à la guerre, qui avait su lui imposer sa bonté, comme un frein qu’elle subissait même aux plus forts moments du combat, alors qu’elle était dans toute sa surexcitation, écumant de fureur et de meurtre. C’est miracle de pouvoir mêler à de telles actions quelque image de la justice, et à la rigueur de principes d’Épaminondas appartient seul d’avoir pu y associer la douceur et la pratique des mœurs les plus tolérantes, l’innocence dans toute sa pureté. Là où l’un dit aux Mamertins «que les traités n’ont plus cours, quand on est en armes»; un autre, à un tribun du peuple, «que le temps de la justice et celui de la guerre sont deux»; un troisième, «que le bruit des armes l’empêche d’entendre la voix des lois», Épaminondas entendait même celle de la civilité et de la simple courtoisie. N’avait-il pas été jusqu’à emprunter à ses ennemis l’usage de sacrifier aux Muses en marchant au combat pour atténuer, par la douceur et la gaîté qu’elles répandent, la furie et la rudesse du guerrier? N’hésitons donc pas à penser après un si grand modèle que, même contre un ennemi, tout n’est pas permis; que l’intérêt général n’est pas autorisé à tout revendiquer au mépris des intérêts privés: «Le souvenir du droit privé subsiste au milieu des dissensions publiques (Tite Live)»; «Il n’y a pas de puissance qui puisse nous faire enfreindre les droits de l’amitié (Ovide)»; disons-nous qu’il y a des choses interdites à un homme de bien qui sert son roi, ou la cause de l’ordre et des lois, «car la patrie n’étouffe pas tous les devoirs, et il lui importe d’avoir des citoyens qui soient pieux envers leurs parents (Cicéron)». C’est là une éducation à répandre à notre époque. Nous n’avons que faire de principes exclusifs; c’est assez que nos épaules soient bardées de fer sans que nos âmes le soient; c’est assez de tremper nos plumes dans l’encre, sans encore que nous les trempions dans le sang. Si c’est le comble du courage, l’effet d’une vertu particulièrement rare 107 que de mépriser l’amitié, les obligations que nous avons les uns envers les autres, la parole donnée, les liens de parenté pour le bien commun et l’obéissance aux magistrats, il suffit bien, pour nous excuser de ne point posséder une telle grandeur de sentiments, qu’elle n’ait point pris place dans ce qui faisait la grandeur d’âme d’Épaminondas.
J’abomine les appels à la violence de cette autre âme en délire: «Tant que l’épée sera tirée du fourreau, chassez toute pitié de vos cœurs, que la vue même de vos pères dans le camp adverse ne vous arrête pas, frappez du fer ces têtes vénérables (Lucain).» Otons à ceux qui, par nature, sont méchants, sanguinaires et traîtres, ce prétexte à se livrer à leurs penchants; laissons là cette justice excessive qui ne nous appartient pas et tenons-nous-en à des exemples plus empreints des droits de l’humanité.—A cet égard l’époque et l’exemple peuvent beaucoup. Durant la guerre civile, dans un engagement contre Cinna, un soldat de Pompée ayant, par mégarde, tué son frère qui était dans les rangs opposés, se tua lui-même sur le champ par honte et par regret. Quelques années après, dans le cours d’une autre guerre civile, toujours chez ce même peuple, un soldat qui avait tué son frère demandait, pour ce fait, une récompense à ses chefs.
En résumé, l’utilité d’une action ne suffit pas pour la rendre honorable.—C’est à tort qu’on voudrait justifier de * l’honnêteté et de la beauté d’une action par ce fait seul qu’elle est utile, et en conclure que chacun peut être tenu de l’accomplir et doit l’estimer honnête en raison de son utilité: «Toutes choses ne conviennent pas également à tous (Properce).» Considérons celle qui est la plus nécessaire et la plus utile à la société humaine, le mariage; le conseil des saints ne trouve-t-il pas qu’il est plus honnête de s’en abstenir, réprouvant ainsi, parmi les devoirs de l’homme, celui qui est le plus respectable, comme nous-mêmes en agissons vis-à-vis des animaux, en envoyant dans les haras ceux dont nous faisons le moins de cas.
Tout, en ce monde, est soumis à des changements continuels; c’est ce qui fait que Montaigne, qui se dépeint au jour le jour, peut ne pas se montrer constamment avec les mêmes sentiments et les mêmes idées.—Les autres auteurs se proposent l’éducation de l’homme; je me borne à le décrire. 109 Celui que je dépeins est bien mal composé; si j’avais à le façonner à nouveau, je le ferais certainement tout autre qu’il n’est, mais aujourd’hui c’est chose faite. Les traits sous lesquels je le présente, sont bien tels, quoique changeant et se diversifiant; car le monde n’est autre qu’un mouvement perpétuel; tout y est continuellement en branle; la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Égypte participent du mouvement général et de celui qui leur est propre; l’immobilité elle-même n’est qu’un mouvement moins accentué. Je ne puis fixer l’objet que je veux représenter: il se meut vague et chancelant comme sous l’influence d’une ivresse naturelle; je le prends tel qu’il est à l’instant où mon intention se porte sur lui; je ne le peins pas tel qu’il est, mais tel qu’il m’apparaît au passage; passage non d’un âge à un autre, ni, comme on dit dans le peuple, de sept ans en sept ans, mais de jour en jour, de minute en minute. C’est donc sur le moment même qu’il me faut achever ma description; un instant plus tard, je pourrais me trouver non seulement en présence d’une physionomie qui s’est modifiée, mais encore les idées d’après lesquelles je l’apprécie n’être plus elles-mêmes celles que j’avais le moment d’avant. Je relève les accidents divers et variables qui se produisent en moi et les conceptions plus ou moins fugitives qu’engendre mon imagination, lesquelles souvent sont le contraire les unes des autres, soit qu’à certains moments je sois autre que moi-même, soit que ce qui en est l’objet m’apparaisse dans un cadre et sous un jour autres; si bien qu’il m’arrive de temps en temps de me contredire et cependant, comme disait Demade, jamais je ne cesse d’être vrai. Si mon âme pouvait se fixer, je ne serais pas hésitant, je parlerais nettement, en homme sûr de lui-même; mais elle est sans cesse cherchant sa voie et s’essayant.
Quoique sa vie n’offre rien de particulier, l’étude qu’il en fait n’en a pas moins son utilité, d’autant que jamais auteur n’a mieux connu son sujet.—J’expose une vie tout à fait des plus ordinaires, qui ne présente rien de saillant, ce qui est tout un. La vie intime de l’homme du peuple est du reste un sujet de philosophie et de moralité au même degré qu’une vie vécue dans de plus brillantes conditions; dans chaque homme se retrouve l’homme tout entier. Les auteurs traitent communément des sujets spéciaux auxquels leur personnalité demeure étrangère; dérogeant à cette habitude, ce qui est la première fois que cela arrive, c’est moi-même, dans ma plus complète intégrité, que je livre au public, c’est Michel de Montaigne en personne et non Michel de Montaigne grammairien, poète ou jurisconsulte. Si le monde se plaint de ce que je parle trop de moi, je me plains de ce que lui ne pense seulement pas à lui-même. Mais est-il raisonnable, ne vivant que pour moi, de prétendre initier le public à la connaissance de moi-même? Est-ce raisonnable aussi de présenter dans toute leur crudité, au monde auprès duquel la façon et l’art ont tant de poids et sont tant prisés, de simples effets de la nature, et encore d’une nature qui n’a que bien peu de ressort? N’est-ce pas vouloir construire un 111 mur sans avoir de pierres, ou entreprendre toute autre chose du même genre, que d’écrire un livre sans la science et le talent * voulus? C’est l’art qui permet d’adapter la musique aux idées que l’on veut rendre; les miennes ne procèdent que du hasard. J’ai du moins pour moi ceci de conforme à la règle, c’est que personne n’a traité un sujet, le possédant avec plus de connaissance que je n’ai de celui qui m’occupe; je suis à cet égard plus savant que qui que ce soit; en second lieu, jamais personne ne l’a scruté davantage, n’en a plus analysé les diverses parties et les conséquences qui en découlent, et n’a une idée plus exacte et plus complète du but qu’il se propose. Pour mener à bien ce travail, je n’ai besoin que de sincérité, et cette qualité-là s’y trouve aussi réelle, aussi pure qu’il se peut. Je dis la vérité, non pas aussi nette que je voudrais, mais que je l’ose, et j’ose un peu plus au fur et à mesure que je vieillis, parce que j’ai remarqué qu’aux gens avancés en âge on concède une plus grande liberté de bavarder et de s’étendre complaisamment sur ce qui les touche. Ici, il n’y a pas à craindre, ce qui arrive souvent, que l’artisan et le travail qu’il produit soient en contradiction, et qu’on vienne dire: «Comment se peut-il qu’un homme qui cause si bien, ait écrit un ouvrage aussi sot?» ou encore: «Comment cet ouvrage, qui dénote tant de savoir, a-t-il pu être écrit par un homme qui a une si faible conversation?» Quand la société de quelqu’un est banale et que ses ouvrages ont de la valeur, c’est que la capacité qu’il y montre, provient d’une source à laquelle il l’emprunte et n’est pas de son cru. Un savant n’est pas savant en toutes choses, mais l’homme capable, l’est en tout, jusque dans son ignorance. Mon livre et moi sommes si bien assortis, que nous allons de pair; ailleurs, on peut apprécier ou ne pas apprécier l’ouvrage et avoir une idée autre sur l’auteur; tel n’est pas ici le cas, le jugement porté sur l’un s’applique à l’autre. Celui qui jugera sans se rendre compte, se fera plus de tort qu’à moi; celui qui jugera en connaissance de cause, aura pleinement satisfait à ce que je souhaite. Je serai plus heureux que je ne le mérite, si j’arrive à me concilier suffisamment l’approbation publique pour que les gens qui ont du bon sens, veuillent bien admettre que j’eusse été capable de tirer profit de la science si j’en avais eu, et qu’il est regrettable que ma mémoire ne m’ait pas mieux servi.
Expliquons ici ce que je répète souvent: que je ne me repens que rarement et que ma conscience se contente de son propre témoignage, non comme si j’avais la conscience d’un ange ou d’une bête, mais comme fait une conscience humaine; à quoi j’ajouterai cette redite continuelle qui n’est pas chez moi un vain étalage de mots, mais un acte de soumission complète et absolue: «Ce que je dis, est le fait de quelqu’un qui ne sait pas et qui s’enquiert; et, comme conclusion, je m’en remets purement et simplement aux croyances universellement admises et qui nous ont été légitimement transmises.» Je n’enseigne pas, je raconte.
Tout vice laisse dans l’âme une plaie qui la tourmente 113 sans cesse; une bonne conscience procure, au contraire, une satisfaction durable.—Il n’y a pas de vice, méritant réellement cette qualification, qui ne nous offense et que ne fasse ressortir un jugement sain. La laideur et les inconvénients du vice sont, en effet, si apparents que peut-être ceux-là ont-ils raison, qui disent qu’il est surtout le résultat de la bêtise et de l’ignorance, tant il est difficile d’imaginer qu’on puisse le connaître sans le haïr. La méchanceté résorbe la majeure partie de son propre venin et s’en empoisonne elle-même. Le vice amène un remords dans l’âme, qui est comme un ulcère dans les chairs; toujours elle s’égratigne et s’ensanglante elle-même. La raison efface toutes les autres tristesses, toutes les autres douleurs, tandis qu’elle entretient celles qui nous viennent du remords, qui est d’autant plus aigu qu’il naît au dedans de nous, semblable en cela au froid et au chaud qui, occasionnés par la fièvre, nous sont plus pénibles que lorsqu’ils proviennent de causes externes. J’appelle vice (chacun toutefois dans la mesure qui lui est propre), non seulement ce que condamnent la nature et la raison, mais aussi ce qu’à tort ou à raison l’homme a décrété tel, lorsque les lois et l’usage l’ont ratifié.
De même, tout ce qui est bon réjouit une nature bien née; bien faire procure toujours je ne sais quelle satisfaction qui nous réconforte dans notre for intérieur et nous inspire cette généreuse fierté compagne d’une bonne conscience; une âme qui apporte du courage dans le vice, peut, par exception, se donner la sécurité, mais n’arrive ni à se complaire, ni à être satisfaite. Ce n’est pas un léger contentement que l’on éprouve, de se sentir préservé de la contagion d’un siècle si contaminé et de pouvoir se dire en soi-même: «Qui plongerait ses regards jusque dans le fond de mon âme, ne me trouverait, jusqu’à présent, coupable ni d’avoir affligé ou ruiné quelqu’un, ni de m’être vengé ou avoir porté envie, non plus que d’avoir attenté publiquement aux lois, d’avoir contribué à faire prévaloir des nouveautés, participé aux troubles, manqué à ma parole; et, bien que la licence des temps l’ait permis et appris à chacun à le pratiquer, je n’ai mis la main ni sur les biens, ni sur la bourse d’aucun Français; je n’ai vécu que de la mienne, aussi bien pendant la guerre que pendant la paix, et n’ai jamais usé du travail de personne sans le payer.» De pareils témoignages de conscience plaisent; et cette satisfaction intime, qui est la seule récompense qui jamais ne nous fasse défaut, est d’un grand prix.
Chacun devrait être son propre juge, les autres n’ont, pour nous juger, qu’une fausse mesure à leur disposition.—Chercher, dans l’approbation d’autrui, la récompense des actions vertueuses, c’est prendre une base d’appréciation trop incertaine et mal définie, surtout dans un siècle corrompu et ignorant comme celui-ci, où l’estime que vous témoigne la foule est injurieuse, et où on ne sait à qui se fier qui soit à même de distinguer ce qui mérite d’être loué! Dieu me garde d’être un homme de bien semblable 115 à ceux auxquels tous les jours je vois, pour leur faire honneur, attribuer cette qualification: «Les vices d’autrefois sont devenus les mœurs d’aujourd’hui (Sénèque).»—Certains de mes amis ont, parfois, entrepris de me chapitrer et de me censurer en toute sincérité, soit de leur propre mouvement, soit sollicités par moi, parce que c’est là un service qui, pour une âme bien faite, surpasse comme bon procédé, aussi bien qu’en utilité, tous ceux que l’amitié peut nous rendre. Tout en faisant à ces critiques l’accueil le plus courtois et le plus reconnaissant, je puis dire aujourd’hui en conscience que j’ai souvent constaté si peu de justesse dans leurs reproches comme dans leurs louanges, qu’il ne s’en est pas fallu de beaucoup qu’en m’y prenant à leur manière, je ne fisse mal plutôt que bien. Surtout nous autres particuliers, dont les sentiments ne se manifestent guère au dehors de nous, avons besoin d’avoir au dedans un juge qui prononce sur la valeur de nos actes et qui tantôt nous encourage, tantôt nous châtie selon ce qu’il apprécie. Pour juger des miens, j’ai des lois et une cour de justice qui me sont propres, et c’est à elles que j’ai le plus souvent recours; je modifie bien mes actions suivant le jugement d’autrui, mais c’est uniquement d’après moi que je les juge. Il n’y a que vous qui sachiez si vous êtes lâche et cruel, si vous êtes loyal, si vous avez des idées religieuses; les autres ne vous voient pas, ils vous devinent d’après des conjectures incertaines; ce n’est pas tant votre naturel qu’ils aperçoivent que l’apparence que, par l’effet de l’art, vous êtes arrivé à vous donner; ne vous en rapportez donc pas à leur sentence, tenez-vous-en à la vôtre: «Usez de votre propre jugement... Le témoignage qu’en vous-mêmes se rendent le vice et la vertu est d’un grand poids; en dehors de lui, tout le reste n’est rien (Cicéron).»
Le repentir est, dit-on, la suite inévitable d’une faute; cela n’est pas exact pour les vices enracinés en nous.—On dit que le repentir suit de près la faute, cela ne semble pas s’appliquer à celle montée à un si haut diapason, qu’elle a fait élection de domicile en nous au point d’y être comme chez elle. On peut désavouer et renier les vices qui ne sont qu’accidentels et vers lesquels la passion nous a une fois entraînés; mais ceux qui, à la suite d’une longue habitude, se sont enracinés et ancrés par l’effet d’une volonté forte et persistante, ne sont pas sujets à résipiscence. Le repentir n’est autre qu’un dédit de notre volonté, une révolte qui nous passe par l’esprit, une contradiction avec nous-mêmes qui fait que nous allons en tous sens; il amène l’un à désavouer le vice, un autre sa vertu et sa continence des temps passés: «Que n’avais-je autrefois l’expérience que j’ai aujourd’hui; et que mes joues n’ont-elles conservé le duvet de la jeunesse (Horace)!»
La vie extérieure d’un homme n’est pas sa vie réelle; il n’est lui-même que dans sa vie intérieure.—C’est une existence exquise que celle qui, jusque dans la vie privée, ne se départit 117 jamais de la règle. Tout le monde peut faire le métier de bateleur et, sur les tréteaux, représenter un personnage honnête; mais au dedans de nous, dans notre for intérieur où nous régnons en maître et où tout ce qui se passe demeure caché, ne pas nous écarter de cette règle-là est le difficile. C’est approcher de cette perfection que d’être pondéré chez soi, dans nos actions ordinaires dont nous n’avons de comptes à rendre à personne, qui se font sans que nous les étudiions à l’avance et sans apprêts.—C’est dans cet esprit que Bias traçait son tableau d’une famille modèle, «dont le chef, disait-il, est au dedans par sa propre vertu, ce qu’il est au dehors par la crainte des lois et de l’opinion publique»; et, c’est une parole digne d’être rapportée que celle de Livius Drusus répondant aux ouvriers qui lui offraient de mettre, pour trois mille écus, sa maison à l’abri des vues que ses voisins y avaient: «Je vous en donnerai six mille, si vous faites que partout chacun puisse voir ce qui s’y passe.» Agésilas avait une habitude qui lui faisait honneur: quand il était en voyage, il logeait dans les temples, afin que le peuple et les dieux eux-mêmes fussent témoins incessants de ses faits et gestes.—Tel passe aux yeux du monde pour avoir accompli des miracles, chez lequel ni sa femme, ni son valet de chambre n’ont rien aperçu qui soit même digne de remarque; peu d’hommes ont été un sujet d’admiration pour leurs domestiques; nul n’a été prophète dans sa maison, ni même dans son pays, disent les enseignements de l’histoire. Il en est de même des choses sans importance; et si insignifiant que soit ce qui se passe à mon sujet, c’est exactement ce qui a lieu chez les grands: dans ma province de Gascogne, on trouve drôle de me voir imprimé; et plus ceux qui entendent parler de moi habitent loin de mon manoir, plus ils font cas de moi; en Guyenne il me faut payer mes imprimeurs, ailleurs ce sont eux qui m’achètent.—De ce qu’il en est ainsi, certains, qui de leur vivant et alors qu’ils sont là restent ignorés, espèrent acquérir de la réputation quand ils seront morts et qu’ils ne seront plus; je préfère avoir moins de succès posthumes, et ne me donne au monde que pour ce que je puis en retirer; du reste, je l’en tiens quitte. Celui qu’au retour d’une cérémonie publique, le peuple ébaubi reconduit jusqu’à sa porte, cesse son rôle en quittant la robe qu’il a revêtue pour le jouer et retombe d’autant plus bas que, il y a un instant, il était monté plus haut; chez lui, dans son intérieur, tout est tumultueux et vil.—Alors même que les actions les plus humbles de notre vie privée seraient toujours ordonnées, il faudrait un jugement pénétrant et particulièrement apte pour le constater, d’autant que l’ordre est une vertu sans éclat qui ne provoque pas l’attention. Enlever une brèche, diriger une ambassade, gouverner un peuple, sont des actions qui ressortent; réprimander, rire, vendre, acheter, aimer, haïr, causer avec les siens et avec soi-même et cela toujours doucement, raisonnablement sans jamais ni se négliger, ni se démentir, sont choses plus rares, plus difficiles et moins remarquables. 119 Ceux qui mènent une existence retirée du monde ont en cela à satisfaire, quoi qu’on en dise, à des devoirs aussi pénibles, aussi tendus sinon plus, que ceux qui vivent autrement; et les simples particuliers, dit Aristote, pratiquent la vertu dans des conditions plus difficiles et plus hautes que ne font ceux qui remplissent des charges publiques; c’est par le désir d’arriver à la gloire, plus que par conscience, que nous recherchons les situations élevées.—Le moyen le plus prompt d’acquérir de la gloire devrait être de faire par conscience ce que nous faisons pour la gloire. Le courage même d’Alexandre me semble représenter sur le théâtre où il s’est exercé, une somme d’énergie notablement inférieure à celle qu’il a fallu à Socrate pour pratiquer ses vertus dans le milieu peu élevé et obscur où il a vécu. Je me figure aisément Socrate à la place d’Alexandre, je ne puis m’imaginer Alexandre à la place de Socrate; demandez à celui-là ce qu’il sait faire, il vous dira: «Subjuguer le monde»; posez la même question à celui-ci, il vous dira: «Vivre de la vie humaine dans les conditions que nous a faites la nature»; science bien plus vaste, plus lourde et qui a plus sa raison d’être.
La grandeur d’âme se manifeste surtout chez les hommes de condition sociale médiocre.—Le mérite de l’âme n’est pas de s’élever haut, mais d’aller d’une façon ordonnée; sa grandeur ne se manifeste pas dans la grandeur, mais dans la médiocrité. Ceux qui scrutent ce qui est en dedans de nous et nous jugent d’après ce qu’ils y constatent, ne tiennent pas grand compte de la lueur que peuvent répandre les actes de notre vie publique; ils voient que ce ne sont que de minces filets d’eau, émergeant en gouttelettes d’un fond en somme limoneux et épais; quant à ceux qui nous jugent sur ces apparences brillantes qui s’aperçoivent de dehors, ils concluent qu’intérieurement nous sommes tels; ils ne peuvent accoupler les facultés communes, semblables aux leurs qui sont également en nous, avec ces autres facultés qui les étonnent et sont si loin de ce à quoi ils songent à atteindre. C’est ainsi que nous attribuons aux démons des formes étranges. Qui ne se représente Tamerlan avec des sourcils relevés, de larges narines, un visage affreux, une taille démesurée que notre imagination conçoit tels, d’après le bruit qui s’est fait autour de son nom? Qui m’eût jadis montré Érasme, m’aurait difficilement empêché de voir autre chose que des maximes et des sentences dans tout ce qu’il disait à son domestique et à son hôtesse. Nous nous représentons bien plus un artisan sur sa garde-robe ou sur sa femme, qu’un premier président vénérable par son maintien et ses capacités; il nous semble que de ces trônes si haut placés, on ne s’abaisse pas à daigner vivre. Les âmes vicieuses sont souvent incitées à bien faire par quelque cause étrangère; réciproquement, les âmes vertueuses sont parfois sollicitées au mal; il ne faut donc, par suite, les juger que lorsqu’elles sont dans leur état normal, quand elles sont chez elles, s’il leur arrive quelquefois d’y être, ou, 121 au moins, quand elles sont à peu près au calme et dans leur assiette naturelle.
Ceux qui entreprennent de réformer les mœurs se trompent en croyant y arriver; ils ne parviennent à changer que l’apparence.—Les penchants naturels se développent et se fortifient par l’éducation, mais ne se modifient guère ni ne se surmontent. De mon temps, mille natures ont dévié soit vers la vertu, soit vers le vice, malgré un système d’éducation qui eût dû produire un résultat opposé: «Ainsi les bêtes fauves déshabituées de leurs forêts, semblant s’être adoucies en captivité, dépouillant leur mine farouche, souffrent enfin l’empire de l’homme; mais si, d’aventure, un peu de sang vient à toucher leurs lèvres enflammées, leur rage se réveille, leur gosier en est altéré, elles brûlent de s’en assouvir; et c’est à peine si, dans leur fureur, elles se retiennent de déchirer leur maître pâle de frayeur (Lucain).» On ne déracine pas des qualités originelles, on n’arrive qu’à les dissimuler, à les cacher. Ainsi, la langue latine est comme ma langue maternelle, je la comprends mieux que le français; mais il y a quarante ans que je ne m’en suis plus du tout servi pour parler et guère pour écrire; cependant quand de très fortes émotions se sont emparées subitement de moi, ce qui m’est arrivé deux ou trois fois dans ma vie, dont l’une en voyant mon père, en pleine santé, tomber inanimé dans mes bras, les premières paroles qui me sont échappées du fond du cœur, ont toujours été en latin, la nature se faisant jour par la force même des choses, bien que tenue depuis longtemps à l’écart; et de cela, on cite bien d’autres exemples.
Ceux qui essaient de corriger les mœurs publiques de notre époque en modifiant les idées ayant cours, ne réforment que ce que l’apparence a de vicieux, mais non le fond des choses qui demeure, si même il ne s’aggrave. L’aggravation est à craindre, parce que ces modifications ne portant que sur des questions de forme, laissées à l’appréciation de chacun *, coûtant moins à pratiquer et nous faisant valoir davantage, font qu’on s’abstient de tout autre changement susceptible de concourir à notre amélioration et que, de la sorte, nous pouvons, à bon marché, nous abandonner aux autres vices inhérents à notre nature et que nous recélons à l’état latent. Regardez un peu ce qui se passe dans la réalité: il n’est personne, s’il s’examine, qui ne découvre en soi une disposition qui lui soit propre, disposition maîtresse qui résiste aux effets de l’éducation et aux assauts de toutes les passions contraires à ce penchant dominant.—Pour moi, je n’éprouve guère de ces secousses; je suis presque toujours dans mon assiette naturelle, comme il arrive des corps massifs qui ont du poids; si je ne suis pas en possession de moi-même, je suis toujours bien près d’y être. Mes écarts ne sont jamais considérables, n’ont rien d’excessif ni d’étrange, et mes retours en moi-même sont toujours sérieux et sincères.
Les hommes en général, même dans leur repentir, ne 123 s’amendent pas; s’ils cherchent à être autres, c’est qu’ils espèrent s’en mieux trouver. Pour lui, son jugement a toujours dirigé sa conscience.—Ce qui nous est une véritable condamnation et s’applique à notre manière de faire à tous, c’est que lorsque nous revenons sur nos erreurs, notre repentir même est entaché de corruption et de mauvaises intentions; nous n’avons que confusément l’idée de nous amender, nous éludons la pénitence que nous en faisons, et nous nous y comportons d’une façon à peu près aussi fautive que lorsque nous cédions au péché. Quelques-uns, soit parce que le vice est dans leur nature, soit parce que depuis longtemps il est dans leurs habitudes, n’en saisissent plus la laideur; chez d’autres, du nombre desquels je suis, il leur est à charge, mais mettant en balance le plaisir ou tout autre avantage qu’ils en retirent, ils le supportent ou s’y prêtent, moyennant une transaction qui ne laisse pas d’être encore du vice et de la lâcheté. Cependant on peut concevoir parfois entre le vice et le plaisir qu’il procure une disproportion telle, qu’avec quelque raison elle excuse le péché, comme nous disons d’une faute légère dont nous retirons des avantages importants; et cela, non seulement s’il s’agit de plaisirs accidentels dont on ne jouit que hors du péché, c’est-à-dire qu’après qu’il a été commis, tels que ceux que procure le larcin, mais même de ces plaisirs qu’on ressent à l’instant même où se produit la faute, comme il arrive quand on entre en jouissance de la femme, à laquelle nous induit une tentation violente, quelquefois même irrésistible, dit-on.—J’étais l’autre jour en Armagnac, dans le domaine d’un de mes parents; j’y vis un paysan qu’on désigne par ce surnom: le Larron. Il racontait ainsi son existence: Né de parents adonnés à la mendicité, et trouvant que s’il lui fallait gagner sa vie en travaillant honnêtement, il n’arriverait jamais à se mettre à l’abri de la misère, il s’avisa de se faire voleur, métier qu’il pratiqua durant toute sa jeunesse, sans jamais se compromettre en raison de sa force physique. Il allait moissonner et vendanger les terres d’autrui; mais au loin et sur des étendues telles qu’on ne pouvait supposer qu’un homme seul pût, sur ses épaules, emporter des récoltes en aussi grande quantité en une seule nuit; de plus, il avait soin de répartir sur divers le dommage qu’il commettait, de sorte que les pertes subies étaient de moindre importance pour chacun. Aujourd’hui qu’il est vieux, grâce à ce mode d’opérer qu’il confesse ouvertement, il est riche pour un homme de sa condition. Pour entrer en arrangement avec Dieu au sujet de ces biens mal acquis, il dit, que tous les jours il indemnise par ses bienfaits les successeurs de ceux qu’il a pillés; et que, s’il n’arrive pas à les désintéresser complètement (ce qu’il ne peut faire d’une seule fois), il en chargera ses héritiers, étant seul à même de les renseigner à cet égard, parce que seul il connaît le préjudice causé à chacun. Que cette histoire soit vraie ou fausse, celui qui l’a contée, considère le larcin comme une chose déshonnête et l’a en haine, mais moins encore que l’indigence; il 125 se repent d’une façon générale d’y avoir eu recours, mais étant donnés les avantages qu’il en a retirés et la réparation qu’il y apporte, il ne s’en repent pas. Ce n’est pas là assurément le cas d’habitudes qui font que le vice s’incarne en nous et oblitère notre entendement; ce n’est pas davantage le fait d’un ouragan qui, ébranlant violemment notre âme, la trouble, l’aveugle et, sur le moment, précipite notre jugement et, avec lui, tout notre être, en la puissance du vice.
D’ordinaire, je suis tout entier à ce que je fais et vais tout d’une pièce; je n’ai guère de mouvement qui se dérobe, échappe à ma raison, et qui ne se produise d’accord avec à peu près toutes les parties de moi-même, sans qu’il y ait division ou antagonisme entre elles; mon jugement en porte uniquement la faute ou le mérite, et lorsque, sur un point, il y a erreur de sa part, c’est pour toujours, car depuis presque ma naissance il n’a pas varié; ses penchants, sa voie, sa force sont les mêmes et, sur les questions d’ordre général, dès l’enfance j’ai conçu les opinions que j’ai toujours gardées depuis.—Il y a des péchés impétueux, prompts, subits: ne nous en occupons pas; mais il y en a d’autres qui se reproduisent si souvent en nous, sur lesquels nous délibérons et consultons sans cesse, qui tiennent à notre tempérament, à notre profession, à la charge que nous remplissons, et je ne puis comprendre que ceux-ci nous demeurent si longtemps sans que nous ayons le courage de nous y soustraire, si la raison et la conscience de celui chez lequel ils existent ne voulaient et ne se prêtaient constamment à ce qu’il en soit ainsi; aussi j’imagine et conçois difficilement que le repentir, qu’à un moment donné il prétend ressentir, soit réel. Je ne comprends pas la secte de Pythagore, quand elle dit «que les hommes prennent une âme nouvelle, quand ils approchent des images des dieux pour recueillir leurs oracles», si cela ne signifie «qu’il faut bien que, pour la circonstance, notre âme soit étrangère à elle-même, soit nouvelle, qu’elle nous ait été momentanément prêtée; parce que telle qu’elle est, elle témoigne trop peu qu’elle se soit purifiée et ait atteint le degré de netteté qui convient pour approcher la divinité».
Nous faisons tout l’opposé de ce que prônent les Stoïciens qui, tout en nous ordonnant de corriger les imperfections et les vices que nous reconnaissons en nous, nous défendent de faire que ce soit un sujet de trouble pour le repos de notre âme. Nous, nous cherchons à faire croire que nous en avons un grand regret et que le remords nous dévore intérieurement; mais que nous nous amendions, que nous nous corrigions, que nous interrompions nos progrès dans la mauvaise voie, il n’y paraît pas. Il n’y a de guérison que si on se décharge de son mal; un repentir sincère mis dans un plateau de la balance, l’emporterait aisément sur le péché placé dans l’autre. Je ne vois aucune qualité si aisée à contrefaire que la dévotion, si on n’y conforme ni ses mœurs, ni sa vie; elle est, par essence, cachée et difficile à pénétrer, l’apparence en est facile et produit fort bel effet.
Il ne se repent aucunement de sa vie passée, et les erreurs 127 qu’il a pu commettre, c’est à la fortune et non à son jugement qu’il en impute la faute.—Personnellement, je puis souhaiter, d’une façon générale, être autre que je suis; je puis me condamner et me déplaire dans mon ensemble, supplier Dieu de me modifier du tout au tout et lui demander d’excuser ma faiblesse naturelle; mais, cela, je ne saurais l’appeler du repentir, pas plus que je ne nomme ainsi le déplaisir que j’éprouve de n’être ni un ange, ni un Caton. Mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis et à ma condition; je ne puis faire mieux, et le repentir ne s’applique pas aux choses qui sont au-dessus de nos forces, tout au plus est-ce du regret que nous pouvons en éprouver. J’imagine qu’il existe des natures infiniment plus élevées et mieux ordonnées que la mienne; cela ne fait pas que je puisse perfectionner mes qualités, pas plus que ni mon bras, ni mon esprit n’acquièrent plus de vigueur, parce que j’en conçois qui en aient davantage. Si imaginer et désirer agir plus noblement que nous ne le faisons, avait pour effet que nous nous repentions de ce que nous avons fait, nous aurions à nous repentir de nos actions les plus innocentes, d’autant que nous nous rendons bien compte que chez une nature meilleure que la nôtre, elles eussent été accomplies avec plus de perfection et de dignité, et nous voudrions faire de même. Lorsque, maintenant que j’ai atteint la vieillesse, je réfléchis à la manière dont je me suis comporté dans ma jeunesse, je trouve que je me suis presque toujours conduit avec ordre; selon ce qui m’était possible, j’ai opposé au mal toute la résistance dont j’étais capable. En ceci je ne me flatte pas et, en pareilles circonstances, je serais, encore et toujours, tel que j’ai été; ce n’est pas une tache qui est en moi, c’est mon teint général qui est ainsi. Je ne connais pas de repentir superficiel, mitigé ou de pure cérémonie; pour qu’il y ait repentir, il faut, selon moi, que rien ne demeure hors de son atteinte, qu’il me tenaille les entrailles, les meurtrisse aussi profondément que pénètre le regard de Dieu et que, comme lui, il s’étende à tout mon être.
Pour ce qui est de mes affaires d’intérêt, j’en ai manqué plusieurs de très avantageuses, faute de les avoir bien menées; les réflexions qui les avaient précédées n’ont pourtant jamais cessé d’être justes, eu égard aux circonstances qui se présentaient; du reste, je me résous toujours au parti le plus facile et le plus sûr. En revenant aujourd’hui sur ce passé, je trouve qu’en observant toujours cette règle, j’ai sagement procédé vu l’état de la question sur laquelle j’avais à prononcer et, qu’en pareilles occasions, je ferais de même dans mille ans d’ici; je ne considère pas, bien entendu, ce qui est à l’heure présente, mais ce qui était quand j’ai eu à décider; la valeur d’une décision est toute momentanée, les circonstances et les matières auxquelles elle a trait, allant roulant et se modifiant sans cesse.—J’ai, dans mon existence, commis quelques lourdes erreurs, importantes même, non parce que je n’ai pas vu juste, mais par malchance. Il y a, dans toute affaire que l’on traite, des points cachés que l’on ne peut deviner, particulièrement 129 ceux ayant trait à la nature des hommes; des conditions qui n’apparaissent, ni ne se révèlent, parfois même inconnues de celui chez lequel elles existent, et qui ne s’éveillent et ne surgissent que parce que l’occasion survient. Si ma prudence n’a pu les pénétrer, ni les prophétiser, je ne lui en sais pas mauvais gré; elle a agi dans les limites de ce qui lui incombait. Si l’événement me trahit, s’il favorise la solution que j’ai écartée, il n’y a pas de remède; mais je ne m’en prends pas à moi, j’accuse la fortune et non ce que j’ai fait. Cela, non plus, n’est pas du repentir.
Les conseils sont indépendants des événements. Montaigne en demandait peu et en donnait rarement; une fois l’affaire finie, il ne se tourmentait pas de la suite à laquelle elle avait abouti.—Phocion avait donné aux Athéniens un conseil qui ne fut pas adopté; l’affaire ayant cependant réussi contre ce qu’il en avait pensé, quelqu’un lui dit: «Eh bien, Phocion, es-tu content de voir que cela marche si bien?»—«Je suis content, répondit-il, que les choses aient ainsi tourné, mais je ne me repens pas du conseil que j’ai donné.»—Quand mes amis s’adressent à moi pour avoir un avis, je le leur donne librement, nettement, sans m’inquiéter, comme fait presque tout le monde, de ce que, si la chose est hasardeuse, il peut arriver qu’elle tourne à l’inverse de ce que j’ai cru, et qu’on pourra me reprocher le conseil que j’ai émis; cette éventualité m’importe peu, ceux qui m’en feraient reproche auraient tort et cela ne saurait faire que j’eusse dû leur refuser ce service.
Je n’ai guère à m’en prendre à d’autres qu’à moi, de mes fautes ou de mes infortunes; car, en réalité, je n’ai guère recours aux avis d’autrui, si ce n’est par déférence, ou lorsque j’ai besoin d’être renseigné, n’ayant pas la science, ou une connaissance suffisante du fait. Mais, dans les choses où le jugement seul est en cause, les raisons émises par d’autres peuvent servir à m’affermir dans ma décision, elles ne me font guère revenir dessus; je les écoute toutes avec intérêt et attention; seulement, autant qu’il m’en souvient, je ne m’en suis jamais rapporté jusqu’ici qu’à moi-même. J’estime que ce ne sont que des mouches, des riens qui font vaciller ma volonté; je prise peu mes propres opinions, mais je ne fais pas plus cas de celles des autres. La fortune me le rend bien: si je ne reçois pas de conseils, j’en donne aussi fort peu; on ne m’en demande guère, on les suit moins encore, et je ne connais pas d’affaire publique ou privée que mon avis ait modifiée et remise sur pied. Ceux mêmes que les circonstances ont mis dans le cas de me consulter, se sont d’ordinaire laissé conduire plutôt par d’autres cervelles que par la mienne; et comme je suis aussi jaloux de mon repos que de mon autorité, je préfère qu’il en soit ainsi: en me laissant de côté, on satisfait à mes goûts qui sont de penser à moi-même et de conserver par devers moi le fruit de mes réflexions. J’ai plaisir à me trouver désintéressé des affaires d’autrui et n’en avoir pas de responsabilité.
131
Toute affaire terminée, n’importe de quelle façon, me laisse peu de regrets; l’idée qu’il devait en être ainsi, m’ôte tout souci; la voilà entrée dans le grand courant universel, dans cet enchaînement des causes dont, au dire des Stoïciens, dépendent tous les événements futurs, auquel votre caprice ne peut ni souhaiter ni imaginer la plus petite modification. S’il en était autrement, ce serait le renversement de tout l’ordre de choses dans le passé et dans l’avenir.
On ne saurait appeler repentir les changements que l’âge apporte dans notre manière de voir; la sagesse des vieillards n’est que de l’impuissance, ils raisonnent autrement mais peut-être moins sensément que dans la vigueur de l’âge.—Je hais ce repentir accidentel que l’âge apporte. Je ne suis pas de l’avis de celui qui, dans l’antiquité, disait devoir aux années l’obligation d’être débarrassé de la volupté. Quel que soit le bien que j’en puisse retirer, je ne me résignerai jamais de bonne grâce à l’impuissance qui s’est emparée de moi: «Jamais la Providence ne sera si ennemie de son œuvre, que l’affaiblissement de nos facultés génératrices soit mis au rang des meilleures choses (Quintilien).» Nos désirs sont peu fréquents quand nous sommes arrivés à la vieillesse; une profonde satiété s’empare de nous dès que nous les avons satisfaits; à cela, la conscience n’a rien à voir; l’épuisement et la prostration qui en résultent, nous inspirent une vertu qui n’est que de la fatigue et du catarrhe. Il ne faut pas nous laisser si complètement impressionner par ces altérations qui sont dans l’ordre naturel des choses, que notre jugement en soit atteint. La jeunesse et le plaisir ne m’ont pas empêché jadis de reconnaître le vice sous le masque de la volupté; le manque d’appétit que les ans m’apportent, ne font pas qu’à cette heure je méconnaisse la volupté sous le masque du vice; maintenant que je n’y suis plus intéressé, je juge comme si je l’étais. Moi qui secoue vivement et attentivement ma raison, je trouve qu’elle est la même que lorsque j’étais à un âge où l’on est plus porté à la débauche, avec cette seule différence que peut-être elle s’est affaiblie et est devenue pire en vieillissant; je ne trouve pas que les plaisirs auxquels elle refuse que je me livre aujourd’hui par considération pour la santé de mon corps, elle me les refuserait dans l’intérêt du salut de mon âme plus qu’elle ne l’a fait autrefois. De ce qu’elle est hors de combat, je ne l’en estime pas plus valeureuse pour cela; mes tentations sont si passagères, si atténuées, qu’elles ne valent pas la peine qu’elle s’y oppose; il me suffit aujourd’hui de les écarter d’un signe de la main pour les éconduire. Qu’on la mette en présence de ces désirs ardents qui me possédaient jadis, je craindrais qu’elle ait encore moins de force de résistance qu’autrefois; je ne vois pas qu’elle en juge autrement qu’elle en jugeait alors, ni plus sainement; si donc elle est en voie de guérison, l’amélioration est due en ce qu’elle est en de moins bonnes conditions; quelle misère qu’un tel remède, qui nous fait devoir la santé à la maladie! 133 Ce n’est pas à notre malheur que nous devrions être redevables de ce service, mais au bonheur d’avoir un jugement apte à nous le rendre.—On n’obtient rien de moi par les offenses et les sévices; ils ne font que m’irriter, ce sont procédés bons pour les gens qui ne marchent qu’à coups de fouet. Ma raison s’exerce bien plus librement quand les choses vont à mon gré; elle est bien plus absorbée, préoccupée, lorsqu’il lui faut se résigner au mal que songer au plaisir. Je juge bien mieux, quand je suis en bonne disposition; en santé, je vois les choses sous un jour plus allègre et plus pratique que lorsque je suis malade.—Je me suis mis en règle et me suis réconcilié avec ma conscience le plus que j’ai pu, alors que j’étais encore à même de jouir de cet état réparateur; j’eusse été honteux et jaloux que ma vieillesse, en son état de misère et d’infortune, eût été mieux partagée sous ce rapport que mes bonnes années, alors que j’étais sain, éveillé et vigoureux, et qu’on eût actuellement à me juger, non sur la vie que j’ai menée, mais sur l’état en lequel je suis quand je vais cesser d’être.
A mon avis, le bonheur de l’homme consiste à «vivre heureux»; et non, comme disait Antisthènes, à «mourir heureux». Je n’ai pas attendu d’en être réduit à cette monstruosité d’affubler une tête et un corps d’homme déjà perdu, d’une queue de philosophe, et que le peu de temps qui me reste à végéter fût un désaveu et un démenti de la plus belle, la plus complète et la plus longue partie de ma vie; je veux me présenter et qu’on me voie, à tous égards, sous un jour uniforme. Si j’avais à revivre, je revivrais comme j’ai vécu; je ne regrette pas le passé et ne redoute pas l’avenir; si je ne m’abuse, mes pensées ont toujours été à peu près de pair avec mes actes.—C’est une des principales obligations que je dois à ma bonne fortune, que mon état physique ait toujours répondu à ce que comportaient mes saisons; j’en ai vu l’herbe, les fleurs, le fruit, et j’en vois heureusement la sécheresse; je dis heureusement, parce que c’est dans l’ordre de la nature. Je supporte assez doucement les maux dont je suis affligé, d’autant qu’ils viennent à leur heure, me rendant plus agréable le souvenir de la longue félicité dont j’ai joui dans le passé. Ma sagesse a bien été sensiblement la même à ces diverses époques de ma vie; cependant jadis, bien plus entreprenante, elle avait meilleure grâce, était plus alerte, gaie, naturelle, qu’elle n’est à présent cassée, grondeuse, pénible; je renonce donc à toutes les modifications de circonstance, qui nous coûtent tant, auxquelles nous sommes sollicités sur la fin de nos jours. Que Dieu nous en donne le courage, mais il faut que notre conscience s’amende d’elle-même, par le fait que notre raison prend plus de force et non parce que nos appétits se réduisent; la volupté n’est par elle-même ni pâle, ni décolorée de ce que notre vue affaiblie et trouble nous la fait apercevoir sous cette apparence.
Il faut s’observer dans la vieillesse pour éviter, autant que possible, les imperfections qu’elle apporte avec elle.—On doit aimer la tempérance pour elle-même et par respect pour 135 Dieu qui nous l’a prescrite; il doit en être de même de la chasteté. L’abstinence à laquelle nous obligent les catarrhes quand nous en sommes affligés, et que m’imposent les coliques auxquelles je suis en butte, n’est ni de la chasteté, ni de la tempérance; d’autre part, on ne saurait se vanter de mépriser la volupté et de lui résister, si on ne la voit, si on l’ignore, elle, ses grâces, sa puissance et sa beauté si attrayante; connaissant l’une et l’autre, j’ai qualité pour en parler. Il me semble qu’en la vieillesse, nos âmes sont sujettes à des maladies et à des imperfections plus importunes qu’en la jeunesse; je le disais déjà quand j’étais jeune, on m’objectait alors que je n’avais pas de barbe au menton pour en parler sciemment; je le dis encore aujourd’hui, autorisé cette fois par mes cheveux gris. A ce point de notre existence, nous appelons sagesse nos humeurs chagrines et le dégoût qui s’est emparé de nous; la vérité, c’est que nous n’avons pas tant renoncé au vice que nous n’en avons changé, et, à mon avis, pour faire plus mal. Outre une fierté sotte et caduque, un verbiage ennuyeux, une humeur pointilleuse et insociable, de la superstition, un besoin ridicule de richesses alors que nous n’en avons plus l’usage, la vieillesse fait naître en nous, à ce qu’il me paraît, de plus grandes dispositions à l’envie, à l’injustice et à la malignité; nous lui devons plus encore de rides à l’esprit qu’au visage, et on ne voit pas d’âmes, ou bien peu, qui, en vieillissant, ne sentent l’aigre et le moisi. L’homme grandit et décroît dans toutes ses parties à la fois. A voir la sagesse de Socrate et certaines particularités de sa condamnation, je suis porté à croire qu’il s’y est prêté quelque peu de lui-même; rompant avec ses principes, il a, à dessein, renoncé à se défendre parce que, âgé de soixante-dix ans, il se sentait exposé à voir, d’un moment à l’autre, les allures si riches de son esprit s’engourdir, et sa lucidité habituelle s’affaiblir. Quelles métamorphoses je vois la vieillesse opérer tous les jours chez des personnes de ma connaissance? C’est une maladie puissante qui s’infiltre naturellement en nous, sans que nous nous en apercevions; il faut beaucoup s’y être préparé et prendre de grandes précautions pour éviter la déchéance dont elle nous frappe, ou au moins en retarder les progrès. Je sens que, malgré toute la résistance que je lui oppose, elle gagne peu à peu sur moi; je lutte autant que je puis, mais sans savoir jusqu’où je finirai par être entraîné. Quoi qu’il advienne, je suis satisfait qu’on sache de quelle hauteur je serai tombé.
137
La diversité des occupations est un des caractères principaux de l’âme humaine; le commerce des livres est de ceux qui la distraient.—Il ne faut pas se mettre sous la dépendance exclusive de son humeur et de son tempérament; notre principale supériorité réside dans les diverses applications que nous savons faire de nos facultés. Se tenir attaché, obligé par nécessité à une occupation unique, c’est être, mais ce n’est pas vivre; les âmes les mieux douées sont celles qui ont en elles le plus de variété et de souplesse. Caton l’ancien en est un honorable témoignage: «Il avait l’esprit si flexible et si également propre à toutes choses que, quoi qu’il fît on eût dit qu’il était uniquement né pour cela (Tite Live).»—S’il m’appartenait de me dresser comme je le conçois, il n’est rien, quelque relief que cela puisse donner, que je ne voudrais posséder au point de ne pouvoir m’en détacher. La vie est un mouvement inégal, irrégulier, aux formes multiples. Ce n’est pas être son propre ami, et encore moins son maître, c’est être son esclave que de se suivre sans cesse et de se laisser tellement aller à ses penchants qu’on ne puisse ni s’y soustraire, ni leur faire violence. Je le reconnais à cette heure, parce que je n’arrive pas aisément à échapper aux importunités de mon âme qui ne sait pas d’ordinaire se distraire sans se laisser accaparer: si elle s’occupe à quelque chose, elle s’y applique et s’y donne tout entière; si peu important que soit le sujet sur lequel son attention est appelée, elle le grossit volontiers ou l’étire jusqu’à ce qu’il soit arrivé à valoir qu’elle s’y attache de toutes ses forces; aussi, quand elle est inoccupée, son oisiveté me pèse et affecte même ma santé. La plupart des esprits ont besoin de se reporter sur des sujets étrangers pour se dégourdir et s’exercer; le mien en a plutôt besoin pour se calmer et trouver le repos: «C’est le travail qui fait que nous échappons aux vices de l’oisiveté (Sénèque)», car sa principale et plus laborieuse étude est de s’étudier lui-même. Les livres sont du nombre des occupations qui le distraient de cette étude; aux premières pensées qui lui viennent, il s’agite, les ressorts de sa vigueur jouent en tous sens; c’est pour lui un exercice où il se montre tantôt violent, tantôt pondéré et plein de grâce; et finalement, il se range, se modère et n’en devient que plus fort. Il a en lui de quoi tenir ses facultés en éveil; la nature lui a donné, comme à tous autres, assez de fond pour ce qu’il a à en faire, et les sujets qui se prêtent à ses recherches et à ses appréciations ne lui font pas défaut.
Pour Montaigne, son occupation favorite était de méditer 139 sur lui-même; la lecture ajoutait à ses sujets de méditation; il se plaisait aussi aux conversations sérieuses; les entretiens frivoles étaient pour lui sans intérêt.—Méditer, pour qui sait se tâter et n’hésite pas à tirer parti de ses observations, est une étude de première utilité et qui s’étend à tout, et je préfère façonner mon âme que la meubler. Il n’y a pas d’occupation qui, selon la nature de notre âme, ait moins de valeur, ni qui en ait davantage, que de s’entretenir avec soi-même; les plus grands esprits, «pour lesquels vivre c’est penser (Cicéron)», y ont consacré la meilleure partie de leur temps; aussi la nature y a-t-elle attaché ce privilège, qu’il n’y a rien que nous ne puissions faire si longtemps, et qu’il n’est pas une chose à laquelle nous nous adonnions plus fréquemment et plus facilement. C’est l’occupation des dieux, dit Aristote, de laquelle naissent leur béatitude et la nôtre.
La lecture me sert surtout à me fournir de sujets qui me portent à réfléchir; elle fait travailler mon jugement, mais non ma mémoire. Peu de conversations m’intéressent, dont l’objet n’est pas sérieux et ne prête pas à réfléchir; cependant, je dois avouer que, par sa gentillesse et sa beauté, un sujet peut me retenir et me captiver autant, et même plus, que d’autres graves et sérieux; mais sur tout autre, je ne prête qu’une attention superficielle à tout ce qui se dit autour de moi; je sommeille et il m’arrive souvent dans les conversations de pure convenance, où il n’est question que de choses frivoles et sans importance, soit de répondre, comme si je sortais d’un songe, des bêtises ridicules qu’on n’admettrait même pas de la bouche d’un enfant, soit de garder un silence obstiné encore plus sot et, de plus, impoli. J’ai une façon de rêverie qui fait que je me replie en moi-même; d’autre part, je suis d’une ignorance puérile sur bien des choses que généralement tout le monde sait; ces deux défauts m’ont valu qu’on peut raconter sur moi cinq ou six faits fort exacts, me dépeignant aussi niais que n’importe qui, quel qu’il soit.
Il était peu porté à se lier et apportait beaucoup de circonspection dans les rapports d’amitié qu’engendre la vie journalière; mais, assoiffé d’amitié vraie, il se livrait sans restriction s’il venait à rencontrer quelqu’un répondant à son idéal.—Cette organisation si défectueuse que je viens de signaler, me rend difficile le choix de mes fréquentations, auxquelles il me faut apporter une grande circonspection, et fait que je suis peu propre à m’occuper des questions qui forment le fond de la vie courante. Nous vivons et faisons affaire avec le peuple; si sa conversation nous importune, si nous dédaignons d’entrer en rapport avec les gens de condition infime et sans éducation (et ils ont souvent tout autant de bon sens que les plus clairvoyants), comme toute sagesse qui ne s’accommode pas des propos insignifiants qui se débitent communément manque son effet, il ne faut nous mêler ni de nos propres affaires, ni de celles d’autrui, puisque ce n’est qu’avec eux que se traitent les questions d’intérêt public comme 141 celles d’intérêt privé.—Les allures de l’âme sont d’autant plus belles qu’elles sont moins forcées et plus naturelles; nos meilleures occupations sont celles qui exigent de nous le moins d’efforts. Mon Dieu, que la sagesse rend donc service à ceux dont elle subordonne les désirs au pouvoir qu’ils ont de les réaliser! Il n’y a pas de science plus utile: «Suivant ce qu’on peut» était le refrain et le mot favori de Socrate; mot bien profond! Il faut faire porter nos désirs sur les choses les plus aisées, celles qui sont à notre portée, et les y limiter. N’est-ce pas une sotte idée de ma part de ne pas lier commerce d’amitié avec une foule de gens que le sort a placés dans mon voisinage et dont je ne puis me passer, pour m’en tenir à une personne ou deux qui sont en dehors de mon cercle habituel? ne serait-ce pas là le fait du désir irréalisable que j’ai d’une chose perdue et que je ne puis recouvrer? Ma tolérance de mœurs, ennemie de toute rancune et de rigorisme, a pu aisément me préserver d’exciter l’envie ou l’inimitié; jamais homme n’a donné plus d’occasions, je ne dis pas d’être aimé, mais de n’être pas haï; par contre, la réserve que j’apporte dans mes relations m’a, avec raison, aliéné la bienveillance d’un certain nombre qui sont excusables de l’avoir prise dans un sens qu’elle n’avait pas et en mauvaise part.
Je suis très capable d’acquérir et de conserver des amitiés exquises comme il en existe peu; d’autant que lorsque des liaisons me conviennent, je les recherche comme un affamé; je fais des avances, j’y apporte une telle avidité que je manque rarement de les nouer et de finir par être payé de retour; j’en ai fait souvent l’heureuse expérience. Je suis peu porté aux amitiés banales, telles qu’elles se rencontrent d’ordinaire: elles me laissent froid, car outre qu’il est dans ma nature de ne pas me livrer si je ne me donne tout entier, ma bonne étoile a fait que, dès * ma jeunesse, j’ai été rendu extrêmement délicat sous ce rapport par une amitié unique, mais parfaite, qui, à la vérité, m’a un peu dégoûté des autres, et peut-être trop mis en tête l’idée que, comme dit un ancien, l’amitié s’accommode d’une compagnie restreinte mais non d’une société nombreuse; et puis, j’ai naturellement peine à ne me donner qu’à moitié et sous restriction, en observant cette prudence soupçonneuse, dégradante, qu’on nous recommande de conserver dans les rapports qu’entraînent des amitiés trop étendues et qui n’offrent pas toute garantie, réserve qui est de toute nécessité, surtout en ce temps, où il y a continuellement danger à parler franchement de quelqu’un.
Il est utile de savoir s’entretenir familièrement avec toutes sortes de gens, et il faut savoir se mettre au niveau de ceux avec lesquels on converse.—Aussi je vois bien que celui qui, comme moi, se propose de jouir des commodités de la vie (je veux dire des commodités essentielles), doit fuir comme la peste ces difficultés et délicatesses d’humeur. Je louerais une âme qui serait composée de plusieurs étages et qui, sachant se monter et se démonter, s’adapterait à tout ce avec quoi sa 143 fortune la mettrait en présence; qui pourrait causer avec son voisin de ses constructions, de ses chasses, de ses querelles, s’entretiendrait volontiers avec un charpentier, un jardinier; j’envie ceux qui savent s’accommoder du moindre personnage de leur suite et régler leur conversation de manière à se mettre à sa portée. Je ne suis pas de l’avis de Platon conseillant de toujours parler en maître à ses serviteurs, hommes ou femmes, en bannissant toute plaisanterie, toute familiarité. Outre la raison que j’en ai donnée ci-dessus, il est inhumain et injuste de se prévaloir à ce degré de cette prérogative de la fortune; et les mœurs qui comportent le moins d’inégalité entre les valets et les maîtres, me semblent les plus conformes à l’équité. Il est des personnes qui s’étudient à avoir l’esprit guindé, planant dans les régions élevées; je maintiens le mien à plat dans les régions inférieures; son seul tort est de s’occuper de tout: «Vous me racontez ce qu’ont fait les descendants d’Eaque, et tous les combats livrés sous les murs sacrés d’Ilion; mais vous ne me dites pas combien coûte le vin de Chio, quel esclave doit me préparer mon bain, ni dans quelle maison et à quelle heure je me mettrai à l’abri du froid des montagnes des Abruzzes (Horace).»
De même qu’à la guerre la valeur des Lacédémoniens avait besoin, de peur qu’elle ne tourne à la témérité et à la furie, d’être modérée par le son doux et gracieux des flûtes dans les circonstances où toutes les autres nations emploient des instruments aigus et retentissants et poussent des vociférations pour émouvoir et chauffer à outrance le courage de leurs soldats, ainsi, il me semble, à l’encontre de ce qui est généralement admis que, chez la plupart d’entre nous l’esprit a, dans ses actes, plus besoin de plomb que d’ailes, de calme et de repos que d’ardeur et d’agitation; et, par-dessus tout, j’estime que c’est bien faire le sot, que d’avoir l’air entendu avec des gens qui ne le sont pas, de toujours parler un langage recherché, et «disputer sur la pointe d’une aiguille». Il faut se ranger à la manière d’être de ceux avec qui l’on est, et parfois affecter l’ignorance; dans l’usage courant, mettez de côté la force et la subtilité, il suffit d’être logique; demeurez même terre à terre, si on le veut.
Les savants ont souvent un langage prétentieux, et ce même défaut lui fait fuir les femmes savantes. Que la femme ne se contente-t-elle de ses dons naturels; cependant si elle veut étudier, qu’elle cultive la poésie, l’histoire et ce qui, dans la philosophie, peut l’aider à supporter les peines de la vie.—C’est un défaut dans lequel tombent volontiers les savants que de faire constamment parade de leur science doctorale et semer leurs livres partout; ils en ont, en ces temps-ci, si fort rempli les boudoirs et les oreilles de ces dames que, si elles n’en ont pas retenu le fond, elles en ont du moins adopté la forme: à tout propos, à tout sujet, si peu relevés, si communs qu’ils soient, elles emploient une nouvelle et docte façon d’écrire et de parler: «Crainte, colère, joie, chagrin, tout jusqu’à 145 leurs plus secrètes passions, est exprimé dans ce style; que dirai-je encore? c’est doctement qu’elles se pâment (Juvénal).» Elles citent Platon et saint Thomas pour des choses sur lesquelles le témoignage du premier venu suffirait aussi bien; la doctrine, qui n’a pu pénétrer jusqu’à leur âme, est demeurée dans leur langue. Si celles qui sont convenablement élevées m’en croient, elles se contenteront de faire valoir les richesses naturelles qu’elles ont en propre. Elles cachent et dissimulent leurs beautés sous des beautés étrangères; c’est une grande simplicité d’esprit que d’étouffer sa propre clarté, pour luire d’une lumière empruntée; elles sont comme enterrées et ensevelies sous l’art auquel elles ont recours: «Elles ne sont que fard et parfum (Sénèque)»; c’est qu’elles ne se connaissent pas assez, le monde n’a rien de plus beau; au rebours de ce qui est, c’est à elles à faire honneur aux arts, à donner de l’éclat au fard. De quoi ont-elles besoin? de vivre aimées et honorées; elles n’ont et n’en savent que trop pour réaliser ce but, pour lequel il ne faut qu’éveiller un peu et réchauffer les qualités qui sont en elles. Quand je les vois s’adonner à la rhétorique, à la science judiciaire, à la logique et autres drogueries semblables, si vaines et qui leur sont si inutiles, je me prends à craindre que ceux qui le leur conseillent, ne le fassent que pour avoir, sous ce prétexte, le droit de les régenter; quelle autre excuse, en effet, puis-je leur trouver? C’est assez que, sans nous, elles puissent faire exprimer à leurs regards si gracieux la gaîté, la sévérité, la douceur; accompagner un refus de rudesse, de doute, d’espérance; qu’elles comprennent sans interprète les discours que leur tiennent leurs adorateurs; cette science leur suffit pour qu’elles se fassent obéir à la baguette et gouvernent l’école et ceux qui y professent.
Si cependant elles étaient contrariées de nous céder sur un point quelconque et qu’elles veuillent aussi chercher des distractions dans les livres, la poésie est un passe-temps approprié à leurs besoins; c’est un art folâtre et spirituel où tout est présenté travesti, où l’expression l’emporte sur la pensée, où dominent le désir de plaire et de faire de l’effet tout comme chez elles. L’histoire leur fournit aussi des sujets faits pour les intéresser. En philosophie, de ce qui sert à nous conduire dans la vie, elles prendront les indications qui les mettent à même de juger de nos humeurs et de nos caractères, de se défendre contre nos trahisons, de contenir les témérités de leurs propres désirs, de ménager leur liberté, de prolonger les plaisirs de la vie, de supporter humainement l’inconstance d’un amoureux, la rudesse d’un mari, l’importunité des ans et des rides et autres choses semblables. Voilà la limite extrême de ce que je leur concéderais dans l’étude des sciences.
Montaigne, de caractère ouvert et exubérant, s’isolait volontiers, soit par la pensée au milieu des foules, à la cour par exemple; soit d’une manière effective chez lui, où on était affranchi de toutes les contraintes superflues que la civilité nous impose.—Il y a des natures particulières, 147 renfermées en elles-mêmes; je suis, moi, essentiellement communicatif et exubérant; je suis tout en dehors et, du premier coup d’œil, on me voit tel que je suis, né pour la société et l’amitié. J’aime et prêche la solitude; mais, pour moi, elle consiste surtout à être plus complètement en tête-à-tête avec mes affections et mes pensées; je m’applique non à restreindre l’espace dans lequel je vais et je viens, mais mes désirs et mes soucis, et j’écarte de moi les préoccupations que pourraient me causer les affaires d’autrui, fuyant la servitude et les obligations, qui sont ma mort; ce n’est pas tant le commerce des hommes qui me pèse, que la multiplicité des affaires.—A dire vrai, la solitude, quand elle est occasionnée par un isolement effectif, tend plutôt à me dilater les idées et à faire qu’elles se portent davantage sur les faits extérieurs; quand je suis seul, c’est surtout sur les affaires de l’État et sur celles de l’univers que ma pensée se reporte.—Au Louvre et en nombreuse société, je me replie sur moi-même et m’y cantonne; les foules me font rentrer en moi, et mes tête-à-tête avec moi-même ne portent jamais sur des sujets si folâtres, si licencieux, si personnels, que lorsque je me trouve dans des lieux où le cérémonial prescrit le respect et la prudence. Ce ne sont pas nos folies qui me font rire, mais ce que nous tenons pour être de la sagesse. Par tempérament je ne suis pas ennemi de l’agitation des cours; j’y ai passé une partie de ma vie et suis à même de bien tenir ma place dans la haute société, pourvu que ce ne soit que de temps à autre et quand j’y suis disposé; mais le peu d’attention que je prête à ce dont on parle, me jette forcément dans la solitude.—Chez moi, au milieu de ma famille qui est nombreuse, dans ma maison qui est des plus fréquentées, je vois assez de monde; mais les personnes avec lesquelles j’aime à m’entretenir y sont rares. J’y ai établi, pour moi comme pour les autres, une liberté qui n’existe pas d’ordinaire ailleurs: toute cérémonie en est bannie, on ne va pas au-devant de ceux qui arrivent, on n’accompagne pas ceux qui s’en vont; de même de toutes les autres obligations pénibles que nous impose la courtoisie aux usages si serviles et si importuns! Chacun s’y conduit comme il l’entend, s’entretient à sa guise avec ses pensées seul à seul ou avec qui bon lui semble; j’y demeure muet, rêveur, renfermé, sans que mes hôtes s’en offensent.
Dans le monde, il recherchait la société des gens à l’esprit juste et sage; nature des conversations qu’il avait avec eux. C’est là ce que finalement il appelle son premier commerce.—Les hommes dont je recherche la société et l’intimité sont ceux dont on dit qu’ils sont honnêtes et avisés; ceux que je vois ici, me dégoûtent de tous autres qui ne satisfont pas à ces conditions; à le bien prendre, c’est en effet une catégorie des plus rares et qui est surtout le fait de la nature. Ce que je recherche dans leur fréquentation, c’est uniquement une intimité, une compagnie, des ressources de conversation, un moyen pour l’âme de s’exercer; je n’ai en vue aucun autre bénéfice. Quand je cause 149 avec de pareilles gens, tout sujet m’est bon; peu m’importe qu’il soit sérieux ou frivole, il est toujours opportun et agréable, tout y porte l’empreinte du bon sens et de l’expérience avec un mélange de bonté, de franchise, de gaîté et d’amitié. Ce n’est pas seulement quand on traite ces questions si compliquées de substitution ou les affaires des rois que notre esprit montre sa beauté et sa force, elles se révèlent tout aussi bien dans les entretiens familiers; je me rends compte de la valeur de ceux qui m’entourent même à leur silence, à leur sourire, et les pénètre peut-être mieux à table qu’au conseil; Hippomaque ne disait-il pas qu’il reconnaissait les bons lutteurs rien qu’à les voir marcher dans la rue? S’il plaît à l’érudition de figurer à notre programme, nous ne l’évincerons pas, sous condition que ce ne soit pas sous la forme magistrale, impérieuse et importune qu’elle revêt d’ordinaire, mais modeste et seulement à titre accessoire; nous ne cherchons ici qu’à passer le temps; aux heures consacrées à nous instruire et à être endoctrinés, nous irons la trouver là où elle trône; pour le moment, qu’elle s’abaisse jusqu’à nous s’il lui plaît d’être admise, car, tout utile et désirable qu’elle est, je suppose qu’au besoin nous pourrions bien encore nous en passer complètement et faire sans elle ce que nous nous proposons. Une âme bien élevée, qui est formée à fréquenter la société, se rend pleinement agréable d’elle-même; la science n’est autre chose que le contrôle et le relevé de ce que produisent de telles âmes.
Le commerce avec les femmes vient en second lieu; il a sa douceur, mais aussi ses dangers. Montaigne voudrait que, de part et d’autre, on y apportât de la sincérité; à cet égard l’homme est au-dessous de la brute.—C’est également pour moi un doux commerce que la fréquentation des belles et honnêtes femmes, «car nous aussi avons des yeux qui s’y connaissent (Cicéron)». Si l’âme n’y trouve pas tant de jouissance que dans les relations de société dont il vient d’être question, la satisfaction qu’en éprouvent nos sens, qui y ont plus large part, en est presque l’équivalent, pas tout à fait cependant à mon avis. Mais c’est un commerce où il faut un peu se tenir sur ses gardes, notamment ceux chez qui les appétits charnels sont, comme chez moi, très prononcés. J’y ai été échaudé dans ma jeunesse et en ai souffert toutes les tortures que les poètes disent advenir à ceux qui s’y livrent d’une façon déréglée et déraisonnable; il est vrai que, depuis, ce coup de fouet a servi à mon instruction: «Quiconque de la flotte grecque s’est sauvé d’entre les rochers de Capharée, détourne toujours ses voiles des eaux perfides de l’Eubée (Ovide).» C’est folie d’y attacher toutes ses pensées et de s’y engager d’une affection passionnée et sans limite.—Mais, d’autre part, s’y mêler sans amour pour, comme des comédiens, jouer sans scrupule le rôle que tout le monde joue à cet âge et qui est dans les habitudes, en n’y mettant du sien que des paroles menteuses, c’est à la vérité pourvoir à sa sûreté, mais bien lâchement, comme ferait celui qui, 151 de peur du danger, abandonnerait son honneur ou renoncerait à un profit ou à un plaisir; car il est certain que ceux qui agissent ainsi, ne peuvent rien en espérer qui touche et satisfasse une belle âme. Il ne faut jeter, en pareil cas, son dévolu qu’en parfaite connaissance de cause, si on veut goûter réellement le plaisir de jouir d’une femme que l’on désire, lorsque bien injustement la fortune a favorisé les sentiments hypocrites qu’on lui témoigne, ce qui arrive souvent, car il n’en est pas qui ne se laisse facilement persuader par le premier serment qui lui est fait de la servir. Aucune, en effet, si grossière et si mal élevée qu’elle soit, qui ne s’imagine être très aimable, soit qu’elle ait pour elle son âge, la nuance de sa chevelure ou sa démarche (car il n’y en a pas plus de laides à tous égards, que d’universellement belles), au point que les filles des Brahmines, faute d’autre recommandation, vont se présentant sur la place, à la foule pour ce assemblée par la voix du crieur public, montrant leurs parties matrimoniales, afin que chacun juge si, au moins sous ce rapport, elles ne valent pas qu’un mari s’attache à elles. Cette trahison commune et ordinaire aux hommes de notre époque, amène forcément ce que déjà l’expérience enseigne, c’est que les femmes s’isolent ou se groupent entre elles pour nous fuir, ou, à notre exemple, jouant, elles aussi, leur rôle dans la comédie, se prêtent à ces relations, mais sans y apporter ni passion, ni attentions, ni amour. «Incapables d’attachement, insensibles à celui des autres (Tacite)», elles estiment, selon les principes posés par Lysias dans Platon, qu’elles peuvent se donner à nous avec d’autant plus * d’utilité et d’avantage, que nous les aimons moins; et il arrive alors que, comme au théâtre, le public y a autant et même plus de plaisir que les acteurs. Pour moi, je ne connais pas plus Vénus sans Cupidon qu’une maternité sans progéniture, ce sont choses qui vont ensemble et découlent l’une de l’autre. Au surplus, cette tromperie se retourne contre celui qui la commet; si elle ne lui coûte guère, elle n’aboutit par contre à rien qui vaille. Ceux qui ont fait de Vénus une déesse ont considéré que sa beauté est surtout immatérielle et spirituelle; or la jouissance que cette sorte de gens y cherchent est toute sensuelle, ce n’est pas celle que l’homme devrait se proposer, ce n’est même pas celle de la brute.—Les animaux ne la veulent pas grossière et matérielle à ce point; nous voyons leur imagination et leurs désirs souvent sollicités et surexcités avant leurs organes; qu’ils soient de l’un ou de l’autre sexe, on les voit dans le nombre apporter du choix dans leurs affections, des préférences, et l’attachement qu’ils ont depuis longtemps les uns pour les autres déterminer souvent leur accouplement. Ceux mêmes chez lesquels l’âge a tari la vigueur physique, frémissent encore, hennissent, tressaillent d’amour. Nous les constatons pleins de convoitise et d’ardeur, avant le fait; nous les voyons après, quand le corps n’est plus en action, se complaire encore à ce doux souvenir; il y en a qui, s’en montrant fiers, font entendre des chants 153 de joie et de triomphe et tombent exténués et repus. Qui n’y cherche qu’à se décharger d’une nécessité que nous impose la nature, n’a que faire de la coopération d’autrui et d’y mêler tant d’apprêts; ce n’est pas là un mets destiné à apaiser une faim gloutonne et excessive.
Idée qu’il donne de ses amours; les grâces du corps l’emportent ici sur celles de l’esprit, bien que celles-ci y aient aussi leur prix.—Comme quelqu’un qui ne demande pas qu’on le tienne pour meilleur qu’il n’est, je dirai ici un mot des erreurs de ma jeunesse. Je ne me suis guère adonné aux femmes qui se livrent au premier venu qui les paie, et cela, autant par mépris, qu’en raison du danger qu’y court la santé; si bien que je m’y sois pris, je n’en ai pas moins eu à subir deux atteintes légères à la vérité et de début. J’ai voulu aiguiser ce plaisir par le désir que j’en avais, la difficulté de le satisfaire et aussi la gloire qui devait m’en revenir. J’aimais à la façon de l’empereur Tibère qui, dans ses maîtresses, recherchait autant la modestie, la noblesse, que les autres qualités de la femme; ou encore à la manière de Flora qui ne se prêtait pas à qui n’était au moins dictateur, consul ou censeur, et mettait son amour-propre à n’avoir que des amants de haut rang. Il est certain que les perles et le brocart donnent de la saveur à la chose, de même les titres que l’on porte et le train de vie que l’on mène.
En outre je faisais grand cas de l’esprit, pourvu toutefois que le physique ne laissât pas complètement à désirer; car pour être franc, si l’un ou l’autre de ces deux genres de beauté eût dû nécessairement faire défaut, j’eusse plutôt renoncé à celle de l’esprit. Celui-ci a sa place dans les meilleures choses; mais en amour, où la vue et le toucher prédominent, on arrive quand même à quelque chose sans ses grâces, et à rien sans les charmes physiques. La beauté c’est là le véritable avantage qu’ont les femmes; elle leur appartient d’une façon si exclusive, que celle de l’homme, quoique recherchée avec quelque variante dans les traits, est d’autant plus séduisante que la physionomie encore enfantine et imberbe à une vague ressemblance avec celle de la femme. On dit que chez le Grand Seigneur les adolescents qui, en nombre infini, sont, en raison de leur beauté, attachés à son service, sont congédiés au plus tard quand ils ont vingt-deux ans.—La raison, la prudence, les services que peut rendre l’amitié, se trouvent à un plus haut degré chez les hommes que chez la femme, aussi gouvernent-ils les affaires de ce monde.
Un troisième commerce dont l’homme a la disposition, est celui des livres; c’est le plus sûr, le seul qui ne dépende pas d’autrui; les livres consolent Montaigne dans sa vieillesse et dans la solitude.—Ces deux commerces, l’un avec les hommes par une conversation libre et familière, l’autre avec les femmes par l’amour, sont aléatoires et dépendent d’autrui; l’un a l’inconvénient qu’il ne peut avoir lieu qu’à de trop rares intervalles, l’autre qu’il perd de son agrément avec l’âge; aussi 155 n’eussent-ils pas suffi aux besoins de ma vie. Le commerce des livres, qui est le troisième, est de beaucoup plus certain et plus à nous; il n’a pas les avantages des deux premiers, mais il a pour lui que nous pouvons facilement et à tous moments y avoir recours. Constamment à ma portée durant tout le cours de mon existence, il m’assiste en tous lieux, en toutes circonstances, me console dans la vieillesse et la solitude, me décharge du poids d’une oisiveté ennuyeuse, et me débarrasse, à toute heure, de gens dont la présence me contrarie; il amortit enfin les élancements de la douleur, lorsqu’elle n’est pas trop aiguë, et qu’elle ne l’emporte pas sur tout palliatif. Pour me distraire d’une idée importune, il n’est rien comme de recourir aux livres; ils s’emparent aisément de moi et me la font perdre de vue. Jamais ils ne se blessent de ce que je ne les recherche qu’à défaut des satisfactions plus réelles, plus vives, plus naturelles que procure la fréquentation des hommes et de la femme, et toujours ils me font même figure. Il n’y a pas grand mérite, dit-on, à aller à pied, pour qui mène après lui son cheval par la bride; et notre Jacques, roi de Naples et de Sicile, beau, jeune, bien portant, qui, en voyage, se faisait transporter sur une civière, couché sur un méchant oreiller de plumes, vêtu d’une robe de drap gris, avec un bonnet de même étoffe, suivi, malgré cela, d’une grande pompe royale: litières, chevaux de main de toutes sortes, gentilshommes et officiers, faisait preuve d’une austérité facile à endurer et peu méritoire; le malade qui a la guérison sous la main, n’est pas à plaindre.—C’est dans l’application et l’expérience que j’ai faites de cette maxime, qui est très juste, que consiste tout le fruit que je tire des livres. Je ne m’en sers, en effet, pas beaucoup plus que ceux qui n’en ont pas; j’en jouis comme les avares de leurs trésors, par le seul fait que je sais que je pourrai en jouir quand il me plaira; ce droit de possession suffit à mon âme qui s’en contente. Je ne voyage jamais sans livres, que ce soit en paix ou que ce soit à la guerre; toutefois, il se passera des jours, des mois sans que je m’en serve. Ce sera pour tantôt, dis-je, ou pour demain, ou pour quand cela me conviendra; et le temps s’écoule, passe, sans m’être à charge. Je ne saurais dire combien c’est un repos et un délassement pour moi, que la pensée que je les ai sous la main et puis y prendre plaisir à mon heure; je ne puis reconnaître assez de quel secours ils me sont dans la vie. Ils constituent les meilleures provisions que j’aie pu me procurer, pour ce voyage qu’est la vie de l’homme, et je plains extrêmement les gens intelligents qui en sont privés. J’accepte d’autant mieux tout autre passe-temps qui se présente si léger qu’il soit, que je sais que celui-ci ne peut me faire défaut.
Sa bibliothèque est son lieu de retraite préféré; description qu’il en donne.—Chez moi, je suis assez souvent dans ma bibliothèque, d’où, d’un coup d’œil, je vois tout ce qui se passe dans ma maison. De l’entrée, j’aperçois en contre-bas le jardin, la basse-cour, la cour, et plonge dans la plupart des pièces. A un 157 moment j’y feuillette un livre, puis c’est un autre, et cela sans ordre, sans dessein préconçu, à bâtons rompus. Tantôt j’y rêve, tantôt je prends des notes ou dicte, en me promenant, les rêveries qui sont consignées ici.—Cette bibliothèque est au troisième étage d’une tour. Au premier, est ma chapelle; au second, une chambre et ses dépendances, où je couche souvent quand je veux être seul; au-dessus se trouve une vaste garde-robe. Jadis, ce local était inutilisé; j’y passe la plus grande partie de mes journées et la plupart des heures du jour; je n’y vais jamais la nuit. Lui faisant suite, se trouve un cabinet assez bien décoré, où l’on peut faire du feu l’hiver et d’où l’on a une jolie vue; et, si je ne redoutais autant l’embarras que la dépense résultant du travail que cela nécessiterait et durant lequel je ne pourrais me livrer à aucune occupation, je pourrais facilement construire de chaque côté et y attenant une galerie de cent pas de long sur douze de large, qui serait de plain-pied; les murs de soutènement existent et ont la hauteur voulue, élevés qu’ils ont été dans un autre but. Tout lieu dont on veut faire un lieu de retraite, doit avoir un promenoir; mes pensées sommeillent quand je suis assis; mon esprit ne marche pas seul, il semble qu’il faille que mes jambes lui communiquent leur mouvement; et ceux qui étudient sans le secours des livres, en sont tous là.—La pièce, sauf dans la partie où se trouvent ma table et mon siège et où la paroi est en ligne droite, est de forme circulaire, ce qui me permet d’apercevoir tous mes livres disposés tout autour, sur cinq rangées de tablettes; il s’y trouve trois fenêtres d’où l’on a une vue belle et étendue; l’espace demeuré libre a seize pas de diamètre. En hiver, j’y suis moins continuellement, parce que ma maison est, comme l’indique son nom, juchée sur un tertre et que, de toutes ses pièces, celle-ci est la plus éventée; qu’en outre, elle est éloignée et d’accès un peu pénible, ce qui me plaît assez, tant par l’exercice auquel cela m’astreint que parce que cela me délivre de l’importunité des gens. C’est là mon repaire; j’essaie de faire que ce coin soit mon domaine exclusif et demeure en dehors de toute communauté avec ma femme, ma fille et n’importe quels autres; partout ailleurs, j’ai bien autorité, mais elle est plus nominale que réelle et plus vague que directe. Bien misérable, en effet, à mon sens, celui qui, chez soi, n’a pas où être chez soi, où ne songer qu’à soi, où se cacher! L’ambition fait payer cher ses faveurs à ses esclaves, en les mettant toujours en évidence, comme une statue sur un champ de foire: «Une grande situation est une grande servitude (Sénèque)»; ils n’ont nulle part où s’isoler, pas même dans leur cabinet d’aisances. Je ne trouve rien de si pénible dans la vie austère qu’embrassent les religieux que cette règle, que je vois se pratiquer dans certaines congrégations, d’être perpétuellement réunis dans un même local, formant ainsi une nombreuse assistance constamment témoin des actes de chacun; je trouve en quelque sorte plus supportable d’être toujours seul, que de ne pouvoir l’être jamais.
159
Les Muses sont le délassement de l’esprit. Dans sa jeunesse, Montaigne étudiait pour briller; depuis l’âge mûr, pour devenir plus sage; devenu vieux, il étudie pour se distraire.—Quelqu’un qui me dirait que c’est avilir les Muses que de ne s’en servir que comme jouet et comme passe-temps, ignorerait ce que valent ce plaisir, ce jeu, ce passe-temps que j’apprécie si bien, que peu s’en faut que je ne dise qu’il est ridicule de s’en proposer autre chose. Je vis au jour le jour, et, ne vous en déplaise, ne vis que pour moi et n’aspire à rien de plus. Quand j’étais jeune, j’étudiais pour briller; plus tard, un peu pour gagner en sagesse; maintenant, je le fais pour me distraire; jamais cela n’a été pour en retirer profit. Cédant à un sentiment bien frivole, j’ai beaucoup dépensé pour mes livres, non seulement pour pourvoir à mes besoins, mais, par surcroît, pour satisfaire ma vanité et me donner le luxe d’augmenter les volumes de ma bibliothèque; il y a longtemps que cela ne m’est plus arrivé.
Le commerce des livres a, lui aussi, ses inconvénients; il n’exerce pas le corps et, de ce fait, est, dans la vieillesse surtout, préjudiciable à la santé.—Les livres sont, sous bien des rapports, d’un bien grand agrément pour qui sait les choisir; mais il n’est pas de bien sans peine, et le plaisir qu’ils procurent n’est pas plus que les autres net et pur. Il a ses inconvénients et des inconvénients très sérieux: l’âme s’y exerce, mais, pendant ce temps, le corps, dont il ne faut pas oublier les soins qu’il réclame, demeure inactif, ce qui amène en lui de l’abattement et de la tristesse. Je ne connais pas d’excès qui, au déclin de la vie, me soit plus préjudiciable et que je doive plus éviter.
Ce sont là mes trois occupations favorites, d’entre celles que je pratique le plus, indépendamment des obligations que me créent vis-à-vis du monde mes devoirs civiques et de société.
C’est par la diversion que l’on peut arriver à calmer les plus vives douleurs; on console mal par le raisonnement.—J’ai été autrefois chargé de consoler une dame qui était dans une réelle affliction; * car la plupart des deuils chez les personnes de ce sexe ne sont pas naturels, c’est surtout affaire de cérémonie: «Une femme a toujours des larmes toutes prêtes qui, sur commande, coulent en abondance (Juvénal).» On ne s’y prend pas bien en cherchant à les arrêter dans ces manifestations, car toute opposition 161 les excite et les porte davantage encore à la tristesse; on exaspère le mal par la jalousie qu’il ressent d’être contrecarré. Chaque jour, dans nos conversations, lorsque ce que nous avons dit sans y mettre d’importance vient à être contesté, ne nous arrive-t-il pas de nous en formaliser et de nous y attacher alors souvent beaucoup plus qu’à ce qui serait pour nous d’un réel intérêt? Et puis, en allant ainsi directement au but, en vous opposant franchement à leur tristesse, votre entrée en matière est brutale, tandis que les premiers rapports du médecin avec son patient doivent être gracieux, gais, agréables; jamais docteur laid et rechigné n’a réussi. Il faut, au contraire, dès l’abord, aider et provoquer leurs épanchements, témoigner qu’on approuve leur douleur et qu’on l’excuse. Cette complicité vous fait gagner qu’on vous accorde de passer outre et, par trahison facile et insensible, vous arrivez à faire entendre des paroles plus fermes, propres à amener à guérison.—En la circonstance, désireux de surprendre, par mon savoir-faire, l’assistance qui avait les yeux sur moi, je m’avisai de combattre le mal à visage découvert. Je reconnus bientôt, par l’effet produit, que je m’y étais mal pris et que je n’arriverais pas à persuader; mes raisonnements sont d’habitude trop incisifs et pas assez insinuants, j’agis ou trop brusquement ou avec pas assez d’énergie. Aussi, après quelques moments employés à calmer sa peine, je n’essayai pas de l’en guérir par de fortes et impressionnantes raisons, parce que je n’en trouvais pas et que je pensais produire plus sûrement mon effet d’autre façon. Ce ne fut pas non plus en faisant un choix parmi les moyens divers de consolation que la philosophie met à notre disposition, tels que: «Ce dont on gémit n’est pas un mal», comme dit Cléanthe; ou selon les Péripatéticiens, «n’est qu’un mal léger»; ou encore, d’après Chrysippe: «La plainte n’est chose ni juste, ni légitime». Je ne suivis pas davantage le conseil d’Épicure consistant à reporter sa pensée des choses attristantes sur d’autres qui vous distraient, ce qui pourtant rentre assez dans ma manière de faire. Laissant de côté ces divers procédés que Cicéron recommande de mettre en jeu à propos, je fis dévier insensiblement la conversation, l’infléchissant peu à peu vers des sujets qui s’y rattachaient, puis, au fur et à mesure que mon interlocutrice se confiait davantage en moi, sur d’autres qui avaient de moins en moins de rapport avec son chagrin, je l’arrachai sans qu’elle s’en doutât à ses pensées douloureuses et l’amenai à retrouver du calme et à faire bonne contenance tout le temps que je demeurai; en un mot, je créai une diversion. Ceux qui, après moi, s’employèrent à consoler cette dame, n’en furent pas plus avancés parce que ce n’était pas à la racine du mal que j’avais porté la cognée.
A la guerre, les diversions se pratiquent utilement pour éloigner d’un pays un ennemi qui l’a envahi et pour gagner du temps.—Ailleurs, dans le cours de mon livre, j’ai eu 163 occasion de citer des diversions intervenues dans des affaires publiques; il en est fait fréquemment usage à la guerre, ainsi que le relate l’histoire, à l’instar de Périclès dans la guerre du Péloponèse et de mille autres, pour éloigner d’un pays les forces ennemies qui l’ont envahi.—Ce fut un ingénieux artifice que celui auquel eut recours, à Liège, le sieur d’Himbercourt qui lui dut son salut, lui et quelques autres envoyés avec lui dans cette ville, qu’assiégeait le duc de Bourgogne, pour veiller à l’exécution des conditions de capitulation de la place qui s’était rendue. Le peuple, convoqué durant la nuit pour cette mise à exécution, commença à s’ameuter contre les conventions passées, et plusieurs proposèrent de courir sus aux négociateurs qu’ils tenaient en leur pouvoir. Au premier avis qu’il eut de l’approche des premières bandes de ces gens se ruant sur son logis, le sieur d’Himbercourt leur dépêcha immédiatement deux habitants de la ville (il en avait quelques-uns près de lui), chargés de faire au conseil qui représentait la population, de nouvelles offres moins rigoureuses, qu’il avait sur-le-champ imaginées pour parer à la difficulté de la situation. Ces deux messagers arrêtèrent le flot des manifestants malgré leur exaspération, et les ramenèrent à l’hôtel de ville pour entendre les propositions qu’ils apportaient et en délibérer. La délibération fut courte, et une foule tumultueuse, aussi animée que la première fois, se porta derechef sur la demeure de l’envoyé du duc. D’Himbercourt lui détacha aussitôt quatre nouveaux entremetteurs qui, protestant auprès de ceux qui tenaient la tête du mouvement que, pour le coup, ils sont porteurs de propositions beaucoup plus avantageuses qui leur donneront pleine et entière satisfaction, parviennent, par leurs assurances, à leur faire rebrousser chemin et à se reporter où les meneurs tenaient conseil; de la sorte, amusant le peuple par ces temporisations, variant, par ces vaines consultations auxquelles il le conviait, le cours de sa furie, le négociateur parvint à l’endormir et à gagner le jour, ce qui était pour lui le point capital.
Cet autre conte est du même genre: Atalante, demoiselle d’une beauté parfaite et d’une merveilleuse légèreté à la course, consentit, pour se défaire des nombreux prétendants qui la demandaient en mariage, à épouser celui qui l’égalerait en vitesse, sous condition que ceux qui seraient vaincus, perdraient la vie. Il s’en trouva quelques-uns qui, jugeant que le prix valait d’en courir les risques, furent victimes de ce cruel marché. Quand, après eux, vint pour Hippomène le moment de tenter l’épreuve, il s’adressa à la déesse qui lui inspirait cet ardent amour, l’appelant à son secours; celle-ci, exauçant sa prière, lui remit trois pommes d’or en lui faisant connaître l’usage à en faire. Une fois en lice, quand Hippomène sent sa maîtresse sur le point de l’atteindre, il laisse, comme par mégarde, échapper une de ses pommes; Atalante, intéressée par la beauté de ce fruit, ne manque pas de se détourner de sa course pour le ramasser: «Surprise, charmée par la beauté de cette pomme, la vierge ralentit son allure pour saisir cet or qui roule à ses 165 pieds (Ovide).» Il agit de même au moment opportun avec la seconde, puis avec la troisième, si bien que par ce subterfuge et cette diversion, l’avantage de la course lui demeure.
C’est aussi un excellent remède contre les maladies de l’âme; par elle, on rend moins amers nos derniers moments. Socrate est le seul qui, dans l’attente de la mort, sans cesser de s’en entretenir, ait constamment, durant un long espace de temps, conservé la plus parfaite sérénité.—Quand les médecins ne peuvent nous débarrasser d’un catarrhe, ils le font dévier et se porter sur une partie de notre être où son action soit moins dangereuse. Je constate que c’est également le remède le plus communément appliqué aux maladies de l’âme: «Il est bon parfois de détourner l’âme vers d’autres goûts, d’autres soins, d’autres occupations; souvent il faut essayer de la guérir par un changement de lieu, comme les malades qui ne sauraient autrement recouvrer la santé (Cicéron).» On arrive rarement à triompher des maux auxquels elle est en proie, en les attaquant directement; on ne parvient ainsi ni à aider sa force de résistance ni à diminuer celle du mal, mais on peut le faire dévier et le transformer.
Socrate nous donne sur la manière d’envisager les accidents de la vie, une autre leçon, mais si haute, d’application si difficile, qu’il n’appartient qu’aux esprits les plus éminents d’avoir possibilité d’y arrêter leur pensée, de la méditer et de l’apprécier. Il est le seul chez lequel l’attente de la mort n’altère en rien l’humeur ordinaire; il se familiarise avec cette idée et s’en fait un jeu; il ne cherche pas de consolation en dehors d’elle: mourir lui apparaît un accident naturel qui le laisse indifférent; il y arrête sa pensée et s’y résout sans autre préoccupation.—Les disciples d’Hégésias, exaltés par les beaux raisonnements qu’il leur inculque, se donnent la mort en se laissant mourir de faim; et ils sont si nombreux ceux qui agissent ainsi, que le roi Ptolémée fait défendre à leur maître de prôner désormais dans son école un enseignement qui pousse au suicide. Ces gens-là ne considéraient pas la mort en elle-même, ils ne s’en occupaient pas; ce n’est pas sur elle que leur pensée se reportait: ils rêvaient une transformation de leur être, et avaient hâte qu’elle se réalisât.
Chez les condamnés à mort la dévotion devient une diversion à leur terreur.—Ces malheureux, près d’être exécutés, qu’on voit sur l’échafaud, pénétrés d’une ardente dévotion qui s’est emparée de tous leurs sens et à laquelle ils apportent toute la ferveur possible, prêtant l’oreille aux instructions qu’on leur donne, les yeux levés et les mains tendues vers le ciel, récitant des prières à haute voix avec une émotion vive et continue, font là une chose certainement digne d’éloge et appropriée aux circonstances; ils sont à louer au point de vue de la religion, mais non, à proprement parler, sous celui de la fermeté. Ils fuient la lutte, évitent de regarder la mort en face, comme les enfants qu’on distrait quand on veut leur donner un coup de lancette. J’en ai vu qui, lorsque 167 leur vue tombait sur les horribles apprêts de leur supplice, en étaient terrifiés et reportaient, en quelque sorte avec furie, leur pensée vers autre chose. Ne recommande-t-on pas à ceux qui ont à franchir un vide, de profondeur telle qu’on peut en éprouver de l’effroi, de fermer et de détourner les yeux?
Fermeté, lors de son exécution, de Subrius Flavius condamné à mort.—Subrius Flavius devait, sur l’ordre de Néron, être décapité de la main même de Niger, comme lui officier de l’armée romaine. Amené sur le terrain où devait avoir lieu l’exécution et où Niger avait fait creuser la fosse où devait être inhumée sa victime, fosse qui avait été faite sans soin et sans régularité, Flavius se tournant vers les soldats qui étaient là, leur dit: «Ce n’est pas là un travail tel que le comporte une bonne discipline.» Puis, s’adressant à Niger qui l’exhortait à tenir la tête ferme: «Puisses-tu seulement frapper avec la même fermeté!» Et ses pressentiments étaient fondés, car Niger, dont le bras tremblait, dut s’y reprendre à plusieurs fois. Ce Flavius semble avoir envisagé son sort sans en être autrement ému, et sa pensée ne pas s’en être un instant détournée.
Dans une bataille, dans un duel, l’idée de la mort est absente de la pensée des combattants.—Celui qui meurt dans la mêlée les armes à la main, ne songe pas à la mort, il ne la pressent pas et ne s’en préoccupe pas; l’ardeur du combat le tient tout entier.—Une personne de ma connaissance, d’un courage incontestable, se battant en duel en champ clos, tomba, et, étant à terre, fut criblé par son adversaire de neuf à dix coups de dague. Les assistants, le croyant perdu, lui criaient de recommander son âme à Dieu; mais, il me l’a dit depuis, bien que ces voix parvinssent à son oreille, elles furent sans effet sur lui: il ne pensait qu’à se tirer d’affaire et à se venger, et le combat se termina par la mort de l’autre.—Celui qui notifia à L. Silanus son arrêt de mort, lui rendit un grand service; l’entendant lui répondre qu’«il s’attendait bien à mourir, mais non de la main de scélérats», il se rua sur lui avec ses soldats, pour l’obliger à se rétracter. Silanus, quoique désarmé, se défendit obstinément à coups de poing et à coups de pied et fut tué dans le cours de la bagarre. Par le fait de la violente colère qui s’était emparée de lui, il échappa à l’oppression douloureuse que lui auraient causée l’attente de la mort lente à laquelle il était réservé et la vue des préparatifs.
Dans les plus cruelles calamités, en face de la mort, nombre de considérations se présentent à notre esprit, l’occupent, le distraient et rendent notre situation moins pénible.—Notre pensée est toujours ailleurs; c’est, soit l’espérance d’une vie meilleure qui nous arrête et nous soutient, soit l’espoir des avantages qui peuvent en revenir à nos enfants, soit la gloire qu’en acquerra notre nom dans l’avenir, ou encore l’idée que nous allons être affranchis des maux de cette vie, ou celle de la vengeance qui attend ceux qui sont cause de notre mort: «S’il 169 est des dieux justes, j’espère que tu trouveras ton supplice sur les écueils et qu’en expirant, tu invoqueras le nom de Didon; je le saurai, le bruit en viendra jusqu’à moi dans le séjour des Mânes (Virgile).»
Xénophon, couronné de fleurs, offrait un sacrifice, quand on vint lui annoncer la mort de son fils Gryllus, tombé à la bataille de Mantinée. Aux premiers mots de cette nouvelle, il jeta sa couronne à terre; mais quand, poursuivant, on lui apprit de quelle valeur il avait fait preuve en succombant, il la ramassa et la remit sur sa tête.—Jusqu’à Épicure qui se console de sa fin prochaine, en songeant à l’utilité de ses écrits qu’il espère voir passer à l’éternité: «Tous les travaux qui ont de l’éclat et sont susceptibles de nous illustrer, sont faciles à supporter (Cicéron).»—Une même blessure, une même fatigue, dit Xénophon, ne sont pas de même poids pour un général et pour un soldat. Épaminondas se résigne bien plus allègrement à la mort, quand il sait qu’il a remporté la victoire: «c’est là ce qui console, ce qui adoucit les plus grandes douleurs (Cicéron)»; nombre d’autres circonstances nous amusent, nous distraient et nous détournent de l’attention que nous serions tentés de prêter à la chose elle-même. Aussi les arguments de la philosophie vont-ils continuellement côtoyant, contournant ce sujet; s’ils l’entament, ce n’est que superficiellement.—Le grand Zénon, chef de cette école philosophique des Stoïciens qui domine toutes les autres par l’élévation de sa doctrine, disait en parlant de la mort: «Aucun mal n’est honorable; la mort est honorable, donc elle n’est pas un mal.» Contre l’ivrognerie, il s’exprimait ainsi: «Nul ne confie son secret à l’ivrogne, tout le monde le confie au sage; le sage ne sera donc pas un ivrogne.» Est-ce là aller droit au but, n’est-ce pas biaiser? J’aime voir ces âmes d’élite ne pouvoir se dégager de nos errements; si parfaits qu’ils soient comme hommes, ce ne sont toujours que des hommes et ils en ont toutes les faiblesses.
Moyen de dissiper un ardent désir de vengeance.—La vengeance est une douce passion qui est naturelle à l’homme et a sur nous un grand empire; je m’en rends bien compte quoique n’en ayant pas fait l’expérience. Dernièrement, pour en détourner un jeune prince, je ne lui dis pas, suivant le précepte de la charité, qu’à celui qui vous a frappé sur une joue il faut tendre l’autre; je ne lui représentai pas davantage les conséquences tragiques que la poésie attribue à cette passion. N’en prononçant même pas le nom, je me mis à lui faire goûter la beauté des sentiments contraires: l’honneur, la popularité, l’affection qu’il acquerrait en se montrant bon et clément; je fis une diversion en mettant en éveil son ambition. C’est ainsi qu’il faut procéder.
C’est encore par la diversion qu’on se guérit de l’amour et de toute autre passion; le temps, qui calme tout, agit de la même façon.—Si en amour l’affection risque de vous entraîner au delà de ce qui doit être, c’est là, dit-on, une disposition qui est à combattre par une diversion. Et l’on dit vrai; je l’ai souvent 171 essayé avec succès. Rompez-en la violence, en diversifiant vos désirs; même, il n’y a pas inconvénient à ce que, si vous le voulez, l’un d’eux prime et domine les autres, toutefois de peur qu’il ne vienne à vous absorber et à vous tyranniser, affaiblissez-le, amortissez-le, en ne lui consacrant pas une attention exclusive et multipliant vos distractions: «Lorsque vous êtes tourmenté par de trop ardents désirs (Perse), assouvissez-les sur le premier objet qui s’offre (Lucrèce)»; seulement pourvoyez-y de bonne heure, de peur que vous n’ayez peine à recouvrer votre liberté une fois qu’il se sera emparé de vous, «qu’à de premières blessures vous n’ajoutiez de nouveaux coups, que de nouvelles émotions n’effacent les anciennes (Lucrèce)».
J’ai éprouvé jadis, en raison de ma nature impressionnable, un violent chagrin, plus justifié encore qu’il n’était violent; j’en eusse peut-être été accablé, si je m’étais uniquement fié à mes propres forces. Une diversion énergique était indispensable pour m’en distraire: je me fis amoureux par calcul, en même temps que pour me livrer à une étude de ce sentiment; mon âge du reste s’y prêtait, et l’amour me soulagea me délivrant du mal que l’amitié m’avait causé.—Il en est de même pour tout; dès qu’une idée pénible me tient, je trouve plus simple de changer le cours de mes pensées, plutôt que d’essayer de la surmonter; je lui substitue une idée contraire si je puis, ou tout au moins une qui soit autre; toujours le changement me soulage, dissout et dissipe l’idée qui m’oppresse. Si je ne puis la combattre, je lui échappe, et, tout en fuyant, je cherche à l’égarer et ruse avec elle; je change de lieu, d’occupation, de compagnie, j’accumule pour me sauver les amusements, les sujets de méditation, pour faire qu’elle perde ma trace et m’abandonne.
La nature procède de même, elle met notre versatilité à profit; c’est par là qu’agit surtout le temps qu’elle nous a donné comme souverain remède à nos passions; en alimentant encore et encore notre imagination d’affaires de toutes sortes, il désagrège et altère l’impression première si forte qu’elle soit. Un sage ne songe guère moins à son ami mort depuis vingt-cinq ans, que s’il n’y avait qu’un an; d’après Épicure, son impression demeure celle des premiers jours; il n’estimait pas, en effet, que les sensations pénibles soient atténuées ni parce qu’elles ont été prévues, ni par le long temps auquel elles remontent; mais tant d’autres pensées s’entremêlent aux premières, que celles-ci perdent leur acuité et finissent par se lasser.
De même, en détournant l’attention, on fait tomber un bruit public qui vous offense.—Pour détourner de lui l’attention publique, Alcibiade coupe les oreilles et la queue à un beau chien qu’il possède et le chasse par les rues de la ville, afin que la foule, ayant là sujet de babiller, ne s’occupe pas de ses autres faits et gestes.—J’ai connu aussi des femmes qui, dans le but de détourner d’elles les conversations et les suppositions des gens et désorienter 173 les bavards, cachaient leurs véritables affections sous d’autres simulées. J’en ai vu une qui, cherchant à donner le change à l’opinion, s’est laissé prendre pour tout de bon, rompant avec le sentiment qu’elle éprouvait réellement au début, pour suivre celui qui tout d’abord était feint. J’ai appris de la sorte, par cet exemple, que ceux que ces dames favorisent sont bien sots de consentir à de telles supercheries; il faudrait vraiment que celui qui s’entremet ainsi pour vous servir et auquel sont réservés bon accueil et entretiens intimes en public, soit bien maladroit pour ne pas finir par prendre votre place et vous envoyer à la sienne. C’est ce qui vulgairement s’appelle tailler et coudre un soulier pour qu’un autre le chausse.
Un rien suffit pour attirer et détourner notre esprit; en présence même de la mort les objets les plus frivoles entretiennent en nous le regret de la vie.—Il faut peu de chose pour nous distraire et détourner notre attention parce que peu de chose nous captive. Nous n’envisageons guère les choses dans leur ensemble et dégagées de toute considération étrangère; ce qui nous frappe, ce sont des circonstances ou des détails de peu d’importance et tout superficiels, et la forme, si frivole soit-elle, l’emporte sur le fond, «comme ces enveloppes légères dont les cigales se dépouillent en été (Lucrèce)». Ce qui rappelle à Plutarque sa fille regrettée, ce sont ses espiègleries quand elle était enfant. Le souvenir d’un adieu, d’un fait, d’un geste gracieux, d’une recommandation dernière nous afflige. La robe de César promenée dans Rome troubla la ville entière plus que sa mort ne l’avait fait. Il en est de même de ces expressions qui nous tintent sans cesse aux oreilles: «Mon pauvre maître!» ou «Mon grand ami!» «Hélas, mon père chéri!» «Ma bonne fille!» Quand j’entends ces banalités et que j’y regarde de près, je trouve que ce sont tout simplement des plaintes tirées d’un vocabulaire, * des sons sans signification réelle dont les termes et le ton me blessent; ils me rappellent les exclamations des prédicateurs qui souvent par là émeuvent leur auditoire, plus que par les raisons qu’ils exposent; ou encore l’impression que nous cause la voix plaintive des bêtes que l’on tue pour notre service. Sans que j’analyse ni développe la cause véritable et générale de cet effet, «c’est ainsi que la douleur s’excite d’elle-même (Lucrèce)», c’est surtout par là que nous manifestons notre deuil.
La persistance des graviers que je rends, m’a parfois occasionné, particulièrement quand ils séjournent dans la verge, des rétentions d’urine de longue durée, de trois et quatre jours, me faisant courir risque de la mort, au point que c’eût été folie de penser l’éviter, et même de désirer qu’elle ne vînt pas, tant sont cruelles les souffrances que cet état m’occasionne. Oh! que ce bon empereur, qui faisait lier l’extrémité de la verge aux criminels, pour les faire mourir faute de pouvoir uriner, était passé maître en la science du bourreau! En étant là, je considérais par combien de causes légères, d’objets futiles mon imagination faisait naître en moi le 175 regret de quitter la vie; quels riens créaient en mon âme de la difficulté et donnaient de l’importance à ce déménagement; à combien de frivolités je songeais à un moment si sérieux: un chien, un cheval, un livre, un verre, tout en vérité, étaient pour moi des sujets de préoccupation, pour le cas où je disparaîtrais; chez d’autres, ce sont d’ambitieuses espérances, leur bourse, leur science qui les préoccupent non moins sottement à mon avis. Je vois la mort avec indifférence quand je la considère comme, d’après une loi universelle, le point auquel aboutit fatalement la vie. Je la brave d’une façon générale, mais en détail je suis moins résolu; les larmes d’un laquais, la distribution de ma défroque, une connaissance qui me serre la main, une consolation banale me désolent et m’attendrissent. C’est le même trouble que nous causent les plaintes que nous lisons dans les récits fabuleux, où les regrets de Didon et d’Ariane, décrits dans Virgile et dans Catulle, passionnent ceux mêmes qui n’y croient pas. C’est le fait d’une nature obstinée et dure de n’en ressentir aucune émotion, ce qui, chose extraordinaire, était, dit-on, le cas de Polémon; mais ne dit-on pas aussi de lui qu’un chien enragé le mordant, put lui emporter tout le gras du mollet sans que son visage pâlit. Nulle sagesse n’est parvenue à concevoir la cause de la tristesse si vive, si complète que notre imagination peut faire naître en nous, alors que n’y parvient pas la réalité quand bien même y ont part les yeux et les oreilles, organes que n’impressionnent cependant pas des accidents imaginaires.
Souvent l’orateur et le comédien arrivent à ressentir en réalité les sentiments qu’ils cherchent à communiquer à leur auditoire.—C’est sans doute la raison qui fait que les arts eux-mêmes usent et mettent à profit notre faiblesse et notre bêtise naturelles. L’orateur, est-il professé dans les écoles de rhétorique, devra, dans cette farce qu’est un plaidoyer, s’émouvoir au son de sa propre voix et sous l’effet de l’agitation à laquelle il semblera en proie; il se laissera tromper par la passion qu’il dépeint dans cette comédie qu’il joue, se donnera toutes les apparences d’un deuil vrai et sincère pour communiquer ces sentiments aux juges que cela touche moins encore, comme il advient chez ces personnes qu’on loue pour assister aux cérémonies mortuaires et donner plus d’apparat aux funérailles, qui vendent leurs larmes et leur tristesse dans la mesure où on les leur achète et chez lesquelles il en est qui, tout en réglant leur émotion suivant ce qui est de convention, en arrivent, par l’habitude et la contenance qu’elles prennent, à se pénétrer tellement de leur rôle qu’une mélancolie réelle finit par les gagner.—Étant allé, avec quelques autres de ses amis, conduire à Soissons le corps de M. de Grammont qui avait été tué au siège de la Fère, je remarquai que, partout où nous passions, les gens que nous rencontrions se lamentaient et pleuraient à la seule vue du convoi que nous formions, car ils ne connaissaient même pas le nom du trépassé.—Quintilien raconte avoir vu des comédiens 177 si fort entrés dans un rôle de deuil, qu’ils en pleuraient encore une fois rentrés chez eux; et qu’il lui était arrivé à lui-même d’avoir été tellement ému de sentiments qu’il avait cherché à inculquer à d’autres, qu’il les avait partagés au point de se surprendre non seulement pleurant, mais le visage pâle et dans l’attitude de quelqu’un vraiment accablé de douleur.
Singulier moyen que nous mettons en œuvre pour faire diversion à la douleur que nos deuils peuvent nous causer.—Dans un pays proche de nos montagnes, les femmes font le prêtre Martin; non seulement elles avivent les regrets qu’elles éprouvent de la perte d’un mari, en rappelant les bonnes et agréables qualités qu’il avait, mais, revenant du même coup en arrière, elles publient également ses imperfections, comme pour se ménager à elles-mêmes quelques compensations et faire, par le dédain, diversion à leur pitié. En cela, elles ont encore meilleure grâce que nous qui, en les mêmes circonstances, à la perte de quelqu’un que nous connaissons à peine, nous évertuons à lui prodiguer des éloges aussi nouveaux pour lui que peu mérités et le dépeignons, alors qu’il n’est plus, tout autre qu’il nous apparaissait lorsqu’il était encore de ce monde, comme si le regret était une source de renseignements inédits, nous révélant chez le défunt des qualités jusqu’alors inconnues, ou que les larmes, lavant notre entendement, lui donnent plus de lucidité. Dès maintenant, je renonce aux témoignages favorables qu’on voudra exprimer sur mon compte, non parce que j’en serai indigne, mais parce que je serai mort.
Nous nous laissons fréquemment influencer par de purs effets d’imagination; parfois, il n’en faut pas davantage pour nous porter aux pires résolutions.—Quelqu’un auquel on demanderait quel intérêt il a à prendre part à un siège auquel il assiste, répondra: «C’est en raison de l’exemple qui m’est donné, de l’obéissance que nous devons tous à notre prince, que je m’y trouve; je ne prétends en retirer aucun profit; quant à la gloire, je sais combien est faible la part qui peut en revenir à un simple particulier comme moi; je n’y apporte ni entraînement, ni animosité.» Voyez-le pourtant le lendemain à son rang de bataille, au moment de l’assaut: il est transformé, il bout, il rougit de colère; cette fureur qu’il ne manifestait pas hier, cette haine qu’il a au cœur, ce sont le reflet étincelant de tant d’acier, le feu, le tintamarre que produisent les canons et les tambours, qui les ont fait sourdre en lui. «Quelle cause futile!» direz-vous. Comment! vous croyez qu’à cela il y a une cause? Il n’en est pas besoin pour agiter notre âme; une simple rêverie, qui n’a ni corps ni sujet d’être, la gouverne et la trouble. Que je me mette à faire des châteaux en Espagne, mon imagination s’y forge avantages et plaisirs dont mon âme tressaille d’aise et se réjouit. Combien de fois aussi ces mêmes songes font-ils que la colère et la tristesse nous envahissent, et que nous nous livrons à de fantastiques idées qui 179 altèrent en nous le corps et l’âme. Que de grimaces peignant l’étonnement, le comique, la confusion, nos rêves amènent sur notre visage; que de soubresauts, d’agitations ne communiquent-ils pas à nos membres et à la voix! Ne dirait-on pas que cet homme, qui est seul, semble avoir la vision de gens en grand nombre avec lesquels il dispute, ou d’un démon intérieur qui le persécute? Interrogez-vous vous-mêmes sur la cause de semblables illusions; est-il dans la nature autre chose en dehors de nous, sur laquelle ce qui n’est pas ait action?—Cambyse, à la suite d’un songe où son frère lui était apparu comme devant devenir roi de Perse, le fit mourir; et ce frère, il l’aimait et avait toujours eu confiance en lui.—Aristodème, roi des Messéniens, se tua, parce que l’idée lui vint que je ne sais quel hurlement de son chien était de mauvais augure.—Le roi Midas, à la suite d’un songe déplaisant qu’il avait eu, en fit autant, tant il en éprouva de trouble et de contrariété.—C’est faire de la vie exactement le cas qu’elle vaut, que de la quitter pour un songe. Regardez cependant combien notre âme triomphe des misères qu’endure le corps, de sa faiblesse, de ce qu’il est en butte à toutes les offenses et altérations; il lui appartient vraiment bien d’en parler! «O premier argile, façonnée si malheureusement par Prométhée! Qu’il apporta donc peu de sagesse à la confection de son œuvre! Il n’a vu que le corps dans son art, sans se préoccuper de l’esprit; c’est pourtant par l’esprit qu’il eût dû commencer (Properce)!»
La vieillesse est si naturellement portée vers les idées tristes et sérieuses que, pour se distraire, elle a besoin de se livrer quelquefois à des accès de gaîté.—A mesure que nos réflexions ayant un caractère d’utilité, sont plus sérieuses et plus approfondies, elles deviennent plus embarrassantes et plus pénibles; le vice, la mort, la pauvreté, les maladies sont des sujets graves, sur lesquels nous ne pouvons méditer longtemps sans fatigue. Il faut avoir l’âme bien instruite des moyens de résister au mal et de le combattre, des règles qui font que notre vie et notre foi sont dans la voie droite, et souvent lui rappeler cette belle étude et l’y exercer; mais, si cette âme appartient à un milieu rentrant dans la catégorie générale, il faut procéder par intermittences et avec modération; elle s’affolerait, si on lui imposait une application trop continue.—J’avais besoin, quand j’étais jeune, de m’avertir et de me raisonner pour demeurer dans le devoir; car l’allégresse 181 et la santé ne se prêtent guère, dit-on, aux raisonnements sérieux et sages; aujourd’hui que ma situation est autre, les misères de la vieillesse ne m’avertissent que trop, elles m’assagissent et me sermonnent. De l’excès de gaîté, je suis tombé dans celui de la sévérité, qui est un état plus fâcheux; c’est pourquoi, maintenant, de parti pris, je me livre un peu à la débauche, laissant parfois mon esprit s’abandonner à des pensées folâtres et d’un autre âge qui le reposent. Je ne suis, à cette heure, que trop rassis, trop lourd, trop mûr; les ans me sont chaque jour une leçon qui m’invite au calme et à la tempérance. Mon corps fuit tout écart et les redoute; c’est lui qui, à son tour, porte mon esprit à se ranger; à son tour il le régente et plus rudement et d’une façon plus impérieuse qu’il ne l’a été lui-même par lui; que je dorme ou que je veille, il ne me laisse pas chômer une heure sans m’entretenir de la mort, de la patience et de la pénitence. Je me défends aujourd’hui contre la tempérance, comme autrefois contre la volupté; elle me tire tellement en arrière, que j’en deviens stupide. Or, je veux demeurer maître de moi à tous égards; la sagesse, elle aussi, a ses excès et n’a pas moins besoin d’être modérée que la folie. Aussi, de peur que par excès de prudence je me dessèche, me tarisse et compromette mon état, dans les intervalles où mes souffrances me laissent du répit, «de peur que mon âme ne soit trop attentive à ses maux (Ovide)», je dévie tout doucement, je détourne les yeux de ce ciel orageux et nébuleux que j’ai devant moi et que, Dieu merci, je considère bien sans effroi mais non sans effort, ni sans que ma pensée s’y reporte; et me voilà m’amusant du souvenir des folies de ma jeunesse passée; «mon esprit, soupirant après ce qu’il a perdu, se rejette tout entier dans le passé (Pétrone)». Que l’enfant porte ses regards en avant de lui et le vieillard en arrière; n’est-ce pas là ce que signifiait le double visage de Janus! A ces moments, les ans peuvent m’entraîner s’ils le veulent, mais ce sera à reculons; tant que mes yeux pourront reconnaître cette belle saison qui pour moi n’est plus, j’y reporterai mes regards de temps à autre; si elle s’échappe de mon sang et de mes veines, du moins je ne veux pas en déraciner l’image de ma mémoire: «C’est vivre deux fois, que de vivre de sa vie passée (Martial).»
Aussi Montaigne saisit-il toutes les occasions de goûter quelque plaisir et pense qu’il vaut mieux être moins longtemps vieux, que vieux avant de l’être.—Platon recommande aux vieillards d’assister aux exercices, aux danses et à tous les jeux de la jeunesse, pour se réjouir par les autres de la souplesse et de la beauté physique qu’ils n’ont plus et se ressouvenir des grâces et des avantages de cet âge si verdoyant. Il veut que dans ces ébats dont ils seront les témoins, ils attribuent l’honneur de la victoire au jeune homme qui aura le plus distrait et causé de sensations agréables au plus grand nombre d’entre eux.—Autrefois, je notais comme journées extraordinaires les jours lourds 183 et sombres; actuellement, ils sont passés chez moi à l’état d’habitude, ce sont les jours beaux et sereins qui sont devenus rares; je suis en passe de me féliciter, comme d’une faveur nouvelle, quand je ne souffre de nulle part. Je puis me chatouiller, je n’arrive plus à arracher un pauvre rire à ce méchant corps; je ne m’égaie qu’en idée et en songe, détournant par cette ruse les chagrins de la vieillesse; mais il me * faudrait certes bien quelque autre remède qu’un rêve! c’est un assaut où l’art lutte vainement contre la nature.—Quelle grande simplicité d’esprit que de prolonger, comme nous le faisons tous, les incommodités humaines, d’anticiper sur leur venue en nous sevrant des jouissances qui nous restent encore! Je préfère être vieux moins longtemps, que vieux avant de l’être; aussi les moindres occasions de plaisir que je puis rencontrer, je les saisis. Je sais bien par ouï dire qu’il existe quelques genres de volupté, telles que les satisfactions d’amour-propre, qui ne portent pas atteinte à la sobriété qu’il nous faut observer et qui sont fortes et glorieuses; mais elles relèvent de l’opinion, et l’opinion n’a pas sur moi un pouvoir suffisant pour me les faire désirer, car je ne les recherche pas tant magnanimes, magnifiques et fastueuses, que je ne les désire doucereuses, faciles et immédiates: «S’éloigner de la nature pour suivre le peuple, c’est prendre un guide peu sûr (Sénéque).» Ma philosophie est dans les actes, toute d’actualité et conforme à la nature; l’imagination y a peu de part. Que ne puis-je, par exemple, prendre encore plaisir à jouer aux noisettes et à la toupie! «Aux approbations de la foule je préfère le témoignage de ma conscience (Ennius).» La volupté est peu ambitieuse, elle s’estime assez riche par elle-même pour ne pas vouloir faire la dépense de ce que coûtent les réputations; elle aime mieux demeurer dans l’ombre. Il faudrait donner le fouet à un jeune homme qui ferait consister son plaisir à déguster les vins et les sauces; il n’est rien que je n’aie moins su faire et moins apprécier; c’est à cette heure que je l’apprends. J’en ai grand’honte, mais qu’y faire? j’ai encore plus de confusion des motifs qui m’y poussent.—A nous de rêver et de baguenauder; à la jeunesse le bon bout, à elle de soutenir sa réputation. Elle marche à la conquête du monde, à sa domination; nous, nous en venons: «A elle, les armes, les chevaux, les javelots, la massue, la paume, la nage, la course; à nous, vieillards, les dés et les osselets (Cicéron).» Les lois elles-mêmes nous renvoient au logis. Je ne puis moins faire, en dédommagement des piteuses conditions que je dois aux années, que de recourir aux jouets et aux amusettes comme fait l’enfance en laquelle nous retombons; la sagesse et la folie auront bien à faire pour, à elles deux et en s’y reprenant à tour de rôle, me soutenir et me venir en aide en cet état calamiteux qu’amène l’âge: «Mêle à ta sagesse un grain de folie (Horace).»—Je fuis de même les plus légères piqûres; celles qui, autrefois, ne m’eussent même pas éraflé, me transpercent aujourd’hui; souffrir commence à tant rentrer dans mes habitudes! «Pour un corps débile, la moindre atteinte est insupportable (Cicéron);—un esprit 185 malade ne peut rien supporter de pénible (Ovide).» J’ai toujours été fort impressionnable et très susceptible à l’effet de la douleur; j’y suis plus sensible encore et de toutes parts accessible, «le moindre choc brise ce qui est déjà fêlé (Ovide)». Ma raison s’oppose bien à ce que je récrimine et me révolte contre les incommodités que la nature m’inflige, mais elle ne peut m’empêcher de les sentir; je courrais d’un bout du monde à l’autre, pour avoir une bonne année de tranquillité gaie et agréable, moi qui n’ai d’autre but que de vivre et d’être de bonne humeur. Je jouis assez souvent d’une tranquillité morose et stupide, mais elle m’endort et me fait mal à la tête; cela ne me suffit pas. Si, soit à la ville soit à la campagne, en France ou ailleurs, il y a quelqu’un ou quelque bonne compagnie, aimant son chez soi ou préférant voyager, qui s’accommoderaient des conditions dans lesquelles je suis, et moi des leurs, ils n’ont qu’à me faire signe, je leur amènerai aussitôt l’auteur des Essais en personne.
Ce qu’il y a de pire dans la vieillesse, c’est que l’esprit se ressent des souffrances et de l’affaiblissement du corps.—Puisque c’est le privilège de l’esprit de pouvoir échapper à la vieillesse, autant que je le puis je lui conseille de le faire; que même pendant cet âge, il verdisse, il fleurisse s’il est possible, comme le gui sur un arbre mort. Mais je crains bien d’avoir affaire à un traître; il est si étroitement lié au corps, qu’il m’abandonne continuellement pour le suivre et participer à sa déchéance. Alors je le prends à part, je le flatte, mais en vain; j’ai beau le détourner de cette liaison par trop intime, lui présenter et Sénèque et Catulle, les dames et les danses de la cour, si son compagnon a la colique, il semble qu’il l’ait aussi; les opérations mêmes qui lui sont propres, qui sont siennes, ne peuvent s’accomplir; elles font tout l’effet d’être figées; il n’y a aucune animation dans ce qui vient de lui si en même temps le corps n’en présente pas.
La santé, la vigueur physique font éclore les grandes conceptions de l’esprit; la sagesse n’a que faire d’une trop grande austérité de mœurs.—Nos maîtres ont eu tort, lorsque recherchant les causes des élans parfois extraordinaires de notre esprit, après les avoir attribués à une inspiration divine, à l’amour, à une exaltation guerrière, à la poésie, au vin, ils n’ont pas fait la part de la santé; de cette santé bouillante, vigoureuse, entière, sans souci, telle qu’autrefois la force de l’âge et la quiétude l’entretenaient en moi d’une façon continue. Ce feu de joie fait saillir en l’esprit, en plus de son pétillement naturel, des éclairs vifs et étincelants qui soulèvent les enthousiasmes les plus gaillards, pour ne pas dire les plus extravagants. Aussi n’est-ce pas merveille si un état contraire affaiblit mon esprit, l’immobilise et lui fait produire un effet opposé: «L’esprit perd sa vigueur dans un corps languissant (Pseudo-Gallus)»; et encore il voudrait que je lui sache gré de ce qu’à ces sollicitations il résiste beaucoup plus que cela n’arrive d’ordinaire chez la plupart des hommes! Au moins pendant que nous avons 187 trêve, chassons les maux et les difficultés avec lesquels nous sommes aux prises: «Que la vieillesse se déride, lorsqu’elle le peut encore (Horace);—il est bon d’adoucir par l’enjouement les noirs chagrins de la vie (Sidoine Apollinaire).»—J’affectionne une sagesse gaie et sociable, et fuis une rudesse de mœurs par trop austères; toute mine rébarbative m’est suspecte «comme aussi la tristesse arrogante d’un visage renfrogné,—car dans cette foule de gens au maintien sévère se cache plus d’un débauché (Martial)». Je crois Platon de bon cœur, quand il dit que les humeurs, suivant qu’elles sont faciles ou difficiles, sont de grande influence sur la bonté ou la perversité de l’âme. Socrate avait une physionomie qui jamais ne variait, toujours sereine et riante; ce n’était pas comme le vieux Crassus qui avait sans cesse l’air mécontent et qu’on ne vit jamais rire. La vertu est foncièrement gaie et enjouée.
Ceux qui se blesseront de la licence de cet ouvrage devront bien plutôt blâmer la licence de leurs propres pensées; quant à lui Montaigne, il ose dire tout ce qu’il ose faire; il croit du reste que la confession de ses fautes aura peu d’imitateurs.—Je sais que parmi les gens qui se scandaliseront de la licence de mes écrits, s’en trouveront fort peu qui n’auraient à se scandaliser davantage de la licence de leurs pensées; j’écris bien suivant leur goût, mais j’offense leurs regards. Il est de bon ton de critiquer les écrits de Platon et de passer légèrement sur les relations qu’on lui prête avec Phédon, Dion, Stella, Archéanassa. «N’ayez pas honte de dire ce que vous n’avez pas honte d’approuver tout bas.» Je hais un esprit hargneux et triste qui glisse par-dessus les plaisirs de sa vie et ne songe qu’à ses peines, ne considère qu’elles, comme les mouches qui ne peuvent se tenir sur une surface bien polie et bien lisse et qui s’attachent et reposent sur ce qui est rugueux et raboteux, ou encore comme les ventouses qui ne recherchent et ne soutirent que le mauvais sang.
Du reste, je me suis fait une loi d’oser dire tout ce que j’ose faire, et vais jusqu’à regretter que toute pensée ne puisse être publiée; le pire de tous mes actes, la pire de toutes les situations en lesquelles je puis être, ne me semblent pas si laids, que je ne trouve de laideur et de lâcheté à ne pas oser les avouer. Chacun est discret quand il se confesse, on devrait bien l’être aussi quand on agit; la hardiesse dans la faute est quelque peu atténuée et maîtrisée par la hardiesse à la confesser; qui s’obligerait à tout dire s’obligerait à ne rien faire de ce qu’on est contraint de taire. Dieu veuille que cette licence excessive de ma part décide les autres à plus d’expansion, en tenant moins compte de ces vertus timorées et minaudières nées de nos imperfections, et que le sacrifice de ma modestie les amène à ce qui est raisonnable. Il faut, quand on veut les conter, reconnaître ses vices et les étudier; ceux qui les cachent aux autres, se les cachent d’ordinaire à eux-mêmes; ils ne les considèrent pas comme suffisamment dissimulés, s’ils les aperçoivent; ils les soustraient et les déguisent à leur propre conscience: «Pourquoi personne 189 n’avoue-t-il ses vices? Parce que nous en sommes encore esclaves; il faut être éveillé pour raconter un songe (Sénèque).»—Les maux du corps se dessinent davantage quand ils acquièrent plus de gravité; nous constatons que ce que nous nommions rhume ou foulure est bel et bien la goutte. Les maux de l’âme, au contraire, deviennent moins saisissables à mesure qu’ils s’aggravent; celui qui en est le plus malade est celui qui le sent le moins; voilà pourquoi il faut souvent les examiner au grand jour, d’une main impitoyable qui les met à découvert et les arrache du fond de nos poitrines. Il en est des mauvaises actions comme des bonnes, leur confession est parfois à elle seule une satisfaction, et il n’est pas de faute dont la laideur puisse nous dispenser de la confesser.—Je souffre quand il me faut dissimuler, aussi j’évite de devenir le confident des secrets d’autrui, n’ayant guère le cœur à nier que je les connais; je puis les taire, mais les nier, je ne le puis sans faire effort et sans en éprouver du déplaisir. Pour bien garder un secret, il faut que ce soit dans notre nature et non par l’obligation que nous en avons. Quand on est au service des princes, c’est peu d’être discret si en même temps on n’est pas menteur. Si celui qui demandait à Thalès de Milet s’il devait nier par serment solennel avoir commis un adultère dont il était coupable, se fût adressé à moi, je lui eusse répondu qu’il ne devait pas se parjurer, un mensonge me paraissant pire encore que l’adultère. Thalès, au contraire, le lui conseilla pour parer à un plus grand mal par un moindre, solution qui n’aboutissait pas tant à faire choix entre deux maux, qu’à ajouter l’un à l’autre. A ce propos, disons en passant qu’un homme qui a de la conscience, est mis à son aise quand, en compensation d’une faute, on le met en présence de quelque entreprise périlleuse à laquelle il aura à satisfaire; mais que c’est le soumettre à une rude épreuve que de ne lui laisser le choix qu’entre deux fautes, ainsi qu’il arriva à Origène. Placé dans l’alternative de sacrifier aux idoles, ou de souffrir de servir à assouvir les appétits charnels d’un grand vilain Éthiopien qu’on lui présentait, Origène se résigna à la première de ces conditions, ce qui fut un gros péché, dit-on. Il faut convenir cependant que les femmes qui, de notre temps, conséquentes avec leurs idées fausses sur la religion, nous protestent qu’elles aimeraient mieux charger leur conscience de dix hommes que d’une messe, n’eussent pas éprouvé le même dégoût.
Si c’est une indiscrétion de publier ainsi ses erreurs, il n’y a pas grand danger qu’elle soit prise pour exemple et passe dans les usages; Ariston ne disait-il pas que les vents que les hommes redoutent le plus, sont ceux qui les découvrent. Il faut retrousser ce sot haillon qui cache nos mœurs. On envoie sa conscience dans les lieux de débauche et on se donne une contenance irréprochable; jusqu’aux traîtres et aux assassins qui s’attachent à l’observation des lois de l’étiquette, bornant là leur devoir. Ce n’est ni à l’injustice de se plaindre de l’impolitesse; ni à la malice, de l’indiscrétion. 191 Il est dommage que le méchant ne soit pas en outre un imbécile et que la décence pallie ses méchancetés; ces enduits ne conviennent qu’à des cloisons intérieures bien bâties et en bon état, valant la peine qu’on les badigeonne pour en assurer la conservation.
Ce que les hommes craignent le plus, c’est qu’une occasion ne mette leurs mœurs à découvert. Montaigne va maintenant entrer dans le vif de son sujet; il appréhende que ce chapitre ne fasse confiner son livre du salon de ces dames dans leur boudoir.—Pour plaire aux Huguenots qui blâment notre confession en aparté et à l’oreille d’un tiers, je me confesse publiquement, en toute conviction et sincérité. Saint Augustin, Origène et Hippocrate ont publié leurs erreurs d’opinions; j’y ajoute, moi, mes erreurs de mœurs. J’ai le plus ardent désir de me faire connaître, et peu m’importe à quel prix, pourvu que ce soit sous mon vrai jour; car, pour mieux dire, je ne désire rien, mais j’éprouverais un mortel déplaisir à être pris pour autre que je ne suis par ceux auxquels il arrive de connaître mon nom. Celui qui n’a en vue que l’honneur et la gloire, qu’espère-t-il gagner en se produisant au monde sous un masque qui dérobe à la connaissance des foules ce qu’il est réellement? Louez un bossu de sa belle taille, il ne saurait faire autrement que de considérer cet éloge comme une injure; si vous êtes un lâche et qu’on vous honore comme un vaillant, est-ce de vous dont on parle? on vous prend pour un autre; le croire, c’est faire comme celui qui se montrait fier des saluts qu’on lui adressait, le prenant pour le maître de la troupe, lui qui n’était qu’un des moindres personnages de sa suite.—Le roi de Macédoine Archélaus passant dans une rue, quelqu’un lui versa de l’eau sur la tête; les assistants l’excitaient à le punir: «Oui, leur dit-il, seulement ce n’est pas sur moi qu’il a versé de l’eau, mais sur celui pour lequel il me prenait.»—Socrate répondait à un autre qui lui disait qu’on médisait de lui: «Non, il n’y a rien en moi de ce que disent ces gens.»—Quant à moi, je ne saurais aucun gré à qui me louerait d’être un bon pilote, d’avoir beaucoup de modestie ou de chasteté; et pareillement, je ne me considérerais non plus comme offensé par qui dirait de moi que je suis un traître, un voleur ou un ivrogne. Ceux qui ne se connaissent pas, peuvent se repaître d’approbations qu’ils ne méritent pas; moi, je ne le puis, parce que je me vois, me scrute jusqu’au fond des entrailles et sais bien ce qui m’appartient; il me plaît qu’on me loue moins, pourvu qu’on me connaisse mieux; on pourrait me tenir pour un sage dans des conditions de sagesse que je tiens être de la sottise. Alors que mes Essais sont lus communément par les dames et traînent sur les meubles de leur salon, ce chapitre va les faire passer dans leur boudoir où elles les liront en cachette; j’avoue que c’est surtout en tête-à-tête que j’aime leur société, en public elle manque de saveur et ne constitue plus une faveur.—Dans nos adieux, nous exagérons, au delà de ce qui est d’ordinaire, l’affection que nous portons à ce que nous abandonnons; 193 en train de quitter les jeux de ce monde, ce sont ici les dernières accolades que nous nous donnions, eux et moi.
Comment se fait-il que l’acte par lequel se perpétue le genre humain, paraisse si honteux qu’on n’ose le nommer?—Revenons-en à notre thème. Qu’a donc fait aux hommes l’acte génital, pourtant si naturel, si nécessaire, si juste, pour que nous n’osions pas en parler sans en avoir honte, et pour l’exclure des conversations sérieuses et de bon ton? Nous disons hardiment: tuer, dérober, trahir; et cet autre mot, nous n’osons le prononcer qu’entre les dents. Serait-ce parce que moins nous en parlons, plus nous y pensons? Il y a lieu de remarquer en effet que les mots les moins en usage, qu’on n’écrit guère et sur lesquels on se tait le plus, sont ceux qu’on sait le mieux et qui sont le plus généralement connus; celui-ci, quel que soit l’âge, quelles que soient les mœurs, nul ne l’ignore non plus que le pain; il est imprimé en chacun de nous, sans qu’il ait été prononcé, sans qu’il se soit fait entendre ou ait été vu; et le sexe qui en use le plus, est celui auquel il est imposé de s’en taire davantage. Ce qu’il y a de remarquable *, c’est que nous avons mis cet acte sous la sauvegarde du silence, d’où c’est un crime de l’arracher, même pour l’accuser et le juger; nous n’osons le critiquer qu’en usant de périphrases et en ayant recours à des formes imagées. Quelle insigne faveur pour un criminel d’être si exécrable que la justice estime qu’il ne doit être ni touché, ni vu et qui, grâce à la dureté de la condamnation qui le frappe, demeure libre et sauf. N’en est-il pas de lui comme des livres qui se répandent et se vendent d’autant plus qu’ils sont interdits? Quant à moi, je me rallie à ce qu’en dit Aristote: «Acte pudique, qui pare la jeunesse et attire des reproches à la vieillesse.»—Les vers suivants avaient cours dans l’école ancienne, qui est plus dans mes idées que l’école moderne parce que j’estime que les vertus y étaient plus grandes et les défauts moindres: «Ceux qui fuyant par trop Vénus l’esquivent, sont en faute autant que ceux qui par trop la suivent (Plutarque).» «O déesse, seule tu gouvernes la nature; sans toi, rien ne voit la lumière du jour, rien n’est gai, rien n’est aimable (Lucrèce).»
Pourquoi avoir voulu brouiller les Muses avec Vénus? leur accord leur sied si bien, ainsi qu’en témoignent les vers de Virgile où le poète décrit une entrevue amoureuse de cette déesse avec Vulcain.—Je ne sais qui a pu brouiller Pallas et les Muses avec Vénus, et les mettre en froid avec l’Amour; je ne vois aucunes divinités qui se conviennent mieux et qui ne doivent davantage les unes aux autres. Qui enlèverait aux Muses leurs productions inspirées par l’amour, leur déroberait le plus beau sujet sur lequel elles ont à s’exercer et ce qu’il y a de plus noble dans leurs œuvres; qui ferait perdre à l’Amour le concours que lui prêtent la poésie et les services qu’elle lui rend, l’affaiblirait en le privant ainsi des meilleures de ses armes; ce serait entacher d’ingratitude et d’inintelligence ce dieu essentiellement 195 sociable et bienveillant et ces déesses protectrices de l’humanité et de la justice.—Il n’y a pas si longtemps que j’ai dû renoncer à son culte et cessé de faire partie de ses adorateurs, pour que je ne conserve pas le souvenir précis de sa force et de sa valeur: «Je sens encore les brûlures d’une ancienne flamme (Virgile)». La fièvre laisse après elle un reste d’agitation et de chaleur: «Heureux si, dans mes années d’hiver, ce reste de chaleur ne m’abandonne pas (Jean Second)»; et, si épuisé et alourdi que je suis, j’éprouve quelque peu encore les effets affaiblis de cette ardeur passée: «Telle la mer Égée, battue par l’Aquilon ou le Notus, ne s’apaise pas subitement après la tempête; longtemps tourmentée, elle s’agite et gronde encore (Le Tasse).» Mais autant que je puis m’y connaître, la force et la valeur de ce dieu sont présentées plus vives et plus animées dans les descriptions qu’en donne la poésie, qu’elles ne le sont dans la réalité: «Le vers du poète a des doigts et chatouille (Juvénal)»; elle sait donner à l’Amour je ne sais quel air plus langoureux que celui qu’il revêt; et Vénus, dans la plus complète nudité, n’est ni si belle, si vive, si haletante que la peint Virgile dans ce passage: «Elle dit, et, comme il hésite, la déesse l’entoure mollement de ses beaux bras plus blancs que la neige et l’échauffe dans un embrassement. A ce contact, Vulcain sent renaître son ardeur accoutumée, une chaleur qu’il connaît bien l’envahit de toutes parts, et jusque dans la moelle des os. Ainsi brille l’éclair dans la nuée pourfendue par le tonnerre et qui, de ses rubans de feu, sillonne les nuages épars dans les airs..... Enfin, Vulcain satisfait aux sollicitations amoureuses de son épouse et, incarné en elle, s’abandonne tout entier aux charmes d’un sommeil réparateur.»
Le mariage diffère de l’amour; contracté en vue de la postérité, les extravagances amoureuses doivent en être bannies; du reste ceux auxquels l’amour seul a présidé, plus que tous autres ont tendance à mal tourner.—Ce que j’observe dans cette description, c’est que Virgile nous dépeint une Vénus bien passionnée pour une épouse; dans ce marché, dicté par la sagesse, qu’est le mariage, les appétits sont moins folâtres, les ébats moins tumultueux et plus tempérés. L’amour hait toute union contractée en dehors de son intervention exclusive, et ne participe que faiblement aux rapprochements sexuels qui ont été préparés et s’accomplissent à tout autre titre, comme c’est le cas dans le mariage où des considérations d’alliances, de situations de fortune y ont, avec raison, autant et plus de part que les grâces et la beauté. On ne se marie pas pour soi; quoi qu’on dise, on se marie au moins autant, sinon plus, pour sa famille et sa postérité; les conditions dans lesquelles s’effectue un mariage et les résultats qu’il doit produire, intéressent notre race, bien au delà de nous-mêmes; c’est pourquoi il me plaît de les voir négocier par des intermédiaires plutôt que par les intéressés, nous en rapportant plus au sentiment d’autrui qu’au nôtre, principe qui va bien à l’encontre des idées de ceux qui sont pour les mariages d’inclination. 197 Aussi est-ce commettre une sorte d’inceste que de se livrer, dans ces rapports vénérables et sacrés entre mari et femme qui se proposent d’engendrer, à toutes les violences et extravagances de l’amour en folie, ce que je crois avoir déjà exprimé précédemment; il faut, dit Aristote, approcher sa femme avec réserve et avec calme, de peur que des caresses trop lascives n’éveillent en elle le plaisir à un degré qui la mette hors d’elle plus que de raison. Ce qu’il prône en faisant appel à la conscience, les médecins le répètent au nom de la santé: «Un plaisir trop chaleureux, trop voluptueux, trop souvent renouvelé, altère la semence et empêche la conception»; ils disent encore que «ces attouchements empreints de langueur, comme le veut ici la nature, pour que le résultat réponde à l’attente et soit fécond, doivent n’avoir lieu que rarement et à de notables intervalles», «afin que la femme saisisse plus avidement les dons de Vénus et les recèle profondément dans son sein (Virgile)». Je ne connais pas de mariages qui soient plus rapidement troublés et arrivent plus tôt à tourner mal, que ceux auxquels ont conduit la beauté et les désirs amoureux. Il faut à cette union des bases plus solides et de plus longue durée; on ne doit s’y engager qu’avec circonspection, un entraînement irréfléchi n’y vaut rien.
L’amour ne fait pas partie intégrante du mariage, pas plus que la vertu n’est liée d’une manière absolue à la noblesse. Digression sur le rang en lequel sont tenus les nobles dans le royaume de Calicut.—Ceux qui pensent honorer le mariage en y joignant l’amour, me font le même effet que ceux qui, pour rehausser la vertu, tiennent que la noblesse et elle sont même chose. Elles sont quelque peu parentes, mais que de différences entre elles! c’est erreur de mêler leurs noms et leurs titres; les confondre, c’est faire tort soit à l’une, soit à l’autre. La noblesse est une belle qualité, qui a été introduite avec raison; mais c’est une qualité qui est octroyée par autrui et peut échoir à un homme de rien et vicieux; aussi est-elle beaucoup moins estimée que la vertu. Si c’en est une, c’est une vertu artificielle et apparente qui dépend des temps et de la fortune; qui, suivant les pays, revêt des formes différentes: vivante et mortelle, elle n’a pas de naissance non plus que le Nil dont la source est inconnue; elle a une généalogie et est un bien de communauté; elle se transmet comme elle a été acquise; elle crée des obligations bien faiblement observées. La science, la force, la bonté, la beauté, la richesse et toutes les autres qualités se communiquent et on peut en trafiquer; la noblesse ne sert qu’à celui qui la possède, elle est de nul emploi pour autrui.—On soumettait à l’un de nos rois de se prononcer entre deux candidats présentés pour une même charge, dont l’un était gentilhomme et l’autre ne l’était pas; il prescrivit que sans tenir compte de cette qualité, on choisit celui qui avait le plus de mérite; mais qu’à mérite égal, on eût égard à la noblesse; c’était assigner bien exactement à celle-ci le rang qu’elle doit occuper.—A 199 un jeune homme qui ne s’était pas encore révélé et qui demandait à succéder, dans la charge qu’il occupait, à son père qui était un homme de valeur et qui venait de mourir, Antigone répondait: «Mon ami, pour l’attribution de ces bénéfices, je ne tiens pas tant compte de la noblesse de mes soldats, que des preuves de courage qu’ils ont données.» Il ne saurait en effet en être de cela comme à Sparte, où dans les divers offices à remplir auprès des rois: trompettes, ménétriers, cuisiniers, les enfants étaient admis à succéder à leurs pères, quelle que fût leur ignorance en la matière et avant tous autres, si expérimentés que fussent ceux-ci dans la partie.—Dans le royaume de Calicut, les nobles constituent une espèce au-dessus du commun des mortels; le mariage leur est interdit, ainsi que toute profession autre que celle des armes; les hommes peuvent avoir autant de concubines qu’ils veulent, et pareillement les femmes autant de galants qu’il leur plaît, sans que jamais il s’élève de jalousie dans tout ce monde; mais c’est un crime capital et irrémissible de prendre ces concubines et ces galants en dehors de leur propre caste. Ils se tiennent pour souillés par le simple contact de quiconque n’est pas des leurs et vient à les frôler en passant; c’est une atteinte tellement grave et injurieuse, qu’ils tuent tous ceux qui les approchent seulement d’un peu trop près; de telle sorte que les gens des classes notées d’infamie, qui circulent par la ville, sont tenus de crier au tournant des rues, comme font les gondoliers de Venise, pour éviter de se heurter; et les nobles leur commandent de se jeter du côté qui leur convient: de la sorte ceux-ci évitent une tache qu’ils estiment ne jamais pouvoir être effacée et ceux-là une mort certaine. Nulle période de temps si longue soit-elle, nulle faveur du prince, nul service rendu, pas plus que la vertu ou la richesse ne peuvent faire que, dans ce pays, un roturier devienne noble; coutume à l’appui de laquelle vient encore la défense de se marier entre gens de métiers différents; une fille de famille de cordonniers ne peut épouser un charpentier; les parents sont dans l’obligation de préparer leurs enfants à exercer la profession de leurs pères à l’exclusion de toute autre, ce qui maintient les distinctions sociales et fait que les situations de chacun vont se poursuivant sans jamais se modifier.
Un bon mariage, s’il en est, est une union faite d’amitié et de confiance; il n’est pas d’état plus heureux dans la société humaine.—Un bon mariage, s’il en existe, refuse de se nouer sous les auspices de l’amour et de l’admettre en tiers; il doit plutôt viser à être un pacte d’amitié. C’est une douce association de deux existences, pleine de constance, de confiance, d’un nombre infini d’utiles et solides services et d’obligations réciproques. Aucune femme, qui en a savouré les délices, «unie par l’hymen à l’homme de son choix (Catulle)», ne voudrait tenir lieu de maîtresse à son mari; si elle a part à son affection comme épouse, elle y est en position bien plus honorable et plus sûre. Si ailleurs il soupire et fait l’empressé, qu’on lui demande, à ce moment, à qui, de sa femme 201 ou de sa maîtresse, il préfère voir arriver une mésaventure honteuse? quelle est celle des deux dont l’infortune l’affligerait le plus? à laquelle il désire le plus de grandeur? il n’y a pas de doute que ce ne soit à celle qui lui est unie par un mariage en bonnes conditions.
Par cela même qu’on en voit si peu de bons, on peut en apprécier le prix et la valeur. Tout bien considéré, il n’est rien dans notre société qui soit plus beau qu’un tel mariage. C’est là une institution dont nous ne pouvons nous passer et nous l’avilissons à qui mieux mieux; il en advient comme de ce qui se voit aux cages d’oiseaux: ceux qui sont dehors, se désespèrent de n’y pouvoir entrer; ceux qui sont dedans, ont le même désir d’en sortir. Socrate auquel on demandait ce qui valait le mieux de prendre femme ou de n’en pas prendre, répondit: «Que vous fassiez l’un ou l’autre, vous vous en repentirez.» C’est une association de laquelle on peut justement dire: «L’homme est à l’homme, ou un dieu (Cécilius), ou un loup (Plaute)»; il faut que de nombreuses qualités se rencontrent pour la créer. En ce temps-ci, les âmes simples chez le peuple s’y prêtent volontiers, parce que les plaisirs, la curiosité et l’oisiveté n’occupent pas en eux une place prépondérante; par contre, les caractères portés à la débauche, comme est le mien, qui sont rebelles à toutes liaisons et obligations de quelque nature que ce soit, y sont moins propres: «Il m’est plus doux de vivre exempt de cette chaîne (Pseudo-Gallus).»
Montaigne a cédé à l’exemple et aux usages, mais il répugnait au mariage; il en a, nonobstant, observé les lois à un degré dont il ne se croyait pas capable; ceux qui se marient avec la résolution contraire ont grand tort.—A suivre mon inclination naturelle, je me serais enfui plutôt que d’épouser la sagesse en personne, si elle m’eût voulu; mais nous avons beau dire, les coutumes et les usages admis de tous nous entraînent. La plupart de mes actes sont une conséquence des exemples que j’ai eus sous les yeux, bien plus qu’ils ne découlent de mes préférences; à celui-ci notamment je ne suis pas venu de moi-même, on m’y a amené; j’y ai été porté par des circonstances qui y étaient étrangères, car même les choses qui présentent des inconvénients peuvent, par le fait de quelques particularités et accidents, devenir acceptables, et il n’en est aucune si laide, si vicieuse, si évitable soit-elle, qui ne puisse en arriver là, tant les dispositions de l’homme sont versatiles. J’y ai été porté, certainement plus mal préparé alors et plus à contre-cœur que je ne le suis aujourd’hui après en avoir essayé; et, pour si licencieux qu’on me tienne, j’ai, en vérité, plus sévèrement observé les lois du mariage que je ne l’avais promis et espéré. Il n’est plus temps de se montrer récalcitrant, quand on s’est laissé entraver; il faut se garder d’engager imprudemment sa liberté, mais après qu’on en a accepté les obligations, il faut observer les lois d’un devoir qui est réciproque, ou au moins faire effort à cet effet.—Ceux qui se prêtent à ce marché avec des sentiments 203 de haine et de mépris, en agissent d’une façon fort injuste, qui deviendra pour eux une source de difficulté; et les femmes qui acceptent comme un oracle sacré, cette belle règle que je les vois se passer de mains en mains: «Sers ton mari comme ton maître, et t’en garde comme d’un traître», ce qui veut dire: «Conserve vis-à-vis de lui une déférence contrainte, hostile et méfiante», se rallient à un cri de guerre et de défi qui, lui aussi, est injurieux et sera la source de relations difficiles. Je n’ai pas assez d’énergie pour me jeter dans une voie aussi épineuse; et à vrai dire, je n’en suis pas encore arrivé à cette perfection d’habileté et de galanterie d’esprit qui fait confondre raison avec injustice, et tourner en ridicule tout ordre, toute règle qui ne s’accordent pas avec mes désirs; de ce que je hais la superstition, je ne me jette pas, tête baissée, dans l’irréligion. Si on ne satisfait pas toujours au devoir, encore faut-il toujours le reconnaître et l’aimer; et c’est une trahison que de se marier, sans remplir ses obligations conjugales. Assez sur ce point, continuons.
Différence entre le mariage et l’amour; une femme peut céder à un homme dont elle ne voudrait pas pour mari.—Virgile nous dépeint un mariage où règne l’accord, qui satisfait aux convenances et dans lequel cependant il n’y a pas beaucoup de loyauté. A-t-il voulu dire qu’il n’est pas impossible de céder aux instigations de l’amour, tout en se réservant de satisfaire dans une certaine mesure aux devoirs matrimoniaux; qu’on peut manquer à ces devoirs, sans s’y dérober tout à fait? il y a des valets qui volent leurs maîtres, sans pour cela les haïr!—La beauté, l’opportunité, la destinée, car la destinée y met aussi la main: «Il y a une fatalité qui pèse sur ces organes que cachent nos vêtements, car si les astres ne te protègent, il ne te servira de rien d’avoir les plus belles apparences de virilité (Juvénal)», toutes ces causes font que l’épouse s’attache à un étranger, sans se livrer pourtant si complètement à lui qu’il ne subsiste encore quelque lien par lequel elle tient à son mari. Ce sont là deux idées distinctes, qui procèdent différemment et ne sauraient être confondues: Une femme peut se donner à tel individu qu’elle ne voudrait absolument pas pour époux, je ne dis pas en raison seulement de sa situation dans le monde, mais pour lui-même. Peu de gens ont épousé des amies, qui ne s’en soient repentis; cela se voit jusque dans l’autre monde; quel mauvais ménage a fait, dit-on, Jupiter avec sa femme qu’il avait connue avant le mariage et avec laquelle il avait déjà fait l’amour! C’est ce qui se traduit par: «Se soulager dans un panier et le mettre ensuite sur sa tête.» J’ai vu de mon temps dans des milieux fort honorables le mariage mettre fin à l’amour entre personnes qui le pratiquaient d’une façon immorale et scandaleuse; c’est qu’aussi ce sont là deux états qui relèvent de considérations qui sont bien loin d’être les mêmes. Nous sommes portés, de nous-mêmes, à deux choses différentes et qui se contrarient. Isocrate disait qu’Athènes était une ville qui plaisait, à la mode de ces femmes qu’on fréquente parce qu’elles 205 se prêtent à l’amour; chacun aimait à s’y promener et à y passer un moment, mais nul ne l’aimait en vue de l’épouser, c’est-à-dire pour y élire domicile et y passer sa vie.—J’ai vu avec dépit des maris haïr leurs femmes, pour cette seule raison qu’ils avaient des torts envers elles. Au moins ne faudrait-il pas les aimer moins parce qu’on s’est mis en faute; le repentir et la compassion devraient au contraire nous les rendre plus chères.
Nos lois sont trop sévères envers les femmes; nous voulons qu’elles maîtrisent leurs désirs plus ardents que les nôtres que nous n’essayons pas même pas de modérer.—Les buts poursuivis sont autres, ajoutait Isocrate, sans toutefois être incompatibles. Le mariage a pour lui son utilité, sa légitimité, son honorabilité, sa permanence; il procure un plaisir modéré, mais qui s’étend à tout. L’amour, lui, ne vise que le plaisir, mais il est vrai qu’il est plus excitant, plus vif, plus pénétrant; c’est un plaisir qu’attise la difficulté et où il faut du piquant, du mordant; ce n’est plus l’amour, s’il n’a ni ses flèches, ni son feu. Dans le mariage, les dames se donnent à nous avec trop de prodigalité, ce qui émousse l’acuité de notre affection et de nos désirs. Voyez combien, pour éviter cet inconvénient, Lycurgue et Platon se donnent de peine dans leurs lois.
Les femmes ne sont pas du tout dans leur tort, quand elles refusent de reconnaître les règles de conduite qu’a posées la société, d’autant que ces règles faites par les hommes, l’ont été sans leur participation. Par la force même des choses, ce sont constamment entre elles et nous des finasseries et de petites querelles; et dans les moments mêmes où, d’un consentement réciproque, nous sommes le plus étroitement unis à elles, il y a désordre et dispute. De l’avis de ce même Isocrate, nous ne tenons pas suffisamment compte de ce que nous savons cependant bien, que la femme est, sans comparaison, plus ardente que l’homme aux effets de l’amour. Ce prêtre de l’antiquité, qui fut tantôt homme, tantôt femme et «connaissait les plaisirs des deux sexes (Ovide)», en a témoigné.—Nous avons aussi à cet égard les déclarations que nous tenons de leur propre bouche, faites autrefois en des siècles différents, par un empereur et une impératrice de Rome, passés maîtres et des plus fameux en la matière: lui, en une nuit, dépucela il est vrai jusqu’à dix vierges sarmates ses captives; mais elle, dans le même laps de temps, se livra bel et bien vingt-cinq fois, changeant de compagnie suivant qu’il en était besoin, ou que la fantaisie l’en prenait: «jusqu’à ce que, épuisée mais non rassasiée, elle dût s’arrêter brûlante encore de volupté (Juvénal)».—Relevons également le différend soulevé en Catalogne par une femme qui se plaignait des assauts par trop répétés qu’elle avait à subir de la part de son mari; plainte motivée, suivant moi, moins par l’incommodité qu’elle en éprouvait (c’eût été là un miracle et je ne crois aux miracles qu’en matière de foi), que pour, en se soustrayant partiellement sous ce prétexte à cet acte base fondamentale du mariage, contester l’autorité du mari sur 207 la femme et montrer que l’humeur querelleuse et la malice de ce sexe vont plus loin que la couche nuptiale et foulent aux pieds jusqu’aux dons et aux douceurs dont nous sommes redevables à Vénus. A cette plainte, le mari, doué, à la vérité, d’un tempérament exceptionnellement brutal, répondait que, même les jours de jeûne, il ne savait se passer de l’approcher moins de dix fois. L’affaire donna lieu à cet arrêt singulier de la reine d’Aragon, rendu après mûre délibération du conseil, par lequel cette bonne souveraine, afin d’établir une règle et fixer les idées sur la modération et la réserve à apporter en tous temps, dans les rapports entre époux légalement unis, ordonnait comme limite légitime et nécessaire de ces rapprochements le nombre de six par jour; le dit arrêt, disait la reine, restreignant et sacrifiant de beaucoup les besoins et les désirs de son sexe «pour établir une règle d’application facile et par conséquent permanente et immuable». Sur quoi, les docteurs comparant ces besoins avoués à ceux de l’homme, de s’écrier: «Quels doivent donc être l’appétit et l’ardeur amoureuse de la femme, puisqu’il faut en arriver à ce degré, pour y satisfaire dans des conditions raisonnables, prévenir tout écart et sauvegarder leur vertu», alors que Solon, le modèle de ceux qui veulent que toute chose soit réglée par la loi, ne taxe cette fréquentation de la femme par le mari qu’à trois fois par mois, afin que celui-ci soit toujours en mesure de remplir ce devoir!—Et c’est, dis-je, nonobstant cette donnée, et tout en admettant que chez la femme les besoins de cette nature sont plus grands que chez l’homme, que nous avons été leur imposer la continence, à elles exclusivement, allant jusqu’à édicter à cet égard les châtiments les plus sévères et même la peine de mort.
Il n’y a pas de passion plus impérieuse, et nous nous opposons à ce qu’elles en tempèrent les effets ou reçoivent entière satisfaction.—Il n’y a pas de passion plus impérieuse que celle-ci à laquelle nous voulons qu’elles seules résistent, non simplement dans la mesure que cela comporte, mais comme à un vice abominable, exécrable, pire que l’irréligion et le parricide; tandis que nous autres hommes, nous nous y abandonnons sans que ce soit pour nous une faute, sans que cela nous vaille un reproche. Ceux d’entre nous qui ont essayé d’en triompher, ont assez avoué quelle difficulté ils ont éprouvée, ou plutôt en quelle impossibilité ils ont été d’y parvenir, bien qu’ayant eu recours à un régime spécial pour mater, affaiblir et refroidir les révoltes de la chair; et elles, nous les voulons, au contraire, bien portantes, vigoureuses, bien à point, en bonnes dispositions et chastes tout à la fois; c’est-à-dire chaudes et froides en même temps!—Le mariage qui, à ce que nous prétendons, doit les empêcher de se consumer, leur procure en l’état de nos mœurs bien peu d’apaisement: si le mari qu’elles prennent est encore à un âge où le sang bouillonne, il se fera gloire de se dépenser ailleurs: «Aie enfin de la pudeur, Bassus, ou allons en justice; tu m’as vendu cet organe, je l’ai payé très cher, il n’est donc plus à toi (Martial).» C’est à bon droit 209 que Polémon le philosophe fut cité en justice par sa femme, parce qu’il allait semant en terrain stérile la semence qu’il eût dû répandre en terrain propice à la fécondation. Quant aux femmes qui épousent des hommes usés, elles sont, bien que mariées, dans une condition pire que les vierges et les veuves. Nous les tenons pour suffisamment loties, dès qu’elles ont un homme auprès d’elles, comme firent les Romains quand ils tinrent pour violée Clodia Læta que Caligula avait approchée, quoiqu’il fût avéré qu’il ne l’avait pas possédée, tandis qu’au contraire, par là, on avive en elles ce besoin de la nature, l’attouchement et la compagnie d’un mâle quel qu’il soit, réveillant la chaleur de leurs sens, qui demeureraient plus calmes si on les laissait seules. Aussi, est-ce vraisemblablement dans le but de rendre, par ce moyen et ses effets, leur chasteté plus méritoire, que Boleslas roi de Pologne et Kinge sa femme, selon un vœu formé de commun accord le jour même de leurs noces, se privèrent, bien que couchant ensemble, ce jour-là et à tout jamais, des satisfactions que leur permettait le mariage.
L’éducation qu’on donne aux jeunes filles, tout opposée à ce qu’on exige d’elles, éveille constamment en elles ce sentiment; elles n’entendent parler que d’amour et ce qu’on leur en cache, souvent maladroitement, elles le devinent.—Nous les formons dès l’enfance en vue de les préparer à l’amour; leurs grâces, leur parure, leur savoir, leur langage, toute leur éducation sont dirigés en conséquence; leurs gouvernantes ne cessent d’en entretenir leur imagination, ne serait-ce qu’en s’appliquant continuellement à les en dégoûter. Ma fille (le seul enfant que j’aie) est à l’âge où les lois tolèrent que se marient celles chez lesquelles les sens parlent de bonne heure; son développement est tardif, elle est fluette et d’un tempérament lymphatique, contre lequel ne réagit pas sa mère qui l’élève près d’elle, la produisant peu, si bien qu’elle ne fait que commencer à se défaire des naïvetés de l’enfance. Elle lisait ces jours-ci, devant moi, un livre français où se rencontrait le mot «fouteau», qui sert parfois à désigner un arbre assez connu; la femme chargée de s’occuper d’elle, l’arrêta court et assez rudement sur ce mot à double sens, lui faisant sauter le passage scabreux où il figurait. Je la laissai faire pour ne pas troubler sa manière ordinaire de procéder dans laquelle je n’interviens pas; mais il faut convenir que la direction imprimée à la femme est bien singulière et qu’elle est à changer. Ou je me trompe bien, ou la fréquentation de vingt laquais pendant six mois n’aurait pas fait travailler l’imagination de ma fille pour trouver l’usage et la signification de l’autre sens de ces syllabes incriminées, comme le fit cette bonne vieille par sa réprimande et son interdiction de les prononcer: «La vierge nubile se plaît à apprendre des danses lascives, jusqu’à s’en courbaturer les membres; elle rêve dès l’enfance à des amours impudiques (Horace).»—Lorsque les femmes viennent à se relâcher un peu de leur attitude cérémonieuse, qu’elles se laissent aller à parler en toute liberté, nous 211 ne sommes que des enfants, comparés à elles, sous le rapport de ce qu’elles savent sur ce sujet. Écoutez-les causer de nos poursuites et des propos que nous leur tenons, vous arriverez bientôt à vous convaincre que nous ne leur apprenons rien qu’elles ne sachent et sur quoi elles ne soient éclairées autrement que par nous. Serait-ce, comme le dit Platon, parce que, dans une vie antérieure, elles ont été garçons et adonnées à la débauche? Je me trouvais une fois dans un endroit, d’où j’entendais, sans que ma présence pût être soupçonnée, une conversation qu’elles tenaient; que ne puis-je la reproduire? Sainte Vierge, me dis-je, nous pouvons bien, à cette heure, pour acquérir de l’habileté, étudier les phrases d’Amadis et les vocabulaires de Boccace et de l’Arétin, c’est vraiment bien employer notre temps! Il n’est pas un mot, pas un acte, pas une rouerie qu’elles ne connaissent mieux que nos livres ne les relatent; elles ont cela dans le sang, «Vénus elle-même le leur a inspiré (Virgile)»; ces bons maîtres d’école que sont la nature, la jeunesse, la santé le leur soufflent continuellement dans l’âme, elles n’ont que faire de l’apprendre, elles l’engendrent: «Jamais colombe, ou tel autre oiseau plus lascif encore que vous pourrez nommer, n’a, par de douces morsures, sollicité plus amoureusement les baisers, qu’une femme qui s’abandonne à sa passion (Catulle).»
Du reste, c’est l’amour, c’est l’union des sexes qui est la grande affaire de ce monde; aussi ne faut-il pas s’étonner si les plus grands philosophes ont écrit sur ce sujet.—Si la fougue naturelle de leurs désirs n’eût été un peu tenue en bride par la crainte et les idées d’honneur qu’on leur a inculquées, nous prêterions tous au ridicule. Tout le mouvement du monde a cette conjonction des sexes pour objectif et aboutit à elle; elle se retrouve partout; elle est le centre vers lequel tendent toutes choses. Il subsiste encore des ordonnances de Rome antique et sage, traitant de questions afférentes à l’amour; Socrate donne des préceptes pour l’instruction des courtisanes; «souvent ces petits livres qui tiennent sur les coussins de soie de nos belles, sont l’ouvrage de Stoïciens (Horace)». Zénon, dans ses lois, va jusqu’à parler des écarquillements et des secousses qui se produisent dans le dépucelage. Sur quoi portaient le livre du philosophe Straton, intitulé «l’Œuvre de chair»; ceux de Théophraste ayant pour titre, l’un «l’Amoureux», l’autre «de l’Amour»; celui d’Aristippe, «Délices des temps passés»? A quoi tendaient les descriptions si étendues, si imagées de Platon, des pratiques amoureuses * autrement éhontées, auxquelles on se livrait de son temps; l’ouvrage «de l’Amoureux», de Démétrius de Phalère; «Clinias, ou l’amoureux malgré lui», d’Héraclide du Pont; celui d’Antisthène, «des Noces ou l’art de faire les enfants»; et cet autre du même auteur, «du Maître et de l’amant»; celui d’Ariston, «des Ébats amoureux»; ceux de Cléanthe, «de l’Amour» et «de l’Art d’aimer»; les dialogues amoureux de Sphéreus; la fable, effrontée au dernier point, de Jupiter et de Junon, par Chrysippe, et les cinquante lettres si 213 lascives qu’il a écrites? Je laisse de côté les ouvrages des philosophes de l’école d’Épicure, qui était favorable à la volupté et la prônait.—Aux temps anciens, cinquante divinités étaient préposées à cet acte, et il a existé une nation où, pour endormir la concupiscence de ceux qui venaient faire leurs dévotions, on avait dans les temples des filles * et des garçons dont on pouvait se procurer la jouissance; il entrait dans le cérémonial du culte, d’en user avant d’approcher des autels: «Parce que l’incontinence est nécessaire pour observer la continence, et que l’incendie s’éteint par le feu.»
Dans l’antiquité, les organes de la génération étaient déifiés; aujourd’hui comme alors, tout, du fait de l’homme comme de celui de la nature, rappelle constamment l’amour aux yeux de chacun.—Dans la majeure partie du monde, cette pièce de notre corps était déifiée; dans une contrée, il y en avait qui se l’écorchaient pour en offrir et en consacrer quelque parcelle à la divinité, tandis que c’était leur semence que d’autres offraient et consacraient. Dans une autre région, les jeunes gens se la perçaient en public et, dans les ouvertures ainsi pratiquées, introduisaient, entre la peau et la chair, des broches en bois, les plus longues et les plus grosses qu’ils pouvaient endurer, qu’ils brûlaient ensuite en holocauste à leurs dieux; ceux qui tressaillaient sous l’intensité de cette cruelle douleur, étaient jugés n’être ni vigoureux, ni chastes. Ailleurs, la désignation du grand pontife et la considération dont il jouissait, étaient basées sur la dimension de cet organe, dont l’effigie, dans les cérémonies en l’honneur de certaines divinités, était promenée en grande pompe.—En Égypte, à la fête des Bacchanales, les dames en portaient au cou une image en bois d’une grande richesse d’ornementation, de fortes proportions et lourde suivant la force de chacune; en outre, la statue du dieu en présentait un qui excédait presque en dimension le reste du corps.—Près de nous, les femmes mariées en font prendre, sur leur front, la forme à leur voilette, pour se glorifier de la jouissance qu’elles en ont; et si elles deviennent veuves, elles le rejettent en arrière sous leur coiffure où il se perd.—A Rome, les matrones les plus sages tenaient à honneur d’offrir des fleurs et des couronnes au dieu Priape; et, le jour de leurs noces, on faisait asseoir celles qui étaient vierges sur les parties les moins honnêtes de sa statue.—Je ne sais trop si, de nos jours, on ne peut relever certaines pratiques se rattachant à cette même dévotion? Quelle signification avait cette pièce ridicule des hauts de chausses ou culotte de nos pères, qui se voit encore dans ceux que portent nos Suisses? Dans quel but, à l’heure actuelle, faisons-nous que, sous ce vêtement, nos parties génitales se dessinent d’une façon si apparente et, ce qui est pire, accroissant souvent par artifice et imposture leur dimension naturelle? Je suis porté à croire que cette disposition a été inventée dans des siècles meilleurs où régnait plus de bonne foi qu’aujourd’hui, pour ne tromper personne 215 et que chacun apparût en public tel qu’il était, comme il arrive encore chez les peuples de mœurs plus simples, qui portent des vêtements accusant dans leur réalité les formes des parties qu’elles recouvrent, ce qui permettait d’apprécier l’ouvrier par ce dont il semblait capable, comme sous d’autres rapports nous le jugeons d’après les proportions de son bras ou de son pied.—Ce bonhomme qui, au temps de ma jeunesse, fit, dans sa capitale, châtrer tant de belles et antiques statues, pour qu’elles ne blessent pas la vue, appliquant cette maxime de cet autre non moins pudibond de l’antiquité: «C’est une cause de déréglements, que d’étaler en public des nudités (Ennius)», eût dû s’aviser aussi que, comme dans la célébration des mystères de la bonne déesse d’où tout ce qui rappelait le sexe masculin était banni, cela ne l’avançait en rien, s’il ne faisait encore châtrer les chevaux, les ânes, toute la nature enfin: «Sur la terre, les hommes, les bêtes fauves, les animaux domestiques; dans l’eau, les poissons; dans l’air, les oiseaux aux mille couleurs, tout brûle, tout éprouve les fureurs de l’amour (Virgile).» Les dieux, dit Platon, nous ont pourvus d’un membre qui ne connaît pas l’obéissance et qui nous tyrannise; qui, comme un animal furieux, prétend, dans la violence de ses appétits, tout soumettre à lui; les femmes ont pareillement le leur qui, à la façon d’un animal glouton et avide, délire quand on lui refuse des aliments alors que le moment de lui en donner est venu, et ne souffre pas qu’on le fasse attendre; il fait passer en leur corps la rage qui l’anime, il en trouble le fonctionnement, arrête la respiration, est cause de mille maux de toutes sortes, jusqu’à ce qu’ayant aspiré le fruit de la soif commune qui dévore et l’homme et la femme, il en ait largement arrosé et ensemencé le fond de la matrice.
Mieux vaudrait renseigner de bonne heure la femme sur les choses de l’amour que de laisser son imagination travailler; en somme, dans toutes les règles qu’il a édictées à ce sujet, l’homme n’a que lui-même en vue.—Ce même législateur, qui ordonna cet acte de vandalisme, eût bien dû s’aviser aussi que ce serait peut-être une mesure plus chaste et d’un résultat plus certain, de renseigner de bonne heure les femmes sur ce qui en est, plutôt que de laisser leur esprit livré à lui-même et, plus ou moins échauffé, chercher à deviner; le désir, l’espérance leur font substituer à la réalité des conceptions trois fois plus extravagantes; j’ai connu quelqu’un qui s’est perdu, pour avoir fait en lui la découverte de ce don de la nature en un lieu où il ne convenait pas d’en user dans toute la mesure où, en vue du rôle auquel il est destiné, nous en avons la possibilité.—Que de mal font ces images monstrueuses que les enfants en tracent sur les murs et les portes des édifices publics! cela induit la femme à un cruel mépris à notre égard quand elle constate la disproportion avec ce dont la nature nous a gratifiés. Sait-on si Platon n’a pas été guidé par cette considération quand, à l’instar d’autres républiques 217 dont les institutions sont des modèles, il ordonnait que, dans les gymnases où se pratiquaient les exercices physiques, hommes et femmes, quel que fût l’âge, se présentassent nus aux yeux les uns des autres.—Les Indiennes qui, continuellement, voient les hommes ainsi, se trouvent, de ce fait, avoir au moins un de leurs sens, celui de la vue, qui échappe à toute exagération. Dans ce grand royaume de Pégu, elles n’ont elles-mêmes, pour se couvrir, à partir de la ceinture, qu’une bande d’étoffe fendue sur le devant et tellement étroite que, quels que soient les efforts qu’elles peuvent faire pour sauvegarder la décence, à chaque pas elles sont complètement à découvert. Bien qu’on dise que c’est là un usage ayant pour but d’attirer les hommes à elles et de distinguer les sexes chez ce peuple, où chacun est libre de s’abandonner à ses instincts, il se pourrait que cette coutume aboutît à un effet contraire à ce que l’on en attend; la faim demeurée entière est plus pénible à supporter que si elle a déjà été en partie satisfaite, comme cela arrive dans le cas actuel, au moins par les yeux; c’est ce qui faisait dire à Livie que, pour une honnête femme, un homme nu n’est pas plus qu’une image.—Les Lacédémoniennes, qui, femmes, étaient plus vierges d’imagination que ne sont nos filles, voyaient tous les jours les jeunes gens de leur ville dépourvus de tout vêtement, quand ils se livraient à leurs exercices; elles-mêmes ne prenaient guère soin, quand elles marchaient, que leurs cuisses demeurassent couvertes, estimant, comme fait Platon, que leur vertu les protégeait assez, sans qu’il fût encore besoin de jupes bouffantes. Par contre ceux-là, dont parle saint Augustin, ont attribué un pouvoir prodigieux à la tentation que fait naître la nudité, qui mettent en doute si, au jugement universel, les femmes conserveront leur sexe à la résurrection ou prendront le nôtre, pour ne pas nous induire encore en tentation quand nous jouirons de la béatitude éternelle.—En résumé, on les provoque et on les surexcite par tous les moyens; sans cesse nous échauffons et nous excitons leur imagination, puis nous en faisons reproche à leur ventre. Confessons donc la vérité: il n’en est guère parmi nous qui ne redoute plus la honte qui peut lui advenir par les fautes de sa femme que par les siennes; qui ne se préoccupe plus (ô merveilleuse charité!) de la conscience de son épouse qu’il veut irréprochable, que de la sienne; qui ne préférerait être lui-même un voleur et un sacrilège et que sa femme fût meurtrière et hérétique, que de ne pas la voir plus chaste que son mari; quelle inique appréciation du vice! Nous et elles sommes capables de mille corruptions, qui causent plus de dommages et sont plus contraires aux lois naturelles que n’est la luxure, mais nous estimons qu’une chose constitue un vice, et un vice plus ou moins grave, non d’après sa nature, mais selon notre intérêt; et c’est là la raison pour laquelle il y a tant d’inégalité dans nos appréciations sur son degré de gravité.
Il est bien difficile, dans l’état actuel de nos mœurs, 219 qu’une femme soit toujours chaste et fidèle.—La rigueur que nous avons édictée contre la femme qui succombe à ces tentations, leur en fait un crime beaucoup plus grand que cela ne vaut et a pour elles des conséquences hors de proportion avec la chose elle-même; mieux leur vaudrait aller au palais plaider pour faire fortune, ou à la guerre conquérir un grand nom, plutôt que d’avoir charge, au milieu de l’oisiveté et des satisfactions de tous genres, de faire une défense si difficile. Ne voient-elles pas qu’il n’y a ni marchand, ni procureur, ni soldat qui ne quittent leurs occupations professionnelles pour se livrer à cette autre guerre dirigée contre elles, et qu’il en est de même du moindre crocheteur, du plus misérable savetier, si harcelés et épuisés qu’ils soient par le travail et la faim? «Tous les trésors d’Achéménès, toutes les richesses de l’Arabie et de la Phrygie, pourraient-ils payer un seul des cheveux de Licymnie dans ces doux moments où, tournant la tête, elle apporte sa bouche à tes baisers, ou que, par un doux caprice, elle refuse ce qu’elle veut se laisser ravir, sauf à te prévenir bientôt elle-même (Horace)?» Je ne sais si les exploits de César et d’Alexandre surpassent en difficulté la résolution d’une femme jeune et belle, élevée à notre façon, dans la fréquentation d’un monde où elle brille, ayant contre elle tant d’exemples contraires et se maintenant dans toute sa pureté, au milieu de mille poursuites continues et pressantes. Rien de ce qu’elle pourrait faire n’est aussi épineux et n’exige qu’elle se démène davantage que ce qu’elle ne fait pas. Je trouve plus aisé de porter toute la vie une cuirasse qu’un pucelage; et c’est parce qu’il est le plus pénible de tous, que le vœu de virginité est le plus noble: «La puissance de Satan a son siège dans les rognons,» dit S. Jérôme.
Elles n’en ont que plus de mérite lorsqu’elles parviennent à demeurer sages, mais ce n’est pas en se montrant prudes et revêches qu’elles feront croire davantage à leur vertu; l’indiscrétion des hommes est un grand tourment pour elles.—Certes le plus ardu des devoirs imposés à l’humanité, celui qui nécessite le plus d’efforts, nous l’avons abdiqué entre les mains des dames et leur en abandonnons la gloire. C’est là un stimulant suffisamment puissant pour qu’elles s’opiniâtrent à l’observer, et un terrain éminemment favorable pour nous défier et fouler aux pieds cette illusoire supériorité de valeur et de vertu que nous prétendons avoir sur elles; pour peu qu’elles veillent à ne pas s’en départir, elles y gagnent non seulement une plus grande estime, mais encore qu’on les aime davantage. Un galant homme ne discontinue pas ses poursuites parce qu’il a éprouvé un refus, si ce refus est motivé par la chasteté et non parce qu’il ne plaît pas; nous avons beau jurer, menacer et nous plaindre, nous ne les en aimons que mieux, et mentons quand nous affirmons le contraire; il n’est rien qui nous attire davantage qu’une femme qui se maintient sage sans cesser d’être douce et bienveillante. Il est lâche et stupide de persister à poursuivre de ses assiduités une femme qui vous témoigne 221 de la haine et du mépris; mais vis-à-vis de celle qui ne vous objecte qu’une résolution dictée de parti pris par la vertu et à laquelle se mêle de sa part de la gratitude, ne pas rompre toute relation est le fait d’une âme noble et généreuse. Il est possible à la femme de nous être, dans une certaine mesure, reconnaissante de nos attentions et de nous marquer, sans manquer aux règles de l’honnêteté, qu’elle ne nous dédaigne pas; cette loi qu’on leur fait de nous avoir en horreur parce que nous les adorons, de nous haïr parce que nous les aimons, est cruelle, ne serait-ce que par sa difficulté d’application. Pourquoi n’écouteraient-elles pas nos offres et nos demandes, si elles ne transgressent pas ce dont la modestie leur fait un devoir? est-ce parce qu’on suppose qu’en elles résonne quelque sens que ces propos peuvent émoustiller? Une reine, de nos jours, disait avec beaucoup d’esprit que «refuser de prêter l’oreille à ces avances, est un témoignage de faiblesse, c’est dénoncer sa propension à céder, et qu’une dame qui n’a pas été exposée à la tentation, ne peut se vanter de la chasteté qu’elle a gardée».—L’honneur n’est pas renfermé dans de si étroites limites; il peut se détendre, se donner quelque liberté sans se rendre coupable; au delà de son domaine, il est une zone neutre où l’on est libre, où ce qui se passe est sans conséquence; qui a pu le chasser et l’acculer aux confins extrêmes pour arriver à vaincre sa résistance finale, est bien difficile, s’il n’est satisfait d’une semblable fortune; l’importance du succès se mesure à la difficulté surmontée. Voulez-vous savoir l’impression que vous faites sur le cœur d’une femme par vos hommages et vos mérites? jugez-en d’après son caractère. Telle donne plus, qui ne donne pas autant; une faveur vaut uniquement par le prix qu’y attache celle qui l’octroie; les autres circonstances qui l’accompagnent ne sont que des accidents fortuits qui n’y ajoutent rien, et sont comme si elles n’existaient pas; le peu que celle-là concède, peut lui coûter plus à donner, qu’à sa compagne de se livrer tout entière. Si en quelque chose la rareté ajoute au prix d’un objet, c’est bien ici; ne regardez pas combien peu vous obtenez, mais combien peu l’ont obtenu; la valeur d’une pièce de monnaie dépend du lieu où elle a été frappée et de la marque qu’elle porte.—Quelque chose que le dépit et l’indiscrétion de quelques-uns les amènent à dire dans l’excès de leur mécontentement, toujours la vertu et la vérité finissent par reprendre le dessus. J’ai vu des femmes dont la réputation était demeurée longtemps injustement compromise, regagner l’approbation de tous en persévérant tout simplement dans leur ligne de conduite, sans qu’elles se soient préoccupées de ce qui pouvait se dire, ni recourir à aucun artifice; chacun en vint à se repentir et à confesser son erreur. Alors qu’elles n’étaient pas mariées, on les avait un peu en suspicion; devenues dames, elles tiennent aujourd’hui le premier rang parmi celles que l’on estime.—Quelqu’un disait à Platon: «Tout le monde parle mal de vous.—Laissez dire, répondit-il, je vivrai de façon qu’il faudra bien que l’on change de langage.»—Outre 223 que la crainte de Dieu et la valeur d’une gloire qui s’acquiert si rarement doivent les inciter à ne pas succomber, la corruption de ce siècle leur en fait une obligation; et si j’étais à leur place, il n’y a rien que je ne fisse plutôt que de livrer ma réputation à la merci de gens si dangereux. De mon temps, le plaisir de conter ses bonnes fortunes (plaisir qui ne doit guère le céder en douceur à la chose elle-même) n’était permis qu’à ceux qui avaient un ami unique et fidèle, qu’ils prenaient pour confident; à présent, dans les réunions et à table, on passe le temps à se vanter des faveurs obtenues et l’on révèle les plus intimes secrets de l’alcôve. C’est vraiment trop d’abjection et de bassesse de cœur, que de révéler ainsi ouvertement et donner en pâture aux commentaires et à la malignité de tous, ces épanchements intimes si tendres, si délicats; c’est le fait de personnes ingrates, indiscrètes et volages.
La jalousie est une passion inique; le préjugé qui nous fait regarder comme une honte l’infidélité de la femme, n’est pas plus raisonnable.—Notre exaspération inique et immodérée contre les faiblesses de la femme, vient de cette maladie qu’est la jalousie, la plus malsaine d’entre celles qui affligent l’âme humaine en laquelle elle soulève les plus violents orages. «Qu’est-ce qui empêche de prendre de la lumière à la lumière? celle-ci s’en trouve-t-elle diminuée (Ovide)?» La jalousie et l’envie sa sœur me paraissent les plus ineptes de toutes nos infirmités morales. De cette dernière, qui passe pour être une passion si tenace et si puissante, je ne puis guère parler ne l’ayant, Dieu merci, jamais ressentie; quant à la jalousie, je la connais au moins de vue. Les bêtes l’éprouvent: Une de ses chèvres étant tombée amoureuse du berger Cratis, son bouc, par jalousie, vint, pendant qu’il dormait, choquer sa tête contre la sienne et la lui écrasa.—Nous avons, à l’exemple de certaines nations barbares, exagéré cette fièvre; comme de juste, les âmes les mieux disciplinées n’y échappent naturellement pas, mais sans en perdre la raison: «Jamais un homme adultère, percé de l’épée d’un mari, n’a rougi de son sang les eaux du Styx (Jean Second).» Lucullus, César, Pompée, Antoine, Caton et autres de bravoure incontestable, furent des maris trompés et le surent, sans en faire autrement de tapage; il n’y eut, à cette époque, qu’un Lépide qui fut assez sot pour s’en tourmenter au point d’en mourir: «Malheureux! si ton mauvais destin veut que tu sois pris sur le fait, tu seras traîné par les pieds hors du logis, et par les voies qui leur seront ménagées, raves et surmulets s’introduiront en toi (Catulle)!»—Quand Vulcain, au dire du poète, surprit sa femme avec un autre dieu, il se contenta de les livrer tous deux à la risée de tous les autres dieux, «ce qui fit dire à l’un d’eux des moins austères, qu’il consentirait bien, lui aussi, à subir une telle honte (Ovide)». Vulcain ne se dérobe pas, pour cela, aux * douces caresses que lui offre l’infidèle et, tout en se réchauffant sur son sein, lui reproche la défiance dont, en raison de cette vengeance maritale, semble empreinte son affection: «A quoi bon tant de détours? 225 pourquoi, déesse, ne pas vous fier à votre époux (Virgile)?» Quant à elle, elle lui adresse une requête pour Enée, un de ses bâtards: «C’est une mère qui vous demande des armes pour son fils (Virgile)»; ce qu’il lui accorde généreusement, s’exprimant en outre de la façon la plus honorable sur ce rejeton: «Il s’agit de faire des armes pour un héros (Virgile).» C’est là, à la vérité, une abnégation qui dépasse ce dont l’homme est capable, et je conviens qu’un tel excès de mansuétude demeure l’apanage des dieux; «on ne saurait, en effet, établir de comparaison entre les hommes et eux (Catulle)».
Chez la femme, la jalousie est encore plus terrible que chez l’homme; elle pervertit tout ce qu’il y a en elle de beau et la rend susceptible des plus grands méfaits.—Pour ce qui est de la confusion qui en résulte entre les enfants, fruits de ces unions tant légitimes qu’illégitimes, outre que les plus graves législateurs ordonnent de n’en pas tenir compte et ont fait prévaloir cette manière de faire dans toutes les constitutions qu’ils ont données, cela ne touche pas les femmes qui, elles, n’ont pas d’hésitation sur ceux qui leur appartiennent; plus que nous cependant, et je ne sais comment cela se fait, elles sont en proie à cette passion: «Souvent la jalousie de Junon ne trouva que trop à s’exercer dans les infidélités quotidiennes de son époux (Catulle).»—Lorsque la jalousie s’empare de ces pauvres âmes faibles et incapables de résistance, c’est pitié avec quelle cruauté elle les tiraille et les tyrannise; elle s’introduit en elles sous couleur d’amitié; mais, une fois dans la place, les mêmes causes qui, auparavant, faisaient éclore leur bienveillance, deviennent des sujets de haine mortelle. Elle est, d’entre les maladies de l’esprit, celle à laquelle tout fournit le plus d’aliments et qui comporte le moins de remède: la santé, la vertu, le mérite, la réputation du mari sont autant de prétextes qui surexcitent leur dépit et leur rage: «Il n’y a pas de haines plus implacables que celles de l’amour (Properce).» Cette fièvre enlaidit et corrompt tout ce que, sous d’autres rapports, il y a de beau et de bon en elles. Tout ce que fait une femme jalouse, si chaste, si bonne ménagère soit-elle, a quelque chose d’aigre et d’importun; elle est possédée d’une agitation enragée qui indispose contre elle, produisant un effet tout contraire à ce qu’elle en attend. Ce fut bien le cas, à Rome, d’un certain Octavius: il avait couché avec Pontia Posthumia; son affection pour elle s’accrut par la jouissance qu’il en avait eue. Il lui adressa instances sur instances pour qu’elle consentit à l’épouser; ne pouvant l’y décider, l’amour extrême qu’elle lui inspirait, le porta à agir comme s’il eût été son plus cruel et mortel ennemi, il la tua.—Les symptômes ordinaires de cette maladie inhérente à l’amour, sont de même ordre; ce sont des haines intestines, de sourdes menées, des complots incessants: «on sait jusqu’où peut aller la fureur d’une femme (Virgile)»; c’est une rage qui se ronge elle-même, d’autant plus que, pour excuser ses méfaits, elle est obligée de se couvrir d’intentions bienveillantes à l’égard de celui qu’elle poursuit.
227
La chasteté est-elle chez la femme une question de volonté? Pour réussir auprès d’elles tout dépend des occasions, et il faut savoir oser; du reste, ce que nous entendons leur interdire est assez mal défini.—La chasteté est un devoir susceptible d’une grande extension. Est-ce par exemple la volonté de la femme que, par elle, nous cherchons à maîtriser? Si c’est sa volonté: sa souplesse, sa soudaineté font qu’elle est beaucoup trop prompte à exécuter ce qu’elle conçoit, pour que la chasteté ait possibilité de l’arrêter. Un songe suffit pour l’engager au point qu’elle ne peut se dédire. Il n’est pas en son pouvoir de se défendre par elle-même contre les concupiscences et les désirs, même avec l’aide de la chasteté qui, elle aussi du sexe féminin, est de ce fait en butte aux mêmes assauts. Si, seule, sa volonté nous importe, où cela nous conduit-il? Supposez quelqu’un de nous, sans yeux ni langue, ayant le don de se trouver à point nommé, ne voyant pas, ne parlant pas, dans la couche de toute femme disposée à lui faire bon accueil; avec quel empressement elles le rechercheraient! Les femmes scythes ne crevaient-elles pas les yeux à leurs esclaves et à leurs prisonniers de guerre, pour pouvoir en user plus librement et sans être reconnues.—Oh! quel immense avantage que de savoir profiter de l’occasion. A qui me demanderait ce qui importe le plus en amour, je répondrais que c’est tout d’abord de savoir saisir le moment opportun; en second lieu cela encore, et, en troisième lieu toujours cela. C’est de là que tout dépend.—Il m’est arrivé souvent de manquer une bonne fortune; parfois, pour n’avoir pas été assez entreprenant; que Dieu garde de tout mal quiconque, à cet égard, en est encore à se moquer de moi! En ce siècle, il faut plus de témérité que je n’en ai, témérité dont les jeunes gens s’excusent en la mettant sur le compte de la chaleur qui les transporte, mais que, si elles y regardaient de près, les femmes reconnaîtraient provenir plutôt du mépris qu’on a pour leur vertu. C’était une superstition chez moi que de craindre de les offenser, car je suis porté à respecter ce que j’aime; de plus, indépendamment de ce qu’en pareille circonstance un manque de respect déprécie la faveur qui nous est faite, j’aime qu’on s’y comporte un peu comme un enfant, qu’on se montre timide et qu’on soit aux petits soins.—J’ai d’ailleurs, sinon toute, du moins quelque peu de cette honte qui est sottise dont parle Plutarque, et j’ai eu à en pâtir et à le regretter sous maints rapports dans le cours de ma vie; c’est là un défaut qui s’accorde assez mal avec ma nature en général, mais ne sommes-nous pas un composé de sentiments et d’idées en perpétuelle contradiction? J’ai de la peine quand j’éprouve un refus, comme aussi lorsque c’est moi qui refuse; il m’en coûte tant de causer de la contrariété à autrui, que dans les occasions où c’est un devoir pour moi d’essayer de décider quelqu’un à une chose qui lui est pénible et où l’hésitation est permise, je n’insiste que faiblement et à contre-cœur. Dans les affaires de ce genre où je suis directement intéressé, bien qu’Homère dise avec 229 raison «que chez un indigent la honte est une sotte vertu», je charge d’ordinaire un tiers de subir ce désagrément à ma place, de même que je décline toute mission de ce genre quand on veut m’y employer; car ma timidité est telle sur ce point qu’il m’est arrivé parfois d’avoir la volonté de refuser et de n’en avoir pas la force.
Donc c’est folie d’entreprendre de combattre chez les femmes un désir si cuisant et si naturel. Aussi lorsque je les entends se vanter que, de par leur volonté, leur imagination est demeurée vierge et insensible, je me moque d’elles, elles reculent par trop. Si c’est une vieille décrépite, n’ayant plus de dents, ou une jeune qui soit étique et s’en aille de la poitrine qui tient ce langage, elles peuvent avoir l’apparence de dire vrai sans toutefois être complètement à croire; mais dans la bouche de celles qui se meuvent et respirent encore, c’est vouloir trop prouver, elles n’en rendent leur vertu que plus suspecte. Les excuses inconsidérées qu’elles mettent en avant témoignent contre elles, comme il arriva à un gentilhomme de mes voisins qu’on soupçonnait d’impuissance, «insensible aux plus lascives caresses, jamais il n’avait donné le moindre signe de vigueur (Catulle)». Trois ou quatre jours après ses noces, ce gentilhomme, pour faire croire aux moyens qui lui manquaient, jurait sans sourciller que vingt fois dans la nuit précédente il avait approché sa femme, propos dont on usa depuis pour le convaincre que jamais il ne l’avait connue et casser son mariage. Une pareille assertion ne signifie rien, puisqu’il ne saurait y avoir ni continence ni vertu, qu’autant qu’on a résisté à la tentation qui pousse à y manquer; la seule chose qu’elles soient fondées à dire, c’est qu’elles ne sont pas disposées à se rendre; les saints eux-mêmes s’expriment de la sorte. Je parle ici, bien entendu, des femmes qui, sachant bien ce qu’elles disent, se vantent de leur froideur et de leur insensibilité, et veulent qu’on prenne leurs affirmations au sérieux; car je n’y trouve pas à redire quand cela vient de celles dont, en parlant ainsi, le visage minaude et les yeux démentent les paroles et qui ne font qu’user d’une forme de langage qui leur est propre, où tout se qui se dit est à prendre à contre-pied. Je suis fort épris de la naïveté et de la liberté; mais il n’y a pas de milieu, et il faut que ces qualités conservent leur simplicité enfantine, sinon ce n’est plus qu’ineptie fort déplacée en pareil cas chez des dames et qui tourne immédiatement à l’impudence. Ces formes déguisées qu’elles emploient, aussi bien que leurs mines, ne trompent que les sots; le mensonge y occupe une place d’honneur, et, bien qu’avec elles on n’avance que par voie détournée, on n’en arrive pas moins à la vérité par une fausse porte.—Puisque nous ne pouvons contenir l’imagination de la femme, que voulons-nous donc d’elle? Est-ce d’en combattre les effets? Mais combien sont ignorés, qui n’en portent pas moins atteinte à la chasteté: «Souvent la femme fait ce qui peut se faire sans témoin (Martial)»; ce que nous craignons le moins est parfois ce qui est le plus à redouter; et, d’entre leurs péchés, ceux que rien ne trahit sont encore les pires: «Je hais 231 moins une femme vicieuse lorsqu’elle ne dissimule pas ses vices (Martial).» Il est des actes qui peuvent les déflorer, sans qu’il y ait impudicité de leur part, et qui plus est, sans qu’elles s’en doutent: «Il est telle sage-femme qui, en inspectant de la main si une jeune fille est vierge, lui en fait perdre le caractère, soit sciemment, soit inconsciemment, soit par accident (S. Augustin)»; cela est arrivé à des jeunes filles cherchant à se rendre compte, à d’autres en se jouant. Nous ne saurions circonscrire avec précision ce que nous leur défendons, nous ne pouvons formuler nos exigences que d’une façon vague et générale; parfois même, l’idée que nous nous faisons de leur chasteté est ridicule. Parmi les exemples les plus singuliers que j’en puis donner, je citerai celui de Fatua femme de Faunus, qui, après ses noces, ne laissa plus apercevoir ses traits par aucun homme, et celui de la femme de Hiéron qui ne s’apercevait pas que son mari exhalait par le nez une odeur désagréable, s’imaginant que c’était là une particularité commune à tous les hommes. Pour que nous ayons satisfaction, il faudrait qu’elles devinssent insensibles et invisibles.
C’est d’après l’intention qu’il faut juger si la femme manque ou non à ses devoirs; son infidélité ne peut toujours lui être reprochée; et puis, quel profit retirons-nous de prendre trop de souci de la sagesse de nos femmes?—Reconnaissons donc que c’est principalement d’après l’intention qu’il faut juger s’il y a, ou non, manquement à ce devoir. Il y a des maris qui ont éprouvé ce genre d’infortune, non seulement sans le reprocher à leur femme, sans y voir d’offense de leur part, mais en leur en ayant une grande obligation, trouvant même, dans leur conduite, une confirmation de leur vertu: telle qui préférait l’honneur à la vie, s’est prostituée et livrée aux embrassements forcenés d’un ennemi mortel pour obtenir la vie de son mari, faisant pour lui ce qu’elle n’eût jamais fait pour elle-même. Ce n’est pas ici le moment d’en citer des exemples; ils sont d’une nature trop élevée et trop riche pour prendre place dans ce cadre, réservons-les pour les produire en plus noble exposition. Mais, parmi ceux inspirés par des considérations plus vulgaires, ne voyons-nous pas tous les jours, autour de nous, des femmes qui se prêtent pour simplement être utiles à leurs maris, parfois sur leur ordre exprès et par leur entremise? Dans l’antiquité Phaulius d’Argos offrit la sienne par ambition au roi Philippe; et, par civilité, un certain Galba, qui avait donné à souper à Mécène et voyait sa femme et son hôte commencer à se faire les yeux doux et échanger des signes d’intelligence, se laissa aller sur son coussin, feignant d’être accablé de sommeil, pour se prêter à leurs amours; ce qu’il avoua du reste d’assez bonne grâce, car un valet ayant été assez osé pour, à ce moment, faire main basse sur les vases qui étaient sur la table, il lui cria sans ambages: «Comment, coquin! tu ne vois donc pas que ce n’est que pour Mécène, que je suis endormi?»—Il y a des femmes de mœurs légères, dont la volonté est moins contaminée 233 que chez d’autres qui ont une conduite d’apparence plus régulière. Il y en a qui se plaignent d’avoir été vouées à la chasteté avant d’avoir atteint l’âge où elles ont eu leur pleine connaissance; de même j’en ai vu se plaindre, en toute sincérité, d’avoir été livrées à la débauche avant cet âge: peut-être était-ce par la faute de parents vicieux, peut-être par la misère qui est un rude conseiller. Aux Indes orientales, où la chasteté est particulièrement en honneur, il était admis par l’usage qu’une femme mariée pouvait s’abandonner à qui lui faisait présent d’un éléphant; la gloire d’être estimée un si haut prix, l’excusait. Le philosophe Phédon, qui était de bonne famille, fit métier, pour vivre, après la conquête de l’Elide son pays, de se prostituer contre argent comptant, à qui voulut de lui, et cela dura aussi longtemps que sa beauté le lui permit. Solon fut, dit-on, le premier qui, en Grèce, concéda aux femmes, par ses lois, la liberté de pourvoir par la prostitution aux besoins de l’existence, coutume qui, dit Hérodote, avait été introduite avant lui dans les institutions de plusieurs peuples.—Finalement, quel fruit nous rapporte ce souci qui nous est si pénible? si fondée que soit notre jalousie, encore faudrait-il voir si cette passion nous torture utilement? Eh bien, est-il quelqu’un qui pense avoir un moyen efficace de maîtriser la femme? «Mettez-la sous clef, donnez-lui des gardiens; mais qui les gardera eux-mêmes? Elle est rusée, c’est par eux qu’elle commencera (Juvénal)»; la moindre facilité, en ce siècle si raffiné, lui suffit pour échapper.
Il vaut mieux ignorer que connaître leur mauvaise conduite; un honnête homme n’est pas moins estimé parce que sa femme le trompe; c’est un mal qu’il faut garder secret. Mais c’est là un conseil qu’une femme jalouse ne saurait admettre, tant cette passion, qui l’amène à rendre la vie intolérable à son mari, la domine une fois qu’elle s’est emparée d’elle.—La curiosité est toujours un défaut, mais ici, elle est pernicieuse: c’est folie de vouloir s’éclairer sur un mal qui ne comporte pas de traitement qui ne l’accroisse et ne l’aggrave, dont la honte s’augmente et acquiert de la publicité surtout par la jalousie, dont la vengeance qu’on en tire blesse plus nos enfants qu’elle ne nous guérit. Vous vous desséchez, vous mourrez à la peine, en voulant élucider une question aussi malaisée à vérifier. Combien piteusement y sont arrivés ceux qui, de mon temps, en sont venus à bout! Si celui qui vous dénonce l’infidélité de votre femme ne vous apporte en même temps le remède qui vous tire d’embarras, l’avis qu’il vous donne constitue une injure qui mérite plus un coup de poignard que s’il vous donnait un démenti. On ne se moque pas moins de celui qui se met en peine de se venger, que de celui qui ignore; la tache d’un mari trompé est indélébile, celui qui une fois l’a été l’est pour toujours; le châtiment affirme son infortune plus encore que ne le fait la faute elle-même. Il est étrange de voir arracher de l’ombre et du doute nos malheurs privés et, en leur donnant des conséquences tragiques, les publier en quelque sorte à 235 son de trompe; d’autant que ce sont des malheurs que nous ne ressentons que par la connaissance que nous en avons, car «Bonne femme» et «Bon ménage» se disent non de qui l’est, mais de qui l’on se tait. Il y a plus d’esprit à éviter cette ennuyeuse et inutile connaissance; aussi les Romains avaient-ils coutume, lorsqu’ils revenaient de voyage, de se faire précéder chez eux de quelqu’un chargé d’annoncer leur arrivée à leurs femmes, afin de ne pas les surprendre. C’est aussi pour cela que chez certaine nation, avait été établi l’usage que le prêtre couchât le premier avec la mariée, le jour des noces, pour ôter au mari le doute et la curiosité de chercher à savoir, dès ses premiers rapports avec elle, si elle lui venait vierge, ou déflorée par un autre qui l’aurait possédée avant lui.
Mais, dira-t-on, il y a les propos du monde. Je sais cent honnêtes gens qui sont des maris trompés, sans qu’on en parle, ni que cela ait fait esclandre. On plaint un galant homme auquel cela arrive, mais l’estime qu’on a pour lui n’en est pas altérée. Faites donc qu’en raison de votre vertu votre infortune passe inaperçue, que les gens de bien vous gardent leur sympathie, et qu’à celui qui vous a outragé la pensée en soit odieuse. Et puis, à qui, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, «jusqu’au général qui a commandé tant de légions et qui, en tout, est supérieur à un misérable comme toi (Lucrèce)», ne prête-t-on pas pareille mésaventure? C’est une imputation qu’en ta présence tu vois adresser à tant de personnes honorables, que tu peux bien penser que tu ne dois pas être épargné quand tu n’es pas là. Il n’est pas jusqu’aux dames qui n’en plaisantent; mais de quoi plaisante-t-on davantage, en ces temps-ci, si ce n’est d’un ménage paisible et bien assorti? Chacun de vous a infligé cet affront à quelqu’un: attendez-vous à la pareille, car compensations et représailles sont dans l’ordre naturel des choses. La fréquence de cet accident doit aujourd’hui en tempérer l’amertume, car il est presque passé en coutume.
Malheureuse passion! qui a encore le désagrément qu’on ne peut s’en entretenir avec autrui: «Le sort nous envie jusqu’à la consolation de faire entendre nos plaintes (Catulle)!» A quel ami, en effet, confier nos doléances sans que, s’il n’en rit, cela ne lui donne l’idée et ne le renseigne sur la possibilité de prendre part, lui aussi, à la curée! Les sages gardent le secret sur les amertumes comme sur les douceurs du mariage; et, parmi les désagréments que présente le cas qui nous occupe, l’un des principaux pour un homme bavard, comme je le suis, c’est qu’il est dans les usages qu’il est indécent de communiquer à des tiers ce que l’on en sait et ce que l’on en ressent, et qu’il y a même inconvénient à le faire.
Ce serait temps perdu que de donner ce même conseil aux femmes pour les dégoûter d’être jalouses; elles sont par nature si soupçonneuses, si frivoles, si curieuses, qu’il ne faut pas espérer les guérir en les traitant suivant les règles. Elles se corrigent souvent de ce défaut, mais en revenant à la santé dans des conditions beaucoup plus à redouter que n’était la maladie elle-même; car il 237 en est ici comme de ces enchantements qui ne vous débarrassent de votre mal qu’en le transmettant à un autre: quand cette fièvre les quitte, c’est d’ordinaire qu’elles la passent à leurs maris.—Je ne sais, à vrai dire, si quelque chose peut nous faire plus souffrir que leur jalousie; c’est le plus dangereux état d’esprit en lequel elles peuvent se trouver, comme la tête est des parties de leur corps ce qu’elles ont de pire. Pittacus disait que «chacun avait son infirmité; que la sienne c’était la mauvaise tête de sa femme, et que, n’était cela, il s’estimerait heureux sous tous rapports». C’est un bien grand inconvénient; et s’il a pesé si lourdement sur l’existence d’un homme si juste, si sage, si vaillant, que toute sa vie il en ait souffert, qu’en advient-il de nous qui sommes de si minces personnages?—Le sénat de Marseille jugea sainement, en accédant à la requête de ce mari qui demandait l’autorisation de se tuer pour échapper à la vie infernale que lui faisait sa femme, car c’est là un mal qui ne disparaît qu’en emportant la pièce et auquel il n’est d’autre expédient que la fuite ou la souffrance, solutions toutes deux également fort difficiles. Celui-là s’y entendait, ce me semble, qui a dit que «pour qu’un mariage soit bon, il faut la femme aveugle et le mari sourd».
Un mari ne gagne rien à user de trop de contrainte envers sa femme; toute gêne aiguise les désirs de la femme et ceux de ses poursuivants.—Prenons garde d’un autre côté que ces obligations que nous leur imposons, par l’extension et la rigueur que nous y mettons, ne conduisent à deux résultats contraires à ce que nous nous proposons: qu’elles ne soient un stimulant pour ceux qui les harcèlent de leurs poursuites, et qu’elles-mêmes n’en deviennent que plus faciles à se rendre.—Pour ce qui est du premier point, par ce fait que nous augmentons la valeur de la femme, nous surexcitons le désir de la conquérir et ajoutons au prix qu’on y attache. Ne serait-ce pas Vénus qui a ainsi fait adroitement renchérir sa marchandise, sachant bien qu’on transgresserait ces lois qui, par leurs sottes exigences, ne font que surexciter l’imagination et surélever les prix, car en somme, pour me servir de l’expression de l’hôte de Flaminius: toutes tant qu’elles sont, ne sont qu’un même gibier que différencie seule la sauce qui l’accompagne. Cupidon est un dieu rebelle, il met son plaisir à lutter contre la dévotion et la justice, et sa gloire à opposer sa toute-puissance à toute autre puissance que ce soit, à ce que toute règle cède devant la sienne: «Sans cesse il cherche l’occasion de nouveaux excès (Ovide).»—Quant au second point, serions-nous autant trompés, si nous craignions moins de l’être? C’est dans le tempérament de la femme; mais la défense même qui lui en est faite l’y incite et l’y convie: «Voulez-vous, elles ne veulent plus; ne voulez-vous plus, elles veulent (Tacite); il leur répugne de suivre une roule qui leur est permise (Lucain).» Quelle meilleure preuve en avons-nous que le fait de Messaline, l’épouse de Claude? Au début, elle trompe son mari en cachette, ainsi que cela se fait; mais la stupidité de celui-ci lui 239 rendant ses intrigues trop faciles, subitement elle dédaigne d’observer cet usage et la voilà qui se met à faire l’amour à découvert, avouant ses amants, les entretenant, leur donnant ses faveurs à la vue de tous; elle veut que son époux en prenne ombrage. Mais rien de tout cela ne pouvant donner l’éveil à cette brute, et la trop lâche facilité avec laquelle il tolérait ses débordements, qu’il paraissait autoriser et légitimer, ôtant à ses plaisirs leur saveur et leur piquant, que fait-elle? Femme d’un empereur plein de vie et de santé, à Rome, en plein midi, à la face du monde entier, au milieu des fêtes et au cours d’une cérémonie publique, un jour que son mari était absent de la ville, elle épouse Silius qui depuis longtemps déjà était son amant! Ne semble-t-il pas que la nonchalance de son mari l’amenait à devenir chaste, ou qu’elle cherchait, en en épousant un autre, à accroître en elle l’ardeur de ses propres désirs par la jalousie qu’elle inspirerait à ce second époux, qu’elle surexciterait à son tour en lui résistant? Mais la première difficulté à laquelle elle se heurta fut aussi la dernière. La bête s’éveilla en sursaut et, comme il n’y a de pire que d’avoir affaire à ces gens qui font les sourds et semblent endormis, qu’en outre, ainsi que j’en ai fait l’expérience, cette patience excessive, quand elle vient à prendre fin, se traduit par des vengeances qui n’en sont que plus âpres, parce que, prenant feu subitement, la colère et la fureur qui se sont accumulées en nous éclatent du premier coup avec toute leur intensité; «lâchant la bride à ses transports (Virgile)», Claude la fit mettre à mort, elle et un grand nombre de ceux auxquels elle s’était donnée, y compris certains qui n’en pouvaient mais, à l’égard desquels elle avait dû employer le fouet pour les décider à venir prendre place dans son lit.
Lucrèce a peint les amours de Vénus et de Mars avec des couleurs plus naturelles que Virgile décrivant les rapports matrimoniaux de Vénus et de Vulcain; quelle vigueur dans ces deux tableaux si expressifs! Caractère de la véritable éloquence.—Ce que Virgile dit des rapports matrimoniaux de Vénus et de Vulcain, Lucrèce l’avait exprimé avec plus de naturel encore en décrivant ses moments d’abandon entre elle et Mars: «Souvent le dieu des combats, le redoutable Mars, enivré de ton amour, se départit de sa fierté et s’effondre dans tes bras... Penché avidement sur ton sein, son souffle suspendu à tes lèvres, il ne peut assez se repaître de la vue de tes charmes. Alors que tu le tiens enlacé de ton beau corps, ô déesse, c’est le moment opportun pour lui parler en faveur des Romains (Lucrèce).»—Quand me reviennent à l’esprit les mots employés par ces deux poètes et dont la traduction atténue si notablement l’expression: reiicit (s’effondre dans tes bras),—pascit (il ne peut assez se repaître de tes charmes),—pudet, inhians (penché avidement sur ton sein, son souffle suspendu à tes lèvres),—molli favet (l’échauffe dans un tendre embrassement),—medullas, labefacta (la chaleur l’envahit de partout et le pénètre jusqu’à la moelle des os),—percurrit (sillonné de ses rubans de feu),—et ce circumfusa (tu le tiens enlacé) si 241 noble et mère de cet autre si gracieux infusus (incarné en elle), j’ai du dédain pour ces locutions qui veulent être piquantes et sont si peu expressives, pour ces mots à allusions qui sont nés depuis. A ces bonnes gens qu’étaient les anciens, ce n’était pas un style de temps à autre incisif et subtil qu’il fallait, mais un langage disant bien ce qu’il voulait dire, naturel, ne se départissant jamais de son énergie; l’épigramme se rencontre constamment chez eux, non seulement dans la conclusion, mais au commencement et au milieu; non seulement à la queue, mais à la tête, à l’estomac, aux pieds. Il n’y a rien de forcé, de traînant, tout y va à même allure, «leur discours est d’une contexture virile, ils ne s’attachent pas à l’orner de fleurs (Sénèque)». Ce n’est pas une éloquence efféminée, où rien ne choque; elle est nerveuse, solide, elle satisfait et ravit plus encore qu’elle ne plaît, et les esprits sont conquis d’autant plus qu’ils sont mieux trempés.—Quand je vois cette façon audacieuse de s’exprimer, si vive, si profonde, je ne dis pas que c’est «bien dire», je dis que c’est «bien penser». C’est la hardiesse de l’imagination qui élève et donne du poids aux paroles, «c’est le cœur qui rend éloquent (Quintilien)»; de nos jours, on nomme jugement ce qui n’est que verbiage, et les belles phrases sont dites des conceptions ayant de l’ampleur. Ce que peignaient les anciens ne révèle pas tant la dextérité de main, que la forte impression que le sujet qu’ils traitaient faisait sur leur âme. Gallus parle simplement, parce qu’il conçoit de même. Horace ne se contente pas d’une expression superficielle, elle ne rendrait pas son idée; il voit plus clair et plus profondément; son esprit crochète le magasin aux mots et aux expressions et y fouille pour y prendre ce qui peindra le mieux sa pensée; il lui faut plus que ce qu’on y trouve d’ordinaire, comme sa conception dépasse, elle aussi, ce qui est courant. Plutarque dit qu’il apprit le latin par les choses qui lui étaient décrites en cette langue; il en est ici de même, le sens éclaire et fait ressortir les termes employés; ce ne sont plus simplement des sons; ils ont chair et os; ils signifient plus qu’ils ne disent, et il n’est pas jusqu’aux imbéciles qui ne saisissent quelque chose de ce dont il s’agit.—En Italie, je disais tout ce qui me plaisait en fait de conversations banales; mais quand elles portaient sur des points sérieux, je n’aurais pas osé me fier à un idiome que je n’étais pas en état de plier et d’adapter à mon sujet, en dehors des acceptions communes; en pareil cas, je veux pouvoir y mettre quelque chose de moi.
Enrichir et perfectionner leur langue est le propre des beaux écrivains; combien sont peu nombreux ceux du siècle de Montaigne se trouvant être de cette catégorie.—Les beaux esprits ajoutent à la richesse de la langue par la manière dont ils la manient et l’emploient; non pas tant en innovant qu’en y introduisant plus de vigueur et la rendant apte à plus d’applications diverses, en l’étirant et lui donnant de l’élasticité. Ils n’y apportent pas de mots nouveaux, mais ils donnent de la valeur à ceux 243 auxquels ils ont recours, les accentuent et fixent leur signification et leur usage; ils font admettre des tournures de phrase nouvelles et tout cela avec prudence et à propos. Mais à combien peu est-il donné qu’il en soit ainsi! on peut en juger par nombre d’écrivains français de ce siècle. Ils sont assez hardis et dédaigneux du passé, pour ne pas suivre la voie commune, mais leur peu d’invention et de discrétion les perd; on ne voit chez eux qu’une affectation assez misérable pour ce qui est étrange, des circonlocutions froides et absurdes qui, au lieu de relever le sujet, le rabaissent; pourvu qu’ils produisent quelque nouveauté qui leur fournisse de quoi s’applaudir, peu leur importe son plus ou moins de justesse; pour la satisfaction de produire un mot nouveau, ils cessent de se servir de ceux employés d’habitude, qui souvent ont plus de force et d’énergie.
La langue française se prête mal, en l’état, à rendre les idées dont l’expression comporte de l’originalité et de la vigueur; mais on n’en tire pas tout ce que l’on pourrait. On apporte aussi trop d’art dans le langage employé pour les sciences.—Notre langue me semble assez étoffée, mais manquer un peu de façon. Elle en aurait autant que besoin est, si on mettait à contribution le jargon dont nous usons à la chasse et à la guerre, qui constitue une mine de fort rendement. A l’instar des plantes, les diverses formes que revêt le langage, s’amendent et se fortifient par la transplantation. Le nôtre est suffisamment fourni, mais ne se prête pas aisément à être manié avec vigueur; il est d’ordinaire hors d’état de rendre de fortes idées. Si vous voulez en exprimer de cet ordre, vous le sentez languir et fléchir sous vous; il faut qu’à défaut de ressources qui lui sont propres, le latin pour les uns, le grec pour les autres, viennent à son secours.—Parmi ces mots de Virgile et de Lucrèce que j’ai signalés plus haut, il en est dont nous ne saisissons que difficilement l’énergie, parce que l’usage et l’emploi fréquents en ont un peu avili et par trop vulgarisé la grâce; de même dans notre langue, telle qu’on la parle communément, il y a des tournures de phrase excellentes, des métaphores dont la beauté n’est flétrie que par le long temps auquel en remonte l’emploi et dont la vivacité de couleur est ternie par un usage trop courant; mais cela ne leur ôte rien de leur goût pour ceux qui ont le palais délicat, et ne porte pas atteinte à la gloire de ceux d’entre les auteurs anciens qui, selon toute probabilité, ont été les premiers à donner à ces mots le relief qu’ils ont acquis.
On emploie pour les sciences un style trop relevé, trop artificiel, qui diffère du style naturel dont on use d’habitude. Mon page fait l’amour et en connaît le langage; lisez-lui Léon l’hébreu et Ficin, on y parle de lui, de ses pensées, de ses actions, et cependant il n’y comprend rien. Je ne reconnais * pas dans Aristote la plupart des impressions que j’éprouve ordinairement; on les a couvertes, affublées d’une autre robe, pour l’usage de l’école. Assurément ils doivent avoir raison d’en agir ainsi; toutefois si j’étais du métier, 245 autant on apporte d’art à travestir la nature, autant je m’appliquerais à traiter l’art avec tout le naturel possible. Quant à Bembo et Equicola, je n’en parlerai même pas.
Montaigne, quand il écrivait, aimait à s’isoler et à se passer de livres pour ne pas se laisser influencer par les conseils et ses lectures; il ne faisait exception que pour Plutarque.—Quand j’écris, je n’ai recours ni aux livres, ni aux souvenirs que j’en conserve, de peur qu’ils n’influencent ma manière d’écrire, sans compter que les bons auteurs me désespèrent par trop et me découragent. J’imite volontiers la façon de ce peintre qui, ayant représenté des coqs d’une façon peu heureuse, défendait à ses aides, pour empêcher toute comparaison, de laisser entrer de vrais coqs dans son atelier. J’aurais plutôt besoin, pour me donner un peu de brillant, d’appliquer le procédé d’Antigénide, ce musicien qui, lorsqu’il avait à jouer sa musique, faisait en sorte qu’avant ou après qu’il s’était fait entendre, les assistants eussent à endurer l’audition de quelques autres mauvais chanteurs. Mais il m’est plus difficile de me défaire de Plutarque. Cet auteur est si universel et si complet, qu’en toutes occasions, quelque extraordinaire que soit le sujet dont vous vous occupiez, il s’ingère dans votre travail, vous tend une main libérale et vous est une source intarissable de richesses et d’embellissements; aussi ai-je peine à le voir si fort exposé à être pillé par ceux qui le hantent. Pour moi, chaque fois que je le fréquente si peu que ce soit, je ne puis m’empêcher de lui soutirer une cuisse ou une aile.
J’ai aussi à dessein décidé d’écrire cet ouvrage chez moi, en pays sauvage, où personne ne me vient en aide, ni ne me corrige; où je ne fréquente que des gens qui ne comprennent même pas le latin de leur «patenôtre», et le français encore moins. Fait ailleurs, il eût été meilleur, mais il eût été moins de moi; et son but principal, comme son mérite, sont d’être exactement moi. Je corrige bien une erreur accidentelle (elles y foisonnent, parce que j’écris au courant de la plume, sans faire attention), mais les imperfections journalières et à l’état d’habitude qui sont en moi, ce serait de la déloyauté de les faire disparaître. Quand on me dit, ou que je me suis dit à moi-même: «Tu abuses des figures,—voilà un mot des crus de la Gascogne,—c’est là une locution scabreuse (je n’en écarte aucune de celles qui, en France, s’emploient en pleine rue, et ceux qui prétendent opposer la grammaire à l’usage sont de drôles de gens),—ce passage témoigne de l’ignorance,—celui-ci est paradoxal,—en voici un par trop bouffon,—tu plaisantes trop souvent, on croit que tu parles sérieusement, alors que tu badines»;—je réponds: «C’est vrai», mais je ne corrige que les fautes d’inattention et non celles qui me sont habituelles. Est-ce que ce n’est pas ainsi que toujours je parle? Est-ce que je ne me représente pas tel que je suis? Eh bien, cela suffit. J’en suis arrivé à ce que je voulais, puisque tout le monde me reconnaît dans mon livre, et le retrouve en moi.
247
Il a une grande tendance à imiter les écrivains dont il lit les ouvrages, aussi traite-t-il de préférence des sujets qui ne l’ont pas encore été; n’importe lequel, un rien lui suffit.—J’ai, comme les singes, une forte propension à l’imitation. Quand je me mêlais de faire des vers (je n’en ai jamais fait qu’en latin), ils accusaient d’une façon évidente le poète que j’avais lu en dernier lieu; de même mes Essais: les premiers feuillets sentent un peu un terroir autre que le mien; à Paris, je parle un langage un peu différent qu’à Montaigne. Une personne que je regarde avec attention, imprime facilement en moi quelque chose d’elle; ce que je considère, je m’en empare: une attitude peu convenable, une grimace déplaisante, une forme de langage ridicule, les défauts principalement; plus ces travers me frappent, plus ils me demeurent accrochés et ils ne s’en vont qu’à force que je les secoue. On m’a vu plus souvent jurer, sous l’influence du milieu où je me trouvais, que par tempérament, imitation désastreuse comme celle de ces singes horribles par leur taille et leur force, que le roi Alexandre rencontra dans certaines contrées de l’Inde, et dont il eût été difficile de venir à bout, s’ils n’en avaient fourni eux-mêmes le moyen par leur disposition à contrefaire tout ce qu’ils voyaient faire, ce qui amena ceux qui les chassaient à leur apprendre, en le faisant eux-mêmes devant eux, à chausser des souliers en nouant force cordons, à s’affubler la tête d’accoutrements avec nœuds coulants, à oindre leurs yeux de glu, en en faisant eux-mêmes le simulacre. Ces malheureuses bêtes, dans leur esprit d’imitation, s’engluèrent, et passant leurs têtes dans les lacets, se garrottèrent * d’elles-mêmes et se mirent imprudemment de la sorte à la merci de ceux qui voulaient les capturer.—Quant à cette autre faculté de reproduire ingénieusement, en les imitant, les gestes et les paroles d’autrui, cela qui, fait à dessein, cause souvent du plaisir et excite l’admiration, je ne l’ai pas plus que ne le possède une souche. Lorsque je jure, me laissant aller à moi-même, c’est uniquement en disant: «Par Dieu!» qui, de tous les jurons, est celui qui vient le plus naturellement à l’idée. On dit que Socrate jurait par le chien; Zénon aurait employé cette même apostrophe dont se servent maintenant les Italiens: Câprier! Pythagore disait: Air et eau. Je suis tellement disposé à recevoir, sans que je m’en rende compte, ces impressions toutes superficielles que lorsque, pendant trois jours de suite, j’ai eu à la bouche ces mots de Sire et d’Altesse, huit jours encore après, il m’échappe de les employer pour Excellence ou Monseigneur; et que ce que je me suis mis à dire en badinant et plaisantant, le lendemain, je le dis fort sérieusement. Aussi, quand j’écris, c’est malgré moi que je prends des sujets déjà rebattus, de peur de ne les traiter qu’aux dépens d’autrui. Tous me sont également bons, une mouche suffit à m’en fournir; et Dieu veuille que celui dont je m’occupe en ce moment ne provienne pas du fait d’une volonté aussi volage! Je puis commencer par où il me plaît, toutes les matières qui doivent passer par ma plume, se trouvant liées les unes aux autres.
249
Les idées les plus profondes, comme les plus folles, lui viennent à l’improviste, surtout lorsqu’il est à cheval, et le souvenir qu’il en conserve est des plus fugitifs.—Ce qui me contrarie, c’est que mon âme s’abandonne d’ordinaire à ses plus profondes rêveries, et aussi à celles qui sont le plus chimériques et qui me plaisent le mieux, à l’improviste, lorsque je les recherche le moins, et qu’elles s’évanouissent subitement, parce que je n’ai rien sous la main pour les fixer sur-le-champ; c’est surtout quand je suis à cheval, à table, au lit, mais principalement à cheval, moment où je m’entretiens le plus avec moi-même.—Quand je parle, j’ai absolument besoin qu’on me prête attention et qu’on fasse silence, si je traite un sujet qui me demande un peu d’effort; si on vient à m’interrompre, je m’arrête. En voyage, l’état même des chemins amène des interruptions dans les conversations, d’autant que le plus souvent je fais route alors en compagnie de gens avec lesquels je ne puis causer longtemps de suite, ce qui me laisse tout le loisir de m’entretenir avec moi-même. J’éprouve, en pareil cas, ce qui m’arrive quand j’ai des songes; lorsque je rêve (et je me figure souvent que je rêve), je recommande à ma mémoire d’en conserver souvenir; mais, le lendemain, si je me rappelle encore que ces songes étaient de nature gaie, triste ou étrange, c’est en vain que je fais effort pour m’en remémorer les détails; plus je cherche, plus l’oubli s’accentue. De même des idées qui, par hasard, me viennent en tête: je n’en conserve qu’un vague souvenir, tout juste ce qu’il en faut pour faire que je me fatigue l’esprit et me tourmente inutilement à les retrouver.
Montaigne estime que l’amour n’est autre que le désir d’une jouissance physique; l’acte en lui-même est tel, que les dieux semblent avoir voulu par là apparier les fous et les sages, les hommes et les bêtes.—Laissant donc les livres de côté et envisageant les choses simplement et uniquement au point de vue matériel, je trouve qu’après tout, l’amour n’est que la soif, qui nous tient, de la jouissance que nous éprouvons avec qui est l’objet de nos désirs; et Vénus, autre chose que le plaisir que nous avons à faire que certains de nos organes se déversent, satisfaction analogue à celle que la nature nous procure également pour certaines autres parties de notre corps; soif et plaisir qui ne deviennent vicieux que lorsque nous y apportons un manque de modération ou de discrétion. Pour Socrate, l’amour était le besoin de procréer, en usant de la beauté pour intermédiaire.—En considérant attentivement l’agitation fébrile et ridicule en laquelle nous met ce plaisir, les mouvements absurdes si désordonnés, et les divagations qui, dans cet acte de folie, s’emparent de Zénon et de Cratippe eux-mêmes; analysant les émotions qu’il nous cause, cette rage sans retenue, ce visage enflammé de fureur et de cruauté au moment même où l’amour nous pénètre de ses plus douces sensations, transports auxquels succède une prostration, sorte d’extase empreinte de gravité et de sévérité; en voyant, dis-je, nos délices 251 et nos sécrétions avoir, dans notre organisme, le même siège; notre suprême volonté nous occasionner des transes, nous arracher des plaintes comme fait la douleur, je crois que Platon est dans le vrai quand il dit que l’homme a été créé par les dieux pour leur servir de jouet: «Cruelle manière de se jouer (Claudien)!» et que c’est pour se moquer, que la nature nous a laissé cette faculté qui, de toutes nos actions, constitue celle où nous agissons le plus à l’aveugle et qui est dans les moyens de tous; elle a voulu, par là, ravaler au même niveau les fous et les sages, nous et les bêtes. Quand je me représente l’homme le plus contemplatif, le plus prudent, passant par cet état, je le tiens pour un effronté de se prétendre un être prudent et contemplatif; ce sont les pieds du paon qui rabattent son orgueil.—«Qu’est-ce qui empêche de dire la vérité en riant (Horace)?» Ceux qui n’admettent pas qu’on puisse émettre des idées sérieuses en se jouant, font, dit quelqu’un, comme celui qui hésite à adorer la statue d’un saint si elle lui apparaît sans être vêtue des pieds à la tête. A la vérité, nous mangeons et buvons comme font les animaux, et cela n’entrave en rien les fonctions de notre âme, ce qui fait que dans ces actes, nous conservons notre supériorité sur eux; mais, dans l’accomplissement de l’acte vénérien, toute pensée autre cesse d’exister, son impérieuse tyrannie fait que, sans en avoir conscience, toute la théologie, toute la philosophie qui sont en Platon, ne sont plus que bêtises, sans portée aucune, et nous ne nous en plaignons pas. En toutes autres choses, on peut conserver quelque décence et des règles ont pu être posées pour sauvegarder la pudeur; ici, on ne peut seulement pas en imaginer, si ce n’est de vicieuses ou de ridicules. Essayez donc de trouver un procédé sage et discret pour y satisfaire. Alexandre disait que c’était surtout par cela et le sommeil qu’il se reconnaissait appartenir à la race des mortels. Le sommeil assoupit et suspend les facultés de l’âme; ce travail les absorbe et les dissipe également. C’est certainement une marque, non seulement de notre corruption et de notre orgueil, mais aussi de notre vanité et d’un vice de conformation.
D’autre part, pourquoi regarder comme honteuse une action si utile et commandée par la nature? On se cache et on se confine pour construire un homme, pour le détruire on recherche le grand jour et de vastes étendues.—D’un côté la nature nous pousse à cette union des sexes, attachant au désir que nous en avons, la plus noble, la plus utile et la plus agréable de toutes ses fonctions; d’autre part, elle nous fait la taxer de manque de respect, la fuir comme déshonnête, en rougir et en recommander l’abstinence. Sommes-nous assez brutes de qualifier de brutal un acte auquel nous devons l’existence! Les peuples se sont rencontrés dans certaines de leurs pratiques religieuses, telles que les sacrifices, l’emploi de luminaires, de l’encens, le jeûne, les offrandes et aussi la prohibition de cet acte; c’est un point sur lequel toutes les religions sont d’accord, sans parler de 253 l’usage si répandu de la circoncision, * qui en est une punition. Peut-être, après tout, est-ce avec raison que nous nous blâmons de faire une aussi sotte production qu’est l’homme, et de qualifier de honteux l’acte duquel il dérive et aussi les organes qui y ont part (les miens aujourd’hui sont bien réellement honteux * et penauds).—Les Esséniens, dont parle Pline, demeurèrent plusieurs siècles, sans avoir besoin ni de nourrices, ni de maillots; continuellement des étrangers leur arrivaient venant grossir leur secte, séduits qu’ils étaient par la belle règle qu’ils s’étaient imposée, de s’exterminer plutôt que d’avoir des relations sexuelles avec les femmes, et de voir s’éteindre la race des humains plutôt que de se prêter à en procréer un seul.—On dit que Zénon n’en connut qu’une et ne la connut qu’une fois dans sa vie; et que ce ne fut que par civilité, pour ne pas paraître les dédaigner de parti pris.—Chacun évite, à l’égard de l’homme, d’être témoin de sa naissance et accourt pour le voir mourir. Pour le détruire, on recherche un champ spacieux, en pleine lumière; pour le construire, on se cache dans une anfractuosité sombre où on soit le plus à l’abri possible. C’est un devoir de se dérober pour le faire et * d’en avoir honte, c’est une gloire à laquelle concourent plusieurs vertus que de le défaire; l’un est un acte injurieux, l’autre constitue un mérite. Aristote ne dit-il pas que, d’après certain dicton de son pays, «bonifier quelqu’un, c’est le tuer». Les Athéniens, ayant à purifier l’île de Délos et se concilier Apollon, pour faire part égale à ces deux actes de l’existence humaine, défendirent à la fois toute inhumation et tout accouchement sur le territoire de cette île: «Nous estimons n’exister que par le fait d’une faute commise (Térence).»
N’y a-t-il pas des hommes et même des peuples qui se cachent pour manger, des fanatiques qui se défigurent, des gens qui s’isolent du reste de l’humanité! On abandonne les lois de la nature pour suivre celles plus ou moins fantasques des préjugés.—Il y a des peuples où l’on se couvre le bas du visage pour manger. Je connais une dame, et des plus grandes, qui est dans ces idées: elle estime que mâcher donne une contenance désagréable qui diminue de beaucoup la grâce et la beauté de la femme, et, quand elle dîne en public, elle mange le moins qu’elle peut. Je connais aussi un homme qui ne peut supporter ni voir manger, ni être vu lorsqu’il mange et qui évite toute assistance plus encore quand il se remplit que lorsqu’il se vide.—Chez les Turcs, on voit un grand nombre de gens qui, pour acquérir plus de mérite que les autres, ne se laissent jamais voir quand ils prennent leurs repas et n’en font qu’un par semaine; ils se tailladent, se déchiquettent la figure et les membres, ne parlent à personne; ce sont des fanatiques qui pensent honorer leur nature en la dénaturant, qui s’estiment de se mépriser, et pensent devenir meilleurs en se rendant pires! Quel monstrueux animal que l’homme; il se fait horreur à lui-même; ses plaisirs lui sont à charge, il recherche le mal!—Il y en a qui cachent l’existence qu’ils mènent, 255 «désertant par un exil volontaire leur demeure et leur doux intérieur (Virgile)»; ils la dérobent à la vue des autres et évitent la santé et l’allégresse comme autant de choses contraires et qui peuvent être nuisibles. Des sectes, et même des peuples entiers maudissent leur naissance et bénissent leur mort; il en est qui ont le soleil en abomination et adorent les ténèbres. Nous ne sommes ingénieux qu’à nous malmener; c’est à cela surtout que nous appliquons toutes les ressources de notre esprit, qui est un bien dangereux instrument de déréglement: «Les malheureux! ils se font un crime de leurs joies (Pseudo-Gallus).» Hé! pauvre homme! tu as bien assez d’incommodités que tu es obligé de subir, sans les accroître encore par tes inventions! Ta condition est assez misérable, sans que tu t’ingénies à l’être encore davantage! Tu as en quantité bien suffisante des laideurs réelles, portant sur des points essentiels; inutile de t’en forger d’imaginaires! Te trouves-tu donc trop à l’aise, que tu te plaignes de la moitié de cette aise? Penses-tu que pour satisfaire à tous les devoirs qui te sont d’obligation et que tu tiens de la nature, il faille t’en créer de nouveaux, sans quoi elle serait * en défaut et oisive en toi! Tu ne crains pas d’offenser ses lois qui sont universelles et sur lesquelles le doute n’est pas possible, et tu te piques d’observer les tiennes qui sont fantasques et dictées par des préjugés, t’y appliquant d’autant plus qu’elles sont plus particulières, incertaines et controversées; les ordonnances spéciales à ta paroisse t’occupent et t’attachent, celles du monde ne te touchent point. Conduis-toi donc un peu suivant les considérations que je t’indique, c’est là toute ta vie.
Parler discrètement de l’amour, comme l’ont fait Lucrèce et Virgile, c’est lui donner plus de piquant.—Les vers de nos deux poètes traitant de la sorte avec retenue et discrétion de la lascivité, me paraissent la mettre à jour et l’éclairer de tons qui la font ressortir mieux encore. Les dames ne se couvrent-elles pas les seins d’une gaze? les prêtres ne mettent-ils pas à l’abri des regards certains objets sacrés? les peintres ne donnent-ils pas du relief à leurs tableaux par les ombres qu’ils y disposent, et ne dit-on pas que le soleil et le vent se font sentir davantage par réflexion, que lorsqu’ils nous arrivent directement?—C’était une sage réponse que celle faite par cet Égyptien à quelqu’un qui lui disait: «Que portes-tu là, caché sous ton manteau?» et auquel il répondait: «Si je le cache sous mon manteau, c’est pour que tu ne saches pas ce que c’est!» mais il est certaines autres choses qu’on ne cache que pour mieux les faire remarquer. Ovide y met moins de façon; aussi, quand il dit: «Et, toute nue, je la pressai sur mon sein», il est par trop cru et cela me laisse aussi insensible que si j’étais privé de virilité. Martial retroussant sa Vénus autant qu’il lui plaît, n’arrive pas davantage à nous la présenter au même degré dans la plénitude de ses attraits; qui dit tout, nous soûle et nous dégoûte. Celui qui, au contraire, regarde à s’exprimer, nous porte à en penser plus qu’il n’y en a; c’est là un genre de modestie qui tient de la traîtrise; 257 c’est notamment ce que font Virgile et Lucrèce, en entr’ouvrant une si belle route à notre imagination; l’action et la peinture qui la représente, se ressentent du tour ingénieux que ces auteurs donnent à leurs phrases.
L’amour, tel que le pratiquent les Espagnols et les Italiens, plus respectueux et plus timide, que chez les Français, plaît à Montaigne qui en aime les préambules; quant à la femme, dès l’instant qu’elle est à nous, son pouvoir prend fin.—L’amour chez les Espagnols et les Italiens, plus respectueux, plus timide, plus minaudier, plus voilé que chez nous, me plaît. Je ne sais qui, dans l’antiquité, aurait voulu avoir le gosier allongé comme le cou d’une grue, afin de savourer plus longtemps ce qu’il avalait; un tel souhait convient bien pour ce genre de volupté qui est prompte et précipitée, même pour des natures comme la mienne, chez lesquelles le vice aime les satisfactions immédiates. Pour accroître ces sensations, il faut en prolonger les préambules; chez ces peuples, tout de la part de la femme est faveur et récompense pour l’amoureux: une œillade, une inclinaison de tête, un mot, un geste. Qui pourrait dîner du fumet d’un rôti, ne vivrait-il pas à bon compte? L’amour est une passion qui, à une bien petite dose de sérieux, mêle beaucoup plus de vanité et de rêverie fiévreuse; il faut en user et la payer de même monnaie. Apprenons aux dames à se faire valoir, à nous amuser et même à se jouer de nous; avec cette impétuosité qui nous caractérise, nous Français, nous voulons tout emporter du premier coup; si nous étions plus ménagers de leurs faveurs, les conquérant en détail, chacun, jusqu’au malheureux vieillard, y trouverait à glaner selon ce qu’il peut et ce qu’il mérite. Celui qui n’a de jouissance que dans la jouissance, qui ne veut gagner que le gros lot, qui n’aime la chasse que pour ce qu’il y prend, n’est pas de notre école; plus il y a de marches et de degrés à monter, plus celui qui a atteint le sommet se trouve élevé et honoré; nous devrions nous plaire à être menés, quand nous cherchons à gagner les bonnes grâces de la femme, comme lorsque nous pénétrons dans ces palais magnifiques où l’on accède par des portiques et des vestibules variés, par de longues et agréables galeries et de nombreux détours. Cette façon d’aller serait toute à notre avantage; nous ferions des stations chemin faisant, et notre amour en aurait une plus longue durée; tandis que lorsque le désir et l’espérance sont éteints, nous allons, mais cela ne mène plus à rien qui vaille. La femme a tout à craindre de nous, quand nous sommes maîtres d’elle et que nous en avons pris pleine possession; dès qu’elle s’est entièrement abandonnée à la merci de notre foi et de notre constance, vertus rares et difficiles, elle est complètement à la merci du hasard; de l’instant où elle est à nous, nous ne sommes plus à elle: «Une fois le caprice de notre passion assouvi, nous comptons pour rien nos promesses et nos serments (Catulle).» Un jeune Grec, Thrasonide, était tellement jaloux de son amour que, maître du cœur d’une maîtresse, il se refusa à en jouir 259 pour ne pas s’en rassasier, ne pas éteindre ni alanguir par la jouissance l’ardeur inquiète dont il se glorifiait et se délectait.
La coutume d’embrasser les femmes lorsqu’on les salue lui déplaît; c’est profaner le baiser, les hommes eux-mêmes n’y gagnent pas.—Un haut prix ajoute à la qualité des choses: voyez combien, chez nous, la forme, toute spéciale à notre nation, que nous donnons à nos salutations, déprécie, par la facilité avec laquelle nous les prodiguons, la grâce du baiser qui les accompagne et dont, au dire de Socrate, la puissance est si grande et si dangereuse pour s’emparer de nos cœurs. C’est une coutume déplaisante et injurieuse pour nos dames, d’avoir à présenter leurs lèvres à quiconque mène trois valets à sa suite, si mal plaisant qu’il soit, «à tel qui a un nez de chien, d’où pendent des glaçons livides dont sa barbe est engluée; j’aimerais cent fois mieux lui baiser le derrière (Martial)». Nous-mêmes n’y gagnons guère, car à la manière dont le monde est réparti, pour trois belles à embrasser, il nous faut en embrasser cinquante laides; et pour un estomac sensible, comme l’ont les gens de mon âge, un mauvais baiser est bien loin d’être compensé par un bon.
Il approuve que même avec des courtisanes, on cherche à gagner leur affection, pour ne pas avoir que leur corps seulement.—En Italie, même les femmes qui se donnent au premier venu qui les paie, on ne les approche qu’avec déférence et en les entourant d’attentions. On dit à cela «qu’il y a des degrés dans la jouissance qu’on peut éprouver avec une femme; que ces attentions ont pour objet d’obtenir d’elles qu’elles se donnent le plus entièrement possible parce que, quand elles se vendent, elles ne vendent que leur corps, et que leur volonté, qui conserve toute sa liberté et dont elles ne cessent de disposer, demeure forcément en dehors du marché». C’est cette volonté que l’on cherche ainsi à gagner, et on a raison; il importe de se la concilier et on ne peut y arriver que par des prévenances.—L’idée de penser que je puisse posséder un corps dont je n’ai pas l’affection, me fait horreur; il me semble que c’est commettre là un acte de frénésie analogue à celui de ce garçon qui se polluait par amour pour cette belle statue de Vénus, sortie du ciseau de Praxitèle; ou de cet Égyptien forcené, souillant le cadavre d’une morte qu’il avait charge d’embaumer et de mettre dans le linceul; ce qui donna lieu à la loi, édictée depuis en Égypte, prescrivant de ne remettre que trois jours après leur mort, aux mains de ceux chargés de les inhumer, les corps des femmes qui étaient jeunes et belles ou de bonne famille.—Périandre fit quelque chose de plus étonnant encore: il continua à Mélissa sa femme, alors qu’elle était morte, ses marques d’affection conjugale (qui plus légitime, eût dû être plus contenue), allant jusqu’à entrer en jouissance d’elle.—La lune n’obéit-elle pas à une idée vraiment lunatique, quand, ne pouvant jouir autrement d’Endymion son favori, elle le tint endormi pendant plusieurs mois, pour avoir toute latitude de se repaître de la jouissance qu’elle pouvait ressentir avec 261 un être qui ne se donnait qu’en songe.—Je dis pareillement que c’est aimer un corps sans âme * ou privé de sentiment, que d’en aimer un qui ne soit pas consentant ou ne vous désire pas. Toutes les jouissances ne sont pas unes; il en est d’étiques et de languissantes. Mille autres causes que la bienveillance de la femme à notre égard peuvent faire qu’elle se donne à nous; ce n’est pas là, par soi-même, un témoignage d’affection. Là comme ailleurs, il peut y avoir une arrière-pensée; parfois, elle se borne à se laisser faire, «aussi impassible que si elle préparait le vin et l’encens du sacrifice..., vous diriez qu’elle est absente ou de marbre (Martial)». J’en connais qui préfèrent prêter leur personne que leur voiture, c’est même la seule chose qu’elles soient disposées à prêter. Il peut encore se faire que votre compagnie plaise, en vue d’une idée autre que le désir de vous appartenir, ou encore comme lui plairait la compagnie d’un gros garçon d’étable. Il y a aussi à considérer à quel prix vous avez part à ses faveurs: «Si elle se donne à vous seul, et marque ce jour-là d’une pierre blanche (Tibulle)»; ou si mangeant votre pain, elle l’assaisonne d’une sauce que son imagination lui rend plus agréable: «C’est vous qu’elle presse dans ses bras et c’est pour un autre qu’elle soupire (Tibulle).» N’avons-nous pas été jusqu’à voir quelqu’un, de nos jours, recourir à cet acte pour satisfaire une horrible vengeance et tuer, en l’empoisonnant, une honnête femme pour que dans ses embrassements avec son ennemi elle lui communique la mort? cela est pourtant arrivé!
Les femmes sont plus belles et les hommes ont plus d’esprit en Italie qu’en France, mais nous avons autant de sujets d’élite que les Italiens; chez eux, la femme mariée est trop étroitement tenue.—Ceux qui connaissent l’Italie, ne s’étonneront jamais si, pour ce sujet, je ne vais pas chercher d’exemples ailleurs, parce qu’en cette matière cette nation l’emporte sur le reste du monde.—Dans ce pays, les belles femmes sont plus communes et il y en a moins de laides que chez nous; mais j’estime que nous allons de pair avec eux pour ce qui est des beautés assez rares approchant de la perfection. Il en est de même des gens d’esprit: ils en ont incontestablement beaucoup plus que nous, la bêtise y est sans comparaison plus rare; mais, en fait de natures d’élite se distinguant d’une façon particulière, nous n’avons rien à leur envier. Si j’avais à étendre ce parallèle, il me semble que je serais fondé à dire que, sous le rapport de la vaillance, la situation est inverse: comparée à ce qu’elle est chez eux, cette vertu est chez nous en quelque sorte innée et répandue dans toutes les classes de la société; mais on la trouve parfois chez certains d’entre eux portée à un tel degré d’abnégation et de vigueur, qu’elle surpasse les plus beaux spécimens que nous en ayons.
Chez eux, le mariage pèche en ce que leurs mœurs imposent aux femmes une loi si sévère, les assujettit tellement, que le moindre rapport avec un étranger constitue une faute capitale présentant autant de gravité que les relations les plus intimes; il en résulte 263 nécessairement que c’est toujours là qu’elles en arrivent; leur détermination est vite prise, puisque les conséquences sont les mêmes; et une fois le pas franchi, croyez bien qu’elles sont tout flamme: «La luxure est comme une bête féroce qui s’irrite de ses chaînes et ne s’en échappe qu’avec plus de fureur (Tite-Live).» Il faudrait qu’on leur lâchât un peu les rênes: «J’ai vu naguère un cheval rebelle au frein, lutter de la bouche et s’élancer comme la foudre (Ovide).» Par un peu de liberté, on rend moins ardent le désir d’avoir de la compagnie. * Eux et nous, courons à peu près les mêmes risques: eux par trop de contrainte, nous par trop de licence.—C’est un heureux usage chez nous, que nos enfants soient admis dans de bonnes maisons, pour y être élevés et dressés en qualité de pages comme dans une école de noblesse; c’est même un acte réputé peu courtois et blessant que de ne pas satisfaire à une demande de cette nature faite pour un gentilhomme. J’ai constaté également (car autant de maisons, autant de genres et de procédés différents) que des dames qui ont voulu imposer aux filles de leur suite certaine austérité de conduite, n’ont pas eu beaucoup à se louer du résultat de leurs efforts; il faut à cela apporter de la modération et s’en remettre pour une bonne part à la discrétion de chacune, car, quoi qu’on fasse, aucune règle de discipline ne peut arriver à les brider sous tous rapports; mais il est bien vrai que celle qui, livrée à elle-même, s’en tire sans encourir de dommages, doit inspirer bien plus de confiance que celle qui sort sans tache, d’une école où elle était prisonnière et gardée sévèrement.
Il est de l’intérêt de la femme d’être modeste et d’avoir de la retenue, même lorsqu’elles ne sont pas sages.—Nos pères inspiraient à leurs filles d’éprouver de la honte et de la crainte (elles n’en avaient pas moins de désirs et de courage, ce sont là choses qui ne varient pas en elles); nous, nous les dressons à avoir de l’assurance; et, en cela, nous ne sommes pas dans le vrai. Notre façon de faire convient aux femmes Sarmates, qui ne pouvaient coucher avec un homme que lorsque à la guerre elles en avaient tué un autre de leurs propres mains. Pour moi, qui ne puis plus avoir action sur elles que par l’attention qu’elles veulent bien me prêter, je me borne à leur faire entendre, si elles me les demandent, les conseils que, de par le privilège de mon âge, je suis à même de leur donner. Je leur prêche donc l’abstinence, à elles comme à nous; et, si ce siècle en est trop ennemi, qu’au moins elles y mettent de la discrétion et de la modestie, car, ainsi que le porte la réplique d’Aristippe, contée dans la vie de ce philosophe et faite par lui à des jeunes gens qui rougissaient de le voir entrer chez une courtisane: «Le vice n’est pas d’y entrer, mais de n’en pas sortir.» Il faut que celle qui ne prend pas à cœur de sauvegarder sa conscience sauvegarde au moins sa réputation; si au fond cela ne vaut guère mieux, du moins l’apparence est sauve.
La nature d’ailleurs les a faites pour se refuser en apparence, bien qu’elles soient toujours prêtes; par ces refus 265 elles excitent beaucoup plus l’homme.—Je loue que, dans la dispensation de leurs faveurs, elles suivent une certaine gradation et prennent du temps; Platon indique que dans les amours de tous genres, la facilité et la promptitude sont interdites aux intéressés. Céder imprudemment et avec précipitation sur tous les points à la fois, est de leur part un effet de gourmandise qu’il leur faut dissimuler, en y apportant toute leur adresse; en ne cédant, au contraire, qu’à bon escient et avec mesure, elles déconcertent bien plus nos désirs et nous cachent les leurs. Que toujours elles fuyent devant nous, même celles qui ont la volonté de se laisser attraper; comme les Scythes, par la fuite, elles assureront bien mieux leur victoire. Selon la loi que leur en fait la nature, ce n’est pas proprement à elles de vouloir et de désirer; leur rôle est de souffrir, d’obéir, de consentir. C’est pour cela que la nature les a mises à même de toujours entrer en rapport avec nous, qui n’avons que rarement cette faculté, sans même être constamment sûrs de notre fait; c’est toujours leur heure, afin que toujours elles soient prêtes, quand c’est la nôtre; «elles sont nées pour pâtir (Sénèque)», et tandis que la nature a voulu que nos appétits se décèlent d’une façon saillante, elle a fait que les leurs demeurent cachés et renfermés; leurs organes ne permettent pas à leurs désirs de se manifester, mais seulement de rester sur la défensive.—Il faut laisser à la licence qui était le propre des Amazones, des traits semblables à celui-ci: Quand Alexandre traversa l’Hyrcanie, Thalestris, leur reine, laissant par delà les montagnes voisines le reste d’une armée considérable qui la suivait, vint le trouver avec trois cents guerriers de son sexe bien montés et bien armés. L’abordant, elle lui dit à haute voix, devant toute l’assistance, que le bruit de ses victoires et de sa valeur l’avait amenée pour le voir et mettre à sa disposition, pour seconder ses projets, ses ressources et sa puissance; qu’elle le trouvait si beau, si jeune et si vigoureux, qu’elle-même, qui possédait également ces qualités au point d’atteindre la perfection, était d’avis qu’ils couchassent ensemble, afin que de la plus vaillante femme du monde et du plus vaillant homme qui fût vivant, naquît quelque chose de grand et de rare pour l’avenir. Alexandre la remercia pour ce qu’elle lui avait dit tout d’abord; et, pour avoir le temps de satisfaire à ce qu’elle demandait en terminant, il suspendit sa marche et stationna en ce lieu treize jours, qu’il passa à fêter le plus allègrement qu’il put cette princesse d’un si grand courage.
Il y a de l’injustice à blâmer l’inconstance de la femme; rien de violent ne peut durer et, par essence, l’amour est violent; c’est, en outre, une passion qui n’est jamais assouvie.—Nous sommes, sur presque tout, mauvais juges de leurs actions, comme elles le sont des nôtres; je le reconnais, avouant la vérité quand elle est contre moi, aussi bien que lorsqu’elle est pour. C’est un vilain déréglement qui les porte à changer si souvent et les empêche de fixer leur affection sur quelque sujet que 267 ce soit, comme on le voit faire à cette déesse, à laquelle on prête tant de changements et tant d’amants. Il est vrai que si l’amour n’est pas violent, ce n’est plus l’amour, et que violence et constance ne marchent pas de pair. Que ceux qui s’étonnent de cette inconstance, qui se récrient et recherchent les causes de cette maladie qui les possède et qu’ils qualifient de dénaturée et d’incroyable, regardent combien il s’en trouve parmi eux qui en sont affectés sans pour cela s’en épouvanter et croire à un miracle. Il serait plutôt étrange de constater en elles de la constance, parce que cette passion n’est pas seulement un effet des sens, et que si l’avarice et l’ambition sont sans limites, il n’y en a pas davantage pour la luxure; elle survit à la satiété, on ne peut lui assigner ni de se fixer, ni de prendre fin; elle va toujours de l’avant, étendant sans cesse son action.—Peut-être l’inconstance est-elle, en quelque sorte, plus pardonnable chez la femme que chez nous; comme nous, elle peut invoquer le penchant, qui nous est commun, à rechercher la variété et la nouveauté; mais elle peut de plus alléguer, tandis que nous ne le pouvons pas, qu’elles achètent chat en * poche, c’est-à-dire sans être suffisamment renseignées. Jeanne reine de Naples fit étrangler sous le grillage de sa fenêtre Andréosso son premier mari, avec un lacet d’or et d’argent tissé de ses propres mains, parce qu’elle ne le trouvait pas nanti, pour la satisfaction de ses corvées conjugales, d’organes et de vigueur répondant suffisamment à l’espérance qu’elle en avait conçue en voyant sa taille, sa beauté, sa jeunesse et les bonnes dispositions en lesquelles il paraissait, qui l’avaient séduite et abusée.—A cette excuse, s’ajoute que le rôle actif comportant plus d’efforts que le rôle passif, la femme est, elle du moins, toujours en état de satisfaire à ce qui lui incombe, tandis qu’il peut en être autrement de nous. C’est pour ce motif que Platon établit fort sagement dans ses lois, qu’avant tout mariage et pour décider de son opportunité, les juges devront examiner les garçons et les filles qui y prétendent, ceux-là nus de la tête aux pieds, celles-ci jusqu’à la ceinture seulement.—Il peut arriver qu’à l’essai, la femme ne nous trouve pas digne de son choix, qu’«après avoir vainement employé toute son industrie à exciter son époux, elle abandonne une couche impuissante (Martial)». Ce n’est pas tout, en effet, que la volonté y soit, la faiblesse et l’incapacité sont des causes légitimes qui rompent le mariage: «Il faut alors chercher ailleurs un époux plus capable de délier la ceinture virginale (Catulle).» Et pourquoi ne serait-ce pas et n’en prendrait-elle pas un autre à sa mesure, ayant des choses de l’amour une intelligence plus licencieuse et plus active, si celui qu’elle a «ne peut mener à bonne fin ce doux labeur (Virgile)»?
Quand l’âge nous atteint, ne nous leurrons pas sur ce dont nous sommes encore capables et ne nous exposons à être dédaignés.—N’est-ce pas une grande impudence de nous présenter avec nos imperfections et nos faiblesses, là où nous désirerions plaire, donner une bonne impression de nous et nous faire 269 apprécier? Pour le peu dont je suis capable aujourd’hui, «une fois, et je suis à bout de forces (Horace)», je ne voudrais pas importuner quelqu’un que je révère et que j’appréhenderais d’offenser: «Ne craignez rien d’un homme qui vient d’accomplir son onzième lustre (Horace).»—N’est-ce pas assez pour la nature, d’avoir rendu cet âge si misérable, sans le rendre encore ridicule? aussi, je hais de voir que, pour quelques restes de chétive vigueur qui, à cette époque de la vie, nous échauffent à peine trois fois la semaine, nous sommes émoustillés et nous nous démenons avec la même âpreté que si nous étions à même de satisfaire brillamment et pleinement aux plus légitimes désirs; c’est un vrai feu de paille qui se produit en nous, et j’admire combien il nous rend vifs et frétillants, alors qu’en réalité, nous sommes si profondément congelés et éteints. On ne devrait se trouver en semblable disposition que lorsqu’on est à la fleur d’une belle jeunesse; aussi fiez-vous-y et vous verrez qu’au lieu de seconder cette ardeur généreuse qui est en vous, que rien ne peut lasser, qui se croit capable de tout et devoir toujours durer, elle vous laissera bel et bien en chemin; elle est bien plutôt le fait d’un enfant à peine formé, encore à l’âge des corrections et ignorant, qui ne ferait que s’en étonner et en rougir: «comme un ivoire de l’Inde teint de pourpre, ou comme des lys qui, mêlés à des roses, en reflètent les vives couleurs (Virgile)». Celui qui peut, sans mourir de honte, penser au dédain que lui marqueront le lendemain ces deux beaux yeux témoins de sa lâcheté et de son impertinence, «qu’ils lui reprocheront par leur silence même (Ovide)», n’a jamais éprouvé le contentement et la fierté de les voir battus et éteints par les fatigues d’une nuit activement employée dans les bras l’un de l’autre. Chaque fois que j’ai vu une femme s’ennuyer de mes caresses, ce n’est pas son indifférence que j’ai tout d’abord accusée: j’ai commencé par craindre que ce ne fût plutôt à la nature que je dusse m’en prendre, parce qu’elle m’a traité avec partialité et d’une façon peu courtoise; «elle m’a insuffisamment pourvu, et les dames n’avaient sans doute pas tort de mépriser de si maigres apparences»; imperfection éminemment regrettable, chacune des parties de mon être étant mienne au même titre que toute autre et celle-ci celle à laquelle, plus qu’à toutes les autres, je dois ma qualité d’homme.
Montaigne reconnaît la licence de son style, mais il est obligé par les mœurs de son temps à cette grande liberté de langage qu’il est le premier à regretter.—Je dois, pour le public, me peindre tout entier. Ces Essais sont instructifs, parce que la vérité, la réalité, y règnent d’une façon absolue. Je dédaigne de considérer comme un devoir réel de m’astreindre à ces règles étroites, factices que l’usage a introduites suivant les pays, et m’en tiens à celles d’application générale et constante que la nature nous a tracées et dont sont filles, mais filles bâtardes, la civilité et les conventions sociales. Qu’importent les vices que nous semblons avoir, à côté de ceux que nous avons réellement? Quand nous en aurons 271 fini avec ceux-ci, nous nous attaquerons aux autres, si nous croyons nécessaire de les combattre; car il y a danger à ce que nous nous imaginions des devoirs nouveaux, pour excuser la négligence que nous apportons à remplir ceux que nous avons naturellement et arriver à faire confusion entre eux. C’est ainsi qu’on voit dans les contrées où les fautes sont des crimes, les crimes n’être que des fautes; et, chez les nations où les lois de la bienséance ne sont qu’en petit nombre et peu observées, celles plus primitives, émanant du bon sens, être mieux pratiquées. La multitude innombrable de devoirs aussi multipliés réclame une telle attention, que nous en arrivons à les négliger et à les perdre de vue; trop d’application pour les choses * sans importance, nous détourne de celles qui * en ont davantage. Que ces hommes, qui voient les choses superficiellement, ont donc une route facile comparée à la nôtre! Toutes ces conventions ne sont que des ombrages derrière lesquels nous nous abritons et qui servent à régler nos comptes entre nous. Mais elles ne nous permettent pas de nous libérer, elles ne font au contraire que grever notre dette envers ce grand juge qui, rejetant les draperies et les haillons qui dérobent à la vue nos parties honteuses, n’hésite pas à nous examiner de toutes parts, jusque et y compris nos méfaits les plus intimes et les plus secrets; si, au moins, notre prétendue décence à l’égard de notre pudeur virginale avait ce côté utile de nous préserver de nous voir ainsi mis à nu! Aussi celui qui ferait perdre à l’homme la niaiserie qui lui fait apporter cette si scrupuleuse superstition dans l’emploi de certains mots, ne causerait-il pas grand préjudice au monde. Notre vie est faite partie de folie, partie de circonspection; qui ne traite que de ce qui est considéré comme convenable et régulier, en laisse de côté plus de la moitié.—Ce que je dis là n’est pas pour m’excuser; si je m’excusais de quelque chose, ce serait des excuses qu’il a pu m’arriver de présenter plutôt que de mes fautes proprement dites; ce sont des explications que je donne à ceux d’idées opposées aux miennes et qui sont en plus grand nombre que ceux qui peuvent penser comme moi. Par égard pour eux, car je désire contenter tout le monde, ce qui est à la vérité * fort difficile, «parce qu’il y n’a pas un seul homme qui puisse se conformer à cette si grande variété de mœurs, de jugement et de volonté (Q. Cicéron)», j’ajouterai qu’ils ne doivent pas me reprocher les citations que je fais d’autorités reçues et approuvées depuis des siècles. Ce n’est pas une raison, en effet, parce que je m’écarte des règles admises, pour qu’ils me refusent la tolérance dont jouissent, même de notre temps, chez nous, jusqu’à des personnes d’état ecclésiastique des plus en vue, ainsi qu’en témoignent, parmi tant d’autres, les deux exemples que voici: «Que je meure, si l’orifice par lequel j’ai accès en toi, n’est pas pour moi la source de toutes les voluptés (Théodore de Bèze).»—«Le membre viril d’un ami la contente toujours, et toujours reçoit bon accueil (Saint-Gelais).»—J’aime la décence, et ce n’est pas de propos délibéré, qu’en écrivant, j’emploie des expressions 273 scandaleuses, c’est la nature qui en a fait choix pour moi. Je ne loue ce mode, pas plus que je ne loue toute manière de faire contraire aux usages reçus; mais je l’excuse et estime que des circonstances, aussi bien générales que particulières, atténuent l’anathème dont il peut être l’objet. Poursuivons.
Il est injuste d’abuser du pouvoir que les femmes nous donnent sur elles, en nous cédant; Montaigne n’a rien à se reprocher a cet égard.—D’où peut provenir cette usurpation d’autorité souveraine que vous prenez sur les femmes qui, à leurs propres risques, vous accordent leurs faveurs, «lorsque dans l’obscurité de la nuit, elles vous accueillent furtivement pendant quelques moments (Catulle)»? Pourquoi * vous croyez-vous aussitôt autorisés à vous immiscer dans leurs faits et gestes, à les traiter avec froideur, vous arrogeant les droits d’un mari? C’est une convention qui vous laisse libres tous deux, que celle qui existe entre vous; que ne vous considérez-vous lié par elle, comme vous voulez qu’elle les lie à vous? il n’y a pas de règles qui régissent les choses concédées bénévolement. Ma thèse va, il est vrai, à l’encontre des usages, et cependant, en mon temps, j’en suis passé par là et, en vérité, dans les marchés de cette sorte, j’ai observé, autant que leur nature le permet, la même conscience que dans tout autre marché et y ai apporté une certaine justice; je ne leur ai témoigné d’affection que dans la mesure où j’en ressentais pour elles, et leur en ai bien naïvement laissé voir la naissance, l’apogée, la décadence, les accès et les défaillances, car on n’est pas toujours en bonnes dispositions. J’ai tellement évité de me prodiguer en promesses, que je crois avoir tenu plus que je n’avais promis et que je ne devais; elles m’ont trouvé fidèle jusqu’à favoriser leurs inconstances, je parle d’inconstances avouées et qui parfois ont été multipliées. Je n’ai jamais rompu avec elles tant que je leur ai conservé de l’attachement, si faible qu’il fût; et quelles que soient les occasions qu’elles m’ont données, je ne me suis jamais séparé d’elles en conservant à leur égard du mépris ou de la haine, considérant que de telles privautés entre elles et moi, même lorsqu’elles dérivent des plus honteux marchés, m’obligent quand même à quelque bienveillance à leur égard. Il m’est arrivé de me mettre parfois en colère et d’avoir des impatiences un peu indiscrètes à propos de leurs ruses, de leurs faux-fuyants et dans les contestations qui se sont élevées entre nous, car, par tempérament, je suis sujet à éprouver de brusques émotions qui, bien que légères et courtes, me font sortir souvent de ma règle de conduite. Lorsqu’elles ont voulu essayer de s’emparer de ma liberté de jugement, je n’ai pas hésité à leur adresser des admonestations paternelles, plutôt mordantes, ne ménageant pas leur point faible.—Si je leur ai donné sujet de se plaindre de moi, c’est plutôt pour les avoir aimées d’une façon qui, auprès de celle dont on use actuellement avec elles, peut être dite sottement consciencieuse; je leur ai tenu parole sur des choses pour lesquelles elles m’en auraient aisément dispensé; il en est 275 qui parfois se sont rendues, alors que leur réputation était intacte, à des conditions qu’elles eussent souffert, sans trop de difficulté, que leur vainqueur n’observât pas. Plus d’une fois, dans l’intérêt de leur honneur, il m’est arrivé de renoncer au plaisir au moment où il eût été le plus grand; et, quand la raison me le commandait, je les ai défendues contre moi-même, si bien qu’en s’en remettant franchement à moi, leurs intérêts se trouvaient plus sûrement et plus sévèrement sauvegardés que si elles avaient suivi leurs propres inspirations. J’ai, autant que j’ai pu, assumé sur moi seul, pour les leur épargner, les risques de nos rendez-vous, et ai toujours organisé nos parties inopinément et dans des conditions plutôt incommodes; et cela, pour moins éveiller les soupçons et aussi pour nous heurter, à mon avis, à moins de difficultés, parce qu’en pareil cas, c’est par où l’on se croit le plus en sûreté qu’on est le plus souvent pris; on observe et on gêne moins ce qui ne semble pas à craindre; on peut oser plus facilement ce que les gens ne supposent pas que vous oserez et qui devient facile par sa difficulté même. Jamais homme, dans ces rapports, n’évita avec plus de soin de faire courir à la femme risque de maternité.—C’est là une façon d’aimer des plus correctes, mais bien ridicule à notre époque et peu pratiquée; personne ne le sait mieux que moi; et cependant je ne me repens pas d’avoir agi ainsi, quoique je n’aie fait qu’y perdre. Aujourd’hui que «le tableau votif que j’ai appendu aux murs du temple de Neptune, indique à tous que j’ai consacré à ce dieu mes vêtements encore tout mouillés du naufrage (Horace)», autrement dit, qu’après bien des traverses je suis débarrassé de cette dangereuse passion, je puis en parler ouvertement. A quelqu’un autre qui s’exprimerait comme je le fais, peut-être répondrais-je: Mon ami, tu rêves; l’amour de ton temps ne se croyait pas tenu à beaucoup de bonne foi et de loyauté; «si tu prétends l’assujettir à des règles, c’est que tu veux marier la folie avec la raison (Térence).» Il n’est pas moins vrai qu’à l’encontre de cette appréciation, si j’avais à recommencer, je me conduirais certainement comme je l’ai fait, suivant la même marche, bien que le résultat n’ait guère été fructueux; l’insuffisance et la sottise sont en effet louables dans une action qui ne l’est pas, et autant je m’éloigne en cela des idées prédominantes, autant j’abonde dans les miennes.
Même dans ses transports les plus vifs, il conservait sa raison; tant qu’on reste maître de soi et que ses forces ne sont point altérées, on peut s’abandonner à l’amour.—Au surplus, dans ces marchés, je ne me livrais pas complètement; j’y cherchais le plaisir, mais ne m’y oubliais pas; je conservais intact, dans l’intérêt de ma compagne du moment comme dans le mien, le peu de réflexion et de discernement que je tiens de la nature; j’éprouvais de l’émotion, mais ne me perdais pas dans le rêve.—Ma conscience allait bien jusqu’à la débauche, au déréglement de mœurs, mais jamais jusqu’à l’ingratitude, la trahison, la méchanceté, la cruauté. Je n’achetais pas à tout prix le plaisir que 277 donne ce vice, je me contentais simplement d’en passer par ce qu’il comporte d’ordinaire, car «aucun vice n’est sans conséquences (Sénèque)». Je hais presque au même degré une oisiveté croupissante et endormie, qu’une occupation ardue et pénible; celle-ci m’agite, celle-là m’assoupit. J’aime autant les blessures que les meurtrissures, les coups qui pourfendent que ceux qui ne font pas plaie. En agissant de la sorte, j’en suis arrivé, dans les rapports de cette nature, alors que je pouvais davantage m’y livrer, à observer un juste milieu entre ces deux extrêmes. L’amour est une agitation éveillée, vive et gaie; je n’en étais ni troublé, ni affligé; mais seulement échauffé, et je ménageais mes forces; il faut s’en tenir là, il n’est nuisible qu’aux fous.—Un jeune homme demandait au philosophe Panétius s’il convenait au sage d’être amoureux: «Laissons là le sage, lui répondit-il, ni toi ni moi ne le sommes, et ne nous engageons pas dans une chose qui émeut si violemment, qu’elle nous fait l’esclave d’autrui et nous rend méprisables à nous-mêmes.» Il disait vrai, il ne faut pas engager son âme dans une affaire aussi entraînante par elle-même qu’est l’amour, si elle n’est en état d’en soutenir les effets et de contredire par la réalité ce mot d’Agésilas: «la sagesse et l’amour ne vont pas ensemble». C’est, j’en conviens, une occupation frivole, qui blesse les convenances, honteuse, illégitime; mais, conduite comme je l’indique, je la crois utile à la santé, propre à dégourdir un esprit et un corps alourdis; et si j’étais médecin, je la conseillerais, aussi bien que tout autre traitement, à un homme de ma complexion et en ma situation, pour l’éveiller, le maintenir en force longtemps encore quand viennent les ans et retarder pour lui les étreintes de la vieillesse. Tant que nous n’en sommes qu’aux approches, que notre pouls bat encore, «alors que ne font qu’apparaître nos premiers cheveux blancs et les premières atteintes de l’âge, qu’il reste encore à la Parque de quoi filer pour nous, que nous avons encore l’usage de nos jambes et qu’un bâton ne nous est pas encore indispensable (Juvénal)», nous avons besoin d’être sollicités et chatouillés par quelque sensation comme celle-ci qui nous agite et nous stimule. Voyez combien l’amour a rendu de jeunesse, de vigueur et de gaîté au sage Anacréon. Socrate, à un âge plus avancé que le mien, ne disait-il pas, en parlant d’une personne pour laquelle il concevait ce sentiment: «Ayant mon épaule appuyée contre la sienne comme si nous regardions ensemble un livre, sans mentir, je ressentis soudain une piqûre dans l’épaule, semblant produite par une morsure d’insecte; et cette impression de fourmillement persista pendant cinq jours, m’occasionnant au cœur une démangeaison continue.» Ainsi le contact tout fortuit, rien que d’une épaule, échauffait et faisait sortir de son état ordinaire cette âme déjà refroidie et énervée par l’âge et qui, entre toutes celles des hommes, a approché le plus de la perfection. Et pourquoi pas? Socrate était homme et ne voulait ni être ni sembler être autre chose.—La philosophie ne s’élève pas contre les voluptés qui sont dans l’ordre de la nature, pourvu qu’on n’en 279 abuse pas. Elle prêche d’en user modérément et non de les fuir; ses efforts tendent à nous détourner de celles qui sont contre nature ou qui, tout en en procédant, sont abâtardies. Elle dit que l’esprit ne doit pas intervenir pour accroître nos besoins physiques, et nous avertit, avec juste raison, de ne pas éveiller notre faim par des excès, de * ne pas vouloir nous gorger au lieu de nous borner à nous nourrir, comme aussi d’éviter toute jouissance qui nous met en appétit et toutes viandes et boissons qui nous affament et nous altèrent. De même, en ce qui concerne l’amour, elle nous invite à ne nous y donner que pour la satisfaction de nos besoins physiques et faire que l’âme n’en soit pas troublée, parce que cela ne la regarde pas et qu’elle n’a simplement qu’à suivre et à assister le corps. Mais ne suis-je pas dans le vrai quand j’estime que ces préceptes, que je considère pourtant comme un peu excessifs, visent un corps en état de bien remplir son rôle; et que, pour un corps débilité comme pour un estomac délabré, il est excusable de le réchauffer et de le soutenir par des procédés artificiels, et de recourir à l’imagination pour lui rendre l’appétit et l’allégresse que de lui-même il ne possède plus?
Dans l’usage des plaisirs le corps et l’âme doivent s’entendre et y participer chacun dans la mesure où il le peut, ainsi que cela se produit dans la douleur.—Ne pouvons-nous pas dire que tant que nous demeurons en cette prison terrestre, il n’y a rien en nous qui affecte exclusivement soit le corps, soit l’âme; que c’est bien à tort que, par cette distinction, nous démembrons l’homme tout vif, et qu’il semble rationnel que nous ressentions le plaisir aussi bien au moins que nous ressentons la souffrance?—Ainsi, par exemple, la douleur causée par leurs péchés, grâce à l’esprit de pénitence qui les pénétrait, était ressentie par l’âme des saints avec une intensité qui les amenait à la perfection; et, en raison de l’union intime existant entre elle et le corps, cette douleur affectait naturellement celui-ci, bien qu’il eût peu de part à ce qui la produisait. Mais ils ne se contentaient pas de ce qu’il se bornât simplement à suivre et à assister l’âme dans ses souffrances, ils le soumettaient lui aussi à des tourments atroces s’attaquant à lui personnellement, afin que tous deux, le corps comme l’âme, rivalisant entre eux, plongeassent l’homme dans la douleur qu’ils estimaient d’autant plus salutaire qu’elle était plus aiguë.—Ici, dans le cas des plaisirs sensuels, n’y a-t-il pas injustice à faire que l’âme s’en désintéresse et à dire qu’il faut qu’elle soit entraînée à y participer, comme s’il s’agissait de quelque obligation servile imposée par la nécessité? N’est-ce pas plutôt à elle de les concevoir et de les préparer, puis y conviant le corps, à y assister et à en conserver la direction, comme il lui appartient également, à mon avis, quand il s’agit de plaisirs qui lui sont propres, d’en inspirer et infuser au corps la sensation dans la mesure où il est capable de l’éprouver, et de s’étudier à ce qu’ils lui soient doux et salutaires. On a raison de dire que le corps ne doit pas 281 suivre ses penchants s’ils peuvent être préjudiciables à l’esprit, mais pourquoi ne serait-ce pas aussi chose raisonnable que l’esprit ne s’abandonnât pas aux siens, quand ils peuvent être préjudiciables au corps?
Avantages que le vieillard, qui n’a pas encore atteint la décrépitude, peut retirer de l’amour. A dire vrai, l’amour sans limites ne convient qu’à la première jeunesse.—Je n’ai pas d’autre passion qui ait action sur moi; ce que font l’avarice, l’ambition, les querelles, les procès sur ceux qui, comme moi, n’ont pas d’occupation déterminée, l’amour, plus que tout autre mobile, est capable de le produire en moi. Il me rendrait la vigilance, la sobriété, la grâce, le soin de ma personne. Il ferait que la façon dont je me présente, malgré les outrages de la vieillesse, outrages qui nous déforment et nous mettent dans un état si pitoyable, se maintiendrait sans altération; que je me remettrais à ces sages et saines études, par lesquelles je gagnerais en estime et en affection parce qu’alors mon esprit, ne désespérant plus de lui-même et de ses moyens, se ressaisirait. J’y trouverais une diversion aux mille pensées ennuyeuses, aux mille chagrins qui ont leur source dans la mélancolie en laquelle nous plongent à cet âge l’oisiveté et le mauvais état de notre santé. Il réchaufferait, au moins en songe, ce sang que la nature abandonne, soutiendrait notre tête qui s’incline, nous distendrait les nerfs, rendrait un peu de vigueur et de plaisir à vivre à ce pauvre homme qui marche à grands pas vers sa ruine. Mais, d’autre part, je comprends bien que c’est là une commodité fort malaisée à recouvrer; par suite de la faiblesse en laquelle nous sommes tombés et de notre longue expérience, notre goût est devenu plus délicat et plus raffiné; nous demandons plus, alors que nous apportons moins; nous sommes plus difficiles dans notre choix, quand nous avons moins qui milite en notre faveur, et, nous reconnaissant tels, nous sommes moins hardis et plus défiants; rien ne peut plus nous donner l’assurance d’être aimés, vu les conditions en lesquelles nous sommes tombés et celles de cette verte et bouillante jeunesse. J’ai honte de me trouver au milieu d’elle «dont la raideur de nerfs, qui fait que toujours elle est en état de bien faire, n’a rien à envier à l’arbre qui se dresse sur lu colline (Horace)»; pourquoi aller étaler notre misère au milieu de cette allégresse, «et divertir à nos dépens ces jouvenceaux ardents, en leur montrant un flambeau réduit en cendres (Horace)»? Ils ont la force et la raison, cédons-leur une place que nous ne pouvons plus occuper; ces bourgeons de beauté naissante ne souffrent pas d’être maniés par des mains aussi engourdies, et l’emploi de moyens exclusivement matériels ne leur suffit pas, comme le fit entendre un jour ce philosophe des temps anciens répondant à quelqu’un qui le raillait de n’avoir pas su gagner les bonnes grâces d’une jeunesse qu’il poursuivait de ses assiduités: «Mon ami, le hameçon ne mord pas à du fromage si frais.» C’est un commerce où il faut que les parties en présence soient dans 283 des conditions analogues qui les fassent se convenir; tous les plaisirs d’autre nature que nous éprouvons peuvent se reconnaître par des récompenses de diverses sortes, celui-ci ne se paie qu’en monnaie de même espèce.—Il est certain que dans ces ébats, le plaisir que je cause chatouille plus agréablement mon imagination que * celui que je ressens; or, c’est manquer de générosité que de recevoir un plaisir, alors qu’on n’en rend pas; c’est d’une âme vile de toujours consentir à devoir et se complaire à demeurer en relations avec qui on est à charge; et il n’y a pas de beauté, de grâce, de privauté si exquises qu’elles soient, qu’un galant homme puisse désirer à ce prix. Si les femmes ne peuvent plus nous donner du plaisir que par pitié, je préfère beaucoup plus ne pas vivre que de vivre d’aumônes; je voudrais avoir le droit de leur demander leurs caresses, dans ces mêmes termes que j’ai vu employer en Italie pour quêter: «Faites-moi quelque bien dans votre propre intérêt», ou à la façon de Cyrus exhortant ses soldats: «Qui est en disposition de m’aimer, me suive.»—Adressez-vous, me dira-t-on, à des femmes qui soient dans les mêmes conditions que vous, frappées elles aussi de la déchéance que vous subissez, vous trouverez plus aisément à vous lier ensemble. Oh! quelle sotte et insipide liaison en résulterait: «Je ne veux pas arracher la barbe à un lion mort (Martial)!» C’est un reproche que faisait Xénophon à Menon et qu’il condamnait en lui, de rechercher, en amour, des femmes en ayant passé l’âge. J’éprouve plus de volupté à voir simplement un couple formé de beaux jeunes gens bien appariés et s’aimant, voire même à me les représenter en imagination, qu’à être moi-même second dans un duo allant tristement et prêtant à la pitié; c’est là un goût fantasque que j’abandonne à l’empereur Galba, qui ne recherchait que des femmes d’âge, aux chairs durcies; ou à ce pauvre malheureux poète, s’écriant en parlant de lui-même: «Plaise aux dieux que, dans mon exil, je puisse te voir telle que je me représente ton image! Que je puisse embrasser tes cheveux blanchis par le chagrin et presser dans mes bras ton corps amaigri (Ovide)!»—Au premier rang de la laideur, je place la beauté obtenue à force d’artifices. Émonez, jeune adolescent de Chio, qui, par le soin qu’il avait pris d’enjoliver sa personne, pensait avoir acquis la beauté que lui avait refusée la nature, s’étant présenté au philosophe Arcésilas et lui ayant demandé si un sage pouvait devenir amoureux, s’attira cette réponse: «Mais certainement! pourvu que ce ne * soit pas d’une beauté de mauvais aloi acquise, comme la tienne, à force de sophistications.» La laideur d’une vieillesse avouée est, suivant moi, moins vieille et moins laide que si on cherche à la dissimuler à force de couleurs et d’onguents.—Si je ne craignais qu’on ne me saisisse à la gorge, je dirais que l’amour ne me semble réellement en sa saison naturelle qu’à l’âge voisin de l’enfance, comme aussi du reste la beauté: «lorsque se glissant dans un chœur de jeunes filles, avec ses cheveux flottants et ses traits encore indécis, un jeune homme peut tromper sur son sexe les yeux 285 les plus clairvoyants (Horace)». Ce qu’Homère n’admet que jusqu’à ce que le menton commence à s’estomper d’une barbe naissante, Platon trouve déjà qu’il est rare que cela subsiste jusqu’à ce moment, et l’on sait pour quelle cause le sophiste Dion qualifiait * si plaisamment d’Aristogitons et d’Harmodiens les poils follets qui surviennent à l’époque de l’adolescence. Déjà j’estime que le moment en est quelque peu passé quand on est arrivé à l’âge de la virilité, non moins qu’en la vieillesse, «car l’amour n’arrête pas son vol sur les chênes dénudés (Horace)». Marguerite, reine de Navarre, en femme qu’elle était, avantageant les personnes de son sexe, leur assignait une limite plus reculée et voulait qu’à l’âge de trente ans le moment soit venu pour elles d’échanger la qualification de belle en celle de bonne. Moins longtemps nous donnons à ce dieu action sur notre vie, mieux nous en valons. Voyez son image, n’a-t-il pas une figure enfantine? Qui ne sait qu’à l’encontre de tout principe, on va toujours à reculons dans son école; l’étude, l’exercice, l’usage de ses préceptes conduisent à l’épuisement; les débutants y sont maîtres: «l’amour ne connaît pas de règle (S. Jérôme)». Il n’est pas discutable que sa conduite a surtout de l’agrément quand l’inadvertance et le trouble y ont place; que ce qui serait faute ailleurs est succès pour lui et lui donne du piquant et de la grâce; pourvu qu’il soit ardent, inassouvi, peu importe qu’il soit prudent. Voyez comme il va chancelant, trébuchant, folâtrant! c’est le mettre aux fers que de lui imprimer une direction habile et sage; c’est attenter à sa liberté divine, que de l’asservir à qui a les mains calleuses et couvertes de poil.
On voit souvent les femmes sembler faire de l’amour une question de sentiment et dédaigner la satisfaction que les sens peuvent y trouver.—Du reste, on voit souvent les femmes sembler faire de l’amour une question toute de sentiment et dédaigner la satisfaction que les sens peuvent y trouver, tout leur est bon à cet effet; par contre, que de fois la beauté du corps ne nous fait-elle pas passer chez elles sur la faiblesse de leur esprit? Par exemple, ce que je n’ai jamais vu, c’est que la beauté de l’esprit si cultivé, si accompli qu’il fût, leur ait fait faire bon accueil à un corps tant soit peu tombé en décadence. Que ne prend-il fantaisie à quelqu’une d’elles d’appliquer cette noble idée digne de Socrate, de troquer son corps pour acquérir de l’esprit, et prostituant sa personne au plus haut prix qu’elle en pourra obtenir, acheter, avec les bénéfices, l’intelligence de la philosophie et le développement de son esprit!—Platon prescrit dans ses lois que celui qui, à la guerre, se sera signalé par un fait d’armes important et utile, ne puisse, durant tout le cours des opérations, quels que soient sa laideur ou son âge, se voir refuser un baiser ou toute autre faveur de galanterie, de qui il le désirerait. Ce que ce philosophe trouve équitable comme récompense de la valeur militaire, pourquoi ne le serait-ce pas pour tout autre mérite; et que ne vient-il à l’idée de chacune de ces vertus, pouvant ainsi mériter 287 récompense, de prendre le pas sur les autres pour avoir la gloire d’obtenir cette marque d’amour qui ne porte pas atteinte à la chasteté? je dis à la chasteté «parce que, si l’on en vient au combat, l’amour est alors comme un grand feu de paille qui s’éteint en un instant (Virgile)»; les vices mort-nés dans notre esprit ne sont pas de ceux qui sont les plus redoutables.
En somme, hommes et femmes sont sortis du même moule, et un sexe n’a pas le droit de critiquer l’autre.—Ce long commentaire m’a échappé à force de bavarder, donnant lieu à un flux de paroles peu mesurées parfois et qui peuvent n’être pas sans inconvénient: «Ainsi tombe du chaste sein d’une jeune vierge une pomme, don furtif de son amant; oubliant qu’elle l’a cachée sous sa robe, elle se lève à l’approche de sa mère et la fait rouler à ses pieds; la rougeur qui lui couvre subitement le visage, révèle la faute dont elle s’est rendue coupable (Catulle).»—Pour terminer, je dis que mâles et femelles sortent du même moule et que, sauf leur éducation et les mœurs, la différence n’en est pas grande. Platon, dans sa République, convie indifféremment les uns et les autres à participer à tous les exercices, études et professions, aussi bien à ceux qui s’appliquent à la guerre qu’à ceux relatifs aux occupations du temps de paix; et le philosophe Antisthène, lui, ne faisait aucune distinction entre la vertu de la femme et la nôtre. Il est bien plus aisé de porter une accusation contre un sexe que de trouver des excuses à l’autre, et c’est ici le cas d’appliquer le dicton: «La pelle se moque du fourgon», autrement dit: tel raille autrui, qui lui-même prête plus encore aux mêmes critiques.
Différence des opinions des philosophes sur les causes de divers usages et accidents: sur «Dieu vous bénisse» dit à qui éternue, sur le mal de mer; digression sur la peur.—Il est aisé de constater que les grands auteurs, traitant des causes de tels et tels faits, ne donnent pas uniquement celles qu’ils croient être les véritables, mais souvent aussi en citent qu’ils n’estiment pas telles, pourvu qu’elles soient ingénieuses ou élégantes; en cela, ils sont réellement utiles si leurs dires sont appuyés de bonnes raisons. Ne pouvant être certains de la cause principale, nous en énumérons plusieurs; peut-être se trouvera-t-elle par hasard dans le nombre: «Ce n’est pas assez de n’indiquer qu’une cause, il faut en donner plusieurs, quoiqu’il n’y en ait qu’une de bonne (Lucrèce).»
289
Désirez-vous savoir d’où vient cette habitude de dire: «Dieu vous bénisse!» à ceux qui éternuent? Voici: nous produisons trois sortes de vents: L’un, qui sort d’en bas, est fort malpropre; un autre, qui sort par la bouche, accuse que nous avons trop mangé; le troisième est l’éternuement, il vient du cerveau et ne prête à aucune critique, d’où l’accueil honnête que nous lui faisons. Ne vous moquez pas de cette explication; si subtile qu’elle vous paraisse, elle est, dit-on, d’Aristote.
Il me semble avoir vu dans Plutarque (l’auteur qui, à ma connaissance a le mieux su allier l’art à la nature et le jugement au savoir) qu’après avoir donné quelques preuves que la crainte peut produire le mal de mer, il attribue à cette cause les soulèvements d’estomac qu’éprouvent ceux qui voyagent sur mer. Moi qui suis fort sujet à ce mal, je sais pertinemment que, chez moi, la crainte n’en est pas la cause, et je le sais non par conjectures mais par expérience. Sans mettre en avant ce qu’on m’a dit, que les animaux, et en particulier les pourceaux, l’éprouvent en dehors de toute appréhension de danger, ni ce qu’une de mes connaissances m’a raconté sur elle-même que, bien qu’y étant fort sujet, l’envie de vomir lui est passée deux ou trois fois, pendant de violentes tempêtes, par suite de la frayeur où elle était, se trouvant, comme dit Sénèque, «trop préoccupée du péril qu’elle courait pour songer à elle-même»; je n’ai jamais craint sur l’eau pas plus qu’ailleurs au point d’en être troublé et d’en perdre la tête, quoique ayant souvent couru des risques où la peur eût été bien justifiée si toutefois elle l’est quand ce n’est que la mort qu’on a à redouter.—La peur naît parfois faute de jugement, aussi bien que faute de cœur; tous les dangers que j’ai courus, je les ai envisagés les yeux ouverts sans que mes idées s’en soient trouvées affectées, entravées ou amoindries; pour craindre, il faut encore du courage. Bien m’en prit autrefois d’être ainsi et non comme tant d’autres; cela m’a permis de me diriger et de conserver mon sang-froid alors que j’étais en fuite; j’ai pu par là m’en tirer, sinon sans crainte, du moins sans effroi ni étonnement; j’étais ému, mais non étourdi et éperdu. Les grandes âmes vont bien plus loin et nous donnent le spectacle de retraites non seulement calmes et couronnées de succès, mais encore exécutées fièrement. Voici, à ce propos, ce que conte Alcibiade sur Socrate dont, en cette circonstance, il était le compagnon d’armes: «Je le trouvai, dit-il, Lachez et lui, après la déroute de notre armée, fermant la marche derrière les fuyards. Je l’observais tout à mon aise, n’ayant rien à craindre pour moi-même parce que j’étais sur un bon cheval et qu’il était à pied; il en avait du reste été ainsi pendant toute la durée du combat. Je remarquai surtout combien il était avisé et résolu, en comparaison de Lachez; et aussi la crânerie de son allure qui ne différait en rien de celle qu’il avait d’ordinaire. Il avait conservé sa fermeté et sa lucidité d’esprit, observait et se rendait compte de ce qui se passait autour de lui, regardant tantôt les 291 uns, tantôt les autres, amis et ennemis; encourageant les uns de ce même regard qui signifiait aux autres qu’il était décidé à vendre bien cher son sang et sa vie à qui tenterait de les lui ôter; et cela les sauva, car on n’attaque pas volontiers ceux qui montrent de telles dispositions, tandis qu’on court sur ceux que la peur entraîne.» Tel est le témoignage de ce grand capitaine, qui nous apprend, ce que nous constatons tous les jours, qu’il n’est rien qui nous expose davantage au danger qu’un soin exagéré de nous en préserver: «D’ordinaire, moins il y a de crainte, moins il y a de danger (Tite-Live).» C’est à tort qu’on dit dans le peuple: «Un tel craint la mort», quand on veut exprimer que quelqu’un y songe et la prévoit. La prévoyance s’applique également à ce qui nous touche en bien comme en mal; considérer et apprécier le danger est, en quelque sorte, le contraire de s’en effrayer.—Je ne me sens pas assez fort pour résister à cette violente secousse que nous cause la peur, pas plus qu’à toute autre passion aussi véhémente; si une fois j’en étais frappé, j’en serais atterré et ne m’en relèverais jamais complètement; qui aurait fait perdre pied à mon âme, ne parviendrait jamais à la remettre en place bien d’aplomb; elle aurait beau se tâter, s’étudier avec soin et au plus profond d’elle-même, malgré cela elle n’arriverait jamais à fermer et consolider la plaie dont elle aurait été atteinte. Cela a été une grande chance pour moi que, jusqu’ici, aucune maladie ne l’ait jetée hors d’elle-même. A chaque épreuve qui m’arrive, j’y fais face en appelant à moi tout ce que j’ai de force de résistance; aussi, la première qui l’emporterait, me laisserait-elle à bout de ressources pour continuer la lutte. Je ne suis pas à même de renouveler mon effort; si, par quelque endroit, le mal rompt la digue que je lui oppose, me voilà désemparé et je suis noyé sans pouvoir échapper. Épicure dit que le sage ne peut jamais en arriver à un état d’âme qui soit contraire aux principes qu’il s’est une fois posés; je suis porté à prendre la contrepartie de cette maxime, et crois que celui qui, une seule fois, aurait été réellement fou, ne sera jamais bien sage. Dieu * qui mesure le froid à ses créatures selon la fourrure qui les protège, me mesure mes passions, à la force que j’ai pour leur résister. La nature m’a laissé à découvert d’un côté et m’a couvert de l’autre; elle m’a désarmé en m’ôtant la force, mais armé d’insensibilité et aussi de ce fait qu’en moi, la peur est raisonnée et sans beaucoup de prise.
Je ne puis supporter longtemps, et quand j’étais jeune je les supportais encore moins, les coches, les litières, les bateaux; je hais, à la ville comme à la campagne, tout moyen de locomotion autre que le cheval; la litière m’incommode plus encore que les coches, par la même raison qui fait que j’endure plus aisément une mer agitée lors même qu’elle peut donner des inquiétudes que le mouvement qu’on ressent en temps calme. La légère secousse que produisent les rames, sous l’action desquelles le navire se dérobe sous nous, me barbouille, je ne sais pourquoi, la tête et 293 l’estomac, de même que je ne puis me sentir assis sur un siège qui vacille. Quand la voile ou le courant nous emporte d’un mouvement régulier, ou que nous allons à la remorque, l’absence d’à coups fait que je n’éprouve pas de gêne; ce que je ne puis souffrir, ce sont les mouvements saccadés, et plus ils sont lents plus ils m’incommodent; je ne sais trop comment les dépeindre avec plus de précision. Les médecins m’ont conseillé, pour remédier à cette disposition, de me contenir le bas-ventre avec une serviette bien serrée; c’est un moyen dont je n’ai pas essayé, parce que j’ai pour habitude de réagir contre les défauts que je puis avoir pour les dompter par ma seule volonté.
Variété d’emploi des chars; comment ils ont été parfois utilisés à la guerre et pendant la paix.—Si ma mémoire me le permettait, je ne considérerais pas comme du temps perdu d’énumérer ici la variété infinie, au dire des historiens, des divers modes d’emploi des chars à la guerre. Ils ont varié suivant les nations et les temps, semblent avoir été d’un grand effet et étaient devenus une nécessité; aussi est-il étonnant que nous ne soyons pas mieux documentés sur ce point.—Je ne ferai que rappeler qu’à une époque assez rapprochée, du temps de nos pères, les Hongrois s’en servirent avec succès contre les Turcs: sur chacun se trouvaient un soldat armé d’un bouclier et un mousquetaire, avec nombre d’arquebuses chargées et disposées prêtes à faire feu, le tout couvert d’une forte bâche, comme le sont les galiotes. Ils en avaient jusqu’à trois mille semblables, établis sur le front de bataille. Après que le canon avait joué, ceux qui montaient ces chars, déchargeaient * tout d’abord sur l’ennemi les armes à feu qui y avaient été placées, ce qui n’était pas sans donner un certain avantage, puis on se portait contre lui. Ils les employaient aussi en les lançant contre la cavalerie de l’adversaire, pour la rompre et y faire brèche; et cela indépendamment du secours qu’ils en * tiraient, quand ils craignaient des surprises, pour garder leurs flancs lorsqu’ils étaient en marche en rase campagne, ou encore pour couvrir en hâte et fortifier un lieu de stationnement.—De mon temps, sur l’une de nos frontières, un gentilhomme qui était peu dispos de sa personne, ne trouvant pas de cheval capable de le porter en raison de son poids et redoutant une attaque, parcourait le pays sur un char semblable à ceux que je viens de décrire et s’en trouvait bien. Bornons-nous là pour les chars employés à la guerre.
Les derniers rois de notre première race, dont la fainéantise ressortait cependant bien déjà suffisamment autrement, voyageaient et se promenaient sur un char tiré par quatre bœufs. Marc-Antoine fut le premier qui, en compagnie d’une jeune musicienne, se fit conduire dans Rome par des lions attelés à son char. Postérieurement, Héliogabale en fit autant, se disant être Cybèle la mère des dieux; il allait aussi attelant des tigres pour figurer Bacchus et il lui arriva d’atteler son char de deux cerfs, une autre fois de quatre 295 chiens, une autre de quatre jeunes filles qui, toutes nues, le traînaient en grande pompe, lui-même étant en pareil état de nudité. L’empereur Firmus attelait quatre autruches de grandeur étonnante, si bien qu’il semblait voler plutôt que rouler.
En général les souverains ont grand tort de se livrer à des dépenses exagérées de luxe; ces prodigalités sont mal vues des peuples qui estiment, avec raison, qu’elles sont faites à leurs dépens.—Ces inventions étranges me mettent en tête l’idée que c’est une sorte de pusillanimité de la part des monarques, et un témoignage qu’ils ne comprennent pas assez ce qu’ils sont, que de chercher, par des dépenses excessives, à se faire valoir et à paraître. Ce pourrait être excusable en pays étranger; mais au milieu de leurs sujets, là où ils peuvent tout, leur dignité même leur constitue le plus haut degré auquel, en fait d’honneurs, ils puissent atteindre. Il en est de même d’un gentilhomme, pour lequel je trouve qu’il est bien superflu de se vêtir d’une manière particulière, quand il est chez lui: sa demeure, son train de maison, sa cuisine, répondent assez pour lui. Je trouve judicieux le conseil que donne Isocrate à son roi: «D’avoir un intérieur et un mobilier splendides, d’autant que cela constitue une dépense qui dure et passe à ses successeurs, et d’éviter toute magnificence dont l’usage et le souvenir sont éphémères.»—Quand j’étais jeune, j’aimais la parure, n’ayant d’autres moyens de me faire remarquer, et cela m’allait bien; il en est sur qui les beaux vêtements jurent.—Nous possédons des relevés de comptes qui étonnent par l’extrême économie de certains de nos rois, pour eux et tout ce qui les touchait personnellement, ainsi que par celle qu’ils apportaient dans leurs libéralités; et c’étaient des rois puissants, renommés par leur valeur et les dons de la fortune. Démosthène combattait à outrance une loi de son pays, qui mettait à la charge des deniers publics les dépenses faites pour donner plus de solennité aux jeux et aux fêtes; il voulait que sa grandeur se manifestât par le nombre de ses vaisseaux prêts à prendre la mer et de ses armées prêtes à entrer en campagne. C’est avec raison qu’on reproche à Théophraste d’émettre l’idée contraire dans son livre sur la richesse, et de prétendre que des dépenses de cette nature doivent être une conséquence naturelle de l’opulence. Aristote, lui, dit que ce sont là des plaisirs qui ne sont appréciés que de la populace, dont le souvenir disparaît dès qu’ils ont pris fin, et dont ne peut faire cas un homme sérieux qui a du jugement. Ces dépenses trouveraient, ce me semble, un emploi bien plus digne de la majesté royale, bien plus utile, juste et durable, si elles étaient affectées à la construction de ports, de darses, de fortifications, de murailles, d’édifices somptueux, d’églises, d’hôpitaux, de collèges, à l’amélioration des rues et des chemins. Pour en avoir agi ainsi, le pape Grégoire XIII laissera une mémoire des plus recommandables et qui se perpétuera. C’est aussi par là que, pendant longues années, ses ressources lui permettant de satisfaire ses goûts, la libéralité naturelle et la 297 magnificence de notre reine Catherine se sont manifestées; et c’est un grand déplaisir pour moi, que la construction du beau Pont-Neuf, dont notre grande ville lui est redevable, ait été interrompu, et de ne pouvoir, avant de mourir, espérer le voir achevé.
Il semble aux sujets, spectateurs des triomphes que se ménagent ainsi leurs rois, que c’est leur propre richesse qu’on étale sous leurs yeux et que c’est eux qui font les frais des fêtes qu’on leur donne; d’autant que les peuples pensent volontiers de leurs maîtres, ce que nous pensons de nos valets, qu’ils doivent mettre leur soin à ce que nous ayons en abondance tout ce qui nous est nécessaire, mais sans prétendre en avoir leur part. C’est ce qui explique ce mot de l’empereur Galba qui, satisfait du plaisir que lui avait causé un musicien pendant son souper, s’étant fait apporter sa cassette particulière et y ayant pris une poignée d’écus, la lui donna en disant: «Cela est à moi, et ne provient pas du trésor public.» Toujours est-il que le plus souvent le peuple a raison, et que c’est de ce avec quoi il devrait se nourrir, qu’on satisfait ses regards.
Un roi, en effet, ne possède ou ne doit posséder rien en propre; une sage économie doit présider à ses libéralités, d’autant que, quoi qu’il fasse, il lui sera toujours impossible de satisfaire l’avidité de ses sujets.—La libéralité, de la part d’un souverain, n’a même pas grand mérite; les particuliers qui la pratiquent, en ont davantage parce que, de fait, un roi ne possède rien en propre et se doit lui-même aux autres: l’administration n’est pas créée pour le bien de l’administrateur, mais pour celui de l’administré; un supérieur n’est jamais institué pour le bénéfice que cela lui donne, mais pour le profit que l’inférieur doit en retirer; le médecin est fait pour le malade et non pour lui-même; toute magistrature, tout art existant le sont dans un intérêt autre que le leur: «Nul art n’est confiné en lui-même (Cicéron).» Aussi les gouverneurs des princes qui, dans leur enfance, s’évertuent à leur inculquer des idées de largesses et leur prêchent qu’ils ne doivent pas savoir refuser et qu’ils ne sauraient faire meilleur emploi de ce qu’ils ont que de le donner (éducation qui, de mon temps, a été fort en crédit), ont plus en vue leur intérêt que celui de leur maître, ou comprennent mal leurs devoirs étant donné à qui ils parlent. Il est trop aisé de pousser à la libéralité celui qui est à même de la pratiquer, comme il l’entend, aux dépens d’autrui; et, comme on lui en sait gré, non d’après la valeur du présent qu’il fait, mais d’après les moyens qu’il a de le faire, elle arrive à devenir sans effet en des mains si puissantes; ils sont prodigues et on ne les tient même pas pour généreux. C’est pour cela que la libéralité n’est pas une vertu de premier ordre d’entre celles que devrait posséder un roi; c’est la seule, comme dit Denys le tyran, qui s’allie bien à la tyrannie elle-même. A ces princes j’enseignerais plutôt ce proverbe d’un laboureur de l’antiquité: «Qui veut tirer profit de sa semence, doit semer avec la main, et non verser à même du sac (Plutarque)»; il faut épandre le grain et non le répandre; 299 eux ont à donner, ou mieux à payer et à restituer à tant de gens suivant leurs services, qu’ils doivent être des dispensateurs loyaux et avisés. J’aimerais mieux qu’un prince fût avare, que de le voir d’une libéralité sans mesure ni discrétion.
La vertu qui doit prédominer chez un roi semble plutôt être la justice, et, de toutes les branches de la justice, celle qui doit accompagner la libéralité est celle qui se remarque le plus en eux, parce qu’ils se l’ont plus particulièrement réservée, tandis qu’ils exercent toutes les autres plutôt par des intermédiaires. Une largesse immodérée n’est pas faite pour leur valoir de la bienveillance, car elle leur aliène plus de gens qu’elle ne leur en gagne: «On peut d’autant moins être généreux, qu’on l’a plus été... Quelle folie de se mettre dans l’impuissance de faire longtemps ce qu’on fait avec plaisir (Cicéron)»; la libéralité, pratiquée sans tenir compte du mérite, est une honte pour qui reçoit, il n’en a aucune gratitude. Des tyrans ont été sacrifiés à la haine du peuple par ceux-là mêmes qu’ils avaient injustement comblés de faveurs; certaines catégories de gens, estimant qu’ils s’assurent la possession de biens indûment reçus, en montrant du mépris et de la haine pour ceux de qui ils les tiennent, se rallient au jugement et à l’opinion que la foule professe à l’égard de cette manière de faire.
Les sujets d’un prince qui donne avec excès, deviennent eux-mêmes excessifs dans leurs demandes; ils se règlent non d’après la raison, mais sur l’exemple qu’ils ont sous les yeux. Il est certain que bien souvent notre impudence devrait nous faire rougir; nous sommes, en bonne justice, payés au delà de ce qui nous est dû quand la récompense égale le service; ne devons-nous donc rien, en effet, à nos princes par suite de nos obligations naturelles? S’ils prennent notre dépense à leur charge ils vont trop loin, c’est assez qu’ils nous viennent en aide; le surplus s’appelle bienfait et nous ne sommes pas en droit de l’exiger, car le mot même de libéralité implique l’idée de liberté chez celui qui donne. A notre mode, on n’arrive jamais au bout; ce qui est reçu ne compte plus, on n’aime que les libéralités à venir; aussi, plus un prince s’épuise en donnant, plus il s’appauvrit en amis. Comment pourrait-il assouvir tous les appétits, qui vont croissant au fur et à mesure qu’il y satisfait? Qui songe à prendre, ne pense plus à ce qu’il a pris; la convoitise a l’ingratitude pour caractère essentiel.
L’exemple de Cyrus ne fera pas mal ici, pour servir aux rois de notre époque à distinguer quand leurs dons sont bien ou mal employés; il leur montrera combien, en les distribuant ainsi qu’il le faisait, ce souverain a eu la main plus heureuse qu’eux, qui, après avoir épuisé leurs ressources, en sont réduits à contracter des emprunts auprès de sujets qui leur sont inconnus, et à demander à ceux auxquels ils ont fait du mal, plutôt qu’à ceux qu’ils ont obligés, une aide, qui, en la circonstance, n’a de gratuit que le nom. Crésus reprochait à Cyrus ses largesses, et calculait à combien 301 s’élèverait son trésor, s’il eût été plus parcimonieux. Ce dernier eut l’idée de justifier ses libéralités et, dépêchant dans toutes les directions aux grands de ses états envers lesquels il avait été particulièrement généreux, il pria chacun, pour lui venir en aide et le tirer d’un mauvais pas, de lui envoyer tout l’argent dont il pourrait disposer et de l’aviser de ce qu’il serait en mesure de lui donner. Quand toutes les réponses furent arrivées, il se trouva que tous ses amis, ayant estimé que ce n’était pas assez de ne lui offrir que la somme qu’ils avaient reçue de sa munificence, y avaient ajouté beaucoup de leurs propres deniers, et que le total dépassait considérablement l’économie qui, au dire de Crésus, aurait pu être faite. Là-dessus, Cyrus lui dit: «Je n’aime pas moins les richesses que les autres princes, mais je crois les mieux administrer; voyez à combien peu me revient ce trésor inestimable que me constituent tant d’amis, qui me sont de plus sûrs trésoriers que ne seraient des mercenaires qui ne m’auraient pas d’obligation et ne me porteraient pas affection; ma fortune est mieux gardée par eux que dans mes coffres qui m’attireraient la haine, l’envie et le mépris des autres princes.»
On pouvait, à Rome, excuser la pompe des spectacles tant que ce furent des particuliers qui en faisaient les frais, mais non quand ce furent les empereurs, parce que c’était alors les deniers publics qui en supportaient la dépense.—Les empereurs romains avaient pour excuse de leur profusion en fait de jeux et spectacles publics, que leur autorité dépendait en quelque sorte (du moins en apparence) de la volonté du peuple qui, de tout temps, avait l’habitude d’être flatté au moyen de ce genre de divertissements développés à l’excès. Dans le principe, c’étaient les particuliers qui avaient établi et entretenu cette coutume de gratifier leurs concitoyens et leurs compagnons de ces magnificences exagérées, dont ils supportaient la majeure partie des frais; le caractère de ces réjouissances publiques changea, quand, par imitation, ce furent ceux qui étaient devenus les maîtres qui les donnèrent: «Le don fait à des étrangers d’un argent pris à autrui, ne doit pas être considéré comme une libéralité (Cicéron).»—Philippe écrivait en ces termes à son fils, pour lui faire reproche de chercher à gagner l’attachement des Macédoniens par des présents: «As-tu donc envie que tes sujets te prennent pour le détenteur de leur bourse, au lieu que tu sois leur roi? Si tu veux te les attacher, amène-les à toi par les bienfaits de tes vertus et non par ceux de ton coffre-fort.»
Description de ces étranges spectacles; ce que l’on doit le plus en admirer, c’est moins leur magnificence, que l’invention et les moyens d’exécution qui dénotent dans les arts un degré auquel nous n’atteignons pas.—C’était cependant une belle chose que de transporter et de dresser sur les arènes quantité de gros arbres, avec toutes leurs branches et leur verdure, qui, bien symétriquement disposés, représentaient une 303 grande forêt ombreuse, et d’y lâcher, comme le fit un jour l’empereur Probus, mille autruches, mille cerfs, mille sangliers, mille daims, et d’en abandonner la chasse au peuple; d’y faire, le lendemain, assommer en sa présence cent lions de forte taille, cent léopards, trois cents ours; et le troisième jour, y faire combattre à outrance trois cents paires de gladiateurs.—C’était aussi bien beau à voir, ces vastes amphithéâtres aux parois extérieures incrustées de marbre, sculptées, garnies de statues, et dont l’intérieur brillait sous la richesse des décorations somptueuses dont il était paré: «Vois le pourtour du théâtre orné de pierres précieuses et son portique tout reluisant d’or (Calpurnius).» Sur tout le pourtour du grand vide qu’enfermait cette enceinte, depuis le bas jusqu’au faîte, régnaient soixante ou quatre-vingts rangées de gradins, également en marbre et garnis de sièges sur lesquels cent mille personnes pouvaient prendre place et y être à l’aise: «Qu’il s’en aille, dit-il, s’il a quelque pudeur, et quitte les sièges destinés aux chevaliers, lui qui ne paye pas le cens fixé par la loi (Juvénal).»—Dans le cours d’une même journée, c’était d’abord les parois de la partie du fond où avaient lieu les jeux, qui s’entr’ouvraient ingénieusement, et des crevasses se formaient, représentant des antres d’où se précipitaient les animaux destinés au spectacle; puis la scène se transformait en une mer profonde qui recélait force monstres marins et portait des vaisseaux armés pour la représentation d’une bataille navale; un troisième changement survenait ensuite, l’arène se vidait et se desséchait pour les combats de gladiateurs; enfin, le sol, au lieu de gravier, était sablé de vermillon et de storax et on y dressait un festin magnifique auquel prenait part toute cette foule immense, ce qui constituait le dernier acte de la journée: «Que de fois avons-nous vu une partie de l’arène s’abaisser, et de l’abîme entr’ouvert surgir tout à coup des bêtes féroces et toute une forêt d’arbres d’or à l’écorce de safran. Non seulement j’ai vu dans nos amphithéâtres les monstres des forêts, mais aussi des phoques au milieu des combats d’ours et le hideux troupeau des chevaux marins (Calpurnius).»—Quelquefois, c’était une haute montagne couverte d’arbres fruitiers et d’arbres verts, qu’on y élevait: du sommet s’échappait, comme de l’orifice d’une source vive, de l’eau qui s’écoulait en ruisseau. Parfois, on y faisait se mouvoir un grand navire, dont les flancs s’ouvraient, se disjoignaient d’eux-mêmes, et quatre à cinq cents fauves en bondissaient, qui se battaient entre eux tandis que le navire se refermait et disparaissait de lui-même. D’autres fois, on faisait jaillir du sol des jets d’eau odoriférante qui, projetée à une hauteur considérable, retombait en vapeur, arrosant et embaumant toute cette multitude en nombre infini.—Pour abriter contre les intempéries, on tendait au-dessus de cette immense enceinte, soit des voiles de pourpre brodés à l’aiguille, soit des étoffes de soie teintes d’une couleur ou d’une autre, qu’on déployait ou qu’on repliait en un instant, suivant que l’idée en prenait: «Bien qu’un soleil brûlant 305 darde ses rayons sur l’amphithéâtre, on retire les voiles, dès que paraît Hermogène (Martial).» Les filets, placés devant les spectateurs pour les protéger contre les bonds par trop violents des bêtes féroces, étaient également tissés d’or; «les rets eux-mêmes brillent de l’or dont ils sont tissés (Calpurnius)».
S’il y a quelque chose qui excuse de tels excès, ce n’est pas tant la dépense que l’invention et la nouveauté qui s’y trouvent et nous pénètrent d’admiration; ces actes mêmes de vanité nous révèlent combien ces siècles produisaient de gens à l’imagination bien autrement fertile que ne sont les nôtres. Il en est de cette fertilité d’esprit comme de toutes les autres productions de la nature; on ne saurait cependant dire qu’elle y a atteint l’apogée de sa puissance; nous ne progressons pas sans cesse, nous pivotons plutôt sur nous-mêmes, tournant à tous vents dans un sens et dans l’autre, nous allons et revenons sur nos pas. Je crains que nos connaissances ne soient fort limitées sous tous rapports; nous ne voyons guère loin, pas plus en avant qu’en arrière; elles sont restreintes et de courte durée, peu étendues comme temps, comme sous le rapport des matières qu’elles embrassent: «Bien des héros ont vécu avant Agamemnon; mais, ensevelis dans une nuit profonde, ils ne nous font pas aujourd’hui verser de larmes (Horace).—Avant la guerre de Troie, beaucoup de poètes avaient chanté d’autres événements (Lucrèce).» Ce que Solon rapporte de ce qu’il avait appris des prêtres d’Égypte sur la haute antiquité à laquelle remontait leur pays et sur leur manière d’établir et de conserver l’histoire des pays étrangers, est, en la circonstance, un témoignage qui n’est pas à repousser: «S’il nous était donné de voir l’étendue infinie des régions et des siècles où, se plongeant et s’étendant de toutes parts, l’esprit n’a plus de bornes pour arrêter sa vue, nous découvririons une quantité innombrable de formes dans cette immensité (Cicéron).» Quand tout ce qui, des temps passés, est venu jusqu’à nous, serait vrai et connu, ce serait encore moins que rien auprès de ce que nous en ignorons. Combien les plus curieux eux-mêmes sont peu et imparfaitement au courant de ce qui se passe en ce monde à l’époque où nous vivons! Qu’il s’agisse des révolutions qui affectent les gouvernements, de l’état social des plus grandes nations, ou de ces événements particuliers auxquels le hasard donne de l’importance et qui marquent, il nous en échappe cent fois plus que nous n’arrivons à en connaître. Nous crions au miracle de l’invention faite chez nous de l’artillerie, de l’imprimerie, alors qu’en Chine, à l’autre bout du monde, d’autres que nous s’en servaient mille ans auparavant. Si ce que nous connaissons du monde égalait ce que nous n’en connaissons pas, il est à croire que nous serions en présence d’une infinie variété de corps de toutes formes et de toutes espèces en perpétuelle transformation. Rien dans la nature n’est unique et rare; il n’en est ainsi qu’eu égard à nos connaissances restreintes, qui sont les bases très défectueuses des règles que nous avons établies et qui font que nous nous forgeons d’ordinaire une 307 très fausse idée de toutes choses. De même qu’aujourd’hui, en raison de notre propre faiblesse et de notre décadence, nous sommes, bien à tort, portés à trouver que le monde a vieilli et périclité: «Notre âge n’a plus la même vigueur, ni la terre la même fécondité (Lucrèce)»; ce même poète que je viens de citer, concluait, avec tout aussi peu de raison, en considérant la vigueur qu’il voyait aux esprits de son temps qui abondaient en nouveautés et inventions dans les arts de diverses sortes, que le monde était de création récente et encore en pleine jeunesse: «A mon avis, le monde n’est pas ancien; il ne fait que de naître; aussi voyons-nous que certains arts sont en progrès et se perfectionnent, notamment celui de la navigation qui se développe chaque jour davantage (Lucrèce).»
Un nouveau monde vient d’être découvert; ses habitants sont de mœurs simples, dans les arts qu’ils connaissent ils ne le cèdent en rien à ce que nous pouvons produire.—Notre monde vient d’en découvrir un autre (et qui nous garantit que ce soit le dernier de ses frères, puisque les démons, les sibylles et nous en ignorions jusqu’ici l’existence?), qui n’est pas moins grand, moins peuplé, moins organisé que le nôtre; et cependant, il est si nouveau, si enfant, qu’on lui apprend son A, B, C, et qu’il n’y a pas cinquante ans, il ne connaissait ni lettres, ni poids, ni mesures, pas plus que l’art de se vêtir et pas davantage le blé et la vigne; tout nu, encore sur les genoux de sa mère, il ne vivait que par sa nourrice. Si nous étions fondés à admettre que notre poète avait raison de dire que son siècle était en pleine jeunesse, et nous à conclure que notre monde avance vers sa fin, ce nouveau-né rayonnera alors que le nôtre sera sur son déclin et l’univers sera frappé d’hémiplégie; une moitié de lui-même sera percluse, tandis que l’autre sera dans toute sa vigueur. Je crains bien toutefois que nous ayons très fort hâté le dépérissement et la ruine de ce dernier venu, pour être entré en communication avec lui, et que nous lui fassions payer cher nos idées et nos actes. C’était un monde dans l’enfance; ne l’avons-nous pas fouetté et asservi à nos errements, en abusant de notre supériorité et des forces dont nous disposions? En tout cas, nous ne l’avons ni gagné à nous par notre justice et notre bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart des réponses de ses habitants, dans les négociations engagées avec eux, témoignent qu’ils ne nous le cédaient en rien en fait d’esprit naturel et d’à propos. Ils ne nous sont pas davantage inférieurs sous le rapport de l’industrie, ainsi qu’en témoigne la merveilleuse magnificence des villes de Cusco et de Mexico, où se voyaient, entre autres choses surprenantes, le jardin du roi où tous les arbres, les fruits et les plantes étaient, avec une ressemblance parfaite, reproduits en or en vraie grandeur et disposés comme cela se voit dans tout autre jardin; de même étaient reproduits de semblable façon, dans ses galeries, tous les animaux existant dans ses états ou vivant dans les mers qui les baignent; nous en pouvons 309 également juger par la beauté de leurs ouvrages où ils utilisaient les pierreries et les plumes, par ceux qu’ils confectionnaient en coton et par leurs peintures. Quant à leur piété, la manière dont ils observaient les lois, leur bonté, leur libéralité, leur loyauté et leur franchise, notre infériorité sous ce rapport nous a été des plus utiles; ils ont été victimes de ce qu’ils valaient mieux que nous à cet égard, par là ils se sont vendus et trahis eux-mêmes.
Pour ce qui est de leurs vertus, il n’est pas douteux que s’ils ont succombé c’est beaucoup plus par ruse et par surprise que grâce à la valeur de leurs ennemis.—Pour ce qui est de la hardiesse et du courage, ainsi que de la fermeté, de la constance, de la résolution contre les douleurs, la faim et la mort, je ne craindrais pas d’opposer les exemples que je trouverais chez eux aux plus fameux d’entre ceux de l’antiquité dont notre monde a conservé la mémoire. Ne tenons pas compte chez ceux qui les ont subjugués, des ruses et des jongleries auxquelles ils ont eu recours pour les tromper, de l’étonnement facile à concevoir qu’ont éprouvé ces nations en voyant apparaître si inopinément des gens ayant de la barbe, si différents d’elles-mêmes par le langage, la religion, le physique, l’attitude; venant d’un endroit du monde si éloigné, qu’ils n’avaient jamais supposé qu’il fût habité; montés sur de grands monstres qui leur étaient inconnus à eux qui n’avaient jamais vu ni cheval, ni animal quelconque dressé à porter un homme ou toute autre charge; garnis d’une peau luisante et dure, et d’une arme tranchante et resplendissante, alors qu’eux, pour la possession de cette merveille qu’était un miroir qui les captivait par son brillant, ou celle d’un couteau, donnaient en échange des valeurs considérables en or et en perles, et qu’ils ne savaient ni ne pouvaient, avec les moyens à leur disposition, même en s’y appliquant tout à loisir, percer ces armures en acier. A quoi il faut ajouter l’effet foudroyant de nos canons et de nos arquebuses, leur bruit semblable à celui du tonnerre, qui eussent été capables de porter le trouble même dans l’âme de César s’ils l’eussent surpris aussi inexpérimenté des effets de ces armes que l’étaient, à ce moment, ces peuples qui, en dehors de quelques tissus de coton qu’ils étaient à même de fabriquer, allaient tout nus, dont les armes les plus redoutables étaient l’arc, les pierres, des bâtons, des boucliers en bois, dont enfin l’amitié et la bonne foi avaient été surprises par les envahisseurs, et qui étaient tout étonnés de voir des choses inconnues qui leur paraissaient étranges. Supposons que les avantages que donnaient aux conquérants de semblables inégalités n’aient pas existé, les combats qui leur ont procuré de si nombreuses victoires n’auraient même pas été livrés. Quand je considère l’ardeur incroyable avec laquelle tant de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants ont tant de fois affronté avec persistance, pour la défense de leurs dieux et de leur liberté, des dangers dont ils ne pouvaient 311 triompher, leur généreuse obstination à supporter toutes les difficultés et souffrances les plus extrêmes, la mort même, plutôt que de se soumettre à la domination de gens qui les avaient si honteusement abusés: certains, faits prisonniers, allant jusqu’à se laisser mourir de privations et de faim entre les mains de leurs ennemis, plutôt que d’accepter la vie de la part d’adversaires qui, pour les vaincre, avaient mis en œuvre des procédés aussi vils; quand je réfléchis à tout cela, je suis amené à penser que s’ils avaient été attaqués à armes égales et avaient eu la même expérience que leurs vainqueurs, ne leur eussent-ils pas été supérieurs en nombre, la victoire eût été disputée avec le même acharnement, plus grand peut-être encore, qu’en aucune autre des guerres dont nous sommes témoins.
Tout autre eût été le sort de ces peuples s’ils fussent tombés entre les mains de conquérants plus humains et plus policés. Témoignage de leur bon sens et de leur mansuétude.—Que n’est-ce par Alexandre, ou ces anciens Grecs et Romains, que cette si noble conquête ait été faite! Cette transformation de tant d’empires et de peuples, ces si grands changements eussent été effectués avec douceur; c’est progressivement qu’eût été défriché ce qu’il y avait en eux d’inculte; les bonnes semences qu’ils tenaient de la nature eussent été consolidées et mises à même de germer; et les conquérants, introduisant chez eux les progrès réalisés pour la culture de la terre et aussi, en admettant que cela eût été nécessaire, les arts concourant à l’ornement des villes, auraient en même temps associé les vertus grecques et romaines à celles déjà innées chez ces peuples. Quelle réparation, quelle amélioration c’eût été pour leur civilisation, comparées à ce qu’ont causé les exemples et les débordements de ceux des nôtres qui, les premiers, ont abordé ces terres nouvelles si, en amenant ces populations à admirer et imiter leurs vertus, ils avaient fait naître entre elles et nous un accord fraternel et régner la bonne intelligence! Combien il eût été facile de tirer profit de ces âmes neuves, affamées du désir d’apprendre et qui, pour la plupart, présentaient de si heureuses dispositions naturelles! Au lieu de cela, nous avons abusé de leur ignorance et de leur inexpérience, pour leur inculquer plus facilement la trahison, la luxure, l’avarice; pour les porter à des actes de toutes sortes d’inhumanité et de cruauté, à l’exemple et sur le modèle de nos mœurs. Qui jamais a sacrifié à ce degré, dans l’intérêt du commerce et du trafic? Que de villes rasées, que de nations exterminées, que de millions d’individus passés au fil de l’épée, que de bouleversements dans cette si belle et si riche partie du monde, pour le négoce des perles et du poivre! Misérables victoires! Jamais l’ambition, jamais les inimitiés publiques n’ont poussé à ce point les hommes les uns contre les autres et produit de si horribles hostilités et de si révoltantes calamités.
En suivant les côtes, quelques Espagnols, à la recherche de mines, prirent terre dans une contrée fertile, agréable à l’œil et fort peuplée; 313 et, adressant aux populations leurs requêtes habituelles: «Ils étaient, disaient-ils, des gens paisibles, venant de loin, envoyés par le roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitée, auquel le Pape, représentant de Dieu sur la terre, avait concédé la domination sur les Indes entières. S’ils consentaient à devenir ses tributaires, ils seraient traités avec une grande bienveillance.» Ensuite de cela, ils demandaient des vivres pour se nourrir, et de l’or pour la confection de certains médicaments; au surplus, ils prônaient la croyance en un seul Dieu, la vérité de notre religion qu’ils recommandaient d’adopter, ajoutant au tout quelques menaces. La réponse qui leur fut faite, est celle-ci: «Pour des gens placides, s’ils l’étaient, ils n’en avaient guère l’apparence; quant à leur roi, il devait être bien indigent et nécessiteux, puisqu’ils sollicitaient pour lui; et celui qui lui avait attribué leur territoire bien aimer les dissensions, puisqu’il donnait à un tiers des terres qui ne lui appartenaient pas, au risque de le mettre aux prises avec leurs anciens possesseurs. Pour ce qui était des vivres, ils leur en fourniraient; quant à de l’or, ils en avaient peu, c’était chose qu’ils n’appréciaient guère, parce qu’elle était inutile à leur vie que leur unique préoccupation était de passer heureuse et agréable; qu’en conséquence, ils pourraient sans scrupule prendre ce qu’ils en trouveraient en dehors de ce qui était employé au service de leurs cultes. Que ce qu’ils disaient de la croyance en un seul Dieu, leur plaisait; mais qu’ils ne voulaient pas changer de religion, en ayant une qui leur avait depuis si longtemps rendu service; que, du reste, ils avaient coutume de ne prendre conseil que de leurs amis et connaissances; quant à leurs menaces, c’était manquer de jugement que d’en adresser à des gens dont le caractère et le degré de puissance leur étaient inconnus; qu’ils se dépêchassent donc de quitter promptement leur pays, car eux-mêmes n’étaient pas habitués à prendre en bonne part ni les honnêtetés ni les remontrances de gens qui leur étaient étrangers et se présentaient en armes; qu’autrement, s’ils ne déféraient pas à cette injonction, on agirait à leur égard comme il avait été fait de ces autres», et ils montraient, exposées autour de la ville les têtes de quelques individus mis à mort par autorité de justice. Voilà comment balbutiaient ces peuples en enfance. Ce qui est certain, c’est que, quelques autres avantages que le pays pût leur offrir, les Espagnols ne s’arrêtèrent et ne tentèrent de coups de main ni ici, ni ailleurs, où ils ne trouvèrent pas les marchandises qu’ils recherchaient; le pays des Cannibales, dont j’ai déjà parlé et qu’ils n’occupèrent pas, en témoigne.
Mauvaise foi et barbarie des Espagnols à l’égard des derniers rois du Pérou et de Mexico; horrible autodafé qu’ils firent un jour de leurs prisonniers de guerre.—Le roi du Pérou, l’un des deux plus puissants monarques, rois des rois de ce nouveau monde, et peut-être aussi de celui que nous occupons, fut l’un des derniers qu’ils détrônèrent. L’ayant fait prisonnier dans une bataille, ils lui imposèrent une rançon excessive, dépassant 315 tout ce qu’on peut imaginer et qui fut exactement payée. Pendant sa captivité, il fit preuve d’un caractère franc, libéral, ferme et d’un esprit juste et étendu. Après en avoir tiré un million trois cent vingt-cinq mille cinq cents écus pesant d’or et, en outre, de l’argent et autres choses ne s’élevant pas à moins (leurs chevaux n’allaient plus que ferrés d’or massif), l’idée leur vint de savoir et de s’approprier ce qui pouvait rester des trésors de ce prince, quelle que fût la déloyauté à laquelle ils dussent avoir recours pour en arriver à leurs fins. A cet effet, on porta contre lui une accusation, à l’appui de laquelle on produisit des preuves aussi fausses que l’accusation elle-même, lui imputant d’avoir conçu de provoquer un soulèvement dans ses états pour recouvrer sa liberté; et, là-dessus, sur un beau jugement rendu par ceux-là mêmes qui avaient inventé cette trahison, on le condamna à être étranglé et pendu publiquement, après lui avoir fait racheter le supplice d’être brûlé vif par une acceptation du baptême, qui lui fut donné sur le lieu même de l’exécution; traitement inouï et barbare qu’il subit cependant avec calme et courage, sans se démentir ni par son attitude, ni par ses paroles qui, dans la forme comme dans le fond, furent vraiment dignes d’un roi. Puis, pour endormir ses peuples étonnés et frémissants de faits si étranges, on affecta un grand deuil de sa mort, et on lui fit de somptueuses funérailles.
De ces deux rois, l’autre était le roi de Mexico. Longtemps il défendit sa ville que les Espagnols assiégeaient; et, dans ce siège, les assiégés montrèrent, plus que jamais jusqu’où peuvent aller la souffrance et la persévérance chez un prince et chez un peuple. Son mauvais sort fit qu’il tomba vivant au pouvoir de ses ennemis par suite d’une capitulation portant qu’il serait traité en roi; et autant de temps qu’il demeura entre leurs mains, il se comporta avec toute la dignité de son rang.—Ne trouvant pas après leur victoire tout l’or qu’ils avaient espéré, les vainqueurs, après avoir tout remué et fouillé, se mirent à poursuivre leurs recherches en exerçant sur leurs prisonniers les plus cruels traitements qu’ils purent inventer; mais, se heurtant à des courages plus forts que leurs supplices, ils ne réussirent pas, et en conçurent une telle rage qu’ils en vinrent à mettre à la torture, en présence l’un de l’autre, le roi lui-même et l’un des principaux seigneurs de sa cour. Ce seigneur, environné de brasiers ardents, finit, sous l’effet de la douleur, par implorer son maître d’un regard qui faisait pitié, comme pour lui demander pardon de ce qu’il ne pouvait plus résister. Le roi, qui se trouvait en même situation, fixant sur lui un regard sévère et assuré, en reproche de sa lâcheté et de sa pusillanimité, lui dit ces seuls mots d’une voix ferme et rude: «Et moi, suis-je donc dans un bain; suis-je plus à mon aise que toi?» et, presque aussitôt, succombant à la douleur, ce seigneur rendit sur place le dernier soupir. Le roi fut emporté à moitié rôti; non par commisération, mais parce que sa constance faisait ressortir encore davantage tout l’odieux de la cruauté de ses bourreaux; la pitié du reste ne toucha 317 jamais ces âmes barbares qui, pour obtenir une information douteuse sur quelques vases d’or à piller, ne regardaient pas à faire griller sous leurs yeux un homme, bien plus, un roi si grand par ses mérites et sa situation.—Plus tard, celui-ci ayant tenté de s’affranchir par les armes de la longue captivité et de la sujétion en lesquelles on le tenait, ils le pendirent; et sa fin, elle aussi, fut digne d’un prince magnanime.
Une autre fois, ils brûlèrent vifs, d’un seul coup, sur un même bûcher, quatre cent soixante individus, qui étaient simplement prisonniers de guerre; quatre cents étaient gens du commun et soixante comptaient parmi les principaux seigneurs d’une même province.—C’est d’eux-mêmes que nous tenons ces détails, car non seulement ils les avouent, mais ils s’en vantent et les crient bien haut. Est-ce comme témoignage de leur justice ou par zèle pour la religion? quoi qu’il en soit, ce sont des moyens tout autres que ceux qu’admet une si sainte cause, et elle les réprouve. Si ces barbares s’étaient proposé de propager notre foi, ils auraient considéré que ce n’est pas en s’emparant de territoires qu’elle s’étend, mais en prenant possession des hommes; et ils se seraient bornés aux meurtres inévitables qu’entraîne la guerre, sans se livrer bénévolement à ces boucheries universelles comme il peut s’en pratiquer à l’égard de bêtes sauvages, poussées autant que le fer et le feu en donnent possibilité, n’épargnant de parti pris que ceux, en nombre suffisant, dont ils voulaient faire de misérables esclaves, pour le service et l’exploitation de leurs mines; si bien que plusieurs de leurs chefs, déconsidérés et haïs de tous, ont été punis de mort, sur les lieux mêmes de leurs conquêtes, par ordre des rois de Castille, justement offensés par l’horreur de ces actes abominables. Dieu a permis avec justice que les produits de ces pillages en grand aient été engloutis par la mer pendant qu’on les transportait en Europe, ou dans des guerres intestines où ces brigands se sont dévorés les uns les autres; la plupart ont péri sur place, sans tirer aucun fruit de leur victoire.
L’or par lui-même n’est pas une richesse, il ne le devient que s’il est mis en circulation.—Quant à ce qui, de ces trésors, est parvenu en Espagne, bien qu’entre les mains d’un prince bon et sage administrateur, les résultats qu’ils ont donnés, n’ont pas confirmé les espérances qu’en avaient conçues ses prédécesseurs, et que devait produire cette profusion de richesses d’abord rencontrées sur ce nouveau continent; car, bien qu’encore ces résultats aient été considérables, ils ne sont rien auprès de ceux qu’on en pouvait attendre. Cette déception doit être attribuée à ce que l’usage de la monnaie était complètement inconnu dans ces contrées; par suite tout leur or, ne servant que pour en faire montre et parade comme il arrive d’un objet mobilier qui se transmet de père en fils, se trouvait avoir été réuni entre les mains de quelques grands potentats qui en épuisaient complètement les mines pour en fabriquer cet immense monceau de vases et de statues employés à 319 l’ornement de leurs palais et de leurs temples; tandis que chez nous, nous le faisons servir à des acquisitions et au commerce; nous le travaillons, nous lui donnons mille formes sous lesquelles il se répand et se disperse. Imaginons que nos rois aient de même amoncelé tout l’or qu’ils ont pu amasser durant des siècles et qu’ils l’aient gardé immobilisé, ce qui s’est produit chez ces peuples se reproduirait chez nous.
Les Mexicains croyaient à cinq âges du monde et pensaient se trouver dans le dernier quand les Espagnols vinrent les exterminer.—Les Mexicains étaient quelque peu plus civilisés que les autres peuples de cette partie du monde et plus avancés dans les arts. Ils avaient, comme elle a existé chez nous, la croyance que l’univers touche à sa fin, et la désolation que nous avons apportée chez eux en fut considérée comme un signe précurseur. Ils pensaient que l’existence du monde comporte cinq phases, formées chacune par l’existence de soleils en nombre égal et devant se succéder, desquels quatre auraient déjà fourni leur temps et dont le cinquième est celui qui nous éclaire. Le premier de ces soleils fut détruit, avec toutes les créatures existantes, à la suite d’un déluge universel. Le second, par la chute du ciel qui étouffa tout ce qui avait vie: cet âge fut celui des géants, dont on montrait aux Espagnols des ossements qui, comparés à ceux de l’homme, leur assignent une taille de vingt palmes de hauteur. Le troisième prit fin par le feu qui embrasa et consuma tout. Le quatrième, par un cyclone d’air et de vent qui alla jusqu’à niveler des montagnes; les hommes n’en moururent pas, mais furent changés en magots (quelles impressions la crédulité humaine, dans sa faiblesse, n’est-elle pas susceptible de recevoir!). Quand périt ce quatrième soleil, le monde demeura pendant vingt-cinq ans plongé dans les ténèbres: la quinzième année de cette période, furent créés un homme et une femme qui reconstituèrent la race humaine; dix ans après cette création, apparut un jour un nouveau soleil qui venait d’être créé; c’est de ce moment que ces peuples font dater les années par lesquelles ils comptent. Trois jours après la création de ce dernier soleil, les dieux anciens moururent; puis, du jour au lendemain, naquirent ceux qui existent actuellement.—L’auteur de ces renseignements ne sait pas ce qu’ils supposent de la manière dont ce soleil prendra fin; mais nous touchons à cette grande conjonction des astres, à laquelle a été due, il y a huit cents et tant d’années, le quatrième bouleversement qui a précédé la période actuelle et qui, d’après les astrologues, doit amener des perturbations considérables dans le monde et être le point de départ d’un nouvel ordre de choses.
La route de Quito à Cusco au Pérou surpasse à tous égards n’importe quel ouvrage qui ait été exécuté en Grèce, à Rome, ou en Égypte.—La pompe et la magnificence qui se rencontraient dans ces pays et qui m’ont conduit à aborder ce sujet, étaient telles, que ni la Grèce, ni Rome, ni l’Égypte ne 321 présentent d’ouvrages aussi grandioses, aussi utiles et qui aient été d’exécution aussi difficile que cette route qui existe au Pérou, œuvre des rois du pays, qui va de la ville de Quito à celle de Cusco que sépare une distance de trois cents lieues. Elle est en droite ligne, plane, large de vingt-cinq pas, pavée, encadrée de chaque coté de hautes et belles murailles le long desquelles, à l’intérieur, coulent continuellement deux ruisseaux d’eau vive; elle est bordée de beaux arbres, qu’on nomme molly. Là où, en la construisant, on s’est heurté à des montagnes ou à des rochers, on les a entaillés ou aplanis; là où l’on a eu affaire à des bas-fonds, ils ont été comblés par de la maçonnerie. En fin de chaque journée de marche, sont de beaux bâtiments, renfermant des approvisionnements de vivres, de vêtements et d’armes, tant pour les voyageurs que pour les armées qui la suivent. Pour bien apprécier la valeur de cet ouvrage, il faut tenir compte de la difficulté vaincue qui a été particulièrement grande; on y a fait emploi de pierres de taille, dont les moindres n’avaient pas moins de dix pieds de côté; faute d’autres moyens de transport, il a fallu les charrier à force de bras; pour les mettre en place, comme ils ne connaissaient pas l’art des échafaudages, on établissait simplement, contre les bâtiments que l’on élevait, des rampes en terre qu’on enlevait une fois le travail achevé.
Pour en revenir aux chars, ils étaient inconnus dans le nouveau monde.—Pour revenir à nos chars, c’était chose inconnue dans le nouveau monde; on y suppléait, ainsi qu’à toute autre espèce de voitures, par des hommes qui vous portaient sur leurs épaules.—Le jour où le dernier roi du Pérou fut fait prisonnier, il était ainsi porté, au milieu du combat, sur des brancards d’or, assis sur un siège d’or. On voulait le prendre vivant, et, autant on tuait de ses porteurs pour le faire tomber, autant s’en trouvaient d’autres qui, rivalisant de zèle, prenaient la place des morts, si bien qu’on ne put le jeter à bas, quelque carnage qu’on fît de ses gens, jusqu’à ce qu’un cavalier, se portant à lui, le saisit et le précipita à terre.
Qui connaît les grandeurs et leurs incommodités, peut les fuir sans beaucoup d’efforts ni grand mérite.—Puisque nous ne pouvons atteindre aux grandeurs, vengeons-nous en médisant d’elles; d’ailleurs, ce n’est pas absolument médire d’une chose que d’y trouver des défauts; il y en a dans tout, si beau, si désirable que ce soit. En général, les grandeurs ont cet avantage incontestable, qu’elles peuvent s’abaisser autant que cela plaît, et qu’il est loisible 323 à qui en jouit de choisir la condition qui lui convient, car on tombe rarement de toute sa hauteur et les grandeurs dont on peut descendre sans tomber existent en plus grand nombre que les autres.—J’estime que nous faisons des grandeurs plus de cas qu’elles ne valent, et qu’aussi nous estimons au-dessus de sa juste valeur la résolution que nous voyons prendre, ou que nous entendons dire avoir été prise, par ceux qui les méprisent ou qui y renoncent de leur propre mouvement; elles ne sont pas, par essence, tellement avantageuses, que de s’y dérober soit, par lui-même, un acte si merveilleux. Je trouve bien difficile l’effort nécessaire pour résister à la souffrance que les maux nous causent, mais ce me paraît une petite affaire que de se contenter d’une médiocre situation de fortune et de fuir les grandeurs; c’est une vertu à laquelle, moi, qui ne suis qu’un oison, j’arriverais, je crois, sans avoir à me contraindre beaucoup; combien donc il en doit peu coûter à ceux chez lesquels entre en ligne de compte la considération que nous vaut d’ordinaire ce refus, qui peut être dicté par une ambition plus grande que le désir qu’on peut avoir des jouissances qu’elles donnent, d’autant que l’ambition n’est jamais plus conséquente avec elle-même que lorsqu’elle emploie des voies détournées et inusitées.
Montaigne n’a jamais souhaité de postes très élevés; une vie douce et tranquille lui convient bien mieux qu’une vie agitée et glorieuse.—Je m’efforce de devenir patient et de modérer mes désirs; j’ai tout autant à souhaiter qu’un autre, et, dans les souhaits que je forme, j’apporte autant de liberté et n’y mets pas plus de discrétion que qui que ce soit; cependant, il ne m’est jamais arrivé de souhaiter ni royaume, ni empire, non plus que d’arriver à d’éminentes situations qui donnent le commandement; ce n’est pas là ce que je vise, je m’aime trop pour cela. Quand je rêve d’accroître mon importance, mes visées n’ont rien d’élevé; modestes et timorées comme le comporte mon caractère, elles ne s’appliquent qu’aux progrès que je puis faire en décision, prudence, santé, beauté et même en richesses; mais je ne songe à m’élever ni en crédit, ni en autorité pour arriver à pouvoir davantage; l’idée seule en écrase mon imagination. Au contraire de cet autre, je préférerais être le deuxième ou le troisième à Périgueux, que le premier à Paris ou au moins, sans mentir, le troisième à Paris que d’y être le premier en charge. Je ne veux pas plus, comme un misérable inconnu, avoir à me débattre aux portes avec un huissier, que de faire que s’ouvrent, sur mon passage, les foules en adoration. Je suis habitué à une situation moyenne, aussi bien du fait du sort que par goût, et ai montré par la conduite que j’ai tenue dans le cours de ma vie et par ce que j’ai entrepris, que j’ai plutôt fui que désiré m’élever au-dessus du degré de fortune où Dieu m’a fait naître; en tout, s’en tenir à l’ordre établi par la nature, est chose à la fois juste et facile. J’ai l’âme poltronne au point que je ne mesure pas le succès par la hauteur à laquelle il nous place, mais à la facilité avec laquelle il s’obtient.
325
Si mon cœur n’a pas de hautes visées, en revanche il est franc et veut que je reconnaisse hardiment son humilité.—L. Thorius Balbus a été un galant homme, beau, doué d’une bonne santé, entendu dans tous les plaisirs et commodités de la vie dont il a largement joui; il a vécu tranquille, n’ayant en vue que sa propre satisfaction, l’âme bien préparée contre la mort, les superstitions, la douleur et autres misères que l’homme ne peut éviter; pour achever, il a fini les armes à la main, sur un champ de bataille, pour la défense de son pays.
Si j’avais à établir un parallèle entre cette existence et celle de M. Régulus que chacun connaît, si grande, de si haute vertu, couronnée par une fin admirable; l’une sans nom, sans éclat; l’autre exemplaire et glorieuse au delà de toute expression, j’en parlerais certainement comme a fait Cicéron, si je savais aussi bien dire que lui. Mais s’il me fallait prendre l’une ou l’autre pour modèle, je dirais que la première est autant dans mes moyens et selon mes désirs que je règle sur ces moyens, que l’autre les dépasse et de beaucoup; je ne puis que vénérer celle-ci, tandis que je me résoudrais volontiers à vivre celle-là.
Revenons aux grandeurs de ce monde dont nous parlions. Que je l’exerce ou que je la subisse, la domination n’est pas dans mes goûts.—Otanez, l’un des sept seigneurs de Perse qui pouvaient aspirer à l’empire, adopta un parti que j’aurais moi-même pris volontiers. Il céda à ses compagnons son droit de concourir à la souveraineté, soit par l’élection, soit par le sort, sous condition que lui et les siens vivraient sur le territoire de l’empire indépendants de toute obligation, sans que personne ait autorité sur eux; qu’ils ne seraient tenus qu’à l’observation des lois anciennes et jouiraient de toute liberté n’y portant pas atteinte: il était aussi peu porté à commander qu’à être commandé.
Il est très porté à excuser les fautes des rois, parce que leur métier est des plus difficiles; on leur cède en tout, ils n’ont même pas la satisfaction de la difficulté vaincue.—Le plus pénible et le plus difficile métier de ce monde est, suivant moi, d’être un roi digne de ce rang. J’excuse plus leurs fautes qu’on ne le fait généralement, parce que je considère l’énorme fardeau dont ils ont la charge et que j’en suis étonné. Il est difficile de conserver de la mesure dans l’exercice d’une puissance aussi démesurée, quoique ce soit un singulier encouragement à la vertu pour ceux mêmes qui ne sont pas parfaitement doués par la nature, que d’être dans une situation où tout ce que vous pouvez faire de bien est noté et enregistré, où tant de gens aspirent à participer au moindre de vos bienfaits, et où votre capacité, comme celle des prédicateurs, est soumise surtout à l’appréciation du peuple, mauvais juge en la matière, facile à tromper comme à contenter. Il est peu de choses sur lesquelles nous pouvons émettre un jugement sincère, parce qu’il en est peu auxquelles nous n’ayons de quelque façon un intérêt particulier. La supériorité et l’infériorité, le maître 327 et le sujet sont en opposition et se jalousent naturellement; perpétuellement ils empiètent sur leurs domaines respectifs. Je ne crois aucun d’eux, quand ils revendiquent ce qu’ils prétendent être leurs droits; c’est à la raison seule, qui n’admet pas les compromissions et conserve son impartialité, qu’il appartient de décider quand elle peut se faire entendre. Je feuilletais, il n’y a pas un mois, deux livres d’auteurs écossais, traitant tous deux ce même sujet, mais à des points de vue opposés; celui qui prend parti pour le peuple, fait du roi un être de condition pire qu’un charretier; celui qui en tient pour le monarque le place, sous le rapport de la puissance et de la souveraineté, à quelques brasses au-dessus de Dieu.
L’un des inconvénients des grandeurs, qu’une circonstance fortuite m’a révélé récemment, est la suivante: Il n’y a rien peut-être de plus agréable dans les relations entre hommes, que les assauts auxquels nous nous livrons les uns contre les autres, tant par point d’honneur que pour faire ressortir notre valeur, dans les divers exercices soit du corps, soit de l’esprit; assauts auxquels ceux qui sont investis de la souveraine grandeur, ne prennent en fait aucune part sérieuse.—Il m’a paru, en effet, qu’à force de respect, on y traite toujours les princes avec dédain et en leur faisant injure. Dans mon enfance, une chose m’offensait infiniment, c’était que ceux qui luttaient avec moi dans nos jeux, évitaient de s’y appliquer franchement pour de bon, parce qu’ils me trouvaient indigne de leurs efforts; c’est ce qu’on voit arriver tous les jours aux princes, chacun se trouve indigne de leur tenir tête. Si on s’aperçoit qu’ils ont le moindre désir d’obtenir la victoire, il n’est personne qui ne s’y prête et ne préfère trahir sa propre gloire que d’offenser la leur, et qui n’apporte à la leur disputer que juste la résistance indispensable pour qu’elle leur fasse honneur. Quelle part ont-ils à la mêlée, alors que chacun y bataille pour eux? Ils me font l’effet de ces paladins des temps passés, se présentant aux joutes et aux combats avec des armes enchantées.—Brisson, luttant à la course avec Alexandre, se laissa battre, en ne donnant pas tout ce qu’il eût pu: Alexandre l’en tança; il eût dû lui faire donner le fouet.—C’est là ce qui faisait dire à Carnéade que «les enfants des princes n’apprennent rien où la vérité ne soit faussée, si ce n’est à manier les chevaux; en tout autre exercice, chacun cède devant eux et leur donne gagné, mais le cheval, qui n’est ni flatteur ni courtisan, jette le fils du roi à terre tout comme il ferait du fils d’un crocheteur».
Homère a dû se résigner à admettre que Vénus, cette si vénérée et si délicate déesse, soit blessée dans les combats livrés sous Troie, afin de pouvoir la doter de courage et de hardiesse, qualités que ne peuvent posséder ceux qui n’ont pas à redouter le danger; si on fait les dieux susceptibles de se courroucer, de craindre, de fuir, de ressentir la jalousie, la douleur, de se passionner, c’est pour pouvoir leur faire honneur des vertus qui sont la contrepartie 329 de ces imperfections. Celui qui n’a part ni au hasard, ni à la difficulté, ne peut prétendre à bénéficier de l’honneur et du plaisir qui suivent les actions qui présentent des risques.—C’est pitié d’avoir un pouvoir tel que tout cède devant vous; une telle fortune rejette trop loin de vous la société et ceux qui vous tiennent compagnie, elle vous plante trop à l’écart. Cette commode et lâche facilité à faire que tout s’abaisse sous vous, exclut tout plaisir de n’importe quelle sorte; elle fait que vous glissez et ne marchez pas; c’est dormir, ce n’est pas vivre. Représentez-vous un homme omnipotent: il est sous une oppression constante; il faut qu’il vous demande de lui faire l’aumône de lui résister et de l’entraver dans ses volontés; son bonheur n’est pas complet et il en souffre.
Leurs talents et leurs vertus ne peuvent se manifester; on leur cache leurs défauts; comment s’étonner qu’ils commettent tant de fautes?—Les bonnes qualités des princes sont, en eux, comme mortes et non avenues; car elles ne se manifestent que par comparaison, et, chez eux, le point de comparaison n’existe pas; ils ne connaissent guère les louanges de bon aloi, étant toujours affligés d’une approbation continue, qui jamais ne varie. Ont-ils affaire au plus sot de leurs sujets? ils n’ont pas le moyen de prendre avantage sur lui: «C’est parce qu’il est mon roi,» dit celui-ci; et, ce disant, il lui semble avoir donné suffisamment à entendre qu’il s’est prêté à être vaincu. Par ce fait qu’ils sont rois, leur grandeur étouffe et absorbe toutes les autres qualités réelles et essentielles qu’ils peuvent posséder et qui ne peuvent se faire jour; elle ne leur laisse, pour se faire valoir, que les actions qui les touchent, telles que les devoirs de leur charge; un roi a une si haute situation, qu’en lui on ne voit qu’elle. Elle constitue en dehors de lui une atmosphère lumineuse qui l’environne, le cache et nous le dérobe; notre vue, arrêtée et aveuglée par ces flots de lumière, ne pouvant les pénétrer, cesse de percevoir ce qu’ils lui voilent.—Le sénat romain avait décerné à Tibère le prix de l’éloquence; il le refusa, estimant que l’eût-il mérité, il ne lui eût pas été possible de se prévaloir d’un jugement rendu par une assemblée aussi peu libre de ses actes.
Comme on leur concède tout ce qui peut les honorer, on en arrive à autoriser et aggraver leurs défauts et leurs vices, non seulement en les approuvant mais aussi en les imitant.—Dans l’entourage d’Alexandre, chacun portait, comme lui, la tête inclinée sur le côté; et les flatteurs de Denys, lorsqu’ils étaient en sa présence, se heurtaient entre eux, poussaient et renversaient ce qui était à leurs pieds, pour paraître avoir la vue aussi courte que lui. Être affecté de hernie a été parfois un titre de recommandation et de faveur; j’ai vu des gens simuler la surdité. Plutarque a vu des courtisans qui, parce que le maître haïssait sa femme, répudiaient la leur qu’ils aimaient; bien plus, le libertinage, les mœurs les plus dissolues, et aussi la déloyauté, le blasphème, la cruauté, l’hérésie, tout comme la superstition, l’irréligion, la mollesse et encore 331 pis, si pis il y a, ont été en crédit par suite de mauvais exemples, plus dangereux encore que celui donné par les flatteurs de Mithridate qui, parce que leur maître prétendait à l’honneur d’être bon médecin, se faisaient inciser et cautériser les membres par lui; les autres, c’est leur âme, partie autrement plus délicate et plus noble, qu’ils souffrent se voir cautérisée.
Pour achever par où j’ai commencé, je rappellerai que l’empereur Adrien discutant avec le philosophe Favorinus sur l’interprétation à donner à un mot, celui-ci ayant cédé assez promptement et ses amis le lui reprochant: «Vous vous moquez, leur dit-il; vous voudriez qu’il ne soit pas plus savant que moi, lui qui commande à trente légions!»—Auguste avait écrit des vers contre Asinius Pollion: «Quant à moi, dit Pollion, je me tais: il n’est pas sage d’écrire à rencontre de qui peut proscrire.»—Tous deux avaient raison; Denys, parce qu’il n’avait pu égaler Philoxène en poésie et Platon dans ses raisonnements, condamna l’un aux carrières et fit vendre l’autre comme esclave dans l’île d’Égine.
En punissant les coupables, la justice ne saurait avoir d’autre but que d’empêcher les autres hommes de commettre les mêmes fautes; c’est ainsi que l’aveu que Montaigne fait de ses défauts, doit servir à corriger les autres.—C’est un usage de nos procédés judiciaires de condamner des gens, pour que cela serve d’avertissement aux autres. Les condamner uniquement parce qu’ils ont failli, serait, comme dit Platon, une ineptie, parce que ce qui est fait ne peut se défaire; aussi les condamne-t-on pour qu’ils ne commettent pas à nouveau la même faute, ou qu’on ne suive pas l’exemple qu’ils ont donné; pendre quelqu’un ne le corrige pas, ce sont les autres qui sont corrigés par ce qui lui arrive.—Je fais de même: parmi mes erreurs, il y en a qui sont naturelles et qui ne peuvent être ni corrigées ni réparées; et, tandis que les honnêtes gens servent la cause publique en provoquant à les imiter, je la sers peut-être aussi en montrant ce qui, en moi, est à éviter: «Ne voyez-vous pas que le fils d’Albus vit mal et que Barrus est dans la misère? Leur exemple doit nous instruire à ne pas dissiper notre patrimoine (Horace)»; en publiant et accusant mes imperfections, il se trouvera des gens qui apprendront à les redouter.—Les points que j’apprécie le plus en moi tirent plus d’honneur de ce qu’ils constituent contre moi des chefs 333 d’accusation que s’ils m’étaient des titres de recommandation; voilà pourquoi j’y reviens et m’y arrête si souvent. Mais quand on a tout raconté sur soi, on ne peut plus se mettre en cause qu’à son détriment; on amplifie ce que vous avouez prêter à condamnation, on ne vous croit pas sur ce que vous estimez être à louer. Il peut se trouver des gens comme moi qui m’instruis plus par les contraires que par les similaires, en voyant ce qui est à fuir plutôt que ce qui est à suivre, tendance qui faisait dire à Caton l’ancien que «les sages ont plus à apprendre des fous, que les fous des sages». Pausanias rapporte qu’un joueur de lyre de l’antiquité avait l’habitude d’obliger ses élèves à aller écouter un mauvais musicien qui logeait en face de lui, pour leur apprendre à haïr ses mauvais accords et ses fausses mesures. L’horreur que j’éprouve à voir des cruautés, me reporte plus vers la clémence que ne m’y attirerait quelqu’un auquel je la verrais pratiquer; la vue d’un bon écuyer ne m’incite pas autant à rectifier ma position à cheval, que si j’aperçois un procureur ou un vénitien cheminant ridiculement sur une monture de la sorte; entendre parler un langage incorrect, m’amène à corriger le mien, bien plus que si celui que l’on me tient est parfait. Tous les jours les sottises d’autrui m’avertissent et me mettent sur mes gardes; ce qui blesse, touche et éveille davantage que ce qui plaît. Le temps où nous vivons est propre à nous amender à reculons, en ce que nous voyons faire plus souvent ce qu’on ne devrait pas que ce qui devrait être, et que le désaccord règne parmi nous plus que l’accord. Ayant peu profité des bons exemples, j’utilise les mauvais dont les leçons sont constamment sous mes yeux. Je me suis efforcé de me rendre aussi agréable que je voyais d’autres personnes l’être peu, aussi ferme que j’en voyais d’autres être faibles, aussi doux que j’en voyais de revêches, aussi bon que d’autres m’apparaissaient méchants; mais ce que je me proposais là, s’est trouvé au-dessus de mes forces.
C’est surtout dans les conversations que l’esprit se forme et se corrige; cet exercice est plus instructif encore que l’étude dans les livres.—L’exercice le plus naturel pour notre esprit, celui qui porte le plus de fruit, est, à mon sens, la conversation. Je trouve que c’est dans la vie ce qu’il y a de plus doux, et c’est pourquoi, à cette heure, si j’étais obligé de choisir, je consentirais plutôt, je crois, à perdre la vue que l’ouïe ou l’usage de la parole. Les Athéniens, et aussi les Romains, entretenaient cet exercice en grand honneur dans leurs académies; et, de nos jours, les Italiens en ont conservé quelque chose pour leur plus grand avantage, ce qui se constate quand on compare la compréhension qu’ils ont de toutes choses avec celle que nous en avons nous-mêmes.—L’étude dans les livres est une occupation calme et fade, qui n’échauffe pas; tandis que, lorsque nous discutons, nous apprenons et nous nous exerçons tout à la fois. Si je converse avec un contradicteur un peu serré, à l’âme forte, il me presse les flancs, me pique à gauche et à droite; ses idées font surgir les miennes; la jalousie, la 335 vanité, la contention d’esprit m’excitent et font que je m’élève au-dessus de moi-même; être tous du même avis quand on cause, est chose absolument ennuyeuse. Mais, si notre esprit se fortifie par les échanges d’idées avec des esprits vigoureux et pondérés, on ne saurait dire combien il perd et s’abâtardit au contact d’esprits inférieurs et maladifs; il n’y a pas de contagion qui gagne plus que celle-ci, et je sais par expérience ce qu’en vaut l’aune. J’aime à discourir, mais avec un petit nombre de gens et seulement pour mon agrément; se donner en cela en spectacle aux grands, et faire, à qui mieux mieux, parade de son esprit et de son verbiage, me semble un métier très peu convenable pour un homme d’honneur.
On y apprend à supporter la sottise; et Montaigne, connaissant la faiblesse de l’esprit humain, écoutait patiemment les propos les plus extravagants.—La sottise est un défaut; mais ne pouvoir la supporter, s’en dépiter et s’en tourmenter, comme cela m’arrive, est une autre sorte de maladie qui, par ses inconvénients, ne le cède guère à la sottise, et c’est ce dont je veux à présent m’accuser.—Je n’éprouve ni gêne, ni difficulté à entrer en conversation et à discuter, d’autant que l’opinion d’autrui trouve en moi un terrain peu propice pour y pénétrer et y pousser de fortes racines: nulle proposition ne m’étonne; nulle croyance, si contraire qu’elle soit à la mienne, ne me blesse; il n’y a pas d’idée, si frivole, si extravagante soit-elle, dont l’esprit humain ne me semble pouvoir s’accommoder et qui ne puisse en émaner.—Nous, qui ne reconnaissons plus à notre jugement le droit de décider sur quoi que ce soit, nous ne prêtons pas une attention sérieuse aux opinions diverses qui se produisent; mais, si notre jugement s’en désintéresse, nous y prêtons facilement l’oreille. Quand un des plateaux de la balance est absolument vide, je laisse l’autre osciller sous le faix de songes de vieille femme, et me trouve excusable d’admettre les nombres impairs comme plus favorables que les nombres pairs, de préférer le jeudi au vendredi, d’aimer mieux être douze ou quatorze à table que treize, de voir en voyage avec plus de satisfaction un lièvre courir dans le sens que je suis que s’il traversait mon chemin, de tendre, pour être chaussé, le pied gauche le premier plutôt que le droit. Toutes les idées chimériques qui sont en crédit autour de nous valent au moins qu’on les écoute; personnellement, j’estime qu’elles pèsent autant que rien, néanmoins elles font pencher la balance. Encore faut-il convenir que les opinions que professe le vulgaire sur certains points sont, par leur nature, de plus de poids que ces niaiseries; et qui les dédaigne d’une façon absolue, peut, en voulant éviter d’être taxé de superstition, pécher par opiniâtreté, ce qui est un défaut.
La contradiction éveille l’esprit, mais il faut qu’elle ait lieu en termes courtois; la critique est susceptible de nous corriger, mais il faut qu’elle soit de bonne foi et savoir l’accepter.—Par suite, les contradictions qu’on m’oppose ne m’offensent ni ne m’influent; elles ne font que m’exciter et me sont 337 des occasions de m’exercer. Nous n’aimons pas à voir nos erreurs relevées, et toute observation dans ce sens n’est acceptée et ne saurait avoir de l’effet qu’autant qu’elle nous est faite en manière de conversation, sans qu’on semble vouloir nous régenter; on ne considère pas si les objections présentées sont justes, mais seulement comment, à tort ou à raison, on les réfutera: au lieu de les accueillir à bras ouverts, nous les recevons avec nos griffes. Il me serait assez pénible de m’entendre dire par mes amis: «Tu es un sot, tu rêves»; cependant j’aime qu’entre gens galants on ait le courage de son opinion, que les mots traduisent exactement la pensée. Il faut nous fortifier l’ouïe et l’endurcir contre les tons par trop doucereux et cérémonieux.—J’aime une société où règne une familiarité forte et virile, une amitié qui se complaît dans l’âpreté et l’énergie qu’elle apporte dans ses relations, tel l’amour qui mord et égratigne jusqu’au sang; une conversation n’est suffisamment vigoureuse et ardente qu’autant qu’elle est querelleuse, qu’elle n’est pas civilisée et policée au point de redouter les chocs et d’être gênée dans ses allures, «car il n’y a pas de discussion sans contradiction (Cicéron)».—La contradiction ne me cause pas d’irritation, mais éveille mon attention; je presse mon contradicteur et fais mon profit de ses arguments; la recherche de la vérité ne devrait-elle pas être le but commun de l’un et de l’autre? Que répondre, si déjà la colère a infirmé notre jugement; si le trouble, devançant la raison, s’est emparé de notre esprit?—Il serait utile qu’un pari s’engageât entre ceux qui discutent, pari qui serait gagné par celui qui aurait raison; cela constituerait un témoignage matériel, qui nous permettrait de nous rendre compte des conversations dans lesquelles nous aurions le dessous, si bien que mon valet pourrait me dire: «L’année dernière, il vous en a coûté cent écus, en vingt fois différentes, pour avoir été ignorant et entêté.»—Je fais fête à la vérité et la caresse en quelques mains que je la trouve; je capitule allégrement et, vaincu, je lui tends mes armes du plus loin que je la vois approcher; pourvu qu’on ne le fasse pas d’une manière trop arrogante et impérieuse, j’éprouve plaisir à être repris et suis, plus souvent par politesse que parce que je me repens, dans la meilleure intelligence avec ceux qui m’ont montré mes torts. Par la facilité que je mets à me rendre, je cherche à encourager les gens à me reprendre librement et à les en récompenser * alors même que c’est à mes dépens.
Toutefois, il est * assurément malaisé d’amener tous les hommes de l’époque actuelle à penser ainsi; ils n’ont pas le courage de corriger autrui parce qu’ils n’ont pas le courage de souffrir être corrigés, et leur langage, quand ils se trouvent en présence les uns des autres, manque toujours de franchise. Pour moi, j’ai tant de plaisir à être connu et jugé, que la forme sous laquelle on me connaîtra, qu’on me condamne ou qu’on m’approuve, m’est indifférente; mes idées sont si souvent contradictoires, qu’elles se condamnent elles-mêmes, et il m’importe peu qu’un autre le fasse, vu surtout que je 339 donne à la critique que l’autorité que je veux; mais je me brouille avec qui le prend de trop haut, comme quelqu’un que je connais qui regrette les avis qu’il a émis quand on ne les approuve pas, et se trouve offensé lorsqu’on fait difficulté de les suivre.—Si Socrate accueillait toujours de bonne grâce les contradictions qu’on soulevait sur ce qu’il disait, on peut dire que cela tenait à sa force et que, certain de triompher de ses adversaires, il acceptait leurs objections comme autant de sujets devant lui procurer de nouvelles victoires. Nous voyons que, par contre, rien ne nous met en situation délicate comme l’opinion que nous avons de la supériorité de celui contre lequel nous discutons et du dédain que nous pouvons lui inspirer; aussi, ne serait-ce que par raison, celui qui a conscience de sa faiblesse est bien inspiré en acceptant avec bonne grâce les critiques qui le redressent et le mettent en meilleure posture. En vérité, je recherche plus la fréquentation de ceux qui me rudoient que celle de ceux qui me craignent; c’est un plaisir sans saveur et nuisible que d’avoir affaire à des gens qui nous admirent et nous cèdent toujours. Antisthène recommandait à ses enfants de «ne savoir aucun gré à qui les louait et ne pas l’en remercier». Je suis bien plus fier de la victoire que je remporte sur moi quand, dans l’ardeur même du combat, je me contrains à m’incliner devant la force des arguments de la partie adverse, que je ne me sais gré du succès que je gagne sur elle si c’est parce qu’elle n’est pas de force. Enfin, j’accepte et avoue les atteintes de toutes sortes qui me sont portées directement, si faibles qu’elles soient; mais je ne supporte pas très patiemment celles où la forme laisse par trop à désirer.
Dans les conversations la subtilité et la force des arguments importent moins que l’ordre; quant à discuter avec un sot, il ne faut s’y prêter absolument pas.—Le sujet en discussion m’importe peu, les opinions émises me sont égales, et la manière de voir qui l’emporte m’est à peu près indifférente. Il m’arrivera de discuter un jour entier sans m’impatienter, si le débat se déroule en bonne forme. Ce n’est pas tant la force et la subtilité dans l’argumentation auxquelles je tiens, qu’à l’ordre dans les idées, à cet ordre, qui subsiste dans toutes les altercations qu’ont entre eux même les bergers et les garçons de boutique et que nous n’observons jamais. S’ils s’en écartent, c’est uniquement pour s’invectiver; ne le faisons-nous pas nous-mêmes? Mais eux, leurs querelles et leurs impatiences ne les font pas sortir du sujet de leur dispute, la discussion suit son cours; s’ils parlent à la fois, sans s’attendre, ils ne cessent pas pour cela de se comprendre. Toute réponse me satisfait au delà de ce que je souhaite, si elle s’applique à ce que je dis; mais quand l’entretien devient confus et désordonné, je ne m’occupe plus de ce qui en est l’objet et, pris de dépit, sans égard pour quoi que ce soit, m’attache à y ramener l’ordre; j’en deviens têtu, malicieux, impérieux dans ma façon de discuter, au point d’avoir à en rougir ensuite.—Il est impossible de discuter 341 de bonne foi avec un sot; c’est si fort chez moi, que non seulement mon jugement mais même ma conscience s’oblitèrent à me mesurer avec pareil adversaire, contre lequel rien ne prévaut.
Les disputes devraient être interdites; quand on en arrive là, chacun sous l’empire de l’irritation perd la notion de ce qui est raisonnable.—Les disputes devraient être défendues et punies comme tous les autres crimes commis par paroles. Quels vices n’éveillent-elles pas et n’accumulent-elles pas quand elles dégénèrent ainsi sous l’effet de la colère? Nous nous prenons d’inimitié d’abord contre les raisons qui nous sont opposées, puis contre les gens qui nous les opposent. Nous n’apprenons à discuter que pour contredire, et chacun contredisant et étant contredit, il en résulte que toute conversation ainsi dégénérée aboutit à perdre et à mettre à néant la vérité. Aussi Platon, dans sa République, interdit-il cet exercice aux gens ineptes et mal élevés. Pourquoi nous mettre à rechercher ce qui est, en discutant avec quelqu’un qui a un pas et des allures qui ne sont pas convenables?—On ne fait pas tort au sujet en discussion, en le quittant momentanément pour voir dans quelles conditions il convient de le traiter; je ne dis pas selon les règles de l’école et de l’art, mais en demeurant naturel et y apportant de la justesse d’esprit. A quoi en arrive-t-on finalement si l’un tire vers l’Orient et l’autre vers l’Occident? Le point important du débat se perd de vue, rejeté à l’écart par des digressions multipliées; au bout d’une heure d’une discussion orageuse, personne ne voit plus ce dont il est question; l’un est en bas, l’autre en haut, un autre à côté; chacun se butte à un mot, à une comparaison, ne saisit plus les objections qu’on lui fait, tant il est engagé dans sa course, ne pensant qu’à suivre son idée et non la vôtre.—Il en est qui, faibles des reins, craignent tout, refusent tout, mêlent et confondent dès le principe les propos qu’on leur tient; ou qui, au fort des débats, s’obstinent à garder subitement un silence inattendu, par dépit de leur ignorance qu’ils dissimulent en affectant un orgueilleux dédain, ou parce que, par une modestie qui est de la sottise, ils fuient l’effort nécessaire pour poursuivre la discussion.—Pourvu que celui-ci frappe son adversaire, il ne se préoccupe pas dans quelle mesure il se découvre lui-même; un autre compte ses mots, qu’il donne en place de raisons; celui-là a surtout pour lui sa voix retentissante et la vigueur de ses poumons; en voilà un qui conclut contre ses propres assertions; celui-ci vous assourdit de préfaces et de digressions inutiles; cet autre a recours à de véritables injures et cherche, en soulevant une querelle d’Allemand, à se débarrasser du contact et de l’opposition d’un esprit auquel le sien ne peut résister; ce dernier se soucie peu de la raison, mais il vous enserre par les déductions d’arguments spécieux, en tous points conformes aux formules scolastiques.
L’attitude des gens de science, l’usage qu’ils en font, excitent contre eux la défiance; suivant qui la possède, c’est 343 un sceptre ou la marotte d’un fou.—Or, qui n’est en défiance de la science, «de ces lettres qui ne guérissent de rien (Sénèque)»; qui ne doute, en considérant l’usage que nous en faisons, qu’on puisse en tirer quelque résultat sérieux pour les besoins de la vie? A qui la logique a-t-elle donné du jugement? où sont ses belles promesses? «Elle n’enseigne ni à mieux vivre, ni à mieux raisonner (Cicéron).» Voit-on des harengères caquetant, s’exprimer moins confusément que les hommes dont c’est la profession, quand ils pérorent en public? J’aimerais mieux que mon fils apprît à parler dans les tavernes, qu’aux écoles où s’enseigne ce verbiage.—Ayez un maître en cet art, entretenez-vous avec lui; que ne se borne-t-il à nous faire sentir cette perfection artificielle, à plonger dans le ravissement les femmes et les ignorants desquels nous sommes, en donnant lieu d’admirer la fermeté de ses raisons, la beauté de sa méthode? Il peut nous dominer et nous persuader comme il l’entend; pourquoi cet homme, qui a tant d’avantages par ce qu’il sait et la manière dont il le produit, joint-il à ses armes naturelles les injures, l’indiscrétion et la rage? Qu’il se dépouille de son bonnet, de sa robe et de son latin, qu’il ne fatigue pas nos oreilles de passages d’Aristote qu’il nous récite textuellement et à tout propos, et vous le prendriez pour quelqu’un de nous, ou pis encore.—Les complications et les enchevêtrements de langage par lesquels les gens de cette sorte nous circonviennent, me font l’effet de tours de passe-passe, leur souplesse combat et force nos sens mais n’ébranle en rien nos croyances; en dehors de ces jongleries, tout ce qu’ils font est commun et vil; pour être des savants, ils n’en sont pas moins des sots. J’aime et honore le savoir, autant que l’honorent ceux qui le possèdent. Quand il en est fait l’usage qu’il comporte, c’est l’acquisition la plus noble et la plus puissante qu’ait faite l’homme; mais chez ceux-là (et leur nombre en ce genre est infini) dont il constitue la base fondamentale de leur capacité et de ce qu’ils valent, dont toute l’intelligence est dans la mémoire, «qui se tapissent dans l’ombre d’autrui (Sénèque)», qui ne peuvent rien sans l’assistance de leurs livres, je les haïs, si j’ose dire, plus encore que les imbéciles.—Dans mon pays et de mon temps, l’instruction vide les bourses mais n’améliore * que rarement les âmes; sur des âmes obtuses elle agit à l’instar d’une masse crue et indigeste qui leur reste sur l’estomac et les étouffe; sur des âmes qui ont plus de pénétration elle arrive aisément à les purifier, ajoute à leur clarté, et les rend subtiles au point de les épuiser. C’est une chose de qualité à peu près indifférente par elle-même: très utile accessoire pour une âme bien douée, elle est pernicieuse, préjudiciable même pour une autre; ou plutôt, elle est d’un très précieux usage, mais ne peut s’acquérir à vil prix; dans certaines mains c’est un sceptre, dans d’autres c’est la marotte d’un fou.—Poursuivons.
C’est l’ordre et la méthode qui donnent du prix aux conversations, la forme y importe autant que le fond; un effet 345 analogue se produit dans notre vie familiale.—Quelle plus grande victoire peut-on attendre, que de montrer à son adversaire qu’il ne peut lutter? Quand vous faites triompher votre proposition, c’est la vérité qui l’emporte; quand vous triomphez par la méthode avec laquelle vous conduisez votre argumentation, c’est vous qui triomphez. M’est avis que dans Platon et Xénophon, Socrate discute moins dans l’intérêt de la discussion elle-même, que dans l’intérêt de ceux qui y prennent part; il cherche davantage à faire ressortir aux yeux d’Euthydamus et de Protagoras leur manque d’à propos que l’inanité de leur art. Le premier sujet venu de controverse lui est bon, parce que son but est moins de l’élucider que d’être utile, c’est-à-dire d’ouvrir l’intelligence de ceux qu’il travaille et exerce. L’agitation et la chasse sont à proprement parler notre lot; nous ne sommes pas excusables de les conduire mal ou contrairement à ce qui est rationnel; quant à manquer notre coup, c’est autre chose, parce que nous sommes nés pour nous livrer à la recherche de la vérité, et qu’il n’appartient qu’à plus puissant que nous de la posséder; car elle n’est pas, comme disait Démocrite, cachée dans le fond des abîmes; elle va plutôt s’élevant jusqu’à l’infini, pour en arriver à n’être connue que de Dieu. Le monde n’est qu’une école où l’on passe son temps à chercher; ce n’est pas à qui atteindra le but, mais à qui fournira les plus belles courses. Autant peut dire des sottises celui qui dit vrai que celui qui dit faux, parce qu’il n’est pas question ici du sujet dont on parle mais de la manière dont on le traite.—Je suis porté à regarder autant à la forme qu’au fond, autant l’avocat que la cause, ainsi que le voulait Alcibiade. Tous les jours, je m’amuse à lire des auteurs sans m’occuper de leur science, cherchant seulement leur façon de dire sans m’inquiéter du sujet qu’ils traitent; de même, il m’arrive de m’efforcer d’entrer en communication avec des esprits qui ont de la réputation, non pour m’instruire mais pour les connaître, et, les connaissant, pour les imiter s’ils en valent la peine. Tout homme peut dire vrai; mais dire avec ordre, modération et science, cela n’est au pouvoir que d’un petit nombre; aussi je ne suis pas offensé par l’erreur qui provient de l’ignorance, tandis que je le suis par l’ineptie. J’ai rompu plusieurs marchés auxquels j’avais intérêt, par suite de contestations sans raison soulevées par ceux avec lesquels je les passais.—Je ne m’émeus pas, une fois l’an, des fautes de ceux qui sont sous ma dépendance; mais nous sommes tous les jours à nous prendre de querelle, à cause de la bêtise et de l’entêtement qu’ils apportent dans ce qu’ils avancent et dans les raisons stupides et animales qu’ils donnent pour s’excuser et se défendre; ils n’écoutent ni ce qu’on leur dit, ni les explications qu’on leur donne, et ils répondent de même; c’est à désespérer; cela me produit l’effet d’une tête heurtant violemment la mienne. Je m’accommode plutôt des défauts de mes gens que de leur aplomb, de leur importunité et de leur sottise; qu’ils fassent moins, mais qu’ils soient à même de faire; vous vivez 347 avec l’espérance d’échauffer leur volonté, mais il n’y a rien qui vaille à tirer ni à espérer d’une souche.
C’est un grand défaut que de ne pouvoir souffrir les sottises des autres; que de fois nous leur reprochons ce qui existe chez nous-mêmes.—Peut-être vois-je les choses autrement qu’elles ne sont, cela se peut; c’est pourquoi je m’accuse d’impatience et conviens tout d’abord que c’est une faute aussi bien chez celui qui a raison que chez celui qui a tort, parce que c’est toujours fâcheux et tyrannique de ne pouvoir souffrir une façon d’être différente de la sienne, et qu’il n’y a vraiment pas de niaiserie plus grande, plus fréquente et plus ridicule que de s’émouvoir et de se piquer des niaiseries des gens; cela se retourne généralement contre nous, et ce philosophe des temps passés n’aurait jamais manqué d’occasion de pleurer, s’il se fût mis à se considérer lui-même. On demandait à Myson, l’un des sept sages, qui tenait de l’humeur de Timon et de Démocrite et était porté à tout prendre en mauvaise part et à en rire, pourquoi il riait tout seul; il répondit: «Précisément de ce que je suis seul à rire.»—Que de sottises je reconnais dire et répondre chaque jour; combien, par suite, les autres doivent en constater en moi un plus grand nombre encore; et si je m’en mords les lèvres pour n’en pas rire, que doivent-ils faire, eux! En somme, il faut vivre avec les vivants et laisser l’eau couler sous le pont, sans nous en occuper ou tout au moins sans en éprouver de trouble.—De fait, ne rencontrons-nous pas, sans nous en émouvoir, des gens mal bâtis et difformes; pourquoi ne supportons-nous pas également, sans nous mettre en colère, des esprits mal conformés? Cela tient à ce que le juge se montre à tort plus mal disposé que la faute ne le comporte. Ayons toujours à la pensée cette maxime de Platon: «Quand je trouve quelque chose qui n’est pas tel que ce devrait être, n’est-ce pas parce que je suis moi-même dans des conditions anormales? n’est-ce pas moi qui suis en dehors de ce qui est la règle? mon observation ne peut-elle se retourner contre moi?» sage et doux refrain qui flagelle la plus répandue, la plus universelle erreur des hommes. Non seulement les reproches que nous nous faisons les uns aux autres, mais nos raisons, nos arguments, les sujets qui font l’objet de nos controverses peuvent nous être rétorqués et nous nous enferrons avec nos propres armes. A cet égard, l’antiquité nous a laissé des exemples frappants: «Chacun aime l’odeur de son fumier», est un proverbe latin qui témoigne esprit et à propos de la part de celui qui l’a inventé. Nos yeux ne voient pas en arrière, et, cent fois par jour, nous nous moquons de nous-mêmes en nous moquant de ce que nous voyons chez le voisin; les défauts que nous détestons chez d’autres, sont encore plus apparents chez nous où nous les admirons avec une merveilleuse impudence sans nous rendre compte de la contradiction.—Hier encore, j’ai été à même de voir un homme de jugement, * très affable personne, qui se moquait avec autant de raison que d’esprit de la sottise d’un autre 349 qui va rompant la tête à tout le monde de l’exposé de sa généalogie et de ses alliances, aux trois quarts fausses (ce sont ceux dont les titres sont le plus douteux et le moins certains, qui ressassent le plus souvent ce sujet ridicule); si notre critique eût reporté son regard sur lui-même, il se serait trouvé tout aussi intempérant et ennuyeux quand, à tout propos, il fait valoir le mérite de la race à laquelle sa femme appartient. Quelle malencontreuse vanité de la part de ce mari, de fournir ainsi lui-même des armes à sa femme; s’il comprenait le latin, il faudrait lui crier ce que je traduis: «Courage! elle n’est pas d’elle-même assez folle, irrite encore sa folie (Térence)!»—Je ne veux pas dire que celui-là seul qui est absolument net, puisse accuser (il n’y aurait plus personne pour porter une accusation); je ne dénie même pas ce droit à qui est lui-même entaché de ce qu’il reproche aux autres; mais je voudrais que lorsque notre jugement nous fait critiquer quelqu’un, il ne nous épargne pas et porte dans notre for intérieur, sur le fait imputé, une sévère investigation. C’est œuvre de charité, de la part de qui est impuissant à extirper un vice chez lui-même, de s’employer néanmoins à l’extirper chez les autres, où il produit peut-être des fruits moins mauvais et moins âpres qu’en nous; mais ce ne semble pas une excuse recevable de répondre à quelqu’un qui m’avertit de mes défauts, que lui-même n’en est pas exempt. Pourquoi? Parce qu’un avis fondé est toujours utile. Si nous avions bon nez, nous sentirions plus désagréablement les mauvaises odeurs que nous répandons, par cela même que c’est nous qui les exhalons. Socrate n’estime-t-il pas que quelqu’un qui se reconnaîtrait coupable, et avec lui son fils et un étranger, de quelque acte violent et injuste, devrait commencer par se présenter à la justice, pour se faire condamner et provoquer lui-même l’expiation de sa faute par le bourreau; faire en second lieu qu’il en soit de même pour son fils; et, seulement après, tenir la même conduite à l’égard de l’étranger. Ce précepte peut paraître un peu sévère, mais du moins celui qui se trouve coupable, devrait-il commencer par se livrer le premier à la punition de sa propre conscience.
Ce qui frappe nos sens a une grande influence sur nos jugements; la gravité d’un personnage, son costume, sa situation, etc., tout cela donne du poids aux sottises qu’il débite.—Les sens sont nos propres juges et statuent tout d’abord; comme ils ne constatent les faits que d’après leur manifestation extérieure, il n’est pas étonnant que tout ce qui se rapporte au fonctionnement de la société, soit un perpétuel et universel mélange de cérémonies où les apparences jouent un grand rôle; aussi dans les moyens employés pour la diriger, sont-elles un des meilleurs et de ceux qui produisent le plus d’effet. C’est toujours à l’homme que nous avons affaire et, chez lui, ce qui est tangible l’emporte de beaucoup sur ce qui ne l’est pas. Aussi, ceux qui, dans ces dernières années, ont voulu introduire un culte dont les pratiques sont exclusivement contemplatives et immatérielles, ne 351 doivent-ils pas s’étonner s’il y a des personnes qui pensent qu’il ne se serait pas maintenu et se serait effondré entre les mains de leurs auteurs, s’il n’était devenu chez nous la marque, le prétexte, l’instrument de nos divisions et des partis, et que c’est à cela plus qu’à lui-même qu’il doit de durer.—Il en est de même dans les conversations: la gravité, la robe, la situation de celui qui parle, donnent souvent crédit à des propos vains et ineptes; on ne doute pas qu’un monsieur que chacun recherche et redoute, n’ait en lui-même une valeur supérieure; ni qu’un homme comblé de missions et de charges, qui se montre si dédaigneux et si plein de morgue, ne soit plus habile que cet autre qui le salue de si loin et que personne n’emploie. Non seulement ce que disent ces gens, mais jusqu’aux grimaces qu’ils font, sont exaltées et notées; chacun s’applique à en donner quelque belle et solide interprétation. S’ils daignent s’abaisser à prendre part à une conversation à laquelle tout le monde participe, ne porterait-elle que sur des banalités, et qu’on leur témoigne autre chose que de l’approbation et de la déférence, ils font valoir bien haut l’autorité de leur expérience; ils ont entendu, vu, pratiqué; ils vous accablent d’exemples. Je suis bien près de leur dire que nous ne sommes pas convaincus de l’expérience d’un chirurgien, par cela seul qu’il nous raconte les opérations qu’il a faites et qu’il nous rappelle qu’il a guéri quatre cas de peste et trois goutteux, il faut encore qu’il ait su en acquérir plus de jugement et qu’il sache nous persuader qu’il en est devenu plus expert dans la pratique de son art. Il arrive ici ce qui se produit dans un concert instrumental: ce n’est ni le luth, ni l’épinette, ni la flûte qu’on y entend, c’est l’harmonie de l’ensemble, résultat du jeu de ces instruments réunis. Si les voyages et l’exercice de leurs fonctions ont amélioré ces gens, cela doit ressortir par l’esprit dont ils font preuve. Ce n’est pas assez d’énumérer des expériences, il faut les classer et déterminer leur valeur; il faut les examiner de près, les analyser, pour être à même d’apprécier les raisons et les conclusions auxquelles elles conduisent. Jamais il n’y a eu tant d’historiens que maintenant; il est toujours bon et utile de les entendre, parce que leur mémoire nous fournit une infinité de renseignements beaux et dignes d’éloge qu’elle a emmagasinés et qui sont propres à notre instruction. Cela est assurément d’une grande aide dans la vie, mais à l’heure présente ce n’est pas ce que nous cherchons; ce qui nous occupe, c’est de savoir si ces compilateurs, qui se bornent à un simple travail de récitation, méritent eux-mêmes des éloges.
Parfois aussi les grands paraissent plus sots qu’ils ne sont, parce qu’on attend plus d’eux.—Je hais la tyrannie sous toutes ses formes, qu’elle soit effective ou en paroles; je me tiens volontiers en garde contre ces circonstances sans consistance qui, par nos sens, induisent notre jugement en erreur, et, en observant attentivement ces hommes dont on fait des phénomènes, j’ai trouvé qu’ils sont tout au plus des hommes comme les autres: «car le sens 353 commun est assez rare dans ces hautes fortunes (Juvénal).» Souvent quand ils entreprennent et se montrent davantage, n’étant pas en état de supporter la tâche qu’ils ont assumée, on les estime moins et ils apparaissent moins grands qu’ils ne sont réellement. Il faut que celui qui porte un fardeau ait plus de vigueur, puisse plus qu’il n’est nécessaire; quand il en est ainsi, on voit aisément qu’il a encore assez de force pour porter plus encore et qu’il n’en est pas arrivé à son extrême limite; celui qui succombe sous le faix, donne sa mesure et décèle la faiblesse de ses épaules. C’est ce qui fait qu’on voit tant de sots parmi les savants où ils sont en plus grand nombre que les autres; ils auraient été de bons agriculteurs, de bons marchands, de bons artisans, c’est ce pour quoi la nature les avait pourvus. La science est lourde à porter, ils succombent sous le poids; pour étaler et répartir les riches et puissants matériaux qu’elle leur fournit, pour les mettre en œuvre et y trouver aide, leur esprit naturel n’a ni la vigueur, ni la dextérité qu’il faudrait; cela n’est donné qu’aux natures fortes, et elles sont rares. Quand les natures faibles, dit Socrate, se mêlent de philosophie, elles en compromettent la dignité; mal placée, cette science apparaît inutile et nuisible, et c’est là la raison pour laquelle ces gens insuffisants se gâtent et se nuisent à eux-mêmes: «Tel ce singe, imitateur de l’homme, qu’un enfant rieur a habillé d’une précieuse étoffe de soie, en lui laissant le derrière à découvert, à la grande joie des convives (Claudien).» A ceux qui nous gouvernent et nous commandent, qui tiennent le monde dans leurs mains, il ne suffit pas non plus qu’ils aient le même jugement que nous tous, qu’ils puissent ce que nous pouvons; ils sont de beaucoup au-dessous de nous, quand ils ne sont pas de beaucoup au-dessus; ils promettent davantage, par suite ils doivent davantage.
Le plus souvent il est de leur intérêt de garder le silence.—C’est ce qui fait que le silence non seulement leur permet de garder leur gravité et une contenance qui leur attire le respect, mais qu’ils y trouvent souvent profit et économie.—Mégabyse était allé visiter Apelle dans son atelier; longtemps, il demeura sans mot dire, puis se mit à discourir sur les œuvres du peintre, ce qui lui valut cette rude apostrophe: «Tant que tu gardais le silence, tu avais grand air à cause des chaînes et de la magnificence dont tu es paré; mais maintenant qu’on t’a entendu parler, il n’est pas jusqu’aux garçons de mon atelier qui ne te méprisent.» Ses superbes atours, sa haute situation, ne permettaient pas à ce noble visiteur d’être ignorant au même degré que tout le monde et de parler peinture sans s’y connaître; il eût dû au moins conserver son mutisme pour maintenir intacte cette capacité présomptive qu’on lui accordait en raison de son extérieur. A combien de sottes âmes une mine froide et taciturne a-t-elle, en mon temps, tenu lieu de prudence et de capacité réelles!
Et pourquoi les grands seraient-ils plus instruits, plus éclairés que les autres? C’est le hasard qui, la plupart du 355 temps, distribue les rangs, et il ne saurait guère en être autrement.—Les dignités, les charges, se donnent nécessairement plus au hasard qu’au mérite; mais on a tort de s’en prendre aux rois. C’est merveille au contraire qu’ils soient si heureux dans leurs choix, ayant si peu où se renseigner: «Le principal mérite d’un prince, est de bien connaître ceux qu’il emploie (Martial)», car la nature ne les ayant pas doués d’une vue qui leur permette de connaître tous leurs sujets, de discerner en quoi chacun excelle et de scruter nos cœurs, ce qui seul ferait qu’ils parviendraient à savoir quelle est notre volonté et ce à quoi nous sommes le plus aptes, il faut qu’ils nous choisissent par conjecture et à tâtons, en se basant sur notre race, nos richesses, la doctrine que nous pratiquons, ce qu’on dit de nous, qui sont autant de bien faibles arguments. Qui trouverait un moyen permettant d’apprécier les hommes avec justice, de les choisir en toute connaissance de cause, assurerait du même coup une parfaite organisation des services publics.
Le succès obtenu dans les plus grandes affaires n’est pas une preuve d’habileté; souvent il est dû au hasard qui intervient dans toutes les actions humaines.—«Oui, mais il a si bien mené cette grande affaire,» entend-on dire. C’est là une raison, mais elle ne suffit pas; et une autre maxime dit judicieusement qu’«il ne faut pas juger des conseils donnés, par les événements qui ont suivi».—Les Carthaginois punissaient leurs capitaines, quand ils jugeaient mauvaises les dispositions que ceux-ci avaient prises, alors même qu’un heureux résultat final les avait corrigées; souvent le peuple romain a refusé le triomphe pour de grandes et très utiles victoires, parce que la conduite du chef n’avait pas été en rapport avec son bonheur. On voit fréquemment en ce monde le hasard prendre plaisir à rabattre notre présomption, pour nous montrer combien il a de pouvoir en toutes choses; ne pouvant rendre sages les maladroits, il les fait heureux, à l’encontre de ce que commanderait la vertu. Volontiers il se prend à favoriser les opérations dans la préparation desquelles seul il est intervenu, de sorte qu’on voit souvent les plus simples d’entre nous mener à bonne fin de très importantes entreprises tant publiques que privées.—A ceux qui s’étonnaient de voir si mal tourner ses affaires alors que ses conceptions étaient si sages, le persan Siramnez répondait «qu’il était seul à concevoir ses projets, tandis que leur succès dépendait de la fortune». En en faisant application à une situation tout opposée, nos gens pourraient faire la même réponse.—La plupart des choses de ce monde s’accomplissent d’elles-mêmes, «les destins frayent la voie (Virgile)»; le résultat justifie souvent une conduite des plus déraisonnables, notre intervention n’est presque qu’un fait de routine, et très communément amenée plutôt par l’usage et les précédents que par la raison. Étonné de la grandeur de cette affaire qui est l’acte capital de notre époque, il m’est arrivé, pour juger de leur degré d’habileté, de m’enquérir auprès de ceux qui l’avaient 357 conduite, des raisons qui les avaient déterminés à agir comme ils l’avaient fait, et j’ai constaté que ces raisons étaient tout ce qu’il y a de plus vulgaire. Du reste, les plus vulgaires et les plus communément employées, pour n’être pas des plus séduisantes, sont peut-être les plus commodes et les plus sûres dans la pratique. Si celles qui ont le moins de valeur ont le plus de chances de réussite, qu’y a-t-il d’étonnant à ce que les plus basses, les plus lâches, les plus décriées soient les mieux appropriées à la marche des affaires? Pour que les conseils qui assistent les rois conservent leur autorité, il suffit que les profanes qui n’y ont pas part et veulent voir ce qui s’y passe, soient tenus au delà de la première barrière qui en interdit l’approche; et qui veut que leur prestige ne subisse aucune atteinte, doit les révérer en bloc et sans examiner les déterminations qu’ils prennent. Quand je me consulte, je ne fais qu’ébaucher ce qui est le sujet de mes réflexions et ne l’envisage que superficiellement d’après ce qu’il m’en semble tout d’abord, ayant coutume d’attendre du ciel qu’il fasse le principal et le plus fort du travail: «Abandonnons le reste aux dieux (Horace).»
Le bonheur et le malheur sont, j’estime, deux puissances souveraines. Il est imprudent de compter que la prudence humaine puisse remplir le rôle de la fortune; et celui-là entreprend l’impossible qui présume pouvoir embrasser les causes et leurs effets, et diriger les événements à son gré; c’est là une impossibilité, surtout à la guerre, quand il s’agit de résolutions à prendre. Jamais on n’a apporté dans les affaires de cette sorte, plus de circonspection et de prudence qu’on ne le fait parfois dans nos guerres civiles actuelles; il semblerait qu’on craint de se perdre en chemin et qu’on se réserve pour la catastrophe finale!—Je vais plus loin, je soutiens que notre sagesse même et nos délibérations sont, pour la plupart, conduites par le hasard; ma volonté et mon entendement sont menés tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et beaucoup de ces mouvements se produisent sans ma participation; ma raison est sujette à des impulsions, à des agitations journalières et accidentelles: «Rien de variable comme les dispositions de l’âme; maintenant une passion l’agite; que le vent change, c’est une autre qui l’entraînera (Virgile).» Qu’on regarde dans les villes quels sont les puissants, ceux qui réussissent le mieux dans leurs affaires, on trouvera que ce sont d’ordinaire les moins habiles; il est arrivé que des femmelettes, des enfants, des insensés ont gouverné de grands états à l’égal des princes les plus capables; parmi ceux investis de cette haute mission, il s’en rencontre, au dire de Thucydide, plus ayant l’esprit lourd que subtil; et nous attribuons à leur prudence les succès dus à leur bonne fortune: «Si vous vous élevez par la fortune, tout le monde vantera votre habileté (Plaute)»; ce qui démontre bien qu’à tous égards, les événements sont des témoignages bien faibles de ce que nous valons et de ce dont nous sommes capables.
Pour juger des grands, voyez ceux que la fortune fait tomber; comme ils paraissent au-dessous du médiocre 359 lorsqu’ils ne sont plus entourés d’un éclat imposant.—Je disais qu’il suffit pour cela de considérer un homme haut placé. L’aurions-nous connu trois jours auparavant comme homme de peu de valeur que, néanmoins, insensiblement nous venons à nous imaginer qu’il pourrait bien y avoir en lui de la grandeur, de la capacité, et arrivons à nous persuader, son train de maison et son crédit grandissant, que son mérite croît dans la même proportion; nous le jugeons non par ce qu’il vaut, mais d’après les prérogatives de son rang, comme nous faisons des jetons auxquels nous attribuons une valeur conventionnelle.—Par contre, que la chance vienne à tourner, qu’il retombe et se confonde dans la foule, chacun se demande avec surprise quelle cause l’avait fait arriver si haut: «Est-ce bien lui? fait-on. Est-ce là tout ce qu’il savait quand il était au pouvoir? Les princes se contentent-ils donc de si peu? Nous étions vraiment en bonnes mains!» C’est une chose que j’ai souvent vue de mon temps, ainsi qu’il arrive au théâtre où nous nous laissons quelque peu prendre au masque des comédiens quand ils jouent un rôle de grand personnage.—Ce que j’admire moi-même chez les rois, c’est la foule de leurs adorateurs; ils ont droit à ce que tout en nous s’incline et se soumette à eux, sauf notre jugement: aussi ma raison n’est pas dressée à se courber et à fléchir, il n’y a que mes genoux à le faire. Mélanthe, auquel on demandait ce qu’il pensait d’une tragédie de Denys, répondait: «Je ne l’ai pas vue, l’emphase du style me la cachait»; la plupart de ceux qui ont à juger les discours des grands, devraient bien dire de même: «Je ne les ai pas entendus, tant les idées en sont masquées par la gravité, la grandeur, la majesté qu’ils y apportent.»—Antisthène conseillait un jour aux Athéniens d’ordonner que les ânes fussent, aussi bien que les chevaux, employés aux travaux de labourage; à quoi on lui répondait que l’âne n’est pas fait pour un pareil service: «Cela ne fait rien, répliqua-t-il, il vous suffit de le décréter; si ignorants, si incapables que soient les hommes auxquels vous donnez des commandements à la guerre, n’en deviennent-ils pas sur-le-champ très dignes, par le fait même que vous les y employez?»—D’où vient cet usage, chez tant de peuples, de canoniser le roi qu’ils se sont donné en le prenant parmi eux; ils ne se contentent pas de l’honorer, ils vont jusqu’à l’adorer! A Mexico, dès que les cérémonies de son sacre sont achevées, on n’ose plus lever les yeux sur lui; et, comme si on l’avait déifié en l’élevant à la royauté, parmi les serments qu’on lui fait prêter, après avoir juré de maintenir la religion, les lois, les libertés, d’être vaillant, juste et débonnaire, il jure aussi de faire que le soleil répande sa lumière accoutumée, que les nuées se déversent en pluie en temps opportun, que les rivières se maintiennent dans leurs lits, et que la terre produise tout ce qui est nécessaire aux besoins de son peuple.
Montaigne est disposé à se défier de l’habileté de quiconque a une haute situation ou jouit de la faveur populaire.—C’est 361 surtout quand ils ont une haute situation ou jouissent de la faveur populaire, que je suis en défiance des gens, ne partageant pas toujours à cet égard une tendance qui est assez commune. Il faut en effet considérer combien cela donne avantage d’avoir toute autorité pour parler à son heure, choisir son sujet, rompre l’entretien ou en changer le cours; de pouvoir se défendre contre les objections qui vous sont faites par un mouvement de tête, un sourire, ou le silence devant une assemblée qui tremble devant vous par déférence et respect. Un homme de fortune scandaleuse, donnant son avis sur un propos de peu d’importance qui se traitait à sa table sans que personne y apportât beaucoup d’ardeur, commença par ces mots qui sont textuels: «Ce ne peut être qu’un menteur ou un ignorant, celui qui nierait que, etc...» Appréciez le piquant de cet argument philosophique présenté le poignard à la main.
Il n’accepte qu’avec réserve les mots heureux de ses interlocuteurs, qui peuvent les avoir empruntés et ne pas se rendre compte eux-mêmes de leur valeur.—Une autre observation dont je fais grand cas c’est que, dans les conversations et les discussions, toutes les expressions qui nous paraissent heureuses ne doivent pas être acceptées sans contrôle. La plupart des hommes sont riches de la science d’autrui; il peut fort bien arriver à quelqu’un de citer un beau trait, une bonne réplique, une belle sentence, et de les mettre en avant sans en saisir toute la portée. On ne s’assimile pas tout ce qu’on emprunte: c’est ce dont, à l’aventure, on peut juger par moi-même. Il ne faut pas toujours se rendre à ces expressions, si justes, si belles qu’elles paraissent: il faut les réfuter nettement, si on est en mesure de le faire; ou battre en retraite, comme si on ne les avait pas entendues, tâtant leur auteur de toutes parts pour se rendre compte de l’importance qu’elles ont dans sa bouche. Toutefois, il peut arriver qu’à ce jeu nous nous enferrions et ajoutions à la violence du coup qui nous est porté. Jadis, quand, trop pressé par l’adversaire, et les nécessités de la lutte m’y obligeant, j’ai eu recours à ces ripostes, qui parfois ont porté au delà de mes intentions et de mes espérances, je les donnais uniquement pour ne pas demeurer en reste dans les attaques dont j’étais l’objet, et il s’est trouvé qu’elles frappaient fort.—Il m’arrive aussi lorsque je discute avec un adversaire vigoureux, de m’amuser à devancer ses conclusions, lui évitant ainsi la peine de développer son idée, cherchant à prévenir l’expression de sa pensée alors qu’elle ne fait que naître et est encore indécise, l’ordre et la suite qu’il apporte à ses raisonnements m’avertissant à l’avance de ce qui me menace. Avec ces autres, au contraire, qui ne se rendent pas toujours compte de ce qu’ils disent, j’agis tout au rebours: je les attends pour voir où ils veulent en venir, on ne peut avec eux faire à l’avance aucune supposition.
Il se méfie également de ceux qui, dans leurs reparties, se renferment dans les généralités; il faut les amener à préciser pour savoir ce qu’ils valent.—Quand ils se bornent 363 à formuler leurs appréciations par des généralités, telles que: «Ceci est bon, cela ne l’est pas», et qu’ils rencontrent juste, examinez si ce n’est pas l’effet du hasard; amenez-les à circonscrire et à préciser un peu leur manière de voir; qu’ils disent en quoi ceci est bon, par où cela pèche. Ces appréciations conçues en termes généraux, qui sont d’emploi si fréquent, ne signifient rien. Ceux qui les émettent me font l’effet de ces gens qui saluent une foule en s’adressant vaguement aux groupes qui la composent; tandis que ceux qui connaissent réellement les personnes qui entrent dans sa composition, les saluent individuellement et les distinguent en les appelant chacune par son nom; mais c’est beaucoup s’exposer que d’en agir comme ces derniers et de préciser. Je vois tous les jours, et parfois plusieurs fois en un jour, des esprits de peu de fond qui, à la lecture d’un ouvrage, voulant faire les connaisseurs et faire remarquer ce qu’il peut présenter de particulièrement beau, font porter leur admiration sur des points si mal choisis qu’au lieu de nous faire ressortir le talent parfait de l’auteur, ils ne nous apprennent que leur parfaite ignorance. On est certain de ne pas se tromper, en disant: «Voilà qui est beau», quand on vient d’entendre une page entière de Virgile, et les malins n’y manquent pas; mais entreprendre de le suivre dans les détails, formuler sur chacun une appréciation distincte et motivée; faire remarquer par où un bon auteur se surpasse, analyser ses mots, ses phrases, ses idées et ses diverses qualités les unes après les autres, à d’autres! eux n’en sont pas capables: «Il faut non seulement écouter ce que chacun dit, mais encore examiner ce qu’il pense et pourquoi il le pense (Cicéron).»
Souvent les sots émettent des idées justes, mais elles ne sont pas d’eux; hors d’état d’en faire une judicieuse application, il n’y a qu’à les laisser aller, ils ne tardent pas à s’embourber.—J’entends journellement des sots dire des mots qui ne sont pas sots; ce qu’ils disent est juste, reste à savoir jusqu’à quel point ils s’en rendent compte et d’où ils l’ont tiré. Souvent c’est nous qui les aidons à placer un mot heureux, une bonne raison mais qui ne sont pas de leur crû: ils les avaient seulement en garde, ils les produisent à l’aventure et à tâtons, c’est nous qui leur donnons de l’importance et du prix. Vous faites leur jeu, et pour aboutir à quoi? Ils ne vous en savent aucun gré et n’en deviennent que plus ineptes; ne les secondez pas, laissez-les aller, ils en arriveront à ne plus user de ces phrases toutes faites, que comme des gens qui ont peur de s’échauder; ils n’oseront en changer ni les termes, ni la signification, non plus que s’y appesantir; secouez-les tant soit peu, elles leur échappent et ils vous les abandonnent si appropriées, si belles qu’elles soient; ce sont de belles armes, mais qui, entre leurs mains, sont mal emmanchées. Que de fois en ai-je vu faire l’expérience: si vous venez à les éclairer et à les mettre sur la voie, sur-le-champ ils font leur et tournent à leur profit la justesse de l’interprétation que vous venez d’en donner: 365 «C’est ce que je voulais dire, répliquent-ils: c’est précisément là ce que j’avais en tête; si je ne l’ai pas ainsi exprimé, c’est que l’expression m’a fait défaut.» Insistez, il faut user de malice pour châtier ces orgueilleux imbéciles. La maxime d’Hégésias qu’«il ne faut ni haïr ni poursuivre, mais instruire», si juste par elle-même, n’est pas de mise dans ce cas; il y aurait injustice et inhumanité à secourir et remettre d’aplomb qui n’en a que faire et qui en vaudrait moins. J’aime à les laisser s’embourber et s’empêtrer plus encore et si profondément, si c’est possible, qu’enfin ils se reconnaissent pour ce qu’ils sont.
Reprendre un sot avec l’espérance de rectifier son jugement, c’est peine perdue.—La sottise et le déréglement de nos sens ne peuvent guérir du fait d’un avertissement qui nous est donné, et nous pouvons dire de leur guérison ce que Cyrus, sur le point de livrer bataille, répondait à quelqu’un qui le pressait d’exhorter son armée, que «les hommes ne deviennent pas courageux et belliqueux instantanément, sous le coup d’une belle harangue, pas plus qu’on ne devient subitement musicien parce qu’on vient d’entendre une bonne chanson». Il faut à cela des apprentissages qui doivent précéder la mise en œuvre et que peut seule produire une longue et constante éducation. Nous devons prendre ce soin pour les nôtres, les instruire, les corriger avec assiduité; mais aller prêcher le premier passant venu, relever l’ignorance ou la sottise du premier individu que l’on rencontre, c’est un usage que je désapprouve fort. Je le pratique rarement, même dans les conversations particulières que je puis avoir, et suis prêt à tout lâcher plutôt que d’en venir à reprendre par la base une instruction qui est du fait d’un maître d’école; je ne suis pas plus d’humeur à parler qu’à écrire pour des commençants; quant aux conversations générales auxquelles je prends part, comme à celles échangées entre d’autres personnes que moi, si faux et si absurde que me paraisse ce que j’y entends, je ne m’élève jamais contre, ni par un mot, ni par un geste.
Ce qu’il y a de plus déplaisant chez un sot, c’est qu’il admire toujours tout ce qu’il dit.—Rien ne me cause tant de dépit dans la sottise que de la voir se complaire en elle-même, en ressentir du contentement, plus que n’en peut éprouver la raison quelque sujet de satisfaction qu’elle ait. C’est un malheur que la prudence interdise d’être satisfait et fier de soi et vous laisse toujours mécontent et craintif, là où l’entêtement et la témérité portent ceux qui ont ces défauts à se réjouir en toute assurance. Ce sont toujours les plus malhabiles qui reviennent pleins de gloire et d’allégresse de ces luttes oratoires, regardant les autres avec mépris; le plus souvent l’outrecuidance de leur langage, la gaîté qu’ils manifestent leur donnent le succès aux yeux de l’assistance qui, d’ordinaire, a le jugement faible et est incapable de discerner et de bien juger de quel côté est réellement l’avantage. L’obstination et une opinion trop ardente sont des preuves certaines 367 de bêtise; est-il rien de plus affirmatif, résolu, dédaigneux, contemplatif, grave et sérieux que l’âne?
Les causeries familières à bâtons rompus ont aussi leurs charmes; les propos vifs, les reparties hardies, forment le caractère et peuvent parfois nous éclairer sur nos défauts.—Ne pouvons-nous pas comprendre dans ce chapitre afférent aux conversations et échanges d’idées, les causeries familières où il se fait assaut d’esprit et où les propos vont se succédant sans suite, auxquelles on se livre dans l’intimité, entre amis heureux de se trouver ensemble, riant et se moquant plaisamment et avec verve les uns des autres? C’est un exercice qui convient assez à ma gaîté naturelle; s’il n’est pas aussi sérieux et ne réclame pas une aussi forte tension d’esprit que celui dont nous avons parlé jusqu’ici, il n’en a pas moins du piquant, tient l’esprit en éveil et a des avantages; c’était aussi l’opinion de Lycurgue. En ce qui me touche, j’y apporte plus de laisser aller que d’esprit, et plus de bonheur que d’imagination; du reste, je supporte très bien les coups que l’on me porte et endure, sans que cela altère mon humeur, les revanches que l’on peut prendre sur moi, si rudes qu’elles soient et lors même qu’elles dépassent les bornes; et si, quand on s’attaque à moi, je ne suis pas à même de riposter sur-le-champ, je ne vais pas m’amusant et m’entêtant à discuter le coup, je n’y apporte ni humeur, ni mauvaise foi; je le subis, m’y résignant avec bonne grâce, remettant d’en avoir raison à une heure meilleure: il n’y a pas de marchand qui toujours fasse des bénéfices. Chez la plupart des gens, le visage et la voix s’altèrent quand la force vient à leur manquer; et, par une colère déplacée, au lieu de se venger, ils ne font que témoigner tout à la fois de leur faiblesse et de leur impatience. Dans ces moments de surexcitation, nous actionnons parfois des cordes secrètes qui mettent en jeu nos imperfections auxquelles, si nous étions plus calmes, nous ne pourrions toucher sans que cela constitue une offense; par là, nous nous rendons mutuellement le service de nous avertir de nos défauts.
Les jeux de main sont à proscrire; ils dégénèrent trop souvent en voies de fait.—Il y a en France d’autres jeux en usage qui, violents et ne respectant rien, conduisent finalement à en venir aux mains; ces jeux, je les hais mortellement, car j’ai la peau tendre et sensible; dans ma vie, j’ai vu deux princes de la famille royale auxquels ils ont coûté la vie. Ce sont de vilains jeux que ceux où l’on finit par se battre.
Comment Montaigne s’y prenait pour juger d’une œuvre littéraire sur laquelle l’auteur le consultait; sur les siennes, sur ses Essais, il était toujours hésitant bien plus que lorsqu’il s’agissait de celles des autres.—Quand je veux juger de quelqu’un, je lui demande dans quelle mesure il est satisfait de lui-même, jusqu’à quel point ce qu’il dit ou ce qu’il pense le contente. Je cherche à éviter qu’il use de faux-fuyants: «J’ai fait ceci en me jouant; ce travail a été arraché du métier, alors qu’il 369 était encore imparfait (Ovide); je n’ai pas mis une heure à le faire; je ne l’ai pas revu depuis.» A ces excuses je réponds: Laissons donc de côté ce que vous avez ainsi fait et donnez-moi quelque ouvrage qui vous représente bien tout entier, sur lequel il vous convienne qu’on vous apprécie, et indiquez-nous ce que vous y trouvez de plus beau? Est-ce cette partie ou celle-ci; est-ce le sujet dont vous avez fait choix, la grâce que vous avez mise à le traiter; l’imagination, le jugement ou le savoir dont vous y faites preuve? Je constate, en effet, qu’ordinairement on fait erreur, aussi bien quand on juge son propre travail que lorsqu’il s’agit de celui d’autrui, non seulement en raison de l’affection qui s’y mêle, que parce qu’on n’est pas capable de le bien connaître et d’en bien discerner ce qui le distingue. L’œuvre, par son propre mérite ou sa bonne fortune, peut encore mettre l’ouvrier en relief et outrepasser son imagination et son savoir.—Pour moi, je ne juge aucune production étrangère avec moins de lucidité que les miennes; tantôt je prise fort mes Essais, tantôt je n’en fais pas cas, portant sur eux un jugement qui varie beaucoup et sur lequel je suis en doute. Il y a des livres utiles par le sujet même qu’ils traitent et qui ne servent en rien à la réputation de l’auteur; il y a aussi de bons livres qui, comme certains labeurs qui ont cependant leur raison d’être, font honte à l’ouvrier. Je pourrais écrire sur la manière dont nous tenons table, dont nous nous habillons: ce serait, à la vérité, à mon corps défendant; je pourrais le faire aussi sur les édits rendus à notre époque, sur les lettres des princes qui ont été chargés des affaires de l’état; ou bien composer un abrégé d’un bon livre (quoique tout abrégé d’un bon livre soit un sot abrégé) et ce livre venir à se perdre, et autres choses semblables; ces productions pourraient être de très grande utilité pour la postérité, mais quant à l’honneur que cela me procurerait, il dépendrait uniquement de ma bonne fortune. Une bonne partie des livres qui ont de la réputation, sont dans ces conditions.
Un point sur lequel il faut se montrer très réservé, c’est lorsqu’on rencontre des idées qui peuvent ne pas appartenir en propre à l’auteur, sans qu’on ait de certitude à cet égard.—Il y a quelques années, lisant Philippe de Comines, un très bon auteur assurément, j’y remarquai ce mot comme n’étant pas banal: «Qu’il faut bien se garder de rendre tant de services à son maître, qu’on le mette dans l’impossibilité de vous récompenser suivant vos mérites.» L’idée est à louer, seulement elle n’est pas de lui; je l’ai rencontrée il n’y a pas longtemps dans Tacite: «Les bienfaits sont agréables tant que l’on sait pouvoir les acquitter; mais s’ils dépassent nos moyens de les reconnaître, ils nous deviennent odieux.» Sénèque l’exprime catégoriquement: «Qui estime honteux de ne pas rendre, voudrait ne trouver personne dont il soit l’obligé:» Elle se retrouve dans Cicéron, sous une forme plus adoucie: «Qui ne se croit pas quitte envers vous, ne saurait être votre ami.» Le sujet traité peut, suivant sa nature, révéler un homme qui sait et a de la mémoire; mais, pour juger de ce qui lui 371 appartient plus spécialement et mérite attention, pour apprécier la force et la beauté de son âme, il faut savoir ce qui est réellement de lui et ce qui n’en est pas, et, dans ce qui n’est pas de lui, ce qui lui revient pour la part qu’il a au choix, à la disposition, à l’ornementation, au style. Il peut aussi avoir emprunté ses matériaux et en avoir empiré la forme, cela arrive souvent. Nous autres qui ne sommes pas familiarisés avec les livres, nous nous trouvons embarrassés quand nous voyons une belle idée chez un poète nouveau, un argument de valeur chez un prédicateur, et nous n’osons les en louer avant de nous être renseignés auprès de quelque savant pour savoir s’ils sont d’eux, ou si les auteurs en sont autres. Jusque-là, je me tiens toujours sur la réserve.
Digression sur Tacite. Cet historien s’est surtout attaché aux événements intérieurs, et il les juge plus qu’il ne les raconte.—Je viens de parcourir tout d’un trait l’histoire de Tacite (ce qui ne m’arrive guère, voilà bien vingt ans que je n’ai consacré à un livre une heure de suite); je l’ai fait sur le conseil d’un gentilhomme que la France estime beaucoup, tant pour sa valeur personnelle que pour son mérite et sa bonté qui lui sont communs avec ses frères, et il en a plusieurs. Je ne connais pas d’auteur qui, dans un livre qui enregistre tant de faits publics, fasse entrer tant de considérations sur les mœurs et les caractères des individus. Il me semble, contrairement à ce que lui-même paraît croire, que, s’appliquant à retracer sous toutes leurs phases les vies des empereurs de son temps, si diverses et si excessives en tout, la relation d’un aussi grand nombre d’actions mémorables, celles notamment que leur cruauté a fait naître chez leurs sujets, lui donnait matière de nous entretenir de faits plus instructifs et plus intéressants que s’il nous eût raconté les batailles et les agitations auxquelles le monde entier se trouvait en proie; si bien que, souvent, à le voir passer légèrement sur ces morts si belles, je trouve qu’il n’en tire pas tous les enseignements qu’elles renferment, comme s’il craignait de nous ennuyer par leur nombre et les longueurs qui en seraient résultées. C’est une des formes de l’histoire de beaucoup la plus utile, les événements publics dépendant surtout de l’ingérence de la fortune, les événements privés de nous-mêmes. Tacite juge les faits qui se sont passés, plutôt qu’il n’en rapporte l’histoire; il y a chez lui plus d’enseignements que de récits; ce n’est pas un livre à lire, il est à étudier et à apprendre; il renferme tant de sentences, qu’il y en a à tort et à raison; c’est une pépinière de discours moraux et politiques, propres à en pourvoir et en parer ceux en situation de participer à la direction du monde. Il émet toujours à l’appui de ses dires, des raisons solides et vigoureuses, incisives et spirituelles, dans le style affété de son siècle, où on aimait tant à se donner de l’importance, que lorsque les choses par elles-mêmes ne prêtaient pas à la subtilité et au piquant, on en mettait dans les paroles. Sa manière d’écrire ressemble assez à celle de Sénèque, mais me semble plus étoffée, tandis 373 que celle de ce dernier a plus de vivacité; elle convient plutôt à un état troublé et maladif comme est le nôtre en ce moment, vous diriez souvent que c’est nous qu’il peint et qu’il critique.
Sa sincérité ne fait pas doute et il était du parti de l’ordre; néanmoins, il semble avoir jugé Pompée avec trop de sévérité; et, à propos de Tibère, Montaigne a quelque doute sur l’impeccabilité de son jugement.—Ceux qui doutent de sa sincérité, indiquent assez qu’ils ont d’autres raisons de ne pas l’aimer. Ses opinions sont sages et il appartient au meilleur des partis qui divisaient Rome. Je me plains un peu toutefois de ce qu’il ait jugé Pompée plus sévèrement que les gens de bien qui ont vécu de son temps et ont été en relations avec lui, et de l’avoir mis sur le même rang que Marius et Sylla avec cette seule différence qu’il était moins ouvert. On ne conteste pas qu’il n’entrât des idées d’ambition et de vengeance dans son désir de s’emparer du gouvernement, et ses amis eux-mêmes ont craint que la victoire ne lui fît dépasser les bornes de la raison, sans cependant l’entraîner, comme ceux dont il vient d’être question, à ne plus connaître de limites; rien dans la vie de Pompée ne laisse supposer qu’il en serait arrivé à ce degré de cruauté et de tyrannie, et, comme on ne saurait attribuer au soupçon la même valeur qu’à l’évidence, je ne crois pas qu’il eût été tel. On pourrait peut-être tenir les narrations de Tacite pour vraies et sincères, par cela même qu’elles ne sont pas toujours en rapport avec les jugements par lesquels il conclut, dans lesquels il suit son idée première quelle que soit la manière dont il nous présente le fait et sans qu’il en modifie, si peu que ce soit, la physionomie. Il approuve la religion de son temps, se conformant ainsi à ce qu’ordonnaient les lois; il n’y a pas à l’en excuser, il ignorait le vrai Dieu; cela a été un malheur pour lui, mais non un défaut.
Je me suis surtout attaché à me rendre compte de son jugement, et, sur quelques points, je ne suis pas bien fixé à cet égard, comme par exemple à propos de cette phrase de la lettre que Tibère, vieux et malade, envoyait au sénat: «Vous écrirai-je, Messieurs; comment vous l’écrirai-je; ou bien ne vous l’écrirai-je pas? Mais, à l’heure actuelle, les dieux et les déesses ont, à n’en pas douter, décidé de ma perte, car je me sens dépérir de plus en plus chaque jour?» Je ne saisis pas comment Tacite voit là un signe évident que la conscience de Tibère était bourrelée de remords; du moins, en lisant ce passage, cela ne m’a pas produit cet effet.
Il lui reproche aussi de s’excuser d’avoir parlé de lui-même; Montaigne, lui, parle de lui-même dans ses Essais, ne parle que de lui et en observateur désintéressé.—Je trouve aussi un peu timide de sa part, qu’ayant eu occasion de dire qu’il avait exercé à Rome une magistrature honorable, il s’excuse pour qu’on ne croie pas qu’il l’a dit par ostentation; cela paraît bien de l’humilité pour un homme de cette envergure; n’oser parler franchement de soi, accuse un manque de courage. Un esprit 375 franc et élevé, qui juge sainement et sûrement, use sans y regarder de ses propres exemples comme de choses auxquelles il est étranger et se sert franchement de son témoignage comme de celui de tout autre. Il faut passer par-dessus ces règles mondaines de civilité quand c’est pour servir la vérité et la liberté.—Non seulement j’ose parler de moi, mais je ne parle que de moi; je fais fausse route, quand je parle d’autre chose, je sors de mon sujet. Je ne m’aime pas si aveuglément et ne suis pas si attaché et inféodé à moi-même que je ne puisse me regarder et me considérer en faisant abstraction de moi comme je ferais d’un voisin, d’un arbre; c’est une faute de ne pas voir ce que l’on vaut, tout comme d’en dire plus que l’on n’en voit. Nous devons aimer Dieu plus que nous-mêmes et le connaissons moins; ce qui n’empêche pas que nous en parlions à satiété.
Caractère de Tacite à en juger par ses écrits; on ne saurait que le louer, lui et les historiens qui agissent de même, d’avoir recueilli et consigné tous les faits extraordinaires et les bruits populaires.—Si de ses écrits on peut déduire ce qu’il était, Tacite devait être une personnalité éminente, de nature droite et courageuse, sans superstition, ayant l’âme généreuse d’un philosophe. On pourra le trouver quelque peu hardi dans ce qu’il avance, comme lorsqu’il raconte qu’un soldat portant une charge de bois, ses mains se raidirent par le froid, au point qu’elles se collèrent à son fardeau et que, se séparant des bras, elles y demeurèrent fixées et inanimées. En pareille matière, j’ai l’habitude de m’incliner devant l’autorité de témoins de grande valeur.
En nous contant aussi que Vespasien guérit à Alexandrie, par la faveur du dieu Sérapis, une femme aveugle, en lui passant de sa salive sur les yeux, et je ne sais quel autre miracle, il suit l’exemple et obéit au devoir de tous les bons historiens. Ils enregistrent les événements importants, et les bruits et idées en circulation dans les foules sont du nombre des faits de la vie publique. Leur rôle est de rapporter les croyances générales et non de les ramener dans l’ordre, ce qui est du domaine des théologiens et des philosophes qui ont charge de diriger les consciences; c’est ce qui a fait dire très sagement à un autre historien, grand homme comme lui: «A la vérité, j’en dis plus que je n’en crois; mais comme je ne prétends pas certifier les choses dont je doute, je n’entends pas non plus supprimer celles que j’ai apprises (Quinte-Curce)»; un autre dit encore: «On ne doit pas se mettre en peine d’affirmer ou de réfuter les choses..., il faut s’en tenir à la renommée (Tite-Live).» Quoique écrivant dans un siècle où la croyance aux prodiges s’amoindrissait, Tacite dit pourtant ne pas vouloir s’interdire d’insérer dans ses Annales et d’y consigner ce que tant de gens de bien admettent et ce que révérait si profondément l’antiquité; on ne saurait mieux dire. L’histoire doit s’écrire en rapportant les faits tels qu’ils nous parviennent et non selon ce que nous en jugeons.—Moi, 377 qui suis roi en la matière que je traite et n’en dois compte à personne, je n’ai cependant pas pleine confiance en moi-même. Je hasarde souvent des boutades de mon esprit desquelles je me défie et certaines finesses d’expressions que j’estime risquées; je les laisse aller quand même, remarquant que cela est parfois pris en bonne part et qu’il n’appartient pas à moi seul d’en juger. Je me présente debout et couché, de face et d’arrière, de droite et de gauche, tel que je suis à l’état de nature. Les esprits égaux en force, ne le sont pas toujours dans leurs goûts, ni dans l’application qu’ils apportent à ce qui les occupe. Voilà ce qui, sur cet historien, me revient en mémoire d’une façon générale et un peu incertaine; il est à observer que, dans ces conditions, tout jugement ne peut forcément qu’être vague et imparfait.
Montaigne plaisante sur la manie qu’il a d’enregistrer tout ce qui lui passe par la tête; c’est là une occupation qu’il pourrait prolonger indéfiniment.—Il n’y a peut-être pas de vanité plus réelle que d’écrire sur ce sujet, aussi inutilement que je le fais. Ce que Dieu nous a si divinement exprimé, devrait être soigneusement et continuellement médité par les gens intelligents. Qui ne voit que la route que je suis sans arrêt ni fatigue, me mènera tant qu’il y aura au monde de l’encre et du papier? Je ne puis retracer ma vie en narrant ce que j’ai fait, qui est de trop faible importance; je la retrace en consignant les idées qui me passent par la tête. N’ai-je pas connu un gentilhomme qui ne communiquait rien de sa vie que par le travail de ses intestins: on voyait exposée chez lui une rangée de vases de nuit, en contenant les résidus de sept ou huit jours; c’était ce qui faisait l’objet de ses études, de ses entretiens; tout autre sujet lui répugnait. Ce que j’expose ici est un peu plus décent; ce sont les élucubrations toujours mal digérées d’un esprit devenu vieux, tantôt prolixe, tantôt réservé. Quant à voir prendre fin ces continuelles agitations et transformations de mes idées, quels que soient les sujets auxquels elles ont trait, songeons que Diomède, s’occupant uniquement de grammaire, en a rempli six mille volumes. A quoi peut conduire le bavardage, alors que le bégaiement et les préambules du langage ont pu, à eux seuls, permettre d’infliger au monde d’avoir à supporter l’horrible charge de tant de volumes! Que de paroles pour ne traiter que de la parole! O Pythagore, pourquoi n’avoir pas conjuré cette tempête! On reprochait, aux temps jadis, à un Galba l’oisiveté de sa vie; il répondit que «chacun devait compte de ses actes et non de son repos», ce en quoi il se trompait: 379 la justice a aussi à connaître de ceux qui ne travaillent pas et elle les a en animadversion.
On devrait faire des lois contre les écrivains inutiles; il y en a tant que, pendant qu’on sévirait contre les plus dangereux, lui-même aurait le temps de s’amender.—Les lois devraient avoir quelque peine édictée contre les écrivains ineptes et inutiles, comme il en existe contre les vagabonds et les fainéants; on bannirait de la sorte des mains du peuple mes ouvrages et ceux de cent autres. Ce n’est pas là une plaisanterie. La démangeaison d’écrire semble l’un des symptômes d’un siècle en effervescence. Quand avons-nous jamais tant écrit que depuis que l’ère de nos troubles s’est ouverte? les Romains l’ont-ils jamais tant fait, que lorsqu’ils touchaient à leur ruine? Outre que les progrès de l’esprit ne sont pas ce qui rend sage au point de vue politique, cette occupation oisive, qu’est le travail de la plume, naît de ce que chacun s’intéresse mollement aux devoirs de sa charge et s’en dispense. La corruption du siècle se fait par la coopération de chacun de nous en particulier: les uns y contribuent par la trahison, les autres par l’iniquité, l’irréligion, la tyrannie, l’avarice, la cruauté, suivant le degré de leur puissance; les plus faibles y apportent la sottise, la vanité, l’oisiveté: je suis de ces derniers. Il semble que ce soit la saison des choses frivoles, quand, de toutes parts, le mal nous accable; à une époque où la méchanceté s’exerce si communément, n’être qu’inutile devient digne d’éloges. Je me console en pensant que si la justice s’en mêlait, je serais des derniers sur lesquels elle mettrait la main; pendant qu’on s’occuperait de ceux qui gênent le plus, j’aurais le loisir de m’amender; car il serait déraisonnable, ce me semble, de poursuivre la réparation de menus inconvénients, quand les grands pullulent. Philotime, le médecin, auquel quelqu’un présentait son doigt à panser, et qu’à sa mine et à son haleine il reconnaissait atteint d’un ulcère aux poumons, lui dit: «Mon ami, ce n’est pas l’heure de t’amuser à te soigner les ongles.»
Comment les politiques amusent le peuple alors qu’ils le maltraitent le plus.—Pourtant, à ce propos, j’ai vu, il y a quelques années, un personnage pour la mémoire duquel j’ai conservé une estime toute particulière, qui, alors que nous étions aux prises avec les pires calamités, qu’il n’y avait plus ni loi, ni magistrat remplissant son mandat pas plus, du reste, que maintenant, se mit à publier un ouvrage sur je ne sais quelles insignifiantes réformes touchant le costume, la cuisine et la chicane. Ce sont là des amusettes qu’on donne en pâture à un peuple qui est malmené, pour dire qu’on ne l’a pas complètement oublié. Ceux-là font de même qui, dans les moments critiques, rendent des arrêtés pour défendre formellement certaines formes de langage, les danses et les jeux, à un peuple en proie à tous les vices les plus exécrables. Ce n’est pas le moment de se laver et de se décrasser, quand on est atteint d’une bonne fièvre. Seuls, les Spartiates se 381 mettaient à se peigner et à se friser avec soin, quand ils étaient sur le point de s’engager dans quelque aventure où ils couraient risque de la vie.
Tout différent des autres, Montaigne se sent plus porté à devenir meilleur dans la bonne que dans la mauvaise fortune.—J’ai cette autre très mauvaise habitude que, si j’ai un escarpin de travers, je laisse de même sans les redresser et ma chemise et mon habit; je dédaigne de m’amender à moitié. Quand je suis en fâcheuse situation, je m’acharne au mal qui me tient, je m’abandonne par désespoir, ne me retiens plus dans ma chute et jette, comme on dit, le manche après la cognée; je m’obstine à faire de mal en pis, et n’estime plus que je mérite attention de ma part. Il faut que tout en moi soit ou tout bien, ou tout mal. Je suis heureux que ce désolant état mental se produise à un âge qui ne l’est pas moins; il m’est moins douloureux que mes maux s’en trouvent aggravés que si mon bon temps de jadis en avait été troublé. Les paroles qui m’échappent quand je suis dans le malheur, sont des paroles de dépit; mon courage se hérisse au lieu de céder. A l’inverse des autres, je suis plus dévot dans la bonne que dans la mauvaise fortune; j’applique en cela le précepte de Xénophon, mais sans y être amené par les motifs qui le lui inspirent; je fais plus volontiers les doux yeux au ciel pour le remercier que pour le solliciter. Je veille plus sur ma santé quand elle est bonne, que je ne prends de soin pour la rétablir quand elle laisse à désirer; la prospérité m’instruit et me rappelle à mes devoirs, me produisant le même effet que chez d’autres le malheur et les verges. Comme si le bonheur était incompatible avec une bonne conscience, les hommes ne reviennent au bien que dans la mauvaise fortune; chez moi, il me porte d’une façon toute particulière à la modération et à la modestie. La prière me gagne, la menace me rebute; la faveur me fait fléchir, la crainte me raidit.
Il aimait le changement et, comme conséquence, les voyages; cela le sortait de chez lui, car s’il est agréable de commander chez soi, cela a aussi ses ennuis.—Il est assez dans la nature humaine que ce que nous n’avons pas, nous plaise plus que ce que nous avons; nous aimons le mouvement et le changement: «Le jour lui-même ne nous est agréable que parce que chaque heure prend des aspects différents (Pétrone)», et je suis assez dans ces dispositions. Ceux qui sont d’humeur contraire, qui éprouvent de la satisfaction d’eux-mêmes, qui apprécient que ce qu’ils ont vaut mieux que ce qu’ils n’ont pas, qui ne voient rien de préférable au milieu dans lequel ils se trouvent, s’ils ne sont pas mieux lotis que nous, sont néanmoins plus heureux. Je n’envie pas leur sagesse, mais bien leur bonne fortune.
Cette disposition à toujours souhaiter des choses nouvelles et inconnues, contribue beaucoup à entretenir en moi le goût des voyages, auxquels me convient aussi nombre d’autres circonstances, et en particulier la facilité avec laquelle je me désintéresse de la direction 383 de ma maison. Il y a quelque agrément à commander, ne fût-ce que dans une grange, et à être obéi des siens; mais c’est un plaisir trop uniforme et insipide et qui forcément est accompagné de préoccupations pénibles. Tantôt c’est l’indigence et l’oppression qui pèsent sur vos gens et qui vous affligent, tantôt c’est une querelle avec vos voisins, tantôt un empiètement de leur part sur vos domaines: «Ce sont, ou vos vignes que la grêle a ravagées, ou vos arbres, vos champs qui manquent d’eau; ce sont des chaleurs trop fortes ou des hivers trop rigoureux qui viennent tromper vos espérances (Horace)»; à peine pendant six mois Dieu vous enverra-t-il un temps qui satisfasse pleinement votre régisseur; et encore s’il profite aux vignes, il est à craindre qu’il ne nuise aux prés: «Tantôt un soleil trop ardent brûle les moissons; tantôt des pluies subites, d’âpres gelées, les détruisent; tantôt c’est la violence du vent qui les emporte dans ses tourbillons (Lucrèce).» A quoi il faut ajouter que, comme le soulier neuf et bien confectionné de cet homme des temps passés qui lui blessait le pied, un étranger ne sait pas combien il vous en coûte, combien de sacrifices il vous faut faire, pour maintenir l’accord apparent qui se voit dans votre famille et chez vos serviteurs et que peut-être vous achetez trop cher.
Peu fait à la gestion de ses biens, elle lui était d’autant plus à charge que ce qu’il avait lui suffisait et qu’il n’avait nulle envie de l’augmenter.—J’ai pris tard l’administration de mes biens; ceux que la nature avait fait naître avant moi, m’en ont longtemps déchargé et, déjà alors, j’avais pris d’autres habitudes plus en rapport avec mon tempérament. Toutefois, d’après ce que j’en ai vu, c’est une occupation plus absorbante que difficile; quiconque est capable d’autre chose, l’est bien aisément de celle-là. Si j’avais poursuivi la richesse, cette voie m’eût paru trop longue; je me serais mis au service des rois, ce qui, de toutes les professions, est la plus lucrative. Mais, ne prétendant qu’à la réputation de ne rien ajouter à mon patrimoine et de n’en rien dissiper, ce qui s’accorde avec le reste de ma vie qui s’est passée à ne rien faire qui vaille soit en bien, soit en mal; ne cherchant sur cette terre qu’à passer, je puis, Dieu merci, m’acquitter de cette gestion, sans trop y apporter d’attention. Au pis aller, on peut toujours prévenir la pauvreté en réduisant ses dépenses, ce que je m’efforce de faire, comme aussi de me réformer, avant qu’elle ne m’y contraigne. Du reste, je suis arrivé peu à peu, en moi-même, à me suffire avec moins que ce que j’ai et cela sans en éprouver de regret: «Ce n’est pas d’après les revenus de chacun, mais d’après ses besoins, qu’il faut estimer sa fortune (Cicéron).» Mes besoins réels n’absorbent pas tellement tout mon avoir que, sans me priver du nécessaire, la fortune n’ait encore moyen de mordre sur moi. Si ignorant et si dédaigneux que je sois de mes affaires domestiques, ma présence contribue cependant beaucoup à les maintenir en bonne voie; je m’y emploie, bien qu’à contre-cœur, sans compter qu’il y a ceci de particulier chez moi que, lorsque je ne 385 suis pas là, en dehors du surcroît de dépenses auxquelles je suis obligé pour moi-même, il s’y dépense autant que quand j’y suis.
Les voyages ont l’inconvénient de coûter cher, mais cela ne l’arrêtait pas; il s’arrangeait du reste pour y subvenir sans entamer son capital.—Les voyages n’ont de déplaisant pour moi que la dépense qui est considérable et dépasse mes ressources, ayant coutume de me faire suivre d’un train de maison, non seulement dans la mesure du nécessaire, mais permettant de faire figure; ce qui m’oblige à en réduire d’autant plus la fréquence et la durée, car je n’y emploie que le surplus de mes revenus et ma réserve, temporisant, ajournant suivant ce dont je puis disposer. Je ne veux pas que le plaisir de me promener enlève rien à mon bien-être quand je suis au repos; j’entends, au contraire, que les satisfactions que j’éprouve dans les deux cas, se complètent les unes par les autres et s’en trouvent accrues. La fortune m’est venue en aide sur ce point, en ce que, préoccupé par-dessus tout de mener une vie tranquille, plutôt oisive qu’affairée, elle m’a délivré du souci d’augmenter mes richesses, pour pourvoir à l’avenir de nombreux enfants. Je n’ai qu’une fille; si elle n’a pas assez de ce qui m’a abondamment suffi, tant pis pour elle: il y aura imprudence de sa part, et elle ne méritera pas que je lui en désire davantage. Chacun, à l’exemple de Phocion, pourvoit suffisamment ses enfants, quand il les dote dans la mesure où, s’ils lui ressemblaient, cela leur suffirait. Je ne suis pas, à cet égard, de l’avis de Cratès, qui déposa ses fonds chez un banquier, en disposant que «si ses enfants étaient des sots, cet argent leur serait remis; et que, s’ils étaient intelligents, il serait distribué aux plus sots du peuple», comme si les sots, parce qu’ils sont moins capables de se passer de richesses, étaient plus capables d’en user!—Quoi qu’il en soit, le dommage qui pourrait résulter de mon absence, pour la gestion de mes biens, ne me paraît pas valoir, tant que je serai à même de le supporter, que je me prive des occasions qui se présentent de me distraire des ennuis auxquels je suis en butte quand je suis chez moi.
Si peu qu’il s’occupât de son intérieur, il y trouvait mille sujets de contrariété qui, si légers qu’ils soient, constamment répétés, ne laissent pas de blesser souvent davantage que de plus grands maux.—Il s’y trouve toujours quelque chose qui va de travers: tantôt ce sont les affaires d’une maison qui vous tiraillent, tantôt celles d’une autre; vous voyez tout de trop près, votre perspicacité vous nuit ici, comme cela arrive souvent ailleurs. J’évite de me fâcher et feins de ne pas voir les choses qui vont mal; néanmoins je ne puis tant faire qu’à toute heure, je ne me heurte à quelque rencontre qui me déplaît; et les friponneries qu’on me cache le plus, sont celles que je connais le mieux; il en est même auxquelles, pour en atténuer les inconvénients, il faut se prêter soi-même à les cacher. Légers désagréments, direz-vous; oui, mais si légers qu’ils soient parfois, ce 387 n’en sont pas moins des désagréments. Les moindres empêchements, de si minime importance qu’ils soient, sont les plus acérés; les impressions typographiques en petits caractères sont celles qui fatiguent le plus la vue, de même les petits incidents sont ceux qui nous piquent le plus. La tourbe des petites contrariétés nous énerve plus qu’un mal violent, si grand qu’il soit. Plus ces épines de notre vie sont drues et déliées, moins nous nous en méfions et plus leurs morsures sont aiguës, plus elles nous prennent au dépourvu. Je ne suis pas philosophe, je ressens les maux dans la mesure où ils agissent sur moi: et ils agissent plus ou moins, selon la forme qu’ils affectent, selon ce sur quoi ils portent, et souvent plus que de raison; je les saisis avec plus de perspicacité qu’on n’en met généralement à s’en apercevoir, bien que j’y apporte plus de patience, et, quand ils ne me blessent pas, ils ne laissent pas de m’être à charge. C’est une chose délicate que la vie, son cours est facile à troubler. Dès que j’ai un sujet de chagrin, «la première impression reçue, on ne résiste plus (Sénèque)», si sotte qu’en soit la cause, mon humeur s’aigrit d’elle-même; puis elle se monte, s’exaspère, tirant à elle et entassant, pour s’exciter, griefs sur griefs: «En tombant goutte à goutte, l’eau finit par transpercer le rocher (Lucrèce).» Ces vétilles fréquentes me rongent et m’ulcèrent; les ennuis qui se répètent constamment ne sont jamais insignifiants; ils deviennent permanents et sans remède, quand * notamment ils proviennent du fait de membres de la famille, avec lesquels il y a communauté d’existence et avec lesquels on ne peut rompre.—Quand, loin de chez moi, ma pensée se reporte sur mes affaires et que je les envisage dans leur ensemble, je trouve, peut-être parce que je ne les ai pas bien présentes à la mémoire, que jusqu’à présent elles ont bien prospéré, mieux que mes comptes et les raisonnements que je fais ne me portaient à le croire; mes revenus m’apparaissent excédant ce qu’ils sont; de si belles apparences m’illusionnent; mais, dès que j’en reprends la direction, que je vois surgir tous ces menus détails, «alors mon âme se partage entre mille soucis (Virgile)»; mille choses y laissent à désirer ou me sont des sujets de crainte. Cesser complètement de m’en occuper, m’est très facile; m’y remettre sans regret, m’est bien difficile. C’est pitié que là où vous êtes, tout vous regarde et qu’il faille vous occuper de tout ce que vous voyez; je jouirais avec bien plus d’entrain, je crois, des plaisirs que m’offrirait une maison où je serais un étranger; j’y serais plus libre et plus suivant mes goûts. Je suis en cela en conformité de sentiment avec Diogène répondant à quelqu’un qui lui demandait quel vin il trouvait le meilleur: «Je préfère celui qui n’est pas de chez moi.»
Nullement sensible aux plaisirs de la vie de campagne, il n’aime pas davantage s’occuper des affaires publiques; jouir de l’existence lui suffit.—Mon père aimait à faire des constructions à Montaigne où il était né; et, dans toutes ces questions d’exploitation domestique, j’aime à suivre son exemple et sa 389 manière de faire, et ferai tout mon possible pour que ceux qui viendront après moi s’y emploient de même. Si je pouvais davantage pour son souvenir, je le ferais; je me fais gloire de ce que sa volonté s’exerce encore et s’accomplit par mon fait. Plaise à Dieu que jamais je ne manque une occasion d’agir, quand cela se pourra, comme l’eût fait de son vivant un si bon père. Si je me suis mêlé d’achever quelque vieux pan de mur et de modifier quelque partie de bâtiment mal établie, c’est certainement parce que tel était son projet, beaucoup plus que parce que cela me convenait; et je me reproche ma fainéantise qui m’a empêché de continuer la belle restauration qu’il avait commencé de faire subir à notre maison, d’autant que je risque fort d’en être le dernier propriétaire de notre race et celui qui y portera la dernière main. Mais je ne suis porté personnellement ni au plaisir de bâtir qu’on dit si attrayant, ni à chasser, jardiner, ni aux autres passe-temps de la vie de campagne; aucun n’est susceptible de beaucoup m’amuser. Ce sont là choses que je ne pratique pas, non plus que les opinions qui peuvent m’être une source de difficultés; je ne me soucie pas tant d’en avoir de robustes et d’éclairées, que de faciles et commodes pour l’existence; elles sont suffisamment saines et justes, quand elles sont utiles et agréables. Ceux qui m’entendent affirmer mon incapacité à m’occuper d’économie domestique, me soufflent à l’oreille que c’est par dédain. Que si je néglige de connaître les instruments dont il est fait usage pour les labours, les saisons qui leur sont propres, l’ordre dans lequel il doit y être procédé; comment se font mes vins, se greffent mes arbres; de posséder le nom des plantes et des fruits et les distinguer; de savoir la manière d’apprêter les viandes que nous mangeons journellement, démêler le nom et le prix des étoffes dont nous nous habillons, c’est parce que j’ai à cœur de m’occuper de sciences plus relevées, ceux-là m’irritent profondément par leurs réflexions; si cela était, ce serait sottise, et plutôt bêtise que gloire. Je préférerais, en effet, être bon écuyer, que bon logicien: «Que ne t’occupes-tu plutôt à des choses utiles, à faire des paniers d’osier ou des corbeilles de jonc (Virgile)!» Nous occupons notre pensée de généralités, des causes et de la marche de tout ce dont se compose l’univers, toutes choses qui s’accomplissent très bien sans nous, et nous laissons de côté ce qui concerne l’homme en général et notre propre personnalité qui nous touche de plus près encore.
Le plus ordinairement je réside chez moi; je voudrais m’y plaire plus qu’ailleurs: «Après tant de voyages par terre et par mer, après tant de fatigues et de combats, puisse-je enfin y trouver le repos pour ma vieillesse (Horace)!» je ne sais si j’en viendrai à bout. J’aurais voulu, en place de quelque autre partie de sa succession, avoir hérité de mon père l’amour passionné que, dans ses vieux ans, il portait à l’exploitation de ses biens; il était heureux de borner ses désirs à sa situation et de savoir se contenter de ce qu’il avait. Les gens qui s’adonnent à l’étude des hautes questions 391 politiques, pourront trouver que c’est se confiner dans une occupation peu relevée et stérile; cela m’importerait peu, si je parvenais à y prendre autant de goût que lui.—Je suis de l’avis que servir la cause publique et être utile au plus grand nombre, est ce qu’il y a de plus honorable: «Nous ne jouissons jamais mieux des fruits du génie, de la vertu et de toute espèce de supériorité, qu’en les partageant avec ceux qui nous touchent de plus près (Cicéron)»; mais en ce qui me regarde, j’y ai renoncé par poltronnerie et par conscience; de telles charges me paraissent si lourdes, qu’il me semble aussi que je suis incapable de les remplir. Platon, qui était maître en tout ce qui est relatif au gouvernement des états, s’abstint, lui aussi, d’en accepter. Je me contente de jouir du monde, sans y apporter trop d’ardeur; de mener une vie simplement supportable, qui ne pèse ni à moi, ni aux autres.
Il eût souhaité pouvoir abandonner la gestion de ses biens à un ami sûr, à un gendre par exemple, qui l’en eût débarrassé, lui assurant le bien-être pour la fin de ses jours.—Jamais homme ne s’en est remis aussi complètement et avec autant d’abandon que je le ferais aux soins et à l’administration d’un tiers, si j’avais à qui me confier. L’un de mes souhaits, à cette heure, serait de trouver un gendre qui saurait endormir mes vieux jours, en me faisant une existence commode; entre les mains duquel je déposerais, en toute souveraineté, la direction et l’emploi de mes biens; qui en ferait ce que j’en fais, et auquel j’en abandonnerais les bénéfices, pourvu qu’il y apportât un cœur vraiment reconnaissant et ami. Mais voilà! nous vivons dans un monde où la loyauté est inconnue, même de nos propres enfants.
Il se fiait à ses domestiques, évitant de se renseigner sur eux pour ne pas être obligé de les avoir en défiance.—Celui qui, lorsque je voyage, est dépositaire de mon argent, le reçoit intégralement et règle la dépense sans contrôle; du reste, si je comptais, il me tromperait tout autant; de la sorte, à moins que ce ne soit un scélérat, en m’en remettant à lui d’une façon absolue, je l’oblige à bien faire: «Beaucoup de gens nous enseignent à les tromper, en craignant de l’être; la défiance provoque l’infidélité (Sénèque).» La sûreté que je prends le plus communément à l’égard de mes gens, c’est de ne pas me renseigner sur eux; je ne présume le vice qu’après l’avoir constaté; je m’en fie plutôt à ceux qui sont jeunes, les estimant moins pervertis par le mauvais exemple.—Il m’est moins désagréable de m’entendre dire, au bout de deux mois, que j’ai dépensé quatre cents écus, que d’avoir chaque soir les oreilles rebattues par le règlement de ma dépense journalière, et entendre qu’elle a été de trois, de cinq, de sept écus; ce mode n’a pas fait que, sur ce point, j’aie été volé plus qu’un autre. Il est vrai que je prête la main à l’erreur; de parti pris, je ne sais que vaguement et d’une façon incertaine ce que j’ai d’argent; et, dans une certaine mesure, je suis content de cette incertitude. Il faut faire une petite part à la déloyauté ou à l’imprudence d’un serviteur; s’il nous reste de 393 quoi largement tenir notre rang, abandonnons à sa merci, sans y tant regarder, l’excédent que nous tenons de la libéralité de la fortune: c’est la part du glaneur. En somme, je n’attache pas tant d’importance à la bonne foi de mes gens, que je me soucie peu du tort qu’ils me font. Oh! quelle vilaine et sotte occupation que d’être constamment occupé de son argent, de se plaire à le manier, * à le peser, à le recompter! c’est par là que l’avarice nous gagne.
Il n’a jamais pu s’astreindre à lire un titre, un contrat; chez lui, la moindre chose le préoccupe.—Depuis dix-huit ans que j’administre mes biens, je n’ai pas su prendre sur moi d’examiner ni mes titres de propriété ni mes principales affaires, que je devrais cependant connaître à fond, puisque j’ai à y veiller. Ce n’est pas par mépris des choses passagères de ce monde, inspiré par la philosophie: je n’en suis pas détaché à ce degré, et les estime pour le moins à leur valeur; mais bien par l’effet d’une paresse et d’une négligence puériles et incurables. Que ne ferais-je pas plutôt que de lire un contrat, plutôt que de me mettre à secouer ces paperasses poudreuses qui me feraient l’esclave de mes affaires ou, ce qui est encore pis, l’esclave de celles des autres comme font tant de gens pour de l’argent. Rien ne me coûte tant que le souci et la peine; je ne recherche que la nonchalance et la mollesse. J’étais plutôt fait, je crois, pour vivre attaché à la fortune d’autrui, si cela se pouvait sans qu’il en résultât ni obligation ni servitude; et je ne sais si, à le considérer de près, étant donnés mon caractère et ma situation, joints à ce que j’ai à souffrir du fait de mes affaires, de mes serviteurs et de mes familiers, je n’en éprouve pas plus d’abjection, d’importunité et d’aigreur, que si je faisais partie de la suite d’un homme, né plus haut que moi, dans la dépendance duquel je serais sans qu’il gênât trop ma liberté: «La servitude est la sujétion d’une âme lâche et abjecte, privée de son libre arbitre (Cicéron).» Cratès fit plus: il se mit sous la sauvegarde de la pauvreté, pour s’affranchir des indignités et des soins que réclame la direction d’une maison; cela, je ne le ferai pas, car je hais la pauvreté à l’égal de la douleur; mais ce que je ferais volontiers, ce serait d’échanger la vie que je mène, contre une autre moins noble et moins affairée.
Quand je suis absent, je laisse de côté toutes ces préoccupations, et la chute d’une tour m’émouvrait moins que ne fait, quand je suis présent, une ardoise qui se détache de la toiture. Mon âme, quand elle n’est pas sur place, se désintéresse aisément de tout ce qui arrive; mais si elle est là, elle en souffre, autant que peut en souffrir l’âme d’un vigneron; une rêne attachée de travers à mon cheval, un bout d’étrivières qui bat sur ma jambe me préoccupent une journée entière. J’arrive assez aisément à ce que mon courage domine les incommodités de la vie; pour ce qui est de mes yeux je n’y parviens pas: «Les sens, ô dieux, les sens, que nous en sommes donc peu maîtres!»
Que n’a-t-il au moins un aide sur lequel se reposer! Obligé 395 de veiller à tout, sa manière de recevoir les étrangers s’en ressent.—Chez moi, je suis responsable de tout ce qui va mal. Peu de maîtres (je parle de ceux de condition moyenne, comme est la mienne), et s’il y en a, ils sont plus heureux que moi, peuvent se reposer assez sur un second de tous ces tracas, au point qu’il ne leur en demeure encore une bonne part à leur charge. Cela réagit quelque peu sur la manière dont je reçois les survenants, et peut-être y en a-t-il dont le séjour s’est prolongé, ainsi qu’il arrive des fâcheux, plus à cause des agréments de ma cuisine qu’en raison de la bonne grâce de mon accueil; le plaisir que je devrais éprouver de voir mes amis me visiter et se réunir chez moi, s’en trouve considérablement diminué.—La plus sotte contenance que puisse avoir chez lui un gentilhomme, c’est d’être vu gêné par le souci du service de sa maison, parlant à l’oreille d’un valet, en menaçant un autre du regard. Il faut que les choses marchent sans qu’on s’en aperçoive et qu’elles semblent suivre leur cours ordinaire; je trouve déplaisant d’entretenir ses hôtes de ce qu’on fait pour eux, que ce soit pour s’en excuser ou pour s’en prévaloir.—J’aime l’ordre et la propreté, et les préfère à l’abondance: «j’aime que les plats et les verres reflètent mon image (Horace)»; je m’en tiens chez moi à ce qui est strictement nécessaire et donne peu à l’ostentation.—Quand vous êtes chez les autres, qu’un valet se batte, qu’un plat se renverse, vous ne faites qu’en rire; vous dormez, tandis que monsieur, de concert avec son maître d’hôtel, prépare ce qu’il vous offrira le lendemain.—Ce que j’en dis, c’est ce qui se passe en moi; je n’en reconnais pas moins combien ce doit être une douce occupation pour les natures qui y sont portées, d’arriver à faire que sa maison soit paisible, prospère et que tout y marche dans un ordre parfait. Cet état de choses dont je souffre, je l’attribue à mes propres erreurs et aux embarras que je me crée à moi-même, et n’ai nullement l’intention de contredire Platon, qui estime que la plus heureuse occupation pour chacun, est de «faire ses affaires personnelles, sans causer de préjudice à personne».
Montaigne était beaucoup plus porté à dépenser qu’à thésauriser.—En voyage, je n’ai à penser qu’à moi et à l’emploi de mon argent pour lequel suffit un ordre une fois donné; pour l’amasser, au contraire, il faut aller à de trop nombreuses sources, et je n’y entends rien. Je suis moins embarrassé pour dépenser, n’ayant qu’à puiser dans mes fonds disponibles dont c’est la principale destination; mais j’ai des vues trop larges, ce qui fait que mes dépenses sont réparties inégalement, sans règle et, de plus, d’une façon immodérée soit dans un sens, soit dans l’autre: si elles doivent contribuer à me donner du relief, à me servir, je dépense sans restriction; je me restreins également sans limite, quand elles ne doivent pas me mettre en évidence ou satisfaire un désir que j’ai. Que ce soit l’art ou la nature qui nous pousse à vivre en relations avec autrui, cela nous est plutôt un mal qu’un bien; nous nous privons de ce qui nous est utile, pour nous donner les apparences de faire 397 comme les autres; les conditions dans lesquelles nous vivons, les effets que nous en éprouvons, nous importent moins que ce que le public peut en connaître; les biens mêmes de l’esprit et de la sagesse nous paraissent manquer de saveur, si nous en jouissons hors de la vue et de l’approbation de gens qui nous sont étrangers.—Il y a des personnes dont l’or coule à grands flots par des issues souterraines qui échappent à la vue, tandis que d’autres l’étendent ostensiblement en lames et en feuilles; si bien que pour les unes, les liards valent des écus, alors que c’est l’inverse pour les autres; et cela, parce que le monde juge sur ce qu’il voit de l’emploi et de la valeur de ce que vous possédez.—Prêter un soin trop attentif aux richesses, sent l’avarice; les dispenser avec une libéralité trop calculée et trop méticuleuse, ne vaut même pas la surveillance et l’attention pénibles que cela nécessite; qui veut mesurer trop exactement sa dépense, le fait trop étroitement et semble n’y satisfaire que par contrainte. Thésauriser et dépenser sont par eux-mêmes deux choses indifférentes; elles ne deviennent bonnes ou mauvaises que suivant l’idée d’après laquelle nous agissons.
Une autre raison qui le portait à voyager, c’est la situation morale et politique de son pays; il n’a pas le courage de voir tant de corruption et de déloyauté.—Une autre cause me porte à voyager, c’est le peu de goût que j’éprouve pour les mœurs de notre état social. Au point de vue de l’intérêt public, je me consolerais aisément de cette corruption: «Je supporterais ces temps pires que le siècle de fer, dans lesquels les noms manquent aux crimes et que la nature ne peut plus désigner par aucun métal (Juvénal)»; mais en ce qui me touche, j’en souffre trop personnellement; car, dans mon voisinage, par suite des abus qu’engendrent depuis si longtemps ces guerres civiles, notre vie entière s’écoule dans une situation tellement bouleversée, «où le juste et l’injuste sont confondus (Virgile)», qu’en vérité, c’est merveille qu’elle puisse se maintenir: «On laboure tout armé, on n’aime à vivre que de butin, et chaque jour se commettent de nouveaux brigandages (Virgile).» Par notre exemple, je finis par voir que la société humaine se tient et se coud, quoi qu’il arrive. Qu’on place des hommes n’importe comment, ils se resserrent et se rangent, se remuant pour finir par se tasser, comme des objets mal assortis qu’on met pêle-mêle dans une poche et qui trouvent d’eux-mêmes la façon de se juxtaposer et de s’intercaler les uns dans les autres, mieux souvent que l’art n’eût su les disposer.—Le roi Philippe avait fait exécuter une rafle des gens les plus mauvais et les plus incorrigibles que l’on pût trouver et leur avait assigné pour demeure une ville qu’il fit bâtir spécialement pour eux et dont le nom rappelait l’origine; j’estime que cette société hétéroclite dut, avec pour point de départ les vices de ses membres, se constituer en un état politique dont chacun s’accommoda et où finit par régner la justice.—Je vois de nos jours, non un fait isolé, ni trois, ni cent, mais des mœurs nouvelles admises et pratiquées couramment, tellement farouches surtout par leur inhumanité et leur déloyauté, 399 ce qui, pour moi, constitue la pire espèce d’entre les vices, que je ne puis y penser sans horreur; je les admire presque autant que je les déteste, en voyant combien la mise à exécution de ces méchancetés insignes témoigne de vigueur et de force d’âme autant que d’erreur et de déréglement. La nécessité fait les hommes ce qu’ils sont et les réunit; ce lien fortuit se transforme ensuite en lois; de ces législations, parmi lesquelles s’en trouvent de plus sauvages qu’il n’est possible à aucun de nous de les imaginer, certaines sont arrivées à produire d’heureux effets et ont été d’aussi longue durée que celles que Platon et Aristote étaient capables de faire, et ce, alors que toutes les conceptions de cette nature, si ingénieuses qu’elles soient, sont, dans l’application, ridicules et ineptes.
Toutes les discussions sur la meilleure forme de gouvernement sont parfaitement inutiles; pour chaque nation, la meilleure est celle à laquelle elle est accoutumée.—Ces grandes et longues altercations sur la meilleure forme de société et sur les règles les plus propres à nous grouper et à nous contenir, n’ont d’autre intérêt que d’exercer notre esprit, semblables en cela à quelques questions qui, dans les arts, sont, par leur nature même, des sujets d’agitation et de controverse et qui, hors de là, n’existent pour ainsi dire pas. Tels de ces projets de gouvernement pourraient, peut-être, être appliqués à un monde nouveau; mais nous sommes un monde déjà existant, où règnent certaines coutumes, et ce n’est pas nous qui l’engendrons, comme ont fait Pyrrha ou Cadmus. Quelque possibilité que nous puissions avoir de le redresser et de l’organiser à nouveau, nous ne pouvons, sans rompre le tout, le ployer pour effacer le pli déjà pris.—On demandait à Solon si les lois qu’il avait données aux Athéniens étaient les meilleures possibles: «Oui certes, répondit-il, étant données celles qu’ils avaient auparavant.»—Varron s’excuse dans le même sens: «Si, traitant de la religion, il eût abordé un sujet absolument neuf, il eût dit ce qu’il en pense; mais la trouvant déjà admise et * toute formée, il en parlera suivant ce qui est, plutôt que selon ce qu’elle devrait être d’après la nature.»
Le plus parfait et le meilleur gouvernement, non suivant ce qu’on en peut penser, mais dans la réalité, est pour chaque nation celui sous lequel elle vit depuis longtemps; sa forme et sa commodité dépendent essentiellement de l’habitude qu’on en a. La condition en laquelle nous sommes nous déplaît généralement; je tiens cependant que c’est vice et folie que de souhaiter, dans une démocratie, que l’autorité passe aux mains d’un petit nombre, et que, dans une monarchie, un autre gouvernement se substitue à celui existant. «Aime l’état tel qu’il est: si c’est une monarchie, aime la royauté; si c’est une oligarchie ou une démocratie, aime-les pareillement, Dieu t’y ayant fait naître»; ainsi en parlait ce bon monsieur de Pibrac que nous venons de perdre et qui était un esprit si aimable, d’opinions si saines, de mœurs si douces. Cette perte et celle que nous avons faite en même temps de monsieur de Foix sont très regrettables 401 pour la couronne. Je ne sais s’il reste en France de quoi remplacer ces deux Gascons, dans les conseils de nos rois, par un couple pareil en droiture et en capacité. C’étaient de belles âmes dans des genres différents; et assurément, pour ce siècle, elles étaient rares et belles chacune à sa manière; comment opposées et réfractaires, comme elles l’étaient, à la corruption et aux tempêtes de ces temps-ci, ont-elles pu y trouver place?
Rien n’est plus dangereux pour un état qu’un changement radical; il faut s’appliquer à améliorer, mais non renverser.—Rien n’est plus grave pour un état qu’un changement radical; seuls, les changements de cette nature peuvent permettre à l’injustice et à la tyrannie de se produire. Quand quelque pièce vient à se détraquer, on peut la consolider; on peut empêcher que l’altération et la corruption, auxquelles tout est naturellement sujet, ne nous éloignent trop des principes qui sont le point de départ de nos institutions; mais entreprendre de reconstituer une si grande masse, de changer les fondations d’un édifice aussi considérable, c’est faire comme ceux qui, pour décrasser, effacent tout, qui veulent corriger quelques défauts de détail par un bouleversement général; c’est recourir à la mort pour guérir de la maladie: «C’est moins chercher à changer le gouvernement qu’à le détruire (Cicéron).» Le monde n’est pas capable de se rétablir de lui-même; il supporte si difficilement ce qui le gêne, qu’il ne vise qu’à s’en défaire sans regarder à quel prix. Nous voyons par mille exemples que, d’ordinaire, il n’obtient la guérison qu’à ses dépens. Se décharger d’un mal présent n’est pas s’en guérir si, dans son ensemble, notre condition ne s’en améliore; le but du chirurgien n’est pas l’ablation des chairs contaminées, ce n’est là qu’un moyen d’en arrivera la guérison; il voit plus loin, il cherche à faire renaître la chair naturelle et à ramener la partie malade à son état normal. Quiconque ne se propose que de se débarrasser de ce qui le fait souffrir, ne va pas loin, car le bien ne succède pas nécessairement au mal; ce peut être un autre mal, parfois pire. C’est ce qui arriva aux meurtriers de César, qui compromirent l’ordre public, au point qu’ils eurent à se repentir de s’en être mêlés. Depuis cette époque jusqu’à nos jours, pareille mésaventure est arrivée à plusieurs; les Français, mes contemporains, peuvent en parler sciemment; toutes les grandes modifications ébranlent un état et y portent le désordre.
Les réformes elles-mêmes sont difficiles; un gouvernement, même vicieux, peut se maintenir malgré ses abus, sans compter que parfois, si on regardait ses voisins, on y trouverait pire.—Qui voudrait en entreprendre directement la guérison et consulter les intéressés avant d’agir, serait rendu promptement hésitant.—Pacuvius Calavius tourna la difficulté d’une façon qui le démontre nettement. C’était à Capoue, où il jouissait d’une grande influence; ses concitoyens étaient en révolte contre les magistrats. Un jour, ayant réussi à enfermer le sénat 403 dans le palais, il convoque le peuple sur la place publique, et dit à ceux qui se sont rendus à son appel que le moment est venu pour eux de se venger en toute liberté des tyrans qui les oppressent depuis si longtemps et qu’il tient à leur merci, isolés et désarmés. Qu’il est d’avis que, d’après l’ordre que le sort assignera, on les fasse venir les uns après les autres et qu’il soit statué sur chacun séparément, et que ce qui sera décidé soit sur-le-champ exécuté; mais qu’en même temps, il soit désigné quelque homme de bien pour occuper la charge du condamné, afin qu’elle ne demeure pas sans personne pour la remplir. L’assistance n’eut pas plutôt entendu le nom d’un sénateur, qu’il s’éleva contre lui un cri universel de mécontentement: «Je vois bien, dit Pacuvius, qu’il faut lui enlever ses fonctions: c’est un méchant, remplaçons-le par un bon.» Le silence se fit général; chacun, bien embarrassé, ne savait sur qui faire porter son choix. Enfin quelqu’un, plus osé que les autres, met son candidat en avant; mais un concert de voix, plus grand encore que tout à l’heure s’élève pour le rejeter; on lui reproche cent imperfections et les plus justes motifs d’éviction. Ces dispositions à ne pas s’entendre ne font que croître, et le désaccord s’accentue quand on passe au second sénateur; c’est encore pis, quand vient le troisième; on s’accorde aussi peu pour l’élection que l’on s’entend sur la destitution. Finalement, fatigués de ces débats inutiles, les voilà qui commencent de ci, de là, à se retirer peu à peu de l’assemblée, chacun se disant à part soi qu’un mal qui dure depuis longtemps et qui est connu, est toujours plus supportable qu’un mal nouveau dont on n’a pas encore subi l’expérience.
De ce que je nous vois agités de bien piteuse façon (car à quels excès ne nous sommes-nous pas livrés?): «Hélas! nos cicatrices, nos crimes, nos guerres fratricides nous couvrent de honte! Enfants de ce siècle, de quoi ne nous sommes-nous pas rendus coupables? quels forfaits n’avons-nous pas commis? Est-il une chose sainte qu’ait respectée notre jeunesse, un autel qu’elle n’ait point profané (Horace)?» je ne vais cependant pas soudain dire d’un ton ferme et résolu que «la déesse Salus elle-même, le voulût-elle, serait impuissante à sauver cette famille (Cicéron)». Quoi qu’il en soit, nous n’en sommes pourtant pas encore arrivés à nos derniers moments.—La conservation des états est chose qui vraisemblablement dépasse notre intelligence; un gouvernement est, comme le dit Platon, une puissance difficile à dissoudre; il résiste souvent à des maladies mortelles qui le rongent intérieurement; il se maintient malgré le tort que lui causent des lois injustes, en dépit de la tyrannie, de la prévarication et de l’ignorance des magistrats, de la licence et de la sédition des peuples. Dans tout ce qui nous arrive, nous prenons pour terme de comparaison ce qui est au-dessus de nous et regardons ceux qui sont en meilleure situation; mesurons-nous à ceux qui sont au-dessous, et il n’est pas si misérable d’entre nous qui n’y trouve mille sujets de consolation. C’est notre 405 défaut de porter plus complaisamment nos regards sur ceux qui sont plus favorisés que sur ceux qui le sont moins, ce qui faisait dire à Solon que si l’on venait à mettre en un seul tas tous les maux qui affligent l’humanité, il n’y aurait personne qui ne préférerait conserver ceux qu’il a plutôt que de participer, avec tous les autres hommes, à une égale répartition de ces maux entassés, et d’en prendre sa quote-part. Notre gouvernement se porte mal, cela est incontestable; cependant il y en a de plus malades qui n’en sont pas morts: «Les dieux jouent à la balle avec nous (Plaute)» et nous agitent à tour de bras.
L’empire romain est un exemple qu’une domination étendue ne témoigne pas que tout à l’intérieur soit pour le mieux, et que, si miné que soit un état, il peut encore se soutenir longtemps par la force même des choses.—Les astres ont fatalement désigné Rome, pour témoigner de ce qu’ils peuvent sous ce rapport; sa fortune comprend toutes les transformations et aventures que peut subir un état; tout ce que l’ordre et le désordre, le bonheur et le malheur, sont susceptibles de produire. Qui est en droit de désespérer de sa situation, en voyant les secousses et les perturbations qui l’ont agitée et qu’elle a supportées? Si une domination étendue est une garantie de prospérité pour un état (ce qui n’est pas du tout mon avis, très aise que je suis de voir, au contraire, Isocrate recommander à Nicoclès de ne pas porter envie aux princes dont les possessions sont les plus vastes, mais plutôt à ceux qui savent conserver, en bonnes conditions, ce qui leur est échu), Rome ne se porta jamais si bien que lorsqu’elle fut le plus malade. La pire de ses formes de gouvernement fut celle où elle se trouva le plus favorisée de la fortune; à peine trouve-t-on trace d’une constitution sous les premiers empereurs, c’est la plus horrible confusion de pouvoirs qui se puisse concevoir; et cela se supporta et dura, assurant la conservation d’une monarchie, non pas limitée à Rome elle-même, mais comprenant, en grand nombre, des peuples étrangers les uns aux autres, très éloignés, très mal disposés, conquis contre tout droit, et administrés d’une façon déplorable: «Néanmoins, la fortune ne voulut confier à aucune nation le soin de sa haine contre les maîtres du monde (Lucain).» Tout ce qui branle, ne tombe pas. La contexture d’un aussi grand corps est assurée par plus d’un clou; son antiquité même fait qu’il se maintient, comme ces vieux bâtiments dont l’âge a miné les soubassements, qui n’ont plus ni revêtement ni ciment et qui pourtant demeurent se soutenant par leur propre poids: «Il ne se rattache plus à la terre que par de très faibles racines, sa masse seule le retient encore en équilibre (Lucain).»
De la corruption générale des états de l’Europe, Montaigne conclut que la France peut se relever; toutefois il redoute qu’elle ne se désagrège.—Ce n’est pas bien procéder que de se borner, pour juger de la sûreté d’une place, à en reconnaître l’état des fossés et des flanquements; il faut encore étudier 407 les moyens d’action de l’assaillant et de quel côté il peut se présenter; peu de vaisseaux coulent au fond des mers par leur propre poids, sans accident provenant de causes étrangères. Or, regardons de tous côtés, tout croule autour de nous; examinez tous les grands états de la Chrétienté et d’ailleurs que nous connaissons, vous y trouverez une menace évidente de changements et de ruine: «Tous ont leurs infirmités et une même tempête les menace (Ovide).» Les astrologues ont beau jeu pour nous avertir, ainsi qu’ils le font, de troubles prochains devant occasionner de grandes perturbations; leurs prédictions réalisées dès maintenant sont palpables, il n’est pas besoin de consulter le ciel pour cela. De ce que tous nous sommes menacés des mêmes maux, nous pouvons non seulement y trouver un sujet de consolation, mais jusqu’à un certain point l’espérance que cela durera; d’autant que, par la force même des choses, rien ne tombe, là où tout tombe; une maladie qui s’étend à tous, devient un état de santé normal pour les individus; là où tout est au même point, il n’y a pas, par cela même, de dissolution. Pour moi, je ne m’en désespère pas; ces considérations me font entrevoir des chances de salut: «Peut-être un dieu, par un retour favorable, nous rendra-t-il notre premier état (Horace).» Qui sait si Dieu ne voudra pas qu’il en résulte, comme il arrive des corps qui, à la suite de longues et graves maladies, se trouvent être purgés et reviennent à un meilleur état qu’avant, y gagnant une santé plus complète et mieux assise que celle qui a subi ces secousses? Ce qui me rend le plus anxieux, c’est que si nous considérons les symptômes de notre mal, il s’en trouve autant qui ont une origine naturelle que nous devons au ciel d’où ils émanent, que d’autres qui sont le fait des déréglements et des imprudences des hommes; il semble que les astres eux-mêmes ont décrété que nous avons assez duré et que notre existence dépasse les limites ordinaires. Ce qui m’afflige aussi, c’est que le mal qui nous menace en premier lieu, ce n’est pas tant que la masse entière, qui jusqu’ici présentait tous les caractères de solidité, vienne à s’altérer, que de la voir se désagréger et se séparer: c’est là ma plus grande crainte.
Montaigne redoute de se répéter parfois dans ses Essais; il le regretterait, mais sa mémoire lui fait de plus en plus défaut.—En transcrivant ici ces rêvasseries, je crains que ma mémoire ne me trahisse et que, par inadvertance, elle m’ait fait produire deux fois une même chose. Je hais de me relire et ne corrige qu’à regret ce qui m’est une fois échappé. Or, je n’apporte ici rien de nouveau, ce sont des idées qui ont communément cours, et, comme cent fois elles me sont venues à la pensée, j’ai peur de les avoir déjà exprimées. Les redites sont toujours ennuyeuses, les trouverait-on dans Homère; elles sont désastreuses pour les choses qui ne s’indiquent que superficiellement et par circonstance. Je n’aime pas à revenir sans cesse, même sur ce qui est utile, comme le fait Sénèque, et ne prise pas ce mode de l’école stoïcienne de 409 ressasser en long et en large, pour chaque sujet traité, les principes et les hypothèses d’ordre général et de reproduire constamment les arguments et les raisons, toujours les mêmes et que tout le monde connaît.
Ma mémoire périclite cruellement de plus en plus chaque jour, «comme si, la gorge ardente, je buvais à longs traits les eaux somnifères du Léthé (Horace)». Jusqu’à cette heure, Dieu merci, elle ne m’a pas fait commettre d’erreur; mais il me faudra dorénavant, au lieu de faire comme les autres qui cherchent à se ménager le temps et la possibilité de penser à ce qu’ils ont à dire, que j’évite de m’y préparer, de peur de me tracer un programme dont je dépendrais. Me trouver tenu et obligé à suivre un ordre déterminé, dépendre d’un instrument aussi délicat que la mémoire, sont autant de causes qui me troublent. Je ne relis jamais le fait suivant, sans en être offusqué personnellement et malgré moi.—Lynceste était accusé d’avoir conspiré contre Alexandre; amené, suivant la coutume, devant l’armée pour être entendu dans sa défense, il avait en tête une harangue préparée avec soin dont, en hésitant et bégayant, il prononça quelques lambeaux. Comme il se troublait de plus en plus, se débattant avec sa mémoire pour retrouver le fil de son discours, les soldats les plus proches, le tenant pour convaincu du crime dont il était accusé, se précipitent sur lui et le tuent à coups de pique. Ses hésitations et son silence avaient été considérés comme des aveux; aux yeux de ses meurtriers, ayant eu en prison tout le loisir de se préparer, ce ne pouvait être la mémoire qui lui faisait défaut, mais sa conscience qui lui liait la langue et paralysait ses moyens. Que cela est judicieux! Quand on ne recherche qu’un succès oratoire, le lieu, l’assistance, l’attente sont déjà des causes de trouble; qu’est-ce donc quand votre vie dépend des paroles que vous allez prononcer?
S’il doit prononcer un discours préparé, la crainte de perdre le fil de ses idées le paralyse; aussi, comme le lire c’est se lier les mains, et qu’il n’est pas capable d’improviser, il a pris la résolution de s’abstenir désormais.—Pour moi, être lié à ce que j’ai à dire, fait que naturellement je suis porté à oublier. Si je me suis confié et livré entièrement à ma mémoire, j’exerce sur elle un tel effort que je l’accable et qu’elle s’effraie de sa charge. Plus je m’en repose sur elle, plus je suis hors de moi au point de ne savoir quelle contenance tenir; quelquefois je me suis vu très en peine pour cacher les embarras que cela me causait, notamment quand j’avais dessein de simuler, en parlant, une profonde nonchalance dans mon accent et mon attitude, et d’appuyer mes paroles de gestes en apparence fortuits et non prémédités, supposés inspirés par la situation du moment; en pareil cas, j’aime aussi peu ne rien dire qui vaille que d’avoir l’air d’être venu préparé à bien parler et ne le pouvoir pas, ce qui est fort maladroit, surtout chez des gens de ma profession, et coûte beaucoup à qui n’a pas grande facilité pour se tirer d’affaire. La préparation 411 éveille plus d’espérance qu’elle ne sert réellement; on se met souvent sottement en habit pour ne pas mieux sauter que si on était en blouse: «Rien n’est moins favorable à qui veut plaire, que de laisser attendre beaucoup de lui (Cicéron).»—On a écrit de l’orateur Curion que, lorsqu’il se proposait de sectionner son discours en trois ou quatre parties et qu’il avait déterminé le nombre des thèses et des raisons qu’il voulait exposer, il lui arrivait fréquemment soit d’en oublier, soit d’en ajouter une ou deux. Je me suis toujours appliqué à éviter de tomber dans cet inconvénient; je déteste tout engagement et tout parti pris, non seulement par défiance de ma mémoire, mais parce que cela sent trop l’homme du métier: «Ce qu’il y a de plus simple est ce qui convient aux guerriers (Ovide).» Du reste, c’est fini; je me suis promis de ne plus désormais m’imposer la charge de prendre la parole dans un lieu où l’on parle avec solennité; parce que lire un discours écrit, outre que c’est très sot, cela est très désavantageux pour ceux qui, par nature, sont toujours disposés à agir; et quant à me risquer à improviser en me fiant à mon inspiration, je le ferai moins encore, elle est chez moi trop vague et trop lourde et ne saurait fournir les reparties soudaines, parfois importantes, que la nécessité commande.
Il fait volontiers des additions à son livre, mais ne corrige pas; les changements qu’il pourrait y introduire ne vaudraient peut-être pas ce qui y est.—Fais encore, ô lecteur, bon accueil à cette édition de mes Essais, ainsi qu’à cette troisième addition aux études que j’ai déjà publiées sur moi-même; j’ajoute, mais ne corrige pas. D’abord, parce que je trouve que celui qui a offert un ouvrage en vente au public, n’en a plus le droit; qu’il dise mieux, s’il le peut, dans un autre travail, mais qu’il ne déprécie pas la valeur de celui qu’il a déjà vendu. De ceux qui en agissent ainsi, il ne faudrait rien acheter qu’après leur mort. Avant de se produire, qu’ils réfléchissent bien à ce qu’ils écrivent; qu’est-ce qui les presse? Mon livre est toujours le même, sauf qu’à mesure qu’il en est fait un nouveau tirage, pour que celui qui veut l’acquérir ne s’en retourne pas les mains absolument vides, je me permets, puisque ce n’est qu’une marqueterie mal jointe, d’y intercaler quelques ornements supplémentaires. Ce surcroît ne modifie pas l’édition primitive, il ne fait que donner une valeur particulière à chacune de celles qui suivent, ce qui est une petite subtilité peut-être un peu prétentieuse de ma part; il peut toutefois en résulter des interversions au point de vue chronologique, mes historiettes prenant place dans le cours de l’ouvrage, selon leur opportunité et pas toujours suivant les dates des faits auxquels elles ont trait.
Une seconde raison qui fait que je ne corrige pas, c’est qu’en ce qui me regarde, je crains de perdre au change. Mon entendement ne va pas toujours progressant, il va aussi à reculons; je ne me défie guère moins des fantaisies qui me passent par la tête en second ou en troisième lieu que de celles qui sont écloses les premières, des fantaisies présentes que des fantaisies passées; souvent nous nous 413 rectifions aussi sottement que nous corrigeons les autres. J’ai vieilli de plusieurs années depuis mes premières publications qui ont vu jour en mil cinq cent quatre vingts, mais je doute m’être assagi de si peu que ce soit. Moi à cette heure et moi autrefois, sommes réellement deux; quel est le meilleur? en vérité, je ne saurais le dire. Il ferait bon de vieillir, si nous ne cessions d’aller nous améliorant; mais nous n’avançons qu’à la façon des ivrognes, en titubant, en éprouvant des vertiges, sans direction définie, ou encore, semblables à des * joncs que l’air agite au gré de ses caprices.—Antiochus avait, dans ses écrits, pris vigoureusement parti pour l’Académie; sur ses vieux ans, il se rangea du parti contraire; quel que soit celui que j’aurais embrassé, n’eût-ce pas été suivre Antiochus? Après avoir établi que nous devons douter de toutes les opinions humaines, vouloir établir que nous devons les tenir pour certaines, n’est-ce pas affirmer le doute et non la certitude, et donner à penser que si notre vie devait se prolonger, notre imagination, toujours en proie à de nouvelles agitations, en deviendrait non pas meilleure, mais différente?
Il s’en rapporte uniquement à ses éditeurs pour l’orthographe et la ponctuation; des fautes d’autre nature peuvent être relevées dans le texte; le lecteur, qui est au fait de ses idées, les rectifiera de lui-même.—La faveur du public, en me rassurant plus que je n’espérais, m’a donné plus de hardiesse; mais ce que je crains le plus c’est de rassasier; je préférerais en être encore aux premières publications de mes Essais, que de lasser en les multipliant, comme a fait un savant de mon époque. La louange est toujours agréable de qui elle vienne et pour quelque raison que ce soit; encore faut-il, pour qu’elle plaise à juste titre, savoir quelle en est la cause; les imperfections elles-mêmes peuvent y donner lieu. L’estime du vulgaire n’est d’ordinaire pas heureuse dans les choix sur lesquels elle se porte, et je me trompe bien si, en ces temps-ci, les plus mauvais écrits ne sont pas ceux auxquels va de préférence la faveur populaire. Aussi je rends grâce aux honnêtes gens qui daignent prendre en bonne part mes faibles efforts. Il n’est pas d’ouvrage où les fautes que peut présenter un texte, ressortent autant que dans ceux qui traitent de sujets qui n’intéressent pas par eux-mêmes. Ne t’en prends pas à moi, lecteur, de celles qui se sont glissées dans celui-ci, par la fantaisie ou l’inattention d’autres que moi; chacun, par les mains de qui il passe, chaque ouvrier y apporte les siennes. Je ne me mêle ni d’orthographe (j’ai seulement recommandé de se conformer à l’orthographe ancienne), ni de ponctuation, n’étant expert ni en l’une, ni en l’autre. Là où le sens est absolument incompréhensible, je ne m’en mets pas en peine, on ne risque pas de me l’imputer; mais quand il n’est qu’altéré, ce qui arrive souvent, et qu’on me fait dire ce que je ne dis pas, on me fait grand tort; toutefois, si la phrase est trop en contradiction avec ce que l’on peut attendre de moi, un honnête homme ne saurait l’accepter comme étant mienne. 415 Celui qui sait combien peu j’aime le travail et combien je suis attaché à ma manière de faire, croira aisément que je dicterais plus volontiers à nouveau autant de fois des Essais, que de m’assujettir pour chaque nouvelle édition à les relire, pour y apporter des corrections qu’un enfant est à même de faire.
Placé au foyer des guerres civiles, il a beaucoup à en souffrir, toutefois jusqu’ici il a échappé au pillage; malheureusement, ce n’est pas aux lois qu’il en est redevable et il regrette d’en avoir obligation à autrui.—Je disais plus haut que, vivant au centre des guerres civiles, au plus profond de la mine qui fournit ce métal nouveau, pire que l’airain et le fer, dont notre âge devrait porter le nom, non seulement cela me prive de tous rapports d’intimité avec des gens ayant d’autres mœurs que moi, unis entre eux par leurs opinions religieuses qui sont autres que les miennes et, chez eux, priment toute autre cause de rapprochement, mais encore je ne suis pas sans courir de risques au milieu de cette masse d’individus à qui tout est permis et dont la plupart sont, vis-à-vis de la justice, dans une situation qui ne saurait être pire; d’où une licence dépassant toutes bornes. Lorsque j’envisage les conditions particulières dans lesquelles je me trouve, je ne vois personne de mon parti auquel la défense des lois coûte plus qu’à moi, autant, comme disent les hommes de loi, par les profits que je ne réalise pas, que par les pertes que j’éprouve; et tels font les braves, par le zèle et le rigorisme qu’ils déploient, qui, tout bien compté, font beaucoup moins que moi. A tous moments, dans ma maison qui est facilement abordable et dont l’accès est libre (car je ne me suis jamais laissé aller à la transformer en forteresse, préférant de beaucoup voir la guerre se transporter le plus loin possible de mon voisinage), chacun trouve hospitalité; cela lui a valu d’être vue favorablement par tous, et me préserve d’être violenté chez moi comme Job sur son fumier. Je considère comme un fait extraordinaire et qui mérite d’être cité qu’elle soit encore vierge de sang et de pillage, depuis tant de temps que dure cet orage, au milieu de tant d’agitations et de changements qui se produisent autour d’elle; car, à dire vrai, s’il était possible à un homme de mon caractère d’échapper à toute vexation, en vivant dans un milieu où tout le monde aurait eu les mêmes opinions et n’en changerait pas, les incursions et invasions des divers partis, les alternatives et les vicissitudes de la fortune autour de moi ont, jusqu’à présent, plutôt exaspéré que découragé le pays et m’exposent à des dangers et à des difficultés qu’il m’est impossible d’éviter.
J’y échappe, mais je regrette que ce soit plus du fait de ma bonne fortune et aussi de ma prudence que de la justice; je regrette de ne point me trouver protégé par les lois et d’être obligé de me placer sous une autre sauvegarde. En l’état, je vis plus d’à moitié par la faveur d’autrui, ce qui m’est une dure obligation. Je ne voudrais devoir ma sûreté ni à la bonté, ni à la bienveillance des grands qui tolèrent mon attachement à la légalité et à la liberté; non 417 plus qu’à la facilité des mœurs de mes ancêtres et des miennes; qu’arriverait-il en effet, si j’étais autre? Ma conduite et ma franchise dans mes rapports avec mes voisins leur créent, ainsi qu’à ma parenté, des obligations à mon égard; il est cruel qu’il leur soit loisible de satisfaire à ces obligations en consentant à me laisser vivre, et qu’ils puissent dire: «La liberté de continuer la célébration du service divin dans la chapelle de sa maison, alors que nous avons rendu désertes * et ruiné toutes les églises d’alentour, est une concession de notre part; nous lui concédons encore l’usage de ses biens et de la vie en retour de ce que lui-même, à l’occasion, veille à la conservation de nos femmes et de nos bœufs.» Voilà longtemps en effet que, dans ma famille, nous méritons ces mêmes louanges qu’à Athènes, on donnait à Lycurgue qui était le dépositaire et le gardien habituel des bourses de ses concitoyens.—Or, j’estime que la vie est pour nous un droit que nous tenons d’en haut, et qu’elle ne saurait être ni une récompense, ni une grâce qu’on nous octroie; que de nobles gens ont préféré la perdre, que d’en être redevables à autrui! Je cherche à me soustraire à toute obligation quelle qu’elle soit, mais surtout à celles qui peuvent résulter d’un devoir d’honneur; je ne trouve rien de si onéreux que ce qui me vient par don, et lie ma volonté par la gratitude à laquelle cela m’oblige. J’accepte plus volontiers les services qui se vendent; je le crois bien: pour ceux-ci je n’ai que de l’argent à donner, pour les autres je me donne moi-même.
Il se considère comme absolument lié par ses engagements; la reconnaissance lui est lourde, aussi tient-il pour avantageux de se trouver délivré, par leurs mauvais procédés à son égard, de son attachement envers certaines personnes.—L’honnêteté me lie, ce me semble, bien plus étroitement et plus sûrement que ne le fait la contrainte légale; les obligations contractées devant notaire, me pèsent moins que celles contractées par moi-même: n’est-il pas rationnel, en effet, que ma conscience se trouve d’autant plus engagée qu’on s’est tout simplement fié à elle? Là où elle n’est pas intéressée, elle ne doit rien, puisque ce n’est pas à elle que l’on s’est adressé; qu’on recoure à la confiance sur laquelle on a compté, aux assurances qu’on a prises en dehors de moi. Il me coûterait beaucoup moins de franchir pour m’évader les murs d’une prison, et de me mettre en opposition avec les lois, que de violer ma parole. Je suis scrupuleux observateur de mes promesses, au point d’en être superstitieux; aussi, quand je le puis, je n’en fais guère, à quelque propos que ce soit, que de vagues et de conditionnelles. Celles mêmes qui sont sans importance bénéficient de la règle que je me suis imposée; elles sont pour moi un tourment, et ce m’est un soulagement de leur donner satisfaction. De même, quand j’ai en tête quelque projet que j’ai formé et ai toute liberté à cet égard; si j’en dis l’objet, je considère que cela seul me constitue une obligation de l’accomplir, et qu’en faire part à autrui, c’est prendre un engagement 419 envers moi-même; il me semble que dire, c’est promettre; aussi suis-je très réservé pour communiquer ce que je me propose de faire.—Les condamnations portées par moi sur moi-même me sont plus sensibles et plus dures que si elles émanaient de juges qui ne peuvent sur moi que ce qu’ils peuvent sur tout le monde; l’étreinte de ma conscience a une action autrement puissante et plus sévère.—Je satisferais mollement à des devoirs auxquels on me contraindrait, si même je m’y soumettais: «L’acte le plus juste n’est juste qu’autant qu’il est volontaire (Cicéron)»; si la liberté ne lui donne du lustre, il manque de grâce et ne fait pas honneur. «Je ne fais rien de bonne grâce si ma volonté n’y a part (Térence)»; et elle se désintéresse en partie, lorsque ce dont il s’agit m’est imposé par la nécessité, «parce que dans les choses qu’une autorité supérieure ordonne, on sait plus de gré à celui qui commande qu’à celui qui exécute (Valère Maxime)». J’en connais qui poussent au point d’être injustes, ce sentiment de ne pas vouloir paraître céder à la contrainte; ils disent qu’ils donnent quand ils ne font que rendre, qu’ils prêtent quand ils ne font que payer; et envers ceux auxquels ils sont tenus de faire le bien, ils s’en acquittent le plus chichement qu’ils peuvent. Je ne vais pas jusque-là, mais peu s’en faut.
J’aime tant à être déchargé et délié de toute obligation, que j’ai parfois considéré comme avantageuses les ingratitudes, offenses et indignités dont ont pu se rendre coupables à mon égard ceux de qui, soit naturellement, soit par accident, j’avais reçu quelques services d’ami; prenant occasion de leur faute, pour me donner quittance à moi-même et me soustraire à l’acquittement de ma dette. Tout en continuant à leur rendre extérieurement ce que commandent les plus stricts devoirs de société, je trouve cependant grand bénéfice à ne faire que parce que je le dois, ce qu’auparavant je faisais par affection, et à me soulager un peu de la sorte de la part d’attention et de sollicitude qu’intérieurement y eût prise ma volonté, qui, chez moi, quand j’y cède, est trop précipitée et trop impérieuse, du moins pour un homme qui ne veut on quoi que ce soit subir de pression: «Il est prudent de retenir, comme on le fait d’un char dans les courses, les élans trop fougueux de la bienveillance (Cicéron).» Cette atténuation de mon premier mouvement me console des imperfections de ceux qui me touchent; je déplore qu’ils en vaillent moins, mais, par contre, j’y gagne de leur être moins attaché et d’être moins engagé vis-à-vis d’eux. J’approuve celui qui aime moins son enfant parce qu’il est teigneux ou bossu, et non seulement quand il est méchant, mais encore lorsqu’il est mal constitué et difforme (Dieu lui-même en a, par là, déprécié la valeur naturelle), sous condition toutefois d’apporter, dans cette diminution d’affection, de la modération et une exacte justice. La parenté, à mes yeux, n’atténue pas les défauts; elle les aggrave plutôt.
Il ne doit rien aux grands et ne leur demande que de ne pas s’occuper de lui; il s’applique à tout supporter, à 421 se passer de tout; il ne veut avoir d’obligations envers personne, et, s’il ne peut l’éviter, souhaite que ce soit pour toute autre chose qu’obtenir protection contre les fureurs de la guerre civile.—Après tout, par la façon dont j’entends que doivent se pratiquer la bienfaisance et la reconnaissance, qui sont choses bien délicates et d’usage si répandu, je ne vois personne qui, jusqu’à cette heure, soit plus libre et moins tenu par ses obligations que je ne le suis. Ce que je dois, je le dois simplement en raison de celles que nous tenons de la nature et que nous avons tous; en dehors d’elles, personne n’est plus indépendant: «Les présents des grands me sont inconnus (Virgile).» Les princes me donnent beaucoup s’ils ne m’ôtent rien; ils me font suffisamment de bien quand ils ne me font pas de mal: c’est tout ce que je leur demande. Oh! combien je suis reconnaissant envers Dieu, de ce qu’il lui a plu que je reçoive directement de sa grâce tout ce que je possède et n’aie de dette que vis-à-vis de lui! Combien je supplie instamment sa sainte miséricorde que jamais je ne doive à personne de grands remerciements pour des choses essentielles! Bénie soit mon indépendance, qui m’a accompagné si avant dans la vie; puisse-t-elle se continuer jusqu’au bout! Je m’efforce de n’avoir un besoin absolu de personne: «Toutes mes espérances sont en moi (Térence)»; cela est possible à tout le monde, mais surtout à ceux que Dieu a mis à l’abri des nécessités urgentes que la nature elle-même nous impose. C’est une situation bien digne de pitié et pleine de hasards que de dépendre d’autrui; nous ne pouvons toujours l’éviter; nous ne sommes pas pour cela assez assurés de nous-mêmes, ce qui serait pourtant ce qu’il y aurait de plus sage, de plus adroit et de plus sûr. Je n’ai rien que moi, qui soit à moi, et la possession que j’en ai est même en partie défectueuse et empruntée. Je m’applique à avoir du courage, ce qui est la meilleure des garanties; et aussi à me ménager un mode d’existence qui puisse me rendre la vie supportable si, d’autre part, tout venait à me manquer. Hippias d’Élis ne se pourvut pas seulement de science pour, au sein des Muses, pouvoir au besoin demeurer agréablement sans autre compagnie, et de philosophie pour apprendre à son âme, si le sort l’ordonnait, à se contenter par elle-même et se passer courageusement des commodités de la vie qui ont leur source en dehors de nous; il fut encore soucieux d’apprendre à faire sa cuisine, sa barbe, ses robes, sa chaussure, ses hauts-de-chausse pour, autant qu’il se pouvait, ne faire fond que sur lui-même et se soustraire à toute assistance étrangère.—On jouit bien plus librement et plus gaîment des biens qui nous arrivent occasionnellement et pour un temps limité, quand cette jouissance n’est pas pour nous d’obligation, qu’elle n’est pas imposée par le besoin et que, de sa propre volonté et de sa bonne fortune, on a la force et les moyens de s’en passer. Je me connais bien, et m’imagine malaisément qu’une libéralité si généreuse fût-elle de quelqu’un à mon égard, qu’une hospitalité aussi 423 franche et désintéressée qu’elle puisse être, qui me seraient offertes, me produisissent d’autre effet que celui d’une disgrâce, d’une tyrannie, auxquelles se joindraient les reproches que je m’adresserais si, pressé par la nécessité, j’avais été amené à les accepter.—Donner est le signe distinctif des gens ambitieux et qui ont des prérogatives; de même qu’accepter est une marque de soumission; témoin l’injurieux refus que fit Bajazet des présents que Tamerlan lui envoyait, ce qui détermina un conflit entre eux. L’offre de cadeaux faite par l’empereur Soliman à l’empereur de Calicut, indigna ce dernier à tel point que non seulement il les refusa durement, disant que ni lui ni ses prédécesseurs n’avaient coutume de recevoir et qu’il était au contraire de tradition chez eux de donner, mais que, de plus, il fit jeter dans un cachot les ambassadeurs qui lui avaient été envoyés à cet effet.—Quand, dit Aristote, Thétis flatte Jupiter, que les Lacédémoniens flattent les Athéniens, ils ne vont pas leur rappeler le bien qu’eux-mêmes leur ont fait, ce qui est toujours déplaisant à entendre; ce qu’ils leur rappellent, ce sont les bienfaits qu’ils en ont reçus.—Les gens que je vois recourir si familièrement à n’importe qui, et contracter des engagements avec le premier venu, ne le feraient pas, s’ils savouraient comme moi la douceur d’une liberté absolue, et si les obligations qu’ils contractent de la sorte, leur pesaient autant qu’il convient à un sage; on paie parfois ces engagements, on ne s’en dégage jamais. Cruel esclavage pour qui aime la liberté et y avoir les coudées franches dans tous les sens. Mes connaissances, tant celles qui, dans l’échelle sociale, sont au-dessus de moi que celles qui sont au-dessous, savent si jamais ils ont vu quelqu’un moins solliciter, requérir, supplier que je ne fais et être moins à charge à autrui que je ne suis. Il n’est pas étonnant que je sois ainsi, si différent sur ce point de tout ce qu’on peut voir à notre époque, alors que tant de particularités de mon caractère y contribuent: un peu de fierté naturelle, l’impatience que me cause un refus, le peu d’étendue de mes désirs et de mes projets, mon inhabileté en toutes sortes d’affaires, enfin mes qualités favorites, l’oisiveté et l’indépendante; tout cela fait que j’éprouve une haine mortelle à dépendre de quelqu’un autre que moi, comme à avoir sous ma dépendance quelqu’un qui ne soit pas moi. Je fais les plus grands efforts pour me passer de tout concours étranger avant de me déterminer à recourir à la bienfaisance d’autrui, en quelque occasion ou besoin, pressant ou non, que ce soit.—Mes amis m’importunent étrangement quand ils me demandent de solliciter * en leur faveur auprès d’un tiers; il m’en coûte à peu près autant, je crois, de libérer quelqu’un qui me doit en usant de lui, que de m’engager moi-même envers quelqu’un qui ne me doit rien. Ceci mis à part, et aussi étant établi qu’on ne me demande rien qui exige des démarches et me cause des soucis (je suis en guerre ouverte avec tout ce qui nécessite que je me donne la moindre peine), je suis d’un abord facile et prêt à venir en aide aux besoins 425 de chacun. Mais j’ai plus encore fui recevoir, que je n’ai cherché à donner; ne pas recevoir est du reste, au dire d’Aristote, bien plus aisé à pratiquer. Ma bonne fortune ne m’a guère permis de faire un peu de bien aux autres; mais le peu que j’ai pu faire, est tombé sur des gens qui m’en ont su peu de gré. Si elle m’eût fait naître pour occuper un certain rang parmi les hommes, j’eusse souhaité me faire aimer, plutôt que craindre ou admirer; ou plus effrontément, j’aurais autant regardé à plaire qu’à tirer profit. Cyrus, par l’organe d’un très bon capitaine, philosophe encore meilleur, estime très sagement que sa bonté et ses bienfaits sont d’un prix autrement grand que sa vaillance et les conquêtes qu’il doit à la guerre. De même le premier Scipion, partout où il veut donner bonne opinion de lui-même, place son aménité et son humanité au-dessus de sa hardiesse et de ses victoires, et a toujours à la bouche ce mot qui lui fait tant d’honneur, «qu’il a donné lieu de l’aimer autant à ses ennemis qu’à ses amis». Je dis donc que s’il faut quand même avoir des obligations à autrui, il serait plus juste qu’elles aient des causes autres que celles dont je parle, qui découlent de nos malheureuses guerres civiles, et qu’elles me fassent débiteur d’une dette moins lourde que n’est celle que constitue ma conservation totale, corps et biens; cela m’accable.
Ces guerres font qu’il vit dans des transes continues; c’est là une des causes qui font qu’il voyage tant, bien qu’il ne soit pas assuré de trouver mieux.—Je me suis couché mille fois chez moi, m’imaginant que, dans la nuit même, je serais victime d’une perfidie quelconque et qu’on m’assommerait, demandant à la fortune que ce fût sans que j’en éprouve d’effroi et qu’on ne me fît pas languir. Que de fois, après avoir dit mon Pater, ne me suis-je pas écrié: «Ces terres cultivées vont-elles donc devenir la proie d’un soldat barbare (Virgile)?» A cela, pas de remède! c’est ici le lieu où nous sommes nés, la plupart de mes ancêtres et moi; ils l’ont aimé et y ont attaché leur nom. Nous nous endurcissons à tout ce à quoi nous nous accoutumons et, dans une condition aussi misérable qu’est la nôtre, l’habitude est un présent bien précieux de la nature; elle endort notre sensibilité et nous préserve des souffrances que nous causeraient certains maux.—Les guerres civiles ont cela de pire que les autres, c’est que tous nous sommes à faire le guet dans nos maisons: «Qu’il est malheureux d’avoir à protéger sa vie par des portes et des murailles, et d’être à peine en sûreté dans sa propre maison (Ovide)!» C’est en être réduit à une grande extrémité que d’être menacé jusque chez soi et au milieu des siens. La région où je demeure est toujours exposée la première à nos troubles et la dernière à en être débarrassée; la paix n’y est jamais complète: «Même en paix, nous ne cessons de redouter la guerre (Ovide).—Toutes les fois que la fortune a rompu la paix, c’est ici le chemin de la guerre; pourquoi le sort ne m’a-t-il pas donné plutôt des demeures errantes dans les climats brûlants, ou sous l’Ourse glacée (Lucain)?» Parfois je trouve moyen, par la nonchalance et la lâcheté avec laquelle je les 427 envisage, de me rassurer contre ces préoccupations qui, quelquefois aussi, nous portent à avoir de la résolution.—Il m’arrive souvent de me figurer, non sans un certain plaisir, que je suis sous le coup de dangers mortels et de m’y résigner; alors, tête baissée, sans plus y réfléchir ni entrer dans d’autres considérations, je me plonge stupidement, en imagination, dans la mort comme je me précipiterais dans un abîme silencieux et obscur qui m’engloutirait du premier coup, et instantanément s’empare de moi un lourd sommeil, sous l’effet duquel je demeure insensible et inerte et qui m’étouffe. La délivrance que j’en espère, fait que la perspective d’une mort courte et violente me console plus que * ne me trouble la crainte que j’en ai. La vie n’en vaut pas mieux, dit-on, quand elle est de longue durée; d’autre part, la mort est d’autant meilleure qu’elle est moins longue. Je ne m’épouvante pas tant d’être mort, que du temps que je mettrai à mourir. Je me replie sur moi-même et me tiens coi devant cet orage qui, dans une de ses rafales rapides et dont je m’apercevrai à peine, doit m’aveugler et m’emporter avec furie. Encore s’il advenait ce qui, au dire de certains jardiniers, arrive aux roses et aux violettes, qui naissent plus odorantes quand elles poussent auprès d’ails et d’oignons, lesquels sucent et attirent à eux toute la mauvaise odeur qui peut se trouver dans la terre, et que ces natures dépravées humassent le venin de l’air et de la région où je vis, les rendant par leur voisinage meilleurs et plus purs, je ne perdrais pas tout! Mais il n’en est pas ainsi; cependant, il peut en résulter que la bonté apparaisse plus belle et plus attrayante en devenant plus rare, et que, dans ce milieu qui lui est si contraire et qui est si mêlé, l’honnêteté surgisse, enflammée par l’opposition qu’elle rencontre et la gloire qu’elle y trouverait. Les voleurs, dans leur amabilité, ne m’en veulent pas d’une façon particulière; je ne leur en veux pas davantage, il me faudrait en vouloir à trop de gens. Les robes les plus diverses abritent mêmes consciences; la cruauté, la déloyauté, le vol y sont tout pareils, et d’autant plus nuisibles qu’ils s’exercent plus lâchement, plus sûrement, à la dérobée, sous l’ombre des lois. Je hais moins l’injustice avouée que celle qui a recours à la trahison, celle engendrée par les désordres de la guerre que celle qui se produit en paix et revêt des formes judiciaires. La fièvre qui nous tient, s’est déclarée dans un corps dont elle n’a guère empiré l’état; le feu y couvait, la flamme n’a fait qu’éclater; il y a plus de bruit, le mal n’est pas beaucoup plus grand.—A ceux qui me demandent pourquoi je voyage tant, je réponds d’ordinaire que je sais bien ce que je fuis, mais non ce que je vais trouver; et lorsqu’on me dit qu’à l’étranger l’état sanitaire peut être aussi mauvais, que les mœurs n’y * valent pas mieux que chez nous, je réponds d’abord que c’est difficile, «tant le crime s’est multiplié parmi nous (Virgile)»; puis, qu’il y a toujours profit à changer une situation mauvaise contre une autre qui est incertaine, et que nous ne devons pas ressentir les maux qui pèsent sur autrui au même degré que les nôtres.
429
Il aime Paris, n’est français que par cette capitale; puisse-t-elle ne pas être en proie aux dissensions intestines, ce serait sa ruine.—Je ne veux pas oublier que, si courroucé que je puisse être contre la France, je ne cesse de regarder Paris d’un bon œil. Paris a mon cœur depuis mon enfance, et j’éprouve à son sujet ce qui arrive de tout ce qui est excellent; c’est que plus j’ai vu, depuis, d’autres belles villes, plus la beauté de celle-ci a grandi et gagné dans mon affection. Je l’aime pour elle-même et l’aime plus, telle qu’elle est en temps habituel, que lorsque des fêtes viennent ajouter à son éclat; je l’aime tendrement jusque dans ses imperfections et ses taches; je ne suis français que par cette grande cité, si peuplée, si heureusement située; mais surtout, grande et incomparable par le nombre et la variété des facilités de toute nature qu’on y trouve; elle est la gloire de la France et l’un des plus nobles ornements du monde. Dieu veuille en chasser au loin ce qui nous divise! Non livrée aux partis, unie, elle est à l’abri de toute violence; mais je l’en avertis, ce qui peut lui arriver de pis serait qu’elle soit en butte aux factions; je ne crains pour elle qu’elle-même, mais crains malheureusement pour elle autant que pour toute autre partie du royaume. Tant qu’elle demeurera indemne, je ne manquerai pas de lieu de retraite où je puisse aller finir mes jours, et de nature à ne m’en faire regretter aucun autre.
Il regarde tous les hommes, à quelque nation qu’ils appartiennent, comme ses compatriotes; le monde entier est pour lui une patrie.—Ce n’est pas parce que Socrate l’a dit, mais parce qu’en vérité je pense de la sorte, tous les hommes sont pour moi des compatriotes; et ce sentiment, je suis même porté à l’exagérer; j’embrasse un Polonais comme je ferais d’un Français, faisant passer le lien qui unit les individus d’une même nation, après celui qui nous est commun avec tous les habitants de l’univers. Je ne suis guère entiché de la douceur de l’air natal; les connaissances nouvelles que j’ai faites de moi-même, me semblent bien valoir les connaissances banales et d’occasion résultant du voisinage; les amitiés franches que nous contractons l’emportent d’ordinaire sur celles que nous devons à une communauté de climat ou de sang. La nature nous a mis au monde libres de tout engagement, et nous nous emprisonnons de nous-mêmes dans des limites restreintes comme les rois de Perse qui se faisaient une obligation de ne jamais boire que de l’eau du fleuve Choaspe, et renonçaient sottement au droit qu’ils avaient d’user de toute autre eau, semblant, en ce qui les touchait, considérer comme à sec tout le reste du monde.—Sur sa fin, Socrate estimait qu’une sentence d’exil était pire qu’une sentence de mort; je ne suis pas de son avis et ne tomberai jamais tellement en enfance, ni ne serai si étroitement inféodé à mon pays, que je me range à cette idée. Ces vies, dignes de créatures célestes, ont des manifestations que j’estime plus que je ne les aime; elles en ont aussi de si hautes et de si extraordinaires, que mon estime même ne peut atteindre à pareille 431 élévation, d’autant que je n’arrive seulement pas à les concevoir. Ce sentiment, de la part de Socrate, ne témoigne-t-il pas d’une tendresse excessive chez un homme qui considérait l’univers comme sa patrie? il est vrai qu’il n’aimait pas les voyages et n’avait guère mis le pied hors de l’Attique. Que dire aussi de ne pas vouloir que ses amis rachètent sa vie de leurs deniers, et de son refus, pour ne pas désobéir aux lois à une époque où leur corruption était si grande, de se prêter à l’exécution d’un complot qui l’eût délivré de sa prison? Ces exemples, qu’il nous donne, rentrent à mon sens dans cette première catégorie de sentiments que j’estime plus que je ne les partage. Quant à ceux de la seconde catégorie, d’une élévation telle que mon estime n’arrive pas à leur hauteur, il en est des exemples que je pourrais citer de lui; et, dans le nombre, il s’en trouve d’une vertu si rare, qu’ils dépassent ce dont je suis capable; quelques-uns même outrepassent ce que mon jugement peut admettre.
Avantages que Montaigne trouve à voyager; il demeure sans peine huit à dix heures consécutives à cheval et, sauf les chaleurs excessives, ne redoute aucune intempérie.—Outre ces raisons, voyager me semble encore un exercice profitable, parce que l’âme y est continuellement conviée à remarquer des choses nouvelles qu’elle ne connaît pas; et, ainsi que je l’ai dit souvent, je ne sais pas de meilleure école pour la dresser, que de lui mettre sans cesse sous les yeux la si grande diversité d’existence, d’idées, d’usages qui se rencontrent et de lui faire goûter cette perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps, lui, n’y est ni oisif, ni épuisé par le travail; cette agitation modérée le tient en haleine. Tout tourmenté que je suis de coliques, je reste à cheval huit à dix heures sans en descendre et sans que cela m’ennuie, «au delà des forces et de la santé d’un vieillard (Virgile)»; aucun temps ne m’est contraire, sauf la chaleur accablante d’un soleil torride, car je n’use pas des ombrelles dont, depuis les anciens Romains, on se sert en Italie et qui fatiguent plus les bras qu’elles ne soulagent la tête. Je voudrais bien connaître le procédé, employé dans l’antiquité par les Perses lorsque le luxe a commencé à s’introduire chez eux et que mentionne Xénophon, pour se ménager à leur convenance de l’air frais et de l’ombre. J’aime la pluie et la boue autant qu’un canard. Je suis insensible aux changements climatériques et atmosphériques, et qu’il fasse beau ou non, c’est tout un pour moi; je ne souffre que des variations qui se produisent dans mon individu et elles sont moins fréquentes quand je voyage.—Je suis assez difficile à mettre en mouvement; j’hésite autant devant un petit déplacement que pour un grand, à faire mes préparatifs de départ pour une journée d’absence pour aller visiter un voisin que pour un vrai voyage; mais, une fois en route, je vais aussi longtemps qu’on veut.—J’ai l’habitude de faire l’étape, comme font les Espagnols, tout d’une traite et mes journées aussi longues qu’elles peuvent raisonnablement 433 l’être. Pendant les fortes chaleurs, je marche de nuit, du soleil couchant au soleil levant. L’autre façon qui, afin de se restaurer, consiste à s’arrêter en route pour dîner comme on peut et à la hâte, est incommode, surtout pendant les jours courts. Mes chevaux se trouvent beaucoup mieux de mon système; jamais aucun, qui a pu faire avec moi la première journée, ne m’a laissé en route. Je les fais boire partout, pourvu qu’il reste assez de chemin à faire, pour qu’ils aient le temps de digérer leur eau. Ma paresse à me lever permet aux gens de ma suite de dîner à leur aise avant de partir; pour moi, il n’est jamais trop tard pour manger, l’appétit me vient en mangeant et jamais autrement, je n’ai faim que lorsque je me mets à table.
On le blâme de ce que, vieux et marié, il quitte sa maison pour voyager; n’y laisse-t-il pas une gardienne fidèle qui y maintient l’ordre? Sa femme n’est pas de celles qui vivent dans l’oisiveté.—Quelques personnes me reprochent de me plaire encore à voyager bien que je sois marié et vieux. Elles ont tort; il vaut mieux ne quitter sa maison que lorsqu’on l’a mise sur le pied de pouvoir se passer de nous, et qu’on y a établi un ordre qui ne court pas risque de se déranger. Il est bien autrement imprudent de s’en éloigner quand on n’a pas à y laisser une garde aussi sûre qu’il m’est donné de le faire, sur laquelle on puisse autant compter qu’elle pourvoira à tout ce qui vous est nécessaire.
La science, l’occupation les plus honorables et les plus utiles à une mère de famille, sont celles du ménage. J’en vois qui sont avares et fort peu bonnes ménagères; c’est leur qualité maîtresse qui prime toute autre, comme étant l’unique apport capable de ruiner ou de sauver nos maisons. Quoi qu’on puisse dire, l’économie domestique, d’après l’expérience que j’en ai, est la vertu que je place chez une femme mariée au-dessus de n’importe quelle autre. En voyageant, je mets ma femme à même de l’exercer, lui laissant en main durant mon absence toute l’administration de mes biens. Je vois avec dépit le mari, dans quelques intérieurs, revenant vers midi, maussade, soucieux du tracas des affaires, et trouvant Madame dans son cabinet de toilette, encore occupée à se coiffer et à s’attifer; cela est bon pour les reines, et encore je ne sais trop. Il est ridicule et injuste que notre sueur et notre travail servent à entretenir l’oisiveté de nos femmes. Je ne crois pas que personne ait des affaires moins embarrassées que moi, mes biens me donnent toute tranquillité et ne sont grevés d’aucune dette; mais si le mari apporte les revenus, il est dans la nature même des choses que la femme dirige leur mise en œuvre.
On objecte que c’est témoigner peu d’affection à sa femme que de s’en éloigner, mais l’absence momentanée aiguise au contraire le désir de se revoir; on n’aime pas moins un ami absent que présent.—On dit que l’absence peut influer sur les devoirs qu’impose l’affection maritale, je ne le crois 435 pas; ces devoirs peuvent au contraire se ressentir de rapports trop continus, trop d’assiduités blessent. Toute femme qui nous est étrangère ne nous paraît-elle pas une honnête femme? et chacun ne sait-il pas par expérience que se voir continuellement, ne peut procurer un plaisir égal à celui que l’on ressent quand on se quitte et qu’on se rejoint par intervalles? Ces interruptions ravivent en moi l’amour que je porte aux miens, et me fait paraître plus doux le temps que je passe chez moi; le foyer domestique succédant au voyage et réciproquement, je n’en suis que plus dispos pour passer de l’un à l’autre. Je sais que l’amitié a les bras assez longs pour se maintenir et se joindre d’un coin du monde à l’autre; surtout celle de mari à femme, où il y a un continuel échange de services qui en réveillent l’obligation et le souvenir. Les Stoïciens ne disent-ils pas qu’il y a une si grande union et liaison intime entre les sages, que si l’un d’eux dîne en France, son compagnon, qui est en Égypte, s’en trouve rassasié; et qu’il suffit à l’un d’eux d’étendre le doigt n’importe où, pour que tous les sages sur la surface de la terre en ressentent assistance? La jouissance et la possession dépendent beaucoup de l’imagination, qui toujours embrasse avec plus d’ardeur et de persistance ce qu’elle recherche que ce que nous touchons. Reportez-vous à vos amusements de chaque jour, vous trouverez que c’est surtout quand il est là que vous pensez le moins à votre ami; sa présence fait que votre attention se relâche et donne à votre pensée loisir de s’absenter à toute heure et à toute occasion.—Hors de chez moi, à Rome, je surveille et dirige ma maison et ce qui m’y intéresse; je vois s’élever et démolir mes murailles, croître et décroître mes arbres et mes rentes, à deux doigts près, comme lorsque j’y suis: «J’ai constamment sous les yeux ma maison et jusqu’à la moindre disposition des lieux que j’ai quittés (d’après Ovide).» Si nous ne jouissions que de ce que nous touchons, adieu nos écus quand ils sont dans nos coffres, et nos enfants quand ils sont à la chasse. Les voulons-nous plus près de nous? s’ils sont au jardin, estimez-vous que ce soit loin? s’ils sont à une demi-journée, qu’en dites-vous? dix lieues, est-ce loin ou près? si c’est près, qu’est-ce, suivant vous, que onze, douze, treize lieues? et ainsi de proche en proche. Je serais d’avis que la femme à même de dire à son mari: «A tant de pas c’est être près; à partir de tant, cela devient loin», fixe, entre les deux, la limite à laquelle il devra se tenir: «Dites un chiffre pour éviter toute contestation, sinon j’use de la latitude que vous me laissez; et, de même que j’arracherais crin par crin la queue d’un cheval, je retranche une lieue, puis une autre, jusqu’à ce qu’il ne vous en reste plus et que vous soyez vaincu par la force de mon raisonnement (Horace).» Qu’elle appelle hardiment la philosophie à son secours, celle à qui on pourrait reprocher que ne voyant ni l’un ni l’autre des deux bouts qui constituent le point de jonction entre le trop et le pas assez, le long et le court, le léger et le lourd, le près et le loin, ne distinguant ni le commencement ni la fin, ne peut juger du milieu qu’avec bien de 437 l’incertitude: «la nature ne nous permet pas de connaître la limite des choses (Cicéron)».—Les femmes cessent-elles d’être les épouses et amies des gens trépassés, alors qu’elles-mêmes sont encore de ce monde et qu’eux sont dans l’autre? Nous embrassons par la pensée, non seulement les absents, mais encore ceux qui ne sont plus et ceux qui ne sont pas encore. Nous n’avons pas fait marché, en nous mariant, de nous tenir soudés indissolublement l’un à l’autre, comme font je ne sais quels petits insectes que nous voyons, ou à la façon des chiens, comme les ensorcelés de Karenty; une femme ne doit pas avoir les yeux si avidement fixés sur le devant de son mari, qu’elle ne puisse le voir par derrière, quand besoin en est. Le mot de ce poète, qui peint si bien leur caractère, ne serait-il pas ici à sa place pour révéler le motif de leurs plaintes: «Tardez-vous à rentrer! votre épouse s’imagine que vous en aimez une autre, ou que vous en êtes aimé, que vous buvez, ou que vous vous amusez; enfin que tout le bon temps est pour vous et le mauvais pour elle (Térence)»; ou bien ne serait-ce pas que l’opposition et la contradiction sont dans leur nature et constamment en éveil chez elles, et qu’elles se tiennent pour à peu près satisfaites, du moment qu’elles vous gênent.
Dans l’amitié véritable, de laquelle j’ai qualité pour parler, je me donne à mon ami plus que je ne le tire à moi. Non seulement je préfère lui faire du bien plutôt que ce soit lui qui m’en fasse, mais j’aime encore mieux qu’il s’en fasse à lui-même que de m’en faire; c’est quand il s’en fait, qu’il m’en fait le plus; et si l’absence lui plaît ou le sert, elle m’est à moi-même plus douce que sa présence. Il n’y a pas du reste à proprement parler d’absence, quand on a moyen de demeurer en relations. Avec La Boëtie, j’ai autrefois tiré grand avantage et agrément de notre éloignement: quand nous nous séparions, notre vie était mieux remplie et prenait plus d’extension; il vivait, jouissait, voyait pour moi et moi pour lui, aussi complètement que si nous avions été l’un et l’autre sur place; quand nous étions ensemble, ne faisant qu’un, une moitié de nous demeurait oisive; en des lieux séparés, nos volontés s’exerçant chacune de leur côté, leur union produisait davantage. Cette faim insatiable de la présence en corps, accuse un peu de faiblesse dans la jouissance que les âmes doivent ressentir l’une par l’autre.
Pourquoi craindre de voyager quand on est vieux? c’est alors que les voyages sont le plus profitables. Il peut mourir en route, dira-ton; qu’importe!—On m’allègue la vieillesse; j’estime que c’est au contraire aux jeunes gens à se conformer aux opinions qui ont cours et à se gêner pour autrui; ils sont à même de satisfaire à la fois et le monde et eux-mêmes, tandis que nous, nous avons déjà trop à ne satisfaire que nous seuls. A mesure que les satisfactions naturelles viennent à nous manquer, dédommageons-nous avec celles que nous pouvons nous créer. Il est injuste d’excuser la jeunesse de s’adonner à ses plaisirs et d’interdire à la vieillesse d’en rechercher. Jeune, j’étais gai et n’avais 439 qu’à modérer mes passions; vieux, je suis triste et il me faut recourir aux distractions. Les lois de Platon interdisent de voyager avant l’âge de quarante ou cinquante ans, pour que ces pérégrinations soient plus utiles et plus instructives; j’accepterais plus volontiers le second article de ces mêmes lois, l’interdisant après soixante.
«Mais, à votre âge, vous ne reviendrez jamais d’un si long voyage?» me dira-t-on. Que m’importe? je ne l’entreprends ni pour en revenir ni pour l’achever; j’entreprends uniquement de me mouvoir pendant que le mouvement me plaît, je me promène pour me promener. Ceux qui courent après de l’argent ou après un lièvre, ne courent pas; ceux-là courent, qui jouent aux barres ou pour s’exercer à la course. Je puis m’arrêter partout, n’ayant pas de programme déterminé à l’avance; chaque journée marque le terme que je me propose et il en est de même du cours de ma vie; cela ne m’a pas empêché de visiter beaucoup de localités éloignées où j’aurais volontiers fixé ma demeure. Pourquoi pas? Chrysippe, Cléanthe, Diogène, Zénon, Antipater et tant de sages de la secte la plus maussade, ont bien abandonné leurs pays d’origine, sans sujet de plainte et uniquement pour aller respirer un autre air. Certainement, le plus grand déplaisir que j’éprouve dans mes voyages, c’est de ne pas les faire avec la résolution d’établir ma demeure où je me trouverai bien, et d’avoir toujours le retour en perspective pour agir suivant ce qui est dans les habitudes.
Quoiqu’il lui soit indifférent de mourir là ou ailleurs, il préférerait que la mort le surprît à cheval et hors de chez lui; il y serait plus en paix.—Si je craignais de mourir autre part que là où je suis né, si je pensais mourir moins à mon aise loin des miens, à peine sortirais-je de France; je ne sortirais même pas sans effroi de ma paroisse, car je sens la mort qui m’étreint continuellement par la gorge ou les reins. Mais je suis autrement fait; la mort pour moi est la même, n’importe où elle m’atteindra. Si toutefois j’avais à choisir, j’aimerais mieux, je crois, que ce soit à cheval plutôt que dans un lit, de préférence hors de ma maison et loin des miens. On éprouve plus de crève-cœur que de consolation à prendre congé de ses amis; c’est un devoir de civilité que j’omettrais volontiers de remplir, parce que des services auxquels vous engage l’amitié, celui-là est le seul qui soit déplaisant; aussi me passerais-je bien de dire ce grand et éternel adieu. S’il y a quelque avantage à l’assistance que nous prêtent nos amis en la circonstance, elle offre cent inconvénients. J’ai vu des gens mourir dans de bien piteuses conditions parce qu’ils étaient assiégés de tout ce train, l’empressement de chacun les étouffait. C’est contraire au devoir et considéré même comme une marque de peu d’affection et d’attention, de vous laisser mourir en repos: l’un vous tourmente les yeux, l’autre les oreilles, un autre la bouche; il n’y a pas de sens, pas de membre que l’on ne vous martyrise. Votre cœur s’apitoie à entendre les plaintes de vos amis; parfois aussi, c’est avec dépit 441 qu’il vous faut en entendre d’autres, celles-ci feintes, dissimulant les vrais sentiments de ceux qui les exhalent. Celui qui a toujours eu le goût sensible et délicat, l’a encore plus à ce moment; il lui faudrait, en cette occurrence qu’on ne peut éviter, une main douce, en rapport avec sa manière de sentir, pour le gratter précisément où cela lui cuit, ou n’être pas gratté du tout. Nous avons besoin de sage-femme pour nous mettre au monde, nous aurions bien besoin aussi d’un homme encore plus sage pour nous aider à en sortir; un tel homme, qui de plus serait notre ami, serait à acheter bien cher pour le service qu’il rendrait en pareille occasion.—Je ne suis point encore arrivé à cette force d’âme, dédaigneuse de tout ce qui peut survenir, qui puise sa vigueur en elle-même, à laquelle rien n’ajoute et que rien ne trouble; je suis d’un degré au-dessous et cherche uniquement à me fourrer dans un trou comme un lapin et à me dérober pendant ce passage de vie à trépas, non par crainte mais par calcul. Je ne suis pas d’avis que ce soit là le moment pour moi de faire preuve ou étalage de fermeté; pour qui serait-ce, alors que je cesse d’avoir tout droit et tout intérêt à une bonne réputation? Je me contente d’une mort accomplie dans le recueillement, paisible, solitaire, où je sois complètement moi, qui soit en rapport avec la vie retirée et toute bourgeoise que j’ai menée; et ce, à l’opposé de ce qu’admettait la superstition romaine qui tenait pour malheureux celui mourant sans parler et n’ayant pas auprès de lui ses proches pour lui fermer les yeux. J’ai assez à faire à me consoler sans avoir à consoler les autres, assez de pensées en tête sans que les circonstances m’en apportent de nouvelles, assez de choses dont j’ai à m’entretenir sans en rechercher d’autres. Cet acte de la pièce ne comporte pas plusieurs rôles; il n’est qu’à un seul personnage. Vivons et rions avec les nôtres, allons gémir et mourir chez des inconnus; on trouve partout, en payant, quelqu’un pour vous tourner la tête, vous frictionner les pieds, ne s’empresser auprès de vous qu’autant que vous le voulez, vous offrant un visage constamment indifférent, vous laissant agir et vous plaindre à votre guise.
Quelle fâcheuse habitude que notre entourage s’apitoie sur nos maux; cela énerve notre courage.—Je me défais chaque jour par raison de cette humeur puérile et inhumaine, qui fait que nous désirons que nos maux suscitent chez nos amis compassion et chagrin. Nous exagérons ce que nous éprouvons pour provoquer leurs larmes; et la fermeté que nous louons chez les autres, quand ils sont aux prises avec la mauvaise fortune, nous la reprochons et en faisons un grief à ceux qui nous approchent quand c’est nous qui sommes éprouvés: il ne nous suffit pas qu’ils prennent part à nos maux, il faut encore qu’ils s’en affligent. Étendons au contraire la joie et, le plus que nous pouvons, restreignons la tristesse. Qui se fait plaindre sans raison, court risque de n’être pas plaint quand il y aura lieu; c’est risquer de ne l’être jamais, que de se plaindre toujours; en cherchant si souvent à inspirer la 443 pitié, on finit par ne l’obtenir de personne. Qui se dit mort lorsqu’il est vivant, s’expose à passer pour être encore vivant quand il viendra à mourir. J’en ai vu qui se fâchaient de ce qu’on leur trouvait le visage reposé et le pouls calme, qui se gardaient de sourire pour ne pas paraître en voie de guérison, qui regrettaient de se bien porter parce que cela empêchait qu’on les plaignît; et, ce qui est bien plus fort, c’est que ces personnes n’étaient pas des femmes. Je ne dis jamais de mes maladies plus que je n’en ressens; j’évite les paroles décourageantes, mes exclamations se bornent à celles que m’arrache la douleur, sans que je les accompagne d’aucun commentaire. Près d’un malade raisonnable, à défaut d’allégresse, une contenance calme est convenable de la part des assistants; de ce qu’il se voit en mauvais état, il n’est pas hostile à la santé; il lui plaît de la voir forte et entière chez les autres et d’en jouir au moins par ceux qui lui tiennent compagnie; de ce qu’il sent qu’il va s’effondrant, il ne repousse pas les pensées qui occupent la vie et ne fuit pas de participer aux conversations de tout le monde. C’est quand je me porte bien que je veux étudier la maladie; quand elle me tient, j’en ressens assez les effets pour que mon imagination n’ait pas besoin d’intervenir. Nous nous préparons de longue main aux voyages que nous voulons entreprendre, quand nous y sommes résolus; quand vient l’heure de monter à cheval, nous consacrons ce moment à l’assistance, et, pour lui être agréable, nous le prolongeons.
A publier cette étude sur lui-même, Montaigne trouve cet avantage qu’elle lui sert de règle de conduite, que les critiques seront moins portés à dénaturer ses qualités et que sa confession pourra en partie les désarmer.—Je tire de la publication de cette élude sur mes mœurs, cet avantage inespéré, c’est qu’elle me sert en quelque sorte de règle; elle me porte parfois à ne pas me mettre en opposition avec ce que j’ai toujours été. Cette déclaration publique m’oblige à me contenir dans ma direction première et à ne pas démentir les conditions sous lesquelles je me suis dépeint et qui, ainsi décrites, sont, dans leur ensemble, plus exactement rendues qu’elles ne le seraient du fait des jugements faux et méchants d’aujourd’hui. L’uniformité et la simplicité de mon caractère, m’ont permis de le traduire aisément; mais la forme nouvelle et inusitée sous laquelle je le présente, donne bien beau jeu à la médisance. A qui voudrait me critiquer loyalement, je crois, en vérité, en avoir bien suffisamment fourni les moyens en faisant connaître et avouant mes imperfections; il y a là de quoi s’en donner à cœur joie, sans s’en prendre à ce qui n’est pas. Si, parce que j’ai pris l’avance en m’accusant et me révélant, on trouve que j’émousse les dents de la critique, elle sera naturellement amenée à amplifier et étendre ses attaques, l’offense prenant des droits qui dépassent ceux que la justice assigne; et, des vices dont je ne lui montre que quelques racines, elle en fera de gros arbres. Si elle en vient là, qu’elle s’exerce non seulement sur 445 les défauts que j’ai, mais encore sur tous ceux que je puis avoir en germe et qui, par leur nombre et leur nature, font que je prête le flanc de toutes parts; qu’elle m’attaque donc par là. J’imiterais volontiers, en ce cas, l’exemple du philosophe * Bion: Antigone voulant le blesser s’attaquait à son origine; Bion lui ferma la bouche en disant: «Je suis le fils d’un serf, qui était boucher et avait encouru la flétrissure, et d’une fille publique que mon père avait épousée, la bassesse de sa situation ne lui permettant pas d’aspirer plus haut; tous deux avaient commis des méfaits qui leur avaient valu des condamnations. Un orateur me trouvant beau et avenant, m’acheta alors que j’étais encore enfant; à sa mort, il m’a laissé tous ses biens; je les ai réalisés et suis venu en cette ville d’Athènes, où je me suis adonné à la philosophie. Que les historiens ne se mettent pas en peine pour chercher des renseignements sur moi, je leur dirai moi-même tout ce qui est.» Une confession franche et spontanée enlève aux reproches toute portée et désarme l’injure. Tout compte fait, j’estime qu’aussi souvent qu’on me loue on m’ôte de ma valeur, parce qu’on dépasse la mesure; il m’apparaît aussi que, depuis mon enfance, en fait de rang et d’honneur, on m’en a prêté plutôt au-dessus qu’au-dessous de ce qui m’appartient. Je préférerais vivre dans un pays où les questions de prééminence seraient ou réglées ou méprisées. Entre * hommes, quand un différend s’élève à propos de prérogatives, soit pour précéder quelqu’un, soit pour siéger avant lui, le débat devient incivil dès qu’il dépasse l’échange de trois ou quatre répliques; pour fuir de si importunes contestations, je n’hésite pas à céder le pas ou à passer devant, même quand c’est à tort, et jamais homme n’a revendiqué la préséance sur moi sans que je la lui aie abandonnée.
Peut-être aussi cette lecture fera-t-elle que quelqu’un lui convenant, sera désireux d’entrer en rapport d’amitié avec lui.—Outre ce profit que me procure cette étude de moi-même, j’en ai espéré cet autre, que s’il advenait qu’avant ma mort, mon caractère plût et s’accordât avec celui de quelque honnête homme, il chercherait peut-être à se lier avec moi. Je lui ai fait la part belle, puisque tout ce qu’une longue connaissance et intimité lui auraient appris en plusieurs années, il le voit plus sûrement et plus exactement en trois jours en me lisant. Quelle singulière idée! certaines choses que je ne voudrais dire à personne en particulier, je les dis au public, et renvoie à se renseigner dans une boutique de librairie mes amis les plus intimes, désireux de connaître ce que je sais et ce que je pense de plus secret, «livrant à leur examen tous les replis de mon âme (Perse)». Ce désir de ma part est si sincère, que si je connaissais quelqu’un qui me convînt, je l’irais chercher bien loin parce que la douceur d’une compagnie bien assortie et agréable ne peut, à mon avis, se payer trop cher. * Oh! un ami! que ne donnerais-je pas pour en avoir un, et combien est vraie cette sentence des temps jadis, «que l’usage en est plus nécessaire et plus doux que celui de l’eau et du feu»!
447
C’est finir par devenir à charge aux nôtres que de les occuper constamment de nos maux; du reste viendrait-il à tomber malade dans un coin perdu, il est en mesure de se soigner lui-même, et son habitude de mettre à l’avance ordre à ses affaires fait qu’il est toujours prêt.—Pour revenir à mon sujet, je dis donc qu’il n’y a pas grand mal à mourir loin de chez soi et dans l’isolement; nous jugeons bien à propos de nous retirer à l’écart pour satisfaire à des actes de la nature, ayant moins mauvaise grâce que celui-ci et qui sont moins hideux. Ceux qui, pendant de longues années, mènent une vie languissante, devraient bien aussi souhaiter ne pas importuner de leur misère tout leur entourage. C’est ce qui faisait que les Indiens, dans une de leurs provinces, estimaient juste de tuer ceux tombés en cet état; et que, dans une autre, ils les abandonnaient, les laissant seuls se tirer d’affaire comme ils pourraient. A qui de pareilles gens ne finissent-ils pas par se rendre ennuyeux et insupportables; c’est au point que ce qui est du devoir de tous, ne va pas jusqu’à les supporter. C’est inculquer de force la cruauté à vos meilleurs amis, porter votre femme et vos enfants à la dureté et les amener, en les leur plaçant d’une façon répétée sous les yeux, à ne plus s’émouvoir et vous plaindre des maux que vous ressentez. Les gémissements que m’arrachent mes coliques ne sont plus un sujet d’émoi pour personne. Lors même que nous tirerions quelque plaisir de la conversation de ces familiers (ce qui n’arrive pas toujours, en raison de l’inégalité des conditions qui amène aisément du mépris ou du dépit envers l’un ou envers l’autre), n’est-ce pas trop que d’en abuser pendant de longues années? Plus je les verrais se contraindre de bon cœur pour m’être agréable, plus je souffrirais de la peine qu’ils se donnent. Il nous est permis de nous appuyer sur autrui, mais non de nous coucher aussi lourdement sur lui; non plus que de le ruiner pour nous étayer, comme celui qui faisait égorger de petits enfants afin de se servir de leur sang pour se guérir, ou cet autre qu’on fournissait de jeunesses pour, la nuit, réchauffer par leur contact ses membres refroidis par l’âge et tempérer, par la douceur de leur haleine, l’âcreté et la lourdeur de la sienne. La décrépitude réclame la solitude: je suis sociable à l’excès, il me paraît cependant raisonnable de dérober mes infirmités à la vue du monde et de n’en importuner que moi seul; il me faut me ramasser et me recueillir dans ma coquille comme les tortues; me résigner à voir les gens, mais sans être constamment au milieu d’eux. Agir autrement serait abuser, la situation est trop scabreuse; il est temps pour moi de tourner le dos à la compagnie.
«Mais, dira-t-on encore, dans ces voyages, vous serez misérablement arrêté dans quelque mauvais coin où tout vous manquera.» Je porte avec moi presque tout ce qui m’est nécessaire; et puis, pouvons-nous échapper si la fortune entreprend de nous être contraire? Quand je suis malade, je n’ai besoin de rien d’extraordinaire; ce que la nature ne peut plus pour moi, je ne veux pas le 449 demander à des médicaments. Bien avant que la fièvre ou la maladie ne commence à m’abattre, quand je suis encore presque bien portant et en pleine possession de moi-même, je me réconcilie avec Dieu en recevant les derniers sacrements de notre religion; je m’en trouve plus libre, plus dégagé; il me semble que cela me rend plus à même d’avoir raison de la maladie. Quant aux notaires et à leurs conseils, j’en ai encore moins besoin que de médecins; celles de mes affaires auxquelles je n’ai pas mis ordre quand je me portais bien, qu’on ne s’attende pas à les voir réglées une fois que je serai malade. Ce que je veux faire en cas de mort est toujours fait, je n’oserais le différer d’un seul jour; et qui ne sera pas fait c’est, ou bien parce que le doute où je suis m’a empêché de me décider (parfois ne pas se décider est la meilleure décision qu’on puisse prendre), ou parce que je suis absolument résolu à ne rien faire.
Son livre ne lui survivra que peu d’années; il n’en constitue pas moins une précaution pour qu’après lui, on ne le juge pas autre qu’il n’est.—J’écris mon livre pour peu de personnes et peu d’années; si c’eût été un ouvrage destiné à durer, j’y aurais employé un langage plus relevé. Étant données les variations par lesquelles notre langue est passée jusqu’à maintenant, qui peut dire que sa forme actuelle sera encore telle dans cinquante ans? elle se modifie chaque jour entre nos mains et, depuis que je vis, elle s’est transformée de plus d’à moitié. Nous la tenons pour parfaite à l’heure actuelle, chaque siècle en dit autant; je n’ai garde de croire qu’elle en reste là; plus cela ira, plus elle continuera à se transformer. Il appartient aux bons écrivains, à ceux qui écrivent des choses utiles, de la fixer dans une certaine mesure; quant à la durée de cette transformation, elle dépend de ce qui adviendra de notre état politique.—Malgré le laisser-aller avec lequel j’écris cet ouvrage, je ne crains cependant pas d’y introduire quelques articles qui sont plus particulièrement de la compétence de certaines personnes de notre époque qui s’occupent de sciences dont elles ont fait leur spécialité; par suite, elles les comprendront mieux que ne peut le faire la généralité de mes lecteurs.—Avant tout, je ne veux pas qu’après moi on dise, comme je le vois souvent faire, troublant ainsi la mémoire des trépassés: «Il jugeait, il vivait de la sorte;—c’est là ce qu’il voulait;—s’il eût parlé sur la fin de sa vie, il eût dit ceci, il eût donné cela, je puis le dire, l’ayant connu mieux que tout autre.» Or, autant que la bienséance me le permet, j’indique ici le sens de mes opinions et de mes affections; mais, de vive voix, je les exprime volontiers plus librement à qui désire les connaître; si bien que, pour peu qu’on y regarde, on trouvera que dans ces mémoires j’ai tout dit et tout indiqué, et que ce que je n’ai pas la possibilité d’exprimer, je le montre du doigt; «mais ces traits, si légers qu’ils soient, suffisent à ton esprit pénétrant pour deviner le reste (Lucrèce)». Je ne laisse rien à désirer, ni à deviner de moi. Si on doit en disserter, je veux que ce soit en toute vérité et justice; je reviendrais plutôt de l’autre monde pour démentir quiconque me représenterait autrement 451 que je n’étais, fût-ce pour me faire honneur. Je sens du reste que des vivants même on parle toujours autrement qu’ils ne sont, et si je ne m’étais appliqué de toutes mes forces à faire qu’un ami que j’ai perdu ne fût pas défiguré, on me l’aurait taillé de mille façons qui l’eussent rendu tout autre qu’il n’était.
Genre de mort que Montaigne préférerait; toujours est-il qu’il a la satisfaction de se dire que la sienne ne sera pour les siens, dont les intérêts sont assurés, un sujet ni de plaisir ni de déplaisir.—Pour achever d’exposer mes faiblesses d’esprit, j’avoue que lorsque je voyage, je n’arrive guère quelque part sans qu’il me passe dans l’idée de me demander si je ne pourrais pas à mon aise y tomber malade et y mourir. Je voudrais y être logé de telle sorte que je sois tout à fait chez moi, que je n’entende pas de bruit, que ce ne soit pas triste, enfumé, qu’on n’y étouffe pas. Par toutes ces frivoles conditions je cherche à flatter la mort, ou pour mieux dire, à me débarrasser de tout ce qui peut me gêner et m’empêcher de ne penser qu’à elle, qui est d’un poids assez lourd sans qu’il soit besoin de l’accroître encore. Je veux qu’elle ait sa part dans l’aisance et le bien-être de ma vie; elle y tient assez de place et y a assez d’importance pour qu’il en soit ainsi, et j’espère qu’étant donnés les sentiments dans lesquels je suis, elle ne démentira pas mon passé.—La mort affecte des formes plus commodes les unes que les autres, et plus ou moins appréciées suivant les idées de chacun. Parmi celles produites par des causes naturelles, celle amenée par l’affaiblissement et la perte de nos facultés, me paraît facile et douce. Parmi les morts violentes, je redouterais davantage de tomber dans un précipice, que d’être écrasé par une ruine qui s’écroulerait; de recevoir un coup d’épée me pourfendant, qu’un coup de feu; j’eusse préféré boire la ciguë de Socrate, que de me poignarder comme fit Caton; et, bien que ce soit tout un, mon imagination fait cependant une différence aussi grande que celle de la mort à la vie, entre me jeter dans une fournaise ardente ou dans un canal aux eaux dormantes, tant sottement, dans notre crainte, nous regardons plus au moyen qu’à l’effet. Ce n’est qu’un instant à passer, mais il est de telle importance, que je donnerais volontiers plusieurs jours de ma vie pour le passer comme il me convient.—Puisque chacun trouve que c’est un moment plus ou moins désagréable et a ses idées faites sur le choix qu’il ferait entre les différents genres de mort, poussons plus avant pour tâcher d’en trouver qui soient dégagés de tout déplaisir. Ne pourrait-on pas, encore de nos jours, la rendre voluptueuse comme faisaient les Commourants d’Antoine et de Cléopâtre? Je laisse à part ces morts avidement recherchées autant qu’exemplaires, qu’ont produites les efforts de la philosophie et de la religion; mais même parmi les hommes peu recommandables, il s’en est trouvé comme à Rome un Pétrone, un Tigellinus qui, invités à se donner la mort, l’ont pour ainsi dire endormie par les raffinements dont ils en ont entouré les apprêts, la glissant en quelque sorte, sans qu’elle éveillât 453 l’attention, au cours de leurs débauches habituelles, si bien qu’elle les surprenait en société de filles de joie et de gais compagnons, sans qu’ils eussent un mot de regret pour quoi que ce fût; sans qu’il fût question de testament, sans qu’ils affectassent la moindre prétention à faire acte de fermeté, sans préoccupation de ce qu’ils allaient devenir; uniquement occupés de jeux, de festins, de plaisanteries, de conversations tenues comme à l’ordinaire sur les faits du moment, de musique, de poésie érotique. Ne saurions-nous imiter une telle résolution, en ayant une plus honnête contenance? Puisque les fous trouvent moyen de bien mourir, et les sages aussi, trouvons une mort qui convienne aux gens qui ne sont ni fous ni sages. J’ai idée de certaines qui me semblent avoir bon air et qu’on peut souhaiter, puisqu’il faut finir par mourir. Les tyrans romains pensaient donner la vie au criminel, en lui laissant le choix de son genre de mort. D’autre part Théophraste, ce philosophe si délicat, si modeste et si sage, n’a-t-il pas été contraint par la raison d’oser dire ce vers que Cicéron a traduit en latin: «La vie dépend du sort plus que de notre sagesse»? ne cherchons donc pas davantage.—La fortune a aidé à la facilité avec laquelle je quitterai la vie en faisant qu’aujourd’hui je ne suis pour les miens ni un besoin, ni une gêne. Cette situation, je l’eusse acceptée à toute époque de mon existence; mais près de rassembler mes hardes et de plier bagage, c’est pour moi une satisfaction toute particulière de n’être pour eux, en mourant, un sujet ni de plaisir, ni de déplaisir. Par une adroite et ingénieuse compensation, ceux qui sont en droit d’attendre quelque profit matériel de ma mort, se trouvent du même coup en éprouver d’autre part des pertes de même nature; souvent notre mort s’aggrave pour nous du préjudice qu’elle cause à d’autres, dont l’intérêt nous touche presque autant et parfois plus que le nôtre.
Il ne recherche pas ses aises en voyage; il va au jour le jour, sans itinéraire fixe, aussi est-il toujours satisfait.—Dans mes logis d’occasion, je ne recherche ni le luxe, ni l’espace, conditions que j’ai plutôt en grippe; je les souhaite de cette simplicité qui se rencontre plus fréquemment qu’ailleurs dans les pays où l’art a peu de part et auxquels la nature communique la grâce qui lui est propre: «Je préfère un repas où règne la propreté plutôt que l’abondance (Nonius), l’entrain plus que le luxe (Cornélius Nepos).» Que ceux que leurs affaires amènent en plein hiver dans le pays des Grisons, ne trouvent pas sur leur route pleine satisfaction, cela les regarde; mais moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, je ne cours pas ce risque: si la route est laide à droite, je prends à gauche; si je ne suis pas en disposition de monter à cheval, je m’arrête; et, en agissant de la sorte, je ne vois rien en vérité qui ne me plaise et ne me soit aussi commode que là où je me loge; il est vrai que toute superfluité m’est superflue, et que j’ai reconnu que l’on se trouve dans l’embarras, même au sein du luxe et de l’abondance. Ai-je laissé derrière moi quelque chose à voir, j’y retourne; c’est toujours mon chemin, parce que je 455 ne me trace pas un itinéraire invariable pas plus en ligne droite qu’autrement. Si où je vais, je ne trouve pas ce qu’on m’avait dit devoir y être, ainsi qu’il arrive souvent d’après les jugements des autres qui ne s’accordent pas toujours avec les miens et que la plupart du temps je trouve inexacts, je ne regrette pas ma peine, ayant du moins constaté que ce qu’on m’avait dit y être, n’y est pas.
Il sait s’accommoder de tout et rien ne lui paraît étrange; il blâme fort la sotte tendance qu’ont les Français à l’étranger de tout y dénigrer, aussi ne se joignait-il pas à leur société quand il en rencontrait.—Mon tempérament s’accommode de tout; mes goûts sont ceux de tout le monde appartenant à la bonne société; comme il convient à quelqu’un qui est cosmopolite, la diversité des procédés d’une nation à l’autre ne me touche que par le plaisir que me cause cette variété: chaque usage a sa raison d’être. Que l’on me serve dans des assiettes d’étain, de bois ou de terre, que ce soit du bouilli ou du rôti, de la cuisine au beurre ou à l’huile de noix ou d’olive, que ce soit chaud ou froid, tout m’est égal; tellement égal, qu’en vieillissant, j’incrimine cette précieuse faculté et voudrais que plus de délicatesse et de choix s’imposassent à moi pour modérer mon insatiable appétit qui parfois incommode mon estomac.—Quand je me trouve hors de France et que, par courtoisie, on me demande si je veux être servi à la française, je décline cette offre et toujours me place aux tables où les étrangers sont en plus grand nombre. J’ai honte de voir mes compatriotes possédés de cette sotte manie de s’effaroucher des usages contraires aux leurs; il leur semble être hors de leur élément, dès qu’ils sont hors de leur village; où qu’ils aillent, ils s’en tiennent à leurs façons et abominent celles des étrangers. Retrouvent-ils un des leurs en Hongrie, ils se réjouissent de ce hasard, et les voilà qui se réunissent, se fréquentent et s’évertuent à condamner ces mœurs barbares qu’ils ont sous les yeux; pourquoi ne seraient-elles pas barbares, puisqu’elles ne sont pas françaises? Et ce sont les plus habiles qui les relèvent pour les critiquer! La plupart ne partent que pour le retour; ils demeurent renfermés en eux-mêmes et peu communicatifs; ce sont gens qui, prudemment, deviennent taciturnes pour ne pas se livrer; ils se défendent contre la contagion d’un air qui leur est inconnu. Ce que je dis d’eux, me rappelle l’attitude analogue que j’ai constatée parfois chez quelques-uns de nos jeunes courtisans; ils ne s’occupent que des gens de leur sorte et nous regardent avec dédain et pitié, comme si nous étions de l’autre monde. Faites qu’ils n’aient plus à causer des mystères de la cour, ils ne trouvent plus rien à dire; ils sont à nos yeux aussi ignorants et gauches que nous le sommes aux leurs. On a bien raison lorsqu’on dit qu’un homme de bonne société, est un homme qui s’accommode de tout. Moi, au contraire, dans mes voyages, je suis très las de nos manières; ce n’est pas pour chercher des Gascons en Sicile, que je me déplace, j’en ai laissé assez chez moi; ce sont plutôt des Grecs, des Persans que je 457 voudrais y trouver; quand j’en rencontre, je les fréquente et en fais cas: c’est cela que je vise et ce dont je m’occupe. Je vais plus loin: il me semble n’avoir guère, dans mes pérégrinations, rencontré d’usages qui ne vaillent les nôtres; il est vrai que n’ayant jamais perdu beaucoup de vue mes girouettes, je ne risque pas grand’chose en avançant ce fait.—Du reste, la plupart des compagnies que le hasard place ainsi sur votre chemin, causent plus de gêne qu’elles ne procurent de satisfaction; je ne m’y attache pas, maintenant surtout que la vieillesse fait que je me tiens à l’écart et ne m’astreins plus autant aux usages. Quand vous êtes en groupe vous souffrez pour les autres, ou les autres souffrent pour vous; ce sont là deux graves inconvénients, dont le second est même celui qui m’est le plus pénible.
Tout ce qu’il demanderait, ce serait d’avoir un compagnon de voyage de même humeur que lui, car il aime à communiquer ses idées.—C’est une fortune bien rare et d’un soulagement inestimable que d’avoir pour compagnon de route un honnête homme, auquel votre société plaît, qui a du jugement et des habitudes conformes aux vôtres; et il m’a bien fait faute, dans tous mes voyages, de n’en avoir pas; mais un tel compagnon, il faut l’avoir choisi et se l’être attaché alors qu’on est encore chez soi. Aucun plaisir n’a de saveur pour moi si je ne puis m’en entretenir avec quelqu’un; il ne me vient à l’esprit aucune idée tant soit peu gaillarde, que je ne sois contrarié de l’avoir eue si je n’ai à qui en faire part. «Si la sagesse m’était donnée à condition de la tenir renfermée sans la communiquer à personne, je la refuserais (Sénèque).» Cicéron s’exprime encore plus nettement: «Supposez le sage dans l’abondance de toutes les choses nécessaires, libre de contempler et d’étudier à loisir tout ce qui est digne d’être connu, mais que sa solitude soit si grande qu’il n’ait de rapport avec personne, il demandera à sortir de la vie.» L’opinion d’Archytas me sourit: «Il me déplairait, disait-il, même si j’étais au ciel, de me promener parmi ces grands corps célestes domaine de la divinité, sans quelqu’un qui me tienne compagnie»; pourtant il vaut mieux être seul que d’être avec quelqu’un qui soit ennuyeux et sot. N’importe où il était, Aristippe aimait à vivre toujours comme un étranger. «Si le destin me permettait de vivre comme je l’entends (Virgile)», je choisirais de passer ma vie à cheval, «heureux de visiter les régions brûlées par le soleil et celles où se forment les nuages et les frimas (Horace)».
La situation qu’il a, le bien-être dont il jouit, devraient, ce semble, le détourner de sa passion des voyages; mais il y trouve l’indépendance à laquelle il sacrifie même les commodités de la vie.—«N’avez-vous pas, m’objectera-t-on, de passe-temps plus faciles? Qu’est-ce qui vous manque? Votre maison n’a-t-elle pas une belle vue et n’est-elle pas en bon air, suffisamment confortable et plus grande qu’il n’est nécessaire? Vous avez pu y recevoir, plus d’une fois, le roi et toute sa suite. Votre famille 459 n’est-elle pas dans une position sociale telle, que plus de gens se trouvent au-dessous d’elle qu’il n’y en a qui lui soient supérieurs? Le lieu éveille-t-il en vous quelque souvenir extraordinaire, qui vous ulcère et dont vous ne puissiez triompher, «qui, caché dans votre cœur, vous consume et vous ronge (Ennius)»? Où croyez-vous que vous ayez possibilité de vivre sans éprouver ni gêne, ni embarras? «Les faveurs de la fortune ne sont jamais sans mélange (Quinte-Curce).» Reconnaissez donc qu’il n’y a que vous à être une entrave à vous-même; que partout vous vous retrouverez avec vous-même, et partout vos plaintes se reproduiront; car il n’y a de satisfaction ici-bas que pour les âmes dépourvues d’intelligence, ou celles qui ont atteint la perfection. Qui n’éprouve de contentement dans une situation aussi sortable, où pense-t-il pouvoir en trouver? Combien de milliers d’hommes borneraient leurs désirs à une condition semblable à la vôtre. Travaillez seulement à vous amender; sur ce point vous pouvez tout; tandis qu’aux effets de la fortune, la patience est la seule chose qu’on puisse opposer: «Il n’est de tranquillité réelle que celle à laquelle nous conduit la raison (Sénèque)».
Je vois bien la justesse de cette observation et m’en rends parfaitement compte; mais on aurait eu plutôt fait, et c’eût été plus logique, de me dire en un mot: «Soyez sage.» Une semblable résolution outrepasse la sagesse; elle en résulte et en est la conclusion. Me tenir ce raisonnement, c’est imiter le médecin qui va criaillant à un pauvre malade qui dépérit, qu’il se réjouisse; son conseil serait moins sot, s’il lui disait: «Portez-vous bien.» Je ne suis pas de ceux qui s’élèvent au-dessus du commun; et, bien que ce soit un précepte salutaire, certain, facile à comprendre, que de «se contenter de ce que l’on a», c’est-à-dire d’être raisonnable, de plus sages que moi ne l’appliquent pourtant pas davantage. C’est un dicton populaire, mais qu’il est profond et à quoi ne s’étend-il pas? Il faut de la mesure en tout, et tout est susceptible de tempérament.—Je sais bien qu’à le prendre à la lettre, ce plaisir de voyager témoigne de l’inquiétude et de l’irrésolution, deux mauvaises qualités qui, chez moi, sont maîtresses et prépondérantes. Oui, je le confesse, je ne vois rien que je souhaite ou à quoi je rêve qui puisse me fixer; changer, pouvoir varier, c’est là ce qui seul me contente si tant est que quelque chose arrive à me contenter. En voyage, j’éprouve de la satisfaction rien que par ce fait, que je puis m’arrêter n’importe où sans avoir intérêt à le faire et que je suis libre d’en partir quand bon me semble pour aller ailleurs.—J’aime la vie de simple particulier; je l’aime, parce que je la préfère à la vie publique qui, cependant, n’est pas sans me convenir et qui est tout autant dans ma nature. Cette indépendance fait que je n’en sers que plus gaîment mon prince, parce qu’alors je le sers sans y être obligé, que seuls mon jugement et ma raison m’y déterminent, que ce n’est pas faute de mieux, que je ne suis pas contraint de me rejeter sur lui les autres me repoussant et en 461 étant mal vu. Il en est de même en tout: je hais de passer par où la nécessité m’oblige; toute commodité qui m’astreint à quoi que ce soit m’est insupportable: «Je veux toujours pouvoir frapper l’eau d’une rame et de l’autre toucher le rivage (Properce)»; une seule corde jamais n’est suffisante pour me maintenir quand on veut m’arrêter.
C’est là, dira-ton, de la vanité; mais où n’y en a-t-il pas? Les plus belles maximes philosophiques, les plus beaux règlements de conduite sont vains parce qu’ils nous demandent plus que nous ne pouvons.—«C’est là, direz-vous, un jeu bien empreint de vanité!» Où n’y en a-t-il pas? Tous ces beaux préceptes, toute sagesse sont-ils autre chose que vanité? «Le Seigneur sait que les pensées des sages ne sont que vanité (Psalmiste).» Ces subtilités exquises ne sont à leur place qu’au prêche; ce sont des raisonnements qui tendent à nous envoyer tout bâtés dans l’autre monde. La vie consiste dans un mouvement constant et effectif du corps, mouvement qui, par essence, est déréglé et imparfait et auquel je m’efforce de donner une direction suivant mes aspirations: «Nous avons chacun nos passions (Virgile). Nous devons néanmoins faire en sorte que sans jamais contrevenir aux lois générales de la nature, nous suivions cependant nos propres penchants (Cicéron).» A quoi servent ces idées élevées de la philosophie qu’aucun être humain ne peut mettre en pratique, ces règles qui excèdent l’usage que nous avons à en faire et la possibilité que nous avons de les appliquer.
Je vois souvent qu’on nous présente pour la conduite de notre vie, des modèles que ni celui qui les propose, ni ceux auxquels il s’adresse n’ont aucune espérance de pouvoir suivre et, qui plus est, n’en ont pas envie. De ce même papier sur lequel un juge vient d’écrire un arrêt de condamnation pour adultère, il détache un morceau pour envoyer un billet doux à la femme de son collègue; et cette femme avec laquelle vous venez de cueillir le fruit défendu, un moment après et en votre présence, va s’élever plus durement que ne l’eût fait Porcie, contre cette même faute commise par une de ses connaissances. Il en est qui condamnent à mort pour des crimes qu’ils n’estiment même pas être de simples fautes. J’ai vu en ma jeunesse un galant homme donner d’une main au public des vers remarquables par leur beauté et leur dévergondage, tandis qu’en même temps, de l’autre main il propageait sur la Réforme une discussion théologique des plus violentes d’entre celles que, depuis longtemps, le monde a vues se produire. Les hommes sont ainsi: on laisse les lois et les principes suivre leur chemin, et soi-même on en suit un autre, non seulement par déréglement de mœurs, mais parce que souvent nous pensons et jugeons autrement. Écoutez prononcer un discours philosophique: l’imagination, l’éloquence, la compétence s’y révèlent, nous frappent sur le moment et nous émeuvent; mais il ne s’y trouve rien qui empoigne et chatouille notre conscience, ce n’est pas à elle qu’on parle; n’est-ce pas vrai? Comme disait Ariston: «une étuve, 463 une leçon ne sont d’aucun fruit si elles ne nettoient et ne décrassent». On peut s’attacher à considérer l’écorce, mais après seulement qu’on a retiré la moelle; de même que ce n’est qu’après avoir avalé le bon vin d’une belle coupe, qu’on en examine le travail et les ciselures. Partout où, dans l’antiquité, on s’entretient de philosophie, quelle que soit l’école, on trouve le même auteur rédiger des règles de tempérance et libeller en même temps des pages sur l’amour et la débauche. Xénophon, sur les genoux de Clinias, écrivait contre la vertu telle que la prônait Aristippe. Ce n’est pas qu’il n’y ait comme des ondées de conversion miraculeuse qui nous agitent par intervalles; c’est ce que Solon peint très bien quand il se présente comme législateur ou en tant qu’individu, quand il parle pour le peuple ou qu’il ne s’agit que de lui; dans ce dernier cas, se sentant en parfaite santé, ne redoutant aucune défaillance, il suit en toute liberté les règles tracées par la nature, «tandis que le malade en danger a besoin d’être traité par les plus habiles médecins (Juvénal)».—Antisthène permet au sage d’aimer, de faire ce qu’il trouve opportun et d’en user comme il l’entend, sans tenir compte de ce que les lois peuvent édicter, d’autant que son avis à cet égard vaut mieux que ce qu’elles peuvent établir et qu’il s’y connaît davantage en fait de vertu. Diogène, son disciple, disait qu’«il faut opposer la raison aux désordres; à la fortune, la confiance; aux lois, la nature». Pour les estomacs délicats, il faut des ordonnances composées avec art et qu’ils observent à la lettre; les bons estomacs n’ont qu’à suivre simplement les prescriptions dérivant naturellement de leur appétit; c’est ainsi qu’agissent les médecins: ils mangent du melon, boivent le vin frais, tandis qu’ils astreignent leurs patients au sirop et à la panade. «Je ne sais, disait la courtisane Laïs, de quels livres, de quelle sagesse, de quelle philosophie ces gens parlent, mais je les vois se bousculant à ma porte, aussi souvent que les autres.» La licence, qui est le propre de notre nature, nous portant toujours au delà de ce qui nous est loisible et permis, souvent on a restreint au delà de ce que, d’une façon générale, commandait la raison, les préceptes et les lois qui régissent notre vie: «L’homme ne croit jamais avoir atteint le terme assigné à ses passions (Juvénal).» Il serait à désirer qu’entre le commandement et l’obéissance, la proportion soit mieux gardée; il semble injuste de nous proposer un but auquel nous n’avons pas possibilité d’atteindre. Il n’est pas un homme de bien, consacrant toutes ses actions et toutes ses pensées à l’étude des lois, qui dans sa vie ne se mette dix fois dans le cas d’être pendu; et, dans le nombre, il en est qu’il serait grand dommage et très injuste de perdre et de punir: «Que t’importe, Olus, de quelle manière celui-ci ou celle-là dispose de sa personne (Martial)?» Il en est d’autres au contraire qui peuvent ne pas offenser les lois, que nous ne saurions néanmoins tenir pour des gens vertueux et que la philosophie flagellerait à très bon droit, tant, sur ce point, il y a trouble et inconséquence! Nous sommes loin d’être des gens de bien, selon la doctrine divine; nous ne 465 saurions même l’être, d’après les règles que nous avons nous-mêmes établies. La sagesse humaine n’est jamais parvenue à remplir les devoirs qu’elle s’est tracés à elle-même; et si elle y était arrivée, elle en édicterait d’autres plus rigoureux encore, pour avoir toujours à quoi aspirer et prétendre, tant notre nature est ennemie de ce qui est réalisable. L’homme se fait une nécessité de ne pouvoir éviter d’être en faute. Il n’est pas adroit de sa part de se créer des obligations que seul pourrait remplir un autre être que celui qu’il est; pour qui, ces prescriptions qu’il doit s’attendre à ce que personne ne satisfasse? Est-il mal à lui de ne pas faire ce qu’il est impossible qu’il fasse? Les lois qui nous condamnent à de telles impossibilités, nous condamnent de ce que nous ne pouvons pas.
On peut à la rigueur admettre que dire et faire soient dissemblables chez les gens qui professent la morale; mais lui, parlant de lui-même, est tenu à être plus conséquent. L’homme public doit compter avec les vices de son temps; les affaires publiques ne se traitent pas d’après les mêmes principes que les affaires privées; il est fréquent de ne pas trouver réunies chez un même homme les qualités nécessaires à ces deux genres d’affaires.—Au pis aller, prendre cette liberté si contestable de se montrer sous deux aspects différents: d’une façon quand on agit, d’une autre quand on parle, peut être admis chez ceux qui traitent de sujets quelconques; ce ne saurait l’être chez ceux qui, comme je le fais, parlent d’eux-mêmes, il faut alors que tout en eux marche d’accord. Une vie qui n’offre rien de particulier est celle qui reste à l’unisson du milieu dans lequel elle s’écoule; la vertu de Caton était d’ordre trop élevé pour son siècle: son esprit de justice, chez un homme qui se mêlait de gouverner les autres, appelé à participer aux affaires publiques, pouvait passer, sinon pour de l’injustice, du moins pour être sans utilité et hors de saison. Mes mœurs mêmes, quoique différant à peine de l’épaisseur d’un doigt de celles qui ont cours, me rendent pourtant, à mon âge, un peu sauvage et peu sociable. Je ne sais si c’est sans raison que je me trouve dégoûté de la société que je fréquente, mais ce serait bien à tort que je me plaindrais qu’elle le soit de moi puisque je le suis d’elle. La vertu que réclament les affaires de ce monde, est une vertu qui présente des plis, des angles, des coudes qui lui permettent de s’appliquer et de s’adapter à la faiblesse humaine; elle est mélangée, composée; elle n’est pas droite, nette, constante, d’une pureté immaculée. Les chroniques de notre temps reprochent à un de nos rois de s’être jusqu’ici, sous l’impulsion de son confesseur, trop complètement abandonné aux conseils que lui suggérait sa conscience; les affaires publiques se dirigent d’après des règles de conduite moins timorées: «Quitte la cour, si tu veux rester pieux (Lucain).»
J’ai autrefois essayé d’appliquer à la gestion des affaires publiques les règles et principes que j’apporte dans ma manière de 467 vivre; règles et principes rudes, différents de ceux en cours, peu raffinés, mais irréprochables, tels qu’ils sont innés en moi ou résultent de mon éducation et dont j’use dans la vie ordinaire, sinon en y trouvant commodité, du moins sans risque de dévier dans ce que m’inspire une vertu sans expérience et purement scolastique; or j’ai constaté que, dans le monde des affaires, c’est la chose inepte et dangereuse. Il faut, quand on se mêle à la foule, se contourner, serrer les coudes, reculer, avancer, quitter parfois le grand chemin suivant le cas; vivre non pas tant suivant ce que l’on voudrait, que suivant ce que veulent les autres; non selon ce qu’on se propose, mais selon ce qu’on vous propose; selon le temps, les hommes, les affaires. Platon dit que c’est miracle, quand quelqu’un mêlé à la politique en sort la conscience nette; il dit aussi que lorsqu’il place son philosophe à la tête d’un gouvernement, il n’entend pas dire que ce soit à la tête d’un gouvernement corrompu comme celui d’Athènes, et bien moins encore comme le nôtre, où la sagesse elle-même perdrait la raison; une bonne herbe transplantée dans un terrain fort différent de celui qui lui convient, se transforme beaucoup plus suivant ce terrain qu’elle ne le transforme à sa convenance. Je sens que si j’avais à refaire mon éducation en vue d’occupations de cette nature, il faudrait opérer en moi beaucoup de changements et d’appropriations. Si je pouvais me transformer de la sorte (et pourquoi n’y arriverais-je pas avec du temps et de l’attention?) je ne voudrais pas l’entreprendre. Le peu durant lequel je m’y suis essayé, m’en a dégoûté; je sens parfois s’élever en moi des bouffées d’ambition, je me raidis contre ces tentations et leur résiste: «Ferme, Catulle, tiens bon jusqu’à la fin (Catulle).» On ne m’y sollicite guère et j’y suis tout aussi peu porté; la liberté et l’oisiveté, qui sont mes deux penchants dominants, sont des qualités diamétralement opposées à ce qu’il faut dans ce métier. Nous ne savons pas distinguer les facultés de chacun; elles se subdivisent et se délimitent de telle façon qu’elles sont difficiles à distinguer, délicates à apprécier. Conclure de ce que quelqu’un fait preuve de capacité dans la vie privée, qu’il est capable de gérer les affaires publiques, c’est conclure mal; tel se dirige bien, qui ne dirige pas bien les autres; tel écrit des Essais, qui est impropre à l’action; tel conduit bien un siège, qui conduirait mal une bataille; parle bien en petit comité, qui haranguerait mal une foule ou un prince; pouvoir l’un est peut-être même un indice qu’on ne peut l’autre, plutôt qu’on en est capable. Je constate que les esprits élevés ne sont guère moins aptes aux choses d’ordre inférieur, que les esprits inférieurs ne le sont pour les grandes choses. Aurait-on cru que Socrate ait donné lieu aux Athéniens de rire de lui, pour n’avoir jamais pu compter les suffrages de sa tribu et en faire rapport au conseil? certes, la vénération en laquelle je tiens les perfections de ce personnage, fait que je puis bien invoquer, comme excuse de mes imperfections, le cas particulier que je trouve dans ce modèle incomparable. Notre capacité se détaille par le menu; la mienne s’étend à peu de choses et est, en tout, fort restreinte. 469 Saturninus dit à ceux qui lui avaient déféré le commandement suprême: «Compagnons, vous perdez un bon capitaine, pour en faire un mauvais général d’armée.»
Une vertu naïve et sincère ne peut être employée à la conduite d’un état corrompu; du reste, sa notion s’altère dans un milieu dépravé. Quoi qu’il en soit, on doit toujours obéissance à ceux qui ont charge d’appliquer les lois, si indignes qu’ils soient.—Celui qui, en des temps malades comme l’est le nôtre, se vante de mettre au service des affaires de ce monde une vertu naïve et sincère, ou ne sait ce qu’est une pareille vertu, parce que les idées se corrompent quand les mœurs le sont (et, de fait, voyez comme on la dépeint; comme la plupart se glorifient de leurs débordements et y conforment les règles qu’ils se tracent, en son lieu et place c’est l’injustice et le vice dans toute leur réalité que l’on décrit et qu’ainsi travestis on présente aux princes dont on fait l’éducation); ou bien, s’il la connaît, se vante bien à tort de l’appliquer, car, quoiqu’il dise, il fait mille choses contre sa conscience. Je croirais volontiers Sénèque, s’il m’entretenait de l’expérience qu’il en fit dans des conditions toutes semblables, et qu’il voulût bien en parler à cœur ouvert.—La marque la plus honorable de notre disposition à faire le bien est, en ces temps de contrainte, de reconnaître loyalement ses fautes et celles d’autrui, de prêter son concours pour retarder dans la mesure où on le peut la tendance au mal, de ne suivre qu’à regret cette voie, d’espérer et désirer mieux. Dans ces divisions qui nous assaillent et qui ont fait de la France la proie des partis, je vois chacun, même parmi les meilleurs, avoir recours à la dissimulation et au mensonge pour défendre sa cause; celui qui en écrirait l’histoire, se fiant aux apparences, serait bien téméraire et absolument dans le faux. Le parti le plus juste n’est quand même qu’un membre d’un corps vermoulu et véreux; mais le membre le moins malade d’un corps en pareil état n’en passe pas moins pour sain et cela à bon droit, parce que ce n’est que par comparaison que nos qualités se titrent; l’innocence dans la vie politique se mesure selon les lieux et les saisons.—J’aurais aimé que Xénophon eût donné à Agésilas l’éloge que lui méritait le fait suivant: Un prince voisin, avec lequel il avait été autrefois en guerre, lui ayant demandé de lui laisser traverser son territoire, il accéda à sa demande et lui donna passage à travers le Péloponèse; l’ayant à sa merci, non seulement il ne l’emprisonna ni ne l’empoisonna pas, mais il l’accueillit avec courtoisie comme il s’y était obligé par sa promesse et ne se livra vis-à-vis de lui à aucune offense. Avec les idées d’aujourd’hui, une telle promesse ne signifierait rien; mais, ailleurs et en d’autres temps, la franchise et la magnanimité étaient en honneur; ces bambins d’écoliers de nos jours s’en fussent moqués, tant la vertu des Spartiates a peu de ressemblance avec la vertu française. Ce n’est pas que nous manquions d’hommes vertueux, mais ils le sont tels que nous les concevons. Celui dont les sentiments 471 s’élèvent au-dessus de ce qui est de règle en son siècle, doit les faire fléchir ou les émousser; ou bien, et c’est ce que je lui conseille de préférence, se mettre à l’écart et ne pas se mêler à nous, il n’a rien à y gagner: «Si je viens à rencontrer un homme intègre et vertueux, je compare ce monstre à un enfant à deux têtes, ou à des poissons qu’un laboureur ébahi trouverait sous le soc de sa charrue, ou encore à une mule féconde (Juvénal).»—On peut regretter des temps meilleurs, mais on ne peut se dérober à l’état présent; on peut désirer d’autres magistrats, il n’en faut pas moins obéir à ceux qui sont en fonctions; et peut-être y a-t-il plus de mérite à obéir aux mauvais qu’aux bons. Tant que, dans quelque coin, demeurera un représentant des lois dont nous a dotés notre vieille monarchie, je ne le quitterai pas; mais si, par malheur, une scission se produit, que sous l’action des partis contraires qui entravent son existence, elle vienne à se fractionner en deux, et que le choix entre les deux soit douteux et difficile, je me résoudrai probablement à échapper et à me dérober à cette tempête; la nature pourra m’y aider, peut-être aussi les hasards de la guerre. Entre César et Pompée j’eusse franchement pris parti; mais entre ces trois voleurs qui vinrent après eux, il eût fallu ou se cacher ou suivre le courant, ce que j’estime licite, quand la raison est devenue impuissante à nous guider.
Si Montaigne sort aussi fréquemment de son sujet, c’est qu’il s’abandonne aux caprices de ses idées qui, en y regardant de près, ne sont pas aussi décousues qu’elles en ont l’air; et puis, cela oblige le lecteur à plus d’attention.—«Où vas-tu t’égarer (Virgile)?» Ces excursions sont à la vérité un peu en dehors de mon sujet; je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde; mes pensées ne cessent de tenir les unes aux autres, bien que parfois d’assez loin; elles ne se perdent pas de vue, quoique quelquefois il leur faille un peu tourner la tête pour s’apercevoir. J’ai eu sous les yeux un dialogue de Platon construit de même sorte, présentant deux parties conçues chacune dans des genres absolument différents; au commencement il n’y est question que d’amour, tandis que la fin est uniquement consacrée à la rhétorique. Il est des auteurs qui ne craignent pas de passer ainsi d’un sujet à un autre sans rapport avec le précédent, et qui apportent une grâce merveilleuse à se laisser aller au gré du vent ou à sembler s’y abandonner.—Les titres de mes chapitres ne sont pas toujours en concordance avec les matières qui y sont traitées; souvent la relation ne se manifeste que par quelques mots comme dans l’Andrienne et l’Eunuque, ou dans Sylla, Cicéron, Torquatus. J’aime à aller par bonds et par sauts, à la façon des poètes, légère, ailée, divine comme la qualifie Platon. Il y a des ouvrages de Plutarque où il oublie son thème, et où l’argument qu’il traite n’apparaît qu’incidemment, perdu au milieu de sujets qui lui sont étrangers; voyez, par exemple, comme il procède dans son démon de Socrate. Dieu! que ces escapades pleines de sève, que ces variations ont de 473 beauté! elles en ont d’autant plus qu’elles semblent échappées à la plume et le fait du hasard.—C’est le lecteur manquant d’attention qui perd de vue mon sujet, et non moi; en quelque coin se trouvent toujours quelques mots qui, si réduits qu’ils soient, suffisent cependant pour montrer que je l’ai présent à l’esprit. Je passe de l’un à l’autre sans règle, sans transition; mon style et mon esprit vagabondent simultanément. Un peu de folie prévient un excès de sottise, au dire de nos maîtres et plus encore d’après leurs exemples.—Mille poètes se traînent languissamment comme s’ils écrivaient en prose, tandis que la meilleure prose des temps jadis, et j’en donne ici indifféremment des échantillons tout comme je fais des vers, resplendit constamment de la vigueur et de la hardiesse de la poésie; elle a quelque peu de la passion qui l’anime. A celle-ci, sans conteste, la prééminence en ce qui touche l’expression de la pensée; le poète, dit Platon, assis sur le trépied des Muses, déverse à flots tout ce qui lui vient à l’idée, comme coule l’eau de la gargouille d’une fontaine, sans y réfléchir, sans le peser; et il s’en échappe des choses de toutes couleurs, contraires les unes aux autres, formant une suite de propos interrompus. Platon lui-même est constamment inspiré du souffle poétique; la théologie ancienne, disent les savants, est toute poésie, et, au dire des premiers philosophes, c’était à l’origine le langage des dieux.—J’entends que lorsqu’on écrit, les sujets se distinguent d’eux-mêmes, qu’on voie où on en change, où on conclut; où l’un commence, où un autre reprend, sans qu’il soit nécessaire de les accompagner de ces circonlocutions, introduites pour les oreilles faibles ou inattentives, qui les raccordent et les lient les uns aux autres; je ne veux pas me commenter moi-même. Quel est celui qui n’aime pas mieux n’être pas lu que de l’être en dormant, ou au galop: «Il n’y a rien, si utile que ce soit, qui soit utile si on ne fait que passer (Sénèque).» Si prendre un livre c’était l’apprendre, si le voir c’était le fouiller profondément du regard, et le parcourir s’en pénétrer, j’aurais tort de me faire en toutes choses aussi ignorant que je le dis.—Ne pouvant fixer l’attention du lecteur par la valeur de ce que j’écris, «ce ne sera pas déjà si mal» s’il advient que je l’arrête par le pêle-mêle que j’y introduis. «Oui vraiment, dites-vous, mais après s’en être amusé, il le regrettera?» Sans doute, toujours est-il qu’il n’aura pas laissé d’en éprouver de la distraction. Et puis, il est des caractères ainsi faits, qui dédaignent ce qu’ils comprennent; ils m’estimeront d’autant plus qu’ils ne sauront ce que je veux dire et concluront de la profondeur de ma pensée par son obscurité, ce qu’à franchement parler, je hais très fort et éviterais si je savais faire autrement. Aristote se vante quelque part de rechercher de parti pris cette obscurité; c’est un grand tort.—Au début, je multipliais les chapitres, mais il m’a paru que cela rompait l’attention avant qu’elle ne fût éveillée et la faisait s’évanouir par le dédain qu’elle éprouvait à se recueillir et à se fixer pour si peu; je me suis mis alors à les faire plus longs, ce qui oblige à apporter à leur lecture une intention bien arrêtée et à y consacrer 475 un temps déterminé. Ne pas donner au moins une heure à une semblable occupation, c’est ne vouloir rien y donner; et ce n’est pas faire, que de ne pas se donner tout entier à ce que l’on fait. De plus, il m’est personnellement commode de ne m’exprimer qu’à moitié, de parler un peu confusément et à tort et à travers; et j’en veux à la raison qui vient y jouer le rôle de trouble-fête. Je trouve qu’elle est fort gênante et se paie trop cher, quand elle s’immisce au nom de la vertu dans les projets extravagants que nous formons au cours de la vie et dans les opinions fantaisistes que nous concevons. Par contre, je m’emploie à tirer parti de la bêtise, de la vanité, si elles peuvent m’être une cause de plaisir, et je m’abandonne à mes penchants naturels sans y regarder de bien près.
Affection particulière de Montaigne pour la ville de Rome, due aux souvenirs des grands hommes qu’elle a produits; aujourd’hui encore n’est-elle pas la ville universelle et la seule qui ait ce caractère?—J’ai vu ailleurs, en bien des lieux, des ruines de monuments, des statues, un ciel, des terres autres; l’homme y est toujours le même. Bien que cela soit vrai partout, je ne puis cependant, aussi souvent que je vois les restes de l’ancienne Rome, si grande, si puissante, me défendre de l’admirer et de la révérer. Le culte des morts nous est recommandé; or, dès mon enfance, j’ai été nourri des souvenirs de ceux-ci. Je savais ce qui se rapportait à cette capitale de l’univers, bien avant d’être initié à mes propres affaires; je connaissais le Capitole et sur quel plan il est construit, avant de connaître le Louvre; je savais ce qu’était le Tibre, avant de connaître la Seine. J’ai été plus occupé, bien qu’ils soient trépassés, du caractère et de la fortune des Lucullus, des Métellus et des Scipions que d’aucuns des nôtres. Mon père, mort aussi, l’est pour moi au même degré qu’eux; il s’est autant éloigné de moi depuis dix-huit ans qu’il n’est plus, qu’eux en seize siècles, et pourtant je ne cesse d’embrasser et de cultiver sa mémoire; son amitié, sa société sont toujours aussi vivement présentes à mon esprit, car il est dans mon tempérament de mieux remplir peut-être mes devoirs envers les morts qu’envers les vivants; ne pouvant s’aider, ils n’en ont, ce me semble, que plus de droits à mon assistance; la gratitude est là, à même de se montrer dans tout son éclat; un bienfait perd de son mérite, lorsqu’on peut s’attendre à être payé de retour. Arcésilas, rendant visite à Ctesibius qui était malade, et le trouvant dénué de ressources, glissa tout doucement sous le chevet de son lit de l’argent dont il lui faisait don, le tenant en outre quitte de lui en savoir gré en le lui laissant ignorer. Ceux qui ont mérité mon amitié et ma reconnaissance, ne les ont pas perdues pour n’être plus; je m’acquitte d’autant mieux et avec plus de soin vis-à-vis d’eux, qu’ils ne sont plus là et qu’ils l’ignorent; je parle encore plus affectueusement de mes amis, quand ils n’ont plus possibilité d’apprendre ce que je dis d’eux. J’ai cent fois entamé des discussions pour la défense de Pompée et la cause de Brutus; la sympathie que je leur porte subsiste toujours; même 477 aux choses présentes, nous ne nous y attachons que par un effet de notre imagination. Reconnaissant mon inutilité en ce siècle, je me rejette sur cet autre, et j’en suis si aveuglément séduit, que ce qui touche cette vieille Rome, à l’époque où elle était libre, juste et florissante (car je n’en aime ni les débuts, ni le déclin), m’intéresse et me passionne; c’est pourquoi, aussi souvent que je revois l’emplacement de ses rues et de ses maisons, ses ruines qui s’enfoncent sous terre jusqu’aux antipodes, c’est toujours avec le plus grand intérêt. Est-ce un effet de la nature ou une erreur d’imagination qui font que la vue des lieux que nous savons avoir été habités et fréquentés par des personnages dont la mémoire s’est conservée, nous émeut peut-être plus que le récit de leurs actes ou la lecture de leurs écrits? «Tant les lieux sont propres à réveiller en nous des souvenirs! Dans cette ville, tout arrête la pensée; partout où l’on marche, on foule quelque histoire mémorable (Cicéron).» Je prends plaisir à me figurer leur visage, leur attitude, leurs vêtements; je me répète ces grands noms et les fais retentir à mes oreilles; «j’honore ces grands hommes et ne prononce jamais leurs noms qu’avec respect (Sénèque)». Des choses qui sont grandes et admirables en quelques-unes de leurs parties, j’admire jusqu’à ce qu’elles ont d’ordinaire; que j’aurais eu du plaisir à les voir deviser, se promener, souper! Il y aurait ingratitude à mépriser leurs reliques et ce qui nous rappelle tant d’hommes de bien, de si haute valeur, que j’ai vus vivre et mourir et qui, par leur exemple, nous donnent tant de bons enseignements, si nous savions les suivre.
Et puis, cette même Rome telle qu’elle est de nos jours mérite qu’on l’aime. Elle est depuis si longtemps l’alliée, à tant de titres, de notre couronne! C’est la seule ville universelle, elle appartient à tous. Le souverain qui la gouverne a également action sur le reste du monde; elle est la métropole de la Chrétienté; l’Espagnol comme le Français y sont chez eux; pour devenir prince de cet état, il ne faut qu’être chrétien quel que soit le pays qui vous ait vu naître. Il n’est pas de lieu ici-bas, auquel le ciel ait octroyé ses faveurs en si grande abondance et d’une façon aussi continue; sa décadence même est glorieuse et son prestige demeure. «Plus précieuse encore par ses ruines superbes (Sidoine Apollinaire)», jusque dans le tombeau elle conserve l’apparence et le caractère de la capitale d’un empire: «C’est ici surtout qu’on dirait que la nature s’est complu dans son œuvre (Pline).» On peut se reprocher et se défendre contre soi-même d’être sensible à une aussi vaine satisfaction; ce ne sont cependant pas des sentiments tout à fait frivoles, que ceux qui nous procurent du contentement; et, quels qu’ils soient, lorsqu’un homme de bon sens y trouve constamment sujet d’être satisfait, je n’ai pas le cœur de le plaindre.
Il doit beaucoup à la fortune pour l’avoir ménagé jusqu’ici. L’avenir est inquiétant, mais que lui importe ce qui adviendra quand il n’y sera plus? il n’a pas d’enfant mâle qui continuera son nom. Au surplus, ne pas avoir d’enfant 479 du tout, ne lui semble pas chose bien regrettable.—Je dois beaucoup à la fortune qui, jusqu’à présent, ne s’est pas dressée contre moi, au delà du moins * de ce que j’étais à même de supporter; peut-être est-ce là sa façon de laisser en paix ceux qui ne l’importunent pas: «Plus nous nous privons, plus les dieux nous accordent. Pauvre, je ne me range pas moins du parti de ceux qui ne désirent rien. A qui demande beaucoup, il manque toujours beaucoup (Horace).» Si elle continue, je quitterai cette terre heureux et satisfait; «je ne demande rien de plus aux dieux (Horace)». Mais gare le choc s’il vient à se produire; c’est par milliers que se comptent ceux qui échouent au port!—Je me console aisément de ce qui surviendra ici quand je ne serai plus; le présent m’occupe assez, «j’abandonne le reste à la fortune (Ovide)». Il est vrai que je n’ai pas cette cause qui rattache si fort, dit-on, l’homme à l’avenir quand il a des enfants héritiers de son nom et de son honneur; s’il est désirable d’en avoir, la situation critique que nous traversons me porte à elle seule à n’en pas désirer. Je tiens déjà trop par moi-même au monde et à la vie; il me suffit d’être aux prises avec la fortune, dans les circonstances de mon existence où je ne puis l’éviter, sans souhaiter que sous d’autres rapports elle ait encore plus de prise sur moi, et je n’ai jamais estimé que n’avoir pas d’enfants soit un malheur qui rende notre vie incomplète et restreigne notre contentement; la stérilité a bien aussi ses avantages. Les enfants sont du nombre des choses qui ne sont pas fort à désirer, surtout actuellement où il serait difficile qu’ils fussent bons, «rien de bon ne peut naître, tant les germes sont corrompus (Tertullien)»; c’est cependant à juste titre qu’on les regrette, quand on les perd après les avoir eus.
Il laissera après lui son patrimoine tel qu’il l’a reçu, la fortune ne lui ayant jamais octroyé que de légères faveurs sans consistance.—Celui qui m’a laissé la gestion de ma maison, pronostiquait, en considérant combien j’aime peu à demeurer en place, que je la ruinerais. Il s’est trompé; j’en suis, à cet égard, au même point que lorsque je l’ai eue, si même je ne suis en un peu meilleure situation, sans charge qui la grève, comme sans bénéfice. Si la fortune ne m’a causé aucun préjudice sérieux qui sorte de l’ordinaire, elle ne m’a pas fait davantage de grâce; tout ce qui est chez nous venant d’elle, y était avant moi et depuis plus de cent ans; je n’ai personnellement aucun bien sérieux et important que je doive à sa libéralité. J’en ai reçu quelques légères faveurs, mais rien de substantiel: des titres, des honneurs qu’à la vérité elle m’a offerts d’elle-même, sans que je les aie demandés; car, Dieu le sait, je suis positif et n’estime que ce qui est réel et, de plus, de gros rapport; si j’osais, j’avouerais que je trouve l’avarice presque aussi excusable que l’ambition, que la douleur est à éviter autant que la honte, la santé aussi désirable que la science, la richesse que la noblesse.
De ces faveurs, il n’en est pas à laquelle il ait été plus sensible qu’au titre de citoyen romain. Teneur du document par lequel ce titre lui a été conféré; il le reproduit pour 481 ceux que cela intéresse et aussi un peu par vanité.—Parmi ces faveurs, toutes de vanité, que m’a faites la fortune, il n’y en a pas qui ait autant donné satisfaction au fond de niaiserie qui est en moi qu’une bulle authentique de bourgeoisie romaine qui m’a été conférée dernièrement, alors que j’étais à Rome; elle est pompeusement écrite en lettres d’or et dûment scellée, et m’a été octroyée avec la grâce la plus parfaite. Comme le libellé de ces titres varie et est plus ou moins élogieux, et qu’avant d’en avoir vu, j’aurais été bien aise que l’on m’en montrât la formule, je transcris ici le texte de celui qui m’a été remis pour satisfaire la curiosité de quiconque est possédé de ce même désir:
«Sur le rapport fait au Sénat par Orazio Massimi, Marzo Cecio, Alessandro Muti, Conservateurs de la ville de Rome, touchant le droit de cité romaine à accorder à l’Illustrissime Michel de Montaigne, Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel et gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi Très Chrétien, le Sénat et le Peuple romain ont décrété:
«Considérant que, par un antique usage, ceux-là ont toujours été adoptés par nous avec ardeur et empressement, qui, distingués en vertu et en noblesse, avaient servi et honoré notre République, ou pouvaient le faire un jour: Nous, pleins de respect pour l’exemple et l’autorité de nos ancêtres, nous croyons devoir imiter et conserver cette louable habitude. A ces causes, l’Illustrissime Michel de Montaigne, Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel et gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi Très Chrétien, fort zélé pour le nom Romain, étant, en raison de son rang, de l’éclat de sa famille et de ses qualités personnelles, très digne d’être admis au droit de cité romaine par le suprême jugement et les suffrages du Sénat et du Peuple romain; il a plu au Sénat et au Peuple romain que l’Illustrissime Michel de Montaigne, orné de tous les genres de mérite et très cher à ce noble peuple, fût inscrit comme citoyen romain, tant lui que sa postérité, et appelé à jouir de tous les honneurs et avantages réservés à ceux qui sont nés citoyens ou patriciens de Rome ou le sont devenus au meilleur titre. En quoi le Sénat et le Peuple romain pensent qu’ils accordent moins un droit, qu’ils ne paient une dette; et que c’est moins un service qu’ils rendent, qu’un service qu’ils reçoivent de celui qui, en acceptant le droit de cité, honore et illustre la cité même.
«Les Conservateurs ont fait transcrire ce sénatus-consulte par les secrétaires du Sénat et du Peuple romain pour être déposé dans les archives du Capitole, et ont fait dresser cet acte, muni du sceau ordinaire de la ville. L’an de la fondation de Rome 2331, et de la naissance de Jésus-Christ 1581, le 13 de mars.
«Orazio Fosco, secrétaire du sacré Sénat et du Peuple romain.
«Vincente Martoli, secrétaire du sacré Sénat et du Peuple romain.»
483
N’étant bourgeois d’aucune ville, je suis bien aise de l’être de la plus noble qui fut et sera jamais. Si les autres s’examinaient avec attention comme je le fais, ils se trouveraient, comme je me trouve moi-même, vaniteux et frivoles à l’excès. Faire qu’il n’en soit pas ainsi m’est impossible; il faudrait, pour cela, me détruire moi-même. Nous sommes tous imbus de ce défaut, autant les uns que les autres; il se manifeste un peu moins chez ceux qui s’en rendent compte, et encore n’en suis-je pas certain.
C’est qu’en effet l’homme est tout vanité; et c’est parce qu’il est déçu par ce qu’il voit en lui, qu’il reporte constamment ses regards partout ailleurs qu’en lui-même.—Ce sentiment et cette habitude qui existent chez tout le monde, de regarder ailleurs qu’en soi-même, répondent bien à un besoin que nous éprouvons. Nous sommes en effet, à nous-mêmes, un objet dont la vue ne peut que nous remplir de mécontentement; nous n’y voyons que misère et vanité, et il est fort à propos, pour que nous n’en soyons pas découragés, que la nature nous ait fait porter nos regards au dehors. Nous allons de l’avant, nous abandonnant au courant; quant à rebrousser chemin et faire que nos pensées se reportent sur nous, c’est trop pénible; nous en éprouvons ce même trouble, cette même résistance que la mer rejetée sur elle-même. Chacun dit: Regardez les mouvements des corps célestes; regardez votre prochain: la querelle de celui-ci, le pouls d’un tel, le testament de cet autre; en somme, regardez toujours soit en haut, soit en bas, soit à côté, soit en avant, soit derrière vous. Le commandement que, dans l’antiquité, nous faisait le dieu de Delphes était paradoxal: Regardez en vous, disait-il, étudiez-vous; tenez-vous-en à vous-même; ramenez sur vous votre esprit et votre volonté que vous appliquez ailleurs; au lieu de vous déverser, de vous répandre, contenez-vous, soutenez-vous, car on vous trahit, on vous réduit à rien, on vous dérobe à vous-même. Ne vois-tu pas qu’au contraire, tout en ce monde a les regards constamment repliés sur lui-même et n’a d’yeux que pour se contempler soi-même? Toi, que tu regardes en dedans ou en dehors de toi, ta vanité est toujours en jeu; tout au plus est-elle moindre quand elle s’exerce dans des conditions restreintes. Sauf toi, ô homme, disait encore l’oracle, chaque chose commence par s’étudier elle-même et, selon ses propres besoins, limite ses travaux et ses désirs; eh bien, il n’en est pas une seule qui soit aussi dépourvue et que la nécessité presse autant que toi, qui embrasses l’univers: tu es un observateur auquel la science fait défaut, un magistrat sans juridiction, et finalement le bouffon de la comédie.
485
Montaigne ne se passionnait pour rien, se gardait de prendre aucun engagement, résistait même à ce à quoi le poussaient ses propres affections pour n’être pas entraîné, parce qu’une fois pris on ne sait plus où l’on va.—Si je me compare à la généralité des hommes, peu de choses me touchent, ou, pour mieux dire, me captivent; car c’est avec raison qu’elles nous touchent, mais il ne faut pas qu’elles nous accaparent. J’ai grand soin d’augmenter, par l’étude et le raisonnement, ce privilège que j’ai d’être insensible qui, par nature, est fort prononcé chez moi, et a pour conséquence que peu de choses s’imposent à moi et me passionnent. J’ai de la perspicacité, mais je la reporte sur peu d’objets; je suis sensible et facile à émouvoir, mais ai la compréhension et l’application difficiles et concentrées.—Je ne me décide qu’à grand’peine à prendre des engagements; autant que je le puis, je ne m’emploie que pour moi; et, même dans ce cas, je suis porté à tenir en bride et contenir l’affection que je me porte, pour que ce sentiment ne m’envahisse pas complètement, parce qu’il me met à la merci des autres et que le hasard a sur lui plus d’action que moi-même; c’est au point que jusqu’à la santé que j’apprécie tant, je devrais me défendre de la désirer et de m’attacher à sa conservation avec une ardeur telle que j’en arrive à trouver les maladies insupportables. On doit se garder également de trop de haine de la douleur et de trop d’amour du bien-être; Platon recommande de diriger notre vie en la tenant dans un juste milieu entre ces deux extrêmes.—Quant à ces affections qui me distraient de moi pour m’attacher ailleurs, je leur résiste dans toute la mesure de mes forces. J’estime qu’il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même. Si ma volonté était facile à s’engager et à entrer en action, je n’y résisterais pas, parce que je suis, par nature, trop impressionnable, et en fait, «ennemi des affaires et né pour la tranquillité et le repos (Ovide)». Des débats contradictoires et opiniâtres tournant finalement à l’avantage de mon adversaire, un dénouement qui rendrait ridicules des poursuites ardentes que j’aurais entamées, me feraient cruellement souffrir. Si, comme tant d’autres, je m’y laissais entraîner, mon âme n’aurait jamais la force de supporter les alarmes et les émotions qu’éprouvent ceux qui acceptent une telle existence; elle serait, dès le début, disloquée par cette agitation intestine. Si quelquefois on 487 m’a poussé à participer à la gestion d’affaires autres que les miennes, je n’ai promis que de les prendre en main et non de m’y donner corps et âme; de m’en charger, mais non de m’y incorporer; de m’en occuper, oui, et pas du tout de m’y passionner; je les examine, mais ne les couve pas. J’ai assez à faire pour mettre de l’ordre dans ce qui me touche intimement et intéresse tout mon être, à le régler, sans encore me mêler et me fatiguer de questions qui me sont étrangères; mes propres affaires, qui m’incombent naturellement et au premier chef, m’absorbent assez, sans y en joindre d’autres qui sont en dehors. Ceux qui savent combien ils se doivent à eux-mêmes et à quel point ils ont d’obligations à cet égard, trouvent que la charge que la nature leur a ainsi imposée est suffisamment lourde, et ne constitue pas une sinécure: «Tu as bien assez grandement à faire chez toi, ne t’en éloigne pas.»
Beaucoup se font les esclaves des autres, se prodiguant pour s’employer à ce qui ne les regarde pas; il ne manque cependant pas sur notre route de mauvais pas dont il nous faut chercher à nous garder nous-mêmes.—Les hommes se donnent en location; ce n’est pas pour eux-mêmes qu’ils doivent user de leurs facultés, mais pour ceux dont ils se sont faits les esclaves; ce sont ceux auxquels ils se sont loués qui sont en eux, et non eux. Cette disposition d’esprit, qui est fort répandue, ne me plaît pas. Il faut ménager la liberté de notre âme et ne l’engager que dans les circonstances où il est juste de le faire; et ces circonstances sont en petit nombre, si nous en jugeons sainement.—Voyez les gens disposés à se laisser appréhender et accaparer; ils se laissent ainsi faire en toutes choses pour les petites comme pour les grandes, pour ce qui les touche et ce qui ne les touche pas; ils s’ingèrent, sans plus y regarder, partout où il y a à travailler et * des obligations à remplir; ils ne vivent pas s’ils ne s’agitent à outrance: «Ils ne recherchent la besogne que pour avoir de la besogne (Sénèque).» Ce n’est pas tant parce qu’ils veulent toujours aller que parce qu’ils ne peuvent se retenir, ni plus ni moins qu’une pierre ébranlée qui se détache et va, ne s’arrêtant dans sa chute que parce qu’elle ne peut rouler davantage. Pour certaines gens, s’occuper c’est faire preuve de capacité et de dignité; leur esprit cherche le repos dans le mouvement, comme font les enfants encore au berceau; ils peuvent se rendre ce témoignage qu’ils sont aussi serviables pour leurs amis, qu’importuns à eux-mêmes. Personne ne distribue son argent à autrui, et chacun lui distribue son temps et sa vie, choses dont nous sommes prodigues plus que de toutes autres et les seules cependant dont il nous serait utile et louable d’être avares. Mon tempérament est essentiellement différent: je m’observe et, d’ordinaire, ne tiens pas outre mesure à ce que je désire et désire peu; je ne m’occupe et ne me crée de travail que dans ces conditions, rarement et sans que cela porte atteinte à ma tranquillité. A tout ce que veulent et entreprennent ces gens qui se prodiguent, ils apportent toute leur volonté et leur impétuosité. 489 Il y a en ce monde tant de mauvais pas, que, même dans les cas présentant le plus de sécurité, il faut poser le pied légèrement et superficiellement, glisser et ne pas appuyer; la volupté elle-même est douloureuse quand on va trop à fond: «Tu marches sur un feu couvert de cendres perfides (Horace).»
Élu maire de Bordeaux, Montaigne n’accepte cette charge qu’à son corps défendant; portrait qu’il fit de lui à Messieurs de Bordeaux.—Messieurs de Bordeaux m’élurent maire de leur ville, alors que j’étais éloigné de France, et plus éloigné encore de penser que cela pouvait arriver. Je m’en excusai, mais on me démontra que je ne pouvais refuser, à quoi vint s’ajouter un ordre du roi d’accepter.—C’est une charge qui est d’autant plus belle qu’elle n’est ni rétribuée, ni de nature à procurer de bénéfice autre que l’honneur résultant de la façon dont on s’en acquitte. Sa durée est de deux ans, mais elle peut être continuée si on est élu à nouveau, ce qui arrive très rarement: je l’ai été; cela ne s’était produit auparavant que deux fois, il y avait quelques années pour M. de Lansac, et récemment pour M. de Birou, maréchal de France, auquel je succédais; j’ai été remplacé par M. de Matignon, qui était aussi maréchal de France, «l’un et l’autre habiles administrateurs et braves guerriers (Virgile)»; je suis fier de m’être trouvé en si noble compagnie. La fortune a largement participé à cet événement et son intervention n’a pas été vaine; mon cas, en effet, a été celui d’Alexandre qui, ayant reçu d’abord avec dédain les ambassadeurs de Corinthe venus pour lui offrir le droit de bourgeoisie de leur ville, accepta ensuite en les remerciant de bonne grâce, quand ils lui eurent appris que Bacchus et Hercule figuraient au nombre de ceux auxquels ce titre avait été concédé.
Dès mon arrivée, je me fis connaître exactement et consciencieusement tel que je me sens être: sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans énergie, mais aussi sans haine, sans ambition, sans violence, de telle sorte qu’on fût informé et instruit de ce que l’on avait à attendre de moi. Comme je devais mon élection uniquement à ce que l’on avait connu mon père et que c’était pour honorer sa mémoire, j’ajoutai très nettement que je serais fort désolé si une chose, quelle qu’elle fût, venait à occuper ma volonté au même degré que les affaires de la ville avaient jadis accaparé la sienne quand il en avait la gestion, alors qu’il était investi de ces mêmes fonctions auxquelles je venais d’être appelé. Je me souvenais l’avoir vu dans sa vieillesse, alors que j’étais enfant, l’âme cruellement agitée par les tracasseries que lui causaient les affaires publiques, oubliant et le calme dont il jouissait chez lui où les fatigues de l’âge l’avaient longtemps retenu avant ce moment, et son ménage et sa santé; ne comptant en vérité pour rien la vie, qu’il avait failli y perdre, par suite des longs et pénibles voyages auxquels ces intérêts l’obligeaient. Il était ainsi; ce tempérament était un effet de la grande bonté de sa nature; jamais il n’y eut d’âme plus charitable et dévouée au peuple. Ces dispositions que je loue chez 491 les autres, je ne me les approprie pas; et, en cela, je ne suis pas sans excuse.
On enseigne que nous devons nous oublier et ne travailler qu’au bien d’autrui; est-ce raisonnable? Le vrai sage qui sait bien ce qu’il se doit, trouve par là même ce qu’il doit aux autres.—Mon père avait ouï dire qu’il faut s’oublier pour son prochain; que l’intérêt particulier n’est pas à prendre en considération, quand l’intérêt général est en jeu.—La plupart des règles et des préceptes de ce monde abondent dans ce sens, tendant à nous pousser hors de nous-mêmes et à y substituer ce qui importe au service de la société. Cela est vraiment bien imaginé de nous détourner et de nous distraire ainsi de ce qui nous intéresse directement, par crainte que nous y trouvant déjà naturellement portés, nous n’y tenions trop; rien n’a été épargné pour en arriver là. Ce n’est du reste pas une nouveauté; les sages ne prêchent-ils pas de n’avoir de considération pour les choses qu’en raison de leur utilité, et non d’après ce qu’elles sont? La vérité nous est souvent une cause d’empêchements, d’incompatibilités; nous devons fréquemment tromper, pour ne pas nous tromper; il nous faut fermer les yeux, imposer silence à notre jugement, pour redresser et corriger les conclusions résultant de ces difficultés qu’elle nous crée: «Ce sont des ignorants qui jugent, et il faut souvent les tromper pour les empêcher de tomber dans l’erreur (Quintilien).» Nous ordonner de faire passer avant nous dans notre affection, trois, quatre, cinquante catégories de choses, c’est faire comme les archers qui, pour atteindre le but, visent beaucoup plus haut; pour redresser une baguette infléchie, il faut la courber en sens inverse.
J’estime que dans le culte de Pallas, il y avait, comme nous le voyons dans toutes les religions des mystères apparents destinés à être divulgués au public et d’autres plus secrets et d’ordre plus élevé, auxquels n’étaient initiés que les adeptes. Il est vraisemblable que dans ces derniers, était compris le degré exact d’amitié que chacun se doit à lui-même; non cette amitié de mauvais aloi qui nous fait rechercher d’une façon immodérée la gloire, la science, la richesse, etc., et les mettre au premier rang de notre affection comme parties intégrantes de notre être, ni cette amitié sans consistance et indiscrète comme celle que porte le lierre aux parois auxquelles il s’attache, qu’il pourrit et qu’il ruine; mais une amitié saine et réglée, non moins utile qu’agréable. Qui en connaît les devoirs et les exerce, est véritablement inspiré des Muses; il atteint au sommet de la sagesse humaine et du bonheur; sachant exactement ce qu’il se doit, il trouve que le rôle qui lui est dévolu comporte d’utiliser pour lui-même le concours des autres hommes et du monde et que, pour cela, il lui faut contribuer aux devoirs et aux charges de la société dont il fait partie. Celui qui ne vit en rien pour autrui, ne vit guère non plus pour lui-même: «L’ami de soi-même est aussi, sachez-le, l’ami des autres (Sénèque).» La principale charge que nous ayons, c’est de nous conduire; c’est pour 493 cela que nous sommes sur terre. Celui qui oublierait de vivre honnêtement, saintement, et croirait être quitte de son devoir en exhortant et disposant les autres à vivre ainsi, serait un sot; de même celui qui, pour son propre compte, néglige de vivre convenablement et gaîment, se sacrifiant pour faire qu’autrui vive de la sorte, prend à mon gré un parti mauvais et qui n’est pas dans l’ordre de la nature.
Il faut se dévouer aux charges que l’on occupe, mais il ne faut ni qu’elles nous absorbent ni qu’elles nous passionnent, ce qui nous conduirait à manquer de prudence et d’équité.—Je ne veux pas qu’on refuse aux charges qu’on accepte son attention, ses pas et démarches, son don de parole, sa fatigue, au besoin même son sang: «tout prêt moi-même à mourir pour mes amis et ma patrie (Horace)»; seulement ce ne doit être qu’un prêt momentané et accidentel, l’esprit demeurant toujours au repos et en santé, n’être pas inactif, mais n’agir ni malgré lui ni entraîné par la passion. Agir simplement lui coûte si peu, qu’il agit même en dormant, aussi faut-il ne le mettre en branle qu’avec discrétion; car lorsque le corps que l’on charge, semble pas en être surchargé, l’esprit s’imagine qu’il peut plus encore et, n’écoutant que lui-même, donne parfois à ses exigences une extension et une augmentation souvent préjudiciables. Une même chose demande parfois des efforts physiques différents et une force de volonté qui n’est pas toujours la même, l’un va fort bien sans l’autre. Combien de gens se hasardent tous les jours dans des guerres qui leur sont indifférentes, et affrontent le danger dans des batailles dont la perte, s’ils viennent à être battus, ne troublera pas leur sommeil durant la nuit qui vient; tel autre, au contraire, demeuré chez lui à l’abri de dangers auxquels il n’ose même pas penser, est plus passionné pour l’issue de cette guerre, et en a l’âme plus obsédée que le soldat qui y expose son sang et sa vie. Je ne suis guère disposé à me mêler des affaires publiques s’il doit m’en coûter si peu que ce soit, ni à me donner aux autres en m’arrachant à moi-même.—Apporter de l’âpreté et de la violence pour obtenir la réalisation de ses désirs, nuit plus que cela ne sert au résultat que l’on poursuit; nous devenons impatients si les événements sont contraires ou se font attendre; nous sommes aigris et le soupçon nous gagne contre ceux avec lesquels nous sommes en affaire. Nous ne conduisons jamais bien une chose qui nous possède et nous mène: «la passion est un mauvais guide (Stace)». Celui qui n’y emploie que son jugement et son adresse, agit avec plus d’à propos: il dissimule, cède, diffère à son aise, selon que les circonstances le comportent; s’il échoue, c’est sans en éprouver ni tourment ni affliction; il est tout prêt à renouveler sa tentative, il marche toujours maître de lui. Chez celui qu’enivre la violence et qui veut quand même, la nécessité l’amène à commettre beaucoup d’imprudences et d’injustices; l’impétuosité de son désir l’emporte, il devient téméraire; et si la fortune ne lui vient beaucoup en aide, ce qu’il obtient 495 est peu de chose.—La philosophie veut que nous bannissions la colère quand nous punissons ceux qui nous ont offensés; non pour que notre vengeance soit moindre, mais pour qu’au contraire elle n’en porte que mieux et frappe davantage, ce à quoi, lui semble-t-il, la violence met obstacle. Non seulement la colère nous trouble mais, par elle-même, elle lasse le bras qui châtie; c’est un feu qui nous étourdit et épuise notre force, comme dans la précipitation où la hâte se donne à elle-même un croc-en-jambe qui l’entrave et l’arrête: «Trop se hâter est une cause de retard; la précipitation retarde plus qu’elle n’avance (Quinte Curce).» Comme exemple de ce que nous en voyons journellement, l’avarice n’a pas de plus grand empêchement qu’elle-même; plus elle est rapace et intransigeante, moins elle rapporte; d’ordinaire, elle attire à elle plus rapidement le bien d’autrui, quand elle agit sous le masque de la libéralité.
Supériorité d’un prince qui savait se mettre au-dessus des accidents de la fortune. Même au jeu, il faut être modéré; nous le serions plus, si nous savions combien peu nous est nécessaire.—Un gentilhomme de mes amis, très honnête homme, faillit compromettre sa raison pour avoir pris trop à cœur les affaires d’un prince son maître et y avoir apporté une attention trop passionnée. Ce prince s’est lui-même peint ainsi qu’il suit: «Tout comme un autre, il ressent le poids des accidents; pour ceux auxquels il n’y a pas de remède, il se résout immédiatement à en supporter les conséquences; pour les autres, après avoir ordonné les précautions nécessaires pour y parer, ce que, grâce à la vivacité de son esprit, il peut faire promptement, il attend avec calme ce qui peut s’ensuivre.» De fait, je l’ai vu à l’œuvre, conservant une grande indifférence, toute sa liberté d’action et la plus complète impassibilité dans des situations de très haute importance et bien difficiles; je le tiens pour plus grand et plus capable dans la mauvaise fortune que dans la bonne; ses défaites sont plus glorieuses que ses victoires, ses insuccès que ses triomphes.
Même dans ce qui est vain et frivole, comme au jeu d’échecs, de paume et autres, apporter de l’âpreté et de l’ardeur au service d’un violent désir de l’emporter, fait qu’aussitôt notre esprit et nos membres ne se dirigent plus et que leurs mouvements deviennent désordonnés; on s’éblouit, on s’embarrasse soi-même. Celui qui envisage avec plus de modération le gain et la perte, est toujours maître de lui; moins on se pique, moins on se passionne au jeu, plus on le conduit avantageusement et plus on augmente ses chances.
Nous empêchons l’âme de prendre et de conserver, quand nous lui donnons trop à saisir; pour certaines choses il suffit de les lui présenter, pour d’autres de les lui attacher, d’autres sont à lui incorporer. Elle peut tout voir et sentir, mais ce n’est que d’elle-même qu’elle doit se sustenter; et, pour cela, il faut qu’elle ait été instruite de ce qui l’intéresse particulièrement, lui convient et qu’elle peut s’assimiler. Les lois de la nature nous donnent justement cet enseignement. 497 D’après la nature, disent les sages, personne n’est indigent (d’après nous, nous le sommes tous), et ils vont distinguant les désirs qu’elle nous inspire de ceux qui nous viennent du déréglement de notre imagination: ceux qui peuvent se réaliser viennent d’elle, ceux qui fuient devant nous, sans que nous puissions jamais les satisfaire, sont de nous; la pauvreté de biens est aisée à guérir, la pauvreté de l’âme impossible: «Si l’homme se contentait de ce qui lui suffit, je serais assez riche; mais comme il n’en est rien, quelles richesses pourraient jamais me satisfaire (Lucilius)?»—Socrate voyant transporter en grande pompe, à travers la ville, des richesses en quantité: joyaux, meubles de prix, etc., dit: «Que de choses il y a là, que je ne désire pas!»—Douze onces d’aliment par jour suffisaient pour vivre à Métrodore; Épicure se suffisait avec moins encore; Métroclès dormait en hiver avec les moutons, en été dans les cloîtres des temples: «La nature pourvoit à ce qu’elle exige (Sénèque)»; Cléanthe vivait du travail de ses mains et se vantait de pouvoir, s’il l’eût voulu, nourrir en plus un autre lui-même.
Les besoins que nous tenons de la nature sont faciles à satisfaire; nos habitudes, notre position dans le monde, notre âge, nous portent à en étendre le cercle; c’est dans ces limites que nous devons les contenir.—Si ce que la nature, s’en tenant aux seuls besoins que nous avions à l’origine, demande pour assurer strictement la conservation de notre existence est trop peu de chose (et il est de fait que nous pouvons vivre à bon marché, ce qui apparaît bien quand on remarque qu’il nous faut si peu que, par sa petitesse, cela échappe à l’étreinte et aux coups de la fortune), octroyons-nous quelque chose de plus; comprenons dans ce que nous appelons la nature, les habitudes et la situation de chacun de nous, et d’après cela fixons nos besoins et nos aspirations, tenant compte de ce que déjà nous possédons. Il semble en effet que, dans ces limites, nous soyons quelque peu excusables d’agir ainsi, car l’habitude est une seconde nature non moins puissante que la nature elle-même. Ce qui me manque et dont j’ai l’habitude, je considère que cela me fait réellement défaut; j’aimerais presque autant qu’on m’ôtât la vie, que de me la rétrécir en restreignant notablement les conditions dans lesquelles j’ai vécu si longtemps. Je ne suis plus à même de supporter de grands changements, ni de mener un train différent du mien, même si je devais y gagner. Il n’est plus temps de devenir autre; et, de même que si quelque grande fortune venait à m’échoir actuellement, je me plaindrais qu’elle ne me soit pas arrivée alors que je pouvais en jouir: «A quoi me servent des biens dont je ne puis user (Horace)?» je me plaindrais également de toute nouvelle acquisition morale. Il vaut presque mieux ne jamais devenir honnête homme et ne jamais bien comprendre la conduite de la vie, que d’en arriver là quand on n’a plus de temps devant soi.—Moi qui m’en vais, je céderais volontiers à quelqu’un qui vient, l’expérience que j’acquiers sur la prudence à observer dans les affaires de ce monde; c’est de la moutarde 499 après dîner. Je n’ai que faire de biens dont je n’ai pas emploi; à quoi sert la science à qui n’a plus de tête? La fortune nous offense et nous joue un mauvais tour, en nous offrant des présents, dont nous sommes à juste titre dépités de ce qu’ils nous ont manqué au bon moment. Je n’ai plus besoin de guide, quand je ne puis plus marcher. De toutes les qualités dont nous pouvons être doués, la patience me suffit maintenant. A quoi bon une voix magnifique à un chantre qui a les poumons perdus, et l’éloquence à un ermite relégué au fond des déserts de l’Arabie. Il n’y a pas besoin de s’ingénier à faire une fin; en chaque chose, elle survient d’elle-même. Mon monde à moi est fini; les gens de mon espèce disparaissent; j’appartiens tout entier au passé; je ne puis faire autrement que d’approuver cet état de choses et d’y conformer mes derniers jours.—J’en donnerai un exemple: Cette innovation qui a supprimé dix jours d’une année, introduite par le pape, est survenue alors que j’étais déjà si près de ma fin, que je ne puis m’y faire; je suis d’une époque où les années se supputaient autrement. Un si long et si antique usage me revendique et j’y demeure attaché; incapable d’accepter des nouveautés, même quand elles constituent des rectifications, je suis dans l’obligation d’être en cela quelque peu hérétique. Mon imagination, malgré tous mes efforts, fait que je me trouve toujours de dix jours en avance ou de dix jours en retard; elle ne cesse de me murmurer à l’oreille: «Cette modification ne regarde que ceux dont l’existence ne touche pas à son terme.»—Même la santé, chose pourtant si douce, si, par intervalles, je viens à la retrouver, j’en éprouve plus de regret que de jouissance: je n’ai plus comment en profiter. Le temps m’abandonne, et, sans lui, nous ne possédons rien. Oh! que j’attache donc peu de prix à ces grandes dignités conférées à l’élection, qui ne s’attribuent qu’à des gens prêts à quitter ce monde et dont, quand on les a, on ne s’inquiète pas tant de quelle façon on pourra les exercer, que du peu de temps durant lequel on les détiendra; dès l’entrée en fonctions, on songe au moment où il faudra les quitter. En résumé, je touche à ma fin et ne suis point en voie de me refaire. Par suite d’un long usage, mon état actuel est devenu partie intégrante de moi-même; ce que la fortune m’a fait, constitue ma nature.
Je dis donc que, disposés à la faiblesse comme nous le sommes, chacun de nous est excusable de considérer comme lui revenant, tout ce qui est dans la mesure de notre état accoutumé; mais aller au delà, c’est tomber dans la confusion: c’est là la plus large concession que nous puissions faire à nos droits. Plus nous augmentons nos besoins et ce que nous possédons, plus nous nous exposons aux coups de la fortune et de l’adversité. L’étendue de nos désirs doit être circonscrite et restreinte de manière à ne comprendre que les commodités les plus proches de nous, celles qui nous sont contiguës, et cette zone ne pas se prolonger indéfiniment en ligne droite, mais se replier en courbe, dont les extrémités se rejoignent en ne s’écartant de nous que le moins possible. 501 Les agissements qui se produisent sans que nous les ramenions ainsi à nous (et ce mouvement réflexe, je le tiens pour essentiel et devant se produire à bref délai pour avoir son effet utile), comme sont ceux des avares, des ambitieux et tant d’autres qui poursuivent avec acharnement une idée qui les emporte toujours droit devant eux, sont des agissements erronés et maladifs.
C’est folie de s’enorgueillir de l’emploi que l’on occupe; notre personnalité doit demeurer indépendante des fonctions que nous remplissons.—La plupart des fonctions publiques tiennent de la farce: «Tout le monde joue la comédie (Pétrone).» Il faut jouer convenablement son rôle, mais en lui conservant le caractère d’un personnage emprunté; il ne faut pas que le masque et l’apparence deviennent chez nous une réalité, ni faire que ce qui nous est étranger s’incarne en nous; nous ne savons distinguer la peau de la chemise; c’est assez de s’enfariner le visage sans s’enfariner encore la poitrine. J’en vois qui se transforment et s’identifient en autant de figures et d’êtres différents qu’ils ont de charges à remplir; tout en eux pontifie jusqu’au foie et aux intestins, et, jusque dans leur garde-robe, ils agissent comme s’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions. Que ne puis-je leur apprendre à distinguer parmi les salutations qu’ils reçoivent, celles qui s’adressent à eux-mêmes de celles qui s’adressent au mandat qu’ils ont reçu, à la suite qui les accompagne, ou à la mule qui les porte: «Ils s’abandonnent tellement à leur fortune qu’ils en oublient leur nature même (Quinte Curce)»; ils enflent, grossissent leur âme et leur jugement naturel pour les élever à hauteur du siège qu’ils occupent comme magistrats. Montaigne maire et Montaigne simple particulier ont toujours été deux hommes tout à fait distincts, la séparation en était bien nette. De ce qu’on est avocat ou financier, il ne faut pas méconnaître ce que ces professions mettent en jeu de fourberie; un honnête homme n’est pas responsable du vice ou de la sottise de son métier et ne doit pas pour eux décliner de l’exercer, c’est l’usage de son pays et il y a bénéfice; il faut vivre du monde et en tirer profit, en en usant tel qu’on le trouve. Mais le jugement d’un empereur doit s’élever au-dessus de son empire qu’il lui faut voir et considérer comme chose qui lui est étrangère, s’en abstrayant, par moments, pour jouir de son propre fond, et s’entretenir avec lui-même tout autant pour le moins que font Jacques et Pierre.
Si l’on embrasse un parti, ce n’est pas un motif pour en excuser toutes les exagérations; il faut reconnaître ce qui est mal en lui, comme ce qui est bien dans le parti adverse.—Je ne sais pas m’engager si profondément et si complètement; et, quand ma volonté me fait me donner à un parti, je ne me crée pas de si violentes obligations que mon jugement en soit vicié. Dans les troubles qui agitent actuellement ce pays, les intérêts que je sers n’ont pas fait que j’aie méconnu chez nos adversaires leurs qualités dignes d’éloge, pas plus que celles qui, chez 503 ceux dont j’ai embrassé le parti, sont à blâmer. On est porté à adorer tout ce que font les siens; moi, je n’excuse même pas la plupart de ce qui se fait du côté où je suis; un bon ouvrage ne perd pas de son mérite, parce qu’il est écrit contre moi; hors le nœud du débat, car je suis et demeure catholique, je me maintiens dans une modération et une indifférence absolues, «hors les nécessités de la guerre, je ne veux aucun mal à l’ennemi»; ce dont je me félicite d’autant plus, que je vois communément donner dans le défaut contraire: * «Que celui-là s’abandonne à la passion, qui ne peut suivre la raison (Cicéron).» Ceux qui étendent leur colère et leur haine au delà des affaires qui les motivent, comme font la plupart des gens, montrent que l’origine en est ailleurs et provient d’une cause personnelle, de même que lorsque la fièvre persiste chez quelqu’un après qu’il est guéri d’un ulcère, c’est un indice qu’elle dérive d’une autre cause que nous ne saisissons pas. Eux n’en veulent pas à la cause contre laquelle chacun s’arme parce qu’elle blesse l’intérêt général et celui de l’état, ils lui en veulent uniquement de ce qu’elle les atteint dans leurs intérêts privés; et voilà pourquoi ils y apportent une animosité personnelle qui dépasse ce que comportent la justice et la raison telles qu’elles se comprennent généralement: «Ils ne s’accordaient pas tous à blâmer toutes choses, mais chacun d’eux censurait ce qui l’intéressait personnellement (Tite-Live).» Je veux que l’avantage nous reste, mais je ne me mets pas hors de moi s’il en est autrement. Je m’attache sincèrement au parti que je crois le meilleur, mais je ne m’affecte pas de me faire particulièrement remarquer comme ennemi des autres, et n’outrepasse pas ce que, d’une façon générale, commande la raison. Je blâme très vertement des propos de cette sorte: «Il est de la Ligue, car c’est un admirateur de la bonne grâce de M. le duc de Guise.—Il s’émerveille de l’activité du roi de Navarre, donc c’est un huguenot.—Il trouve à redire aux mœurs du roi, au fond du cœur c’est un séditieux.» Je ne concède même pas à un magistrat qu’il ait raison de condamner un livre, parce qu’il s’y trouve indiqué qu’un hérétique est l’un des meilleurs poètes de ce siècle. Se peut-il que nous n’osions dire d’un voleur qu’il a une belle jambe; et est-il obligatoire qu’une fille publique sente mauvais? Dans les siècles où régnait plus de sagesse, a-t-on révoqué ce superbe titre de Capitolinus, décerné tout d’abord à Marcus Manlius pour avoir sauvé la religion et la liberté publique? Étouffa-t-on le souvenir de sa libéralité, de ses faits d’armes, des récompenses militaires accordées à son courage, lorsque plus tard, mettant en péril les lois de son pays, il aspira à la royauté? De ce qu’on prend en haine un avocat, s’ensuit-il que le lendemain il cesse d’être éloquent? J’ai parlé ailleurs du zèle qui fait tomber les gens de bien dans de semblables fautes; pour moi, je sais fort bien dire: «En cela, il se conduit en malhonnête homme, et, en ceci, fait acte de vertu.» On voudrait que lorsque des pronostics ou des événements fâcheux viennent à se produire, chacun, suivant le parti 505 auquel il appartient, soit frappé d’aveuglement ou d’imbécillité, et qu’il les vît, non tels qu’ils sont, mais tels qu’on les désire; je pécherais plutôt par l’excès opposé tant je crains que mon désir ne m’influence, d’autant que je me défie un peu des choses que je souhaite.
Facilité extraordinaire des peuples à se laisser mener par les chefs de parti.—J’ai vu, de mon temps, des choses extraordinaires dénotant avec quelle facilité incompréhensible, inouïe, les peuples, quand il s’agit de leurs croyances et de leurs espérances, se laissent mener et endoctriner comme il plaît à leurs chefs, suivant l’intérêt que ceux-ci y trouvent (cela, malgré cent mécomptes s’ajoutant les uns aux autres), et prêtent toute créance aux fantômes et aux songes. Je ne m’étonne plus que les singeries d’Apollonius et de Mahomet aient séduit tant de gens. La passion étouffe entièrement chez eux le bon sens et le jugement; leur discernement ne distingue plus que ce qui leur rit et sert leur cause. Je l’avais déjà remarqué d’une façon indiscutable dans le premier des partis qui se sont formés chez nous et qui s’est montré si violent; cet autre, venu depuis, l’imite et le dépasse; d’où je conclus que c’est là un défaut inséparable des erreurs populaires. Après la première opinion dissidente qui surgit, d’autres s’élèvent; semblables aux flots de la mer, elles se poussent les unes les autres suivant le sens du vent; on n’est pas du bloc, si on peut s’en dédire, si on ne suit pas le mouvement général. Il est certain qu’on fait tort aux partis qui ont la justice pour eux, quand on veut employer la fourberie à leur service; c’est un procédé que j’ai toujours réprouvé, c’est un moyen qui n’est bon à employer qu’avec ceux qui ont la tête malade; avec ceux qui l’ont saine, il y a des voies non seulement plus honnêtes, mais plus sûres pour soutenir les cœurs et excuser les accidents qui nous sont contraires.
Différence entre la guerre que se faisaient César et Pompée, et celle qui eut lieu entre Marius et Sylla; avertissement à en tirer.—Le ciel n’a jamais vu, et ne verra jamais, un différend aussi grave que celui entre César et Pompée; il me semble toutefois reconnaître en ces deux belles âmes une grande modération de l’une vis-à-vis de l’autre. Ce fut une rivalité d’honneur et de commandement, qui ne dégénéra jamais en une haine furieuse et sans merci; la méchanceté et la diffamation y demeurèrent étrangères; dans leurs actes les plus acerbes, je trouve quelque reste de respect et de bienveillance; et j’estime que s’il leur eût été possible, chacun d’eux eût désiré triompher sans causer la ruine de l’autre, plutôt qu’en la causant. Combien il en est autrement de Marius et de Sylla, prenez-y garde.
Du danger qu’il y a à être l’esclave de ses affections.—Il ne faut pas nous solidariser si éperdument avec nos affections et nos intérêts. Quand j’étais jeune, je combattais les progrès que l’amour faisait en moi lorsque je les sentais trop prononcés, et m’étudiais à faire qu’il ne me fût pas tellement agréable, qu’il ne finît 507 par l’emporter et que je fusse complètement à sa merci. J’en use de même dans toutes les autres occasions où ma volonté se prend trop violemment: je fais effort en sens contraire de celui vers lequel elle incline, suivant que je la vois entraînée et m’enivrer de son vin; j’évite de nourrir son plaisir à un degré tel, que je ne puisse plus en redevenir maître, sans qu’il y ait effusion de sang.—Les âmes qui, par stupidité, ne voient les choses qu’à demi, jouissent de cette chance, que ce qui est nuisible les atteint moins; c’est une sorte de lèpre morale qui a des effets analogues à ceux produits par la santé et que, pour cela, les philosophes ne dédaignent pas complètement; ce n’est pas cependant une raison pour la qualifier de sagesse, ainsi que nous le faisons souvent. C’est pour cela que quelqu’un raillait jadis Diogène qui, tout nu, en plein hiver, pour exercer sa résistance au mal, tenait embrassée une statue de neige; le rencontrant dans cette attitude, il lui dit: «Eh bien! as-tu grand froid maintenant?—Mais, pas du tout, répondit Diogène.—En ce cas, répliqua son interlocuteur, que penses-tu donc faire de difficile et d’exemplaire, en te tenant ainsi?» Pour donner la mesure de notre fermeté, il est indispensable de connaître la souffrance à laquelle elle est capable de résister.
Il faut s’efforcer de prévenir ce qui dans l’avenir peut nous attirer peines et difficultés.—Les âmes susceptibles de se trouver en face d’événements contraires, qui sont exposées aux coups de la fortune dans toute leur intensité et leur acuité, qui ont à les endurer et à les ressentir dans la plénitude de leur poids et de leur amertume, doivent mettre tout leur art à ne pas les provoquer et éviter les circonstances qui peuvent les amener. Ainsi fit le roi Cotys; on lui avait offert de la vaisselle riche et de toute beauté; il la paya libéralement; mais, comme elle était d’une fragilité extrême, il la brisa lui-même sur-le-champ pour s’ôter immédiatement une occasion trop facile de se mettre en colère contre ses serviteurs.—Je me suis de même volontiers appliqué à ce que mes affaires ne soient pas mêlées à celles d’autrui, et n’ai pas cherché à avoir des terres contiguës à celles de personnes qui me soient parentes ou avec lesquelles je sois lié d’étroite amitié; c’est d’ordinaire une source de discorde et de désunion.—J’aimais autrefois les jeux de hasard, tels que les cartes et les dés; j’y ai renoncé, il y a longtemps, parce que quelque beau joueur que je me montrasse, quand je perdais, je n’en ressentais pas moins, en dedans, une vive contrariété.—Un homme d’honneur, qu’un démenti ou une injure atteint au cœur, qui n’est pas de ceux qui acceptent en dédommagement et que console une mauvaise excuse, doit se garder de s’immiscer dans les affaires douteuses et les altercations qui peuvent dégénérer en conflit.—Je fuis les caractères tristes, les gens hargneux, autant que ceux atteints de la peste; et, à moins que le devoir ne m’y oblige, je ne me mêle pas aux discussions portant sur des questions auxquelles je m’intéresse et de nature à m’émouvoir: «Il est plus facile de ne pas commencer que de s’arrêter (Sénèque).» 509 La plus sûre façon est donc d’être prêt à tout événement, avant qu’il ne se produise.
Quelques âmes fortement trempées affrontent les tentations; il est plus prudent à celles qui ne s’élèvent pas au-dessus du commun, de ne point s’y exposer et de maîtriser ses passions dès le début.—Je sais bien que quelques sages s’y sont pris autrement et n’ont pas craint, dans des circonstances diverses, de s’empoigner et de s’attaquer corps à corps avec ce qu’ils réprouvaient; ce sont là gens qui ont une force d’âme dont ils sont sûrs et sous laquelle ils s’abritent pour résister aux revers de toute nature qu’ils peuvent éprouver, opposant au mal une patience à toute épreuve: «Tel un rocher qui s’avance dans la vaste mer et qui, exposé à la furie des vents et des flots, brave les menaces et les efforts du ciel et de la mer conjurés, et demeure lui-même inébranlable (Virgile).»
N’entreprenons pas d’imiter de tels exemples, nous n’y arriverions pas; ces sages ont jusqu’à la force d’assister résolument et sans se troubler à la ruine de leur pays, auquel ils ont fait le complet abandon de leur volonté, la subordonnant à ses intérêts; pour nous qui sommes moins bien trempés, un pareil effort est trop rude. Caton lui sacrifia la plus noble vie qui fut jamais; nous autres, gens de petite taille, il nous faut fuir devant l’orage, et agir suivant ce que nous dicte notre instinct, au lieu de nous résigner; il nous faut esquiver les coups que nous ne sommes pas en état de parer.—Zénon, voyant approcher pour s’asseoir près de lui, Chrémonide, jeune homme dont il était épris, quitta aussitôt sa place; Cléanthe lui en demandant la raison: «Parce que j’entends constamment les médecins, lui répondit Zénon, quand nous avons une affection quelconque, nous ordonner principalement le repos et nous défendre ce qui peut causer de l’irritation à l’organe dont nous souffrons.»—Socrate ne dit pas: «Ne cédez pas aux attraits de la beauté; affrontez-la, mais résistez-lui.» Il dit: «Fuyez-la; courez vous mettre hors de sa vue et de sa rencontre; évitez-la comme un poison violent qui porte et frappe de loin.»—Le meilleur de ses disciples, prêtant à Cyrus, mais, à mon avis, racontant plutôt qu’il n’invente les rares perfections de ce grand prince, nous le montre tellement en défiance de sa force contre les charmes de la divine beauté de Panthée son illustre captive, qu’il charge quelqu’un, moins indépendant qu’il ne l’était lui-même, de lui faire visite et de veiller sur elle.—Le Saint-Esprit dit de même: «Ne nous induisez pas en tentation (saint Matthieu).» Nous ne prions pas pour que la concupiscence n’entre pas en lutte avec notre raison et ne l’emporte pas sur elle, mais pour qu’elle ne l’essaie même pas; pour que nous ne nous trouvions pas en situation d’avoir à endurer les approches, les sollicitations et les tentations du péché; nous supplions le Seigneur de maintenir notre conscience au repos, parfaitement et pleinement délivrée de tout commerce avec le mal.
511
Ceux qui disent avoir triomphé du désir de se venger ou de toute autre passion difficile à surmonter, exposent souvent les choses telles qu’elles sont, mais non telles qu’elles ont été; ils nous parlent de ce qui est, lorsque les causes de leurs erreurs sont affaiblies par le temps et bien loin d’eux; mais revenez plus en arrière, remontez à l’origine de ces causes, vous les prenez au dépourvu. Veulent-ils donc prétendre que leur faute est moindre, parce qu’elle est plus vieille; et, alors que le point de départ est une injustice, que les faits qui en découlent sont justes? Ceux qui, comme moi, souhaiteront le bien de leur pays sans s’en ulcérer et en maigrir, seront contrariés, mais non anéantis, de le voir menaçant ruine ou dans cet état prolongé qui doit l’y conduire: «Pauvre vaisseau désemparé, sur lequel les flots, les vents et le pilote agissent chacun avec des desseins également contraires.»—Celui qui ne soupire pas après la faveur des princes comme après quelque chose dont il ne saurait se passer, ne se formalise pas beaucoup de la froideur de leur accueil et de leur visage, non plus que de l’inconstance de leur volonté. Qui n’est pas attaché à ses enfants ou à ses dignités au point d’en être esclave, ne laisse pas de continuer à vivre encore commodément, après les avoir perdus. Celui qui, en faisant le bien, a surtout en vue sa propre satisfaction, ne se tourmente guère s’il voit les hommes ne pas apprécier ses actes comme ils le méritent. Un quart d’once de patience remédie à de tels inconvénients.—C’est une recette dont je me trouve bien: elle me permet de racheter au meilleur compte ma sensibilité passée, par une insensibilité que je pousse aujourd’hui aussi loin que possible; je sens que, par là, j’ai échappé à beaucoup de peines et de difficultés. Avec bien peu d’efforts, je coupe court aux premières émotions qui m’agitent et lâche, avant qu’elle ne m’emporte, toute affaire qui commence à me peser. Qui n’arrête le départ, ne peut arrêter la course; qui ne sait fermer la porte à ses passions, ne les chasse pas une fois qu’elles ont pénétré; qui ne vient à bout du commencement, ne vient pas à bout de la fin; celui-là ne peut non plus soutenir l’édifice dans sa chute, qui n’a pu en prévenir l’ébranlement: «Car, dès qu’on s’écarte de la raison, les passions se poussent d’elles-mêmes, la faiblesse humaine trouve plaisir à ne pas résister, et, insensiblement, on se voit, par son imprudence, emporté en pleine mer, sans refuge où s’abriter (Cicéron).» Je sens à temps les brises avant-coureurs de la tempête, qui viennent me tâter et bruire au dedans de moi: «Ainsi le vent, faible encore, agite la forêt; il frémit, et ses sourds mugissements annoncent au nautonier la tempête prochaine (Virgile).»
Montaigne fuyait les procès, alors même que ses intérêts devaient en souffrir.—Combien de fois me suis-je fait un tort évident pour éviter d’en recevoir un plus grand encore du fait de la justice après un siècle d’ennuis, de démarches écœurantes et avilissantes qui coûtent à mon caractère plus encore que la prison et le feu: «Pour éviter les procès, on doit faire tout ce qu’on 513 peut et même un peu plus; car il est non seulement honorable, mais quelquefois aussi avantageux de se relâcher un peu de ses droits (Cicéron).» Si nous étions vraiment sages, nous devrions nous réjouir et nous vanter d’un procès perdu, comme un jour j’ai entendu le faire un enfant de grande maison, qui faisait fête à chacun de ce que sa mère venait d’en perdre un, comme si c’eût été sa toux, sa fièvre, ou toute autre chose de désagréable avec quoi elle fût aux prises. Les faveurs mêmes que je tenais de la fortune, telles que parentés, alliances et relations avec ceux qui peuvent tout en la matière, je me suis toujours fait un rigoureux cas de conscience de ne pas les employer contre les intérêts d’autrui, pour obtenir que mon droit l’emporte par d’autres considérations que la justice de ma cause. Enfin, j’ai si bien employé mon temps (et suis heureux de pouvoir le dire) que je suis encore vierge de procès, quoique plusieurs fois j’eusse été très fondé à en entreprendre s’il m’avait convenu d’y recourir; de même aussi je suis vierge de querelles. Me voici bientôt arrivé au terme d’une longue existence, sans avoir jamais fait ou subi de grosses offenses et sans jamais avoir vu accolé à mon nom une épithète malsonnante; c’est là une grâce du ciel bien rare!
Les plus grands troubles ont le plus souvent des causes futiles. Dans toute affaire il faut réfléchir avant d’agir et, une fois lancé, persévérer, dût-on périr à la peine.—Les plus grands troubles qui agitent les sociétés humaines proviennent de causes ridicules. Quel effondrement que celui du dernier de nos ducs de Bourgogne, causé par un différend amené par une charretée de peaux de mouton! L’exergue gravée sur un cachet ne fut-elle pas la cause première et principale du plus horrible écroulement dont la République romaine ait jamais eu à souffrir? car Pompée et César ne sont que les rejetons et les héritiers de la querelle de Marius et de Sylla. De mon temps, combien de fois n’ai-je pas vu les plus sages têtes du royaume assemblées en grande cérémonie et à grands frais pour le trésor public, afin de conclure des traités et des accords dont les clauses étaient cependant décidées en réalité et en toute souveraineté dans les boudoirs des dames, suivant le caprice de quelque femme sans consistance. C’est ce que les poètes avaient bien saisi et qu’ils ont rendu en mettant, pour une pomme, la Grèce et l’Asie à feu et à sang. Enquérez-vous des motifs pour lesquels cet individu va jouer son honneur et sa vie avec son épée et son poignard; qu’il vous dise la circonstance qui a amené ce débat: il ne pourra le faire sans rougir, tant elle est vaine et frivole.
Au début, il suffit d’être un peu avisé pour éviter une affaire; mais, une fois qu’on y est embarqué, les tiraillements se produisent de toutes parts et il faut, pour s’en bien tirer, être approvisionné de nombreux moyens d’action de bien autre importance et bien autrement difficiles. Combien il est plus aisé de n’y pas entrer que d’en sortir! Il faut en pareille occurrence se comporter au rebours 515 du roseau qui, tout d’abord, pousse tout d’une venue une longue tige bien droite, mais qui ensuite, comme s’il était harassé et hors d’haleine, produit une tige noueuse dont les nœuds, de plus en plus gros et rapprochés, marquent comme des temps d’arrêt dénotant qu’il n’a plus sa vigueur et sa persistance premières; il vaut mieux commencer doucement et froidement, et conserver son souffle et ses vigoureux élans pour le moment où on est au fort de la besogne et qu’il s’agit de perfectionner. Quand les affaires commencent, nous les dirigeons et pouvons alors les mener comme bon nous semble; mais après, quand elles sont en train, ce sont elles qui nous mènent et nous emportent: nous ne pouvons que les suivre.
Je ne puis dire cependant que ce procédé m’ait épargné toute difficulté et que je n’ai pas eu souvent * peine à réprimer et à brider mes passions; elles ne se gouvernent pas toujours dans la mesure où, suivant les circonstances, il serait désirable; souvent même, elles interviennent avec aigreur et violence. Toujours est-il que son application apporte bien du soulagement et de l’avantage, sauf à ceux qui, mûs exclusivement par l’amour du bien, ne recherchent pas un avantage qui serait de nature à porter atteinte à leur réputation. C’est qu’à la vérité il n’y a en toutes choses profit pour chacun, que s’il l’apprécie tel; or, dans le cas qui nous occupe, il revient de cette manière de faire plus de contentement mais non plus d’estime, parce qu’on s’est retiré avant que la mêlée ne commençât, avant d’être en présence du péril. J’ajouterai encore qu’en ceci, comme dans tous les autres devoirs de la vie, la route de ceux qui ne voient que l’honneur, est bien différente de celle que suivent ceux qui ont en vue l’ordre et la raison.—Il est des gens qui, sans réflexion, entrent en lice comme des furieux; peu après leur ardeur tombe. Plutarque dit que ceux qui, par mauvaise honte, cèdent et accordent aisément ce qu’on leur demande, sont ensuite portés à manquer de parole et à se dédire; il en est de même de ceux qui prennent légèrement parti dans une querelle, ils l’abandonnent non moins légèrement; cette même difficulté que j’éprouve à m’y jeter, me porterait à y persister une fois que je me serais ébranlé et échauffé. Agir comme ils le font, est mauvais; une fois qu’on y est, il faut marcher, dût-on y rester: «Décidez-vous froidement, disait Bias, mais poursuivez sans relâche.» Le manque de prudence conduit au manque de cœur, ce qui est plus grave encore.
La plupart des réconciliations qui suivent nos querelles, sont honteuses; quand on ne le fait pas de son plein gré, démentir ce qu’on a fait ou dit est une lâcheté.—La plupart des accords qui interviennent aujourd’hui pour clore nos querelles personnelles, sont honteux et menteurs; nous ne cherchons qu’à sauver les apparences, et, pour cela, nous trahissons et désavouons nos véritables intentions: ce ne sont que des replâtrages. Nous savons dans quelles conditions nous avons parlé, quel sens était à attacher à ce que nous avons dit, les assistants le savent, et aussi nos amis auprès desquels nous avons voulu nous 517 grandir; aussi, quand nous démentons notre pensée, est-ce aux dépens de notre franchise et de l’honneur de notre courage: nous cherchons des échappatoires dans la fausseté pour arriver à un accommodement; nous nous donnons à nous-mêmes un démenti pour détruire l’effet d’un démenti donné à un autre. Vous ne devez pas rechercher si vos actes ou vos paroles sont susceptibles d’une autre interprétation derrière laquelle vous pourriez vous retrancher; c’est leur sens vrai et sincère que vous avez désormais le devoir de maintenir coûte que coûte. On s’adresse à votre vertu et à votre conscience, ce ne sont pas * là choses qui prêtent à travestissement; laissons ces vils moyens et ces expédients à la chicane du palais. Les excuses et les réparations que je vois faire tous les jours pour donner satisfaction d’un acte indiscret ou d’une parole inopportune, me semblent plus laides que cet acte ou cette parole. Il vaudrait mieux faire à son adversaire une nouvelle offense, que de s’offenser soi-même en s’humiliant ainsi devant lui. Vous l’avez bravé sous l’action de la colère, et, de sang-froid et en pleine possession de vous-même, vous vous mettez à l’apaiser et à le flatter; de la sorte votre soumission outrepasse l’excès que vous avez commis en premier lieu. Je trouve qu’un gentilhomme ne saurait rien faire qui soit plus honteux pour lui que de se dédire quand cela lui est imposé; d’autant que l’opiniâtreté est un défaut plus excusable que la pusillanimité.—Il m’est aussi facile d’éviter de me livrer à mes passions, qu’il m’est difficile de les modérer: «On les arrache plus aisément de l’âme, qu’on ne les bride.» Que celui qui ne peut atteindre à cette noble impassibilité des Stoïciens, se rejette vers cette stupidité des foules qui est la mienne; ce que ceux-là faisaient par vertu, j’ai été amené à le faire par tempérament. A moyenne hauteur règnent les tempêtes; plus haut et plus bas, les philosophes et les gens de la campagne trouvent les uns et les autres la tranquillité et le bonheur: «Heureux le sage qui parvient à connaître la raison de toutes choses; dépouillé de toute crainte, il foule aux pieds l’inexorable destin et méprise les mugissements de l’avare Achéron. Heureux aussi celui qui connaît les divinités champêtres: Pan, le vieux Sylvain et l’aimable famille des Nymphes (Virgile).»
Toutes les choses, à leur naissance, sont faibles et tendres; aussi faut-il toujours avoir les yeux ouverts sur elles à ce moment, parce que de même que le danger qu’elles peuvent présenter ne se découvre pas quand il est à l’état embryonnaire de même lorsque, ayant grandi, il vient à se manifester, on n’en aperçoit plus le remède. Si j’avais cédé à l’ambition, j’eusse rencontré un million d’embarras, de jour en jour plus malaisés à surmonter qu’il ne m’a été difficile d’arrêter mon penchant naturel pour cette passion: «C’est avec raison que j’ai toujours eu horreur d’élever la tête au-dessus des autres et d’attirer les regards (Horace).»
Jugement que l’on a émis sur la manière dont Montaigne s’est acquitté de sa mairie de Bordeaux et jugement que lui-même en porte.—On a pu avec assez de vérité lui reprocher 519 de ne pas y avoir apporté une ardeur excessive; mais, en somme, il faisait ce qu’il fallait sans bruit ni ostentation et, de fait, il a maintenu l’ordre et la paix.—Tous les actes publics sont sujets à des interprétations diverses qu’on ne saurait prévoir; trop de gens s’en font juges. Il en est qui, parlant de ma conduite comme maire de Bordeaux (je suis content d’en dire un mot, non que cela en vaille la peine, mais pour donner un exemple de ce que je suis dans cet ordre de choses), disent que je m’y suis comporté en homme qui ne s’émeut pas assez et qui ne se passionne guère; et, en cela, ils ne sont pas très éloignés d’avoir raison. J’essaie de tenir en repos mon âme et mes pensées, «toujours tranquille par nature, et plus encore à présent par l’effet de l’âge (Cicéron)»; et si parfois elles se débauchent à recevoir quelque impression rude et pénétrante, c’est en vérité sans que je le leur conseille. De cette apathie naturelle il ne faudrait cependant pas conclure à de l’impuissance (défaut d’application et défaut de bon sens sont deux choses différentes), et encore moins à un manque de reconnaissance et à de l’ingratitude envers cette population, qui, avant même de me connaître, puis après m’avoir connu, m’a donné la plus grande marque de confiance qui était en son pouvoir, faisant bien plus pour moi, en me prorogeant dans cette charge, qu’elle n’avait fait en me la donnant la première fois. Je lui veux tout le bien en mon pouvoir; et certes, si l’occasion s’était présentée, je n’eusse rien épargné pour son service. Je me suis démené pour elle, comme je me démène pour moi. C’est une bonne population, guerrière, généreuse, et néanmoins susceptible d’obéissance et de discipline, capable de bien faire sous une bonne direction.—On dit aussi que mon administration s’est passée sans présenter rien de marquant ni qui ait laissé trace. Quelle plaisanterie! On critique mon inactivité à une époque où l’on reprochait à presque tout le monde de trop faire! J’agis avec promptitude et énergie quand ma volonté m’y pousse; mais cette ardeur ne s’allie pas à la persévérance. Qui voudra user de moi, en tenant compte de ma nature, me donnera des affaires nécessitant de la vigueur et de la liberté d’action, demandant de la droiture, qui puissent se résoudre promptement et même pour lesquelles il faille s’en remettre un peu au hasard, je puis y être de quelque utilité; mais si la chose demande du temps, de la subtilité, du travail, qu’il faille ruser et biaiser, mieux vaut qu’il s’adresse à un autre. Toutes les charges importantes ne sont pas par elles-mêmes difficiles à remplir; j’étais disposé à travailler un peu plus qu’à mon ordinaire si c’eût été absolument nécessaire, car il m’est possible de faire davantage que je ne fais et que je n’aime à faire.—Je n’ai laissé de côté, que je sache, aucun des faits et gestes que le devoir réclamait effectivement. J’ai facilement oublié ceux que l’ambition mêle au devoir et qu’elle couvre de ce nom; ce sont ceux qui, le plus souvent, captivent les regards et les oreilles et dont les hommes se contentent; ce n’est pas de la chose, mais de son apparence 521 qu’ils se paient; s’ils n’entendent pas de bruit, il leur semble qu’on dort. Mon caractère n’est pas de ceux qui aiment le tapage; je réprimerais fort bien des troubles sans en être troublé en moi-même, et châtierais le désordre sans me mettre hors de moi. Si j’ai besoin de me montrer en colère ou surexcité, je fais comme si je l’étais, c’est un masque que j’emprunte. Je suis porté à la mollesse, de mœurs plutôt paisibles que violentes. Je ne reproche pas à un magistrat de dormir, pourvu que ceux qu’il administre dorment avec lui; c’est ce que font les lois elles-mêmes. Je suis pour une vie facile, obscure et muette, «également éloignée de la bassesse et d’un insolent orgueil (Cicéron);» ainsi me l’a faite la fortune. Je suis né d’une famille qui a passé sans éclat et sans tumulte, et qui, de temps immémorial, a été altérée surtout de rectitude et d’honnêteté.
Il n’est pas de ceux qui ont de l’ambition, laquelle n’est pas de mise quand les questions que l’on a à traiter sont affaires courantes dont il ne faut pas exagérer l’importance.—A notre époque, on est si enclin à l’agitation et à l’ostentation, que la bonté, la modération, l’égalité d’humeur, la constance et autres qualités paisibles et sans éclat ne s’apprécient plus. Les corps qui présentent des aspérités se sentent, ceux qui sont lisses se manient sans faire impression; on ressent la maladie, on ne ressent pas, ou bien peu, la santé, pas plus que les choses à notre convenance comparativement à celles qui nous oppressent. C’est agir dans l’intérêt de sa réputation et pour son profit personnel et non pour le bien que de différer, pour le faire en public, ce qu’on eût pu faire dans la chambre du conseil, et en plein midi ce qu’on pouvait faire la nuit précédente, ou de tenir à faire soi-même ce que votre compagnon peut faire aussi bien que vous. Ainsi agissaient, en Grèce, certains chirurgiens qui effectuaient sur des estrades, à la vue des passants, les opérations afférentes à leur art, pour s’attirer plus de pratiques et de clientèle. Les règlements ne sont estimés bons, que publiés à son de trompe. L’ambition n’est pas un vice de petites gens; elle nécessite des efforts bien autres que ceux dont nous sommes capables.—On disait à Alexandre: «Votre père vous laissera un vaste état, facile à gouverner et pacifié»; et ce jeune homme portait envie aux victoires remportées par son père et à la justice avec laquelle il gouvernait; il n’eût pas voulu n’avoir qu’à jouir mollement et paisiblement de l’empire du monde.—Alcibiade, dans Platon, se donne comme préférant mourir jeune, beau, riche, noble, savant, ayant atteint en tout cela à la perfection, plutôt que de vivre longtemps en s’en tenant, sous le rapport de ces qualités, dans les conditions où il était, sans s’exhausser encore. C’est là une maladie peut-être excusable chez une nature aussi forte et aussi complète que l’était la sienne; mais quand ces petites âmes, naines et chétives, qui vont se faisant illusion dans l’idée que leur nom va devenir célèbre parce qu’elles ont jugé sainement une affaire ou convenablement réglé la garde de la porte d’une ville, elles témoignent d’autant plus leur faiblesse, qu’elles 523 s’imaginent davantage que cela les grandit. Si bien que soient ces actes insignifiants, ils n’ont ni corps, ni vie; le premier qui en parle, les atténue déjà; à peine si la connaissance s’en répand d’un carrefour de rue à un autre. Entretenez-en hardiment votre fils et votre valet, comme cet ancien qui, n’ayant personne qui prêtât l’oreille aux louanges qu’il se donnait et convint de son mérite, faisait le fier auprès de sa femme de chambre, s’écriant: «O Perrette, quel galant homme, quel homme capable tu as pour maître!» Au pis aller, entretenez-vous-en avec vous-même, comme un conseiller de ma connaissance qui, ayant dégoisé force articles et commentaires de loi d’une extrême subtilité et d’une ineptie tout aussi grande, se rendant de la chambre du conseil à l’urinoir du palais, fut entendu marmottant entre ses dents et avec la plus intime conviction: «Ce n’est point à moi, Seigneur, ce n’est point à moi, mais à toi-même que la gloire doit en revenir (Psalmiste).» Si on ne peut recevoir des compliments des autres, eh bien! qu’on s’en fasse à soi-même.
La renommée ne s’attache qu’à des actes qui sortent de l’ordinaire, et naît d’elle-même.—La renommée ne se prostitue pas à si bon compte; les actes rares et exemplaires auxquels elle est due, ne supporteraient pas la compagnie de cette foule innombrable de petits faits journaliers. Le marbre exaltera vos titres autant qu’il vous plaira, pour avoir fait réparer tant bien que mal un pan de mur ou curer un égout; mais les hommes de bon sens n’en feront rien. La gloire n’est pas forcément la conséquence d’une chose qui est bonne; il faut encore qu’elle ait été hors de l’ordinaire et d’exécution difficile. Les Stoïciens n’admettaient même pas qu’un acte ne témoignant pas de la vertu méritât estime; ils ne voulaient pas, par exemple, qu’on sût gré à qui, par tempérance, s’abstenait d’une vieille aux paupières enflammées. Parmi ceux au fait des admirables qualités de Scipion l’Africain, il en est qui lui refusent les éloges que Pannétius lui décerne pour son désintéressement, cette qualité n’étant pas tant sienne, disent-ils, que propre au siècle où il vivait. Nous bénéficions des voluptés qui appartiennent au milieu où nous a placés la fortune, n’usurpons pas celles de la grandeur; les nôtres sont plus naturelles et d’autant plus solides et plus sûres qu’elles sont moins élevées. Si ce n’est par conscience, du moins par respect humain, repoussons l’ambition; dédaignons cette soif, basse et honteuse, de renommée et d’honneur qui nous pousse à les mendier auprès de toutes sortes de gens, en recourant aux moyens les plus abjects, et qu’il nous faut payer des prix les plus vils; il est déshonorant d’être honoré dans de pareilles conditions: «Quels éloges que ceux qu’on peut acheter au marché (Cicéron)!» Apprenons à n’être pas plus avides de gloire que nous ne sommes capables de la mériter. Se gonfler de tout acte utile et qui ne porte atteinte à personne, est le propre des gens auxquels c’est chose rare et extraordinaire; ils veulent lui faire attribuer le prix qu’il leur coûte. Quand je suis témoin d’un fait particulièrement éclatant, plus il a d’éclat, plus je rabats de son mérite, par le soupçon que j’ai qu’il ait été produit 525 plus pour l’effet devant en résulter que du fait d’un bon sentiment de la part de son auteur; ainsi étalé en public, il perd la moitié de son prix. Ces actions ont bien plus de grâce, quand elles échappent à ceux qui les accomplissent, sans qu’ils s’y prêtent et sans bruit, et que, venant ensuite à fixer l’attention de quelque honnête homme, il les tire de l’ombre et les met en lumière pour elles-mêmes: «Pour moi, je trouve bien plus digne d’éloges ce qui se fait sans ostentation et loin des yeux du peuple (Cicéron)», a dit l’homme le plus vaniteux qu’il y ait eu en ce monde.
Montaigne n’avait qu’à maintenir l’état de choses existant, il l’a fait; il n’a offensé personne, ne s’est attiré aucune haine, et, quant à être regretté, il ne l’a du moins jamais souhaité.—Je n’avais, comme maire, qu’à maintenir et continuer les choses dans l’état où je les avais trouvées, ce qui se fait sans bruit et sans qu’on s’en aperçoive; l’innovation se remarque beaucoup plus, mais elle est interdite en des temps comme ceux-ci, où nous sommes entourés de dangers et avons surtout à nous défendre des nouveautés. S’abstenir de faire est souvent aussi méritoire qu’agir; mais cela donne moins de relief, et le peu que je vaux est à peu près en entier de cette sorte. En somme, les circonstances, durant mon administration, ont été en rapport avec mon caractère, ce dont je leur sais très bon gré. Est-il quelqu’un qui désire être malade, pour voir comment son médecin le traitera? et ne faudrait-il pas fouetter un médecin qui désirerait que nous ayons la peste, pour pouvoir exercer son art? Je n’ai pas eu ce travers coupable et assez fréquent, de désirer que les affaires de ma cité soient troublées et en souffrance, pour que ma gestion en fût rehaussée et honorée, et je me suis prêté de bon cœur à aider à ce qu’elles se fissent aisément et facilement.—Qui ne voudra pas me savoir gré de l’ordre, de la douce et muette tranquillité dues à ma manière de l’aire, ne pourra du moins me dénier la part que j’y ai eue, grâce à ma bonne fortune; et je suis ainsi fait que j’aime autant être heureux que sage, et devoir mes succès uniquement à la faveur divine plutôt qu’à mes propres agissements. J’avais assez nettement fait connaître à chacun mon incapacité à diriger de semblables affaires publiques; mais ce qui aggrave encore cette insuffisance, c’est qu’elle ne me déplaît pas, que je ne cherche pas à m’en guérir, et cela en raison du genre de vie que j’ai eu dessein de mener. Je ne me suis pas davantage, en cette situation, donné pleine satisfaction, car je n’ai tenu qu’imparfaitement ce que je m’étais promis: j’ai fait beaucoup plus que je ne devais pour ceux vis-à-vis desquels j’avais pris des engagements, tandis que d’ordinaire je promets un peu moins que je ne puis et espère tenir.—Je suis persuadé n’avoir offensé personne et ne m’être attiré aucune haine; quant à être regretté et désiré, ce que du moins je sais bien, c’est que je ne l’ai pas beaucoup souhaité: «Moi, me fier à ce monstre, à la tranquillité de la mer, au calme apparent des flots (Virgile)!»
527
Critique du changement opéré dans le calendrier par la réforme grégorienne.—Il y a deux ou trois ans, qu’en France, l’année a été réduite de dix jours. Que de changements devaient résulter de cette réforme; c’était au fond remuer à la fois le ciel et la terre! Et cependant tout est demeuré en place: mes voisins font à leur heure leurs semailles, leurs récoltes, leurs transactions commerciales; les jours propices et les jours néfastes existent, et tout cela exactement comme de tous temps. Nos habitudes ne se ressentaient pas de l’erreur, pas plus qu’elles ne se ressentent de la correction intervenue, tant il y a partout d’incertitude, tant notre compréhension des choses est grossière, obscure et obtuse! On dit que la question pouvait se régler d’une façon moins incommode, en retranchant comme l’a fait Auguste, pendant quelques années, aux années bissextiles, aussi longtemps qu’il eût été nécessaire pour arriver à la concordance voulue, le jour qu’elles ont en plus et qui, maintenant comme avant, est une gêne et cause du trouble. De ce qu’on n’a pas procédé ainsi, nous sommes encore de quelques jours en avance; toutefois ce moyen demeure pour pourvoir à l’avenir aux corrections à faire, en fixant qu’après une période de tant et tant d’années, ce jour supplémentaire sera toujours supprimé, de telle sorte que l’erreur ne pourra dorénavant excéder vingt-quatre heures.—Nous n’avons d’autre mesure du temps que les années, et il y a bien des siècles que le monde en use; cependant c’est une mesure que nous n’avons pas encore achevé de déterminer, et nous sommes encore dans le doute sur les formes diverses que les autres nations lui donnent et les raisons qui les leur ont fait adopter. Il est des gens qui disent qu’en vieillissant les cieux s’abaissent sur nous et empêchent ainsi la détermination exacte des jours et même des heures! Plutarque va jusqu’à dire des mois, il est vrai que de son temps l’astronomie n’était pas encore arrivée à déterminer le mouvement de la lune! Ce sont là, n’est-ce pas, de bonnes conditions pour l’enregistrement des événements du passé?
Vanité des recherches de l’esprit humain; on veut souvent découvrir les causes d’un fait, avant d’être assuré que ce fait est bien certain.—Je rêvassais tout à l’heure, comme je le fais souvent, combien la raison humaine est un instrument vague et mal réglé. C’est ainsi qu’on voit ordinairement les hommes auxquels on cite des faits, s’amuser plus volontiers à en rechercher les causes qu’à en vérifier la réalité. Ils passent par-dessus 529 toute investigation préliminaire, mais en examinent avec soin les conséquences, ou encore, sans s’inquiéter de la chose, s’enquièrent immédiatement des causes. Plaisants chercheurs de causes! Cette connaissance n’intéresse que celui qui a la direction et non nous, qui n’avons qu’à prendre les choses telles qu’elles sont et qui en avons l’usage entier et absolu suivant ce qui convient à nos besoins, sans qu’il nous soit nécessaire d’en pénétrer ni l’origine, ni le principe; le vin en est-il plus agréable à qui sait comment il se fabrique et d’où il provient? Au contraire, le corps et l’âme entravent et altèrent le droit qu’ils ont d’user de ce qui est et d’eux-mêmes, quand ils y mêlent ce que la science en pense; les effets nous touchent, les moyens pas du tout. Fixer et répartir est du domaine de qui est maître ou gouverne, comme accepter est le fait du sujet et de l’apprenti.—Reprenons ce que nous disions de cette habitude. A l’annonce d’une chose, on commence d’ordinaire par dire: «Comment cela se fait-il?» Il faudrait dire: «Mais, d’abord, cela est-il?» Notre raisonnement est capable de reconstituer cent mondes comme le nôtre et d’en trouver les principes et l’organisation; il ne faut pour cela ni base, ni matériaux; laissez-le aller; «habile à donner du corps à la fumée (Perse)», il construit aussi bien sur le vide que sur le plein, avec rien qu’avec quelque chose. Je trouve que de presque tout, il faudrait dire: «Cela n’est pas.» C’est une réponse que j’emploierais souvent si j’osais; mais on crie aussitôt que parler ainsi dénonce de l’ignorance et de la faiblesse d’esprit, et il me faut la plupart du temps faire le bateleur de compagnie avec ceux qui m’entourent et deviser sur des sujets et des contes frivoles auxquels je n’ajoute aucune foi; sans compter que c’est en vérité un peu rude et bien empreint de l’esprit de contradiction, que de nier catégoriquement un fait qu’on vous énonce; d’autant que peu de gens manquent, surtout quand la chose est difficile à croire, d’affirmer qu’ils l’ont vue et de produire des témoins dont l’autorité nous empêche de contredire. Il en résulte qu’avec cette manière de faire, nous connaissons les causes et effets de mille choses qui n’ont jamais existé, et que le monde discute sur mille sujets dont le pour et le contre sont aussi faux l’un que l’autre: «Le faux approche si fort du vrai, que le sage ne doit pas s’engager dans un défilé si dangereux (Cicéron).»
La vérité et le mensonge ont même physionomie; le port, le goût, les allures sont pareils: nous les regardons du même œil. Non seulement nous sommes lâches par le peu de défense que nous imposons à la tromperie, mais nous cherchons et nous nous convions encore à nous y enferrer; par vanité nous aimons à nous embrouiller, cela semble faire partie intégrante de notre être.
Comment s’accréditent de prétendus miracles. Autorité que prend sur nous toute croyance qui a de nombreux adeptes et est éclose depuis un certain temps déjà; que ne va-ton au fond des choses?—J’ai vu, de mon temps, naître plusieurs miracles. Bien qu’ils se soient étouffés dès l’origine, nous 531 pouvons prévoir quels développements ils auraient pris si, arrivés à maturité, ils eussent vécu; car il ne faut que trouver le bout du fil, on en dévide alors autant qu’on veut. Il y a en effet beaucoup plus loin de rien à la plus petite chose du monde, que de cette petite chose à la plus grande. Or les premiers qui sont mêlés aux commencements d’une chose extraordinaire, s’apercevant, par l’incrédulité qu’ils rencontrent lorsqu’ils se mettent à conter leur histoire, où gît la difficulté de persuader, vont étayant ce point faible de quelque preuve fausse, d’autant, qu’en outre de ce que «les hommes ont tendance à donner cours à des bruits incertains (Tite Live)», nous nous faisons naturellement conscience de rendre avec usure ce qu’on nous a prêté, en y ajoutant quelque peu de notre cru. L’erreur que nous commettons personnellement, donne d’abord naissance à celle qui se propage dans le public; et celle-ci, à son tour, confirme l’erreur individuelle première. Ainsi la chose se forme, allant s’affermissant par son passage de main en main, si bien que chaque témoin nouveau est mieux informé que celui dont il tient la nouvelle, et que celui qui vient en dernier lieu est plus convaincu que le premier. C’est une progression naturelle: quiconque croit quelque chose, estime que c’est faire œuvre de charité que de convaincre quelque autre; et, pour ce faire, il ne craint pas d’ajouter de sa propre invention, à ce qu’il raconte, autant qu’il juge nécessaire pour triompher de la résistance et du manque de conviction qu’il croit exister chez autrui.—Moi-même, qui me fais un scrupule excessif de mentir et qui ne me soucie guère d’imposer ce que je dis, ou qu’on y croie, je constate cependant que lorsque je parle sur une question, si je suis échauffé soit par la résistance de mon auditoire, soit par la chaleur même de ma narration, en dehors de ce que j’ai à en dire je grossis, j’enfle le sujet par mon ton de voix, mes gestes, l’accent et la force de mes expressions, et même par les amplifications et extensions que je me permets non sans dommage pour la vérité initiale. Je ne le fais cependant qu’avec cette restriction que, dès que quelqu’un me rappelle à moi-même et me demande la vérité dans toute sa nudité et sa crudité, c’en est fait aussitôt de toute exagération, je la lui donne sans emphase ni commentaires. Un langage vif et bruyant, comme d’ordinaire est le mien, se laisse volontiers aller à l’hyperbole.—Il n’est rien à quoi les hommes soient plus généralement disposés qu’à chercher à propager leurs opinions; quand, à cet effet, les moyens habituels nous font défaut, nous y ajoutons le commandement, la force, le fer et le feu. C’est un malheur d’en être arrivé à ce que la meilleure preuve de la vérité d’une chose, soit la multitude des gens qui y croient, alors que cette foule comprend tant de fous et si peu de sages, «comme s’il n’y avait rien de plus commun que de ne pas avoir de bon sens (Cicéron). Belle autorité pour la sagesse, qu’une multitude de fous (S. Augustin)». Il est difficile de se former un jugement ferme, qui soit à l’encontre d’opinions généralement admises. Ce sont les simples d’esprit qui, sur le seul exposé des faits, croient tout d’abord; 533 puis, par l’autorité du nombre et des témoignages que l’on fait remonter aussi haut que possible, cela gagne ceux qui ont l’esprit le plus ouvert. Pour moi, quand je ne crois pas quelqu’un m’affirmant une chose, je n’y croirais pas davantage fussent-ils cent à me circonvenir, et ce n’est pas par le temps depuis lequel elle règne que je juge une idée.
Il y a peu de temps, un de nos princes, en proie à la goutte qui avait altéré son bon sens naturel et sa vigoureuse santé, se laissa si fortement persuader par ce qu’on disait des cures merveilleuses opérées par un prêtre qui, à l’aide de paroles et de gestes, guérissait toutes les maladies, qu’il fit un long voyage pour aller le trouver. Celui-ci, par un puissant effet de suggestion, parvint à lui endormir son mal pour quelques heures, si bien que ses jambes, pendant ce court intervalle, lui fournirent le service auquel elles ne satisfaisaient plus depuis longtemps. Si le hasard eût voulu que cinq ou six aventures de ce genre se produisissent, cela eût suffi pour accréditer un miracle de cette nature. On reconnut depuis que celui qui obtenait ce résultat, y mettait tant de simplicité et si peu d’artifice, qu’on ne jugea pas qu’il y eût lieu de le poursuivre judiciairement. C’est à cela qu’on arriverait dans la plupart des cas semblables, si on les examinait à fond. «Nous admirons les choses qui trompent par leur éloignement (Sénèque)»; notre vue nous fait ainsi souvent apercevoir au loin des images qui nous semblent étranges et qui se réduisent à rien, quand on en approche: «Jamais la renommée ne s’en tient à la vérité (Quinte-Curce).»
La plupart d’entre eux reposent sur des riens et on se perd à leur chercher des causes sérieuses; le seul miracle que Montaigne ait constaté, c’est lui-même.—C’est merveilleux comme certaines légendes des plus répandues tiennent à des causes frivoles et ont des origines insignifiantes. C’est même là ce qui empêche les informations d’aboutir: tandis qu’on s’évertue à rechercher des causes et des fins sérieuses et importantes comme il convient pour des choses de si grand renom, on perd trace des vraies qui nous échappent par leur petitesse; pour aboutir dans ces investigations, il est certain qu’il faut un inquisiteur bien prudent, attentif et subtil, qui n’ait ni parti pris, ni préoccupation.—Jusqu’à présent, miracles et événements étranges se cachent de moi et, en fait de monstres et de miracles bien caractérisés, je n’ai vu que moi-même. Avec l’usage et le temps, on se familiarise avec tout ce qui est étrange; malgré cela, plus je me tâte et me connais, plus ma difformité m’étonne et moins je me comprends.
Histoire d’un miracle bien près d’être accrédité, qui ne reposait que sur de simples plaisanteries.—C’est surtout le hasard qui produit et fait accepter de tels accidents.—Passant avant-hier dans un village, à deux lieues de ma maison, je trouvai la place encore toute chaude d’un miracle qui venait d’avorter; depuis plusieurs mois il amusait le voisinage, et, des provinces voisines, qui commençaient à s’en émouvoir, accouraient par grosses 535 troupes des gens de toutes conditions. Un jeune homme de la localité s’était, pour se jouer, mis à contrefaire une nuit, chez lui, la voix d’un esprit, sans penser à autre malice qu’à badiner un moment. Cela lui ayant réussi mieux qu’il n’espérait, afin de donner plus de sel à sa farce, il y associa une fille du village, tout à fait stupide et niaise, puis finalement un troisième individu, tous trois de même âge et aussi simples d’esprit; puis, transformant leur prêche à domicile en prêche public, ils se cachèrent sous l’autel de l’église, ne se révélant que la nuit et défendant qu’on apportât de la lumière. Des paroles qui tendaient à la conversion du monde et menaçaient du jour du jugement (sujets qui, par l’autorité qui s’y attache et le respect qu’ils commandent, se prêtent le plus à l’imposture), ils en vinrent à produire quelques visions et apparitions, mais si naïves et absurdes, qu’à peine y a-t-il rien de si grossier dans les jeux des petits enfants. Qui sait cependant à quel degré cette mauvaise plaisanterie eût trouvé créance, si le hasard s’y fût un peu prêté? Ces pauvres diables sont à cette heure en prison et porteront probablement la peine de la sottise commune; je ne sais si quelque juge ne se vengera pas sur eux de la sienne. Ici, la supercherie ayant été découverte, on y voit clair; mais dans nombre de cas analogues, sur lesquels nous ne sommes pas suffisamment édifiés, je suis d’avis que nous réservions notre jugement, aussi bien pour que contre.
Tous les préjugés de ce monde viennent de ce que nous ne voulons ni douter, ni avouer notre ignorance.—Il s’engendre beaucoup d’abus en ce monde ou, pour être plus catégorique, tous les abus de ce monde s’engendrent de ce qu’on nous apprend à craindre de manifester notre ignorance, et que nous sommes tenus d’accepter tout ce que nous ne pouvons réfuter; nous parlons de toutes choses, comme si c’étaient des préceptes indéniables que nous émettons. L’usage, à Rome, voulait que ce dont un témoin déposait pour l’avoir vu de ses yeux et ce qu’un juge prescrivait avec toute la certitude que lui donnait sa science, fussent énoncés sous cette forme: «Il me semble». On me porte à haïr les choses les plus vraisemblables, quand on me les impose comme infaillibles; j’aime ces expressions: Peut-être,—En quelque sorte,—On dit,—Je pense, et autres semblables qui atténuent et modèrent la témérité de nos propos; et, si j’avais eu à élever des enfants, je leur eusse si bien inculqué cette façon de répondre dubitative et non tranchante: Qu’est-ce?—Je ne saisis pas,—Il se pourrait,—Est-il vrai? qu’ils auraient semblé plutôt des apprentis à soixante ans, que des docteurs à dix, comme cela est aujourd’hui. Qui veut guérir de son ignorance, doit l’avouer.
Iris est fille de Thaumantis; l’admiration est la base de toute philosophie; l’investigation est la source du progrès, l’ignorance l’arrête net. Et cependant, il y a une certaine ignorance forte et généreuse qui, sous le rapport de l’honneur et du courage, ne le cède en rien à la science; ignorance qui, pour se produire, n’exige pas moins de savoir que pour faire montre de science. J’ai vu, dans mon enfance, 537 le compte rendu d’un procès que Corras, conseiller au parlement de Toulouse, fit imprimer et qui portait sur ce fait étrange de deux hommes qui se donnaient tous deux pour un même individu. Il me souvient (et je ne me souviens que de cela) qu’il me parut avoir démontré que l’imposture de celui qu’il déclarait coupable était si étonnante, dépassait tant ce que pouvait en démêler notre entendement et aussi le sien, à lui qui était juge, que je trouvais bien hardi l’arrêt par lequel il fut condamné à être pendu. Nous devrions admettre des arrêts rendus en cette forme: «La cour n’y comprend rien»; ils témoigneraient encore plus de liberté et de bon sens que les juges de l’Aréopage qui, ayant à prononcer dans une cause qu’ils ne parvenaient pas à approfondir, ordonnèrent que les parties se représenteraient dans cent ans.
De ce que les livres saints nous relatent des miracles, il n’en faut pas conclure qu’il doive s’en opérer de nouveaux de notre temps.—Les sorcières dans mon pays courent risque de la vie, chaque fois que les dénonce quelqu’un qui vient attester que ce qu’elles ont rêvé s’est réalisé.—Nos livres sacrés, qui reproduisent la parole divine, renferment eux aussi des prédictions semblables (celles-ci certaines et irrécusables); pour en faire application aux événements modernes, comme nous n’en distinguons pas les causes et ne savons par quels moyens ils se réaliseront, il faut une autre intelligence que la nôtre, et il n’appartient peut-être qu’à ce seul et omnipotent témoignage de nous éclairer et de nous dire: «C’est à celui-ci, à celui-là, et non à tel autre que ceci s’applique.» Dieu doit assurément être cru; mais non le premier venu qui s’étonne de son propre récit (et nécessairement il s’en étonne, quand le fait dépasse la portée de nos sens), soit qu’il parle de faits imputés à autrui, soit qu’il s’accuse lui-même.
Montaigne n’admet pas qu’on maltraite personne parce qu’il a des opinions contraires aux nôtres.—Je suis lourd d’esprit et m’en tiens un peu à ce qui a corps et est vraisemblable, évitant sur ce point le défaut déjà signalé par les anciens: «Les hommes sont portés à ajouter foi à ce qu’ils ne comprennent pas;—l’esprit humain est disposé à croire plus aisément ce qui est obscur (Tacite).» Je vois bien qu’on se courrouce et qu’on m’interdit le doute sous peine des pires injures, c’est là un nouveau procédé de persuasion. Mais, Dieu merci, ce n’est pas à coups de poing qu’on peut imprimer une direction à ma manière de voir. J’admets que ceux auxquels on vient à reprocher qu’une opinion qu’ils émettent est entachée de fausseté se révoltent contre une semblable appréciation; pour moi, quand je ne partage pas une opinion, je me borne à la trouver hardie et difficile à admettre. Comme tout le monde, je condamne les affirmations contraires aux miennes, mais sur un ton qui n’a rien d’impérieux. Celui qui pour prouver ce qu’il soutient, se montre arrogant et autoritaire, montre que chez lui la raison ne tient pas grande place. Tant qu’il ne s’agit que d’une simple discussion sur les mots, telle qu’il s’en produit dans les 539 écoles, les arguments des uns peuvent présenter autant d’apparence de vérité que ceux des autres «pourvu qu’ils discutent la vraisemblance et n’affirment pas (Cicéron)»; mais lorsqu’on en vient à traiter des effets qui en sont la conséquence, ceux qui conservent leur calme ont bien de l’avantage.
Pourquoi ôter la vie aux sorciers pour se défendre contre de prétendus actes surnaturels? la plupart du temps les accusations portées contre eux sont sans fondement.—Pour en arriver à tuer les gens accusés de sorcellerie, il faut avoir une clarté bien vive et bien nette des griefs qui leur sont imputés; la vie humaine est une réalité trop incontestable, pour être prise en garantie des faits surnaturels et fantastiques qu’on leur prête.—Il n’est pas ici question de ceux qui font emploi de drogues et de poisons, ce sont des homicides de la pire espèce; et cependant, même dans ce cas, il ne faut pas, dit-on, toujours croire à leurs aveux: on en a vu s’accuser parfois d’avoir tué des personnes qu’on retrouvait vivantes et bien portantes.—Quant à ces autres accusations extravagantes qu’on voit se produire contre ces prétendus sorciers, je dirai volontiers que c’est déjà bien assez qu’un homme, si recommandable qu’il soit, soit cru quand ce qu’il dit est naturel; et que, lorsqu’il s’agit de choses surnaturelles, au-dessus de ce que nous pouvons comprendre, il ne doit l’être, qu’autant qu’il a reçu du ciel qualité à cet effet. Ce privilège qu’il a plu à Dieu d’attacher à certains de nos témoignages, ne doit pas être avili en en usant à la légère. J’ai eu les oreilles rebattues de mille contes tels que ceux-ci: «Trois personnes l’ont vu tel jour au levant; trois autres l’ont vu le lendemain à l’occident; à telle heure, en tel lieu, il était habillé de telle sorte»; si bien que j’arriverais à ne pas m’en croire moi-même. Combien je trouve plus naturel et plus vraisemblable que deux hommes mentent, que le fait d’un autre qui, en douze heures de temps, porté par les vents, serait passé d’orient en occident; il est bien plus naturel que notre entendement soit déplacé, emporté par le tourbillon d’idées de notre esprit détraqué, plutôt que l’un de nous, en chair et en os, ne s’envole sur un balai, le long du tuyau de sa cheminée, parce qu’un esprit étranger s’est emparé de lui! Ne cherchons pas des illusions venant du dehors et qui nous soient inconnues, alors que perpétuellement nous sommes agités par d’autres qui nous sont propres et existent en nous. Il me semble qu’on est excusable de ne pas croire un miracle, au moins quand il est possible de le démasquer et de l’expliquer par des raisons plausibles, et je suis de l’avis de saint Augustin: «qu’il vaut mieux incliner vers le doute que vers l’assurance, dans ce qui est difficile à prouver et dangereux de croire».
Il est très porté à penser que ces gens ont l’imagination malade et sont fous plutôt que criminels.—Il y a quelques années, je passais sur le territoire d’un prince souverain qui, pour rabattre mon incrédulité, me fit la faveur de me montrer, en sa présence, enfermés dans un local spécial, dix ou douze prisonniers 541 de ce genre, parmi lesquels une vieille femme, vraie sorcière par sa laideur et sa difformité et très fameuse, depuis longtemps, en ce métier. Je vis des preuves, des aveux qu’elle avait faits spontanément, et je ne sais trop quel stigmate indélébile sur cette malheureuse. Je m’enquis, je questionnai tout à mon aise, y apportant toute l’attention que je pouvais, car je ne suis pas homme dont le jugement se laisse beaucoup influencer par des préventions. Finalement, je leur eusse en conscience administré de l’ellébore plutôt que de la ciguë, «leur cas me paraissant plus voisin de la folie que du crime (Tite Live)». Pour traiter ces maladies, la justice a des moyens qui lui sont propres. Quant aux objections et arguments que les gens de bonne foi m’ont présentés là et souvent ailleurs, je n’en ai pas trouvé de concluants et qui n’eussent comporté des solutions autres, chaque fois plus vraisemblables que les leurs. Il est vrai que les preuves et les raisonnements basés sur les faits et l’expérience, je ne les dénoue pas; du reste ils n’ont pas de bout: je les tranche souvent comme Alexandre fit du nœud gordien. Après tout, c’est mettre ses conjectures à bien haut prix, que d’y trouver raison de faire brûler un homme tout vif.
Prestantius dit de son père (et on cite d’autres exemples), qu’assoupi et endormi plus lourdement que par l’effet d’un profond sommeil, il s’imagina être une jument et servir de bête de somme à des soldats; et ce qu’il s’imaginait être, il l’était réellement. Si les sorciers peuvent avoir des songes qui sont des réalités, et si parfois les songes peuvent se manifester par des effets, je ne crois cependant pas que notre volonté en soit responsable devant la justice.—J’en parle comme quelqu’un qui n’est pas juge, ne siège pas dans les conseils des rois et s’estime bien loin d’en être digne, mais en homme du peuple, dressé et voué à s’en rapporter au sens commun dans ses actes et ses paroles. Qui tiendrait compte de mes rêveries pour se mettre en opposition avec la moindre loi de son village, avec une opinion, une coutume existantes, se ferait grand tort, et m’en ferait un non moins considérable; car de ce que je dis, je ne garantis rien, sinon que c’est ce que j’avais en tête, sous une forme confuse et incertaine, quand je l’ai écrit. C’est ici comme une sorte de conversation où je parle de tout, et ce ne sont nullement des avis que j’émets: «Je n’ai pas, comme tant d’autres, honte d’avouer que j’ignore ce que je ne sais pas (Cicéron)»; je ne serais pas si hardi dans mes propos si j’étais de ceux que l’on doit croire, et c’est ce que j’ai répondu une fois à un grand personnage qui se plaignait de l’âpreté et de l’insistance de mes conseils: «Je vois que vous êtes tout disposé à prendre parti dans un sens, je vous soumets l’autre de mon mieux pour éclairer votre jugement, mais non pour le contraindre; Dieu qui dispense le courage, vous mettra à même de choisir.» Je ne suis pas présomptueux au point de seulement désirer que ce que j’en pense, puisse faire pencher d’un côté plutôt que d’un autre dans des questions de cette importance; ma situation ne m’a pas habitué à 543 aboutir à de si hauts et si considérables résultats. Je reconnais avoir nombre de travers d’esprit et aussi de manières de voir, dont volontiers je chercherais à dégoûter mon fils si j’en avais un; et de fait, ce qui est vrai n’est pas toujours chez l’homme ce dont il s’accommode le mieux, tant il est de bizarre composition.
Réflexions sur un proverbe italien qui attribue aux boiteux des deux sexes plus d’ardeur aux plaisirs de l’amour.—A ce propos, et cela ne s’y rattacherait-il pas, peu importe, un proverbe très répandu en Italie dit que celui qui n’a pas couché avec une boiteuse, ne connaît pas Vénus dans ce qu’elle a de plus doux. Le hasard ou quelque fait particulier a, il y a bien longtemps, introduit ce dicton dans le peuple; il s’applique aux hommes comme aux femmes, car la reine des Amazones répondit à un Scythe qui la conviait à l’amour: «Ce sont les boiteux qui le font le mieux (Théocrite).» Dans cette république féminine, pour éviter que les mâles ne s’emparassent du pouvoir, on leur estropiait dès l’enfance les bras, les jambes et autres membres qui leur donnaient avantage sur la femme, qui ne se servait d’eux que pour le surplus dont nous usons d’elle. J’eusse émis comme raison de cette supériorité, que le mouvement détraqué d’une boiteuse peut procurer un plaisir nouveau dans les rapports sexuels que l’on a avec elle et accentuer la jouissance chez ceux qui en essayent; mais je viens de trouver que les philosophes anciens ont déjà élucidé la question et posent que chez une boiteuse, les jambes et les cuisses ne se nourrissant pas, par suite de son infirmité, comme cela devrait être, il en résulte que les parties génitales placées plus haut sont mieux nourries, se développent davantage et deviennent plus vigoureuses; ou encore que ce défaut empêchant de prendre de l’exercice, ceux qui en sont atteints dépensent moins leur force et en sont mieux disposés pour les jeux de Vénus. C’est cette même raison qui faisait que les Grecs reprochaient aux tisserandes d’être plus ardentes que les autres femmes, parce que le métier qu’elles font les empêche, elles aussi, de prendre un exercice suffisant. S’il en est ainsi, de tels raisonnements peuvent nous mener loin, et je pourrais ajouter au sujet de ces dernières que le trémoussement continu que leur occasionne leur travail quand elles sont assises, les éveille et les sollicite, comme il arrive aux dames par suite de l’ébranlement et de l’agitation de leurs carrosses.
L’esprit humain admet comme raisons les choses les plus chimériques; souvent on explique un même effet par des causes opposées.—Ces exemples ne confirment-ils pas ce que je disais au commencement de ce chapitre: que la recherche de la cause devance souvent en nous la constatation de l’effet, et cela s’étend tellement loin, que nous arrivons à juger non ce qui est, mais ce qui n’existe même pas? Outre cette facilité à trouver des interprétations à tout songe quel qu’il soit, notre imagination est encore tout aussi portée à recevoir aisément de fausses impressions sur les plus frivoles apparences. Par la seule autorité de 545 ce dicton ancien très connu, je me suis autrefois laissé aller à croire que j’avais éprouvé plus de plaisir avec une femme parce qu’elle était mal bâtie et à considérer cette infirmité comme ajoutant à ses grâces.
Le Tasse, dans la comparaison qu’il établit entre la France et l’Italie, dit avoir remarqué que nous avons les jambes plus grêles que les gentilshommes italiens, et l’attribue à ce que nous sommes continuellement à cheval. De cette cause, Suétone tire une conclusion tout opposée; car, dit-il, celles de Germanicus étaient devenues plus fortes par la pratique continue de ce même exercice. Rien n’est si souple, si déréglé que notre entendement. Il est comme le soulier de Théramène, qui s’adaptait à tous les pieds; il est double et divers, et donne également à ce à quoi il s’applique des formes multiples et variées: «Fais-moi don d’une drachme d’argent,» disait un philosophe de l’école des Cyniques à Antigone. «Ce n’est pas là un présent digne d’un roi,» répondit celui-ci. «Donne-moi alors un talent,» reprit le philosophe. «Ce n’est pas un présent qui convienne à un Cynique,» repartit Antigone.—«Souvent il est bon de mettre le feu dans un champ stérile et de brûler les restes de paille, soit que cette chaleur prépare les voies et ouvre les pores secrets par lesquels la sève monte dans les herbes nouvelles, soit qu’elle rende la terre plus rude et resserre ses veines ouvertes aux pluies fines, à un soleil trop ardent ou aux froids pénétrants de Borée (Virgile).»
C’est ce qui a amené les Académiciens à poser en principe de douter de tout, ne tenant rien pour absolument vrai non plus que pour absolument faux.—«Toute médaille a son revers»; c’est pourquoi Clitomaque disait jadis que Carnéade, en entreprenant de déraciner chez l’homme la manie de tout analyser, c’est-à-dire l’envie et la témérité de juger tout ce qui s’offre à lui, avait entrepris plus que les travaux d’Hercule. Cette pensée si osée de Carnéade lui était née, à mon avis, de l’impudence qu’étalaient anciennement ceux qui faisaient profession de savoir et de leur outrecuidance démesurée.—Ésope était exposé en vente avec deux autres esclaves. Un acheteur s’enquit auprès de l’un d’eux de ce qu’il savait faire; celui-ci, pour se faire valoir, dit monts et merveilles: il savait ceci, il savait cela, etc. L’autre en dit autant et plus de lui-même. Quand vint le tour d’Ésope et qu’on lui demanda à lui aussi ce qu’il savait faire: «Rien, répondit-il, ces deux-ci ont tout pris, ils savent tout.»—La même chose s’est produite dans les écoles de philosophie. L’audace de ceux qui attribuaient à l’esprit humain l’aptitude à tout savoir, en a amené d’autres à émettre, par dépit et contradiction, qu’il n’est capable de rien; ceux-ci portent cette ignorance à l’extrême, comme ceux-là font de la science; de telle sorte qu’on ne peut nier que l’homme ne soit immodéré en toutes choses, et qu’il ne s’arrête que lorsqu’il y est contraint par l’impuissance où il se trouve de passer outre.
547
Presque toutes nos opinions ne se forment que par l’autorité d’autrui; nous admirons Socrate sans le connaître, sur sa réputation; s’il vivait à notre époque, peu d’hommes feraient cas d’un enseignement donné sous la forme simple et naïve qu’il emploie.—Presque toutes les opinions que nous avons, nous sont imposées sans que nous les ayons contrôlées; à cela il n’y a pas de mal: nous ne saurions, en ce siècle si faible, faire un plus mauvais choix, que si nous choisissions nous-mêmes. Les discours de Socrate, dont ses amis nous ont transmis la forme et le sens, n’ont notre approbation que par respect pour l’approbation universelle qui s’y est attachée de temps immémorial; ce n’est pas par nous-mêmes que nous les connaissons, ils ne sont pas à notre usage. S’il se produisait à cette heure quelque chose de pareil, peu d’hommes l’apprécieraient à sa valeur. Nous n’apercevons, en fait de grâces, que celles qui ont du piquant, qui sont bouffies et regorgent d’artifice; celles qui glissent, naïves et simples, échappent aisément à des organes aussi grossiers que les nôtres: elles ont une beauté délicate et cachée, et il faut une vue bien nette et que rien ne voile pour découvrir cette lumière dérobée. La naïveté n’est-elle pas du reste, à notre sens, proche parente de la sottise et ne la tenons-nous pas pour un défaut?—Socrate imprime à son âme un mouvement naturel qui est dans la manière de faire de tous; un paysan, une femme s’expriment comme il le fait; il parle constamment de cochers, de menuisiers, de savetiers et de * maçons; ses inductions, ses comparaisons sont tirées des actions les plus vulgaires de l’homme, de celles qui se répètent le plus; chacun comprend ce dont il parle. Nous n’eussions jamais de nous-mêmes apporté sous une forme aussi triviale tant de noblesse et de splendeur dans le choix de ses admirables conceptions, nous qui estimons plates et basses toutes celles que ne relève pas la forme sous laquelle elles s’enseignent, qui ne distinguons la richesse que si elle s’étale en grande pompe. Notre monde est pétri d’ostentation, les hommes ne s’enflent que de vent et vont par bonds, comme les ballons. Socrate, lui, ne cherche pas à faire prévaloir de chimériques idées, son but est de nous munir de choses et de préceptes qui profitent réellement de la façon la plus immédiate à la vie: «Régler ses actions, observer la loi du devoir, suivre la nature (Lucain).» Il fut toujours un, et est constamment demeuré semblable à lui-même; il s’est élevé à l’apogée de sa vigueur, non 549 par boutades, mais par tempérament; ou, pour mieux dire, il n’a rien surélevé, il a plutôt rabaissé l’homme pour le ramener à son point d’origine et tel que l’a fait la nature, à laquelle il a subordonné les aspirations, les mécomptes et les difficultés de la vie. Chez Caton, on voit bien clairement qu’il va planant sans cesse bien au-dessus des idées communes; dans ses exploits empreints de tant de bravoure, dans sa mort, on le sent toujours monté sur ses grands chevaux. Socrate, au contraire, va toujours rasant la terre, de ce même pas lent auquel nous allons tous; et il émet ses plus utiles discours, se conduit dans la mort et dans les moments les plus difficiles qu’il soit donné de traverser, comme en toutes les autres choses habituelles de la vie humaine.
Quel immense service n’a-t-il pas rendu à l’homme en lui montrant, dans un langage à la portée de tous, ce qu’il peut par lui-même.—Il s’est bien trouvé que l’homme le plus digne d’être connu et d’être présenté au monde comme exemple, soit celui que nous connaissons avec le plus de certitude. Il nous a été dépeint par les hommes les plus aptes à bien juger qui aient jamais existé; les témoignages qu’ils nous portent sur lui sont admirables d’exactitude et de compétence.—C’est une merveille qu’il ait pu discipliner les idées naissantes et si pures de l’enfant, au point que sans les altérer, ni les étirer, il soit arrivé à produire en notre âme ses plus beaux effets. Il ne nous la représente ni riche, ni ayant de hautes aspirations; il ne nous la montre que saine, mais d’une santé bien allègre et bien nette. Mettant en jeu les ressorts les plus naturels et les plus vulgaires, par des raisonnements absolument ordinaires et communs, sans s’émouvoir ni s’exciter, il fait admettre non seulement les croyances, les actions, les mœurs mieux réglées, mais aussi les plus hautes, les plus vigoureuses qui jamais ont eu cours. C’est lui qui a ramené du ciel, où elle perdait son temps, la sagesse humaine pour la rendre à l’homme chez lequel avec raison elle trouve le plus à s’employer. Voyez-le plaidant devant ses juges; voyez par quelles raisons il se montre courageux quand il est aux prises avec les hasards de la guerre, par quels arguments il fortifie sa patience contre la calomnie, la tyrannie, la mort et même contre le caractère acariâtre de sa femme; il n’emprunte rien ni à l’art, ni à la science; les gens les plus simples reconnaissent chez lui les moyens et la force dont ils disposent eux-mêmes. Il n’est pas possible de revenir en arrière, ni de descendre plus bas. Il a rendu grand service à la nature humaine, en lui montrant combien elle peut par elle-même.
L’homme est incapable de modération, même dans sa passion d’apprendre; inanité de la science. Ce qui nous est vraiment utile est naturellement en nous, mais il faut le découvrir, et c’est ce que Socrate nous enseigne.—Nous sommes chacun plus riches que nous ne pensons; mais on nous dresse à emprunter et à quémander; on nous façonne à nous servir plus d’autrui que de nous-mêmes. L’homme ne sait en rien s’arrêter 551 dès qu’il a satisfait à ce dont il a besoin; qu’il s’agisse de volupté, de richesse, de puissance, il en embrasse plus qu’il n’en peut étreindre; son avidité est incapable de modération. J’estime qu’il en est de même de la curiosité qu’il met à savoir; il se prépare plus de besogne qu’il n’en peut faire et bien plus qu’il ne lui est nécessaire, tirant de plus en plus parti de ce savoir au fur et à mesure qu’il lui fournit davantage de matière à utiliser: «Nous ne mettons pas plus de modération dans l’étude des lettres, que dans tout le reste (Sénèque)»; et Tacite a raison quand il loue la mère d’Agricola de ce qu’elle contenait chez son fils le désir trop ardent d’apprendre.
La science est un bien qui, à le considérer avec calme, a, comme tous les autres biens des hommes, beaucoup de vanité et une faiblesse propre qu’elle tient de la nature; de plus, elle coûte cher. L’acquisition en présente beaucoup plus de risques que celle de n’importe quel autre aliment ou boisson; toute autre chose, quand nous l’avons achetée, nous l’emportons au logis et la plaçons dans un récipient quelconque, où il nous est loisible d’examiner ce qu’elle vaut, la quantité que nous en prendrons, et à quelle heure. Les sciences, nous ne pouvons, dès l’arrivée, les mettre dans un vase autre que dans notre âme; nous les absorbons en les achetant et, quand nous sortons du marché, nous en sommes déjà ou corrompus ou amendés. Il y en a parmi elles qui ne font guère que nous gêner et nous entraver, au lieu de nous nourrir; et telles autres, présentées comme devant nous guérir, nous empoisonnent. J’ai éprouvé du plaisir à voir que, quelque part, des hommes font, par dévotion, vœu d’ignorance, comme d’autres de chasteté, de pauvreté et de pénitence; c’est aussi châtier nos appétits désordonnés que d’émousser cette cupidité qui nous excite à l’étude des livres, et sevrer l’âme de cette volupté que nous savourons avec tant de délices, que nous procure l’idée que nous sommes des savants; c’est satisfaire on ne peut mieux au vœu de pauvreté que d’y joindre celle de l’esprit.—Nous n’avons pas besoin de beaucoup de science pour vivre à notre aise, et Socrate nous apprend que ce qui nous en est nécessaire est en nous; il nous donne la manière de l’y trouver et d’en tirer parti. Toute science, au delà de celle que nous tenons de la nature, est à peu près vaine et superflue; c’est déjà beaucoup si elle ne nous surcharge et ne nous trouble pas plus qu’elle ne nous sert: «Il faut peu de lettres à un esprit sage (Sénèque)»; elle est pour notre esprit une cause de fièvre qui le brouille et l’inquiète. Recueillez-vous, vous trouverez en vous les arguments que vous fournit la nature pour vous préparer à la mort, et ceux-ci sont vrais et les plus propres à nous servir en cas de nécessité; ce sont ceux qui aident le paysan et des peuples entiers à l’affronter avec autant de fermeté qu’un philosophe. Serais-je mort moins allégrement si cela m’était arrivé avant que j’aie connu les Tusculanes? je pense que non; et, quand je fais un retour sur moi-même, je sens que la connaissance de cet ouvrage 553 a enrichi mon langage, mais bien peu fortifié mon courage, qui demeure tel que la nature l’a créé et ne s’arme pour ce combat que comme chacun le fait naturellement; les livres n’ont pas tant servi à mon éducation qu’à exercer mon esprit. On pourrait même dire que la science, en essayant de nous fournir de nouveaux moyens de défense contre les accidents avec lesquels la nature nous met aux prises, ajoute plus à l’idée que nous nous faisons de la grandeur et du poids de ces accidents, qu’elle ne nous soutient par les raisons et les subtilités qu’elle nous suggère. Car ce sont vraiment des subtilités, que ce par quoi elle nous tient souvent bien vainement en éveil. Voyez combien même les auteurs qui possèdent le mieux leur sujet et les plus sages sèment autour d’un bon argument quantité d’autres secondaires et, pour qui y regarde de près, vides de sens; ce ne sont que des arguties de mots qui nous trompent; mais, comme cela peut avoir son utilité, je ne veux pas en discuter autrement. Ici même, il s’en trouve assez de cette nature que j’ai insérés çà et là, soit pour les avoir empruntés, soit pour les avoir imités. Encore faut-il un peu se garder de ne pas appeler force ce qui n’est que gentillesse, solide ce qui n’est que subtil, ou bon ce qui n’est que beau: «ce qui plaît au goût, ne plaît pas autant à l’estomac (Cicéron)»; tout ce qui plaît, ne nourrit pas, «lorsqu’il s’agit de l’âme et non plus de l’esprit (Sénèque)».
L’indifférence et la résignation avec lesquelles les pauvres supportent la mort et les autres accidents de la vie, sont plus instructives que les enseignements de la science.—A voir les efforts que fait Sénèque pour se préparer contre la mort, à le voir s’épuiser pour se raidir et garder son assurance, se démener contre cette obsession, il se serait discrédité à mes yeux si, par sa mort même, il n’eût si vaillamment soutenu sa réputation. Son agitation fébrile qui se renouvelle si souvent, dénote combien il était lui-même nerveux et surexcité. «Une âme forte s’exprime d’une manière plus calme, plus rassise.... L’esprit a la même teinte que l’âme»; ce sont là des phrases qui lui appartiennent, je les lui emprunte pour mieux le dépeindre, elles montrent combien il était préoccupé de ce moment. La façon dont Plutarque l’envisage est dédaigneuse et moins obsédante; je la tiens pour être par cela même plus virile et plus persuasive, et serais porté à croire que son âme avait les mouvements plus calmes et plus réguliers. Le premier, plus aigu, nous pique et amène en nous des sursauts; il fait surtout impression sur notre esprit. Le second, plus solide, nous renseigne, nous prépare, nous réconforte constamment; il impressionne surtout notre entendement. Celui-là enchante notre jugement, celui-ci le gagne.—J’ai vu aussi d’autres écrits d’auteurs plus révérés encore qui, lorsqu’ils nous dépeignent les luttes qu’ils ont eues à soutenir contre les aiguillons de la chair, les représentent si cuisants, si puissants, si invincibles que nous, qui appartenons à la lie du peuple, sommes amenés à admirer autant l’étrangeté et l’acuité, dont nous ne nous rendons pas compte, des 555 tentations qu’ils ont éprouvées, que la résistance qu’ils leur ont opposée.
A quoi peut nous conduire la résistance que provoquent en nous les efforts de la science? Regardons sur terre: Les pauvres gens que nous y voyons disséminés, la tête penchée sur leur travail, qui ne connaissent ni Aristote, ni Caton, ni exemples, ni préceptes, obéissant à la nature, donnent tous les jours des marques de constance et de patience plus pures et plus grandes que ne sont celles que nous étudions dans les écoles avec tant d’application. Combien en vois-je journellement qui se soucient peu de leur pauvreté, qui désirent la mort, qui la reçoivent sans alarme ni affliction. L’homme qui travaille en ce moment mon jardin, a enterré ce matin son père ou son fils. Les noms mêmes qu’ils donnent aux maladies en adoucissent et atténuent l’âpreté: la phtisie est pour eux de la toux; la dysenterie, un cours de ventre; la pleurésie, un refroidissement; et, de même qu’ils en tempèrent les dénominations, ils les supportent sans s’en préoccuper outre mesure. Il faut qu’elles soient bien graves pour leur faire interrompre leur labeur journalier; ils ne s’alitent que pour mourir: «Cette vertu simple et naïve a été changée en une science obscure et futile (Sénèque).»
C’est au milieu des désordres de la guerre civile que Montaigne écrit: excès qui se commettent, indiscipline des armées; les meilleurs, en ces circonstances, finissent par se gâter.—J’écrivais ceci vers l’époque où, pendant plusieurs mois, fondaient directement sur moi, de tout leur poids, les charges résultant des troubles auxquels nous sommes en proie. J’avais, d’une part, les ennemis à ma porte; de l’autre, les maraudeurs, pires encore que les ennemis, «combattant non par les armes, mais par le crime». J’étais journellement en butte à toutes sortes de dommages du fait des hostilités: «A droite et à gauche, un ennemi redoutable me menace; j’ai à craindre des deux côtés à la fois (Ovide).» Quelle guerre monstrueuse! Les autres sont dirigées contre le dehors, celle-ci contre nous-mêmes; elle se ronge, se détruit par son propre venin. Elle est d’une nature si maligne et si désastreuse, qu’elle se ruine en même temps que tout le reste; dans sa rage, elle se déchire et se met en pièces. Nous la voyons plutôt s’éteindre d’elle-même, que faute d’aliment qui la soutienne ou parce que l’un des partis l’emporte. Aucune discipline n’y règne: elle a pour objet de mettre fin à la sédition, elle-même en est pleine; de châtier la désobéissance, elle en donne l’exemple; employée à la défense des lois, elle est aussi pour sa part en révolte contre celles qui la régissent. Où allons-nous? Le seul médicament auquel on puisse avoir recours est infectieux: «Notre mal s’empoisonne du secours qu’on lui donne;—il s’empire et s’aigrit par le remède qu’on y applique (Virgile).—Le juste et l’injuste mêlés et confondus par nos coupables fureurs, ont détourné de nous la protection des dieux (Catulle).»
Dans ces maladies des peuples, on peut, au début, distinguer 557 ceux qui sont bien portants de ceux qui sont malades; mais quand elles se prolongent comme dans notre cas, tout le corps s’en ressent de la tête aux pieds, aucune partie n’est exempte de corruption, car il n’y a pas d’air qui s’aspire aussi goulûment, qui se répande et pénètre comme la licence. Nos armées n’ont de consistance, ne conservent de cohésion que grâce au ciment qu’y introduit le concours de l’étranger; avec des Français, on n’arrive plus à constituer un seul corps d’armée qui soit bien organisé et ne se débande pas. Quelle honte! il n’y a chez nous de discipline que celle qui existe dans les éléments étrangers que nous avons appelés dans nos rangs. Quant à nous, nous nous conduisons suivant notre bon plaisir et non d’après la volonté de nos chefs; chacun fait comme il l’entend; le commandement a plus à faire au dedans qu’au dehors; il lui faut suivre ses soldats, leur faire la cour, se plier à leurs exigences; lui seul obéit, tout le reste est libre et ne connaît aucun frein.—Il me plaît de constater combien il y a de lâcheté et de pusillanimité dans l’ambition, quelle abjection et quelle servitude il lui faut pour arriver à son but; mais je déplore de voir de bonnes natures, capables de pratiquer la justice, se corrompre tous les jours à manier et commander ce milieu où règne tant de confusion. A force de souffrir, on s’y habitue; et l’habitude fait qu’on se résigne et qu’on imite. Nous avions assez de natures mauvaises par elles-mêmes, sans que celles qui sont bonnes et généreuses se gâtent; si cela continue, on trouvera difficilement à qui confier la santé de cet état, au cas où il plairait à la fortune de la lui rendre: «N’empêchez pas du moins ce jeune homme de relever un siècle qui croule (Virgile)!»
Qu’est devenu cet ancien précepte, que les soldats devaient plus craindre leur chef que l’ennemi? Et le merveilleux exemple de ce pommier compris dans les limites d’un camp de l’armée romaine, laquelle on vit le lendemain se transporter ailleurs, laissant au propriétaire de cet arbre le compte intact de ses pommes, bien qu’elles fussent mûres à point et délicieuses?—Je préférerais que notre jeunesse, au lieu d’employer son temps en allées et venues moins utiles, à des apprentissages moins honorables, en consacrât partie à faire la guerre sur mer sous les ordres d’un bon capitaine commandeur de Rhodes, partie à aller constater la discipline des armées turques si différente et si supérieure à la nôtre. Tandis que les expéditions rendent nos soldats plus licencieux, les leurs en deviennent plus retenus et plus craintifs, parce que là les offenses et les vols commis envers le menu peuple, qui en temps de paix se punissent de la bastonnade, atteignent en guerre une importance capitale: un œuf pris sans payer, entraîne cinquante coups de bâton, c’est un prix fait à l’avance; et pour tout autre méfait si léger qu’il soit, n’ayant pas rapport à la nourriture, on empale, on décapite séance tenante le coupable. J’ai été étonné de lire dans l’histoire de Sélim, le plus cruel conquérant qui fut jamais, que lorsqu’il subjugua l’Égypte, les beaux jardins qui environnaient 559 Damas, situés en plein pays conquis, ouverts à tout venant et où son armée avait même ses campements, demeurèrent absolument intacts, respectés de ses soldats auxquels n’avait pas été donné le signal du pillage.
Quels que soient les abus d’un gouvernement, s’armer contre lui sous prétexte d’y remédier est inexcusable; il faut laisser faire à la Providence.—Est-il quelque chose de si mauvais dans un gouvernement, qui vaille d’être combattu par une drogue aussi mortelle que la guerre civile? Non, disait Favonius, pas même le renversement d’un tyran qui a usurpé le pouvoir dans une république. Platon, lui non plus, n’admet pas qu’on violente le repos de son pays pour le guérir, et n’accepte pas un remède qui le trouble, qui remet tout aux mains du hasard, fait couler le sang et cause la ruine des citoyens. Il pose comme du devoir, en pareil cas, de tout homme de bien, de laisser aller les choses et de se borner à prier Dieu d’y porter sa main toute-puissante; il semble même avoir su mauvais gré à Dion, pourtant son grand ami, d’avoir agi quelque peu autrement. J’étais à cet égard dans les idées de Platon, avant de savoir que Platon eût existé. Nous ne pouvons assurément pas, nous chrétiens, le compter comme étant des nôtres, bien que, par la sincérité de sa conscience, il ait mérité de la faveur divine d’approcher si près la lumière de l’Évangile, au travers des ténèbres qui, de son temps, obscurcissaient le monde; aussi je ne pense pas qu’il soit bienséant que ce soit lui, un païen, qui nous montre combien il est impie de ne pas attendre de Dieu, sans y coopérer nous-mêmes, un secours qu’il n’appartient qu’à lui de nous donner. Je me prends souvent à douter que, parmi tant de gens mêlés à nos désordres publics, il s’en trouve à l’entendement si faible, qu’on ait pu les amener à croire de bonne foi que par les pires excès on arriverait à réformer les abus; que le salut doit sortir de la mise en action de ces mêmes moyens qui doivent indubitablement nous conduire à la damnation; qu’en renversant le gouvernement, la magistrature, les lois sous la tutelle desquels Dieu nous a placé, * en démembrant notre mère et en jetant les membres en pâture à ses anciens ennemis; qu’en donnant lieu à des frères, armés les uns contre les autres, de déployer leur courage dans ces luttes parricides, où se meurt leur patrie commune; qu’enfin en appelant à l’aide le diable et les furies, ils apportent leur concours à la divine Providence qui incarne en elle la justice et la douceur, cette vertu par excellence. L’ambition, l’avarice, la cruauté, la vengeance ne se donnent pas assez tout naturellement carrière par elles-mêmes: amorçons-les, attisons-les sous le couvert de ces vertus si glorieuses, la justice et la dévotion. On ne peut imaginer un état de choses pire que celui où la méchanceté est devenue légitime et revêt, avec la connivence du magistrat, le manteau de la vertu: «Rien de plus trompeur qu’une religion dépravée, qui couvre ses crimes de l’intérêt des dieux (Tite Live)»; l’extrême injustice, dit Platon, est que ce qui est injuste soit tenu pour juste.
561
Le peuple se trouve ruiné pour de longues années par les déprédations qui se commirent alors; et lui, Montaigne, a eu de plus à souffrir des suspicions de tous les partis, aggravées par le peu de souplesse de son caractère.—Par suite des déprédations qui se commirent alors, «tant il y avait de troubles et de désordres dans nos campagnes (Virgile)!» le peuple a eu beaucoup à souffrir non seulement dans le présent, mais aussi pour l’avenir; les vivants en ont pâti et, avec eux, ceux qui n’étaient pas encore nés. On le pilla, et moi par conséquent, jusque dans ses espérances, lui enlevant tout ce qui devait le faire vivre pendant de longues années: «Ce que ces bandes criminelles ne peuvent emporter ou emmener, elles le détruisent; elles vont jusqu’à incendier d’innocentes chaumières (Ovide).—Nulle sécurité dans les villes; dans les campagnes, tout est dévasté (Claudien).»
Outre cette épreuve, j’en eus bien d’autres à endurer. J’ai subi les inconvénients qu’entraîne la modération dans ces sortes de maladies; j’ai été dépouillé par tous les partis: j’étais Gibelin pour les Guelphes, et Guelphe pour les Gibelins, comme dit je ne sais où un de mes poètes. La situation de ma maison, mes relations avec les personnes de mon voisinage me présentaient sous un aspect, ma vie et mes actes sous un autre. On ne portait pas contre moi d’accusations formelles, je n’y donnais pas prise, ne transgressant jamais les lois (qui eût ouvert une enquête sur mon compte, n’aurait eu que des éloges à me donner); mais c’étaient des soupçons émis à la sourdine, qu’on se communiquait sous main et auxquels les apparences pouvaient prêter, ce qui ne manque jamais dans une confusion pareille et avec des esprits envieux ou ineptes.—J’aide d’habitude aux présomptions injurieuses que la fortune sème contre moi, par la façon que j’ai toujours eue de fuir à me justifier, m’excuser et entrer en explications, estimant que c’est exposer ma conscience à quelque interprétation fâcheuse que de plaider pour elle, «car la discussion affaiblit l’évidence (Cicéron)»; et, comme si chacun voyait en moi aussi clair que j’y vois moi-même, au lieu de chercher à me soustraire à l’accusation, j’y donne plus de prise encore; je renchéris plutôt sur elle, en confessant des torts ironiques et moqueurs, lorsque je ne m’en tais pas complètement comme d’une chose indigne de réponse. Aussi ceux qui jugent que mon attitude témoigne une trop hautaine confiance dans la justice de ma cause, ne m’en veulent guère moins que ceux qui y voient une preuve de faiblesse qui fait qu’elle ne peut se défendre; les grands en particulier pensent de la sorte, parce qu’à leurs yeux, le manque de soumission est la plus grande faute qui se puisse commettre et qu’ils sont rudes pour le droit qui se connaît, qui a conscience de lui-même et ne se montre ni soumis, ni humble, ni suppliant; c’est là un obstacle auquel souvent je me suis heurté.—Un ambitieux se fût pendu de désespoir de ce qui m’advint alors, un avare en eût fait autant; moi, je me borne à ne pas faire d’acquisitions: «Que je conserve seulement ce qui m’appartient, 563 et même moins s’il le faut, peu m’importe; je ne souhaite m’occuper que de moi durant les jours que les dieux veulent bien m’accorder encore (Horace).» Toutefois les pertes que j’éprouve du fait de la méchanceté d’autrui, lorsqu’il me vole ou qu’il me pille, m’affectent à peu près comme quelqu’un qui serait en proie aux tortures de l’avarice; l’offense m’irrite encore incomparablement plus que le dommage qui m’est fait. Mille maux de toutes sortes m’ont assailli à cette époque les uns après les autres, je les eusse plus virilement supportés s’ils étaient venus fondre sur moi tous à la fois.
Dans son infortune, Montaigne, ne voyant pas d’ami à qui s’adresser, prend le parti de ne compter que sur lui-même, et de se désintéresser de tout ce qui ne le touche pas directement et qu’il ne considère plus que comme un sujet d’étude; il arrive de la sorte à recouvrer sa tranquillité d’esprit.—Je songeais déjà auquel de mes amis je pourrais confier le soin de m’entretenir dans ma vieillesse devenue nécessiteuse et infortunée. Les ayant tous passés en revue dans mon esprit, je me trouvai dans un grand embarras. On ne saurait être recueilli dans une chute aussi lourde et de si haut, que par un ami auquel vous lie une affection solide, à toute épreuve, vrai présent de la fortune; c’est chose rare, si même elle existe. Finalement, je reconnus que le plus sûr était de ne m’en fier qu’à moi-même de la tâche de veiller sur moi et d’assurer mes besoins; et que, s’il m’advenait d’être mal venu dans les faveurs de la fortune, je n’avais autre chose à faire qu’à me recommander davantage à moi-même, de m’y attacher, de m’en occuper plus encore que je ne l’avais fait jusqu’alors. En toutes choses, l’homme a recours à l’appui des autres pour s’épargner de recourir à celui qu’il a en lui, lequel cependant est le seul sur lequel il puisse compter et soit assez puissant pour le tirer d’affaire s’il sait en user; chacun court ailleurs pour assurer son avenir, parce que personne ne s’est adressé à soi-même.—J’en arrivai à conclure que ces épreuves avaient leur utilité: d’abord, parce que c’est avec le fouet qu’on ramène à la raison les mauvais disciples quand celle-ci ne suffit pas, de même qu’on emploie le feu et des coins violemment enfoncés pour redresser une pièce de bois qui a gauchi. Quoique je me prêche depuis bien longtemps de ne m’en tenir qu’à moi et de ne plus m’inquiéter des choses étrangères, cela n’empêche que je tourne toujours encore les yeux sur ce qui se passe à côté; un signe, un mot gracieux d’un grand personnage qui me fait bon visage me tentent; et cependant Dieu sait si on s’en prive en ces temps-ci et quelle portée cela a! J’écoute encore, sans que mon front se ride, les avances que l’on me fait pour que j’accepte des fonctions qui rapportent, et m’en défends si mollement qu’il semble que je ne demande qu’à être vaincu. Or, à un esprit si indocile il faut des corrections; il faut rebattre et resserrer à grands coups répétés de maillet ce vaisseau qui se disjoint, se disloque, qui échappe et que 565 nous ne pouvons retenir. En second lieu, ces accidents me servaient d’exercices pour me préparer à pis, pour le cas où je viendrais à être des premiers engloutis dans cette tempête, alors que j’avais espéré être des derniers du fait de ma bonne fortune et des conditions dans lesquelles je vis; ils m’amenaient à m’astreindre de bonne heure à un genre de vie me préparant à ce nouvel état de choses. La véritable liberté consiste à avoir, en tout, pouvoir sur soi-même: «Le plus puissant est celui qui est maître de soi (Sénèque).» Dans des temps normaux et tranquilles, on se prépare en vue d’accidents survenant couramment et de peu d’importance; mais dans le désarroi dans lequel nous sommes depuis trente ans, tout Français, tant comme particulier qu’au point de vue général, se voit à toute heure menacé d’un complet renversement de sa fortune; aussi faut-il, pour que son courage soit à hauteur de tout événement, avoir pris les mesures de précaution les plus efficaces et les plus énergiques. Sachons gré au sort de nous avoir fait vivre en un siècle où la mollesse, la langueur, l’oisiveté ne sont pas de mise; grâce à cela, tel qui n’eût jamais été connu autrement, deviendra fameux par ses malheurs.—Comme je ne lis guère l’histoire des agitations qui se produisent dans les autres pays, je n’ai pas regret de ne pas m’y être plus adonné jusqu’à présent, ma curiosité à cet égard étant amplement satisfaite par le spectacle si particulier que j’ai sous les yeux, de la mort de notre état public, des symptômes qui l’annoncent, de la forme qu’elle revêt; ne pouvant la retarder, je suis content d’être appelé à y assister et de m’en instruire. Tout en étant émus de ce que nous voyons, nous sommes * avides des fictions, des représentations théâtrales où se reproduit le jeu des tragédies dont se compose la vie humaine; de même nous nous plaisons, en raison de leur rareté et malgré le chagrin que nous en éprouvons, à être témoins de ces tristes événements. Nous ne sommes chatouillés que par ce qui nous irrite; c’est ainsi que les bons historiens fuient, à l’égal de l’eau dormante et d’une mer morte, les périodes de calme, et s’en dédommagent en racontant les séditions, les guerres par lesquelles ils savent qu’ils nous intéressent davantage.
Je doute que je puisse honnêtement avouer à quel prix honteux j’ai passé ma vie dans le repos et la tranquillité, quoique pendant plus de la moitié de mon existence mon pays courût à sa perte. J’apporte un peu trop d’indifférence à supporter les accidents qui ne me touchent pas directement; et pour apprécier vis-à-vis de moi-même dans quelle mesure je suis à plaindre, je ne considère pas tant ce qu’on m’a enlevé, que ce qui m’est laissé intact en fait de liberté et de biens. Il y a quelque consolation à esquiver tantôt un mal, tantôt un autre de ceux qui nous menacent d’une façon immédiate et vont s’abattre ailleurs autour de nous. Ce qui contribue encore à ce que je me résigne, c’est qu’en ce qui a trait à l’intérêt public, plus mon affection a à s’exercer sur une plus grande étendue, plus elle est faible, d’autant qu’il est bien à moitié vrai que «nous 567 ne sentons des maux publics que ce qui nous touche (Tite Live)», et que l’état de santé qui a précédé les désordres actuels était tel, qu’il est une atténuation aux regrets que nous devrions en éprouver.—Ce n’était du reste la santé que comparé aux troubles qui l’ont suivi; et, de fait, nous ne sommes pas tombés de bien haut. La corruption et le brigandage qui règnent chez ceux qui détiennent les dignités et les charges, me semblent plus insupportables que chez n’importe quels autres; être volé dans un bois offense moins que de l’être là où on devrait se trouver en sûreté. La classe élevée n’était qu’un assemblage composé uniquement de membres tarés chacun en son particulier, et tous plus les uns que les autres; la plupart étaient affligés d’ulcères invétérés qu’on ne traitait plus et dont on ne demandait même pas la guérison.
Cet effondrement m’intéressa donc en vérité plus qu’il ne m’atterra, grâce à ma conscience qui non seulement était tranquille, mais dont j’étais fier, ne trouvant aucun reproche à me faire. En outre, comme Dieu ne nous envoie jamais les maux, pas plus que les biens, sans atténuation, ma santé, contre son ordinaire, ne laissa, durant ce temps, rien à désirer; et si sans elle je ne suis bon à rien, avec elle il est peu de choses dont je ne sois capable. Elle me donna le moyen de faire appel à toutes mes ressources et de parer en partie avec la main le coup qui m’était porté et qui eût pénétré plus profondément; je constatai de plus que ma force de résistance me permettait, dans une certaine mesure, de tenir bon contre la fortune et que pour me faire vider les étriers il fallait un choc violent. Cela, je ne le dis pas pour la provoquer à me charger plus vigoureusement; je suis entre ses mains, et me soumets à ses exigences, qu’elle fasse donc suivant son bon plaisir; mais dire que je ne suis pas sensible à ses assauts, cela non! Ceux que la tristesse détient et accable se laissent cependant, par intervalles, toucher par certains plaisirs s’offrant à eux, et parfois un sourire leur échappe; je suis de même, j’ai assez d’empire sur moi pour faire qu’à l’ordinaire mon état soit calme et dégagé de pénibles obsessions; pourtant, je me laisse quelquefois surprendre et mordre par ces accès d’humeur noire, qui m’oppressent pendant le temps que je mets à m’armer pour les chasser ou lutter contre eux.
Pour comble de malheur survint la peste; il fut contraint d’errer à l’aventure avec sa famille six mois durant et, pendant de longues années, la main-d’œuvre fit défaut pour la culture.—Après ces déboires, m’est survenue par surcroît cette autre calamité: sur ma maison et aux alentours la peste s’est abattue avec une violence qu’on n’avait jamais vue. Les corps les plus sains sont sujets à des maladies plus graves que ceux qui sont débilités, parce qu’ils ne peuvent être terrassés que par elles: il en fut de même de l’air de mon domaine, si salubre que de mémoire d’homme la contagion, bien qu’ayant sévi aux environs, n’y avait jamais pris pied; une fois contaminé, les effets les plus étranges se produisirent: «Vieillards et jeunes gens s’entassent 569 pêle-mêle dans le tombeau, nul n’échappe à la cruelle Proserpine (Horace).» Je passai par ce singulier état, que la vue de ma maison m’horripilait; tout ce qui y était, demeurant sans gardien, fut à la merci de qui en eut envie. Moi, si hospitalier, j’eus beaucoup de mal à trouver un refuge pour ma famille qui, devenue errante, était un objet de frayeur pour ses amis et pour elle-même; on la repoussait avec horreur partout où elle se présentait; il lui fallait changer d’asile dès que quelqu’un des siens commençait à se plaindre, fut-ce d’une douleur ressentie au petit doigt, car toutes les maladies étaient considérées alors comme étant la peste, et on ne se donnait pas la peine d’approfondir. Ce qu’il y a de plus fort, c’est que d’après les règles de l’art, quand on est exposé au fléau, pendant quarante jours on a à craindre d’en être atteint, et pendant tout ce temps l’imagination, vous tourmentant à sa façon, enfièvre jusqu’à votre santé.—Tout cela m’eût beaucoup moins touché, si je n’avais eu à me préoccuper des misères des autres et si je n’avais dû pendant six mois servir, dans des conditions aussi pénibles, de guide à cette caravane; car pour moi-même, je portais avec moi mes préservatifs, savoir la résolution et la résignation. Je n’avais pas grand’peur, ce qui est particulièrement à redouter dans ce mal; mais cependant si je m’étais trouvé seul et que j’eusse voulu prendre la fuite, je me fusse mis bien plus promptement à grande distance. Cette mort n’est pas de celles que je redouterais le plus: d’ordinaire, elle est prompte, on perd vite connaissance, on ne souffre pas, on se console par ce fait que tout le monde en est menacé; elle exclut toute cérémonie, tout deuil, la foule ne se presse pas autour de vous. Dans la contrée, un centième des gens périt: «Vous eussiez vu les campagnes désertes, les bois vides jusque dans leurs plus extrêmes profondeurs (Virgile).» Les terres que j’y possède composent la partie la plus importante de mes revenus; leur produit dépend essentiellement de la main-d’œuvre qu’on y emploie; une centaine d’ouvriers y travaillaient, de longtemps la culture n’en put être reprise.
Résignation des gens du peuple dans ce désastre général.—Quels exemples de résolution ne vîmes-nous pas, à ce moment, chez tous ces gens du peuple si simples! Généralement, nul ne prenait plus soin de la vie. Les raisins, principale richesse du pays, demeurèrent suspendus aux ceps. Tous, indifférents à la mort, s’y préparaient et l’attendaient soit pour le soir, soit pour le lendemain, avec une contenance et une voix si peu effrayées, qu’il semblait que ce fût une nécessité qu’ils acceptaient, comme conséquence d’une condamnation s’étendant à tous et à laquelle nul ne pouvait se soustraire. La mort est toujours inévitable; mais combien peu l’attendent avec résolution; une différence de quelques heures qui nous sépare du moment fatal, la compagnie en laquelle nous allons le franchir, diversifient la manière dont nous l’envisageons. Voyez ceux-ci: quoique enfants, jeunes gens et vieillards meurent tous dans l’espace d’un mois, personne parmi eux ne s’en étonne, 571 ni ne pleure. J’en ai vu qui redoutaient d’être épargnés et de demeurer seuls comme dans une horrible solitude; j’en ai connu qui n’avaient d’autre souci que des sépultures et se tourmentaient de voir les corps demeurer épars au milieu des champs, exposés à être dévorés par les bêtes fauves, qui ne tardèrent pas à se multiplier. Que les idées humaines affectent donc de formes diverses! Les Néorites, nation que subjugua Alexandre, déposent les corps des morts au plus profond de leurs forêts pour qu’ils y soient mangés; c’est la seule sépulture qu’ils tiennent pour honorable. Parmi nos gens, il y en eut qui, par avance, creusèrent leur fosse; d’autres s’y couchaient, étant encore vivants; un de mes manœuvres y expira même, attirant la terre à lui avec ses mains et ses pieds pour s’en recouvrir. Cet effort pour se créer un abri afin de s’y endormir plus à l’aise, n’est-il pas à hauteur de ce que firent d’analogue ces soldats romains qu’on trouva, après la bataille de Cannes, la tête enfouie dans des trous qu’ils avaient eux-mêmes creusés, puis comblés de leurs propres mains, en s’y étouffant? En somme, tout un pays en arriva subitement à s’élever par ses actes à une grandeur d’âme qui ne le cède en rien en énergie à aucune résolution concertée de propos délibéré.
Les enseignements de la science dans les grands événements de la vie, ne font que porter atteinte à notre force de résistance; à quoi bon appeler notre attention sur les maux auxquels nous sommes exposés? ne vaut-il pas mieux les ignorer jusqu’au moment où ils nous frappent?—La plupart des enseignements par lesquels la science nous encourage, ont plus d’apparence que de force; ils ornent plus qu’ils ne portent fruit. Nous avons abandonné la nature et voulons lui faire la leçon, à elle qui nous menait si heureusement et si sûrement; et cependant, le peu qui demeure de ce qu’elle nous a appris et dont, grâce à leur ignorance, la vie des foules à l’esprit rustique et inculte garde l’empreinte, la science est tous les jours contrainte de le lui emprunter, pour fournir ses disciples de modèles de constance, d’innocence et de tranquillité. Il est étrange de voir ses adeptes, qui sont bourrés de si belles connaissances, être réduits à imiter cette sotte simplicité, lorsqu’ils veulent mettre en pratique les principes les plus élémentaires de la vertu; et que notre sagesse doive apprendre des bêtes elles-mêmes les enseignements les plus utiles aux actes les plus grands et les plus indispensables de l’existence: comment il faut vivre et mourir, ménager ce que nous possédons, aimer et élever les enfants, pratiquer la justice. C’est là un singulier témoignage de la faiblesse humaine; et il est étrange que la raison, que nous dirigeons comme nous l’entendons, qui toujours imagine quelque diversité ou nouveauté, ne laisse subsister en nous aucune trace apparente de la nature. De celle-ci, les hommes ont fait ce que les parfumeurs font de l’huile: ils l’ont tellement sophistiquée par leurs arguments et leurs raisonnements auxquels elle n’avait rien à voir, qu’elle revêt maintenant un caractère essentiellement 573 variable, particulier à chacun, et a perdu celui qui lui était propre et s’appliquait à tous; maintenant, pour la retrouver, il faut en appeler au témoignage des bêtes, chez lesquelles elle est restée inaccessible à la faveur, à la corruption, à la versatilité d’opinions. Il est vrai que les bêtes elles-mêmes ne suivent pas toujours exactement la route tracée par la nature, mais elles s’en écartent si peu que les ornières en sont toujours visibles; ainsi font les chevaux qu’on mène en main: ils se livrent bien à des bonds et à des escapades, mais toujours dans la limite où leur longe le leur permet; et ils suivent quand même celui qui les conduit; pareillement l’oiseau qu’on dresse: lorsqu’il prend son vol, il ne s’éloigne jamais plus que de la longueur de la ficelle qui le retient.—«Méditez l’exil, les tourments, la guerre, les maladies, les naufrages, pour qu’aucun malheur ne vous surprenne (Sénèque).» A quoi nous sert cette curiosité qui nous fait nous préoccuper de toutes les misères auxquelles est sujette la nature humaine, et de nous préparer avec tant de peine, même contre celles dont nous ne courons pas risque d’être atteints? «L’appréhension de la douleur fait souffrir autant que la douleur elle-même (Sénèque)»; non seulement le coup, mais encore le souffle et le bruit du trait dirigé contre nous, nous frappent. Agir ainsi, c’est faire comme si nous avions le délire, car ce ne peut être que sous l’effet du délire, que vous alliez dès maintenant vous faire donner le fouet parce qu’il peut arriver qu’un jour la fortune vous expose à le recevoir, et prendre dès la Saint-Jean vos robes fourrées parce que vous en aurez besoin à Noël! Faites l’épreuve de tous les maux qui peuvent vous arriver, nous dit-on, et en particulier des plus extrêmes: soumettez-vous à l’épreuve de celui-ci, assurez-vous contre celui-là. Il serait au contraire plus facile et plus naturel d’en écarter jusqu’à la pensée. On dirait vraiment qu’ils ne viendront pas assez tôt et qu’ils ne nous dureront pas assez; on veut encore que notre esprit les étende et les allonge, et qu’avant qu’ils ne nous tiennent, il se les incorpore et s’en repaisse, comme s’ils ne pesaient pas déjà suffisamment sur nos sens: «Ils nous seront assez à charge quand ils s’appesantiront sur nous, dit un de ces maîtres, qui appartient non à l’une des sectes philosophiques les plus tendres, mais à celle dont les principes sont le plus rigoureux; en attendant, sois agréable à toi-même et reporte ta pensée sur ce que tu aimes le mieux. A quoi te sert d’aller au-devant de l’infortune et, lui faisant accueil, gâter le présent par crainte de l’avenir, te faire malheureux dès maintenant parce que tu dois, avec le temps, le devenir? Ce sont ses propres paroles. Peut-être est-ce quand elle nous instruit bien exactement de l’étendue de nos maux, «éclairant les mortels par une triste prévoyance (Virgile)», que la science nous rend service; ne serait-il pas en effet bien dommage que partie de notre mal échappe à notre connaissance et que nous n’en ayons pas l’appréhension?
L’expérience qu’elle prétend nous donner est déjà un tourment; laissons faire la nature, elle se charge au moment 575 voulu de suppléer à tout ce que nous ne savons pas.—Il est certain qu’à la plupart des hommes la préparation à la mort a causé plus de tourments que le passage de vie à trépas ne leur a causé de souffrance; un auteur judicieux a fort exactement dit jadis: «La souffrance que nous ressentons par l’effet d’un mal, frappe moins les sens que l’imagination (Quintilien).» Le sentiment d’une mort imminente provoque parfois subitement en nous la résolution de ne plus éviter une chose absolument inévitable. On a vu, dans les temps passés, des gladiateurs, après s’être lâchement conduits dans le combat, recevoir courageusement la mort, présentant leur gorge au fer de l’adversaire et le conviant à les frapper. La perspective d’une mort encore éloignée comporte une fermeté de plus longue durée, par suite plus difficile à entretenir. Si vous ne savez pas mourir, ne vous en tourmentez pas: la nature vous renseignera sur le moment même d’une façon complète et suffisante; elle fera parfaitement cette besogne à votre place, n’en prenez pas souci: «En vain, mortels, vous cherchez à connaître l’heure incertaine de vos funérailles et le chemin par lequel la mort doit venir (Properce).—Il est moins douloureux de supporter un grand malheur auquel nous ne pouvons échapper et qui nous arrive subitement, que de vivre longtemps dans la crainte (Pseudo-Gallus).» Nous troublons la vie par le souci de la mort, et la mort par le souci de la vie; l’une nous ennuie, l’autre nous effraie. Ce n’est pas contre la mort que nous nous préparons, c’est une chose trop momentanée; un quart d’heure de souffrance, qui est sans conséquence, qui n’a pas de suite nuisible, ne mérite pas de préceptes particuliers; à dire vrai, nous nous préparons contre les préparations à la mort. La philosophie nous ordonne de l’avoir toujours devant les yeux, de la prévoir, de l’envisager avant le temps; puis elle nous donne les règles à suivre, les précautions à prendre pour faire que cette prévoyance et cette pensée continue ne nous blessent pas. Les médecins ne procèdent pas autrement: ils nous accablent de maladies pour avoir occasion d’employer leur art et leurs drogues. Si nous n’avons pas su vivre, c’est bien à tort qu’on veut nous apprendre à mourir et donner à notre vie une fin qui ne soit pas conforme à son ensemble; si, au contraire, nous avons su vivre avec calme et fermeté, nous saurons bien mourir de même. Les philosophes peuvent se vanter tant qu’ils voudront de ce que «toute leur vie a été une méditation sur la mort (Cicéron)», m’est avis que la mort n’est que le bout et non le but de la vie; elle en est la fin, l’extrémité, mais non l’objet. Ce que la vie doit avoir en vue, ce qu’elle doit se proposer, c’est elle-même; c’est à se régler, à se conduire, à se souffrir qu’elle doit exclusivement s’appliquer. Parmi les tâches qui lui incombent et que comprend le chapitre du savoir-vivre, qui est capital et s’étend à tout, il est sur le savoir-mourir un paragraphe qui serait des moins importants, si nos craintes n’ajoutaient à son importance.
A en juger par leur utilité et par la vérité qui en forme le fond, 577 les leçons de la simplicité ne le cèdent guère à celles que nous prêchent les doctrines philosophiques, au contraire. Les hommes ne se ressemblent ni par leur façon de sentir ni par leur force morale; pour leur faire du bien, il faut agir suivant le tempérament de chacun et, pour cela, suivre des voies diverses: «Sur quelque rivage que la tempête me jette, j’aborde (Horace).» Je n’ai jamais vu de paysan, d’entre mes voisins, qui se soit pris à réfléchir sur la contenance et l’assurance qu’il aurait à tenir à son heure dernière; la nature ne l’invite à songer à la mort que lorsqu’il meurt, et, à ce moment, il a meilleure grâce qu’Aristote, sur lequel la mort pèse doublement, et par elle-même et par les longues méditations qu’il lui a consacrées. C’était l’opinion de César, qui estimait que celle dont on a eu le moins à se préoccuper, est la plus heureuse et la moins pénible: «S’affliger d’avance, c’est trop s’affliger (Sénèque).» L’idée de la mort n’est déplaisante que par le fait de notre curiosité; c’est ainsi que toujours nous nous faisons tort, en voulant devancer et régenter ce que fait la nature. Que les docteurs, quand ils sont bien portants, s’en fassent du mauvais sang et qu’elle les porte à la mélancolie, passe encore; mais le commun des mortels n’a, sur ce point, besoin ni de remède ni de consolation, sauf lorsque le coup le frappe, et il n’y songe qu’au moment même où il en souffre. C’est la confirmation de ce que nous disions que la stupidité et le défaut de crainte chez l’homme du peuple, lui donnent la résignation aux maux présents et une profonde indifférence pour ceux que lui réserve l’avenir; c’est parce qu’elle est plus grossière et plus obtuse, que son âme est moins pénétrable et moins sujette à s’agiter. Pour Dieu! s’il en est ainsi, tenons dorénavant école de bêtise: c’est la conclusion finale que la science nous fait entrevoir; c’est aussi à cela que, tout doucement, elle achemine ses disciples.
Socrate, par ses discours et ses exemples, nous enseigne à suivre purement et simplement la nature.—Sa défense devant ses juges.—Nous ne manquerons pas de bons professeurs pour nous enseigner la simplicité naturelle. Socrate en sera; car, autant qu’il m’en souvient, c’est à peu près dans ce sens, qu’il parle aux juges qui vont délibérer sur sa vie: «Je crains, Messieurs, si je vous prie de ne pas me condamner à mort, de prêter le flanc aux imputations que portent contre moi mes accusateurs, qui me reprochent de prétendre être plus entendu que tous autres, parce que j’aurais une connaissance qu’ils n’ont pas, des choses qui sont au-dessus et au-dessous de nous. Je sais que je n’ai ni fréquenté ni connu la mort, ni vu personne qui en ait constaté les avantages et les inconvénients, de manière à pouvoir m’en instruire. Ceux qui la craignent, présupposent la connaître; pour moi, j’ignore ce qu’elle est et ce qui se passe dans l’autre monde. Peut-être n’apporte-t-elle ni bien ni mal, peut-être est-elle désirable. Il est à croire pourtant qu’il y a avantage, si c’est un passage d’un lieu dans un autre, à aller vivre avec tant de 579 grands personnages qui ne sont plus et d’être exempt d’avoir affaire désormais à des juges iniques et corrompus. Si c’est un anéantissement complet de notre être, il y a encore avantage à entrer dans une nuit longue et paisible: nous n’avons rien en effet dans la vie qui soit plus doux qu’un repos et un sommeil tranquille et profond, que les songes ne troublent pas. Les choses que je sais être mauvaises, telles qu’offenser son prochain, désobéir à son supérieur qu’il soit dieu ou homme, je les évite avec soin; quant à celles que je ne sais être bonnes ou mauvaises, je ne saurais les redouter.—Si vous me faites mourir et que je vous laisse vivants, les dieux seuls savent qui de vous ou de moi sera le mieux partagé; c’est pourquoi, en ce qui me touche, vous déciderez ce qu’il vous plaira. Mais, si j’ai un conseil à vous donner, comme j’ai l’habitude de ne conseiller que des choses justes et utiles, je vous dis bien nettement que, pour votre conscience, ce que vous pouvez faire de mieux, c’est de me rendre la liberté, si vous ne voyez dans ma cause autre chose que ma personnalité. Et, puisque vous voilà juges de mes faits et gestes, tant publics que privés, accomplis jusqu’ici; du but que je me proposais; du profit que tant de citoyens, jeunes et vieux, retirent tous les jours de mes entretiens; du bien qui en résulte pour tous; vous ne pouvez vous acquitter convenablement des services que j’ai rendus, qu’en ordonnant que, vu ma pauvreté, je sois nourri au Prytanée, aux frais du trésor public, ainsi que souvent je vous l’ai vu, avec moins de raison, accorder à d’autres.—Ne prenez pas pour de l’obstination ou du dédain que je ne me mette pas, suivant la coutume, à vous supplier et chercher à émouvoir votre commisération. N’ayant pas plus que les autres été engendré, comme dit Homère, ni d’un bloc de bois, ni d’un bloc de pierre, j’ai des amis et des parents qui pourraient se présenter à vous en larmes et en deuil; j’ai trois enfants éplorés, c’est là de quoi éveiller votre pitié; mais ce serait une honte pour notre ville, qu’à mon âge, avec une réputation de sagesse telle, qu’elle est cause de ma mise en accusation, j’aille m’abaisser à une semblable attitude. Que dirait-on des autres Athéniens? J’ai toujours adjuré ceux qui m’ont entendu parler, de ne pas racheter leur vie par une action qui serait déshonnête. Dans les guerres que nous avons faites, à Potidée, à Délie et autres où je me suis trouvé, j’ai montré par mes actes combien j’étais loin de pourvoir à ma sûreté au prix de la honte; ce serait faire pis, que de vous détourner de votre devoir, en vous conviant à quelque chose de laid; car ce ne sont pas mes prières qui doivent vous persuader, mais les raisons pures et solides de la justice. Vous avez fait serment aux dieux de vous y tenir. Il semblerait, en vous suppliant, que je vous soupçonne et vous reproche de ne pas croire à leur existence, et, du même coup je témoignerais contre moi-même que je ne crois pas en eux comme je le dois; que je me défie de leur conduite, au lieu de remettre purement mon affaire 581 entre leurs mains. J’ai toute confiance en eux, et tiens pour certain qu’ils feront en ceci selon qu’il conviendra le mieux pour vous et pour moi; les gens de bien, qu’ils soient vivants ou morts, n’ont rien à craindre des dieux.»
Naïveté, et aussi hauteur de sentiments, de ce plaidoyer si digne de ce philosophe.—N’est-ce pas là un plaidoyer tel qu’il viendrait à l’idée d’un enfant? Quelle élévation d’âme inimaginable, * quelle franchise! combien vrai et juste, et en quelle pressante nécessité! Socrate a eu vraiment bien raison de le préférer à celui que le grand orateur Lysias avait écrit pour lui et qui, parfaitement conforme au style judiciaire, était indigne d’un si noble criminel. Eût-on compris des supplications dans la bouche de Socrate? sa magnifique vertu eût faibli, alors que plus que jamais c’était le moment de se montrer. Se pouvait-il que sa riche et puissante nature s’adressât à l’art pour se défendre, et que dans la circonstance où elle pouvait s’élever plus haut que dans toute autre, il renonçât à la vérité et à la simplicité qui constituaient le plus bel ornement de sa parole, pour se parer du fard des figures de rhétorique et des artifices d’un discours appris par cœur? Il agit très sagement et demeura conséquent avec lui-même, en n’altérant pas cette existence incorruptible qu’il avait toujours menée, cette image si parfaite de l’humanité qui s’incarne en lui, pour allonger d’une année son état de décrépitude et trahir le souvenir immortel de sa fin glorieuse. Il devait sa vie non à lui-même, mais au monde pour lui servir d’exemple; et, c’eût été un dommage public qu’il l’eût terminée dans l’oisiveté et l’obscurité. Certes une telle indifférence et un aussi faible souci de la mort qui l’attendait, méritaient que la postérité lui rendît d’autant plus justice que lui-même ne se l’était pas rendue en faisant si peu cas de la vie. C’est ce qui est arrivé; et rien n’est plus juste que ce que fit la fortune pour honorer sa mémoire: les Athéniens conçurent une telle horreur contre ceux qui avaient été cause de cette mort, qu’on les fuyait comme des excommuniés; on tenait pour souillé tout ce qu’ils avaient touché; personne n’entrait au bain avec eux, personne ne les saluait, ni ne les approchait, si bien que ne pouvant plus se voir un sujet de haine pour tous, ils se pendirent.
La mort y est présentée comme un simple incident de la vie; pourquoi en effet la nature nous ferait-elle prendre en horreur ce passage de vie à trépas, indispensable à l’accomplissement de son œuvre.—Si quelqu’un estime que parmi tant d’autres exemples tirés de la vie de Socrate, que je pouvais citer à l’appui de ma thèse, j’ai eu tort de choisir celui-ci, parce que le discours qu’y tient ce philosophe est bien au-dessus de ce qui peut venir à l’idée de la généralité des hommes, je répondrai que je l’ai choisi exprès, parce que j’en pense autrement et considère que, par sa naïveté, il est à ranger bien en arrière et bien plus bas que ceux qu’on peut entendre émettre communément. Par sa hardiesse dépouillée d’artifice, par la confiance enfantine 583 qu’il révèle, il représente bien l’impression première que fait naître la nature dans son ignorance et sa pureté; car il y a lieu de croire que c’est la douleur qui accompagne la mort que nous sommes naturellement portés à craindre et non la mort elle-même; celle-ci fait partie intégrante de notre être au même degré que la vie. Pourquoi la nature nous aurait-elle inspiré de la haine et de l’horreur pour elle, qui joue un rôle si essentiel en permettant la succession et le renouvellement de ses œuvres? Dans ce concert universel, elle sert plus à la naissance et à l’accroissement des créatures qu’à leur perte ou à leur ruine: «Ainsi se renouvellent toutes choses (Lucrèce);—une vie qui finit procure l’existence à mille autres (Ovide).»—La nature a inspiré aux bêtes le soin d’elles-mêmes et de leur propre conservation; elles vont même jusqu’à redouter ce qui peut leur nuire, tel que se heurter, se blesser, que nous les maîtrisions, que nous les battions et autres accidents qu’elles peuvent concevoir ou que l’expérience leur apprend; mais que nous les tuions, elles ne peuvent le craindre, parce qu’elles n’ont pas la faculté d’imaginer ce que peut être la mort et de s’en rendre compte; on en voit même, dit-on, qui non seulement la souffrent gaîment (les chevaux pour la plupart hennissent en mourant et les cygnes chantent à son approche), mais la recherchent comme un besoin qu’elles éprouvent, ainsi qu’on est porté à le penser, par ce qui a été constaté chez certains éléphants.
Indépendamment de cela, la façon dont argumente Socrate n’est-elle pas admirable par sa simplicité et son énergie? Il est incontestable qu’il est bien plus malaisé de parler et de vivre comme lui, que de parler comme Aristote et de vivre comme César; c’est le comble de la perfection et de la difficulté, et l’art n’y peut atteindre. Nos facultés ne sont pas dressées à cet effet; nous n’en faisons pas l’essai, et ne connaissons pas ce dont elles sont capables; nous avons recours à celles d’autrui et laissons les nôtres inactives, tout comme on pourrait dire de moi, que je ne fais que composer ici un amas de fleurs étrangères, ne fournissant de mon propre cru que le fil qui sert à les attacher.
Montaigne s’excuse d’avoir introduit peu à peu quantité de citations dans son ouvrage; il y a été entraîné par l’occasion que cela lui procurait d’utiliser ses loisirs.—J’ai fait il est vrai, à l’opinion publique, la concession de me parer de ces enjolivements que j’ai empruntés; mais je n’entends ni qu’ils me couvrent, ni qu’ils me cachent; ce serait le rebours de ce que je me propose; je ne veux faire montre que de ce qui est à moi et qui vient de moi du fait même de la nature; si le hasard m’eût fait suivre ma première inspiration, j’eusse été seul à prendre la parole. Malgré ce que je m’étais proposé et la manière dont j’ai commencé, je multiplie de plus en plus, tous les jours, mes citations; j’y suis amené parce que c’est le goût du siècle, et aussi par les loisirs dont je dispose. Peut-être eût-il été mieux de n’en rien faire, je le crois; 585 n’importe, cela peut être utile à d’autres.—Il y a des gens qui mettent en avant Platon et Homère, qu’ils n’ont jamais lus; moi aussi, je donne bien des passages d’auteurs que j’ai pris ailleurs qu’à leur source. Comme j’ai un millier de livres autour de moi là où j’écris, sans me donner de peine et sans grand savoir je puis emprunter, séance tenante, si cela me plaît, à une douzaine de ravaudeurs de cette espèce, écrivains que je ne feuillette guère, de quoi émailler tout le présent chapitre sur la Physionomie; à elle seule, l’introduction qui précède n’importe quel ouvrage d’un auteur allemand suffirait pour me permettre de combler le dit chapitre de citations. Et c’est ainsi que nous arrivons à capter cette gloire dont nous sommes si friands, et à tromper les sots de ce monde! Cet amalgame de lieux communs, dont tant de gens font leur étude, ne s’applique guère qu’à des sujets communs; ils servent à faire de l’étalage, non à nous conduire: c’est là un ridicule résultat de la science; Socrate le critique très plaisamment chez Euthydème. J’ai vu faire des livres traitant de choses qui n’avaient jamais été étudiées par leur auteur, et dont il n’avait même pas entendu parler; il avait chargé plusieurs savants de ses amis des recherches à faire sur telle et telle matière à y traiter et s’était, pour sa part, contenté d’en avoir conçu le projet et d’employer son talent à mettre en fagot ces documents auxquels il ne connaissait rien; l’encre et le papier employés étaient seuls de lui. C’est là, * en conscience, acheter ou emprunter un livre mais non le composer; c’est apprendre aux hommes non qu’on sait faire un ouvrage mais, ce sur quoi ils pouvaient avoir des doutes, qu’on ne le sait pas faire. Un président de parlement se vantait, devant moi, d’avoir amoncelé, dans un de ses arrêts, deux cents et tant de considérants tirés de jugements rendus par d’autres que par lui; en le publiant, il amoindrissait la gloire en laquelle on pouvait le tenir pour un pareil chef-d’œuvre: c’était là, à mon sens, une vantardise pusillanime et absurde en raison du sujet et de la part d’un tel personnage. Je procède inversement et, parmi tant d’emprunts que je fais, suis bien aise d’en pouvoir dérober quelques-uns que je déguise et transforme pour l’usage nouveau auquel je les fais servir; au risque de faire dire que je n’en ai pas compris le véritable sens, je leur donne une tournure particulière de ma façon, de telle sorte que le plagiat soit moins apparent. Les autres avouent leurs larcins et en font parade, aussi leur pardonne-t-on plus qu’à moi; nous, dans notre naïveté, estimons qu’à inventer, il y a un mérite incomparablement plus grand qu’à simplement reproduire.
Il est dangereux de se mettre à écrire sur le tard, l’esprit a perdu de sa verdeur; lui-même aurait dû s’y prendre plus tôt, mais, voulant peindre sa vie, il a dû attendre le moment où elle se déroulait tout entière à ses yeux.—Si j’avais voulu faire de la science, je m’y serais pris plus tôt; j’aurais écrit dans un temps plus rapproché de mes études, alors que j’avais plus d’esprit et de mémoire. Pour faire métier d’écrire, mieux eût 587 valu m’y livrer à cet âge où j’avais toute ma vigueur, qu’à celui que j’ai actuellement; peut-être eussé-je rencontré alors, en une saison plus propice, cette faveur si gracieuse que du fait de mon ouvrage la fortune m’a octroyée en ces derniers temps et que, tout à la fois, je suis heureux de posséder et sur le point de perdre! Deux de mes connaissances, très bien doués sous le rapport de la littérature, ont, à mon avis, perdu la moitié de leur valeur, pour s’être refusé d’écrire à quarante ans, et avoir attendu pour le faire, qu’ils en aient soixante. La maturité a ses défauts tout comme ce qui est encore vert, ils sont même pires; quant à la vieillesse, elle est aussi impropre à ce travail qu’à tout autre chose, et quiconque met sous presse sa décrépitude, fait une folie, s’il espère en faire sortir des idées qui ne sentent pas le disgracié, le rêveur, l’assoupi; notre esprit se resserre et s’épaissit en vieillissant. J’étale avec pompe et abondance mon ignorance, ma science n’apparaît que maigre et piteuse; celle-ci n’est qu’accessoire et accidentelle, celle-là constitue en moi l’essentiel et le principal. Je ne traite de rien à point nommé, si ce n’est de bagatelles, et ne parle de science que pour donner à constater que je ne sais rien. J’ai choisi pour peindre ma vie l’époque où je l’ai tout entière sous les yeux; ce qui en reste appartient plutôt à la mort, et quand celle-ci viendra, s’il m’est donné de pouvoir, comme d’autres l’ont fait, en traduire les impressions, volontiers en quittant ce monde j’en ferai part au public.
Montaigne regrette que chez Socrate une belle âme se soit trouvée dans un corps si disgracié.—Socrate fut un modèle parfait de toutes les grandes qualités. Je regrette que, d’après ce que l’on en dit, * par sa laideur, son visage ait été si peu en rapport avec la beauté de son âme; la nature, à cet égard, a été injuste envers lui qui était si passionnément épris de la beauté. Il n’y a rien de plus vraisemblable que la corrélation entre les formes du corps et les qualités de l’esprit. «Il importe beaucoup à l’âme dans quel corps elle est logée, car plusieurs qualités corporelles aiguisent l’esprit, plusieurs autres l’émoussent»; mais en parlant ainsi Cicéron n’a en vue que la laideur hors nature occasionnée par une difformité des membres.—Nous, nous appelons aussi laideur, cette mauvaise impression que nous éprouvons au premier coup d’œil, principalement lorsqu’il se porte sur un visage dont certains détails nous dégoûtent, tels qu’un vilain teint, une tache, une expression dure ou toute autre cause dont souvent on ne se rend pas compte, alors que cependant les membres sont entiers et tels qu’ils doivent être. La laideur qui, chez La Boétie, revêtait une très belle âme, appartenait à cette catégorie; toute superficielle, bien qu’elle soit celle qui impressionne le plus, elle n’est pourtant pas celle qui préjudicie le plus à l’état de l’esprit, et elle influe peu sur l’opinion des gens à notre endroit.—Cette autre laideur, qu’il convient mieux d’appeler difformité, est plus effective et se répercute assez souvent davantage en nous-mêmes: toute chaussure bien ajustée fait ressortir nettement la forme du pied qu’elle renferme, 589 ce que ne fait pas une chaussure qui n’est lisse que par le cuir avec lequel elle est confectionnée. Quand il parlait de sa laideur, Socrate disait qu’il en était absolument de même de son âme, mais qu’il l’avait corrigée en la travaillant; j’estime que, suivant son habitude, il plaisantait en parlant ainsi, car jamais âme si parfaite ne s’est faite elle-même.
Comme Platon et la plupart des philosophes, il estime singulièrement la beauté; toutefois une physionomie avantageuse n’est pas toujours fondée sur la beauté des traits du visage.—Je ne puis répéter assez combien je tiens la beauté pour une qualité puissante et avantageuse. Socrate l’appelait «une courte tyrannie»; Platon, «un privilège de la nature». Nous n’en avons pas qui ait plus grand pouvoir; elle tient le premier rang dans les rapports des hommes entre eux; elle saisit tout d’abord, elle séduit et influence notre jugement par sa grande autorité et l’impression merveilleuse qu’elle produit. Phryné eût perdu sa cause, malgré l’excellent avocat entre les mains duquel elle l’avait remise, si, entr’ouvrant sa robe, elle n’eût gagné ses juges par l’éclat de sa beauté. Je constate que chez Cyrus, Alexandre et César, ces trois maîtres du monde, elle est entrée en ligne de compte dans leurs moyens d’action; le premier Scipion, lui, n’en a pas tiré parti. Un même mot, chez les Grecs, désignait le beau et le bon; et le Saint-Esprit appelle souvent bons ceux qu’il veut qualifier de beaux. Je ne serais pas éloigné de classer les divers dons faits à l’homme, comme ils le sont dans une chanson, tirée de quelque poète ancien, que Platon dit avoir été très répandue: «la Santé, la Beauté, la Richesse». Aristote dit que le droit de commander appartient à ceux qui ont la beauté en partage, et que lorsqu’il en est chez lesquels elle approche de l’image des dieux, ils ont, comme eux, droit à notre vénération. A quelqu’un qui lui demandait pourquoi on fréquente plus souvent et plus longtemps les personnes qui sont belles, il répondit: «Il n’y qu’un aveugle qui puisse faire une semblable question.» La plupart des philosophes, et parmi eux les plus grands, ont dû à leur beauté d’être admis dans les écoles sans avoir de redevance à payer, et doivent par suite la sagesse à son entremise. Je la considère presque à l’égal de la bonté, non seulement chez les gens qui me servent mais aussi chez les bêtes.
Il ne me semble cependant pas que les traits et la forme du visage, non plus que les lignes d’après lesquelles on détermine certaines dispositions qui seraient en nous et ce que l’avenir nous réserve, aient un rapport direct et simple avec la laideur; pas plus que toute bonne odeur et une atmosphère sereine ne sont un gage de santé, ni un air épais et lourd un indice d’infection en temps d’épidémie. Ceux qui accusent la beauté et les mœurs d’être en contradiction chez la femme, ne sont pas toujours dans le vrai; car une physionomie laissant à désirer sous le rapport de la régularité des traits, peut présenter un air de probité et inspirer confiance; comme au 591 contraire, il m’est arrivé parfois de lire, entre deux beaux yeux, des menaces dénotant une nature mauvaise et dangereuse. Il y a des physionomies qui préviennent en leur faveur; et, au milieu d’ennemis victorieux qui vous pressent de toutes parts et vous sont inconnus, vous ferez sur-le-champ choix de l’un plutôt que de l’autre, pour vous rendre à lui et lui confier votre vie, sans que la beauté pèse beaucoup sur votre détermination.
C’est une faible garantie que la mine, toutefois elle vaut d’être prise quelque peu en considération; et, si j’étais chargé de châtier les gens, je me montrerais plus dur pour les pervers qui démentent et trahissent les sentiments dont ils portent l’expression sur le front; je sévirais davantage contre la méchanceté qui se présente sous un masque bénin.—Il semble qu’il y ait des visages favorisés et d’autres malencontreux, et crois qu’il y a un certain art à distinguer, selon ce que leur figure exprime, les gens qui sont débonnaires de ceux qui sont niais, ceux qui sont sévères de ceux qui sont rudes, les malicieux de ceux qui sont chagrins, les dédaigneux des mélancoliques, et tels autres qui sont affectés de qualités différant peu les unes des autres. Il y a des beautés qui non seulement sont fières, mais encore peu avenantes; il y en a de douces, et même de plus que douces, des fades.—Quant au pronostic de l’avenir par l’examen de ces mêmes signes, c’est là une chose sur laquelle je ne me prononce pas.
En principe, il faut suivre les indications de la nature; les observances religieuses, sans de bonnes mœurs, ne suffisent pas au salut d’un état.—J’ai, en ce qui me touche, ainsi que je l’ai dit ailleurs bien simplement et franchement, adopté ce précepte ancien, que «nous ne saurions être en défaut, en suivant notre nature», et que «s’y conformer», est une règle qui prime toutes les autres. Je n’ai pas, comme Socrate, corrigé par la puissance de la raison mes instincts naturels, et n’ai pas eu recours à l’art pour modifier mes penchants; je me laisse aller comme je suis venu, je ne combats rien. Les deux parties essentielles de moi-même, le corps et l’esprit, sont naturellement disposées à vivre de pair et en bon accord; Dieu merci, car je suis né et ai grandi à une époque où les idées saines et modérées avaient peu cours.—Dirai-je, en passant, que je trouve qu’on fait plus de cas que cela ne vaut, bien qu’elle soit presque seule à avoir cours chez nous, d’une apparence de sagesse scolastique, esclave de certaines règles et soumise à la fois à l’espérance et à la crainte? Cette doctrine qu’on nous inculque, je la voudrais non telle que les lois et les religions l’établissent, mais telle qu’elles la complètent et l’autorisent; ayant par elle-même de quoi se soutenir sans aide, prenant naissance en nous par ses propres racines, produite par ce que nous appelons le sens commun qui se trouve en tout homme qui n’est pas organisé à l’encontre des lois de la nature: ce même bon sens qui, chez Socrate, redresse de mauvais plis, le rend obéissant aux hommes et aux dieux qui commandent dans sa ville, et courageux 593 vis-à-vis de la mort, non parce que son âme est immortelle, mais parce que lui-même est mortel. Quel ruineux enseignement pour toutes les formes de gouvernement, et bien plus dommageable qu’ingénieux et utile, que de persuader aux peuples que la foi religieuse suffit à elle seule à contenter la justice divine, sans qu’il soit besoin de bonnes mœurs; dans l’application apparaît l’énorme différence qu’il y a entre la dévotion et la conscience!
Physionomie de Montaigne; son air naïf lui attirait la confiance. Récit de deux aventures où la bonne impression qu’il produisait et sa franchise lui ont été avantageuses.—J’ai un visage qui plaît, et par les traits et par la bonne opinion qu’à première vue il donne de moi, d’où une apparence toute contraire à celle de Socrate: «Qu’ai-je dit: j’ai? C’est j’ai eu, que je devrais dire, ô Chrémès (Térence).—Hélas, vous ne voyez plus de moi, que le squelette d’un corps affaibli!» Il m’est souvent arrivé que simplement, sur le bon effet produit par ma prestance et mon air, des personnes qui ne me connaissaient pas, se sont pleinement confiées à moi soit pour leurs propres affaires soit pour les miennes, et cela m’a procuré dans les pays étrangers des faveurs particulières et rarement accordées.—Les deux aventures que voici valent peut-être que je les rapporte. Un quidam avait projeté de nous surprendre, ma maison et moi; pour ce faire, il eut l’idée de se présenter tout seul à ma porte, en demandant l’entrée avec une certaine insistance. Je le connaissais de nom et croyais pouvoir me fier à lui, parce qu’il était de mes environs et qu’il y avait quelque alliance entre nous; je lui fis ouvrir, comme je fais à chacun. Il entra tout effrayé, son cheval hors d’haleine, fort harassé, et me conta cette fable: «A une demi-lieue de là, il venait d’être rencontré par un de ses ennemis, que je connaissais aussi, de même que j’avais entendu parler de leur querelle. Cet ennemi s’était lancé à toute bride à sa poursuite; et lui-même, mis en désarroi par la surprise et inférieur en nombre, s’était précipité chez moi pour se mettre en sûreté, en grand souci de ce qu’étaient devenus ses gens qu’il croyait, disait-il, ou morts ou prisonniers». J’essayai bien naïvement de le réconforter, de le rassurer et lui rendre son sang-froid. Bientôt après, voilà quatre ou cinq de ses soldats qui se présentent pour entrer, avec cette même contenance témoignant même effroi; puis d’autres, et après d’autres encore, tous bien armés et équipés, au nombre de vingt-cinq ou trente, feignant d’avoir leurs ennemis sur leurs talons. Ce mystère commençait à m’inspirer du soupçon; je n’ignorais pas en quel siècle nous vivons, combien ma maison pouvait exciter l’envie, et connaissais plusieurs exemples de personnes de ma connaissance, auxquelles il était arrivé malheur dans des circonstances analogues. Toujours est-il que, trouvant que je n’avais pas de bénéfice à avoir commencé à faire plaisir si je n’achevais, et ne pouvant me défaire de ces gens sans tout rompre, je me laissai aller au parti le plus naturel et le plus simple comme je fais toujours, et commandai 595 de les faire entrer. Il faut ajouter qu’à la vérité, je suis peu défiant et peu soupçonneux de ma nature; je penche volontiers à admettre les excuses qu’on me donne et à interpréter les faits dans le sens le plus favorable; je prends les hommes comme ils sont généralement et ne crois pas aux natures perverses et dénaturées, non plus qu’aux prodiges et aux miracles, à moins que je n’y sois forcé par des témoignages irréfutables; en outre, je m’en remets aisément à la fortune et m’abandonne à corps perdu entre ses bras, ce dont jusqu’à ce moment j’ai eu plus occasion de me louer que de me plaindre, l’ayant trouvée plus avisée et plus amie de mes affaires que je ne le suis moi-même. Il y a dans ma vie quelques actions dont on peut dire à juste titre que la conduite en a été difficile, ou si l’on veut prudente; admettez que j’aie été pour un tiers dans le résultat, on peut largement dire que les deux autres tiers sont de son fait. Nous échouons, ce me semble, parce que nous n’avons pas assez confiance dans ce que le Ciel fera pour nous, et que nous prétendons faire par nous-mêmes plus qu’il ne convient; aussi combien fréquemment nos projets n’aboutissent pas! il est jaloux de l’étendue que nous attribuons aux droits de la prudence humaine au détriment des siens, et nous les réduit d’autant plus que nous leur donnons plus d’extension. Ces gens demeurèrent à cheval dans ma cour, tandis que leur chef, qui n’avait pas voulu qu’on mît sa monture à l’écurie, disant qu’il fallait qu’il se retirât dès qu’il aurait des nouvelles de son monde, était avec moi dans ma grande salle. Il était parvenu à s’introduire chez moi et n’avait plus qu’à mettre ses desseins à exécution. Souvent depuis, il a répété (car il ne craignait pas de raconter le fait) que ma figure et ma franchise l’avaient emporté en lui sur la trahison qu’il méditait. Il remonta à cheval; et ses gens, qui avaient les yeux fixés sur lui, attendant le signal qu’il devait leur faire, furent bien étonnés de le voir sortir, renonçant à profiter des avantages que, par sa ruse, il s’était ménagés.
Une autre fois, me fiant à je ne sais quelle trêve qui venait d’être publiée dans nos armées, je me mis en route pour un voyage dans un pays dont la traversée présentait beaucoup de dangers. Je ne fus pas plutôt éventé, que trois ou quatre groupes de cavaliers se lancèrent de divers points à ma poursuite pour me détrousser. L’un d’eux me joignit à ma troisième journée de marche et je fus assailli par quinze ou vingt gentilshommes masqués, suivis d’une ondée d’argoulets. Me voilà pris, obligé de me rendre et conduit au plus épais d’une forêt voisine; et là, démonté, dévalisé, mes caisses fouillées, mon coffre à argent saisi, mes chevaux et tout mon équipage dispersés entre de nouveaux maîtres. Nous demeurâmes longtemps dans ce hallier à discuter sur le montant de ma rançon qu’ils fixaient si haut qu’on voyait bien que je ne leur étais guère connu, et la question fut grandement agitée entre eux si on me laisserait ou non la vie; de fait, certaines circonstances faisaient que je courais un réel danger, «ce fut le cas de montrer du courage 597 et de la fermeté (Virgile)». Je m’en tenais toujours à invoquer la trêve, ne consentant à leur abandonner comme bénéfice que ce dont ils m’avaient dépouillé, ce qui n’était pas à dédaigner, sans vouloir promettre d’autre rançon. Nous en étions là après deux ou trois heures de discussion, lorsque me faisant monter sur un cheval avec lequel je ne courais pas risque de leur échapper, préposant spécialement à ma garde quinze ou vingt arquebusiers et répartissant mes gens entre d’autres, nous voilà emmenés prisonniers par divers chemins. Nous avions déjà marché la distance de trois ou quatre portées d’arquebuse, et j’en étais arrivé «à m’en remettre à l’assistance de Castor et de Pollux (Catulle)», quand soudain il se produisit chez eux un revirement bien inattendu. Je vis revenir vers moi le chef de la bande, qui me parla avec plus de courtoisie; et, se mettant en peine de faire rechercher dans sa troupe mes hardes dispersées, il me fit rendre ce qu’il put en retrouver, jusqu’à mon coffre à argent. Le meilleur présent qu’il me fit, ce fut de me remettre enfin en liberté, le reste m’important peu à pareil moment. Je ne connais pas encore bien la véritable cause d’un changement si peu dans les habitudes, de cette volte-face sans motif apparent, de ce repentir si extraordinaire dans une entreprise préméditée et exécutée de propos délibéré et justifiée par les mœurs de l’époque, car, de prime abord, je leur avais avoué le parti auquel j’appartenais et où je me rendais. Celui qui occupait le premier rang se démasqua, me donna son nom et me dit à plusieurs reprises que je devais ma délivrance à mon visage, à la liberté et à la fermeté de mes paroles, qui faisaient qu’un traitement semblable était indigne de moi, me demandant de lui donner l’assurance de lui rendre la pareille à l’occasion. Il est possible que la bonté divine voulût user, pour ma conservation, de ce moyen si aléatoire; il me servit encore le lendemain contre des embûches pires que celles auxquelles je venais d’échapper et contre lesquelles les premiers eux-mêmes m’avaient mis en garde. Celui auquel j’eus affaire en cette dernière aventure est encore vivant et peut la confirmer; l’auteur de la première a été tué il n’y a pas longtemps.
La simplicité de ses intentions, qu’on lisait dans son regard et dans sa voix, empêchait qu’on ne prît en mauvaise part la liberté de ses discours. Dans la répression des crimes, il n’était pas pour trop de sévérité.—Si ma physionomie ne prévenait en ma faveur, si on ne lisait dans mes yeux et dans ma voix la simplicité de mes intentions, je ne serais pas demeuré si longtemps sans qu’on me cherchât querelle ou qu’on m’offensât, étant donnée la liberté indiscrète que j’ai de dire à tort et à travers tout ce qui me vient à l’idée et de juger témérairement des choses. Cette façon peut, avec raison, paraître incivile et peu dans nos usages; mais je n’ai rencontré personne qui l’ait jugée outrageante et malintentionnée, et je n’ai pas trouvé davantage qui que ce soit que ma liberté ait blessé, quand c’était de 599 moi-même que les propos émanaient; car pour ce qui est des paroles rapportées, elles ont un tout autre son et prennent un sens tout différent.—Aussi, je ne hais personne et suis peu enclin à offenser n’importe qui; même quand la raison est en jeu, je ne me départis pas de ce sentiment; et, quand l’occasion me mettait dans le cas de prononcer des condamnations criminelles, j’ai plutôt fait défaut à la justice: «Je voudrais qu’on n’eût pas commis de fautes, mais je n’ai pas le courage de punir celles qui ont été commises (Tite Live).» On reprochait, dit-on, à Aristote d’avoir été trop miséricordieux envers un méchant: «J’ai été à la vérité, répondit-il, miséricordieux envers l’homme, mais non envers la méchanceté.» Les jugements sont d’ordinaire d’autant plus sévères dans les peines qu’ils prononcent, que le méfait est plus horrible; l’impression qu’il fait sur moi est inverse: l’horreur d’un premier meurtre me fait craindre d’en commettre moi-même un second, la haine que je ressens pour la cruauté commise me fait abhorrer toute imitation et incliner vers la douceur. A moi qui ne suis qu’un personnage de peu d’importance, on peut appliquer ce qu’on disait de Charille, roi de Sparte: «Il ne saurait être bon, puisqu’il n’est pas mauvais pour les méchants»; ou bien encore, car Plutarque présente une seconde interprétation de ce mot, comme il arrive de mille autres choses qui comportent des versions diverses et contraires: «Faut-il qu’il soit bon, puisqu’il l’est même pour les méchants!»—De même que, dans ce qui est licite, je répugne à intervenir lorsqu’il faut m’adresser à des gens auxquels cela déplaît; quand il s’agit de choses illicites, je ne me fais pas assez de conscience, à dire vrai, de m’employer quand ceux dont cela dépend ne s’en offensent pas.
L’expérience n’est pas un moyen sûr de parvenir à la vérité, parce qu’il n’y a pas d’événements, d’objets absolument semblables; on ne peut, par suite, juger sainement par analogie.—Il n’y a pas de désir plus naturel que celui de connaître. Nous essayons tous les moyens qui peuvent nous y amener et, quand la raison n’y suffit pas, nous faisons appel à l’expérience: «C’est par différentes épreuves que l’expérience a créé l’art, nous montrant, par l’exemple d’autrui, la voie à suivre (Manilius).» Ce second procédé est beaucoup moins sûr que le premier et moins digne; mais la vérité est chose de si grand prix, que nous ne devons rien dédaigner de ce qui peut nous y conduire.—La 601 raison a tant de formes que nous ne savons laquelle choisir, l’expérience n’en a pas moins; et les conséquences que nous cherchons à tirer de la comparaison des événements n’offrent pas toute certitude, d’autant qu’ils ne sont jamais identiques. Ce que l’on retrouve toujours dans les choses les plus ressemblantes, c’est la diversité et la variété. Comme exemple le plus typique de ressemblance parfaite, les Grecs, les Latins et nous-mêmes, nous citons celle des œufs entre eux; il s’est cependant trouvé des gens, notamment quelqu’un à Delphes, qui y distinguaient des différences, n’en prenaient jamais un pour un autre, et qui, en ayant de plusieurs poules, savaient reconnaître de laquelle était l’œuf. La dissemblance s’introduit d’elle-même dans nos ouvrages; nul art ne peut réaliser une entière similitude: ni Perrozet, ni un autre ne peuvent si soigneusement polir et blanchir l’envers de leurs cartes, que certains joueurs n’arrivent à les distinguer, rien qu’à les voir glisser entre les mains d’un autre. La ressemblance n’unifie pas au même degré que la différence ne diversifie. La nature s’est fait une obligation de ne pas créer une chose qui ne soit dissemblable de toutes les autres de même nature.
Par cette même raison, la multiplicité des lois est inutile, jamais le législateur ne pouvant embrasser tous les cas.—C’est pourquoi je ne partage pas l’opinion de celui-là qui pensait, par la multiplicité des lois, brider l’autorité des juges en leur laissant peu à décider. Il ne sentait pas que leur interprétation laisse autant de liberté et de champ où se mouvoir, que leur confection. C’est se moquer que de croire restreindre nos discussions et y couper court, en nous rappelant constamment le texte précis de la Bible, d’autant que notre esprit trouve pour critiquer le sens qu’un autre y attache, autant d’arguments que pour soutenir notre propre interprétation, et que commenter prête à non moins d’animosité et de discussions acerbes qu’inventer.—Nous voyons quelle était son erreur, car nous avons en France plus de lois qu’il n’en existe dans tout le reste du monde réuni et plus qu’il n’en faudrait pour en doter tous les mondes d’Épicure: «Nous souffrons autant des lois, qu’on souffrait autrefois des crimes (Tacite)»; et pourtant nous avons tant laissé à nos juges sur quoi opiner et décider, que jamais la liberté avec laquelle ils en usent n’a été plus puissante et plus scandaleuse. Qu’ont gagné nos législateurs à faire choix de cent mille cas et faits particuliers et d’y attacher cent mille lois? ce nombre n’est en aucune proportion avec la diversité infinie des actions humaines: la multiplicité de nos inventions n’atteindra jamais la variété des exemples qu’on peut citer; en ajouterait-on cent fois autant qu’il y en a déjà, qu’on ne ferait pas que, dans les événements à venir, il s’en trouve un seul dans le nombre si grand de milliers qui ont été choisis et enregistrés, qui se puisse juxtaposer et appareiller à un autre si exactement qu’il n’y ait quelque circonstance qui diffère et n’exige quelque modification dans le jugement à intervenir. Il y a peu de corrélation entre nos 603 actions, qui sont en perpétuelle transformation, et nos lois, qui sont fixes et immobiles. Le plus désirable à l’égard de celles-ci, c’est qu’elles soient aussi peu nombreuses, aussi simples que possible et conçues en termes généraux; et encore mieux vaudrait, je crois, n’en pas avoir du tout, que de les avoir en aussi grand nombre que nous les avons.
Celles de la nature nous procurent plus de félicité que celles que nous nous donnons; les juges les plus équitables, ce serait peut-être les premiers venus, jugeant uniquement d’après les inspirations de leur raison.—Les lois de la nature nous procurent toujours plus de félicité que celles que nous nous donnons; témoin l’âge d’or que les poètes nous ont dépeint, et l’état dans lequel nous voyons vivre des nations qui n’en connaissent pas d’autres. Nous en trouvons qui, pour tous juges, ont recours, pour trancher leurs différends, au premier passant qui traverse leurs montagnes; d’autres qui élisent, les jours de marché, quelqu’un d’entre eux qui, sur-le-champ, prononce sur tous leurs procès. Quel danger y aurait-il à ce que les plus sages d’entre nous règlent les nôtres de même façon, selon les circonstances et ce qui leur en semble, sans avoir à tenir compte des précédents ni des conséquences? A chaque pied son soulier, à chaque cas particulier sa solution propre. Le roi Ferdinand, envoyant des colonies aux Indes, faisait acte de sage prévoyance, en prescrivant qu’il n’y fût compris aucun étudiant en jurisprudence, de peur qu’avec cette science, portée par nature à engendrer les altercations et les divisions, le goût des procès ne vînt à s’implanter dans ce nouveau monde; il jugeait, comme Platon, que «jurisconsultes et médecins sont de mauvais éléments dans un pays».
Pour vouloir être trop précis, les textes de loi sont conçus en termes si obscurs (obscurité à laquelle ajoutent encore, ici comme en toutes choses, les interprétations), qu’on n’arrive pas, dans les contrats et testaments, à formuler ses idées d’une façon indiscutable.—Pourquoi notre langage usuel, si commode pour tout autre usage, devient-il obscur et inintelligible quand il est employé dans les contrats et testaments; et que des gens qui s’expriment si clairement quand ils parlent ou qu’ils écrivent, ne trouvent pas, lorsqu’il s’agit d’actes de cette nature, possibilité de dire ce qu’ils veulent, sans prêter au doute et à la contradiction? C’est parce que les princes en cet art se sont tellement appliqués à faire choix de mots qui en imposent, de formules si artistement arrangées, ont tellement pesé chaque syllabe, épluché avec tant de subtilité tous les termes, que l’on s’embarrasse et s’embrouille dans cette infinité de formules et de si menus détails, au point qu’on n’y distingue plus ni règles, ni prescriptions et qu’on n’y comprend absolument rien: «Tout ce qui est divisé au point de n’être que poussière, devient confus (Sénèque).» Qui a vu des enfants essayant de diviser en un nombre de fractions déterminé une certaine quantité de vif argent? plus ils le pressent, le pétrissent 605 et s’ingénient à l’obliger à obéir à leur fantaisie, plus ils irritent la fluidité de ce métal rebelle, qui échappe à leurs efforts et va s’émiettant en globules qui s’éparpillent à l’infini. Il en est ici de même: en multipliant les subtilités, on apprend aux gens à introduire de plus en plus ce qui prête au doute, on nous incite à étendre et diversifier les difficultés, on les augmente et on en met partout. En semant les questions qu’il faudra élucider, en les retaillant pour qu’elles acquièrent plus de netteté, on fait fructifier et foisonner de par le monde l’incertitude et les querelles; telle la terre qu’on rend d’autant plus fertile qu’on l’ameublit davantage et qu’on la remue plus profondément: «C’est la doctrine qui produit les difficultés (Quintilien).» Nous doutions avec Ulpian, nous doutons davantage encore avec Bartholus et Baldus. Il eût fallu effacer les traces de cette innombrable diversité d’opinions et non point s’en parer et en rompre la tête à la postérité. Je ne sais qu’en dire; mais on sent par expérience que tant d’interprétations désagrègent la vérité et la rendent insaisissable. Aristote a écrit pour être compris; s’il ne l’est pas, un autre moins habile que lui, qui cherche à saisir des idées qui ne sont pas les siennes, y réussira encore moins. Nous mettons à nu la matière, nous l’épandons en la délayant; d’un sujet nous en faisons mille et, à force de multiplier et de subdiviser, nous en arrivons à cette infinité d’atomes qu’avait imaginée Épicure.—Jamais deux hommes n’ont jugé une même chose d’une même façon; et il est impossible de trouver deux opinions exactement semblables, non seulement chez plusieurs hommes, mais chez un même homme à des heures différentes. Ordinairement, je trouve à douter de points sur lesquels les commentaires n’ont pas daigné s’exercer; je trébuche aisément là où ne se présente aucune difficulté, comme certains chevaux que je connais, qui bronchent plus souvent dans des chemins sans aspérités.
Qui peut nier que les explications n’augmentent les doutes et l’ignorance, quand on voit qu’il n’y a aucun livre soit humain, soit divin, sur lequel tout le monde ne s’acharne sans que les interprétations mettent fin aux difficultés? Le centième commentateur le laisse à celui qui vient après lui, plus épineux et plus scabreux que ne l’avait trouvé le premier qui a entrepris de l’expliquer. Quand avons-nous jamais dit entre nous d’un livre: «Ce livre a été suffisamment analysé, il n’y a désormais plus rien à en dire»?—Ceci apparaît encore mieux dans la chicane. On donne l’autorité des lois à une infinité de docteurs, à une infinité d’arrêts, et à autant d’interprétations: arrivons-nous cependant à mettre un terme quelconque à ce besoin d’interpréter; constate-t-on quelque progrès et acheminement vers la tranquillité; nous faut-il moins d’avocats et de juges que lorsque cette énorme masse qu’est devenu le droit, en était encore à sa première enfance? Au contraire nous en obscurcissons et ensevelissons la compréhension, que nous ne découvrons plus qu’au travers de quantité de clôtures 607 et de barrières. Les hommes méconnaissent la maladie de leur esprit: il ne fait que fureter et être en quête; il va sans cesse tournoyant, bâtissant, s’empêtrant dans sa besogne, comme nos vers à soie, comme «une souris dans de la poix», et il s’y étouffe. De loin, il pense remarquer je ne sais quelle apparence de clarté et de vérité imaginaires; mais, pendant qu’il y court, tant de difficultés lui barrent la route, soulevant des empêchements, de nouvelles enquêtes à faire, qu’elles l’égarent et l’enivrent; c’est à peu près le cas des chiens d’Ésope qui, croyant apercevoir un corps mort flotter sur la mer et n’en pouvant approcher, entreprirent de boire toute l’eau pour y arriver à sec et en crevèrent. C’est la même idée qu’émettait un certain Cratès, disant des écrits d’Héraclite, «qu’ils avaient besoin d’un lecteur qui fût bon nageur», pour que la profondeur et le poids de sa doctrine ne l’engloutissent et ne le suffoquassent.
Si les interprétations se multiplient à ce point, la cause en est à la faiblesse de notre esprit, qui, en outre, ne sait se fixer; en ces siècles on ne compose plus, on commente.—C’est uniquement la faiblesse de chacun de nous, qui fait que nous nous contentons de ce que d’autres, ou nous-mêmes, avons trouvé dans cette chasse à laquelle nous nous livrons pour arriver à savoir; un plus habile ne s’en contentera pas. Il y a toujours place pour qui viendra après nous, et même pour nous, en nous y prenant autrement. Nos investigations sont sans fin, nous ne nous arrêterons que dans l’autre monde. C’est signe que notre esprit est à court quand nous nous déclarons satisfaits, ou qu’il est las. Nul esprit généreux ne s’arrête de lui-même: il va toujours de l’avant et plus qu’il n’a de force, il a des élans qui l’emportent au delà de ce qu’il peut; s’il n’avance, s’il ne presse, ne s’accule, ne se heurte, ne tourne sur lui-même, c’est qu’il n’est vif qu’à moitié; ses poursuites sont sans limite et sans forme déterminée; il se nourrit d’admiration, de recherches, d’ambiguïté; ce qu’indiquait assez Apollon, en nous parlant toujours en termes à double sens, obscurs et détournés qui, ne donnant jamais pleine satisfaction, ne faisaient qu’amuser et travailler l’imagination. Nous sommes continuellement agités d’un mouvement qui n’a rien de régulier, qui ne se modèle sur rien et est sans but; nos inventions s’échauffent, se succèdent et apparaissent sans interruption aucune: «Ainsi voit-on dans un ruisseau qui coule, une eau roulant sans cesse après une autre, dans un ordre qui est éternellement le même. L’une suit l’autre, l’autre la fuit; celle-ci toujours pressée par celle-là et la devançant toujours. Toujours l’eau s’écoule dans l’eau; c’est toujours le même ruisseau et toujours une eau nouvelle (la Boétie).»
Interpréter les interprétations donne plus de mal qu’interpréter les choses elles-mêmes, nous faisons plus de livres sur des livres que sur des sujets autres; nous ne savons que nous commenter les uns les autres. Tout fourmille de commentaires, et très rares sont les auteurs proprement dits. La principale science de nos siècles, ce 609 qui nous vaut le plus de réputation, n’est-ce pas de pouvoir comprendre les savants; n’est-ce pas la fin dernière et la plus habituelle de nos études? Nos opinions se entent les unes sur les autres: la première sert de tige à la seconde, la seconde à la troisième, nous montons ainsi l’échelle degré par degré, et il arrive de la sorte que le plus haut monté a souvent plus d’honneur que de mérite, car il ne fait que s’élever d’un rien sur l’épaule de l’avant-dernier.
Combien souvent et peut-être sottement, ai-je fait que mon livre parle de lui-même? C’est sottise, ne serait-ce que pour cette raison que j’eusse dû me souvenir de ce que je dis des autres qui font de même: «Ces œillades si fréquentes, adressées à leur ouvrage, témoignent que leur cœur a pour lui de tendres sentiments; et même lorsqu’ils le rudoient et affectent de le traiter avec dédain, ce ne sont là que mignardises et coquetteries d’affection maternelle»; c’est ce que nous dit Aristote, en ajoutant que l’estime et le mépris vis-à-vis de soi-même se traduisent souvent avec le même air arrogant. J’ai pourtant une excuse: «C’est que, sur ce point, j’ai plus qu’un autre le droit de prendre cette liberté parce que c’est précisément de moi, de mes écrits comme de toutes mes autres actions quelles qu’elles soient, que traite mon livre, et que mon sujet veut que j’y revienne souvent»; mais je ne sais trop si cette raison, tout le monde voudra l’admettre.
Ce qu’il y a de singulier, c’est que les discussions ne roulent guère que sur des questions de mots; et, si dissemblables que soient les choses, il se trouve toujours quelque point qui fait que chacun les interprète à sa façon.—En Allemagne, les doutes auxquels ont donné lieu les propres idées de Luther ont produit autant et plus de divisions et de discussions, que lui-même n’en a soulevé par ses interprétations des saintes Écritures. Les termes employés sont la cause de tous nos débats; si je demande ce que veulent dire: nature, volupté, cercle, substitution, la question porte sur des mots, on y répond par des mots. «Qu’est-ce qu’une pierre?—C’est un corps.» Que quelqu’un poursuive: «Et un corps, qu’est-ce?—Une substance.—Et qu’est-ce qu’une substance?» et ainsi de suite; qui l’on interroge de la sorte finit par être hors d’état de répondre. C’est un simple échange d’expressions où l’une en remplace une autre, et où souvent la seconde est plus inconnue que la première; je sais mieux ce qu’est un homme, que je ne comprends quand on me dit que c’est un animal, un mortel, un être raisonnable; pour me délivrer d’un doute, on m’en soumet trois; c’est la tête de l’hydre.—Socrate demandait à Memnon ce que c’était que la vertu: «Il y a, lui répondit celui-ci, vertu d’homme, vertu de femme, de magistrat, d’homme privé, d’enfant, de vieillard.—Voilà qui va bien, s’écria Socrate; nous étions en quête d’une vertu, tu nous en apportes un essaim.» Nous posons une question, on nous en donne le contenu d’une ruche.—Si aucun événement, aucune formation extérieure ne ressemblent entièrement 611 à d’autres, la dissemblance, par un ingénieux mélange opéré par la nature, n’est non plus jamais complète. Si nos visages n’étaient pas semblables, l’homme ne pourrait être distingué de la bête; et s’ils se ressemblaient, un homme ne se distinguerait pas d’un autre. Toutes les choses se tiennent par quelque similitude, l’identité avec un exemple donné n’est jamais absolue; par suite, la relation tirée de l’expérience est toujours imparfaite et en défaut. Toutefois les comparaisons se joignent entre elles par quelque bout; c’est ce qui arrive aux lois que, par quelque interprétation détournée, forcée et indirecte, on assortit à chacun des cas qui se présentent.
Imperfection des lois; exemples d’actes d’inhumanité et de forfaits judiciaires auxquels elles conduisent; combien de condamnations plus criminelles que les crimes qui les motivent!—Les lois morales afférentes aux devoirs particuliers de chacun vis-à-vis de soi-même étant, comme nous le voyons, si difficiles à dresser, il n’est pas étonnant que celles qui gouvernent des individus en si grand nombre le soient plus encore. Considérez les formes de la justice qui nous régit: elles constituent un vrai témoignage de l’imbécillité humaine, tant elles présentent de contradictions et d’erreurs! La faveur et la rigueur qu’on y trouve, et il s’en trouve tant que je ne sais si l’impartialité y existe aussi souvent, sont des maladies, des difformités qui font partie intégrante de la justice et sont dans son essence.—Des paysans, au moment même où j’écris, viennent m’avertir en toute hâte qu’ils ont aperçu à l’instant, dans une forêt qui m’appartient, un homme meurtri de cent coups, respirant encore, qui leur a demandé de lui donner par pitié de l’eau et un peu d’aide pour se soulever. Ils n’ont pas osé l’approcher, disent-ils, et se sont enfuis, de peur d’être attrapés par les gens de justice, comme il arrive à ceux rencontrés près d’un homme assassiné, et d’avoir à rendre compte de l’accident, ce qui eût été leur ruine complète, n’ayant ni le moyen ni l’argent nécessaires pour démontrer leur innocence. Que pouvais-je leur dire? il est certain qu’en satisfaisant à ce devoir d’humanité, ils se fussent compromis.
Combien avons-nous découvert d’innocents qui ont été punis sans, veux-je dire, qu’il y ait de la faute des juges; et combien y en a-t-il que nous ne connaissons pas?—Voici un fait arrivé de mon temps: Des gens sont condamnés à mort pour homicide; l’arrêt est sinon prononcé, du moins on est d’accord et ce qu’il doit porter est arrêté. Là-dessus, les juges sont informés par les officiers d’une cour voisine, ressortissant de la leur, que des prisonniers qu’ils détiennent, avouent catégoriquement cet homicide et font sur cette affaire une lumière indubitable. On délibère si, nonobstant, on doit suspendre et différer l’exécution de l’arrêt rendu contre les premiers; on considère la nouveauté du cas, ses conséquences sur les entraves qui en résulteraient pour l’exécution des jugements; on envisage que la condamnation a été juridiquement 613 prononcée, que les juges n’ont aucun reproche à se faire; en somme, ces pauvres diables sont immolés aux formes de la justice.—Philippe de Macédoine, ou quelque autre, pourvut à pareille difficulté de la manière suivante: Il avait, par un jugement en règle, condamné un homme à une grosse amende envers un autre; la vérité ayant été découverte quelque temps après, il se trouva qu’il avait jugé contrairement à l’équité. D’un côté il y avait l’intérêt de la cause qui était juste, de l’autre celui des formes judiciaires qui avaient été bien observées; il satisfit aux deux, en laissant subsister la sentence telle qu’elle était et compensant de ses propres deniers le dommage fait au condamné. Mais là, l’accident était réparable; mes gens, eux, furent irrémédiablement pendus. Combien ai-je vu de condamnations plus criminelles que le crime pour lequel elles avaient été prononcées!
Montaigne partage l’opinion des anciens, qu’il est prudent, qu’on soit accusé à tort ou à raison, de ne pas se mettre entre les mains de la justice. Puisqu’il y a des juges pour punir, il devrait y en avoir pour récompenser.—Tout ceci me fait souvenir de ces principes qui avaient cours jadis: «Celui qui veut le triomphe du droit dans les questions générales, est obligé de le sacrifier dans les questions de détail; l’injustice dans les affaires de peu d’importance, est le seul moyen de faire que les grandes se règlent avec équité.» La justice humaine est comme la médecine pour laquelle toute chose utile est, par cela même, juste et honnête; cela répond à ce qu’admettent les Stoïciens: «que la nature elle-même, dans la plupart de ses œuvres, va à l’encontre de ce qui est juste»; les Cyrénaïques, «que rien n’est juste par soi-même; ce sont les coutumes et les lois qui déterminent ce qui l’est et ce qui ne l’est pas»; les Théodoriens, «que le larcin, le sacrilège, les actes immoraux de toute nature sont justifiés aux yeux du sage, du moment qu’il reconnaît qu’il peut y avoir profit». A cela, pas de remède, et j’en suis arrivé à penser, comme Alcibiade, que je ne me livrerai jamais, si j’en ai la possibilité, à un homme qui a droit de vie et de mort sur moi, devant lequel mon honneur et ma vie dépendent du talent et de l’habileté de mon avocat plus que de mon innocence.—Je ne voudrais me risquer que devant une justice ayant qualité pour connaître de mes bonnes actions comme de mes mauvaises, de laquelle j’aurais autant à espérer qu’à craindre. Une indemnité n’est pas suffisante à l’égard d’un homme qui fait mieux encore que de ne pas commettre de faute. Notre justice ne nous présente que l’une de ses mains, encore est-ce la main gauche; et quiconque, quel qu’il soit, ayant affaire à elle, s’en tire toujours avec perte.
En Chine, les institutions et les arts, qui diffèrent considérablement des nôtres et que nous ne connaissons qu’imparfaitement, l’emportent en plusieurs points, par leur excellence, sur ce qui se passe chez nous. Dans cet empire, où ni les anciens ni nous n’avons pénétré et dont, d’après l’histoire, la population est si considérable 615 et si diverse de la nôtre, des officiers sont envoyés par le prince pour inspecter l’état des provinces; et, de même qu’ils punissent ceux qui commettent des malversations dans leur charge, ces officiers récompensent d’autre part par de réelles libéralités ceux qui se sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions et ont fait plus que leur devoir n’exigeait. On se présente à eux, non seulement pour satisfaire à ce qu’on doit, mais pour être rémunéré; non pour être simplement payé de ce qui vous est dû, mais * encore pour recevoir des gratifications.
Il n’a jamais eu de démêlés avec la justice, et il est si épris de liberté, qu’il irait n’importe où s’il sentait la sienne menacée.—Nul juge, Dieu merci, ne m’a encore parlé comme juge, en quelque cause que ce soit, nous concernant moi ou un autre, au criminel comme au civil. Je ne suis jamais entré dans une prison, pas même pour la visiter; mon imagination m’en rend la vue désagréable, même du dehors. Je suis si languissant de liberté, que si l’on me défendait l’accès de quelque coin des Indes, j’en vivrais en quelque sorte plus mal à mon aise; et tant que je trouverai un endroit où la terre et la mer soient libres, je ne séjournerai pas dans un lieu où il faudrait me cacher. Mon Dieu, que je souffrirais donc de la condition où je vois tant de gens, astreints à demeurer en un point déterminé du royaume, auxquels sont interdits l’entrée des grandes villes, des résidences royales, l’usage des chemins publics, parce qu’ils ont transgressé les lois! Si celles sous lesquelles je vis, me menaçaient seulement le bout d’un doigt, je m’en irais immédiatement me ranger sous d’autres, où qu’il me faille aller. Toute ma petite prudence, je l’emploie, durant les guerres civiles qui nous affligent, à ce qu’elles n’entravent pas ma liberté d’aller et de venir.
Les lois n’ont autorité que parce qu’elles sont lois, et non parce qu’elles sont justes. Quant à lui, il a renoncé à leur étude, c’est lui seul qu’il étudie; pour le reste, il s’en remet simplement à la nature.—Les lois ont de l’autorité, non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont lois; c’est la base mystérieuse de leur pouvoir; elles n’en ont pas d’autres, celle-ci leur suffit. Elles sont souvent faites par des sots; plus souvent par des gens qui, en haine de l’égalité, manquent d’équité; mais toujours par des hommes, qui transportent dans leur œuvre leur frivolité et leur irrésolution. Il n’est rien comme les lois pour commettre aussi largement et aussi couramment de si lourdes fautes; quiconque leur obéit parce qu’elles sont justes, n’est pas dans le vrai, c’est même la seule raison qui ne puisse être invoquée. Les lois françaises prêtent quelque peu la main, par leur déréglement et leur laideur, au désordre et à la corruption qui se manifestent dans leur application et exécution; leur teneur en est si peu claire et repose sur des principes si variables, que ceux qui leur désobéissent, qui les interprètent, les appliquent et les observent mal, sont excusables. Quelle que soit l’expérience que nous ayons, celle qui 617 nous vient de ce que nous voyons à l’étranger, ne servira guère à nos institutions, tant que nous tirerons si peu de profit de celles que nous nous sommes données à nous-mêmes, avec lesquelles nous sommes plus familiarisés et qui, certes, suffisent bien à nous instruire de ce qu’il nous faut.—Je m’étudie moi-même plus que tout autre sujet; cette étude constitue toute ma physique et ma métaphysique: «Par quel art Dieu gouverne le monde? par quelle route s’élève et se retire la lune? comment, réunissant son double croissant, se retrouve-t-elle chaque mois dans son plein? d’où viennent les vents qui commandent à la mer et quelle est l’influence de celui du midi? quelles eaux forment continuellement les nuages? un jour viendra-t-il qui détruira le monde (Properce)?—Cherchez, vous que tourmente le besoin d’approfondir les mystères de la nature (Lucain)». Dans ce grand tout, je m’abandonne, ignorant et insouciant, à la loi générale qui régit le monde; je la connaîtrai assez, quand j’en sentirai les effets. Ma science ne peut la détourner de sa route; elle ne se modifiera pas pour moi, ce serait folie de l’espérer; folie plus grande encore de m’en tourmenter, puisque nécessairement elle est la même pour tous, s’exerce au grand jour et s’applique à tous. La bonté, la puissance de Celui qui le dirige, nous déchargent de toute ingérence dans ce gouvernement. Les recherches, les contemplations des philosophes ne servent d’aliment qu’à notre curiosité. Ils ont grandement raison de nous renvoyer aux règles de la nature. Mais à quoi sert une si sublime connaissance? ils falsifient ses règles et nous la présentent elle-même avec un visage maquillé, si haut en couleurs et tellement sophistiqué, qu’il en résulte tous ces portraits si différents d’un sujet si constamment le même.—La nature nous a pourvus de pieds pour marcher; nous lui devons aussi la prudence, pour nous guider dans la vie. Cette prudence n’est pas, comme on l’a imaginé, un composé de finesse, de force et d’ostentation; comme la nature elle-même, elle est facile, tranquille, salutaire et de la plus grande efficacité, comme a dit quelqu’un, chez celui qui a le bonheur de savoir l’employer naïvement et à propos, c’est-à-dire naturellement. S’abandonner tout simplement à la nature, est la manière la plus sage de se confier à elle. Oh! que l’ignorance et l’absence de curiosité constituent un doux, un moelleux et sain oreiller pour y reposer une tête bien pondérée.
Que ne prêtons-nous plus d’attention à cette voix intérieure qui est en nous et suffit pour nous guider? Quand nous constatons que nous nous sommes trompés en une circonstance, ne devrions-nous pas être en défiance à tout jamais dans les circonstances analogues?—J’aimerais mieux bien saisir ce qui se passe en moi, que de bien comprendre Cicéron. Par l’expérience que j’ai de moi, j’ai assez de quoi devenir sage, si j’étais bon écolier. Qui se remémore les accès de colère qu’il a eus et jusqu’où cette fièvre l’a emporté, voit combien cette passion est laide, plus que ne le fait apercevoir Aristote, et il en 619 conçoit contre elle une haine mieux justifiée. Qui se souvient des maux qu’il a soufferts, de ceux dont il a été menacé, des circonstances sans gravité qui ont pu le troubler, se prépare par là aux agitations futures et à bien juger son état. La vie de César ne nous est pas d’un exemple plus efficace que la nôtre; que ce soit celle d’un empereur ou celle d’un homme du peuple, c’est toujours une vie en butte à tous les accidents humains. Prêtons l’oreille à cette voix intérieure, elle nous dira tout ce qu’il nous importe particulièrement de connaître.—Celui qui se souvient de s’être si grandement et si souvent trompé en s’en rapportant à son propre jugement, n’est-il pas un sot de n’en pas être à tout jamais en défiance? Quand j’arrive à être convaincu, par les raisons qu’on m’oppose, que mon opinion est erronée, ce n’est pas tant ce qui vient de m’être dit et mon ignorance dans ce cas particulier que je retiens, ce serait de peu de profit; c’est d’une façon plus générale ma débilité, la trahison de mon entendement que je constate, et j’en conclus que tout l’ensemble est à réformer. Dans toutes mes erreurs je fais de même et je sens que cette règle m’est de grande utilité dans la vie; je ne regarde pas, en l’espèce, le fait comme une pierre qui accidentellement me fait broncher; il me révèle qu’il est à craindre que mon allure ne soit, en tout, autre qu’il ne faut, et me dispose à la régler. Savoir qu’on a dit ou fait une sottise, n’est rien; ce qu’il faut apprendre c’est qu’on n’est qu’un sot, chose de bien autre conséquence et bien autrement importante à connaître. Les faux pas que ma mémoire me fait si souvent commettre, lors même qu’elle est le plus sûre d’elle-même, ne sont pas inutiles. Maintenant, elle a beau me jurer qu’elle est certaine d’elle-même, je n’y crois plus; la première objection qu’on fait à son témoignage me met sur mes gardes, et je n’oserais me fier à elle pour quelque chose de sérieux, ni m’en porter garant quand il s’agit de choses accomplies pour autrui; au point que si ce que je fais faute de mémoire, d’autres ne le faisaient plus souvent encore par mauvaise foi, je croirais toujours sur un fait ce qu’un autre en dit, plutôt que ce que j’en dis moi-même.—Si chacun épiait de près les effets et les circonstances des passions qui le dominent, comme je l’ai fait moi-même pour celles dont je suis atteint, il les verrait venir et ralentirait un peu leur violence et leur course. Elles ne nous sautent pas toujours à la gorge du premier coup; elles commencent par nous menacer, puis nous envahissent par degré: «Ainsi l’on voit, au premier souffle des vents, la mer blanchir, s’enfler peu à peu, soulever ses ondes et bientôt, du fond des abîmes, porter ses vagues jusqu’aux nues (Virgile).» Le jugement tient chez moi la première place, du moins s’y applique-t-il avec soin. Il laisse mes appétits aller leur train; ni la haine, ni l’amitié, ni même l’affection que je me porte à moi-même ne l’altèrent et ne le corrompent; et, s’il ne peut modifier les autres éléments de moi-même comme il le conçoit, toujours est-il qu’il ne se laisse pas pervertir par eux: il fait jeu à part.
621
Se connaître soi-même est la science capitale; celui qui sait, hésite et est modeste; l’ignorant est affirmatif, querelleur et opiniâtre.—Cet avertissement «de se connaître soi-même» doit être pour chacun d’une importance capitale, puisque le dieu de science et de lumière la fit inscrire au fronton de son temple, comme comprenant tout ce qu’il avait à nous conseiller; Platon dit que la prudence n’est autre que la mise en application de cette maxime et Socrate, dans Xénophon, la développe avec grands détails. En toute science, ceux-là seuls qui s’en occupent en aperçoivent les difficultés et les obscurités, car il faut encore certaine connaissance pour remarquer qu’on ignore; c’est en poussant une porte, qu’on sait si elle nous est fermée. C’est ce qui a donné naissance à cet aphorisme de l’école de Platon qui semble n’être qu’un simple trait d’esprit: «Ceux qui savent n’ont pas à s’enquérir, puisqu’ils savent; ceux qui ne savent pas, n’ont pas davantage à le faire, puisque pour s’enquérir il faut savoir ce dont on s’enquiert.» Ici «se connaître soi-même» signifie que, bien que chacun se montre très affirmatif, satisfait de lui-même et se croit suffisamment entendu, de fait il ne sait rien, comme le démontre Socrate à Euthydème. Moi, qui ne pense pas autrement, je trouve que ces paroles ont une profondeur et sont d’une variété d’application si infinie, que ce que j’apprends n’a d’autre résultat que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. A ma faiblesse si souvent constatée, je dois ma disposition d’esprit à la modestie, à obéir aux croyances qui me sont d’obligation, à apporter un calme constant et de la modération dans mes opinions, et la haine que j’éprouve pour cette arrogance importune et querelleuse, ennemie capitale de toute discipline et de toute vérité, de ceux qui ne croient et ne se fient qu’à eux-mêmes. Écoutez-les professer; les premières sottises qu’ils mettent en avant, ils les formulent dans un langage de prophète et de législateur: «Rien n’est plus honteux que d’affirmer et de décider, avant d’avoir compris et de savoir (Cicéron).»—Aristarque disait qu’on avait à peine trouvé anciennement sept sages dans le monde entier et que, de son temps, on aurait peine à trouver sept ignorants; n’aurions-nous pas plus de raison que lui, de le dire de notre époque? L’affirmation et l’opiniâtreté sont des signes indéniables de la bêtise: tel convaincu d’ignorance cent fois par jour, se pavane nonobstant aussi affirmatif, aussi entier dans ses dires après qu’avant; vous diriez que depuis sa dernière avanie, on lui a infusé quelque âme nouvelle et retrempé l’entendement, ainsi qu’il arrivait à cet ancien fils de la Terre qui reprenait une ardeur et une force nouvelles dans chacune de ses chutes: «qui, lorsqu’il avait touché sa mère, sentait une nouvelle vigueur renaître dans ses membres épuisés (Lucain)»; cet entêté imbécile pense peut-être reprendre un nouvel esprit pour recommencer une nouvelle lutte. C’est par expérience que j’accuse l’ignorance humaine d’être, d’après moi, ce que produit de plus certain l’école du monde. Ceux qui ne veulent 623 pas reconnaître qu’il en est ainsi, soit par mon propre exemple, à la vérité sans conséquence, soit par le leur, qu’ils le reconnaissent par ce qu’en pensait Socrate, le maître des maîtres, dont Antisthène disait à ses disciples: «Allons, vous et moi, écouter Socrate; là, je serai disciple au même degré que vous.» Ce même philosophe, dissertant sur ce dogme de la secte des Stoïciens à laquelle il appartenait, «que la vertu suffit à assurer le bonheur de la vie et que l’on n’avait besoin de rien autre», ajoutait: «sinon de la force d’âme de Socrate».
Étudiant sans cesse les autres pour se mieux connaître, Montaigne en était arrivé à les juger avec assez de discernement. Quel service on rend à qui sait l’entendre, de lui dire avec franchise ce qu’on pense de lui!—L’attention que, depuis si longtemps, j’apporte à me considérer, me dispose à juger aussi des autres avec assez de discernement, et il est peu de choses dont je parle avec plus de compétence et de réussite. Il m’est arrivé souvent de voir et de distinguer plus exactement qu’ils ne s’en rendaient compte eux-mêmes, les bonnes et mauvaises dispositions en lesquelles se trouvaient mes amis; il en est que j’ai étonnés par l’exactitude de mes indications et que j’ai mis en garde contre eux-mêmes. Habitué depuis l’enfance à étudier ma vie en me mirant dans celle des autres, j’ai acquis, sous ce rapport, une réelle aptitude à les scruter; et, pour peu que j’y pense, je ne laisse guère échapper rien de ce qui se produit autour de moi pouvant y aider: contenances, humeurs, raisonnements. J’étudie tout, ce qu’il me faut éviter comme ce qu’il me faut imiter. Aussi, chez mes amis, je reconnais, par ce qu’ils font, l’état d’âme dans lequel ils se trouvent; non cependant pour classer en genres et en chapitres cette infinie variété d’actions si diverses par leur nature et leur forme, et rattacher ensuite ces premiers groupes à des classes et ordres déjà déterminés, «car on ne saurait dire tous les noms, ni distinguer toutes les espèces, tant le nombre en est grand (Virgile)». Aux savants de parler et émettre ce qui leur vient à l’idée en bien précisant et entrant dans le détail; chez moi qui ne vois que ce que l’usage m’apprend sans qu’aucune règle me guide, les appréciations ne prennent corps qu’à la longue, comme * chose qui ne peut se dire tout d’une fois et en bloc, tout n’étant pas à l’unisson et parfaitement réglé dans les âmes communes et d’ordre inférieur comme sont les nôtres. La sagesse est un bâtiment solide et qui constitue un tout; chaque pièce y a sa place et porte sa marque: «Il n’y a que la sagesse qui soit tout entière renfermée en elle-même (Cicéron).» Je laisse aux artistes, et ne sais s’ils en viennent à bout quand il s’agit de choses si confuses, si ténues, où le hasard a tant de part, de ranger par catégories ces variétés infinies de physionomies, de fixer nos indécisions et d’y introduire de l’ordre. Non seulement je trouve difficile de rattacher nos actions les unes aux autres, mais, même pour chacune, de lui trouver une qualité essentielle qui permette de la désigner d’une 625 manière qui lui soit propre, tant elles apparaissent multiples et sous des aspects divers, suivant le point de vue où l’on se place.—On estime que les natures comme celle de Persée, roi de Macédoine, sont rares: «Son esprit ne se préoccupait d’aucune façon d’être, il menait indifféremment tous les genres de vie, et avait des habitudes si libres en leur essor et si changeantes que ni lui-même, ni les autres ne pouvaient déterminer ce qu’il était.» Cette peinture me paraît pouvoir s’appliquer à peu près à tout le monde, et, par-dessus tout, à quelqu’un que j’ai vu taillé sur le même modèle et duquel on pourrait, je crois, dire avec plus d’exactitude encore qu’«il est mal équilibré, allant toujours sans motif plausible d’un extrême à l’autre; sa vie, qui se passe sans éclat, ne présente ni revers, ni contrariétés sérieuses; il n’a aucune faculté nettement caractérisée; il est vraisemblable que ce qu’on pourra en supposer un jour, c’est qu’il affecte et s’étudie à passer pour un être qu’on ne peut pénétrer».—Il faut des oreilles bien résistantes pour s’entendre juger franchement; et, comme il est peu de monde qui puisse le souffrir sans mordre, ceux qui se hasardent à nous rendre ce service, nous donnent un témoignage d’amitié qui n’est pas ordinaire; car c’est aimer sincèrement que de risquer de nous blesser et de nous offenser pour notre bien. Je trouve rude de juger quelqu’un dont les mauvaises qualités l’emportent sur les bonnes; chez celui qui veut juger l’âme d’autrui, Platon exige trois qualités: capacité, bienveillance et hardiesse.
Montaigne estime qu’il n’eût été bon à rien, sauf à parler librement à un maître auquel il eût été attaché, à lui dire ses vérités et faire qu’il se connût lui-même; pareil censeur bénévole et discret serait chose précieuse pour les rois, auxquels la gent maudite des flatteurs est si pernicieuse.—On me demandait une fois à quoi je pensais que j’eusse été bon, si on se fût avisé de m’employer quand j’étais en âge de servir: «alors qu’un sang plus vif courait dans mes veines et que la vieillesse jalouse n’avait pas encore blanchi mes tempes (Virgile)». A rien, répondis-je; et je me pardonne volontiers de ne savoir faire quoi que ce soit qui m’eût fait l’esclave de quelqu’un. Mais j’eusse été capable de dire ses vérités à mon maître et de contrôler ses mœurs, s’il l’eût voulu. Je ne l’aurais pas fait en gros, en mettant en œuvre les procédés des écoles de philosophie, procédés dont je ne sais pas user et que je ne vois pas avoir produit de réels changements chez ceux qui les connaissent; mais en l’observant pas à pas, aux moments opportuns, jugeant par moi-même ses faits et gestes, un à un, simplement, naturellement, lui faisant voir ce que communément on pensait de lui à l’encontre de ce qu’auraient pu lui dire ses flatteurs. Il n’est pas un de nous qui ne vaudrait moins que les rois, s’il était continuellement corrompu, comme ils le sont, par cette engeance maudite. Comment ne le seraient-ils pas, alors qu’Alexandre, grand roi en même temps que grand philosophe, ne put s’en défendre? J’aurais eu assez de fidélité, de jugement et de 627 liberté pour cela.—Une semblable charge ne serait pas attitrée, sans quoi elle perdrait son efficacité et son mérite; c’est un rôle qui ne saurait être dévolu indifféremment à tout le monde, car la vérité elle-même n’a pas le privilège de pouvoir être dite à toute heure et sur toutes choses; son usage, si noble qu’il soit, est circonscrit et a ses limites. Il arrive souvent, étant donné le monde tel qu’il est, que la rapporter à l’oreille du prince, non seulement ne sert de rien, mais peut être nuisible, et même constituer une injustice à son égard; car on ne me fera pas croire qu’une remontrance, même dictée par un sentiment pieux, ne puisse être une faute et que l’intérêt de la chose qui la motive ne doive souvent céder à celui qu’il y a à respecter les convenances. Je voudrais, pour un tel métier, un homme satisfait de son sort, «qui voulût être ce qu’il est, et rien de plus (Martial)», et qui soit né dans une situation sociale moyenne, parce que d’une part, ne redoutant pas de faire tort par là à son avancement, il n’aurait pas crainte de toucher vivement et profondément le cœur du maître, et que, de l’autre, étant de condition moyenne, il lui serait plus facile d’être en communication avec toutes sortes de gens. Ce soin ne devrait incomber qu’à un seul; attribuer le privilège d’une telle liberté et familiarité à plusieurs, entraînerait des atteintes au respect qui auraient leurs inconvénients; surtout, et pour cette même raison, je requerrais de lui le silence le plus absolu.
Un roi n’est pas à croire quand, pour se faire gloire, il se vante de supporter avec constance les attaques de ses ennemis, tandis que, pour son profit et se corriger, il ne peut souffrir la liberté de langage d’un ami qui n’a d’autre but que d’éveiller son attention, le reste dépendant de lui. Or, il n’est pas de catégorie d’hommes qui, plus qu’eux, ait besoin de sincères avertissements émis en toute liberté. Leur vie se passe en public; ils ont à se concilier l’opinion de tant de gens témoins de leurs actes, que, la coutume étant de leur taire tout ce qui pourrait leur faire modifier leur manière d’être, ils se trouvent, sans s’en apercevoir, encourir la haine et la malédiction de leurs peuples par des circonstances qu’il leur eût été souvent possible d’éviter, sans même que ce fût au détriment de leurs plaisirs, s’ils avaient été avertis et redressés à temps. D’ordinaire leurs favoris regardent à leurs propres intérêts plus qu’à celui de leur maître; et cela leur réussit, car il n’est que trop vrai que la plupart des services qu’une véritable amitié peut rendre à un souverain, sont rudes et périlleux à entreprendre; aussi demandent-ils non seulement beaucoup d’affection et de franchise, mais encore du courage.
Ses Essais sont, à son avis, un cours expérimental, fait sur lui-même, d’idées afférentes à la santé de l’âme et à celle du corps; il va donner ci-après un aperçu du régime qu’il a observé toute sa vie durant.—En somme, toutes ces boutades que j’entasse ici pêle-mêle, constituent une sorte de recueil des essais auxquels je me suis livré dans le cours de ma vie; 629 ce qui s’y trouve, afférent à la santé de l’âme, fournit, sur bien des points, nombre d’exemples qui peuvent instruire, pourvu qu’on prenne le contre-pied de ce que j’ai dit ou fait moi-même. Quant à ce qui est de la santé du corps, personne n’est à même d’en parler avec plus d’expérience que moi, car sur ce point l’expérience est chez moi dans toute sa pureté, elle n’y a été ni corrompue ni altérée par les pratiques de l’art, ou par des idées préconçues; et quand il est question de médecine, elle est là dans son domaine, la raison lui cède complètement la place. Tibère disait que quiconque avait vécu vingt ans, devait être en état de savoir ce qui lui était nuisible ou salutaire, et à même de se passer de médecin. C’est une manière de voir qu’il pouvait tenir de Socrate, lequel recommandait très fort à ses disciples, comme une étude de première importance, celle de leur santé; ajoutant qu’il était difficile qu’un homme de jugement s’observant dans ses exercices, son boire et son manger, ne discernât pas mieux que tout médecin ce qui lui était bon ou mauvais.—La médecine faisant profession d’avoir toujours l’expérience pour pierre de touche dans ses opérations, Platon dit avec raison que pour être de vrais médecins, il faudrait que ceux qui entreprennent d’exercer cet art, aient passé par toutes les maladies qu’ils veulent guérir, par tous les accidents et circonstances sur lesquels ils ont à prononcer. Il serait donc rationnel qu’ils aient eu les maladies syphilitiques pour savoir les traiter; et, en vérité, je m’en fierais davantage à qui ce serait le cas, parce que les autres nous guident comme celui qui peint la mer, les écueils et les ports, assis devant sa table, sur laquelle il fait en toute sécurité évoluer l’image d’un navire; mettez-le en présence de la réalité, il ne sait comment s’y prendre. Ils décrivent nos maux à la manière d’un tambour de ville qui publie un cheval ou un chien perdu: il est, dit-il, de telle couleur, de telle taille, a les oreilles de telle façon; mais présentez-le lui, il ne le reconnaîtra seulement pas. Pour Dieu! que la médecine me soit un jour d’un secours efficace et indiscutable, comme je crierais de bonne foi: «Enfin, je reconnais une science dont je vois les effets (Horace)!» Les arts qui promettent de nous tenir le corps et l’âme en santé, nous promettent beaucoup, mais aussi il n’y en a pas qui tiennent moins ce qu’ils promettent. De notre temps ceux qui exercent ces professions sont, de nous tous, ceux chez lesquels on en constate le moins les effets; tout ce qu’on peut dire d’eux, c’est qu’ils vendent des drogues médicinales; mais qu’ils soient médecins, on ne peut en convenir.—J’ai assez vécu pour constater quelles pratiques m’ont conduit aussi loin; pour qui voudrait en goûter, comme j’en ai fait l’essai, il peut me tenir pour à même de le renseigner. En voici quelques-unes que je relate telles que le souvenir m’en vient; bien que je n’aie pas de façon de faire qui n’ait varié suivant les accidents qui me sont survenus, il est cependant certaines de ces pratiques que j’ai suivies plus que d’autres; j’enregistre ici celles dont j’ai usé le plus souvent jusqu’à cette heure.
631
Montaigne conservait le même genre de vie qu’il fût malade ou bien portant; il fuyait la chaleur émanant directement du foyer.—Mon genre de vie est le même que je sois malade ou bien portant; je fais toujours usage du même lit, mes heures ne varient pas, je mange et bois les mêmes choses; je n’ajoute rien, seulement je me modère plus ou moins, suivant ma force ou mon appétit. Ma santé, c’est le maintien sans complication de mon état habituel. La maladie amène, il est vrai, une rupture d’équilibre dans un sens, mais si j’en croyais les médecins, ils le détermineraient dans l’autre, et, grâce à ma mauvaise fortune et à leur art, je serais alors complètement jeté hors de ma route.—Je ne crois à rien plus fermement qu’à ceci: Que je ne saurais être incommodé par les choses auxquelles je suis depuis si longtemps accoutumé; c’est à nos habitudes à arranger notre vie comme cela leur plaît: elles sont toutes-puissantes à cet égard, elles sont le breuvage de Circé qui transforme nos natures comme bon lui semble. Combien de nations, à trois pas de nous, estiment ridicule notre crainte du serein, qui nous paraît à nous avoir une action si nuisible; et combien s’en moquent nos bateliers et nos paysans! Vous rendez un Allemand malade en le faisant coucher sur un matelas, comme un Italien sur la plume, et un Français sans rideau et sans feu. L’estomac d’un Espagnol ne résiste pas à la manière dont nous mangeons; ni le nôtre à boire comme les Suisses.—A Augsbourg, un Allemand m’a amusé en s’élevant contre l’incommodité de nos foyers, auxquels il faisait le même reproche que celui dont nous usons pour condamner leurs poêles; et, en vérité, cette chaleur lourde, l’odeur qui, lorsqu’ils sont échauffés, se dégage des matériaux dont ils sont construits, portent à la tête chez la plupart de ceux qui n’y sont pas habitués; c’est là un effet auquel j’échappe. Mais, en somme, la chaleur qu’ils donnent est égale, constante, pénètre partout; ils ne produisent ni flamme, ni fumée; on ne reçoit pas, comme chez nous, le vent qui s’introduit par le conduit de nos cheminées; tout cela fait que ce mode de chauffage supporte bien la comparaison avec le nôtre. Que n’imitons-nous l’architecture romaine? On dit qu’anciennement à Rome le feu se faisait en dehors et en contre-bas des maisons, d’où la chaleur se communiquait dans toute l’habitation par des tuyaux qui, logés dans l’épaisseur des murs, embrassaient tout le pourtour des locaux qu’ils devaient échauffer, ce que j’ai vu clairement décrit dans je ne sais quel passage de Sénèque. Mon Allemand m’entendant louer les commodités et les beautés de sa ville qui, certes, le mérite, se mit à me plaindre de ce que je devais la quitter, et, parmi les inconvénients que je devais rencontrer ailleurs, plaça en première ligne les maux de tête que les cheminées m’y occasionneraient. Il avait entendu quelqu’un s’en plaindre et s’imaginait que cela nous était particulier, ne s’apercevant pas par habitude qu’il en était de même chez lui.—Toute chaleur produite par le feu m’affaiblit et m’alourdit; Evenus disait que le feu est le meilleur condiment de 633 l’existence, j’use de préférence de tout autre moyen pour échapper au froid.
Les coutumes d’un pays sont parfois le contraire de celles de quelque autre nation. Tendance que nous avons à aller chercher ailleurs, dans l’antiquité notamment, des arguments que notre époque nous fournirait amplement.—Nous n’estimons pas les vins provenant du tonneau quand déjà il est bas; en Portugal, le fumet en est très prisé et ces vins sont servis sur la table des princes. De fait, chaque nation a des coutumes et des usages qui non seulement sont inconnus à d’autres nations, mais qui y paraissent sauvages et étonnants. Quelle appréciation porter sur ce peuple, qui ne tient compte que des témoignages imprimés, qui ne croit les hommes que dans leurs livres, et la vérité que si elle est d’un âge respectable? Nos sottises, d’après lui, acquièrent de la dignité quand nous les avons mises sous presse; et dire: «je l’ai lu», au lieu de: «je l’ai entendu dire», a pour lui une valeur bien autrement grande. Moi, qui ai même foi dans ce qui sort de la bouche des hommes qu’en ce qui vient de leur main, qui sais qu’on écrit aussi indiscrètement que l’on parle, et qui estime mon siècle autant qu’un autre des temps passés, je crois aussi volontiers un ami qu’Aulu-Gelle et Macrobe, ce que j’ai vu que ce qu’ils ont écrit; et, de même qu’on ne tient pas la vertu pour plus grande parce qu’elle date depuis plus longtemps, je pense que la vérité n’est pas plus sage de ce qu’elle est plus vieille. Je dis souvent que c’est pure sottise de recourir aux exemples que nous trouvons à l’étranger et que l’on prône tant dans les écoles; les temps actuels nous en fournissent aussi abondamment qu’aux époques d’Homère et de Platon. L’idée contraire ne proviendrait-elle pas de ce que nous nous attachons plus à l’honneur de reproduire une citation qu’à la vérité de ce que nous exposons, comme si, en empruntant ses arguments à la boutique de Vascosan ou à celle de Plantin, on prouvait davantage qu’en s’appuyant sur ce qui se voit dans son village? ou bien encore de ce que nous n’avons pas assez d’esprit pour analyser et faire ressortir la valeur de ce qui se passe sous nos yeux et l’apprécier assez finement pour en tirer des conclusions? Car dire que l’autorité nous manque pour faire qu’on ajoute foi à notre témoignage, ne se peut admettre; d’autant que, à mon avis, les choses les plus ordinaires, les plus communes, les plus connues pourraient, si nous savions trouver la meilleure manière de nous y prendre, nous mettre en présence des plus grands miracles de la nature, et nous fournir les plus merveilleux exemples, surtout quand nos observations portent sur les actions humaines.
Exemples de quelques singularités résultant de l’habitude.—Laissant donc, sur ce sujet, les exemples que je connais par les livres, tels que celui que cite Aristote, d’Andron l’Argien qui traversait sans boire les sables arides de la Libye, j’ai ouï dire, devant moi, à un gentilhomme qui a rempli honorablement plusieurs 635 charges, qu’il était également allé sans boire, de Madrid à Lisbonne, en plein été. C’est un homme très vigoureux pour son âge et qui n’a rien d’extraordinaire dans les habitudes courantes de la vie, si ce n’est de demeurer, m’a-t-il dit, deux ou trois mois, voire même une année, sans boire. Il sent de l’altération, mais il la laisse passer, et dit que c’est un appétit qui se dissipe aisément de soi-même, et que, lorsqu’il boit, c’est plus par caprice que par besoin ou plaisir.
Autres exemples d’autre sorte. Il n’y a pas longtemps, je rencontrai l’un des hommes les plus savants de France, d’entre ceux possédant une grande fortune. Il travaillait dans un des coins d’une salle qu’on lui avait garnie de tapisseries, et, autour de lui, ses valets, sans se gêner, faisaient un grand vacarme. Il me dit, et Sénèque en rapporte autant de lui-même, que ce tintamarre lui allait fort, ce tapage ramenant en quelque sorte sa pensée en lui, comme si, pour échapper au bruit, il était obligé de se replier sur lui-même, de se concentrer, pour pouvoir méditer. En étudiant à Padoue, il avait si longtemps travaillé dans un local où s’entendaient continuellement le roulement des voitures et le tumulte de la place, qu’il s’était habitué non seulement à n’en être pas incommodé, mais à ne pouvoir même s’en passer pour bien travailler.—Socrate répondait à Alcibiade qui s’étonnait de ce qu’il pouvait supporter les criailleries continuelles de sa femme: «Cela me fait comme, à ceux qui y sont habitués, le bruit continu des norias qui servent à puiser l’eau.»—Je suis tout le contraire, j’ai l’esprit impressionnable et facile à distraire; aussi quand je suis mal disposé, le moindre bourdonnement de mouche m’est insupportable.
Sénèque, dans sa jeunesse, s’était fortement appliqué, à l’exemple de Sextius, à ne rien manger qui eût eu vie; cela dura un an et il s’en trouvait bien, nous dit-il. Il y renonça uniquement pour qu’on ne le soupçonnât pas d’être favorable à certaines religions nouvelles, en suivant cette règle qu’elles prônaient. Il s’était également mis, vers le même temps, comme le recommande Attale, à ne plus coucher sur des matelas cédant sous le poids du corps et, jusqu’à la fin de ses jours, il n’en employa que de résistants; ce que l’usage faisait considérer à son époque comme acte d’austérité de sa part, nous le tenons aujourd’hui pour du raffinement.
Nos goûts sont susceptibles de se modifier quand nous nous y appliquons; il faut faire en sorte, surtout quand on est jeune, de n’en avoir aucun dont nous soyons les esclaves.—Regardez combien est différente ma manière de vivre de celle de mes valets de ferme; combien les Scythes et les Indiens diffèrent de moi comme force et comme tournure.—J’ai retiré de la mendicité, pour les prendre à mon service, des enfants qui, bientôt après, m’ont quitté, abandonnant ma cuisine et ma livrée, pour revenir à leur existence première; depuis, j’en ai rencontré un qui, pour son dîner, ramassait des moules dans la rue et que ni mes prières, ni mes menaces n’ont pu détourner 637 de la saveur et de la douceur qu’il trouvait à vivre ainsi dans l’indigence. Les gueux ont leurs magnificences et leurs voluptés, tout comme les riches; on dit même qu’ils ont une hiérarchie et des dignitaires tout comme dans l’ordre social.—Ce sont là des effets de l’entraînement, qui peut non seulement nous amener à tel genre de vie qu’il lui plaît (et, disent les sages, il est bon de s’arrêter au meilleur qui, de ce fait, se trouvera facilité), mais aussi nous préparer aux changements et aux variations qui peuvent survenir; et c’est le plus noble et le plus utile des apprentissages que nous puissions faire. Les meilleures des qualités physiques qui me sont propres, c’est de me prêter à tout et que rien ne me soit indispensable; j’ai des penchants qui me sont plus personnels, auxquels je reviens plus fréquemment et qui me sont plus agréables que d’autres, mais avec bien peu d’efforts je m’en détourne, et très aisément j’en adopte qui sont tout le contraire. Un jeune homme doit introduire du trouble dans ce qu’il s’est imposé comme règle, afin que sa vigueur soit toujours en éveil, ne s’altère pas et n’arrive à l’énervement; il n’y a pas de train de vie si sot et si débile, que celui de qui est astreint à une discipline et un règlement constants: «Veut-il se faire porter jusqu’à la première borne milliaire, l’heure est prise dans son traité d’astrologie; s’est-il frotté le coin de l’œil et lui en cuit-il, le collyre devra être composé d’après son horoscope (Juvénal)». S’il m’en croit, il ira jusqu’à commettre des excès, autrement la moindre débauche l’abat, et il devient gênant et désagréable en société. Ce qu’il y a de plus fâcheux pour un homme du monde, c’est d’être d’une délicatesse l’obligeant à un mode d’existence particulier, et c’est le cas s’il ne peut se plier et s’assujettir à toutes les exigences. Il y a de la honte à ne pas faire par impuissance, ou à ne pas oser ce qu’on voit faire à ses compagnons; les gens de ce tempérament n’ont qu’à rester chez eux et observer leur régime. Nulle part une semblable attitude ne convient; mais, dans la profession des armes, c’est un vice capital qui ne peut s’admettre, parce que l’homme de guerre, ainsi que le disait Philopœmen, doit être accoutumé à toutes les variations et irrégularités de la vie.
Habitudes qu’avait contractées Montaigne dans sa vieillesse; passer la nuit au grand air l’incommodait, soin qu’il mettait à se tenir le ventre libre.—Quoique j’aie été dressé, autant qu’on l’a pu, à la liberté et à l’indifférence, je ne m’en suis pas moins, en vieillissant, arrêté davantage par nonchalance à certaines manières de faire (mon âge ne me permet plus de me corriger, je ne peux désormais que chercher à me maintenir dans mon état actuel), et l’habitude a déjà, sans que j’y pense, si bien imprimé en moi son caractère à l’égard de certaines choses, que c’est pour moi faire des excès, que de m’en départir.—Je ne puis sans m’y entraîner: dormir à la belle étoile; manger entre mes repas; me coucher après déjeuner ou souper, sans mettre un assez grand intervalle, comme qui dirait trois * longues heures; m’unir à la femme, si ce n’est avant de m’endormir; entrer en sa 639 possession, en restant debout; demeurer en sueur; boire de l’eau ou du vin purs; rester longtemps la tête découverte; me faire couper les cheveux après dîner; je ne me passerais pas de gants plus malaisément que de chemise; c’est un besoin pour moi de me laver chaque fois au sortir de table et lorsque je me lève; avoir un ciel de lit et des rideaux me semble de première nécessité.—Je dînerais sans nappe, mais il ne me siérait pas de me passer de serviette blanche à chaque repas, comme cela se fait chez les Allemands; je les salis plus qu’ils ne le font, eux et les Italiens, parce que j’ai peu recours aux cuillères et aux fourchettes. Je regrette que l’usage n’ait pas pris de faire comme j’ai vu commencer chez les rois, de changer de serviette, comme d’assiette, à tous les services.—Nous savons que Marius, ce soldat qui a tant peiné, devint, dans sa vieillesse, fort délicat sur la boisson et qu’il ne buvait que dans une coupe affectée à son usage personnel; moi, je préfère également certaine forme de verre, ne bois pas volontiers dans un verre ordinaire, et n’aime pas à être servi par le premier venu; tout verre en métal me déplaît auprès de ceux faits d’une matière claire et transparente: il est besoin que mes yeux, dans la mesure où ils le peuvent, participent à la jouissance qu’éprouve mon palais.—C’est ainsi que je dois à l’usage certaines habitudes efféminées. De son côté, la nature m’a aussi apporté les siennes, telles que de ne pouvoir faire plus de deux repas complets en un jour, sans surcharger mon estomac; non plus que de me passer complètement de l’un d’eux, sans avoir des vents, la bouche desséchée et mon appétit qui proteste.—Je suis incommodé si je demeure longtemps exposé au serein; depuis quelques années lorsque, dans des circonstances de guerre, j’y reste toute la nuit, ce qui est courant, au bout de cinq ou six heures mon estomac commence à s’en trouver mal, j’éprouve de violentes douleurs de tête, n’atteins pas le jour sans vomir, et, quand les autres vont déjeuner, moi je vais dormir et suis ensuite aussi dispos qu’avant. J’avais toujours entendu dire que le serein ne tombe que lorsque vient la nuit; mais un seigneur que je fréquentais assez longuement et intimement en ces dernières années, convaincu que le serein est plus âpre et plus dangereux quand le soleil décline, une heure ou deux avant son coucher, ce qui fait qu’il l’évite à ce moment et ne s’inquiète pas de celui de la nuit, a failli me faire partager non tant son raisonnement que ses sensations. Ainsi le doute même et les recherches auxquelles nous nous livrons pour nous enquérir de ce qui est vrai ou de ce qui ne l’est pas, agissent sur notre imagination et nous changent!—Ceux qui cèdent brusquement à ces opinions diverses, marchent à leur ruine complète; aussi combien je plains quelques gentilshommes qui, par la sottise de leurs médecins, se sont, dans toute la force de leur jeunesse, séquestrés de leur propre mouvement; mieux vaut encore contracter un rhume, que de ne pouvoir plus jamais, parce qu’on en a perdu l’habitude, vivre de la vie commune, dont nous avons à faire si grand usage. Fâcheuse science vraiment que celle qui nous 641 gâte les heures les plus douces de l’existence! Attachons-nous par tous les moyens à ce que nous possédons; le plus souvent on s’affermit dans la possession, en s’y opiniâtrant, et on corrige son tempérament, comme fit César, qui triompha du haut mal à force de le mépriser et de lui résister. On doit adopter les règles qui sont les meilleures mais non s’y assujettir, sauf à celles, s’il en existe, dont l’observation est obligatoire et utile.
Les rois et les philosophes ont journellement à vider leurs intestins; il en est de même des plus grandes dames. Ceux dont la vie se passe en public, se doivent de garder un certain décorum; la mienne est obscure, ne relève que de moi et bénéficie par suite de toutes les libertés qui sont dans la nature; en outre, je suis soldat et gascon, un peu sujets l’un et l’autre à l’indiscrétion; je puis donc dire de cet acte ce que j’en pense. Il faut s’y livrer la nuit, à des heures déterminées; on y arrive par l’habitude en s’y astreignant ainsi que j’y suis parvenu. Mais il ne faut pas s’asservir, comme je l’ai fait en vieillissant, à avoir besoin de local et de siège spécialement aménagés pour cet usage, ni s’en trouver empêché parce que, par paresse, on aura trop différé; toutefois, on est bien un peu excusable de rechercher du soin et de la propreté là comme ailleurs, même quand il s’agit des choses les plus malpropres: «l’homme est de sa nature un animal propre et délicat (Sénèque)». De toutes les fonctions naturelles, c’est celle dans laquelle il m’est le plus pénible d’être interrompu. J’ai vu beaucoup de gens de guerre incommodés par le déréglement de leur ventre; le mien et moi n’avons jamais failli au moment précis, qui est au saut du lit, sauf quand une pressante occupation ou une maladie nous dérangent.
Ce que les malades ont de mieux à faire, c’est de ne rien changer à leur mode de vie habituel; lui-même ne s’est jamais abstenu de ce qui lui faisait envie; il en a été ainsi des plaisirs de l’amour, qu’il a commencé si jeune à connaître que ses souvenirs ne remontent pas jusque-là.—Je ne juge donc pas, comme je l’ai dit, que les malades puissent mieux assurer leur rétablissement autrement qu’en s’en tenant au genre de vie dans lequel ils ont été nourris et élevés; tout changement, quel qu’il soit, nous étonne et nous blesse. Pouvez-vous croire que les châtaignes puissent faire mal à un Périgourdin ou à un Lucquois, le lait et le fromage aux gens de la montagne? En les leur interdisant, non seulement vous changez leur mode d’existence, mais vous leur en imposez un contraire au leur; c’est une modification à laquelle même un homme bien portant ne saurait résister. Ordonnez à un Breton qui a soixante-dix ans, de ne boire que de l’eau; enfermez un homme de mer dans une étuve; défendez la promenade à un domestique basque, c’est les priver de mouvement et finalement d’air et de lumière: «La vie est-elle d’un si grand prix, qu’on nous force à renoncer à cesser de vivre pour prolonger notre existence? car je ne pense pas qu’il faille mettre au nombre des vivants, ceux auxquels on rend incommode l’air qu’ils 643 respirent et la lumière qui les éclaire (Pseudo-Gallus).» Si les médecins ne font pas d’autre bien, ils font du moins qu’ils préparent de bonne heure les patients à la mort, en sapant peu à peu et réduisant en eux l’usage de ce que nous offre la vie.
Que je fusse bien portant ou malade, je me suis d’ordinaire laissé aller à satisfaire mes appétits; je donne une grande autorité à mes désirs et à mes penchants; je n’aime pas à guérir le mal par le mal, et je hais les remèdes qui m’importunent plus que la maladie. Être sujet à la colique et obligé de m’abstenir du plaisir de manger des huîtres, sont deux maux au lieu d’un; le mal nous tiraille d’un côté, le régime de l’autre. Puisqu’on est exposé à des mécomptes, courons plutôt la chance que ce soit après avoir donné satisfaction à ce qui nous cause du plaisir. Le monde fait les choses au rebours: il s’imagine que rien ne peut être utile, s’il n’est en même temps pénible; ce qui est facile, lui est suspect. Mon appétit, en plusieurs choses, s’est de lui-même assez heureusement accommodé de ce qui convient à la santé de mon estomac; quand j’étais jeune, les sauces piquantes et relevées m’étaient agréables; depuis, mon estomac s’en est fatigué et mon goût a aussitôt fait de même. Le vin nuit aux malades, c’est la première chose dont je me dégoûte et la répugnance que j’en éprouve est insurmontable. Tout ce que je prends de désagréable m’est nuisible; et rien ne me nuit, quand j’en ai envie et que cela me sourit.—Aucun acte qui m’était tout à fait agréable ne m’a causé de dommage; aussi m’est-il arrivé de faire céder à mon plaisir, dans une large mesure, n’importe quelle ordonnance médicale; et, tout jeune, «alors que couvert d’une robe éclatante, l’Amour voltigeait sans cesse autour de moi (Catulle)», je me suis prêté aussi licencieusement et inconsidérément qu’un autre aux désirs qui m’étreignaient, «et ai acquis quelque gloire dans ce genre de combat (Horace)» plus, toutefois, par la persistance et la durée de mon attachement que par ma vigueur: «A peine si je me souviens d’y avoir triomphé jusqu’à six fois consécutives (Ovide).» Il y a certes du malheur et du miracle à confesser combien j’étais jeune quand, pour la première fois, je me rencontrai asservi à ses lois; ce fut bien un effet du hasard, car c’était longtemps avant d’être en âge de pouvoir distinguer et choisir; mes souvenirs sur ce qui me touche ne remontent pas si loin, et mon cas peut marcher de pair avec celui de Quartilla, qui ne se souvenait pas de sa virginité: «Aussi ai-je eu de bonne heure du poil sous l’aisselle, et ma barbe précoce étonna ma mère (Martial).»—Les médecins font ployer, le plus souvent avec utilité, leurs prescriptions devant la violence des envies excessives qui se produisent chez leurs malades; nul désir intense ne peut être imaginé si étrange et si pernicieux, que la nature ne le fasse tourner à notre avantage. Et puis, que de contentement dans la satisfaction d’une fantaisie! cela, suivant moi, importe par-dessus tout, ou au moins plus que toute autre considération. Les maux les plus graves et les plus ordinaires sont ceux qui proviennent du fait de notre imagination; et ce dicton 645 espagnol: «Que Dieu me défende contre moi-même!» me plaît à divers titres. Je regrette quand je suis malade de ne pas avoir quelque désir que j’aurais plaisir à assouvir, la médecine aurait bien de la peine à m’en détourner; du reste j’en suis maintenant là que, même quand je suis bien portant, je ne fais plus guère que vouloir et espérer; c’est pitié d’être arrivé à cet état de langueur et d’affaiblissement, que l’on ne puisse faire que souhaiter.
L’incertitude de la médecine autorise toutes nos envies.—L’art de la médecine n’est pas tellement bien fixé, que nous ne soyons fondés à faire ce qui nous convient; il change suivant les climats et les phases de la lune, selon Fernel et selon l’Escale. Si votre médecin trouve mauvais que vous dormiez, que vous fassiez usage de vin, ou de telle viande, ne vous désolez pas; je vous en trouverai un autre qui ne sera pas de son avis; la variété des arguments et des opinions en matière de médecine, embrasse toutes sortes de formes. J’ai vu un malheureux qui, pour guérir, se laissait torturer par la soif, au point de tomber en pâmoison, et dont se moquait plus tard un autre médecin qui condamnait ce régime, comme nuisible; vraiment c’était avoir bien employé sa peine! Tout récemment, est mort de la pierre un homme de cette profession: pour combattre son mal, il avait recours à une abstinence complète; ses confrères disent que ce jeûne lui était absolument contraire, qu’il l’avait asséché et lui avait cuit le sable dans les rognons.
Montaigne avait un timbre de voix élevé; dans la vie courante, l’intonation de notre voix est à régler suivant l’idée qu’on veut rendre.—J’ai constaté que lorsque je suis blessé ou malade, causer m’agite et me nuit autant que tout ce que je puis faire de désordonné; j’ai peine à parler et cela me fatigue, parce que mon timbre de voix est élevé et demande un effort, si bien que, souvent, lorsqu’il m’est arrivé de parler à l’oreille de hauts personnages, les entretenant d’affaires importantes, je les ai mis dans la nécessité de me demander de baisser la voix.
Voici une anecdote plaisante: Quelqu’un, dans une école grecque, parlait sur un ton élevé comme je fais moi-même; le maître de cérémonies lui manda de parler moins haut: «Qu’il m’envoie, répondit-il, le ton sur lequel il veut que je parle.» A quoi, l’autre lui répliqua qu’il prît le ton des oreilles de celui auquel il s’adressait. C’était bien dit, sous condition que cela signifiât: «Parlez suivant ce que vous avez à traiter avec votre auditeur»; si au contraire il avait voulu dire: «Il suffit qu’il vous entende, réglez votre son de voix en conséquence», je ne trouve pas qu’il eût été dans le vrai.—Le ton et le mouvement de la voix concourent en effet à l’expression et à la signification de ce qui se dit; c’est à celui qui parle à la conduire pour lui faire exprimer ce qu’il veut. Il y a un ton de voix pour instruire, un autre pour flatter, un autre pour tancer; non seulement il faut que la voix parvienne à qui l’on s’adresse, mais il faut parfois qu’elle le frappe, le transperce. 647 Quand je réprimande mon domestique avec une dureté de ton marquant mon mécontentement, il ferait bon qu’il vînt me dire: «Mon maître, je vous entends parfaitement, parlez plus doucement.» «Il y a une sorte de voix faite pour l’oreille, non tant par son étendue que par sa propriété (Quintilien).» La parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute; celui-ci doit se disposer à la recevoir d’après le sens qu’elle exprime, comme au jeu de paume où le joueur qui reçoit la balle, s’apprête et se meut dans un sens ou dans un autre, selon qu’il voit le geste de celui qui l’envoie et suivant la forme du coup.
Les maladies, comme tout ce qui a vie, ont leurs évolutions dont il faut attendre patiemment la fin; laissons faire la nature, nous luttons en vain; dès notre naissance, nous sommes voués à la souffrance et, arrivés à la vieillesse, l’effondrement est forcé.—L’expérience m’a encore appris que nous nous perdons par notre peu de patience. Les maux ont leur vie, des limites déterminées, leurs maladies et leur état de santé. La constitution des maladies est formée sur le même modèle que celle des animaux: elles ont leur évolution, leur durée fixées dès leur origine; qui essaie de les abréger en tentant de leur imposer de force sa volonté quand elles nous tiennent, les allonge et les multiplie, les excite au lieu de les apaiser. Je suis de l’avis de Crantor: «Qu’il ne faut pas contrecarrer les maux avec obstination et étourdiment, ni leur laisser prendre le dessus par manque d’énergie; mais qu’il faut leur céder naturellement, suivant l’état qu’ils présentent et celui dans lequel nous sommes.» On doit livrer passage aux maladies, et je trouve qu’elles s’arrêtent moins chez moi, parce que je les laisse faire; j’ai été débarrassé de certaines qui passaient pour opiniâtres et tenaces, elles se sont usées d’elles-mêmes sans que j’y aide, sans que l’art intervienne et même contre ses règles. Laissons un peu faire la nature, elle entend mieux ses affaires que nous. «Mais un tel en est mort!» vous dit-on. C’est vrai et vous ferez de même; si ce n’est de ce mal, ce sera d’un autre. Combien n’y ont pas échappé qui avaient trois médecins à leurs trousses! L’exemple est un miroir où tout se reflète vaguement et sous tous les aspects. Si la médecine qui vous est offerte est agréable, acceptez-la, c’est toujours autant de bien acquis pour le moment présent; je ne m’arrêterai ni au nom ni à la couleur si elle est délicieuse et appétissante, le plaisir est une des principales formes sous lesquelles se manifeste le profit.—J’ai laissé vieillir et mourir en moi, de mort naturelle, des rhumes, des attaques de goutte, des relâchements d’entrailles, des battements de cœur, des migraines et autres accidents qui m’ont abandonné quand j’étais déjà à moitié résigné à leur compagnie; on s’en débarrasse plus en usant de courtoisie, qu’en les bravant. Il faut supporter avec résignation les lois inhérentes à notre condition; nous sommes faits pour vieillir, nous affaiblir, être malades en dépit de toute médecine. C’est la première leçon que les Mexicains font à leurs enfants quand, au 649 sortir du ventre de leur mère, ils les accueillent en disant: «Enfant, tu es venu au monde pour endurer; endure, souffre et tais-toi.» Il n’est pas juste de se plaindre de ce qu’il arrive à quelqu’un, ce qui peut arriver à chacun: «Plains-toi, mais seulement si l’on applique à toi seul une loi qui soit injuste (Sénèque).»
Voyez un vieillard qui demande à Dieu de lui maintenir sa santé entière et vigoureuse, autrement dit de lui rendre sa jeunesse; n’est-ce pas folie? son état ne le comporte pas: «Insensé, pourquoi, dans tes vœux puérils, demander des choses irréalisables (Ovide)?» La goutte, la gravelle, les indigestions, sont l’apanage d’un âge avancé, comme la chaleur, les pluies, les vents, celui des longs voyages. Platon ne croit pas qu’Esculape se soit mis en peine de chercher, par les régimes qu’il prescrivait, à faire durer la vie dans un corps gâté et affaibli, inutile à son pays, hors d’état de remplir ses fonctions et de produire des enfants sains et robustes; et il ne trouve pas qu’un pareil rôle puisse convenir à la justice et à la prudence divines, qui doivent tout conduire en vue d’un but utile. Mon bonhomme, c’en est fait; on ne saurait vous redresser; pour le reste, on vous replâtrera, on vous étançonnera un peu, on prolongera même vos misères de quelques heures, «comme fait celui qui, pour soutenir un bâtiment, l’étaie dans les endroits où il menace ruine; mais un jour vient où tout l’assemblage venant à se rompre, les étais s’écroulent sous l’édifice (Pseudo-Gallus)». Il faut apprendre à souffrir ce qu’on ne peut éviter. Notre vie est composée, comme l’harmonie des mondes, d’éléments contraires et de tons variés: doux et stridents, aigus et sans sonorité, grêles et graves; le musicien qui aimerait les uns et délaisserait les autres, quel parti pourrait-il en tirer? Il faut qu’il sache user de tous simultanément et les mêler. Nous devons faire de même des biens et des maux, car ils sont parties intégrantes de notre vie; notre être n’est possible qu’avec ce mélange, les uns ne sont pas moins nécessaires que les autres. Essayer de réagir contre cette nécessité, c’est renouveler l’acte de folie de Ctésiphon qui entreprenait de lutter à coups de pied avec sa mule.
Je consulte peu quand je sens que ma santé s’altère, parce que les médecins abusent trop, quand ils nous tiennent à leur merci; ils nous rebattent les oreilles de leurs pronostics. Il m’est arrivé autrefois d’avoir été surpris par eux aux prises avec le mal; ils m’ont outrageusement accablé de leur science et de leurs airs d’importance, me menaçant tantôt de violentes douleurs, tantôt de mort prochaine. Je n’en étais ni abattu, ni décontenancé, mais froissé et excité; et si mon jugement même ne s’en trouvait ni modifié, ni troublé, j’en étais cependant quelque peu gêné; puis, il faut entrer en lutte avec eux, et il en résulte toujours de l’agitation.
Dans ses maux, Montaigne aimait à flatter son imagination: atteint de gravelle, il s’applaudit que ce soit sous cette forme qu’il ait à payer son tribut inévitable à l’âge; 651 c’est une maladie bien portée, qui ne le prive pas de tenir sa place dans la société et le prépare insensiblement à la mort.—Je suis aux petits soins avec mon imagination; si je le pouvais, je la déchargerais de toute peine et de toute contestation; il faut la secourir et la flatter, la tromper même, si on le peut. C’est une tâche à laquelle mon esprit s’entend, il n’est pas en peine de trouver de bonnes raisons pour toutes choses, et s’il persuadait comme il prêche, il me serait d’un très heureux secours. En désirez-vous un exemple? voici le langage qu’il tient: «C’est pour mon plus grand bien que j’ai la gravelle. Des crevasses se produisent naturellement dans les édifices qui ont mon âge; à ce moment, ils sont arrivés au point où ils se disjoignent et perdent leur aplomb; c’est une loi commune, et il n’a pas été fait un nouveau miracle en ma faveur. C’est là une redevance que je paie à la vieillesse et je ne saurais m’en tirer à meilleur compte. L’accident qui m’arrive est celui auquel sont le plus sujets les hommes de mon temps, et cela doit me consoler d’être en compagnie; partout se voient des gens affligés de ce mal, et leur société m’en est d’autant plus honorable qu’il s’attaque plus volontiers aux grands; par essence, il a de la noblesse et de la dignité. Parmi les hommes qui en sont frappés, il en est peu qui s’en tirent à meilleur marché que moi, car il leur en coûte la peine de suivre un régime désagréable et l’ennui de drogues à prendre chaque jour, tandis que je dois à ma bonne fortune, grâce à des dames qui, plus gracieusement que mon mal n’est douloureux, m’avaient offert la moitié de celui dont elles étaient atteintes elles-mêmes, de n’avoir jamais avalé qu’à deux ou trois reprises différentes, quelques-unes de ces infusions de panicaut et de turquette dont l’usage est courant, qui m’ont paru faciles à prendre et ont été du reste sans effet. Mes compagnons de misère ont à acquitter mille vœux qu’ils ont faits à Esculape et à payer autant d’écus à leur médecin, pour obtenir cet écoulement aisé et abondant de sables, dont je suis souvent redevable à la nature. La décence de ma tenue, quand je suis en société, ne s’en ressent même pas; je puis demeurer dix heures sans uriner, aussi longtemps que quelqu’un bien portant.—La crainte de ce mal, ajoute mon esprit, t’effrayait autrefois quand il t’était inconnu; les cris et le désespoir de ceux qui l’exagèrent par leur manque de résignation te le faisaient prendre en horreur. C’est un mal qui frappe les membres par lesquels tu as le plus péché, tu es un homme de conscience: «Le mal qu’on n’a pas mérité, est le seul dont on ait droit de se plaindre (Ovide).» Regarde celui-ci comme un châtiment; il est si doux auprès de tant d’autres qui pouvaient t’atteindre, qu’il témoigne d’une faveur toute paternelle; considère combien il est tardif; il n’incommode et n’occupe que l’époque de ta vie qui, d’une manière ou d’une autre, est désormais perdue et stérile; elle remplace, comme si c’était une chose convenue à l’avance, la licence et les plaisirs de la jeunesse. La crainte, 653 la pitié que ce mal inspire communément est pour toi un motif de gloire, faiblesse dont tes amis retrouvent encore quelques traces en toi, bien que ton jugement en fasse fi et que ta raison en soit guérie. Il y a du plaisir à entendre dire de soi: Quelle énergie! Quelle patience! On te voit épuisé de souffrance, pâlir, rougir, trembler, vomir jusqu’au sang, souffrir de contractions et de convulsions étranges, de grosses larmes tomber parfois de tes yeux, rendre des urines épaisses, noires, effrayantes, ou les avoir arrêtées par quelque pierre aux arêtes aiguës qui labourent et écorchent cruellement le canal de l’urètre; et nonobstant, tu t’entretiens avec les assistants, conservant ta contenance d’habitude, plaisantant par moments avec ceux qui t’entourent, tenant ta place dans une conversation sérieuse, démentant tes douleurs par ta parole et triomphant de tes souffrances! Te souvient-il de ces gens des temps passés, qui recherchaient les maux avec tant d’avidité, afin de tenir leur vertu en haleine et lui donner sujet de s’exercer? Suppose que ce soit pour te faire prendre place dans les rangs glorieux de cette école, dans laquelle tu ne serais jamais entré de ton plein gré, que la nature t’a mis en cet état.—Si tu me dis que c’est un mal dangereux et mortel, tous autres ne sont-ils pas dans le même cas? car c’est une tromperie de la médecine que d’en excepter qui, d’après elle, ne mènent pas directement à la mort; qu’importe qu’ils y conduisent accidentellement et si, glissant et biaisant, ils gagnent insensiblement mais sûrement la voie qui y mène! Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant; la mort n’a pas besoin de l’intervention de la maladie pour te tuer. Chez certains, les maladies ont éloigné la mort; ils ont vécu plus longtemps, parce qu’il leur semblait sans cesse être mourants; d’autant qu’il en est des maladies comme des plaies, il y en a qui sont des remèdes et sont salutaires. La colique est fréquemment aussi vivace que nous; on voit des hommes chez lesquels elle a persisté depuis leur enfance jusqu’à leur plus extrême vieillesse; et s’ils ne lui eussent faussé compagnie, elle les eût accompagnés plus loin encore; vous la tuez plus souvent qu’elle ne vous tue. Et lors même qu’elle te serait un indice de mort prochaine, ne rendrait-elle pas service à un homme de ton âge, en lui donnant à réfléchir sur sa fin dernière?—Enfin, et c’est ce qu’il y a de pire, rien ne peut plus te guérir. Arrange-toi donc comme tu voudras; au premier jour, la loi commune te réclamera. Considère avec quel art et combien doucement ta maladie te dégoûte de la vie et te détache du monde, non avec violence et tyrannie, ainsi qu’il arrive de tant d’autres maux que tu vois aux vieillards qu’ils tiennent continuellement entravés par leur faiblesse et leurs douleurs sans leur laisser aucun répit, mais par des avertissements et des enseignements répétés à intervalles entremêlés de longs moments de repos, comme pour te donner le moyen de méditer et de repasser sa 655 leçon à ton aise. Pour te permettre de bien juger et de prendre ton parti en homme de cœur, elle t’expose l’état complet de la situation, en bien comme en mal, et dans un même jour te fait une vie tantôt allègre, tantôt insupportable. Si tu n’étreins pas la mort, du moins tu mets ta main dans la sienne une fois chaque mois, ce qui te donne l’espérance qu’un jour elle t’attrapera sans menace préalable. Tu auras été si souvent conduit jusqu’au port que, confiant qu’il en sera toujours ainsi, vous vous trouverez, toi et ta confiance, avoir passé l’eau sans vous en apercevoir. On n’est pas fondé à se plaindre des maladies qui partagent loyalement le temps avec la santé.»
Passant habituellement par les mêmes phases, on sait au moins avec elle à quoi s’en tenir; et, si les crises sont particulièrement pénibles, quelle ineffable sensation quand d’un instant à l’autre le bien-être succède à la douleur!—Je suis reconnaissant à la fortune de ce qu’elle me livre si souvent assaut avec les mêmes armes: elle m’y façonne, m’y dresse par l’usage, m’y endurcit et m’y habitue; je sais à peu près maintenant à quelles conditions j’en suis quitte. Faute de mémoire naturelle, je m’en crée sur le papier; dès qu’il survient dans mon mal quelque symptôme nouveau, je le mets par écrit, de telle sorte qu’à cette heure, étant passé par à peu près tous les cas qui peuvent se produire, si j’ai quelque doute sur ce qui me menace, je consulte, comme des livres sibyllins, ces notes décousues, où je ne manque jamais de trouver dans mon expérience du passé, quelque pronostic favorable qui me console. L’habitude me permet aussi d’espérer mieux pour l’avenir, car ces évacuations se produisent depuis si longtemps déjà, qu’il est à croire que la nature ne modifiera pas la façon dont elles s’opèrent et qu’il ne m’adviendra rien de pire que ce que je ressens. En outre, les effets de cette maladie s’accordent assez avec mon tempérament vif et aimant à en venir promptement au fait. Quand ses attaques sont peu intenses, elle me fait peur, parce qu’alors elles se prolongent; si au contraire, sans que je les aie provoqués, ses accès sont violents et bien francs, elle me secoue de fond en comble, mais ce n’est l’affaire que d’un jour ou deux.—Mes reins sont demeurés quarante ans sans que j’en souffre; depuis tantôt quatorze ans cela a changé. Nous avons nos périodes de maladie, comme il y a des périodes de santé, et peut-être cet accident touche-t-il à sa fin. L’âge a affaibli la chaleur de mon estomac; la digestion s’en trouvant moins bien faite, les matières arrivent aux reins moins bien travaillées; pourquoi ne pourrait-il pas arriver qu’un phénomène venant à affaiblir la chaleur des reins au point qu’ils ne puissent plus produire ces concrétions pierreuses, la nature doive pourvoir à cette purgation par une autre voie? Les ans ont incontestablement tari en moi bien des rhumes; pourquoi ne tariraient-ils pas aussi ces résidus dont se forme le gravier?—Autre considération: Est-il rien de si doux que cette soudaine transformation, quand d’une douleur excessive j’en arrive, après l’évacuation 657 de ces calculs, à recouvrer, avec la soudaineté de l’éclair, cette belle lumière qu’est la santé, si nette, si complète, ainsi que cela advient à la suite de mes plus soudaines et douloureuses coliques! Y a-t-il rien dans la douleur dont je souffrais, qui puisse contrebalancer le plaisir que j’éprouve d’un revirement aussi rapide? Combien la santé me semble plus belle après la maladie dont elle est si voisine, si contiguë, qu’il me semble les voir en présence l’une de l’autre, toutes deux au plus fort de leur intensité, s’efforçant à qui mieux mieux de se tenir tête et de se contrecarrer! De même que les Stoïciens disent que les vices ont leur utilité et ont été introduits pour donner du prix à la vertu et la mettre en relief, avec moins de hardiesse et plus de raison nous pouvons dire que la nature nous prête la douleur pour faire honneur à la volupté et à la tranquillité, et nous les faire mieux apprécier. Quand Socrate eut été débarrassé de ses fers, et qu’il éprouva cette sensation agréable d’être délivré de l’engourdissement que leur poids lui causait dans les jambes, il se plut à constater l’étroite alliance de la douleur avec la volupté, si intimement associées l’une à l’autre que tour à tour elles se succèdent et s’engendrent réciproquement, ajoutant que, pour ce bon Ésope, il y aurait eu là matière à une belle fable.
La gravelle a encore l’avantage sur d’autres maladies de ne pas entraîner d’autres maux à sa suite, de laisser au patient l’usage de ses facultés, la possibilité de vaquer à ses occupations, même à ses plaisirs, et de ne pas altérer sa tranquillité d’esprit, s’il ne prête pas l’oreille à ce que peuvent lui représenter les médecins.—Ce que je vois de pire dans les autres maladies, c’est qu’elles ne sont pas aussi graves dans leurs effets que dans leur issue; on est un an à se refaire, sans cesser d’être en proie à la faiblesse et à la crainte. Il y a tant de hasard, tant de degrés à franchir pour se tirer complètement d’affaire, qu’on n’y arrive pas; avant qu’on vous ait enlevé les bandages dont vous étiez affublé, qu’on vous ait débarrassé de votre bonnet, qu’on vous ait rendu l’usage de l’air, du vin, de votre femme, des melons, c’est grand miracle si vous n’êtes pas retombé en quelque autre misère. Mon mal a cet avantage qu’il disparaît du coup, alors que les autres laissent toujours quelque impression et altération qui rendent le corps susceptible de contracter une autre maladie, toutes se prêtant la main les unes aux autres.—Parmi nos maux, ceux qui se contentent de prendre pied chez nous sans chercher à s’étendre et à y introduire toute leur séquelle, sont excusables; mais ceux-ci sont courtois et gracieux, dont le passage nous est de quelque utile conséquence. Depuis que j’ai ma colique, je suis, ce me semble, plus que par le passé, exempt d’autres accidents; c’est ainsi que depuis je n’ai plus de fièvre, je me figure que les vomissements excessifs et fréquents que j’ai, me purgent; d’autre part, les dégoûts que j’éprouve, les jeûnes extraordinaires par lesquels je passe, font que mes humeurs malignes se résolvent, 659 et que la nature vide dans ces pierres ce qu’elle a de superflu et de nuisible. Qu’on ne vienne pas me dire que c’est une médecine qui m’est vendue trop cher; qu’est-ce auprès de ces breuvages sentant si mauvais, des cautères, des incisions, des suées, des sétons, des diètes et de tant d’autres modes de traitement qui, au lieu de nous guérir, nous apportent souvent la mort, parce que nous ne pouvons résister à leur violence et à leur importunité? De la sorte, dans mes crises, je me dis que c’est une médecine qui opère; en dehors d’elles, je me considère comme complètement et à tout jamais délivré.
Voici encore un des avantages particuliers de mon mal: c’est qu’à peu de chose près, il fait son jeu à part et me laisse faire le mien, dans lequel il n’entre que si le courage vient à me manquer; alors que j’en souffrais le plus, je suis resté dix heures à cheval. Avec lui, il suffit de souffrir; pour le reste: jouez, soupez, faites ceci et encore cela si vous le pouvez, vos débauches vous seront plus utiles que nuisibles, dites donc à quelqu’un atteint de la vérole, de la goutte ou qui a une hernie, de faire de même! Les autres maladies nous imposent des obligations de toutes natures, entravent bien autrement nos occupations, troublent tout notre organisme et il nous faut en tenir compte dans tous les actes de la vie; celle-ci ne fait que nous pincer la peau, elle laisse à notre disposition notre entendement et notre volonté, et aussi la langue, les pieds, les mains; elle vous éveille plus qu’elle ne vous assoupit. L’âme est atteinte quand nous avons la fièvre; l’épilepsie la terrasse; une violente migraine la réduit à l’impuissance; en un mot elle est influencée par toute maladie qui a action sur notre être tout entier et sur ses parties les plus nobles. Dans mon cas, elle n’est pas inquiétée ou, si elle vient à l’être, c’est de sa faute, c’est qu’elle se trahit elle-même, qu’elle s’abandonne et se démonte. Il n’y a que les fous pour se laisser persuader que ces corps durs et pleins, qui se forment dans les rognons, peuvent se dissoudre par des breuvages; quand ils viennent à se mettre en mouvement, il n’y a rien autre à faire qu’à leur livrer passage, d’autant qu’ils se l’ouvriraient bien eux-mêmes.
Je constate encore dans mon mal cette supériorité, c’est qu’il nous laisse peu à deviner; avec lui, nous sommes exempts du trouble dans lequel les autres maux nous jettent par l’incertitude que nous avons sur leurs causes, leurs effets et leurs progrès, trouble qui est infiniment pénible. Ici, nous n’avons que faire des consultations des docteurs; ce que nous en ressentons nous montre en quoi le mal consiste et où il gît.
Par ces arguments, les uns forts, les autres faibles, et agissant comme fit Cicéron à propos de sa vieillesse, cette autre maladie, je tâche d’endormir et d’amuser mon imagination, j’essaie de graisser mes plaies. Si demain elles s’aggravent, demain j’y pourvoirai par d’autres échappatoires.—Ce qu’il y a de vrai, c’est que depuis peu de temps, les plus légers mouvements font que je rends par les 661 reins du sang tout pur; pour quelle raison? Cela ne m’empêche pourtant pas de me mouvoir comme auparavant et de suivre mes chiens à la chasse avec une ardeur toute juvénile et que rien n’arrête; c’est avoir bien facilement raison d’un aussi grave accident, qui ne me cause qu’une lourdeur un peu plus prononcée et de l’irritation dans la partie du corps qui en est le siège. Cette recrudescence du mal doit provenir de quelque grosse pierre qui comprime mes rognons et se forme à leurs dépens; cet organe, et avec lui ma vie, se vide ainsi peu à peu, non sans que j’en éprouve un soulagement naturel, comme de l’expulsion de matières qui me sont désormais une gêne et une superfluité. Lorsque je sens quelque chose qui s’écroule en moi, ne vous attendez pas à ce que j’aille m’amuser à me tâter le pouls ou analyser mes urines, pour y chercher quelle précaution ennuyeuse je pourrais prendre; ce sera assez temps quand le mal se fera sentir sans que, par peur, j’en allonge la durée. Qui craint de souffrir, souffre au delà de ce qu’il craint. Ajoutons que le doute et l’ignorance de ceux qui se mêlent d’expliquer les ressorts de la nature et ses progrès en nous, et émettent de par leur art des pronostics si fréquemment entachés d’erreur, doivent nous convaincre que ses ressources infinies nous sont totalement inconnues; la plus grande incertitude, la plus grande diversité, la plus grande obscurité règnent dans ce que nous pouvons espérer ou redouter d’elle. Sauf la vieillesse qui est un signe indubitable de l’approche de la mort, je ne vois dans tous les autres accidents que peu d’indications sur lesquelles nous puissions nous baser pour deviner l’avenir. Je ne me juge que par ce que je ressens réellement, et non en en raisonnant; à quoi cela me servirait-il de faire autrement, puisque je ne veux opposer au mal que l’attente et la patience?—Voulez-vous savoir ce que je gagne à suivre cette ligne de conduite? voyez chez ceux qui font le contraire, qui recherchent tant d’avis et de conseils divers, combien souvent leur imagination s’en trouve mal sans que leurs appréhensions soient justifiées. J’ai maintes fois pris plaisir, dans des moments d’accalmie, alors que tout danger était passé, à parler de ces accidents aux médecins, comme si je les sentais venir; j’étais ainsi bien à l’aise pour écouter les horribles conclusions dont ils me menaçaient; j’en devenais encore plus reconnaissant à Dieu de ses grâces et plus convaincu de la vanité de leur art.
Montaigne était grand dormeur, cependant il savait s’accommoder aux circonstances. Sa petite taille lui faisait préférer aller à cheval qu’à pied dans les rues et quand il y avait de la boue.—Il n’est rien qu’on doive plus recommander à la jeunesse que l’activité et la vigilance; notre vie n’est que mouvement. Je m’ébranle difficilement et suis lent en toutes choses: à me lever, à me coucher, à prendre mes repas; pour moi, sept heures c’est matinal; et, là où je suis mon maître, je ne dîne pas avant onze heures et ne soupe qu’après six.—J’ai autrefois attribué à la lourdeur et à l’assoupissement que me causait 663 un sommeil trop prolongé, des fièvres et des maladies que j’ai eues, et j’ai toujours regretté de me rendormir le matin. Platon est d’avis que l’excès de sommeil est plus mauvais que les excès de boisson. J’aime à avoir un lit qui soit dur, à coucher seul, sans femme, comme font les rois, et à être assez couvert. On ne me bassine jamais mon lit; mais depuis que la vieillesse me gagne, on me donne, quand besoin en est, des draps chauds pour m’envelopper les pieds et me mettre sur l’estomac. On trouvait à redire à ce que le grand Scipion fût dormeur; à mon avis, on ne lui faisait ce reproche que parce qu’on n’en avait pas d’autre à lui adresser. Si je suis quelque peu délicat dans mes habitudes, c’est plutôt dans mon coucher que dans toute autre chose; mais tout comme un autre, je me fais à la nécessité et m’en accommode. Dormir a été et n’a cessé d’être la plus grande occupation de ma vie; à l’âge où je suis arrivé, je dors encore fort bien huit ou neuf heures tout d’un trait. Quand il y a utilité, je me dégage de cette propension à la paresse et j’en éprouve un mieux évident; le changement m’est un peu pénible, mais c’est l’affaire de trois jours.—Je ne vois guère de gens qui aient moins de besoins que moi quand les circonstances l’exigent, qui s’entraînent avec plus de continuité et auxquels les corvées pèsent moins. Mon corps est capable de supporter une vie agitée qui se prolonge, mais il ne s’accommode pas d’une agitation véhémente et soudaine. Maintenant, cependant, j’évite les exercices violents qui peuvent me mettre en sueur: mes membres se fatiguent avant qu’ils ne se soient échauffés. Je reste facilement debout toute une journée et me promener n’est jamais un ennui pour moi; mais je n’aime pas à aller par les villes autrement qu’à cheval, et cela, depuis ma première enfance; parce que lorsque je vais à pied, je me crotte jusqu’à l’échine, et que les gens qui, comme moi, sont de petite taille, n’en imposant pas, courent risque, dans les rues, d’être coudoyés et bousculés. J’aimais aussi, quand je me reposais, soit assis, soit couché, à avoir les jambes à hauteur de mon siège, ou plus haut.
Le métier des armes est, de toutes les occupations, la plus noble et la plus agréable.—Il n’est pas d’occupation plus agréable que le métier des armes; noble dans son exécution (car la plus forte, la plus généreuse, la plus belle de toutes les vertus, c’est la vaillance), cette occupation est également noble par ce qui en est le mobile, rien n’étant en effet plus utile, plus juste, s’étendant davantage à tout, que la protection du repos et de la grandeur de son pays. On se complaît dans la compagnie de tant de gens nobles, jeunes, actifs, dans ces spectacles répétés de tant de situations tragiques, cette liberté de rapports dépouillés d’artifice, ce genre de vie mâle et sans cérémonie; dans cette variété de mille actions diverses, ces accents généreux de musique guerrière qui vous soutiennent, vous échauffent les oreilles et surexcitent l’âme; dans l’honneur que cela vous procure, et jusque dans les difficultés et les moments pénibles qui s’y rencontrent et dont Platon 665 tient si peu de compte que, dans sa République, il y fait participer les femmes et les enfants. Ce métier, volontairement embrassé, vous met à même de remplir des tâches et de courir tels risques que vous le jugez bon, suivant leur importance et l’éclat qui doit vous en revenir; et si même vous venez à succomber pour la cause à laquelle vous vous êtes consacré, voyez combien «il est beau de mourir les armes à la main (Virgile)». Craindre les périls communs auxquels tant de gens sont exposés, ne pas oser ce que tant d’âmes de toutes natures et le peuple entier osent, c’est le propre d’un cœur lâche et bas au delà de toute mesure; se trouver en compagnie rassure même les enfants. D’autres peuvent vous surpasser en science, en grâce, en force, en fortune, cela tient à des causes étrangères auxquelles vous pouvez vous en prendre; mais vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous, si vous vous montrez d’une fermeté d’âme inférieure à la leur. La mort est plus abjecte, plus languissante, plus pénible dans un lit que dans un combat; la fièvre et les catarrhes sont aussi douloureux et mortels qu’un coup de feu. Celui qui est fait à supporter vaillamment les accidents de la vie ordinaire, n’a point à grandir son courage pour se faire soldat: «Vivre, mon cher Lucilius, c’est combattre (Sénèque).»
Montaigne était d’excellente constitution; chez lui les maux du corps n’avaient que peu de prise sur l’âme.—Je ne me souviens pas d’avoir jamais eu la gale. Se gratter est une des satisfactions les plus douces que l’on puisse éprouver et qui est toujours à votre portée, mais ce qui s’ensuit est par trop importun; c’est surtout à mes oreilles que je m’en prends, les ayant sujettes par moment à des démangeaisons.
Je suis né avec tous mes sens bien entiers, atteignant presque à la perfection. Mon estomac est facile et bon, ma tête solide et, le plus souvent, l’un et l’autre demeurent tels quand j’ai la fièvre; j’ai de même l’haleine bonne. J’ai dépassé l’âge auquel chez certains peuples, et non sans quelque raison, il était tellement admis que la vie devait prendre fin après une durée déterminée, qu’ils n’admettaient pas que ce terme fût dépassé; même maintenant, j’ai encore des moments, bien que courts et irréguliers, où je suis tellement en pleine possession de moi-même, que c’est presque la santé et le bien-être de ma jeunesse. Il n’est question ici, bien entendu, ni de vigueur, ni de jouissances intimes; il n’y a pas de raison pour qu’elles se soient maintenues chez moi au delà des limites qui leur sont propres, et «mes forces ne me permettent plus de braver les intempéries du ciel à la porte d’une maîtresse (Horace)».—Mon visage et mes yeux décèlent immédiatement ce qui se passe en moi, c’est par là que commencent tous les changements que j’éprouve; ils s’y manifestent même plus violents qu’ils ne sont, et souvent je fais pitié à mes amis avant d’en ressentir la cause. Mon miroir ne me surprend pas quand il me met à même de constater de semblables transformations; car, même dans ma jeunesse, il m’est 667 arrivé plus d’une fois d’avoir un teint, une mine défaite de mauvais augure, sans que rien d’extraordinaire me fût survenu, si bien que les médecins ne trouvant quoi que ce soit qui justifiât cette altération de ma figure, l’attribuaient à l’état de mon esprit en butte à quelque passion qui me rongeait intérieurement; ce en quoi ils se trompaient. Si mon corps se comportait aussi à mon gré que mon âme, nous marcherions un peu plus à notre aise; j’avais alors celle-ci, non seulement exempte de trouble, mais encore pleine de satisfaction et en fête, ce qui est mon cas le plus ordinaire tant par nature que de parti pris. «Jamais les troubles de mon âme n’ont influé sur mon corps (Ovide)»; je tiens, au contraire, que maintes fois, par son influence salutaire, elle l’a relevé de ses chutes; lui, est souvent abattu, au lieu qu’elle, lorsqu’elle n’est pas enjouée, est du moins tranquille et reposée. J’ai eu la fièvre intermittente pendant quatre ou cinq mois; elle m’avait complètement altéré la physionomie; aussi longtemps qu’elle a duré, mon esprit a conservé non seulement tout son calme, mais même toute sa gaîté. Quand je n’éprouve pas de douleurs, l’affaiblissement et la langueur que je ressens, ne m’attristent guère. Que de défaillances physiques je connais, dont le nom seul me fait horreur et que je redouterais moins que les mille passions qui agitent l’esprit et auxquelles je vois des gens être en proie! J’ai pris le parti de ne plus courir, j’ai déjà assez de me traîner, mais je ne me plains pas de ma décadence qui est dans l’ordre naturel des choses: «Qui s’étonne de trouver des goîtres dans les Alpes (Juvénal)?» Je ne regrette pas davantage de ne pas devoir durer autant et sans plus de décrépitude qu’un chêne.
Ses préoccupations n’ont pas souvent troublé son sommeil et ses songes étaient rarement tristes.—Je n’ai pas à me plaindre de mon imagination; j’ai eu dans ma vie peu de préoccupations qui aient seulement interrompu mon sommeil, et, sauf quand cela répondait à mon désir, j’étais toujours contrarié lorsqu’elles m’éveillaient.—J’ai rarement des songes; quand j’en ai, je rêve de choses fantastiques et chimériques, produites d’ordinaire par des pensées plaisantes, plutôt ridicules que tristes. Je tiens pour vrai que nos songes sont les loyaux interprètes des dispositions dans lesquelles nous sommes; mais il faut un certain art pour en saisir la relation et les comprendre: «Il n’est pas surprenant en effet que les hommes retrouvent en songe les choses qui les occupent dans la vie, qu’ils méditent, qu’ils voient, qu’ils font lorsqu’ils sont éveillés (Attius).» Platon va plus loin et dit qu’il rentre dans les services que la prudence doit nous rendre, de tirer des songes des indications qui nous révèlent l’avenir; je ne vois rien à l’appui de cette thèse, si ce n’est les merveilleux exemples que nous en citent Socrate, Xénophon, Aristote, tous personnages dont l’autorité est irréprochable. Les historiens disent que les Atlantes n’ont jamais de songes et aussi qu’ils ne mangent rien qui ait eu vie; j’associe ces deux choses, parce que la seconde donne peut-être 669 la cause de la première; Pythagore ne recommande-t-il pas de se nourrir d’une façon particulière, quand on veut avoir des songes conformes à ce que l’on souhaite? Ceux que j’ai sont bénins, ils ne m’agitent pas et, sous leur action, aucune parole ne m’échappe. J’ai vu, de mon temps, certaines personnes en être extraordinairement agitées; Théon le philosophe rêvait en se promenant tout endormi, et le valet de Périclès en faisait autant sur les toits et le faîte même de sa maison.
Il était peu délicat sous le rapport de la nourriture; la délicatesse est du reste le fait de quiconque affecte une préférence trop marquée pour quoi que ce soit.—A table, je n’ai guère de préférence; je prends le premier mets venu, celui qui est le plus à ma portée, et n’aime pas à passer d’un goût à un autre. La multiplicité des plats et des services me déplaît autant que tout autre excès en n’importe quoi. Je me contente facilement d’un petit nombre de mets, et ne partage pas l’opinion de Favorinus qui veut que, dans un festin, on vous retire un plat avant que vous n’en ayez pleinement satisfait votre estomac pour vous en substituer toujours un nouveau, tient pour misérable un souper où on n’a pas servi à satiété aux convives des croupions d’oiseaux d’espèces diverses, et estime que seul le becfigue vaut d’être mangé tout entier.—Quand je suis en famille, je mange beaucoup de viandes salées; par contre, je préfère le pain qui n’a pas de sel et, chez moi, mon boulanger n’en fournit pas d’autre pour ma table, bien que ce ne soit pas l’usage du pays.—Dans mon enfance, on a eu surtout à me corriger du refus que je faisais de choses que généralement on aime beaucoup à cet âge: les sucreries, les confitures, les pâtisseries cuites au four. Mon gouverneur combattit en moi cette répulsion pour ces mets délicats, comme une sorte de délicatesse outrée; et, de fait, elle ne témoigne autre chose qu’un goût difficile, quel que soit ce à quoi cela s’applique. Qui fait passer à un enfant d’aimer d’une façon trop particulière et exclusive le pain bis, le lard ou l’ail, combat également chez lui un penchant à la friandise. Il est des gens qui, lorsqu’on leur sert des perdrix, semblent prendre beaucoup sur eux et faire acte de résignation, regrettant le bœuf et le jambon; ils l’ont belle, c’est de la délicatesse au premier chef, c’est un goût qui marque, chez un favorisé de la fortune, une lassitude qui fait que les choses ordinaires et habituelles ont seules du piquant: «C’est le luxe qui voudrait échapper à l’ennui des richesses (Sénèque).» Renoncer à faire bonne chère avec ce qu’un autre considère comme tel, apporter une attention particulière à sa table, «ne pas savoir te contenter d’un plat de légumes pour ton dîner (Horace)», est le caractère essentiel de ce vice. Il y a bien là, à la vérité, une différence avec le cas que je cite; si on a des besoins impérieux, il vaut évidemment mieux que ce soit pour des choses faciles à se procurer, mais c’est toujours un défaut que d’avoir des manies quelles qu’elles soient. Jadis, je considérais comme fort délicat un de mes parents 671 qui, par suite d’un long temps passé à naviguer, avait désappris à se servir de lit et à se déshabiller pour se coucher.
Dès le berceau, il a été habitué à vivre comme les gens de la plus basse classe et à se mêler à eux; cette fréquentation l’a rendu sympathique au sort des malheureux.—Si j’avais des enfants mâles, je leur aurais volontiers désiré la bonne fortune que j’ai eue. L’excellent père que Dieu m’a donné, pour lequel je n’ai rien pu faire que de lui vouer une reconnaissance, bien vive il est vrai, pour sa bonté à mon égard, me fit élever, dès le berceau, dans un pauvre village qui lui appartenait et où il me laissa tant que je fus en nourrice et encore au delà, me dressant à vivre dans les conditions de la plus basse classe: «C’est un grand pas fait vers la liberté, que de savoir régler son estomac (Sénèque).» Ne vous chargez jamais, et chargez encore moins vos femmes, de l’élevage de vos enfants; laissez à la fortune le soin de les former comme s’élèvent les enfants du peuple, en n’écoutant que les lois de la nature; laissez-les, en suivant les usages, s’habituer ainsi à la frugalité et à l’austérité; qu’ils soient dans l’avenir plutôt dans le cas de voir leurs privations s’adoucir, que s’aggraver. L’idée de mon père tendait à autre chose encore, c’était à m’unir au peuple, à ces hommes qui ont besoin de notre aide; il voulait que je fusse porté à regarder plutôt du côté de ceux qui me tendent les bras, que de ceux qui me tournent le dos; ce fut pour cette même raison qu’il me fit tenir sur les fonts baptismaux par des personnes de condition très inférieure, pour me créer ainsi des obligations vis-à-vis d’elles et faire que je m’y attache.
Son dessein n’a pas mal réussi; je m’occupe volontiers des petits, soit parce qu’il y a à cela plus de gloire, soit par un sentiment naturel de compassion, vertu qui a une grande action sur moi. Le parti que dans nos guerres civiles je reprouve, je le condamnerais bien plus sévèrement s’il était florissant et prospère; tandis qu’au contraire, je me montrerais mieux disposé pour lui, si je le voyais malheureux et écrasé.—Combien j’ai de considération pour le beau caractère de Chélonis, cette fille et femme des rois de Sparte! Quand, dans les désordres de la ville, Cléombrote son mari se trouva l’emporter sur Léonidas son père, en excellente fille elle accompagna celui-ci en exil, embrassant contre le vainqueur la cause de celui tombé dans le malheur. Lorsque la chance vint à tourner, elle changea de parti comme avait fait la fortune et prit courageusement celui de son mari qu’elle suivit partout où son infortune lui fit porter ses pas, n’ayant, ce semble, d’autre préférence que de se ranger du côté où elle faisait le plus besoin et où sa pitié trouvait le plus à s’exercer.—Je serais davantage porté à imiter l’exemple de Flaminius qui s’employait beaucoup plus pour ceux qui avaient besoin de lui que pour ceux en situation de lui venir en aide, qu’à faire comme Pyrrhus qui s’humiliait devant les grands et se montrait orgueilleux vis-à-vis des petits.
673
Il n’aimait pas à rester longtemps à table; les anciens Grecs et Romains entendaient beaucoup mieux que nous cette jouissance.—Demeurer longtemps à table m’ennuie et m’est mauvais parce que, je mange tant que j’y suis, probablement par habitude, ce moyen étant le seul qui, lorsque j’étais enfant, me permettait d’y faire bonne contenance. C’est pourquoi, chez moi, bien qu’on s’y attarde peu, j’y prends place d’ordinaire un peu après les autres, comme faisait Auguste; mais je cesse de faire comme lui, en ce que souvent aussi il en quittait avant eux, tandis qu’après j’aime, au contraire, à me livrer assez longuement au repos et à entendre causer, pourvu que je n’y prenne pas part: parler l’estomac plein me fatiguant et me faisant mal, autant que crier et discuter avant le repas m’est un exercice salutaire et agréable.
Les Grecs et les Romains des temps anciens agissaient plus raisonnablement que nous, en consacrant, quand aucune autre occupation extraordinaire ne les en empêchait, plusieurs heures et la majeure partie de la nuit aux repas, qui sont du nombre des principaux actes de la vie, mangeant et buvant avec moins de hâte que nous dont toutes les actions sont accomplies précipitamment; ils se livraient à ce plaisir naturel tout à loisir et l’utilisaient mieux que nous, l’entremêlant d’intermèdes de divers genres utiles et agréables.
Indifférent à ce qu’on lui servait, il se laissait aller à manger de tout ce qui paraissait sur la table.—Ceux qui, à table, ont à prendre soin de moi, peuvent aisément m’empêcher de manger ce qu’ils estiment m’être nuisible; car, en fait de mets, je ne désire jamais ce que je ne vois pas et ne trouve jamais à y redire. Par contre, ils perdent leur temps à me prêcher de m’abstenir de ceux qui sont servis; c’est au point que lorsque je veux jeûner, il faut que je mange à part de ceux qui soupent et qu’on ne me présente que ce que comporte bien exactement une collation en règle, parce que si je me mets à table, j’oublie ma résolution. Quand je demande qu’on change la manière dont certaines viandes sont apprêtées, mes gens savent que c’est signe que je n’ai pas grand appétit et que je n’y toucherai pas.—Toutes celles qui peuvent être mangées telles, je les aime peu cuites et avancées, au point même, pour certaines, que leur odeur s’en trouve altérée. Je ne suis contrarié que lorsqu’elles sont dures; pour le reste, elles peuvent être n’importe comment, ce m’est aussi indifférent et me touche aussi peu que possible; si bien, qu’à l’inverse de ce qu’on éprouve généralement, il m’arrive de trouver même le poisson trop frais et trop ferme. Ce n’est pas parce que j’ai de mauvaises dents, je les ai toujours eues aussi bonnes qu’il se peut, et ce n’est que maintenant que l’âge commence à les menacer; dès l’enfance, j’ai pris l’habitude de me les frotter avec une serviette le matin et au commencement et à la fin de chaque repas.
C’est une grâce que Dieu nous fait quand la mort nous gagne peu à peu, ce qui est l’effet de la vieillesse; du reste, 675 indissolublement liée à la vie, on en constate en nous la présence et les progrès durant tout le cours de notre existence.—A ceux que Dieu soustrait à la vie par parcelle, c’est une grâce qu’il leur fait, c’est le seul avantage de la vieillesse; notre dernière mort en sera d’autant moins étendue et nuisible, ne tuant plus en nous que la moitié ou le quart d’un homme. Voilà une de mes dents qui vient de tomber sans douleur, sans effort, elle était arrivée au terme de sa durée; cette partie de mon être et plusieurs autres sont déjà mortes; d’autres, d’entre les plus actives et qui tenaient le premier rang quand j’étais dans la force de l’âge, le sont à moitié. C’est ainsi que je fonds et échappe à moi-même. Quelle bêtise ce serait de la part de mon entendement, de s’affecter, au même degré, du saut final de cette chute déjà si prononcée, que si je m’effondrais tout d’une pièce; j’espère qu’il ne la commettra pas.—A la vérité, j’éprouve une grande consolation, quand je pense à ma mort, de m’imaginer qu’elle sera de celles qui s’accomplissent dans des conditions justes et naturelles, et que ce que désormais je puis demander à cet égard à la destinée, ne peut plus être qu’une faveur que je ne saurais revendiquer comme un droit. Les hommes sont portés à croire qu’autrefois, comme leur taille, la durée de leur existence était plus grande; ils se trompent, car Solon, qui vivait en ces temps reculés, indique soixante-dix ans comme en étant la limite extrême. Moi, qui ai tant adoré, et en toutes choses, cette «excellente médiocrité» des temps passés, et qui ai tant considéré une juste moyenne comme la perfection, puis-je prétendre à une vieillesse démesurée et extraordinaire? Tout ce qui nous arrive contre l’ordre habituel de la nature peut être fâcheux, mais nous devons toujours faire bon accueil à ce qui est conforme à ses lois: «Tout ce qui se fait naturellement, doit être tenu pour bon (Cicéron).» C’est ainsi, dit Platon, que la mort due à des plaies ou à des maladies, est mort violente; tandis que celle qui nous surprend, occasionnée par la vieillesse, est de toutes la plus légère et empreinte même de douceur: «Les jeunes gens meurent de mort violente, les vieillards de maturité (Cicéron).»—Partout et en tout, la mort se mêle et se confond avec la vie; le déclin de celle-ci fait songer à l’heure où viendra celle-là, son action s’accentue à mesure que nous approchons du terme fatal. J’ai des portraits qui me représentent à l’âge de vingt-cinq ans et de trente-cinq; il m’arrive de les comparer à celui d’aujourd’hui; combien il s’en faut que ce soit encore moi! ma physionomie actuelle diffère bien plus des précédentes, que de celle que j’aurai quand je viendrai à trépasser.—C’est par trop abuser de la nature, que de la tracasser si longtemps à l’avance par des soins qui l’obligent à nous quitter; elle finit par se lasser de nous suivre, en nous voyant abandonner la direction de nous-mêmes, nos yeux, nos dents, nos jambes et tout le reste à la merci de soins étrangers que nous mendions, et nous en remettre entièrement aux mains de l’art.
677
Montaigne n’a jamais acquis la certitude que certains mets lui fussent nuisibles, mais ses goûts ont subi des changements et des revirements.—Je ne suis très amateur ni de salades, ni de fruits, sauf de melons. Mon père n’aimait aucune sauce, je les aime toutes. Trop manger me gêne; mais je ne suis pas encore certain qu’il y ait des viandes qui, par leur nature même, me soient nuisibles, pas plus que je ne constate que la lune, quand elle est pleine ou nouvelle, le printemps ou l’automne aient action sur moi. Il se produit en nous des effets qui ont lieu à des moments indéterminés et dont nous ne nous rendons pas compte; ainsi les raiforts par exemple: longtemps je n’en ai pas été incommodé, puis je m’en suis mal trouvé; à présent, je m’en accommode à nouveau très bien. Pour plusieurs choses, je sens mon estomac et mon appétit aller ainsi se modifiant; du vin blanc je suis passé au vin clairet, et du vin clairet me voici revenu au vin blanc.
Je suis friand de poisson, et les jours maigres sont pour moi des jours où je me régale, comme me sont fêtes aussi les jours de jeûne; je crois (il en est qui le disent) qu’il est de plus facile digestion que la viande. Je me fais conscience de manger de celle-ci, les jours où le poisson est d’obligation; mon goût est de même et se fait scrupule de mêler l’un à l’autre, il y a entre eux, ce me semble, une trop grande différence.
Circonstances dans lesquelles il lui est arrivé parfois de ne pas prendre de repas; tout régime trop longtemps suivi cesse d’être efficace.—Dans ma jeunesse, il m’est arrivé de me passer parfois de quelque repas pour avoir meilleur appétit le lendemain et, de la sorte, accroître mon plaisir en me disposant à mieux profiter et à jouir plus vivement de l’abondance que je prévoyais, agissant en cela au rebours d’Épicure qui jeûnait et faisait maigre pour accoutumer sa volupté à se passer de l’abondance; ou bien je jeûnais pour me conserver dispos en vue d’un travail quelconque de corps ou d’esprit, l’un comme l’autre devenant honteusement paresseux chez moi quand je suis surchargé d’aliments; d’autant que je déteste ce fonctionnement simultané si peu raisonnable de l’imagination, cette déesse si saine et si alerte, et de l’estomac, ce petit dieu alourdi et bruyant quand il est gonflé des émanations des sucs qu’il procrée. Je m’en abstenais encore, quand j’avais cet organe fatigué, ou enfin lorsque je n’avais pour me tenir compagnie personne qui me convint, car je dis avec ce même Épicure, qu’il ne faut pas tant regarder ce qu’on mange, qu’avec qui on mange; et je loue Chilon de n’avoir pas voulu s’engager à se trouver à un festin auquel le conviait Périandre, avant de connaître quels étaient les autres convives; il ne saurait en effet y avoir pour moi de plus grand attrait, de sauce si appétissante, qui vaillent ceux résultant de la société avec laquelle on s’y rencontre.—Je crois qu’il est plus sain de manger doucement, moins à la fois et plus souvent; mais je tiens à satisfaire pleinement mon appétit et ma faim, et ne prendrais pas goût à me condamner 679 à faire par jour, comme on l’ordonne aux malades, trois ou quatre chétifs repas où je serais rationné; et puis, qui peut me donner l’assurance que les bonnes dispositions dans lesquelles je suis ce matin, je les retrouverai encore à souper? Profitons, nous surtout qui sommes vieux, du premier moment favorable qui vient; laissons aux faiseurs d’almanachs les espérances et les pronostics. Le fruit essentiel que je retire de la santé, ce sont les jouissances qu’elle nous permet; tenons-nous-en à la première qui se présente, que nous avons sous la main et que nous connaissons. J’évite de m’astreindre trop longtemps à un même régime; celui qui en suit un et veut qu’il lui profite, ne doit pas le prolonger indéfiniment; sans cela, nous nous y endurcissons, notre organisme y perd de son activité; six mois après, l’estomac y est si bien acoquiné que tout l’avantage que vous en retirez est d’avoir perdu la liberté de faire autrement sans en éprouver d’inconvénients.
Il ne sert de rien non plus de se trop couvrir; on s’y habitue et cela n’a plus d’effet.—Je porte de simples bas de soie, et pas plus en hiver qu’en été je n’ai les jambes et les cuisses autrement couvertes. En raison de mes rhumes, je me suis laissé aller à me tenir la tête plus chaude, ainsi que le ventre à cause de mes coliques; en peu de jours, ces deux maux s’y sont habitués et ont dédaigné mes précautions ordinaires; une simple coiffe avait fait place à un capuchon; un bonnet, à un chapeau doublé; aujourd’hui, les fourrures de mon pourpoint ne me servent plus que d’enjolivement; et tout cela ne me fait plus aucun effet, si je n’y ajoute une peau de lièvre ou de vautour, et sur ma tête une calotte. Suivez une semblable gradation, cela vous mènera loin; aussi n’en ferai-je rien, et volontiers, si j’osais, je reviendrais sur ce que j’ai déjà commencé. Avec cette mode, vous survient-il quelque nouvel inconvénient, les réformes que vous avez déjà introduites ne vous sont plus d’aucune utilité: vous vous y êtes habitué, il vous faut en chercher d’autres. Ainsi se ruinent ceux qui se laissent empêtrer dans des régimes particuliers, auxquels ils s’astreignent superstitieusement; ce qu’on fait ne suffit pas, il faut plus encore; et après, encore davantage; on n’en a jamais fini.
Nos occupations et nos plaisirs nous portent à donner plus d’importance au souper qu’au dîner; l’estomac, d’après Montaigne, s’accommode mieux du contraire.—Pour mes occupations et notre plaisir, il est beaucoup plus commode de supprimer le dîner, comme faisaient les anciens, et de remettre à faire un repas copieux à l’heure où on se retire chez soi pour y prendre du repos, et ainsi ne pas interrompre la journée; c’est ce que je faisais autrefois. Au point de vue de la santé, l’expérience m’a depuis enseigné qu’au contraire il vaut mieux maintenir le dîner, la digestion se faisant mieux quand on est éveillé.—Je ne suis guère sujet à être altéré, pas plus quand je me porte bien que lorsque je suis malade; dans ce dernier cas, j’ai assez fréquemment la bouche sèche, mais ce n’est pas de la soif, et d’ordinaire je ne 681 bois que lorsque, en mangeant, l’envie m’en vient, généralement quand déjà le repas est bien avancé. Je bois assez copieusement pour un homme qui ne présente rien de particulier; en été, dans un repas auquel j’assiste avec appétit, non seulement j’outrepasse les limites dans lesquelles se tenait Auguste qui ne buvait jamais que trois fois, mais pour ne pas aller à l’encontre de la règle posée par Démocrite qui défendait de s’arrêter à quatre, comme nombre portant malchance, je me laisse aller jusqu’à cinq si besoin est, ce qui fait environ trois demi-setiers, car je me plais à faire usage de verres de petite capacité et les vide chaque fois, ce que d’autres se gardent de faire comme contraire aux convenances. Je trempe mon vin, le plus souvent avec moitié, parfois avec un tiers d’eau; et quand je suis chez moi, par suite d’une ancienne habitude prise sur le conseil donné à mon père par son médecin, qui lui aussi agissait de même, le mélange s’opère à l’office, deux ou trois heures avant qu’on le serve. On dit que cet usage de tremper le vin avec de l’eau, remonte à Cranaüs, roi d’Athènes; pour ce qui est de son utilité, je l’ai entendu discuter. J’estime plus convenable et meilleur pour la santé, de n’en user pour les enfants qu’après seize ou dix-huit ans et, jusque-là, de ne leur faire boire que de l’eau. La manière de vivre la plus usitée et communément suivie, est celle qui est préférable; toute singularité me semble à éviter, et j’aime aussi peu voir un Allemand mettre de l’eau dans son vin, qu’un Français qui le boirait pur; l’usage, auquel tout le monde se conforme, fait loi dans les choses de cette espèce.
Il n’aimait pas l’air confiné; était plus sensible au chaud qu’au froid; avait bonne vue, mais elle se fatiguait aisément; il était d’allure vive; à table, il mangeait avec trop d’avidité.—Je crains un air lourd à respirer et ne puis supporter la fumée; la première réparation que je me hâtai de faire exécuter chez moi, fut celle des cheminées et des cabinets d’aisance qui, chose insupportable, laissent communément à désirer dans les bâtiments d’ancienne construction; et au rang des incommodités que l’on rencontre à la guerre, je place ces épais nuages de poussière dans lesquels, pendant la chaleur, il faut demeurer des journées entières. J’ai la respiration libre et facile; le plus souvent, quand j’ai des refroidissements, mes poumons demeurent indemnes et je n’ai pas de toux.
Un été pénible m’est plus contraire que l’hiver, parce qu’outre l’incommodité de la chaleur dont on peut moins se défendre que du froid, et en dehors de l’action des rayons de soleil sur la tête, mes yeux supportent mal leur éclat éblouissant; actuellement, je ne pourrais même pas dîner, assis devant un feu ardent dont je recevrais la réverbération.
Quand je lisais plus que je ne le fais maintenant, pour amortir la blancheur du papier, je couvrais mon livre d’une feuille de verre et ma vue s’en trouvait fort soulagée. Jusqu’à présent, je n’emploie pas de lunettes et j’y vois aussi loin que jamais et que n’importe 683 qui; il est vrai que lorsque le jour tombe, je commence, quand je lis, à éprouver du trouble et de la faiblesse; mais tout travail, particulièrement la nuit, m’a toujours fatigué les yeux. C’est là un pas en arrière à peine sensible, auquel viendra s’en ajouter un second, à celui-ci un troisième, puis à ce dernier un quatrième; reculant ainsi de plus en plus chaque fois, je finirai par insensiblement être devenu complètement aveugle, avant que je ne m’aperçoive de la décadence et de la vieillesse de ma vue, tant les Parques apportent d’artifice à détordre l’écheveau de notre vie. De même, je ne suis pas bien certain que mon ouïe n’ait pas tendance à devenir dure; et vous verrez que je l’aurai à moitié perdue, que je m’en prendrai encore à la voix de ceux qui me parlent. Il faut exercer une action bien forte et bien continue sur l’âme, pour l’amener à sentir comme elle s’en va peu à peu.
Ma marche est vive et assurée, et je ne sais lequel des deux, de mon esprit ou de mon corps, je puis le plus difficilement arrêter en un point donné. Il faut qu’un prédicateur soit bien de mes amis, pour captiver mon attention pendant toute la durée d’un sermon. Dans les cérémonies, où chacun est si guindé dans son attitude, où j’ai vu des dames ne laissant même pas errer leurs regards, je ne suis jamais venu à bout de faire que quelque chose en moi ne battît la campagne; j’ai beau être assis, je n’en demeure pas plus calme. La servante de Chrysippe le philosophe disait de son maître, quand il buvait en compagnie de gens sur lesquels le vin agissait, et que seul il n’en ressentait aucun effet, qu’il n’était ivre que des jambes que, par habitude, il remuait sans cesse en quelque position qu’il fût. On a pu dire de même de moi dès mon enfance, que j’avais du vif-argent dans les pieds ou qu’ils étaient atteints de folie, tant je suis porté naturellement à me remuer et à me déplacer n’importe où je me trouve.
Je mange avec voracité, ce qui est indécent et de plus nuisible à la santé, voire même au plaisir que l’on éprouve en mangeant; dans ma hâte, je me mords souvent la langue et parfois les doigts. Diogène, rencontrant un enfant qui mangeait ainsi, donna un soufflet à son précepteur. Il y avait à Rome des gens qui enseignaient à mâcher comme on vous apprend à marcher, avec grâce. Je ne prends pas le temps de causer, ce qui est un si doux assaisonnement des repas, quand les propos qui s’y tiennent sont à l’avenant, agréables et ne se prolongeant pas.
Conditions pour un bon repas; il est des gens qui dédaignent ce genre de plaisir, ce dédain est le fait d’un esprit maladif et chagrin.—Nos plaisirs se jalousent et s’envient les uns les autres; ils se heurtent et se contrarient réciproquement. Alcibiade, qui s’entendait fort à faire bonne chère, allait jusqu’à bannir la musique des repas, afin qu’elle ne troublât pas la douceur des conversations, ajoutant, d’après ce que Platon nous rapporte, qu’«appeler des musiciens et des chanteurs dans les festins, est un usage de gens communs qui sont hors d’état de 685 causer et de s’entretenir entre eux d’une façon utile et agréable, alors que les gens intelligents savent si agréablement le faire». Varron veut pour un bon repas «des convives de mine avenante, de conversation agréable, qui ne soient ni muets, ni bavards; des mets délicats et proprement servis, un local approprié et aussi un beau temps». C’est une fête qui ne demande pas peu d’apprêts et qui ne cause pas un médiocre plaisir qu’une bonne table bien préparée; ni les grands chefs militaires, ni les philosophes les plus renommés n’en ont dédaigné ni l’usage ni la science. Ma mémoire garde le souvenir de trois repas de ce genre, qui me furent souverainement agréables, dont la fortune m’a gratifié à diverses époques de ma vie, alors qu’elle était dans tout son épanouissement; désormais, ces fêtes me sont interdites par mon état de santé, car chacun en est pour soi-même le principal charme et en goûte les attraits suivant les bonnes dispositions de corps et d’esprit dans lesquelles il se trouve.—Moi, qui ne vais toujours que terre à terre, je n’aime pas cette sagesse, contraire à la nature de l’homme, qui voudrait nous rendre dédaigneux et ennemis des attentions que nous pouvons avoir pour le corps; j’estime qu’il est aussi injuste de repousser les plaisirs que nous offre la nature, que de s’y trop attacher. Xerxès, pouvant se donner toutes les voluptés humaines, était un sot de proposer un prix à qui lui en trouverait d’autres; mais celui-là ne l’est guère moins qui se prive de celles que la nature nous procure. Il ne faut ni les poursuivre, ni les fuir; il faut les accepter. Je les prise un peu plus, et leur fais un plus gracieux accueil que par le passé, m’abandonnant plus volontiers maintenant à ce penchant naturel. Il ne nous sert de rien d’exagérer leur inanité, elle apparaît et se fait assez sentir d’elle-même. Grand merci à notre esprit maladif et chagrin de nous dégoûter d’elles, comme il l’est de lui-même; il se comporte et traite tout ce qu’il reçoit, tantôt d’une façon, tantôt d’une façon contraire, selon son tempérament insatiable, vagabond et versatile: «Dans un vase impur, tout ce que vous y versez, se corrompt (Horace).» Appliqué à scruter attentivement et à un point de vue tout particulier les avantages que nous offre la vie, quand j’y regarde d’un peu près, je n’y trouve guère que du vent. Quoi d’étonnant? tout en nous est-il autre chose que du vent? et encore, plus sagement que nous, le vent se plaît à bruire, à s’agiter, à se contenter de ce qui lui est propre, sans désirer la stabilité, la solidité qui ne sont pas du nombre des propriétés qu’il possède.
Les plaisirs de l’âme sont peut-être supérieurs à ceux du corps; les plus appréciables sont ceux auxquels l’une et l’autre participent simultanément.—Les plaisirs qui sont le fait exclusif de notre imagination, comme du reste les déplaisirs qui ont même origine, l’emportent sur les autres, au dire de certains et comme le marquait la balance de Critolaüs. Ce n’est pas extraordinaire: notre esprit les forge à sa fantaisie et sans que rien l’entrave; j’en vois tous les jours des exemples remarquables et probablement fort désirables. Mais, porté pour ceux qui participent 687 de notre imagination et de la réalité, et étant de goût peu raffiné, je ne puis mordre si pleinement à ces seules conceptions imaginaires et me laisse tout lourdement aller aux plaisirs qui sont dans la loi générale qui régit l’humanité et que notre corps et notre esprit ressentent à la fois.—Les philosophes de l’école cyrénaïque veulent qu’à l’instar de ce qui se produit pour la douleur, les plaisirs qui intéressent le corps aient sur nous plus d’action, parce que l’âme n’y demeure pas étrangère: c’est justice. Il est des gens, dit Aristote, d’une stupidité farouche, qui en sont dégoûtés; j’en connais d’autres qui, par ambition, font comme s’ils l’étaient. Que ne renoncent-ils aussi à respirer? que ne vivent-ils d’eux-mêmes et ne refusent-ils la lumière, parce qu’elle leur est donnée gratuitement et ne leur coûte ni peine, ni frais d’invention? Je voudrais voir Mars, Pallas ou Mercure pourvoir à leur existence, au lieu que ce soit Vénus, Cérès et Bacchus. Chercheront-ils la quadrature du cercle, tout en étant juchés sur leurs femmes? Je n’aime pas qu’on nous ordonne d’avoir l’esprit dans les nuages, quand nous avons le corps à table; je ne veux pas que l’esprit s’y cloue et s’y vautre, je veux qu’il y participe, qu’il s’y asseie et non qu’il s’y couche. Aristippe soutenait les droits du corps, comme si nous n’avions pas d’âme; Zénon ne considérait que l’âme, comme si nous n’avions pas de corps: tous deux étaient dans l’erreur. La philosophie de Pythagore était, dit-on, toute contemplative; celle de Socrate a uniquement pour objet les mœurs et les actes, et Platon tient le milieu entre les deux; ceux qui parlent ainsi, nous en content. La mesure exacte nous a été donnée par Socrate; Platon penche * bien plus de son côté que de celui de Pythagore et cela lui convient bien mieux. Quand je danse, je suis tout à la danse; quand je dors, tout au sommeil; et même, quand je me promène solitairement dans un beau verger, si mes pensées se sont un moment portées sur des choses étrangères qui viennent à se présenter à moi, je les ramène l’instant d’après à la promenade, au verger, à la douceur de la solitude et à moi-même.
Tout ce qui est de nécessité, la nature, en bonne mère, l’a rendu agréable, et le sage use des voluptés comme de toutes autres choses.—La nature, en bonne mère, a fait que les actions auxquelles elle nous incite pour nos besoins, nous avons également plaisir à les accomplir; elle nous y convie non seulement par la raison, mais encore par le désir qu’elle nous en suggère, et c’est un tort que d’aller à rencontre de ses règles. Quand je vois César, et aussi Alexandre, aux moments les plus ardus de leurs grands travaux, jouir si pleinement des plaisirs humains et corporels, je ne dis pas que ce soit là amollir l’âme; je dis que c’est la fortifier que de subordonner, grâce à la vigueur de leur courage, aux pratiques de la vie ordinaire leurs violentes occupations et leurs laborieuses pensées; et sages ils eussent été, s’ils avaient cru que celles-là constituaient la * partie normale de leur existence, tandis que celles-ci en étaient la phase extraordinaire!—Nous 689 sommes de grands fous. Nous disons: «Il a passé sa vie dans l’oisiveté;—Je n’ai rien fait aujourd’hui.» Eh quoi! n’avez-vous pas vécu? C’est là non seulement votre occupation essentielle, mais celle qui fait de vous quelqu’un. «Si on m’eût mis à même, dites-vous encore, de conduire de grandes affaires, j’aurais montré ce dont j’étais capable.» Avez-vous su méditer et diriger votre vie? Vous avez, dans ce cas, accompli la plus grande des besognes qui nous incombent. Pour se manifester et fructifier, la nature n’a que faire de la fortune; son action s’exerce à tous les degrés sociaux sans se révéler, comme aussi à découvert. Si vous avez su régler vos mœurs, vous avez fait bien plus que celui qui a composé des livres; en sachant prendre du repos, vous avez plus fait que celui qui a conquis des villes et des empires.
Le plus grand, le plus glorieux chef-d’œuvre de l’homme, c’est de vivre à propos, autrement dit de faire chaque chose en son temps; tout le reste: régner, thésauriser, bâtir, ne sont au plus qu’accessoires et menus détails. Je prends plaisir à voir un général d’armée, au pied d’une brèche à laquelle il va donner l’assaut, se dégager complètement de ses préoccupations et recouvrer sa liberté au dîner, pour deviser avec ses amis; à voir Brutus, ayant le ciel et la terre qui conspirent contre lui et la liberté romaine, dérober à la surveillance continue qu’il exerce sur ses troupes quelques heures de nuit pour, en toute tranquillité d’esprit, lire Polybe et y prendre des notes. C’est le fait des âmes sans envergure, écrasées par le poids des affaires, de ne pouvoir s’en affranchir et ne savoir ni les laisser ni les reprendre: «Braves compagnons qui avez souvent partagé avec moi les plus rudes épreuves, noyons aujourd’hui nos soucis dans le vin; demain, nous nous remettrons à parcourir les vastes mers (Horace).»
Que ce soit par plaisanterie, ou autrement, que l’on parle du vin théologal et scolastique passé en proverbe, et des agapes des adeptes de la Sorbonne, je trouve qu’ils ont bien raison de dîner d’autant plus confortablement et agréablement, qu’ils ont employé utilement et sérieusement la matinée aux exercices de leur école; la conscience d’avoir bien dépensé le reste de leur temps est un juste et savoureux condiment de celui qu’ils passent à table. C’est ainsi que vivaient les sages; et cette inimitable et continue propension à la vertu qui nous frappe d’étonnement chez les deux Caton, cette humeur sévère jusqu’à être importune, se sont sans difficulté soumises aux lois qui régissent la nature humaine, à celles de Vénus et de Bacchus comme aux autres, et ils se sont complu à les observer, obéissant en cela aux préceptes de la secte à laquelle ils appartenaient, qui voulaient que pour être parfait le sage soit expert et entendu dans l’usage des voluptés qui sont dans l’ordre naturel des choses, * comme en tout autre devoir de la vie: «Qu’il ait le palais délicat autant que le jugement (Cicéron).»
Les délassements siéent aux âmes fortes comme aux autres, ainsi que le montre l’exemple d’Épaminondas, de Scipion 691 et de Socrate.—Se détendre et se prêter aisément à la vie commune honore considérablement, ce me semble, une âme forte et généreuse et lui sied on ne peut mieux. Épaminondas se mêlant aux danses des jeunes gens de sa ville, chantant, faisant de la musique, y apportant toute son attention, n’estimait pas que ce fût déroger à l’honneur qu’il s’était acquis par ses glorieuses victoires et à l’extrême rectitude de mœurs qui était en lui.—Parmi tant de traits admirables de la vie du premier Scipion, si recommandable qu’on le jugeait digne de descendre des dieux, il n’en est aucun qui ajoute davantage à son charme que de se le représenter flânant sur le bord de la mer et y jouant comme un enfant, en compagnie de Lælius, à ramasser et collectionner des coquilles, ou courir l’un après l’autre à qui mieux mieux; et, lorsqu’il faisait mauvais temps, s’amusant et s’évertuant à écrire des comédies, où il retraçait les faits et gestes les plus ordinaires des basses classes; ou à se le figurer en Sicile, occupé qu’il était de ces merveilleuses opérations qu’il allait entreprendre en Afrique contre Annibal, visitant quand même les écoles et assistant aux leçons des philosophes, au point de fournir en cela des armes contre lui aux ennemis qu’il avait à Rome et qu’aveuglait l’envie qu’ils lui portaient. Y a-t-il quelque chose de plus remarquable chez Socrate que, vieux comme il l’était, il se soit mis à apprendre à danser, se soit fait enseigner la musique, et qu’il considérât comme bien employé le temps qu’il y passait? Nous le voyons à la fois demeurer en extase, debout, durant une journée entière et la nuit qui suivit, en présence de toute l’armée grecque, absorbé et ravi par quelque profonde pensée, et être le premier, parmi tant de vaillants que comprenait cette armée, à voler au secours d’Alcibiade que les ennemis accablaient, à le couvrir de son corps et, par la force des armes, le dégager de la foule; à la bataille de Délium, relever et sauver Xénophon renversé de cheval; être encore le premier de tout Athènes, indignée comme lui d’un spectacle si odieux, à s’interposer pour arracher Théramène aux satellites des trente tyrans qui le conduisent à la mort, et, bien que suivi uniquement de deux autres citoyens qu’a entraînés son exemple, n’y renoncer que sur les instances de Théramène lui-même. Recherché par une beauté dont lui aussi est épris, il ne se départ pas de la plus sévère abstinence. Continuellement à la guerre il va nu-pieds même sur la glace, porte le même vêtement hiver comme été, surpasse tous ses compagnons par sa patience à supporter les fatigues; lorsqu’il assiste à un festin, il ne mange pas autrement qu’à son ordinaire. Pendant vingt-sept ans, sans que jamais son visage accuse la moindre émotion, il endure la faim, la pauvreté, l’indocilité de ses enfants, les violences de sa femme, et finalement la calomnie, la tyrannie, la prison, les fers et le poison. Et cependant, si ce même homme, pour satisfaire à un devoir de politesse, avait à tenir tête à quelqu’un le verre en main, il était, de toute l’armée, celui qui s’en tirait le mieux; il ne refusait pas aux enfants de jouer aux noisettes, ni de courir avec eux sur un 693 cheval de bois, et cela il le faisait de bonne grâce, car, dit la philosophie, tout sied également bien au sage, et l’honore. De tels faits abondent dans la vie de Socrate; et qu’on considère sa doctrine ou ses actes, on ne saurait jamais s’empêcher de le reconnaître comme un modèle de perfection en tous genres. Il est peu d’exemples d’existence aussi remplie et aussi pure, et on fait tort à notre instruction en nous en proposant d’autres, comme cela arrive journellement, qui, faibles et défectueuses, sont à peine bonnes à envisager à un point de vue unique, et nous reportent quasiment en arrière, plus propres à corrompre qu’à corriger. Les bonnes gens du commun s’y trompent; il est bien plus facile, pour gagner un objectif à atteindre et ne point s’égarer, de prendre des biais habilement ménagés que de s’y porter naturellement, à découvert, par la grande voie y conduisant directement; mais aussi, c’est bien moins honorable et on n’y gagne pas en recommandation.
L’âme ne doit pas fuir les plaisirs que lui offre la nature, mais elle doit les goûter avec modération et montrer une égale fermeté dans la volupté comme dans la douleur.—La grandeur d’âme ne consiste pas tant à s’élever et aller de l’avant, qu’à savoir régler sa conduite et la circonscrire dans de justes limites; elle tient comme étant grand tout ce qui est suffisant, et témoigne de son élévation en préférant les choses moyennes à celles qui sont éminentes. Il n’est rien de si beau et de si légitime que de bien remplir son rôle d’homme dans toutes ses parties. Il n’est pas de science si ardue que de bien savoir vivre * naturellement cette vie; et de nos maladies la plus sauvage, c’est de mépriser l’existence.
Qui veut isoler son âme, le fasse hardiment s’il le peut, lorsque le corps se portera mal, afin de lui éviter la contagion. En dehors de cela, au contraire, que toujours elle l’assiste et le favorise, qu’elle ne lui refuse pas de participer à ses plaisirs naturels et de s’y complaire comme dans un bon ménage, y apportant, si elle est plus sage que lui, de la modération, de peur que l’abus ne fasse que le déplaisir s’y mêle. L’intempérance est la peste de la volupté; la tempérance n’en est pas le fléau, elle en est l’assaisonnement. Eudoxe, qui faisait de la volupté le souverain bien, et ses compagnons qui, avec lui, y attachaient un si haut prix, la savourèrent dans tout ce qu’elle a de plus doux, grâce à la tempérance qui chez eux fut tout particulièrement exemplaire.
Je commande à mon âme de considérer de même œil la douleur et la volupté: «La dilatation de l’âme dans la joie n’est pas moins anormale que sa contraction dans la douleur (Cicéron)», de les envisager avec la même fermeté: l’une gaiement, l’autre sévèrement, et, selon ce qu’elle peut, d’être aussi soigneuse de calmer l’une, que de ne point s’absorber dans l’autre. Apprécier sainement les biens qui nous échoient, a pour conséquence naturelle de juger sainement nos maux: la douleur, tout à ses débuts, a quelque chose qui ne se 695 peut éviter; la volupté, poussée à l’excès, quelque chose dont il faut se garder. Platon les met sur le même rang et veut que ce soit la tâche de la force d’âme de combattre les étreintes de la douleur, comme les attraits excessifs et enchanteurs de la volupté. Ce sont deux sources: bien heureux qui y puise où il convient, au moment opportun et dans la mesure du nécessaire, qu’il soit cité, homme ou bête. La première est à prendre comme une médecine, quand il y a nécessité et le moins possible; l’autre, quand on a soif, mais sans aller jusqu’à l’ivresse. La douleur, la volupté, l’amour, la haine sont les premières choses que ressent un enfant; que, lorsque la raison lui vient, elles se subordonnent à elle, c’est là ce qui constitue la vertu.
Pour lui, Montaigne, il n’a point hâte de voir passer le temps, et, quand il ne souffre pas, il le savoure, jouissant du calme qui s’est fait en lui, sans préoccupation de l’avenir, ce poison de l’existence humaine.—J’ai un vocabulaire à moi: je dis que je passe le temps, quand il m’est mauvais et incommode; lorsqu’il m’est bon, je ne veux pas le passer, je le savoure, je m’y arrête. Il est à franchir au plus vite, quand il nous est mauvais; à faire durer le plus qu’on peut, lorsqu’il nous est bon. Ces expressions banales: «passe-temps» et «passer le temps», peignent bien la manière d’en user de ces gens prudents qui ne pensent pas avoir meilleur emploi de la vie, que de la voir couler, s’échapper; de la passer en biaisant autant qu’il est en eux; de l’ignorer et la fuir comme une chose ennuyeuse et à dédaigner. Elle me fait un effet tout autre; je trouve qu’elle est commode et qu’elle a du prix, même quand elle est comme chez moi en sa décadence finale. La nature nous l’a mise en main, entourée de telles conditions favorables, que nous n’avons à nous en prendre qu’à nous si elle nous est à charge ou nous échappe sans avoir été employée utilement: «La vie de l’insensé est désagréable, inquiète; sans cesse elle n’a que l’avenir en vue (Sénèque).» Je me prépare pourtant à la perdre sans regret, mais parce que c’est dans l’ordre des choses, et non parce qu’elle est pénible et importune; du reste, il ne convient bien qu’à ceux-là seuls qui se plaisent dans la vie, de ne pas éprouver de déplaisir à la quitter. Il y a bénéfice à en jouir et j’en jouis deux fois autant que les autres, parce que la jouissance s’en mesure au plus ou moins d’application que nous y apportons. Surtout à cette heure, où je m’aperçois que la mienne touche de si près à sa fin, je veux en accentuer le cas que j’en fais, arrêter la promptitude de sa fuite par ma promptitude à la ressaisir, et compenser la rapidité avec laquelle elle s’écoule par l’intensité dont j’en use; à mesure que diminue le temps durant lequel je dois encore en avoir possession, je m’applique davantage à rendre cette possession plus profonde et plus complète.
Les autres ressentent la douceur que produisent en nous la satisfaction et la prospérité; je la ressens comme eux, mais ce n’est pas seulement en passant et sans m’y attacher. Il faut l’étudier, la 697 savourer, la ruminer, pour bien rendre à celui qui nous l’octroie, toute la grâce que nous lui en devons. On jouit de tous les plaisirs comme on fait du sommeil, sans s’en rendre compte. Pour que même le bien-être que j’éprouvais à dormir ne m’échappât pas ainsi stupidement, je m’avisai jadis qu’on me troublât pendant que je reposais, afin de n’en pas être inconscient.—J’analyse mes jouissances; je ne m’en tiens pas à la surface, j’approfondis et oblige ma raison, devenue chagrine et dégoûtée, à y prêter attention. Suis-je dans un moment de calme? y a-t-il quelque plaisir qui me produise une sensation agréable? je ne le laisse pas gaspiller par les sens, j’y associe mon âme, non pour s’y engager, mais pour qu’elle en éprouve de l’agrément; non pour qu’elle y demeure indifférente, mais pour qu’elle en soit consciente; je l’emploie, pour sa part, à se complaire dans cet état satisfaisant, à peser et estimer le bonheur qu’il me cause et par là à l’augmenter. Elle mesure ainsi combien elle est redevable à Dieu du repos de sa conscience et de celui que lui laissent les autres passions auxquelles elle est sujette, et de ce que le corps est dans son état naturel, jouissant sagement et en connaissance de cause des fonctions douces et agréables que, dans sa bonté, il a plu au Tout-Puissant de nous attribuer pour compenser les douleurs qu’à son tour sa justice nous inflige. Elle apprécie de la sorte de quel prix est pour elle d’être en telle situation que, partout où elle porte la vue, le ciel est calme autour d’elle; nul désir, nulle crainte, nul doute ne troublent son atmosphère; son imagination peut, sans en souffrir, se représenter toute difficulté passée, présente ou future. Cet état acquiert toute sa valeur, quand on le compare à ceux qui sont autres; quand, les envisageant sous les mille formes sous lesquelles ils se présentent, je songe aux gens que le sort ou leur propre erreur entraîne et expose aux fureurs de la tempête, et aussi à ceux qui, plus près de moi, accueillent si mollement et avec tant d’insouciance leur bonne fortune. En voilà qui véritablement passent le temps: ils ne voient qu’au delà du moment présent et de ce qu’ils possèdent, ne vivent que d’espérances, d’ombres et de vaines images que leur imagination place devant leurs yeux: «tels ces fantômes qu’on voit, dit-on, voltiger après la mort autour des tombeaux, ou ces songes qui trompent nos sens endormis (Virgile)», et qui, en toute hâte, prennent la fuite devant qui les suit. Le but et le résultat de cette poursuite c’est de toujours poursuivre, de même qu’Alexandre n’avait, disait-il, d’autre but en travaillant que de travailler, «estimant n’avoir rien fait, tant qu’il lui restait quelque chose à faire (Lucain)».
La vie est à accepter telle que Dieu nous l’a faite; c’est se montrer ingrat à son égard, que de repousser les satisfactions dont il l’a dotée.—Donc, quant à moi, j’aime la vie et la cultive telle qu’il a plu à Dieu de me l’octroyer. Je ne souhaiterais pas qu’il y manquât la nécessité où nous sommes de boire et de manger, et me reprocherais tout autant de désirer que ce 699 besoin soit, en nous, double de ce qu’il est: «Le sage recherche avec avidité les richesses naturelles (Sénèque).» Je ne regrette pas davantage que nous ne nous sustentions pas uniquement en nous mettant dans la bouche un peu de cette drogue par laquelle Épiménide se privait d’appétit et qui suffisait à le faire vivre; que stupidement les enfants venant au monde ne nous sortent des doigts ou des talons, en admettant même, pour ne pas sembler marquer du dédain pour cet acte, que ce mode de génération par les doigts et les talons ne le cédât point à l’autre sous le rapport de la volupté; ni que notre corps ne soit pas sans désir et insensible aux caresses; s’en plaindre, c’est être ingrat et injuste. J’accepte de bon cœur et avec reconnaissance ce que la nature a fait pour moi; je m’en déclare satisfait et m’en loue. On fait tort à ce grand et tout-puissant donateur quand on refuse ses dons, qu’on les annule ou qu’on les défigure; de sa part tout est bon, tout ce qu’il a fait est bien fait: «Tout ce qui est selon la nature, est digne d’estime (Cicéron).»
Des opinions émises par la philosophie, j’embrasse plus volontiers celles qui reposent sur les bases les plus solides, c’est-à-dire qui sont plus humaines, plus nôtres. Raisonnant comme je vis, en toute humilité, sans élévation dans les idées, je trouve bien enfantin de sa part qu’elle se dresse sur ses ergots pour nous prêcher que marier le divin au terrestre, ce qui est raisonnable à ce qui ne l’est pas, la sévérité à l’indulgence, ce qui est honnête à ce qui est déshonnête, constituent autant de monstruosités; que la volupté est une chose brutale, indigne que le sage y goûte; que le seul plaisir à tirer de la jouissance d’une jeune et belle épouse, c’est la satisfaction qu’éprouve notre conscience à accomplir un acte qui est dans l’ordre, comme de chausser ses bottes pour une course à cheval qu’il nous faut entreprendre. Si seulement chez les adeptes d’une telle philosophie, leur droit à dépuceler leurs femmes, la vigueur et la sève qu’ils y dépensent, étaient réduits dans la mesure que prône son enseignement, peut-être abandonneraient-ils ces idées!
Vivons suivant la nature, ce guide si doux autant que prudent et judicieux; chez la plupart des gens dont les idées vont s’élevant au-dessus du ciel, les mœurs sont plus bas que terre.—Ce n’est pas ce que dit Socrate, son maître et le nôtre; il fait de la volupté corporelle le cas qui convient, mais lui préfère celle de l’esprit comme ayant plus de force, de constance, de facilité, de variété, de dignité. Cette dernière, selon lui, ne va pas seule, il n’est pas rêveur à ce point, elle a seulement le pas sur l’autre; pour lui, la tempérance est la modératrice et non l’adversaire des plaisirs. La nature est un guide doux, mais chez lequel la douceur ne prime ni la prudence, ni la justice: «Il faut pénétrer la nature des choses et voir exactement ce qu’elle commande (Cicéron).» Je suis toujours en quête de sa piste, mais continuellement de fausses traces que l’art a semées sous nos pas, nous la font perdre; c’est pourquoi cette maxime souverainement bonne, émise par les académiciens et les péripatéticiens: «Vivre selon la nature», 701 devient si difficile à délimiter et à expliquer; et il en est de même de celle-ci: «Consentir à ce qu’elle demande», proche voisine de la précédente et qui appartient aux stoïciens. N’est-ce pas une erreur de tenir certaines actions comme inconvenantes, par cela seul qu’elles sont nécessaires? Aussi, ne m’ôtera-t-on pas de la tête que l’alliance du plaisir avec la nécessité, que les dieux, dit un ancien, cherchent toujours à associer, ne soit un mariage très convenable. Dans quel but disjoindre d’une façon absolue ces éléments d’un tout faisant si bien corps et dont l’agencement parfait justifie leur commune origine? resserrons au contraire le lien qui les unit en faisant qu’ils se rendent mutuellement service; que l’esprit éveille et vivifie le corps si lourd par lui-même, et que le corps modère la légèreté de l’esprit et fasse qu’il se fixe: «Quiconque exalte l’âme comme le souverain bien et condamne la chair comme chose mauvaise, embrasse et chérit l’âme avec ses sens; c’est à ses sens aussi qu’il doit ce sentiment qui lui fait fuir la chair, et qui naît de ce nous raisonnons sous l’empire de la vanité humaine et non d’après la vérité divine (S. Augustin).» Rien de ce dont Dieu nous a fait présent, n’est indigne de nos soins; nous en devons compte jusqu’au moindre détail. L’homme n’a pas reçu, par manière d’acquit, mission de se diriger lui-même; cette mission lui a été donnée expressément, nettement, comme sa fonction capitale; le Créateur la lui a imposée de la façon la plus sérieuse et la plus sévère. C’est seulement en ordonnant, qu’on a action sur les esprits vulgaires; et, comme un langage étranger donne plus de poids à ce que nous disons, nous insisterons sur ce point par cette citation latine: «N’est-ce pas sottise de faire avec mollesse et en maugréant ce qu’on est obligé de faire; de pousser le corps d’un côté, l’âme de l’autre, et de se partager entre les mouvements les plus contraires (Sénèque)?»
Bien plus, faites-vous indiquer, un jour, par curiosité, les idées et les agréments que conçoit dans son imagination celui qui repousse la pensée d’un bon repas et se reproche le temps qu’il emploie à se nourrir, et vous verrez que parmi tous les mets de votre table il n’y en a pas d’aussi insipide que ce bel état dans lequel il entretient son âme (le plus souvent, mieux vaudrait que nous dormions complètement, que de demeurer éveillés, étant donnée la cause qui nous fait veiller), et vous trouverez que ses raisons et ce qu’il se propose d’obtenir, ne valent pas votre ragoût. Cet état serait-il même amené par les ravissements en lesquels tombait Archimède, qu’ils ne l’excuseraient pas.—Je ne vise pas ici (ne les confondant pas avec ce tas de marmots que sont les hommes comme nous, pas plus que je ne leur attribue les désirs et les pensées en lesquels notre vanité se complaît) ces âmes vénérables que l’ardeur religieuse et la dévotion portent à une constante et consciencieuse méditation des choses divines, qui, tout aux efforts que leur inspire l’espérance vive et profonde d’arriver à gagner cette félicité éternelle, but final et dernière étape auxquels tendent 703 les aspirations de tous les chrétiens, seul plaisir continu et incorruptible, dédaignent de prêter attention à ces nécessités qui nous sont aussi des satisfactions, mais passagères et ambiguës, et renoncent si facilement à s’occuper de leur corps, lui refusant l’usage de ce qui, dans cette vie, est l’apanage des sens; c’est là une poursuite de l’idéal qui constitue un cas tout à fait privilégié.—Entre nous, ce sont choses que j’ai toujours vues en singulier accord, que des idées visant à s’élever au-dessus du ciel et des mœurs avilissant plus bas que terre.
En somme, dans tous les états de la vie, il faut jouir loyalement de ce que l’on est, et c’est folie de vouloir s’élever au-dessus de soi-même.—Ce grand homme qu’était Ésope, voyant son maître uriner en se promenant, s’écriait: «Hé quoi! nous faudra-t-il donc soulager de même notre ventre en courant?» Ménageons le temps, quoiqu’il nous en reste beaucoup que nous passons dans l’oisiveté, ou employons mal; notre âme, pour la tâche qui lui incombe, ne dispose pas d’assez d’heures autres que celles qui font besoin au corps, pour se séparer de lui durant le peu de temps qui lui est de toute nécessité. Les gens que hante cette idée de sacrifier le corps à l’âme, de devenir autres qu’ils ne sont et cesser de n’être que des hommes, sont fous; ce n’est pas en anges qu’ils se transforment, c’est en bêtes; au lieu de s’élever, ils se rabaissent.—Ces humeurs transcendantes m’effraient, comme font les sites élevés et inaccessibles, et je ne regrette rien tant dans la vie de Socrate que ses extases et ce génie familier auquel il attribuait ses inspirations. Rien, chez Platon, ne tient tant à l’humanité que ce qui passe pour lui avoir valu l’appellation de divin; et, parmi nos sciences, celles qui traitent des questions supérieures sont celles qui me semblent toucher le plus à la terre et être de moindre importance.—Je ne trouve non plus rien, dans la vie d’Alexandre, de si humble et qui témoigne davantage qu’il est du nombre des mortels, que ses prétentions chimériques à l’immortalité, qui lui valurent cette spirituelle raillerie de Philotas. Il lui avait fait part, dans une lettre, en le conviant à s’en réjouir avec lui, de l’oracle de Jupiter Ammon qui l’avait mis au rang des dieux: «J’en suis bien aise, lui répondit Philotas, en raison de la considération qui t’en revient; mais combien sont à plaindre les hommes appelés à vivre avec un homme qui dépasse à tel point et que ne contente pas la mesure de l’homme, et qui ont à lui obéir!»—«C’est parce que tu te soumets aux dieux, que tu commandes aux hommes (Horace).»—La gracieuse inscription dont les Athéniens avaient décoré leur ville, en l’honneur de la venue de Pompée, rentre dans ma façon de penser: «Tu es d’autant plus dieu, que tu te reconnais n’être qu’un homme (Plutarque).»
«Savoir loyalement jouir de ce que l’on est», est la perfection absolue et pour ainsi dire divine. Nous ne recherchons d’autres conditions que les nôtres, que parce que nous ne savons pas faire usage de celles en lesquelles nous nous trouvons; nous ne 705 sortons de nous-mêmes, que faute de savoir tirer parti de ce qui est en nous. Mais nous avons beau monter sur des échasses, sur ces échasses il nous faut quand même marcher avec nos jambes, et sur le trône le plus élevé du monde nous ne sommes assis que sur notre derrière. Les plus belles existences sont, à mon sens, celles qui rentrent dans le modèle général de la vie humaine, qui sont bien ordonnées, et d’où surtout sont exclus le miracle et l’extravagance.—Quant à la vieillesse, elle a un peu besoin d’être traitée avec quelque tendresse; c’est pourquoi je termine en recommandant la mienne à ce dieu protecteur de la santé et de la sagesse, de la sagesse gaie et sociable: «O fils de Latone! accorde-moi de jouir en paix du fruit de mes labeurs; donne-moi une âme saine dans un corps sain; et, je t’en prie, préserve-moi d’une vieillesse languissante, fermée au commerce des Muses (Horace).»
FIN DES ESSAIS. (TRADUCTION)

| LIVRE SECOND. (Suite.) |
||
| Pages. | ||
| Chapitre XXXVI. | —Des plus excellens hommes.—A quels hommes, entre tous, donner la prééminence. | 10 |
| Chapitre XXXVII. | —De la ressemblance des enfans aux pères. | 22 |
| LIVRE TROISIÈME. | ||
| Chapitre I. | —De l’vtile et de l’honneste. | 78 |
| Chapitre II. | —Du repentir. | 106 |
| Chapitre III. | —De trois commerces.—De la société des hommes, des femmes et de celle des livres. | 136 |
| Chapitre IV. | —De la diuersion. | 158 |
| Chapitre V. | —Sur des Vers de Virgile. | 178 |
| Chapitre VI. | —Des coches. | 286 |
| Chapitre VII. | —De l’incommodité de la grandeur.—Des inconvénients des grandeurs. | 320 |
| Chapitre VIII. | —Sur l’art de conferer.—De la conversation. | 330 |
| Chapitre IX. | —De la vanité. | 376 |
| Chapitre X. | —De mesnager sa volonté.—En toutes choses, il faut se modérer et savoir contenir sa volonté. | 484 |
| Chapitre XI. | —Des boyteux. | 526 |
| Chapitre XII. | —De la physionomie. | 546 |
| Chapitre XIII. | —De l’expérience. | 598 |
ERRATA DU TROISIÈME VOLUME.
Page 85, lig. 37.—Au lieu de: «veut», lire: «voudrait ne».
Page 114, lig. 16.—Au lieu de: «scache», lire: «sçache».
Page 118, lig. 32.—Au lieu de: «Il semble», lire: «Il nous semble».
Page 168, lig. 25.—Au lieu de: «conforce» lire: «consorce».
Page 178, lig. 10.—Au lieu de: «mourir: Vn frère... fié, Aristodemus», lire: mourir, vn frère... fié. Aristodemus».
Page 205, lig. 5.—Au lieu de: «elle», lire: «elles».
Page 279, lig. 6.—Après: «vouloir», ajouter: «que»;—après: «borner», supprimer: «que».
Page 342, lig. 5.—Au lieu de: «differendum», lire: «disserendum».
Page 344, lig. 6.—Au lieu de: «Euthydomus», lire: «Euthydemus».
Page 364, lig. 37.—Au lieu de: «opinon», lire: «opinion».
Page 416, lig. 13.—Au lieu de: «suis», lire: «fuis».
Pour ce qui est des astérisques (*) insérés dans la traduction, se reporter au Nota de la page 15 du premier volume.
ADDITION AUX ERRATA DU SECOND VOLUME.
Page 46, lig. 29.—Au lieu de: «sort», lire: «fort».
Page 174, lig. 12.—Au lieu de: «combieu», lire: «combien».
Page 197, lig. 17.—Au lieu de: «raison», lire: «raisons».
Page 280, lig. 26.—Au lieu de: «homme», lire: «hommes».
Pour ce qui est des astérisques (*) insérés dans la traduction, se reporter au Nota de la page 15 du premier volume.
ADDITION AUX ERRATA DU PREMIER VOLUME.
Page 218, lig. 21.—Au lieu de: «foy», lire: «soy».
Cette version électronique reproduit dans son intégralité la version originale. La partie écrite en «vieux français» est suivie par la «traduction» en français moderne.
L’orthographe a été conservée. Seuls quelques mots ont été modifiés. Ils sont soulignés par des tirets. Passer la souris sur le mot pour voir le texte original.
Les corrections indiquées par les ERRATA ont été prises en compte.
La ponctuation n’a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.
En cliquant sur les liens suivants, vous accédez directement aux livres français publiés sur gutenberg.org et qui sont classés par popularité, genre, auteurs.
End of the Project Gutenberg EBook of Essais de Montaigne (self-édition); v. III,
by Michel de Montaigne
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ESSAIS DE MONTAIGNE; VOLUME III ***
***** This file should be named 58801-h.htm or 58801-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/8/8/0/58801/
Produced by Claudine Corbasson and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by The
Internet Archive/American Libraries.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.