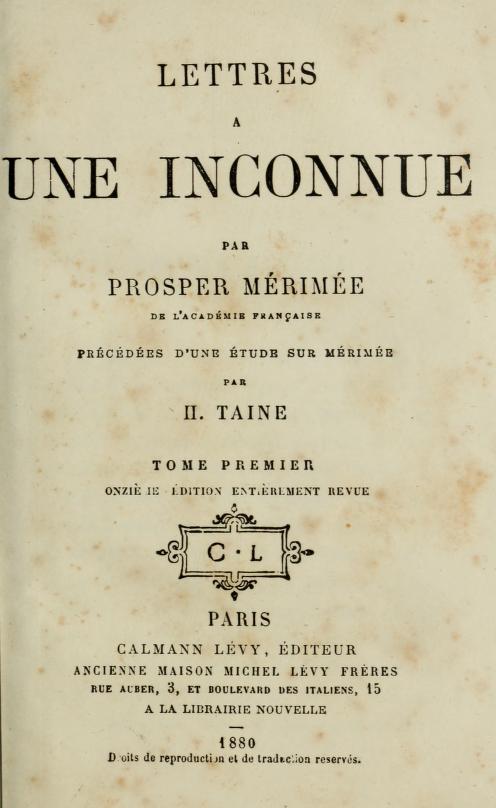
Project Gutenberg's Lettres à une inconnue, Tome Premier, by Prosper Mérimée
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of
the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have
to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Lettres à une inconnue, Tome Premier
Précédée d'une étude sur P. Mérimée par H. Taine
Author: Prosper Mérimée
Contributor: Hippolyte Taine
Release Date: January 31, 2018 [EBook #56473]
Language: French
Character set encoding: UTF-8
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LETTRES UNE INCONNUE ***
Produced by Laura Natal Rodrigues and Marc D'Hooghe at
Free Literature (Images generously made available by the
Internet Archive.)
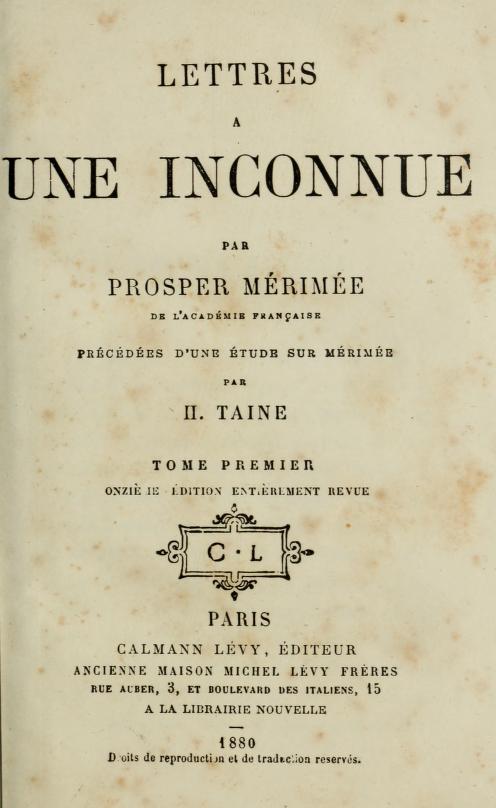
J'ai rencontré plusieurs fois Mérimée dans le monde. C'était un homme grand, droit, pâle, et qui, sauf le sourire, avait l'apparence d'un Anglais; du moins, il avait cet air froid, distant, qui écarte d'avance toute familiarité. Rien qu'à le voir, on sentatit en lui le flegme naturel ou acquis, l'empire de soi, la volonté et l'habitude de ne pas donner prise. En cérémonie surtout, sa physionomie était impassible. Même dans l'intimité et lorsqu'il contait une anecdote bouffonne, sa voix restait unie, toute calme; jamais d'éclat ni d'élan; il disait les détails les plus saugrenus, en termes propres, du ton d'un homme qui demande une tasse de thé. La sensibilité chez lui était domptée jusqu'à paraître absente; non qu'elle le fût: tout au contraire; mais il y a des chevaux de race si bien mâtés par leur maître, qu'une fois sous sa main, ils ne se permettent plus un soubresaut. Il faut dire que le dressage avait commencé de bonne heure. À dix ou onze ans, je crois, ayant commis quelque faute, il fut grondé très-sévèrement et renvoyé du salon; pleurant, bouleversé, il venait de fermer la porte, lorsqu'il entendit rire; quelqu'un disait: «Ce pauvre enfant! il nous croit bien en colère!»—L'idée d'être dupe le révolta, il se jura de réprimer une sensibilité si humiliante, et tint parole. Μέμνησο ἁπιστεῖν (souviens-toi d'être en défiance) telle fut sa devise. Être en garde contre l'expansion, l'entraînement et l'enthousiasme, ne jamais se livrer tout entier, réserver toujours une part de soi-même, n'être dupe ni d'autrui, ni de soi, agir et écrire comme en la présence perpétuelle d'un spectateur indifférent, être soi-même ce spectateur, voilà le trait de plus en plus fort qui s'est gravé dans son caractère, pour laisser une empreinte dans toutes les parties de sa vie, de son œuvre et de son talent.[1]
Il a vécu en amateur: on ne peut guère vivre autrement quand on a la disposition critique; à force de retourner la tapisserie, on finit par la voir habituellement à l'envers. En ce cas, au lieu de personnages beaux et bien posés, on contemple des bouts de ficelle; il est difficile alors d'entrer avec abnégation et comme ouvrier dans une œuvre commune, d'appartenir même au parti que l'on sert, même à l'école que l'on préfère, même à la science qu'on cultive, même à l'art où on excelle; si parfois on descend en volontaire dans la mêlée, le plus souvent on se tient à part. Il eut de bonne heure quelque aisance, puis un emploi commode et intéressant, l'inspection des monuments historiques, puis une place au sénat et des habitudes à la cour. Aux monuments historiques, il fut compétent, actif et utile; au sénat, il eut le bon goût d'être le plus souvent absent ou muet; à la cour, il avait son indépendance et son franc-parler. Voyager, étudier, regarder, se promener à travers les hommes et les choses, telle a été son occupation; ses attaches officielles ne le gênaient pas. D'ailleurs, un homme d'autant d'esprit se fait respecter quand même; son ironie transperce les mieux cuirassés. Il faut voir avec quelle désinvolture il la manie, jusqu'à la tourner contre lui-même, et faire coup double.—Un jour, à Biarritz, il avait lu une de ses nouvelles devant l'impératrice. «Peu après ma lecture, je reçois la visite d'un homme de la police, se disant envoyé par la grande-duchesse. «Qu'y a-t-il pour votre service?—Je viens, de la part de Son Altesse impériale, vous prier ce venir ce soir chez elle avec votre roman.—Quel roman?—Celui que vous avez lu l'autre jour à Sa Majesté.» Je répondis que j'avais l'honneur d'être le bouffon de Sa Majesté et que je ne pouvais aller travailler en ville sans sa permission; et je courus tout de suite lui raconter la chose. Je m'attendais qu'il en résulterait au moins une guerre avec la Russie, et je fus un peu mortifié que non-seulement on m'autorisât, mais encore qu'on me priât d'aller le soir chez la grande-duchesse, à qui on avait donné le policeman comme factotum. Cependant, pour me soulager, j'écrivis à la grande-duchesse une lettre d'assez bonne encre.—Cette lettre «d'assez bonne encre» serait une pièce curieuse, et je suis sûr qu'on ne lui a plus envoyé le factotum.—Quant aux corps constitués, il n'est guère possible de les aborder avec plus de sérieux extérieur et moins de déférence intime. Grave, digne, posé dans sa cravate, quand il faisait une visite académique ou improvisait un discours public, ses façons étaient irréprochables; cependant, en sourdine, la serinette d'arrière-plan jouait un air comique qui tournait en ridicule l'orateur et les auditeurs. «Le président des antiquaires s'est levé et tout le monde avec lui. Il a pris la parole et a dit qu'il proposait de boire à ma santé, attendu que j'étais remarquable à trois points de vue, c'est à savoir: comme sénateur, comme homme de lettres et comme savant. Il n'y avait que la table entre nous, et j'avais une grande envie de lui jeter à la tête un plat de gelée au rhum... Le lendemain, j'ai entendu le procès-verbal de la veille, où il était dit que j'avais parlé très-éloquemment. J'ai fait un speech pour que le procès-verbal fût purgé de tout adverbe, mais en vain.»—Candidat à l'Académie des inscriptions, et conduit chez des érudits d'aspect redoutable, il écrivait au retour: «Avez-vous jamais vu des chiens entrer dans le terrier d'un blaireau? Quand ils ont quelque expérience, ils font une mine effroyable en y entrant, et souvent ils en sortent plus vite qu'ils n'y sont entrés, car c'est une vilaine bête à visiter que le blaireau. Je pense toujours au blaireau en tenant le cordon de la sonnette d'un académicien, et je me vois in the mind's eye tout à fait semblable au chien que je vous disais. Je n'ai pas encore été mordu cependant; mais j'ai fait de drôles de rencontres.»—Il fut reçu et eut, à côté des autres, son terrier archéologique. Mais on devine bien qu'il n'était pas d'humeur à se confiner dans celui-ci ni dans un autre; tous ceux qu'il habita avaient plusieurs sorties. Il y avait en lui deux personnages: l'un qui, engagé dans la société, s'y acquittait correctement de la besogne obligée et de la parade convenable; l'autre qui se tenait à côté ou au-dessus du premier, et, d'un air narquois ou résigné, le regardait faire.
Pareillement il y avait en lui deux personnages dans les affaires de cœur. Le premier, l'homme naturel, était bon et même tendre. Nul n'a été plus loyal, plus sûr en amitié; quand il avait une fois donné sa main, il ne la retirait plus. On le vit bien quand il défendit M. Libri contre les juges et contre l'opinion; c'était l'action d'un chevalier qui, à lui seul, combat une armée. Condamné à l'amende et mis en prison, il ne prit point des airs de martyr, et mit autant de grâce à subir sa mésaventure qu'il avait mis de bravoure à la provoquer. Il n'en dit rien, sauf dans une préface, et encore en manière d'excuse, alléguant qu'il avait dû, «au mois de juillet précédent, passer quinze jours dans un endroit où il n'était nullement incommodé du soleil et où il jouissait d'un profond loisir.» Rien de plus, c'est le sourire discret et fin du galant homme.—Outre cela, serviable, obligeant; des gens qui le priaient de s'employer pour eux s'en allaient déconcertés par sa froide mine; un mois après, il arrivait chez eux ayant en poche la faveur demandée. Dans sa correspondance, il lui échappe un mot frappant que tous ses amis disent très-vrai: «Il m'arrive rarement de sacrifier les autres à moi-même, et, quand cela m'arrive, j'en ai tous les remords possibles.»—À la fin de sa vie, on trouvait chez lui deux vieilles dames anglaises auxquelles il parlait peu, et dont il ne semblait pas se soucier beaucoup; un de mes amis le vit les larmes aux yeux parce que l'une d'elles était malade. Jamais il ne disait un mot de ses sentiments profonds; voici une correspondance d'amour, puis d'amitié, qui a duré trente ans; la dernière lettre est datée de son dernier jour, et l'on ne sait pas le nom de sa correspondante. Pour qui sait lire ces lettres, il y est gracieux, aimant, délicat, véritablement amoureux, et, qui le croirait? poète parfois, ému jusqu'à devenir superstitieux, comme un Allemand lyrique. Cela est si étrange, qu'il faut citer presque tout.—«Vous aviez été si longtemps sans m'écrire que je commençais à être inquiet. Et puis j'étais tourmenté d'une idée saugrenue que je n'ai pas osé vous écrire. Je visitais les Arènes de Nîmes avec l'architecte du département, lorsque je vis à dix pas de moi un oiseau charmant, un peu plus gros qu'une mésange, le corps gris de lin, avec des ailes rouges, noires et blanches. Cet oiseau était perché sur une corniche et me regardait fixement. J'interrompis l'architecte pour lui demander le nom de cet oiseau. C'est un grand chasseur, et il me dit qu'il n'en avait jamais vu de semblable. Je m'approchai, et l'oiseau ne s'envola que lorsque j'étais assez près de lui pour le toucher. Il alla se poser à quelques pas de là, me regardant toujours. Partout où j'allais, il semblait me suivre, car je l'ai retrouvé à tous les étages de l'amphithéâtre. Il n'avait pas de compagnon et son vol était sans bruit comme celui d'un oiseau nocturne. Le lendemain, je retournai aux Arènes et je revis encore mon oiseau. J'avais apporté du pain que je lui jetai, mais il n'y toucha pas. Je lui jetai ensuite une grosse sauterelle, croyant, à la forme de son bec, qu'il mangeait des insectes, mais il ne parut pas en faire cas. Le plus savant ornithologiste de la ville me dit qu'il n'existait pas dans le pays d'oiseaux de cette espèce. Enfin, à la dernière visite que j'ai faite aux Arènes, j'ai rencontré mon oiseau toujours attaché à mes pas, au point qu'il est entré avec moi dans un corridor étroit et sombre, où lui, oiseau de jour, n'aurait jamais dû se hasarder. Je me souvins alors que la duchesse de Buckingham avait vu son mari sous la forme d'un oiseau le jour de son assassinat, et l'idée me vint que vous étiez peut-être morte et que vous aviez pris cette forme pour me voir. Malgré moi, cette bêtise me tourmentait, et je vous assure que j'ai été enchanté de voir que votre lettre portait la date du jour où j'ai vu pour la première fois mon oiseau merveilleux.»—Voilà comment, même chez un sceptique, le cœur et l'imagination travaillent; c'est une «bêtise»; il n'en est pas moins vrai qu'il était sur le seuil du rêve et dans le grand chemin de l'amour.[2]
Mais, à côté de l'amoureux, subsistait le critique, et le conflit des deux personnages dans le même homme produisait des effets singuliers. En pareil cas, il vaut peut-être mieux n'y pas voir trop clair.—«Savez-vous bien, disait La Fontaine, que, pour peu que j'aime, je ne vois les défauts des personnes non plus qu'une taupe qui aurait cent pieds de terre sur elle? Dès que j'ai un grain d'amour, je ne manque pas d'y mêler tout ce que j'ai d'encens dans mon magasin.» C'est peut-être pour cela qu'il était si aimable.—Dans les lettres de Mérimée, les duretés pleuvent avec les douceurs: «Je vous avouerai que vous m'avez paru fort embellie au physique, mais point au moral... Vous avez toujours la taille d'une sylphide, et, bien que blasé sur les yeux noirs, je n'en ai jamais vu d'aussi grands à Constantinople ni à Smyrne. Maintenant, voici le revers de la médaille. Vous êtes restée enfant en beaucoup de choses, et vous êtes devenue par-dessus le marché hypocrite... Vous croyez que vous avez de l'orgueil, j'en suis bien fâché, mais vous n'avez qu'une petite vanité bien digne d'une dévote. La mode est au sermon aujourd'hui. Y allez-vous? Il ne vous manquait plus que cela.»—Et un peu plus tard: «Dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, vous substituez toujours à un sentiment réel un convenu... Au reste, je respecte les convictions, même celles qui me paraissent le plus absurdes. Il y a en vous beaucoup d'idées saugrenues, pardonnez-moi le mot, que je me reprocherais de vous ôter, puisque vous y tenez et que vous n'avez rien à mettre à la place.» Après deux mois de tendresses, de querelles et de rendez-vous, il conclut ainsi: «Il me semble que tous les jours vous êtes plus égoïste. Dans nous, vous ne cherchez jamais que vous. Plus je retourne cette idée, plus elle me paraît triste... Nous sommes si différents, qu'à peine pouvons-nous nous comprendre.» Il paraît qu'il avait rencontré un caractère aussi rétif et aussi indépendant que le sien, a lioness, though tame, et il l'analyse.—«C'est dommage que nous ne nous voyions pas le lendemain d'une querelle; je suis sûr que nous serions parfaitement aimables l'un pour l'autre... Assurément mon plus grand ennemi, ou, si vous voulez, mon rival dans votre cœur, c'est votre orgueil; tout ce qui froisse cet orgueil vous révolte; vous suivez votre idée, peut-être à votre insu, dans les plus petits détails. N'est-ce pas votre orgueil qui est satisfait lorsque je baise votre main? Vous êtes heureuse alors, m'avez-vous dit, et vous vous abandonnez à votre sensation parce que votre orgueil se plaît à une démonstration d'humilité...»—Quatre mois plus tard, et à distance, après une brouille plus forte: Vous êtes une de ces chilly women of the North, vous ne vivez que par la tête... Adieu, puisque nous ne pouvons être amis qu'à distance. Vieux l'un et l'autre, nous nous retrouverons peut-être avec plaisir.» Puis, sur un mot affectueux, il revient.—Mais l'opposition des caractères est toujours la même; il ne peut souffrir qu'une femme soit femme: «Rarement je vous accuse, sinon de ce manque de franchise qui me met dans une défiance presque continuelle avec vous, obligé que je suis de chercher toujours votre idée sous un déguisement... Pourquoi, après si longtemps que nous sommes ce que nous sommes l'un à l'autre, êtes-vous encore à réfléchir plusieurs jours avant de répondre à la question la plus simple?... Entre votre tête et votre cœur, je ne sais jamais qui l'emporte; vous ne le savez pas vous-même, mais vous donnez toujours raison à votre tête... S'il y a un tort de votre part, c'est assurément cette préférence que vous donnez à votre orgueil sur ce qu'il y a de tendresse en vous. Le premier sentiment est au second comme un colosse à un pygmée. Et cet orgueil n'est au fond qu'une variété de l'égoïsme.» Tout cela finit par une bonne et durable amitié.—Mais n'admirez-vous pas cette manière agréable de faire sa cour? On se rencontrait au Louvre, à Versailles, dans les bois des environs; on s'y promenait tête à tête, en secret, longuement, même en janvier, plusieurs fois par semaine; il admirait «une radieuse physionomie, de fines attaches, une blanche main, de superbes cheveux noirs», une intelligence et une instruction dignes de la sienne, les grâces d'une beauté originale, les attraits d'une culture composite, les séductions d'une toilette et d'une coquetterie savantes; il respirait le parfum exquis d'une éducation si choisie et d'une «nature si raffinée, qu'elles résumaient pour lui toute une civilisation»; bref, il était sous le charme. Au retour, l'observateur reprenait son office; il démêlait le sens d'une réponse, d'un geste; il se détachait de son sentiment pour juger un caractère; il écrivait des vérités et des épigrammes que le lendemain on lui rendait.
Tel il fut dans sa vie, tel on le retrouve dans ses livres. Il a écrit et étudié en amateur, passant d'un sujet à un autre, selon l'occasion et sa fantaisie, sans se donner à une science, sans se mettre au service d'une idée. Ce n'était pas faute d'application ou de compétence. Au contraire, peu d'hommes ont été plus et mieux instruits. Il possédait six langues, avec leur littérature et leur histoire; l'italien, le grec, le latin, l'anglais, l'espagnol et le russe; je crois qu'en outre il lisait l'allemand. De temps en temps, une phrase de sa correspondance, une note montre à quel point il avait poussé ces études. Il parlait caló, de manière à étonner les bohémiens d'Espagne. Il entendait les divers dialectes espagnols et déchiffrait les vieilles chartes catalanes. 11 savait la métrique des vers anglais. Ceux-là seuls qui ont étudié une littérature entière, dans l'imprimé et dans le manuscrit, pendant les quatre ou cinq âges successifs de la langue, du style et de l'orthographe, peuvent apprécier ce qu'il faut de facilité et d'efforts pour savoir l'espagnol comme l'auteur de Don Pèdre, et le russe comme l'auteur des Cosaques et du Faux Démétrius. Il était naturellement doué pour les langues, et en avait appris jusque dans l'âge mûr: vers la fin de sa vie, il devenait philologue et s'adonnait à Cannes aux minutieuses études qui composent la grammaire comparée.—À cette connaissance des livres, il avait ajouté celle des monuments; ses rapports prouvent qu'il était devenu spécial pour ceux de France; il comprenait non-seulement l'effet, mais la technique, de l'architecture. Il avait étudié chaque vieille église sur place, avec l'aide des meilleurs architectes; sa mémoire locale était excellente et exercée: né dans une famille de peintres, il avait manié le pinceau et faisait bien l'aquarelle; bref, en ceci comme en tout sujet, il était allé au fond des choses; ayant l'horreur des phrases spécieuses, il n'écrivait qu'après avoir touché le détail probant. On trouverait difficilement une tête d'historien dans laquelle la collection préalable, bibliothèque et musée, soit si complète.—Ajoutez-y des dons encore plus rares, ceux qui permettent de faire revivre ces débris morts, je veux dire l'expérience de la vie et l'imagination lucide. Il avait beaucoup voyagé, deux fois en Grèce et en Orient, douze ou quinze fois en Angleterre, en Espagne et ailleurs, et partout il avait observé les mœurs, non-seulement de la bonne compagnie, mais de la mauvaise. «J'ai mangé plus d'une fois à la gamelle avec des gens qu'un Anglais ne regarderait pas, de peur de perdre le respect qu'il a pour son propre œil. J'ai bu à la même outre qu'un galérien.» Il avait vécu familièrement avec des gitanos et des toréadors. Il faisait des contes le soir à une assemblée de paysans et de paysannes de l'Ardèche. Un des endroits où il se trouvait le mieux à sa place, c'était dans une venta espagnole, avec «des muletiers et des paysannes d'Andalousie». Il cherchait des types frustes et intacts, «par une curiosité inépuisable de toutes les variétés de l'espèce humaine», et formait dans sa mémoire une galerie de caractères vivants, la plus précieuse de toutes; car les autres, celles des livres et des édifices, sont des coquilles jadis habitées, maintenant vides, dont on ne comprend la structure qu'en se figurant, d'après les espèces survivantes, les espèces qui ont vécu. Par une divination vive, exacte et prompte, il faisait cette reconstruction mentale. On voit par la Chronique de Charles IX, par les Débuts d'un Aventurier, par le Théâtre de Clara Cazul, que tel est son procédé involontaire. Ses lectures aboutissent naturellement à la demi-vision de l'artiste, à la mise en scène, au roman qui ranime le passé. Avec tant d'acquis et des facultés si belles, il eût pu prendre dans l'histoire et dans l'art une place à la fois très-grande et très-haute; il n'a pris qu'une place moyenne dans l'histoire, et une place haute mais étroite dans l'art.
C'est qu'il se défiait, et que trop de défiance est nuisible. Pour obtenir d'une étude tout ce qu'elle peut donner, il faut, je crois, se donner tout entier à elle, l'épouser, ne pas la traiter comme une maîtresse avec qui l'on s'enferme deux ou trois ans, sauf à recommencer ensuite avec une autre. Un homme ne produit tout ce dont il est capable que, lorsque ayant conçu quelque forme d'art, quelque méthode de science, bref, quelque idée générale, il la trouve si belle, qu'il la préfère à tout, notamment à lui-même, et l'adore comme une déesse qu'il est trop heureux de servir. Mérimée aussi pouvait s'éprendre et adorer; mais, au bout d'un temps, le critique en lui se réveillait, jugeait la déesse, trouvait qu'elle n'était pas assez divine. Toutes nos méthodes de science, toutes nos formes d'art, toutes nos idées générales ont quelque endroit faible; l'insuffisant, l'incertain, le convenu, le postiche y abondent; il n'y a que l'illusion de l'amour qui puisse les trouver parfaites, et un sceptique n'est pas longtemps amoureux. Celui-ci mettait son lorgnon, et dans la belle statue démêlait le manque d'aplomb, la restauration fausse et spécieuse, l'attitude de mode: il se dégoûtait et s'en allait, non sans motifs. Il les indique en passant, ces motifs; il voit ce qu'il y a de hasardé dans notre philosophie de l'histoire, ce qu'il y a d'inutile dans notre manie d'érudition, ce qu'il y a d'exagéré dans notre goût pour le pittoresque, ce qu'il y a d'insipide dans notre peinture du réel. Que les inventeurs et les badauds acceptent le système ou le style par amour-propre, ou par niaiserie; pour lui, il s'en défend, ou, s'il ne s'en est pas défendu, il s'en repent.—«Vers l'an de grâce 1827, j'étais romantique. Nous disions aux classiques: «Point de salut sans la couleur locale.» Nous entendions par couleur locale ce qu'au XVIIe siècle on appelait les mœurs; mais nous étions très-fiers de notre mot, et nous pensions avoir imaginé le mot et la chose.» Depuis, ayant fabriqué des poésies illyriques que les savants d'outre-Rhin traduisirent d'un grand sérieux, il put se vanter d'avoir fait de la couleur locale. «Mais le procédé était si simple, si facile, que j'en vins à douter du mérite de la couleur locale elle-même, et que je pardonnai à Racine d'avoir policé les sauvages héros de Sophocle et d'Euripide.»—Vers la fin de sa vie, il évitait de parti pris toutes les théories; à ses yeux, elles n'étaient bonnes qu'à duper des philosophes ou à nourrir des professeurs: il n'acceptait et n'échangeait que des anecdotes, de petits faits d'observation, par exemple en philologie, la date précise où l'on cesse de rencontrer dans le vieux français les deux cas survivants de la déclinaison latine. À force de vouloir la certitude, il desséchait la science et ne gardait de la plante que le bois sans les fleurs. On ne peut expliquer autrement la froideur de ses essais historiques, Don Pèdre, les Cosaques, le Faux Démétrius, la Guerre sociale, la Conjuration de Catilina, études solides, complètes, bien appuyées, bien exposées, mais dont les personnages ne vivent pas; très-probablement, c'est qu'il n'a pas voulu les faire vivre. Car, dans un autre écrit, les Débuts d'un Aventurier, reprenant son faux Démétrius, il a fait rentrer la séve dans la plante, en sorte qu'on peut la voir tour à tour sous les deux formes, terne et raide dans l'herbier historique, fraîche et verte dans l'œuvre d'art. Évidemment, quand il préparait dans cet herbier ses Espagnols du XIVe siècle ou les contemporains de Sylla, il les voyait par l'œil intérieur aussi nettement que son aventurier; du moins, cela ne lui était pas plus difficile; mais il répugnait à nous les faire voir, n'admettant dans l'histoire que des détails prouvés, se refusant à nous donner ses divinations pour des faits authentiques, critique au détriment de son œuvre, rigoureux jusqu'à se retrancher la meilleure partie de lui-même et mettre son imagination sous l'interdit.
Dans ses œuvres d'art, le critique domine encore, mais presque toujours avec un office utile, pour restreindre et diriger son talent, comme une source qu'on enferme dans un tuyau pour qu'elle jaillisse plus mince et plus serrée. Il avait de naissance plusieurs de ces talents que nul travail n'acquiert et que son maître Stendhal ne possédait pas, le don de la mise en scène, du dialogue, du comique, l'art de poser face à face deux personnages, et de les rendre visibles au lecteur par le seul échange de leurs paroles. De plus, comme Stendhal, il savait les caractères et contait bien. Il soumit ces vives facultés à une discipline sévère, et, par un effort double, entreprit de leur faire rendre le plus d'œuvre avec le moins de matière.—Dès l'abord, il avait beaucoup goûté le théâtre espagnol, qui est tout nerf et toute action; il en reprit les procédés pour composer sous un faux nom de petites pièces d'un sens profond et d'intention moderne; chose unique dans l'histoire littéraire, plusieurs de ces pastiches, l'Occasion, la Périchole, valent des originaux.—Nulle part la saillie des caractères n'est si nette et si forte que dans ses comédies. Dans les Mécontents et dans les Deux Héritages, chaque personnage, suivant un mot de Goethe, ressemble à ces montres parfaites, en cristal transparent, sur lesquelles on voit en même temps l'heure exacte et tout le jeu du mécanique intérieur. Tous les détails portent et sont chargés de sens; c'est le propre des grands peintres de dessiner en cinq ou six coups de crayon une figure qu'on n'oublie plus. Même dans des pièces moins réussies, par exemple dans les Espagnols en Danemark, il y a des personnages, le lieutenant Charles Leblanc, et sa mère l'espionne, qui resteront à demeure dans la mémoire humaine.—Au fond, si un sceptique aussi déterminé avait daigné avoir une esthétique, il aurait expliqué, je crois, que, pour un connaisseur de l'homme, chaque homme se réduit à trois ou quatre traits principaux, lesquels s'expriment complètement par cinq ou six actions significatives; le reste est dérivé ou indifférent; c'est temps perdu que de le montrer. Les lecteurs intelligents le devineront, et il ne faut écrire que pour les lecteurs intelligents. Laisser le bavardage aux bavards, ne prendre que l'essentiel, ne le traduire aux yeux que par des actions probantes, concentrer, abréger, résumer la vie, voilà le but de l'art.—Du moins tel est le sien, et il l'atteint mieux encore dans ses récits que dans ses comédies; car les exigences de la mise en scène et de l'effet comique ne surviennent pas pour grossir les traits, charger la vérité, mettre sur la figure vivante un masque de théâtre.[3] L'écrivain, ayant moins d'obligations et plus de ressources, peut dessiner plus juste et moins appuyer. La plupart de ces nouvelles sont des chefs-d'œuvre, et il est à croire qu'elles resteront classiques. Il y a de cela plusieurs raisons.—D'abord, en fait, voici trente ou quarante ans qu'elles durent, et Carmen, l'Enlèvement de la Redoute, Colomba, Matteo Falcone, l'Abbé Aubain, Arsène Guillot, la Vénus d'Ile, la Partie de trictrac, Tamango, même le Vase étrusque et la Double Méprise, presque tous ces petits édifices sont aussi intacts qu'au premier jour. C'est qu'ils sont bâtis en pierres choisies, non en stuc et autres matériaux de mode. Point de ces descriptions qui passent au bout de cinquante ans et qui nous ennuient tant aujourd'hui dans les romans de Walter Scott; point de ces réflexions, dissertations, explications, que nous trouvons si longues dans les romans de Fielding; rien que des faits, et les faits sont toujours instructifs. D'autant plus qu'il n'y met que des faits importants, intelligibles même pour des hommes d'un autre pays et d'un autre siècle; dans Balzac et dans Dickens, qui n'ont pas cette précaution, beaucoup de détails minutieux, locaux ou techniques, tomberont comme un enduit qui s'écaille, ou ne serviront qu'aux commentaires des commentateurs.—Autre chance de durée; ces romans sont courts, le plus long n'a qu'un demi-volume, l'un d'eux, six pages; tous sont clairs, bien composés, rassemblés autour d'une action simple et d'un effet unique. Or, il faut songer que la postérité est une sorte d'étrangère, qu'elle n'a pas la complaisance des contemporains, qu'elle ne tolère pas les ennuyeux, qu'aujourd'hui peu de personnes supportent les huit volumes de Clarisse Harlowe; bref, que l'attention humaine surchargée finit toujours par faire faillite; il est prudent, quand après un siècle on lui demande encore audience, de lui parler un style bref, net et plein.—En outre, il est sage de lui dire des choses intéressantes et qui l'intéressent. Des choses intéressantes: cela exclut les événements trop plats ou trop bourgeois, les caractères trop effacés et trop ordinaires. Des choses qui l'intéressent: cela veut dire des situations et des passions assez durables pour qu'après cent ans elles soient encore de circonstance. Mérimée choisit des types francs, forts, originaux, sortes de médailles d'un haut relief et d'un métal dur, avec un cadre et des événements appropriés: le premier combat d'un officier, une vendetta corse, le dernier voyage d'un négrier, une défaillance de probité, l'exécution d'un fils par son père, une tragédie intime dans un salon moderne; presque tous ses contes sont meurtriers, comme ceux de Baudello et des nouvellistes italiens, et en outre poignants par le sang-froid du récit, par la précision du trait, par la convergence savante des détails.—Bien mieux, chacun d'eux, dans sa petite taille, est un document sur la nature humaine, un document complet et de longue portée, qu'un philosophe, un moraliste, peut relire tous les ans sans l'épuiser. Plusieurs dissertations sur l'instinct primitif et sauvage, des traités savants, comme celui de Schopenhauer sur la métaphysique de l'amour et de la mort, ne valent pas les cent pages de Carmen. Le cierge d'Arsène Guillot résume beaucoup de volumes sur la religion du peuple et sur les vrais sentiments des courtisanes. Je ne sais pas de plus amère prédication contre les méprises de la crédulité ou de l'imagination, que la Double Méprise et le Vase étrusque. Il est probable qu'en l'an 2000 on relira la Partie de trictrac, pour savoir ce qu'il en coûte de manquer une fois à l'honneur. Remarquez enfin que l'auteur n'intervient point pour nous faire la leçon; il s'abstient, nous laisse conclure; même et de parti pris, il s'efface jusqu'à paraître absent; les lecteurs futurs auront des égards pour un maître de maison si poli, si discret, si habile à faire les honneurs de son logis. Les bonnes manières plaisent toujours, et on ne peut rencontrer d'hôte mieux élevé. À la porte, il salue ses visiteurs, les introduit, puis se retire, les laissant libres de tout examiner et critiquer seuls; il n'est pas importun, il ne se fait pas le cicerone de ses trésors, jamais on ne le prendra en flagrant délit d'amour-propre. Il cache son savoir au lieu de le montrer; il semble, à l'écouter, que chacun aurait pu faire son livre. L'un est une anecdote qu'un de ses amis lui a contée et qu'il a aussitôt écrite. L'autre est «un extrait» de Brantôme et d'Aubigné. S'il a fait les Débuts d'un Aventurier, c'est qu'étant au frais, malgré lui, pendant quinze jours, il n'avait rien de mieux à faire. Pour écrire la Guzla, la recette est simple: se procurer une statistique de l'Illyrie, le voyage de l'abbé Fortis, apprendre cinq ou six mots de slave. Ce parti pris de ne pas se surfaire va jusqu'à l'affectation. Il a si grand'peur de paraître pédant, qu'il fuit jusque dans l'autre extrême, le ton dégagé, le sans façon de l'homme du monde. Peut-être un jour sera-ce là son endroit vulnérable; on se demandera si cette ironie perpétuelle n'est pas voulue, s'il a raison de plaisanter au plus fort de la tragédie, s'il ne se montre pas insensible par crainte du ridicule, si son ton aisé n'est pas l'effet de la contrainte, si le gentleman en lui n'a pas fait tort à l'auteur, s'il aimait assez son art. Plus d'une fois, notamment dans la Vénus d'Ille, il s'en est servi pour mystifier le lecteur. Ailleurs, dans Lokis,[4] une idée saugrenue, à, double entente, étrange de la part d'un esprit si distingué, gît au fond du conte, comme un crapaud dans un coffret sculpté. Il paraît qu'il trouvait plaisir à voir des doigts de femme ouvrir le coffret, et qu'un joli visage bien effaré par le dégoût le faisait rire. Presque toujours, il semble qu'il ait écrit par occasion, pour s'amuser, pour s'occuper, sans subir l'empire d'une idée, sans concevoir un grand ensemble, sans se subordonner à une œuvre.—En ceci comme dans le reste, il était désenchanté, et à la fin on le trouve dégoûté. Le scepticisme produit la mélancolie. À ce sujet, sa correspondance est triste; sa santé défaillit peu à peu; il hivernait régulièrement à Cannes, sentant que la vie le quittait; il se soignait, se conservait; c'est l'unique souci qui suive l'homme jusqu'au bout. Il allait tirer de l'arc par ordonnance de médecin, et peignait, pour se distraire, des vues du pays; tous les jours, on le rencontrait dans la campagne, marchant en silence, avec ses deux Anglaises; l'une portait l'arc, l'autre la boîte aux aquarelles. Il tuait ainsi le temps et prenait patience. Il allait, par bonté d'âme, nourrir un chat, dans une cabane écartée, à une demi-lieue de distance; il cherchait des mouches pour un lézard qu'il nourrissait: c'étaient là ses favoris. Quand le chemin de fer lui amenait un ami, il se ranimait et sa conversation redevenait charmante; ses lettres l'étaient toujours; il ne pouvait s'empêcher d'avoir l'esprit le plus original et le plus exquis. Mais le bonheur lui manquait; il voyait l'avenir en noir, à peu près tel que nous l'avons aujourd'hui; avant de clore les yeux, il eut la douleur d'assister à l'écroulement complet, et mourut le 23 septembre 1870.—Si on essaye de résumer son caractère et son talent, on trouvera, je pense, que, né avec un cœur très-bon, doué d'un esprit supérieur, ayant vécu en galant homme, beaucoup travaillé, et produit quelques œuvres de premier ordre, il n'a pas pourtant tiré de lui-même tout le service qu'il pouvait rendre, ni atteint tout le bonheur auquel il pouvait aspirer. Par crainte d'être dupe, il s'est défié dans la vie, dans l'amour, dans la science, dans l'art,[5] et il a été dupe de sa défiance. On l'est toujours de quelque chose, et peut-être vaut-il mieux s'y résigner d'avance.
H. TAINE.
Novembre 1873.
[1] On dirait qu'il s'est peint lui-même dans Saint-Clair, personnage du Vase étrusque. «Il était né avec un cœur tendre et aimant; mais, à un âge où l'on prend trop facilement des impressions qui durent toute la vie, sa sensibilité trop expansive lui avait attiré les railleries de ses camarades... Dès lors, il se fit une étude de cacher tous les dehors de ce qu'il regardait comme une faiblesse déshonorante... Dans le monde, il obtint la triste réputation d'insensible et d'insouciant... Il avait beaucoup voyagé, beaucoup lu, et ne parlait de ses voyages et de ses lectures que lorsqu'on l'exigeait.»—Darcy, dans la Double Méprise, est encore un caractère analogue au sien.
[2] Voici de lui une action généreuse et délicate; Béranger, en cas pareil, en fit une semblable: «J'allais être amoureux quand je suis parti pour l'Espagne. La personne qui a causé mon voyage n'en a jamais rien su. Si j'étais resté, j'aurais peut-être fait une grande sottise, celle d'offrir à une femme digne de tout le bonheur dont on peut jouir sur terre, de lui offrir, dis-je, en échange de la perte de toutes les choses qui lui étaient chères, une tendresse que je sentais moi-même très-inférieure au sacrifice qu'elle aurait peut-être fait.»
[3] Le Résident dans les Espagnols en Danemark, le Comte et les autres gentilshommes dans les Mécontents, Kermouton et le marchand do beurre dans les Deux Héritages. Mais, en revanche, quels résumés vrais que les caractères de Clémence, de Sévin et de miss Jackson!
[4] Lettres à une Inconnue, II, 333, 335.
[5] Lettres à une Inconnue, I, 8. «Défaites-vous de votre optimisme, et figurez-vous bien que nous sommes dans ce momie pour nous battre envers et contre tous... Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de faire le mal pour le plaisir de le faire.»
Paris, jeudi.
J'ai reçu in due time votre lettre. Tout est mystérieux en vous, et les mêmes causes vous font agir précisément de la manière opposée à celle dont se conduiraient les autres mortelles. Vous allez à la campagne, bien;... c'est-à-dire que vous aurez tout le temps d'écrire; car, là, les journées sont longues, et le désœuvrement porte à écrire des lettres. En même temps, la surveillance et l'inquiétude de votre dragon étant moins gênées par les occupations réglées de la ville, vous aurez plus de questions à subir quand il vous arrivera des lettres. D'ailleurs, dans un château, l'arrivée d'une lettre est un événement. Point du tout; vous ne pouvez pas écrire, mais, en revanche, vous pouvez recevoir force lettres. Je commence à me faire à vos façons et je ne suis plus guère surpris de rien. Au reste, je vous en prie, épargnez-moi et ne mettez pas à une trop rude épreuve cette malheureuse disposition que j'ai prise, je ne sais comment, de trouver bien tout ce qui est de vous.
J'ai souvenance d'avoir été peut-être un peu trop franc dans ma dernière lettre en vous parlant de mon caractère. Un vieux diplomate de mes amis, homme très-fin, m'a dit souvent: «Ne dites jamais de mal de vous-même. Vos amis en diront toujours assez.» Je commence à craindre que vous ne preniez au pied de la lettre tout le mal que je disais de moi-même. Figurez-vous que ma grande vertu, c'est la modestie; je la porte à l'excès et je tremble que cela ne me nuise dans votre esprit. Une autre fois, quand je me sentirai mieux inspiré, je vous ferai la nomenclature exacte de toutes mes qualités. La liste sera longue. Aujourd'hui, je suis un peu malade, et je n'ose me lancer dans cette «progression à l'infini».
Devinez en mille où j'étais samedi soir, ce que je faisais à minuit. J'étais sur la plate-forme d'une des tours de Notre-Dame, et je buvais de l'orangeade, et je prenais des glaces en compagnie de quatre de mes amis et d'une lune admirable; le tout accompagné d'un gros hibou qui battait des ailes autour de nous. C'est, en vérité, un fort beau spectacle que Paris au clair de lune et à cette heure. Cela ressemble à ces villes dont on parle dans les Mille et une Nuits, où les habitants ont été enchantés pendant leur sommeil. Les Parisiens se couchent à minuit en général, bien sots en cela. Notre party était assez curieuse: il y avait quatre nations représentées, chacun pensant d'une manière différente. L'ennui, c'est qu'il y avait quelques-uns de nous qui, en présence de la lune et du hibou, se sont crus obligés de prendre le ton poétique et de dire des lieux communs. Au fait, peu à peu tout le monde s'est mis à déraisonner.
Je ne sais comment et par quel enchaînement d'idées cette soirée semi-poétique me fait penser à une autre qui ne l'était pas du tout. J'ai été à un bal donné par des jeunes gens de mes amis, où étaient invitées toutes les figurantes de l'Opéra. Ces femmes sont bêtes pour la plupart; mais j'ai remarqué combien elles sont supérieures en délicatesse morale aux hommes de leur classe. Il n'y a qu'un seul vice qui les sépare des autres femmes: c'est la pauvreté. Toutes ces rhapsodies vont vous édifier singulièrement. Aussi je me hâte de terminer, ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt.
Adieu. Ne m'en voulez pas pour la peinture peu flattée que je vous ai faite de moi-même.
Paris.
La franchise et la vérité sont rarement bonnes auprès des femmes, elles sont presque toujours mauvaises. Voilà que vous me regardez comme un Sardanapale, parce que j'ai été à un bal de figurantes d'Opéra. Vous me reprochez cette soirée comme un crime, et vous me reprochez comme un plus grand crime encore de faire l'éloge de ces pauvres filles. Je le répète, rendez-les riches, et il ne leur restera plus que leurs bonnes qualités. Mais l'aristocratie a élevé des barrières insurmontables entre les différentes classes de la société, afin qu'on ne puisse voir combien ce qui se passe au delà de la barrière ressemble à ce qui se passe en deçà. Je veux vous conter une histoire d'Opéra que j'ai apprise dans cette société si perverse. Dans une maison de la rue Saint-Honoré, il y avait une pauvre femme qui ne sortait jamais d'une petite chambre sous les toits, qu'elle louait moyennant 3 francs par mois. Elle avait une fille de douze ans toujours très-bien tenue, très-réservée et qui ne parlait à personne. Cette petite sortait trois fois la semaine dans l'après-midi, et rentrait seule à minuit. On sut quelle était figurante à l'Opéra. Un jour, elle descend chez le portier et demande une chandelle allumée. On la lui donne. La portière, surprise de ne pas la voir redescendre, monte à son grenier, trouve la femme morte sur son grabat, et la petite fille occupée à brûler une énorme quantité de lettres qu'elle tirait d'une fort grande malle. Elle dit: «Ma mère est morte cette nuit, et elle m'a chargée de brûler toutes ses lettres sans les lire.» Cette enfant n'a jamais su le véritable nom de sa mère; elle se trouve maintenant absolument seule au monde, et n'ayant d'autre ressource que celle de faire les vautours, les singes ou les diables à l'Opéra.
Le dernier conseil de sa mère a été pour l'engager à être bien sage et à continuer à être figurante à l'Opéra. Elle est d'ailleurs fort sage, très-dévote et ne se soucie guère de raconter son histoire. Veuillez me dire si cette petite fille n'a pas infiniment plus de mérite à mener la vie qu'elle mène, que vous n'en avez, vous qui jouissez du bonheur singulier d'un entourage irréprochable et d'une nature si raffinée, quelle résume un peu pour moi toute une civilisation. Il faut vous dire la vérité. Je ne supporte la mauvaise société qu'à de rares intervalles, et par une curiosité inépuisable de toutes les variétés de l'espèce humaine. Je n'ose jamais aborder la mauvaise société en hommes. Il y a là quelque chose de trop repoussant, surtout chez nous; car, en Espagne, j'ai toujours eu des muletiers et des toreros pour amis. J'ai mangé plus d'une fois à la gamelle avec des gens qu'un Anglais ne regarderait pas, de peur de perdre le respect qu'il a pour son propre œil. J'ai même bu à la même outre qu'un galérien. Il faut dire aussi qu'il n'y avait que cette outre et qu'il faut boire quand on a soif.—Ne croyez pas pour cela que j'aie une prédilection pour la canaille. J'aime simplement à voir d'autres mœurs, d'autres figures, à entendre un autre langage. Les idées sont toujours les mêmes, et, si l'on fait abstraction de tout ce qui est convention ou règle, je crois qu'il y a du savoir-vivre ailleurs que dans un salon du faubourg Saint-Germain. Tout cela est de l'arabe pour vous, et je ne sais pourquoi je vous le dis.
8 août.
J'ai été longtemps sans finir cette lettre. Ma mère a été fort malade et moi très-inquiet. Elle est maintenant hors de danger, et j'espère que, dans quelques jours, elle sera en parfaite santé. Je ne puis supporter l'inquiétude, et, pendant le temps du danger, j'ai été tout à fait bête.
Adieu.
P.-S.—L'aquarelle que je vous destinais ne tourne pas à bien, et je
la trouve si mauvaise, qu'il est probable que je ne vous l'enverrai
pas. Que cela ne vous empêche pas de me donner la tapisserie que
vous me destinez. Tâchez de choisir un messager sûr. Règle générale:
ne prenez jamais une femme pour confidente; tôt ou tard, vous vous
en repentiriez. Sachez aussi qu'il n'y a rien de plus commun que de
faire le mal pour le plaisir de le faire. Défaites-vous de vos idées
d'optimisme et figurez-vous bien que nous sommes dans ce monde pour
nous battre envers et contre tous. À ce propos, je vous dirai qu'un
savant de mes amis, qui lit les hiéroglyphes, m'a dit que, sur les
cercueils égyptiens, on lisait très-souvent ces deux mots: Vie;
guerre; ce qui prouve que je n'ai pas inventé la maxime que je viens
de vous donner. Cela s'écrit en hiéroglyphe de la sorte
![]() . Le
premier caractère veut dire vie; il représente, je crois, un de ces
vases appelés canopes. L'autre est une abréviation d'un bouclier avec
un bras tenant un lance. There's science for you.
. Le
premier caractère veut dire vie; il représente, je crois, un de ces
vases appelés canopes. L'autre est une abréviation d'un bouclier avec
un bras tenant un lance. There's science for you.
Adieu encore.
Paris.
Vos reproches me font grand plaisir. En vérité, je suis prédestiné des fées. Je me demande souvent ce que je suis pour vous et ce que vous êtes pour moi. À la première question, je ne puis avoir de réponse; pour la seconde, je me figure que je vous aime comme une nièce de quatorze ans que j'élèverais. Quant à votre parent si moral qui dit tant de mal de moi, il me fait penser à Twachum, qui dit toujours: Can any virtue exist without religion? Avez-vous lu Tom Jones, livre aussi immoral que tous les miens ensemble. Si on vous l'a défendu, vous l'aurez lu très-certainement. Quelle drôle d'éducation vous recevez en Angleterre! À quoi sert-elle? On s'essouffle à prêcher pendant longtemps une jeune fille, et il est arrivé ce résultat que cette jeune fille a désiré précisément connaître l'être immoral pour lequel on s'était flatté de lui imposer de l'aversion. Quelle admirable histoire que celle du serpent! Je voudrais que lady M... lût cette lettre. Heureusement qu'elle s'évanouirait vers la dixième ligne.
En tournant la page, je relis ce que je viens de vous écrire, et il m'a semblé qu'il y avait en apparence peu de suite et d'enchaînement dans les idées. Erreur! Mais j'écris à mesure que je pense, et, comme ma pensée va plus vite que ma plume, il en résulte que je suis obligé de supprimer toutes les transitions. Je devrais peut-être faire comme vous et biffer toute la première page; mais j'aime mieux l'abandonner à vos méditations et à vos papillotes. Il faut vous dire aussi que je suis très-préoccupé en ce moment d'une affaire qui m'intéresse et qui, je l'avoue à ma honte, réside opiniâtrément dans une moitié de mon cerveau, tandis que l'autre est toute remplie de vous. J'aime assez le portrait que vous faites de vous-même. Il ne me paraît pas trop flatté, et tout ce que je connais de vous me plaît prodigieusement. . . . . .
. . . . . . .
Je vous étudie avec une vive curiosité. J'ai des théories sur les plus petites choses, sur les gants, sur les bottines, sur les boucles, etc., et j'attache beaucoup d'importance à tout cela, parce que j'ai découvert qu'il y a un rapport certain entre le caractère des femmes et le caprice (ou la liaison d'idées et le raisonnement, pour mieux dire) qui leur fait choisir telle ou telle étoffe. Ainsi, par exemple, on me doit d'avoir démontré qu'une femme qui porte des robes bleues est coquette et affecte le sentiment. La démonstration est facile, mais elle serait trop longue. Comment voulez-vous que je vous envoie une aquarelle détestable plus grande que cette lettre et qu'on ne peut rouler ni ployer? Attendez que je vous en fasse une plus petite que je pourrai vous envoyer dans une lettre.
J'ai été l'autre jour faire une promenade en bateau. Il y avait sur la rivière une grande quantité de petits canots à voile portant toute sorte de gens. Il y en avait un fort grand dans lequel étaient plusieurs femmes (de celles qui ont mauvais ton). Tous ces canots avaient abordé, et du plus grand sort un homme d'une quarantaine d'années, qui avait un tambour et qui tambourinait pour s'amuser. Tandis que j'admirais l'organisation musicale de cet animal, une femme de vingt-trois ans à peu près s'approche de lui, l'appelle monstre, lui dit qu'elle l'avait suivi depuis Paris et que, s'il ne voulait pas l'admettre dans sa société, il s'en repentirait. Tout cela se passait sur le rivage dont notre canot était éloigné de vingt pas. L'homme au tambour tambourinait toujours pendant le discours de la femme délaissée, et lui répondait avec beaucoup de flegme qu'il ne voulait pas d'elle dans son bateau. Là-dessus, elle court au canot qui était amarré le plus loin du rivage et s'élance dans la rivière en nous éclaboussant indignement. Bien qu'elle eût éteint mon cigare, l'indignation ne m'empêcha pas, non plus que mes amis, de la retirer aussitôt, avant qu'elle en pût avaler deux verres. Le bel objet de tant de désespoir n'avait pas bougé et marmottait entre ses dents: «Pourquoi la retirer, si elle avait envie de se noyer?» Nous avons mis la femme dans un cabaret, et, comme il se faisait tard et que l'heure du dîner approchait, nous l'avons abandonnée aux soins de la cabaretière.
Comment se fait-il que les hommes les plus indifférents soient les plus aimés? C'est ce que je me demandais, tout en descendant la Seine, ce que je me demande encore, et ce que je vous prie de me dire, si vous le savez.
Adieu. Écrivez-moi souvent, soyons amis et excusez le décousu de ma lettre. Je vous expliquerai un jour pourquoi.
Mariquita de mi alma (c'est ainsi que je commencerais si nous étions
à Grenade), j'ai reçu votre lettre dans un de ces moments de mélancolie
où l'on ne voit la vie qu'au travers d'un verre noir. Comme votre
épître n'est pas des plus aimables (excusez ma franchise), elle n'a pas
peu contribué à me maintenir dans une disposition maussade. Je voulais
vous répondre dimanche, immédiatement et sèchement. Immédiatement,
parce que vous m'aviez fait une espèce de reproche indirect, et
sèchement parce que j'étais furieux contre vous. J'ai été dérangé
au premier mot de ma lettre, et ce dérangement m'a empêché de vous
écrire. Remerciez-en le bon Dieu, car aujourd'hui le temps est beau;
mon humeur s'est adoucie tellement, que je ne veux plus vous écrire
que d'un style tout de miel et de sucre. Je ne vous querellerai donc
pas sur vingt ou trente passages de votre dernière lettre qui m'ont
fort choqué et que je veux bien oublier. Je vous pardonne, et cela
avec d'autant plus de plaisir qu'en vérité, je crois que, malgré la
colère, je vous aime mieux quand vous êtes boudeuse que dans une autre
disposition d'esprit. Un passage de votre lettre m'a fait rire tout
seul comme un bienheureux pendant dix minutes. Vous me dites short
and sweet: Mon amour est promis, sans préparation, pour amener le
gros coup de massue par quelques petites hostilités préalables. Vous
dites que vous êtes engagée pour la vie, comme vous diriez: «Je suis
engagée pour la contredanse.» Fort bien. À ce qu'il paraît, j'ai bien
employé mon temps à disputer avec vous sur l'amour, le mariage et le
reste; vous en êtes encore à croire ou à dire que, lorsqu'on vous
dit: «Aimez monsieur,» on aime. Avez-vous promis par un engagement
signé par-devant notaire ou sur papier à vignettes? Quand j'étais
écolier, je reçus d'une couturière un billet surmonté de deux cœurs
enflammés réunis comme il suit: ![]() ;
de plus, une déclaration
fort tendre. Mon maître d'études commença par me prendre mon billet,
et l'on me mit en prison. Puis l'objet de cette naissante passion
se consola avec le cruel maître d'études. Il n'y a rien qui soit
plus fatal que les engagements pour ceux au profit desquels ils sont
souscrits. Savez-vous que, si votre amour était promis, je croirais
sérieusement qu'il vous serait impossible de ne pas m'aimer? Comment ne
m'aimeriez-vous pas, vous qui ne m'avez pas fait de promesses, puisque
la première loi de la nature, c'est de prendre en grippe tout ce qui
a l'air d'une obligation? Et, en effet, toute obligation est de sa
nature ennuyeuse. Enfin, de tout cela, si j'avais moins de modestie,
je tirerais cette dernière conséquence, que, si vous avez promis votre
amour à quelqu'un, vous me le donnerez, à moi, à qui vous n'avez rien
promis. Plaisanterie à part et à propos de promesses, depuis que
vous ne voulez plus de mon aquarelle, j'ai assez grande envie de vous
l'envoyer. J'en étais mécontent et j'avais commencé une copie d'une
infante Marguerite, d'après Velasquez, que je voulais vous donner.
Velasquez ne se copie pas facilement, surtout par des barbouilleurs
comme moi. J'ai recommencé deux fois mon infante, mais à la fin j'en
suis encore plus mécontent que du moine. Le moine est donc à vos
ordres. Je vous l'enverrai quand vous voudrez. Mais son transport
est peu commode. Ajoutez à cela que les invisibles qui s'amusent
quelquefois à intercepter nos communications pourront peut-être bien
garder mon aquarelle. Ce qui me rassure, c'est qu'elle est si mauvaise,
qu'il faut être moi pour la faire, et vous pour en vouloir. Donnez-moi
vos ordres. J'espère que vous serez à Paris vers le milieu d'octobre.
Je me trouverai maître de quinze ou vingt jours à cette époque. Je
ne voudrais pas les passer en France, et depuis longtemps j'avais
l'intention de voir les tableaux de Rubens à Anvers et la galerie
d'Amsterdam. Mais, si j'avais la certitude de vous voir, je renoncerais
à Rubens et à Van Dyck avec la plus facile résignation. Vous voyez
que les sacrifices ne me coûtent pas. Je ne connais pas Amsterdam.
Pourtant, décidez. Votre vanité va vous faire dire ici: «Le beau
sacrifice de ne me préférer qu'à de grosses Flamandes bien blanches et
bien harengères, et en peinture encore!» Oui, c'est un sacrifice et
un très-grand. Je sacrifie le certain, qui est le plaisir, chez moi
très-vif, de voir des tableaux de maître, à la chance très-incertaine
que vous le compenserez. Observez que, sans admettre le cas impossible
où vous ne me plairiez pas, si moi je vous déplaisais, j'aurais tout
lieu de regretter mes travaux et mes grosses Flamandes...
;
de plus, une déclaration
fort tendre. Mon maître d'études commença par me prendre mon billet,
et l'on me mit en prison. Puis l'objet de cette naissante passion
se consola avec le cruel maître d'études. Il n'y a rien qui soit
plus fatal que les engagements pour ceux au profit desquels ils sont
souscrits. Savez-vous que, si votre amour était promis, je croirais
sérieusement qu'il vous serait impossible de ne pas m'aimer? Comment ne
m'aimeriez-vous pas, vous qui ne m'avez pas fait de promesses, puisque
la première loi de la nature, c'est de prendre en grippe tout ce qui
a l'air d'une obligation? Et, en effet, toute obligation est de sa
nature ennuyeuse. Enfin, de tout cela, si j'avais moins de modestie,
je tirerais cette dernière conséquence, que, si vous avez promis votre
amour à quelqu'un, vous me le donnerez, à moi, à qui vous n'avez rien
promis. Plaisanterie à part et à propos de promesses, depuis que
vous ne voulez plus de mon aquarelle, j'ai assez grande envie de vous
l'envoyer. J'en étais mécontent et j'avais commencé une copie d'une
infante Marguerite, d'après Velasquez, que je voulais vous donner.
Velasquez ne se copie pas facilement, surtout par des barbouilleurs
comme moi. J'ai recommencé deux fois mon infante, mais à la fin j'en
suis encore plus mécontent que du moine. Le moine est donc à vos
ordres. Je vous l'enverrai quand vous voudrez. Mais son transport
est peu commode. Ajoutez à cela que les invisibles qui s'amusent
quelquefois à intercepter nos communications pourront peut-être bien
garder mon aquarelle. Ce qui me rassure, c'est qu'elle est si mauvaise,
qu'il faut être moi pour la faire, et vous pour en vouloir. Donnez-moi
vos ordres. J'espère que vous serez à Paris vers le milieu d'octobre.
Je me trouverai maître de quinze ou vingt jours à cette époque. Je
ne voudrais pas les passer en France, et depuis longtemps j'avais
l'intention de voir les tableaux de Rubens à Anvers et la galerie
d'Amsterdam. Mais, si j'avais la certitude de vous voir, je renoncerais
à Rubens et à Van Dyck avec la plus facile résignation. Vous voyez
que les sacrifices ne me coûtent pas. Je ne connais pas Amsterdam.
Pourtant, décidez. Votre vanité va vous faire dire ici: «Le beau
sacrifice de ne me préférer qu'à de grosses Flamandes bien blanches et
bien harengères, et en peinture encore!» Oui, c'est un sacrifice et
un très-grand. Je sacrifie le certain, qui est le plaisir, chez moi
très-vif, de voir des tableaux de maître, à la chance très-incertaine
que vous le compenserez. Observez que, sans admettre le cas impossible
où vous ne me plairiez pas, si moi je vous déplaisais, j'aurais tout
lieu de regretter mes travaux et mes grosses Flamandes...
Vous me paraissez dévote, superstitieuse même.—Je pense en ce moment à une jolie petite Grenadine qui, en montant sur son mulet pour passer dans la montagne de Ronda (route classique des voleurs), baisait dévotement son pouce et se frappait la poitrine cinq ou six fois, bien assurée après cela que les voleurs ne se montreraient pas, pourvu que l'Ingles (c'est-à-dire moi), tout voyageur est Anglais, ne jurât pas trop par la Vierge et les saints. Cette méchante manière de parler devient nécessaire dans les mauvais chemins pour faire aller les chevaux. Voyez Tristram Shandy. J'aime beaucoup votre histoire du portrait de cet enfant. Vous êtes faible et jalouse, deux qualités dans une femme et deux défauts dans un homme. Je les ai tous les deux. Vous me demandez qu'elle est l'affaire qui me préoccupe. Il faudrait vous dire quel est mon caractère et ma vie, chose dont personne ne se doute, parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui m'inspirât assez de confiance. Peut-être que, lorsque nous nous serons vus souvent, nous deviendrons amis et vous me connaîtrez; ce serait pour moi le bien le plus grand que quelqu'un à qui je pourrais dire toutes mes pensées passées et présentes. Je deviens triste, et il ne faut pas finir ainsi. Je suis dévoré du désir d'une réponse de vous. Soyez assez bonne pour ne pas me la faire attendre.
Adieu; ne nous querellons plus et soyons amis. Je baise respectueusement la main que vous me tendez en signe de paix.
25 septembre.
Votre lettre m'a trouvé malade et fort triste, fort occupé des plus ennuyeuses affaires du monde, et je n'ai pas le temps de me soigner. J'ai, je crois, une inflammation de poitrine qui me rend extrêmement maussade. Mais, dans quelques jours, je me propose de me dorloter et de me guérir.
Mon parti est pris. Je ne quitterai pas Paris en octobre, dans l'espérance que vous y reviendrez. Vous me verrez ou vous ne me verrez pas, à votre choix. La faute en sera à vous. Vous me parlez de raisons particulières qui vous empêchent de chercher à vous trouver avec moi. Je respecte les secrets et je ne vous demande pas vos motifs. Seulement, je vous prie de me dire really truly si vous en avez. N'êtes-vous pas plutôt préoccupée d'un enfantillage? Peut-être vous a-t-on fait, à mon sujet, quelque sermon dont vous êtes encore toute pénétrée. Vous auriez bien tort d'avoir peur de moi. Votre prudence naturelle entre sans doute pour beaucoup dans votre répugnance à me voir. Rassurez-vous, je ne deviendrai pas amoureux de vous. Il y a quelques années, cela aurait pu arriver; maintenant, je suis trop vieux et j'ai été trop malheureux. Je ne pourrais plus être amoureux, parce que mes illusions m'ont procuré bien des desengaños sur l'amour. J'allais être amoureux quand je suis parti pour l'Espagne. C'est une des belles actions de ma vie. La personne qui a causé mon voyage n'en a jamais rien su. Si j'étais resté, j'aurais peut-être fait une grande sottise: celle d'offrir à une femme digne de tout le bonheur dont on peut jouir sur terre, de lui offrir, dis-je, en échange de la perte de toutes les choses qui lui étaient chères, une tendresse que je sentais moi-même très-inférieure au sacrifice qu'elle aurait peut-être fait. Vous vous rappelez ma morale; «L'amour fait tout excuser, mais il faut être bien sûr qu'il y a de l'amour.» Soyez persuadée que ce précepte-là est plus rigoureux que ceux de vos méthodistes amis. Conclusion: je serai charmé de vous voir. Peut-être ferez-vous l'acquisition d'un véritable ami, et moi peut-être trouverai-je en vous ce que je cherche depuis longtemps: une femme dont je ne sois pas amoureux et en qui je puisse avoir de la confiance. Nous gagnerons probablement tous deux à notre connaissance plus approfondie. Faites pourtant ce que votre haute prudence vous conseillera.
Mon moine est prêt. À la première occasion, je vous enverrai donc ce moine et sa monture. L'infante n'étant pas achevée, et étant trop mal commencée pour être jamais terminée, restera où elle est et me servira de garde-main pour un dessin que je vous ferai quand j'aurai le temps. Je meurs d'envie de voir la surprise que vous me destinez, mais je me creuse la tête inutilement pour le deviner. Quand je vous écris, je néglige trop les transitions, artifice de style bien nécessaire. Je crains que vous ne trouviez cette lettre terriblement décousue. C'est qu'à mesure que j'écris une phrase, il m'en vient une autre à l'esprit, laquelle donne naissance à une troisième avant que la seconde soit terminée. Je souffre beaucoup ce soir. Si vous avez de l'influence là-haut, tâchez de m'obtenir un peu de santé ou tout au moins de résignation; car je suis le plus mauvais malade du monde, et je fais la mine à mes meilleurs amis. Quand je suis étendu sur mon canapé, je pense avec plaisir à vous, à notre mystérieuse connaissance, et il me semble que je serais bien heureux de causer avec vous autant à bâtons rompus que je vous écris; et encore songez qu'il y a cet avantage que les paroles volent et que les écrits restent.
Au surplus, ce n'est pas l'idée d'être un jour imprimé tout vif ou posthume qui me tourmente. Adieu; plaignez-moi. Je voudrais avoir le courage de vous dire mille choses qui me rendent cette vie triste. Mais comment vous les dire de si loin? Quand donc viendrez-vous? Adieu encore une fois. Vous voyez que, si le cœur vous en dit, vous avez tout le temps de m'écrire.
P.-S.—26 septembre.—Je suis encore plus triste qu'hier. Je souffre horriblement. Mais, si vous n'avez jamais éprouvé par vous-même ce que c'est qu'une gastrite, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'une douleur vague qui est très-vive pourtant. Elle a cela de particulier qu'elle agit sur tout le système nerveux. Je voudrais bien être à la campagne avec vous; vous me guéririez, j'en suis sûr. Adieu. Si je meurs cette année, vous aurez le regret de ne m'avoir guère connu.
Savez-vous que vous êtes quelquefois bien aimable? Je ne dis pas cela pour vous faire un reproche sous un froid compliment; mais je voudrais bien recevoir souvent de vous des lettres comme la dernière. Malheureusement, vous n'êtes pas toujours pour moi dans d'aussi charitables dispositions. Je ne vous ai pas répondu plus tôt parce que votre lettre ne m'a été remise qu'hier soir, à mon retour d'une petite excursion que j'ai faite. J'ai passé quatre jours dans une solitude absolue et ne voyant pas un homme, encore moins une femme, car je n'appelle pas hommes ou femmes certains bipèdes qui sont dressés à apporter à manger et à boire quand on leur en donne l'ordre. J'ai fait, pendant cette retraite, les réflexions les plus tristes du monde, sur moi, sur mon avenir, sur mes amis, etc. Si j'avais eu l'esprit d'attendre votre lettre, elle aurait donné une tout autre tournure à mes idées. «J'aurais emporté du bonheur pour une semaine au moins.» J'admire beaucoup votre descente chez ce brave M. Y... Votre courage me plaît singulièrement. Je ne vous aurais jamais crue capable d'un tel capricho, et je vous en aime encore davantage. Il est vrai que le souvenir de vos splendid black eyes est peut-être pour quelque chose dans mon admiration. Pourtant, vieux comme je suis, je suis presque insensible à la beauté. Je me dis que «cela ne gâte rien»; mais je vous assure qu'en entendant dire par un homme très-difficile que vous étiez fort jolie, je n'ai pu me défendre d'un sentiment de tristesse. Voici pourquoi (d'abord persuadez-vous bien que je ne suis pas le moins du monde amoureux de vous): je suis horriblement jaloux, jaloux de mes amis, et je m'afflige en pensant que votre beauté vous expose aux soins et aux attentions d'un tas de gens qui ne peuvent vous apprécier et qui ne voient en vous que ce qui m'occupe le moins. En vérité, je suis d'une humeur affreuse en pensant à cette cérémonie où vous allez assister. Rien ne me rend plus mélancolique qu'un mariage. Les Turcs, qui marchandent une femme en l'examinant comme un mouton gras, valent bien mieux que nous qui avons mis sur ce vil marché un vernis d'hypocrisie, hélas! bien transparent. Je me suis demandé bien souvent ce que je pourrais dire à une femme le premier jour de ma noce, et je n'ai rien trouvé de possible, si ce n'est un compliment sur son bonnet de nuit. Le diable, heureusement, est bien fin s'il m'attrape à pareille fête. Le rôle de la femme est bien plus facile que celui de l'homme. Un jour comme celui-là, elle se modèle sur l'Iphigénie de Racine; mais, si elle observe un peu, que de drôles de choses elle doit voir!—Vous me direz si la fête a été belle. On va vous faire la cour et vous régaler d'allusions au bonheur domestique. Les Andalous disent, quand ils sont en colère: Mataria el sol à puñaladas si no fuese por miedo de dejar el mundo a oscuras!
Depuis le 28 septembre, jour de ma naissance, une suite non interrompue de petits malheurs est venue m'assaillir. Ajoutez à cela que ma poitrine va de mal en pis et que je souffre horriblement. Je retarderai mon voyage en Angleterre jusqu'au milieu de novembre. Si vous ne voulez pas me voir à Londres, il faut y renoncer; mais je veux voir les élections. Je vous rattraperai bientôt après à Paris, où le hasard nous rapprochera si votre volonté persiste à nous séparer. Toutes vos raisons sont pitoyables et ne valent pas la peine d'être réfutées, d'autant plus que vous savez bien vous-même qu'elles n'ont aucune importance. Vous faites la railleuse quand vous dites si agréablement que vous avez peur de moi. Vous savez que je suis laid et très-capricieux d'humeur, toujours distrait et souvent taquin et méchant lorsque je souffre. Qu'y a-t-il là qui ne soit bien rassurant?—Vous ne vous éprendrez jamais de moi, soyez tranquille. Les prédictions confiantes que vous me faites ne peuvent se réaliser. Vous n'êtes pas pythonisse. Or, en vérité, les chances de mort pour moi sont augmentées cette année. Rassurez-vous pour vos lettres. Tout ce qui se trouve d'écrit dans ma chambre sera brûlé après ma mort; mais, pour vous faire enrager, je vous laisserai par testament une suite manuscrite de la guzla qui vous a tant fait rire. Vous participez de l'ange et du démon, mais beaucoup plus du dernier. Vous m'appelez tentateur. Osez dire que ce nom ne vous convient pas beaucoup mieux qu'à moi! N'avez-vous pas jeté un appât à moi, pauvre petit poisson; puis, maintenant que vous me tenez au bout de votre hameçon, vous me faites danser entre le ciel et l'eau jusqu'à ce qu'il vous plaise, quand vous serez lasse du jeu, de couper le fil; et alors j'en serai pour l'hameçon dans le bec et je ne pourrai plus trouver le pêcheur. Je vous sais gré de votre franchise à m'avouer que vous avez lu la lettre que M. V... m'écrivait et dont il vous avait chargée. Je l'avais bien deviné, car, depuis Ève, toutes se ressemblent en ce point. J'aurais voulu que cette lettre fût plus intéressante; mais je suppose que, malgré ses lunettes, vous trouvez M. V... homme de goût. Je deviens méchant parce que je souffre. Je pense à la promesse que vous m'avez faite d'un schizzo,—promesse que vous m'avez faite sans que je l'eusse sollicitée,—et je me sens radouci. J'attends le schizzo avec la plus grande dévotion.—Adieu, niña de mis ojos; je vous promets de n'être jamais amoureux de vous. Je ne veux plus être amoureux, mais je voudrais avoir un ami féminin. Si je vous voyais souvent, et si vous êtes telle que je le crois, je vous aimerais bien de vraie et platonique amitié. Tâchez donc de faire en sorte que nous puissions nous voir quand vous serez à Paris. Faudra-t-il que nous attendions une réponse pendant des jours entiers? Adieu encore une fois. Plaignez-moi, car je suis bien triste et j'ai mille raisons pour l'être.
Lady M... m'a annoncé hier au soir que vous alliez vous marier. Cela étant, brûlez mes lettres; je brûle les vôtres, et adieu. Je vous ai déjà parlé de mes principes. Ils ne me permettent pas de rester en relation avec une dame que j'ai connue demoiselle, avec une veuve que j'ai connue mariée. J'ai remarqué que, l'état civil d'une femme étant changé, les rapports changent aussi, et toujours pour le pire. Bref, à tort ou à raison, je ne puis souffrir que mes amies se marient. Donc, si vous vous mariez, oublions-nous. Je vous en conjure, n'ayez point recours à une de vos échappatoires ordinaires et répondez-moi franchement.
Je vous proteste que, depuis le 28 septembre, je n'ai eu que des contrariétés et des chagrins de toute espèce. Votre mariage était encore dans les fatalités qui devaient tomber sur moi. L'autre nuit, ne pouvant dormir, je repassais dans mon esprit toutes les misères dont j'ai été accablé depuis quinze jours, et je n'y trouvais qu'une seule compensation, qui était votre aimable lettre et la promesse non moins aimable que vous me faisiez d'un schizzo. C'est bien maintenant que j'ai envie de poignarder le soleil, comme disent les Andalous. Mariquita de mi vida (laissez-moi vous appeler ainsi jusqu'à vos noces), j'avais une pierre superbe, bien taillée, brillante, scintillante, admirable sur tous points. Je la croyais un diamant que je n'aurais pas troqué pour celui du Grand Mogol.—Pas du tout! voilà qu'il se trouve que ce n'est qu'une pierre fausse. Un chimiste de mes amis vient de m'en faire l'analyse. Figurez-vous un peu mon désappointement. J'ai passé bien du temps à penser à ce prétendu diamant et au bonheur de l'avoir trouvé.
Maintenant, il faut que je passe autant de temps (encore plus) à me persuader que ce n'était qu'une pierre fausse.
Tout cela n'est qu'un apologue. J'ai dîné avant-hier avec le diamant faux et je lui ai fait une mine de chien. Quand je suis en colère, j'ai assez en main la figure de rhétorique appelée ironie, et j'ai fait au diamant un éloge de ses belles qualités le plus ampoulé que j'ai pu et avec un sang-froid bien glacial. Je ne sais, en vérité, pourquoi je vous dis tout cela! surtout si nous allons nous oublier prochainement. En attendant, je vous aime toujours et je me recommande à vos prières,—angel in thy orisons, etc.
Vendredi prochain, votre dessin partira par un courrier et se trouvera sans doute dimanche à Londres. Vous pourrez l'envoyer réclamer mardi chez M. V..., Pall-Mall.
Excusez la démence de cette lettre, j'ai de tristes affaires en tête.
Mon cher ami féminin,
Nous devenons fort tendres. Vous me dites: Amigo de mi alma; ce qui est fort joli dans une bouche féminine. Votre lettre ne me donne pas de nouvelles de votre santé. Vous me disiez dans l'avant-dernière lettre que mon ami féminin était malade, et vous auriez dû savoir que j'en étais en peine. Ayez plus d'exactitude à l'avenir. C'est bien à vous à vous plaindre de mes réticences, vous qui êtes le mystère incarné! Que voulez-vous de plus sur l'histoire du diamant, si ce n'est son nom? Des détails peut-être; mais ils seraient ennuyeux à écrire, et ils vous amuseront peut-être un jour que nous ne trouverons rien à nous dire, assis face à face, chacun dans un fauteuil au coin du feu. Écoutez le rêve que j'ai fait il y a deux nuits, et, si vous êtes sincère, interprétez-le. Methought que nous étions tous les deux à Valence, dans un beau jardin avec force oranges, grenades, etc. Vous étiez assise sur un banc adossé à une haie. En face était un mur de quelque six pieds qui séparait le jardin d'un jardin voisin beaucoup plus bas. Moi, j'étais en face de vous, et nous causions en Valencien, à ce qu'il me semblait.—Nota bene que je n'entends le valencien qu'avec beaucoup de peine. Quelle diable de langue parle-t-on en rêve quand on parle une langue qu'on ne sait pas? Par désœuvrement, et comme c'est mon habitude, je montai sur une pierre et je regardai dans le jardin d'en bas. Il y avait un banc aussi adossé contre le mur, et sur ce banc une espèce de jardinier valencien et mon diamant écoutant le jardinier, qui jouait de la guitare. Cette vue me mit à l'instant de très-mauvaise humeur, mais je n'en montrai rien d'abord. Le diamant leva la tête, me vit avec surprise, mais ne bougea pas et ne parut pas autrement déconcerté. Après quelque temps, je descendis de ma pierre et je vous dis, de l'air du monde le plus naturel et sans vous parler du diamant, que nous pouvions faire une excellente plaisanterie qui serait de jeter une grosse pierre par-dessus la crête du mur. Cette pierre était fort lourde. Vous fûtes très-empressée à m'aider, et, sans me faire de questions (ce qui n'est pas naturel), à force de pousser, nous parvînmes à poser la pierre sur le haut du mur et nous nous apprêtions à la précipiter, lorsque le mur lui-même céda, s'écroula, et nous tombâmes tous les deux avec la pierre et les débris du mur. J'ignore la suite, car je me réveillai. Pour vous faire mieux comprendre la scène, je vous envoie un dessin. Je n'ai pu voir la figure du jardinier, dont j'enrage.
Vous êtes bien aimable, je vous le dis souvent depuis quelque temps. Vous êtes bien aimable d'avoir répondu à la question que je vous ai adressée dernièrement. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre réponse m'a plu. Vous m'avez dit même, et peut-être involontairement, plusieurs choses qui m'ont fait plaisir, et surtout que le mari d'une femme qui vous ressemblerait vous inspirerait une véritable compassion. Je le crois sans beaucoup de peine, et j'ajoute qu'il n'y aurait personne de plus malheureux, si ce n'est un homme qui vous aimerait. Vous devez être froide et moqueuse dans vos mauvaises humeurs, avec une fierté insurmontable qui vous empêche de dire: «J'ai tort.» Ajoutez à cela l'énergie de votre caractère qui doit vous faire mépriser les larmes et les plaintes. Lorsque, par la suite du temps et la force des choses, nous serons amis, c'est alors que l'on verra lequel de nous deux sait le mieux tourmenter l'autre. Les cheveux m'en dressent à la tête rien que d'y penser. Ai-je bien interprété votre mais? Soyez sûre que, malgré vos résolutions, nos fils sont trop mêlés pour que nous ne nous retrouvions pas dans le monde quelque jour. Je meurs d'envie de causer avec vous. Il me semble que je serais parfaitement heureux si je savais que je vous verrai ce soir.
À propos, vous avez tort de suspecter la curiosité de M. V... Fût-elle égale à la vôtre, ce qui n'est pas possible, M. V... est un Caton, et il mettrait bon ordre à ce qu'il n'y eût pas de bris de scellés. Ainsi, envoyez-lui le schizzo sous cachet et ne craignez aucune indiscrétion de sa part. Je voudrais vous voir au moment où vous écrivez: Amigo de mi alma. Quand vous ferez faire votre portrait pour moi, dites cela intérieurement, au lieu de «petite pomme d'api», comme disent les dames qui veulent donner à leur bouche un tour gracieux.—Faites donc que nous nous voyions sans mystère et comme de bons amis. Vous serez sans doute désolée d'apprendre que je me porte fort mal et que je m'ennuie horriblement. Venez bientôt à Paris, chère Mariquita, et rendez-moi amoureux. Je ne m'ennuierai plus alors, et, pour la peine, je vous rendrai bien malheureuse par mes humeurs. Depuis quelque temps, votre écriture devient bien lâche et vos lettres bien courtes. Je suis très-convaincu que vous n'avez d'amour pour personne et que vous n'en aurez jamais. Cependant, vous comprenez assez bien la théorie.
Adieu; je fais tous les souhaits possibles pour votre santé, pour votre bonheur, pour que vous ne vous mariiez pas, pour que vous veniez à Paris, enfin pour que nous devenions amis.
Mariquita de mi alma, je suis bien triste d'apprendre votre indisposition. J'espère que, lorsque cette lettre vous parviendra, vous serez entièrement rétablie et en état de m'écrire de plus longues lettres. Votre dernière était d'une brièveté désespérante et d'une sécheresse à laquelle j'étais autrefois accoutumé de votre part, mais qui m'est maintenant plus pénible que vous ne sauriez croire. Écrivez-moi longuement et dites-moi bien des choses aimables. Qu'est-ce que votre maladie? Avez-vous quelque contrariété ou des chagrins de cœur? Il y a dans votre dernier billet quelques phrases mystérieuses comme toutes vos phrases qui sembleraient l'annoncer. Mais, entre nous, je ne crois pas que vous ayez encore la jouissance de ce viscère nommé cœur. Vous avez des peines de tête, des plaisirs de tête; mais le viscère nommé cœur ne se développe que vers vingt-cinq ans, au 46e degré de latitude. Vous allez froncer vos beaux et noirs sourcils et vous direz: «L'insolent doute que j'aie un cœur!» car c'est la grande prétention maintenant. Depuis que l'on a fait tant de romans et de poëmes passionnés ou soi-disant tels, toutes les femmes prétendent avoir un cœur. Attendez encore un peu. Quand vous aurez un cœur pour tout de bon, vous m'en direz des nouvelles. Vous regretterez ce bon temps où vous ne viviez que par la tête, et vous verrez que les maux que vous souffrez maintenant ne sont que des piqûres d'épingle en comparaison des coups de poignard qui pleuvront sur vous quand le temps des passions sera venu.
Je me plaignais de votre lettre, qui renferme cependant quelque chose de fort aimable: c'est la promesse formelle et d'assez bonne grâce de m'envoyer votre portrait. Cela me fait beaucoup de plaisir, non-seulement parce que je vous connaîtrai mieux, mais surtout parce que vous me montrez ainsi plus de confiance. Je fais des progrès dans votre amitié et je m'en applaudis. Ce portrait, quand l'aurai-je? Voulez-vous me le donner dans la main? j'irai le prendre. Voulez-vous le donner à M. V..., qui me l'enverra avec la discrétion convenable? Ne craignez rien de lui ni de sa femme. J'aimerais mieux le tenir de votre blanche main. Je pars pour Londres au commencement du mois prochain. J'irai voir l'élection, je mangerai du white-bait fish à Blackwall; j'irai revoir les cartons de Hampton-Court, et je repartirai pour Paris. Si je vous voyais, je serais bien heureux, mais je n'ose l'espérer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez bien envoyer le schizzo sous enveloppe à M. V..., ainsi que vos lettres; je l'aurai assez promptement, car je serai à Londres, suivant toutes les apparences, le 8 décembre. Je vous ai reproché votre curiosité et votre indiscrétion quand vous avez ouvert la lettre de M. V...; mais, pour vous dire la vérité, il y a des défauts en vous qui me plaisent et votre curiosité est du nombre. J'ai bien peur que vous ne me preniez en grippe si nous nous voyons souvent et que le contraire n'arrive pour moi. Je pense en ce moment à l'expression de votre physionomie, qui est un peu dure, a lioness though tame.
Adieu; je baise mille fois vos pieds mystérieux.
Sans doute, sans doute, envoyez à M. V.., ce que vous me faites espérer depuis si longtemps. Joignez-y une lettre, une longue lettre, car, si vous m'écriviez à Paris, il est probable que je me croiserais avec elle. Prévenez M. V... qu'il garde cette lettre et le paquet et que j'irai le chercher chez lui en personne à la fin de la semaine prochaine. Ce qui serait encore plus aimable de votre part, et ce que vous n'écrivez pas, ce serait de me faire dire où et comment je pourrais vous voir. Au reste, je n'y compte pas et je vous connais trop bien pour attendre de vous cette preuve de courage. Je ne compte que sur le hasard, qui me donnera peut-être un talisman ou un peloton de fil.
Je vous écris couché sur un canapé et fort souffrant; couleur de pré brûlé par le soleil; c'est de moi et non du canapé que je vous donne la couleur. Il faut que vous sachiez que la mer me rend fort malade, et que the glad waters of the dark blue sea ne me sont agréables que lorsque je les vois du rivage. La première fois que je suis allé en Angleterre, j'avais été si malade, que je fus bien quinze jours avant de reprendre ma couleur ordinaire, qui est celle du cheval pâle de l'Apocalypse. Un jour que je dînais en face de madame V..., elle s'écria tout à coup: Until to day, I thought you were an Indian. Ne vous effrayez pas et ne me prenez pas pour un spectre.
Je vous demande pardon de vous parler toujours du diamant. Quels doivent être les sentiments de quelqu'un qui n'est pas connaisseur en pierres, à qui des joailliers ont dit: «Cette pierre est fausse,» et qui pourtant la voit briller admirablement; qui se dit quelquefois: «Si les joailliers ne se connaissaient pas en diamants! s'ils s'étaient trompés ou s'ils voulaient me tromper!» Je regarde donc de temps en temps (le moins que je puis) mon diamant, et, toutes les fois que je le regarde, je le trouve un vrai diamant en tous points. C'est dommage qu'il ne me soit pas possible de faire une expérience chimique concluante. Qu'en dites-vous? Si je vous voyais, je vous expliquerais ce que cette affaire a d'obscur et vous me donneriez quelque bon conseil ou, ce qui vaudrait peut-être mieux, vous me feriez oublier mon diamant vrai ou faux, car il n'y a pas de diamant qui soutienne la comparaison avec deux beaux yeux noirs. Adieu; j'ai horriblement mal au coude gauche, sur lequel je m'appuie pour vous écrire; et puis vous ne méritez pas qu'on vous écrive trois pages petit texte. Vous ne m'envoyez que quelques lignes d'écriture très-lâches, et, de vos trois lignes, il y en a toujours deux qui me mettent en colère.
Vous êtes charmante, chère marquise, trop charmante même. Je viens de recevoir le schizzo. Je possède à la fois votre portrait et votre confiance, double bonheur. Vous étiez en veine de bonté ce jour-là, car votre lettre était longue et aimable; seulement, elle a un défaut, c'est qu'elle ne conclut à rien. Vous verrai-je ou non? That is the question. Je sais bien, moi, comment la résoudre; mais vous ne voulez pas vous déterminer. Vous êtes, comme vous le serez toute votre vie, entre votre caractère et vos habitudes de couvent; tout le mal vient de là. Je vous jure que, si vous ne me permettez pas de vous faire visite, j'irai vous demander de vos nouvelles de la part de madame D... À ce propos, madame D... doit vous rendre un favorable témoignage de ma discrétion. J'ai même résisté à un désir que je sentais au bout de mes doigts pour ouvrir le paquet qui m'apportait le schizzo. Admirez-moi.
Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous voie à la promenade par exemple, ou bien mieux au British Museum ou à la galerie Ingerstein? J'ai un ami à côté de moi qui est fort intrigué du paquet énorme que j'ai été décacheter loin de lui, et du changement que son arrivée a produit dans mon moral. Je ne lui ai rien dit qui pût l'approcher de la vérité, mais il me paraît pourtant sur la voie. Adieu; je voulais vous dire que le schizzo était arrivé à bon port et qu'il m'a fait le plus grand plaisir. Écrivons-nous souvent à Londres si nous ne nous voyons pas...
Londres, 10 décembre.
Dites-moi, au nom de Dieu, «si vous êtes de Dieu», querida Mariquita, pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma lettre? Votre avant-dernière, et surtout le schizzo qui l'accompagnait, m'avaient mis dans un tel flutter, que ce que je vous ai écrit tout d'abord n'avait pas trop le sens commun. Maintenant que je suis plus rassis et que quelques jours de séjour à Londres m'ont considérablement rafraîchi la cervelle, je vais essayer de raisonner avec vous. Pourquoi ne voulez-vous pas me voir? Personne de votre entourage ne me connaît, et ma visite serait fort vraisemblable. Votre principal motif paraît être la peur de faire quelque chose d'improper, comme on dit ici. Je ne prends pas au sérieux ce que vous dites de la crainte que vous avez de perdre vos illusions sur moi en me connaissant davantage. Si c'était là votre véritable motif, vous seriez la première femme, le premier être humain qu'une considération semblable aurait empêché de satisfaire son désir ou sa curiosité. Venons à l'impropriété. La chose est-elle improper en elle-même? Non, car il n'y a rien de plus simple. Vous savez d'avance que je ne vous mangerai pas. La chose n'est donc improper—si improper elle est—que pour le monde. Remarquez en passant que ce mot monde nous rend malheureux depuis le jour où on nous met des habits incommodes, parce que le monde le veut ainsi, jusqu'au jour de notre mort.
. . . . . . .
En m'envoyant votre portrait, il me semble que vous m'avez donné la preuve que vous m'estimiez assez pour croire à ma discrétion. Pourquoi n'y croiriez-vous plus? La discrétion d'un homme, et la mienne en particulier, est d'autant plus grande qu'on lui demande davantage. Cela posé, et vous étant sûre de ma discrétion, vous pouvez me voir, et le monde n'est pas plus avancé qu'il ne l'est maintenant, et il ne peut par conséquent crier à l'impropriété. J'ajouterai encore, et la main sur la conscience (c'est-à-dire à gauche), que je ne vois pas, quant à moi, la moindre inconvenance là-dedans. Je dirai plus. Si cette correspondance doit se continuer sans que nous nous voyions jamais, elle devient la chose la plus absurde qu'il y ait au monde. J'abandonne tout cela à vos réflexions.
Si j'étais plus fat, je me réjouirais de ce que vous me dites de mon diamant. Mais nous ne pouvons jamais nous aimer d'amour. Je parle de vous et de moi. Notre connaissance n'a pas commencé d'une manière qui puisse nous mener là. Elle est beaucoup trop romantique. Quant au diamant, mon compagnon de voyage, tout en fumant son cigare, me parlait d'elle sans savoir que je m'y intéressais et me disait de bien tristes choses. Il paraît ne pas douter de sa fausseté. Chère Mariquita, vous dites que vous ne voulez jamais être «diamant de la couronne», et vous avez bien raison. Vous valez mieux que cela. Je vous offre une bonne amitié qui, je l'espère, pourra être utile un jour à tous les deux.
Adieu.
Paris, février 1842.
J'ai lu, il y a une heure, votre lettre qui, depuis mardi, était sur ma table, mais cachée sous un tas de papiers. Puisque vous ne méprisez pas mes dons, voici des confitures de rose, de jasmin et de bergamote. Vous voudrez bien en offrir un pot à madame de C..., with my best respects. Il paraît que je vous ai offert des babouches, et vous les refusez avec tant d'insistance, que je devrais bien vous les envoyer. Mais, depuis mon retour, on me pille. Plus de babouches, je ne les trouve plus. Voulez-vous ceci en échange? Peut-être ce miroir turc vous sera-t-il plus agréable; car vous me faites l'effet d'être devenue encore plus coquette qu'en l'an de grâce 1840. C'était au mois de décembre, et vous aviez des bas de soie rayés; voilà tout ce que je me rappelle.
C'est à vous à décider le protocole dont vous me parlez. Vous ne croyez pas à mes cheveux gris. Voici une pièce justificative.
Je ne donne rien pour rien. Avant d'aller à Naples, vous aurez la bonté de prendre mes ordres et de me rapporter ce que je vous dirai. Je pourrai vous donner une lettre pour le directeur des fouilles de Pompéi, si ces choses-là vous intéressent.
Vous faites de votre precious self un portrait si brillant, que je vois ajourner aux calendes grecques le moment où nous nous reverrons, Allah kerim! Je vous écris au milieu d'un bruit infernal. Je ne sais trop ce que je vous dis; mais j'aurais bien des choses à vous dire, de vous et de moi, que j'ajourne à la première fois que j'aurai de vos nouvelles. En attendant, adieu, et conservez ces fines attaches et cette radieuse physionomie que j'admirais.
Paris, samedi. Mars 1842.
Je me demande depuis deux jours si je vous écrirai, et j'aurais d'assez bonnes raisons de fierté pour ne pas le faire; mais, ma foi, bien que vous ne doutiez pas, j'espère, du plaisir que m'a fait votre lettre, j'en ai à vous le dire.
Vous voilà riche; tant mieux. Je vous fais mon compliment. Riche, c'est-à-dire libre. Votre ami, qui a eu cette bonne idée, me fait l'effet d'une manière d'Auld Robin Gray; il devait être amoureux de vous; vous ne l'avouerez jamais, car vous aimez fort le mystère. Je vous pardonne, nous nous écrivons trop rarement pour nous quereller. Pourquoi n'iriez-vous pas à Rome et à Naples voir des tableaux et du soleil? Vous êtes digne de comprendre l'Italie, et vous en reviendrez riche de quelques idées et de quelques sensations. Je ne vous conseille pas la Grèce. Vous n'avez pas la peau assez dure pour résister à toutes les vilaines bêtes qui mangent le monde. À propos de Grèce, puisque vous gardez si bien ce qu'on vous donne, voici un brin d'herbe. Je l'ai cueilli sur la colline d'Anthela aux Thermopyles, à l'endroit où sont morts les derniers des trois cents. Il est probable que cette petite fleur a dans ses atomes constitutifs un peu des atomes de feu Léonidas. En outre, à cet endroit-là même, je me souviens que, couché sur un tas de paille de maïs, devant le corps de garde de gendarmerie (quelle profanation!), je parlai de ma jeunesse à mon ami Ampère, et je lui dis que, parmi les souvenirs tendres qui me restaient, il n'y en avait qu'un seul qui ne fût mêlé d'aucune amertume. Je pensais alors à notre belle jeunesse. Pray keep my foolish flower.
Écoutez, voulez-vous quelque souvenir de l'Orient plus substantiel?
J'ai déjà donné malheureusement tout ce que j'avais rapporté de beau. Je vous donnerais bien des babouches, mais pour que vous les mettiez pour d'autres, merci. Si vous voulez de la confiture de rose et de jasmin, il m'en reste encore un peu, mais dépêchez-vous, ou je la mangerai toute. Nous nous donnons si rarement de nos nouvelles, que nous avons bien des choses à nous dire pour nous mettre au courant. Voici mon histoire:
J'ai revu ma chère Espagne pendant l'automne de 1840; j'ai passé deux mois à Madrid, où j'ai vu une révolution très-bouffonne, de très-belles courses de taureaux, et l'entrée triomphale d'Espartero, qui était la parade la plus comique du monde. Je demeurais chez une amie intime, qui est pour moi une sœur dévouée; j'allais le matin à Madrid et je revenais dîner à la campagne avec six femmes, dont la plus âgée avait trente-six ans. Par suite de la révolution, j'étais le seul homme qui pût aller et venir librement, en sorte que ces six infortunées n'avaient pas d'autre cortejo. Elles m'ont prodigieusement gâté. Je n'étais amoureux d'aucune et j'ai peut-être eu tort. Bien que je ne fusse pas dupe des avantages que me donnait la révolution, j'ai trouvé qu'il était très-doux d'être ainsi sultan, même ad honores. À mon retour à Paris, je me suis donné l'innocent plaisir de faire imprimer un livre sans le publier. On n'en a tiré que cent cinquante exemplaires: papier magnifique, images, etc., et je l'ai donné aux gens qui m'ont plu. Je vous offrirais cette rareté si vous en étiez digne; mais sachez que c'est un travail historique et pédantesque si hérissé de grec et de latin, voire même d'osque (savez-vous seulement ce que c'est que l'osque?), que vous ne pourriez y mordre.—L'été passé, je me suis trouvé quelque argent. Mon ministre m'a donné la clef des champs pour trois mois, et j'en ai passé cinq à courir entre Malte, Athènes, Éphèse et Constantinople. Dans ces cinq mois, je ne me suis pas ennuyé cinq minutes. Vous à qui j'ai fait si grand'-peur jadis, que seriez-vous devenue si vous m'aviez vu dans mes courses en Asie avec une ceinture de pistolets, un grand sabre et—le croiriez-vous?—des moustaches qui dépassaient mes oreilles! Sans vanité, j'aurais fait peur au plus hardi brigand de mélodrame. À Constantinople, j'ai vu le sultan en bottes vernies et redingote noire, puis tout couvert de diamants, à la procession du Baïram. Là, une belle dame, sur la babouche de qui j'avais marché par mégarde, m'a donné un grandissime coup de poing en m'appelant giaour. Voilà mes seuls rapports avec les beautés turques. J'ai vu à Athènes et en Asie les plus beaux monuments du monde et les plus beaux paysages possibles.
Le drawback consistait en puces et en cousins gros comme des alouettes; aussi n'ai-je jamais dormi. Au milieu de tout cela, je suis devenu bien vieux. Mon firman me donne des cheveux de tourterelle; c'est une jolie métaphore orientale pour dire de vilaines choses. Représentez-vous votre ami tout gris. Et vous, querida, êtes-vous changée? J'attends avec impatience que vous soyez moins jolie pour vous voir. Dans deux ou trois ans, quand vous m'écrirez, dites-moi ce que vous faites et quand nous nous verrons. Votre «souvenir respectueux» m'a fait rire et aussi votre prétention à le disputer, dans mon cœur, aux chapiteaux ioniques et corinthiens.
D'abord, je n'aime plus que le dorique, et il n'y a pas de chapiteaux, sans en excepter ceux du Parthénon, qui vaillent pour moi le souvenir d'une vieille amitié. Adieu; allez en Italie, et soyez heureuse. Je pars aujourd'hui pour Évreux pour affaires de mon métier; je serai de retour lundi soir. Si vous voulez manger des feuilles de rose, dites; je vous préviens qu'il n'y en a plus qu'une cuillerée pour vous.
Paris, lundi soir. Mars 1842.
Je viens de recevoir votre lettre, qui m'a mis de mauvaise humeur. Ainsi, c'est votre orgueil satanique qui vous a empêchée de me voir. Au reste, je n'ai pas trop le droit de vous faire des reproches; car, l'autre jour, je vous ai rencontrée, je crois, et un sentiment aussi mesquin m'a retenu au moment où j'allais vous parler. Vous dites que vous valez mieux qu'il y a deux ans: cela vous plaît à dire. Vous m'avez semblé embellie; mais vous paraissez avoir acquis, en revanche, une assez jolie dose d'égoïsme et d'hypocrisie. Cela peut être très-utile; seulement, il n'y a pas de quoi se vanter. Quant à moi, je crois ne valoir ni plus ni moins qu'autrefois; je ne suis pas plus hypocrite et j'ai peut-être tort. Il est certain qu'on ne m'en aime pas davantage. Puisque cette bourse n'est point brodée par votre blanche main, que voulez-vous que j'en fasse? Vous devriez bien pourtant me donner quelque œuvre de vous; mon miroir et mes confitures méritaient cela; au moins eût-il été bien de me dire si vous les aviez reçus; mais je n'ai plus le droit de vous gronder. Quand vous irez en Italie et que vous passerez par Paris, il est probable que vous ne m'y trouverez pas. Où serai-je? le diable le sait. Il n'est pas impossible que je vous rencontre aux Studij; mais il se peut aussi que j'aille à Saragosse, voir cette femme dont vous dites que vous valez autant qu'elle. En fait de sœur, je n'en aurai point d'autre. Dites-moi donc, et cela avant votre départ de Paris, à quelle époque vous irez à Naples, et si vous voulez vous charger d'un volume pour M. Buonuicci, le directeur de fouilles de Pompéi. Je laisserai en partant ce volume chez madame de C... ou ailleurs.
J'ai souvenance d'avoir vu, il y a bien longtemps, une madame de C... dans une maison où se passa un mélodrame dans lequel je jouai le rôle de niais. Demandez-lui si elle se souvient de moi.
Adieu donc, et pour longtemps sans doute. Je suis fâché de ne vous avoir pas vue. Donnez-moi de temps en temps de vos nouvelles, vous me ferez toujours grand plaisir, quand même vous continueriez le beau système d'hypocrisie où vous êtes entrée si triomphalement. Pour la lettre de Buonuicci, je vous recommanderai, vous et votre société, comme grands archéologues, etc. Vous serez contente de son empressement.
Paris, samedi 14 mai 1842.
Vous saurez, pour commencer, que je ne suis point brûlé. «L'accident du chemin de fer de la rive gauche!» c'est ainsi que nous commençons toutes nos lettres à Paris depuis quatre jours; et puis je vous dirai que votre lettre m'a fait grand plaisir. Je l'ai trouvée au retour d'un petit voyage que je viens de faire pour affaires de mon métier, voilà pourquoi je vous réponds si tard. S'il faut être franc, et vous savez que je ne me corrige pas de ce défaut, je vous avouerai que vous m'avez paru fort embellie au physique, mais point du tout au moral; vous avez de très-belles couleurs et des cheveux admirables que j'ai regardés plus que votre bonnet, qui en valait la peine probablement, puisque vous semblez irritée que je n'aie pas su l'apprécier. Mais je n'ai jamais pu distinguer la dentelle du calicot. Vous avez toujours la taille d'une sylphide, et, bien que blasé sur les yeux noirs, je n'en ai jamais vu d'aussi grands à Constantinople ni à Smyrne.
Maintenant, voici le revers de la médaille. Vous êtes restée enfant en beaucoup de choses, et vous êtes devenue par-dessus le marché hypocrite. Vous ne savez pas cacher vos premiers mouvements; mais vous croyez les raccommoder par une foule de petits moyens. Qu'y gagnez-vous? Rappelez-vous cette grande et belle maxime de Jonathan Swift: That a lie is too good a thing to be lavished about! Cette magnanime idée d'être dure pour vous-même vous mènera loin assurément, et, dans quelques années d'ici, vous vous trouverez aussi heureuse qu'un trappiste qui, après s'être maintes fois donné la discipline, découvrirait un jour qu'il n'y a pas de paradis. Je ne sais de quel gage vous parlez, et il y a bien d'autres obscurités dans votre lettre. Nous ne pouvons pas être ensemble comme je suis avec madame de X...; la première condition entre frère et sœur, c'est une confiance sans bornes: madame de X... m'a gâté sous ce rapport. J'ai la niaiserie de regretter cette épingle, mais je me console en pensant qu'après tout, vous vous en êtes repentie. Voilà encore un beau trait de votre part. Comme votre stoïcisme a dû être flatté de cette victoire sur vous-même! Vous croyez que vous avez de l'orgueil, j'en suis bien fâché, mais vous n'avez qu'une petite vanité bien digne d'une dévote. La mode est au sermon aujourd'hui.—Y allez-vous? Il ne vous manquait plus que cela. Je quitte ce sujet, qui me mettrait de trop mauvaise humeur. Je crois que je n'irai pas à Saragosse. Il ne serait pas impossible que j'allasse à Florence; mais ce qu'il y a de certain, c'est que je passerai deux mois dans le Midi à voir des églises et des ruines romaines. Peut-être nous rencontrerons-nous au coin d'un temple ou d'un cirque. Je vous conseille fortement d'aller en droiture à Naples. Vous pourriez cependant, si vous passiez cinq ou six heures à Livourne, les employer mieux en allant à Pise voir le Campo-Santo. Je vous recommande la Mort d'Orcagna, le Vergonzoso, et un buste antique de Jules César. À Civita-Vecchia, vous n'avez à voir que M. Bucci, chez qui vous achèterez des pierres gravées antiques, et vous lui ferez mes compliments. Puis vous irez à Naples, vous logerez à la Victoire, vous passerez quelques jours à humer l'air et à voir le ciel et la mer. De temps en temps, vous irez aux Studj. M. Buonuicci vous mènera à Pompéi. Vous irez à Pæstum, et vous penserez à moi; dans le temple de Neptune, vous pourrez vous dire que vous avez vu la Grèce. De Naples, vous irez à Rome, où vous passerez un mois en vous disant qu'il est inutile de tout voir parce que vous y reviendrez. Puis vous irez à Florence, où vous resterez dix jours. Ensuite, vous ferez ce que vous voudrez. En passant à Paris, vous trouverez mon livre pour M. Buonuicci et mes dernières instructions. Probablement, je serai alors à Arles ou à Orange. Si vous vous arrêtez là, vous me demanderez, et je vous expliquerai un théâtre antique, ce qui vous intéressera médiocrement. Vous m'avez promis quelque chose en retour de mon miroir turc. Je compte pieusement sur votre mémoire. Ah! grande nouvelle! Le premier académicien des quarante qui mourra sera cause que je ferai trente-neuf visites; je les ferai aussi gauchement que possible et j'acquerrai sans doute trente-neuf ennemis. Il serait trop long de vous expliquer le pourquoi de cet accès d'ambition. Suffit que l'Académie soit maintenant mon cachemire bleu.
Adieu; je vous écrirai avant de partir. Soyez heureuse, mais retenez cette maxime, qu'il ne faut jamais faire que les sottises qui vous plaisent. Vous aimez peut-être mieux celle de M. de Talleyrand, qu'il faut se garder des premiers mouvements, parce qu'ils sont presque toujours honnêtes.
Paris, 22 juin 1842.
Votre lettre est venue un peu tard, je m'impatientais. Il faut d'abord que je réponde aux points capitaux de votre lettre.—1° J'ai reçu votre bourse; elle exhalait un parfum fort aristocratique et je l'ai trouvée très-jolie. Si vous l'avez brodée vous-même, cela vous fait honneur. Mais j'ai reconnu votre goût récent pour le positif: d'abord, une bourse pour y mettre de l'argent, puis vous l'estimez cent francs à la diligence. Il eût été plus poétique de déclarer qu'elle valait une ou deux étoiles; pour moi, je l'estime tout autant. J'y mettrai des médailles. Je l'aurais estimée davantage si vous aviez daigné y joindre quelques lignes de votre blanche main.—2° Je ne veux pas de vos faisans; vous me les offrez d'une vilaine façon, et, de plus, vous me dites des choses désagréables au sujet de mes confitures turques. C'est vous qui avez le palais d'une giaour, si vous ne savez pas apprécier ce que mangent les houris. Je crois avoir répondu à tout ce qu'il y a de raisonnable dans votre lettre. Je ne veux pas vous quereller pour le reste. Je vous abandonne à votre conscience, qui, j'en suis sûr, est quelquefois plus sévère pour vous que moi, que vous accusez de dureté et d'insouciance. L'hypocrisie, que vous pratiquez assez bien, mais en vous jouant, vous jouera un tour à la longue: c'est qu'elle deviendra chez vous très-réelle. Quant à la coquetterie, qui est la compagne inséparable du vilain vice que vous prônez, vous en avez toujours été atteinte et convaincue. Cela vous allait bien lorsque vous la tempériez par une certaine franchise, et par du cœur et de l'imagination. Maintenant... maintenant, que vous dirai-je? Vous avez de très-beaux cheveux noirs et un beau cachemire bleu, et vous êtes toujours aimable quand vous le voulez. Dites que je ne vous gâte pas! Quant à cette essence dont vous me parlez, c'est votre amitié que vous appelez ainsi.—J'aime ce mot essence—oui, de la vraie essence de rose qui est toujours gelée comme celle d'Andrinople; je vous conterai cette histoire orientale.
Il y avait une fois un derviche qui avait paru un saint homme à un boulanger. Le boulanger lui promit un jour de lui donner toute sa vie du pain blanc. Voilà le derviche enchanté. Mais, au bout de quelque temps, le boulanger lui dit: «Nous sommes convenus de pain bis, n'est-ce pas? J'ai du pain bis excellent, c'est mon fort, que le pain bis.» Le derviche répondit: «J'ai du pain bis plus que je n'en puis manger; mais...»
Ma chatte vient de monter sur ma table et j'ai eu toutes les peines du monde à l'empêcher de se coucher sur mon papier. Elle m'a fait oublier la fin de mon conte; c'est dommage, car c'était fort beau. Savez-vous que j'avais fait, parmi d'autres châteaux, celui-ci: c'était de vous rencontrer à Marseille en septembre et de vous y montrer les lions, et de vous y faire manger des figues et de la bouillabaisse. Mais il faut que je sois de retour à Paris vers le 15 août, afin d'y faire de la prose pour mon ministre. Mais vous mangerez de la bouillabaisse toute seule, et vous verrez sans moi le musée et les caves de Saint-Victor. En revanche, vous pourriez recevoir de ma main, à Paris, mes instructions pour l'Italie. Puisque ce que vous désirez arrive, je vous prie humblement de désirer que je sois académicien. Cela me fera grand plaisir, pourvu que vous n'assistiez pas à ma réception. Au reste, vous avez du temps devant vous pour souhaiter. Il faut que la peste se déclare parmi ces messieurs pour que mes chances soient belles; il faudrait surtout, pour les embellir, que je vous empruntasse un peu de cette hypocrisie que vous entendez si bien aujourd'hui. Je suis trop vieux pour me reformer. Si j'essayais, je serais encore pire que je ne suis. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de moi; mais comment le saurais-je? Vous ne me direz jamais ni tout le bien ni tout le mal que vous en pensez. Autrefois, je ne pensais pas grand bien de my precious self. Maintenant j'ai un peu plus d'estime pour moi, non pas que je me croie devenu meilleur, mais c'est le monde qui est devenu pire. Je pars dans huit jours pour Arles, où je vais exproprier force canaille qui habite le théâtre antique; n'est-ce pas une jolie occupation? Vous seriez aimable de m'écrire avant mon départ une lettre remplie de douceurs. J'aime beaucoup qu'on me gâte, et puis je suis horriblement triste et découragé. Il faut vous dire que je passe mes soirées à relire mes œuvres, qu'on réimprime. Je me trouve bien immoral et quelquefois bête. Il s'agit de diminuer l'immoralité et la bêtise sans se donner trop de peine; d'où il résulte pour moi beaucoup de blue devils. Je vous dis adieu et vous baise très-humblement les mains. Savez-vous ce que j'ai trouvé dans mes archives? un fil bleu très-court avec deux nœuds. Je l'ai mis dans la bourse.
Châlon-sur-Saône, 30 juin 1842.
Vous avez bien deviné la fin de l'histoire: le derviche fut mystifié par le boulanger, mais le saint homme n'aimait pas le pain bis.
Je suis dans une ville qui m'est particulièrement odieuse, seul dans une auberge à écouter un vent de sud-est effroyable, qui dessèche tout et qui produit dans les grands corridors des harmonies à porter le diable en terre. Cela fait que je suis très-furieux contre la nature entière. Je vous écris pour me consoler un peu, et je me réjouis en pensant que, dans votre prochain voyage, vous aurez plus d'une fois des jours semblables à celui-ci. J'ai vu dans l'église Saint-Vincent une fort jolie demoiselle qui faisait des stations. N'appelez-vous pas ainsi des prières ou quelque chose d'approchant que l'on dit devant quelques gravures qui représentent les principales scènes de la Passion? Sa mère était auprès d'elle qui la surveillait fort attentivement. Tout en prenant des notes sur de vieux chapiteaux byzantins, je me demandais ce que pouvait avoir fait cette jeune fille pour mériter cette pénitence. Le cas devait être assez grave. Êtes-vous devenue bien dévote, suivant la mode presque générale maintenant? vous devez être dévote par la même raison que vous avez un cachemire bleu. J'en serais fâché cependant; notre dévotion en France me déplaît; c'est une espèce de philosophie très-médiocre, qui vient de l'esprit et non du cœur. Lorsque vous aurez vu la dévotion du peuple en Italie, j'espère que vous trouverez, comme moi, que c'est la seule bonne; seulement, ne l'a pas qui veut et il faut être né au delà des Alpes ou des Pyrénées pour croire ainsi. Vous ne sauriez vous faire une idée du dégoût que m'inspire notre société actuelle. On dirait qu'elle a cherché par toutes les combinaisons possibles à augmenter la masse d'ennui nécessaire dans l'ordre du monde. Je vous attends à votre retour d'Italie; vous aurez vu une société où tout tend, au contraire, à rendre l'existence de chacun plus douce et plus supportable. Nous reprendrons alors nos discussions sur l'hypocrisie, et il est possible que nous nous entendions.
J'ai passé presque tout mon hiver à étudier la mythologie dans de vieux bouquins latins et grecs. Cela m'a extrêmement amusé, et, s'il vous vient jamais en tête l'envie de connaître l'histoire des pensées des hommes, ce qui est bien plus intéressant que celle de leurs actions, adressez-vous à moi et je vous indiquerai trois ou quatre livres à lire, qui vous rendront aussi savante que moi, ce qui n'est pas peu dire! À quoi passez-vous votre temps? je me demande cela quelquefois sans pouvoir trouver une réponse raisonnable. Si j'avais à tirer votre horoscope, je prédirais que vous finirez par faire un livre: c'est la conséquence inévitable de la vie que vous menez et que les femmes mènent en France. D'abord de l'imagination et quelquefois du cœur; puis, de l'hypocrisie, on passe à la dévotion, puis on se fait auteur. À Dieu ne plaise que vous en veniez jamais là!
J'espère voir madame de X... à Paris cette année, si cela arrivait, je voudrais que vous la vissiez. Vous apprendriez que le pain bis est plus difficile à faire que vous n'avez l'air de le croire. Rien ne sera plus facile, si vous le voulez bien, que de faire la connaissance de cette boulangère-là.
Adieu; le vent souffle toujours. Je dois rester un mois en province, et, si vous avez du temps à perdre et l'envie de me faire grand plaisir, vous n'avez qu'à m'écrire à Avignon, poste restante.
Avignon, 20 juillet 1812.
Puisque vous le prenez sur ce ton, ma foi, je capitule. Donnez-moi du pain bis, cela vaut mieux que rien du tout. Seulement, permettez-moi de dire qu'il est bis, et écrivez-moi encore. Vous voyez que je suis humble et soumis.
Votre lettre est venue dans un moment de tristesse noire causée par cette' triste nouvelle (la mort du duc d'Orléans), que je venais d'apprendre en revenant d'une course dans les montagnes. J'avais grand besoin d'une lettre d'un autre style; telle quelle était, votre lettre a été du moins une diversion.
J'y réponds article par article. La figure de rhétorique dont vous vous croyez l'inventeur est connue depuis longtemps. On pourrait avec le grec lui donner un nom nouveau et très-baroque. En français, elle est connue sous le nom moins pompeux de menterie. Servez-vous-en avec moi le moins que vous pourrez. N'en abusez pas avec les autres. Il faut garder cela pour les grandes occasions. Ne cherchez pas trop à trouver le monde sot et ridicule. Il ne l'est que trop! Il faudrait, au contraire, s'efforcer de se le représenter tel qu'il n'est pas. Il vaut mieux avoir des illusions que de n'en avoir plus du tout. J'en ai encore trois ou quatre, dont quelques-unes ne sont pas bien solides, mais je me bats les flancs pour les conserver.
Votre histoire est connue: «Il y avait une fois une idole...» Lisez Daniel; mais il s'est trompé, la tête n'était point d'or, elle était d'argile comme les pieds. Mais l'adorateur avait une lampe à la main et le reflet de cette lampe dorait la tête de l'idole. Si j'étais l'idole (vous voyez que je ne prends pas cette fois le beau rôle), je dirais: «Est-ce ma faute si vous avez éteint votre lampe? est-ce une raison pour me briser?» Il me semble que je deviens un peu bien oriental. Basta! Vous aimeriez à la folie madame de X..., si vous la connaissiez. Ce n'est pas du pain blanc qu'elle me donne, mais c'est quelque chose qui le remplace. Ce n'est pas une boulangère, c'est un boulanger.
Je vois avec peine que votre coquetterie va toujours croissant. Je suis parfaitement renseigné sur votre dévotion. Je vous remercie de vos prières, si elles ne sont point une figure de rhétorique. À propos de votre cachemire bleu, je vous soupçonnais de dévotion, parce que la dévotion est, en 1842, une mode comme les cachemires bleus. Voilà le rapport que vous ne compreniez pas, c'était bien clair pourtant. Je suis bien fâché que vous lisiez Homère dans Pope. Lisez la traduction de Dugas-Montbel, c'est la seule lisible. Si vous aviez du courage pour braver le ridicule et du temps à dépenser, vous prendriez la grammaire grecque de Planche et le dictionnaire du susdit. Vous liriez la grammaire pendant un mois pour vous endormir. Cela ne manquerait pas son effet. Après deux mois, vous vous amuseriez à chercher dans le grec le mot traduit, en général, assez littéralement par M. Montbel; deux mois après encore, vous devineriez assez bien, par l'embarras de sa phrase, que le grec dit autre chose que ce que le traducteur lui fait dire. Au bout d'un an, vous liriez Homère comme vous lisez un air, l'air et l'accompagnement; l'air, c'est le grec; l'accompagnement, la traduction. Il serait possible que cela vous donnât l'envie d'étudier sérieusement le grec, et vous auriez d'admirables choses à lire. Mais je vous suppose n'ayant pas de toilettes qui vous occupent ni de gens à qui les montrer. Tout est remarquable dans Homère. Les épithètes, si étranges traduites en français, sont d'une justesse admirable. Je me souviens qu'il appelle la mer pourpre, et jamais je n'avais compris ce mot. L'année dernière, j'étais dans un petit caïque sur le golfe de Lépante, allant à Delphes. Le soleil se couchait. Aussitôt qu'il eut disparu, la mer prit pour dix minutes une teinte violet foncé magnifique. Il faut pour cela l'air, la mer et le soleil de Grèce. J'espère que vous ne deviendrez jamais assez artiste pour avoir du plaisir à reconnaître qu'Homère était un grand peintre. Les dernières phrases de votre lettre sont pour moi autant d'énigmes. Vous me dites que vous ne m'écrirez plus jamais, ce qui serait fort mal; d'ailleurs, je me soumets et vous n'aurez plus de moi que des compliments. Je crois vous en avoir adressé déjà plusieurs. Vous m'en demandez sans doute en me disant que vous n'avez ni cœur ni imagination; à force de nier l'un et l'autre, de parti pris, cela peut porter malheur. Il ne faut pas jouer avec cela. Mais je crois que vous avez voulu faire un essai de votre figure de rhétorique sur moi. Heureusement, je sais à quoi m'en tenir.
Si vous avez quelque bonne pensée sur mon compte, écrivez-la-moi. Je suis encore pour une quinzaine de jours dans ce pays. Je voudrais vous dire un mot de la vie que je mène. Je cours les champs sans rencontrer autre chose que des pierres. Adieu. J'espère que vous me trouvez cette fois passablement résigné et convenable, signora Fornarina?
Paris, 27 août 1842.
Je trouve, en arrivant ici, une lettre de vous moins féroce que les précédentes. Vous eussiez bien fait de me l'envoyer là-bas. Cette rareté ne se pouvait posséder trop tôt. Je me hâte de vous féliciter de vos études grégeoises, et, pour commencer par quelque chose qui vous intéresse, je vous dirai comment on appelle en grec les personnes qui ont comme vous des cheveux dont elles ressentent une juste fierté. C'est efplokamos. Ef, bien, plokamos, boucle de cheveux. Les deux mots réunis forment un adjectif. Homère a dit quelque part:
Νύμφη εὐπλοχαμοῦς Καλυψῶ.
Nimfi efplokamouça Calypso.
Nymphe bien frisante Calypso.
N'est-ce pas fort joli? Ah! pour l'amour du grec, etc.
Je suis bien fâché que vous partiez si tard pour l'Italie. Vous risquez de tout voir à travers des pluies atroces, qui ôtent la moitié de leur mérite aux plus belles montagnes du monde, et vous serez obligée de me croire sur parole quand je vous vanterai le beau ciel de Naples. Vous ne mangerez plus de bons fruits, mais vous aurez des bec-figues, ainsi nommés parce qu'ils se nourrissent de raisins.
Je n'admets point votre version de la parabole.
Il m'est arrivé à mon retour une aventure qui m'a quelque peu mortifié en me faisant connaître de quelle espèce de réputation je jouis de par le monde. Voici. Je faisais mon paquet à Avignon et me préparais à partir pour Paris par la malle-poste, lorsque deux figures vénérables entrèrent, qui s'annoncèrent comme membres du conseil municipal. Je croyais qu'ils allaient me parler de quelque église, lorsqu'ils me dirent pompeusement et prolixement qu'ils venaient recommander à ma loyauté et à ma vertu une dame qui allait voyager avec moi. Je leur répondis de très-mauvaise humeur que je serais très-loyal et très-vertueux, mais que j'étais fort mécontent de voyager avec une femme, attendu que je ne pourrais pas fumer le long de la route. La malle-poste arrivée, je trouvai dedans une femme grande et jolie, simplement et coquettement mise, qui s'annonça comme malade en voiture et désespérant d'arriver vivante à Paris. Notre tête-à-tête commença. Je fus aussi poli et aimable qu'il m'est possible de l'être quand je suis obligé de rester dans la même position. Ma compagne parlait bien, sans accent marseillais, était très-bonapartiste, très-enthousiaste, croyait à l'immortalité de l'âme, pas trop au catéchisme, et voyait en général les choses en beau. Je sentais qu'elle avait une certaine peur de moi. À Saint-Étienne, le briska à deux places fut échangé pour une voiture à quatre places. Nous eûmes les quatre places à nous deux, et par conséquent vingt-quatre heures de tête-à-tête à ajouter aux trente premières. Mais, bien que nous causassions (quel joli mot!) beaucoup, il me fut impossible de me faire une idée de ma voisine, si ce n'est qu'elle devait être mariée et une personne de bonne compagnie. Pour finir, à Moulins, nous primes deux compagnons assez maussades, et nous arrivâmes à Paris, où ma femme mystérieuse se précipita dans les bras d'un homme très-laid qui devait être son père. Je lui ôtai ma casquette, et j'allais monter dans un fiacre quand mon inconnue, d'une voix émue, me dit, ayant laissé le père à quelques pas: «Monsieur, je suis pénétrée des égards que vous avez eus pour moi. Je ne puis vous en exprimer assez toute ma reconnaissance. Jamais je n'oublierai le bonheur que j'ai eu de voyager avec un homme aussi illustre.» Je cite le texte. Mais ce mot illustre m'expliqua les conseillers municipaux et la peur de la dame. Il était évident qu'on avait vu mon nom sur le livre de la poste, et que la dame, qui avait lu mes œuvres, s'attendait à être avalée toute crue, et que cette opinion fort erronée doit être partagée par plus d'une autre de mes lectrices. Comment avez-vous eu l'idée de me connaître? Cela m'a mis de mauvaise humeur pendant deux jours, puis j'en ai pris mon parti. Ce qu'il y a de singulier dans ma vie, c'est qu'étant devenu un très-grand vaurien, j'ai vécu deux ans sur mon ancienne bonne réputation, et qu'après être redevenu très-moral, je passe encore pour vaurien.
En vérité, je ne crois pas l'avoir été plus de trois ans, et je l'étais, non de cœur, mais uniquement par tristesse et un peu peut-être par curiosité. Cela me nuira beaucoup, je crois, pour l'Académie; et puis aussi on me reproche de ne pas être dévot et de ne pas aller au sermon. Je me ferais bien hypocrite, mais je ne sais pas m'ennuyer et je n'aurais jamais la patience. Si vous vous étonnez que toutes les déesses soient blondes, vous vous étonnerez bien davantage à Naples en voyant des statues dont les cheveux sont peints en rouge. Il paraît que les belles dames autrefois se poudraient avec de la poudre rouge, voire même avec de la poudre d'or. En revanche, vous verrez aux peintures des Studij quantité de déesses avec des cheveux noirs. Pour moi, il me semble difficile de décider entre les deux couleurs. Seulement, je ne vous conseille pas de vous poudrer. Il y a en grec un terrible mot qui veut dire des cheveux noirs: Μελαγχαἱτης (Mélankhétis); ce χα est une aspiration diabolique.
Je serai à Paris tout l'automne, je pense. Je vais travailler beaucoup à un livre moral, aussi amusant que la guerre sociale que vous porterez à Naples. Adieu. Vous m'avez promis des douceurs, je les attends toujours, mais je n'y compte guère.
Vous admiriez mon livre de pierres antiques. Hélas! j'ai perdu la plus belle l'autre jour, une magnifique Junon, en faisant une bonne action: c'était de porter un ivrogne qui avait la cuisse cassée. Et cette pierre était étrusque, et elle tenait une faux, et il n'y a aucun autre monument où elle soit ainsi représentée. Plaignez moi.
Vous avez une écriture charmante en grec et bien plus lisible qu'en français. Mais qui est votre maître de grec? Vous ne me ferez pas croire que vous avez appris à écrire les caractères cursifs en regardant dans un livre imprimé. Qui est professeur de rhétorique à D...?
Je trouve votre lettre très-aimable. Je vous dis cela parce que je sais que les compliments vous sont agréables, et puis parce que cela est assez vrai. Pourtant, comme je ne saurai jamais me corriger du malheureux défaut de dire ce que je pense aux gens qui ne sont pas tout le monde pour moi, vous saurez que je vous vois faire des progrès bien rapides en satanisme et que je m'en afflige. Vous devenez ironique, sarcastique et même diabolique. Tous ces mots-là sont tirés du grec, comme trop mieux savez, et votre professeur vous dira ce que j'entends par diabolique; διἁβολος, c'est-à-dire calomniateur. Vous vous moquez de mes plus belles qualités, et, quand vous me louez, c'est avec des réticences et des précautions qui ôtent à l'éloge tout son mérite. Il est trop vrai que j'ai fréquenté, à une certaine époque de ma vie, très-mauvaise compagnie. Mais, d'abord, j'y allais par curiosité surtout et j'y suis demeuré toujours comme en pays étranger. Quant à la bonne compagnie, je l'ai trouvée bien souvent mortellement ennuyeuse. Il y a deux endroits où je suis assez bien, où, du moins, j'ai la vanité de me croire à ma place: 1° avec des gens sans prétention que je connais depuis longtemps; 2° dans une venta espagnole, avec des muletiers et des paysannes d'Andalousie. Écrivez cela dans mon oraison funèbre et vous aurez dit la vérité.
Si je vous parle de mon oraison funèbre, c'est que je crois qu'il est temps de vous y préparer. Je suis très-souffrant depuis longtemps, et surtout depuis quinze jours. J'ai des éblouissements, des spasmes, des migraines horribles. Il doit y avoir quelque grand accident à ma cervelle, et je pense que je puis devenir bientôt, comme dit Homère, convive de la ténébreuse Proserpine. Je voudrais savoir ce que vous direz alors. Je serais charmé que vous en fussiez triste pour quinze jours. Trouvez-vous ma prétention exagérée? Je passe une partie de mes nuits à écrire, ou à déchirer ce que j'ai écrit la veille; de la sorte j'avance peu. Ce que je fais m'amuse; mais cela amusera-t-il les autres? Je trouve que les anciens étaient bien plus amusants que nous; ils n'avaient pas de buts si mesquins; ils ne se préoccupaient pas d'un tas de niaiseries comme nous. Je trouve que mon héros Jules-César fit, à cinquante-trois ans, des bêtises pour Cléopâtre et oublia tout pour elle, ce pourquoi peu s'en fallut qu'il ne se noyât au propre et au figuré. Quel homme de notre siècle, je dis parmi les hommes d'État, n'est pas complètement racorni, complètement insensible à l'âge où il peut prétendre à la députation? Je voudrais montrer un peu la différence de ce monde-là avec le nôtre; mais comment faire?
Êtes-vous arrivé, dans l'Odyssée, à un passage que je trouve admirable? C'est lorsque Ulysse est chez Alcinoüs inconnu encore et qu'après dîner un poète chante devant lui la guerre de Troie. Le peu que j'ai vu de la Grèce m'a mieux fait comprendre Homère. On voit partout dans l'Odyssée cet amour incroyable des Grecs pour leur pays. Il y a dans le grec moderne un mot charmant: c'est ξενιτεἱά, l'étrangeté, le voyage. Être en ξενιτεἱά, c'est pour un Grec le plus grand de tous les malheurs; mais y mourir, c'est ce qu'il y a de plus effroyable pour leur imagination. Vous raillez ma gastronomie: avez-vous compris les entrailles que les héros mangent avec tant de plaisir? Les pallicares modernes en mangent encore; cela s'appelle κονκονρἑτζι, et cela est vraiment délicieux. Ce sont de petites brochettes de bois de lentisque parfumé, avec quelque chose de croustillant et d'épicé autour qui, fait comprendre sur-le-champ pourquoi les prêtres se réservaient ce morceau-là dans les victimes.
Adieu. Si je vous en disais davantage sur ce sujet, vous me croiriez plus gourmand que je ne suis. Je n'ai plus d'appétit et rien ne me plaît plus en fait de petits bonheurs. Cela veut dire que je suis bon à jeter aux corbeaux. Il fera un temps de chien pendant tout le mois d'octobre, et ce sera bien fait!
Paris, 24 octobre 1842.
C'est fort aimable à vous de me laisser dans l'ignorance de la partie du monde qui a l'avantage de vous posséder. Adresserai-je cette lettre à Naples ou à ***, ou bien à Paris? Vous me dites dans votre dernière lettre que vous allez partir pour Paris, peut-être pour l'Italie, et, depuis, point de nouvelles. Je soupçonne que vous êtes ici et que vous m'en avertirez quand vous serez repartie; cela sera highly in character. Depuis vous avoir écrit, j'ai fait un voyage de quelques jours, et, à mon retour, j'ai trouvé votre lettre de date déjà si ancienne, que je n'ai pas cru pouvoir vous répondre à ***. D'ailleurs, j'admire beaucoup comment, en regardant de gros caractères imprimés, vous avez deviné l'écriture cursive toute seule, comme vous dites. Si vous avez un peu de patience, avec des dispositions semblables, vous deviendrez une madame Dacier. Pour moi, je ne m'occupe plus de grec ni de français; je suis tombé à l'état de fossile, et, lorsque je lis ou écris, je vois les caractères danser d'une façon très-peu agréable. Vous me demandez s'il y a des romans grecs. Sans doute il y en a, mais bien ennuyeux, selon moi. Il n'est pas que vous ne puissiez vous procurer une traduction de Théagène et Chariclée, qui plaisait tant à feu Racine. Essayez si vous pouvez y mordre; il y a encore Daphnis et Chloé, traduit par Courier. Cela est fort prétentieusement naïf et pas trop exemplaire. Enfin, il y a une nouvelle admirable, mais immorale et très-immorale: c'est l'Ane de Lucius, traduit encore par Courier. On ne se vante pas de l'avoir lue, mais c'est son chef-d'œuvre! Décidez-vous d'après cela, je m'en lave les mains. Le mal des Grecs, c'est que leurs idées de décence et même de moralité étaient fort différentes des nôtres. Il y a bien des choses dans leur littérature qui pourraient vous choquer, voire même vous dégoûter, si vous les compreniez. Après Homère, vous pouvez lire en toute assurance les tragiques, qui vous amuseront et que vous aimerez parce que vous avez le goût du beau, τὸ καλόν, ce sentiment que les Grecs avaient au plus haut degré et que nous tenons d'eux, nous autres, happy few. Si vous avez le courage de lire l'histoire, vous serez charmée d'Hérodote, de Polybe et de Xénophon. Hérodote m'enchante. Je ne connais rien de plus amusant. Commencez par l'Anabase ou la Retraite des Dix Mille; prenez une carte de l'Asie et suivez ces dix mille coquins dans leur voyage; c'est Froissard gigantesque. Puis vous lirez Hérodote, enfin Polybe et Thucydide; les deux derniers sont bien sérieux. Procurez-vous encore Théocrite et lisez les Syracusaines. Je vous recommande bien aussi Lucien, qui est le Grec qui a le plus d'esprit, ou plutôt de notre esprit; mais il est bien mauvais sujet, et je n'ose. Voilà trois pages de grec. Quant à la prononciation, si vous voulez, je vous enverrai une page de ma main que j'avais préparée à votre intention, qui vous apprendra la meilleure, c'est-à-dire la prononciation des Grecs modernes. Celle des écoles est plus facile, mais absurde.
Nous avons commencé à nous écrire en faisant de l'esprit, puis nous avons fait quoi? je ne vous le rappellerai pas. Voilà que nous faisons de l'érudition. Il y a un proverbe latin qui fait l'éloge du juste milieu; j'avais l'intention de vous dire des duretés en commençant ma lettre, et c'est au grec que vous devez sans doute sa parfaite douceur. Je ne vous en garde pas moins rancune de la persistance de vos habitudes hypocrites; mais, en écrivant, j'ai perdu un peu de ma mauvaise humeur. Ne regrettez pas le voyage d'Italie, si vous n'y êtes pas. Il y a fait un temps effroyable, froid, pluie, etc. Rien de plus laid qu'un pays qui n'est pas habitué à ces deux fléaux. Adieu. Je voudrais bien savoir où vous êtes.—Ἔῤῤωσο (Fortifie-toi).
C'est la fin d'une lettre grecque.
P.-S.—En ouvrant un livre, je trouve ces deux petites fleurs cueillies aux Thermopyles, sur la colline où Léonidas est mort. C'est une relique, comme vous voyez.
Jeudi, octobre 1842.
Voulez-vous entendre un opéra italien avec moi aujourd'hui? Je suis le propriétaire d'une loge les jeudis, avec mon cousin et sa femme. Ils sont en voyage et je suis seul maître; il faudrait que vous eussiez sous la main ou votre frère ou l'un de vos parents qui ne me connaîtrait pas. Enfin, vous me feriez grand plaisir en venant. Répondez-moi un mot avant six heures et je vous ferai dire le numéro de la loge; je crois qu'on donne la Cenerentola. Inventez quelque jolie histoire que vous me direz à l'avance pour expliquer ma présence; mais que l'histoire soit telle que je puisse causer avec vous.
Vendredi matin, octobre 1842.
Je vous remercie bien d'être venue hier, vous m'avez fait grand plaisir. J'espère que votre frère n'a rien trouvé d'extraordinaire à la rencontre. J'ai un cachet étrusque pour vous; je ne puis souffrir celui dont vous vous servez. Je vous donnerai l'autre la première fois que je vous verrai. Voici la page de grec que je vous avais préparée; quand vous retomberez dans l'érudition, elle pourra vous servir.
Mardi soir, octobre 1842.
Je n'ai rien perdu, comme il semble, à attendre votre réponse; elle est très-laborieusement méchante. Mais la méchanceté ne vous va pas, croyez-moi; abandonnez ce style et reprenez votre ton de coquetterie ordinaire, qui vous sied à merveille. Il y aurait de la cruauté de ma part à vouloir vous voir, puisque cela vous rendrait si malade qu'il faudrait une quantité extraordinaire de gâteaux pour vous guérir. Je ne sais où vous avez pris que j'ai des amis dans les quatre coins du monde. Vous savez bien que je n'en ai qu'un ou qu'une à Madrid. Croyez que je suis très-reconnaissant de la magnanimité que vous avez montrée à mon égard, l'autre soir aux Italiens. J'apprécie comme je le dois la condescendance avec laquelle vous m'avez montré votre figure pendant deux heures, et je dois à la vérité de dire que je l'ai fort admirée, comme aussi vos cheveux, que je n'avais jamais vus d'aussi près; quant à cette assertion que vous ne m'avez rien refusé de ce que je vous avais demandé, vous aurez quelques millions d'années de purgatoire pour cette belle menterie. Je vois bien que vous avez envie de ma pierre étrusque, et, comme je suis encore plus magnanime que vous, je ne vous dirai pas, comme Léonidas: «Viens et prends!» mais je vous demanderai encore comment vous voulez que je vous l'envoie. Je ne me rappelle pas vous avoir comparée à Cerbère; mais vous avez bien quelques rapports, non-seulement parce que vous aimez beaucoup, comme lui, les gâteaux, mais aussi parce que vous avez trois têtes, je veux dire trois cerveaux: l'un d'une coquetterie effroyable, l'autre d'un vieux diplomate; le troisième, je ne vous le dirai pas, parce qu'aujourd'hui je ne veux vous dire rien d'aimable. Je suis très-malade et très-tourmenté de plusieurs tuiles qui me sont tombées sur la tête. Si vous avez quelque crédit sur le Destin, priez-le qu'il me traite bien d'ici à deux ou trois mois. Je viens de voir Frédégonde, qui m'a ennuyé fort, malgré mademoiselle Rachel, qui a de très-beaux yeux noirs sans blanc, comme le diable, dit-on.
Paris, mardi soir.
Je ne vous comprends pas et je suis tenté de vous prendre pour la pire de toutes les coquettes. Votre première lettre, où vous me dites que vous ne me connaissez plus, m'avait mis de mauvaise humeur et je n'y ai pas répondu tout de suite. Aussi vous me dites, avec beaucoup d'amabilité, que vous ne voulez pas me voir, de peur de vous ennuyer de moi. Si je ne me trompe, nous nous sommes vus six ou sept fois en six ans, et, en additionnant les minutes, nous pouvons avoir passé trois ou quatre heures ensemble, dont la moitié à ne nous rien dire. Cependant, nous nous connaissons assez pour que vous ayez pris quelque estime de moi, et vous m'en avez donné la preuve jeudi. Nous nous connaissons même plus que ne font des gens qui se seraient vus dans le monde, depuis le temps que nous causons ensemble assez librement par lettres. Convenez qu'il est peu flatteur pour mon amour-propre que vous me traitiez ainsi après six ans. Au reste, comme je n'ai pas de moyen de combattre vos résolutions, il en sera de celle-ci ce que vous voudrez, mais je trouve un peu niais de ne pas nous voir. Je vous demande pardon de ce mot, qui n'est ni poli ni amical, mais qui est malheureusement vrai, à mon sens du moins. Je ne me suis nullement moqué de vous l'autre soir. Je vous ai même trouvé beaucoup d'aplomb. Quant au cachet antique, vous en verrez une empreinte sur cette lettre, et il est à vos ordres, lorsque vous m'aurez dit où je dois vous le donner; non, comment je dois l'envoyer. N'offensons pas l'eternal fitness of things. Je ne vous demande rien en échange, par la raison que tout ce que je vous ai demandé, vous me l'avez refusé. Si vous croyez faire mal en me voyant, ne faites-vous point mal en m'écrivant? Comme je ne suis pas très-fort sur votre catéchisme, cette question demeure embrouillée pour moi. Je vous parle trop durement, peut-être; mais vous m'avez fait de la peine, et les choses que j'ai sur le cœur, je ne m'en délivre pas comme vous, en mangeant des gâteaux. En vérité, cela est digne de Cerbère.
Paris, samedi, novembre 1842.
Das Lied des CLÆRCHENS gefällt mir zu gar; aber warum haben Sie nicht das Ende geschrieben?—C'est vraiment admirable de voir à quel point cette pierre étrusque vous plaît! Combien de gâteaux l'estimez-vous? Vous n'avez pas seulement cherché à savoir ce qu'il y a dessus. C'est un homme qui tourne un pot. Il faut dire une hydrie, c'est plus grec et plus noble. C'était peut-être le cachet d'un potier autrefois, ou bien il y a là une allusion mythologique que je pourrais vous expliquer, si je voulais. Quant à l'autre cachet, son histoire est étrange. Je l'ai trouvé dans le feu d'une cheminée, rue d'Alger, en tisonnant; c'est une très-grosse et très-lourde bague en bronze; les caractères en sont cabalistiques; on croit quelle a servi à un magicien ou bien à des gnostiques. Vous y avez vu un petit homme, un soleil, une lune, etc. N'est-ce pas fort curieux de trouver cela rue d'Alger dans les cendres? Qui sait si ce n'est pas au pouvoir mystérieux de cet anneau que je dois votre chanson de Claire? Je suis très-réellement malade, mais ce n'est pas une raison pour ne pas sortir. Par exemple, si vous vouliez recevoir le cachet étrusque de ma main, je vous le donnerais avec grand plaisir; tandis que cela ferait scandale dans une lettre chez votre portier. Mais je ne veux plus rien vous demander, car vous devenez tous les jours plus impérieuse, et vous avez des raffinements de coquetterie scandaleux. Il paraît que vous n'appréciez pas les yeux sans blanc et que vous estimez beaucoup les blancs-bleus. Vous prenez aussi soin de me rappeler vos yeux, que je n'ai pas oubliés, bien que je les aie peu vus. Celui qui vous a appris cette particularité, que vous osez me dire ignorée de vous, est-ce votre maître de grec ou votre maître d'allemand? ou bien dois-je croire que vous avez appris toute seule l'écriture cursive allemande comme la grecque? Autre article de foi à ajouter à l'aversion que vous avez pour les miroirs. Vous devriez bien cultiver une fleur germanique nommée die Aufrichtigkeit. Je viens d'écrire le mot Fin au bas de quelque chose de très-savant, que j'ai fait avec toute la mauvaise humeur possible; reste à savoir s'il n'y a pas des longueurs dans ce mot. Cependant, je me sens plus léger depuis que j'ai fini, et plus heureux; c'est pourquoi je suis si doux et si aimable à votre égard; sans cela, je vous aurais dit plus vertement vos vérités. Vous devriez me voir, ne fût-ce que pour sortir de l'atmosphère de flatterie où vous vivez. Il faut qu'un jour nous allions ensemble au Musée voir des tableaux italiens; ce sera une compensation pour le voyage manqué, et l'avantage de m'avoir pour cicerone est inappréciable. Ce n'est pas une condition pour que je vous donne ma pierre étrusque; dites comment, et vous l'aurez.
Paris, novembre 1842.
M. de Montrond dit qu'il faut se garder des premiers mouvements, parce qu'ils sont presque toujours honnêtes. On dirait que vous avez beaucoup médité sur ce beau précepte, car vous le pratiquez avec une rare constance: lorsqu'il vous vient une bonne résolution, vous l'ajournez toujours indéfiniment. Si j'étais à Civita-Vecchia, je chercherais, parmi les pierres de mon ami Bucci, quelque Minerve étrusque; ce serait pour vous le meilleur cachet. En attendant, mon potier est tout prêt, et je dis toujours comme Léonidas: Μολὡν λαβἑ. Je pense le garder encore quelque temps, jusqu'à la veille de votre départ. Vous saurez que je suis beaucoup mieux et moins en proie aux blue devils. J'ai travaillé même avec plaisir, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je fais de grands projets pour mon hiver, et c'est bon signe pour mon moral. Tout cela me rend de bonne humeur; car, si je vous écrivais sous le coup de votre lettre allemande, je vous dirais vos vérités le plus durement qu'il me serait possible. Vous n'y perdrez rien, car, si je vois aujourd'hui en couleur de rose, c'est une raison pour que mes lunettes prennent bientôt une teinte plus sombre. Je voudrais bien savoir ce que vous faites et comment vous passez votre temps. En vous voyant si savante en grec et en allemand, etc., je conclus que vous vous ennuyiez fort à ***, et que vous passez votre vie avec des livres et quelques savants professeurs pour vous les commenter. Mais je me demande si cela n'a pas changé à Paris, et je m'imagine que votre temps se passe de tout autre manière. Si je ne vivais pas depuis longtemps dans la solitude la plus rigoureuse, je saurais vos faits et gestes, et probablement les rapports qu'on me ferait me donneraient une toute autre idée de vous que vos lettres ne le font; bien que vous vous vantiez extrêmement, j'ai la faiblesse de croire que vous êtes avec moi plus franche, je veux dire moins hypocrite que dans le monde. Il y a en vous des contraires si nombreux, que j'en suis fort dérangé pour arriver à une conclusion exacte, c'est-à-dire à la somme totale: + tant de bonnes qualités, - tant de mauvaises = X. Cet X-là m'embarrasse. Lorsque je vous vis, à votre départ de Paris, chez madame de V..., notre amie, votre extrême élégance me surprit fort. Les gâteaux, que vous mangez de si bon appétit pour vous remettre des courbatures que vous gagnez à l'Opéra, m'ont encore plus étonné. Ce n'est pas que, parmi vos défauts, je ne compte en première ligne la coquetterie et la gourmandise; mais je croyais que la forme de ces défauts-là était une forme toute morale; je croyais que vous ne songiez pas trop à votre toilette et que vous étiez femme à manger par distraction; que vous aimiez à faire de l'impression sur les gens par vos yeux et «vos beaux mots», non pas par vos robes. Voyez comme je m'étais trompé! Mais, cette fois, vous ne me reprocherez pas de voir en mal: tandis que vous vous pervertissez tous les jours, il me semble que je m'améliore. Il est une heure tout à fait indue et j'ai quitté une très-docte compagnie de Grecs et de Romains pour vous écrire. L'idée que je dois me lever de bonne heure demain, c'est-à-dire aujourd'hui, vient de me passer par la tête et m'empêche de vous expliquer comme quoi je vaux mieux que je ne valais, lorsque vous vous amusiez à me mystifier avec madame ***. À une autre fois mon éloge; aussi bien je n'ai plus de place.
Paris, 2 décembre 1842.
Il y a dans je ne sais quel vieux roman espagnol un conte assez gracieux. Un barbier avait sa boutique à l'angle de deux rues, et la boutique avait deux portes. Par une de ces portes, il sortait et donnait un coup de poignard au passant, et, rentrant aussitôt, il ressortait par l'autre porte et pansait le blessé. Gelehrten ist gut predigen. Je n'en yeux pas autrement à votre cachemire bleu ni à vos gâteaux; tout cela me semble fort naturel; j'estime la coquetterie et la gourmandise, mais quand on les avoue franchement. Et vous qui aspirez à bon droit à être quelque chose de plus qu'une femme du monde, pourquoi en auriez-vous les défauts? pourquoi n'êtes-vous jamais franche avec moi? Et, pour vous en donner l'exemple, voulez-vous ou ne voulez-vous pas venir avec moi, mardi prochain, au Musée? Si vous ne voulez pas, ou si cela vous contrarie ou vous inquiète, vous aurez votre pierre étrusque mardi soir dans une petite boîte qui vous sera apportée de la manière la plus simple. Vous êtes assez amusante avec votre disposition à la coquetterie. Vous me reprochez mon insouciance, et, si je n'étais pas, ou si je ne paraissais pas insouciant, vous me feriez enrager. Pourquoi porte-t-on un parapluie? C'est parce qu'il pleut. Madame de M. *** viendra à Paris malgré vos souhaits. Elle doit acheter le trousseau de sa fille, qui se marie au printemps; et, à moins d'une révolution extraordinaire, ledit trousseau se fera à Paris, et peut-être la noce aussi. Je ne connais pas le futur; mais, à force d'intrigues, j'ai contribué à en écarter un autre qui me déplaisait, quoique très-exceptionnable sous beaucoup de rapports. Il n'était pas assez grand de taille; il avait, d'ailleurs, cinq ou six grandesses accumulées sur un petit corps. Cette action-là est une preuve de mon amélioration. Autrefois, les ridicules des autres m'amusaient; maintenant, je voudrais les épargner à presque tout le monde. Je suis aussi devenu plus humain, et, lorsque j'ai revu des courses de taureaux, à Madrid, je n'ai pas retrouvé mes émotions de plaisir de dix ans plus tôt; et puis j'ai horreur de toutes les souffrances et je crois aux souffrances morales depuis quelque temps. Enfin, je tâche d'oublier mon moi le plus possible. Voilà, en peu de mots, la liste de mes perfections.
Ce n'est pas par vanagloria que je voudrais être académicien. Je me présenterai un de ces jours, et je serai black-boulé. J'espère avoir assez de constance et de fermeté pour prendre bien la chose et pour persister. Si le choléra revient, j'arriverai peut-être au fauteuil. Non, je n'ai nulle vanagloria. Je vois les choses peut-être trop positivement, mais j'ai été escarmentado pour avoir vu trop poétiquement. Au reste, croyez que vous ne saurez jamais ni tout le bien ni tout le mal qui est en moi. J'ai passé ma vie à être loué pour des qualités que je n'ai pas et calomnié pour des défauts qui ne sont pas les miens. Je me représente maintenant vos soirées passées entre vos deux frères. Adieu.
Décembre, lundi matin.
Voilà ce qui s'appelle parler. Demain à deux heures, là où vous dites. J'espère vous voir demain délivrée de votre migraine, malgré laquelle vous êtes plus aimable qu'à votre ordinaire. Adieu; je serai heureux de regarder la Joconde avec vous. Je suis obligé de courir les quatre coins de Paris et je n'ai que le temps de vous remercier de votre gracieuseté presque inattendue.
Mercredi.
N'est-ce pas qu'on fait le diable plus noir qu'il n'est? Je me réjouis d'apprendre que vous n'êtes pas enrhumée et que vous avez bien dormi. C'est plus que je ne puis dire. Veuillez seulement réfléchir que le Musée sera fermé le 20 janvier pour l'exposition des tableaux, et que ce serait pitié de ne pas lui dire adieu. Vous allez trouver à cette proposition mille et un mais sans doute. Craignez de vous repentir, le 21 janvier, de n'avoir pas retrouvé le courage que vous avez eu hier.
Paris, dimanche soir. Décembre.
Votre lettre ne m'a pas surpris un moment, je m'y attendais. Je vous connais assez maintenant pour être sûr que, lorsque vous avez eu quelque bonne pensée, vous vous en repentez, et vous tâchez de la faire oublier bien vite. Vous vous entendez fort bien, d'ailleurs, à dorer les pilules les plus amères, c'est une justice que je vous dois. Comme je ne suis pas le plus fort, je n'ai rien à dire pour combattre votre héroïque résolution de ne pas retourner au Musée. Je sais fort bien que vous n'en ferez qu'à votre tête; seulement, j'espère que, d'ici à un mois, vous pourrez avoir quelque pensée plus charitable en ma faveur; peut-être avez-vous raison. Il y a un proverbe espagnol qui dit: Entre santa y santo, pared de cal y canto. Vous me comparez au diable. Je me suis aperçu que, mardi soir, je ne pensais pas assez à mes bouquins et trop à vos gants et à vos brodequins. Mais, malgré tout ce que vous me dites avec votre diabolique coquetterie, je ne crois pas que vous ayez peur de retrouver au Musée nos folies d'autrefois. Franchement, voici ce que je pense de vous, et comment je m'explique votre refus: vous aimez à avoir un but vague à votre coquetterie, et ce but, c'est moi. Vous ne le voudriez pas trop près, d'abord: parce que, si vous manquiez à le toucher, votre vanité en souffrirait trop, et puis parce que, en le voyant de trop près, vous trouveriez qu'il ne vaut pas la peine qu'on le vise; ai-je deviné? J'avais envie, l'autre jour, de vous demander quand je vous reverrais, et peut-être m'auriez-vous dit un jour si je vous en avais bien pressée; et puis j'ai pensé qu'après m'avoir dit oui, vous m'écririez non; que cela me ferait de la peine et me mettrait en colère.
Je vous parle toujours avec la plus niaise franchise, mais l'exemple ne vous touche point.
Dimanche, 19 décembre 1842.
On voit bien que vous avez eu des professeurs d'allemand et de grec; mais il est permis de douter que vous en ayez eu de logique. En effet, vit-on jamais raisonner de la sorte! par exemple, lorsque vous me dites que vous ne voulez pas me voir, parce que, quand vous me voyez, vous craignez de ne plus me revoir, etc. À ces causes, je tiens votre lettre pour non avenue. La seule chose qui m'ait paru claire, c'est que vous avez un mouchoir à me donner. Envoyez-le-moi ou dites-moi de le recevoir de votre main, ce qui me conviendrait beaucoup mieux. Je hais les surprises qu'on m'annonce, parce que je me les représente beaucoup plus belles qu'elles ne sont en effet. Croyez-moi, revoyons le Musée ensemble; si je vous ennuie, tout sera dit, je ne vous y reprendrai plus; sinon, qui empêche que nous nous voyions de temps en temps? À moins que vous ne me donniez quelque raison intelligible, je persisterai à croire ce qui vous irrite tant.—Je vous aurais répondu tout de suite, mais j'avais perdu votre lettre et je voulais la relire. J'ai bouleversé ma table, je l'ai rangée, ce qui n'est pas une petite affaire; enfin, après avoir brûlé quelques rames de vieux papiers destinés à ramasser la poussière sur mon bureau, j'ai cru que votre lettre s'était anéantie par quelque sortilège. Je l'ai retrouvée tout à l'heure dans mon Xénophon, où elle était entrée, je ne sais comment; je l'ai relue avec admiration. Il faut assurément que vous n'ayez guère de cette vénération dont vous me parlez quelquefois, pour me dire tant de sinrazones; mais je vous les pardonnerai si nous nous voyons bientôt; car, lorsque vous parlez, vous êtes bien plus aimable que lorsque vous écrivez.
Je suis très-souffrant, je tousse à fendre les rochers, et cependant je vais lundi soir entendre mademoiselle Rachel dire des tirades de Phèdre devant cinq ou six grands hommes. Elle croira que ma toux est une cabale contre elle. Écrivez-moi bientôt. Je m'ennuie horriblement, et vous feriez une œuvre de charité en me disant quelque chose d'aimable, comme vous faites quelquefois.
Décembre 1842.
Il y a longtemps que je veux vous écrire. Mes nuits se passent à faire de la prose pour la postérité; c'est que je n'étais content ni de vous, ni de moi, ce qui est plus extraordinaire. Je me trouve aujourd'hui plus indulgent. J'ai entendu ce soir madame Persiani, qui m'a raccommodé avec la nature humaine. Si j'étais comme le roi Saül, je la prendrais en place d'un David. On me dit que M. de Pongerville, l'académicien, va mourir: cela me désole, car je ne le remplacerai pas, et je voudrais qu'il attendît jusqu'à ce que mon temps fût venu. Ce Pongerville-là a traduit en vers un poète latin nommé Lucrèce, lequel mourut à quarante-trois ans pour avoir pris un philtre à l'effet de se faire aimer ou de se rendre aimable. Mais, auparavant, il avait fait un grand poème sur la Nature des choses, poème athée, impie, abominable, etc.
La santé de M. de Pongerville me tracasse plus que de droit, et puis je vais être obligé de me lever à dix heures après-demain pour les ennuis du jour de l'an. Comment tout le monde ne s'entend-il pas pour voyager ou aller à tous les diables, ce jour-là? J'ai encore d'autres ennuis qui vous feraient rire et que je ne vous dirai pas. Savez-vous que, si nous continuons à nous écrire sur ce ton d'aimable confiance, chacun gardant pour soi ses pensées secrètes, nous n'avons qu'une ressource, c'est de soigner notre style, puis de publier un jour notre correspondance, comme on a fait pour celle de Voiture et de Balzac? Vous avez surtout une manière de considérer comme non avenues les choses dont vous ne voulez pas parler qui fait le plus grand honneur à votre diplomatie. Il me semble que vous embellissez. Cela me paraissait impossible, car la mer ne peut acquérir de nouvelles eaux. Cela prouve que ce que vous perdez d'un côté, vous le gagnez de l'autre. On embellit quand on se porte bien; on se porte bien quand on a un mauvais cœur et un bon estomac. Mangez-vous toujours des gâteaux?
Adieu; je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon commencement de l'autre. Vos amis useront vos joues ce jour-là. Lorsque j'aurai fini la prose dont je vous parlais tout à l'heure, j'irai pour ma peine passer une dizaine de jours à Londres. Ce sera vers Pâques.
Décembre 1842.
Vous saurez que j'ai été très-malade depuis que nous ne nous sommes vus. J'ai eu tous les chats du monde dans la gorge, tous les feux de l'enfer dans la poitrine et j'ai passé quelques jours dans mon lit à méditer sur les choses de ce monde. J'ai trouvé que j'étais sur la pente d'une montagne dont j'avais à peine, avec beaucoup de fatigue et peu d'amusement, dépassé le sommet, que cette pente était bien roide et bien ennuyeuse à dégringoler, et qu'il serait assez avantageux de rencontrer un trou avant d'arriver au bas. Le seul motif de consolation que j'aie découvert le long de cette pente, c'est un peu de soleil bien loin, quelques mois passés en Italie, en Espagne ou en Grèce à oublier le monde entier, le présent et surtout l'avenir. Tout cela n'était pas gai; mais l'on m'a apporté quatre volumes du docteur Strauss, la Vie de Jésus. On appelle cela de l'exégèse en Allemagne; c'est un mot tout grec qu'ils ont trouvé pour dire discussion sur la pointe d'une aiguille; mais c'est fort amusant. J'ai remarqué que plus une chose est dépourvue d'une conclusion utile, plus elle est amusante. Ne pensez-vous pas un peu de la sorte, señora caprichosa?...
Mardi soir. Décembre 1842.
Ce n'est plus du Jean-Paul, c'est du français, et du français du temps de Louis XV. Belle argumentation, toute fondée sur l'intérêt. Il y a des gens qui achètent un meuble dont la couleur leur plaisait; comme ils ont peur de le gâter, ils y mettent des housses de toile qu'ils n'ôteront que lorsque le meuble sera usé. Dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, vous substituez toujours à un sentiment réel un convenu. C'est peut-être une convenance. La question est de savoir ce que c'est pour vous auprès d'autre chose qu'il serait presque bête et ridicule de lui comparer dans ma manière de voir. Vous savez que, bien que je n'aie pas beaucoup d'admiration pour les mauvais raisonnements, je respecte les convictions, même celles qui me paraissent les plus absurdes. Il y a en vous beaucoup d'idées saugrenues, pardonnez-moi le mot, que je me reprocherais de chercher à vous ôter, puisque vous y tenez et parce que vous n'avez rien à mettre en place. Mais nous rêvons. N'y a-t-il pas l'appareil de cal y canto qui nous réveille sans cesse? Devons-nous chercher encore à fermer la crevasse par laquelle nous voyons des choses de féerie? Que craignez-vous? Il y a dans votre lettre d'aujourd'hui, au milieu d'un tas de duretés et de sombres pensées bien froides, quelque chose qui est vrai. «Je crois que je ne vous ai jamais tant aimé qu'hier.» Vous auriez pu ajouter: «Je vous aime moins aujourd'hui.» Je suis sûre que, si vous étiez aujourd'hui telle que vous étiez hier, vous auriez eu les remords que je vous prédisais et qui ne vous tourmentent guère, à ce qu'il me semble. Mes remords à moi sont d'un autre genre.
Je me repens souvent d'être trop loyal dans mon métier de statue. Vous me donniez votre âme hier, j'aurais voulu vous donner la mienne; mais vous ne voulez pas. Toujours la housse de toile! Voilà un sujet sur lequel vous me feriez vous dire toutes les injures possibles; et pourtant jamais je n'en ai eu moins d'envie avant d'avoir reçu votre lettre. Après tout, je suis comme vous: les bons souvenirs me font oublier les mauvais. À propos, voyez quelle tendresse! vous me gardez une surprise pour mon départ. Croyez-vous que je sois bien impatient? Hier, en revenant de dîner en ville, je me suis aperçu que je savais par cœur le discours de Temessa que vous aviez admiré; et, comme j'étais un peu rêveur, je l'ai traduit en vers; en vers anglais s'entend, car j'abhorre les vers français. Je vous les destinais, mais vous ne les aurez pas. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il y avait une horrible faute de quantité dans le mot Ājax. C'est Ájax qu'il faut, n'est-ce pas?
Quand vous verrai-je, pour vous dire ce que vous ne me dites jamais? Vous voyez que nous commandons au temps. Il se transforme pour nous. Entre deux tempêtes, nous avons toujours un jour d'alcyon. Dites-moi seulement deux jours, car je suis à l'attache maintenant.
Paris, 3 janvier 1813.
À la bonne heure, voilà ce qui s'appelle parler. Vous êtes si aimable quand vous le voulez! pourquoi donc vous faites-vous souvent si mauvaise? Non, bien entendu, les remercîments par écrit ne valent rien, et toute la diplomatie que j'ai mise à vous procurer les lettres de recommandation si chaleureuses pour votre frère mérite que vous me disiez quelque chose d'aimable. Je vous pardonnerai de très-grand cœur tout ce que vous me dites de moqueur au sujet des ballons et de l'Académie, à laquelle je pense bien moins que vous ne dites. Si je suis jamais académicien, je ne serai pas plus dur qu'un rocher. Peut-être serai-je alors un peu racorni et momifié, mais assez bon diable au fond. Pour la Persiani, je n'ai pas d'autre moyen d'en faire mon David que d'aller l'entendre tous les jeudis. Quant à mademoiselle Rachel, je n'ai pas la faculté de jouir des vers aussi souvent que de la musique; et elle—Rachel, non la musique—me remet en mémoire que je vous ai promis une histoire. Vous la conterai-je ici, ou vous la garderai-je pour quand je vous verrai? Je vais vous l'écrire, j'aurai sans doute autre chose à vous dire. Donc, j'ai dîné, il y a une douzaine de jours, avec elle, chez un académicien. C'était pour lui présenter Béranger. Il y avait là quantité de grands hommes. Elle vint tard, et son entrée me déplut. Les hommes lui dirent tant de bêtises et les femmes en firent tant, en la voyant, que je restai dans mon coin. D'ailleurs, il y avait un an que je ne lui avais parlé. Après le dîner, Béranger, avec sa bonne foi et son bon sens ordinaires, lui dit quelle avait tort de gaspiller son talent dans les salons, qu'il n'y avait pour elle qu'un véritable public, celui du Théâtre-Français, etc. Mademoiselle Rachel parut approuver beaucoup la morale, et, pour montrer qu'elle en avait profité, joua le premier acte d'Esther. Il fallait quelqu'un pour lui donner la réplique et elle me fit apporter un Racine en cérémonie par un académicien qui faisait les fonctions de sigisbée. Moi, je répondis brutalement que je n'entendais rien aux vers et qu'il y avait dans le salon des gens qui, étant dans cette partie-là, les scanderaient bien mieux. Hugo s'excusa sur ses yeux, un autre sur autre chose. Le maître de la maison s'exécuta. Représentez-vous Rachel en noir, entre un piano et une table à thé, une porte derrière elle et se composant une figure théâtrale. Ce changement à vue a été fort amusant et très-beau; cela a duré environ deux minutes, puis elle commença:
Est-ce toi, chère Élise?...
La confidente, au milieu de sa réplique, laisse tomber ses lunettes et son livre; dix minutes se passent avant qu'elle ait retrouvé sa page et ses yeux. L'auditoire voit qu'Esther enrage quelque peu. Elle continue. La porte s'ouvre derrière: c'est un domestique qui entre. On lui fait signe de se retirer. Il s'enfuit et ne peut parvenir à fermer la porte. La porte susdite, ébranlée, oscillait, accompagnant Rachel d'un mélodieux cric crac très-divertissant. Comme cela ne finissait pas, mademoiselle Rachel porta la main sur son cœur et se trouva mal, mais en personne habituée à mourir sur la scène, donnant au monde le temps d'arriver à l'aide. Pendant l'intermède, Hugo et M. Thiers se prirent de bec au sujet de Racine. Hugo disait que Racine était un petit esprit et Corneille un grand. «Vous dites cela, répondit Thiers, parce que vous êtes un grand esprit; vous êtes le Corneille (Hugo prenait des airs de tête très-modestes) d'une époque dont le Racine est Casimir Delavigne.» Je vous laisse à penser si la modestie était de mise. Cependant, l'évanouissement passe et l'acte s'achève, mais fiascheggiando. Quelqu'un qui connaît bien mademoiselle Rachel dit en sortant: «Comme elle a dû jurer ce soir, en s'en allant!» Le mot m'a donné à penser. Voilà mon histoire; ne me compromettez pas auprès des académiciens, c'est tout ce que je vous demande.
Dimanche, je ne vous ai reconnue que lorsque j'étais tout près de vous. Mon premier mouvement a été d'aller vers vous; mais, en vous voyant très-accompagnée, j'ai passé mon chemin. J'ai bien fait, je pense. Il me semble que je vous ai connu les joues pâles, d'où j'ai conclu qu'elles étaient roses par la solennité de ce jour.
Bonsoir ou plutôt bonjour. Lundi ou plutôt mardi. Il est trois heures du matin.
Jeudi, janvier 1843.
Profitons du beau temps dès aujourd'hui.
One homme n'eut les dieux tant à la main,
Qu'asseuré fut de vivre au lendemain.
Donc, où vous dites «à deux heures, demain jeudi», je dis «aujourd'hui», car il est une heure du matin. Les étoiles brillent, et, en revenant tout à l'heure du raout ministériel, j'ai trouvé le pavé aussi tolérable que la dernière fois. Mettez cependant vos bottes de sept lieues, c'est le plus sûr. Si, par extraordinaire, vous étiez sortie quand cette lettre vous arrivera, je vous attendrai jusqu'à deux heures et demie; puis samedi, si vous ne pouvez aujourd'hui. A une autre que vous, je dirais autre chose. Je voulais vous écrire aujourd'hui, mais je me suis arrêté en pensant à ma promesse. J'ai mal fait. Vous auriez dû me dire votre heure et votre jour; cela nous eût épargné l'inconvénient de nous manquer. J'espère qu'il n'en sera rien. Je suppose surtout que vous avez réellement envie de faire cette promenade, car votre lettre est plus froide que les précédentes. Il y a dans votre manière un équilibre admirable. Vous ne voulez jamais que je sois parfaitement content, et vous prenez d'avance vos mesures pour me faire enrager. Cela vous sera peut-être plus difficile que vous ne pensez, car, bien que je sois malade depuis deux jours, je vois tout couleur de rose. Hier, j'ai dîné dans une maison où, entrant tard au milieu d'un cercle de femmes, j'ai cru d'abord vous reconnaître, et j'en suis devenu stupide pendant un quart d'heure. Je ne tournais pas les yeux vers cette personne qui vous ressemblait, et je réfléchissais fort mal, comme lorsqu'on est troublé, sur ce que je devais faire: vous reconnaître ou non.
Enfin, par un effort désespéré, je me suis avancé vers ladite femme, qui s'est trouvée être une Espagnole que j'ai cependant vue trois ou quatre fois. Il ne tient qu'à elle de croire che ha fatto colpo. Je vous envoie les Sketches de Dickens, qui m'ont amusé autrefois. Peut-être les avez-vous lues déjà, mais peu importe! Ainsi, à deux heures, aujourd'hui jeudi.
Paris, dimanche 16 janvier 1843.
Je vous remercie d'avoir pensé à me rassurer, mais je crains cette chaleur aux joues dont vous parlez si légèrement. Je regrette bien, je vous assure, d'avoir insisté tant pour vous procurer cette affreuse averse. Il m'arrive rarement de sacrifier les autres à moi-même, et, quand cela m'arrive, j'en ai tous les remords possibles. Enfin, vous n'êtes pas malade et vous n'êtes pas fâchée; c'est là le plus important. Il est bien qu'un petit malheur survienne de temps en temps pour en détourner de plus grands. Voilà la part du diable faite. Il me semble que nous étions tristes et sombres tous les deux; assez contents pourtant au fond du cœur. Il y a des gaietés intimes qu'on ne peut répandre au dehors. Je désire que vous ayez senti un peu de ce que j'ai senti moi-même. Je le croirai jusqu'à ce que vous me disiez le contraire. Vous me dites deux fois: «Au revoir!» C'est pour de bon, n'est-ce pas? Mais où et comment? J'ai été si malheureux dans ma dernière invention, que je suis tout à fait découragé. Je ne m'en lierai plus qu'à vos inspirations.
Je suis très-enrhumé ce soir, mais la pluie n'y est pour rien, je pense. J'ai passé toute la matinée à voir des talismans et des bagues chaldéennes, persanes, etc., dans une galerie sans feu, chez un antiquaire qui mourait de peur que je ne les lui volasse. Pour le tourmenter, je suis resté au froid plus longtemps que mon inclination ne m'y portait.
Bonsoir et au revoir bientôt. C'est à vous à commander maintenant. Ne fût-ce que pour m'assurer que cette pluie ne vous a pas enrhumée, découragée ni irritée, je voudrais bien vous voir.
Dimanche soir, janvier 1843.
Pour moi, je n'étais pas trop fatigué, et cependant, en regardant sur la carte nos pérégrinations, je vois que nous aurions dû l'être tous les deux. C'est que le bonheur me donne des forces; à vous, il vous les ôte. Wer besser liebt? J'ai dîné en ville et je suis allé à un raout après. Je ne me suis endormi que très-tard, pensant à notre promenade.
Vous avez raison de dire que c'était un rêve. Mais n'est-ce pas un grand bonheur de pouvoir rêver quand on le veut bien? Puisque vous êtes dictatrice, c'est à vous de dire quand vous voudrez recommencer. Vous dites que nous n'avons pas eu de procédés l'un pour l'autre. Je ne comprends pas. Est-ce parce que je vous ai trop fait marcher? Mais comment pouvions-nous faire autrement? Moi, je suis très-content de vos procédés, et je les louerais davantage si je n'avais peur que les éloges ne vous rendissent moins aimable à l'avenir. Quant aux follies, n'y songez plus, c'est devenu une charte. Lorsque vous trouvez à redire à quelque chose, demandez-vous si vous préféreriez really truly le contraire? J'aimerais que vous me répondissiez franchement à cette question. Mais la franchise n'est pas trop parmi vos qualités les plus apparentes. Vous vous êtes moquée de moi, et vous avez pris pour un mauvais compliment ce que je vous ai dit un jour de cette envie de dormir, ou plutôt de cette torpeur qu'on éprouve quelquefois lorsqu'on se sent trop heureux pour trouver des mots qui puissent exprimer ce que l'on éprouve. J'ai bien remarqué hier que vous étiez sous l'influence de ce sommeil-là, qui vaut bien toutes les veilles. J'aurais pu vous reprocher à mon tour vos reproches; mais j'étais trop content intérieurement pour troubler mon bonheur.
Adieu, chère amie; à bientôt, j'espère.
Mercredi soir, janvier 1843.
J'ai attendu toute la journée une lettre de vous. Je trouvais le pavé sec et le ciel tolérable. Mais il paraît qu'il vous faut maintenant un soleil comme celui de jeudi dernier. Je crois, en outre, que vous aviez besoin d'élaborer la lettre que j'ai reçue tout à l'heure. Elle contient des reproches et des menaces, le tout très-gracieusement arrangé comme vous savez faire. D'abord, je dois vous remercier de votre franchise, et j'y répondrai par une franchise égale. Pour commencer par les reproches, je trouve que vous faites une grosse affaire pour pas grand'chose. C'est en réfléchissant sur les faits et en les grossissant par vos réflexions que vous êtes parvenue à faire de ce que vous appelez vous-même des frivolités, a star chamber matter. Il n'y a qu'un point qui vaille la peine d'une explication. Vous me parlez de précédents, et vous avez l'air de croire que je travaille à établir des précédents avec la patience et le machiavélisme d'un vieux ministre. Ayez un peu de mémoire et vous verrez que rien n'est plus faux. S'il fallait argumenter d'après les précédents, j'aurais cité celui du salon de la rue Saint-Honoré la première fois que je vous revis; puis notre première visite au Louvre, qui faillit me coûter un œil. Tout cela vous paraissait assez simple alors; maintenant, c'est autre chose. Vous avez dû voir que je fais quelquefois ce qui me vient en tête, que j'y renonce dès que j'ai la conviction que cela vous déplaît, et que beaucoup plus souvent je me borne à penser au lieu de faire. En voilà assez sur les reproches et les précédents.
Quant aux menaces, croyez qu'elles me sont très-sensibles. Cependant, bien que je les craigne fort, je ne puis m'empêcher de vous dire encore tout ce que je pense. Rien ne me serait plus facile que de vous faire des promesses, mais je sens qu'il me serait impossible de les tenir. Contentez-vous donc de notre manière d'être passée, ou bien ne nous voyons plus. Je dois même vous dire que l'insistance et l'espèce d'acharnement que vous mettez à me contrarier pour ces frivolités me les rendent plus chères et m'y font attacher une importance nouvelle. C'est la seule preuve que vous puissiez me donner des sentiments que vous pouvez avoir pour moi. S'il faut vous voir pour résister aux tentations les plus innocentes, c'est un travail de saint qui dépasse mes forces. J'aurais sans doute beaucoup de plaisir à vous voir, mais la condition de me transformer en statue, comme ce roi des Mille et une Nuits, m'est insupportable.
Nous venons de nous expliquer très-clairement l'un et l'autre. Vous déciderez suivant votre sagesse si nous devons ajourner notre première promenade à quelques années ou au premier soleil. Vous voyez que je n'accepte pas le conseil d'hypocrisie que vous me donnez. Vous saviez d'avance que cela m'était impossible. La seule hypocrisie dont je sois capable, c'est de cacher aux gens que j'aime tout le mal qu'ils me font. Je puis soutenir cet effort quelque temps, mais toujours, non. Quand vous recevrez cette lettre, il y aura huit jours que nous ne nous serons vus. Si vous persistez dans vos menaces, écrivez-moi tout de suite. Ce sera de votre part une attention de bonté dont je vous saurai gré.
Janvier 1843.
Je ne m'étonne plus que vous ayez appris l'allemand si bien et si vite: c'est que vous possédez le génie de cette langue, car vous faites en français des phrases dignes de Jean-Paul; par exemple, lorsque vous dites: «Ma maladie est une impression de bonheur qui est presque une souffrance!» prosaïquement, j'espère que cela veut dire: «Je suis, guérie et je n'étais pas bien malade.» Vous avez raison de me gronder de n'avoir pas assez d'égards pour les malades; je me suis bien reproché de vous avoir fait marcher, de vous avoir permis de vous asseoir longtemps à l'ombre. Quant au reste, je n'ai pas de remords, ni vous non plus, j'espère. Moi, je n'ai pas de souvenirs distincts, contre mon habitude. Je suis comme un chat qui se lèche longtemps la moustache quand il a bu du lait. Convenez que le repas dont vous parlez quelquefois avec admiration, que le kêf même, qui est supérieur à ce qu'il y a de mieux en ce genre, n'est rien en comparaison du bonheur «qui est presque une souffrance». Il n'y a rien de pire que la vie d'une huître, voire même d'une huître qui n'est jamais mangée. Vous prétendez me gâter, vous avez été tellement gâtée vous-même, que vous vous entendez mal à gâter les autres. Votre triomphe, c'est de les faire enrager; mais, en fait de compliments, vous m'en devriez, je pense, pour la magnanimité dont j'ai fait preuve en me laissant rassurer par vous. Je m'admire moi-même. Ainsi, au lieu de votre sermon, dites-moi quelque chose de terrible à cette occasion, ou plutôt dites-moi toutes ces folies couleur de rose que vous dites si bien. Vous m'avez fait recommencer mon voyage en Asie mieux que je ne l'ai fait. La machine plus rapide que le chemin de fer est toute trouvée, nous la portons tous les deux dans nos têtes. J'ai pris le «hint», et, depuis que j'ai reçu votre lettre, je suis allé avec vous à Tyr et à Éphèse; nous avons grimpé ensemble dans la belle grotte d'Éphèse. Nous nous sommes assis sur de vieux sarcophages et nous nous sommes dit toute sorte de choses. Nous nous sommes querellés et raccommodés; tout a été comme dans cette prairie l'autre jour. Seulement, il n'y avait pour nous voir que de grands lézards très-inoffensifs quoique forts laids. Je ne puis pas même, in the mind's eye, vous voir aussi tendre que je voudrais; même à Éphèse, je vous vois un peu boudeuse et abusant de ma patience.
Vous me parliez l'autre jour de surprise que vous me feriez; franchement, comment voulez-vous que j'y croie? Tout ce que vous pouvez faire c'est de céder quand vous êtes à bout de mauvaises raisons. Mais comment inventerez-vous de vous-même de donner, quand vous avez le génie du refus? Je suis bien sûr, par exemple, que vous n'imaginerez jamais de me proposer un jour pour nous promener. Voulez-vous lundi ou mardi? Le ciel me donne des inquiétudes; cependant, je compte sur votre bon démon, comme disaient les Grecs. À ce propos, je veux vous apporter un passage d'une tragédie grecque que je vous traduirai littéralement, et vous m'en direz votre avis. Je crois que la comédie espagnole est restée quelque part, entre l'endroit de la Tamise où nous avons débarqué et celui où nous nous sommes rembarqués. Je vous en apporterai une autre. Mais, comme je tiens à ce que vous lisiez l'histoire du comte de Villa-Mediana, je vous chercherai le petit poème du duc de Biron. Adieu; n'ayez pas de secondes pensées et donnez-moi une place dans les premières. Vous savez pour moi quelles sont les unes et les autres. Faites-moi penser à vous conter une histoire de somnambule que je voulais vous dire l'autre jour.
Paris, 21 janvier 1843.
Vous êtes bien aimable et je vous remercie de votre première lettre, qui m'a fait encore plus de plaisir que la seconde, laquelle sent un peu les seconds mouvements. Elle a du bon cependant. Mais écrivez donc plus lisiblement l'allemand. J'ai bien besoin des commentaires que vous m'offrez, commentaires verbaux s'entend, ce sont les meilleurs. D'abord, j'ai lu heilige Empfindung, puis je crois qu'il faut lire selige. Mais il y a deux sens. Est-ce sentiment de bonheur ou sentiment passé, mort; feu sentiment? Si je vous avais vue écrivant, j'aurais probablement deviné à votre expression ce que vous vouliez dire. Double coquetterie de votre part, coquetterie d'écriture, coquetterie d'obscurité. Hélas! vous me croyez plus savant que je ne suis en matière de toilette. J'ai cependant mes idées très-arrêtées sur ce point; je vous les soumettrai, si bon vous semble; mais je ne comprends pas la plupart des belles choses qu'il faut admirer, à moins qu'on ne me les démontre; vous m'expliquerez et je comprendrai tout de suite, je vous assure. Mais quand et comment? ces deux questions me préoccupent autant que votre pourquoi et pour qui! N'avez-vous pas regretté un peu les beaux jours passés au soleil de printemps? Aucun danger pour les merveilles de bottines! Si vous me dites que vous y avez pensé et que vous y pensez, vous me ferez prendre patience; mais il faudra plus que penser, il faudra résoudre. Je n'ai nulle envie de vous rappeler vos promesses; car j'espère que vous ajouterez à votre bonne foi à les remplir de bonne grâce, de ne pas les faire trop attendre. J'ai été tellement consterné par cette averse et ce qui s'ensuit, que je suis devenu tout confit en douceur et en abnégation de moi-même. J'ai maintenant assez de confiance en vous pour croire que vous ne vous en prévaudrez pas pour devenir tyrannique. Vous y avez, je crains, de grandes dispositions; ç'a été mon défaut autrefois: je dis la tyrannie, mais j'en suis corrigé, je m'en flatte. Adieu donc, dearest! Pensez donc un peu à moi.
27 janvier 1843.
Voici ce qui m'est arrivé. J'étais très-souffrant ce matin, et j'ai été obligé de sortir pour affaires de mon commerce; je suis rentré vers cinq heures assez furieux, et je me suis endormi devant mon feu en fumant un cigare et en lisant le docteur Strauss. Or, il me semblait que j'étais dans le même fauteuil, mais lisant éveillé, lorsque vous êtes entrée et m'avez dit: «N'est-ce pas que c'est la manière la plus simple de nous voir?—Pas trop bonne,» disais-je, car il me semblait qu'il y avait deux ou trois personnes dans la chambre. Cependant, nous causions comme si de rien n'était; sur quoi, je me suis éveillé, et j'ai trouvé qu'on m'apportait une lettre de vous. Voyez comme il fait bon dormir! Je ne crois pas vous avoir écrit rien de méchant, et, par conséquent, je n'ai pas de pardon à vous demander. Ce serait plutôt à vous de le faire, et vous le faites avec si peu de contrition et tant d'ironie, que je vois bien que vous avez perdu cette vénération dont autrefois vous m'honoriez. Je ne puis rester cependant en colère contre vous, malgré mes résolutions, et je me résigne à être encore votre victime; mais n'abusez pas de ma magnanimité. Cela ne serait ni beau ni généreux. Vous parlez de soleil et vous m'y renvoyez, c'est presque comme aux kalendes grecques; probablement nous en aurons des nouvelles au mois de juin; mais faut-il attendre jusque-là? Il est vrai que vous êtes escarmentada du temps nébuleux. Mais, en prenant nos précautions, ne pourrions-nous pas profiter du premier temps tolérable? Je ne voudrais pas que vous vous enrhumassiez à mon occasion. Mettez vos bottes de sept lieues. Vous voir n'importe en quel costume, c'est ce qui me fera toujours assez de plaisir. Quel est ce mal de côté dont vous parlez si légèrement? Savez-vous que les fluxions de poitrine commencent ainsi? Vous serez allée au bal et vous aurez eu froid en sortant. Rassurez-moi bien vite, je vous prie. J'aimerais mieux vous savoir cross que malade. Si vous vous portez tout à fait bien, si vous êtes en belle humeur, et qu'il fasse tant soit peu beau samedi, pourquoi ne ferions-nous pas cette promenade? Nous pourrions nous faire mener quelque part, loin des hommes, et marcher ensemble en causant. Si vous ne pouvez ou ne voulez samedi, je ne me fâcherai pas; mais tâchez au moins que ce soit bientôt. Quand je vous demande quelque chose, vous ne le faites qu'après m'avoir fait enrager pendant si longtemps, que vous m'empêchez d'avoir autant de reconnaissance que je devrais peut-être; et vous, en outre, vous vous ôtez tout le mérite que vous auriez en étant promptement généreuse. Causer ensemble, et, ce qui nous est arrivé quelquefois, penser ensemble, est-ce donc un plaisir dont vous vous lassiez si vite? Il est vrai qu'on ne répond que pour soi, mais chacune de nos promenades a été pour moi plus heureuse que la précédente, par les souvenirs qu'elle m'a laissés. J'en excepte la dernière, et celle-là, je voudrais l'effacer au plus vite, pour la remplacer par une autre où vous ne couriez pas le risque d'être malade. Ainsi la paix est faite; j'attends vos ordres pour les ratifications jeudi soir.
Paris, 3 février 1843.
Ce beau temps ne vous fait-il donc pas penser à Versailles, et, par conséquent, ne vous donne-t-il pas envie de rire? Si vous aviez un peu de logique, vous n'auriez point ri. En effet, vous n'ignorez pas que Versailles est le chef-lieu du département de Seine-et-Oise, qu'il y a des autorités chargées de protéger le faible et qu'on y parle français. En un tel pays, vous seriez aussi en sûreté qu'à Paris. De plus, le but que vous vous proposez, c'est de vous promener sans rencontrer des badauds de votre connaissance. À Versailles, un jour que le musée n'est pas ouvert, vous êtes sûre de ne trouver personne. Je ne parle ni de l'air ni de la beauté des lieux, qui ont leur mérite et qui influent toujours sur la nature des idées. Je suis persuadé, par exemple, qu'à Versailles, vous n'auriez point eu cette colère rentrée de l'autre jour; je vous en crois parfaitement guérie, car la fin de votre lettre m'a paru de votre bon génie. Le commencement sentait un peu votre diable. Je vous écris en hâte. Je suis accablé de commissions et je vais bien m'ennuyer. Pensez un peu à moi, et ne vous fâchez pas. Ne riez pas trop en y pensant.
Paris, 7 février 1843.
Veuillez me permettre un calcul très-simple, et tout sera dit sur Versailles. C'est donc très-difficile, une promenade d'une heure dans un si beau jardin? Or, ce jour de grand brouillard, n'avons-nous pas passé deux heures au musée ensemble? J'ai dit.
Vous me faites rire avec les commissions qu'on me donne, à ce que vous supposez. Bien que celles-ci ne me manquent pas, les commissions dont je vous parlais sont des réunions où plusieurs personnes ne font pas la besogne que ferait un seul beaucoup mieux. Ne croyez pas être la seule qui fasse des commissions. J'ai couru tout Paris pour acheter des robes et des chapeaux, et, mercredi, j'ai rendez-vous pour commander un costume de bergère rococo. Tout cela pour les deux filles de madame de M ***. Conseillez-moi. Quel costume doivent-elles avoir pour un bal travesti? Une Écossaise et une Cracovienne sont en route. J'ai une bergère; il me faut encore un autre déguisement. Voici le signalement: l'aînée est brune, pâle, un peu moins grande que vous, très-jolie, expression gaie. L'autre est très-grande, très-blanche, prodigieusement belle, avec les cheveux qu'aimait le Titien. J'en voudrais faire une bergère avec de la poudre. Conseillez-moi pour l'autre.
Je me demande pourquoi vous me semblez si embellie, et je ne puis trouver de réponse satisfaisante. Est-ce parce que vous avez l'air moins effarouché? Cependant, la dernière fois, vous me faisiez penser à un oiseau qu'on vient de mettre en cage. Vous m'avez vu trois mines, je ne vous en connais que deux. L'effarouchement est une sorte de dépit radieux que je n'ai vu qu'à vous.
Vous m'accusez à tort d'être mondain; depuis quinze jours, je ne suis sorti qu'une fois le soir pour faire une visite à mon ministre. J'ai trouvé toutes les femmes en deuil, plusieurs avec des mantilles; non, des barbes noires qui les font ressembler à des Espagnoles; cela m'a paru fort joli. Je suis d'une tristesse et d'une maussaderie étranges. Je voudrais bien vous chercher querelle, mais je ne sais sur quoi. Vous devriez m'écrire des choses très-aimables et très-senties, je tâcherais de me figurer votre mine en les écrivant, et cela me consolerait.
Mon roman vous amuse-t-il? Lisez la fin du deuxième volume: M. Yellowplush.—C'est une assez bonne charge, à ce qu'il me semble. Adieu, écrivez-moi bientôt.
Je rouvre ma lettre pour vous prier de remarquer que le temps a l'air de se rasséréner.
Paris, dimanche 11 février 1843.
Je ne sais trop si je dois croire pieusement tout ce que vous me dites, dans votre lettre, de votre indisposition et des affaires qui vous retiennent. Au milieu de toutes les choses aimables que vous me dites, je crois que vous n'avez guère envie de me voir. Me trompé-je, ou bien est-ce que je suis si peu habitué à vos douceurs, que je ne puis les croire vraies? Mardi, serez-vous guérie? serez-vous libre? serez-vous d'aussi bonne humeur que mercredi passé? Hier, dans l'après-midi, il a fait un temps superbe; peut-être serons-nous autant favorisés mardi prochain, si mon baromètre ne m'abuse. J'ai quelque chose pour vous qui vous paraîtra fort bête peut-être. Depuis que je ne vous ai vue, j'ai beaucoup couru le monde, et fait quantité de bassesses académiques. J'en avais perdu l'habitude, et cela m'a fort coûté; mais je crois que je m'y referai assez vite. Aujourd'hui, j'ai vu cinq illustres poètes ou prosateurs, et, si la nuit ne m'eût surpris, je ne sais si je n'aurais pas achevé tout d'un trait mes trente-six visites. Le drôle, c'est quand on rencontre des rivaux. Plusieurs vous font des yeux à vous manger tout cru. Je suis, au fond, excédé de toutes ces corvées, et je serais heureux de tout oublier pendant une heure avec vous.
11 février 1843.
Cette neige ne se charge-t-elle pas toute seule de dire non, sans que vous vous en mêliez? Cela devrait vous guérir de cette mauvaise habitude de négation. Le diable est bien assez méchant sans que vous alliez sur ses brisées. J'ai beaucoup souffert la nuit passée. J'ai eu la fièvre et des élancements très-douloureux. Ce soir, je vais assez bien. Il me semble que, dans votre billet, vous cherchez le moyen de me faire quelque querelle sur notre promenade. Qu'a-t-elle eu de si malheureux, si vous ne vous êtes pas enrhumée? et je vous ai fait marcher si vite, que je n'en ai guère d'inquiétude. Vous aviez un air de santé et de force qui faisait plaisir à voir. Et puis vous perdez peu à peu quelque chose de votre contrainte. Vous gagnez de tout point à ces promenades, sans parler de la variété de connaissances archéologiques que vous acquérez, sans vous en donner la peine. Vous voilà déjà passée maîtresse en matière de vases et de statues. Chaque fois que nous nous rencontrons, il y a une croûte de glace à rompre entre nous. Je trouve qu'au bout d'un quart d'heure seulement nous reprenons notre dernière causerie au point où nous l'avions laissée. Mais, si nous nous voyions plus souvent, sans doute il n'y aurait plus de glace du tout. Que préférez-vous, la fin ou le commencement de nos rencontres?
Vous ne m'avez pas remercié de ne pas vous avoir dit un mot de Versailles. J'y ai pensé souvent, je vous jure. J'avais quelque chose à vous montrer que j'ai oublié. C'est de l'auld langsyne. Voyons, devinez si vous pouvez. J'oublie en vous voyant ce que je voulais dire; j'ai noté un sermon à vous faire à l'endroit de vos jalousies de votre frère: de la façon dont je conçois votre rôle de sœur, vous devriez souhaiter à votre frère quelque belle et bonne passion. Remarquez que vous ne pourrez jamais rien empêcher, et que, si vous ne devenez pas confidente heureuse, ou du moins résignée, vous êtes prédestinée à devenir étrangère. Adieu. Mon doigt me fait un mal de chien, mais on me dit que c'est bon signe. Je vais penser à vos pieds et à vos mains pour faire diversion. Vous n'y pensez guère, je crois.
17 février 1843.
Que j'aie été injuste envers vous, cela est possible et je vous en demande pardon; mais vous ne vous mettez pas assez à ma place; et, parce que vous ne sentez pas comme moi, vous voudriez, ce qui est impossible, que je ne sentisse qu'à votre manière. Peut-être devriez-vous me savoir plus de gré que vous ne faites de tous mes efforts pour vous ressembler. Je ne comprends rien à la mine que vous m'avez faite aujourd'hui. Au reste, à ne s'attacher qu'à la lettre, il y a longtemps que je vois que vous m'aimez mieux de loin que de près. Mais ne parlons plus de cela maintenant. Je veux seulement vous dire que je ne vous fais aucun reproche, que je ne suis pas mécontent de vous, et que, si je suis triste quelquefois, vous ne devez pas croire que je suis en colère. J'ai de vous une promesse, vous pensez bien que je ne l'oublierai pas. Je ne sais si je vous la rappellerai. Il n'y a rien que je déteste tant que les querelles, et assurément il en faudrait une pour vous redonner de la mémoire. Rien de ce qui vous fait de la peine ne me donnera de plaisir; ainsi, j'accepte le programme que vous m'annoncez. Nous avons eu, en effet, une heureuse inspiration l'autre jour. Quelle neige et quelle pluie! Quel chagrin si vous m'aviez remis à aujourd'hui! Vous craignez toujours les premiers mouvements; ne voyez-vous pas que ce sont les seuls qui vaillent quelque chose et qui réussissent toujours? Le diable est lent, je crois, de son naturel et se décide toujours pour le plus long chemin. Ce soir, je suis allé aux Italiens, où je me suis assez amusé, bien qu'on ait fait un succès de claqueurs à mon ennemie madame Viardot.
J'ai reçu des livres d'Espagne que j'attendais pour travailler à quelque chose; en sorte que je suis assez in high spirits pour le moment. Je souhaite que vous pensiez un peu à moi, et surtout que nous pensions ensemble. Adieu; je suis charmé que ces épingles vous plaisent. J'avais craint qu'elles ne vous eussent inspiré du mépris; mais, malgré le plaisir que j'aurais à vous les voir porter, ne mettez pas le châle bleu la première fois. Vous avez dit avec beaucoup de raison qu'il était trop voyant.
Paris, lundi soir, février 1843.
Si je ne craignais de vous gâter, je vous dirais tout le plaisir que m'ont causé votre lettre, la toute gracieuse promesse que vous me faites, et surtout cette impatience de voir revenir le temps sec. N'est-ce pas une grande folie de votre part de vouloir prendre des termes fixes pour nos promenades, comme si nous pouvions jamais être assurés d'un jour? N'avais-je pas bien raison de dire: le plus souvent que vous pourrez? Il faut toujours supposer, quand il y aura du beau temps pendant deux jours, qu'il pleuvra deux mois de suite après. Qu'importe, si, au bout de l'année, nous nous trouvons en avance de quelques jours de promenade? Votre lettre est, en effet, toute de premier mouvement; c'est pour cela que je l'aime tant. Je crains seulement que vous n'ayez de si bonnes dispositions que parce que nous ne pouvons en profiter. Cependant, vos bonnes promesses me rassurent un peu, et vous auriez trop de reproches à vous faire si vous ne les teniez pas. Vous m'avez fait venir toute sorte de pensées, l'autre soir aux Italiens, avec votre costume couleur d'arc-en-ciel. Mais vous n'avez pas besoin de coquetterie avec moi. Je ne vous aime pas mieux en arc-en-ciel qu'en noir...
En vérité, avez-vous été furieuse contre moi par réflexion? Alors, ce serait un premier mouvement qui aurait été mauvais pour moi l'autre jour, et cela me ferait peine et plaisir. Je saurai lequel des deux en vous voyant.
Je connais la superstition des couteaux et des instruments tranchants, mais point celle des piquants. J'aurais cru, au contraire, que cela signifiait attachement, et c'est cela peut-être qui m'a fait choisir les épingles. Vous rappelez-vous que vous n'avez pas voulu me laisser ramasser les vôtres chez madame de P...? J'ai cela encore sur le cœur avec bien d'autres griefs contre vous. Je vous les pardonne tous aujourd'hui, mais je les retrouverai aussi révoltants lorsque vous y en aurez ajouté d'autres. C'est un grand malheur que de ne pouvoir oublier. J'écris aujourd'hui comme un chat, je ne puis encore tailler ma plume, et je ne sais si vous pourrez lire mon griffonnage. Il est presque aussi intelligible que ce que vous écrivez en blanc. Je suppose que vous allez fort dans le monde ce carnaval. En rangeant ma table, je m'aperçois que je ne suis point allé à un bal chez le directeur de l'Opéra. Où est le bon temps où j'y prenais plaisir? Maintenant, tout cela m'ennuie horriblement. Ne vous semblé-je pas bien vieux?
Le temps a l'air de vouloir se remettre, mais je n'ose rien dire. J'ai juré de vous laisser toute liberté.—Théodore Hook est mort. Avez-vous lu Ernest Maltravers et Alice, de Bulwer? Il y a des tableaux charmants d'amour jeune et d'amour vieux. Je les ai tous les deux à votre service.
Jeudi soir, février 1843.
Je cherche vainement dans vos dernières paroles quelque chose qui me soulage en m'irritant contre vous, car la colère serait un soulagement pour moi. J'ai brûlé votre lettre, mais je me la rappelle trop bien. Elle était très-sensée, peut-être trop, mais très-tendre aussi. Depuis huit jours, j'ai tant d'envie de vous revoir, que j'en viens à regretter nos querelles mêmes. Je vous écris, savez-vous pourquoi? C'est que vous ne me répondrez pas et que cela me mettra en colère, et tout vaut mieux que le découragement où vous m'avez laissé. Rien n'est plus absurde, nous avons eu parfaitement raison de nous dire adieu. Nous comprenons si bien l'un et l'antre les choses raisonnables, que nous devrions agir le plus raisonnablement du monde. Mais il n'y a de bonheur, à ce qu'il paraît, que dans les folies et surtout dans les rêves. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que je n'ai jamais cru, sinon cette fois, à la persistance de nos querelles. Mais il y a dix jours que nous nous sommes séparés d'une manière presque solennelle qui m'a effrayé. Étions-nous plus irrités que d'ordinaire, plus clairvoyants? nous aimions-nous moins? Il y avait certainement entre nous, ce jour-là, quelque chose que je ne me rappelle pas distinctement, mais qui n'avait jamais existé. Les petits accidents viennent après les grands. En même temps que je vous disais adieu, mon cousin changeait son jour aux Italiens, et je pense que je ne vous y rencontrerai plus le jeudi. Je me rappelle aussi que vous avez dit prophétiquement que je vous oublierais pour l'Académie, et c'est devant l'Académie que nous nous sommes quittés. Tout cela est fort bête, mais cela m'obsède, et je meurs d'envie de vous revoir, ne fût-ce que pour nous quereller.
Vous enverrai-je cette lettre? je ne sais trop. Hier, je suis allé, sur la foi d'un vers grec, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Vous rappelez-vous quand nous nous devinions toujours?
Adieu; répondez-moi. Je me sens un peu soulagé pour vous avoir écrit.
Jeudi matin, février 1843.
Hélas! oui, c'est ce pauvre Sharpe[1] qui vient d'être frappé d'une façon si soudaine et si cruelle. Je suis sans nouvelles de lui depuis le 5; si vous connaissez quelqu'un à Londres qui puisse m'en donner de certaines, veuillez lui écrire, et savoir quel est son état, quelles espérances restent encore. Peut-être connaîtriez-vous sa sœur. Je suppose que c'est chez elle que vous l'avez vu. Malgré vous-même, les seconds mouvements ne paraissent que trop dans votre lettre. Il y a cependant de ces petites phrases tout aimables qui vous échappent à votre insu. Vous vous donnez beaucoup de peine pour être mauvaise, et vous n'y parvenez qu'à force d'application.
Avez-vous réfléchi quelquefois comme c'est une invention admirable, de mettre dans un beau palais des tableaux et des statues, et d'y laisser promener le monde? Malheureusement, on va fermer ce beau lieu pour y mettre de vilaines croûtes modernes. Cela ne vous fait-il pas de la peine? Croyez-moi, allons faire nos adieux à toutes ces vieilles statues. Le samedi est un jour admirable, car il n'y vient que des Anglais peu gênants pour ceux qui aiment à regarder de près les tableaux. Que vous semble de samedi, c'est-à-dire après-demain? Ce sera le dernier samedi. Ce mot de dernier me fait de la peine. Ainsi donc, à samedi. Vous me parlez de vos remords pour mon œil. De quelle espèce sont vos remords? l'accident pouvait s'éviter de deux manières: je pouvais ne pas compromettre mon œil, vous pouviez le ménager. C'est, je pense, pour le dernier fait que vous avez des remords, du moins que vous devez en avoir eu avant les seconds mouvements. Si vous ne m'écrivez pas, je vous attendrai samedi à deux heures devant la Joconde, à moins d'un temps horrible; mais il fera beau, je l'espère, et, s'il survenait quelque contre-temps, ce serait assurément votre faute.
Pourquoi vous servez-vous de papier si petit, et pourquoi m'écrivez-vous trois lignes seulement, dont deux pour me quereller? Qu'importe que l'on vive plus vite, pourvu que l'on soit plus heureux! N'est-ce pas quelque chose que d'avoir des souvenirs au lieu d'années de chrysalide dont on ne se souvient plus?
[1] M. Sutton Sharpe, avocat anglais très-distingué.
Paris, février 1843.
Il m'est arrivé bien souvent dans ma vie de faire en rechignant des choses que j'ai été bien aise ensuite d'avoir faites. Je désire qu'il vous arrive comme à moi. Supposez que le contraire fût arrivé: n'auriez-vous pas éprouvé un peu d'impatience d'être venue seule? N'auriez-vous pas eu, laissez-moi le croire, quelque inquiétude de m'avoir fait de la peine? Considérez maintenant avec quelque orgueil cette étrange influence que deux fois vous avez eue sur ma pensée et sur mes résolutions. Tout le mal, c'est d'avoir eu un peu d'incertitude. N'admirez-vous pas comme moi cette étrange coïncidence (je ne dirai pas sympathie, pour ne pas vous déplaire) de nos pensées? Vous rappelez-vous qu'autrefois nous fîmes une expérience presque aussi miraculeuse? et dernièrement encore, près d'un poêle dans le musée espagnol, vous avez lu dans ma pensée aussi vite que je pensais. Il y a longtemps que je soupçonne quelque chose de diabolique en vous. Je me rassure un peu en pensant que j'ai vu vos deux pieds et que vous n'avez pas le cloven foot. Pourtant, il se pourrait que, sous ces bottines, vous m'eussiez caché une petite griffe. Tâchez donc de me rassurer.
Adieu. Voici le livre dont je vous ai parlé.
Paris, 9 février 1843.
J'étais inquiet de ne pas recevoir un mot de vous, non que je craignisse un second mouvement, mais je vous croyais souffrante et je me reprochais cette longue promenade et notre retour par le vent et la pluie. Heureusement, c'est la poste qui a fait son dimanche et m'a fait attendre votre lettre. Bien que je souffrisse beaucoup de ce retard, je ne vous ai pas accusée un seul moment. Je suis bien aise de vous le dire, pour que vous sachiez que je me corrige de mes défauts en même temps que vous des vôtres. Au revoir donc et à bientôt. Je n'ai plus mal à l'œil. Le vôtre, je pense, est toujours aussi brillant. Comme on se fait des monstres de tout! N'aurions-nous pas eu tort de ne pas nous être revus?
Je suis bien triste et tourmenté. Un de mes amis intimes, que je voulais aller voir à Londres, vient d'être atteint de paralysie. Je ne sais encore s'il vivra, ou, ce qui serait pire que la mort, s'il ne demeurera pas longtemps dans cet affreux état d'insensibilité où cette maladie réduit les esprits les plus distingués. Je me demande si je ne devrais pas aller le voir tout de suite.
Écrivez-moi, je vous prie, et dites-moi quelque chose de tendre qui me fasse oublier ces tristes pensées.
Paris, 27 février 1843.
Nos lettres se sont croisées et j'ai été tranquillisé plus tôt que je n'espérais. Je vous en remercie. Votre lettre m'a fait grand plaisir par ce qu'elle me dit, quoique en style fort énigmatique. Ce verbe que vous redoutez si fort a toujours un son bien doux, même quand il est accompagné de tous ces adverbes dont vous savez si bien l'entortiller. Moquez-vous de ma tristesse et de la mine que je faisais sur les ruines de Carthage. Marius, assis comme nous, rêvait peut-être qu'il rentrerait dans Rome, et moi, je ne voyais guère d'espérance dans mon avenir. Vous m'effrayez, chère amie, en me disant que vous n'osez plus écrire et que vous aurez plus de courage pour parler. Lorsque nous sommes ensemble, c'est le contraire que vous dites. N'en résultera-t-il pas que vous ne me parlerez plus et que vous ne m'écrirez plus? Vous étiez fâchée contre moi, m'avez-vous dit. Était-ce bien juste de votre part et l'avais-je mérité? N'avais-je pas votre promesse et aussi un peu votre exemple? En êtes-vous restée aveugle? Avez-vous conservé un souvenir désagréable? Êtes-vous encore fâchée? Voilà ce que je voudrais savoir et ce que vous ne me direz sans doute pas.
Je commence à vous savoir par cœur, et je crois que c'est ce qui m'attriste souvent. Il y a en vous un mélange d'oppositions et de contradictions si étrange, qu'il y a pour faire enrager un saint. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
J'ai appris hier une bien triste nouvelle. Le pauvre Sharpe est mort mercredi dernier. J'ai reçu la nouvelle de sa mort au moment où je le croyais non-seulement hors de tout danger, mais sur le point de reprendre ses occupations ordinaires. Je ne m'accoutume pas à l'idée de ne plus le voir. Ilme semble que, si j'allais à Londres, je le retrouverais. . . . . .
Jeudi soir, 1er mars 1843.
J'avais bien peur de ne pouvoir vous voir samedi, et je me promettais de vous bien gronder pour n'avoir pas voulu l'autre jour. Mais je suis parvenu à me débarrasser de tous les empêchements. À samedi donc. Il y a bien longtemps que nous n'avons eu de querelle. Ne trouvez-vous pas que cela est bien doux et bien préférable à nos colères d'autrefois, qui n'avaient de bon que les raccommodements? Je vous trouve toujours cependant un défaut: c'est de vous rendre si rare. À peine nous voyons-nous une fois en quinze jours. Chaque fois, il semble qu'il y ait une glace nouvelle à rompre. Pourquoi ne vous retrouvé-je pas telle que je vous ai quittée? Si nous nous voyions plus souvent, cela n'arriverait pas. Je suis pour vous comme un vieil opéra que vous avez besoin d'oublier pour le revoir avec quelque plaisir. Moi, au contraire, il me semble que je vous aimerais davantage vous voyant tous les jours. Montrez-moi que j'ai tort, et dites-moi un jour bien proche pour nous revoir. C'est le 14 mars que mon sort se décide à l'Académie. Le raisonnement me dit d'espérer, mais je ne sais quel sentiment de seconde vue me dit tout le contraire.—En attendant, je fais des visites fort consciencieusement. Je trouve des gens fort polis, fort accoutumés à leurs rôles et les prenant très au sérieux; je fais de mon mieux pour prendre le mien aussi gravement, mais cela m'est difficile. Ne trouvez-vous pas drôle qu'on dise à un homme: «Monsieur, je me crois un des quarante hommes de France les plus spirituels, je vous vaux bien,» et autres facéties? Il faut traduire cela en termes honnêtes et variés, suivant les personnes. Voilà le métier que je fais et qui m'ennuierait fort s'il se prolongeait. Le là correspond aux ides de mars, jour de la mort de mon héros, feu César. Cela est ominous, n'est-ce pas?
Paris, vendredi matin, 13 mars 1843.
Voici votre cravate. Elle s'est retrouvée samedi dernier dans l'antichambre de Son Altesse royale monseigneur le duc de Nemours. Personne ne m'a demandé d'explications de sa présence dans ma poche. Je vous l'aurais envoyée plus tôt si je n'avais voulu ajouter le désir de retrouver votre propriété à celui de me donner de vos nouvelles. Je constate que, bien que le premier soit très-vif, il n'a pu triompher de l'indifférence que vous avez sur le second point. Pourquoi avez-vous si grand'peur du froid? Il me semble que nous avons fait une fois un essai de neige qui n'a pas trop mal réussi. Voici le dégel qui va rendre les rues impraticables pour je ne sais combien de temps. Répondez-moi vite. Je vois avec peine que vous aimez à tourmenter. . . . . .
. . . . . . .
Paris, 11 mars 1843.
C'est une grosse faute et presque un crime que de ne pas profiter du temps admirable qu'il fait. Que diriez-vous d'une grande promenade pour demain jeudi? Vous deviez m'avertir la première, mais vous vous en gardez bien. Il faut absolument que nous allions saluer les premières feuilles. Elles poussent à vue d'œil. Je pense aussi à l'influence que le soleil exerce sur votre humeur, à ce que vous m'avez dit. Je voudrais en faire l'épreuve. Moi, je vous aime dans tous les temps; mais je crois que le bonheur de vous voir est plus bonheur avec du soleil. Adieu.
Paris, samedi soir, mars 1843.
Pas la moindre trace de repentir dans votre lettre. Je regrette la pipe ambrée que vous aviez choisie. Il y avait quelque chose de particulièrement agréable à porter souvent à ma bouche un don de vous. Mais soit fait ainsi que vous voulez; c'est ce que je dis fort souvent, et toujours sans que ma résignation me profite.
Je suis complètement abruti par le métier que je fais. La cathédrale me pèse de tout son poids sur les épaules, sans compter l'espèce de responsabilité que j'ai acceptée dans un moment de zèle dont je me repens fort aujourd'hui. J'envie beaucoup le sort des femmes, qui n'ont rien à faire qu'à tâcher de se faire belles, et préparer l'effet qu'elles veulent produire sur les autres. Les autres, cela me semble un vilain mot, mais je crois qu'il vous préoccupe plus que moi. Je suis très en colère contre vous, sans bien en savoir la cause; mais il doit y en avoir une très-réelle, car je ne saurais avoir tort. Il me semble que tous les jours vous êtes plus égoïste. Dans nous, vous ne cherchez jamais que vous. Plus je retourne cette idée, plus elle me paraît triste.
Si vous n'avez pas écrit pour ce livre à Londres, n'écrivez pas; il est absurde de charger une femme de semblable commission. Bien que je tienne beaucoup à un livre rare, je ne voudrais pas que vous pussiez causer l'ombre d'un étonnement en le demandant. L'éditeur du livre est un quaker très-vertueux, dit-on, lequel aurait eu un peu tard des preuves que les catholiques espagnols du XVe siècle étaient des gens sans moralité, malgré l'Inquisition, et peut-être à cause d'elle. L'exemplaire original et unique a coûté quinze cents livres sterling. Il a cent et quelques pages. J'ai eu tort de vous en parler et plus tort de réfléchir si tard à l'énormité de la chose. Adieu. . . . . .
. . . . . . .
Voici la lettre que j'allais vous faire porter quand j'ai reçu la vôtre. J'ai été tellement occupé par mes rapports et mes enquêtes, que je n'ai pu vous écrire plus tôt. Je vous proposais une promenade mardi, à condition que nous aurions une heure de plus. Dites-moi si vous êtes libre mardi. Votre distraction est fort jolie, mais y suis-je pour quelque chose? That is the question. Quels pardons avez-vous à me demander? vous ne sentez pas ce que je sens. Nous sommes si différents, qu'à peine pouvons-nous nous comprendre. Tout cela n'empêche pas que j'aurai grand plaisir à vous voir et que je vous remercie de votre dernière lettre, qui est très-aimable. Vous ne m'avez pas dit où vous alliez à la campagne, ni quand vous partiez. J'irai à Rouen dans quelques jours.
Adieu encore; j'espère vous voir mardi, j'espère que vous serez en belle humeur et moi moins triste que je ne suis aujourd'hui.
Jeudi soir, 15 mars 1843.
Cela m'a fait un sensible plaisir[1], d'autant plus que je m'attendais à une défaite. On m'apportait les bulletins à mesure qu'ils s'élaboraient. Il me semblait impossible de réussir; ma mère, qui souffrait depuis quelques jours d'un rhumatisme aigu, a été guérie du coup.—J'en ai d'autant plus envie de vous voir. Essayez si je vous en aime mieux ou moins, et cela le plus tôt possible. Je suis harassé des courses que j'ai faites, car il faut maintenant remercier, et remercier amis et ennemis, pour montrer qu'on a de la grandeur d'âme. J'ai le bonheur d'avoir été black-boulé par des gens que je déteste, car c'est un bonheur que de n'avoir pas le fardeau de la reconnaissance à l'égard des personnes qu'on estime peu. Écrivez-moi, je vous prie, quand vous voulez que nous nous voyions.
J'ai bien envie que nous fassions quelque longue promenade.
Vous êtes sorcière, en effet, d'avoir si bien deviné l'événement. Mon Homère m'avait trompé, ou bien c'est à M. Vatout que s'adressait sa prédiction menaçante.
Adieu, dearest friend! Entre mes épreuves à corriger, mon rapport à faire, et un peu aussi le tracas que j'ai eu depuis trois jours, je n'ai guère trouvé le temps de dormir. Je vais essayer.—J'aurais d'assez drôles d'histoires à vous conter des hommes et des choses.
[1] Sa nomination comme membre de l'Académie française.
17 mars 1843.
Je vous remercie bien de vos compliments, mais je veux mieux encore. Je veux vous voir et faire une longue promenade. Je trouve cependant que vous avez pris la chose trop au tragique. Pourquoi pleurez-vous? les quarante fauteuils ne valaient pas une petite larme. Je suis excédé, éreinté, démoralisé et complètement out of my wits. Puis Arsène Guillot fait un fiasco éclatant et soulève contre moi l'indignation de tous les gens soi-disant vertueux, et particulièrement des femmes à la mode qui dansent la polka et suivent les sermons du P. Ravignan; tant il y a que l'on dit que je fais comme les singes, qui grimpent au haut des arbres et qui, arrivés sur la plus haute branche, font des grimaces au monde. Je crois avoir perdu des voix par cette scandaleuse histoire; d'un autre côté, j'en gagne. Il se trouve des gens qui m'ont black-boulé sept fois et qui me disent qu'ils ont été mes plus chauds partisans. Ne trouvez-vous pas que cela vaut bien la peine de faire ainsi le péché de mensonge, surtout pour le gré que j'en sais aux gens? Tout ce monde où j'ai vécu presque uniquement depuis quinze jours me fait désirer avidement de vous voir. Au moins, nous sommes sûrs l'un de l'autre, et, quand vous me faites des mensonges, je puis vous les reprocher et vous savez vous les faire pardonner. Aimez-moi, quelque vénérable que je sois devenu depuis bientôt trois jours.
Lundi soir, 21 mars 1843.
Je suis très-triste et j'ai des remords de ma fureur d'aujourd'hui. La seule excuse que j'y trouve, c'est que la transition entre notre halte délicieuse dans cette espèce d'oasis si étrange et notre promenade a été trop brusquée, c'est tomber du ciel en enfer. Si je vous ai affligée, j'en suis aussi repentant que possible, mais j'espère que je ne vous ai pas fait autant de peine que j'en ressentais. Vous m'avez souvent reproché d'être indifférent à tous; je suppose que vous vouliez dire seulement que j'étais peu démonstratif. Lorsque je sors de ma nature, c'est que je souffre beaucoup. Convenez aussi qu'il est bien triste, après tant de temps passé ensemble, après être devenus l'un pour l'autre ce que nous sommes, de vous voir toujours défiante pour moi. Le temps a été aujourd'hui comme notre humeur. Ce soir, le voilà rétabli, je pense. Les étoiles sont plus brillantes que jamais. Organisons quelque course moins orageuse. Adieu, plus de querelles; je tâcherai d'être plus raisonnable, tâchez d'être plus à vos premiers mouvements.
Mars 1843.
Moi, j'étais fatigué comme si j'avais fait quatre ou cinq lieues à pied, mais d'une fatigue si agréable, que je voudrais la sentir encore; tout nous a si bien réussi, que, bien que je sois accoutumé à voir réussir un plan bien combiné, je partage votre étonnement. Être si libre et si loin du monde, et cela par les bienfaits de la civilisation, n'est-ce pas amusant? Savez-vous pourquoi je n'ai pris qu'une fleur de ces jacinthes si jolies et si blanches, c'est que je voulais en garder pour une autre fois; qu'en dites-vous? D'ailleurs, en regardant sur ma carte, j'ai vu que nous avions fait une faute de géographie. Nous nous sommes trompés d'environ un quart de lieue; nous devions aller plus loin; mais ne regrettons rien, une autre fois nous ferons mieux. Pour une reconnaissance, tout n'a pas été mal. Vous avez été surtout excellente. Vous ne m'apprenez rien en me disant que vous m'avez rendu ce que je vous ai donné; mais vous me faites presque autant de plaisir en me le disant, car cela me prouve que vous ne pensiez pas les cruelles choses que vous m'avez dites dans un de nos jours néfastes. Je les oublie tout à fait aujourd'hui; oubliez aussi mes colères et mes injures. Vous me demandez si je crois à l'âme. Pas trop. Cependant, en réfléchissant à certaines choses, je trouve un argument en faveur de cette hypothèse, le voici: Comment deux substances inanimées pourraient-elles donner et recevoir une sensation par une réunion qui serait insipide sans l'idée qu'on y attache? Voilà une phrase bien pédantesque pour dire que, lorsque deux gens qui s'aiment s'embrassent, ils sentent autre chose que lorsqu'on baise le satin le plus doux. Mais l'argument a sa valeur. Nous parlerons métaphysique, si vous voulez, la première fois. C'est un sujet que j'aime beaucoup, car on ne peut jamais l'épuiser. Vous m'écrirez, n'est-ce pas, avant lundi, en me disant où nous nous trouverons? Il faut être là-bas à une heure, non à une demi-heure. Vous vous en souviendrez; par conséquent, il faut nous mettre en marche à une demi-heure. Tout cela n'est-il pas clair?
Il est quatre heures et demie, et il faut que je me lève avant dix heures.
Lundi soir. Mars 1843.
Je commence, je crois, à comprendre votre énigme. En réfléchissant à ce que vous m'avez dit aujourd'hui, j'arrive où m'avait déjà conduit une espèce de divination instinctive; assurément, mon plus grand ennemi ou, si vous voulez, mon rival dans votre cœur, c'est votre orgueil; tout ce qui le froisse vous révolte. Vous suivez votre idée, peut-être à votre insu, dans les plus petits détails. N'est-ce pas votre orgueil qui est satisfait lorsque je baise votre main? Vous êtes heureuse alors, m'avez-vous dit, et vous vous abandonnez à votre sensation parce que votre orgueil se plaît à une démonstration d'humilité. Vous voulez que je sois statue parce qu'alors vous êtes ma vie. Mais vous ne voulez pas être statue à votre tour; surtout, vous ne voulez pas cette égalité de bonheur donné et reçu, parce que tout ce qui est égalité vous déplaît.
Que vous dirai-je à cela? que, si cet orgueil voulait se contenter de ma soumission et de mon humilité, il devrait être content; je lui céderai toujours, pourvu qu'il laisse votre cœur suivre ses bons mouvements. Pour moi, je ne mettrai jamais sur une même ligne mon bonheur et mon orgueil, et, si vous vouliez me suggérer des formules d'humilité nouvelles, je les adopterais sans hésiter. Mais pourquoi de l'orgueil, c'est-à-dire de l'égoïsme, entre nous? êtes-vous donc insensible au plaisir de s'oublier l'un pour l'autre? Ce sentiment d'amitié si étrange que nous éprouvons tous les deux quelquefois, qui, ce matin par exemple, nous a amenés là où nous n'avions aucune raison d'aller, n'est-ce pas une puissance plus douce et plus vive que toutes celles que vous pourrait donner votre démon d'orgueil? Vous avez été si aimable ce matin, que je ne veux ni ne peux vous quereller. Je suis cependant d'une humeur affreuse. Je vous disais que j'allais m'ennuyer à un dîner. Figurez-vous que je me suis trompé de jour, que j'ai mortellement contrarié des gens qui ne m'attendaient pas et qui me l'ont bien rendu. J'ai passé ma soirée à regretter de n'être pas seul chez moi avec mes souvenirs. Je m'attends à une mauvaise lettre de vous. J'ai voulu vous écrire le premier, car je serai furieux sans doute après-demain. Vous me rendrez doux comme un mouton si vous voulez. Voilà l'hiver revenu tout à fait. Comment avez-vous supporté le froid de l'autre jour? celui-ci ne vous effraye-t-il pas? Je ne sais si vous ferez bien de sortir demain; je crains la responsabilité du conseil, et j'aime mieux que vous décidiez. Voilà encore de l'humilité.
Vendredi, 29 mars 1843.
Je sens, par une de ces intuitions of the mind's eye, que le temps sera beau encore pour quelques jours, mais qu'il se gâtera pour longtemps. D'un autre côté, notre promenade de l'autre jour, ayant été à peu près manquée, doit être considérée comme non avenue. Les ours seuls en ont profité. Je leur envie l'intérêt que vous leur portez, et j'ai le dessein de me faire faire un costume qui me donne une partie de leurs charmes. Jusqu'à présent, nous avons toujours marché de l'est au sud. Il me semble que nous pourrions essayer de la marche contraire. Nous irions chercher d'abord notre barrière et le ruisseau peu limpide qui coule auprès. Nous finirions par où nous commençons ordinairement. Le diable, c'est que j'ai à travailler dans ce moment plus que d'ordinaire. Cependant, si vous pouviez samedi, à trois heures, nous ferions notre voyage de découverte jusqu'à cinq heures et demie; sinon, il faudrait ajourner à lundi, ce qui serait bien long. Si vous saviez comme vous étiez gentille l'autre jour, vous ne voudriez jamais être taquine comme vous l'êtes quelquefois. J'aurais voulu vous voir encore plus franche; mais il me semblait pourtant que vos pensées étaient toutes révélées pour moi, bien que vos paroles fussent plus entortillées que l'Apocalypse. Je voudrais que vous eussiez la centième partie du plaisir que j'ai à vous voir penser. Pour moi, c'était un bonheur si grand, que je crains trop qu'il ne soit pas partagé. Il y a deux personnes en vous. Vous n'êtes plus comme Cerbère, vous voyez. De trois, vous voilà réduite à deux. L'une, qui est la meilleure, est tout cœur et toute âme. L'autre est une jolie statue bien polie par le monde, bien drapée de soie et de cachemire; c'est un charmant automate dont les ressorts sont le plus habilement arrangés qui se puissent voir. Lorsqu'on croit parler à la première, on trouve la statue. Pourquoi faut-il que cette statue soit si gentille! Autrement, j'espérerais que, comme les vieux chênes d'Espagne, vous perdriez votre écorce en vieillissant.
Il vaut mieux que vous restiez telle que vous êtes, mais que la première personne commande davantage à son automate. Voilà bien des métaphores où je m'embrouille.
Je pense en ce moment à une main blanche. Il me semblait que j'avais envie de vous gronder. Mais je ne me rappelle plus bien le pourquoi. C'est moi maintenant qui ai des courbatures. J'étais accablé en rentrant l'autre jour, et je n'ai pas, comme vous, la ressource de dormir douze heures. Il est vrai que je tiens moins que vous à ne pas m'user. J'espère avoir une lettre de vous demain, mais vous m'en écrirez une autre pour me dire si samedi ou lundi... Troisième combinaison: samedi jusqu'à quatre heures, et lundi de deux heures à cinq, Ce serait une perfection, ce me semble. Il faudrait que j'eusse votre réponse samedi avant midi.
Vendredi soir, 8 avril.
J'ai depuis deux jours une horrible migraine, et vous m'écrivez toute sorte de méchancetés. Le pire, c'est que vous n'avez pas de remords, et j'avais quelque espoir que vous en auriez. Je suis si accablé, que je n'ai pas même la force de vous dire des injures. Quel est donc ce miracle dont vous parlez? Le miracle serait de vous rendre moins entêtée, et je ne le ferai jamais. Cela est trop au-dessus de mon pouvoir. Il faudra donc attendre à lundi pour savoir le mot de l'énigme, puisque vous ne pouvez demain. Savez-vous qu'il y aura huit jours que nous ne nous sommes vus? Il y avait longtemps que nous n'avions tant attendu. En revanche, il faudra faire une longue promenade et tâcher quelle se passe sans disputes. À deux heures, si vous voulez bien. Je compte précisément sur le soleil. Votre pensée de Wilhelm Meister est assez jolie, mais ce n'est qu'un sophisme, après tout.
On pourrait dire avec presque autant d'exactitude que le souvenir d'un plaisir est une espèce de peine. Cela est vrai surtout des demi-plaisirs, je veux dire de ceux qui ne sont pas partagés. Vous aurez ces vers si vous y tenez. Vous aurez même votre portrait en Turquesse, que j'ai un peu arrangé. Je vous ai mis un narghilé à la main pour plus de couleur locale. Quand je dis vous aurez tout cela, je veux dire en payant. Si vous ne vous exécutez pas de bonne grâce, songez que j'ai une terrible vengeance. On m'a demandé aujourd'hui un dessin pour un album qui se vendra au profit du tremblement de terre. Je donnerai votre portrait. Qu'en dites-vous? Je me demande quelquefois comment je ferai dans cinq ou six semaines d'ici, quand nous ne nous verrons plus. Je ne m'accoutume pas à cette idée-là.
Paris, 15 avril 1843.
J'avais si grand mal aux yeux ce matin et hier, que je n'ai pu vous écrire. Je suis un peu mieux ce soir et je ne pleure plus guère. Votre lettre est assez aimable, contre votre ordinaire. Il y a même une ou deux phrases tendres, sans mais et sans secondes pensées. Nous avons des idées très-différentes sur une foule de choses. Vous ne comprenez pas ma générosité de me sacrifier pour vous. Vous devriez me remercier pour m'encourager. Mais vous croyez que tout vous est dû. Pourquoi faut-il que nous nous rencontrions si rarement dans nos manières de sentir! Vous avez fort bien fait de ne pas parler de Catulle. Ce n'est pas un auteur à lire pendant la semaine sainte, et il y a dans ses œuvres plus d'un passage impossible à traduire en français. On voit très-bien ce qu'était l'amour à Rome vers l'an 50 avant J.-C, C'était un peu mieux cependant que l'amour à Athènes au temps de Périclès. Déjà les femmes étaient quelque chose. Elles faisaient faire des bêtises aux hommes. Leur pouvoir est venu, non du christianisme, comme on le dit ordinairement, mais je pense par l'influence qu'exercèrent les barbares du Nord sur la société romaine. Les Germains avaient de l'exaltation. Ils aimaient l'âme. Les Romains n'aimaient guère que le corps. Il est vrai que longtemps les femmes n'eurent pas d'âme. Elles n'en ont point encore en Orient, et c'est grand dommage. Vous savez comment deux âmes se parlent. Mais la vôtre n'écoute guère la mienne.
Je suis content que vous fassiez cas des vers de Musset, et vous avez raison de le comparer à Catulle. Catulle écrivait mieux sa langue, je crois, et Musset a le tort de ne pas croire à l'âme plus que Catulle, que son temps excusait. Il est une heure tout à fait indue. Je vous dis adieu pour bassiner mon œil. Je pleure en vous écrivant. À lundi. Priez pour que nous ayons un beau soleil. Je vous apporterai un livre. Mettez vos bottes de sept lieues.
Paris, 4 mai 1843.
Je ne dors plus du tout et je suis d'une humeur de chien. J'aurais bien des choses à dire à votre lettre. Je ne commencerai pas, à cause de cette humeur, ou plutôt je tâcherai de la modérer un peu. Votre distinction entre les deux moi est fort jolie. Elle prouve votre profond égoïsme. Vous n'aimez que vous, et c'est pour cela que vous aimez un peu le moi qui ressemble au vôtre. Plusieurs fois avant-hier, j'en ai été scandalisé. J'y pensais assez tristement pendant que vous n'étiez occupée qu'à contempler les arbres à votre manière. Vous avez bien raison d'aimer les chemins de fer. Dans quelques jours, on ira en trois heures à Rouen et à Orléans. Pourquoi n'irions-nous pas voir Saint-Ouen? Mais qu'y avait-il de plus beau que nos bois l'autre jour? Il me semble seulement que vous auriez dû rester plus longtemps. Lorsqu'on a assez d'imagination pour expliquer naturellement cette branche de lierre, on doit ne pas être en peine de trouver l'emploi de quelques heures. Vous avez donc porté ce lierre dans vos cheveux le soir? Je ne me doutais guère que celui-ci devait servir à favoriser vos coquetteries.
Je suis tellement mécontent de vous, que vous trouverez peut-être que j'ai trop du moi que vous aimez. En vérité, je crois que je mettrai à exécution la menace que je vous ai faite un jour.
Comment avez-vous trouvé le feu d'artifice? J'étais chez une Excellence qui a un beau jardin d'où nous l'avons bien vu. Le bouquet m'a paru bien. Ce doit être fort supérieur à un volcan, car l'art est toujours plus beau que la nature. Adieu, Tâchez de penser un peu à moi.
Nos promenades sont maintenant une partie de ma vie, et je ne comprends guère comment je vivais auparavant. Il me semble que vous en prenez votre parti très-philosophiquement. Mais comment serons-nous quand nous nous reverrons? Il y a six mois, nous reprenions notre conversation interrompue presque au même mot où nous en étions restés. En sera-t-il de même? Je ne sais quelle crainte j'ai que je vous retrouverai toute autre. Chaque fois que nous nous voyons, vous êtes armée d'une enveloppe de glace qui ne fond qu'au bout d'un quart d'heure. Vous aurez amassé à mon retour un véritable iceberg. Allons, il vaut mieux ne pas penser au mal avant qu'il arrive. Rêvons toujours. Croiriez-vous qu'un Romain pût dire de jolies choses et qu'il pût être tendre? Je veux vous montrer lundi des vers latins, que vous traduirez vous-même et qui viennent comme de cire à propos de nos disputes ordinaires. Vous verrez que l'antiquité vaut mieux que votre Wilhelm Meister.
Mercredi, juin 1843.
Votre lettre était si bonne et si aimable, qu'elle a enlevé jusqu'au dernier nuage qui pouvait rester après l'orage de l'autre jour. Mais il me semble que nous ne serons sûrs tous les deux d'avoir oublié que lorsque nous aurons mis d'autres souvenirs entre notre querelle.
Pourquoi ne nous verrions-nous pas vendredi? Si cela ne vous dérange pas, vous me ferez le plus grand plaisir. J'espère qu'il fera beau temps. Vous me promettez, d'ailleurs, de me dire quelque chose qui doit être trop important pour pouvoir être différé. J'apporterai un livre espagnol et nous lirons, si vous voulez. Vous ne m'avez pas dit si vous me payeriez mes leçons. Le temps qui ne se passe pas à dire ce que vous appelez des folies me semble si mal employé, qu'il faut du moins que j'y gagne quelque chose. En fait d'impossibilités, ne pourrais-je aller vous voir et vous donner des leçons d'espagnol à domicile? Je m'appellerais don Furlano, etc., et vous serais adressé par madame de P***, comme une victime de la tyrannie d'Espartero. Je commence à trouver un peu dure cette dépendance où nous sommes du soleil et de la pluie. Je voudrais bien aussi faire votre portrait. Vous promettez souvent d'inventer quelque chose. Vous prétendez gouverner, mais en vérité vous vous acquittez assez mal de votre charge. Je ne puis juger que très-imparfaitement de vos possibles et de vos impossibles. Si vous méditiez sur le joli problème de se voir le plus souvent possible, ne feriez-vous pas une bonne action? J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais il faudrait vous reparler de notre querelle et je voudrais en anéantir le souvenir. Je ne veux penser qu'au raccommodement qui s'en est suivi et que vous avez l'air de regretter. Ce serait cruel. Je suis bien assez fâché de devoir à un si mauvais motif tant de bonheur.
Adieu. Pensez à votre statue et animez-la sans la tourmenter d'abord.
Paris, 14 juin 1843.
Je suis bien heureux d'apprendre que vous allez mieux et bien fâché que vous ayez pleuré. Vous vous méprenez toujours sur le sens de mes paroles. Vous voyez de la colère ou de la méchanceté où il n'y a que de la tristesse. Je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit cette fois, mais je suis sûr que je n'ai voulu dire qu'une chose, c'est que vous m'avez fait beaucoup de peine. Tous ces querelles qui surviennent entre nous me prouvent que nous sommes très-différents, et, comme, malgré cette différence-là, il y a entre nous une affinité grande,—c'est le Wahlverwandschaft de Goethe,—il résulte nécessairement un combat qui me fait souffrir. Lorsque je dis que je souffre, ce ne sont pas des reproches que je vous adresse. Je vois en noir ce qu'un instant auparavant j'avais vu en couleur de rose. Vous savez très-bien effacer ce noir avec deux paroles, et, ce soir, en lisant votre lettre, je pense avec bonheur que le soleil n'est peut-être pas perdu. Mais votre système de gouvernement est toujours le même; vous me ferez toujours enrager après m'avoir rendu par moments très-heureux. Quelqu'un plus philosophe que moi prendrait le bonheur quand il vient et ne se fâcherait pas du mal. C'est le défaut de ma nature de me rappeler tout le mal passé quand je souffre; mais aussi je me rappelle tout le bonheur quand je suis heureux. J'ai beaucoup travaillé à vous oublier depuis tantôt trois semaines, mais je n'y ai pas trop bien réussi. L'odeur de vos lettres a été une difficulté très-grande à la tâche que je m'étais imposée. Vous souvenez-vous que j'ai senti cette odeur indienne un jour que nous nous sommes fait beaucoup de peine et aussi, je crois, beaucoup de plaisir?
Je suis accablé d'affaires.
Écrivez-moi vite. J'ai travaillé beaucoup et à de drôles de choses. Je vous en parlerai quand nous nous verrons.
Paris, samedi soir, 23 juin 1843.
Je commençais à être fort en peine de vous. Je craignais que l'humidité ne vous eût fait mal et je me reprochais de vous avoir raconté si longuement cette sotte histoire. Puisque vous ne vous êtes pas enrhumée et que vous n'avez pas eu de colères rentrées, je puis à mon tour me rappeler avec bonheur tous les moments que nous avons passés ensemble. Je trouve comme vous que, ce jour-là, nous avons été plus parfaitement—si parfaitement peut comporter du plus ou du moins—heureux que jamais. À quoi cela tient-il? Nous n'avons rien dit ni fait d'extraordinaire, si ce n'est de ne pas nous quereller. Et remarquez, s'il vous plaît, que c'est de vous que les disputes viennent toujours. Je vous ai cédé sur une infinité de points, et je n'ai pas été de mauvaise humeur pour cela. Je voudrais bien que le bon souvenir que vous gardez de cette journée vous profitât pour l'avenir. Pourquoi ne me dites-vous pas tout de suite ce que vous expliquez dans votre lettre tellement quellement, mais avec une certaine franchise qui me plaît? . . . . .
. . . . . .
Je suis flatté que mon conte vous ait amusée; mon amour-propre d'auteur s'est offensé pourtant que vous vous soyez contentée de l'analyse, assez décousue que je vous en ai faite. J'espérais que vous auriez demandé à le lire ou à l'entendre. Mais, puisque vous ne voulez pas, il faut en prendre son parti. Néanmoins, s'il faisait beau mardi, qui nous empêcherait de nous asseoir tous les deux sur nos sièges rustiques, et moi de vous faire la lecture? Il y en a pour une heure. Le mieux, c'est de nous promener tout bonnement. Le voulez-vous? Le programme sera de ne pas se disputer. Écrivez-moi vos intentions suprêmes. J'ai reçu madame de M*** et ses filles, florissantes toutes les trois. Rien de fixé pour mon départ. Il est fort prochain suivant toute apparence, mais pourtant ce n'est pas à un adieu définitif qu'il faut vous attendre.
Paris, 9 juillet 1843.
Vous avez raison d'oublier les querelles si vous pouvez en venir à bout. Elles se grossissent, comme vous le dites fort bien, lorsqu'on les examine de près. Le mieux est de rêver toujours le plus longtemps possible, et, comme nous pouvons faire toujours le même rêve, cela ressemble fort à une réalité. Je vais assez bien depuis hier. J'ai dormi, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Il me semble même que je suis en meilleure humeur depuis que je me suis soulagé en exhalant mes vapeurs l'autre jour. C'est dommage que nous ne nous voyions pas le lendemain d'une querelle. Je suis sûr que nous serions parfaitement aimables l'un pour l'autre. Vous m'aviez promis de m'indiquer un jour; mais vous n'y avez pas pensé, ou, ce qui serait plus mal, vous avez cru indecorous de le faire. C'est cette préoccupation que vous avez sans cesse qui nous est bien souvent un sujet de brouillerie. À mesure que le moment de ne plus vous voir approche, je me sens plus mécontent de moi, et, pour le résultat, c'est comme si j'étais mécontent de vous. J'ai bien pu dire que vous vous contraignez beaucoup pour me plaire; je me prends sans cesse à me mettre en fureur contre cette contrainte même qui, dans ce qu'elle a de plus agréable, cache toujours un fond horriblement triste; mais rêver, c'est le plus sage. À quand? voilà toute la question.
Vous devriez bien me traduire un livre allemand qui me met au supplice. Rien n'est plus enrageant qu'un professeur allemand qui croit avoir une idée. Le titre est tentant: das Provocationsverfahren der Römer.
Paris, juillet 1843.
Voilà une lettre de vous bien aimable et presque tendre. Je voudrais être en disposition moins mélancolique pour en jouir entièrement. Tout ce que je puis faire de mieux, c'est de vous remercier de tout ce qu'il y a de bon dans cette lettre et de ne pas vous parler des idées plus ou moins tristes qui me viennent à son sujet. Le malheur, c'est que je ne rêve pas aussi complètement que vous. Mais laissons cela et parlons d'autre chose. Je partirai dans dix jours. J'ai été hier à la campagne faire une visite et j'en suis revenu très-las et très-triste. Las, parce que je me suis ennuyé, et triste, parce que je songeais que c'était un beau jour perdu. Ne vous faites-vous jamais un pareil reproche? J'espère que non. Quelquefois, je crois que vous sentez tout ce que je sens, puis viennent des drawbacks, et alors je doute de tout.
Adieu; si je continuais à vous écrire, je dirais des choses que vous ne comprendriez pas comme je les dirais. . . . . .
. . . . . . .
Jeudi soir, 28 juillet 1843.
J'ai lu votre lettre (je parle de la première) une vingtaine de fois au moins depuis que je l'ai reçue, et, chaque fois, elle m'a fait éprouver une impression nouvelle et en général fort triste, mais jamais elle ne m'a mis en colère. J'ai cherché très-inutilement à y répondre. J'ai pris très-inutilement un grand nombre de partis, et je reste ce soir aussi incertain et aussi triste que la première fois. Vous avez assez bien deviné mes pensées, peut-être pas entièrement. Vous ne pourriez jamais les deviner toutes. J'en change d'ailleurs si souvent, que ce qui est vrai dans un moment cesse de l'être quelque moments après. Vous avez tort de vous accuser. Vous n'avez, je pense, pas d'autre reproche à vous faire que ceux que je me fais. Nous nous laissons rêver sans vouloir être éveillés. Peut-être sommes-nous trop vieux pour rêver ainsi de propos délibéré. Pour ma part, j'approuve le mot de ce Turc; mais rien, ne serait-ce pas le pire? J'ai beaucoup varié sur ce point. Plusieurs fois, il m'est venu en tête de ne pas vous répondre et de ne plus vous voir. Cela est fort raisonnable et peut très-bien se soutenir. L'exécution est plus difficile. À ce propos, vous avez tort de m'accuser de ne plus vouloir nous voir. Je n'en ai pas dit un mot. Est-ce encore une pensée que vous avez surprise? Vous, au contraire, vous me la dites très-nettement. Il y aurait encore autre chose à faire ce serait de ne pas s'écrire un mot pendant le voyage que je vais faire, de penser à nous ou à toute autre chose, et de se revoir ou de ne pas se revoir au retour, suivant que la réflexion le conseillerait. Cela est encore assez raisonnable, mais d'exécution embarrassante. Quand je ne pense plus à votre lettre et seulement à votre amabilité, savez-vous ce que je voudrais? c'est nous revoir encore une fois. Cette affaire de l'hôtel de Cluny m'a forcé à retarder mon départ. Je devrais être en route. Je crains de ne pouvoir pas signer un maudit procès-verbal où il faut que mon nom soit avant lundi. Puisque vous aviez envie de me parler lundi, peut-être n'auriez-vous pas d'objections à me dire définitivement adieu samedi.
En vous parlant de cela, j'ai peut-être tort. Dieu sait en quelle disposition vous êtes! Après tout, vous pouvez fort bien dire non. Je vous promets de ne m'en pas fâcher.
Paris, jeudi soir, 2 août 1843.
Je suis moins poétique que vous. La χθὡν εὑρυοδεἱη, c'est-à-dire la large terre, malgré le mackintosh, était encore plus froide que vous, et j'en suis enrhumé, mais sans rancune. J'en aurais à lire tout ce que vous me dites et que vous croyez agréable. Combien de mais toujours! que vous êtes ingénieuse à ôter aux autres et à vous-même l'enchantement qu'ils peuvent avoir! Je dis enchantement, et j'ai tort sans doute; car je ne crois pas que les marmottes en aient. Vous étiez un de ces jolis animaux-là avant que Brahma envoyât votre âme dans un corps de femme. À la vérité, vous vous réveillez quelquefois, et, comme vous dites fort bien, c'est pour quereller. Soyez donc bonne et gracieuse comme vous savez l'être. Malgré ma mauvaise humeur, j'aime mieux vous voir avec vos grands airs indifférents que de ne pas vous voir du tout. Je vous disais bien que toute cette botanique ne valait rien; mais vous voulez toujours faire à votre tête. J'ai découvert des choses encore plus curieuses que des courses champêtres sur des indices moins évidents. Croyez-moi, jetez au feu toutes ces fleurs fanées, et venez en chercher de nouvelles.
Adieu.
Paris, 5 août 1843.
J'attendais une lettre de vous avec bien de l'impatience, et plus elle tardait, plus je m'attendais à des seconds mouvements et à toutes leurs vilaines conséquences. Comme j'étais préparé à toutes les injures de votre part, votre lettre m'a paru meilleure qu'en un autre moment. Vous me dites que vous avez été heureuse aussi, et ce mot efface tous les autres qui précèdent et qui suivent pour l'affaiblir. C'est ce que vous m'avez dit de mieux depuis longtemps, c'est presque la seule fois où je vous ai senti un cœur fait comme un autre. Quelle radieuse promenade! Je ne suis nullement malade et j'étais l'autre jour assez heureux pour en garder de la santé et de la bonne humeur pour longtemps. Si le bonheur passe vite, il peut se renouveler. Malheureusement, le temps se gâte, puis vous parlez de voyage. Peut-être cette pluie vous a-t-elle ôté l'envie de courir. Pour moi, elle m'ôte jusqu'à la force de faire des projets. Pourtant, s'il y avait un bon jour avant votre départ, ne ferions-nous pas bien d'en profiter et de dire adieu pour longtemps à notre parc et à nos bois? Je ne reverrai plus leurs feuilles de cette année du moins, et cette idée-là m'attriste. J'espère que vous les regretterez aussi. Quand vous verrez un rayon de soleil, prévenez-moi, et allons retrouver nos châtaignes et notre montagne. Vous avez pensé à moi et à nous pendant un moment bien court, mais le souvenir n'en reste-t-il pas bien longtemps?
Vézelay, 8 août 1843, au soir.
Je vous remercie de m'avoir écrit un mot avant mon départ. C'est l'intention qui m'a fait plaisir et non l'expression de votre lettre. Vous me dites des choses fort extraordinaires. Si vous pensez la moitié de ce que vous dites, le plus sage serait de ne plus nous revoir. L'affection que vous avez pour moi n'est chez vous qu'une espèce de jeu d'esprit. Vous êtes toute esprit. Vous êtes une de ces chilly women of the North, vous ne vivez que par la tête. Ce que je pourrais vous dire, vous ne le comprendriez pas. J'aime mieux vous répéter encore que je suis fâché de vous avoir fait de la peine, que ç'a été indépendant de ma volonté et que je vous en demande pardon. Nos caractères sont aussi différents que nos stamina. Que voulez-vous! vous pouvez quelquefois deviner mes pensées, mais vous ne me comprendrez jamais.
Je suis ici dans une horrible petite ville perchée sur une haute montagne, assassiné par les provinciaux, et fort préoccupé d'un speech que je dois faire demain. Je représente, et vous me connaissez assez pour savoir combien le métier d'homme public m'est odieux. J'ai pour me consoler un compagnon de voyage très-aimable et une admirable église qui me doit de ne pas être par terre à l'heure qu'il est. Lorsque j'ai vu cette église pour la première fois, c'était fort peu de temps après vous avoir vue à ***. Je me demandais aujourd'hui si nous étions plus fous alors que maintenant.
Ce qu'il y a de certain, c'est que nous nous faisions l'un de l'autre une idée probablement très-différente de celle que nous avons maintenant. Si nous avions su alors combien nous nous ferions enrager l'un l'autre, croyez-vous que nous nous serions revus? Il fait un froid affreux, de la pluie, et des éclairs au milieu de tout cela. J'ai une rame de prose officielle à écrire, et je vous quitte d'autant plus facilement que ce ne sont pas des tendresses que j'aurais à vous dire. Je suis aussi mécontent de moi-même que de vous. C'est cependant la force des choses à qui j'en veux le plus. Je serai à Dijon dans quelques jours. Si vous vouliez m'écrire là, vous me feriez plaisir, surtout si vous trouviez sous votre plume quelque chose de moins brutal que votre dernière lettre. Vous ne pouvez vous faire une idée d'une de nos soirées d'auberge. Parmi les idées les plus riantes qui me viennent à l'esprit, je pense à aller passer quelque part en Italie le temps qui doit s'écouler entre ma tournée et le voyage d'Alger. Je me figure que, de votre côté, vous avisez aux moyens d'être à la campagne lorsque je reviendrai à Paris. Que deviendront tous ces projets-là? En partant, j'ai vu M. de Saulcy, qui venait de recevoir une lettre de Metz. On lui faisait un grand éloge de votre frère, qui plaît beaucoup aux gens à qui on l'a recommandé. Je vous aurais écrit cela plus tôt sans les mille et un tracas du départ.
Adieu. Il me semble que je me trouve mieux pour avoir un peu causé avec vous. Si j'avais plus de papier et moins de rapports à faire, je serais capable, je crois, de vous dire maintenant quelque chose de tendre. Vous savez que mes colères finissent ordinairement de la sorte.
À Dijon, poste restante, et n'oubliez pas mes titres et qualités!
Avallon, 14 août 1843.
Je croyais être le 10 à Lyon, j'en suis encore à plus de soixante lieues. Il faut que je m'arrête à Autun ayant d'avoir de vos nouvelles. Si vous êtes aimable, vous m'écrirez encore à Lyon. Je suis de plus en plus content de Vézelay. La vue en est admirable, et puis j'ai quelquefois du plaisir à être seul. En général, je me trouve assez mauvaise compagnie; mais, quand je suis triste sans avoir de grands motifs pour l'être, quand cette tristesse n'est pas de la colère rentrée, alors je me plais dans une solitude complète; J'étais dans cette disposition les derniers jours que j'ai passés à Vézelay. Je me promenais ou je me couchais au bord d'une certaine terrasse naturelle qu'un poète pourrait bien appeler un précipice, et, là, je philosophais sur le moi, sur la Providence, dans l'hypothèse qu'elle existe. Je pensais à vous aussi, et plus agréablement qu'à moi. Mais cette pensée-là n'était pas la plus gaie, parce que, aussitôt quelle venait, je me représentais combien je serais heureux de vous voir auprès de moi dans ce coin ignoré. Et puis, et puis tout cela se terminait par cette autre pensée plus désolante, que vous étiez bien loin, qu'il n'était pas facile de se voir et pas sûr même que vous le voulussiez bien. Ma présence à Vézelay a beaucoup intrigué la population. Lorsque je dessinais, surtout lorsque je me servais d'une chambre claire, un rassemblement considérable se formait autour de moi, et c'était à qui bâtirait des conjectures sur mon genre d'occupation. Cette célébrité ne laissait pas d'être fort ennuyeuse, et j'aurais bien voulu avoir avec moi un janissaire pour contenir les curieux. Ici, je suis rentré dans la foule. Je suis venu pour voir un vieil oncle que je ne connaissais guère. Il a fallu rester deux jours avec lui. Pour ma peine, il m'a mené voir quelques têtes sans nez qui proviennent d'une fouille faite aux environs. Je n'aime pas les parents. On est obligé d'être familier avec des gens qu'on n'a jamais vus parce qu'ils se trouvent fils du même père que votre père. Mon oncle est cependant un très-brave homme, point trop provincial, et peut-être je le trouverais aimable si nous avions deux idées communes. Les femmes sont ici aussi laides qu'à Paris. En outre, elles ont des chevilles grosses comme des poteaux. À Nevers, il y avait d'assez jolis yeux. Point de costumes nationaux. Outre nos perfections morales, nous avons l'avantage d'être le peuple le plus rabougri et le plus laid de l'Europe. Je vous envoie un bout de plume de chouette que j'ai trouvée dans un trou de l'église abbatiale de la Madeleine de Vézelay. L'ex-propriétaire de la plume et moi, nous nous sommes trouvés un instant nez à nez, presque aussi inquiets l'un que l'autre de notre rencontre imprévue. La chouette a été moins brave que moi et s'est envolée. Elle avait un bec formidable et des yeux effroyables, outre deux plumes en manière de cornes. Je vous envoie cette plume pour que vous en admiriez la douceur, et puis parce que j'ai lu dans un livre de magie que, lorsqu'on donne à une femme une plume de chouette et quelle la met sous son oreiller, elle rêve de son ami. Vous me direz votre rêve.
Adieu.
Saint-Lupicin, 15 août 1843, au soir.
À 600 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Au milieu d'un océan de puces très-agiles
et très-affamées.
Votre lettre est diplomatique. Vous pratiquez l'axiome que la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Heureusement pour vous, le post-scriptum m'a désarmé. Pourquoi dites-vous en allemand ce que vous pensez en français? Serait-ce que vous ne le pensez qu'en allemand, c'est-à-dire que vous ne le pensez guère? Je ne veux pas le croire. Mais il y a en vous des choses qui m'irritent au dernier point. Comment êtes-vous encore timide avec moi? Pourquoi n'avez-vous jamais voulu me dire quelque chose qui m'aurait fait tant déplaisir? Croyez-vous qu'il y ait des équivalents dans une langue étrangère?
Vous ne vous figurez pas le lieu où je suis.
Saint-Lupicin est dans les montagnes du Jura. C'est laid au dernier point, sale et peuplé de puces. Je vais être obligé de me coucher tout à l'heure et je vais passer une nuit comme mes nuits d'Éphèse. Malheureusement, à mon réveil, je ne trouverai ni lauriers, ni ruines grecques. Quel vilain pays! Je pense souvent que, si les chemins de fer se perfectionnaient, nous pourrions aller ensemble dans un lieu semblable et qu'alors il s'embellirait. Il y a ici une immense quantité de fleurs, un air singulièrement pur et vif; on entend la voix humaine à une lieue de distance. Pour vous prouver que je pense à vous, voici une petite fleur cueillie dans ma promenade au coucher du soleil. C'est la seule qui se puisse envoyer. Toutes les autres sont colossales.—Que faites-vous? À quoi pensez-vous? Vous ne me diriez jamais à quoi vous pensez réellement, et c'est folie à moi de vous le demander. Depuis mon départ, j'ai eu peu de bons moments. Un ciel d'un gris de plomb, tous les accidents et toutes les misères possibles. Une roue cassée, un œil en compote; tout cela est raccommodé tant bien que mal. Mais ce à quoi je ne m'habitue pas, c'est à la solitude. Il me semble que, cette année, elle m'est plus pénible qu'à l'ordinaire. Je veux dire la solitude avec le mouvement. Il n'y a rien de plus triste. Il me semble que, si j'étais en prison, je serais plus à mon aise qu'à courir ainsi le pays. Je regrette surtout nos promenades. Vous me faites plaisir en me disant que vous aimez toujours nos bois. J'espère que nous les reverrons, et cependant mon malheureux voyage s'allonge démesurément. Le département du Jura, avec ses montagnes et ses chemins de traverse, me retarde de plus de dix jours. Je vais de désappointement en désappointement. Encore si c'étaient les premières montagnes que je visse. Je n'ai nulle envie d'aller en Italie. C'est une invention de votre part. Votre lettre m'a fait tantôt plaisir et tantôt m'a fait enrager. J'y vois quelquefois entre les lignes les choses les plus tendres du monde. D'autres fois, vous me paraissez encore plus chilly que de coutume. Il n'y a que le post-scriptum qui me satisfasse. Je ne l'ai vu que tard. Il est à une si grande distance du reste de la lettre! Si vous m'écrivez tout de suite, écrivez-moi à Besançon; sinon, adressez votre lettre chez moi à Paris. Je ne sais pas où je serai dans huit jours d'ici.
Paris, lundi, septembre 1843.
Nous nous sommes séparés l'autre jour également mécontents l'un de l'autre. Nous avions tort tous les deux, car c'est la force des choses qu'il fallait seulement accuser. Le mieux eût été de ne pas nous revoir de longtemps. Il est évident que nous ne pouvons plus maintenant nous trouver ensemble sans nous quereller horriblement. Tous les deux, nous voulons l'impossible: vous, que je sois une statue; moi, que vous n'en soyez pas une. Chaque nouvelle preuve de cette impossibilité, dont au fond nous n'avons jamais douté, est cruelle pour l'un et pour l'autre. Pour ma part, je regrette toute la peine que j'ai pu vous donner. Je cède trop souvent à des mouvements de colère absurde. Autant vaudrait-il se fâcher de ce que la glace est froide.
J'espère que vous me pardonnerez maintenant; il ne me reste nulle colère, seulement une grande tristesse. Elle serait moindre si nous ne nous étions pas quittés de la sorte. Adieu, puisque nous ne pouvons être amis qu'à distance. Vieux l'un et l'autre, nous nous retrouverons peut-être avec plaisir. En attendant, dans le malheur ou dans le bonheur, souvenez-vous de moi. Je vous ai demandé cela il y a je ne sais combien d'années. Nous ne pensions guère alors à nous quereller.
Adieu encore, pendant que j'ai du courage.
Paris, jeudi, 6 septembre 1843.
Il me semble que je vous ai vue en rêve. Nous sommes demeurés si peu de temps ensemble, que je ne vous ai rien dit de ce que je voulais vous dire. Vous-même, vous aviez l'air de ne pas trop savoir si j'étais une réalité. Quand nous verrons-nous? Je fais en ce moment le métier le plus bas et le plus ennuyeux: je sollicite pour l'Académie des inscriptions. Il m'arrive les scènes les plus ridicules, et souvent il me prend des envies de rire de moi-même, que je comprime pour ne pas choquer la gravité des académiciens que je vais voir. C'est un peu à l'aveugle que je me suis embarqué, ou plutôt qu'on m'a embarqué dans cette affaire. Mes chances ne sont point mauvaises, mais le métier est des plus rudes, et le pire de tout, c'est que le dénoûment se fera longtemps attendre: vraisemblablement jusqu'à la fin d'octobre, et peut-être plus. Je ne sais si je pourrai aller en Algérie cette année. La seule réflexion qui me console, c'est que je resterai ici et que, par conséquent, je vous verrai. Cela vous fera-t-il plaisir? Dites-moi que oui et gâtez-moi bien. Je suis tellement abruti par ces ennuyeuses visites, que j'ai besoin de toutes vos câlineries, et des plus tendres, pour me donner un peu de courage et de vie.
Vous avez tort d'être jalouse des inscriptions. J'y mets quelque amour-propre, comme à une partie d'échecs engagée avec un adversaire habile; mais je ne crois pas que la perte ou le gain m'affecte le quart autant qu'une de nos querelles. Mais quel vilain métier que celui de solliciteur! Avez-vous jamais vu des chiens entrer dans le terrier d'un blaireau? Quand ils ont quelque expérience, ils font une mine effroyable en y entrant, et souvent ils en sortent plus vite qu'ils n'y sont entrés, car c'est une vilaine bête à visiter que le blaireau. Je pense toujours au blaireau en tenant le cordon de la sonnette d'un académicien, et je me vois in the mind's eye tout à fait semblable au chien que je vous disais. Je n'ai pas encore été mordu cependant. Mais j'ai fait de drôles de rencontres.
Adieu.
Septembre 1843.
Je m'ennuie beaucoup de vous, pour me servir d'une ellipse que vous affectionnez. Je ne me représentais pas l'autre jour, clairement du moins, que nous nous disions adieu pour bien longtemps. Est-ce vrai maintenant que nous ne nous verrons plus? Nous nous sommes quittés sans nous parler, sans nous regarder presque. C'était comme l'autre jour, à la cause près. Je sentais une espèce de bonheur calme qui ne m'est pas ordinaire. Il m'a semblé pour quelques instants que je ne désirais rien de plus. Maintenant, si nous pouvons retrouver ce bonheur-là, pourquoi nous le refuserions-nous? Il est vrai que nous pouvons encore nous quereller, comme cela nous est arrivé tant de fois. Mais qu'est-ce que le souvenir d'une querelle auprès de celui d'un raccommodement! Si vous pensez la moitié de tout cela, vous devez avoir envie de refaire encore une de nos promenades. Je vais faire un petit voyage la semaine prochaine. Samedi, si vous voulez, ou bien mardi prochain, nous pourrions nous voir. Je ne vous ai pas écrit plus tôt parce que je m'étais persuadé que vous seriez la première à me parler de revoir nos bois. Je me suis trompé, mais je ne vous en veux pas beaucoup. Vous avez le secret de me faire oublier bien des choses, de substituer chez moi une impression à la raison. Encore une fois, je ne vous le reproche pas. On est heureux de pouvoir rêver ainsi.
Paris, septembre 1843.
Nos lettres se sont croisées. Vous aurez vu, j'espère, que ma colère, que je regrette beaucoup, n'a pas eu la cause que vous lui supposez. Mais votre lettre me prouve qu'il nous est impossible de ne pas nous quereller. Nous sommes trop différents. Vous avez tort de vous repentir de ce que vous avez fait: c'est moi qui ai eu tort de vouloir que vous fussiez autre que vous n'êtes. Croyez que je n'ai nullement changé à votre égard. Je regrette par-dessus tout de vous avoir quittée de la sorte, mais il y a des moments où l'on ne peut être de sang-froid. Je désirerais vous revoir maintenant pour retrouver auprès de vous un de nos beaux rêves de cet été, et vous dire adieu alors pour longtemps en demeurant sur une impression douce et tendre. Vous trouverez cette idée-là fort absurde. Cependant, elle me poursuit, et je ne puis m'empêcher de vous la dire. Refusez, vous ferez peut-être bien. Je crois que maintenant j'aurai assez d'empire sur moi pour ne pas me mettre en colère. Je n'en répondrais pas cependant. Le parti que vous prendrez sera le bon. Je ne puis vous promettre que les meilleures intentions du monde d'être calme et résigné.
Avignon, 29 septembre.
Il y a bien des jours que je n'ai reçu de vos nouvelles et presque aussi longtemps que je ne vous ai écrit. Mais, moi, je suis excusable. En vérité, le métier que je fais est des plus fatigants. Tout le jour, il faut ou marcher ou courir la poste, et, le soir, malgré la fatigue, il faut brocher une douzaine de pages de prose. Je ne parle que des écritures ordinaires, car, de temps en temps, j'ai à faire la chouette à mon ministre. Mais, comme ils ne lisent pas, je puis impunément dire toutes les bêtises possibles.
Le pays que je parcours est admirable, mais les gens y sont bêtes à outrance. Personne n'ouvre la bouche si ce n'est pour faire son éloge, et cela depuis l'homme qui porte un habit noir jusqu'au portefaix. Aucune apparence de ce tact qui fait le gentleman et que j'ai retrouvé avec tant de plaisir parmi les gens du peuple en Espagne. À cela près, il est impossible de voir un pays qui ressemble plus à l'Espagne. L'aspect du paysage et de la ville est le même. Les ouvriers se couchent à l'ombre ou se drapent de leurs manteaux d'un air aussi tragique que les Andalous. Partout l'odeur d'ail et d'huile se marie à celle des oranges et du jasmin. Les rues sont couvertes de toiles pendant le jour, et les femmes ont de petits pieds bien chaussés. Il n'y a pas jusqu'au patois qui n'ait de loin le son de l'espagnol. Un plus grand rapport se trouve encore produit par l'abondance des cousins, puces, punaises, qui ne permettent pas de dormir. J'ai encore deux mois à mener cette vie avant de revoir des êtres humains! Je pense sans cesse à mon retour à Paris, et mon imagination me peint je ne sais combien de délicieux moments passés avec vous. Peut-être ce que je puis espérer de mieux, c'est de vous voir une minute de loin et d'obtenir un petit signe de tête en manière de reconnaissance. . . . . .
. . . . . . .
Vous me demandez un dessin de chapiteau roman. Je n'en ai plus un seul. J'ai envoyé tous mes croquis à Paris. Ensuite, un chapiteau vous intéresserait peu. Ce sont ou des diables, ou des dragons, ou des saints qui en font la décoration. Les diables des premiers siècles du christianisme n'ont rien de bien séduisant. Pour les dragons et les saints, je suis sûr que vous en faites peu de cas. J'ai commencé à dessiner pour vous un costume maçonnais. C'est le seul que j'aie rencontré qui ait quelque grâce; encore la ceinture est-elle si drôlement placée, que la taille la plus fine ne paraît pas différente de la plus grosse. Il faut une organisation physique particulière pour porter ce costume. Lebon marché des cotonnades et la facilité des communications avec Paris ont fait disparaître les costumes nationaux.
10 septembre.—Je me suis donné une espèce d'entorse hier au soir. Je vous écris un pied sur une chaise, dans un état de fureur difficile à décrire. Quand mon pied désenflera-t-il? That is the question. Si j'étais obligé de passer cinq à six jours de plus ici, je ne sais ce que je deviendrais. Je crois que j'aimerais mieux être sérieusement malade que d'être ainsi arrêté par une petite misère. Pourtant, cela me fait assez souffrir.
Avignon est rempli d'églises et de palais, tous munis de hautes tours avec créneaux et mâchicoulis. Le palais des papes est un modèle de fortification pour le moyen âge. Cela prouve quelle aimable sécurité régnait dans ce pays vers le XIIIe ou XIVe siècle. Dans le palais des papes, on monte une centaine de marches d'un escalier tortueux, puis tout à coup on se trouve vis-à-vis une muraille. En tournant la tête, on voit, à quinze pieds plus haut, la continuation de l'escalier, où l'on ne peut parvenir que par une échelle. Il y a aussi des chambres souterraines qui servaient à l'inquisition. On montre les fourneaux où l'on chauffait les ferrements pour torturer les hérétiques, et les débris d'une machine très-compliquée pour donner la question. Les Aviguonnais sont aussi fiers de leur inquisition que les Anglais de leur Magna Charta. «Nous aussi, disent-ils, nous avons eu des auto-da-fé, et les Espagnols n'en ont eu qu'après nous!»
J'ai vu à Vienne, il y a quelques jours, une statue antique qui a bouleversé toutes mes idées sur la statuaire romaine. J'avais toujours vu le beau idéal de convention intervenir dans l'imitation de la nature. Là, c'est tout différent. Cette statue représente une grosse maman bien grasse, avec une gorge énorme un peu pendante et des plis de graisse le long des côtes, comme Rubens en donnait à ses nymphes. Tout Cela est copié avec une fidélité surprenante à voir. Qu'en disent Messieurs de l'Académie?
Adieu, voici l'heure de la poste. Écrivez-moi à Montpellier, puis à Carcassonne. J'espère que je ne serai pas trop longtemps sans aller chercher votre lettre, qui me rend toujours si heureux.
Adieu encore.
Toulon, 2 octobre.
J'ai été longtemps sans vous écrire, chère amie. Aussitôt que mon pied a été rendu à ses proportions ordinaires, j'ai voulu réparer le temps perdu en faisant des courses dans le Comtat. J'ai été à même d'apprécier la différence qui existe entre les cousins de Carpentras, d'Orange, Cavaillon, Apt et autres lieux. Ils possèdent presque tous la propriété d'empêcher un honnête-homme de dormir. Je ne vous parlerai pas des belles choses que j'ai vues ni des humbugs que j'ai découverts. Mais savez-vous ce que c'est qu'un draquet? C'est la même chose qu'un fantasty. Voici l'explication de ces deux mots barbares: vous saurez d'abord que la richesse du département de Vaucluse consiste surtout en soies. Dans chaque maisonnette de paysan, on élève des vers et on file la soie, d'où résulte d'abord une odeur infecte, ensuite que très-souvent on trouve des écheveaux de soie accrochés aux buissons. Vers le soir, il y a des paysannes assez imprudentes pour ramasser ces écheveaux et les mettre dans leur panier. Le panier s'alourdit peu à peu, toujours augmentant de poids, si bien que l'on est tout en nage à le porter. Lorsque, après une longue et pénible marche, on arrive aux abords d'un ruisseau, alors le panier devient réellement insupportable et on est obligé de le mettre à terre. Aussitôt il en sort un petit être à grosse tête, ricanant toujours, emmanché d'une espèce de queue de lézard, qui se plonge dans le ruisseau en disant: «M'as ben pourta!» ce qui veut dire en provençal ou dans l'idiome des draquets: «Tu m'as bien porté!» J'ai vu déjà plus d'une femme qui avait été ainsi mystifiée par ces démons espiègles, et je suis désolé de n'en pas avoir rencontré moi-même. J'aurais eu le plus grand plaisir à faire connaissance avec eux.
Ma tournée s'allonge à mesure que les jours accourcissent. Je vais demain à Fréjus pour aller de là aux îles de Lérins, où je trouverai peut-être les ruines de la première église chrétienne d'Occident. Je suis plus qu'à demi persuadé que je ne trouverai rien du tout. Mais il faut faire son métier en conscience et inspecter tout ce qu'il y a d'historique.
Il est impossible de voir rien de plus sale et de plus joli que Marseille. Sale et joli convient parfaitement aux Marseillaises. Elles ont toutes de la physionomie, de beaux yeux noirs, de belles dents, un très-petit pied et des chevilles imperceptibles. Ces petits pieds sont chaussés de bas cannelle, couleur de la boue de Marseille, gros et raccommodés avec vingt cotons de nuances différentes. Leurs robes sont mal faites, toujours fripées et couvertes de taches. Leurs beaux cheveux noirs doivent la plus grande partie de leur lustre au suif de chandelle. Ajoutez à cela une atmosphère d'ail mêlée de vapeur d'huile rance, et vous pouvez vous représenter la beauté marseillaise. Quel dommage que rien ne soit complet dans le monde! Eh bien, elles sont ravissantes malgré tout. Voilà un vrai triomphe.
Mes soirées, qui sont bien longues maintenant, commencent à m'ennuyer horriblement. Il est vrai que j'ai, en général, des volumes de lettres à écrire et des rapports à faire pour mes deux ou trois ministres. Ces douces occupations ne m'empêchent pas d'avoir le spleen depuis trois semaines. Je fais les rêves les plus noirs du monde, et mes pensées ne sont pas d'une couleur plus gaie. Pas un mot de vous! J'en aurais bien besoin pourtant. Si vous m'écrivez tout de suite, adressez votre lettre à Carcassonne. Il me faut une lettre de vous pour me ranimer. . . . . .
. . . . . . .
Après Carcassonne, j'irai à Perpignan, à Toulouse et à Bordeaux. J'espère bien y trouver un souvenir de vous. Je n'ai pas achevé le croquis que je vous destine. Je vous l'apporterai à Paris. Dites-moi ce que je pourrai vous apporter encore qui vous fasse plaisir. Voici une fleur d'un arbrisseau épineux qui croît aux environs de Marseille et qui a une odeur de violette très-suave.
Adieu.
Paris, vendredi matin, 3 novembre 1813.
Est-il possible que vous ne puissiez me dire tout ce que vous écrivez? Quelle est donc cette timidité bizarre qui vous empêche d'être franche et qui vous fait chercher les mensonges les plus extraordinaires, plutôt que de laisser échapper un mot de vérité qui me ferait tant de plaisir? Parmi les bons sentiments dont vous me parlez, il y en a un que je ne comprends pas, dites-vous; et vous ne cherchez pas à me le faire comprendre, je ne le devine même pas. Quant aux deux autres, je vous avoue que je ne suis guère plus habile. Croyez-vous au diable? Suivant moi, toute la question est là. S'il vous fait peur, arrangez-vous pour qu'il ne vous emporte pas. Si le diable est hors de cause en cette affaire, comme je le suppose, reste à se demander si l'on fait du mal ou du tort à quelqu'un. Je vous dis mon catéchisme. C'est, je crois, le meilleur, mais je ne vous le garantis pas. Je n'ai jamais cherché à faire des conversions, mais, jusqu'à présent, on n'a pu faire la mienne. Vous vous adressez, d'ailleurs, des reproches plus sévères que je ne vous en adresse. Quelquefois, je cède à la tristesse et à l'impatience. Rarement je vous accuse, sinon parfois de ce manque de franchise qui me met dans une défiance presque continuelle avec vous, obligé que je suis de chercher toujours votre idée sous un déguisement. Si j'avais été bien convaincu de ce que vous m'avez dit l'autre jour, j'en serais très-malheureux, car je ne pourrais souffrir de vous faire de la peine. Voyez pourtant qu'à force de dire tantôt blanc, tantôt noir, vous me faites douter de tout. Je ne sais plus ce que vous pensez, ce que vous sentez. Parlons donc une fois à cœur ouvert.
Perpignan, 14 novembre.
. . . . .
Vous aviez été si longtemps sans m'écrire, que je commençais à être inquiet. Et puis j'étais tourmenté d'une idée saugrenue que je n'ai pas osé vous dire. Je visitais les arènes de Nîmes avec l'architecte du département, qui m'expliquait longuement les réparations qu'il avait fait faire, lorsque je vis, à dix pas de moi, un oiseau charmant, un peu plus gros qu'une mésange, le corps gris de lin, avec les ailes rouges, noires et blanches. Cet oiseau était perché sur une corniche et me regardait fixement. J'interrompis l'architecte pour lui demander le nom de cet oiseau. C'est un grand chasseur, et il me dit qu'il n'en avait jamais vu de semblable. Je m'approchai, et l'oiseau ne s'envola que lorsque j'étais assez près de lui pour le toucher. Il alla se poser à quelques pas de là, me regardant toujours. Partout où j'allais, il semblait me suivre, car je l'ai retrouvé à tous les étages de l'amphithéâtre. Il n'avait pas de compagnon et son vol était sans bruit, comme celui d'un oiseau nocturne.
Le lendemain, je retournai aux arènes et je revis encore mon oiseau. J'avais apporté du pain, que je lui jetai. Il le regarda, mais n'y toucha pas. Je lui jetai ensuite une grosse sauterelle, croyant à la forme de son bec qu'il mangeait des insectes, mais il ne parut pas en faire cas. Le plus savant ornithologiste de la ville me dit qu'il n'existait pas dans le pays d'oiseau de cette espèce.
Enfin, à la dernière visite que j'ai faite aux arènes, j'ai rencontré mon oiseau toujours attaché à mes pas, au point qu'il est entré avec moi dans un corridor étroit et sombre où lui, oiseau de jour, n'aurait jamais dû se hasarder.
Je me souvins alors que la duchesse de Buckingham avait vu son mari sous la forme d'un oiseau le jour de son assassinat, et l'idée me vint que vous étiez peut-être morte et que vous aviez pris cette forme pour me voir. Malgré moi, cette bêtise me tourmentait, et je vous assure que j'ai été enchanté de voir que votre lettre portait la date du jour où j'ai vu pour la première fois mon oiseau merveilleux.
Je suis arrivé ici avec un temps affreux. Une pluie comme on n'en voit jamais dans le Nord a inondé toute la campagne, coupé les routes, changé tous les ruisseaux en grosses rivières. Il m'est impossible de sortir de la ville pour aller à Serrabonne, où j'ai affaire. Je ne sais combien de temps cela durera.
Il y a une foire à Perpignan, et de plus les Espagnols qui fuient l'épidémie encombrent la ville, si bien que je n'ai pu trouver à me loger dans une auberge. Si je n'étais parvenu à émouvoir la commisération d'un chapelier, j'aurais été réduit à coucher dans la rue. Je vous écris dans une petite chambre bien froide, à côté d'une cheminée qui fume, maudissant la pluie qui bat mes vitres. La servante qui me sert ne parle que catalan et ne me comprend que lorsque je lui parle espagnol. Je n'ai pas un livre et je ne connais personne ici. Enfin, le pire de tout, c'est que, si le vent du nord ne s'élève pas, je resterai ici je ne sais combien de jours, sans même la ressource de retourner à Narbonne, car le pont qui pouvait assurer ma retraite ne tient plus à rien, et, si l'eau grossit, il sera emporté. Admirable situation pour faire des réflexions et pour écrire ses pensées. Mais des pensées, je n'en ai guère maintenant. Je ne sais que m'impatienter. J'ai à peine la force de vous écrire. Vous ne me parlez pas d'une lettre que je vous ai écrite d'Arles. Peut-être s'est-elle croisée avec la vôtre?
J'ai été à la fontaine de Vaucluse, où j'ai eu quelque envie d'écrire votre nom; mais il y avait tant de mauvais vers, de Sophies, de Carolines, etc., que je n'ai pas voulu profaner votre nom en le mettant en si mauvaise compagnie. C'est l'endroit le plus sauvage du monde. Il n'y a que de l'eau et des rochers. Toute la végétation se réduit à un figuier qui a poussé je ne sais comment au milieu des pierres, et à des capillaires très-élégantes dont je vous envoie un échantillon. Lorsque vous avez bu du sirop de capillaire pour un rhume, vous ne saviez peut-être pas que cette plante avait une forme aussi jolie.
Je serai à Paris vers le 15 du mois prochain. Je ne sais pas du tout quelle route je prendrai. Il est possible que je revienne par Bordeaux. Mais, si le temps ne s'améliore pas, je reviendrai par Toulouse. Je serai alors à Paris quinze jours plus tôt. J'espère trouver une lettre de vous à Toulouse. S'il n'y en avait pas, je vous en voudrais mortellement.
Adieu.
Paris, 17 novembre 1843.
Il me semble vous voir d'ici avec la mine que vous me faites quelquefois; j'entends votre mine des mauvais jours; je crains, outre votre mauvaise humeur, que vous ne vous soyez enrhumée. Rassurez-moi bien vite sur ces deux points. Vous avez été si bonne et si gracieuse, que je vous pardonnerais, je crois, un retour à la mauvaise humeur, pourvu que vous me disiez que notre promenade ne vous a pas fait de mal. J'ai dormi presque toute la journée, de ce demi-sommeil que vous aimez. Le froid qu'il fait me désespère. Il y avait autrefois un été de la Saint-Martin, qui consolait un peu de la chute des feuilles. Je crains que cela n'ait passé comme bien des choses de ma jeunesse. Écrivez-moi, chère amie; dites-moi que vous vous portez bien, que vous ne m'en voulez pas de mes reproches. Vous ne me corrigerez pas de ce défaut-là. Si je n'étais habitué à penser tout haut avec vous, je serais presque tenté d'être toujours en colère, car vous êtes si aimable alors, qu'on ne peut se repentir du chagrin qu'on a dû vous causer; cependant, je me souviens seulement des moments où nous avons l'un et l'autre les mêmes pensées, et où il me semblait que vous oubliez et mon importunité et votre orgueil. On m'apporte votre lettre. Je vous en remercie de cœur. Vous êtes aussi bonne, aussi charmante que vous l'étiez avant-hier; de votre part, c'est doublement beau, car les choses aimables que vous me dites, vous les sentez encore et ce n'est pas la peur de mes colères qui vous les dicte. Si vous saviez tout le plaisir que me fait un mot de vous qui vient de vous-même, vous en seriez moins avare. J'espère que vous ne changerez pas de situation d'âme.
Je suppose que vous vous êtes fort amusée à votre bal d'hier. Moi, je suis allé aux Italiens, d'où l'on nous a proposé de nous mettre à la porte, Ronconi étant ivre ou en prison pour dettes. Enfin, à force de crier, nous avons eu l'Elisir d'amore; puis je suis rentré chez moi et j'ai corrigé des épreuves jusqu'à trois heures du matin. Vous croyez que l'Académie m'occupe fort? Je m'aperçois que j'y pense aujourd'hui pour la première fois. Je n ai guère de chances de réussir. Savez-vous quelque sortilège pour que mon nom sorte de la boîte de sapin nommée urne?
Paris, mardi soir, 22 novembre 1843.
J'ai eu une bonne part de votre courbature. C'est la réaction d'une contrariété morale sur le physique. J'ai quelque peine à croire que votre entêtement soit bien involontaire. Le fût-il en effet, vous auriez toujours tort, ce me semble. Qu'en résulte-t-il? Vous parvenez, en donnant de mauvaise grâce, à ôter du mérite à un sacrifice que vous faites. Vous n'en sentez que plus vivement la peine de ce sacrifice, puisque vous n'avez plus la consolation qu'on en apprécie le mérite. Pour parler votre langue, vous vous donnez de doubles remords. Je vous ai dit cela plus d'une fois. Vous m'accusez d'injustice et je ne crois pas avoir mérité ce reproche. Si j'ai été injuste, ça n'a pas été souvent. Vous me jugez très-mal. Il est vrai que nous avons des caractères si différents, et surtout des points de vue si différents, que nous ne pouvons jamais juger les choses de même. J'ai tâché de ne pas me mettre en colère. Je crains de n'avoir réussi qu'imparfaitement et je vous en demande pardon. Toutefois, il y a eu quelque amélioration de ma part, convenez-en. Comment voulez-vous disputer sur le sujet que vous dites: «Qui aime le mieux?» La première chose à faire serait de s'entendre sur le sens du verbe, et c'est ce que nous ne ferons jamais. Nous sommes trop ignorants l'un et l'autre pour être jamais d'accord, et surtout trop ignorants l'un de l'autre. Pour moi, j'ai cru vous connaître plus d'une fois, et vous m'échappez toujours. J'avais raison de dire que vous étiez comme Cerbère: Three gentlemen at once.
Entre votre tête et votre cœur, je ne sais jamais qui l'emporte; vous ne le savez pas vous-même, mais vous donnez toujours raison à la tête. Il vaut mieux se quereller que de ne pas se voir. Voilà la seule chose qui me paraisse démontrée. À quand nous querellerons-nous? N'oubliez pas que vendredi est mon jour de réception. J'ai embrassé une trentaine de confrères depuis quatre jours[1], principalement ceux qui, m'ayant promis, m'ont manqué de parole.
[1] À l'occasion de sa nomination comme membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Paris, 13 décembre 1843.
Nous nous sommes quittés sur un mouvement de colère; mais, ce soir, en réfléchissant avec calme, je ne regrette rien de ce que j'ai dit, si ce n'est peut-être la vivacité de quelques mots dont je vous demande pardon. Oui, nous sommes de grands fous. Nous aurions dû le sentir plus tôt. Nous aurions dû voir plus tôt combien nos idées, nos sentiments étaient contraires en tout et sur tout. Les concessions que nous nous faisions l'un à l'autre n'avaient d'autre résultat que de nous rendre plus malheureux. Plus clairvoyant que vous, j'ai sur ce point de grands reproches à me faire. Je vous ai fait beaucoup souffrir pour prolonger une illusion que je n'aurais pas dû concevoir.
Pardonnez-moi, je vous en prie, car j'en ai souffert comme vous. Je voudrais vous laisser de meilleurs souvenirs de moi. J'espère que vous attribuerez à la force des choses le chagrin que j'ai pu vous occasionner. Jamais je n'ai été avec vous tel que j'aurais voulu être, ou plutôt tel que j'avais le projet de paraître à vos yeux. J'ai eu trop de confiance en moi. J'ai cherché dans mon cœur à combattre ce que ma raison me démontrait. À tout prendre, peut-être vous en viendrez à ne voir dans notre folie que son beau côté, à ne vous rappeler que des moments heureux que nous avons trouvés l'un auprès de l'autre. Quant à moi, je n'ai pas le moindre reproche à vous faire. Vous avez voulu concilier deux choses incompatibles et vous n'avez pas réussi. Ne dois-je 'pas vous savoir gré d'avoir essayé pour moi l'impossible?
Paris, mardi soir, 1844.
J'ai attendu toute la journée une lettre de vous, Ce n'est pas ce qui m'a empêché de vous écrire, mais j'ai été horriblement occupé. Je crois que le beau temps d'aujourd'hui m'a un peu soulagé le cœur. Je n'ai plus de colère, si j'en avais, et j'ai moins de tristesse en me rappelant vos discours d'hier. Les nuages sont peut-être pour beaucoup dans ce qui s'est passé entre nous. Déjà une fois nous nous sommes querellés par un temps d'orage; c'est que nos nerfs sont plus forts que nous. J'ai grande envie de vous voir et de savoir comment vous êtes au moral. Si nous essayions de faire demain cette promenade si malencontreusement manquée hier? Que vous en semble? Votre orgueil ne sera sans doute pas de cet avis. Mais c'est à votre cœur que j'en appelle.
Vous serez bien aimable de me répondre un mot demain avant midi, si vous ne pouvez ou si vous ne voulez pas. Mais ne venez pas si vous êtes de mauvaise humeur, si vous avez quelque autre arrangement; enfin, si vous avez la moindre idée que notre promenade n'effacera pas les vilaines impressions d'hier.
Paris, samedi soir 15 janvier 1844.
Je suis bien fâché de vous savoir souffrante. Mais vous me permettrez de ne croire que ce que je pourrai de la manière dont vous avez attrapé ce rhume. Il est rare que cet accident arrive à garder des malades; il est encore plus rare de les garder avec la constance que vous avez mise à le faire. Toutes les maladies autour de vous sont arrivées beaucoup trop à point pour ne m'être pas un peu suspectes. Autrefois, vous étiez plus franche. Vous m'écriviez tout simplement une page de reproches, et vous vous disiez fort en colère. Maintenant, vous avez un autre système.—Vous m'écrivez de petits billets fort jolis et coquets, et il vous survient des malades et des rhumes. Je crois que j'aimais mieux l'autre procédé. Heureusement, les bouderies passent et les malades guérissent. J'espère vous voir en belle humeur mardi, si vous l'avez pour agréable. Vous me traitez comme le soleil, qui ne paraît qu'une fois par mois. Si j'étais de meilleure humeur, je pourrais pousser plus loin la comparaison; mais je suis moi-même très-souffrant, et je n'ai pas comme vous le bonheur d'être gâté par tout ce qui m'entoure et d'aimer la tisane de dattes et de figues. Vous me demandez de vous faire un dessin de nos bois. Cela me serait bien difficile sans les revoir. Vous ne croyez plus à Bellevue, dites-voys; vous devez comprendre par là qu'il n'est pas aisé de les inventer. D'ailleurs, je ne les regarde pas avec l'attention que vous mettez à tout observer.—Moi, je ne vois que vous. Oui, ces bois sont invraisemblables, si près de Paris et si loin.—Si vous y tenez bien fort, j'essayerai; mais vous me direz d'abord ce que vous voulez que je fasse, je veux dire quelle partie de nos bois. Adieu; je ne suis pas très-content de vous. Un mois passé sans se voir est un peu trop. J'ai, demain et après, deux corvées bien ennuyeuses que je vous conterai. Adieu.
Paris, 5 février 1844.
Vous me reprochez ma dureté, et peut-être avez-vous quelque raison. Il me semble cependant que vous seriez plus juste en disant colère ou impatience. Il serait encore assez bien de votre part de réfléchir si cette colère ou cette dureté est motivée ou si elle ne l'est pas.
Examinez s'il n'est pas bien triste pour moi de me trouver sans cesse aux prises avec votre orgueil, et de voir que votre orgueil a la préférence. J'avoue que je ne comprends nullement ce que vous me dites quand vous parlez de votre obéissance qui vous donne le tort de tout, et ne vous donne le mérite de rien. Le contraire pourrait se soutenir mieux, ce me semble; mais il n'y a de votre part ni tort ni mérite. Rappelez-vous un moment et avec franchise ce que vous êtes pour moi. Vous acceptez ces promenades qui sont ma vie; mais cette glace sans cesse renaissante qui me désespère chaque fois davantage, ce plaisir de calcul ou, j'aime mieux le croire, d'instinct, que vous avez à me faire désirer ce que vous refusez obstinément: tout cela peut excuser ma dureté; mais, s'il y a un tort de votre part, c'est assurément cette préférence que vous donnez à votre orgueil sur ce qu'il y a de tendresse en vous. Le premier sentiment est au second comme un colosse à un pygmée.—Cet orgueil n'est au fond qu'une variété de l'égoïsme. Voulez-vous un jour mettre de côté ce grand défaut, et être pour moi aussi aimable que vous le pourrez? J'accepterais très-volontiers ce parti si vous me promettiez d'être tout à fait franche, et si vous aviez le courage de tenir cet engagement, ce serait une expérience peut-être bien triste pour moi. Cependant, je l'accepterais avec joie, puisque vous n'auriez, dites-vous, que du bonheur dans ce cas.—Adieu, à bientôt. Mettez vos bottes de sept lieues, nous ferons une belle promenade; si le temps n'était pas plus mauvais qu'il y a quelques jours, vous n'auriez pas de risques de vous enrhumer. Je suis bien souffrant de migraine et d'étourdissement, mais j'espère que vous me guérirez.
Paris, 12 mars 1844.
C'est fort bien. Comme si je n'avais pas assez d'ennuis de toute espèce! Cent visites à faire! Un libraire qui me fait envoyer un rapport de quarante pages à faire et à discuter! Des épreuves à corriger! Il me semble que vous devriez bien, sachant tout cela, m'écrire au moins quelques lignes d'encouragement. Je suis à peu près à bout de mon courage et de ma patience. Heureusement, cela finit jeudi prochain[1].—Jeudi à une heure, je serai redevenu un bipède ordinaire; d'ici là, est-ce trop vous demander que quelques mots tendres comme vous en avez trouvé la dernière fois que nous nous sommes vus? Il est trois heures, et je vous quitte pour mes épreuves de Mademoiselle Arsène Guillot.—Lundi ou plutôt mardi.
[1] Sa réception à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Jeudi soir, 15 mars 1844.
Cela m'a fait un sensible plaisir[1], d'autant plus que je m'attendais à une défaite. On m'apportait les bulletins à mesure qu'ils s'élaboraient. Il me semblait impossible de réussir; ma mère, qui souffrait depuis quelques jours d'un rhumatisme aigu, a été guérie du coup.—J'en ai d'autant plus envie de vous voir. Essayez si je vous en aime mieux ou moins, et cela le plus tôt possible. Je suis harassé des courses que j'ai faites, car il faut maintenant remercier, et remercier amis et ennemis, pour montrer qu'on a de la grandeur d'âme. J'ai le bonheur d'avoir été black-boulé par des gens que je déteste, car c'est un bonheur que de n'avoir pas le fardeau de la reconnaissance à l'égard des personnes qu'on estime peu. Écrivez-moi, je vous prie, quand vous voulez que nous nous voyions.
J'ai bien envie que nous fassions quelque longue promenade.
Vous êtes sorcière, en effet, d'avoir si bien deviné l'événement. Mon Homère m'avait trompé, ou bien c'est à M. Vatout que s'adressait sa prédiction menaçante.
Adieu, dearest friend! Entre mes épreuves à corriger, mon rapport à faire, et un peu aussi le tracas que j'ai eu depuis trois jours, je n'ai guère trouvé le temps de dormir. Je vais essayer.—J'aurais d'assez drôles d'histoires à vous conter des hommes et des choses.
[1] Sa nomination comme membre de l'Académie française.
17 mars 1844.
Je vous remercie bien de vos compliments, mais je veux mieux encore. Je veux vous voir et faire une longue promenade. Je trouve cependant que vous avez pris la chose trop au tragique. Pourquoi pleurez-vous? les quarante fauteuils ne valaient pas une petite larme. Je suis excédé, éreinté, démoralisé et complétement out of my wits. Puis Arsène Guillot fait un fiasco éclatant et soulève contre moi l'indignation de tous les gens soi-disant vertueux, et particulièrement des femmes à la mode qui dansent la polka et suivent les sermons du P. Ravignan; tant il y a que l'on dit que je fais comme les singes, qui grimpent au haut des arbres et qui, arrivés sur la plus haute branche, font des grimaces au monde. Je crois avoir perdu des voix par cette scandaleuse histoire; d'un autre côté, j'en gagne. Il se trouve des gens qui m'ont black-boulé sept fois et qui me disent qu'ils ont été mes plus chauds partisans. Ne trouvez-vous pas que cela vaut bien la peine de faire ainsi le péché de mensonge, surtout pour le gré que j'en sais aux gens? Tout ce monde où j'ai vécu presque uniquement depuis quinze jours me fait désirer ardemment de vous voir. Au moins nous sommes sûrs l'un de l'autre, et, quand vous me faites des mensonges, je puis vous les reprocher et vous savez vous les faire pardonner. Aimez-moi, quelque vénérable que je sois devenu depuis bientôt trois jours.
Paris, 26 mars 1844.
Je crains que le discours ne vous ait paru un peu long. J'espère qu'il ne faisait pas aussi froid de votre côté que du mien. Je suis encore à grelotter. Nous aurions dû faire une courte promenade ensemble après la cérémonie. Vous avez pu voir quelle horrible toux j'ai. Cela aurait presque pu passer pour de la cabale. Avant la séance, l'orateur m'a fort prié de lui dire dans quelle partie de la salle se trouvait la personne à qui il avait envoyé des billets. L'avez-vous trouvé mieux en costume qu'en frac? Vous pourrez me persuader bien des choses, mais jamais que vous parliez autrement que sérieusement de gâteaux quand vous avez faim. Je maintiens mon adjectif, et vous même en avez reconnu la justesse. Cela est facile à voir par le courroux que vous en montrez. Vous dites que vous ne savez que rêver et jouer.—Vous savez, en outre, cacher vos pensées, et c'est ce qui me désole. Pourquoi, après si longtemps que nous sommes ce que nous sommes l'un à l'autre, êtes-vous encore à réfléchir plusieurs jours avant de répondre franchement à la question la plus simple? On dirait que vous soupçonnez des pièges partout. Adieu; j'ai été bien content de vous voir. J'ai eu de la peine à vous trouver cachée sous le chapeau de votre voisine. Autre enfantillage. Avez-vous vu ce que je vous ai envoyé? en pleine Académie? Mais vous ne voulez jamais rien voir.
Lundi soir. Mars 1844.
Je commence, je crois, à comprendre votre énigme. En réfléchissant à ce que vous m'avez dit aujourd'hui, j'arrive où m'avait déjà conduit une espèce de divination instinctive; assurément, mon plus grand ennemi ou, si vous voulez, mon rival dans votre cœur, c'est votre orgueil; tout ce qui le froisse vous révolte. Vous suivez votre idée, peut-être à votre insu, dans les plus petits détails. N'est-ce pas votre orgueil qui est satisfait lorsque je baise votre main? Vous êtes heureuse alors, m'avez-vous dit, et vous vous abandonnez à votre sensation parce que votre orgueil se plaît à une démonstration d'humilité. Vous voulez que je sois statue parce qu'alors vous êtes ma vie. Mais vous ne voulez pas être statue à votre tour; surtout, vous ne voulez pas cette égalité de bonheur donné et reçu, parce que tout ce qui est égalité vous déplaît.
Que vous dirai-je à cela? que, si cet orgueil voulait se contenter de ma soumission et de mon humilité, il devrait être content; je lui céderai toujours, pourvu qu'il laisse votre cœur suivre ses bons mouvements. Pour moi, je ne mettrai jamais sur une même ligne mon bonheur et mon orgueil, et, si vous vouliez me suggérer des formules d'humilité nouvelles, je les adopterais sans hésiter. Mais pourquoi de l'orgueil, c'est-à-dire de l'égoïsme, entre nous? êtes-vous donc insensible au plaisir de s'oublier l'un pour l'autre? Ce sentiment d'amitié si étrange que nous éprouvons tous les deux quelquefois, qui, ce matin, par exemple, nous a amenés là où nous n'avions aucune raison d'aller, n'est-ce pas une puissance plus douce et plus vive que toutes celles que vous pourrait donner votre démon d'orgueil? Vous avez été si aimable ce matin, que je ne veux ni ne peux vous quereller. Je suis cependant d'une humeur affreuse. Je vous disais que j'allais m'ennuyer à un dîner. Figurez-vous que je me suis trompé de jour, que j'ai mortellement contrarié des gens qui ne m'attendaient pas et qui me l'ont bien rendu. J'ai passé ma soirée à regretter de n'être pas seul chez moi avec mes souvenirs. Je m'attends à une mauvaise lettre de vous. J'ai voulu vous écrire le premier, car je serai furieux sans doute après-demain. Vous me rendrez doux comme un mouton si vous voulez. Voilà l'hiver revenu tout à fait. Comment avez-vous supporté le froid de l'autre jour? celui-ci ne vous effiaye-t-il pas? Je ne sais si vous ferez bien de sortir demain; je crains la responsabilité du conseil, et j'aime mieux que vous décidiez. Voilà encore de l'humilité.
Strasbourg, 30 avril 1844.
Je suis encore ici, grâce aux lenteurs du conseil municipal. Il m'a fallu passer un jour à faire de l'éloquence la plus sublime pour les exhorter à restaurer une vieille église. Ils répondent qu'ils ont plus besoin de tabac que de monuments, et qu'ils feront un magasin de mon église. Je partirai demain pour Colmar, et je pense être à Besançon le lendemain, c'est-à-dire jeudi. Je n'y demeurerai guère que le temps de jeter quelques fleurs sur la tombe de Nodier, et je tâcherai de revenir bien vite voir nos bois. La saison me semble ici plus avancée qu'à Paris. La campagne est admirable et d'un vert qu'aucun pinceau ne saurait imiter.
Je suis bien content de vous trouver si gaie; pour moi, je ne puis vous en dire autant. Il me semble que j'ai la fièvre tous les soirs et je suis d'une humeur horrible. La cathédrale, que j'aimais fort autrefois, m'a semblé laide, et c'est à peine si les vierges sages et les folles de Sabine, de Steinbach, ont trouvé grâce devant moi. Vous avez bien raison d'aimer Paris. C'est, après tout, la seule ville où l'on puisse vivre. Où trouveriez-vous ailleurs ces promenades, ces musées où nous avions tant de choses à nous dire et tant de tendresses aussi? Je voudrais croire à ce que vous me promettez, c'est-à-dire que nous reprendrons notre causerie interrompue, comme si nous n'avions pas été séparés. Je suis sûr de ce qui m'attend. Une épaisse glace se sera formée. Vous ne me reconnaîtrez même pas. Dussé-je vous quereller encore, cela vaut mieux que de ne pas vous voir.
Adieu.
Paris, samedi 3 août 1844.
Je suppose que vous êtes partie pour la campagne en prenant contre vos promesses un french leave. C'est fort aimable à vous. J'ai eu la naïveté d'attendre quelque signifiance de vous tous les jours. On se corrige difficilement. Dans le cas, très-peu probable, où vous seriez à Paris, et dans celui, encore plus improbable, où vous seriez curieuse d'assister à une séance de l'Académie des inscriptions, j'ai deux billets à vos ordres. Cela est fort ennuyeux. En attendant, j'ai travaillé de mon mieux à ma difficile besogne, qui sera bientôt terminée. Puis je partirai pour un mois ou deux. Si cela pouvait vous donner des remords ou, ce que j'aimerais bien mieux, l'envie de me voir, vous me feriez vite oublier ma mauvaise humeur.
Paris, 19 août 1844.
. . . . . . .
Il est tout à fait décidé que je partirai pour l'Algérie du 8 au 10 du mois prochain. Je resterai ou plutôt je courrai ça et là, jusqu'à ce que la fièvre ou les pluies viennent m'interrompre. De toute façon, je ne vous reverrai qu'en janvier. Vous auriez dû songer à cela avant de partir. Quand je dis que vous ne me reverrez que l'année prochaine, cela dépend de vous. Pendant que vous apprenez le grec, j'étudie l'arabe. Mais cela me semble une langue diabolique, et jamais je ne pourrai en savoir deux mots. À propos de Syra, cette chaîne que vous aimez est allée en Grèce et dans bien d'autres lieux. Je l'ai choisie parce qu'elle est d'un ancien travail antivulgaire. J'ai supposé qu'elle vous plairait. Vous rappelle-t-elle nos promenades et nos causeries sans fin? Je suis allé dimanche dîner chez le général Narvaez, qui donnait son raout et pour la fête de sa femme. Il n'y avait guère que des Espagnoles. On m'en a montré une qui a voulu se laisser mourir de faim par amour, et qui s'éteint tout doucement. Ce genre de mort doit vous sembler bien cruel. Il y en avait une autre, mademoiselle de ***, que le général Serrano a plantée là pour Sa grosse Majesté Catholique; mais elle n'en est pas morte, et a même l'air de se porter très-bien. Il y avait encore madame Gonzalez Bravo, sœur de l'acteur Romea et belle-sœur de la même Majesté, qui, à ce qu'on dit, se fait un grand nombre de belles-sœurs. Celle-ci est très-jolie et très-spirituelle. Adieu. . . . . .
Paris, lundi, septembre 1844
Nous nous sommes séparés l'autre jour également mécontents l'un de l'autre. Nous avions tort tous les deux, car c'est la force des choses qu'il fallait seulement accuser. Le mieux eût été de ne pas nous revoir de longtemps. Il est évident que nous ne pouvons plus maintenant nous trouver ensemble sans nous quereller horriblement. Tous les deux, nous voulons l'impossible: vous, que je sois une statue; moi, que vous n'en soyez pas une. Chaque nouvelle preuve de cette impossibilité, dont au fond nous n'avons jamais douté, est cruelle pour l'un et pour l'autre. Pour ma part, je regrette toute la peine que j'ai pu vous donner. Je cède trop souvent à des mouvements de colère absurde. Autant vaudrait-il se fâcher de ce que la glace est froide.
J'espère que vous me pardonnerez maintenant; il ne me reste nulle colère, seulement une grande tristesse. Elle serait moindre si nous ne nous étions pas quittés de la sorte. Adieu, puisque nous ne pouvons être amis qu'à distance. Vieux l'un et l'autre, nous nous retrouverons peut-être avec plaisir. En attendant, dans le malheur ou dans le bonheur, souvenez-vous de moi. Je vous ai demandé cela il y a je ne sais combien d'années. Nous ne pensions guère alors à nous quereller.
Adieu encore, pendant que j'ai du courage.
Paris, jeudi, 6 septembre 1844.
Il me semble que je vous ai vue en rêve. Nous sommes demeurés si peu de temps ensemble, que je ne vous ai rien dit de ce que je voulais vous dire. Vous-même, vous aviez l'air de ne pas trop savoir si j'étais une réalité. Quand nous verrons-nous? Je fais en ce moment le métier le plus bas et le plus ennuyeux: je sollicite pour l'Académie des inscriptions. Il m'arrive les scènes les plus ridicules, et souvent il me prend des envies de rire de moi-même, que je comprime pour ne pas choquer la gravité des académiciens que je vais voir. C'est un peu à l'aveugle que je me suis embarqué, ou plutôt qu'on m'a embarqué dans cette affaire. Mes chances ne sont point mauvaises, mais le métier est des plus rudes, et le pire de tout, c'est que le dénoûment se fera longtemps attendre: vraisemblablement jusqu'à la fin d'octobre, et peut-être plus. Je ne sais si je pourrai aller en Algérie cette année. La seule réflexion qui me console, c'est que je resterai ici et que, par conséquent, je vous verrai. Cela vous fera-t-il plaisir? Dites-moi que oui et gâtez-moi bien. Je suis tellement abruti par ces ennuyeuses visites, que j'ai besoin de toutes vos câlineries, et des plus tendres, pour me donner un peu de courage et de vie.
Vous avez tort d'être jalouse des inscriptions. J'y mets quelque amour-propre, comme à une partie d'échecs engagée avec un adversaire habile; mais je ne crois pas que la perte ou le gain m'affecte le quart autant qu'une de nos querelles. Mais quel vilain métier que celui de solliciteur! Avez-vous jamais vu des chiens entrer dans le terrier d'un blaireau? Quand ils ont quelque expérience, ils font une mine effroyable en y entrant, et souvent ils en sortent plus vite qu'ils n'y sont entrés, car c'est une vilaine bête à visiter que le blaireau. Je pense toujours au blaireau en tenant le cordon de la sonnette d'un académicien, et je me vois in the mind's eye tout à fait semblable au chien que je vous disais. Je n'ai pas encore été mordu cependant. Mais j'ai fait de drôles de rencontres.
Adieu.
Paris, 14 septembre 1844.
Tout était prêt et nous allions partir aujourd'hui, quand est venue une bourrasque qui a jeté nos projets au vent. Il y a conflit entre la guerre et l'intérieur. La guerre ne veut point de nous. Nous restons, ou, pour mieux dire, je ne vais pas en Afrique. Je vais passer une quinzaine de jours en courses et je reviendrai à Paris. À part la vexation qui accompagne tout projet avorté, et le regret très-vif d'avoir employé deux mois à apprendre un tas de choses inutiles, j'ai pris mon parti avec la plus grande impassibilité. Peut-être devinerez-vous pourquoi.
J'ai trouvé dans votre dernière lettre quelques phrases malsonnantes pour lesquelles je pourrais bien vous faire la guerre, si je ne trouvais, comme vous, qu'il est inutile et, qui plus est, dangereux et triste de se disputer à distance.—Je ne me représente pas trop comment vous passez les vingt-quatre heures de la journée. Je trouve bien l'emploi de seize, mais il y en a dix sur lesquelles je voudrais des détails. Lisez-vous toujours Hérodote? Mais quel dommage que vous n'essayiez pas un peu de l'original avec la traduction de Lanher, que vous avez, je pense! vous n'aurez guère d'autre difficulté que l'excès des ή ioniens. Si vous avez à votre disposition l'Anabase de Xénophon, vous pourrez y prendre plaisir, surtout si vous avez une carte d'Asie sous les yeux. Je ne me rappelle guère les dialogues marins. Lisez plutôt Jupiter confondu, ou bien Jupiter tragique, ou bien le Festin ou les Lapithes, à moins que vous ne m'en gardiez l'étrenne.
Je suis sûr que vous êtes florissante, toute robes et fleurs, et j'ose vous conseiller des lectures grecques! Adieu; écrivez-moi vite et ne vous moquez pas de moi. Je partirai lundi pour aller je ne sais où, mais pas trop loin, selon tous mes calculs.
Poitiers, 15 septembre 1844.
Si je réponds tard à votre lettre du mois dernier, que je trouve ici, ce n'est pas, comme votre mauvaise conscience vous le dirait, par représailles pour la lenteur que vous avez mise à me donner de vos nouvelles. Vous avez passé dix jours entiers sans que l'idée de m'écrire une ligne vous vînt entête, et c'est bien mal. Vous me parlez de vos contemplations à D... Je crois que vous vous y êtes fort amusée, et je ne puis m'empêcher de croire que vous ne vous amusez que quand vous trouvez occasion de faire des coquetteries. Pour moi, j'ai mené une vie maussade au dernier point depuis mon départ de Paris. Comme Ulysse, j'ai vu beaucoup de mœurs, d'hommes et de villes. J'ai trouvé les unes et les autres très-laides. Puis j'ai eu quelques accès de fièvre, qui m'ont étonné et chagriné en me montrant comme je décline. J'ai trouvé le pays le plus plat et le plus insignifiant de la France; mais il y a beaucoup de bois et de grands arbres et des solitudes où j'aurais bien aimé à vous rencontrer. Votre souvenir se représente à moi maintenant dans une foule de lieux, mais je le lie surtout aux bois et aux musées. Si vous avez quelque plaisir à occuper une place dans ma mémoire, et une grande place, vous devez penser qu'avec la vie que je mène, je ne vous oublie pas. Tel arbre me rappelle telle conversation. Je passe mon temps à méditer sur nos promenades. J'admire beaucoup Scribe d'avoir fait rire un public vertueux et néo-catholique avec les prix de vertu. Je suis également surpris de ce que vous me dites de son débit. Autrefois, il lisait comme un fiacre. Il faut croire que c'est l'habit académique qui donne cet aplomb, et cela me rend un peu d'espoir.
Depuis mon départ, je n'ai pas déballé deux fois mon discours, et, si cela continue, je ne crois pas, en vérité, que j'y puisse changer une ligne. Je m'attends qu'au dernier moment je serai épouvanté de la quantité de sottises que j'aurai laissées. Tant que je n'aurai pas tourné mon timon vers Paris, je ne saurai pas l'époque de mon retour avec quelque certitude. Si mon gouvernement ne me force pas à aller plus loin que Saintes, je crois que nous arriverons à peu près en même temps. Quel bonheur si nous pouvions nous voir dès le lendemain! Adieu; écrivez-moi à Saintes, je pense y être bientôt et m'y arrêter quelques jours.
Parthenay, 17 septembre 1844.
Votre lettre, que j'ai reçue à Saintes, a fait un peu diversion aux tribulations que j'y éprouvais. J'étais fort empêché à plonger dans le désespoir quatre mille de mes concitoyens qui m'envoyaient des députations et me faisaient des discours fabuleux.
Entre mon devoir et ma sensibilité naturelle, j'étais fort malheureux. Enfin, j'ai pris le parti le plus sage, et j'ai tranché du proconsul. D'ici à un an, je n'oserais pas repasser à Saintes. Je vois avec plaisir que vous vous souvenez de Paris à D... J'avais craint que vous n'eussiez oublié nos bois et nos gazons émaillés. Pour moi, j'y pense toujours plus vivement, surtout à présent que je viens de faire un pas vers Paris. Suivant toute apparence, je vous y précéderai. J'y serai dans dix jours au plus tard, à moins d'accidents que je ne puis prévoir. Et vous? voilà le plus important. Être à Paris sans vous me semblera bien plus dur que de courir les champs comme je fais à présent. J'ai une soif de vous voir que vous ne pouvez comprendre. Pourrez-vous, voudrez-vous revenir pour dire adieu à vos domaines de la rive gauche? je cherche à n'y pas penser, mais je n'y puis réussir. Pour me préparer aux déceptions comme Scapin quand il revenait de voyage, je cherche à me représenter Your Ladyship, statue cuirassée aussi méchante quelle m'est apparue quelquefois. J'ai beau faire, je vous vois toujours telle que vous avez été la dernière fois que nous nous assîmes si commodément sur un quartier de roc. Vraiment, je le crois un peu, d'abord parce que vous me l'avez promis, et puis je ne me persuaderai jamais que nous ayons pu changer tous les deux après avoir été aussi unis de pensée. Si vous songez à revenir, écrivez-moi à Blois, j'y serai bientôt, ou bien après le 25 à Paris, et dites-moi quand je pourrai vous voir et le plus tôt possible. Je vous écris d'une horrible ville de chouans et d'une auberge abominable, où l'on fait un bruit infernal. On met tant de cheveux dans tout ce qu'on me donne à dîner, que je mange à peine. J'ai trouvé aujourd'hui à Saint-Maixent des femmes avec la coiffure du XIVe siècle, et des corsages presque du même temps qui laissent voir la chemise, laquelle est en toile à torchon, boutonnée sous le cou et fendue comme celle des hommes. Malgré le pain d'épice qui est dessous, cela me semble très-joli. Je me suis presque foulé la main aujourd'hui et je n'ai plus la force d'écrire.
Adieu.
Perpignan, 14 novembre.
. . . . . . .
Vous aviez été si longtemps sans m'écrire, que je commençais à être inquiet. Et puis j'étais tourmenté d'une idée saugrenue que je n'ai pas osé vous dire. Je visitais les arènes de Nîmes avec l'architecte du département, qui m'expliquait longuement les réparations qu'il avait fait faire, lorsque je vis, à dix pas de moi, un oiseau charmant, un peu plus gros qu'une mésange, le corps gris de lin, avec les ailes rouges, noires et blanches. Cet oiseau était perché sur une corniche et me regardait fixement. J'interrompis l'architecte pour lui demander le nom de cet oiseau. C'est un grand chasseur, et il me dit qu'il n'en avait jamais vu de semblable. Je m'approchai, et l'oiseau ne s'envola que lorsque j'étais assez près de lui pour le toucher. Il alla se poser à quelques pas de là, me regardant toujours. Partout où j'allais, il semblait me suivre, car je l'ai retrouvé à tous les étages de l'amphithéâtre. Il n'avait pas de compagnon et son vol était sans bruit, comme celui d'un oiseau nocturne.
Le lendemain, je retournai aux arènes et je revis encore mon oiseau. J'avais apporté du pain, que je lui jetai. Il le regarda, mais n'y toucha pas. Je lui jetai ensuite une grosse sauterelle, croyant à la forme de son bec qu'il mangeait des insectes, mais il ne parut pas en faire cas. Le plus savant ornithologiste de la ville me dit qu'il n'existait pas dans le pays d'oiseau de cette espèce.
Enfin, à la dernière visite que j'ai faite aux arènes, j'ai rencontré mon oiseau toujours attaché à mes pas, au point qu'il est entré avec moi dans un corridor étroit et sombre où lui, oiseau de jour, n'aurait jamais dû se hasarder.
Je me souvins alors que la duchesse de Buckingham avait vu son mari sous la forme d'un oiseau le jour de son assassinat, et l'idée me vint que vous étiez peut-être morte et que vous aviez pris cette forme pour me voir. Malgré moi, cette bêtise me tourmentait, et je vous assure que j'ai été enchanté de voir que votre lettre portait la date du jour où j'ai vu pour la première fois mon oiseau merveilleux.
Je suis arrivé ici avec un temps affreux. Une pluie comme on n'en voit jamais dans le Nord a inondé toute la campagne, coupé les routes, changé tous les ruisseaux en grosses rivières. 11 m'est impossible de sortir de la ville pour aller à Serrabonne, où j'ai affaire. Je ne sais combien de temps cela durera.
Il y a une foire à Perpignan, et de plus les Espagnols qui fuient l'épidémie encombrent la ville, si bien que je n'ai pu trouver à me loger dans une auberge. Si je n'étais parvenu à émouvoir la commisération d'un chapelier, j'aurais été réduit à coucher dans la rue. Je vous écris dans une petite chambre bien froide, à côté d'une cheminée qui fume, maudissant la pluie qui bat mes vitres. La servante qui me sert ne parle que catalan et ne me comprend que lorsque je lui parle espagnol. Je n'ai pas un livre et je ne connais personne ici. Enfin, le pire de tout, c'est que, si le vent du nord ne s'élève pas, je resterai ici je ne sais combien de jours, sans même la ressource de retourner à Narbonne, car le pont qui pouvait assurer ma retraite ne tient plus à rien, et, si l'eau grossit, il sera emporté. Admirable situation pour faire des réflexions et pour écrire ses pensées. Mais des pensées, je n'en ai guère maintenant. Je ne sais que m'impatienter. J'ai à peine la force de vous écrire. Vous ne me parlez pas d'une lettre que je vous ai écrite d'Arles. Peut-être s'est-elle croisée avec la vôtre?
J'ai été à la fontaine de Vaucluse, où j'ai eu quelque envie d'écrire votre nom; mais il y avait tant de mauvais vers, de Sophies,de Carolines, etc., que je n'ai pas voulu profaner votre nom en le mettant en si mauvaise compagnie. C'est l'endroit le plus sauvage du monde. Il n'y a que de l'eau et des rochers. Toute la végétation se réduit à un figuier qui a poussé je ne sais comment au milieu des pierres, et à des capillaires très-élégantes dont je vous envoie un échantillon. Lorsque vous avez bu du sirop de capillaire pour un rhume, vous ne saviez peut-être pas que cette plante avait une forme aussi jolie.
Je serai à Paris vers le 15 du mois prochain. Je ne sais pas du tout quelle route je prendrai. Il est possible que je revienne par Bordeaux. Mais, si le temps ne s'améliore pas, je reviendrai par Toulouse. Je serai alors à Paris quinze jours plus tôt. J'espère trouver une lettre de vous à Toulouse. S'il n'y en avait pas, je vous en voudrais mortellement.
Adieu.
Paris, 5 décembre 1844.
J'avais juré de ne pas vous écrire, mais je ne sais pas si j'aurais pu tenir mon serment encore longtemps. Pourtant, je ne pensais pas que vous fussiez souffrante. Notre promenade avait été si heureuse! Je ne croyais pas possible que vous pussiez en garder un mauvais souvenir. Il paraît que ce qui vous irrite, c'est que je suis plus entêté que vous. Voilà une belle raison et dont vous devez bien vous faire gloire. Ne devriez-vous pas plutôt avoir honte de m'avoir rendu tel! Et puis vous dites que je suis dur, et vous me demandez si je m'en aperçois. Franchement, non. Pourquoi ne m'avertissez-vous pas? Si je l'ai été, je vous en demande pardon. Il me semble qu'en nous en allant, vous n'aviez pas un seul grain de colère contre moi. Je vous croyais aussi confiante, aussi intime que je l'étais pour vous. Vous dirai-je que c'est le souvenir le plus doux que j'ai conservé de notre promenade? Quand je vous vois ainsi, vous me rendez bien heureux. Si vous aviez alors de la colère, cela fait honneur à votre dissimulation. Mais j'aime mieux croire aux secondes pensées que de croire que vous n'étiez pas sincère alors. Dites-moi si je me trompe.
J'ai commencé ce soir le dessin que vous commandez. C'est difficile à faire. Je voudrais vos instructions. Vous tenez donc à ce champ de chardons? Vous dites qu'il vous paraît l'un des plus beaux lieux du monde. Je vous apporterai mon esquisse et aussi votre portrait. Je vous ai donné vos yeux mauvais. Ne croyez pas que telle est leur expression ordinaire. J'en connais une meilleure, d'autant plus précieuse qu'elle est plus rare. Vous verrez tout cela et vous donnerez vos ordres. Vous voudrez bien, pour le payement, vous rappeler que je ne suis pas un peintre ordinaire, ce n'est pas l'œuvre que vous devrez payer, c'est la peine et le temps. Enfin, il est toujours bien de se montrer généreux avec les artistes.
Pendant que vous vous guérissiez de votre colère, j'en avais presque contre vous. Je m'étais figuré que vous m'écririez plus tôt. C'est en partie pour avoir attendu votre lettre, en partie par mauvais sentiment d'orgueil, que je ne vous ai pas prévenue. Vous voyez que je m'accuse aussi de mes méfaits. Pardonnez-moi celui-là. Au moins ce n'était pas le passé qui me rendait injuste.
Depuis que je vous ai vue, j'ai été presque toujours très-souffrant; je croyais que c'était la leçon d'espagnol sur «la large terre», comme dit Homère. Votre lettre m'a remis. Je crois maintenant que c'est la mine que vous aviez en nous quittant qui en était cause. Vous n'avez pas daigné tourner la tête pour me dire adieu.—Nous aurons bien des pardons à nous demander tous les deux pour toutes nos mauvaises pensées!
Il est une heure indue, mon feu est éteint et je grelotte. Je vous dis encore adieu et vous remercie de cœur de m'avoir écrit. Il y a huit jours que j'attends cette lettre. N'êtes-vous pas entêtée aussi!
Paris, jeudi 7 février 1845.
Tout s'est passé mieux que je ne l'espérais[1]. Je me suis trouvé un aplomb rare. Je ne sais si le public a été content de moi, je le suis de lui.
[1] Sa réception à l'Académie française.
Vendredi, 8 février 1845.
Puisque vous ne m'avez pas trouvé trop ridicule, tout est bien. Je n'aurais pas été content de vous savoir là, voyant mon habit couleur d'estragon et ma figure idem.—Pourquoi pas demain? autrement, il faudrait attendre à mercredi prochain, et je n'en aurais pas le courage. Nous en aurons long à nous raconter. J'aurais perdu tout mon aplomb si je vous avais sue là.
Toulouse, 18 août 1845.
Je viens de trouver ici votre lettre; c'est fort heureux, car j'étais furieux de n'avoir pas eu de vos nouvelles à Poitiers comme je m'y attendais. Vous me direz que j'avais tort de m'attendre à ce que vous penseriez à moi plus tôt que vous n'avez fait. Que voulez-vous! je ne puis m'habituer à vos façons. Vous n'êtes jamais plus près de m'oublier que lorsque vous m'avez persuadé que vous pensiez à moi. Heureusement qu'entre tous ces oublis il y a des souvenirs, et j'y pense sans cesse. Je ne vois pas de ces belles grottes dont vous me parlez et je n'en ai pas besoin pour que bien des idées tristes et gaies me viennent par la tête. Je ne suis pas difficile en matière de paysage, comme vous le savez. Je n'y fais pas attention quand je me promène avec vous. Je voudrais bien vous gâter comme vous me le demandez. Mais je suis de trop mauvaise humeur. Je viens de passer quinze jours sans décolérer, d'abord contre le temps, puis contre les architectes, puis contre vous et contre moi-même. Le temps, qui avait été des plus affreux ces jours passés, s'est remis subitement au beau hier, mais avec une chaleur accablante, accompagnée d'un vent de sirocco qui m'ôte toutes mes forces. J'ai passé vingt-quatre heures chez un député, et, si j'avais l'ambition d'être un homme politique, cette visite-là m'aurait complètement fait changer d'avis. Quel métier! quels gens il faut voir, ménager, flatter! Je dirai comme Hotspur: I had rather be a kitten and cry mew. Esclavage pour esclavage, j'aime mieux la cour d'un despote; au moins, la plupart des despotes se lavent les mains. Je suis fâché d'apprendre que vous partiez si tard pour D...; c'est-à-dire je crains que vous n'en reveniez bien tard. Ce qui me fait prendre patience dans mon métier, c'est de penser que, lorsque je serai de retour, je vous retrouverai en face de ces lions de l'Institut, et qu'après m'avoir fait grise mine pendant un quart d'heure, vous me ferez oublier tous mes ennuis. Combien de temps passerez-vous à D...? Voilà ce que je me demande à présent; très-probablement, vous irez en Angleterre, et lady M... vous exposera encore ses belles théories about the baseness of being in love. Je voudrais bien que vous fussiez la première figure amie qui se présentât à moi aussitôt après mon retour. Malheureusement, cela ne sera pas et vous attendrez qu'il n'y ait plus une feuille aux arbres pour revenir à Paris. Dieu sait si vous n'y reviendrez point Anglaise aux trois quarts? Dites-moi bien que cela ne sera pas, que vous tâcherez de ne pas rester trop longtemps, et que vous ne serez pas pire que vous n'êtes. C'est déjà bien assez comme cela. Écrivez-moi à Montpellier, d'où je vous rapporterai un sachet, puis à Avignon. Je calcule mes heures de façon à être de retour le 20 septembre. Ce sera difficile, mais j'espère bien y parvenir.
Adieu; votre lettre finit bien, mais pourquoi ne me parlez-vous pas comme vous écrivez quelquefois?
Avignon, 5 septembre 1845.
Je remercie ces gens malades qui vous retiennent à Paris. Je vous remercie encore plus vous-même, si vous pensez moins à leurs rhumatismes qu'au plaisir que vous me ferez en restant. Suivant toute apparence, je serai de retour dans une quinzaine de jours, ou plutôt je ferai une halte dans mes foyers, entre mon voyage du Midi et celui du Nord; le second sera, j'espère, des plus courts et vous ne vous en apercevrez sans doute pas. Je me réjouis de vous savoir en si bonne santé. Pour moi, je n'en puis dire autant. Je suis souffrant depuis mon départ; j'avais compté sur le beau temps et sur le soleil du Languedoc pour me remettre; mais il est demeuré sans effet. Aujourd'hui, je reviens accablé de fatigue d'une très-longue course, où j'ai fait plus de mauvais sang que je n'en fais ordinairement quand vous ne vous en mêlez pas. Je suis tout étourdi et je vois presque double; pendant que vous mangez des pêches fondantes, j'en mange de jaunes très-acides et d'un goût singulier qui n'est pas trop déplaisant et que je voudrais vous faire connaître. Je mange des figues de toutes couleurs; mais je n'ai nul appétit à tout cela. Je m'ennuie horriblement le soir, et je commence à regretter la société des bipèdes de mon espèce. Je ne compte point les provinciaux pour quoi que ce soit. Ce sont des choses à mes yeux souvent fatigantes, mais tout à fait étrangères au cercle de mes idées. Ces Méridionaux sont d'étranges gens: tantôt je leur trouve de l'esprit, tantôt il me semble qu'ils n'ont que de la vivacité. Ce voyage me les fait voir un peu plus en laid qu'à l'ordinaire. Mon seul plaisir, dans le pays assez beau que je parcours, serait de rêvasser à mon aise, et je n'en ai pas le temps. Vous devinez à quoi j'aimerais rêver, et avec qui? Je voudrais vous raconter quelques histoires dignes d'être envoyées à deux cents lieues: malheureusement, je n'en apprends pas qui se puissent raconter. J'ai vu l'autre jour les ravages d'un torrent qui a noyé cent vingt chèvres, rasé des maisons, et vous avez eu mieux que cela à Paris; mais ce que vous n'y trouverez jamais, c'est une vue comme celle qu'on rencontre à chaque pas quand on parcourt le Comtat. Venez-y, ou plutôt atlendez-moi à Paris et promenons-nous dans nos bois, que je trouverai alors admirables. Écrivez-moi à Vézelay (Yonne).
Barcelone, 10 novembre 1845.
Me voici arrivé au terme de mon long voyage sans rencontrer de trabucayres ni de rivières débordées, ce qui est encore plus rare. J'ai été admirablement reçu par mon archiviste, qui avait déjà préparé ma table et mes bouquins, où je vais assurément perdre le peu d'yeux qui me restent. Il faut, pour arriver à son despacho; traverser une salle gothique du XIVe siècle et une cour de marbre plantée d'orangers hauts comme nos tilleuls, et couverts de fruits mûrs. Cela est fort poétique, comme, aussi mon appartement, qui me rappelle les caravansérails de l'Asie pour le luxe et les conforts. On est cependant mieux ici qu'en Andalousie, mais les natifs sont inférieurs en tout aux Andalous. Ils ont de plus un défaut majeur à mes yeux ou plutôt à mes oreilles: c'est que je n'entends rien à leur baragouin. J'ai trouvé à Perpignan deux bohémiens superbes qui tondaient des mules. Je leur ai parlé caló, à la grande horreur d'un colonel d'artillerie qui m'accompagnait, et il s'est trouvé que j'étais bien plus fort qu'eux et qu'ils ont rendu à ma science un éclatant témoignage dont je n'ai pas été peu fier. Le résumé de mes impressions de voyage, c'est que ce n'était pas la peine d'aller si loin et que j'aurais peut-être achevé mon histoire aussi bien sans aller secouer la vénérable poussière des archives d'Aragon. C'est un trait d'honnêteté de ma part dont mon biographe, j'espère, me tiendra compte. En route, quand je ne dormais pas, c'est-à-dire pendant presque toute la route, j'ai fait mille châteaux en Espagne auxquels il manque votre approbation. Répondez-moi sur-le-champ et mettez l'adresse en très-gros et lisibles caractères.
Madrid, 18 novembre 1845.
Me voici installé ici depuis une semaine et plus, avec un grand froid, quelquefois de la pluie, un temps tout semblable à celui de Paris. Seulement, je vois tous les jours des montagnes dont la cime est couverte de neige, et je vis familièrement avec de très-beaux Velasquez. Grâce à la lenteur ineffable des gens de ce pays-ci, je n'ai commencé que d'aujourd'hui seulement à mettre le nez dans les manuscrits que j'étais venu consulter. Il a fallu une délibération académique pour me permettre de les examiner, et je ne sais combien d'intrigues pour obtenir des renseignements sur leur existence. D'ailleurs, cela me semble peu de chose et ne valait pas la peine de faire un si long voyage. Je pense que j'aurai fini mes perquisitions assez promptement, c'est-à-dire avant la fin du mois.
J'ai trouvé ce pays-ci fort changé depuis ma dernière visite. Les gens que j'avais laissés amis sont ennemis mortels. Plusieurs de mes anciennes connaissances sont devenues de grands seigneurs, et très-insolents. Somme toute, je me plais moins à Madrid en 1845 qu'en 1840. Ici, l'on pense tout haut et l'on ne se gêne guère pour personne. On a une franchise qui nous surprend fort, nous autres Français, et qui m'étonne d'autant plus que vous m'avez habitué à tout autre chose. Vous devriez aller faire un tour de l'autre côté des Pyrénées pour prendre une leçon de véracité. Vous ne sauriez vous faire une idée des figures qu'on a quand l'objet aimé n'arrive pas à l'heure où on l'attend, ni du bruit des soupirs qu'on laissé échapper librement; on est tellement habitué à des scènes semblables, qu'il n'y a pas de scandale ni de cancans. Chacun et chacune savent qu'ils seront de même dimanche. Est-ce bien? est-ce mal? je me demande cela tous les jours sans conclure. Je vois les amants heureux et je trouve qu'ils abusent de l'intimité et de la confiance. L'un raconte ce qu'il a mangé à son dîner, l'autre donne des détails peu ragoûtants sur un rhume qui le tient. Le plus romanesque des amants n'a pas la moindre idée de ce que nous nommons galanterie. Les amants ne sont, à vrai dire, ici que des maris non autorisés par l'Église. Ils sont les souffre-douleur des maris véritables, font les commissions et gardent madame quand elle prend médecine. Il fait si froid, que je n'irai pas à Tolède comme je me l'étais proposé. Il n'y a pas de taureaux par la même raison. En revanche, on annonce force bals qui m'ennuient fort. J'irai après-demain chez Narvaez, ou je verrai probablement Sa Majesté Catholique. Vous pouvez m'écrire ici, si vous me répondez courrier par courrier; sinon, à Bayonne, poste restante. Je pense quand je m'ennuie, c'est-à-dire tous les jours, que vous viendrez peut-être me voir à mon débarquement, et cette idée me ranime. Malgré votre infernale coquetterie et votre aversion pour la vérité, je vous aime mieux que toutes ces personnes si franches. N'abusez pas de cet aveu.
Adieu.
Paris, lundi 19 janvier 1846.
Je suis bien fâché que vous n'ayez pas plus de courage. Il ne faut jamais attendre les douleurs en matière de dents, et c'est parce qu'on n'ose pas aller chez le dentiste qu'on se prépare des souffrances abominables. Allez donc chez Brewster ou chez tout autre plus tôt que plus tard. Si vous le désirez, j'irai avec vous et je vous tiendrai, s'il le faut. Croyez, du reste, que c'est l'homme le plus habile en son genre et qui est, en outre, conservateur par système.—Vous êtes bien bonne de vous reprocher le récit pathétique que vous m'avez fait. Vous auriez dû, au contraire, vous réjouir de m'avoir fait faire une bonne action. Il n'y a rien que je méprise et même que je déteste autant que l'humanité en général; mais je voudrais être assez riche pour écarter de moi toutes les souffrances des individus. Vous ne me dites pas ce qui m'intéresserait le plus, c'est-à-dire quand je pourrai vous voir. Cela me prouve que vous n'en avez nulle envie. Voulez-vous faire une promenade mercredi? Si vous étiez prise parles dents, ne venez pas. Si vous aviez toute autre maladie je n'admettrais pas d'excuse, parce que je n'y croirais pas.
Paris, 10 juin 1846.
En ouvrant le paquet de livres, j'ai eu la bêtise de croire que je trouverais un mot de vous, et que le beau soleil vous aurait inspirée. Pas une ligne! Je me suis mis à relire votre lettre de ce matin, que j'ai trouvée un peu bien sèche à la seconde lecture. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je remarque l'espèce de bascule très-impartiale de votre correspondance et, en général, de toute votre conduite à mon égard. Vous n'êtes jamais plus près de me faire quelque méchanceté que lorsque vous venez d'être bonne et gracieuse pour moi. Vous m'aviez promis de me donner un jour bientôt. Mais, si j'attendais l'exécution de vos promesses, la patience que le ciel m'a départie ne suffirait pas. L'autre jour, vous étiez aussi insouciante en me disant adieu qu'en me disant bonjour. Ce n'était pas cela l'avant-dernière fois. C'est un phénomène très-curieux que l'eau qui a bouilli se gèle plus facilement que l'eau froide. Vous illustrez cette chimie-là. En me quittant, vous aviez votre air de bouderie; aussi je m'attends que vous serez charmante mercredi. Il faudra revoir nos jolies promenades sablées pour nous. Vous me ferez grand plaisir en acceptant. Mais c'est ce qui ne vous touche que médiocrement. Si vous avez quelque curiosité, elle sera récompensée par un monument d'auld lang syne que je vous montrerai. Et puis je vous donnerai quelque chose. Du moins, j'ai eu envie de vous donner quelque chose, mais vous avez été si mal pour moi, d'abord en m'écrivant votre lettre de ce matin, puis en n'écrivant rien avec les livres, que je ne sais trop si je vous offrirai ce présent projeté. Pourtant, si vous le demandez, il est probable que je céderai.
Je suis devenu, comme vous savez, grand observateur du temps. Le vent est magnifique au nord-est. Cela nous promet quelques beaux jours. Je voudrais que vous fissiez autant que moi attention au soleil et à la pluie.
Dijon, 29 juillet 1846.
J'espérais trouver ici une lettre de vous, mais je suppose que vous vous amusez trop pour penser à m'écrire. Je n'ai rien trouvé à Bar non plus, ce qui m'étonne et m'indigne fort. Est-ce la faute de la poste ou la vôtre? J'avais toujours cru la poste infaillible. Que faites-vous, où êtes-vous en ce moment? Je ne sais en vérité où vous adresser cette lettre, et je vous l'envoie à tout hasard à Paris. Écrivez-moi donc à Privas et puis à Clermont-Ferrand. J'ai beaucoup vu de mœurs, d'hommes et de villes depuis vous avoir quittée il y a quinze jours, et, comme Ulysse, j'ai eu toute sorte de contrariétés dans mes pérégrinations. Chaque année, je trouve la province plus sotte et plus insupportable. Cette fois-ci, j'ai le spleen et je vois tout en noir, peut-être parce que vous m'avez oublié si indignement. Je n'ai eu de bons moments qu'en traversant toute sorte de bois très-épais dans les Ardennes, qui me faisaient penser à d'autres bois bien plus agréables. Je crains que vous n'y pensiez guère. Pour m'achever, j'ai trouvé ici d'horribles bêtises qu'on a faites avec notre argent. Ce sont des pères de famille vertueux et niais qui les ont faites, et contre lesquels je dois lancer les rapports les plus fulminants, tendant à les faire crever de faim. Ce métier de férocité m'afllige. J'aurais besoin d'être adouci par une lettre de vous. J'en reviens toujours à mes moutons. Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? Je vais être je ne sais combien de temps sans nouvelles, car je n'ai pas d'itinéraire assez arrêté pour vous indiquer mes étapes. En somme, je ne trouve que des raisons d'être furieux. Il est vraisemblable que vous vous trouvez bien où vous êtes, et je m'attends à ne vous revoir que cet hiver, quand l'Opéra vous rappellera à Paris.
Adieu; quand vous penserez à moi, vous verrez si je sais être magnanime. Ne m'écrivez pas à Privas, mais à Clermont-Ferrand. Je viens de m'apercevoir que je n'avais que faire à Privas. Après Clermont, j'irai probablement à Lyon, mais vous aurez de mes nouvelles auparavant.
10 août 1846.
À bord d'un bateau à vapeur
dont je ne sais le nom.
Je suis allé dans les montagnes de l'Ardèche chercher un lieu écarté où il n'y eût ni électeurs ni candidats. J'y ai trouvé une si grande quantité de puces et de mouches, que je ne sais pas si les élections ne valaient pas mieux. Avant de quitter Lyon, j'avais reçu une lettre de vous qui m'avait fait beaucoup de plaisir, car j'étais vraiment un peu inquiet. J'ai beau avoir l'habitude de votre négligence à mon endroit, je ne puis m'empêcher, quand je suis sans nouvelles de vous, de penser qu'il vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il y aurait de vraiment extraordinaire, c'est que vous daignassiez penser à moi aussi souvent que je pense à vous. J'apprends avec beaucoup de peine que vous êtes partie pour D... plus tard que vous ne l'aviez prévu, et que par conséquent vous reviendrez plus tard. Je ne doute pas que vous ne vous amusiez fort à D...; mais, si, au milieu des gâteries que vous aimez tant, il vous prenait quelque souvenir de nos promenades, vous feriez une œuvre méritoire en hâtant votre retour. J'ai eu hier un grand succès dans ma veillée avec des paysans et des paysannes à qui j'ai fait dresser les cheveux sur la tête, en leur racontant des histoires de revenants. Il y avait une lune magnifique qui éclairait parfaitement les traits réguliers et montrait les beaux yeux noirs de ces demoiselles, sans laisser apercevoir leurs bas sales et la crasse de leurs mains. Je suis allé me coucher très-fier de mon succès auprès d'un auditoire tout nouveau pour moi. Le lendemain, quand j'ai vu au soleil mes Ardéchoises, con villanos manos y pies, j'ai presque regretté mon éloquence. Ce diable de bateau fait sauter ma plume de çà et de là, de la façon la plus ridicule! Il faut une éducation particulière pour pouvoir écrire sur une table qui danse perpétuellement. Je n'en peux plus de sommeil et de fatigue. Je vous dis adieu. Vous m'écrirez à Paris le jour de votre arrivée, et, le lendemain, nous irons revoir nos bois. Je serai à Paris le 18 au plus tard; plus probablement, j'arriverai le 15.
Adieu encore.
Paris, 18 août 1846.
Je suis arrivé ici aujourd'hui en médiocre état de conservation, la tête toute étourdie de quatre cents kilomètres parcourus tout d'un trait. Pour me remettre, il faudrait votre présence réelle. Mais quand reviendrez-vous? That is the question. Je vous suppose beaucoup trop éprise de la mer et des monstres marins pour songer à retourner ici de sitôt. J'en aurais grand besoin pourtant, je vous assure. Je ne saurais vous dire combien d'ennuis et de chagrins se sont amoncelés sur moi dans ce petit voyage. Il me rappelle le rêve de Gloster: I would not sleep another such a night though I were to live a world of happy days. En rentrant ici, je m'y sens encore plus isolé qu'à l'ordinaire, plus triste que dans aucune des villes que je viens de quitter: quelque chose comme un émigré qui rentre dans sa patrie et qui y trouve une nouvelle génération. Vous allez croire que j'ai horriblement vieilli dans ce voyage. Cela est vrai, et je ne serais pas étonné que quelque chose comme l'aventure d'Épiménide me fût arrivé. Tout cela, c'est pour vous dire que je suis horriblement triste et de mauvaise humeur et que j'ai grande envie de vous voir. Hélas! vous n'avancerez pas d'une heure l'époque de votre retour. Le plus sage, c'est de me résigner. Lorsque vos robes se seront fanées à l'air de la mer, ou qu'il en viendra de plus fraîches de Paris, peut-être penserez-vous à moi. Mais alors je serai à Cologne, ou peut-être à Barcelone. J'irai à Cologne au commencement de septembre, et à Barcelone en octobre. On me dit des merveilles des manuscrits qui s'y trouvent. On dit que, pour une femme, il n'y a rien de plus agréable au monde que de montrer de jolies robes.—Je ne puis vous offrir d'équivalent à ces joies-là. Mais je souffrirais trop de vous croire ainsi faite.—Dieu est grand! quelle que soit la nouvelle que vous avez à m'annoncer, écrivez-moi promptement. Nous verrons-nous pendant qu'il y a des feuilles? Me ferez-vous manger des pêches de Montreuil, cette année? Vous savez comme je les aime. Si vous avez quelque tendre souvenir, j'espère qu'il vous inspirera une résolution généreuse. J'ai la fièvre et je tremble horriblement en écrivant.
Paris, 22 août 1846.
Nos lettres se sont croisées. J'espérais que la vôtre m'apporterait de meilleurs nouvelles, je veux dire l'annonce de votre prochain retour. Avant de partir, vous paraissiez plus pressée de nous revoir. Il y a longtemps que je me plains de la trop grande différence entre le dire et le faire pour vous. À ce qu'il paraît, vous passez le temps si heureusement, si agréablement, que vous ne pensez pas même à l'époque de votre retour à Paris. Vous me demandez si cela me ferait bien plaisir, ce qui est une dérision assez méchante. Pour moi, je m'ennuie fort ici, encore plus qu'en voyage, et cependant je suis assez occupé pour ne plus avoir le loisir de regretter le monde absent de Paris; mais ce n'est pas à cela que je tiens. C'est vous, ce sont nos promenades qui me font faute. Si vous les aimiez la moitié autant que vous le dites, elles ne se feraient guère attendre. J'y ai pensé pendant tout le temps de mon voyage, et j'y pense maintenant plus que jamais. Pour vous, vous les avez oubliées.
Paris est absolument dépourvu d'habitants intelligents. Il n'y reste plus que des bonnetiers ou des députés, ce qui revient à peu près au même. Je crois que je partirai pour Cologne dans les premiers jours de septembre. Sera-ce avant de vous avoir revue? J'ai bien peur que vous ne me disiez que, pour si peu, ce n'est pas la peine de revenir. Ainsi la moitié de notre année se sera passée vous absente ou malade. Il me prend des envies d'aller vous voir à ***, et j'y céderais probablement si vous trouviez des possibilités que je ne prévois pas. Pourtant, voyez. Adieu; je suis de trop mauvaise humeur pour vous écrire longuement. Je finis comme j'ai commencé, en vous répétant que rien ne pourra me faire plus de plaisir que de vous revoir, surtout si ce plaisir est partagé par vous. Sinon, restez là-bas tant que vous voudrez.
Paris, 3 septembre 1846.
Je m'étais figuré, tant j'étais de mon village, que vous préféreriez une ou deux promenades avec moi à huit jours de white bait; mais, puisque vous n'êtes pas de cet avis, votre volonté soit faite! Je n'ai pas même le courage de ne pas vous écrire, ce que je m'étais promis, et ce que je devrais faire si j'étais moins bête. Mon voyage de Cologne est un peu désorganisé depuis deux jours. Un de mes compagnons de route me manque de parole, un autre ne pourra peut-être pas. En sorte que je cours grand risque de me trouver seul sur le Rhin bleu. Ce sera un petit malheur. Mais je ne sais plus si je repasserai par ici. Ainsi, nous courons grand risque, je veux dire que je cours grand risque de ne nous revoir qu'en novembre. À vous la responsabilité. Je sais que vous la porterez légèrement. Je ne me mettrai pas en route avant le 12 septembre. D'ici là, j'espère que vous voudrez bien me donner de vos nouvelles et vos commissions. Probablement encore, je serai à Paris vers le commencement d'octobre; mais, si j'ai le moindre courage, j'irai à Strasbourg, à Lyon, et de Lyon à Marseille. Je crains de n'avoir pas ce courage, surtout si vous parlez de retour. Pendant votre absence, en recueillant mes souvenirs, j'ai fait de vous deux dessins en pied. Je les trouve assez ressemblants; cependant, ils ont besoin d'être retouchés. Nous verrons s'ils vous plaisent. Je m'ennuie extraordinairement et je voudrais voir tomber des torrents de pluie pour me consoler. Mais le temps est toujours au très-sec. Il n'y a que les feuilles qui tombent. Il n'en restera plus la queue d'une en octobre.
Vous apprendrez avec plaisir que vous avez à l'Opéra italien les mêmes enrouements que la saison passée, plus une autre Brambilla. Il n'en reste plus que cinq inconnues, et une mademoiselle Albini qui n'avait pas de voix en 1839, mais qui en a peut-être trouvé depuis quelque part.
Adieu, je ne dis pas sans rancune. Ce qui m'a particulièrement piqué, c'est que vous n'avez répondu que par le silence le plus dédaigneux à ma proposition d'aller vous voir à ***; mais n'y pensons plus.
Metz, 12 septembre 1846.
Il est fort heureux que vous ayez bien voulu penser à m'écrire avant mon départ, car j'allais en Allemagne sans nouvelles de vous. J'ai reçu votre lettre au moment de me mettre en route. D'après les promesses que vous me faites et dont j'attends avec trop de confiance peut-être l'entier accomplissement, je serai de retour vers le commencement d'octobre, peut-être le 1er. J'espère qu'il restera encore quelques feuilles. Nous verrons si vous serez as good as your word. Je vais demain à Trêves et de là soit à Mayence, soit à Cologne, selon que le temps sera ou non invitant. De toute façon, vous feriez bien de m'écrire très-vite à Aix-la-Chapelle, et puis assez vite après à Bruxelles. Je n'ai pas besoin de vous dire de m'écrire des choses aimables et qui me tentent au retour. Quand je suis lancé, une fois en route, j'ai toutes les peines du monde à m'arrêter, et il faudra les promesses les plus séduisantes pour m'empêcher de pousser jusqu'en Laponie. Je crois vous avoir parlé de deux portraits. J'en ai maintenant au moins trois, et, à chaque tentative infructueuse, j'ai recommencé sans détruire le premier essai et sans mieux réussir; enfin, vous verrez si ma mémoire m'a bien ou mal servi. Vous me demandez quelle robe? En vérité, je ne m'en suis guère préoccupé; mais ce n'est pas là que gît la ressemblance. Je désespère de saisir jamais l'expression indéfinissable de votre physionomie. Je viens d'arriver ici après une nuit passée en malle-poste sans dormir, et j'ai la tête excessivement giddy. Il me semble que mes bougies tournent sur ma table. On m'annonce pour demain une navigation entremêlée d'échouages, car la Moselle n'a que fort peu d'eau, mais ce n'est pas cela qui m'empêchera de dormir. Je vous écrirai probablement de quelque auberge allemande et très-assurément de Lille, où je m'arrêterai. De là, sans doute, je pourrai vous annoncer le jour de mon arrivée. J'apprends avec beaucoup de plaisir que vous vous ennuyez à ***; je vous l'avais prédit. Quand on habite Paris, on ne peut plus retourner en province. On dit et on fait quantité d'énormités qui passeraient à Paris et qui sont grosses comme des maisons à ***. Cela vous est peut-être aussi arrivé, du caractère dont je vous connais. Je vous pardonnerai tout si, le 1er ou 2 octobre, vous m'annoncez votre retour.
Bonn, 18 septembre 1846.
Je suis depuis six jours dans ce beau pays, non pas Bonn, mais je dis la Prusse rhénane, où la civilisation est très-avancée, sauf pour les lits, qui ont toujours quatre pieds de long et les draps trois. Je mène tout à fait une vie allemande, c'est-à-dire que je me lève à cinq heures et me couche à neuf, après avoir fait quatre repas. Jusqu'à présent, cette vie-là me convient assez et je ne me suis pas trouvé mal de ne rien faire qu'ouvrir la bouche et les yeux. Seulement, les Allemandes sont devenues horriblement laides depuis ma dernière visite. Voici le chapeau de la plus jolie que j'aie encore rencontrée;—ce fut sur un bateau à vapeur entre Trèves et Coblence; la place me manque pour l'illustration, que je mets au verso: c'est une capote d'où pend une pièce d'étoffe carrée, ouverte à l'extrémité, dont un angle est relevé à gauche au moyen d'une petite cocarde verte, blanche et rouge; la capote est noire, l'Allemande fort blanche avec des pieds comme il suit... N. B.—Le dessin est exécuté à l'échelle de un centimètre pour mètre. Je voudrais que vous introduisissiez ces capotes-là. Vous leur feriez faire fortune.—En fait de monuments, je n'ai guère été content de ce que j'ai vu: les architectes allemands m'ont paru pires que les nôtres. On a saccagé le Munster à Bonn et peint l'abbaye de Laarh à faire grincer les dents. Les sites de la Moselle sont beaucoup trop vantés. Au fond, cela est peu de chose. Je ne trouve plus rien de beau depuis que j'ai passé le Tmolus. Mon admiration demeure exclusive pour ses ombrages et surtout pour la façon dont on y entend la cuisine; ici, la grande affaire est zu speisen. Tous les honnêtes gens, après avoir dîné à une heure, prennent le thé et des gâteaux à quatre, vont manger à six un petit pain avec de la langue fourrée dans un jardin; ce qui permet d'attendre jusqu'à huit heures pour entrer dans un hôtel et souper. Ce que deviennent les femmes pendant ce temps-là, je l'ignore; ce qu'il y a de certain, c'est que, de huit à dix, il ne reste pas un homme dans les maisons: chacun est dans son hôtel favori à boire, manger et fumer; la raison est, je crois, dans les pieds de ces dames et la bonté du vin du Rhin.
Je pense que vous allez être à Paris dans deux ou trois jours. En voyant les bois du Rhin et de la Moselle si verts, je ne puis me figurer que ceux de notre température soient devenus des balais. Cela n'est malheureusement que trop possible. Vous l'avez voulu. Adieu; je suis fâché de ne pas vous avoir dit de m'écrire à Cologne, mais il est trop tard.
Soissons, 10 octobre 1846.
Il paraît que vous avez été de bien mauvaise humeur samedi dernier; mais enfin vous avez repris votre sérénité dimanche, sauf quelques petits nuages qui flottent encore dans votre lettre. Pour suivre la métaphore, je voudrais bien un jour vous voir au beau fixe, sans qu'il y eût des tempêtes auparavant. Malheureusement, c'est une habitude que vous avez prise. Nous nous séparons presque toujours meilleurs amis que nous ne nous sommes vus. Tâchons donc d'avoir, un de ces jours, l'amabilité continue que j'ai rêvée quelquefois. Il me semble que nous nous en trouverions bien l'un et l'autre. Vous me faites des menaces pour le seul plaisir de m'ôter les consolations de l'espérance. Vous sentez si bien votre tort, que vous me dites que vous êtes dispensée de loyauté à l'égard d'une certaine promesse que vous m'avez faite déjà une fois et que vous ne voulez pas tenir. N'est-ce pas un effet du hasard seul qui vous a permis de dire que vous aviez accompli cette promesse? Vous ne vouliez me voir que pendant un quart d'heure; ainsi, il y avait de votre part trahison méditée. Je sais ce que vous pensez vous-même de ces subterfuges-là, et je m'en rapporte à votre propre jugement. Vous pouvez me faire beaucoup de plaisir ou beaucoup de peine; c'est à vous de choisir.
Le temps affreux qui me m'a pas quitté depuis samedi est sans doute celui que vous avez à Paris. Le seul chagrin qu'il me fasse, c'est que je pense à mes bois, dont le vent enlève les feuilles, à mes gazons, que la pluie inonde, et à l'éloignement de notre prochaine promenade. Hier, au milieu des champs, par un vrai déluge, je ne pensais pas à autre chose. Et vous, regrettez-vous la pluie à cause de moi, ou bien parce qu'elle vous empêche d'aller à shopping à votre ordinaire?
Quel jour étiez-vous à l'Opéra italien?
Était-ce jeudi par hasard, et aurions-nous été tout près l'un de l'autre sans nous en douter? J'aurais bien voulu vous voir un peu avec votre cour, pour savoir si vous êtes pour le monde telle que je le voudrais.
J'espère être à Paris jeudi soir ou vendredi au plus tard. S'il fait beau samedi, voulez-vous faire une longue promenade? Dans le cas contraire, nous en ferons une courte, ou nous irons au Musée. La mémoire de ces promenades est à la fois un plaisir et une douleur. C'est pour moi une sensation qu'il faut renouveler sans cesse pour qu'elle ne devienne pas triste. Adieu, chère amie; je vous remercie bien de tout ce qu'il y a de tendre dans votre lettre. Je tâche d'oublier le peu qui reste de dur et de sec. Je pense que c'est à votre usage une espèce de parure de fantaisie dont vous vous couvrez. J'aime à deviner dessous que vous êtes tout cœur et tout âme; croyez que cela paraît, malgré tous vos efforts pour le cacher.
Paris, 22 septembre 1847.
. . . . . . .
La Revue me tourmente beaucoup pour Don Pèdre. Je voudrais savoir votre opinion à ce sujet. Je suis partagé entre l'avarice et la pudeur. J'aurais aussi à vous prier d'en lire quelque chose. Cela me paraît avoir l'inconvénient de tout ce qui a été fait longuement et péniblement. Je me suis donné bien du mal pour une exactitude dont personne ne me saura gré. Cela me chagrine quelquefois.
Vous comprendrez sans peine que, depuis votre départ, j'ai eu très-souvent les blue devils.
. . . . . . .
Ce que vous me dites de Don Pèdre me plaît assez, parce que votre opinion est d'accord avec mon désir et ce que je crois mon intérêt. Pourtant, il y a une question de dignité qui me tient encore au cœur et qui m'a empêché de tout terminer d'abord avant mon départ. Je serai bien aise d'avoir votre avis de vive voix, et je vous montrerai quelques bribes d'après lesquelles vous jugerez mieux. Je n'ai jamais été plus tristement choqué de la bêtise des gens du Nord qu'à ce voyage-ci, et aussi de leur infériorité sur les Méridionaux. La moyenne du Picard me paraît au-dessous de la plus inférieure espèce du Provençal. En outre, je mourais de froid dans toutes les auberges où mon triste sort me poussait.
. . . . . . .
Saturday, 26 febr. 1848[1].
I believe you are now a little better. I don't know why you could be so uneasy about your brother. No wonder you have no news. Bad ones corne very soon. I begin to get accustomed to the strangeness of the thing and to be reconciled with the strange figures of the conquerors, who what's stranger still, behave themselves as gentlemen. There is now a strong tendency to order. If it continues, I shall turn a staunch republican. The only fault I find with the new order of things is that I do not very clearly see how I shall be able to live and that I cannot see you.
I hope though it will not be long before the coaches can go on.
Samedi, 26 février 1848.
Je crois que vous êtes maintenant un peu plus rassurée. Je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas complètement tranquille à l'égard de votre frère. Ne prenez point souci de l'absence de nouvelles. Les mauvaises nouvelles arrivent promptement.
Je commence à m'accoutumer à la plus étrange des choses, et à me familiariser avec l'étrange figure des vainqueurs qui, ce qui est plus étrange encore, se conduisent en gentlemen. Il y a maintenant une violente tendance à l'ordre. Si cela continue, je deviendrai un républicain décidé. Le seul inconvénient que je trouve au nouvel ordre de choses, c'est que je n'aperçois pas très-clairement comment je pourrai gagner ma vie, et que je ne puis vous voir.
J'espère néanmoins qu'avant peu les voitures recommenceront à circuler.
Paris, mars 1848.
Je suis tourmenté par cette faillite de la maison ***, dans laquelle je crains que vous n'ayez des intérêts. Rassurez-moi, je vous prie, là-dessus, ou, s'il y a quelque malheur, tâchons de nous consoler ensemble. Chaque jour nous apportera d'ici à longtemps de nouvelles peines. Il faut se soutenir et se faire part mutuellement du peu de courage que l'on conserve. Voulez-vous nous voir demain ou après? Il me semble qu'il y a un siècle que nous ne nous sommes vus. Adieu; vous avez été l'autre jour bien aimable, et je regrette que vous ne l'ayez pas été plus longtemps.
Paris, mars 1848.
Je crois que vous vous effrayez un peu trop. Les choses ne sont pas plus mal quelles n'étaient hier; ce qui ne veut pas dire quelles soient bien et qu'il n'y ait pas de danger. Quant à ce projet de voyage, il est bien difficile de donner un conseil et de voir clair dans ce grand brouillard étendu sur notre avenir. Il y a des gens qui pensent que Paris, à tout prendre, est un lieu plus sûr que la province. Je suis assez de cet avis. Je ne crois pas à une bataille dans les rues: d'abord, parce qu'il n'y a pas encore de motif; puis, parce que la force et l'audace sont du même côté, et que, de l'autre, je ne vois que platitude et poltronnerie. Si la guerre civile devait commencer, c'est, je crois, en province quelle se déclarerait d'abord. Il y a déjà une assez grande irritation contre la dictature de la capitale, et peut-être des mesures que l'on ne peut prévoir amèneraient-elles ce résultat dans l'Ouest ou ailleurs. Quant aux conséquences des émeutes, voyez ce qu'elles ont été à Paris dans la première révolution, et ce qu'elles ont été en province tout récemment. Le département de l'Indre, où vous voulez aller, en a vu une il y a deux ans, à Buzançais, plus vilaine que toutes celles de 93. Il est bien entendu que je ne vous conseille pas et que je raisonne seulement théoriquement. Je ne crois pas à un danger immédiat. Je crois même que, les circonstances devenant plus graves, Paris serait encore le meilleur séjour. Enfin, entre l'Indre et Boulogne, je préférerais le dernier lieu, qui a l'avantage d'être près de la mer. Mais je serais bien triste si vous partiez sans me voir. Ne pourriez-vous pas retarder de quelques jours? Vous voyez que tout s'est passé tranquillement hier. Nous aurons encore des processions semblables et longtemps, avant qu'on en vienne aux coups de feu, si l'on y vient jamais dans ce pays si timide. Adieu. . . . . .
. . . . . . .
Samedi, 11 mars 1848.
Le temps se met de la partie pour nous contrarier encore. J'espère qu'il nous sera plus favorable lundi. Je suis inquiet de votre mal de gorge par cette pluie ou ce froid. Soignez-vous bien et tâchez d'oublier un peu tout ce qui se passe. Je suis moulu par une nuit de corps de garde; mais, après tout, la fatigue a son bon côté dans ce temps-ci. Je voudrais bien avoir autre chose que votre ombre. Je regrette que vous vous soyez retirée sitôt. Le bonheur de vous voir est aussi grand sous la république que sous la monarchie, il ne faut pas en être avare. Dans quel étrange monde vivons-nous! Mais le plus important à vous dire et le plus pressé, c'est que je vous aime tous les jours davantage, je crois, et que je voudrais bien que vous prissiez assez de courage pour m'en dire autant.
Paris, 13 mai 1848.
J'espérais que vous ne partiriez pas si vite et sans me dire adieu. Je vous avais même écrit hier, espérant vous voir aujourd'hui. Je ne sais pourquoi je ne me réconcilie pas à ce voyage. Mais vous ne me dites pas combien de temps vous prétendez demeurer à boire du lait, et c'était pourtant le point capital. J'aimerais bien que vous fussiez à Paris avec un chapeau neuf pour la réception de jeudi à l'Académie, où les chapeaux neufs seront rares, je le crains. C'est dans un intérêt purement académique que je vous fais cette demande. Dans le mien, je compte sur vous samedi prochain pour une belle promenade. Si vous voulez aller jeudi prochain à l'Académie, faites prendre des billets chez moi jusqu'à midi.
Paris, mercredi 15 mai 1848.
Tout s'est passé très-bien, parce qu'ils sont si bêtes, que, malgré toutes les fautes de la Chambre, elle s'est trouvée plus forte qu'eux. Il n'y a ni tués ni blessés, on est fort tranquille. La garde nationale et le peuple sont dans d'excellents sentiments. On a pris tous les chefs des émeutiers, et il y a tant de troupes sous les armes, que, d'ici à quelque temps, il n'y a rien à craindre. J'espère que nous nous verrons samedi. En somme, tout s'est passé pour le mieux. J'ai assisté à des scènes très-dramatiques qui m'ont fort intéressé et que je vous raconterai.
27 juin 1848.
Je rentre chez moi ce matin, après une petite campagne de quatre jours où je n'ai couru aucun danger, mais où j'ai pu voir toutes les horreurs de ce temps et de ce pays-ci. Au milieu de la douleur que j'éprouve, je sens par-dessus tout la bêtise de cette nation. Elle est sans égale. Je ne sais s'il sera jamais possible de la détourner de la barbarie sauvage où elle a tant de propension à se vautrer. J'espère que votre frère va bien. Je ne pense pas que sa légion ait été sérieusement engagée. Mais nous sommes bien accablés de fatigue et nous n'avons pas dormi depuis quatre jours. Croyez peu à tout ce que disent les journaux sur les morts, les destructions, etc. J'ai parcouru avant-hier la rue Saint-Antoine: les vitres étaient brisées par le canon et beaucoup de devantures de boutiques endommagées; d'ailleurs, le ravage n'était pas si grand que je l'avais supposé et qu'on le disait. Voici ce que j'ai vu de plus curieux. Je me hâte de vous le dire pour aller me coucher: 1° La prison de la Force est demeurée plusieurs heures gardée par la garde nationale et entourée d'insurgés. Ils ont dit à la garde nationale: «Ne tirez pas sur nous et nous ne tirerons pas. Gardez les prisonniers.» 2° Je suis entré dans une maison qui fait le coin de la place de la Bastille pour voir la bataille; elle venait d'être enlevée sur les insurgés. J'ai demandé aux habitants: «Vous a-t-on pris beaucoup?—On n'a rien volé.» Ajoutez à cela que j'ai conduit à l'Abbaye une femme qui coupait la tête aux mobiles avec son couteau de cuisine, et un homme qui avait les deux bras rouges de sang pour avoir fendu le ventre à un blessé et s'être lavé les mains dans la plaie. Comprenez-vous quelque chose à cette grande nation? Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous nous en allons à tous les diables!
Quand revenez-vous? Nous ne nous battrons plus de six semaines, tout au moins.
Paris, 2 juillet 1848.
J'aurais bien besoin de vous voir pour me remettre un peu des tristes scènes de la semaine dernière, et c'est avec le plus vif plaisir que j'apprends vos projets de retour, plus prochains que je ne l'avais espéré. Paris est et sera tranquille pour un temps assez long. Je ne pense pas que la guerre civile, ou plutôt la guerre sociale soit finie; mais une nouvelle bataille aussi effroyable me semble impossible. Il a fallu pour l'amener une infinité de circonstances qui ne peuvent plus se reproduire. Quand vous reviendrez, vous ne trouverez guère les traces hideuses que votre imagination vous représente probablement. Les vitriers et les badigeonneurs en ont déjà fait disparaître la plus grande partie. Mais j'ai peine à croire que vous ne nous trouviez pas à tous la mine allongée, et encore plus triste que lorsque vous êtes partie. Que voulez-vous! c'est le régime actuel et il faut s'y habituer. Petit à petit, nous en viendrons à ne plus penser au lendemain et à nous trouver très-heureux quand nous nous éveillerons le matin ayant notre soirée assurée. Au fond, ce qui me manque le plus à Paris, c'est vous, et je crois que, si vous y étiez, je trouverais le reste très-bien. Le temps s'est remis à la pluie depuis trois jours. Maintenant, je la vois tomber avec la plus grande insouciance; mais je ne voudrais pas cependant que cela durât trop. Vous me parlez en termes si généraux de votre retour, que je ne sais trop sur quoi compter, et vous savez que j'aime assez à savoir combien de temps durera le purgatoire. Vous parliez de six semaines en me disant adieu, et maintenant vous dites que vous reviendrez plus tôt? Que veut dire plus tôt? voilà ce que je voudrais bien savoir. Mandez-moi aussi ce que deviennent les désagréables affaires qui vous ont empêchée d'assister à ma fête, célébrée par tant de coups de canon.—Adieu; pour prendre patience, j'ai besoin d'avoir souvent de vos nouvelles. Donnez-m'en vite et envoyez-moi quelque souvenir. Je pense à vous sans cesse. J'y pensais même en voyant ces maisons désertes de la rue Saint-Antoine pendant qu'on se battait à la Bastille.
Paris, 9 juillet 1848.
Vous êtes comme Antée, qui reprenait des forces en touchant la terre. Vous n'avez pas plus tôt touché votre pays natal, que vous retombez dans tous vos vieux défauts. Vous répondez joliment à ma lettre. Je vous priais de me dire combien de temps vous prétendiez demeurer encore à manger des amiles; un chiffre de jour n'était pas bien difficile à écrire, mais vous avez préféré trois pages de circonlocutions où je ne puis comprendre autre chose, sinon que vous seriez revenue, si vous n'étiez pas restée. Je vois aussi que vous passez votre temps assez agréablement. Je pensais bien que l'écharpe de madame *** n'avait pas été achetée pour en faire des reliques. Vous auriez du me dire au moins contre qui vous aviez jugé à propos de l'essayer. En somme, je suis fort mécontent de votre lettre.—Nous passons ici des jours bien longs et passablement chauds, mais aussi tranquilles qu'on peut le souhaiter ou plutôt l'espérer sous la République. Tout annonce que nous aurons une trêve assez longue. Le désarmement s'opère avec assez de vigueur et produit de bons résultats. On remarque un curieux symptôme: c'est que, dans les faubourgs insurgés, on trouve quantité de dénonciateurs pour indiquer les cachettes, et même les coryphées des barricades. Vous savez que c'est bon signe quand les loups se battent entre eux. Je suis allé hier à Saint-Germain pour commander le dîner de la Société des bibliophiles. J'ai trouvé un cuisinier très-capable et, de plus, éloquent. Il m'a dit que c'était à tort que tant de gens se faisaient un fantôme des artichauts à la barigoule, et il a compris tout de suite les plats les plus fantastiques que je lui ai proposés. C'est dans le pavillon où Henri IV est né que demeure ce grand homme. On a, de là, la plus belle vue du monde. En faisant deux pas, on se trouve dans un bois avec de grands arbres et un magnifique underwood au-dessous. Pas une âme pour jouir de tout cela! Il est vrai qu'il faut cinquante-cinq minutes pour parvenir dans ces beaux lieux. Mais serait-ce impossible d'aller y dîner ou déjeuner un jour avec madame...? Adieu. Écrivez-moi bientôt.
Paris, lundi 19 juillet 1848.
Vous devinez parfaitement les choses quand vous voulez bien vous en donner la peine, et vous m'avez envoyé ce que je vous demandais; qu'importe que ce fût une répétition! Ne suis-je pas comme le pauvre ex-roi? «Je reçois toujours avec un nouveau plaisir, etc.» Ce que je ne puis vous dire, c'est combien j'ai été charmé de retrouver ce parfum connu et d'autant plus délicieux qu'il est bien connu et qu'il s'y rattache tant de souvenirs. Vous vous êtes enfin décidée à lâcher le grand mot. Il est vrai qu'il y a un mois que vous êtes partie et qu'en partant vous aviez parlé de six semaines; d'où il suivrait que, dans quinze jours, je pourrais vous revoir; mais aussitôt vous vous mettez à compter les six semaines à votre manière, c'est-à-dire du jour où vous m'écrivez. Cela ressemble un peu à la manière de compter du diable, qui, comme vous savez, groupe les chiffres tout autrement que les bons chrétiens. Dites-moi donc un jour, prenons le délai le plus long que je puisse vous accorder, soit le 15 août. Nous avons passé fort paisiblement le 14 juillet, malgré les prédictions sinistres qu'on nous faisait. La vérité, si on peut la découvrir sous le gouvernement où nous avons le bonheur de vivre, la vérité, c'est que nos chances de tranquillité sont singulièrement augmentées. Il avait fallu plusieurs années d'organisation et quatre mois d'armements pour préparer les affaires des 23-26 juin. Une seconde représentation de cette sanglante tragédie me paraît impossible, du moins tant que les conditions actuelles ne seront pas très-matériellement changées. Pourtant, quelque petit complot, quelques assassinats, quelques émeutes même sont encore probables. Nous avons pour un demi-siècle peut-être à nous perfectionner, les uns dans la confection des barricades, les autres dans leur destruction. On emplit Paris en ce moment d'obusiers et de mortiers à grenades, très-transportables et très-efficaces. C'est un argument nouveau et qu'on dit excellent. Mais laissons la πολεμιχὰ. Vous ne pouvez vous faire une idée du plaisir que vous me ferez en acceptant mon invitation à déjeuner avec lady ***.
Paris, samedi 5 août 1848.
. . . . . . .
On reparle de coups de fusil, mais je n'y crois nullement. Pourtant, ce soir, mon ami M. Mignet se promenait avec mademoiselle Dosne dans le petit jardin qui est devant la maison de M. Thiers. Une balle est venue de haut en bas sans faire le moindre bruit, qui a frappé contre la maison, près de la fenêtre de madame Thiers; et, comme toute balle porte son billet, celle-là en avait un pour une partie charnue sur laquelle était assise une petite fille de douze ans en dehors de la grille du jardin. On la lui a extirpée très-proprement et elle n'aura aucun autre mal qu'une légère cicatrice. Mais à qui en voulait-on? à Mignet? cela est impossible; à mademoiselle Dosne? encore moins. Madame Thiers n'était pas chez elle, ni Thiers non plus. Personne n'a entendu d'explosion; pourtant, la balle était de calibre de guerre, et les fusils à vent sont tous d'un calibre beaucoup plus faible. Pour moi, je pense que c'est une tentative républicaine d'intimidation, bête comme tout ce qui se fait aujourd'hui. Voilà les seules balles à craindre à mon avis. Le général Cavaignac a dit: «On me tuera, Lamoricière me succédera, ensuite Bedeau; puis viendra le duc d'Isly, qui balayera tout.» Ne trouvez-vous pas quelque chose de prophétique là-dedans? On ne croit guère à une intervention en Italie. La République sera un peu plus poltronne que la monarchie. Seulement, il se peut qu'on fasse la frime de laisser soupçonner qu'on serait tenté d'intervenir, dans l'espoir qu'on obtiendra des atermoiements, un congrès et des protocoles. Un de mes amis qui revient d'Italie a été pillé par des volontaires romains qui trouvent les voyageurs de meilleure composition que les Croates. Il prétend qu'il est impossible de faire battre les Italiens, excepté les Piémontais, qui ne peuvent être partout.
Je vous envoie toute cette politique et j'espère qu'elle ne changera rien à vos projets. On fait de grands préparatifs à la Marine pour transporter six cents de ces messieurs pris en juin: ce sera le premier convoi. Je ne serais pas éloigné de croire qu'il y eût, le jour du transport, quelques milliers de veuves éplorées à la porte de l'Assemblée; mais de nouveaux insurgés, n'y croyez point.—Laissez donc de côté le romaïque, où vous avez tort de vous complaire, car il vous jouera le même tour qu'à moi, qui n'ai pu l'apprendre et qui ai désappris le grec. Je m'étonne que vous compreniez quelque chose à ce baragouin-là. Il va, d'ailleurs, disparaître en peu de temps. Déjà on parle grec à Athènes, et, si cela continue, le romaïque ne servira plus qu'à la canaille. Dès 1841, on n'entendait plus prononcer, dans la Grèce du roi Othon, un seul des mots turcs si fréquents dans les τραγἡδιον de M. Fauriel. Vous ai-je traduit une ballade très-jolie d'un Grec qui revient chez lui après une longue absence et que sa femme ne reconnaît pas? Elle lui demande, comme Pénélope, des renseignements sur sa maison; il y répond fort bien, mais elle n'est pas convaincue; elle en veut, d'autres qu'elle obtient et la reconnaissance se fait. Tout cela est abandonné à votre divination. Adieu; j'attends de vos nouvelles.
Paris, 12 août 1848.
Le beau temps s'en va et nous allons entrer, d'ici à quelques jours, dans la saison froide, qui m'est si antipathique. Je ne puis vous dire combien je suis en colère contre vous. En outre, les abricots et les prunes sont presque passés et je me faisais une fête d'en manger avec vous. Je suis parfaitement sûr que, si vous aviez réellement voulu revenir, vous seriez déjà à Paris. Je m'ennuie horriblement et j'ai bien envie de m'en aller quelque part sans vous attendre. Tout ce que je puis faire, c'est de vous donner jusqu'au 25 à trois heures, et pas une heure de plus.—Nous sommes fort tranquilles. On parle toujours, il est vrai, d'une émeute que M. Ledru ferait par manière de protestation contre l'enquête; mais ce ne peut être quelque chose de sérieux. La première condition pour qu'on se batte, c'est qu'il y ait de la poudre et des fusils des deux côtés. Or, maintenant, tout est du même côté. Avant-hier, au concours général, un gamin nommé Leroy a eu un prix. Les autres gamins ont crié: «Vive le roi!» Le général Cavaignac, qui assistait, je ne sais pourquoi, à la cérémonie, a ri de fort bonne grâce. Mais, le même gamin ayant eu un autre prix, les cris sont devenus si forts, qu'il en a perdu toute contenance et tortillait sa barbe comme s'il eût voulu l'arracher. Adieu; je vous en veux horriblement! écrivez-moi bien vite.
Paris, 20 août 1848.
. . . . . . .
Je commence à croire que je ne vous verrai pas cette année. Voilà que l'on recommence à parler d'émeutes, et puis le choléra va venir compliquer les affaires. On dit qu'il est à Londres. IL est certainement à Berlin. Depuis quelques jours, on s'attend à une bagarre. On prédit des coups de fusil pour la discussion de l'enquête. Je suis si entêté dans mes idées, que je n'y crois pas encore; mais je suis à peu près seul de mon avis. La situation est au fond bien embrouillée. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Rome pendant la conjuration de Catilina. Seulement, il n'y a pas de Cicéron. Quant à l'issue d'une émeute, je ne doute pas que la bonne cause ne triomphe. Personne n'en doute, mais avec des fous il ne faut pas compter sur des entreprises raisonnables; peut-être, en effet, ai-je tort de croire que l'impossibilité de réussir empêche cette émeute susdite. Nous verrons, au reste, la semaine prochaine. Mercredi, la discussion doit commencer; l'enquête me paraît surtout prouver une chose, c'est la profonde division des républicains entre eux. Il est évident qu'il n'y en a pas deux de la même opinion. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que le citoyen Proudhon a un grand nombre d'adeptes et que ses petites feuilles se vendent à milliers dans les faubourgs. Tout cela est fort triste; mais, quoi qu'il arrive, nous vivrons longtemps de cette vie-là, et il faut nous y accoutumer. Le point qui me paraît capital, c'est de savoir si vous viendrez le 25. S'il doit y avoir bataille, elle sera perdue ou gagnée ce jour-là. Ainsi, ne faites pas encore de projets, ou plutôt faites celui de venir assister à notre victoire ou à notre enterrement pour le 25. Une autre chose me chagrine: c'est que la chaleur s'en va, le beau temps se passé, et il n'y aura plus de pêches à votre retour. Les feuilles commencent à jaunir et à tomber. Je prévois tous les ennuis du froid et de la pluie, qui me semblent beaucoup plus graves et beaucoup plus certains que l'émeute. Je suis malade depuis quelques jours, c'est peut-être pour cela que je suis triste. Je n'ai pas besoin de vous dire que je serais très-contrarié de mourir avant notre déjeuner à Saint-Germain, qui, je l'espère, tiendra toujours. Adieu; écrivez-moi vite. Vous ne devriez pas taquiner les gens de si loin.
Paris, 23 août 1848.
Vous n'êtes guère aimable de ne pas me répondre plus tôt. Je crois que je vous ai écrit trop en noir la dernière fois. Je vois aujourd'hui les choses, non en couleur de rose, mais gris de lin. C'est la couleur la plus gaie que comporte la République. On m'avait fait croire malgré moi à la bataille; maintenant, je n'y crois plus, ou, si j'y crois, c'est pour plus tard. Aussi bien, je m'imagine que vous mourez de froid au bord de votre mer. Je suis toujours malade, je ne mange ni ne dors; mais le pire de mes maux, c'est que je m'ennuie épouvantablement. Cependant, j'ai à travailler, et ce n'est pas dans l'oisiveté que je bâille; mais, dans quelque situation que le phénomène se manifeste, il est toujours fort désagréable. Pour vous, je ne comprends pas ce que vous pouvez faire à D..., et je ne vois pas d'autre explication à votre séjour parmi vos sauvages, que de penser que vous y avez fait quelque conquête dont vous êtes toute fière. Je vous réserve une belle querelle pour votre retour. Sera-ce vendredi ou bien lundi? Je ne crois pas qu'il soit prudent à vous d'attendre plus longtemps. Adieu; je vous quitte pour aller entendre votre favori, M. Mignet, qui fait un discours à d'Académie morale. Croyez que l'enquête se passera sans coups de fusil; quant au scandale, on ne sait plus ce que c'est par le temps qui court.
Paris, samedi 5 novembre 1848.
J'ai été très-irrité contre vous, car j'avais le plus grand besoin de vous voir; j'ai été et je suis encore très-souffrant et, qui pis est, affreusement triste. Une heure passée auprès de vous m'aurait fait grand bien. Vous n'avez même pas pris la peine que vous preniez autrefois de me dire quelque chose d'aimable lorsque vous aviez quelque méchanceté en tête. Quelques justes reproches que j'aie à vous faire, il faudra toujours finir par vous pardonner; mais je voudrais bien que vous fissiez quelque chose pour cela. Me ferez-vous quelque finezay pour me dédommager de tout l'ennui que j'ai eu pendant quinze jours? Je vous laisse à trouver vous-même ce dédommagement adequate.
Avez-vous entendu le canon et avez-vous eu peur? J'ai cru qu'on voulait démolir la République aux trois premiers coups. J'ai compris au quatrième de quoi il s'agissait. Vous avez toujours à moi un livre grec. J'ai peur que vous ne gâtiez votre hellénisme avec le baragouin romaïque. Cependant, je crois qu'il y a de très-jolies choses dans ce volume. Je travaille à un ouvrage nouveau également historique.
Londres, 1er juin 1850.
Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, c'est que, ayant à faire dix lieues par jour, je ne pouvais m'asseoir devant une table sans m'endormir tout de suite. Je ne vous dirai pas grand'chose de mes impressions de voyage, si ce n'est que décidément les Anglais sont individuellement bêtes et en masse un peuple admirable. Tout ce qui peut se faire avec de l'argent, du bon sens et de la patience, ils le font; mais ils se doutent des arts comme mon chat. Il y a ici des princes népâlais dont vous deviendriez éprise. Ils ont des turbans plats tout bordés de grosses émeraudes en pendeloques, et ne sont que satin, cachemire, perles et or! Leur couleur est un café au lait très-foncé. Ils ont bon air et on dirait qu'ils ont de l'esprit.
J'ai été interrompu en cet endroit de ma lettre par une visite et je n'ai pu retrouver le fil de mes idées qu'aujourd'hui 2 juin, jour de dimanche. Nous allons à Hampton-Court pour éviter les chances de suicide que le Lord's day ne manquerait pas de nous offrir. J'ai dîné hier avec un évêque et un dean qui m'ont rendu de plus en plus socialiste. L'évêque est de ce que les Allemands appellent l'école rationaliste; il ne croit pas même à ce qu'il enseigne, et, moyennant son tablier de gros de Naples noir, il fricote ses cinq ou six mille livres tous les ans et passe son temps à lire du grec. Outre cela, je me suis enrhumé, en sorte que je suis on ne peut plus démoralisé. Sous le prétexte que nous sommes en juin, on me livre à des courants d'air destructeurs. Toutes les femmes me paraissent faites en cire. Elles mettent des bustles (tournures) si considérables, qu'il ne tient qu'une femme sur le trottoir de Regent's Street. J'ai passé ma matinée hier dans la nouvelle chambre des Communes, qui est une affreuse monstruosité. Nous n'avions pas encore d'idée de ce qu'on peut faire avec un manque de goût complet et deux millions de livres sterling. Je crains de devenir tout à fait socialiste en mangeant de trop bons dîners dans de la vaisselle plate en vermeil, et en voyant des gens qui gagnent quatorze mille livres sterling aux courses d'Epsom. Mais il n'y a pas encore de probabilité qu'une révolution éclate ici. La servilité des pauvres gens est étrange pour nos idées démocratiques. Chaque jour, nous en voyons quelque nouvel exemple. La grande question est de savoir s'ils ne sont pas plus heureux. Écrivez-moi à Lincoln, poste restante. Lincoln est dans le Lincolnshire, je crois, mais je n'en jurerais pas.
Salisbury, samedi 15 juin 1850.
. . . . . . .
Je commence à avoir assez de ce pays-ci. Je suis excédé de l'architecture perpendiculaire et des manières également perpendiculaires des natifs. J'ai passé deux jours à Cambridge et à Oxford, chez des révérends, et, tout bien considéré, je préfère les capucins. Je suis particulièrement furieux contre Oxford. Un fellow a eu l'insolence de m'inviter à dîner. Il y avait un poisson de quatre pouces dans un grand plat d'argent et une côtelette d'agneau dans un autre. Tout cela servi dans un style magnifique avec des pommes de terre dans un plat de bois sculpté. Mais jamais je n'ai eu si faim. C'est la suite de l'hypocrisie de ces gens-là. Ils aiment à montrer aux étrangers qu'ils sont sobres, et, moyennant qu'ils font un luncheon, ils ne dînent pas. Il fait un vent du diable et un froid de chien. S'il ne faisait grand jour à huit heures du soir, on pourrait se croire en décembre. Cela n'empêche pas toutes les femmes de sortir avec un parasol ouvert. Je viens de faire une boulette. J'ai donné une demi-couronne à un monsieur en noir qui m'a montré la cathédrale, et puis je lui ai demandé l'adresse d'un gentleman pour qui j'avais une lettre du dean. Il s'est trouvé que c'était à lui-même que la lettre était adressée. 11 a eu l'air fort sot, et moi aussi; mais il a gardé l'argent. Je compte aller demain revoir Stone-Henge, et j'irai le soir dîner à Londres, s'il fait un peu moins de brouillard. Lundi ou mardi, je partirai pour Canterbury, et je pense être à Paris vendredi. Je voudrais bien que vous fussiez à Salisbury. Stone-Henge vous étonnerait fort. Adieu; je retourne à mon église. Ma lettre partira, Dieu sait quand! On vient de me dire que, le jour du Seigneur, la poste se reposait. J'ai un rhume abominable, je tousse et je n'ai que du vin de Porto à boire.—Les femmes ont ici des cerceaux à leurs robes. Il est impossible de voir quelque chose de plus ridicule qu'une Anglaise en cerceau.—Qu'est-ce que c'est qu'une miss Jewsbury, un peu rousse, qui fait des romans? Je l'ai rencontrée l'autre soir, et elle m'a dit quelle avait rêvé toute sa vie un plaisir quelle croyait impossible, qui était de me voir (textuel). Elle a fait un roman sous le titre de Zoé. Vous qui lisez tant, vous me direz quelle est cette personne, pour qui je suis un livre. Il y a un petit hippopotame au Jardin zoologique, qu'on nourrit de riz au lait. Le Punch du 15, donne son portrait qui est d'une ressemblance achevée. Adieu; tâchez de me dédommager par une jolie promenade de mon voyage de trois semaines.
Bâle, 10 octobre 1850.
Il y a bien longtemps que je veux vous écrire et je ne sais comment il se fait que j'ai tant tardé. D'abord, j'ai vécu dans des lieux si déserts et si sauvages, qu'il n'était pas vraisemblable que la poste y pénétrât, et puis j'ai eu tant de gymnastique à faire pour visiter les châteaux gothiques des Vosges, que, le soir, il ne me restait plus de force pour prendre une plume. Le temps, qui avait été très-mauvais à mon départ, s'est mis au beau pour mon excursion d'Alsace, et j'ai joui très-complètement des montagnes, des bois et d'un air que la fumée de charbon de terre n'a jamais vicié, et qui n'a jamais vibré aux accents du chœur des Girondins. J'éprouvais un vif plaisir au milieu de ces lieux sauvages et je me demandais comment on pouvait vivre ailleurs. Les bois sont encore tout verts et ont des odeurs délicieuses qui me rappellent nos promenades. Me voici enfin en pays républicain modèle, où il n'y a ni douaniers ni gendarmes, et où il y a des lits de ma taille, confort ignoré en Alsace, Je m'y repose un jour. Demain, je verrai la cathédrale de Fribourg, et j'irai tout de suite vérifier si les statues sont aussi belles que celles d'Erwin de Steinbach, à Strasbourg.—De Strasbourg, je partirai le 12, et serai le là à Paris. J'espère vous y trouver. Je n'ai pas besoin de vous dire combien cela me ferait plaisir. Mais cela ne vous empêchera pas d'en faire à votre tête. Adieu; vous devez, étant paresseuse comme vous êtes, me savoir gré de vous écrire si tard, puisque cela vous dispense de me répondre.
Paris, lundi 15 juin 1851.
Ma mère va mieux et je pense que sous peu elle sera tout à fait remise. J'ai été bien inquiet; j'ai craint une fluxion de poitrine. Je vous remercie de l'intérêt que vous lui avez témoigné.
Hier, je suis sorti pour la première fois depuis huit jours, pour aller voir les danseuses espagnoles qui travaillaient chez la princesse Mathilde. Elles m'ont paru médiocres. La danse chez Mabille a tué le mérite du boléro. En outre, ces dames avaient une telle quantité de crinoline par derrière et tant de coton par devant, qu'on s'aperçoit que la civilisation envahit tout. Ce qui m'a le plus amusé, c'est une petite fille de douze ans et une vieille duègne, l'une et l'autre encore toutes surprises de se voir hors de la tierra de Jésus et aussi barbares qu'on puisse le désirer.—Je viens de recevoir votre coussin; vous êtes vraiment une très-habile ouvrière, ce dont je ne vous aurais jamais soupçonné. Le choix des couleurs et la broderie sont également merveilleux. Ma mère a fort admiré le tout. Quant à la symbolique, il m'a suffi du commencement d'explication que vous avez bien voulu me donner pour comprendre tout le reste.—Je ne sais comment vous remercier.
Je joins ici le Saint-Évremont. Je l'avais perdu, et il m'a fallu des efforts de mémoire prodigieux pour le retrouver. Vous me direz ce que vous pensez du père Ganaye. Je trouve qu'on ne peut plus lire après cela rien du XIXe siècle.
Adieu.
Londres, samedi 22 juillet 1851.
Je suis bien triste de ce que vous me dites de votre départ; je comptais vous retrouver à Paris et je ne puis m'accoutumer à l'idée de votre éloignement. Je n'ai pas même la consolation de vous gronder; tâchez d'être de retour dans les premiers jours d'août. Je ne vous ferai pas de reproches, parce que je suis sûr que vous ferez tous vos efforts pour me dire adieu. Pensez qu'il est bien dur de passer plusieurs mois sans vous voir. Enfin, vous savez tout le bonheur que j'aurai, et, si la chose est possible, elle se fera.
Le Palais de Cristal est une grande arche de Noé, merveilleux pour la singularité des objets qui s'y trouvent, très-médiocre d'ailleurs au point de vue de l'art; en résumé, on y passe une journée très-amusante.
Je suis si contrarié de votre lettre, que je n'ai pas le courage d'écrire. Adieu.
Paris, jeudi soir, 2 décembre 1851.
Il me semble qu'on livre la dernière bataille, mais qui la gagnera? Si le président la perd, il me semble que les héroïques députés devront céder la place à Ledru-Rollin. Je rentre horriblement fatigué et n'ayant rencontré que des fous, à ce qu'il m'a paru. La mine de Paris me rappelle le 24 février; seulement, les soldats font peur aux bourgeois. Les militaires disent qu'ils sont sûrs du succès; mais vous savez ce que c'est que leurs almanachs. Voilà notre promenade ajournée...
Adieu, écrivez-moi et dites-moi si les vôtres sont engagés dans la bagarre.
Paris, 3 décembre 1851.
Que vous dirai-je? Je n'en sais pas plus long que vous. Il est certain que les soldats ont l'air farouche et font cette fois peur aux bourgeois. Quoi qu'il en soit, nous venons de tourner un récif et nous voguons vers l'inconnu. Rassurez-vous et dites-moi quand je pourrai vous voir.
24 mars 1852.
. . . . . . .
J'ai toutes les tracasseries du monde, outre beaucoup d'ouvrage sur les bras; enfin, j'ai entrepris une œuvre chevaleresque dans un premier mouvement, et vous savez qu'il faut se garder de cela. Je m'en repens parfois. Le fond de la question, c'est qu'à force de voir des pièces justificatives sur l'affaire de Libri, j'ai eu la démonstration la plus complète de son innocence, et je suis à faire une grande tartine dans la Revue, au sujet de son procès et de toutes les petites infamies qui s'y rattachent. Plaignez-moi; il n'y a que des coups à gagner à ce métier-là; mais quelquefois on se sent si révolté par l'injustice, qu'on devient bête.
Quand donc ferons-nous un tour au Musée? Je suis bien fâché d'apprendre cette triste mort d'une personne que vous aimez. Mais c'est une raison de plus pour se voir et essayer si une intimité comme la nôtre est un remède contre le chagrin. Vous avez bien raison de trouver la vie une sotte chose, mais il ne faut pas la rendre pire qu'elle n'est. Après tout, il y a de bons moments, et le souvenir de ces bons moments est plus agréable que le souvenir des mauvais n'est triste. J'ai plus de plaisir à me rappeler nos causeries que de chagrin à penser à nos querelles. Il faut faire ample provision de ces bons souvenirs...
Paris, 22 avril au soir, 1852.
Votre lettre m'a fait grand bien. Je suis en ce moment nerveux comme on l'est après avoir cédé à un premier mouvement; vous savez qu'ils sont presque toujours honnêtes. C'est le moment où tous les sentiments bas reviennent. On me menace d'un procès pour mépris de la justice et attaque contre la chose jugée. Cela me paraît fort, mais tout est possible, y siempre lo peor es Cierto. D'un autre côté, l'École des chartes aiguise ses griffes pour me déchirer. Il va falloir subir peut-être des interrogatoires et faire une polémique enragée. J'espère qu'au moment de la bataille je retrouverai mon énergie. À présent, je suis tout déconfit et ennuyé. Je vous remercie de ce que vous me dites; j'y suis très-sensible. Tâchez de vous porter de mieux en mieux pour venir me voir en prison, le cas échéant.
Vendredi soir, 1er mai 1852.
Ma bonne mère est morte; j'espère qu'elle n'a pas trop souffert. Elle avait les traits calmes et l'air doux qui lui était ordinaire. Je vous remercie de tout l'intérêt que vous lui avez témoigné.
Adieu; pensez à moi et donnez-moi vite de vos nouvelles.
Paris, 19 mai 1852.
Ce beau temps ne vous dit-il rien? Il me renouvelle, à ce qu'il me semble. Je vous attendais presque hier, je ne sais pourquoi; il me semblait que vous auriez dû savoir que je vous attendais. Venez donc au plus vite; j'ai quantité de choses à vous dire. Je ne sais si l'on veut me prendre ou non, et l'on me dit à ce sujet tantôt blanc, tantôt noir. Ce qui me rend très fidgetty, c'est la pensée d'une cérémonie publique[1] devant la fleur de la canaille et trois imbéciles en robe noire, roides comme des piquets et persuadés qu'ils sont quelque chose, auxquels on ne peut songer à dire le profond mépris qu'on a pour leur robe, leur personne et leur esprit.
Adieu; répondez-moi un mot.
[1] L'audience pour l'article poursuivi concernant Libri.
Paris, 22 mai 1852.
Notre promenade vous a-t-elle fatiguée? Dites-moi vite que non. J'attendais un mot de vous aujourd'hui. Je suis confisqué par mon avocat, qui me plaît fort[1]. Il me semble homme d'esprit, point trop éloquent et comprend l'affaire exactement comme moi. Cela me donne un peu d'espérance. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1] M. Nogent Saint-Laurens.
Mai 1852, mercredi à cinq heures.
Quinze jours de prison et mille francs d'amende! Mon avocat a très-bien parlé; les juges ont été très-polis; je n'ai pas été nerveux du tout. En somme, je ne suis pas aussi mécontent que j'aurais le droit de l'être. Je n'en appelle pas.
27 mai 1852, au soir.
Vous êtes, par ma foi, d'un bon sel! J'étais allé l'autre jour chez des magistrats et j'avais eu l'imprudence d'avoir un billet de mille francs dans ma poche. Je ne l'ai plus retrouvé; mais il est impossible que, chez des personnes d'un si haut mérite, il se glisse des coupeurs de bourse; aussi le billet s'est évaporé de lui-même, n'y pensons plus. En même temps, j'ai eu le malheur de toucher un soi-disant pestiféré et l'on a jugé prudent de me mettre en quarantaine pour quinze jours; le grand malheur vraiment! Mon ami M. Bocher va en prison à la fin de juin, nous nous y installerons ensemble. En attendant, j'ai grand besoin de vous voir!—Mes vengeances ont déjà commencé. Mon ami Saulcy se trouvait hier chez des gens où l'on a parlé de l'arrêt qui me concerne; là-dessus, sans consulter l'air du bureau, voilà mon canonnier qui, avec la discrétion de son arme, se lance à tort et à travers dans les grands mots de sottise, fatuité, stupidité, amour-propre de faquins, etc., prenant à témoin un monsieur en habit noir qu'il connaissait de vue, mais dont il ignorait la profession. Or, c'était M. ***, un de mes juges, qui aurait préféré être ailleurs. Figurez-vous l'état de la maîtresse de la maison, des assistants, et enfin Saulcy, averti trop tard, qui tombe sur un canapé en crevant de rire, et disant; «Ma foi, je ne me dédis de rien!»
Lundi soir, 1er juin 1852.
. . . . . . .
Je passe tout mon temps à lire la correspondance de Beyle. Cela me rajeunit de vingt ans au moins. C'est comme si je faisais l'autopsie des pensées d'un homme que j'ai intimement connu et dont les idées des choses et des hommes ont singulièrement déteint sur les miennes. Cela me rend triste et gai vingt fois tour à tour dans une heure et me fait bien regretter d'avoir brûlé les lettres que Beyle m'écrivait. . . . . .
Marseille, 12 septembre 1852.
. . . . . . .
Je suis allé en Touraine, où j'ai visité Chambord par une pluie battante et Saint-Aignan par une pluie intermittente. Je suis rentré à Paris le 7 par la pluie, reparti le même jour au milieu d'un orage et j'ai descendu le Rhône par un brouillard à couper au couteau. C'est seulement dans la Canebière que j'ai retrouvé le soleil; depuis deux jours, il brille dans toute sa gloire. J'y ai trouvé (à Marseille, et non dans le soleil) mon cousin et sa femme, que j'ai embarqués hier sur le Léonidas par une mer d'un bleu céleste, sans une vague, et un temps ni froid ni chaud dont vous n'avez nulle idée en vos tristes pays du Nord. Ce sont les seuls parents qui me restent, et les propriétaires de ce salon que vous avez daigné honorer de votre approbation. Je me suis senti pris d'un isolement bien triste lorsque j'ai vu le panache de fumée du Léonidas disparaître derrière les îles que vous connaissez par la description de Monte-Cristo. Je me suis senti vieux et ganache. J'aurais eu besoin de votre présence et j'ai pensé combien vous vous seriez amusée en ce pays qui me paraît si maussade. Je vous y ferais manger des fruits de vingt espèces différentes qui vous sont inconnues; par exemple, des pêches jaunes et des melons blancs et rouges, des azeroles et des pistaches fraîches. Outre cela, vous passeriez votre journée dans des boutiques de curiosités turques et autres, où il y a les inutilités les plus agréables à voir et les plus désagréables à payer. Je me suis demandé souvent pourquoi vous ne faites pas un voyage dans le Midi, et je ne trouve pas de bonnes raisons contre. Je vais courir les montagnes pendant trois jours, tout seul, sans pouvoir échanger une pensée avec un bipède parlant français. Je ne sais, après tout, si cela ne vaut pas mieux que d'avoir affaire aux provinciaux des villes; chaque année, il me semble qu'ils deviennent plus intolérables. Ici, maires et préfets ont la tête perdue de l'arrivée du président; on blanchit toutes les préfectures, on met des aigles partout où il en peut tenir. Il n'y a pas de niaiseries qu'on n'imagine; quel drôle de peuple! Au milieu de tout cela, je crains bien que les épreuves de Démétrius ne se perdent; car je dois les corriger en route et elles ne m'arrivent pas.
. . . . . . .
Moulins, 27 septembre 1852.
. . . . . . .
J'ai été fort malade et je suis encore assez faible, d'autant plus que le remède qui m'a tiré d'affaire, c'est-à-dire le mistral ou le vent du Nord, m'a donné un rhume qui me fatigue fort et qui ne se guérit pas par les nuits blanches et les courses continuelles. J'ai été, pendant quarante-cinq heures, avec une disposition à la congestion cérébrale telle, que je croyais que j'allais voir le royaume des ombres. J'étais absolument seul, et je me suis traité moi-même ou plutôt je ne me suis pas traité du tout, car j'étais dans un état de prostration physique et moral qui me rendait la moindre excursion horriblement pénible. Je sentais bien quelque ennui de passer dans un monde inconnu; mais ce qui me semblait encore plus ennuyeux, c'était de faire, de la résistance. C'est par cette résignation brute, je crois, qu'on quitte ce monde, non pas parce que le mal vous accable, mais parce qu'on est devenu indifférent à tout, et qu'on ne se défend plus. J'attends ici qu'un monsignore à qui j'ai affaire sorte de retraite. Très-probablement j'aurai pour deux ou trois jours à courir d'après ses indications, puis je reviendrai à Paris. C'est demain mon jour de naissance, que j'aurais voulu passer avec vous. Il se trouve que je suis toujours seul ce jour-là et d'une tristesse abominable.
. . . . . . .
Carabanchel, 11 septembre 1853.
. . . . . . .
En arrivant ici, j'ai trouvé que tout se préparait pour la fête de la maîtresse de la maison. On devait jouer une comédie et réciter et chanter une loa[1] en son honneur et celui de sa fille. J'ai été mis en réquisition pour fabriquer des ciels, réparer des décorations, dessiner des costumes, etc., sans parler des répétitions que je donnais à cinq déesses mythologiques dont une seule avait déjà monté sur un théâtre de société. Mes déesses se sont trouvées très-jolies hier, jour fatal, mais mourantes de peur; cependant, tout a fort bien été. On a fort applaudi, sans comprendre les vers très-amphigouriques du poète auteur de la Loa. Sa comédie, qui était une traduction de Bonsoir, monsieur Pantalon, a encore mieux été, et j'admire la facilité avec laquelle les jeunes filles de la société se transforment en actrices passables. Après la comédie, bal et souper au milieu duquel un jeune protégé de la comtesse a improvisé des vers assez jolis, qui ont fait pleurer l'héroïne de la fête et boire tout le monde un peu vertement. Ce matin, j'ai un mal de tête de chien et je trouve le soleil diablement chaud. Je vais aller à Madrid voir les taureaux, et j'abandonne mes déesses pour deux ou trois jours afin de faire mes visites et de travailler à la bibliothèque. Comme il y a neuf dames ici sans un homme, on m'appelle à Madrid «Apollon». Des neuf muses, il y en a malheureusement cinq qui sont mères ou tantes des quatre autres; mais ces quatre-là sont des Andalouses de race, avec des petits airs féroces qui leur vont à ravir, surtout quand elles sont dans leur costume olympien avec des péplum qu'elles s'obstinent par amour pour l'euphonie à appeler peplo.
Vous avez sans doute un moins beau temps que nous.
. . . . . . .
[1] Loa, espèce de dithyrambe dialogué en l'honneur de la personne que l'on veut fêter.
L'Escurial, 5 octobre 1853.
Je vous envoie une petite fleur que j'ai trouvée dans la montagne, derrière ce vilain couvent de l'Escurial. Je ne l'avais pas rencontrée depuis la Corse; là, cela s'appelle mucchiallo; ici, personne n'en sait le nom. Le soir, lorsque le vent passe dessus, cela a une odeur qui me semble délicieuse. J'ai retrouvé l'Escurial aussi triste que je l'avais laissé il y a quelque vingt ans, mais la civilisation y a pénétré: on y trouve des lits en fer et des côtelettes, plus du tout de punaises ni de moines. Le dernier article me manque beaucoup et rend encore plus ridicule la lourde architecture d'Herrera. Je vais aller dîner à Madrid ce soir, car je ne supporterai pas un jour de plus de ce séjour-ci. Selon toute apparence, je resterai à Madrid jusqu'au 15 de ce mois, et puis j'irai à Valladolid, Toro, Zamora et Léon, si le temps, qui jusqu'à présent a été magnifique, ne se met pas tout d'un coup au laid, chose improbable. Je suis allé à Tolède et ici. J'irai à Ségovie, par quoi j'évite des bals qui m'ennuient fort. J'ai vu l'autre soir l'ouverture du grand Opéra. C'était pitoyable, sauf la salle très-belle et très-commode et remplie de femmes très-jolies. Les acteurs sont d'un médiocre assommant. Si vous étiez ici, vous verriez la plus belle collection de fruits qu'on puisse rencontrer. Il y a une foire à Madrid, et il vient des fruits de fort loin dont la plupart vous sont inconnus. Il est fâcheux que cela ne puisse s'envoyer. S'il y avait ici quelque chose qui vous fût agréable, vous n'avez qu'à parler.
. . . . . . .
Madrid, 25 octobre 1853.
. . . . . . .
Notre colonie s'est dissoute, la duchesse ayant daigné accoucher d'une fille. Sa mère s'est constituée garde-malade, et nous sommes revenus en masse à la ville. J'y ai gagné un rhume odieux, et, pour m'achever, il fait un sirocco du diable. Malgré ce vilain temps et mes éternuments, je suis allé voir hier Cucharès, le meilleur matador depuis Montès. Les taureaux étaient si mauvais, qu'il a fallu en donner un aux chiens et exciter la moitié des autres avec des banderoles de feu. Deux hommes ont été jetés en l'air et nous les avons cru morts un instant, ce qui a jeté quelque intérêt sur la course, autrement tout à fait détestable. Les taureaux n'ont plus de cœur et les hommes ne valent guère mieux. Je pense entreprendre mon voyage archéologique dès que le temps se sera fixé. On m'annonce un été de la Saint-Martin qui ne vient jamais. Il est probable que, si vous me mandiez vos commissions, je recevrais votre lettre à temps pour y faire honneur. Malheureusement, je ne sais pas trop ce qu'il y a de bon dans ce pays-ci. Je vous ai pris à tout hasard des mouchoirs d'un dessin fort laid; mais il m'a semblé que vous vous étiez assez allègrement emparée d'un ces mouchoirs qui me venait je ne sais d'où. Ici, on ne voit plus guère que des costumes français. Hier, aux taureaux, il y avait des chapeaux. Voulez-vous des jarretières et des boutons? Si l'on en porte encore, dites-moi ce qu'il vous en faut, mais ne perdez pas de temps pour me répondre.—Je lis Wilhelm Meister, ou je le relis. C'est un étrange livre, où les plus belles choses du monde alternent avec les enfantillages les plus ridicules. Dans tout ce qu'a fait Goethe, il y a un mélange de génie et de niaiserie allemande des plus singuliers: se moquait-il de lui-même ou des autres? Faites-moi penser à vous donner à lire à mon retour, les Affinités électives. C'est, je crois, ce qu'il a fait de plus bizarre et de plus antifrançais. On m'écrit de Paris pour me vanter un livre d'Alexandre Dumas fils, qui s'appelle un Cas de rupture, ou quelque chose d'approchant. À Madrid, on ne lit pas. Je me suis demandé à quoi les dames passent leur temps quand elles ne font pas l'amour, et je ne trouve pas de réponse plausible. Elles pensent toutes à être impératrices. Une demoiselle de Grenade était au spectacle quand on a annoncé dans sa loge que la comtesse de Téba épousait l'empereur. Elle s'est levée avec impétuosité en s'écriant: En ese pueblo y no hay porvenir.[1]»
Au nombre de mes divertissements, j'ai oublié de vous parler d'une académie de l'histoire dont je suis membre. Elle est presque aussi amusante que la nôtre. Adieu.
[1] «Dans ce pays-ci, il n'y a pas d'avenir.»
Madrid, 22 novembre 1853.
. . . . . . .
Quand je pense à la neige qu'il y a sur le Guadarrama, je perds tout courage: pourtant, nous avons un soleil magnifique; mais il a beau briller, il n'échauffe pas. La nuit, il fait un froid abominable et les factions des soldats au palais ne sont plus que d'un quart d'heure. Avant mon départ, je veux assister encore à quelques séances des Cortès, qui se sont ouvertes avant-hier, très-modestement, sans discours royal, Sa Majesté étant assez près de son terme pour qu'on lui épargne les émotions. Je suis assez bien la politique locale et je connais assez de gens dans tous les partis pour que le spectacle m'amuse en ce moment où nous sommes privés de taureaux. Je vous apporterai des jarretières, puisque vous ne voulez pas de boutons. Ce n'est pas sans peine que je les ai découvertes. La civilisation fait de progrès si rapides, que l'élastique a remplacé à presque toutes les jambes les ligas classiques des temps passés. Lorsque j'ai demandé aux femmes de chambre d'ici de m'indiquer une boutique, elles se sont signées d'indignation, me disant qu'elles ne portaient pas de ces vieilleries-là et que c'était bon pour le peuple. Le progrès des modes françaises est effrayant: les mantilles sont à présent assez rares. Les chapeaux, et quels chapeaux! les remplacent. Vous seriez réjouie de voir les chefs-d'œuvre des couturières de cette capitale. Je suis allé il y a quelques jours passer cinq à six heures à Aranjuez, chez un loup-cervier de mes amis, M. Salamanca. C'est le garçon le plus spirituel et le meilleur diable que j'aie rencontré. Il gagne beaucoup d'argent, comme il semble, et le fait rouler noblement. Il trouve le temps de faire des affaires et de la politique, car il a été ministre et le sera encore, s'il veut. Tout dans cet homme sent l'Andalousie, c'est la grâce même. Nous avons eu le 15, pour la fête de Sainte-Eugénie, un bal à l'ambassade de France où a paru madame ***, femme du ministre des États-Unis, avec un costume à faire crever de rire. Velours noir bordé de galons, d'oripeaux, et diadème de théâtre. Son fils, qui a l'air d'un maroufle, s'est fait renseigner sur la solidité des personnes présentes, et, après avoir pris ses informations, a envoyé un cartel à un duc très-noble, très-riche, fort niais et désireux de vivre longtemps. Les pourparlers durent encore, mais il n'y aura pas mort d'homme.
Adieu.
Madrid, 28 novembre 1853.
Votre lettre s'est croisée avec la mienne, que vous avez dû recevoir au moment où m'arrivait la vôtre. Je vous y expliquais pourquoi je resterais encore quelques jours ici. On me presse fort d'attendre la noche buena, c'est-à-dire Noël; mais je serai en France et probablement à Paris vers le 12 ou le 15, si le temps n'est pas trop mauvais. Je vous écrirai de Bayonne ou de Tours, où je suis obligé de m'arrêter.
. . . . . . .
On danse beaucoup ici, malgré le deuil de cour. Seulement, on met des gants noirs. On est très-agité par les premières délibérations du Sénat. Il s'agit de savoir si ce ministère durera ou s'il y aura un coup d'État. L'opposition est très-animée et se propose de donner des coups de bâton par-dessus les épaules du comte de San-Luis. La maison que j'habite est un terrain neutre où se rencontrent les ministres et les chefs de l'opposition; ce qui est assez agréable pour les amateurs de nouvelles. Il est vrai que ce qui s'appelle ici la société se compose d'un si petit nombre de personnes, que, si elles se fractionnaient, il n'y aurait plus moyen de vivre. Quelque chose que l'on fasse à Madrid, pourvu qu'on aille dans un lieu public, on est sûr de rencontrer les mêmes trois cents personnes. Il en résulte une société très-amusante et infiniment moins hypocrite qu'ailleurs. Il faut que je vous conte une bonne bêtise. L'usage ici est d'offrir tout ce qu'on loue. La belle du premier ministre dînait l'autre jour à côté de moi; elle est bête comme un chou et fort grosse. Elle montrait d'assez belles épaules sur lesquelles tombait une guirlande avec des glands en métal ou en verre. Ne sachant que lui dire, je lui fis l'éloge des unes et des autres, et elle me répondit: Todo eso a la disposition de V. Adieu; écrivez-moi plus longuement. Je puis à la rigueur recevoir de vos nouvelles ici, mais j'espère sûrement trouver une lettre de vous à Bayonne.—Pourquoi ai-je tant d'envie de vous revoir? Il y a pourtant quelque chose de très-pénible à se conformer à vos protocoles, dignes de M. de Nesselrode pour le mépris de la logique et de la vraisemblance.
Paris, 29 juillet 1854.
Je suis arrivé ici avant-hier, et je ne vous ai pas écrit plus tôt parce que j'étais trop triste. J'ai trouvé ici un de mes amis d'enfance entrepris par le choléra. Aujourd'hui, on le croit à peu près hors de danger. En passant le détroit, il faisait un vent glacé qui m'a donné un rhume ou rhumatisme étrange. Je souffre comme si j'avais la poitrine serrée dans un cercle de fer et tous les mouvements que je fais sont douloureux. Pourtant, il faut que je parte ce soir pour la Normandie, où je vais faire un discours aux oisifs de Caen. La corvée finie, je reviendrai au plus vite. Je pense être à Paris le 2 août au soir. Après cela, je n'ai plus de projet arrêté. D'abord, j'avais eu l'idée d'aller passer un mois à Venise; mais les quarantaines et les autres ennuis suscités par le choléra rendent un voyage de ce côté à peu près impossible. Mon ministre m'a offert de m'envoyer à Munich, comme commissaire de je ne sais quoi, à propos d'une exposition bavaroise. Je n'ai dit ni oui ni non et j'attendrai mon retour à Paris pour me décider. Probablement, vous irez passer quelques jours à Londres, et le Palais de Cristal mérite ce voyage. Sous le rapport d'art et de goût, cela est parfaitement ridicule, mais il y a dans l'invention et l'exécution quelque chose de si grand et de si simple à la fois, qu'il faut aller en Angleterre pour s'en faire une idée. C'est un joujou qui coûte vingt-cinq millions, et une cage où plusieurs grandes églises pourraient valser. Les derniers jours que j'ai passés à Londres m'ont amusé et intéressé. J'ai vu et pratiqué tous les hommes politiques, j'ai assisté au débat des subsides à la Chambre des lords et aux Communes, et tous les orateurs en renom ont parlé, mais très-méchamment, à ce qu'il m'a semblé. Enfin, j'ai fait un très-bon dîner. On en fait d'excellents au Palais de Cristal, et je vous les recommande, à vous qui êtes gourmande. J'ai rapporté de Londres une paire de jarretières qui viennent, à ce qu'on m'assure, de chez Borrin. Je ne sais ce que mettent les Anglaises à leurs bas, ni comment elles se procurent cet article indispensable, mais je crois que ce doit être une chose bien difficile et bien trying pour leur vertu. Le commis qui m'a donné ces jarretières en a rougi jusqu'aux oreilles.—Vous me dites des choses très-aimables, qui me feraient le plus grand plaisir, si l'expérience ne m'avait rendu par trop défiant. Je n'ose espérer ce que je désire le plus ardemment. Vous savez que vous n'avez qu'à remuer un doigt pour que j'accoure.
Je voudrais que vous fissiez comme si nous étions l'un et l'autre en danger de ne plus nous revoir, en ce temps de si grande incertitude. Adieu; je vous aime bien, quoi que vous fassiez. Écrivez-moi à Caen, chez M. Marc, capitaine de vaisseau. Je serai bien heureux d'avoir de vos nouvelles.
Paris, 2 août au soir, 1854.
Je suis arrivé ici ce matin, très-courbaturé, très-ennuyé, très-souffrant et très-triste. Je ne me guéris pas de cette douleur au côté et à la poitrine qui m'empêche de trouver une position pour dormir. Avant-hier, je suis arrivé à Caen, le jour même de la cérémonie. J'ai vu le secrétaire et j'ai pris mes mesures pour échapper à toutes les visites officielles. À trois heures, je suis entré dans la salle de l'École de droit, où j'ai trouvé dix-huit à vingt femmes dans une tribune, et environ deux cents hommes avec des figures telles que toute autre ville peut en offrir, selon toute apparence'; silence merveilleux. J'ai débité ma tartine sans la plus légère émotion, et on a applaudi très-poliment. La séance a duré encore une heure et demie et s'est terminée par la lecture de vers d'un bossu, haut de deux pieds et demi, pas trop mauvais. Immédiatement j'ai été emmené entre les autorités à l'hôtel de ville, où l'on m'a donné un banquet, qui n'a duré que deux heures et où il y avait de très-bons poissons et des homards délicieux. Je croyais en être quitte, lorsque le président des antiquaires s'est levé et tout le monde avec lui. Il a pris la parole, et a dit qu'il proposait de boire à ma santé, attendu que j'étais remarquable à trois points de vue, c'est à savoir: comme sénateur, comme homme de lettres et comme savant. Il n'y avait que la table entre nous et j'avais une grande envie de lui jeter à la tête un plat de gelée au rhum. Pendant qu'il parlait, je méditais ma réponse sans qu'il me fût possible de trouver un mot. Lorsqu'il s'est tu, j'ai compris qu'il fallait absolument parler et j'ai commencé une phrase sans savoir comment je la continuerais. J'ai parlé de la sorte pendant cinq ou six minutes avec beaucoup d'aplomb, sans trop me rendre compte de ce que je disais. On m'a assuré que j'avais été très-éloquent; mais je n'en étais pas quitte. Le maire m'a empoigné et mené à un concert que les dames et les messieurs de la Société philharmonique donnaient au bénéfice des pauvres. J'ai été exposé sur un fauteuil à un très-grand nombre de gens bien vêtus, les femmes très-jolies et très-blanches, habillées comme à Paris, si ce n'est qu'elles exhibaient moins d'épaules et qu'avec des robes de bal elles avaient des brodequins marrons. On a chanté fort mal et des airs d'opéra-comique; puis une grande femme très-parée, de la haute, a fait la quête dans une coupe de cristal. Je lui ai donné vingt francs, ce qui m'a valu une révérence en fromage des plus gracieuses. À minuit, on m'a ramené chez moi, où j'ai très-mal dormi et même pas du tout. À huit heures, le lendemain, on est venu me chercher pour présider une séance non politique, et j'ai entendu le procès-verbal de la veille, où il était dit que j'avais parlé très-éloquemment. J'ai fait un speech pour que le procès-verbal fût purgé de tout adverbe, mais inutilement. Enfin, je suis remonté en malle-poste et me voilà: tout serait au mieux si je pouvais passer une bonne journée avec vous pour me remettre.—Je ne crois pas à vos impossibilités. Je garde mes doutes et mon chagrin. Mon ministre voudrait que j'allasse à l'Exposition de Munich. Je n'en ai pas trop envie; mais où aller cette année, si ce n'est en Allemagne? Adieu; je vous aime quoi que vous fassiez et je crois que vous devriez être un peu plus touchée de cela. Vous pouvez toujours m'écrire ici.
Innsbruck, 31 août 1854.
Je suis bien las et pourtant j'ai envie de vous écrire. J'ai la tête lourde et je suis ivre de paysages et de panoramas magnifiques, depuis quatre jours. Je suis parti de Bâle pour aller à Schaffouse, d'où l'on s'embarque sur le Rhin. À droite et à gauche, ce sont des montagnes ravissantes, beaucoup plus belles que celles, ou les soi-disant telles, qui bordent le Rhin inférieur, si admiré des Anglaises, entre Mayence et Cologne. Du Rhin, nous entrâmes dans le lac de Constance et dans la ville de ce nom, où nous mangeâmes des truites fort bonnes et entendîmes des Tyroliens jouer du zitther. Traversant le lac, nous allâmes à Lindau, où nous attendait un chemin de fer qu'on a fait passer devant les plus belles forêts, les plus beaux lacs, les plus belles montagnes que produit la contrée. Cela nous a menés à Kempten; seulement, on est accablé de fatigue, comme après avoir longtemps examiné une belle galerie de tableaux. Au lieu de nous reposer, nous sommes repartis la nuit de Kempten, et nous sommes arrivés hier quelques minutes avant minuit à Innsbruck, au travers d'un pays encore plus beau, non, mais plus grand que celui que nous venions de voir. Le désagrément a été de changer, de calculer à toutes les postes. Il y en a au moins une douzaine entre Kempten et Innsbruck.
Je mange des bécasses délicieuses, pour me refaire, et des soupes très-extraordinaires, mais qui ont leur mérite quand on a pris de l'appétit à beaucoup de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le drawback de ce voyage, c'est qu'on ne connaît pas les mœurs et les idées de ce peuple, et cela est plus intéressant que tous les paysages. Les femmes m'ont paru, dans le Tyrol, traitées selon leurs mérites. On les attache à des chariots et elles traînent des fardeaux fort lourds avec succès. Elles m'ont paru fort laides, avec des pieds énormes; les belles dames que j'ai rencontrées en chemin de fer ou en bateau ne sont pas beaucoup mieux. Elles ont des chapeaux indécents et des brodequins bleu de ciel, avec des gants vert-pomme. C'est en grande partie ces qualités susdites qui composent ce que les naturels appellent gemüth et dont ils sont très-vaniteux.
À voir les œuvres d'art de ce pays, il me semble que ce dont il manque le plus radicalement, c'est l'imagination. Il s'en pique pourtant et tombe alors dans des extravagances prétentieuses. Je viens de voir la ville: tout y est neuf, sauf le tombeau de Maximilien; mais un site admirable. Plus de costumes: le monde qu'on rencontre est laid et a l'air commun; mais on ne peut faire un pas sans voir une montagne, et quelle montagne! Demain, nous montons au glacier. Le temps est magnifique et promet de durer. En somme, je suis content d'être parti. Je voudrais que vous fussiez avec moi; il me semble que vous trouveriez de quoi vous amuser, plus qu'au milieu de vos loups marins. Quand revenez-vous à Paris? Écrivez-moi à Vienne. Ne perdez pas de temps. Écrivez-moi très-longuement et très-tendrement.
Tenez, voici une fleur du Brenner.
Prague, 11 septembre 1854.
Mes compagnons m'ont quitté ce matin pour s'en retourner en France. Je suis souffrant et out of spirits, il me vient les idées les plus noires. Si je suis mieux demain matin, je partirai pour Vienne, où je serai dans la soirée. Je commence à m'ennuyer horriblement. Cette ville-ci est très-pittoresque et on y fait de très-bonne musique. Hier, j'ai couru trois ou quatre jardins et concerts publics, où j'ai vu danser des danses nationales et des valses, le tout avec décence et sang-froid; pourtant, rien de plus entraînant qu'un orchestre bohémien. Les figures ici sont très-différentes de celles que j'avais encore vues en Allemagne: de très-grosses têtes, de larges épaules, très-peu de hanches et pas du tout de jambes, voilà la description d'une beauté bohémienne.
Hier, nous employions inutilement notre savoir en anatomie, pour comprendre comment ces femmes-là marchent. À cela près, elles ont de fort beaux yeux et quelquefois des cheveux noirs très-longs et très-fins, mais des pieds et des mains d'une longueur, d'une grosseur et d'une largeur qui surprennent les voyageurs les plus habitués aux choses extraordinaires. La crinoline leur est inconnue. Le soir, elles boivent, dans les jardins publics, une carafe de bière, et prennent après une tasse de café au lait, ce qui les dispose à manger trois côtelettes de veau avec du jambon, et c'est à peine s'il leur reste de la place pour quelques pâtisseries légères, de la nature de nos babas. Telles sont mes observations sur les mœurs et les coutumes. Mon lit se compose d'une couverture des couleurs les plus jolies, d'un mètre de long, à laquelle est boutonnée une serviette qui me sert de drap. Quand j'ai mis cela en équilibre sur moi, mon domestique dépose sur le tout un édredon que je passe toutes les nuits à culbuter et à replacer; mais, en revanche, je mange toute sorte de choses très-extraordinaires, entre autres des champignons crus marinés qui sont excellents et des oiseaux de montagne idem; tout cela ne m'empêche pas de souhaiter beaucoup votre présence. Selon toute apparence, vous vous trouvez à merveille à D..., sans songer aux gens malheureux qui errent en Bohême. Votre sublime indifférence, vraie ou fausse (c'est ce que je n'ai pas encore pu savoir), m'irrite beaucoup. Vous ne pensez aux gens que lorsque vous les voyez. Je suis dans une grande incertitude quant à ce que je ferai. Si j'avais l'assurance de vous faire enrager en restant longtemps à Vienne, je m'y installerais pour Dieu sait combien de mois; mais vous n'en perdriez pas une bouchée, et je crains fort de m'ennuyer mortellement de leur gemüth. Il est donc probable que je ne resterai à Vienne que juste assez longtemps pour voir les étrangetés, c'est-à-dire environ les derniers jours du mois. Vers le 1er octobre, je pourrais être à Berlin, et, avant le 10 ou le 12, à Paris.—Je suppose que vous m'avez écrit à Vienne, pour me dire ce que vous faites et ce que vous comptez faire; cela aura une grande influence sur mes résolutions. Je viens de voir des autographes de Ziska et de Jean Huss. Ils avaient une très-belle écriture l'un et l'autre pour des hérésiarques.
Vienne, 2 octobre 1854.
Really truly, cette bonne ville de Vienne est un séjour agréable, et il me faut une certaine force d'âme pour la quitter, maintenant que j'y ai des amis et que j'ai compris le plaisir d'y flâner. Ajoutez à cela l'avantage d'avoir les nouvelles de Crimée quelques minutes avant vous. Nous sommes depuis avant-hier dans toutes les émotions. Sébastopol est-il pris? lorsque cette lettre vous arrivera, tout sera fini sans doute. Ici, on le croit, mais un peu légèrement, à mon avis. Les Autrichiens, sauf quelques anciennes familles russes de cœur, nous font des compliments. Un cocher de fiacre m'a félicité avant-hier en sortant de l'Opéra. Plaise à Dieu que tout cela ne soit pas une de ces nouvelles comme en fait le télégraphe électrique quand il est de loisir. Quoi qu'il en soit, je trouve très-beau que nos gens, six jours après leur débarquement, aient vigoureusement frotté les Russes. Nous avons ici lady Westmoreland, qui est sœur de lord Raglan et mère de l'aide de camp du susdit, qui était dans tous ses états. Elle a reçu hier au soir un mot de son fils, après la bataille. Nous jouissons beaucoup de la figure des Russes de Vienne. Le prince Gortshakof a dit que c'était un incident, mais que cela ne faisait rien aux principes. Le ministre de Belgique, qui est ici le bel esprit, a dit qu'il avait raison de se retrancher dans les principes, parce qu'on ne les prenait pas à la baïonnette. À propos de bel esprit, on m'a constitué ici lion, bon gré, mal gré. Prononcez laïonne à l'anglaise, pour ne pas avoir une idée fausse du rôle qu'on m'a fait jouer. L'autre jour, on m'amené à Baden, qui est un endroit charmant, dans une vallée, aux portes de Vienne, mais où l'on se croirait à cent lieues d'une grande ville. Mon cornac m'a conduit chez de très-belles dames. Le monde étant ici gemüthlich, on prend tout ce que dit un Français pour de l'esprit. On m'a trouvé très-aimable. J'ai écrit des pensées sublimes sur des albums, j'ai fait des dessins; en un mot, j'ai été parfaitement ridicule. C'est en partie la honte de ce métier-là qui me fait prendre aujourd'hui le chemin de Dresde. Je ne m'y arrêterai qu'un jour et j'irai à Berlin; après avoir vu le musée, je partirai pour Cologne et j'y trouverai une lettre de vous.
Vous ai-je dit que j'étais allé en Hongrie? J'ai passé trois jours à Pesth et me suis cru en Espagne ou plutôt en Turquie. Ma pudeur y a beaucoup souffert, car on m'a montré un bain public à Bade, où les Hongrois et les Hongroises sont pêle-mêle dans un court-bouillon d'eau minérale très-chaude. J'y ai vu une très-belle Hongroise, qui s'est caché la figure de ses mains, n'ayant pas comme les femmes turques des chemises pour se voiler le visage. Ce spectacle m'a coûté six kreutzer, soit quatre sous. J'ai vu la Dame de Saint-Tropez au théâtre hongrois, n'ayant pas l'esprit de reconnaître un mélodrame français sous le titre S.-Tropez à Unôz. J'ai entendu des musiciens bohémiens jouer des airs hongrois très-originaux, qui font perdre la tête aux gens du pays. Cela commence par quelque chose de très-lugubre et finit par une gaieté folle et qui gagne l'auditoire, lequel trépigne, casse les verres et danse sur les tables. Mais les étrangers n'éprouvent pas ces phénomènes. Enfin, et je garde le plus beau pour la fin, j'ai vu une collection de vieux bijoux magyars, d'un travail merveilleux. Si j'avais pu vous en apporter un, vous seriez venue jusqu'à Cologne, pour l'avoir plus tôt.
Parmi toutes ces courses, je me porte à merveille; le temps est admirable, mais froid le soir. Je ne crains pas le froid pour ma route, car j'ai acheté une pelisse énorme pour soixante-quinze florins. Vous trouveriez ici pour rien des fourrures magnifiques. C'est, je crois, la seule chose à bon marché en ce pays. Je m'y ruine en fiacres et en dîners en ville. L'usage est de payer son dîner aux domestiques; on paye le portier en sortant, enfin on paye partout, pas grand' chose à la fois, il est vrai. Adieu; je ne suis pas trop content de votre dernière lettre, sinon de ce que vous m'annoncez votre prochain retour à Paris. Bien que je n'aie pas de chaînes magyares, j'espère que vous me recevrez bien. Je commence à désirer de revoir mon gîte et les soirées me semblent un peu bien longues.
Je pense être à Cologne avant huit jours, et à Paris du 10 au 15.
Paris, dimanche, 27 novembre 1854.
Il est bien malheureux de perdre ses amis, mais c'est une calamité qu'on ne peut éviter que par une autre bien plus grande, qui est de n'aimer rien. Surtout, il ne faut pas oublier les vivants pour les morts. Vous auriez dû venir me voir au lieu de m'écrire. Il faisait un temps magnifique. Nous aurions causé philosophiquement sur les vanités de ce monde. Je suis resté toute la journée au coin de mon feu, en disposition très-sombre et misanthropique, et de plus très-souffrant. Ce soir, je vais un peu mieux, mais je serai plus mal si je ne vous vois pas demain.
Londres, 20 juillet 1856.
J'ai reçu votre lettre hier soir, qui m'a fait un très-grand plaisir. Si je ne craignais de rêver, je vous dirais des tendresses à cette occasion. Je partirai bientôt pour Édimbourg. Je consulterai un sorcier écossais. On veut me mener voir un vrai chieftain, qui n'a pas de culottes et qui n'en a jamais porté, qui n'a pas d'escalier dans sa maison, qui a son barde et son sorcier. Cela ne vaut-il pas la peine de faire le voyage? J'ai trouvé ici des gens si accueillants, si aimables, si accaparants, qu'il est évident qu'ils s'ennuient beaucoup. J'ai revu hier deux de mes anciennes beautés: l'une est devenue asthmatique et l'autre méthodiste; puis j'ai fait la connaissance de huit à dix poètes, qui m'ont paru quelque chose d'encore plus ridicule que les nôtres. J'ai revu le palais de Sydenham avec plaisir, quoiqu'on l'ait entièrement gâté par de grands monuments bâtis aux héros de Crimée. Les héros en question sont ivres toute la journée par les rues. Il y a encore beaucoup de monde à Londres, mais tous se préparent à s'envoler. Pour moi, je vais lundi chez le duc de Hamilton. J'y resterai jusqu'à mercredi, jour où je ferai mon entrée à Édimbourg. Probablement dans quinze jours, je reviendrai ici vous retrouver. Tâchez d'être arrivée. Vous ne pouvez me donner une plus grande preuve d'affection; vous savez quel bonheur j'en ressentirais. Adieu; vous pouvez m'écrire Douglas hotel, Edinburg. J'y serai quelques jours avant de me lancer dans le Nord.
Édimbourg, Douglas hotel, 26 juillet 1856.
J'espérais avoir une lettre de vous, ici ou à Édimbourg. Point de nouvelles. Le pire, c'est que je m'enfonce dans le Nord et je ne sais où vous dire d'adresser vos lettres. Je vais avec un Écossais voir son château, bien loin au delà des lacs, mais je ne saurais vous dire où nous nous arrêterons sur la route, ce qu'il me promet avec force châteaux, ruines, paysages, etc. Dès que je serai apprêté, je vous écrirai encore. J'ai passé trois jours chez le duc de Hamilton, dans un château immense et dans un très-beau pays. Il y a tout près du château, à moins d'une heure, un troupeau de bœufs sauvages, les derniers qui existent en Europe. Ils m'ont paru aussi civilisés que les daims de Paris. Partout dans ce château, il y a des tableaux de grands maîtres, des vases grecs et chinois magnifiques et des livres aux reliures des plus grands amateurs du siècle dernier. Tout cela est disposé sans goût et l'on voit que le propriétaire en jouit très-médiocrement. Je comprends maintenant pourquoi on recherche les Français en pays étranger. Ils se donnent de la peine pour s'amuser, et, ce faisant, amusent les autres. Je me suis senti la personne la plus amusante de la très-nombreuse société où nous étions, et j'avais en même temps la conscience de ne l'être guère. J'ai trouvé Édimbourg tout à fait à mon goût, sauf l'architecture exécrable des monuments, qui ont la prétention d'être grecs et qui la justifient comme une Anglaise justifie celle de paraître Parisienne, en se faisant habiller par madame Vignon. L'accent de tous les natifs m'est odieux. J'ai échappé aux antiquaires après avoir vu leur exposition, qui est fort belle. Les femmes sont ici en général très-laides. Le pays exige des robes courtes, et elles se conforment à la mode et aux exigences du climat en tenant leur robe à deux mains, à un pied de leurs jupons, laissant voir des jambes nerveuses et des brodequins de cuir de rhinocéros avec des pieds idem. Je suis choqué de la proportion de rousses que je rencontre. Le site est charmant, et, depuis deux jours, il fait chaud et le temps est clair. En somme, je suis assez bien, sauf que je voudrais vous avoir avec moi. Lorsque l'ennui et les blue devils me gagnent, je pense à nos jours de gaieté intime, auxquels je ne connais rien d'égal. Toute réflexion faite, écrivez-moi à Douglas hotel, Edinburg. Je ferai retirer mes lettres, si je ne reviens pas vite.
Dimanche, 3 août 1856.
D'une maison de campagne,
près de Glasgow.
Je m'ennuie de vous, comme vous le disiez si élégamment autrefois. Je mène cependant une vie douce, allant de château en château, partout hébergé avec une hospitalité pour laquelle je désespère de trouver un adjectif et qui n'est praticable qu'en cet aristocratique pays. J'y prends de mauvaises habitudes. Arrivant ici chez de pauvres gens qui n'ont guère plus de trente mille livres de rente, je me suis trouvé méconnu en voyant qu'on me donnait à dîner sans instruments à vent et sans un joueur de cornemuse en grand costume. J'ai passé trois jours chez le marquis de Breadalbane, à me promener en calèche dans son parc. Il y a environ deux mille daims, outre huit à dix mille autres dans ses bois non adjacents au château de Faymouth. Il y a aussi comme singularité, chose à quoi chacun vise ici, un troupeau de bisons américains, très-féroces, qu'on enferme dans une péninsule et qu'on va voir par les fentes de leurs palissades. Tout ce monde-là, marquis et bisons, a l'air de s'ennuyer. Je crois que leur plaisir consiste à faire envie aux gens, et je doute que cela compense le tracas qu'ils ont d'être les aubergistes du tiers et du quart. Parmi tout ce luxe, j'observe de temps en temps de petites mesquineries qui me divertissent. Au fond, je n'ai encore rencontré que d'excellentes gens qui me prennent avec mon caractère si opposé au leur, sans la moindre difficulté.
On vient de me conter une histoire qui me réjouit et dont je veux vous faire part. Un Anglais se promène le long d'un poulailler, dans un château d'Écosse, un samedi soir. Grand bruit, cris de coqs et de poules. Il croit que quelque renard est entré et il avertit. On lui répond que ce n'est rien, et qu'on sépare seulement les coqs des poules pour qu'ils ne polluent pas the Lord's day.
Avant mon retour, vous voudrez bien m'écrire: 18, Arlington Street, care of the honble E. Ellne. On m'enverra de là vos lettres ou bien on les gardera pour mon arrivée à Londres. Adieu. Je n'ai pas besoin de vous dire de m'écrire le plus souvent que vous pourrez.
Kinloch-Linchard, 16 août 1856.
Je n'ai pas été trop content de votre lettre, que j'ai reçue au moment de quitter Glenquoich Vous savez que vous avez toujours une première façon précipitée d'envisager les choses, qui vous fait regarder comme impossibles les actions les plus simples. Repensez donc à ce que je vous ai dit, et, après avoir réfléchi mûrement, répondez oui ou non. Adressez votre réponse à Londres, chez le Right honble E. Ellne, 18, Arlington Street.
. . . . . . .
Je commence à avoir par-dessus la tête des grouses et de la venaison. Les paysages, vraiment remarquables, que je vois tous les jours ont encore du charme pour moi, mais j'ai satisfait ma curiosité, et je ne trouverai plus rien d'extraordinaire. Ce que je ne puis assez me lasser d'admirer, c'est la hérissonnerie de ces gens-là. Ils seraient mis aux galères ensemble, qu'ils n'en deviendraient pas plus sociables. Cela tient à ce qu'ils craignent d'être pris sur le fait à être bêtes, comme disait Beyle, ou bien à une organisation qui leur fait préférer les jouissances égoïstes: le devine qui pourra. Nous sommes arrivés ici en même temps que deux hommes et une femme entre deux âges, du grand monde et ayant voyagé. Au dîner, il a fallu casser la glace. Après le dîner, le mari a pris un journal, la femme un livre, l'autre homme s'est mis à écrire des lettres, tandis que, moi, je faisais la chouette au maître et à la maîtresse de la maison. Notez bien que les gens qui s'isolaient ainsi dans un salon avaient été aussi longtemps et plus que moi sans voir notre hôtesse, et qu'ils avaient nécessairement beaucoup plus de choses que moi à lui conter. On me dit, et je suis disposé à le croire par le peu que j'ai vu, que la race celtique (qui vit dans d'affreux trous autour du palais que je fréquente) sait causer. Le fait est qu'un jour de marché, on entend un bruit continuel de voix très-animées, des rires et des cris. Le gaélique est très-doux. En Angleterre et dans les Lowlands, silence complet. Ce n'est pas bien à vous de ne m'avoir écrit qu'une fois. Je vous ai écrit au moins deux fois pour une. Mais je n'ai pas envie de vous quereller de si loin. Voici mes projets. Je partirai d'ici pour aller à Inverness, où je resterai un jour; de là à Édimbourg, puis à York, Durham et peut-être Derby. Je compte être le 23 à Paris.
Carabanchel, jeudi, décembre 1856.
(J'ai oublié le quantième.)
Il fait une pluie effroyable. Hier, le plus beau temps du monde. On me promet qu'il reviendra demain. J'ai profité de ce beau temps pour me fouler le poignet, et, si je vous écris, c'est que j'ai été instruit dans la méthode américaine, où l'on ne remue pas les doigts. Cela m'est arrivé par la faute d'un cheval qui voulait absolument dire quelque chose d'inconvenant à la jument de lord A..., et qui, irrité de ma résistance à sa passion coupable, m'a traîtreusement jeté par-dessus sa tête, d'une ruade, lorsque j'allumais mon cigare. Cela se passait dans un sentier au bord de la mer, qui n'était qu'à cent pieds plus bas et j'ai choisi heureusement le sentier pour tomber. Je ne me suis fait aucun mal, sauf à la main, qui est aujourd'hui très-enflée. Je compte aller la semaine prochaine à Cannes, où vous serez aimable de m'écrire, poste restante. Pour en finir sur le chapitre de la santé, je crois que je serai beaucoup mieux. Cependant, j'ai ressenti encore une fois un de ces étourdissements qui m'inquiétaient, mais moins fort qu'à Paris. Il y a ici un médecin qui me dit que ce sont des spasmes nerveux et qu'il faut faire beaucoup d'exercice. Ainsi fais-je, mais je ne dors pas plus qu'à Paris, bien que je me couche à onze heures. Il n'eût tenu qu'à moi de passer lion (dans le sens anglais); tout le monde s'ennuie ici. J'ai été assiégé de cartes russes et anglaises, et on a voulu me présenter à la grande-duchesse Hélène, honneur que j'ai décliné avec empressement. Nous avons pour fournir aux cancans une comtesse Apraxine, qui fume, porte des chapeaux ronds et a une chèvre dans son salon, qu'elle a fait couvrir d'herbes. Mais la personne la plus amusante est lady Shelley, qui, tous les jours, fait quelque nouvelle drôlerie. Hier, elle écrivait au consul de France: «Lady S..., prévient M. P... qu'elle a aujourd'hui un charmant dîner d'Anglais et qu'elle sera charmée de le voir après, à neuf heures cinq.» Elle a écrit à madame Vigier, ex-mademoiselle Cruvelli: «Lady Shelley serait charmée de voir madame Vigier, si elle voulait bien apporter sa musique avec elle.» À quoi l'ex-Cruvelli a répondu aussitôt: «Madame Vigier serait charmée de voir lady Shelley, si elle voulait bien venir chez elle et s'y conduire comme une personne comme il faut.»—Et vous, à quoi passez-vous votre temps? Je suis sûr que vous ne pensez plus guère à Versailles, par suite de cette absence de souvenirs qui vous caractérise. J'espère que nous irons en mars voir pousser les premières primevères. Et cette étrange soirée et matinée de Versailles, tout cela était-il vrai?
Adieu; écrivez-moi vite à Cannes.
Lausanne, 24 août 1857.
J'ai trouvé votre lettre à Berne, le 22 au soir, parce que mes excursions dans l'Oberland se sont prolongées bien au delà du temps que j'avais prévu. Je ne sais trop où vous adresser celle-ci. Vous ne devez plus être à Genève. Je l'adresse à Venise, où, selon toute apparence, vous ferez le plus long séjour. Je trouve que vous auriez pu varier un peu vos tirades d'enthousiasme sur le plaisir de voyager, par quelques compliments flatteurs en manière de consolation pour ceux qui n'ont pas l'avantage de vous accompagner. Je vous pardonne cependant en faveur de votre inexpérience des voyages. Vous comptez n'être que trois semaines en route: cela me paraît à peu près impossible. Je vous accorde un mois. Je vous prie seulement de considérer que le 28 septembre est un anniversaire malheureux pour moi, parce qu'il date de très-longtemps. C'est le 28 septembre que je suis venu au monde. Il me serait très-agréable de passer ce jour-là en votre compagnie; à bon entendeur salut. J'ai fait ma petite tournée très-agréablement. Je n'ai eu qu'un jour de pluie; il est vrai que je n'en ai pas perdu une goutte en descendant de la Wengernalp, pendant quatre heures, sur une rosse qui glissait sur les roches et qui n'avançait pas. J'ai bu du vin de Champagne que nous avions apporté sur la Mer de glace et que j'ai frappé à même le glacier. Le guide m'a dit que personne avant moi n'avait eu cette idée sublime. Je suis en face de la Gemmi et de la chaîne du Valais, qui n'a pas les grands profils de la Jungfrau et de ses acolytes. Je pense que nous aurions pu nous rencontrer à Genève et faire ensemble quelque excursion; tout cela est triste à penser. J'espère trouver une lettre de vous à Paris, où je serai le 28.
Adieu; amusez-vous bien, ne vous fatiguez pas trop. Pensez quelquefois à moi. Si vous me marquez votre itinéraire avec quelque exactitude, je vous donnerai des nouvelles de Paris. Ici, c'est le diable d'écrire. Les plumes du pays sont ce que vous voyez. Adieu encore.—Voici une petite feuille qui a cru à six mille pieds au-dessus du niveau de la mer.
End of the Project Gutenberg EBook of Lettres à une inconnue, Tome Premier, by
Prosper Mérimée
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LETTRES UNE INCONNUE ***
***** This file should be named 56473-h.htm or 56473-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/6/4/7/56473/
Produced by Laura Natal Rodrigues and Marc D'Hooghe at
Free Literature (Images generously made available by the
Internet Archive.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.