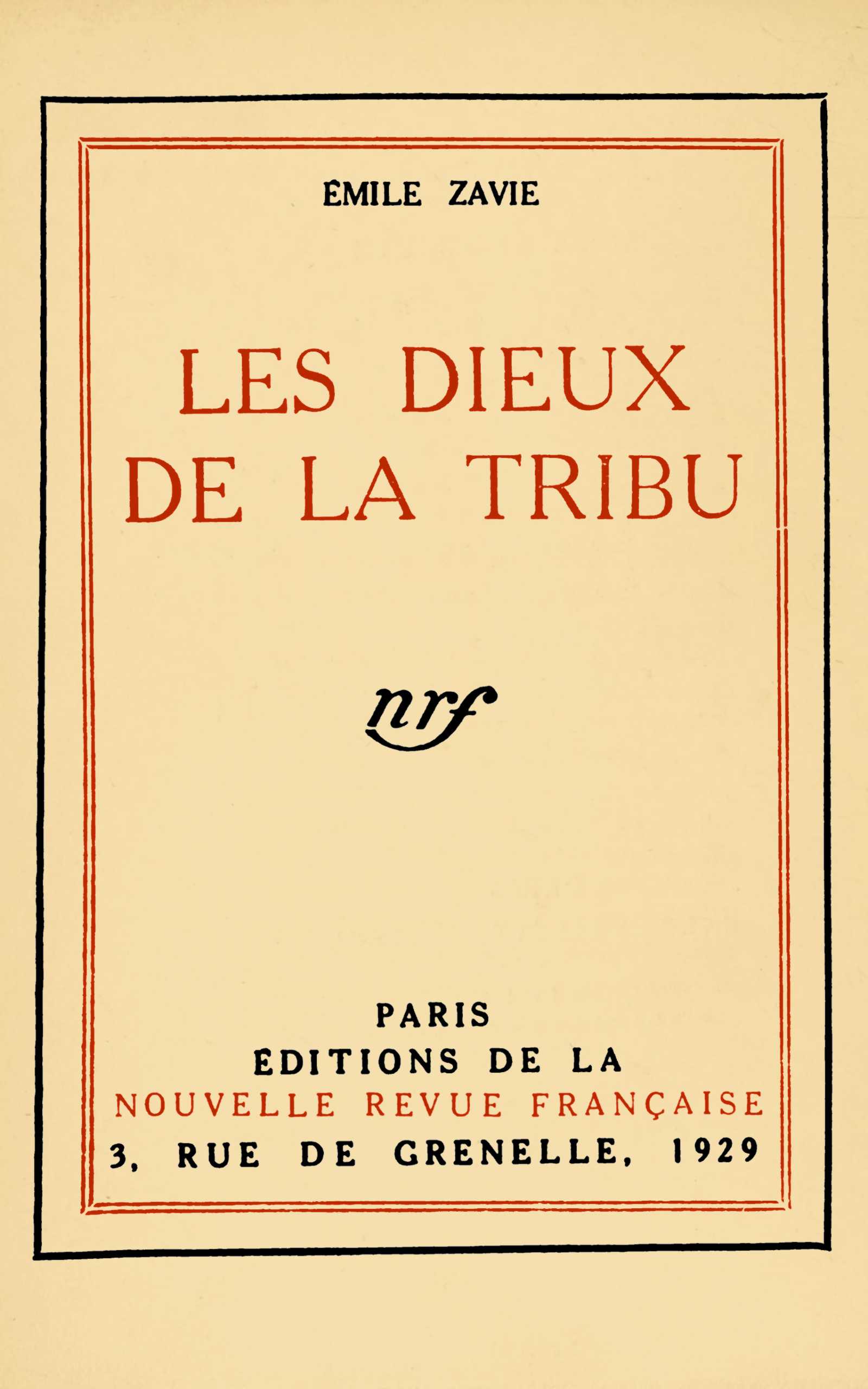
Title: Les dieux de la tribu
Author: Émile Zavie
Release date: February 17, 2026 [eBook #77973]
Language: French
Original publication: Paris: Gallimard, 1929
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/77973
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This book was produced from images made available by the HathiTrust Digital Library.)
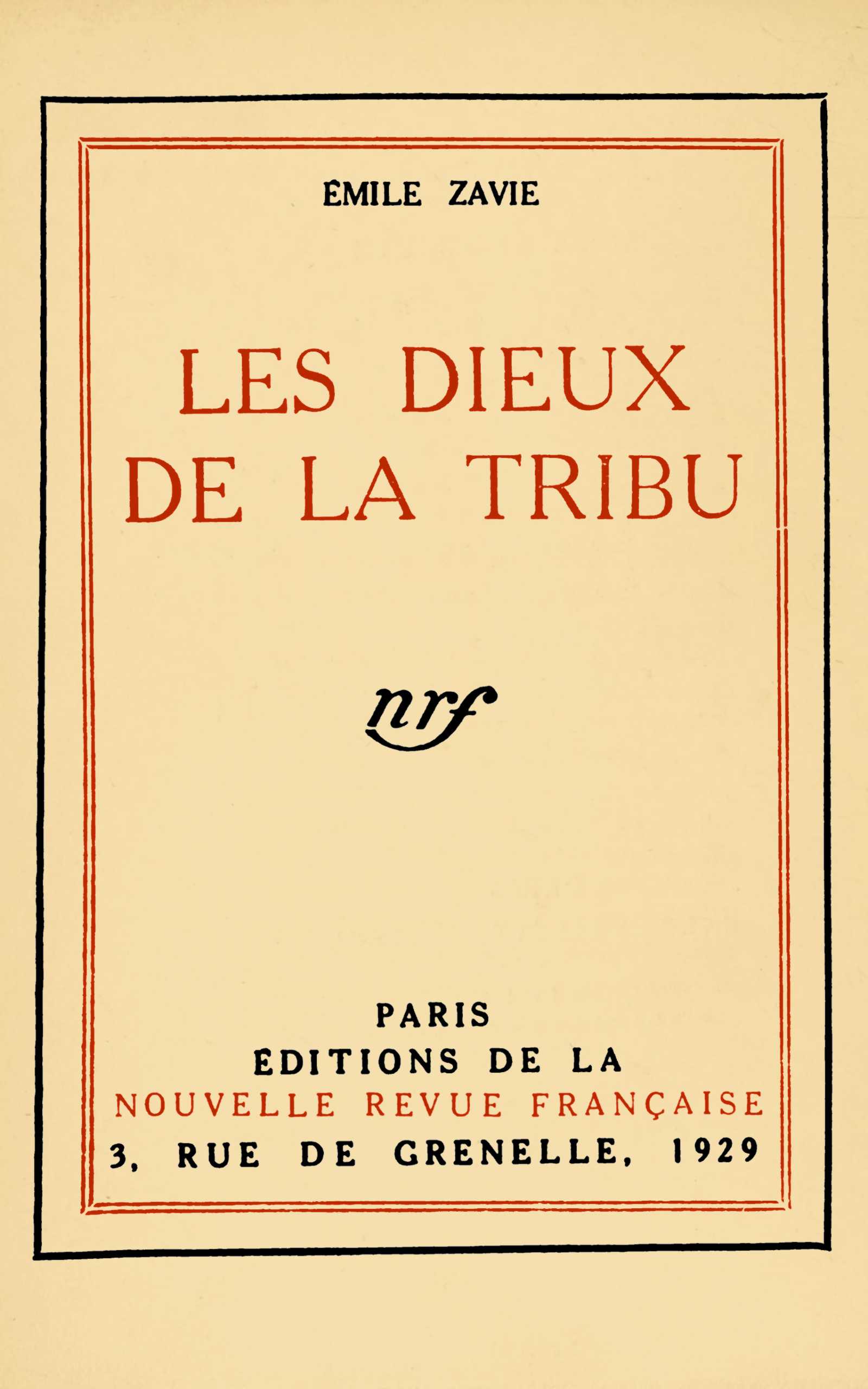
ÉMILE ZAVIE

PARIS
ÉDITIONS DE LA
NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
3, RUE DE GRENELLE, 1929
DU MÊME AUTEUR
A PARAITRE
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE, APRÈS IMPOSITIONS SPÉCIALES, CENT NEUF EXEMPLAIRES IN-QUARTO TELLIÈRE SUR PAPIER VERGÉ PUR FIL LAFUMA, AU FILIGRANE DE LA N. R. F., DONT NEUF EXEMPLAIRES HORS COMMERCE MARQUÉS A à I, ET CENT EXEMPLAIRES RÉSERVÉS AUX BIBLIOPHILES DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, NUMÉROTÉS DE I à C ET SIX CENT QUARANTE-SEPT EXEMPLAIRES RÉSERVÉS AUX AMIS DE L’ÉDITION ORIGINALE SUR PAPIER VÉLIN PUR FIL LAFUMA-NAVARRE, DONT DIX-SEPT EXEMPLAIRES HORS COMMERCE MARQUÉS DE a à q, SIX CENTS EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS DE 1 A 600, ET TRENTE EXEMPLAIRES D’AUTEUR NUMÉROTÉS DE 601 à 630, CE TIRAGE CONSTITUANT PROPREMENT ET AUTHENTIQUEMENT L’ÉDITION ORIGINALE.
EXEMPLAIRE No
TOUS DROITS DE REPRODUCTION ET DE TRADUCTION RÉSERVÉS POUR TOUS LES PAYS Y COMPRIS LA RUSSIE. COPYRIGHT BY LIBRAIRIE GALLIMARD, 1929.
A
ANDRÉ BILLY
qui
a connu
LONLAY-LABBAYE
et
quelques autres…
— Je sais tout ce que l’on peut reprocher à ce livre qui commence par une histoire pour rebondir dans une autre, comme cela se rencontre dans la réalité qui est imprévue et point délimitée par les règles d’un code que certains mainteneurs du roman estiment sans doute immuables… Mais leurs soucis importent peu.
Ainsi me parla mon ami Lonlay-Labbaye, journaliste notable, le matin où il déposa sur mon bureau un important manuscrit.
— Pourquoi cette plaidoirie ? lui dis-je.
Je tournais d’un doigt épouvanté les pages dactylographiées de son ouvrage, car déjà je songeais : « Tout cela qu’il me faudra lire pour donner ensuite un avis favorable ».
— Leurs soucis importent peu, reprit Lonlay-Labbaye. Tu liras ce livre. Et tu le publieras. Pas sous mon nom. Ce serait mon premier. Mais toi qui en as déjà écrit quelques-uns, tu peux le mettre sous ta signature. Il passera inaperçu…
— Merci…
— Il passera inaperçu dans ta production s’il n’est pas réussi ou s’il est hors de portée du public… Mais moi, je ne veux plus en entendre parler.
— Je ne comprends pas.
— C’est pourtant simple. Par contre, tâche de garder le titre que j’ai trouvé.
— Les Dieux de la Tribu ?…
— Oui. Il te déplaît ?
— Non. Mais je ne saisis pas…
— J’ai lu quelque part dans les vieilles chroniques de voyages, que lorsqu’un sauvage se déplaçait, il emportait avec lui les divinités de sa case, de sa tribu. C’est-à-dire ses façons de voir, de juger, d’interpréter les hommes, les événements et les choses inconnues.
« Nous de même. Chacun suit les règles de sa famille, de son clan… »
— Les commerçants ne veulent pas de protêts, les bourgeois pas de scandale, les militaires pas d’histoires…
— Si tu veux…
— Tout cela n’est pas nouveau. Mais tu l’exposes un peu mieux, je pense, au cours de ton récit ?
— Non. Ça ralentirait le train du livre…
— Pas une seule explication ? C’est contraire aux principes. Alors, il faut une préface ?
— C’est cela. Tu écriras cette préface.
— Tu me rappelles ces romanciers qui ayant composé un roman, publient ensuite le « journal » de ce roman pour étaler devant le public leurs ratures, leurs hésitations, leurs recherches et leurs fiches, pour s’excuser d’avoir, quand même, manqué leur chef-d’œuvre.
— Peut-être…
— Une autre question. En feuilletant ton ouvrage, je vois souvent apparaître ton nom : Lonlay-Labbaye. Est-ce donc une justification du journalisme que tu as voulu présenter ?
— Quelle idée ! il n’y a pas plus lieu de justifier le journalisme que la diplomatie ou la médecine. Mais d’après toi, le journalisme serait donc attaqué ?
— On lui reproche de compter de mauvais journalistes.
— Il y a de mauvais ouvriers partout.
— On lui reproche d’embaucher de détestables écrivains et certains veulent que le journalisme soit une école d’écrivains.
— Comme la diplomatie, sans doute ? La vérité c’est qu’il n’y a aucune corrélation forcée entre un journaliste et un écrivain, pas plus qu’entre un médecin, un officier, un diplomate et un écrivain. Le journalisme a autant de rapport avec la littérature qu’avec la diplomatie par exemple. Un journaliste raconte ce qu’il a vu ou entendu ou appris ; un diplomate, un soldat, établissent leur rapport, un médecin sa thèse… Ce qui fait que l’on rencontre des gens qui sont écrivains et diplomates, écrivains et marins, écrivains et journalistes. Ce ne sont pas, de droit, ni les meilleurs des écrivains, ni les plus courageux des marins, ni les plus habiles des journalistes, ni les plus sages des diplomates.
« Toutefois, le journalisme comme l’armée, la marine, la médecine ou la diplomatie permet à un romancier de voir beaucoup de choses, d’entendre, d’agir, d’observer.
— Selon toi, les écrivains se recrutent partout…
— Je n’ai voulu écrire ni un pamphlet ni une plaidoirie, reprit Lonlay qui ne m’écoutait pas.
— Quelle sorte d’histoire as-tu donc enfermée là-dedans ?
— Une histoire…
Et c’est en vain qu’à partir de ce moment, j’essayai d’interroger mon ami. A toutes mes questions, il opposait cette tranquille froideur britannique, héritage du pays où il fut élevé. En effet, né à Londres de parents parisiens, il a vécu en Angleterre et n’a appris le français qu’assez tard. S’il écrit peut-être dans un style laborieux, il n’en reste pas moins un des plus experts journalistes de ce temps, entendez : un des plus adroits dénicheurs de nouvelles, aimant son métier par goût, l’accomplissant avec probité, ce qui, chez les professionnels, est plus courant qu’on ne le croit généralement.
Cependant, je parvins à deviner, à cause même des silences de Lonlay, que le récit qu’il m’apportait n’était pas autre chose qu’une histoire surprise en marge de ses déplacements mêlée à l’un des reportages qu’il avait accompli, une enquête enfin, avec ces à-côtés de coulisses que l’on ne divulgue jamais, toute une expérience personnelle que l’on n’a pas l’habitude encore de distribuer dans les colonnes des quotidiens.
— Si tu lis, tu verras, conclut-il.
Lonlay-Labbaye ne me confia pas davantage qu’il était l’un des héros de son ouvrage. Mais sur ce point, aucun doute, puisqu’il n’avait pas hésité à se mettre lui-même en scène. Fallait-il voir là une des raisons qui l’empêchaient de signer son premier livre ?
Cette histoire d’Ozilie et d’Evgueny que je n’ai pas osé retoucher, tant il me semblait difficile de la mettre au ton coutumier d’un récit de chez nous, à moins de la recommencer entièrement, surprendra sans doute un peu le lecteur français par ses remous psychologiques et aussi par la marche même de son action, tantôt rapide, tantôt fuyante, selon le mouvement déconcertant de la vie réelle, qu’elle semble suivre dans ses détours, ses montées et ses descentes, toutes surprises qui ne sont pas régies par les habituelles traditions d’un genre — le roman — qui a fini par s’emparer de tous les autres.
Du moins j’aurai prévenu le lecteur.
E. Z.
Sombre comme la nuit et comme elle peu sûre.
Michelet.
Voici comment les événements commencèrent.
Au moment où il refermait la porte de la villa, il entendit le jardinier prévenir sa femme :
— Il vient de sortir comme d’habitude.
Pierre Caussanges s’en allait, en effet, sur la route de Chamarges, pour sa promenade de chaque soir. Il songea : « Tout ce que je fais est signalé. Cependant, je me soucie peu de ces gens. Ce jardinier, comme j’étais loin de penser à lui ! »
Caussanges marchait vite à cause de l’air de plus en plus vif. Les premiers froids approchaient et la fraîcheur des nuits, cet octobre, s’annonçait bien avant la fin du jour. Depuis que la bise avait fui, le vent lombard, comme on le nomme en ce pays de montagnes, soulevait à la rencontre du crépuscule des poussières assoupies.
Près de la maison des Rouzan, Caussanges s’arrêta. Sa cigarette venait de s’éteindre. Il usa cinq allumettes. Peine inutile. Pour se mettre à l’abri, il descendit dans un fossé, pas très profond, creusé en contre-bas, pour l’écoulement des eaux de pluie.
Et c’est alors qu’il aperçut, accrochée aux ronces, une feuille de papier que la bourrasque avait emportée jusque-là. Pierre cueillit la lettre. Pas de signature. Une douteuse initiale soulignait les salutations de la fin. Pas de date non plus. Pas d’indication d’origine. Sur les deux feuillets à peine froissés, aucun nom, pas de renseignement. Caussanges se mit à lire :
Il est donc venu — disait le texte — comme je te l’avais annoncé et mon oncle l’a reçu. Il s’est montré très aimable, mais peu communicatif. Et il a su disparaître heureusement presque tout de suite. On lui a montré la propriété, la maison, le parc…
« C’est une jeune fille qui a écrit ces lignes, sans doute à propos d’un fiancé… », pensa Caussanges.
Mais il ne me plaît point — reprenait la lettre — Il est trop serviable, serviteur même. Il dit : « ô Mademoiselle ! » « Votre goût »… Il en est obséquieux… J’ai horreur de ce genre d’hommes. Et toi ? Moi, je prends mon air le plus « étrangère » pour lui répondre. J’affecte de ne pas comprendre.
Et puis il semble croire que je suis très riche. Il évalue d’avance ce que je représente car il est certain que j’hériterai de tout ce qu’il découvre.
Ces aveux inespérés que le malicieux hasard lui mandait par le sans fil du vent, divertissaient Pierre Caussanges. Il en oubliait de remonter sur la route.
Un beau parti ! Tu entends ? Je suis un beau parti… Eh bien, tous ces gens que l’on m’a présentés ces jours-ci me déplaisent. Ils viennent mais ne me voient pas. Ils regardent ce qui m’entoure, le « décor » comme disait Evgueny. Et puis ils me découvrent après, s’ils ont le temps. On les sent décidés alors à me faire tous les compliments, encouragés par ce qu’ils ont vu avant. Comme j’ai envie de leur dire que je suis pauvre, que rien de tout ce qu’ils ont évalué ne me reviendra et que je ne dois compter que sur mon travail pour vivre !
Est-ce une indiscrétion grave de lire une lettre perdue, recueillie sur le bord d’un chemin ? Caussanges se sentait presque gêné par la tournure de ces confidences. Il releva la tête, vit la campagne déserte jusqu’à l’horizon de cyprès… Il poursuivit sa lecture ; toutefois il allégea son inquiétude en sautant quelques lignes et reprit un peu plus bas.
Lorsqu’on lui a fait voir les tableaux d’ancêtres — pas les miens, ceux de mon oncle qui les a pris je ne sais où — il n’a pas eu l’air de croire en leur authenticité. Je l’ai bien senti parce que je l’observais. Que je n’y croie pas, moi, c’est déjà un peu fort. Mais lui, il aurait pu faire semblant… Peut-être n’était-il ému que par leur valeur marchande…
Pierre tourna le feuillet. Il lisait non par une indiscrète curiosité, mais pour glaner quelques détails qui le mettraient sur la piste du propriétaire de la lettre. Rassuré par cette explication qu’il venait de se donner comme excuse, Caussanges reprit au hasard :
Tu vas dire que je cherche un peu trop l’oiseau bleu de l’absolu. Peut-être. Mais tu oublies que je suis pressée. Donc, je dois juger vite. Je te tiendrai au courant tout de même, si cela t’amuse. Donne-moi des nouvelles d’Evgueny. Comment supporte-t-il les événements ?
Ce nom d’Evgueny qu’il rencontrait pour la deuxième fois intriguait Caussanges. Il continua dès lors sans rien omettre :
… les événements ? Que dit-il de mon évasion ? Car, pour lui, c’est une évasion. Qu’il se rassure, (Ne le lui annonce pas, ni à personne) je retournerai à N.-T. à cause de toi, d’abord, lorsque j’aurai mis « l’Irréparable » — j’en ai plusieurs sous la main — entre Lui et Moi. Mais je voudrais que cet « Irréparable » ne fût pas un coup de folie, comprends-tu ? Au contraire : quelque chose qui m’agrée et qui soit parfaitement présentable. Sinon, Evgueny croirait à du dépit.
Ainsi, pour unique indice, un nom. La fin de la lettre ne contenait que des politesses, diverses recommandations et des baisers à distribuer.
Mille caresses à Frieda. Comment se comporte Seringa ? Taurus va-t-il bien ? Et Rocamadour, « gardien-des-portes-sacrées », que devient-il ?
« Tout ça, ce sont des noms d’animaux », conclut Caussanges pour lui-même. Puis il examina la lettre. Le papier n’en était pas recherché. L’écriture s’y inscrivait fortement avec des espaces entre chaque mot et d’assez larges interlignes. Quelle femme pressée griffonna cette confession ? A quelle inconnue était-elle adressée ? Quelle étourdie enfin laissa ces aveux s’envoler ?
Le ronflement bien connu d’un moteur…
Pierre Caussanges leva la tête. Presque aussitôt l’avant d’une automobile se mit à grandir. Dans la voiture, une femme, debout, examinait chaque côté de la route.
« C’est celle qui a égaré cette lettre », se dit Caussanges. Et d’un geste irréfléchi, il glissa les feuillets qu’il avait lus dans sa poche. Un geste comme celui-là suffit, parfois, pour déchaîner des complications endormies. Puis Caussanges sortit de son abri.
Sur la route, il était furieux contre lui-même : « J’aurais dû jeter cette lettre. » Mais comment s’en débarrasser à présent ?
Cependant l’automobile s’était arrêtée. La jeune femme sauta à terre. « Si je lui demandais : « Mademoiselle, est-ce vous qui ?… »
Ce fut l’inconnue qui parla la première :
— Excusez-moi, Monsieur. Auriez-vous, par hasard, découvert tout à l’heure, une feuille ?… que j’avais placée près de moi, sur la banquette ? Un coup de vent la fit partir. Je viens seulement de m’en apercevoir. Depuis, je cherche…
Elle s’exprimait d’une voix qui détachait chaque mot et le jetait en avant. « Elle n’est pas française », estima Caussanges. Il répondit :
— Une lettre ?
— Une lettre, précisément, reprit-elle.
Elle ajouta avec vivacité :
— Vous l’avez trouvée, n’est-ce pas ?
Elle considérait ce grand jeune homme maigre et blond. Lui sentait qu’on l’évaluait : « Trente ans au moins, peut-être trente-huit. Un imperméable trop long pour sa taille qui est longue, des bottines trop solides, des yeux bleus, une cravate comme un nœud de soulier. Professeur ou fonctionnaire ? » Ainsi Caussanges interprétait le regard de la dame en auto. Elle reprit :
— Cette lettre, sans intérêt d’ailleurs, contenait une adresse de villégiature dont je ne me souviens pas. Or, je ne sais comment répondre à celle qui m’écrivait.
— C’est bien désagréable, constata Caussanges.
Il ne pouvait se résoudre à remettre la lettre qu’il avait trouvée. Pourquoi ? A cause du regard ironique de celle qui parlait ? Il essayait de la définir : « C’est une voyageuse avec un chapeau ordinaire, un manteau comme on en voit sur toutes les épaules ».
— Alors, vous ne savez rien ? conclut la jeune femme.
— Non. Mais en cherchant.
— J’ai déjà cherché. Excusez-moi, Monsieur…
C’était fini. Elle allait disparaître. Et il ne la reverrait plus. Jamais. Comment retarder ce départ fatal ?
— De quel côté cette lettre s’est-elle envolée ? demanda Caussanges.
— Du côté droit, répliqua la jeune femme. Mais cela ne prouve rien, affirma-t-elle.
— Vous avez regardé des deux côtés du chemin ?
— Certainement. Mais peut-être, vous, vous auriez plus de chance.
Quelle obscure malice Pierre Caussanges crut-il discerner dans cette remarque ? L’idée que cette jeune femme qu’il ne connaissait pas, pouvait mal le juger, lui déplut. « Elle s’imagine que j’ai ramassé sa lettre ? » Il était sincèrement indigné.
— Je suis sûre que ma lettre n’est pas loin. Je lisais n’est-ce pas ? Un coup de vent. Je baisse la tête. La lettre était près de moi dans cette voiture découverte. Je me suis aperçue beaucoup trop tard que ma lettre était partie. Alors, je suis revenue… A ce moment-là, vous étiez derrière moi, enfin derrière la voiture ?
— Oh ! très loin derrière vous…
— Vous alliez au village ?
— Quel village ?
— Celui qui est là-bas…
Et elle désignait de son doigt ganté, des toits rouges, parmi des arbres. Le village dont elle parlait, c’est ce que Caussanges, comme les gens du pays, appelaient la ville.
— Oui, dit-il, j’allais jusque-là.
— A pied ?
— Sans doute. C’est ma promenade de chaque soir.
— Régulièrement ?
— A peu près…
— Alors, vous vous ferez mouiller tout à l’heure…
— J’en ai peur.
— Vous êtes forcé maintenant, pour avoir un abri, d’arriver rapidement au village. Voulez-vous monter dans l’auto ? Je vous y conduirai.
— Et la lettre ? s’étonna Caussanges.
— Tant pis pour elle ! Vous ne l’avez pas vue. Moi non plus. Donc elle est perdue…
— Et votre réponse ?
— Je ne répondrai pas.
— Mais… votre amie sera inquiète.
— Elle m’écrira de nouveau. Je lui dirai la vérité.
— Que la lettre s’est égarée ?
— Non ! Pourquoi entrer dans tous les détails, ricana-t-elle. « Le reste est silence », comme l’écrit Shakespeare. Ne vous inquiétez pas et montez.
Caussanges s’assit dans l’automobile. La route maintenant défilait à droite et à gauche. Préoccupé par la lettre qu’il portait sur lui, il demanda :
— Vous reviendrez par ici, Mademoiselle ?
— Comment dites-vous : « par ici ? »
— Je veux dire : vous allez à la ville, mais vous reviendrez ce soir par ce même chemin ?
— Je crois que vous m’interrogez ?… Puisque vous y tenez, sachez…
Il fit un geste de protestation.
— Sachez que je vais prendre le train ce soir et que je retourne à Paris.
— Vous habitez Paris ?
— Non, Monsieur.
Et elle éclata de rire.
— Je vais à Wien.
— A Wien ?
— Oui, en Autriche. C’est loin, n’est-ce pas ?
— Vous passez par Paris ?
— Non, je ne m’arrête pas.
Après un silence, la jeune femme commença :
— Et maintenant que vous ne me demandez plus rien, je vais à mon tour vous poser quelques questions.
— Tout à votre disposition.
— D’abord, reviendrez-vous sur cette route, pour regagner votre maison ? Oui ! Eh bien, si par hasard vous trouviez la lettre que je cherchais tout à l’heure, vous seriez bien aimable de la recueillir.
— Et où vous l’enverrai-je ? dit-il avec trop d’empressement.
— J’allais vous le préciser…
Elle parut calculer…
— Voyons, je serai à Paris demain… J’y resterai trois ou quatre jours… Mais je ne puis la faire expédier là où je serai.
Comme si elle se décidait tout d’un coup :
— Adressez-la à mon nom, voulez-vous : « Ozilie de Wicheslaw, poste restante, bureau de la rue Danton ». Je ne sais pas le numéro du bureau. Mais l’adresse est suffisante. Vous vous souviendrez ?
Caussanges répéta docilement.
— Écrivez le nom si vous craignez de l’oublier. Les Français retiennent difficilement les noms étrangers.
— Je ne puis déjà plus oublier le vôtre, déclara Caussanges.
Ozilie de Wicheslaw n’eut pas l’air d’entendre ce compliment. Elle répliqua :
— Tant mieux. Je vous souhaite de réussir dans votre recherche. Merci grandement.
Elle rectifia aussitôt :
— Merci beaucoup.
— Et moi, je vous souhaite bon voyage… Mademoiselle ?
Il parut, cette fois, hésiter sur « Mademoiselle ».
— Oui, Mademoiselle, vous pouvez ainsi dire. Adieu, Monsieur.
On était arrivé aux premières maisons de la ville. L’automobile s’arrêta. Mais déjà un orage s’amoncelait dans le ciel. Des nuages prenaient de l’avance sur la nuit.
— Vous avez des courses à faire en ville ? demanda la jeune fille.
— Non. Aucune. Je me promenais, voilà tout.
— Alors, si je ne vous avais pas dit de monter dans la voiture, vous ne seriez pas venu jusqu’ici ?
— Probablement.
— Eh bien, reprit Ozilie, accompagnez-moi à la gare. L’auto vous ramènera chez vous, puisque de toutes façons, Antonin (c’est le machiniste) doit rentrer à la maison.
Caussanges hésitait.
— Acceptez-vous ?
« J’ai l’habitude, — ajouta-t-elle, pour réprimer ce qu’avait de trop impératif sa façon d’être obligeante, — j’ai l’habitude de vouloir vite, d’agir vite et de ne jamais revenir sur une décision.
— C’est oui, répondit Caussanges.
— Directement à la gare, ordonna-t-elle.
L’automobile repartit.
La gare : un jardin, des voitures, l’affairement et la nonchalance d’une gare du Midi français. Le train était naturellement en retard.
— Vous me tenez compagnie, décida Ozilie tandis que son chauffeur allait lui prendre son billet…
Et pour rassurer Caussanges, elle ajouta :
— Antonin vous attendra…
— Vous pouvez renvoyer Antonin. Le temps est couvert mais il ne pleuvra pas. Je rentrerai à pied.
— Comme il vous plaira.
Elle prévint aussitôt le chauffeur qu’il pouvait rentrer.
— J’ai déposé dans le compartiment de Mademoiselle le manteau et la valise de Mademoiselle, répondit Antonin.
Alors, sur le quai de cette petite station, tandis que des sonnettes tintaient continuellement, Ozilie de Wicheslaw interrogea son compagnon. Ce fut un interrogatoire adroit et discret. Elle apprit ainsi que Caussanges convalescent, se reposait dans ce pays depuis trois semaines. Auparavant il habitait Paris. D’autre part, un héritage inespéré l’avait mis à l’abri du besoin. Il ne savait pas s’il retournerait à Paris. Cependant la campagne l’ennuyait. Il appartenait à l’enseignement…
Ozilie écoutait Caussanges sans l’interrompre. Elle semblait l’approuver. « J’ai tout deviné, sauf l’héritage », se disait-elle. Tout d’un coup :
— Mais quel est votre nom ?
— Caussanges. Pierre Caussanges.
Et il se mit à parler de la propriété dont le sort lui avait fait don.
— Où est-elle située ?
Il précisa :
— Sur la route de Chamarges, à droite…
— Je vois, dit-elle. Ces terres avec cette maison qui s’étendent du ravin jusqu’au bois…
— Oui, répondit-il, heureux qu’elle eût remarqué son domaine.
Cette nuance, Ozilie, la saisit. Elle reprit :
— La propriété de Mlle Isabelle est voisine.
— En face. Vous connaissez Mlle Isabelle ?
— Et vous ? demanda-t-elle.
— Moi ? Pas du tout. Je sais, comme tout le monde, qu’elle habite chez son oncle. Et si je l’ai aperçue ce n’est que de loin, par hasard, et encore je ne suis pas sûr si c’était elle ou une de ses amies.
— Tiens ! On peut donc apercevoir de chez vous ce qui se passe chez Mlle Isabelle ?
Pierre Caussanges interdit, tout d’abord, prit le parti de rire :
— Oui, de la terrasse, avoua-t-il. Le matin, en sortant de chez moi, sans chercher à être indiscret, je découvrais toute l’aile gauche de la maison de Mlle Isabelle.
— Mais vous, demanda-t-il avec un empressement chargé d’hésitation, vous connaissez beaucoup Mlle Isabelle ?
— Il n’est pas difficile de la connaître un peu mieux que vous, en effet, répliqua-t-elle malicieuse.
Toutefois, Ozilie n’ajouta rien d’autre sur ce sujet, mais estimant que Pierre Caussanges avait fini de parler de lui-même, elle jugea nécessaire de dire quelques mots. Elle s’arrêta près d’un train de marchandises qui encombrait les voies. Un employé passait, entraîné par un lourd chariot de bagages. Une locomotive essoufflée, haletait…
— Des gares comme celle-ci, commença Ozilie, dans des paysages pauvres et poussiéreux, toujours sous la menace d’une révolution, me rappellent jusqu’à l’obsession mon enfance et ma jeunesse.
Ozilie de Wicheslaw parlait d’une voix vive et chantante. Rien ne restait de ce ton saccadé qu’elle avait pris sur la route, tout à l’heure, pour adresser la parole à Caussanges.
— J’ai été élevée en partie à la cour de Kabardie et en dernier lieu à Thorenberg où la cour s’était réfugiée après le coup d’État du premier chambellan. Comme mon nom vous l’indique, je suis d’origine autrichienne par mon père, mais ma mère était née en France, d’une famille française.
Elle fut obligée d’arrêter son récit. Un convoi partait avec un grand fracas de vitres, de roues, de sifflets et de fumée…
— J’ai été beaucoup « voyagée », dit-elle encore et j’ai de nombreuses langues eu l’occasion d’apprendre.
Ozilie parfois, s’exprimait lentement, cherchant ses mots, traduisant à mesure en français, semblait-il, ce qu’elle évoquait dans sa langue d’origine, puis elle accélérait de nouveau :
— Je les parle assez couramment, comme le français, c’est-à-dire aussi mal. Non, ne me complimentez pas.
Mais Caussanges ne songeait pas à la complimenter. Il écoutait les confidences. Cette facilité de paroles et d’aveux, il l’excusait, la mettant sur le compte des différences de races et d’éducation. Ozilie poursuivait :
— Je ne retournerai jamais « là-bas. » Je sens bien que c’est impossible. Alors, il faut que la France m’adopte. C’est plus difficile…
« Mais voici mon train qui est composé. Adieu donc, Monsieur. Au plaisir de vous revoir et de lire votre lettre et celle que vous aurez retrouvée… »
Elle salua Caussanges d’un signe de tête et monta dans un compartiment, sans plus se soucier du jeune homme.
Pierre, toutefois, attendit quelques minutes sur les quais, puis ne voyant pas apparaître dans les montants d’une portière le visage d’Ozilie, il gagna la sortie.
Comme il traversait la salle d’attente, Caussanges subitement se trouva stupide d’avoir quitté Ozilie. Comment pourrait-il, désormais, vivre sans elle ?
— C’est le coup de foudre ! affirma-t-il.
Puis, il se souvint qu’il avait déjà éprouvé des « coups de foudre » de cette espèce, chaque fois, exactement, qu’il avait découvert une femme aimable ou sympathique. Cela durait un jour, trois jours, même une semaine… Cependant, ce soir, il emportait une sensation brusque d’angoisse, d’isolement et le désir absurde de rester encore auprès de cette personne dont il ne soupçonnait même pas l’existence deux heures plus tôt…
Mais aussi il se devait de renvoyer à Ozilie la lettre qu’il avait recueillie dans un fossé avec un mot pour expliquer comment, par un heureux hasard, il l’avait découverte. Cette lettre il ne pouvait l’expédier que de Chamarges. Et puis après ? Là se termineraient toutes leurs relations, Ozilie — quel nom aimable et délicieux ! — le remercierait sans doute. Lui dirait-elle d’aller la voir ? Ou de lui écrire encore ? Ou simplement de continuer les relations commencées ? C’était peu probable. Or Caussanges souhaitait de connaître mieux, de connaître davantage Ozilie. Jusqu’ici, il s’était à peine enquis de Mlle Isabelle, sa voisine, très jolie, disait-on. Par M. Chenoncay, l’oncle de la jeune fille, n’arriverait-il pas à entrer en relations avec la nièce et par la nièce, à retrouver Ozilie ? Tout cela exigerait du temps, de la patience et pas mal d’habileté. Cependant, n’était-il pas préférable de ne point perdre de vue Ozilie. Rien ne l’en empêchait. Il était libre. Il lui suffirait de faire prévenir le jardinier de sa villa. Un télégramme y pourvoirait. La décision de Caussanges fut fixée, d’un seul coup. Ozilie n’avait-elle pas des principes qu’il approuvait ? « Vouloir après réflexion, puis agir vite et ne jamais regretter. »
Il avait réfléchi. Il voulait. Restait l’acte. Entendu : il partirait. Ce sont toujours les irrésolus qui, pour se prouver à eux-mêmes leur force et leur volonté, se décident par coups de tête, avec plus ou moins d’inconséquence.
« Je télégraphierai à Chamarges en cours de route », se dit-il.
Caussanges prit donc un billet pour Paris, puis choisit un wagon non loin de celui qu’occupait Mlle de Wicheslaw…
Quelques minutes plus tard, le train partait…
D’interminables trains bruyants sifflaient dans la cage du hall. Une locomotive crachait sa vapeur entre ses roues. Près de la « sortie », Ozilie se retourna. La nuit, dans cette gare de Valence, se réfugiait aux deux portes de la voûte. Soudain, Ozilie, aperçut, sur le quai, Pierre Caussanges. Le professeur préoccupé de ne pas se retrouver en présence de la jeune fille ne la voyait point. Lorsqu’il arriva près d’elle, la jeune fille l’aborda :
— Il me semble que vous me suivez, Monsieur !
Pierre Caussanges stupéfait, ne savait quoi répondre. Il cherchait des explications tandis que son silence l’accusait. Il le sentait confusément. Aussi maudissait-il le stupide hasard qui le remettait si vite en face de celle qu’il poursuivait discrètement.
— Vous ne répondez pas ? Vous ne savez même pas mentir par politesse ! persifla la jeune fille.
Caussanges essaya de protester. Peut-être y serait-il parvenu ? On ne lui en laissa pas le loisir.
— Où allez-vous ?
— Si je vous déclarais que cela ne vous regarde pas ?
— Cela me regarde, Monsieur, car vous auriez pu me dire tout à l’heure, dans mon auto, que vous alliez à la gare. Donc, j’ai le droit, maintenant…
Elle parlait avec une brusque autorité. Devant cette jeune fille ironique, Caussanges haussa les épaules. Comment avait-il fait pour ne pas mieux surveiller la direction que prenait Ozilie ?…
— Enfin, où allez-vous ? répéta la voyageuse.
— A Paris.
— Je n’aime pas les gens qui mentent quand ils ne savent pas mentir.
— Mais je vous assure qu’à votre école, j’apprendrai.
Il fut lui-même le premier surpris de son impertinente audace.
— La direction de Paris, c’est le quai numéro un, Monsieur, répliqua Ozilie.
— Je me rendais en ville, pour dîner, en attendant le rapide.
— Qu’allez-vous faire à Paris ?
— Je rentre, comme tout le monde…
— Comme ça, sans pardessus ni valise…
— Ils sont aux bagages.
— Comme c’est vraisemblable ! Quand avez-vous décidé ce voyage ?
— Quand je l’ai décidé ? Il y a longtemps.
— Oui, quand vous m’avez rencontrée.
— Non. Bien avant.
Ozilie secoua la tête :
— Ce n’est pas possible.
— Quand vous m’avez annoncé vous-même que vous alliez à Paris, reprit Caussanges, je ne me suis plus permis de vous dire que je partais également. Vous auriez cru que je voulais vous accompagner. Aussi, je suis monté derrière vous, sans vous prévenir. Je ne me montrais point. Je pensais que vous ne me verriez pas le long du parcours. Il a fallu cette rencontre…
Elle regardait le jeune homme. Elle parut disposée à lui faire confiance. Caussanges se l’imagina. Toutefois, il eut le tort d’insister :
— … Ce hasard qui nous met une fois de plus en face l’un de l’autre.
— Pourquoi avez-vous été si étonné de me voir ?
— J’étais certain que vous étiez déjà sortie de la gare.
Ozilie n’insista point, mais elle n’était pas convaincue. Elle reprit un détail encore mal expliqué :
— Votre pardessus vous l’avez donc mis aux bagages ? Vous aurez froid…
— Je ne crains pas le froid.
— Quelle imprudence quand même de l’avoir laissé dans votre valise !
— J’aurais dû, en effet, le retirer. Je n’y ai plus pensé à la dernière minute. Il ne se perdra pas…
— A quel moment, continua la jeune fille, avez-vous porté votre valise à la gare ?
— La veille, mon domestique l’avait déposée à la consigne.
Ozilie se taisait. Caussanges, cependant, en dépit de l’assurance de ses réponses, devinait que la jeune fille ne le croyait qu’à demi. Il jugea prudent de ne pas prolonger un entretien aussi mal commencé, et, saluant la curieuse personne, il s’éloigna très vite, un peu trop vite…
Valence est une petite ville de la vallée du Rhône qu’un vent froid, chargé de poussière, balaie presque sans répit. Dans la journée, peu de monde : l’aspect d’une calme cité où il fait ou bien trop chaud ou trop froid, suivant les saisons. Le soir, dès la tombée de la nuit, le désert…
L’express de Paris venant de Marseille ne s’arrêtait, pour souffler et embarquer quelque supplément de voyageurs, qu’une heure avant minuit. Ceux qu’un sort inclément obligeait à attendre, cherchaient alors asile dans les restaurants et les cafés de la ville endormie où ils risquaient fort de se trouver seuls de leur espèce. C’est ce qu’il advint à Pierre Caussanges et à Mlle Ozilie de Wicheslaw. Sans se concerter, ils dînèrent dans la même salle et choisirent naturellement, chacun de leur côté, la même brasserie, en bordure, près de la cour de la gare, où d’autres déshérités pratiquaient désespérément les travaux forcés des cartes postales.
Ozilie devant une table, Caussanges devant une autre, se livraient à ces identiques labeurs. Plusieurs fois leurs yeux se rencontrèrent et toujours le jeune homme indifférent en apparence changea, le premier, la direction de son regard… Parfois aussi, ils consultaient le cadran de la grosse horloge. Ils virent ainsi l’aiguille atteindre dix heures, puis dix heures et quart, dix heures et demie, onze heures moins le quart…
A ce moment-là, son paquet de cartes postales à la main, Ozilie se leva, arrangea son manteau, puis, grâce à un détour qu’elle jugea naturel, vint passer devant Caussanges.
— Ne sortez pas, dit-elle, avec un sourire agressif. L’air de la nuit est assez vif. Et vous n’avez pas de pardessus.
— Je vous remercie de l’intérêt que vous semblez me porter, répliqua Pierre Caussanges. J’attendrai ici un autre rapide puisque ma présence dans votre train vous gêne…
— J’ai été un peu vive tout à l’heure, reprit Ozilie. Il ne faut pas m’en tenir rigueur. J’ai été très mal élevée par un père qui m’adorait et une mère qui me laissait tout faire. Et puis l’on s’occupait si peu de moi !…
— Je n’ai pas à vous juger, encore moins à vous excuser. Vous ne pouvez pas mal faire.
— Vous le croyez ?
Elle riait maintenant.
— Je le crois, répondit-il avec un grand sérieux.
Ozilie le regarda attentivement et comprit que Caussanges ne plaisantait pas, qu’il avait mis dans ces quelques mots plus qu’une banale conviction. Un dévouement s’offrait ainsi et elle avait risqué de passer outre. Elle examina encore une fois ce jeune homme. Elle le jugea à son tour, sans tricherie, pas très homme d’action, mais réfléchi, méditatif et d’un naturel excellent. La bonté de ses yeux bleus fidèles lui en était un sûr garant. Quelle alliance, quelle amitié désintéressée rencontrait-elle à la fortune des horaires ?
Alors, avec cette spontanéité un peu câline qui lui avait si souvent réussi, elle offrit sa main au jeune homme.
— Ne cherchez pas de traits ironiques, voulez-vous ? Ne vous guindez pas. Et au lieu d’être des indifférents, soyons des amis ?…
Caussanges se leva aussitôt et porta à ses lèvres cette énergique petite main qui se tendait vers lui pour une trêve amicale.
Premières conversations, à bâtons rompus, sur des questions sans péril entre une femme et un homme qui ne se connaissaient pas tout à l’heure… On cherche à se présenter sous le plus favorable éclairage. On essaie de deviner les goûts, les préférences, la couleur de l’âme de son partenaire. On fait de l’esprit et du sentiment sans effort. On se sent tout nouveau, différent de soi-même et comme un autre personnage retouché par un adroit magicien… Et l’on est ravi et inquiet par cette pointe d’incertitude qui nous travaille : est-ce le commencement d’un grand amour, le début d’un caprice ou d’une passionnette, cette fausse grande passion qui a tous les dehors d’une véritable, qui leurre les candidats en présence et qui meurt aussi vite que née, laissant derrière elle son désagréable goût d’amertume ? Ou bien encore n’est-ce que le prélude d’un souvenir de voyage, d’une de ces sympathies soudaines que notre existence réglée viendra râcler avec son râteau symétrique ?
Que serez-vous pour moi, vous à qui je parle et qui me répondez avec une nonchalance étudiée ? Vous verrai-je autre part, dans une autre solitude, beaux yeux fiers que le paysage anonyme qui se précipite au-devant des portières, emplit d’une nuit changeante et toujours renouvelée ?…
Ainsi, Pierre Caussanges et Ozilie de Wicheslaw assis face à face, dans le même wagon du rapide de Paris se posaient ces questions intérieures.
Pierre se surprenait à conter à cette jeune fille sa vie, son enfance triste dans une petite ville, l’internat depuis onze ans jusqu’à dix-huit ans, les cours à la Faculté, la caserne, puis de nouveau les études et les cours, où il trônait alors du côté de la chaire. Puis la guerre… Il avait l’impression d’avoir toujours vécu parmi les livres, entre les murs d’une classe, avec des tableaux noirs, sans interruption.
— Ah ! non, je ne regrette pas mon enfance, ni ma jeunesse, disait-il…
— Et votre maman ? demanda Ozilie sans autre transition que la logique de sa fantaisie.
— Orphelin de bonne heure, je n’ai connu ni mon père, ni ma mère, mais deux vieilles tantes et mon oncle, qui fut mon tuteur. Un tuteur pas comme les autres, du reste, puisqu’il vient de mourir en me laissant sa fortune.
— Quel est votre meilleur souvenir ? demanda encore Ozilie.
Caussanges parut réfléchir — une façon de dissimuler sa surprise — puis, en souriant de la question que lui jetait cette étrangère et de la réponse qu’il allait faire :
— La caserne, dit-il. Je n’ai pu suivre le peloton des élèves-officiers, étant trop souvent malade. Alors, j’avais été chargé du cours des illettrés. Toujours le tableau noir, la classe, les études, comme vous voyez… Mais j’étais libre…
« Et puis encore la guerre où j’ai appris à connaître d’autres hommes que des professeurs et des élèves… C’est tout…
— Pas une robe dans tout cela ?
— Non, pas l’ombre, avoua-t-il. Si ce n’est un moment la vocation, — que je m’attribuais — d’être magistrat, comme mon oncle…
— Mais c’est une plaisanterie ! J’y reviens : pas de robe dans cette vie ?
— L’apparence d’une, tout de même…
— Ah ! tout de même, reprit Ozilie intéressée, comme ses pareilles de tous pays en semblable circonstance.
— Pourquoi toucher à ces choses-là ? On ne peut en rapporter que des morceaux froissés… Comme tout écolier, il va de soi que j’ai d’abord collectionné les fleurs de la sœur aînée d’un camarade, puis ce fut une jeune fille rencontrée aux vacances de juillet que j’ai retrouvée mariée aux vacances de Pâques, l’année suivante. Les amours de jeunesse ne dérangent pas l’ordre de notre destin…
— C’est assez rare, en effet…
Pierre Caussanges ignorait l’art de tenir une conversation. Ou bien, il commençait un cours. Lorsqu’il se tut, Ozilie ne prit point la parole.
Après un silence, elle se décida :
— Et depuis votre héritage, vous avez abandonné le professorat ?
— Non. J’ai obtenu un congé assez long pour raison de repos.
— Quand quitterez-vous le professorat ?
— Je ne sais pas si mes revenus me permettront de vivre sans ma profession. Et je ne sais pas…
— Qu’est-ce encore que vous ne savez pas ?
— … Si je pourrais m’habituer à vivre sans être tout de même un peu professeur. Il faut bien s’occuper dans la vie.
— Vous avez voyagé beaucoup ?
— Depuis que mon oncle est mort, je voyage un peu, j’apprends à connaître la géographie que j’enseignais. Avant, rien en dehors de mes déplacements obligatoires. Mais vous, vous avez beaucoup voyagé ?
— Oui, dit-elle, avec complaisance. Ma vie jusqu’ici s’est passée dans les wagons et dans les gares, dans les automobiles et les cabines de steamers… Mes plus longs, mes plus grands séjours consécutifs furent à la cour de Kabardie et dans la ville de Thorenberg, à Wien, puis enfin… à Paris, ma foi. Quelle peut être l’existence d’une personne ainsi ballottée, toujours sur les routes ? Vous l’imaginez, n’est-ce pas ? à l’opposée de la vôtre : des figures nouvelles, des pays disparates, des crépuscules tantôt à droite, tantôt à gauche et des maisons toujours hostiles… Mais c’est une jeunesse sans interruption, un plaisir de nomade à l’affût, voyez-vous, que d’aller en sautant du train, dans une cité inconnue où l’on ne séjournera pas assez pour avoir le cœur soulevé par la banalité des visages et de la toile de fond… Telle fut ma vie (Et cela promet de durer). Je n’ai pas de demeure à moi aujourd’hui ; demain, j’achèverai de ne plus me souvenir de ma patrie et ce sera comme si je n’en avais pas.
« Un soir, reprit-elle, que j’étais à Sumatra, sur les terrasses vitrées du caravansérail, j’eus l’impression que toute mon existence serait celle d’une errante à la recherche de son domicile. Un jeune garçon me regardait avec insistance. C’est ce même regard que je retrouvai plus tard à Ismaïlia, près du Caire, quand nous allâmes en Égypte, le même encore dans le parc de Thorenberg. Pour le jeune garçon de Sumatra, pour celui d’Ismaïlia et pour celui de Thorenberg, j’étais et je devais rester l’exilée que l’on discerne un moment, que l’on comprend à peine et qui s’en va toujours avant qu’on l’ait comprise.
« Plus ou moins, toutes les femmes sont des incomprises, voyez-vous, parce que pour elles, plus que pour d’autres, leur véritable patrie n’est point ici-bas…
— Où est-elle donc ?
— Sur les cartes imaginaires pas encore dressées par les services célestes…
Elle parlait, elle confondait quelquefois les langues et les patries et mêlait les tristesses d’Europe et les nostalgies d’Orient… Pierre Caussanges se taisait devant ce désespoir cosmopolite. Il avait eu déjà l’occasion de le remarquer : la jeune fille au cours de sa conversation, égrenait des noms étrangers, sans affectation du reste. Ainsi elle commençait tout d’un coup :
— Lorsque je jouais avec le petit garçon du premier officier d’ordonnance de mon père, dans le parc de Thorenberg…
Ou encore, des aphorismes imprévus :
— Pour connaître les gens, il faut leur demander leurs trois plus grandes joies, leurs trois plus grandes peines, leurs trois plus grandes terreurs, leurs trois meilleurs souvenirs.
« Mes trois meilleurs ? ajoutait-elle aussitôt, je n’en ai pas. Car je puis me les procurer à volonté assez facilement ; ce sont trois choses qui nous font évader de nous-mêmes. J’aime les boissons alcoolisées, les danses nègres et les cerises à l’eau-de-vie.
« La première fois que je bus de l’arak, à Thorenberg, j’avais quatorze ans et des nattes dans le dos. La première danse, ce fut à Londres, pendant votre guerre dernière et les cerises à l’eau-de-vie, c’est dans un mastroquet, derrière la gare du Montparno que je les ai dégustées. Voilà mes trois plus beaux souvenirs. Ah ! et puis le jour où je fus tout à fait habillée en jeune fille occidentale et où j’abandonnai les oripeaux coloriés, les bijoux de fer et les diadèmes en pièces d’argent que je portais à la cour de Thorenberg.
« Ma plus grande frayeur ? Voulez-vous savoir ? Ce ne fut pas quand nous avons quitté Thorenberg, après le coup d’État, sous la gueule ronde des canons ; ce ne fut pas quand je fus jetée sur la terre par un étalon ; ce ne fut pas non plus quand nous avons cru que le prince Evgueny avait été décapité ; ce ne fut pas… Non, c’est au cours d’un « révoltage » des Indous, à Sumatra. Rien que des bouches en « o » qui criaient. Puis tout d’un coup les balais en ciseaux des invisibles mitrailleuses d’Angleterre nettoyant l’horizon. Et le silence aussitôt après, puis les aboiements de forcenés et les tricotements des machinengewehr. Et puis les drapeaux britanniques, rouge et bleu de l’Empire, flottant de nouveau sur les monuments publics pour annoncer la victoire pacificatrice. Ce jour-là, j’ai eu peur. J’ai eu peur de la force albionesque qui dominera tous les peuples d’une autre race. »
Pierre Caussanges écoutait. Une vague crainte toutefois : « Elle plaisante… » Le train fonçait sur les rails, bondissait, se penchait dans les tournants. La nuit était absolue, sans lumière. On ne voyait sur les talus, les arbres, les ponts, que les rectangles lumineux de certains wagons qui constituaient un autre train parallèle à celui qui roulait…
— Maintenant, dit-elle, nous avons beaucoup parlé. Si nous essayions un peu de dormir…
Elle s’étendit aussitôt sur la banquette. Déjà elle fermait les yeux et Pierre baissait le rideau devant la lampe électrique, lorsque :
— Je dois avoir beaucoup de fautes quand je me fais comprendre en français ? Si j’étais pour vous connaître davantage, plus souvent et plus longtemps, je vous demanderais de me les faire observer.
— Vous en faites, certes, mais très peu. Et sans doute, vaut-il mieux ne pas les corriger, votre langage imagé y perdrait en force et en originalité.
— Oh ! si vous me faites des louanges pour mes barbarismes ! Dites plutôt qu’ils vous divertissent.
— Je me sens incapable de vous mentir, même pour vous plaire…
Il sembla à Caussanges qu’une légère rougeur fardait les joues de la jeune fille. Mais elle fit celle qui déjà dormait et n’avait reçu qu’à travers les premières brumes du songe cet aveu à peine falsifié.
A Paris, ils débarquaient le lendemain matin, déjà familiarisés avec la ville par l’air plus froid, le temps de pluie et les fumées de la banlieue. Ozilie disparaissait dans un de ces grands manteaux particuliers aux institutrices en villégiature. Elle emportait une seule valise, le petit sac de voyage de celles qui se déplacent souvent et promptement. Elle avait confié à Caussanges, la veille, qu’elle ne prenait que le strict nécessaire : « ma brosse à ongles, ma brosse à dents, mon savon et ma Bible. » Transformée, voyageuse en tenue d’automne, elle salua Pierre Caussanges d’un rapide signe de tête.
Mais lui, imprudemment demanda :
— Vous êtes pressée ? Vous allez loin ? Puis-je vous être utile ?
Il aurait voulu lui glisser encore cette question : « quand pourrons-nous de nouveau nous rencontrer ? »
— Vous ne faites rien, dit-elle, accompagnez-moi donc à la consigne.
Caussanges fut aussitôt très contrarié. Ozilie le remarqua peut-être, car elle ajouta :
— Vous oubliez déjà la valise que votre domestique a mise, il y a deux jours, aux bagages ?
Cet inutile mensonge qu’il avait fait à Valence, Pierre maintenant en était gêné. Il réfléchit qu’il lui serait toujours possible de s’étonner de ne rien trouver.
— Votre domestique vous a-t-il seulement remis le bulletin pour retirer votre pardessus ?
— Quel pardessus ?
— Celui que vous avez plié dans votre valise.
L’embarras de Caussanges, elle le vit, la maligne Ozilie.
— Suis-je sotte ! s’écria-t-elle. Je vous fais perdre votre temps. Qu’iriez-vous faire aux bagages ?
— Mais non. Précisément, je m’y rendais.
— Marchons, dit-elle alors.
Ils s’avançaient difficilement dans la foule. Soudain Ozilie reprit avec un visage durci :
— Avouez donc, Monsieur Caussanges, avouez que vous avez pris le train, derrière moi, comme un collégien, que vous n’avez ni valise ni pardessus qui vous suivent…
Quand il y a une sottise ou une maladresse à commettre certains hommes s’en voudraient de laisser l’une ou l’autre en suspens. Pierre Caussanges commença de nier.
— Vous n’affirmez pas assez, dit Ozilie, et vous protestez sans conviction.
Pierre Caussanges avoua en souriant qu’il était monté dans le train, derrière Ozilie. Il avait décidé en effet de partir dans la même direction que la jeune fille sitôt que celle-ci l’eut quitté…
— Je ne vous en veux pas, interrompit Ozilie. Mais maintenant, c’est fini. Laissez-moi, oui, laissez-moi.
— Je ne veux pas vous déranger.
— Vous me faites perdre mon temps et vous perdez le vôtre aussi.
— Qu’est-ce qui vous déplaît dans ma personne ?
— Rien, répliqua Ozilie en riant. Mais ce n’est pas suffisant.
— Pas suffisant ?…
— Oui. Ne pas déplaire n’est pas suffisant pour plaire.
— Que faut-il que je fasse ? J’ai de la fortune… Ne prenez pas ce que je vous dis…
— Monsieur, je ne suis pas un objet que l’on achète, ni un jouet capable de distraire. Cherchez mieux, cherchez plus loin… Il y a tant de femmes que vous pourriez suivre et qui ne vous mèneront pas de Chamarges à Paris, un long parcours !
Il restait devant elle les bras allongés, les mains jointes sur son veston boutonné.
— Perdez donc ! lui dit-elle tout d’un coup, perdez cette habitude de sacristain désœuvré !
Et comme il la regardait, gêné et silencieux, elle déclara d’une voix posée :
— Vous avez cru que j’étais riche parce que vous m’avez vue en automobile. Mais c’était l’automobile de votre voisine de Chamarges. Parce que je voyage en « première » : le voyage m’a été payé. Parce que je suis à peu près convenablement habillée ! ce sont les robes que Mlle Isabelle m’abandonne et me permet d’user. Parce que j’ai quelques bijoux, dont trois véritables : comme les robes, ils proviennent de Mlle Isabelle à qui ils ont eu le tort de déplaire.
« Je suis une petite institutrice, Monsieur. Une modeste institutrice qui parle plusieurs langues, qui est de famille honorable, c’est vrai, et qui est obligée de gagner son pain de chaque jour. Laissez-moi, je vous prie, Monsieur. Vous n’êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier à faire ainsi erreur sur mon compte. Je vous ai permis un peu sur ma piste de tâtonner. Parce qu’une femme prend toujours quelque plaisir à soulever un homme sérieux dans son sillage, et puis parce que je voulais me rendre compte, savoir si vous étiez semblable à tant d’autres. Je suis fixée. Excusez-moi, comme je vous excuse… »
Elle avait parlé d’un trait, d’une voix contenue. Tandis que Caussanges assez mortifié la saluait, elle s’éloigna et se perdit très vite dans la foule des voyageurs, vers la sortie. Cette fois-ci, Caussanges n’essaya point de la suivre.
Mais il examina sur-le-champ une dizaine de projets qu’il rejetait à mesure. Il se décida pour celui qui lui parut le plus simple : écrire à Mlle Ozilie, lui demander un entretien.
Rentré chez lui, à Paris, Caussanges rôda dans son appartement de la rue Bochart de Saron, puis il commença une lettre, une autre encore. Jamais il ne se sentait satisfait. « C’est trop long, disait-il, c’est plein d’excuses, de protestations. Elle ne lira pas si loin… » Caussanges s’arrêta à un billet qui allait droit au fait :
Vous êtes partie ce matin, si vite, Mademoiselle, que je n’ai pas eu le temps de vous répondre et de vous assurer de la sincérité de mes sentiments désintéressés…
Il terminait en sollicitant un entretien. Il se garda bien de faire allusion aux feuillets qu’il avait recueillis sur la route de Chamarges. Il les réservait pour une seconde ou une troisième lettre, au cas où la première resterait sans réponse. Il dirait à ce moment-là qu’il venait de découvrir, au cours d’un récent voyage à Chamarges, un curieux document dont il citerait quelques extraits. A cette minute, la jeune fille serait bien forcée de lui demander des précisions si elle tenait toujours aux deux pages emportées par le vent…
Caussanges, pour distancer l’obsession qu’il avait d’Ozilie, détruisit quelques papiers qui encombraient sa table, jeta des journaux dans une corbeille, résolut de se promener dans Paris. Mais où aller ? Les journaux dont il venait de se défaire lui remirent en esprit le nom de Lonlay-Labbaye.
« Si je lui parlais d’Ozilie ! se dit-il. Cela pourrait l’intéresser. Enfin, il n’est pas de mauvais conseil. »
Caussanges tenait par dessus tout à trouver un confident à qui il pourrait conter sa récente histoire. Lonlay-Labbaye, le journaliste, lui paraissait digne de cet emploi. C’était un grand et mince personnage, ancien correspondant de guerre pendant la tourmente de 1914-1918 et qui continuait de voyager pour son journal, de l’auberge au palace, comme autrefois, il allait d’un État-major à un Grand-Quartier. On lui reconnaissait de l’audace, de l’expérience, du flair et de l’imagination. Ses confrères eux-mêmes s’accordaient pour lui allouer tantôt l’une, tantôt l’autre de ces qualités.
De l’expérience, Lonlay en avait. Et le métier le formait chaque jour. Les accidents de chemins de fer lui apprenaient la géographie, les drames énigmatiques, les villes qui ont une cour d’assises, les réunions politiques, les déplacements de souverains et les enquêtes de police l’âme diverse des hommes.
Par hasard, Lonlay, à qui Caussanges téléphona, n’était pas encore sorti.
— Allo ! Tu as quelque chose à m’annoncer… Rien d’intéressant ! Mais si, c’est intéressant puisque cela te concerne… Eh bien, viens me voir… Oui, chez moi, boulevard Saint-Germain… Quand tu voudras… Allo ! je t’attends. Je ne sors pas.
Lonlay écouta le récit de Pierre Caussanges. Aucune interruption. Il laissait, selon sa coutume, parler son sujet, quitte à le ramener à la question lorsque de trop grands écarts se produisaient. La rencontre de Caussanges et d’Ozilie de Wicheslaw sur le chemin de Chamarges fit tomber en arrêt le reporter. Lorsque son ami eut terminé, Lonlay recomposa l’ensemble à sa manière, puis :
— C’est une demoiselle qui cherche un fiancé. La chasse est ouverte. C’est normal. Non, ne lui parle pas de l’innocence de tes intentions. Veux-tu un conseil et non une opinion conforme à ce que tu penses ? A ce que tu as, déjà, à demi décidé d’entreprendre ? Oui. Eh bien, fais-lui savoir que tu n’as jamais songé à l’épouser, attendu que tu es fiancé toi-même…
— Mais ce n’est pas vrai !
— Ça n’a pas d’importance. Si tu l’intéresses déjà un peu, tu l’intéresseras davantage. Et peut-être se produira-t-il ceci : ou bien elle ne songera plus qu’à te faire rompre les fiançailles dont tu lui parles, ou bien, te jugeant peu compromettant, elle tolèrera ta présence près d’elle. C’est à toi, à ce moment-là, de savoir t’y prendre pour devenir indispensable…
— Que faudra-t-il faire ?
— Si tu en es là, rentre à Chamarges tout de suite, sans tourner la tête…
— Mais encore ? reprit Caussanges.
— Par exemple : « Tu es assez riche pour deux »… Trouve le moyen de le glisser au bon moment. On ne sait pas… Cela peut avoir une certaine influence. Mais un sûr instinct m’avertit qu’avec elle, tu seras aussi malheureux pour deux.
— Et si je lui demandais dans un prochain billet où je dois lui remettre sa « lettre » que j’ai retrouvée ?
— Elle comprendra que tu désires une entrevue.
— Et après ?
— Elle est fort capable de te la refuser.
— Oh ! elle n’oserait pas, quand même ! s’écria Caussanges.
— Elle ne me paraît pas femme à se gêner, d’après ton histoire. Elle te répondra qu’elle n’a pas le temps, qu’elle n’est pas libre, qu’elle n’a plus besoin de cette lettre qu’elle a égarée, que son amie lui ayant écrit de nouveau lui a répété son adresse…
— Et alors, la lettre que j’aurais trouvée ?…
— Elle te priera de la détruire. Et tu le feras. Et je te connais : tu lui écriras pour lui annoncer que tu t’es conformé à ses ordres…
Lonlay accorda à Caussanges quelques secondes de réflexion, puis il demanda :
— Tu as toujours sur toi la lettre de cette demoiselle ?
— Quelle lettre ?
— Bien. Veux-tu me la montrer.
— Je ne sais pas si je l’ai…
Caussanges trouva dans son portefeuille, comme par hasard, la lettre qu’il avait cueillie parmi des ronciers, sur la route de Chamarges. Lonlay la lut lentement. Quand il eut fini :
— Je ne comprends plus ton récit, dit-il à Caussanges. Ou alors je ne comprends plus ton histoire… Peut-être que cette lettre que tu as ramassée, ce n’est pas une lettre que Mademoiselle… Comment l’appelles-tu ?… Ozilie… a reçue, mais une lettre qu’elle se préparait à envoyer. Elle la lisait ou la relisait dans l’auto, en allant à la gare, avant de la mettre à la poste. Sinon, ce n’est pas clair. Et Ozilie, dame de compagnie, a naturellement été curieuse de lire une lettre qu’on lui avait confiée.
— Ozilie n’est pas dame de compagnie, elle est institutrice chez Mlle Isabelle, rectifia Caussanges.
— Tu en es sûr ?
— C’est Ozilie qui me l’a avoué.
— Institutrice, dame de compagnie, cela revient au même pour la circonstance. Et cette Isabelle qui est-ce ?
— Je ne la connais pas. Je sais qu’elle est la nièce de M. Chenoncay, propriétaire de l’enclos voisin de ma maison à Chamarges.
— Tâche de te renseigner encore et enchaînons : Donc, Mlle Isabelle écrit une lettre, la confie à Mlle Ozilie qui doit à la gare prendre le train. Elle a prié Ozilie de mettre cette lettre à la poste. Dans l’auto, seule sur la route, Ozilie trouve le moyen de décacheter — ne te fâche pas ; c’est une supposition — discrètement l’enveloppe qu’on lui a remise. Espère-t-elle y découvrir des secrets qu’elle a besoin de savoir ? Peut-être. Ozilie commence sa lecture. Mais il y a plusieurs feuillets. Elle en dépose quelques-uns sur le siège, près d’elle. Le vent les emporte. C’est clair…
— C’est vraisemblable, approuva Caussanges.
— Grosse émotion d’Ozilie lorsqu’elle s’aperçoit, un peu tard, j’en suis sûr, de cette disparition. Elle court à la recherche des précieux papiers. C’est à ce moment que tu la vois venir. Tu viens d’achever ta première lecture du fragment envolé. Ozilie, très ennuyée, ne peut plus expédier une lettre ainsi diminuée. Mais si ce garçon qu’elle rencontre (c’est toi) avait découvert les feuillets égarés ! Ozilie s’efforce de te convertir en allié. Elle te parle la première, t’entraîne à la ville, te met en confiance pour que, si tu trouves les pages perdues, tu les expédies à elle-même, à une adresse qu’elle t’indique, non à la maison où elle réside à Paris et qui ne lui appartient pas, où en tous cas, elle craint on ne sait quelle surveillance.
— Pourquoi se serait-elle brouillée avec moi, si elle tenait à mes services ?
— Un peu de patience, j’y arrive. Elle te retrouve à la gare de Valence. Elle t’imaginait à Chamarges. Qu’est-ce que tu fais là ? Elle se tient ce raisonnement qui n’est pas dépourvu de justesse : « Puisque ce monsieur a pris le train, c’est pour me suivre. Puisqu’il n’habite plus le pays où la lettre a été perdue, il m’est inutile. » Elle ne veut pas s’encombrer de ta personne. Elle te le déclare bien carrément. Après, elle réfléchit, elle trouve plus efficace de pactiser avec toi. Elle est capable d’un sentiment désintéressé. Mais toi, tu insistes, tu es maladroit, tu veux connaître son adresse. Aussitôt, elle se sépare de toi sans hésiter…
— Cela me paraît plein de logique, concéda Pierre Caussanges.
— Plus j’examine la lettre que tu as ramassée, reprit Lonlay, plus ma version me paraît évidente. La tienne n’est pas mal, mais elle est incomplète. Il y a cependant une chose que je n’explique pas : quel est donc cet Evgueny dont il est fait mention dans cette lettre ?
— Je ne connais pas d’Evgueny.
— Je m’en doute un peu. C’est une question que je me pose tout haut. Je vais quand même te lire le passage qui reste pour moi sans solution :
Donne-moi des nouvelles d’Evgueny ? Comment supporte-t-il les événements ? que dit-il de mon évasion ? Car, pour lui, c’est une évasion. Qu’il se rassure. (Ne le lui annonce pas, ni à personne). Je retournerai à N.-T., à cause de toi d’abord, lorsque j’aurai mis « l’Irréparable » entre Lui et Moi. Toutefois, je voudrais que cet « Irréparable » — j’en ai plusieurs sous la main — ne fût pas un coup de folie, comprends-tu ?… Mais au contraire quelque chose qui m’agrée et qui soit parfaitement présentable. Sinon, Evgueny croirait à du dépit…
— Tu connais cette ville qui est N. T. ? Et cet Evgueny ? demanda Lonlay.
— Pas du tout.
— Et Ozilie comment est-elle ?
— C’est une jeune fille de ma taille, à peu près, expliqua Caussanges. Elle est grande par conséquent, pour une jeune fille. Une démarche aisée, souple, bien particulière et reconnaissable quand on l’a remarquée, ne serait-ce qu’une seule fois.
— Bon. Après ? Après la démarche, insista Lonlay. Les yeux ? Les cheveux ?
— Des cheveux tirant sur le brun, plutôt chatains mais que l’on ne voit guère sous le chapeau. Des yeux qui paraissent noirs tellement ils sont brillants. Mais ils sont en réalité gris verts. Tantôt très doux. Parfois durs avec fermeté. Souvent un peu mélancoliques. De grands cils, des sourcils bien fournis. Visage ovale.
— Comment était-elle habillée ? interrompit Lonlay.
— En blanc.
— Oui. Mais comment ?
— Ah ! ça, je ne pourrais pas te dire. J’ai vu l’ensemble. J’ai gardé une impression générale.
— Et dire que c’est pour des gens qui ne voient rien, comme toi, que les femmes soignent tous les menus détails que tu ne retiens pas !
— Les détails composent l’ensemble favorable.
Lonlay avait gardé les deux feuillets perdus par Ozilie et retrouvés par Caussanges. Les papiers qu’il froissait l’amenèrent à poser une autre question.
— Elle est de condition modeste ?
— Je le crois.
— Comment le sais-tu ?
— Elle me l’a dit et je m’en suis aperçu.
— Achève ta pensée. Elle est de petite aisance et tu es riche… riche pour deux.
— Maintenant, oui.
— C’est-à-dire que tu vas l’épouser.
— Pourquoi pas ? s’étonna Caussanges.
— Épouse-la, si tu veux, mais ne lui écris pas. Tu lui as parlé de ce beau projet ?
— Je ne pouvais pas : je ne la connaissais pas assez.
— C’est cependant un bon procédé pour faire connaissance.
— Mais j’ignore tout de sa vie, de son mystère, de…
— En l’épousant, tu risques au moins de satisfaire à ta curiosité. J’y insiste par contre : arrange-toi pour savoir qui est cette Mlle Isabelle. Ainsi tu auras, du même coup quelques précisions sur ta voyageuse Ozilie.
Lonlay s’était, tout en parlant, dirigé sur la pièce voisine. Il avait une idée.
— Excuse-moi : un travail à terminer. Une seconde, je reviens. Lis, réfléchis à mes conclusions, examine si tu n’as rien oublié dons ton récit…
Lonlay ne revint pas tout de suite. Il mit d’abord de petits copeaux de bois dans sa cheminée, puis au-dessus du foyer, il fit chauffer la lettre d’Ozilie.
— Je ne m’étais pas trompé ! murmura-t-il.
Les mains du journaliste qui serraient les feuillets découverts à Chamarges, tremblaient un peu. Sous l’action de la chaleur, entre les lignes lisibles du texte manuscrit, une autre écriture, plus serrée, apparut. Une nouvelle lettre secrète se composait et Lonlay la déchiffrait :
Tu l’avais deviné, chère Gina, c’est bien à cause d’Evgueny que j’ai dû partir sans même prendre le temps de te faire mes adieux. C’est le Premier qui m’a paternellement conseillé ce départ. Il pensait comme moi que cette inclination du Prince n’était que l’effet de l’imagination d’un sédentaire. L’absence et l’éloignement devaient avoir promptement raison de ce… (plusieurs mots illisibles…). Mais surtout, il m’a montré combien la présence d’Ozilie à la Grande Marche pourrait devenir gênante lorsque le prince serait appelé à de « hautes destinées ». Enfin, il m’a dit : « Lorsqu’on apprendra que vous n’êtes plus à la cour de Neu-Thorenberg, il nous sera plus facile de faire croire que le Prince est en Kabardie, parmi ses partisans, comme nous voulons qu’on le croie quelque prochain jour. »
— Je joue la carte Evgueny ! décida Lonlay. Et il se releva pour prendre rapidement note du texte roussi qui s’imprimait sous le souffle du brasier. Certains paragraphes surtout, retenaient son attention :
J’ai quitté ce pays de Chamarges où je m’ennuyais décidément trop, pour vivre à Paris. J’habiterai en hôtel et non dans l’appartement de mon oncle…
Ici plusieurs lignes mal venues, puis ceci qui avait trait visiblement au Prince :
Il me semble qu’il est resté cet enfant frivole sur lequel nul poids de couronne ne doit peser. Quant à moi, j’ai changé depuis le jour où j’ai pris la fuite de cette maison où je n’étais plus en sûreté.
Un jour, dans la grande allée du jardin, il eut l’inconscience de me répéter qu’il m’aimait. Moi, aussi, à ce moment, je croyais l’aimer un peu. Nous étions des enfants l’un et l’autre…
Lonlay transcrivit également ce passage tronqué, l’encre sympathique employée pour la correspondance secrète ayant dû s’effacer par plaques :
Au fond, dois-je l’avouer ? Je ne regrette pas cet homme inconsistant dont on ne pourra jamais rien faire ;… Un prince, peut-être. Mais pas un roi.
— C’est bien curieux, observa Lonlay, ces lignes sont visibles pour moi juste au moment où les dépêches officielles annoncent que le Prince Evgueny, héritier du trône de Kabardie, se trouve dans ce pays en pleine agitation pour la plus grande joie des Anglais.
Caussanges, pendant ce temps, attendait sans impatience. Il ne pensait pas à s’étonner de l’absence du journaliste qui était assez coutumier de ces façons. Lorsque celui-ci reparut, un instant plus tard, Caussanges reprit la conversation presque au point où il l’avait laissée.
— Pour conclure, tu ne me conseilles pas de lui renvoyer sa lettre ?
— Il vaut mieux la garder, répondit Lonlay.
— Et pourquoi ? demanda Caussanges, surpris surtout par le ton de cette riposte.
Comme il relevait la tête, il vit le visage soucieux de son ami.
— Pourquoi la garder ?
— Je trouve cette lettre étrange.
Lonlay fut sur le point de raconter sa découverte. Mais il connaissait l’imprudence de Caussanges.
— Les jambages des mots sont bizarres, ajouta-t-il et les intervalles entre chaque ligne me paraissent bien longs.
— Ce qui te permet un diagnostic ?…
Lonlay regarda Caussanges. Évidemment ce dernier ne se doutait de rien, il n’avait rien deviné…
— J’ai la conviction, assura Lonlay, que toutes mes hypothèses sur Ozilie sont fausses. Il y a autre chose.
— Je m’en doutais, affirma Caussanges presque joyeux.
L’idée d’une Ozilie, dame de compagnie, décachetant une lettre qu’on lui a confiée, lui déplaisait. « Ce sont des choses qu’un esprit droit ne fait jamais », se disait-il…
— Que décides-tu ?
— Je ne sais pas encore, avoua Caussanges.
— N’écris pas à Ozilie. Attends… Garde sa lettre précieusement. Je te la plie sous enveloppe…
Lonlay se disait : « Dois-je le mettre au courant de ce que j’ai lu ? Il va faire des bêtises… »
— Je vais essayer de me renseigner sur ta jeune personne. Sortons ensemble, veux-tu ? Tu me parleras encore d’Ozilie, tu m’accompagneras jusqu’au journal. Je ne m’attarderai pas…
— Après le journal, où iras-tu ? demanda Caussanges.
— Je prendrai le train.
— Ah ! Tu iras loin ?
— Je pense que je vais réussir… oui, « réussir » un assez joli reportage.
Mais Lonlay n’en dit pas plus sur ce sujet-là. Pour ces sortes de travaux, la discrétion était de rigueur.
Toutefois, on peut affirmer qu’arrivé à son journal, il se rendit dans le bureau du rédacteur en chef.
— Vous savez, ce Prince de Kabardie…
— Qui combat, dans son pays…, répliqua l’autre par hasard au courant.
— Oui. Je sais où il est… Je pourrais le voir, lui parler peut-être.
— Un déplacement important ?
— Quelque chose comme la Suisse.
— Prenez un bon pour la caisse, répondit le rédacteur en chef, après une seconde de réflexion. Puis il ajouta :
— A quand votre premier télégramme ?
— Dans trois jours, quatre au plus…
— Au revoir, Lonlay. Bon voyage…
Il faut croire que nul pouvoir au monde ne peut retenir certaines personnes sur le point de commettre une sottise, surtout lorsque cette sottise doit entraîner pour elles des conséquences imprévues et fâcheuses.
« N’écris pas ! » conseillait Lonlay-Labbaye. Après réflexions, Pierre Caussanges n’envoya pas à Mlle Ozilie la lettre qu’il avait préparée, mais une nouvelle lettre qu’il composa.
Il garantissait à la jeune fille qu’il avait prié les gens de sa villa de Chamarges de rechercher sur la route les deux feuillets emportés par le vent, qu’il expédierait ces deux feuillets sitôt qu’il les aurait reçus, si par hasard on les découvrait… A ces précisions, Caussanges trouva opportun d’ajouter un post-scriptum soigneusement étudié.
J’avais bien deviné à certains signes, à certains détails que vous n’étiez pas une riche héritière, comme vous avez pensé que je le supposais. J’avais compris, au contraire, que vous étiez une honnête fille, de bonne éducation, certes…, etc…
Puis il cacheta son envoi, mit l’adresse « poste-restante, bureau Danton. » Un moment, il songea qu’il lui serait aisé de surveiller les abords de ce bureau, mais il renonça à ce projet comme indigne de lui. Et aussi parce qu’il le jugea impraticable.
Caussanges, cette fois-ci, ne se trompait point.
C’était, en effet, Trophime Trophimova, une slave blonde, femme de chambre de Mlle Ozilie, qui retirait les lettres que cette dernière se faisait adresser à la poste.
Lorsqu’elle ouvrit la lettre de Caussanges, Ozilie se dit :
— Je m’en doutais. Il n’a pas encore osé me renvoyer mes deux feuillets qu’il a ramassés sur la route de Chamarges. Ces feuillets, il les avait déjà lorsque je lui ai parlé pour la première fois. Il les a lus et il les a gardés sur lui. Le prochain courrier me les apportera, « miraculeusement dénichés dans un buisson par un domestique » de ce Monsieur.
Mais lorsque la jeune fille en vint aux dernières lignes (« J’avais bien deviné… que vous n’étiez point une riche héritière… »), c’est-à-dire au post-scriptum qu’une femme ne néglige jamais parce qu’elle pense toujours y découvrir l’essentiel de ce qu’on lui mande, elle secoua la tête.
— L’imbécile ! murmura-t-elle sur un ton d’irrémédiable mépris.
Trois jours plus tard, Ozilie recevait une deuxième lettre de Caussanges. Tout de suite, elle en reconnut l’écriture. Quelles nouvelles protestations ? Et à quoi bon décacheter cette lourde enveloppe ? Ozilie hésitait. Mais peut-être Caussanges lui envoyait-il les deux feuillets perdus ?
Ozilie les retira en effet, craquelés par un long séjour en poche. Caussanges ne précisait pas comment ces feuillets avaient été recueillis, mais parlait du hasard, de la chance et du flair de son jardinier. Ozilie riait en lisant ces grosses explications. Elle se sentait à présent portée à l’indulgence pour ce singulier garçon qui, sur une page d’envoi, lui rappelait avec gaucherie un choix de ses anciens propos :
C’est vous-même qui m’avez offert votre amitié, c’est vous-même qui m’avez proposé alliance et maintenant vous ne me connaissez plus !
— C’est pourtant vrai, reconnut la jeune fille.
Mais les feuillets qu’elle avait cru un moment perdus attirèrent son attention.
— Comme ils sont durcis et cassants !…
« Trophime, ajouta-t-elle, écris donc à Chamarges pour savoir le temps qu’il a fait depuis notre départ : orages, pluies ou grand soleil.
— Je puis répondre tout de suite à Mademoiselle, assura Trophime. Une lettre que l’on m’a remise ce matin m’annonce qu’il a plu continuellement, sans arrêt, même que le torrent a grossi comme il ne le fait guère qu’au commencement de l’hiver.
Ozilie sourit de nouveau :
— Je vais te dicter une réponse, reprit-elle. Écris.
— Mais je fais des fautes !
— Tant mieux. Écris :
Des nouvelles de Chamarges que j’ai reçues ce matin en même temps que votre aimable envoi m’ont appris que des orages avaient inondé la campagne. J’espère que vos gens n’ont pas été trop mouillés au cours de leurs recherches, pas plus mouillés que les deux feuillets perdus et miraculeusement préservés des œuvres de la tempête…
J’ai lu vos lettres à mon retour à Paris, car je m’étais absentée une semaine. Comment vous remercier ?…
Cependant Ozilie tournait dans ses mains les feuillets que Caussanges lui avait expédiés. Déjà elle les froissait et les transformait peu à peu en une sorte de boulette qu’elle se proposait de jeter dans la cheminée, lorsque, surprise encore par la fragilité du papier qui se brisait sous ses doigts, elle l’examina.
Sur cette lettre, qui avait dû être exposée au-dessus d’un foyer, entre les lignes écrites à l’encre ordinaire, des caractères inconnus, d’une couleur roussie, se lisaient facilement…
Ozilie pâlit. Elle regarda devant elle. Puis à Trophime Trophimova qui attendait :
— Cela suffira. Prépare tes valises. Nous allons partir.
— Encore !… Et cette lettre qui n’est pas finie ?
— Inutile.
— Vous ne répondez pas à ce monsieur ?
— Quel monsieur ? Donne-moi ce que tu as fait.
Ozilie s’approcha de la cheminée, y déposa les deux lettres, celle que Trophime venait de transcrire et les feuillets « retrouvés » sur la route de Chamarges.
— Une allumette…
Ozilie attendit que les papiers fussent consumés, puis elle compléta sa première décision.
— Cette histoire-là est terminée.
— Qu’allons-nous faire ?
— Il y a bien d’autres distractions…
— Ah oui, conclut Trophime. Je les connais… Les voyages encore…
Le soir même, Caussanges envoyait quelques mots à Lonlay pour l’avertir qu’il avait fait tenir à Mlle Ozilie la lettre de la route de Chamarges. « J’ai trouvé ce procédé plus loyal », ajoutait Caussanges.
— C’est de ma faute, constata Lonlay. J’aurais dû prévoir que Caussanges agirait ainsi. La jeune personne va se tenir sur la défensive à présent !
Le romanesque chez moi s’étendait à l’amour, à la bravoure, à tout.
Stendhal.
Sur la piste des personnages…
Deux jours plus tard, le 10 octobre, dans l’après midi, Ozilie faillit perdre patience. Décidée à quitter Paris le soir même pour se rendre en Suisse, elle avait envoyé Trophime Trophimova jusqu’à la rue Danton. La femme de chambre sortie à quatre heures, devait uniquement demander les lettres parvenues à la poste-restante et revenir. Mais la « Trophimova » ne revenait pas. Serait-elle de retour à temps pour prendre le train, ce soir ? Avec les habitudes de Trophime, on pouvait en douter.
Ozilie s’efforçait de ne point penser à ces désagréments. Elle songeait plutôt qu’elle laisserait sans trop de regrets, cette chambre d’hôtel de la rue de Tournon, où fidèle à ses principes, elle s’était réfugiée pendant son séjour à Paris, de préférence à cet appartement situé près du Luxembourg que M. Chenoncay réservait aux voyageurs venant de Chamarges.
Par contre, elle emportait la nostalgie de Paris. Elle ne quittait jamais sans un serrement de cœur, cette ville qui l’enchantait. Et elle goûtait une fois encore les amères joies du départ et cette impression si vive que l’on ressent à changer d’existence, à rompre les liens convenus, établis avec les horaires et l’habitude…
Mais aujourd’hui, il fallait reconnaître que le voyage était imposé par la nécessité et non par un subit caprice. Ozilie s’était promis de ne pas rouler avant longtemps sur les routes de la Suisse et voici que, par sa faute, cette lettre perdue à Chamarges, retrouvée et déchiffrée on ne sait comment par Pierre Caussanges, l’obligeait à regagner cette cour de Neu-Thorenberg qu’elle avait déserté quelques mois plus tôt.
Ce Caussanges, comme elle s’était trompée sur lui ! Elle l’avait pris pour un loyal garçon. Elle lui avait confié un peu de son âme tourmentée, et, sous des manières voilées, il est vrai, le plus clair de ses goûts. Elle avait, en somme, pensé tout haut en sa présence et cherché à analyser devant lui aussi bien la femme qu’elle croyait être que celle qu’il lui aurait plu de représenter…
Cette erreur de diagnostic la corrigerait-elle ? Désormais, elle n’accorderait plus autant de crédit à son instinct. Elle ne jugerait plus sans appel les gens, sur la première impression. Mais alors, à quoi se fier ?
A cinq heures et quart, Trophime reparut. Elle ne rapportait qu’une seule lettre. Et pour excuses la dignité de son silence.
— Vous avez pris une voiture ? demanda Ozilie, ironique, qui ne tutoyait pas sa femme de chambre lorsqu’elle s’apprêtait à lui faire des reproches.
— Oui, Mademoiselle, répondit la « Trophimova » aussi sévère que sa maîtresse. La voiture est encore en bas.
— Vous étiez chargée ?
— Non, Mademoiselle. J’étais pressée.
— Vous n’êtes pas trop fatiguée ?
— Si, Mademoiselle. J’ai attendu longtemps devant le guichet.
— Si longtemps ?
— Très longtemps. Et je crois en outre que j’ai été suivie dans la rue.
— Les admirateurs se multiplient derrière vos pas…
— Oh ! pas des admirateurs, rectifia simplement Trophime insensible à ces railleries.
— Quoi donc, s’il vous plaît ?
— Des policiers, je présume.
— Tu les connais ?
— Non. Mais ils me connaissent.
Toutefois, Ozilie qui lisait la lettre, dont le texte dactylographié était court et catégorique, haussa les épaules :
Un envoyé de S. A. le prince Evgueny vous attendra du 10 au 12 octobre, tous les jours après-midi, de quatre heures et demie à cinq heures et demie sur la terrasse des Tuileries. Il désire vous parler, à vous seulement, de faits de la plus haute importance.
Pour S. A. Evgueny :
Une signature illisible griffait le papier.
D’abord, Ozilie fut stupéfaite et furieuse. Elle recevait un ordre sans paraphe, ni sceau, ni lieu d’origine, mais un ordre quand même. Evgueny ne changerait donc jamais ! Et comment avait-il eu connaissance de l’adresse d’Ozilie, poste restante si ce n’était par Gina ? Voilà un danger qu’elle n’avait pas prévu.
Un moment, elle pensa expédier Trophime à ce rendez-vous, mais elle réfléchit qu’un envoyé d’Evgueny devait la connaître, elle, Ozilie, tout au moins de vue, puisque la lettre n’indiquait aucun de ces signes conventionnels destinés, paraît-il, à faciliter les rencontres.
— Reste ici, avec les valises, jusqu’à mon retour.
Trophime, accoutumée à ce qu’elle considérait comme des brusqueries de caractère, ne répondit pas. Mais comme la jeune fille allait sortir :
— Si Mademoiselle veut prendre mon automobile, qu’elle ne s’en prive pas.
— Tu as une automobile maintenant !
— Celle qui vient de me transporter jusqu’ici. Et je me souviens que je n’ai pas encore payé ce qui est inscrit au compteur.
Ozilie descendit. Au chauffeur qui attendait, elle donna cette adresse :
— Place de la Concorde.
« Si je découvre cet envoyé d’Evgueny, pensait-elle, ce sera tant mieux ou tant pis. De toutes façons, je ne me dérangerai pas demain ni les jours suivants. »
Sur la terrasse des Tuileries, rien de remarquable. Un vieillard, puis un autre vieillard, un jeune homme et une dame, puis une petite fille… Ozilie regardait. Non. Pas d’envoyé d’Evgueny.
« Suis-je sotte ! se dit-elle. S’il vient, il ne peut pas être en costume de Cour, comme « là-bas », mais habillé à la mode de Paris. Ne serait-ce pas ce Monsieur qui fait semblant de lire ?… »
Sur un banc, un homme tenait un livre. Il baissait la tête et ne se souciait de personne. Ozilie devait-elle continuer sa route ? Cependant, elle crut s’apercevoir que le personnage l’examinait au point d’en oublier sa lecture.
— C’est l’envoyé, pensa-t-elle aussitôt.
Elle observa le long visage maigre de cet homme qu’elle n’avait pas remarqué encore parmi les familiers d’Evgueny. Puis elle se dirigea résolument vers celui qu’elle soupçonnait d’être l’émissaire du prince. Elle s’arrêta et tout de suite :
— C’est vous qui m’adressez des lettres non signées ?
L’homme interpellé ne répondit pas.
— Bien, je me suis trompée. Excusez-moi, Monsieur.
Déjà, elle s’éloignait. L’homme ferma son livre, se leva en agitant les bras.
— Oui, c’est moi qui vous ai écrit, déclara-t-il.
— Vous avez mis du temps pour vous décider ?
— Je n’avais pas compris tout de suite.
— Vous comprenez maintenant ?
— Parfaitement.
— Eh bien, c’est moi qui ne comprends pas !… Je ne comprends pas ce que vous me voulez.
Ozilie se tenait droite devant le personnage dont elle soutenait le regard.
— Le prince désirerait, commença l’émissaire… Le prince serait heureux de savoir pourquoi vous l’avez fui, débita-t-il avec une hésitation que l’on sentait feinte.
— Son Altesse, Monsieur, le sait si vous ne le savez pas. Ma réponse ne lui apprendrait rien.
— Moi, Mademoiselle, c’est comme si je ne savais rien. Le prince… Son Altesse désirerait encore…
Elle l’interrompit :
— Vous êtes délégué ?… Vous appartenez au Prince ? Quel prince ?
— Oui, Mademoiselle, répondit le délégué avec assurance.
— Alors, vous savez qui je suis ?
— Je le sais, Mademoiselle.
— Comment se fait-il donc que, m’ayant reconnue vous ne m’ayez pas encore saluée comme il convient ?
L’homme, cette fois, parut vraiment confus. Ozilie, satisfaite de le sentir embarrassé, reprit :
— Qu’attendez-vous, Monsieur. Vous êtes inexcusable. J’écrirai à Son Altesse pour lui rappeler qu’il n’a jamais eu le choix heureux.
L’homme s’inclina :
— Ce n’est pas à vous qu’il appartient de dire que Son Altesse n’a jamais eu le choix heureux.
Ozilie ne releva pas cette réponse de celui qu’elle avait mortifié.
— Mademoiselle, je vous prie…, continua le délégué.
— Si vous me connaissez, pourquoi m’appelez-vous Mademoiselle ?
— Pour ne pas attirer l’attention de ceux qui nous écoutent.
— Il n’y a personne, répliqua Ozilie.
— Peut-être. On ne sait jamais.
— Eh bien, poursuivit Ozilie, faites-moi la grâce quand même de me nommer chaque fois que vous m’adresserez la parole : « Votre Noblesse ».
— Faites-moi la grâce de ne jamais dire « Son Altesse » en parlant du Prince. Ce sera plus prudent.
— Je n’ai rien à craindre, Monsieur.
— On le dit. Mademoiselle, le prince, mon maître, m’a envoyé auprès de vous… auprès de Votre Noblesse, si vous voulez, parce qu’il désirerait que vous lui fassiez remettre les lettres que vous avez de lui.
— Si j’avais quelque chose à envoyer à Son Altesse, ce ne serait pas vous, Monsieur, que je choisirais comme émissaire.
L’homme, qui semblait très calme et acceptait avec patience les impertinences d’Ozilie, changea d’attitude :
— C’est une explication que je puis rapporter. Mais je voudrais quelques mots de vous en réponse à cette autre question : les raisons de votre fuite ?
— J’ai déjà expliqué tout cela.
— Comment ?
— Peu vous importe…
— Oui, par lettre. Mais les lettres se perdent. Imaginez que celle-là se soit égarée. Vous ne dites rien ? C’est bien la preuve que la demande du Prince vous est désagréable. Peut-être même vous paraît-elle dangereuse ?…
— Le danger est pour vous, Monsieur, que je remercie, en attendant que votre maître agisse de même avec vous.
— Mais « Votre Noblesse » se tait toujours sur la deuxième question… remarqua le délégué ironique.
— J’ai répondu, Monsieur, Son Altesse sait cela mieux que vous.
— Votre Noblesse l’assure…
— N’en doutez pas.
— Ce n’est pas moi, c’est Son Altesse Evgueny qui cherche à savoir la vérité. Si Son Altesse avait pleine certitude, il ne m’aurait point envoyé à Paris ; je n’aurais pas accompli un long voyage…
— Oh ! long voyage… dit Ozilie en riant. N’exagérons rien.
— C’est long quand même.
— Une demi-journée !
— Je vous demande pardon, rectifia le délégué.
— Quel train avez-vous donc pris ?
— Celui de nuit, répondit-il.
— Eh bien, en partant de Genève le soir, à neuf heures et demie, vous arrivez à la gare de Lyon à neuf heures du matin, le lendemain.
Ozilie qui se tenait en face du délégué, ne vit pas le sourire de son partenaire.
— Je vous le concède, dit-il, cependant vous oubliez les précautions à prendre, les raisons du voyage à cacher, les détours qu’il faut prévoir…
— Mais enfin, Monsieur, que me voulez-vous ? demanda tout d’un coup Ozilie, d’une voix agressive.
— Ce que je vous ai dit. Pas plus.
A son tour, elle regardait cet homme avec étonnement. Et lui, de la voir ainsi, se sentait pris de pitié pour cette femme qui se débattait. Peut-être aurait-il prononcé quelques paroles superflues. Mais Ozilie le rappela au souci de son propre rôle.
— Qu’est-ce que cela peut bien cacher ? Répétez un peu la demande que vous m’avez faite ?
Le délégué recommença, exagérant la leçon apprise. Ozilie réfléchissait.
— Je vois, conclut-il, que pour vous, tous ces mots ont un sens. Pour moi, non…
Ozilie, sans répondre, s’éloigna…
Lonlay-Labbaye ne s’était point pressé de fermer sa valise aussi vite du moins qu’il l’avait laissé entendre à Pierre Caussanges. D’abord, il avait voulu voir lui-même Ozilie, lui parler, la faire parler.
« Il faut avouer, disait-il, que je n’ai pas réussi. Et cette première entrevue ne m’a pas appris grand’chose ».
Lonlay se rendait compte également qu’il ne pouvait pas recommencer l’expérience et se présenter de nouveau devant Mlle Ozilie de Wicheslaw. C’est alors qu’il songea à Jacques Wisel.
Boulevard Raspail, non loin de la rue de Rennes, habitait ce curieux garçon, voyageur par goût, historien par ennui, propriétaire terrien par état. Lonlay estimait en outre qu’il recueillerait auprès de Wisel d’utiles précisions sur la Kabardie actuelle et sur l’exil du prince héritier Evgueny. Car Lonlay avait l’habitude de consulter ses amis, suivant leurs spécialités, plutôt que de rechercher des documents dans des ouvrages plus ou moins introuvables.
Comme un homme pour qui les heures sont précieuses, Lonlay énuméra devant Wisel ses acquisitions.
Wisel tenait le journaliste pour un garçon audacieux, volontaire, passionné pour sa profession aimant du reste à rendre service, assez orgueilleux toutefois sous ses airs modestes. Et il ne cachait pas l’estime et l’indulgence un peu sur le qui-vive qu’il ressentait pour cet esprit actif et fertile en ressources. D’autre part, Lonlay qui aimait les déplacements, l’imprévu et qui s’intéressait à tout ce qu’il pouvait découvrir lui apportait toujours une vivante distraction.
Wisel écoutait donc avec curiosité l’exposé de Lonlay :
— Il y a en Suisse, près de Genève, un lieu dit « La Grande Marche » que l’on ne relève ni sur les cartes ni dans les guides.
— Exact, sans doute. Car je ne connais pas.
— Un Prince, nommé Evgueny, établi là, s’y entoure d’une petite cour d’exilés comme lui. Peu de renseignements sur ce Prince. Toutefois, ce monarque doit ignorer l’art de choisir ses ministres et ses émissaires. Son peuple l’a déclaré déchu et lui-même, l’Altesse, a dû abandonner sa couronne et son royaume pour se réfugier, incognito, en Suisse.
— Qu’y a-t-il autour de lui ?
— Comme personnages de la cour, un premier ministre dont la fille Gina, négligente ou hostile, ne répondait pas aux lettres que lui envoyait une demoiselle Ozilie de Wicheslaw.
— Quelle est cette demoiselle ? demanda encore Wisel, gagné peu à peu par cette intrigue.
— Une aventurière, sans doute. Caussanges l’a rencontrée…
Lonlay conta par le menu l’entrevue d’Ozilie et de Caussanges…
— Si je comprends bien, vous ne possédez pas grand’chose. Et sans être indiscret, reprit Jacques Wisel, puis-je savoir à quoi ces renseignements doivent vous servir ?
— Comment ? s’étonna Lonlay. Mais c’est bien simple. Il y a un petit prince en exil qui n’a rien voulu confier à personne, pas même l’endroit de son refuge. Il se cache, il est silencieux, il vit secrètement. Des partisans restés fidèles, lui composent un entourage discret. Or, nous tombons par hasard — le hasard, c’est Caussanges, vous le connaissez de vue et de nom — sur une pièce qui nous permet de suivre la piste de toute une intrigue amoureuse, au milieu des machinations et des jalousies d’une cour de réfugiés… Cela ne vous intéresse pas ?
— Vous allez donc dévoiler la retraite de ce Prince, servir d’indicateur à ses ennemis, vouer ainsi ce jeune garçon à quelque obscure et tenace vengeance ?…
— Vous vous trompez ! On ne révèle jamais ces choses-là !
— En somme, vous n’avez pas réussi auprès de cette dame au nom étrange ?
— Ozilie ? Pas du tout.
Lonlay ne cachait pas son souci de connaître Ozilie et la démarche qu’il avait entreprise sans succès auprès de la jeune fille.
— Il faudrait lui expédier Floriant de Floriot, observa Jacques Wisel ironique. Il saurait peut-être l’interroger.
— Vous plaisantez. Floriot ne saurait me servir.
— Pourquoi le gardez-vous dans votre compagnie ?
En parlant ainsi, Jacques Wisel faisait allusion à la petite classe de reporters qui s’égaillaient dans le sillage de Lonlay. On en remarquait deux ou trois, quatre même, de journaux différents, appelés à accomplir de compagnie les mêmes déplacements, qui prenaient parfois leur mot d’ordre chez Lonlay, ne dédaignaient pas ses renseignements et profitaient de son expérience.
Des rivalités, certes, mais pas de trahison. Une sorte de syndicat tacite était ainsi formé : les nouvelles y étaient souvent jetées en commun ; chacun les présentait ensuite à son gré.
— Floriant de Floriot me divertit, répliqua Lonlay-Labbaye. Il représente pour moi le personnage qui s’est trompé de métier, qui est entré par distraction dans la carrière la plus contraire à ses goûts et à son tempérament. C’est pourquoi il m’est utile. Ce qu’il néglige d’entreprendre, c’est cela qu’il faut faire tout de suite. Ce bureaucrate ingénu est comme une gageure réussie. Mais je ne lui demande jamais rien au-dessus de ses forces. »
Dans ces derniers mots Lonlay se peignait en entier, avec son besoin d’autorité qu’il maquillait sous des conseils, une bonhomie obligeante et de l’ironie. Il n’ignorait pas, du reste, qu’on lui décernait quelques mérites et que l’on reconnaissait son ascendant sur autrui. Ce pouvoir, quelques-uns le croyaient important. Mais Lonlay délimitait sans tricherie le secret de sa force. Il parlait peu, il agissait beaucoup, payait toujours de sa personne et donnait rarement un avis superflu. C’est suffisant parfois pour s’assurer des alliés. Enfin, dans le monde disparate où il vivait, Lonlay savait reconnaître ses amis, leur rendre service et ne point les oublier dans l’adversité.
— Je crois deviner, reprit Wisel, que vous m’avez choisi pour voir cette jeune personne ?
— Je ne suis pas allé jusqu’à un choix. Mais je suis sûr que votre rencontre avec une véritable dame d’honneur d’une cour étrangère vous sera une vivante leçon d’histoire.
« Et puis, cela vous divertira », ajouta Lonlay.
— Je ne vois que les désagréments de cette démarche, répondit Wisel soucieux. Mais en lui-même, il songeait à l’inconscience du journaliste et d’une façon générale, aux déformations qu’inflige tout métier à celui qui s’y livre avec force.
— Je n’en discerne pas avec un homme adroit, sympathique et courageux.
— Que voulez-vous faire des lettres du Prince ? insista Wisel.
— Rien. Si Ozilie me les apportait, nous ne saurions où les cacher. Mais rassurez-vous, elle ne vous les offrira pas. Ces lettres, ce n’est donc qu’une entrée en matière. Je vous expliquerai : pour la circonstance, vous auriez le titre de second délégué du Prince… Ce qu’il nous faudrait, c’est l’adresse précise, du Prince. Le lieu dit « La Grande Marche » est un nom de convention pour les initiés.
— Et lorsque vous aurez cette adresse ?
— J’irai voir le Prince. Pourquoi pas ? poursuivit Lonlay. On annonçait ces jours derniers que Son Altesse Evgueny combattait parmi ses partisans, puis qu’il avait été enlevé par ses adversaires… Un petit télégramme sans commentaires. Cette nouvelle a été démentie, puis confirmée. Retrouver le Prince détrôné, le retrouver en Suisse, où personne ne songe plus à le rechercher, n’est-ce pas renverser toutes les hypothèses et accomplir un coup de maître ?
— Oui, dit Wisel sans enthousiasme, je conçois maintenant l’intérêt que vous portez à Son Altesse…
— Vous voyez bien qu’il est nécessaire que vous rencontriez Sa Noblesse Ozilie. Laissez-moi faire. Je vais tout préparer. Et vous passerez une amusante après-midi.
— Décidément Floriot ne vous est d’aucun secours dans ces cas-là !
— C’est votre impression surtout que je voudrais connaître. Vous parlerez de choses vagues, pas compromettantes. Je suis impatient de confronter votre opinion avec la mienne…
A l’hôtel de la rue de Tournon, cet après-midi du 12 octobre, en entrant dans sa chambre, Ozilie qui était sortie après son déjeuner, pour le plaisir de marcher un peu, découvrit Trophime Trophimova à cheval sur la plus grande des valises.
Armée d’une étoffe de flanelle, d’une paire de ciseaux et d’un bâton de rouge, Trophime polissait ses ongles.
— Nous ne partons pas encore, lui annonça Ozilie. Tu peux replacer nos bagages.
— Pour quoi faire ? Ils sont bien comme ça, répliqua Trophime sans se déranger.
Ozilie n’insista point. Elle songeait encore à cet étrange envoyé d’Evgueny qui lui avait réclamé les lettres du Prince et demandé les causes de son départ. Que se passait-il donc à la cour de Neu-Thorenberg ? Que faisait Gina qui n’écrivait pas ? Pourquoi le délégué s’était-il montré d’abord hésitant, puis décidé, puis impertinent ? Son insolence même avait obligé Ozilie à se retirer, car elle s’était refusée à continuer une conversation ainsi engagée. « Cependant il faut attendre, se disait-elle. Il faut savoir ce que tout cela signifie ».
Et elle demanda à Trophime de vouloir bien se rendre encore une fois jusqu’à la poste de la rue Danton.
— Est-ce pressé ? s’enquit la femme de chambre.
— Tout ce que je fais est pressé, Trophime…
— Ah !… Mais ce que vous dites de faire ?
— Je dis : Tout ce que j’entreprends est pressé. Va et reviens vite.
— J’en reviens, assura Trophime. Oui, je savais que vous m’enverriez rue Danton…
— Tu n’as rien rapporté ?
— Si. Une lettre, une seule.
— Et tu ne me la remettais pas ? s’étonna Ozilie, qui, cependant, avait dépassé avec Trophime la période des étonnements.
— J’attendais que vous me disiez d’y aller, répondit-elle. Vous ne m’aviez pas encore averti que c’était pressé…
Ozilie jugea inutile de continuer. Elle prit la lettre que la femme de chambre lui tendait. C’était un billet à peu près semblable au précédent :
Un délégué vous attend toujours devant la grille des Tuileries, place de la Concorde, de quatre heures à…
— Je n’irai pas ! décréta tout de suite Ozilie. Non, je n’irai pas.
Mais en pareille circonstance, une décision muette a plus de prix que deux dénégations prononcées à voix haute, sur le ton de la colère. A quatre heures, Ozilie ne bougea point. Mais à quatre heures et demie elle commença de s’apprêter et à cinq heures elle sortait. « Il faut en finir », dit-elle comme pour s’excuser d’avoir changé d’avis…
Le crépuscule avec le vent chassait les rares ombres que le froid n’avait pas dispersées. Le cri d’une sirène de remorqueur dispersait des mouettes sur le fond de l’horizon.
La jeune fille attendait. Elle s’était promis de rester jusqu’à l’heure fixée par le billet anonyme : six heures. Mais une inquiétude ne la quittait pas et cette impression de se sentir surveillée par des yeux inconnus.
Notamment ce garçon habillé de noir ? Ozilie n’admettait pas que son instinct se permît de l’égarer. Toutefois, elle hésitait… Mais pour se punir de cette hésitation qu’elle attribuait à de la timidité et pour se prouver son sang-froid elle partit résolument à la rencontre du gentleman.
Tout de suite il s’inclina et sans détours :
— Vous connaissez, Mademoiselle… la mission qui m’est confiée. Je pense que vous avez réfléchi à la réponse que vous voulez me remettre. Aussi, je ne vous en parlerai plus et j’attendrai tout de votre bonne volonté.
Il s’était exprimé très vite et maintenant il regardait du côté des Champs-Elysées. Ozilie l’examina. C’était un homme sérieux, un peu trop sérieux même. Ozilie cherchait à définir l’impression qu’elle recevait de ce personnage de taille moyenne qui devait avoir une dizaine d’années de plus qu’elle. Il lui parut sympathique. C’est pourquoi, par esprit de contradiction ou peut-être pour ne pas céder à son premier mouvement, elle répliqua :
— Je vais vous rassurer sur-le-champ, Monsieur. Je n’ai pas de lettres à remettre au Prince. Si je suis partie, c’était pour changer d’air. Telle est ma réponse. Vous pouvez vous retirer, Monsieur, si votre temps a quelque valeur.
— C’est ce que je fais, Mademoiselle.
Déjà il allait s’éloigner, l’air ravi, semblait-il lorsqu’Ozilie lui demanda avec une indifférence polie :
— Comment va Son Altesse ?
— Fort bien, répondit Jacques Wisel.
— Il habite toujours ?…
Elle ne termina point sa question.
— Toujours.
— A la « Grande Marche », alors ? précisa cette fois la jeune fille.
— Toujours la même adresse.
— Pour lui écrire…?
— Écrivez lui, s’il vous plaît, répliqua Wisel. On fera suivre si c’est nécessaire.
— Vous êtes content d’être à Paris ? demanda encore Ozilie.
— Très content.
Puis Jacques Wisel sourit, pour cacher son embarras : il ne savait comment mentir.
— Mon départ pour Paris était depuis plusieurs jours chose convenue. Son Altesse l’ayant appris vint jusqu’à la gare me confier un message. Je m’en acquitte ce soir.
— Vous êtes le deuxième messager ainsi expédié.
— Je l’apprends à l’instant, Mademoiselle.
Il déblayait son récit d’un trait, pressé d’en finir. Toutefois, il revint sur ce qu’il avait conté, comme un écolier qui a perdu le rythme de sa leçon.
— Vous êtes au service du Prince ? poursuivit Ozilie qui ne cachait plus sa curiosité.
— Oh ! si peu !
— Mais enfin, vous êtes à son service ? Je veux dire : vous faites partie de la Cour ?
— Vous en voyez la preuve, se contenta de répondre le délégué.
— Rien de changé au château ?
— Quel château ? Celui de Son Altesse ?
— Oui.
— Non. Rien. Vraiment rien.
— Et Gina ?
Jacques Wisel ne se pressait pas de répondre. Lorsqu’il y consentit, il le fit avec un étonnement qui était peut-être feint, mais qui surprit un peu Ozilie.
— Gina ?
— La fille du premier ministre.
— Ah ! Mlle Gina ! Presque invisible ces derniers temps. On a parlé d’une mauvaise grippe.
— C’est pour cela qu’elle ne me répondait pas ! Et moi qui l’accusais d’indifférence !
Jacques Wisel se taisait. Ozilie sans bien discerner les raisons qui la faisaient agir, aurait voulu continuer cette conversation avec le nouvel émissaire. Mais elle se sentait déroutée par cette politesse distante.
— Je ne veux pas abuser de vos instants, Monsieur… mais… Croyez-vous vraiment que je garde par devers moi une importante correspondance du Prince ?
— Je ne crois rien, Mademoiselle.
— La croyez-vous compromettante, dangereuse ?
— Ces questions, je n’ai même pas le droit de me les poser.
Cette réponse déplut à la jeune fille. Peut-être aussi les manières et l’accent de Jacques Wisel.
— Au revoir, Monsieur. J’ai votre adresse, n’est-ce pas ? Non, je ne vous enverrai pas un mot, au cas où… je changerai d’avis. Je n’aime pas écrire.
— Comment me préviendrez-vous ?
— Vous le verrez bien, dit-elle en riant.
A quels signes imperceptibles à l’œil nu, deux êtres qui se voient pour la première fois se reconnaissent-ils comme des gens certains en eux-mêmes qu’ils devaient un jour ou l’autre se rencontrer et devenir des amants ou des amis ?
Ozilie entendit-elle l’appel de cet avertissement intraduisible ? Elle ne pouvait se décider à partir. Jacques Wisel non plus ne pensait pas à s’en aller.
— Avouez-moi, reprit brusquement Ozilie, avouez-moi que vous connaissez peu le Prince et encore moins la Cour ?
Est-ce Ozilie qui a parlé ? Elle ne s’en rend pas compte elle-même. Quelle autorité, qui la guide en ce moment, lui fait poser cette question ?
Wisel n’a pas bougé. Mais une incertitude le paralyse. Serait-il deviné ? « J’ai agi avec légèreté, pense-t-il, en acceptant cette ridicule délégation pour faire plaisir à Lonlay. »
— Avouez-moi que vous êtes un délégué de hasard ?
— Si c’est votre opinion, Mademoiselle.
Puis comme s’il prenait une résolution :
— S’il vous est plus facile de vous exprimer en anglais, dites-le-moi.
— Non, c’est l’allemand que je préfère. Mais je parle donc si mal en français ? Je continue, car cela m’intéresse. Dites-moi, vous n’êtes pas un familier de Son Altesse ?
— Oui, je connais mal le Prince et pas du tout la Cour. On m’a chargé de ce message. Je n’y entends rien. Voilà la vérité. Maintenant, Mademoiselle, faites comme il vous plaira.
Cet homme allait-il se retirer à présent ? Ozilie le ramena aussitôt.
— Écoutez-moi.
— Parlez, Mademoiselle. Je vous écoute.
Contradiction bien humaine. Ozilie ne tenait plus maintenant à confier à cet étranger ce qu’elle voulait lui soumettre tout à l’heure.
— Il vaut mieux que vous sachiez tout, reprit-elle enfin.
Jacques Wisel attendait. « Quel secret fardé vais-je entendre ? » Toutefois, cette jeune fille lui inspirait confiance et remuait en lui il ne savait quels romanesques désirs de dévouement. « Dans quelles difficultés doit-elle se débattre » ? pensa-t-il.
— D’abord, je dois vous raconter des choses qui ne sont pas de mon secret, reprit Ozilie.
— Marchons, si vous voulez…
— Oui, vers les Champs-Elysées. Je mettrai un voile à ces choses-là.
Sous une lampe à arc ils s’arrêtèrent. La même idée : l’un et l’autre, ils voulaient lire dans leurs yeux.
Jacques Wisel parut à Ozilie un peu plus grand que tout à l’heure et plus âgé qu’elle n’avait cru, si l’on s’en rapportait aux cheveux grisonnants de ses tempes. Un visage ferme, un regard doux avec le sourire, plutôt triste au repos.
« Que pense-t-il de moi ? » se demandait Ozilie. Wisel, s’il s’était interrogé, n’aurait pu répondre. Ou du moins une seule chose : la jeune fille l’attirait. Il remarquait encore : « Elle a des sourcils très fournis et des cils très longs. » Car, déjà, il avait tracé à son insu, en lui-même un portrait d’Ozilie qu’il lui fallait compléter.
— Donc, il y a un peu plus d’un an, je vivais, avant de venir à Paris, reprit la jeune fille, à la cour d’un Prince en exil, d’un Prince détrôné, si vous préfériez… Les partisans de ce Prince ne désespèrent pas encore de son retour au Trône. Moi, qu’est-ce que j’étais ? La fille d’un fonctionnaire du Palais-Royal. Or, Son Altesse, un jour, me remarqua. Je lui étais indulgente à cause de ses malheurs. Le Prince découvrit dans mon dévouement plus que de l’affection. Je ne sais si je me fais bien comprendre ?
— Continuez, Mademoiselle.
— Pouvais-je demeurer près de S. A. Evgueny dans ces conditions-là ? Je ne le crois pas. D’abord, je ne voulais pas de situation fausse. Et une seule alternative s’offrait. Ou bien le Prince m’épousait et renonçait par le fait à la couronne. Ou bien il ne renonçait pas à la couronne et il eût été peut-être très malheureux — moi aussi — par les difficultés que je lui aurais suscitées. La situation n’avait pas d’issue. J’allai consulter le chancelier qui me conseilla le parti le plus sage, celui de m’en aller. Vous me suivez, Monsieur ?…
— Je vous entends, Mademoiselle…
— Je partis. Un des oncles de Mlle Isabelle, chez qui je vis, il faut le dire ici, avait des propriétés en France, du côté du Dauphiné… Ou de la Savoie, peu importe. Evgueny le sait. Lorsqu’il apprit mon départ, il m’écrivit à mon nom, à l’adresse de cet oncle, quelques lettres dans lesquelles il me suppliait de rentrer auprès de lui, qu’il ne m’abandonnerait jamais, etc…
— Est-ce qu’il vous promettait la moitié de sa couronne au cas où les événements…? demanda Jacques Wisel.
— Le Prince est bien trop adroit pour commettre une imprudence de cette taille.
— Qu’avez-vous répondu aux lettres de Son Altesse ?
— Que je ne pouvais retourner auprès de lui et que je devais me marier prochainement.
— Ah ! vous allez vous marier…
— Mettons que cela pourrait être vrai, répondit Ozilie en souriant.
— Le Prince a dû être furieux, observa encore Jacques Wisel.
— Je ne lui ai pas donné à lui-même ces explications définitives, mais à une personne de son entourage dont j’étais sûre.
— Confiance mal placée…
— Non. J’étais sûre que cette personne répéterait au Prince ce que je lui avouais à elle. Aujourd’hui, on me prie de retourner les insignifiantes lettres que j’ai reçues d’Evgueny.
— Vous tenez à ces souvenirs ?
— Pas du tout ! s’écria Ozilie.
— Eh bien, alors !
— Cette correspondance, je veux bien la rendre au Prince. Mais.
— Il y a un empêchement ?…
— Sérieux. Cette correspondance n’est pas à Paris. Elle est en lieu sûr. Voilà ce que j’avais à vous dire. Daignez Monsieur, en informer Son Altesse mal renseignée si vous en avez le loisir ou l’occasion.
— Comptez sur moi, répondit Jacques Wisel.
— Peut-être vous verrai-je à la Cour de Neu… car je pense bien y retourner dans quelques jours.
— Je le souhaite également.
Ozilie tendit la main à Jacques Wisel. Se jugeaient-ils à cette minute, l’un et l’autre, de la même famille spontanée et loyale, sincère et sensible ? Se découvraient-ils alliés comme s’ils étaient unis par une amitié éprouvée ? Mais que de parages obscurs, encore. « Nous sommes de même race, toi et moi », affirmaient leurs yeux souriants, tandis que se prolongeaient les souhaits et les adieux.
— Bon voyage, répéta Wisel.
— Tenez-moi au courant, dit Ozilie. Et soyez indulgent pour mes lettres : je connais si mal la langue française…
— Mais à quel nom ! s’écria soudain Jacques Wisel étonné tout d’un coup de la marche rapide de leur soudaine entente.
— Ozilie de Wicheslaw… L’adresse, je l’ignore encore. Mais je vous la dirai… En attendant, bureau rue Danton, à Paris comme vous savez… Si c’est nécessaire, ajouta-t-elle en se retirant.
Ozilie revint chez elle, à pied dans la nuit. Elle suivit un moment les quais de la Seine. Au-dessus du fleuve, les nuages fuyaient, un orage s’annonçait.
Cette promenade favorisait les réflexions de la jeune fille. Une allégresse subite la poussait… Quel chemin parcouru depuis le soir où, sur la route de Chamarges, un brusque écart du vent lui avait enlevé les deux feuillets d’une lettre qu’elle relisait ! Lettre inutile à présent. A quoi bon désormais écrire à Gina de fausses confidences sur les fiancés qui se pressaient chez son oncle en quête d’une riche héritière ? Pourquoi même chercher des raisons à son évasion de la « Grande Marche », loin du Prince Evgueny ?
Pauvre Prince détrôné pour qui elle avait gardé une trouble pitié. Un temps, elle avait cru l’aimer. Mais elle sentait bien, aujourd’hui, que l’amour c’était autre chose.
« Dans cette lettre égarée, songeait Ozilie, je parlais de l’« Irréparable » à placer entre le Prince et moi. Qu’est-ce que j’entendais alors par l’« Irréparable », si ce n’était le fiancé de mon choix ? L’aurais-je entrevu, par hasard, puisque j’ose, pleine d’assurance et de confiance en moi, considérer sans crainte l’idée de mon retour en Suisse, à la Cour d’Evgueny, tout au moins pour quelques semaines ».
Ozilie ne cherchait pas pourquoi elle se découvrait ainsi joyeuse et pleine d’espérance. Ce Jacques Wisel qui existait maintenant pour elle, qui était-ce ? Aurait-elle occasion de le revoir ? Sans doute. Elle ne se demandait ni où, ni comment ; elle imaginait des possibilités de toutes sortes et ramenait d’un coup volontaire ses pensées aux préparatifs de départ pour la « Grande Marche ».
« Finissons-en avec cette histoire. Je demanderai une explication au Prince… Partons vite… »
Quand reviendrait-elle ? Le plus tôt possible. Mais d’abord liquider les affaires de la Grande Marche.
« Je prendrai le train demain matin… »
C’est ce qu’elle annonça tout de suite à Trophime qui, pour se distraire, avait entrepris de peindre en bleu foncé les volets de la chambre d’hôtel.
— Quelle odeur désagréable ? Qu’est-ce donc ?
— De l’huile, expliqua Trophime.
— Eh bien, demain, nous ne respirerons plus cette infection-là.
— Dommage. Je commençais à m’intéresser à cet appartement. Je le décorais. Alors, nous allons à Chamarges ?
— Non, en Suisse.
Trophime regarda la jeune fille.
— Et l’on dira de moi que je n’ai pas de suite dans les idées.
— Ne t’inquiète pas du qu’en-dira-t-on. Écris plutôt à la machine deux ou trois lettres que je vais te dicter.
— Elle est emballée dans une valise, la machine.
— Eh bien, il faut la déballer.
— Je ne sais plus dans quelle valise… Mais, dites-moi, en Suisse, vous ne redoutez pas le Prince Evgueny ?
— Pourquoi aurais-je peur du Prince ? J’ai prévu tout un plan. Dépêche-toi de retrouver ta machine.
Ozilie tout en se promenant commença de dicter :
— « Chère amie »,
« Non, efface. Ah ! tu prends des notes ?… Comme tu voudras. Alors ! « Chère fiancée chérie ». Tu es prête ?
— Il y a longtemps que c’est écrit.
— Je continue : « Je suis un peu triste… » Non : « très triste » parce que depuis quinze jours… » Non. Pas quinze jours. « Six jours seulement, je suis sans nouvelles de vous. Que devenez-vous ? Il faut m’écrire, sinon, je serai désespéré… désespéré… Rappelez-vous cette nuit du mois dernier où tu vins me surprendre. Rappelle-toi nos baisers… »
— C’est fou ! c’est insensé ! interrompit Trophime, tenant au-dessus de son papier un crayon scandalisé. Où allez-vous chercher des imaginations pareilles ? Si votre oncle lisait cela ?
— D’abord, ce n’est pas écrit pour mon oncle ! trancha Ozilie. Je ne sais plus où j’en étais ! Relis-moi ce que tu as écrit !
Trophime, mécontente, commença la lecture d’une voix uniforme.
— « Cher ami, chez fiancé chéri. Je suis un peu triste, très triste parce que depuis quinze jours, six jours seulement, je suis sans nouvelles de vous…
— Tu as raison ! C’est insensé ce que tu as écrit là. C’est « Chère petite fiancée chérie » au féminin qu’il faut et non « fiancé chéri ». Enfin, continue, je corrigerai.
— Mademoiselle en a encore beaucoup comme cela ?
— Trois, répondit Ozilie, trois lettres. Ce sera vite fait. Je sais ce qu’il faut dire. La deuxième a pour sujet : « Quand seras-tu mon épouse devant tous ; à quand notre mariage en grande cérémonie ? »
— C’est original, fit la femme de chambre, ironique. Et la troisième ?
— La troisième est relative à notre nuit de noces.
— Votre nuit… Je pense que Mademoiselle a lu tout cela dans des livres et qu’elle s’en souvient, remarqua Trophime d’un air pincé.
— Quand tu auras fini ces lettres, tu mettras en bas du feuillet le nom et l’adresse de l’expéditeur. Voyons, le nom ? Claude Bauvoise. Ou bien Robert… Je sais ! Tu mettras une signature illisible.
— Et l’adresse des enveloppes ?
— La mienne, poste restante, rue Danton.
— Alors, vous vous écrivez des lettres d’amour à vous-même maintenant ?
Trophime protestait beaucoup, mais elle finissait par céder. Un grave indice chez elle lorsqu’on lui demandait quelque chose : sa correction parfaite. Si elle répondait : « Oui », tout de suite, sans observation, on pouvait être assuré qu’elle ne ferait rien. Au contraire, quand elle discutait les ordres, c’était la preuve qu’elle se sentait d’humeur remuante. On avait alors l’impression que Trophime voulait comprendre toutes les consignes pour les mieux exécuter.
Les trois lettres qu’Ozilie attribuait ainsi à un correspondant anonyme, Trophime Trophimova les transcrivit. La jeune fille les prit pour les porter à la poste.
— Demain, avant de partir pour la Suisse, tu iras les retirer rue Danton.
— Et vous pourrez être fière de montrer la correspondance de votre fiancé, répondit Trophime. Cependant, il vous était facile, même pour laisser traîner ces lettres devant le Prince (ou devant Mlle Gina qui rapporte tout au Prince) et prouver ainsi que votre « Irréparable » était accompli, il vous était facile d’écrire des lettres sans y ajouter tant d’horreurs. D’abord, ce ne sont pas des lettres de fiancés, ça !
— Je me demande ce que tu peux bien en savoir ? dit Ozilie, déjà prête à sortir.
— Dame ! J’en ai assez souvent reçu.
O Dieu, moi qui pourrais enfermé dans une coquille de noix, me croire le roi d’un espace infini !… Si ce n’était que j’ai de mauvais rêves.
Shakespeare.
Lonlay-Labbaye commence son enquête.
A la tombée de la nuit, ce 18 octobre, pourquoi cette propriété close de murs, sa solitude et son silence, m’oblige-t-elle à un arrêt ?
Une porte fermée avec de hautes grilles. Mais à travers les grilles, on aperçoit une allée et, dans cette allée, un gros chien noir et blanc qui va, vient, s’arrête et reprend sa course monotone de bête prisonnière…
« Gardien-des-portes-sacrées ! »
Cette invocation lue sur la lettre d’Ozilie, que Pierre Caussanges découvrit par hasard, me revient à l’esprit devant ce chien qui tourne comme un loup de jardin zoologique dans sa cage ratissée. Et voici que ma mémoire complète la phrase écrite par Ozilie : « Rocamadour, gardien-des-portes-sacrées ».
Suis-je donc devant la maison du prince Evgueny ? J’appelle :
— Rocamadour !
Là-bas, sur sa piste de gravier, le chien s’arrête. Les oreilles tendues en pavillon, le nez pointant, les yeux interrogateurs, il flaire cet homme qui connaît son nom. Pour moi, pas de doute possible : je viens de découvrir Neu-Thorenberg sur la route dite pour les seuls initiés « de la Grande Marche ».
Je n’ai pas perdu mon temps.
Ce matin, en effet, dès mon arrivée à Genève, j’ai laissé à l’hôtel Jacques Wisel qui a tenu à me suivre et je me suis renseigné. La « Grande Marche » ? On ne connaît pas. Quelqu’un, par charité, m’a indiqué une voie au hasard, sur une route parallèle au lac. J’ai l’impression que je m’égare. Je reviens. Je me trompe à un croisement. Tout d’un coup, ces haies de fusains soutenues par des treillis de fils de fer, puis ces murs, cette porte grillée, la romantique désolation de cette propriété, ce chien qui s’ennuie et cette halte imposée par un ordre secret…
Maintenant, il ne s’agit plus que d’approcher le prince Evgueny. Une lettre d’audience ne me serait pas inutile. Mais comment la solliciter d’un homme qui se cache derrière ces murs ? Le mieux est d’aller de l’avant.
Jusqu’ici, pas de sentinelles apparentes. Sans doute, la nuit les fera surgir. Ce soir, cependant, je ne vois personne. Comment pénétrer dans ce parc qui semble clos de tous côtés. Les murs ? N’y pensons pas. S’il y a une brèche — et tout parc possède la sienne, paraît-il, on me l’a dit et je l’ai lu — ce ne peut être que le long de la haie, loin des grilles de la porte d’entrée. Tout d’abord, je ne trouve rien. Toutefois, voici sur cette crête que pousse le museau prudent d’un chat gris largement taché de noir. En grimpant à cet endroit — un mètre cinquante de hauteur pas plus — je pourrai distinguer la villa. Un rétablissement sur les poignets. Le chat a déjà disparu. Des arbres malheureusement cachent le paysage. Il faut descendre dans le parc pour apercevoir quelque chose. Et Rocamadour ! Sans doute, je ne suis pas dans le rayon de sa surveillance…
Une hésitation compréhensible tout d’un coup : Suis-je sûr que le Prince est ici ? Ne devrais-je pas me renseigner encore ? Mais pourquoi renvoyer à demain ? La meilleure manière de savoir n’est-ce pas de chercher soi-même ? Le domaine est là, à ma portée. Nul ne s’oppose à mon inspection. Une aussi belle occasion se présentera-t-elle de nouveau ?
Et puis des scrupules encore ? Ai-je le droit de… Tout d’un coup, la sirène d’une automobile sur la route. Pas d’autre ressource que de me glisser le long du mur dans la propriété, car je n’ai plus le temps matériel de redescendre dans le fossé et de gagner le chemin que je suivais.
C’est fait. Je suis à « Neu-Thorenberg ». Le bruit de mes pas, sur les sentiers, à cause des feuilles tombées, on l’entend à peine. Une allée, puis une autre plus loin. Puis d’autres encore. Des poteaux indicateurs placés à un carrefour sollicitent ma curiosité. Je ne puis pas rentrer à Genève sans les avoir au moins vus de près. Je déchiffre, écrits en français et en anglais : « Place du Sobranié ». Au-dessous : « Perspective du Prince Cyrille ». A gauche : « Boulevard du Sobranié ». Puis, à droite : « Avenue du Prince Evgueny ». Tout cela avec des flèches pour indiquer la direction. Aucun doute désormais : je suis chez « Son Altesse »… J’ai gagné.
Cependant, la villa du Prince n’est pas visible… Je devine devant moi une pièce d’eau, reconnaissable surtout aux vapeurs qui s’élèvent dans le soir…
Soudain, deux silhouettes dans la perspective du « Prince Cyrille »…
Mon premier mouvement, me cacher derrière cette baraque à outils, qui n’est peut-être pas, du reste, une baraque à outils, puisqu’elle porte ce titre sur son fronton : « Musée de l’armée ». Malheureusement, les deux silhouettes ont vu mon geste. Et leur immobilité étonnée va, sans doute, me coûter cher.
Soyons beau joueur. Je salue et je m’approche, le chapeau à la main. Une des silhouettes me reconnaît, j’en suis sûr. Elle est toute en blanc — c’est Mlle Ozilie — et durcit son visage de mécontentement…
— Je ne pensais pas avoir l’honneur, Mademoiselle…
— Retire-toi, Trophime, ordonne Mlle Ozilie à la jeune femme assez corpulente qui l’accompagne.
— Oh ! ça m’est égal, riposte la suivante, j’ai déjà tout compris !
— Que faites-vous là, Monsieur ?
— Mon métier, Mademoiselle.
— Lequel ?
— Celui que vous savez.
Elle insiste :
— Lequel ? Délégué, toujours ? Ce qu’il y a de certain c’est que vous ne teniez pas beaucoup à me rencontrer, si j’en juge par votre rapide retraite, suivie d’un changement de tactique.
— Je suis ici incognito. Je ne tenais pas à me faire remarquer.
— Ici, Monsieur, dites-moi donc « Votre Noblesse » je vous prie. L’incognito qui vous protège ne vous libère point de l’étiquette…
Mais elle pense à part et je le vois clairement : « Que fabrique dans ce jardin l’envoyé du Prince ? » Et moi je songe, sans me formaliser de son observation : « Comment me tirer de ce mauvais pas ? Enfin, je pouvais plus mal tomber. » Je constate aussi la tendance d’Ozilie à prononcer « ou » là où une Française dirait « u » et cette façon d’aspirer certaines lettres, l’h notamment.
Je répète que je suis dans ce parc pour le service secret.
— Comment ? s’étonne Mlle Ozilie.
— Oui, je suis ici, mais c’est comme si je n’y étais pas : je dois passer inaperçu.
— Vous réussissez ! Et pourquoi passer pour invisible ?
— Secret professionnel.
— Vous voulez rire ? Le prince sait où vous êtes ?
— Il le sait, bien sûr. Mais s’il me rencontrait, il ferait celui qui m’ignore. Et moi celui qui ne l’a jamais vu, que de loin…
J’imagine à mesure la première fable plausible. En parlant je regarde Ozilie. Elle aussi mériterait bien une enquête. Quelle est cette femme ? Que fait-elle ? Que désire-t-elle ? Tout ce qu’elle a raconté à Caussanges, je parie que c’est inexact. Et si je compte sur Caussanges pour apprendre quelque chose ! Mais j’ai assez réfléchi ; je puis me permettre une question :
— Il y a longtemps que vous êtes… que Votre Noblesse est arrivée ?
— Quatre jours bientôt.
C’est extraordinaire : elle me répond maintenant sans se fâcher.
— Votre Noblesse a vu Son Altesse ?
— Oui. A son jour d’audience.
Nous marchons un peu. Nous sommes arrivés — un poteau indicateur me l’apprend — dans l’avenue du grand duc Michel. Cette bâtisse, au fond, simple maison de campagne, n’est-ce pas le « palais de Neu-Thorenberg », qui appartenait au Prince bien avant son exil et où celui-ci s’est, à présent, réfugié ? Je me souviens que je ne dois jamais paraître surpris. Des gens passent, près de nous, un jardinier, deux domestiques. Ils nous saluent.
— Vous vous êtes décidée… Votre Noblesse s’est décidée à revenir à la Cour ?
— Oui, j’ai voulu reprendre ma place.
— Vous regrettiez la Cour ?
— Non. Mais je ne savais pas Son Altesse en danger. L’ayant appris, je suis rentrée.
Quelle étourderie à cette minute ! Je ne sais pas cacher mon étonnement et j’interroge sans y mettre de formes :
— Le prince est en danger ?
— Vous ne savez pas ? Des troubles ont surgi en Kabardie, poursuit Ozilie. Les indigènes se querellent pour le pouvoir. Il y en a qui ont peur du retour d’Evgueny. Des émissaires sont partis pour empêcher ce retour. On veut encercler le Prince ici, le retenir par tous les moyens, attenter à sa vie même. Ne me faites pas marcher, ajoute Ozilie méprisante.
— Je ne me permettrai pas, Votre Noblesse… Avez-vous rencontré quelqu’un de suspect ?
— Rien, Monsieur, avant de vous avoir découvert.
— Merci, je l’ai bien mérité.
Et j’ai le sang-froid — légèrement tardif — de laisser croire que je prends cette insolence pour une plaisanterie un peu vive.
Un petit silence toutefois. Quelque froideur. Mais la jeune personne est comme moi, pleine de curiosité.
— Quel temps fait-il à Paris ? demande-t-elle.
— Temps d’octobre : pluies, accalmies, vent et ces soirées si brusques, vous savez, où les femmes sont tout d’un coup si nombreuses sur les trottoirs des villes et semblent se hâter pour essayer des jambes faites pour la course…
— Il y a longtemps que vous avez quitté Paris ?
— Un peu après vous.
— Vous aimez Paris ?
— Comme tous les étrangers, je l’adore, Votre Noblesse, mais je ne le proclame pas sur tous les toits.
— Oui. On vous arrêterait. De quel pays êtes-vous donc ?
— De la Suisse, parbleu.
— Es ist nicht möglich, dit-elle.
— Pourquoi n’est-ce pas possible ?
— Parce que vous n’avez pas l’air d’un Suisse, mais d’un Français. Parlez-moi de Paris.
Et nous revenons sur Paris. Au fond, Ozilie n’est pas contrariée ni surprise de me voir à Neu-Thorenberg. Ma présence, même, lui paraît tout à fait normale.
— Vous aimeriez mieux trotter dans Paris, me dit-elle.
— Vous aussi, Votre Noblesse, car enfin, que faites-vous ici ?
— Si on vous le demande, vous direz…
— C’est une façon de m’exprimer, Votre Noblesse. Je ne demande rien, je ne sais rien en dehors de ce que l’on me dit.
— Vous devez savoir peu de choses, en effet… Parce que vous ne possédez pas d’aimant pour attirer les confidences…
Je songe de mon côté : « Ce sont les démarches de Jacques Wisel et les miennes qui ont obligé cette dame à revenir à la cour d’Evgueny. Si je l’avais surveillée lorsqu’elle a quitté les Tuileries, elle m’aurait indiqué le chemin que j’ai péniblement cherché à tâtons. Mais maintenant, il faudra bien qu’elle me fasse connaître ce qu’elle sait. »
Derrière nous, des voix, un râclement de souliers. Je commence tout de suite mon enquête :
— Qui est-ce ?
— C’est Esteban.
— Ah ! oui, Esteban.
« Sa Noblesse » me refait :
— « Ah ! oui, Esteban. » Vous ne connaissez pas Esteban, celui qui…
— Oui, parfaitement… Et où va-t-il, Esteban ?
— Il va faire sa prison. C’est l’heure.
— Ah ?
— Vous avez prononcé un « ah » qui, cette fois, me prouve que vous ne savez rien.
Ozilie n’a pas tort. J’ai su depuis, mais j’aurais quand même mieux fait de le savoir à ce moment-là, qu’Esteban puni de « cinq jours de solitude » (cinq jours d’arrêt) travaillait à Genève l’après-midi, comme interprète dans un grand hôtel et venait chaque soir, se placer volontairement en cellule, à Neu-Thorenberg : « le capitaine de lanciers Esteban ayant été réprimandé par S. A. Evgueny, pour manquement au service. »
— Je vois, reprend Ozilie impitoyable. Je vois. Vous êtes vraiment de la secrète police du Prince. J’en suis désormais assurée.
— Pourquoi ?
— Parce que vous êtes mal renseigné…
Elle se met à rire. Puis, méfiante, elle corrige :
— Ou bien parce que vous jouez à l’imbécile pour rester discret. Vous m’interrogez et vous ne parlez pas. Que faites-vous donc en réalité ?
— Pour vous prouver que je n’ai pas peur de vos indiscrétions et que j’ai confiance en vous, je vais vous avouer que je suis ici en surveillance.
— Je m’en serais doutée, répond-elle.
— Pour le compte du Prince. Vous voyez : je ne dissimule rien.
— … Rien de ce que l’on devine. C’est en effet la deuxième fois que vous me dites les mêmes choses sur deux tons différents.
A part moi, je remarque sans y insister davantage, qu’Ozilie parle souvent, très souvent, un français naturellement correct. Puis, brusquement, elle accumule des fautes grossières. Je reprends.
— Je fais une enquête incognito, c’est-à-dire que je ne connais personne, personne ne me connaît, personne ne peut se permettre de me reconnaître.
— Alors, mettons que moi non plus je ne vous ai pas reconnu tout à l’heure. Parlons d’autre chose.
— Si vous voulez… Parlons des villas qui sont échelonnées sur la route de Chamarges.
— Ah !
Son regard à cette minute et la colère qui monte dans toute sa personne !
— Pourquoi ? reprend Ozilie avec brusquerie, pourquoi ferais-je le silence sur Chamarges ? Vous êtes maintenant un excellent appareil pour porter au Prince ce que je veux qu’il sache.
— Merci.
— Ne me remerciez pas encore. Écoutez. J’ai quitté Chamarges pour remettre moi-même au Prince les lettres qu’il désirait. Et du même coup, mesurer ma force.
— Je ne comprends pas.
— Je vais vous renseigner. J’ai cru, un moment, que j’aimais le Prince. Mais oui, Monsieur ! Et on vous l’a dit sûrement. Comme je ne voulais pas être plus tard une gêne pour lui, je suis partie…
— Pour Chamarges.
— Exact. Ayant quitté la Cour et le Prince, je me suis aperçue que je n’éprouvais pour ce dernier que de la sympathie. Pas de trouble. Pas de gêne. Au contraire, un sentiment de sécurité et de calme… Donc, je m’étais trompée.
— Sans doute… dis-je, et je pense : « C’est peut-être vrai, après tout, ce qu’elle me raconte là… »
— Vous qui savez tout, poursuit Ozilie, ne découvrez-vous pas dans ces signes apaisants les premiers symptômes de l’agonie du troublant amour ?
— Vous ne gardez rien au cœur ? Aucune contrainte ?
— Absolument pas de fièvre.
J’ai l’air de prendre au sérieux cette consultation :
— Alors, c’est excellent. Lorsque l’on a un bon estomac on n’y pense ni quand on mange, ni quand on a fini de manger. Et vous êtes revenue à la Cour ?
— Le Prince m’ayant fait l’honneur de me réclamer, comme vous savez, des lettres, « ses lettres », je suis revenue à la Grande Marche. Et comme j’ai su que le Prince était en danger, je suis restée pour montrer que je ne l’abandonnais pas.
— Auprès du Prince, vous n’avez éprouvé aucun embarras.
— Rien, répond Ozilie, en riant cette fois.
— Excellent encore. Mais pourquoi me dites-vous tout cela ?
— Pour que vous le répétiez à Son Altesse.
— Impossible, Votre Noblesse.
— Pourquoi impossible ?
— Je ne raconte au Prince que ce qui est exact et que j’ai contrôlé moi-même.
Je crois une seconde que « Sa Noblesse » Ozilie va se fâcher. Mais elle se contient, hausse les épaules :
— Vous devez être souvent silencieux !
« Allons, ajoute-t-elle, avouez que vous êtes là pour protéger le Prince. Ne faites pas l’innocent. Je sais.
— Oh ! si vous savez, que voulez-vous que je vous apprenne ?
— Depuis que les émeutes ont éclaté en Kabardie, on ne laisse plus le Prince seul et personne ne peut pénétrer au Palais.
— Ce n’est pas difficile de deviner tout cela.
— Possible, Monsieur. Encore faut-il savoir que depuis cinq heures du soir, les sentinelles sont doublées et les rondes permanentes. Personne ne passe plus !
Je pense presque tout haut :
— Heureusement que je suis entré…
— Oh ! pour vous, tous les passages sont ouverts.
— Sauf la grande grille qui est bien fermée.
— Qui peut le savoir mieux que vous, Monsieur ?
— Qui ? Votre Noblesse. Mais « Rocamadour-gardien-des-portes-sacrées ! »
Ozilie se tourne vivement vers moi, d’un subit mouvement où il y a de la surprise et de la crainte.
— Enfin, dit-elle en se maîtrisant une fois de plus, on garde le Prince parce qu’on a peur pour lui…
— Oh ! on a peur ! De quoi donc ?
— Des ennemis du Prince et de ses amis. Ces derniers veulent l’enlever pour le proclamer roi ; les autres pour le faire disparaître.
— Cependant des dépêches anglaises annoncent que Son Altesse combat en Kabardie…
— Si vous croyez les informations de source anglaise ! Mais cela vous étonne, Monsieur l’émissaire, que je sache tout cela ?
— Que vous le sachiez, non. Que vous le disiez, oui.
Je la regarde bien en face. Grande, aussi grande que moi presque, qui suis d’une bonne taille, souple, elle tient fixés sur les miens ses yeux durs et noirs. Elle est plus forte d’ailleurs qu’on ne le croit.
— Hélas ! Je ne vous apprends rien, Monsieur, et c’est parce que ces faits sont connus que le péril grandit autour de Son Altesse…
Un autre poteau indicateur : « avenue Stanislas ». Et cet autre plus loin. Et cette pièce d’eau qu’entourent d’autres chemins.
— Nous voici devant la mer intérieure, observe Ozilie. Puis elle se signe deux fois en passant près d’un vieillard qui sommeille dans l’ombre :
— La bénédiction de Dieu soit sur vous ! dit ce prêtre.
Je m’incline aussi. Mais un jeune officier arrive sur nous. On le prendrait pour un colonel de hussards polonais.
— Allons, bon, Son Altesse ! s’écrie Ozilie.
— Ah ! c’est Son Altesse !
— Oui, dans l’uniforme qui lui plaît. Le reconnaissez-vous, ô fin limier chargé de veiller sur lui ?
— La nuit approche et ma vue baisse, Votre Noblesse.
— Vous êtes complet.
— J’aime mieux vous laisser seule.
— A votre aise…
Même soir. Il peut être sept heures et demie, huit heures ? Ma montre s’est arrêtée quand j’ai sauté par dessus le petit mur.
Évidemment, j’ai bien fait de m’en aller. Sans doute, le Prince Evgueny m’a aperçu lorsque je parlais à Ozilie. S’il interroge la jeune fille, qu’en résultera-t-il ? On va peut-être me donner la chasse…
Ce qui me rassure un peu, c’est qu’Ozilie est persuadée que je lui ai joué la comédie quand je lui ai demandé le nom de ce bel hussard de Pologne. Je m’arrête derrière une bordure de buis et me retourne. En réalité, ce Prince paraît frêle, mince et triste. Il se dirige vers une sorte de hangar qu’Ozilie ne perdait pas de vue tout à l’heure.
En passant près de « Sa Noblesse », c’est à peine si Son Altesse daigne la saluer. Cependant Ozilie commence une longue révérence, puis elle attend. Le Prince s’arrête. Je me hâte de gagner le petit hangar, sorte de salle de débarras. Je voudrais voir le Prince de près. Ce n’est pas maintenant que je dois m’interroger : ai-je le droit d’attendre ? ai-je le droit d’examiner ce qui ne me concerne pas ? Ces questions-là, nous en reparlerons plus tard, si c’est nécessaire. J’arrive derrière cette baraque en même temps que le Prince et Ozilie. Mais nous ne sommes pas du même côté.
La première pièce de ce hangar où l’on a accumulé des meubles hors d’usage semble bâtie pour me servir de refuge. J’ai su depuis que c’était la salle de tir réservée au Prince. Ce soir, il y fait complètement nuit. Mais une lumière me parvient par une lucarne, du fond de cette chambre. Je me dirige à tâtons de ce côté. Je m’approche de l’ouverture. J’entends, je crois reconnaître la voix d’Ozilie et une autre, celle du Prince, hésitante, avec des notes trop basses ou trop élevées, toujours d’une tonalité changeante.
Si j’entends assez mal, je distingue mieux — grâce à cette lucarne — je remarque dans la pièce voisine qui est éclairée d’abord le trouble du Prince. Il se tient devant Ozilie dans une attitude rigide, lointaine, tandis que la jeune fille, tout à fait à l’aise, témoigne d’une parfaite assurance. Et je perçois :
— Ainsi, c’est vrai, vous êtes revenue pour cela seulement ?
C’est Son Altesse qui parle un français un peu lent, mais pas désagréable. J’entends encore :
— Je ne vous ai rien demandé. Ce n’est pas moi. C’est le premier ministre, sans doute, qui a dû prendre sur lui de vous envoyer des émissaires en mon nom. Quels émissaires ?
Ici la voix d’Ozilie :
— Je ne les connais pas, mais Votre Altesse doit les connaître.
— Je n’ai rien envoyé, répond le Prince.
Il paraît ennuyé, un peu las, d’une froideur de commande.
— Je regrette beaucoup ces excès de zèle, reprend-il. Gardez vos lettres, détruisez-les comme il vous plaira, j’ai confiance en vous.
Le Prince qui s’était probablement assis s’est levé. Il marche. L’audience est finie.
Un valet — invisible pour moi — a ouvert la porte. Ozilie se retire, à reculons, après trois révérences.
— Prince, vous êtes digne de régner.
C’est elle qui s’exprime ainsi. Le ton un peu trop grandiloquent de ces derniers mots a quelque chose de théâtral. Mais le moyen d’exprimer simplement de semblables souhaits ! Un courtisan, seul, possède cet art. D’autre part — je le sais — Ozilie ne croit pas en la fermeté, ni peut-être en la générosité d’Evgueny.
Ozilie partie, la morgue déplaisante du Prince disparaît. Je le constate avec surprise. Evgueny court à la fenêtre. Il doit regarder Ozilie qui s’éloigne. Il secoue la tête. Il paraît très abattu. Que se passe-t-il ? Est-il vraiment amoureux de cette jeune fille ou joue-t-il, pour lui-même la tristesse d’un amant incompris ?
Ma situation toutefois me semble assez périlleuse. Si je pouvais m’en aller ! C’est le moment, puisque le Prince examine des armes, choisit un revolver. Mais voici qu’il allume d’autres lampes électriques. Pourquoi ?
Quelqu’un vient d’arriver. Je ne vois personne en dehors d’Evgueny et cependant on parle dans cette pièce. J’écoute. C’est la voix d’Evgueny.
— Quand le Premier sera là, il aura affaire à moi.
Voici que le Prince s’assied devant sa table et se met à écrire une lettre qu’il se dicte à mesure :
— « Pourquoi, monsieur, ces mesures extraordinaires ? Et ces démarches pour capter des lettres qui ne me gênent point ? Vous n’y trouverez rien de confidentiel. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien… Non… de ne pas continuer à traquer cette jeune fille et de retirer vos espions de son passage !… »
Que va répondre le premier ministre ? Et Ozilie quand elle saura que ce n’est ni le Premier ministre ni le Prince, ni un autre de la Cour qui l’a suivie et lui a demandé les lettres du Prince ? A ce moment-là, je ferai bien de ne pas planter ma toile de tente à Neu-Thorenberg. Mais peut-être ne suis-je qu’au début de mes étonnements.
J’attends aussi, car je ne sais comment partir. Le Prince est seul. Et il se croit seul aussi puisqu’il ignore ma présence. Il va de long en large. Il dit bonjour à des gens invisibles. On dirait qu’il s’habitue à saluer militairement des personnages qui le saluent. Il prononce quelques mots à voix basse…
Maintenant le Prince entame une petite chanson, donne un ordre à un homme que je suppose imaginaire, en congédie un autre, tout cela avec cet air hautain qu’il affectait tout à l’heure avec Ozilie.
Puis, il se laisse choir dans un fauteuil. Il arrange son pantalon, se gratte la jambe avec application, se lève, sautille sur un pied, se regarde devant une glace, essaie plusieurs attitudes de fermeté, boxe dans le vide, enfin il s’occupe à corriger le pli tombant de ses lèvres, lourd héritage des Georgevitch et des Romanoff panachés. Tout d’un coup, il déclare, très haut :
— Il faut que je sois fort, très fort, le plus fort. Il faut que je fasse ce que je veux.
En parlant, il serre les poings et continue de se regarder, en tournant devant la glace.
— Est-ce moi qui tremble en face de celui que j’ai nommé moi-même ?
Brusquement il fait volte-face comme si l’on venait de l’interrompre et, d’un ton de commandement :
— Monsieur, vous aurez quinze jours d’arrêt ! Retirez-vous !
Satisfait sans doute de l’intonation de sa phrase, il recommence :
— Vous serez puni. Disparaissez !
Puis il prononce une allocution en étudiant avec complaisance ces gestes reproduits dans le haut miroir. Comme il se sent libre, sûr de lui-même ! Quelle aisance dans ses mouvements ! Quelle assurance dans l’accent égal de sa voix. Comme tout doit lui sembler facile, coulant, simple. Et à chaque ordre qu’il distribue sans effort, comme tout ponctuellement s’arrange.
Le Prince joue positivement, ainsi que font les enfants à « comme s’ils étaient plusieurs ». J’entends en effet, les demandes qu’il formule à des réponses favorables sans doute, mais que nul, hors lui-même, ne perçoit.
D’abord je me sens gêné et inquiet. Puis une impression de douloureux cauchemar, la désagréable impression d’être le seul témoin d’une étrange aberration. Et le complice en quelque sorte de cette exposition inquiétante et comique, angoissante aussi : les extravagances que peut inventer dans la solitude un homme seul qui se croit seul.
Jusqu’au moment où la lumière se fait en mon esprit et où je comprends soudain le secret du Prince Evgueny…
Tragique vie intérieure du timide, lutte sans repos contre un ennemi vigilant et sournois qui a élu domicile dans son propre appareil humain. La nuit même, cet hôte, adversaire infatigable, rôde et procure à son esclave des songes où il n’a pas le meilleur rôle. Éveillé, le malheureux reprend confiance : « Tu es grand, tu es fort, tu es intelligent, se répète-t-il. Tu fais ce que tu veux. Rien ne te résiste et tu es supérieur à ces gens ! »
Avec ce viatique peut-être parviendra-t-il à se vaincre lui-même.
Mais il y a autant de timides que de timidités.
Il faut compter aussi avec les alternatives de triomphes et de défaites, de capitulations, de violences agressives qui déconcertent, avec les fausses soumissions et les colères dissimulées sous un sourire. Mais que d’ennemis qui, sans même le savoir, l’ont blessé. Il les range par ordre… Ils sont voués à une vengeance lente et silencieuse.
Quelquefois, la revanche surgit. Un jour vient en effet, son jour. Il doit agir, il doit commander. Stupeur ! Il agit, il décide, il exécute.
— Le danger est grand, lui annonce-t-on.
Il le sait, car il l’a depuis longtemps imaginé sous tous ses visages. Et il y va. Il vit dans un élément nouveau où il respire. Il sait qu’il peut s’attaquer désormais à ses adversaires… Mais cette minute de victoire va-t-elle bientôt sonner pour le Prince Evgueny ? Il l’ignore. Il s’y prépare.
Ce soir encore.
Rien ne bouge dans la pièce voisine. Le Prince s’est peut-être endormi. Le moment est bien choisi pour me retirer. Mais une porte que l’on ouvre. La curiosité, une fois encore, est la plus forte. Je reste… Le temps de me rendre compte.
Un officier vient annoncer quelque chose que je ne parviens pas à saisir. Le Prince de répondre d’une voix sans réplique :
— Non, personne. Je ne veux voir personne.
Le premier ministre, avant que l’officier soit sorti, est entré quand même. Je ne connais pas le « Premier ». Je le reconnais cependant tout de suite. Il n’y a pas à se tromper : c’est ce gros homme patient et têtu qui domine Son Altesse…
Le Prince n’a pas remué. Cependant le « Premier » a salué et tout de suite, il commence d’une voix insidieuse et ferme, pas du tout agréable car elle tâche à voiler un bizarre accent opiniâtre et décidé :
— Votre Altesse est toujours imprudente. Se retirer ici, dans ce hangar, est bien périlleux !
Joie ! Le « Premier » s’exprime en français. Pourquoi ? Sans doute parce qu’il est plus difficile à un espion de Kabardie d’entendre cette langue ou encore parce que le Prince et le « Premier » peuvent parler très vite, ainsi, dans un idiome qu’ils connaissent parfaitement.
— Des espions sont signalés dans le parc. Mais l’on veille sur Votre Altesse. Des gens sûrs…
Silence persistant du Prince. Je remarque qu’il ne parle même pas de l’ordre qu’il écrivit quelques instants plus tôt à l’usage du « Premier ».
— Rien à craindre, par conséquent, poursuit le ministre.
— C’est donc pour cela, ironise Evgueny, que je rencontre autour de moi tant de visages peu rassurants !
— Que Votre Altesse me le dise ou m’en donne l’ordre écrit. Je ferai partir tous les gens à visages déplaisants mais je ne réponds plus de rien.
— Je n’ai pas dit « déplaisants ». J’ai dit « peu rassurants » reprend le Prince. Il y a une nuance…
Le premier ministre sourit. Il sait par expérience que la grande offensive du Prince n’ira pas plus loin. Le reste viendra peut-être, mais plus tard.
— J’étais venu, déclare-t-il, pour mettre Votre Altesse au courant des événements de Kabardie. Votre Altesse connaît-elle les dernières nouvelles ?
Evgueny fait signe que non.
— Je vais donc résumer. En Kabardie, la révolution continue. Le Prince veut-il reprendre le pouvoir ? Déjà des télégrammes annoncent qu’il est là-bas, qu’il encourage ses partisans. Et cela donne confiance à ses amis. Mais bientôt on saura qu’il est en Suisse, à l’abri. Et alors ?…
Le Prince ne répond pas.
— Voici, poursuit le Premier, une proclamation que je vais faire tenir à la presse et que vous adressez à vos sujets. Voulez-vous la lire ?
— Non, merci.
— Bien. Votre Altesse n’a qu’à signer…
— …
— En bas de page. On fera clicher la signature.
— Laissez-moi cette pièce ; je vais la signer et la lire.
— Maintenant, voici des décrets. Votre premier ministère est constitué. Votre maison, avec la confirmation des grades et des emplois. Car il faut penser à récompenser non seulement ceux qui vous ont servi en exil — ce qui est très honorable — mais aussi ceux qui sont restés là-bas et risquent encore leur vie.
— Laissez. Je signerai.
— Votre Altesse ne dîne pas, ce soir ?
— Merci, Monsieur, j’ai dîné.
— J’emporte tous ces papiers, reprend le premier ministre.
— Ils ne sont pas signés, fait observer le Prince.
— C’est juste.
Ces derniers mots d’un air indifférent. Le Premier a l’air de considérer cette signature qu’il demande comme une formalité dont il peut aisément se passer.
Le premier ministre va sortir, puis comme s’il les apercevait seulement, il désigne les armes du Prince sur la table.
— Bonne précaution.
— Non. Je vais m’exercer dans le stand, à côté, au tir à la cible.
— Votre Altesse n’y verra rien.
— J’allumerai.
— Les lampes attireront les mauvais papillons de nuit.
— Il y a tant de gardiens dans le parc !
— Et le bruit des balles.
— Ah ! c’est vrai, réplique le Prince ironique. Le bruit des balles ! Je n’y pensais pas : ils sont capables de fuir.
Sitôt que le ministre est parti, le Prince saisit les décrets et la proclamation, les jette dans la cheminée et y met le feu. Tandis qu’une flamme s’élève, Evgueny — quel mélancolique et dur visage à la clarté de ce foyer ! — se frotte les mains.
— Ah, murmure-t-il, « il » croit faire de moi ce qu’il veut ! « Il » se trompe lourdement. C’est moi qui fais ce que je veux. Des proclamations pour ces gens qui ne savent ce qu’ils veulent ! C’est bien inutile…
« Et puis, je « lui » dirai que je les ai égarés, ces papiers, ou qu’on me les a volés, s’« il » insiste… »
Et le Prince éclate de rire. Il y a chez lui, en effet, tout un côté de farces à froid, de mystifications secrètes qui doit souvent décontenancer ceux qui l’approchent. Mais se peut-il que cet Evgueny soit tout simplement un jeune homme faible, vaniteux et cruel ?
— Maintenant, allons tirer dans le stand, reprend Son Altesse. Si quelques espions du ministre passent à ma portée, ils me serviront de cible. Un accident est si vite arrivé !
Cette dernière réflexion ne présage rien d’agréable. Aussi j’estime qu’il est sage de ne pas rester dans le poste d’écoute que je me suis choisi et qui est précisément le stand de tir du Prince.
Au dehors, nuit opaque. Quelle heure peut-il être ? Neuf heures ? Dix heures ? Je vais au hasard, dans un terrain inconnu lorsque j’entends des piétinements derrière moi. Serais-je suivi ? Je marche encore, puis je m’arrête… Si j’allais me réfugier à présent chez mon excellente ennemie Ozilie. Sa demeure est dans cette région. Par Ozilie, sans doute, je trouverai la sortie de ce parc… C’est une expérience à tenter. Et puis, je n’ai pas le choix.
A une ronde qui marche prudemment — celle que j’entendais derrière moi — je demande ma route.
— Suivez l’avenue du grand duc Michel, tout droit. Puis, sur votre gauche, dans la Wilhelmstrasse. Le pavillon des dames est là.
« Bien, les femmes dans ce pays sont isolées. »
J’avance. Comment découvrir l’avenue du grand duc dans cette obscurité ? Une baraque de bois dans un fouillis de broussailles. Est-ce là ? Sur le seuil de la porte une femme éclairée par une lumière verte.
Elle fume. Je me renseigne. On me répond d’un accent bref et las.
— Mademoiselle Ozilie ? Elle est couchée.
— Je voudrais bien lui parler.
— C’est pressé, interroge posément la dame toujours assise.
— Non, c’est grave.
— Alors, je vous écoute… Ozilie, c’est moi.
Je regarde cette forte femme enveloppée dans un large manteau. Ses cheveux cachent son visage. Mais je ne reconnais point Ozilie…
— J’écoute, reprend-elle. Vous êtes atteint d’une crise de timidité ?
— Comment ? C’est vous Ozilie ?
— Oui, à partir de huit heures du soir, c’est moi. Vous pensez bien que je ne vais pas déranger la vraie pour vous faire plaisir.
— Ne plaisantons pas. Voulez-vous avertir Mademoiselle, je vous prie…
La dame qui fume s’en va en haussant les épaules. Elle a soin de refermer la porte dernière elle. Nuit cette fois-ci de nouveau. J’attends. Si seulement je connaissais le sentier qui mène à la sortie ! Silence. Des cris d’oiseaux. Un froissement de feuilles. Un chat qui fuit… Peut-être un chien. Mon petit browning de poche est au cran d’arrêt. Mais que fait-on dans cette maison ? Enfin, la porte s’ouvre.
— Bonsoir Mademoiselle.
— Ce n’est pas Mademoiselle. De la part de qui voulez-vous voir Mademoiselle ?
Bon ! c’est encore la dame à la cigarette.
— De la part du délégué du Prince qu’elle a rencontré à Paris.
— Ah ! bien, c’était vous ! Pourquoi ne le disiez-vous pas !
— Vous ne m’avez rien demandé.
— Vous parlez tout le temps ! Ah ! c’est vous le délégué ? Alors, je puis vous annoncer tout de suite que Mademoiselle n’est pas là.
— Comment ? Elle n’est pas là ?
— Elle n’est pas là, à cette heure-ci, pour vous recevoir.
— Écoutez, c’est très sérieux. Faites vite.
— Bon. Venez. Mais je ne veux pas être responsable. Vous m’avez bousculée, violentée et vous êtes entré malgré moi…
J’ai su depuis — cette chose-là et quelques autres — que je m’étais adressé à Trophime, la camerière-secrétaire de Mlle Ozilie, celle-là même qui, quelques heures plus tôt, accompagnait Ozilie dans le parc.
— Venez. On n’attend que vous !
— Que vous arrive-t-il, mon délégué ? demande une voix que je reconnais et qui s’échappe de coussins jetés dans cette pièce où l’on vient de me pousser.
Je m’excuse :
— Je suis tellement incognito qu’ils ne me reconnaissent plus.
— Ça ne m’étonne pas !
— Ils sont sur mes talons et ils me donnent la chasse.
— Mon pauvre délégué ! Et vous avez pensé à moi ?
— Naturellement.
— Je suis toute secouée de vos amabilités polies.
— Secouée ? Pourquoi ?
— Oui, je suis marquée, touchée si vous préférez… Et pourquoi ne pas vous cacher chez le Prince ?
— Ce serait compromettre ceux qui m’emploient.
— Par contre, vous n’hésitez pas à me compromettre, moi !
— Oh ! vous, ce n’est pas possible.
— On peut tourner et retourner votre réponse. Est-ce une louange, une impertinence ?
— Ne choisissez pas. C’est un hommage à la vérité.
— Conservez vos louanges pour des jours meilleurs, interrompt Ozilie… Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi je suis tenue de donner asile à un homme poursuivi, alors que cet homme, à Paris, me réclamait sans ménagement des lettres que son Prince n’exigeait même pas, ou s’il les demandait, c’était avec politesse et sans promptitude.
C’est la première allusion directe d’Ozilie à notre rencontre, à l’objet de notre rencontre à Paris. Enfin ! L’essentiel, c’est que je me sente à l’abri. Et nul n’ira imaginer que je me suis retiré dans le quartier des femmes. Il faudrait cependant y demeurer un peu, car le temps presse et la nuit n’est pas finie. Je reprends :
— Ce n’est pas un refus ?
— Ce ne peut être qu’un refus, riposte Ozilie, toujours blottie dans ses coussins, pauvrement mise en valeur par une lumière atténuée de voiles verts…
— Comme c’est dommage.
Et je commence à réciter de mémoire un petit morceau choisi que j’ai retenu à force de l’avoir étudié pour en découvrir le sens caché, morceau dont elle doit bien se souvenir. Nous ne sommes pas nombreux à l’avoir lu ce texte, mais je m’aperçois tout de suite qu’il intéresse beaucoup Ozilie :
— « Je ne regrette pas cet homme inconsistant dont on ne pourra rien faire. Un Prince, peut-être, mais pas un Roi ».
J’élève un peu la voix pour rappeler ce passage :
— « Un jour, dans la grande allée du jardin, il eut l’inconscience de me répéter qu’il m’aimait. Moi aussi, à ce moment-là, je croyais l’aimer un peu. Nous étions des enfants l’un et l’autre… »
Je parle légèrement plus fort pour dire cette autre citation :
— « Il me semble qu’il est resté cet enfant frivole sur lequel… »
— Vous savez, je ne suis pas sourde ! interrompt Ozilie d’une voix qu’elle voudrait calme.
— … « Sur lequel nul poids de couronne ne doit peser. Quant à moi… »
— Taisez-vous donc !
— Je ne demande qu’à me taire.
— On ne le dirait pas.
— Pourquoi Votre Noblesse n’enferme-t-elle pas un homme qui a tant de mémoire ?
Elle me regarde sans faire un mouvement.
— Où voulez-vous que j’enferme cet appareil à récitation ?
— Chez vous, pour quelques instants.
— Comment connaissez-vous ces textes — dont je me moque d’ailleurs ? C’est donc vous qui avez recueilli la lettre perdue ?
— Quelle lettre perdue ?
Aussitôt elle se tait. Je n’insiste pas. Je reste sagement sur mon silence.
— Mais, s’écrie Ozilie, où vous placer ? Avez-vous dîné ? Non ? Allez donc dîner avec Trophime Trophimova.
— Trophime ?
— C’est ma femme de chambre.
Je me rends bien compte qu’elle se venge un peu en m’envoyant à la table de Trophime. Je le crois du moins. Elle me le laisse supposer un moment, puis :
— Moi, j’ai fini. Le soir, je mange peu. Mais Trophime ne commence jamais et avec elle, ça dure tout le temps.
Ozilie s’est levée. On ne voit que son visage dans un grand manteau de fourrure, visage tendu et décidé. Elle reprend :
— Comment avez-vous eu connaissance des textes que vous récitiez ?
— Je ne puis vous répondre.
— Remarquez, dit-elle doucement, que le premier mouvement de surprise passé, cela m’est indifférent. Cette lettre eut son utilité un moment. Elle ne l’a plus aujourd’hui.
— Oui, depuis que vous avez revu le Prince, que vous vous êtes réconciliée avec lui et que vous ne le redoutez plus, sur aucun terrain.
— Expliquez-vous !
— Ne m’interrompez pas… Cette lettre que vous avez perdue était destinée à Mlle Gina, n’est-ce pas ? Le Prince devait la lire un jour ou l’autre. En ce temps-là, vous ne désiriez qu’une chose : que le Prince n’ignorât point ce que vous pensiez de lui. A présent, comme je l’ai dit, il y a entre vous et lui non un traité, mais d’autres bases à un arrangement. Vous le supposez, tout au moins. Certes, cette lettre — l’expression est de vous — « vous est indifférente ». Ne croyez-vous pas que les opinions que vous portiez sur Evgueny intéresseraient quand même le Prince, aujourd’hui ?
— Vous en avez un double de cette lettre ? continue Ozilie, sans se fâcher.
— Le cabinet noir de la poste et la photographie sont deux grandes inventions.
— Un mot encore : le Prince a-t-il eu connaissance de cette… lettre ?
— Jamais, Votre Noblesse.
— Pourquoi ?
— Parce que je suis le seul qui ai vu ces textes écrits à l’encre sympathique — je suis précis — et que je les garde pour moi.
Ozilie reste silencieuse un moment. Elle va jusqu’à la fenêtre, arrange les rideaux, revient vers moi :
— La raison de votre discrétion ?
Quelle raison donner ? Cette conversation qui dure n’est qu’embûches et périls.
— Je n’entreprendrai jamais rien contre vous.
— Pourquoi ? insiste-t-elle.
— C’est mon secret.
— Même si je vous priais de vouloir bien tout de suite vous éloigner de cette baraque de planches où je suis, pour l’instant, domiciliée ?
— Je ne reprends pas ce que j’ai dit.
En parlant, je me dirige vers la porte, comme si je voulais sortir et devancer son ordre.
— C’est bien, Monsieur. Non, pas par là. Vous n’avez pas dîné et Trophime vous attend.
— Trophime, je t’envoie un invité.
C’est Ozilie qui me conduit elle-même dans la pièce trop parfumée où réside la camérière.
— Vous n’avez pas dîné ? s’étonne quelque chose accroupi à l’orientale au fond de la chambre.
— Pas encore, Madame.
— Vous pouvez m’appeler Mademoiselle, ça ne me dérange pas. Eh bien, il est temps de manger ! Tournez le deuxième bouton électrique, vous y verrez mieux.
— Quelle heure est-il donc ?
— Vous ne savez pas l’heure ? demande Trophime.
— Ma montre s’est arrêtée.
— Et vous vous dites policier ! Vous ne connaissez même pas l’heure !
— Mais je vais la connaître.
— Comment ? je vous prie.
— Grâce à vous.
— Encore une erreur, cher Monsieur. Si vous étiez mieux renseigné, vous sauriez que Mademoiselle me reproche toujours d’ignorer l’heure et le jour. Je dis : « il fait soleil, il fait gris, il fait pluie » ou bien « il fait soir, il fait nocturne » et ça me suffit.
« Alors, vous voulez dîner, bien que je ne « chasse » pas, pardon… « sasse » pas… connaisse pas l’heure qu’il est… Voici du pâté de foie, voici des hors-d’œuvre, voici des viandes frigorifiées, mais cuites, voici du potage, voici du thé et voici de la bière. Voulez-vous du café au lait allemand ?
— Je vous remercie. Je ne vous dérange pas ?
Je distingue mieux dans cette salle où il n’y a pas de meubles, mais seulement des tapis et des coussins, la jeune femme blonde qui fumait tout à l’heure narquoisement devant sa porte. Elle secoue les épaules.
— Vous avez froid ?
— Peut-être, soupire-t-elle. J’ai trop fumé en regardant la nuit descendre. Ce n’est pourtant pas pour cela que je frissonne. C’est à cause de votre question. Même si vous me dérangiez, qu’est-ce que ça peut faire ? Vous avez faim, n’est-ce pas ? C’est un ordre de Mademoiselle. Vous me tiendrez compagnie. Si vous me dérangez, je dormirai. Mangez. Mademoiselle ne sait pas manger.
— Ah !
— Vous pouvez parler avec confiance ; Mademoiselle s’est retirée. Elle vous abandonne avec moi.
— Donc, disiez-vous, Mademoiselle ne sait pas manger ?…
— Non, elle ne sait pas, décrète Trophime avec autorité. Elle ne mange que quatre fois par jour.
— Ce n’est déjà pas mal.
— Vous trouvez ! Elle mange le matin une fois en se levant, après son débarbouillage, une fois au milieu du jour. A quatre heures, — elle a une montre attachée à son poignet — et à sept heures, elle prend du thé et des petites choses. Mais elle fait semblant de manger.
— Le reste du temps à quoi s’occupe-t-elle ?
— Ici, elle lit. Des journaux, des livres, des histoires, des romans, des journaux encore. Comme si c’était intéressant de lire des histoires que l’on oublie tout de suite après, sur des gens qu’on n’a jamais vus et qui peut-être bien n’existent pas.
— Mais vous, dis-je à Trophime, vous mangez plus souvent ?
— Chaque fois que je ne travaille pas.
— Vous travaillez beaucoup, sans doute ?
— C’est moi qui fais tout ici ! Je travaille beaucoup mais peu à la fois.
— Comment : peu à la fois ?
— Oui, entre chaque travail je me repose.
Ainsi discourant, nous mangeons l’un et l’autre avec appétit. Trophime parle, mais elle sait nettoyer son assiette avec ses doigts, car j’ai en vain cherché autour de moi une fourchette. Je me suis assis sur mes talons et je goûte à plusieurs reprises aux plats que Trophime me présente.
— Il y a longtemps que vous n’avez pas mangé ? s’informe-t-elle.
— Depuis midi.
— Ça fait long, ça, remarque-t-elle.
— Vous n’aviez pas mangé non plus ?
— Non. Rien mangé depuis que je fumais sur le seuil de la porte. Mais à présent, c’est pour vous tenir compagnie. Honneur à l’invité, comprenez-vous ?
Il y a une corbeille à papiers près de moi. A plusieurs reprises, je l’ai poussée légèrement.
— Il vous gêne, Monsieur ? C’est mon casier à documents. C’est bien plus commode qu’un placard qui est tout de suite plein.
Et comme ce « casier à documents » lui déplaît sans doute, Trophime lui envoie un coup de pied. Le panier tombe sur le sol et se vide. Des lettres, des notes, des enveloppes encombrent le tapis.
— Poussez-les, Monsieur. Voulez-vous maintenant de la bière ?
— Volontiers, Mademoiselle.
— C’est que je n’en ai pas.
— Bon. Je me passerai de bière.
— Je n’en ai pas ici. Il faut que je me lève.
— Laissez. Indiquez-moi où se tient cette bière.
— Non. Pas vous. Elle se tient chez Mademoiselle. Je ne puis pourtant pas appeler Mademoiselle pour qu’elle m’apporte la bière.
Elle rit, s’agite un peu, puis avec un effort :
— Allons, je vais me dresser debout. Restez ici.
La corbeille à papiers m’intrigue. A côté de moi des enveloppes de poste-restante : « Mademoiselle Ozilie de Wicheslaw, bureau de la rue Danton. » L’adresse même qu’Ozilie donna à Pierre Caussanges. Sans doute, ces enveloppes doivent-elles servir à Trophime pour retirer les lettres de « Sa Noblesse » à Paris. Mais ainsi dispersées, elles risquent de se perdre. A tout hasard, j’en recueille quelques-unes que j’examinerai à loisir, plus tard.
Précisément, Trophime revient :
— Vous n’avez pas froid ? Fraîcheur des nuits, attention. Tenez, prenez ce manteau.
Elle me jette sur les épaules un large manteau de fourrures.
— C’est chaud, dit-elle. Et solide. Mademoiselle m’a dit que c’était du « claragazul »… Mais on n’y voit rien dans cette maison. Tiens, qu’y a-t-il par terre ?
— C’est votre corbeille qui…
— Non… Cette plaque que j’ai bousculée.
Elle se baisse :
— Mais c’est votre plaque de policier secret !
Elle me tend un petit triangle de cuivre où l’on peut lire : « I. S. 24 ».
— Si ce n’est pas la vôtre, c’est celle de Michel, un autre inspecteur qui est venu le premier jour.
— Ce sera la mienne, si vous voulez.
Elle sourit.
— Alors, accrochez-la solidement, conclut Trophime qui tourne un bouton électrique.
Et j’aperçois devant moi, tenant deux bouteilles de bière, une assez imposante blonde, au visage blanc, avec des yeux bleus sympathiques où se mélangent et se heurtent sans doute l’ingénuité et la malice.
— Ce sont les dernières. Mademoiselle n’en commandera plus. Tant mieux !
— Pourquoi, tant mieux ?
— Parce que ça signifie que nous allons lâcher cette villa…
— Vous vous ennuyez ici ?
— Je m’ennuie partout quand j’y reste trop longtemps, certifie Trophime. Et rien ne m’ennuie plus que de voyager… Quelquefois, je fais ce rêve : me retirer à la campagne, vivre en paix. Deux chaumières et un cœur…
— Pourquoi deux chaumières ?
— Parce que, en cas de séparation, j’en garde une… Mais la campagne, non, ce n’est pas pour moi encore. Déjà de cette villa, j’en ai marre comme prononce le Prince lui-même. Je le comprends. Elle est ennuyeuse cette cour où le Prince vit seul toute la journée.
— Comment, seul ?
— Bien sûr. Les membres de la Cour travaillent en ville. Il ne reste ici que deux professeurs de danses qui sommeillent. Et les chiens de garde : Taurus, Rocamadour…
— Et Frieda ?
— Frieda, c’est une petite chienne sans intérêt, la seule que l’on attache…
— Pourquoi ? Elle est méchante ?
— Non. Elle est idiote. Elle court partout. Elle urine contre les poteaux indicateurs, elle fait des trous avec ses pattes, elle ravage les rues de la ville.
Trophime s’arrête, allume une cigarette.
— Servez-vous, dit-elle.
Puis elle repart :
— Enfin, les gens m’ennuient. Ils sont prétentieux. Ils croient que c’est arrivé. Quand ils se rencontrent, ils se font des saluts avec cérémonie, ils s’appellent : « Comte, Monseigneur, Margrave », ils se disent : « Son Excellence le Ministre de la Police, Son Excellence le Ministre de la Guerre, Sa Noblesse ». Ils se croient réellement « premier aide de camp » ou « premier écuyer ». De vieilles femmes qui sont nettoyeuses de ménage à Genève ou dans les villas voisines s’imaginent « demoiselles d’honneur » parce qu’elles l’ont été autrefois.
— Autrefois ?
— Oui, autrefois, quand la cour existait réellement et que le Roi, père du Prince actuel, gouvernait…
« Eh bien, vous savez ce qu’ils font ces beaux messieurs ? appuie Trophime avec vivacité. L’ancien colonel des uhlans de la garde, aujourd’hui ministre de la Guerre sans armée, est mécanicien d’auto. Et le premier chancelier qui gouverne…
Pour prononcer ces mots, Trophime baisse la voix :
— … gouverne à la place du Prince ! Il donne des leçons en ville.
— Des leçons de quoi ?
— Il est raccommodeur de pianos… Et le ministre de la police ? Il est électricien. C’est pourquoi l’électricité marche au Palais une nuit sur deux. Vous êtes arrivé pendant une nuit lumineuse ?
— Le ministre ne s’occupe pas de l’électricité ici ?
— Si. Il s’en occupe. Et la femme du Premier ? Elle est vendeuse. Et la femme du chef policier ? Elle est manucure.
— Et Mlle Gina ?
— Elle est sténo-dactylographe.
J’insinue parce qu’il faut bien que je parle un peu :
— Mais c’est fort bien tous ces gens qui travaillent dans la journée.
— Ce n’est pas moi qui les blâmerai, approuve Trophime. Non, je sais trop ce que c’est que le travail. Mais ce qui est comique, c’est que lorsqu’ils rentrent au Palais, ils s’arrêtent chez le concierge où il y a un petit vestiaire ; ils y accrochent leurs accoutrements de travailleurs pour la ville et endossent leurs anciens uniformes de cour, costumes d’officiers, d’aides de camp, de ministres. Ainsi affublés, ils pénètrent dans l’enceinte du Palais. Le lendemain matin, ils replacent leurs défroques au vestiaire et se déguisent en mécanicien, électricien, manucure, laveur de chien pour retourner à Genève.
« Quand ils sont habillés en « ce qu’ils étaient auparavant », précise Trophime, ils ne connaissent plus personne et ils redeviennent Son Altesse, Son Excellence, Sa Noblesse. Et des saluts, des révérences ! Jusqu’au Suisse, Monsieur, que vous avez sûrement aperçu. Il est concierge. Sa femme le remplace lorsqu’il y a des visiteurs. Lui, il fait le premier huissier pour la première antichambre. Il introduit les personnalités et il tend la main pour qu’on lui donne un pourliche ?
— Un pourliche ?
— Oui. En français ça signifie un pourboire. On voit bien que vous êtes Suisse, mon bon Monsieur. Après, il va annoncer dans une seconde pièce les gens qui sont dans la première. Dans cette seconde pièce on attend. Un autre huissier apparaît. C’est lui, le concierge, mais il n’a plus de barbe. Il a des favoris sur le visage. Il est devenu premier huissier avec des chaînes au cou. C’est le Premier Ministre qui veut ça, pour l’impression. Mais le concierge y trouve son bénéfice. On fait entrer le visiteur dans une troisième pièce. Le concierge en chasse vite les souris et les araignées. Il nettoie un peu ; il balaie. Puis il se maquille encore et c’est un chambellan à lunettes noires, tout rasé qui arrive. Il faut lui mouiller la patte.
— Vous dites ?
— Lui donner backchich si vous préférez… Vous ne percevez pas les finesses de la langue française…
— Et c’est toujours le concierge ?
— Toujours.
— J’aurais bien voulu voir ces métamorphoses.
— Vous n’avez qu’à solliciter une audience de Son Altesse. Mais si… Transformez-vous un peu… Vous ne verrez pas le Prince, mais vous admirerez trois fois le concierge dans ses travestis.
La porte derrière moi s’est ouverte. Je le devine au petit courant d’air qui soulève les papiers du « casier » de Trophime répandus sur les coussins. Ozilie doit nous écouter…
— J’espère que tu lui en racontes depuis un moment ! murmure-t-elle.
Trophime, sans s’effrayer, approuve :
— Je lui communique mes impressions.
— Elle ne vous dérange pas, Monsieur ? me demande Ozilie.
— Pas du tout, Votre Noblesse.
— Vous voyez, intervient Trophime, Votre Noblesse, il est content.
— On dit — rectifie lentement, sans rire, Ozilie — on dit : « Votre Noblesse peut se rendre compte que son invité est content ».
Puis, à moi, de nouveau, Ozilie accentue :
— Il faut l’excuser, Monsieur. Trophime est une vraie pie borgne. Elle est très bavarde. Elle raconte tout ce qui lui passe par la tête, sans réfléchir, indistinctement. Comme on dirait en France, elle est très exhibitionniste.
Ozilie, sur ces mots, se retire. Brusquement, elle revient :
— Le Prince se dirige par ici. Fuyez Monsieur !
Et elle disparaît.
— Bon ! soupire Trophime, voilà l’autre, à présent…
— Comment faire ? Tout va se découvrir. Fâcheuse idée d’être entré dans ce pavillon !
— Ne vous frappez pas, répond Trophime qui me témoigne une soudaine sympathie — un peu trop vive même.
Pour Ozilie et pour moi, elle décide :
— Ne courez pas. Où iriez-vous dans la nuit, dehors ? Votre chapeau ? Bien. Suivez-moi.
Une tenture qu’elle soulève. Elle me pousse et me voici dans un étroit cabinet.
— Silence ! Je viendrai vous chercher quand il sera parti. J’éteins les lumières et je me couche.
Elle éteint, en effet, car je ne distingue plus rien. Cependant, devant moi quelque chose que je prends pour un rideau opaque. Erreur. Ce sont les deux battants d’une porte qui ne se rejoignent pas tout à fait. Ils sont fermés toutefois. Mes mains rencontrent des verrous soigneusement tirés. De l’autre côté de cette porte, la pièce où Mlle Ozilie et le Prince sont face à face. Leurs voix me parviennent… Décidément, je suis appelé ce soir à surprendre Son Altesse Evgueny dans l’intimité. Et, cette fois, l’endroit choisi est ingénieusement agencé : je me trouve prisonnier dans le poste d’écoute de Mlle Trophime.
D’abord la voix d’Ozilie :
— A quoi dois-je attribuer l’honneur d’une visite si tardive de Votre Altesse ?
La voix du Prince Evgueny :
— J’ai aperçu de la lumière chez vous. J’ai pensé que vous étiez souffrante. J’ai voulu me renseigner.
— Votre Altesse est bien aimable. Votre Altesse n’a pas sommeil ?
— Vous savez qu’il est plus de dix heures et que le couvre-feu est sonné, réplique le Prince.
— C’est vrai, mais que Votre Altesse m’excuse. J’ai un peu oublié les habitudes de la Cour.
Voix hésitante du Prince :
— Vous êtes seule ici ?
— Je suis avec Trophime.
— On peut nous entendre.
— A cette heure-ci, Trophime dort.
Un temps, puis avec cette maladroite hardiesse des amoureux et des timides :
— Vous ne pourriez pas renvoyer Trophime ?
— Pourquoi ? s’étonne Ozilie. Je suis très contente d’elle. Trophime accomplit parfaitement son service.
— Non ! Envoyez-la faire une course…
— Avec vos aides de camp qui sont à la porte ?
— Je suis venu seul.
— Votre Altesse aime toujours ses petites promenades nocturnes qu’il croit solitaires.
— Vous vous moquez de moi ?
— Votre Altesse sait bien que non.
— J’ai, commence le Prince, une prière à adresser à Mlle Ozilie, à Mlle Ozilie en personne. C’est pour lui demander de vouloir bien présenter ma requête à Mlle Isabelle Chenoncay.
— Très bien. Je transcrirai à Mlle Isabelle quand je la verrai, répond Ozilie gravement.
— Non, insiste le Prince. Il faudrait lui transmettre tout de suite. Vous avez bien un moyen de communication depuis le temps que vous vous connaissez et vivez de compagnie.
Ozilie ne se presse pas de répondre. Enfin :
— Nous en avons plusieurs, sans compter le téléphone.
— Eh bien, continue le Prince en riant, téléphonez-lui.
Quelques pas. Ozilie doit se diriger vers un petit meuble que j’ai remarqué, près du mur. Je la distingue en ce moment par une fente, celle que produisent les deux battants au point où ils se rejoignent mal. Ozilie fait mine de décrocher un récepteur.
— Allo ! Oui !… Allo !… Mlle Isabelle Chenoncay, je vous prie. Allo ! ne coupez pas !…
Soudain, la voix contrite et en faisant, sérieusement, le geste de reposer son récepteur :
— Eh bien, vous voyez : ce n’est pas libre.
Encore un moment. Puis, comme on se jette à l’eau, la voix anxieuse du Prince :
— Si vous saviez ! Je ne puis pas vous oublier !
La réplique d’Ozilie, sans timbre, cette fois :
— L’air de la nuit ne vaut décidément rien pour Votre Altesse.
Le Prince changeant de ton et presque enjoué :
— Vous savez que je n’ai plus de professeur de français et que je regrette les bonnes leçons de jadis.
— Votre Altesse désire-t-elle que je cherche de mon côté ?
— Pourquoi avez-vous fui si vite ? demande le Prince d’un accent une fois de plus transformé.
— Je n’ai pas fui, je suis partie.
— Vous même, cependant, vous reconnaissez que vous avez pris la fuite.
— C’est exact. Erreur volontaire que l’on ne peut lire que sur les lettres que j’ai adressées à Mlle Gina.
Ce doit être là une vive impertinence, car je sens le Prince décontenancé. Si je comprends bien, Ozilie lui fait observer sans détours qu’il eut connaissance de la correspondance qu’elle envoyait à la fille du premier ministre. Toutefois, Evgueny essaie d’un :
— Je ne peux plus me passer de vous.
Ce qui amène cette riposte d’Ozilie :
— Je compatis beaucoup aux peines de Votre Altesse, mais un Prince digne de ce nom doit-il se laisser submerger par des soucis de cœur ?
— Suis-je donc un Prince digne de ce nom ? Et croyez-vous que je tienne à être Roi ?
— Ceci ne me concerne point. Mais je dois loyalement vous prévenir que je suis fiancée. Presque mariée…
— Depuis longtemps ?
— Depuis deux mois.
— Deux mois ! Non ! Ce n’est pas possible.
— Vous faut-il des preuves, Monseigneur ! J’ai des lettres qui en font foi. Je puis les mettre sous les yeux de Votre Altesse…
Ozilie doit chercher ces lettres, car si je l’entends remuer des papiers, je ne la vois plus.
— J’avais des lettres ici, remarque-t-elle. Où sont-elles ? Encore égarées !
D’une voix plus élevée :
— Trophime, Trophime, où sont mes lettres ?
— Vous ne les trouvez pas ? demande le Prince. Ne cherchez pas…
— Mais il me les faut, affirme Ozilie qui s’impatiente. Trophime ! veux-tu répondre ?
La « Trophimova » qui, depuis un moment s’est glissée près de moi — mais c’est pour mieux écouter — murmure :
— Zut ! ce sont les trois lettres que je n’ai pas eu le temps de retirer de la poste restante.
S’adressant à moi, en confidence :
— Vous les retirerez pour moi. Je vous expliquerai. Il ne faut pas que ces lettres traînent.
— Pourquoi ?
— On y parle du mariage secret de Mademoiselle. Chut !
— Elle est mariée ?
— Ça vous ennuie ? Rassurez-vous : ce n’est pas tout à fait vrai. C’est pour que le Prince lui f… la paix. Ces lettres que je devais retirer, on les aurait laissées, comme ça traîner par ici pour qu’il les découvre… Alors, quand vous serez à Paris, — si vous y êtes avant nous — vous les prendrez et vous me les enverrez à mon nom. C’est un secret. N’en parlez pas. Et vous me rendrez service. Quand vous irez…
Mais la voix de Mlle Ozilie nous interrompit :
— Trophime, veux-tu te décider à me répondre ?
— Qu’est-ce qu’il y a Votre Noblesse ? interroge Trophime comme quelqu’un qui vient de s’éveiller.
Et pour moi, elle bredouille :
— En voilà une perte ! De belles horreurs ces lettres, à croire que Mademoiselle a un amant !
Evgueny s’en mêle :
— Laissez dormir Trophime : elle ne les trouvera pas plus que vous.
— Pourquoi, je vous prie ? riposte Ozilie.
— Parce que la police de mon Premier a dû passer par là.
« Bienheureuse police, toujours responsable ! » Mais j’écoute soudain avec plus d’attention.
— Oh ! cet homme qui est venu ce soir ! s’écrie Ozilie.
— Un homme est entré, chez vous, ce soir ! s’étonne Evgueny… Naturellement, il vous a parlé et il a subtilisé vos lettres. Laissez donc ! C’est moi qui vous les rapporterai. On va me les offrir demain pour mon petit déjeuner. Mais ces lettres que contenaient-elles ?
— Des choses… répond évasivement Ozilie.
Trophime, n’étant plus appelée, s’est recouchée.
— S’il pouvait les lire, murmure Trophime en riant, il en ferait une tête !
— Ce sont des lettres de mon fiancé, précise Ozilie. Et j’y tenais.
— Ainsi, conclut le Prince, maintenant, je puis dire que je suis seul, sans ami ni conseiller. Pourtant j’avais une si grande confiance en vous !
Ozilie, la voix changée, affirme :
— Vous savez, Monseigneur, l’attachement, le respect que j’ai pour vous. Si. La preuve ? Vous sachant en danger à la Cour, je suis revenue, en dépit de tous les conseils.
— Quels conseils ?
C’est tout ce qu’Evgueny a retenu :
— Certains conseils…
— Les mêmes qui vous firent abandonner la Cour, sans doute ?
— Peut-être…
Un moment de répit. On devine que le Prince ne sait quoi inventer. Ou bien, il n’ose plus parler. Quant à Ozilie, elle attend. Que font-ils ? Je ne les vois pas. Enfin, j’entends, mais assez mal (à cause du bruit que provoque Trophime qui vient de se lever une nouvelle fois) quelques confidences d’Ozilie que je reconstitue comme suit :
— Que Votre Altesse veuille bien se souvenir de la promesse qu’elle me fit : retrouver les lettres que l’on m’a dérobées.
— J’y penserai, assure le Prince. Mais comment était l’homme qui est entré chez vous, ce soir, avant moi ?
Et c’est mon signalement que Mlle Ozilie fournit. Elle dépeint un personnage de bonne taille, maigre, au visage long, au teint brun (Teint brun est exagéré) rasé, avec un nez fort et pointu (Je ne crois pas posséder un nez pointu, mais on se connaît si mal soi-même !)
A chaque détail de ce portrait, Evgueny soupire.
— Je ne vois pas… Non, je ne vois pas.
Ozilie insiste. Elle va rappeler au Prince que cet homme est le délégué qui vint à Paris… Ça ne manque pas, en effet. Cependant réplique inattendue d’Evgueny :
— Je vous ai déjà déclaré que ce n’était pas moi qui avais expédié des émissaires à Paris ! Et comment est-il arrivé ici ! Ah ! parce qu’il avait faim. Et vous l’avez envoyé où ?
— Chez Trophime.
— S’il est encore là, je serais curieux de le voir.
Trophime qui a écouté est prête à tout événement :
— Ne bougez pas ! me souffle-t-elle, tandis que, dans l’autre pièce, le Prince retient Ozilie et lui confie :
— Ne dites pas qui je suis à cet homme-là… Pour lui, je dois rester un officier de service… Non ! il ne me connaît pas. Écoutez, s’il est obséquieux devant moi, je vous l’accorde, c’est qu’il m’a déjà vu ; sinon, c’est qu’il croira réellement ce que vous lui annoncerez.
Ozilie doit se montrer sceptique, car le Prince insiste. Merci quand même de l’avertissement que Son Altesse a bien voulu me fournir. Mais que va répondre Trophime à cette question d’Ozilie :
— Ton invité, est-il toujours avec toi ? demande-t-elle en ouvrent la porte de la chambre où se tient Trophime.
— Oh ! non, Votre Noblesse !
— Où est-il maintenant ? insiste Ozilie.
— Je ne sais pas, mais pas loin d’ici.
— Veux-tu essayer de le retrouver. Tu le ramèneras… Écoute ! Tu lui diras qu’il y a ici un officier de service qui désire lui parler. C’est tout, tu entends. Pas autre chose… Va !… Et ne reste pas une heure et demie dehors…
— Si je ne le découvre pas, je reviens tout de suite, conclut Trophime.
Trophime s’habille dans l’obscurité. D’une voix complice elle me donne ces indications :
— On veut vous voir. Donnez-moi votre chapeau, votre pardessus. Venez. Vous allez sortir. Suivez-moi. C’est le Prince qui va vous parler, vous avez entendu ?
— Oui… Il se fait passer pour un officier de service…
— C’est ça, n’ayez pas peur de lui. Je vous ai aperçu comme vous faisiez la conversation avec une ronde. Prenons la sortie qui m’est réservée. Nous rentrerons par la grande porte, chez Ozilie…
J’obéis à la sympathique Trophime qui m’a décidément pris sous sa garde.
Ne savez-vous pas reconnaître le cri de l’hirondelle de merOu la plainte de la mouette chassée par le vent ?Rudyard Kipling.
Les opinions des uns et des autres.
Je ne m’inclinerai donc pas devant Son Altesse Evgueny comme cela m’advint en présence d’autres Altesses, au cours de déplacements plus ou moins imprévus et que je n’ai pas à mentionner pour le quart d’heure. Du reste, c’est Ozilie qui me présente.
— Voici ce Monsieur.
Puis, se tournant de mon côté.
— Monsieur l’officier de service a désiré vous voir.
Je salue et j’attends. Certes, Ozilie n’a pas été fâchée tout à l’heure, à la pensée de m’humilier devant le Prince. Maintenant, elle redoute sa victoire et ses conséquences… En face de moi, un jeune homme blond. Est-ce cet uniforme de hussard corseté qui l’amincit et le rajeunit encore ? On croirait un collégien qui s’est déguisé en soldat pendant ses vacances. Mais ce que je regarde surtout, ce sont les yeux du Prince, des yeux gris-bleus, d’un gris insistant.
Evgueny s’exprime en allemand. Deux ou trois fois, il baisse les paupières. Quand il a terminé, alors seulement, je prends la parole :
— Je comprends assez mal l’allemand ; je puis cependant répondre à votre question : j’appartiens au service du Premier ministre.
Qu’est-ce que je risque ? Je l’ignore, mais maintenant, je dois jouer jusqu’au bout. C’est ma seule chance d’évasion. Les enveloppes de lettres recueillies chez Trophime sont bien cachées ; mes papiers — au cas où le Prince les exigerait ou même les ferait prendre de force — établiraient ma véritable identité. C’est une autre chance à tenter. Ils constituent une suprême sauvegarde.
— Que fais-tu là ?
Evgueny me tutoie sans hésitation ni raideur. Devant un subalterne, quelque chose comme un agent secret, peut-être se sent-il à l’aise ? Il s’arroge en outre les avantages d’une fonction d’emprunt. Il n’a pas à se tenir comme un prince. Il découvre dans sa personnalité une assurance inattendue et le plaisir mal défini que certains caractères — comme le sien — éprouvent dans une mystification bien composée.
Maintenant, Evgueny me demande mon nom. Je n’hésite pas ; je donne le mien, le vrai :
— Lonlay-Labbaye.
Le Prince consulte un petit agenda qu’il tire de sa poche. Il y trouve un petit papier plié qu’il examine consciencieusement :
— C’est exact, dit-il.
Je ne souris pas. L’« officier de service » continue à tenir son rôle. Il insiste même :
— Labbaye, avec un y ?… Il y a longtemps que tu es au service du Premier ?
— Deux jours, Monsieur le Lieutenant.
— Tu as beaucoup de travail ?
— Beaucoup.
Je n’ai pas envie de rire. Cependant le visage d’Ozilie où tant de sentiments sont lisibles : l’étonnement, une vague crainte, puis une sorte de fureur me fourniront, plus tard, des accès de joie. Elle doit se rappeler ce que je lui ai annoncé quand je l’ai rencontrée dans le parc : « Si le Prince m’aperçoit, il passera comme s’il ne me connaissait pas ! »
— De quel pays es-tu ?
— De France, Monsieur.
Et d’autres questions qui ne risquent pas de me compromettre, car si je ne sais rien, le Prince aussi ignore à peu près tout… Soudain, une attaque plus directe :
— C’est le « Premier » qui t’a ordonné de surveiller Mademoiselle ?
— Je pourrais vous répondre, Monsieur le lieutenant, que je n’ai rien à vous dire. J’aime mieux vous assurer que le « Premier » ne donne à personne des missions de ce genre.
Le Prince regarde Ozilie. Mais elle doit songer : « Quelle perfidie ! Ils s’imaginent que je ne vois rien ! Comme ils dissimulent mal l’un et l’autre ! Tout à l’heure, celui-là était Suisse, à présent, il est Français. »
— Alors que fais-tu ici ? reprend Son Altesse.
Dois-je inventer quelque chose ? Je risque de tomber du premier coup sur une bêtise.
— Je regrette, Monsieur, d’être obligé de me taire.
— Mais je suis officier de service. Je fais une ronde…
— Je ne le conteste pas.
— Ton insigne ?
— Voici.
Et je montre le triangle « I. S. 24 » que m’a remis Trophime un moment plus tôt. Le Prince le regarde. Il paraît surpris cette fois.
— Suivez-moi au poste de garde.
C’était bien ce que je craignais.
— Comme il vous plaira, Monsieur.
— Sortons…
Le Prince salue Mlle Ozilie et Mlle Trophime. Toutes deux se courbent dans une révérence. Je dis au revoir à Trophime et je m’incline légèrement, en souriant, devant Ozilie.
— Il fait froid, cette nuit.
C’est le Prince qui parle.
— Comment vous appelez-vous déjà ?
Il ne me tutoie plus. Pourquoi ?
— Je vais vous conduire au corps de garde ; vous y serez mieux pour dormir qu’aux environs du pavillon des femmes. Attention ! vous allez vous jeter sur le Palais de Justice.
— Le Palais de Justice ?
— Oui, cette tonnelle près de ce carré de choux…
Des officiers passent. Une ronde, sans doute. Un homme tient à bout de bras une lanterne qui éclaire tout d’un coup nos pieds et nos jambes. La lanterne s’élève, braquée sur nous. Les officiers s’arrêtent aussitôt et nous saluent en arrondissant leur main près de leur casquette. Lorsque la ronde s’est éloignée le Prince bougonne, comme pour lui-même.
— Ils m’embêtent, tous ces gens, avec leur simulacre de cérémonies et de patrouilles. Ils racontent qu’ils vont prendre la garde ! Je n’en suis pas dupe. Ils vont se coucher. Et ils savent qu’il y a des veilleurs de nuit qui dorment aussi bien qu’eux-mêmes. Sans compter les chiens qui sont plus sûrs.
Le Prince continue donc à tenir pour moi ses fonctions d’officier de service mécontent. J’écoute sans émettre de commentaires.
— Le château, poursuit Evgueny, est une auberge où ils dînent et où ils couchent. Prenez garde, voici le Sobranié. Oui, Monsieur, le Sobranié est figuré par cette remise à outils… Ainsi, ils jouent à la principauté. Toute cette propriété a été transformée par leurs soins. C’est à croire qu’il existe une dose de puérilité jamais morte et qui se maintient chez les hommes les plus graves en apparence.
« Saluez, Monsieur, la caserne des gardes sur votre gauche. C’est ce hangar. La chambre des représentants, c’est ce mur à droite. Quant au Palais Royal, c’est le bâtiment où réside Son Altesse.
— Et le corps de garde ?
C’est ma première question. Elle est partie, malgré moi, par habitude professionnelle certainement.
— Il n’existe pas. Il y a une sorte de soupente pour deux personnes. Vous n’y serez pas trop à l’aise.
Le prince ajoute :
— Il n’y a pas seulement le parc qui est falsifié ! Les habitants le sont aussi…
La raison de ces confidences ? Je l’ignore pour l’instant ; mais je ne les oublie pas.
— Tenez, ajoute Evgueny, il y a d’abord le Prince qui joue au Prince en exil.
Je crois être habile en remarquant :
— C’est son rôle, il me semble…
— Admettons, interrompt Evgueny. Il y a le Premier Ministre. Les conceptions politiques du Premier, ses idées sur l’autorité ! Il surveille le Prince, trop libéral à son gré, il le conseille, il le redoute. Et les projets stratégiques du ministre de la guerre, sa mobilisation des femmes ! Remarquez que ce maquillage est fragile : un appareil en carton. Le jour où les événements tourneront en faveur du Prince, — si ce jour arrive — il faudra tout reviser et compter avec les gens qui seront restés « là-bas », au péril de leur vie, sans honneurs ni profits. Mais vous, Monsieur, en attendant ce miraculeux renversement, pourquoi ne sollicitez-vous pas une place, un grade, un titre ? Il reste des postes sans titulaires et l’on peut toujours en créer de nouveaux.
— Que faut-il faire ?
— Verser une gratification au Premier, à l’huissier, au concierge, à je ne sais qui encore…
— Et au Prince ? dis-je hardiment.
— Rien, réplique Evgueny d’une voix rude. Voyons ! le Prince est tenu en dehors ; il ignore tout, bien entendu. On lui a fabriqué une cour de dignitaires et falsifié sa propriété, celle-ci, le plus certain de ses revenus.
— Tout de même, le Prince a bien quelqu’un dans son entourage qui peut lui parler.
— Non, Monsieur. Il en avait un, autrefois. C’était un homme étonnant, un de vos compatriotes : le colonel Chenoncay…
— Le père de Mlle Ozilie ?
Je ne compte plus mes questions ni mes interruptions.
— Oui, répond le Prince.
Je ne saisis pas très bien. C’est la seconde fois que ce nom de Chenoncay est prononcé devant moi. Caussanges le premier, me cita ce nom. Au fait, le Chenoncay de Chamarges est l’oncle de Mlle Isabelle. Mais alors ? Je demande :
— C’est ce colonel qui a un frère en France ?
— Précisément. Comment savez-vous ? Mais vous connaissez donc Mlle Isabelle ?
C’est au tour du Prince à m’interroger de nouveau. Je ne n’aventure qu’avec prudence :
— Moi ? Non. A peine.
— Comment ? Vous la connaissez à peine et vous allez lui demander l’hospitalité ? s’étonne Evgueny.
— C’est-à-dire que je pouvais me permettre…
Mais un rapprochement dans mon esprit : Isabelle — Ozilie, puisque Mlle Ozilie est la fille du colonel Chenoncay et que le frère du colonel qui est à Chamarges a une nièce qui se nomme Isabelle…
— C’est-à-dire que c’est Mlle Trophime que je connais un peu.
— Ah ! bon ! s’écrie le prince en éclatant de rire.
Et cette gaîté c’est pour ne pas montrer combien ma réponse le satisfait. Ma parole, il est jaloux même des relations de Mlle Isabelle-Ozilie.
Sans insister pour savoir comment j’ai pu lier connaissance avec Trophime, Evgueny s’informe :
— Vous n’avez jamais vu le fiancé de Mlle Isabelle ?
Je rectifie, exprès :
— Le fiancé de Mlle Ozilie ?
— Si vous voulez, c’est la même chose.
Cette confirmation m’enchante. Toutefois, il faut répondre quelque chose :
— Je sais qu’il y a plusieurs fiancés sur les rangs, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait un élu.
— Quels sont ces fiancés ?
— Leurs noms, je les ignore. Il y a un avocat, un magistrat… deux avocats même…
J’ai l’air de chercher, je ne puis retenir un sourire intérieur en constatant le tour qu’a pris cette conversation si étrangement commencée chez Ozilie et qui se poursuit, en pleine nuit, dans le parc endormi du Palais de Neu-Thorenberg.
— Il y a encore un médecin, déjà célèbre et un jeune ancien ministre.
— Français ?… Qui ça peut bien être ?
— Je ne sais pas encore.
— Enfin, y a-t-il un Élu ? reprend le Prince.
Décidément, il y tient. Je n’ai aucune raison de ne pas favoriser les combinaisons d’Isabelle-Ozilie que me confia Trophime. Après tout, elle m’a rendu service. Sans le prévoir, il est vrai…
— A vrai dire, je crois qu’il y a un Élu. Qu’est-ce qui me permet de le croire ? Des tas de petites choses insignifiantes, mais qui ont leur poids.
Nous sommes tout à fait en confiance, « l’officier de service » et moi. Il devine sans doute que je ne veux pas aller plus loin sur ce sujet ou bien que je ne sais plus rien. Il se décide :
— Tenez, le corps de garde est là. Vous pourrez y dormir. La clef est sur la porte. Au revoir, Monsieur. Bonne nuit.
Et Son Altesse Royale me tend la main.
Le corps de garde possède une paillasse et des couvertures. On peut y dormir. Ce n’est qu’une baraque, il est vrai, mais elle est éclairée par une ampoule électrique. On peut y méditer aussi.
Demain, je quitterai ce Palais, quand les portes s’ouvriront. Je rentrerai à Genève, avec les confidences de « l’officier de service ». Que valent-elles ? Pourquoi ce Prince m’a-t-il ainsi parlé, caché — comme Mlle Isabelle Chenoncay — sous un nom d’emprunt.
Ozilie, je le conçois bien, a changé de race — elle se dit autrichienne — comme d’autres émigrent d’un pays ou se réfugient dans un autre siècle. Mais Evgueny ? Je crois qu’il est autoritaire, toutefois la force lui manque. Il veut diriger et, peut-être, régner. Mais il n’a pas l’audace de conquérir le pouvoir. Et saurait-il le conserver ?
Par un revirement incompréhensible pour ceux qui l’entourent, Evgueny qui souhaite la couronne, n’entreprend rien pour se l’attribuer. Peur des coups ? Plus simplement : impuissance dans la décision et l’action. Des projets, des combinaisons, des velléités dont il aperçoit très vite les inconvénients. Il ferait sans doute un excellent « officier de service », non un capitaine. Aurait-il su succéder au roi, son père, honorablement ?
Connaissant sa carence de rêveur d’action, Son Altesse préfère laisser croire qu’il se désintéresse de tout ce que l’on trame en sa faveur et que le retour à la royauté n’est qu’un songe, imaginé par son Premier Ministre. Il pense qu’en répétant : « Je suis trop libéral, presque républicain, donc je ne puis régner », on ne découvrira pas son véritable caractère qu’il cache sous une armature d’indifférence, de mystification et de froideur.
Pendant ce temps, un autre événement que je n’avais point prévu — c’est ma faute — se produisait au Palais de la Grande Marche. Je ne l’ai connu que plus tard, le lendemain ; toutefois, je dois le rapporter ici.
En quittant Paris, j’avais, bien entendu, averti mon journal que je me rendais à Genève. Mais j’avais oublié de recommander le silence sur ce départ. Aussi, Floriant de Floriot, sans nouvelles de moi, apprit-il facilement en quel pays je voyageais. Il fit son possible pour partir aussitôt…
Comment a-t-il su que j’étais allé à la recherche du prince Evgueny ? Jacques Wisel qui m’a suivi — par distraction assure-t-il ; en vérité, à cause de l’intérêt qu’il porte à Mlle Ozilie — et qui s’est installé au même hôtel que moi, a renseigné Floriot. Wisel est excusable d’avoir commis cette indiscrétion ; j’aurais dû le prévenir, lui aussi, de garder secrète mon entreprise.
Floriant de Floriot seul, à Genève, a pris le temps de réfléchir : « Lonlay désire certainement obtenir une audience du Prince. Or, il y a un petit bureau politique du Prince, à Genève même. Allons-y solliciter l’entrevue indispensable. »
Là, on a déclaré à Floriant, selon la consigne ordonnée, que Son Altesse n’était plus en Suisse. Cependant, après cette démarche de Floriot, le premier ministre a été immédiatement avisé à la Grande Marche, que des « envoyés spéciaux (on exagère toujours) venus de Paris, voulaient enquêter sur le cas du Prince ».
La « Grande Marche » fut alertée. Le premier ministre a pensé : « On demande une audience, on la refuse. Fort bien. Mais d’autres essaieront d’arriver jusqu’à Evgueny. Et que racontera celui-ci en présence des journalistes ? » Toutefois, il fallait prévenir le Prince. On s’y décida.
C’est pourquoi lorsque Son Altesse toujours méfiante, costumée en « officier de service », me demandait mon identité chez Ozilie et qu’il consultait son agenda où l’on avait inscrit les noms des « envoyés spéciaux », ce n’était pas, comme je l’ai cru sur le moment, pour composer un peu mieux son personnage, mais pour savoir s’il se trouvait bien en présence d’un de ses dangereux reporters.
Conclusion : c’est en toute connaissance de cause qu’Evgueny m’a parlé du Prince, des ministres, de sa cour en miniature et de son royaume et qu’il m’a conté exactement ce qu’il voulait que je sache. La raison ? Faire ainsi échec aux projets et aux combinaisons de son premier ministre et empêcher le retour du prince Evgueny dans sa principauté.
Je me réveille assez tard. Il est bien huit heures. Dehors, froid. Tout de suite, je pense que j’ai manqué la sortie des dignitaires qui déposent leurs costumes au vestiaire, s’habillent selon leur profession avant de prendre les tramways qui les transporteront en ville. Mais aurais-je eu, sans attirer l’attention, la chance d’assister à cette opération ? C’est douteux.
Où se trouve la sortie ? Le bâtiment des femmes n’est pas loin de moi. Nous avons peu marché cette nuit, le Prince et moi, si nous avons beaucoup parlé. La demeure d’Ozilie, c’est une baraque de planches goudronnées, un véritable campement de réfugiées.
— Monsieur ! J’ai de la veine ! Mademoiselle m’avait ordonné de vous suivre hier, mais vous n’en finissiez pas avec le… avec l’« officier de service ».
C’est Trophime qui me cherchait.
— Venez avec moi. On veut vous voir encore. Et vous aurez droit à un café au lait.
— Dites-moi : où se tient la sortie ?
— Je vous y conduirai tout à l’heure.
— C’est que je suis pressé.
— Mademoiselle aussi est pressée. Elle ne vous gardera pas longtemps. Vous allez en ville ? Dites donc, quand vous reviendrez, voulez-vous me rapporter des cartes postales ?
— Lesquelles ?
— Une douzaine de chaque vue qui vous plaira. J’en envoie un jour douze, toutes les mêmes, à douze personnes différentes, le lendemain, douze autres, toutes pareilles. Comme ça, je ne risque pas d’expédier deux fois la même image à la même destinataire.
— C’est très ingénieux.
— Oui. Et puis, ça dispense de tenir un livre de comptes. Quand vous avez regardé douze fois une fontaine ou un château — je mets le timbre sur la gravure — vous commencez à l’avoir dans la mémoire. Mais vous êtes pressé, je le comprends…
J’écoute un peu distraitement le bavardage de Trophime. J’ai hâte d’arriver à Genève pour mettre au point mon article que je construis en ce moment. Je le vois très bien. D’abord en titre : « Un prince qui ne veut pas régner. » Au-dessous : « Les mystères d’une Cour en exil. » Puis, des alinéas : « Comment on garde le Prince », « Les policiers dans le jardin », « Le Prince s’habitue au commandement », « Ce qu’il confie en se disant un « officier de service », etc…
Ces sous-titres-là ou d’autres, que j’imaginerai à mesure.
Ce travail accompli, je monterai dans une automobile, je franchirai la frontière et je m’arrêterai pour télégraphier à Paris dans le premier bureau de poste français que je découvrirai…
Toutefois, Ozilie me demande. N’est-ce pas Son Altesse qui éprouve quelques remords de ses confidences et qui a changé d’avis. C’est bien regrettable, Monseigneur, mais votre confession est, autant dire, en route…
— Vous voilà enfin ! m’accueille Ozilie dès qu’elle m’aperçoit. Vous avez bien dormi ?
— Il dormait mieux ici, Mademoiselle, intervient Trophime.
— Assez, « Votre Noblesse »…
— En vérité, reprend Ozilie, vous avez l’aspect peu engageant d’un monsieur qui s’est mal reposé et qui n’a pas pu se laver.
C’est curieux comme elle s’exprime correctement. Je le constate une fois de plus ce matin, parce que je sais à présent que Mlle Ozilie de Wicheslaw n’est autre que Mlle Isabelle Chenoncay et lorsque Mlle Ozilie commet des fautes d’accent ou de français, c’est avec l’autorisation de Mlle Isabelle.
— Mademoiselle, recommence Trophime, pour le faire venir jusqu’ici, je lui ai promis que vous lui offririez une tasse de café au lait.
Je proteste aussitôt :
— Quelle plaisanterie !
Mais Ozilie rit sans retenue.
— Allez vous laver chez Trophime, dit-elle. Et prenez le café avec elle…
— Vous voyez !… triomphe Trophime. Suivez-moi. Je prendrai de nouveau le café avec vous, pour vous tenir compagnie.
Tandis que Trophime me verse de l’eau dans une cuvette et ne paraît pas du tout disposée à s’éloigner, je pense que le meilleur moyen de l’obliger à me laisser seul, c’est de lui poser une question très indiscrète :
— Pourriez-vous me dire pourquoi Mlle Isabelle qui est française se dit d’origine autrichienne et se fait appeler Ozilie de Wicheslaw ?
— C’est une devinette ?… Ce n’est pas mon côté fort. J’aime mieux les rébus…
— Mais non ! Je vous demande…
Je répète :
— Pourriez-vous m’expliquer pourquoi Mlle Isabelle qui est française…
— Vous feriez mieux de vous barbouiller la figure, le nez, les cheveux et l’estomac…
— Oui, tout de suite. Mais dites-moi…
— Est-ce que vous auriez peur de l’eau, par hasard ?…
— Pourquoi ? Mademoiselle…
— Parce que vous regardez l’eau sans vous laver.
— Vous ne voulez pas me répondre ?
— Ça vous intéresse beaucoup ? s’étonne Trophime.
— Un peu.
— Un peu, seulement ?
— Un peu plus qu’un peu.
— Eh bien, je vous le dirai un autre jour.
— Mais quand ? Moi, je retourne à Paris ce soir !
— Ne partez pas… D’ailleurs, je vous connais, vous reviendrez.
— Je ne vous trouverai plus.
— C’est bien possible. Et si moi je vous disais : je veux savoir ce que vous allez bricoler à Paris ?
— Je n’ai rien de caché pour vous : je vais diriger le bureau politique du Prince.
— Seigneur ! il n’y avait donc pas assez de gaffes auparavant !
Sa première surprise calmée, Trophime me rassure :
— Vous nous reverrez à Paris, vous nous reverrez…
Je suis entêté. D’ailleurs Trophime ne s’en va pas. J’insiste. Enfin, elle se décide :
— Lavez-vous. Je vais vous expliquer pendant ce temps. Mademoiselle qui a de la fortune avec un oncle qui possède en France et à Wien plusieurs domaines, des maisons à Paris, ne veut pas qu’on le sache, parce qu’elle ne rencontre autour d’elle que des épouseurs qui viennent pour son argent. Alors. Mademoiselle garde ce nom d’Ozilie et son titre qu’elle tient de la Cour, autrefois, du temps de la splendeur et elle se présente comme dame de compagnie de Mlle Isabelle ou institutrice de la famille Chenoncay, vous comprenez ?… Jurez-moi le secret, maintenant…
— Pour toujours ?
— Oui. Jusqu’au mariage de Mademoiselle…
Mais à présent qu’elle a commencé, Trophime ne s’arrête plus.
— Elle est très bonne, Mademoiselle, très douce, et très… réservée, c’est ça, réservée… Mais pleine de volonté. J’ai tort, moi, de la contrarier. Je sais qu’elle ne cède jamais. Mais quand même, je résiste…
J’écoute. J’ai pris le parti de faire ma toilette sans m’occuper de Trophime, pas du tout gênée, d’ailleurs. Elle coupe toutefois ses éloges sur Mademoiselle par quelques remarques de choix qui me concernent :
— Vous laissez du savon derrière les oreilles… Voulez-vous que je passe l’éponge sur votre rein ? Ici, nous n’avons pas de baignoire. C’est dommage, vous seriez plus vite nettoyé…
— Vous avez une grande force d’inertie…
— Qu’est-ce que c’est que ça ? s’inquiète « Trophimova ».
— C’est une sorte de force modératrice que l’on emploie dans certains pays pour arrêter de trop brusques élans. Ainsi, certaines compagnies de chemins de fer orientales diminuent-elles le nombre des accidents.
— Je ne sais pas. J’ai quelques qualités. Celle-là aussi, peut-être, approuve Trophime avec bonne grâce.
« Mais vous êtes habillé… Voici Mademoiselle qui va vous parler… N’oubliez pas : vous m’avez juré le secret jusqu’à son mariage…
Ozilie de Wicheslaw apparaît, sans avoir frappé, à la porte de communication. Elle a quelques précisions à me demander. C’est elle qui paraît embarrassée et non pas moi. Elle m’aborde avec une brusquerie volontaire :
— Vous connaissez beaucoup de monde à Paris… Ne protestez pas… vous devez avoir ouï parler d’un délégué de Son Altesse, M. Jacques Wisel… Vous avez déjà entendu prononcer ce nom ?… Par hasard ?…
— Comment est-il ?
— Des cheveux gris… plus fort que vous, oui. Pas aussi grand. La ressemblance s’arrête-là. Il a l’air très bienveillant, intelligent, spirituel, aimable…
— Je vois, dis-je… Des yeux très doux… C’est bien celui que je connais, l’historien…
Et comme je n’ajoute rien, Ozilie se tait.
L’intérêt qu’elle témoigne à Wisel, qu’est-ce que cela signifie ? Suis-je le premier à m’apercevoir d’un événement dont Ozilie elle-même se rend actuellement mal compte. Je la remercie de son hospitalité, mais elle ne m’entend pas. Soudain :
— Vous allez à Genève ? Je suis indiscrète, mais pourquoi ? Oh ! quelqu’un vous attend à l’hôtel. C’est ça, une jeune personne.
— Pas du tout, Mademoiselle, un de mes amis.
— Je ne veux rien savoir. Et vous resterez longtemps ? Selon les désirs de cette personne ? C’est gentil de se conformer ainsi à ses volontés…
Je parviens à interrompre ce discours :
— Certes, c’est un ami d’importance, intelligent, dévoué, bienveillant, plein d’indulgence, moins grand que moi, plus fort…
— Que voulez-vous dire ? interroge Ozilie.
— Rien, si ce n’est que je vais, maintenant, rejoindre à l’hôtel où il m’attend, mon ami Jacques…
— Son nom ne m’intéresse pas… intervient encore Ozilie.
— Wisel.
— Comment ! Il est à Genève ! Et pour quoi faire ?
— Je l’ignore, Votre Noblesse.
Je salue sans plus attendre, pas du tout mécontent de ma petite mise en scène. Je suis déjà loin quand je me retrouve dans le parc, à la recherche de la sortie. Un officier que je rencontre m’indique la bonne voie :
— Suivez l’avenue du roi Conrad… Puis à gauche.
Oui, mais qui m’expliquera l’intérêt persistant de Mlle Ozilie pour Jacques Wisel ? Je ne le sais pas, je crois le deviner…
A Genève, une bourrasque se prépare. Déjà la pluie glisse régulière, maîtresse des rues désertes.
Je fais arrêter ma voiture non devant l’hôtel où j’ai retenu ma chambre, mais quelques mètres plus loin, près d’un café. Personne sous la toile de la terrasse assombrie, si ce n’est, dans un coin, un homme en pardessus noir à qui un chapeau de paille enfoncé sur les yeux inflige un air de comique en détresse.
Et j’ai la surprise de reconnaître M. Floriant de Floriot.
— D’où venez-vous ? m’interroge-t-il comme s’il s’éveillait.
— D’une petite expédition.
— Vous n’avez rien découvert en dehors de l’orage ?
— Et vous, vous avez tout ce que vous désirez ?
— Tout, c’est beaucoup dire. Mais suffisamment.
Je me mets à l’abri sous la véranda. Toutefois, je ne m’assieds pas. Pourquoi diable M. Floriant est-il venu à Genève.
— J’ai d’abord demandé à voir le Prince. On m’a montré plusieurs huissiers, mais pas de Prince.
Je demande :
— Que vous ont raconté les huissiers ?
— Que la monnaie française n’est pas aussi dépréciée qu’on veut bien le colporter, à la condition d’en donner beaucoup à la fois comme pourboire.
— Vous n’avez pas d’autres précisions ?
— Si, répond M. Floriant. Des gens très courtois nous renseignent. Nous savons ainsi tout ce qui se passe à la Cour, et aussi là-bas, dans le petit pays en révolution.
— Comment ça ?
J’insiste, l’air indifférent si possible, troublé quand même par l’ironique tranquillité de M. Floriant.
— Nous avons en ville un bureau officiel et politique qui nous remet des notes, des télégrammes et tous les commentaires désirables.
— Vous me rassurez ! Et vous télégraphiez ces communiqués qui affirment que le Prince combat à la tête de ses partisans et se fera tuer plutôt que de céder le territoire conquis.
— Le représentant du chancelier est très aimable, réplique M. Floriant, abandonnant le ton de la plaisanterie. Nous avons appris…
— Qui ça, vous ?
— Nous sommes trois en me comptant, le gros Georges et le vieux Paul…
— Que font-ils ?
— Ils jouent aux cartes. Nous avons donc appris en temps utile le départ clandestin du Prince, son arrivée dans son royaume, l’enthousiasme, etc… Quant à la cour qui était près de Genève, nous savons qu’elle a suivi Son Altesse. Vous le saviez aussi ?
— Oui, on me l’a dit également.
— Vous ne l’avez pas cru, continue M. Floriant. Alors, vous avez voulu vous rendre compte vous-même. Vous revenez maintenant… A quoi bon courir les chemins quand on trouve tout à sa portée ? Que savez-vous de plus que moi ?
— Peu de choses, en vérité. Si ce n’est que j’ai obtenu une entrevue avec le Prince.
— Avant son départ ? s’étonne M. Floriant.
— Non, ce matin.
— Vous plaisantez ! Le Prince n’est plus en Suisse depuis huit jours au moins.
— Demain soir, peut-être, le Prince aura quitté la Suisse. Mais aujourd’hui, il n’a pas bougé.
— Enfin ! conclut M. Floriant résigné et peu soucieux de contredire un camarade, si vous en êtes persuadé ! Rien ne ressemble plus à un Prince en exil qu’un dignitaire proscrit. D’autre part, je ne peux pas me démentir, même si votre nouvelle est vraie. Nous sommes plusieurs ici, envoyés de Paris et nous donnons tous les mêmes nouvelles puisées aux mêmes sources. Nous faisons donc la vérité. »
Je connais cette antienne : pas de frais, pas de zèle superflu, pas de démarches compromettantes, pas d’enquêtes dangereuses. Il n’y a qu’à attendre la version officielle. C’est plus commode et l’on ne court ni risques, ni désagréments. Correspondant de guerre, on allonge les communiqués que l’État-Major — quel qu’il soit, — vous fournit avec de pittoresques impressions plus ou moins personnelles, envoyé auprès d’un ministre tout puissant ou d’une Altesse déchue, on reproduit sans abuser des commentaires les contre-vérités qui sont si aimablement fournies…
— Jacques Wisel est inquiet, ajoute M. Floriant.
— Il me cherche ?
— Il est étonné de ne plus vous voir revenir…
— Je vais le rassurer.
M. Floriant qui s’accommode de la solitude n’essaie pas de me retenir.
Je rentre à l’hôtel. Des femmes dans des manteaux garnissent le hall. Elles regardent la pluie qui s’attarde aux vitres sans rideaux. Des hommes fument. Les plus gros parlent allemand. La plupart s’expriment en anglais. Rendez-vous cosmopolite.
Jacques Wisel est sorti. Je me retire dans ma chambre et je commence à écrire. Je compose deux longs télégrammes que je me propose d’envoyer à quelques minutes d’intervalle, le premier relatif à mon « entrevue avec le Prince », le second aux confidences de la « dame d’honneur ». Je termine ces rapports écrits, lorsque Wisel se fait annoncer :
— Qu’il entre !
Et sitôt que l’historien apparaît, je lui déclare sans autre préambule :
— Voulez-vous me rendre le service de relire pour moi ces feuillets ? Vous serez au courant. Je vous fournirai ensuite les renseignements que vous désirerez, c’est-à-dire tout ce que l’on ne peut pas confier au télégraphe…
— Vous n’allez pas télégraphier d’ici, de Genève ? J’ai une voiture découverte. En moins d’une heure nous aurons franchi la frontière. A Bellegarde, vous n’avez à redouter ni le change ni la censure.
— C’est aussi mon avis. Vous m’accompagnez ?
— Avec plaisir. J’en ai assez de distribuer du pain aux mouettes du lac et de contempler les avenues et ces hôtels pour étrangers. Mais cette « Grande Marche » où est-ce ?
— Ce n’est qu’un nom que les partisans du Prince ont donné à la propriété de cet aimable exilé.
— Vous avez retrouvé Mlle Ozilie ?
Je songe, pour moi seul !
« Il ne l’a pas encore oubliée ».
— Sans la chercher. Elle m’a d’ailleurs demandé de vos nouvelles.
— Que lui avez-vous répondu ?
— Que vous étiez à Genève.
Wisel ne dissimule point un geste de surprise et d’embarras.
— Que fait-elle ?
— Elle demeure actuellement dans un pavillon du Palais réservé aux dames, avec sa camérière Trophime Trophimova.
Je me souviens à ce moment que j’ai promis à Trophime de ne pas révéler ce qui unit Ozilie à Isabelle. Je termine aussitôt pour ne plus toucher à ce sujet :
— Je vous avouerai que c’était surtout le Prince qui m’intriguait.
Dans l’automobile, la conversation s’attarde sur les télégrammes que j’ai écrits. Jacques Wisel les commente :
— Intéressante votre rencontre, la nuit, avec cette Majesté que l’on croit, que Floriant de Floriot et quelques autres croient dans son petit royaume en révolution. Mais les confidences de la dame d’honneur, c’est Ozilie, n’est-ce pas ?
« Voilà où il voulait en arriver. »
J’explique à haute voix :
— Non. C’est un arrangement des papotages de Trophime.
— Mlle Ozilie, vous n’en parlez pas ?
— Pas du tout !
Mais pour moi, je me répète : « Décidément il y pense ! »
— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Mais afin de ne pas la compromettre. Elle a été d’ailleurs à mon égard très cordiale, très obligeante. Elle m’a permis de dîner avec Trophime.
— Trophime ?…
— Sa dame de compagnie. Car Ozilie, dame de compagnie a droit, à la cour, à une dame de compagnie. Ozilie m’a donné l’occasion de rencontrer le Prince. Ce matin encore, elle m’a offert du café pour mon déjeuner.
Il faut bien noter que ce n’est pas tout à fait ainsi que les événements se produisirent. Mais on n’est pas contraint de se perdre dans les détails.
— L’étrange petite personne, constate Wisel.
Nous baissons la tête pour parler et aussi parce que le vent dans cette voiture, nous attaque en plein visage.
— Qui est-ce, en réalité ?
J’ai l’air de parler tout haut, pour moi-même. Je reprends :
— Je n’avais pas le loisir de m’en soucier. Mais j’y songe. Par instants, je crois que j’aurais dû la placer dans mon récit. Elle y avait sa part. Elle y aurait apporté tout un appareil romanesque. Toutefois, j’étais obligé de la montrer un peu différente. Pour qu’on ne la reconnaisse pas trop et aussi pour ne pas l’affliger. Il fallait la présenter plus jolie, d’abord. Est-elle même jolie ? Vous le savez ? On ne peut pas l’affirmer. Elle n’est indifférente à personne, voilà la vérité… Notre chauffeur se jette dans les tournants comme s’il voulait se suicider.
Nous sommes renvoyés l’un sur l’autre, suivant les coudes de la route ? Je continue cependant :
— Si elle est sympathique à certains, à d’autres elle est tout à fait antipathique. Et c’est ce qui lui octroie ce caractère abrupt et difficile. Même quand on la connaît un peu mieux, on reste longtemps sans savoir si l’on deviendra son ami ou son ennemi. Cependant, un jour vient où il faut prendre position de gré ou de force.
— Vous n’avez pas eu le temps de l’étudier, mais vous l’analysez assez bien, remarque Wisel.
— Je l’ai vue tout de même à l’œuvre, avec moi, avec Trophime, avec le Prince.
Ce que je crois encore, mais garde pour moi seul, c’est que tout d’abord Ozilie m’a déplu. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons, sans doute, qui la rendent inoubliable à Jacques Wisel et à Pierre Caussanges. Les plus fortes passions ne sont pas inspirées aux hommes par les plus belles femmes ni par les plus triomphantes. Au contraire, il semble que les folies les mieux conduites ou les incartades les plus inattendues hors des routes tracées s’accomplissent souvent à cause de personnes que nos voisins et nos amis déclarent tout à fait sans danger. Ce qui permet au commun des spectateurs de s’embrouiller davantage dans les contremarches de ceux qu’ils observent et qu’ils jugent.
— Et les lettres du Prince ? demande Jacques Wisel.
— Nullement question.
— Et les délégués ?
— Histoire terminée. Voici un arrêt. La frontière. Nos papiers.
La voiture s’arrête quelques instants sur cette route où des courants d’air s’échangent près des poteaux indicateurs.
— De ces délégués, Ozilie en a parlé au Prince, dit-il, lorsque l’automobile fut repartie. Le Prince a répondu : « C’est encore une maladresse de mon premier ministre ». Je ne sais rien de plus.
— Ne pourrais-je pas voir un peu cette cour et ce Palais ?
— On tâchera… Voyons. Mes deux télégrammes en partant cet après-midi, 19 octobre, arriveront à Paris ce soir. Ils paraîtront, le premier demain samedi 20, et le second, dimanche… Nous rentrerons ce soir, si vous voulez, à Genève, pour attendre les événements.
— Vous tenez à revoir le Prince ? demande Wisel.
— Non. Je dois acheter des cartes postales pour Trophime et j’espère bien rencontrer de nouveau Mlle Ozilie.
— Pour quoi faire ?
— Simple curiosité. Du moins, jusqu’à présent. Aucune arrière-pensée. Et puis, quelque chose m’avertit que Mlle Ozilie ne sera pas mécontente de vous retrouver.
— Que voulez-vous que je lui dise ?
— Rassurez-vous : elle sait parler.
Quelle magnifique diversité il y a parmi les hommes ! Et savez-vous une besogne plus attachante que d’étudier les conditions où se créent leurs variétés ?
Maurice Barrès.
Il y a des lieux tout à fait malsains.
Jacques Wisel et Lonlay-Labbaye, rentrés la veille au soir de Bellegarde, achevaient de déjeuner en compagnie de Floriant dans un restaurant cosmopolite de Genève où ne s’aventurent jamais les vrais Genevois, lorsqu’une femme dont le visage disparaissait sous un chapeau blanc s’approcha de leur table.
Lonlay le premier l’aperçut, mais ne témoigna pas de surprise.
— Que désirez-vous, Mademoiselle ? dit-il.
Trophime Trophimova, reconnaissant le « délégué », commença d’une voix rapide, mais sans éclat :
— Enfin, je vous découvre. Tout à l’heure, Mademoiselle va venir. Ici même, oui. Préparez-lui une place parmi vous comme à une amie que vous attendez. Car vous l’attendez, comprenez-vous. Il se passe de graves choses à la maison des fous costumés.
— Qu’y a-t-il donc ? interrogea Lonlay qui s’efforçait d’être calme et tenait à faire preuve de son sang-froid surtout en présence de Wisel et de Floriant.
— Le Prince et le premier ministre sont furieux. Le Prince surtout.
— Evgueny n’est pas content. Pourquoi ?
— Mais alors, le Prince est en Suisse ! s’étonna Floriant de Floriot.
— Il se réveille celui-là et c’est pour crier. Racontez-moi, Trophime.
— Non Monsieur, tous les indigènes du traktir nous regardent.
— C’est parce que vous êtes debout et votre chapeau blanc les rend malades d’admiration. Asseyez-vous !
— Non. Il faut que j’aille chercher Mademoiselle. Elle attend dans une voiture, tout près.
— Devant notre hôtel ? demanda Wisel.
— Non, Monsieur. A votre hôtel, il y a un garçon d’étage qui est dignitaire à la cour quand il a fini son travail en ville. Il vous connaît et nous aussi.
— Ceci m’explique bien des choses. Mais enfin, reprit Lonlay, pourquoi ces messieurs sont-ils mécontents ?
— On sait tout au Palais, répliqua Trophime. On sait ce que les journaux de Paris racontent sur le Prince qui ne veut pas régner et qui se cache en Suisse. On sait ce qu’il a dit à un envoyé spécial et ce qu’il pense des gens de son entourage. Mademoiselle vous racontera mieux.
Trophime s’en alla. Les trois hommes se regardèrent. Lonlay ne disait rien. Le retentissement que provoquait son article dépassait ses prévisions, ou plutôt l’engageait sur une piste qu’il n’avait relevée sur aucune carte des possibilités.
Jacques Wisel se mit à boire deux fois de suite. Ainsi trahissait-il son agitation. Toutefois, il se surveillait avec force. Dans quelques minutes, Mlle Ozilie allait apparaître. Et il s’étonnait, une fois de plus, de penser avec tant de violence à cette jeune fille. Mais la nouvelle qu’il apprenait, si elle déterminait chez lui un brusque bouleversement, ne lui enlevait rien de son apparence réfléchie : Mlle Ozilie ne discernerait que ce qu’il voudrait lui permettre de lire.
Quant à Floriant de Floriot, il ne dissimulait pas son inquiétude. Il répétait de diverses manières des remarques de ce genre :
— Le Prince était donc en Suisse et non dans son pays ! Il y a deux jours que je télégraphie le contraire. Qu’est-ce qu’on nous fait raconter !
— Voilà bien les dépêches officielles…
— Je ne savais pas !…
— Vous ne m’avez pas cru, répliqua Lonlay. Et le premier jour, vous m’avez répondu : « A quoi bon courir les chemins quand on a tout à sa portée. » Souvenez-vous !
— Je ne suis pas le seul, conclut Floriant de Floriot qui cherchait à se rassurer. Alors, ça finit par imposer une vérité.
Une femme entra, puis une autre toute habillée de noir, dans un ample manteau de voyage. Elle paraissait grande et mince. Lonlay ni Wisel ne reconnurent Mlle Ozilie ; mais ils aperçurent Trophime. Les trois hommes sans hésiter, se levèrent…
Sitôt assise, Mlle Ozilie parla :
— Trophime vous a déjà conté l’essentiel. Je suis venue tout de même. Bonjour, Monsieur, dit-elle en tendant la main à Wisel.
Elle reprit :
— Quel grand sujet d’étonnement pour moi de vous rencontrer ici. Mais c’est surtout à Monsieur — elle désignait Lonlay — que je dois tout d’abord parler.
— Je ne vous présente pas votre voisin, M. Floriant de Floriot, intervint discrètement Lonlay. Vous êtes censée le connaître comme vous nous connaissez tous.
— Ne présentez pas, merci. Je connais désormais M. Floriant de Floriot.
Et elle examina d’un coup d’œil Floriant. Elle le jugeait fonctionnaire paisible, mal construit au surplus pour supporter sans défaillance les gaz asphyxiants des villes. Puis :
— Voici que tout à l’heure, donc, le Prince Evgueny — que Dieu conserve, n’est-ce pas ? — vient me voir, tout écumant et enragé, et me demande :
« — Vous êtes l’amie et la complice de ce garçon qui a écrit sur moi à Paris, des stupidités ?
« D’abord, je ne comprenais pas. Il y a tant de garçons capables d’écrire à Paris des stupidités. Je dis :
« — Quel garçon ?
« Je vous fais la grâce de ne pas sténographier ici toute notre conversation. Je devine à la fin que ce garçon c’était vous, Monsieur Lonlay, que le Prince voulait désigner.
« — Mais non, dis-je au Prince, ce garçon est un de vos délégués à Paris. Je le sais. Et c’est comme ça que je l’ai rencontré.
« — Un délégué ? Pas à moi ! interrompt le Prince. Enfin, voilà, ajoute-t-il. On a imprimé sur moi des choses folles. Pas du tout ce que je voulais. »
« Le Prince m’a montré votre article… »
— Comment ? Mon article ? s’étonna Lonlay, surpris sincèrement que son télégramme expédié la veille, paru le matin à Paris, fût déjà connu en Suisse.
— Oui, un article où l’on racontait que le Prince ne voulait pas régner, qu’il préférait vivre paisiblement en Suisse que de se faire tuer au milieu de ses partisans… Enfin, des commentaires très aimables, comme ça… »
Puissance de la voix humaine, sortilège intraduisible. Jacques Wisel écoutait et regardait. La sympathie affectueuse que l’on éprouve pour certaines cantatrices et comédiennes à la voix prenante… Et pour ces femmes qui chantent aux carrefours plébéiens…, Wisel la concevait tout d’un coup. Il n’entendait qu’assez mal ce que contait Ozilie, mais il était conquis par le charme de cet accent étranger et pittoresque.
— Il faut que vous sachiez, reprit Ozilie. Un typographe d’une imprimerie de Genève qui est dignitaire de la Cour.
— Lui aussi ! remarqua Lonlay.
— … a pu obtenir des épreuves d’un télégramme envoyé de France. Ce télégramme est le texte complet de l’article d’un journal parisien. Le typographe a remis au chancelier ces épreuves que demain tous les « canards » de la ville vont reproduire.
« J’ai compris, à partir de ce moment-là, que nous étions un peu suspectes à la Cour…
— Qui ? Vous ?
— Moi. Et encore Trophime qui m’a dit : « Je vais prévenir M. Lonlay. Ça l’intéressera. » Le Prince, de son côté, m’a déclaré :
« — Si ce n’est pas le garçon à qui vous avez donné un asile de nuit, c’est un autre. Et il m’a cité d’abord votre nom, votre adresse ici.
— Comment sait-il ?
— Par le garçon d’étage de votre hôtel.
— Qui est dignitaire à la Cour ?
— Précisément. Il m’a cité encore le nom de M. Wisel. Alors, j’ai voulu accompagner Trophime à Genève. Voilà comment nous sommes arrivées… Non, ne remerciez pas. Réfléchissez et agissez vite.
Elle les regardait et ne mangeait pas. Elle paraissait vraiment anxieuse. « Une femme, songeait Lonlay, ne peut être ainsi bouleversée que pour trois causes : on lui a pris son collier, son chien ou son amant. »
— Maintenant, continua Mlle Ozilie, je crois que c’est M. Wisel que l’on poursuit et que l’on veut arrêter.
— Pourquoi arrêter Wisel ? demanda Lonlay.
— Parce qu’il est responsable des stupidités — excusez-moi, Monsieur — qui sont imprimées à Paris.
— C’est toujours le garçon d’étage qui a fourni ces renseignements. Mais comment arrêter Wisel ? reprit Lonlay.
— Je ne sais pas. Mais ils pourront.
— Ils pourront !… répéta Lonlay en riant.
— Vous ne les connaissez pas du tout. Vous ne vous rendez pas compte de l’agitation furieuse qu’il y a au Palais. Et ce soir, quand on vendra dans les rues les journaux de Paris arrivés avec le train ! Et demain, 21 octobre, quand la suite paraîtra : « les confidences »… je ne sais plus…
— « D’une dame d’honneur », compléta Lonlay.
— Comment savez-vous ?
— Parce que je sais. Nous savons. Tout le monde est au courant.
— Oui. Vous venez de m’avouer : c’est vous l’auteur responsable. Eh bien, il vous faut fuir tout de suite.
— Ils ne m’arrêteront pas.
— Non. Mais il y a la vengeance, la punition comme ils disent. Un coup de pistolet dans la rue ; dans votre chambre, le poison ; dans l’escalier, la chute. Après, on déplore : « Comme c’est regrettable un accident ! ». Fuyez donc ! Auparavant, quelle dame d’honneur avez-vous interrogée ? Vous n’avez vu que Trophime. Mais ce n’est pas…
— Rassurez-vous : c’est une transposition adroite, mais vraie…
— Grand Dieu, qu’est-ce que cela signifie ? Enfin, si vous vous comprenez. Une autre chose comique… Le Prince m’a reproché d’avoir scandaleusement fait dormir sous ma toiture mon fiancé… Vous ne connaissez pas mon fiancé, d’après le Prince ?…
— Je ne vois pas, avoua Lonlay.
— Vous ne voyez pas ! C’est compréhensible. Mon fiancé, eh bien, c’est vous ! N’est-ce pas ! C’est vaudevillesque.
Lonlay ne souriait qu’à demi. Wisel s’amusait. Floriant ouvrait de grands yeux. Mlle Ozilie n’insista pas. Elle reprit :
— M. Wisel n’est pas le responsable. Cependant, il doit partir, car ces Messieurs ne savent pas et ils pourraient faire une prodigieuse erreur irréparable. Donc, fuyez, Monsieur Wisel.
Lonlay ne laissa pas à Jacques Wisel le temps de répondre. Déjà il s’adressait à Floriot.
— Vous qui connaissez ces Messieurs du bureau politique vous devriez aller jusque chez eux. Ils vous donneraient un de leurs petits communiqués habituels. Ce sera, cette fois-ci, un démenti aux journaux de Paris.
— A un journal de Paris, rectifia Ozilie.
— Ce démenti, nous l’enverrons à nos journaux en spécifiant l’origine. Quant à vous, Wisel, vous devriez partir comme on vous le conseille.
— Mais Mademoiselle, que va-t-elle devenir ? demanda celui que tout le monde renvoyait ainsi aux frontières.
— Nous ne sommes encore ni au secret, ni arrêtés, expliqua Ozilie. Mais où aller ? Je suis sûre qu’il y a des barrages près des douanes. Le mieux, pour nous, est de rentrer paisiblement à la « Grande Marche ». A l’heure présente, on nous croit évaporées, n’est-ce pas ? Donc coupables. Nous rentrons, Trophime et moi, avec des provisions, des marchandises que nous aurons prises à Genève. Nous avons l’air bien sages. Donc, nous ne sommes pas coupables. C’est encore à la « Grande Marche » que nous serons le plus en sûreté.
— Je vais au bureau politique, annonça Floriot.
— Et moi, commander pour une nouvelle promenade notre voiture d’hier, ajouta Lonlay.
Les deux hommes se levèrent laissant Ozilie, Wisel et Trophime ensemble. Trophime ne perdait pas son temps. Elle avait cueilli dans chacun des plats qui garnissaient la table : l’omelette de Floriant, le gigot de Lonlay, les petits pois de Wisel, les hors-d’œuvre de quoi emplir son assiette. Elle mangeait avec méthode.
— Je vois que les voyages vont recommencer, conclut-elle.
Mais Ozilie ni Jacques Wisel ne l’écoutaient. Ils parlaient…
— Comment vous remercier ?
Ce furent les premiers mots de Jacques Wisel.
— De quoi ? demanda Ozilie.
— De ce que vous avez fait pour nous, pour moi…
— Ne me remerciez pas.
La sécheresse d’Ozilie était visible. Sécheresse ou prudence sur le qui-vive ? Cette attitude reparaissait ainsi chaque fois que la jeune fille se trouvait devant un inconnu. « A qui en veut-il, celui-là ? » semblait-elle dire. Et elle ne reprenait quelque assurance qu’en se montrant agressive.
— Qui sait ? rectifia-t-elle. Peut-être mes craintes sont-elles mal bâties.
— Enfin, elles m’ont valu cette chance inespérée : vous revoir.
— Mais rien de plus naturel, répliqua Ozilie. N’êtes-vous pas, vous aussi, délégué de Son Altesse ? Donc idoine à revenir par ici. Et par conséquent à me rencontrer.
— C’est exact, concéda Wisel en souriant.
— Pourquoi souriez-vous ? A cause de mes erreurs de français ?
— Ne croyez pas…
— Alors, que dois-je croire ?
— C’est parce que vous paraissez trouver toute simple une rencontre aussi inattendue que celle-ci.
— Cependant, je devais revenir à Genève et vous aussi.
— Moi, passe encore. Mais vous ? demanda Wisel.
— Et les lettres du Prince, celles qu’il exigeait et que je voulais lui remettre moi-même. Oubliez-vous ?
— Je n’ai pas oublié. Et à présent, ces lettres ?
— L’affaire des lettres est terminée. Gina — vous vous souvenez — à qui j’écrivais aussi quelquefois est invisible. Si la fille du chancelier ne cherche pas à me voir, moi non plus. Mais je retournerai à la Grande Marche, par point d’honneur. Pour crâner, comme vous dites…
— Mais je ne dis rien !
— … dans votre langue française.
— Vous n’avez pas peur de retourner à la Grande Marche.
— Pourquoi peur ? Puisque c’est une question d’honneur. Mais je n’y resterai pas… Où j’irai ? Vous avez donc bien envie de le savoir ? J’irai sans doute, à Wien, en Autriche, puis en Italie.
— Pourquoi ne viendriez-vous pas à Paris ?
— D’abord parce que mes passeports ne sont pas prêts pour France. Deuxième raison. Parce que, et vous n’y songez plus je constate, je suis une institutrice modiste… non, modeste et que je dois gagner mon pain quotidien où l’on m’envoie. Seigneur ! et ce M. Lonlay qui ne revient pas avec sa grosse voiture !
— Lonlay est allé quérir une voiture ?
— Oui. Pour vous emmener…
— Pour m’emmener ?… Vous êtes pressée de me voir partir ?
Ozilie répliqua sans avoir l’air d’y entendre malice :
— Très pressée. Votre existence est en danger.
— Que peuvent-ils contre moi ?
— Beaucoup de choses et vous rien du tout contre eux. Vous, ils vous connaissent. Vous, vous n’en connaissez aucun ? Pourriez-vous seulement dessiner la tête du garçon de l’étage qui vous surveillait ?
Wisel ne fit pas d’objection. Il s’inclina même :
— Penser que je vous retrouve aujourd’hui et c’est pour vous perdre tout de suite. Je n’ai jamais oublié le jour où nous nous sommes rencontrés.
Trophime, sans se soucier de cette conversation, avait commandé du thé et des liqueurs. Son repas était terminé. Elle jugea opportun de s’informer auprès de Wisel :
— Vous préférez du café, peut-être ? Bon ! Du café aussi.
— Quel jour était-ce donc ? s’étonna Ozilie répondant à Wisel.
— C’était le 12 octobre.
— Il y a huit jours.
— Que d’événements en huit jours. Si vous saviez comme j’ai été heureux de vous apercevoir tout à l’heure.
— Parlez plus bas, vous allez déranger la méditation de Trophime.
— Vous vous moquez de moi ?
— Un peu, sans doute. Pourquoi vous croyez-vous obligé, Monsieur Wisel, de me débiter des politesses françaises ? Parce que nous sommes tous les deux, parce que c’est la seconde fois que nous nous rencontrons, parce que Trophime ne vous écoute pas…
— J’entends très bien, interrompit Trophime. Mais ça ne m’intéresse pas.
— Ce ne sont pas des politesses, croyez-moi… Je m’exprime si mal.
— Alors, ne parlez plus. Sinon, dans vingt-cinq secondes, vous allez me jurer que vous m’aimez, que vous n’aimez que moi. Ne protestez pas. Si vous saviez ce que j’entends par amour. Je suis très intolérante, vous savez. Je retiens tout. Pas d’accommodages. Les hommes se contentent du relatif. Ils sont plus sages, dit-on. Eh bien, je ne suis pas sage, voilà. En vérité, c’est parce qu’ils y trouvent avantage.
« Et j’en ai tant vu qui s’amusaient autour de moi, avec ce sentiment-là. Je vous en prie, Monsieur Wisel, demeurez comme je vous ai imaginé. Ne vous croyez pas condamné à des galanteries parisiennes. »
— Vous vous trompez, Mademoiselle. Mais je constate que vous avez sur les Français des idées toutes faites…
— Non. Pas uniquement sur les Français, Monsieur Wisel. Ah ! voici Monsieur Lonlay !… Non, ce n’est pas lui…
Cette froideur calculée et irascible que cachait-elle ? Wisel s’en serait aperçu si lui-même n’avait été interdit par les vives ripostes d’Ozilie. Cependant, la jeune fille récupéra cette maîtrise de soi qui lui était chère et, pour atténuer l’accent de ses paroles, elle avoua :
— Oui, je vous taquine. Mais je conçois que vous êtes content parce que je suis venue à Genève, ainsi, pour l’avertissage.
— … ment… rectifia Wisel, presque malgré lui.
— Vous dites ?… ment ?… Ah ! oui, c’est vrai : l’avertissagement.
— Non : l’avertissement.
— Ah ! je suis heureuse ! s’écria Ozilie. Vous vous souvenez que nous devions nous promener ensemble pour des leçons à donner et à recevoir. Vous m’auriez rectifié. J’en ai un pressant besoin. J’aurais été votre petite disciple. Expliquez-moi encore. Doit-on prononcer : révolte ou « révoltage » ? « Émotionner », est-ce que cela est convenable ? Ce matin, Trophime m’assurait qu’il n’y avait pas de raison pour qu’on ne dise pas : « émotionnement », puis « émotionnementer quelqu’un ». De même « réceptionnement », puis « réceptionnementer ». Ainsi de suite parce que la langue française suit le progrès de l’évolution.
« Mais il y a un langage international. Vous ne le nierez pas. Aussi, cela m’irrite en France, quand vous écrivez : Guillaume. Qui ça, Guillaume ? Il n’y a que Guillaume Apollinaire. C’est pour faire entendre le Kaiser allemand, quand c’est Wilhelm pour tout le monde. Vous dites cependant : Wilhelmine. Pourquoi pas « Guillaumette » ? Et encore Londres quand il y a London ; Gênes pour Genova, Florence quand il faut Firenze…
— Doit-on prononcer Paris ou Parisse ? demanda ingénument Wisel. Car il n’y a que les Français — si peu de chose en somme — qui disent : Paris.
Elle sourit, mais ne répondit pas. Elle regardait Jacques Wisel qui semblait ne voir que la porte d’entrée du restaurant. Trophime n’était plus à leur table. Où pouvait-elle bien se tenir ? Il la cherchait des yeux dans la salle presque vide, maintenant. Enfin, il l’aperçut assise à la terrasse. « Le modèle des dames de compagnie cette Trophime », pensa-t-il.
Mais d’où venait-elle ? Russe ? Polonaise ? Roumaine ? Et Ozilie ? Il ne savait d’elle rien de précis si ce n’est l’histoire qu’elle lui avait confiée huit jours plus tôt. Toutefois, il ne cessait de songer à cette jeune fille. Jeune fille ou jeune femme ? Cela aussi, il l’ignorait.
Jacques Wisel parvenait à cet âge où un homme se retourne sur les ombres qu’il a laissées et se demande : « Comment ai-je vécu ? A quoi bon tout cela ? »
Comme il ne se sentait pas d’ambition précise, peut-être par faiblesse de moyens, il se trouvait du même coup sans désirs avec une lassitude souvent plus vieille que son corps. Une mauvaise expérience féminine montait la garde à l’origine de ses déceptions et de sa méfiance. Sentinelle qui ne prend jamais de repos et avec laquelle il faut toujours ruser. Sur ce point, Ozilie lui ressemblait. Toutefois, comme l’avait observé Lonlay, elle se montrait hostile parce qu’elle ne lisait qu’intérêt et basses passions sur les visages qui l’approchaient, tandis que Jacques Wisel opposait par tactique, et d’une façon générale, à toute avance indiscrète ou trop vive une politesse anachronique ou la plus volontaire indifférence…
— Que se passe-t-il donc ? Ce M. Lonlay ne revient pas…
— Voulez-vous que nous allions aux nouvelles ? proposa Wisel.
— Non. Je vous compromettrais. Je vais plutôt envoyer Trophime ? Elle trouvera bien le moyen d’atterrir jusqu’à ce Monsieur.
— Vous en êtes sûre ? interrogea Wisel.
— Tout à fait, affirma Ozilie. Elle ne s’intéresse pas à notre existence quotidienne. Elle en vit une autre. Elle aime ses aises, sa tranquillité, les repas abondants, les lits bas et encombrés de coussins, les voyages, (mais non les départs), tout ce qui la change, l’amuse ou la bouscule. Je la connais depuis si longtemps. Sa mère était déjà au service de ma mère…
Toutefois, Ozilie songeait : « Pourquoi suis-je aimantée, malgré moi, vers ce Français correct que je ne connais pas ? Analyse-t-on jamais ces choses-là ? Si j’avais su que Lonlay était responsable de l’article parisien et non Wisel que l’on a dénoncé par erreur, serais-je venue jusqu’ici prévenir ces Messieurs ? Peut-être… Pour faire échec au chancelier. Mais je le pense parce que c’est fait, parce que je me suis déplacée et que le plus grave est accompli.
« Un indiscutable avertissement intérieur me permet de croire que le vrai danger, pour moi, c’est maintenant, et non lorsque, pensionnaire romanesque, je m’évadais de la Cour pour ne plus subir la présence d’Evgueny. C’est aujourd’hui que je devrais fuir pour demeurer libre. Mais je veux et je n’ose plus vouloir… Le prince Evgueny doit être ainsi quand il est contraint de prendre une décision. Pourtant, je n’ai rien du caractère d’Evgueny… »
Et pour disperser ses secrètes réflexions, Ozilie continua, mais tout haut :
— Je vais être obligée de m’éloigner. Quelques visites encore. Promettez-moi donc que vous partirez cette nuit.
Cette prière rendit perplexe Jacques Wisel. Il ne comprit pas tout de suite que la jeune fille et lui-même avaient séparément, accompli un même travail de réflexions intérieures.
— Vous me le demandez, je le ferai, dit-il. Je vous remercie.
— Encore ? interrompit Ozilie.
Il hésita. Les solitaires, comme Wisel, éprouvent toujours quelque peine pour mettre en route eux-mêmes une conversation ou la faire repartir.
— J’y tiens, reprit-il. Vous vous êtes dérangée pour m’avertir ?
Aussitôt, Ozilie sur la défensive, se montra irritable :
— Pas du tout ! Je ne connaissais que M. Lonlay. Je n’ai pas réfléchi davantage. J’ai pensé — l’ai-je même pensé ?… Enfin, j’ai fait ce rapprochement : Lonlay ? Wisel ?… C’est peut-être la même personne… Wisel est-ce une signature, un pseudonyme ?…
Jacques Wisel ne répondit pas. Justement quand il s’était décidé à parler une nouvelle fois de sa gratitude il songeait : « Puisque cette jeune fille a si rapidement quitté la Grande Marche pour me conseiller de rentrer en France, c’est bien la preuve que j’occupe quelque place de choix dans sa pensée. »
Ozilie devinait-elle la courbe particulière des remarques secrètes de Wisel ? Elle poursuivit avec un visible souci de se montrer désagréable :
— Vous avez bénéficié d’une confusion de noms qui s’est produite en mon esprit. D’ailleurs, Trophime et moi, nous voulions sortir, nous voulions montrer à ces messieurs de la Grande Marche que nous n’avions pas peur, bien que suspectes. Nous restions indépendantes. Nous avions envie de trotter un peu dans Genève.
— Vous êtes sûre que personne ne vous a suivies.
— Je ne crois pas. Tant pis ! Trophime surveillait.
Un moment, une gêne à cause du silence. Enfin, Wisel demanda :
— Vous dites tantôt Trophime, tantôt Trophimova.
— Je dis toujours « Trophime ». Je dis rarement « Trophime fille de Trophime ». Mais je ne dis jamais : « Trophimova » tout court.
« Enfin, cette fois, voici Lonlay !
— Mon vieux, dit le journaliste en entrant, préparez-vous, n’hésitez plus.
— Mes bagages ?
— Je les prendrai quand je m’en irai, dans quelques jours. D’ici une demi-heure, vous serez en sûreté. Vous me télégraphierez aussitôt.
— Au revoir, Mademoiselle, commença Wisel.
— Pas d’adieux, interrompit Lonlay. Votre départ doit passer inaperçu. Vous trouverez une combinaison dans l’auto. Vous la prendrez. Voici mon passeport. Il est au point. Donnez-moi le vôtre.
— Quand vous reverrai-je maintenant ?
Wisel s’adressait aussi bien à Lonlay qu’à Mlle Ozilie.
— Écrivez-moi. Si vous avez quelque chose pour Mademoiselle, envoyez-le-moi, je ferai suivre.
— C’est cela, intervint Ozilie. Sans adieux donc, Monsieur, puisque c’est l’ordre. Je garde une belle image de vous.
— J’avais tant de choses ! tant de choses à vous dire ! murmura Wisel.
— Eh bien, vous me les écrirez ! répliqua-t-elle d’un air enjoué.
Ozilie serra vivement la main de Wisel. Elle le regardait franchement. Elle avait perdu sa figure irritée. Elle souriait, les yeux brillants, trop brillants, peut-être par ce que des larmes y montaient.
A ce moment, Floriot arrivait, l’air important :
— Ils sont furieux, au bureau politique. Ils jurent dans un jargon épouvantable. Ils nous ont affirmé que tout ce que disait ce journal de Paris était faux.
— Alors, pourquoi sont-ils furieux ? observa Lonlay.
— Vous êtes encore là ! s’étonna Floriot en apercevant Wisel.
— Je pars.
— Un cigare ? demanda Lonlay.
— Non, merci, répondit Wisel qui accepta quand même le cigare qu’on lui offrait.
Les deux hommes se servirent de la même allumette. Wisel fumait distraitement. Lonlay qui conservait toujours sa présence d’esprit, décida :
— Vous avez entendu ce que vient de raconter Floriot ?… Quand vous serez à Bellegarde, voulez-vous, mon cher Wisel, télégraphier pour moi, en quelques mots, à mon journal, ce que vous en aurez retenu. Merci d’avance. Je vais vous remettre ma carte télégraphique. Vous la laisserez à mon nom, sous enveloppe à la poste restante de ce pays.
Tous, ils étaient maintenant devant la porte du restaurant. Une automobile découverte tourna en ronflant. Lonlay s’approcha.
— Montez, dit-il à Wisel. Et pas un mot d’adieu.
— Vous avez raison, approuva Ozilie.
La voiture partit aussitôt. Wisel, debout, salua. Il se trouvait sans équilibre… Avoir revu Ozilie et la perdre aussitôt. Quelque chose lui barrait la gorge ; une sorte de mal de mer le gagnait : une bouffée mal aspirée de ce cigare sans doute…
— Enfin ! conclut Lonlay.
Il se retourna et aperçut Ozilie qui, en dépit des consignes, secouait son mouchoir pour une silhouette de Wisel de plus en plus fragile. Lonlay ne se permit aucune remarque. « Les femmes sont partout les mêmes, se dit-il, mobiles et contradictoires. Trois secondes plus tôt elle me félicitait quand j’interdisais toute manifestation de la dernière heure. » Il attendit même patiemment. Il regardait Ozilie avec une curiosité amusée : « Wisel et elle sont beaucoup plus intimes que je ne l’imaginais. »
— Vous rentrez à la Grande Marche ? demanda-t-il à Ozilie.
— Un tour dans Genève. Puis Trophime et moi, nous retournons à la Cour.
— Vous viendrez déjeuner avec nous, demain ? reprit Lonlay.
— Non, vous êtes trop compromettants, répliqua Ozilie.
— Nous serons dans une salle réservée.
— Ça ne fait rien.
— Puisque le « coupable-responsable » est déjà loin ! Et moi, je ne suis qu’un « délégué ». Vous avez bien le droit de m’avoir vu et de me reconnaître.
— Je ferai mon possible, déclara Ozilie.
— Il vaudrait mieux ne rien promettre, observa Trophime.
— Viens avec moi, conclut Ozilie ; nous laissons ces Messieurs.
Lorsqu’Ozilie et Trophime furent parties, Lonlay constata pour Floriot :
— C’est une brave petite fille…
Toutefois, il songeait :
« Curieux, et je l’ai déjà remarqué : il y a des moments où Ozilie use d’un français sans accent et d’autres où elle emploie un mot pour un autre. Suis-je stupide ! s’écria Lonlay. Elle s’exprime correctement quand elle oublie qu’elle est Ozilie de Wicheslaw, parce qu’elle parle comme Isabelle Chenoncay. »
Ce ne fut pas Ozilie qui vint au rendez-vous de Lonlay, ce dimanche 21 octobre. Mais Trophime qui apparut.
Lonlay qui déjeunait avec Floriot n’en conçut aucune surprise. « Ozilie, bien que française autant que Mlle Isabelle Chenoncay peut l’être, a fini, sans doute, par acquérir des habitudes orientales ». Cette remarque, il la conservait pour lui. Toutefois, lorsqu’il distingua le visage troublé de Trophime, il se leva plus vite qu’il ne l’aurait voulu, devant les regards méfiants des garçons.
— Qu’est-il arrivé ?
— J’ai pu sortir parce que je suis libre encore ; répondit doucement Trophime. Mademoiselle ne peut plus. On a tout renversé dans sa chambre. Elle est au secret. On la croit complice. Je crains beaucoup, car elle leur tiendra tête…
— Que risque-t-elle ?
— La prison, longtemps. Quand on est dans leurs prisons, on n’en sort jamais.
— Charmant pays ! On la soupçonne d’avoir favorisé la fuite de Wisel, n’est-ce pas ?
— Oui. Et encore d’être la complice de celui qui a interrogé le Prince… Écoutez-moi. Je suis venue. Il faut nous aider. Il faut la sauver.
— Il n’y a qu’une solution, résuma Lonlay. Il faut la faire évader. Mais comment ?
Lonlay réfléchissait. « Par quels moyens réussir cette évasion dont je télégraphierai un peu plus tard les détails à Paris, sans donner le nom d’Ozilie, bien entendu ? »
— Venez déjeuner avec nous ?
— Je n’ai pas faim, vous savez, assura Trophime.
— Faites semblant. On nous regarde. Vous connaissez Floriot ?
Trophime fit un signe de tête pour saluer Floriot qui s’était levé ; il avait compris que quelque chose de grave se produisait.
— Dites-moi, reprit Lonlay… Y a-t-il beaucoup de jeunes femmes à la Grande Marche ?
— Pas beaucoup. Il y a la femme du Premier… du premier ministre, celle du premier écuyer, celle du gouverneur militaire, celle…
— Quel âge ont-elles ces jeunes femmes ?
— De trente-huit à cinquante ans.
— Très bien. Et des jeunes filles, combien en comptez-vous ?
— La fille du premier écuyer qui a dix ans et Mlle Gina qui a vingt-six ans.
— Vingt-six ans… C’est l’âge d’Ozilie ?… Faites-moi le portrait de Gina : démarche, corpulence, taille…
— Vous ne l’avez jamais vue ? s’étonna Trophime.
— Je ne m’en souviens pas. Allez… Je vous écoute.
Lonlay avait retrouvé ce ton impératif qui lui était habituel, si déplaisant pour ceux qui ne le connaissaient pas ou le connaissaient mal.
— Gina ne ressemble pas à Mademoiselle. Gina est petite. On dirait une enfant de douze ans. Elle est voûtée comme une vieille femme. Enfin, elle boite.
— De quel pied ?
— De quel pied ? attendez que je me rappelle.
Trophime se leva, pencha la tête sur son épaule droite et rentrant ses épaules, se mit à traîner la jambe, imitant le balancement d’un canard.
— Je croyais que c’était du pied droit, dit-elle en s’asseyant de nouveau. Mais elle boite des deux pieds.
— Comment s’habille-t-elle ?
— En noir, presque toujours.
— Et la nuit, en cette saison ?
— Elle porte un grand manteau noir, une cape…
— Ozilie a-t-elle une cape semblable ?
— Je vois où vous voulez arriver ! prévint Trophime, radieuse soudain et qui se mit à manger ce qu’on lui avait servi.
« Moi, j’ai une cape comme ça… »
— A quelle heure la dernière ronde ? poursuivit Lonlay.
— Il y a des rondes toutes les trois heures. Mais à onze heures, on s’arrête jusqu’au matin. Les autres rondes, celle de deux heures, puis celle de cinq heures sont inscrites sur un rapport quand on se lève…
— En cas d’alerte à la Grande Marche, que fait-on ?
— On tire la cloche devant le Palais. Mais vous ne saviez pas tout cela ?
— Vous m’aidez à m’en souvenir. On tire sur une corde ? insista Lonlay.
— Pas du tout, voyons. On appuie sur un bouton électrique, au corps de garde.
— Vous connaissez cette sonnerie ?
— Bien entendu.
— Combien d’autos au Palais ? Où sont-elles ?
— Une seule auto. Dans un garage, au Palais.
— Les sentinelles ?
— On compte sur deux chiens : Rocamadour, près de la porte aux grilles et Taurus. Mais ils sont attachés.
— Rocamadour n’était pas attaché quand j’étais là-bas, l’autre nuit…
— Cela m’étonne… Vous vous trompez. Rocamadour n’est pas attaché, il est devant la grille, devant l’allée, mais il y reste. C’est un poste. Donc, c’est comme s’il était attaché.
— J’admets ce raisonnement. Floriot, voulez-vous verser à boire à Mademoiselle.
Trophime tendait en effet son verre.
— Pas d’hommes en sentinelle ?
— On y a renoncé ; ils s’endormaient, puis ils s’enrhumaient. Après, ils étaient malades.
— Voulez-vous me tracer le plan de la propriété, avec la maison, les jardins, le parc…?
Trophime que cet interrogatoire amusait dessina aussitôt un plan schématique ; mais les commentaires qu’elle ajouta valaient mieux que son croquis. La propriété de la Grande Marche était sise entre deux routes, l’une parallèle au lac, l’autre qui desservait des villas et des maisons particulières. Le « Palais » se trouvait, par rapport à la route du lac, celle que Lonlay avait prise, le soir où il s’était arrêté devant la porte grillée, sur une petite éminence parmi des arbres. Lonlay comprit pourquoi il n’avait pu, du chemin, apercevoir la maison de plain-pied, de l’autre côté, avec l’allée qui conduit à la porte massive, celle où avait été érigé le poste de garde.
Devant le « Palais », une pièce d’eau, « la mer intérieure ». A droite et à gauche du « Palais », des arbres, des broussailles. Autour de la « mer intérieure », des allées qui étaient devenues : « Perspective du Prince Cyrille », « boulevard du Sobranié », « Avenue du Prince Evgueny »…
Après la « mer », plus loin, le verger qui était clos, puis des jardins, puis le parc. Comme clôture, des murs jusqu’au commencement du parc. Ensuite, de hautes futaies qui dissimulaient une palissade ou des piquets reliés par des fils de fer.
En face de la pièce d’eau, mais assez éloigné, un baraquement, où l’on avait logé Ozilie et Trophime.
— C’est très bien, affirma Lonlay lorsque Trophime eut terminé ses explications.
« Écoutez-moi, reprit-il. Vous allez retourner à la Grande Marche. C’est périlleux, mais je ne vois pas le moyen d’agir autrement. Sans éveiller l’attention, vous irez au corps de garde et vous mettrez hors de service la sonnerie qui commande la cloche d’alarme. Vous saurez ?
— Ça me connaît, affirma Trophime. Plus d’une fois, pour vivre en paix avec Mademoiselle, j’ai rendu inutilisables les sonneries électriques.
— Il faut tout connaître dans la vie, approuva Lonlay. Puis vous prendrez un revolver. C’est au cas où les chiens vous poursuivraient. Vous expliquerez à Mlle Ozilie votre plan, qui est le suivant : A neuf heures, Mlle Ozilie, vous annoncera qu’elle est malade. Elle se couchera. Cependant, elle restera sous ses couvertures, habillée de noir, chaussée, prête à partir. Vous placerez dans un coin votre cape noire qu’elle revêtira. Vous soignerez Mademoiselle, vous ferez semblant. Vous aussi, vous serez prête au départ.
« Vous irez chez la concierge, chez Mlle Gina, je ne sais où encore, demander du thé, de la menthe, du tilleul, ce que vous voudrez, pour Mademoiselle qui est couchée. Ce sera une occasion de répandre la maladie de Mlle Ozilie.
« Maintenant, la sentinelle. Il est probable qu’on en désignera une pour votre porte du pavillon. Vous connaissez la sentinelle ?
— On change chaque soir. Hier, nous en avions une que je n’ai pas vue. Ce n’était pas la même que celle d’avant.
— Il y a donc des sentinelles ?
— Pour nous, oui. Mais, je vous l’ai dit, elles dorment.
— Il faut prévoir le cas où elles ne dormiraient pas. Vous tâcherez d’entrer en conversation avec ce gardien. Vous ne lui cacherez pas que votre maîtresse… Mademoiselle, est malade, vous lui ferez même des confidences comme celle-ci : « Cela m’ennuie un peu, mais cette nuit, elle ne me dérangera pas ; je pourrai dormir tranquille, etc… » Et vous boirez devant lui des liqueurs fortes. Vous ferez le simulacre, tout au moins. Et vous trinquerez souvent, le plus souvent possible, avec la sentinelle…
— J’ai compris. Ça me va, interrompit Trophime. Si c’est le jardinier en second, il sera ivre avant une heure…
— N’allez pas trop vite en besogne. Vous préparerez avec des draps, des oreillers, des coussins deux mannequins qui devront représenter l’un Mlle Ozilie, le second vous-même. Ne cherchez pas la ressemblance. Ces mannequins, vous les cacherez jusqu’à onze heures. A onze heures dix, heure de votre montre, vous les étendrez dans vos lits respectifs. J’ai en ce moment une heure dix. Règlez-vous de même. A onze heures quinze, vous vous habillez, Mlle Ozilie se déguise en Gina, vous, en une des personnes du Palais, celle que vous préférerez.
— Comme la femme du chancelier qui porte un bonnet de fourrure et des bottes…
— C’est ça. Vous avez eu soin de souhaiter bonne nuit à votre gardien s’il ne dort pas déjà. Vous avez aussi fermé solidement toutes vos portes et fenêtres, sauf une fenêtre, celle qui s’ouvre sur le petit sentier, le long du mur de clôture, pour aller aux communs. A onze heures vingt, vous êtes prêtes toutes les deux à sauter par la fenêtre. Vous sautez. Vous refermez la fenêtre, quand vous êtes dehors, au moyen de ficelles que vous avez accrochées à l’intérieur et que vous tirez lorsque vous vous trouvez dans le sentier. Puis vous partez. Vous comprenez ?
— C’est lumineux, déclara Floriot.
— Ça me plaît beaucoup, assura Trophime.
— Vous marchez la première. Mlle Ozilie imite la boiterie de Gina. Vous vous dirigez sur ce point que j’indique par un x minuscule sur votre plan et qui est situé à dix mètres de la fin du parc, du côté de la route parallèle au lac. Vous vous éloignez donc, en quittant votre logis, de la pièce d’eau, passez derrière les jardins, vous arrivez dans les bois et le parc, en d’autres termes, vous traversez en angle presque droit la propriété. Quand vous serez parvenues au point x, il sera onze heures trente-cinq. J’y serai. C’est entendu ?
— Dites que nous y serons, rectifia Floriot.
— Vous voulez venir ? s’étonna Lonlay. Cela peut être dangereux.
— On verra bien.
— A votre aise, répondit Lonlay sans enthousiasme.
— Une seule remarque, observa Trophime. Il y a des fils de fer barbelés comme haies, au fond du parc. Nous ne pourrons pas passer.
— Je serai là, répéta Lonlay. Ayez confiance. Si l’on vous rencontre dans le parc, laissez-vous aborder. Racontez ce qui vous plaira pour permettre à Mademoiselle de fuir… soit jusqu’au point x, soit de retourner sans bruit à son pavillon.
« J’oubliais, vous annoncerez à Mademoiselle que Wisel est en sûreté. J’ai reçu un télégramme de lui ce matin.
— Il doit être content !… remarqua Floriot.
— Eh ! je ne sais pas…
— Il dit quelque chose pour Mademoiselle ? demanda Trophime.
— Sans doute. Ce qu’il a écrit est plein de significations. Lisez plutôt : « Colis pommes arrivé parfait état. Merci ».
L’automobile qui venait de Genève avait pris la route parallèle au lac, invisible du reste dans la nuit sans remède. Parfois les phares éclaboussaient de lumière des murs, des futaies, d’autres murs…
— Vous avez confiance dans votre conducteur ?
— Oui, dit Lonlay. C’est un garagiste italien qui s’est établi en Suisse. Nous l’arrêterons à cinquante mètres de la « Grande Marche ».
— Cinquante mètres avant d’arriver ? demanda Floriot.
— Non, cinquante mètres après la porte du « Palais ». Nous descendrons de voiture. L’Italien examinera sa machine comme si elle souffrait d’un malaise. Puis j’irai à la rencontre de nos fugitives.
— Je vous accompagnerai, reprit Floriot.
— Peut-être vaudrait-il mieux que vous restiez avec le conducteur…
L’automobile ralentit son allure devant les murs de la « Grande Marche ».
— C’est ici, dit Lonlay.
Aucune lumière. Derrière la porte grillée, aucun bruit.
— Continuez encore, souffla Lonlay. Ne vous arrêtez pas. Je vais sauter…
Il sauta en effet tandis que la voiture poursuivait son chemin. Lonlay écouta un moment. Puis, tournant le dos à l’automobile qui devait aller se garer un peu plus loin, il longea la Grande Marche, ses murailles, la haie d’arbustes qui fermait son parc. Il s’arrêta et attendit. Il se sentait très calme d’apparence. Cependant il n’était pas sans appréhension. Il regarda l’heure au cadran lumineux de sa montre.
— Elles ne sont pas encore arrivées… Onze heures trente-deux… Rien n’est perdu, toutefois.
Un chien aboyait de l’autre côté des murs. Un chat poussa un miaulement prolongé. Quelqu’un s’avançait sur la route. Lonlay revint sur ses pas. Il commençait à être inquiet. Il ne pouvait demeurer ainsi sur place. Une voiture, des passants risquaient de remarquer cet homme isolé, arrêté près des broussailles d’un jardin.
— C’est extraordinaire, se disait-il, les femmes sont toujours en retard.
Onze heures trente-cinq. Toujours rien. Pourquoi celui qui s’avançait un instant plus tôt ne bougeait-il plus ? Lonlay aperçut à quelques mètres devant lui, un long pardessus immobile. Et une voix demanda :
— C’est vous ?
— Vous n’êtes pas avec le conducteur ?
— J’étais inquiet. Je suis venu, répondit Floriot. Elles ne sont pas là ?
— Pas encore.
— Les femmes ne sont jamais en avance, décréta Floriot.
Les deux hommes se tenaient sur le bord de la route. Une même impatience les forçait à changer de place. Alors ils se rappelaient qu’ils n’entendraient rien ou qu’ils ne verraient pas grand’chose si les femmes survenaient. Outre l’anxiété de ne voir arriver aucune des fugitives, le risque qu’elles affrontaient les préoccupait. Tout d’un coup le froissement que produit parmi des branches et des feuilles le passage d’un chien… Ensemble, ils eurent cette pensée :
— Les voilà !
Des mains écartaient les arbustes de la haie. Un visage les regardait :
— Qui est-ce ? demanda Lonlay.
Et il s’aperçut que sa voix tremblait un peu. Comme on ne répondait pas, Lonlay s’avança :
— Qui est-ce ? reprit-il.
— C’est vous ?
Lonlay attendit.
— Écoutez-moi, je ne puis pas sortir.
— C’est bien elle, dit Lonlay qui s’approcha aussitôt.
— On va vous aider, ajouta-t-il.
— Non, je suis venue seule pour vous annoncer que Trophime n’a pu me suivre.
— Et pourquoi ? interrogea Lonlay. Elle est arrêtée ? En prison ?
— Non. Elle est très malade. Elle est couchée.
— Venez quand même, ordonna Lonlay.
— Je vous remercie. Mais c’est impossible. Si je l’abandonne ce soir, je ne la reverrai jamais.
Floriot et Lonlay restaient perplexes.
— Que vous a-t-elle raconté ?
— Elle m’a dit : « Fuyez. Ne m’attendez pas ». Et elle s’est couchée.
Lonlay traduisit sans hésiter :
— Oui, elle a trop bu avec le gardien.
— C’est un peu votre faute, répliqua Ozilie. Vous lui avez recommandé d’enivrer la sentinelle. Ce n’était pas utile. Le soldat boira toujours avec Trophime à qui il faut un compagnon pour porter des toasts.
— Elle a pris son rôle au sérieux, conclut Lonlay. Venez quand même. On la fera partir demain.
— Non. Ce n’est pas possible. Adieu, Messieurs. Tous mes remerciements.
Et Ozilie disparut.
— Qu’allons-nous faire ? murmura Floriot.
Lonlay ne découvrait pas de solution. Cependant il cherchait. Il avait tout prévu, sauf que Trophime lèverait trop souvent son verre avec la sentinelle. Comment organiser une nouvelle évasion ? Pénétrer dans le parc ? Cela ne lui servirait à rien. Prévenir la police suisse que deux femmes étaient prisonnières à la Grande Marche ? Ce moyen lui déplaisait. Et aboutirait-il à un résultat pratique ? Ozilie avait raison de ne pas laisser Trophime. Tant qu’elle serait là, Trophime ne serait pas maltraitée. Les deux femmes devaient fuir ensemble ou rester ensemble en captivité.
Soudain, il entendit qu’on l’appelait…
— Vous êtes toujours là ? Trophime est arrivée. Est-il temps encore ?
C’était Ozilie qui revenait. Lonlay aussitôt accourut, écarta résolument les branches de la haie. Une forme noire surgit à qui il tendit la main.
— Occupez-vous de Trophime. Elle me suit. Je ne sais comment elle a réussi.
Floriot et Lonlay attirèrent jusqu’à eux Trophime méconnaissable, sans bonnet de fourrure, les cheveux sur les yeux, la jupe maculée de terre humide.
— Elle s’est traînée à quatre pattes, constata Floriot.
— Non, rectifia Trophime. Je suis tombée plusieurs fois. La nuit est si noire.
Les deux hommes entraînèrent Trophime jusqu’à la voiture ; Ozilie les précédait.
— C’est loin ?
— Nous y sommes.
On plaça Trophime dans le fond, presque sur le tapis. L’automobile partit immédiatement.
— Où voulez-vous aller ? demanda Lonlay.
— Pas à Genève, assura Ozilie. Car c’est là que les recherches vont commencer tout de suite.
— Eh bien, répliqua Lonlay, déposez-nous, mon compagnon et moi aux portes de la ville, puis prenez la direction qu’il vous plaira. Le conducteur est à vos ordres.
— Je connais une maison où nous serons tranquilles, Trophime et moi. Nous y arriverons demain matin.
— Oui. Ne traversez pas la frontière tout de suite. Et après, où irez-vous ?
— Après ? Dès que nous aurons dépisté la police de Son Altesse, nous irons à Wien.
— Et à Paris ? quand ?
— Nous vous avertirons…
L’automobile était déjà loin de la Grande Marche. A présent, elle gagnait de vitesse… Il faisait froid. Le vent s’était levé et soufflait parfois, en tempête.
— Le temps va changer, annonça Floriot.
— Oui. Un orage. Dites-moi, reprit Lonlay s’adressant à Ozilie, vous n’avez pas eu peur ?
— Peur ? Peut-être. J’étais très émue. Nous avons suivi votre plan. La sentinelle, Trophime a voulu qu’elle ne se réveille pas. Trophime a bu beaucoup elle-même. Regardez, du reste, comme elle dort.
Quelque chose qui s’était effondré comme un sac mal fermé garnissait le fond de la voiture. Lonlay sourit. Ozilie continua :
— Je me suis égarée un peu dans les jardins. J’étais seule. Je ne voulais pas que vous m’attendiez toute la nuit. Après vous avoir dit « adieu », je suis revenue. J’ai eu une grande agitation, tout d’un coup : une bête rampait. C’était Trophime. Comment a-t-elle pu arriver jusque-là ? Alors, nous sommes allées jusqu’au rendez-vous. Je me disais : « Seront-ils là encore ? »
— Qu’auriez-vous fait si…?
— J’aurais caché Trophime quelque part et j’aurais marché jusqu’à une habitation…
— Que s’est-il passé au Palais ? demanda Lonlay dont la curiosité n’avait plus de limites.
— Des officiers ont été mis aux arrêts. Entre nous, dans la journée, ils se rendent quand même à leurs travaux en ville. Et la nuit, ils couchent dans leur lit. Mais enfin, ils sont aux arrêts, parce que soupçonnés…
— Ordre de qui ?
— Du chancelier… Quant à moi, le Prince m’a dit : « Je n’avais pas conté tout cela à ce petit journaliste ! Il m’a représenté d’une façon ridicule, comme un homme qui a peur de se battre et de gouverner. Il a beaucoup d’imagination, ce Monsieur ! »
— Pauvre Altesse ! murmurait Lonlay. Ce Prince avait donc imaginé que le journaliste dirait seulement : « Confidences d’un officier de service. » Et non « Confidences d’une Altesse. » Il n’avait oublié qu’une chose : se mettre à la place du journaliste et d’un journaliste qui étant renseigné pouvait avoir l’air de ne point l’être.
« Le Prince n’avait pas songé non plus que ce journaliste mettrait en cause non l’officier de service, mais le Prince lui-même et attribuerait à des velléités et à une impuissance d’administrer irrémédiable, les vœux d’une Majesté déguisée en lieutenant faisant une ronde…
Ozilie trouva une conclusion définitive :
— Vous ferez bien de vous méfier !
— Si nous racontons — sans vous nommer — votre évasion, quelque jour, s’informa Lonlay qui suivait son idée, est-ce que cela vous gênera beaucoup ?
— Amusez-vous tant qu’il vous plaira, affirma Ozilie en riant. Au contraire, ils seront furieux un peu plus et un peu plus ridicules. Je n’ai plus de pitié à présent.
« Qu’est-ce que cela promet ! » remarqua Lonlay pour lui-même.
A ce moment, on approchait des faubourgs d’une ville… Genève, sans doute. La voiture s’arrêta. Lonlay et Floriot descendirent. Ils étaient arrivés. Ozilie se leva elle aussi, pour les remercier et examiner l’automobile.
— Oh ! dit-elle, elle est de taille. Ce n’est pas un moteur à petit pouvoir.
— Nous allons vous laisser maintenant que vous êtes hors de danger. Mon ami et moi, nous gagnerons Genève à pied. La marche, exercice excellent…
— Oui, l’heure est venue, nous allons nous séparer, décréta Ozilie. Peut-être pour toujours. Puis-je vous poser une question ?
— Vous allez vous mettre en retard, répondit Lonlay mécontent, car il pressentait cette question.
— Non. Pourrais-je savoir comment vous avez eu connaissance des textes que vous me citiez à la Grande Marche ?
— Il y a tant de hasards dans le monde.
— Ces textes-là, il n’y a que deux personnes qui peuvent les connaître. Une jeune femme qui, selon moi, ne les a point reçus et moi-même.
— Admettez que cette jeune femme les a reçus quand même, répliqua Lonlay.
— Ce n’est pas une réponse.
— C’est pour vous faire entendre que ce secret ne m’appartient pas.
— Eh bien, cela me suffira. Je comprendrai.
— Oui, ne nous quittons pas ennemis.
— Vous avez raison, reprit Ozilie en s’efforçant à rire. Vous m’avez rendu un grand, un très grand service cette nuit…
— Je n’ai pas oublié le secours que vous m’avez accordé, la nuit où je me suis perdu dans le parc de la Grande Marche, répliqua Lonlay. Donnez-nous de vos nouvelles. Et n’oubliez pas que M. Jacques Wisel est en sûreté et qu’il se porte bien.
Ce nom ne fit aucune impression sur Ozilie. Du moins, Lonlay ne put rien discerner sur le visage de la jeune fille. Il est vrai, qu’en dépit des lumières dispersées sur la route, on y voyait assez mal.
Ozilie tendit les mains aux deux Français :
— Au revoir, dit-elle.
— Nos souvenirs respectueux à Mlle Trophime quand elle s’éveillera, intervint Floriot.
L’automobile repartait déjà. Lonlay et Floriot soulevèrent leurs chapeaux. Et ils entendirent Ozilie ordonner au conducteur :
— Le plus loin possible en ligne droite. Après, nous verrons.
— Vous allez télégraphier quelque chose sur cette promenade en auto ? demanda Floriant de Floriot.
« Promenade en auto », ainsi désignait-il l’évasion de Trophime et d’Ozilie. Lonlay s’amusait :
— Je ne vous cache pas qu’arrivé à Genève je vais raconter cette « promenade », en oubliant les noms véritables.
— Je ne vois pas ce que vous pourrez dire ! répartit Floriot d’une voix presque irritée.
— Alors, écoutez ce style télégraphique :
« Malgré les démentis qui sont mis à chaque instant en circulation par le bureau politique du Prince Evgueny, les événements se poursuivent à la petite cour en miniature de la Grande Marche, au « Petit Neu-Thorenberg » comme la nomment les initiés.
« En raison des représailles ordonnées par le Premier Ministre et approuvées par S. A. le Prince Evgueny qui n’a pas encore abandonné son refuge suisse, des officiers ont été mis aux arrêts, des dignitaires au secret… Et hier, dans la nuit, deux jeunes femmes que l’on allait arrêter, se sont enfuies du Palais. Voici dans quelles circonstances… »
« Une petite promenade en auto ».
Sous cette forme Floriot résumait ce que Lonlay appelait tantôt un « enlèvement prémédité », tantôt « l’évasion de deux personnages de la Grande Marche ». Cependant, Floriot et Lonlay avaient assisté à la fuite de Trophime et d’Ozilie, mais chacun en la résumant à sa manière dénonçait librement son caractère.
Lonlay-Labbaye avait le goût du romanesque et de l’imprévu. Il aimait à découvrir les causes secrètes des événements, il prenait plaisir à suivre des pistes. Les reportages difficiles étaient ceux qu’il préférait.
— Il n’y a pas de mystère, comme vous l’entendez, répliquait avec un entêtement agressif Floriant de Floriot. « Et tout l’inattendu, c’est ce que nos faibles têtes ne parviennent pas à prévoir. »
Aussi, lorsque Floriot se trouvait en présence de circonstances tragiques, il s’ingéniait à les réduire aux proportions d’un petit fait. Il condensait un drame ou une aventure dans une dépêche rigide ou bien il tâchait d’en dégager une moralité teintée de scepticisme, tel un conte de Voltaire.
Ainsi, Floriot se jetait du côté de la prudence, comme d’autres aux excès.
Dans les tribulations des habitants de la Grande Marche — à quoi il se trouvait un peu mêlé, grâce à Lonlay-Labbaye — il ne discernait ni un aspect historique ou tragique, ni même cet inquiétant humour d’espionnage et de farce particulier aux prouesses balkaniques. Floriot ne voulait en retenir qu’une « information » qu’il comprimait encore dans un télégramme neutre et sans accent.
Toutefois, lorsqu’il fut contraint, ce matin du 22 octobre — il faisait grand froid dehors et il pleuvait ! — de constater au bureau politique du prince Evgueny où il s’était rendu de bonne heure, l’affolement des employés et la colère des chefs, il comprit que « quelque chose était arrivé ». Et de retour à son quartier-général — le café près de son hôtel — il n’hésita pas à rédiger une dépêche où il relatait la stupeur que provoquaient dans ce petit réduit secret les nouvelles arrivées par fil de Paris.
Puis, du même coup, il conta, d’accord d’ailleurs avec Lonlay-Labbaye, la fuite de deux jeunes femmes de la maison du Prince. On les gardait au secret à la Grande Marche parce que, disait-on, elles avaient fourni des renseignements d’une gravité incalculable, à des journalistes de Paris. Comment étaient-elles parvenues à s’évader ? C’est ce qu’on ne savait pas encore. On avait cependant de bonnes raisons de croire…
Ce télégramme fut, on ne sait pour quelle cause — ou par quelle tractation — connu à la Grande Marche. Le signataire était clairement désigné. Aussi, ce soir-là, lorsque Floriot retourna au bureau politique, — la pluie avait cessé, heureusement — un garçon au teint de brique qui le recevait d’habitude, le pria très poliment, un peu trop aimablement — de vouloir bien pénétrer, pour une conversation particulière, dans une pièce ornée à l’orientale, où trois personnes l’attendaient. Derrière Floriot, la porte se referma.
— Nous vous laissons avec Son Excellence le premier ministre, annonça l’un des trois personnages que Floriot n’avait même pas remarqué.
Et tout aussitôt, il se trouva en présence d’un homme correct, aux yeux énergiques, au menton accusé. L’air d’un maître d’hôtel si les yeux, le menton, l’attitude aussi n’eussent révélé un autre homme et une autre profession.
« Bon ! pensa Floriot, une interview ! Il va falloir que je n’oublie rien ! Comme c’est désagréable ! Lonlay aurait été si heureux de cette chance qui m’arrive quand je ne la demandais pas. »
— Vous savez ce que c’est qu’un enlèvement, Monsieur ? commença le premier ministre.
Floriot s’inclina légèrement, mais jugea inutile de répondre, d’autant plus que le Premier répliquait pour lui :
— Sans doute, puisque vous avez su en télégraphier un, très réussi, à votre journal…
« Cela ne marche pas aussi bien que je l’avais prévu » se dit Floriot, un peu inquiet quand même. Il se souvenait du portrait qu’avait tracé Lonlay-Labbaye lorsqu’il lui avait dépeint le « Premier » : un homme qui aime le pouvoir, qui sait diriger les gens, gouverne le prince Evgueny et ne doit pas être dénué d’audace.
— Monsieur, commença le Premier, je vous ai fait mander non pour vous réprimander vivement, mais pour vous apporter quelques précisions qui intéresseront, j’en suis sûr, sinon vos lecteurs habituels affamés de fantastique, du moins vous-même que je suppose épris d’exactitude et que je m’obstine à croire, dans le fond, très consciencieux…
« Où veut-il en venir ? se demandait Floriot. Ce début, il l’a appris par cœur après l’avoir composé en puisant chez nos auteurs anciens et modernes ».
— Asseyez-vous, je vous prie et accordez-moi quelques-uns de vos instants.
Floriot, intrigué et surpris, prit une chaise et attendit.
— Nous avons dans la tour nord de la Grande Marche, continua avec lenteur le ministre, — dans ce Palais que vous avez décrit sans l’avoir vu, après un dédale de couloirs très obscurs et qui ne sont éclairés, même en plein jour, que par les flambeaux de nos surveillants lorsqu’ils sont forcés de s’y aventurer, des chambres profondes que des mauvaises langues appellent des cachots et personne, jamais, n’aura l’idée d’aller vous chercher… Pardon ! d’aller chercher celui qu’on y aura déposé.
— Je ne connais pas le Palais, interrompit Floriot.
— Vous parlerez quand j’aurai fini, coupa le premier ministre… Nous y avons déjà logé des usuriers, des fabricants de libelles, des espions et aussi un homme qui est mort, il y a deux jours, d’ennui et de privation de la lumière. Cet étranger avait eu le tort d’expédier à sa fiancée une lettre que nos services de surveillance, admirablement organisés, vous avez pu vous en apercevoir, avaient interceptée. L’étranger y faisait mention de faits, inexacts, du reste, comme il l’a reconnu par la suite, sur la Cour de la Grande Marche, mais qui risquaient de nous porter préjudice. »
Floriot intervint avec un calme qui le surprenait lui-même et si promptement que son interlocuteur ne put lui retirer la parole :
— Je remercie Votre Excellence pour les curieux détails qu’elle vient de me fournir si spontanément, mais je ne crois pas devoir les rendre publics encore… J’écoute donc la suite…
— Ne plaisantez pas, Monsieur, trancha le Premier, visiblement irrité. Ce que cet étranger avait commis était d’une gravité bien moindre que ce que vous avez fait. Ainsi, vous osez raconter que deux dames de la Cour se sont évadées la nuit dernière. Il n’y a pas eu d’évasion, Monsieur, je m’en porte garant !
Floriot secoua la tête en souriant :
— Je remarque avec déplaisir, dit-il, que l’on cache les vérités désagréables à Votre Excellence…
— Vous me donnez un démenti, Monsieur ! s’étonna le ministre.
— Pas du tout, assura Floriot qui savait se maîtriser. Je suis sûr que Votre Excellence me confie ce qu’elle sait. Mais ce qu’elle sait n’est pas complet. Votre police… les services de surveillance ne sont peut-être pas aussi dignes d’admiration qu’on pourrait le croire, voilà tout.
Le Premier contenait une vive colère. Mais il savait, lui aussi, se dominer. Il s’informa avec une feinte bonhomie :
— Voyons, quelles sont les deux dames d’honneur dont vous parlez ?…
— Excusez-moi, Excellence. Je demande des renseignements, je suis dans mon rôle. C’est votre droit de me les refuser. Mais moi, je n’en fournis jamais, à personne, qu’à mon journal.
— A votre aise, poursuivit le ministre. D’ailleurs ce n’est pas ceci qui nous préoccupe…
Floriot eut un geste qui pouvait signifier : « Comme il vous plaira ».
— Je vous demande… Je vous prie, rectifia le Premier, de vouloir bien expédier à votre journal un télégramme dans lequel vous tâcherez d’effacer les tristes effets que vous avez pu, par… imprudence, inadvertance, provoquer. Ce télégramme, pour éviter toute erreur, nous allons vous le dicter…
Floriot ne bougea point. Il avait du mérite, car il ne se sentait pas rassuré. Il était certain que des hommes, derrière les portes, écoutaient et attendaient.
— Voici, reprit posément le ministre sans vouloir remarquer l’attitude du reporter… Vous pourriez dire que le bruit a couru et court encore que le prince Evgueny se trouvait dans une villa près de Genève. Ce bruit a produit en ville une grande émotion… Vos renseignements particuliers vous permettent d’affirmer que ce bruit est mal fondé. Vous savez que le Prince est loin de la Suisse. Vous en avez eu l’assurance du Grand Chancelier en personne qui a bien voulu vous accorder une audience. Il vous a déclaré qu’il ne voyait dans ce bruit répandu qu’une plaisanterie. Mais qu’il se refusait à croire que l’on avait voulu créer à Paris des difficultés au gouvernement exilé d’un pays ami de la France…
« C’est tout, Monsieur. Un de nos collaborateurs muni de vos références, va envoyer sur-le-champ, un télégramme dans ce sens à votre maison. Nous aurons le plaisir de vous conserver avec nous jusqu’à son retour et, en l’attendant, je pense que vous boirez avec joie à la santé, à la chance et à la gloire du prince Evgueny qui combat pour sa couronne et vous réjouir aussi d’être le premier à publier cette importante nouvelle »…
Ce dernier argument fut le seul que retint Floriot.
— Vous pouviez commencer votre audience par ces mots, déclara-t-il à l’Excellence un peu surprise.
Il écrivit le télégramme attendu. Il pensait que Lonlay n’aurait pas cette information, du moins qu’il ne l’aurait pas tout de suite. Il conclut en remarquant une fois de plus que le zèle était toujours inutile ou nuisible. Et que les « belles nouvelles » n’étaient pas constamment réservées à ceux qui les cherchaient.
Mais quand, à la tombée de la nuit, il eut rejoint Lonlay-Labbaye et conté son entrevue avec le premier ministre, il fut de l’avis de ce dernier :
— Ne restons pas trois heures de plus ici. C’est suffisant. Vous démentirez par exprès à Bellegarde, si vous le jugez nécessaire.
Lonlay et Floriot prirent immédiatement le train pour se mettre à l’abri de l’autre côté de la frontière…
Pour la première fois, Dick commença à comprendre le jeu terrible que nous jouons dans la vie, et comment aucune réparation ne peut changer une chose une fois faite ni y remédier.
R. L. Stevenson.
Ici Lonlay-Labbaye reprend la parole.
— Toute cette histoire va nous amener des histoires diplomatiques, me disait Floriant de Floriot dans le train qui, sans impatience, nous ramenait en France.
— Pour quelle raison ?
— Ce Prince qui ne veut pas prendre la couronne…
— Mais on ne lui offre pas la couronne ! Écoutez-moi. Je ne cherche pas à calculer les conséquences de notre curiosité. Je ne désire pas non plus tirer des conclusions du peu que nous avons appris. J’ai voulu me renseigner. J’ai vu, par hasard, qu’il y avait un jeune homme faible, mais à côté de lui, selon une règle souvent vérifiée, des personnages puissants et volontaires. Près du débile Evgueny, un chancelier qui sait ce qu’il veut et qui gouvernera au besoin. Ainsi les autocraties et les dictatures se perpétuent. Et si elles tombent, c’est parce que, sans doute, rien n’est éternel et qu’il faut toujours construire.
« Nous revenons de Genève, convaincus, vous et moi, que l’autorité, même arbitraire, même trop énergique d’un seul, est préférable aux incohérentes compétitions de plusieurs petits maîtres.
— Je ne voyais pas si loin, répondit Floriot sans s’émouvoir. Je me demandais : « Cette histoire aura-t-elle des suites ? »
Elle n’eut pas de suites… Du moins celles que redoutait Floriot.
Lorsque je rentrai à mon journal, je ne fus pas blâmé pour avoir expédié d’abondants détails, inédits jusqu’alors, sur le Prince réfractaire au pouvoir, sur les dames d’honneur qui se confient à un reporter et s’évadent d’un Palais… Je ne fus pas félicité non plus. C’est fort bien. Il ne faut pas se montrer trop exigeant.
Floriot, par contre, reçut dans son quotidien, quelques discrets compliments.
— Évidemment, lui confia le troisième secrétaire de la rédaction qui est son ami, évidemment, nous n’étions pas satisfaits tout d’abord quand nous avons vu ce que publiait la concurrence. Mais quand les démentis ont commencé, on se disait : « Allons, Floriot s’est montré prudent. Il a agi avec sa réserve habituelle. »
« D’ailleurs, des dépêches de source anglaise ont confirmé régulièrement ce que tu avais le premier annoncé : « le Prince, à la tête de ses partisans, dirige l’offensive dans le royaume qu’il veut reconquérir ». Un télégramme britannique précisait même — ce que tu ne pouvais savoir — qu’il avait été blessé devant ses troupes. Et c’était cela qui était normal, vraisemblable et exact. »
« Et puis, ton entrevue, avant de quitter Genève, avec le Grand Chancelier qui t’a fait des confidences est une trouvaille… »
Floriot en écoutant ce résumé de l’opinion directoriale, de conclure :
— En somme, je ne m’en suis pas trop mal tiré ?
— Oui. Rien à te reprocher.
Floriot a raison : pourquoi courir sus à la vérité ? Je devrais pourtant le savoir : les gens ont une instinctive horreur de ce qui est vrai. Il suffit pour s’en rendre compte d’observer un passant, — c’est-à-dire un « lecteur moyen » — dans la rue. Tombe-t-il par surprise en arrêt devant une glace ? Il est choqué et mécontent. Il ne se reconnaît pas. Puis, il se reprend et se rectifie. Il reconstruit l’allure et la ressemblance qu’il croit habituellement être les siennes. Les peintres de portraits et les photographes le savent bien qui ne délivrent à leur clientèle que des épreuves retouchées.
Aussi, quelles clameurs lorsqu’un importun prétend imposer ce qu’il a vu ou entendu !
Il y a trois jours, Jacques Wisel, méconnaissable depuis son retour de Suisse, est venu me voir.
— Vous allez repartir ?
— A quoi voyez-vous ça ?
— Votre valise est prête.
— Elle est toujours prête…
— Je sais. Mais cette fois, vous allez l’emporter.
Il ne se trompe pas. Je suis en instance d’un nouveau voyage.
— Il faut bien que je rétablisse ma réputation, tout au moins que je la maintienne.
Jacques Wisel secoue la tête.
— Cela ne vous a pas porté chance cette expédition à la Grande Marche.
Et aussitôt, il en vient à ce qui l’intéresse :
— Pas de nouvelles d’Ozilie ?
— Et vous ?
— Rien du tout.
— Moi, dis-je, pas grand’chose… Une carte, datée de Wien, avec ces mots : « Inaltérable reconnaissance ». Puis une autre carte de Wien également : « Avec les remerciements de la dame d’honneur ». Ni l’une ni l’autre ne sont signées. Mais cela ne permet aucun doute.
— Et Caussanges ? Il n’a rien appris ?
— Il sait quelque chose. Il est retourné dans sa propriété de Chamarges et il a surveillé du haut de sa terrasse, ce qui se passait dans la propriété de sa voisine, Mlle Isabelle Chenoncay. Mais il n’a aperçu ni Isabelle ni… Ozilie. Cependant, un matin, il a remarqué une grande animation : des étrangers visitaient le domaine. Parmi eux, une femme. Ce n’était pas Ozilie. Caussanges s’est informé : la propriété était à vendre. Les Chenoncay iront s’établir à Wien, paraît-il…
— Si j’allais à Wien ? me demande Wisel.
— Je ne vais pas de ce côté.
— C’est étrange, ajoute-t-il. Que pensez-vous de cette femme ? Vous ne croyez pas qu’elle nous contait des histoires imaginaires ?
— Je ne sais ce qu’elle vous a confié.
— Je vous l’ai dit en détail, reprend Wisel.
— Ce que vous pouviez m’avouer…
Il n’insiste pas. Il pose une nouvelle question :
— Et Caussanges ? Son opinion ?
— Je crois qu’il écrit des lettres à Ozilie. Mais il ne les envoie pas. C’est une manière comme une autre de soigner sa maladie.
— Ah ! il lui écrit…
— Il ne s’en cache pas.
Wisel s’arrête. Je songe que je lui ai trouvé, sans le vouloir, une belle occupation pour ses soirées d’hiver.
— Je ne sais si vous l’avez remarqué, mais je tenais beaucoup à cette jeune fille.
J’ai, heureusement pour moi, un certain flegme et je n’éclate pas de rire. Ce qui engage Wisel à continuer :
— C’est stupide. C’est ainsi… Que faire ?
— Voyagez…
Il ne m’écoute pas… Il poursuit :
— Je lui ai écrit à l’adresse qu’elle m’a donnée une lettre, puis une autre… Puis une dernière où j’entasse des reproches inutiles et ridicules sur son incompréhensible silence. C’est ennuyeux… Je donnerais beaucoup pour reprendre cette dernière lettre si c’était possible… Vous ne voyez pas comment ?
— Quelle adresse ?
— Poste restante.
— Rue Danton ?…
— Comment le savez-vous ? s’étonne Wisel.
— Voyons ! C’est l’adresse qu’elle a remise à Caussanges : « Bureau de poste, rue Danton… »
— C’est vrai ! Je n’y songeais plus…
Précisément, en dépit de mes déplacements un peu bousculés, j’ai conservé dans mes poches les enveloppes au nom d’Ozilie de Wicheslaw recueillies dans la chambre de Trophime, la nuit de ma visite à la Grande Marche.
Le moyen le plus simple pour reprendre les lettres de Wisel, c’est d’envoyer la fille de ma concierge rue Danton, avec les précieuses enveloppes que j’ai rapportées.
— Je vais réfléchir. Revenez demain. Je vous dirai si j’ai réussi.
— Où vous rencontrer ? Chez vous ?
Je songe que je pourrais bien demain être obligé de sortir…
— A quatre heures et demie, boulevard Saint-Germain, près de la rue Danton. Promenez-vous devant la librairie. Je serai exact.
Wisel s’en va en me remerciant.
Malheureux Wisel… C’est un peu par ma faute, après tout, s’il est ainsi… Mais pouvais-je prévoir ? Une personne que l’on rencontre vous pousse dans la vie d’une autre que l’on ignorait jusqu’à ce moment-là. Par erreur, distraction ou négligence cette démarche vous entraîne dans un cercle différent, une contrée insoupçonnée…
Se seraient-ils connus, sans moi, ce garçon et cette jeune fille ? J’en doute. Et l’intrigue commence.
Car cette personne, découverte par hasard ou par jeu, voici qu’elle vous est sympathique. Bientôt, vous ne savez plus vous dispenser de sa présence animatrice.
Et tout s’enchaîne, pour peu qu’elle le veuille ou ne le veuille pas…
Je ne puis pourtant pas lui avouer — d’abord ça ne changerait rien — qu’Ozilie de Wicheslaw, nom et titre qui lui furent accordés pour paraître à la Cour du prince Evgueny, c’est Mlle Isabelle Chenoncay, de nationalité française, orpheline actuellement, fille d’un officier de cavalerie, détaché comme instructeur à l’État-Major d’Evgueny…
Je ne puis pas lui raconter que Mlle Ozilie-Isabelle n’est point une petite institutrice, mais l’unique héritière de son oncle Chenoncay, propriétaire de villas et d’immeubles en France et à l’étranger.
« Ozilie, monomane du bluff », semble-t-il croire pour me contraindre à rectifier. Je ne puis pas lui répondre qu’Isabelle n’a point menti, si ce n’est sur quatre ou cinq points seulement, ce qui est vraiment minime pour une femme et toujours avec cette excuse que c’était pour sa défense ou son offensive. Ainsi, si elle se présenta comme une infortunée, ce fut pour décourager les candidats à sa fortune — c’est bien son droit — et parce qu’elle cherchait elle-même son fiancé et s’en remettait à elle seule du soin périlleux de le découvrir.
Je ne peux pas non plus expliquer à Wisel que parmi les lettres qui attendent à la poste restante, il en est trois au moins d’un imaginaire fiancé. Ozilie les composa, dans l’espoir qu’elles tomberaient sous les yeux du prince Evgueny, par l’entremise de quelque espion, et qu’Evgueny serait désormais sans moyen pour lui avouer qu’il l’aimait toujours…
Et lorsque d’Autriche, Ozilie, plus tard, fera réclamer sa correspondance à la poste restante et qu’on lui annoncera que tout a été retiré, elle songera à Wisel et elle se taira. Déjà, son silence n’a pas d’autre cause : elle s’imagine que Jacques Wisel est au courant et qu’il sait qu’elle est Isabelle, riche et mariée…
Oui, je ne puis rien dire. D’abord parce que j’ai promis le secret à Trophime jusqu’à ce que j’apprenne le mariage de Mlle Isabelle. Et puis, cela ne changerait rien, même une allusion la plus discrète. Quelque jour, cependant, si j’en ai le loisir, il faudra que je me mette à la recherche d’Ozilie et que je la ramène à Wisel… Mais d’ici là, Elle ou Lui, ils auront peut-être tout oublié…
Après Wisel, voici Caussanges.
Je ne l’attendais pas. Quelques minutes plus tôt, ils se trouvaient face à face, Jacques Wisel et lui. Que serait-il advenu de cette rencontre ? Ils se voient peu. Peut-être un de ces revirements dont je parlais tout à l’heure ? Rien du tout, aussi bien, l’un et l’autre demeurant dans son silence.
Pierre Caussanges vient, lui aussi, pour avoir des nouvelles. La lettre qu’il découvrit sur la route de Chamarges n’aura pas été sans influence. D’abord, elle le contraignit à en écrire d’autres, car elle apporta dans sa vie de célibataire un levain de curiosité romanesque.
Une certaine crainte de la femme a conduit Pierre Caussanges au célibat. Des liaisons provisoires, des rencontres, où il s’est montré par trop inférieur devant un adversaire féminin probablement plus hardi ou simplement méprisant lui ont donné l’appréhension d’une intimité durable…
Maintenant, il est trop tard. Il le croit du moins. Tant de manies, tant de pas placés dans les mêmes pas ! Et lorsqu’une fortune imprévue vient le surprendre, si elle lui accorde une audace brusque et exagérée, c’est quand même une audace par explosions et sans suite.
Il désirait donc rencontrer quelque chose… Il cherchait. Il ne discernait pas exactement ce qu’il souhaitait. La lettre d’Ozilie est survenue à propos. C’était cela qu’il voulait au fond, sans le savoir. Et maintenant, il ne pense plus qu’à déchiffrer le « secret d’Ozilie », comme il dit. Mais si je lui apportais ce que je sais de ce secret, sans doute Ozilie ne l’intéresserait plus.
Je l’interroge le premier, sans même abandonner ces notes que je termine, car je vais clore ce cahier sous peu de jours, je le sens bien, ne serait-ce qu’en raison de mon nouveau départ qui est imminent.
— Pas de nouvelles ?
— Sans nouvelles…
— Moi, non plus.
— Où sont-elles à ton avis ?
— En Autriche, dans les Balkans, en Allemagne, en Italie…
— Un moment, interrompt Caussanges, j’ai eu l’intention de faire paraître dans les grands journaux européens — mais à cause du change, c’est très cher — une annonce rédigée dans ce style télégraphique qui est une des formes de la sensibilité contemporaine. Mais Ozilie l’aurait-elle vue ? C’est douteux. Si encore on savait à peu près dans quelle région elle voyage ?…
— Elle est longue ton annonce ?
Car je tutoie Caussanges. Je le vois assez rarement — je le voyais plutôt, car depuis l’affaire de Chamarges, il n’hésite pas à venir me surprendre boulevard Saint-Germain. Je voyage souvent avec Floriot, j’ai une sincère estime pour Wisel : je ne les tutoie jamais.
— Non. « Une femme a été perdue ». C’est le titre…
— On pensera à une réclame pour un film. Continue…
— Alors, à ton avis, pas de titre.
— Puisque tu mets l’annonce aux « objets perdus ».
— Non. A la « Correspondance »… Enfin, je réfléchirai. Voici le texte :
Caussanges lut :
— « Si Ozilie errante sur les routes du monde se souvient encore de la lettre perdue et retrouvée dans le chemin de Chamarges qu’elle écrive Caussanges Paris (ici mon adresse) Agences s’abstenir ».
En lisant les journaux ce matin, — vieille habitude — je m’arrête sur une petite dépêche, à coup sûr d’origine anglaise, bien qu’elle soit datée de Constantinople. Elle annonce en cinq lignes que le prince Evgueny a été assassiné en Kabardie par un fanatique. C’est tout. Pas de commentaires. La nouvelle, du reste, a fait peu de bruit. Nul ne souligne la malheureuse destinée du petit prince amoureux et irascible…
Ce télégramme dit vrai, — je l’ai su depuis — en ce qui concerne la mort violente d’Evgueny. Le fanatique n’était pas un partisan de la royauté ou de la république, mais un jaloux que son épouse délaissait. Il a frappé de plusieurs coups de poignard un Européen en qui il a cru reconnaître l’amant de sa femme.
La vérité, plus tard encore, j’ai pu la rétablir ainsi qu’il suit : Evgueny, après la disparition d’Ozilie, avait quitté en secret la Suisse pour gagner la Kabardie et se conformer à ce qu’annonçaient les télégrammes du premier ministre. Toutefois, il s’était arrêté à Wien. Pas d’Ozilie. Où était-elle ? Evgueny ne pouvait imaginer qu’Ozilie vivait alors toujours en Suisse, dans une retraite sûre.
Ce rêveur désenchanté avait voulu sincèrement se perdre dans l’action. Il continua sa route, avec une résolution désespérée dans les replis de son cœur. A peine fut-il parvenu dans son royaume qu’il se fit tuer, par erreur.
De cette fin tragique, aucune allusion à mon journal. Toutefois, quelques excellents camarades doivent dire en me désignant :
— Il a beaucoup d’imagination.
Et c’est un blâme de leur part, chez ceux-là même qui ne savent rien distinguer en dehors d’une réalité qu’on leur apporte toute triturée.
Par contre, Floriot qui était satisfait d’expédier sous forme de télégrammes les communiqués falsifiés qu’on lui distribuait, est considéré aujourd’hui comme un informateur sûr et sérieux. N’insistons pas…
Mais Ozilie, lorsqu’elle apprendra la mort du Prince reviendra-t-elle à Paris ? Elle n’a plus de raison de se cacher, cette voyageuse qui délaisse Chamarges pour Paris, Paris pour la Suisse, Genève pour Wien et ainsi de suite, fuyant toujours comme un malade à la recherche d’un asile meilleur.
Toutefois, si elle ne reparaît pas, ce sera bien la preuve qu’elle croit Wisel au courant de ses deux noms et de sa véritable identité. Et elle ne se décidera jamais — je la connais suffisamment — à fournir des explications que l’on n’admet qu’à demi, pour avouer qu’elle s’est dissimulée sous un manteau étranger… pour s’excuser enfin d’avoir menti…
N’oublions pas. A quatre heures et demie, devant une librairie boulevard Saint-Germain, rendez-vous avec Jacques Wisel. Il me reste encore le temps de donner les instructions nécessaires à la fille de ma concierge pour retirer de la poste restante les lettres adressées à Mlle Ozilie de Wicheslaw. La demoiselle nous rejoindra sur le boulevard. Ainsi, je n’aurai pas de tri à opérer : Wisel recevra toute la correspondance.
— C’est très bien, dit Wisel dès qu’il m’aperçoit. Vous êtes à l’heure.
Je ne lui en ferai pas la remarque, mais il est agité plus qu’il ne le croit. Et il doit m’attendre depuis un moment déjà.
— Vous avez « ma » lettre ?
— Les voici…
Je désigne une jeune personne légèrement sournoise qui vient à ma rencontre et me remet d’un air indifférent un paquet d’enveloppes. Elle s’éloigne, non sans témoigner de sa curiosité. Je tends les lettres à Wisel.
— Qu’est-ce ?…
— Six lettres de Pierre Caussanges — son adresse est au verso — trois qui sont de vous ; — votre écriture est bien reconnaissable — et trois autres d’origine ignorée…
— Je ne veux que les trois miennes, observe Wisel.
— Moi, je n’en désire aucune. Prenez, faites ce que vous voudrez. Vous ne voulez pas vous asseoir dans un café ?
— Il va pleuvoir, c’est vrai, mais je préfère marcher. Je ne puis rester en place, me répond Wisel.
C’est pour ne pas montrer sa stupéfaction. Quelles sont ces trois lettres inattendues dont il examine à présent la suscription.
— On vous a tout donné ?
— Bien sûr.
— Et ces lettres-là ? s’étonne-t-il avec un visage ridé par l’angoisse.
C’est donc cela les effets du capricieux amour ! Quelle chose curieuse à observer chez les autres.
— Je ne sais pas.
— Que dois-je en faire ?
— Les mettre dans une boîte, elles retourneront au bureau d’où elles sont sorties. Mais que de complications vont apparaître !
— Alors ?
— Détruisez-les.
Mais il ne m’écoute pas.
— Qu’en pensez-vous ? Elle avait un autre correspondant ?
— Cela ne signifie rien. Ce sont peut-être des lettres d’affaires.
— Vous pensez ?
— Évidemment !
Je ne suis sûr de rien, mais je réponds avec assurance. Aussitôt Wisel :
— Vous savez beaucoup plus de choses que vous ne voulez en laisser entendre, remarque-t-il avec amertume.
— Pourquoi cette réflexion ? Après tout, vous avez peut-être raison…
— Je parierais que vous êtes au courant du contenu de ces trois lettres, reprend Wisel en tournant dans ses mains les trois enveloppes inconnues.
— Ne pariez pas, vous allez perdre.
— Ozilie et Trophime vous ont fait des confidences.
Il me le déclare sur un ton irrité. Excusons-le… Il est tellement changé depuis le jour où il a fait la découverte d’Ozilie.
J’aime les gens qui savent se décider. Réfléchir. Oui. Mais agir. Et puis il arrive ce qui doit arriver. Je préfère même ceux qui savent au besoin, commettre une sottise. Un peu vivement, j’interviens :
— Si vous étiez seul, est-ce que vous regarderiez ces lettres ?
— Pourquoi cette question ?
— Parce que je vais me retirer. Qu’allez-vous faire ?
— Je vais remettre ces lettres à la boîte.
— Non. Vous en aurez un regret inavoué, mais certain. Prenez le seul moyen qui vous accordera une tranquillité, même provisoire.
— Vous êtes un étrange personnage, Lonlay…
— On me l’a déjà affirmé.
— Vous conservez le secret d’une confidence, mais vous n’hésitez pas à me conseiller d’ouvrir ces lettres qui m’apprendront ce que vous savez…
— Je ne vous y oblige pas…
— Je sais bien. Vous êtes quand même un drôle de corps. Incapable d’une indiscrétion en ce qui concerne un ami. Mais lorsqu’il s’agit de votre journal, vous ne vous connaissez pas de limites… Avouez que vous êtes aussi avide de connaître ces lettres que moi-même. Si on vous les avait remises, à vous seul, que feriez-vous ?
— Je n’hésiterais pas.
— Vous les décachetteriez !
— J’ignore. Mais j’aurais déjà pris une décision.
Jacques Wisel fait encore quelques pas.
— Si elles m’ont accordé des confidences, comme vous le supposez, mon cher Wisel, elles ont dû me demander de les garder secrètes. Par conséquent, c’est comme si elles ne m’avaient pas parlé.
Il s’excuse, il met dans sa poche les lettres de Caussanges et les siennes. Mais il ne sait quoi faire des trois autres. Le timbre de la poste indique Paris. Il me le fait remarquer.
— Je ne sais rien de cette femme, ajoute-t-il, avec un sourire où il y a de la colère et de la rancœur. Et là-dedans, peut-être, se trouve la réponse à toutes les questions que je me pose. Mais qu’apprendrai-je ?
A la manière des hésitants qui reculent un peu ce qu’ils vont décider, il déchira brusquement une enveloppe. Et il se mit à lire. Son geste, je l’avoue, me surprit. Mais bien davantage son visage, à mesure qu’il lisait. Il fut saisi d’un tel désarroi qu’il épelait à voix basse :
Ozilie, nos baisers… Et cette nuit du mois dernier où je vins te surprendre, rappelle-toi… Un signe de toi et j’accours.
Wisel ouvrit la seconde lettre.
Notre nuit de noces. Ton petit corps dans mes bras…
A la troisième maintenant.
Mon épouse chérie… Notre mariage secret qu’il faudra bien régulariser… Quand pourrons-nous, au grand jour paraître ensemble, vivre ensemble…
Pas de date. Une signature illisible. Et tout cela impersonnel, dactylographié ! Wisel s’arrêtait comme par hasard, sur des passages :
Notre mariage jusqu’ici secret, mais légal tout de même, rassure-toi. Et le consentement de ton oncle n’était pas nécessaire…
Il cessa de lire.
— Ce n’est pas possible ! dit-il. Ce n’est pas possible !
Alors, il reprit les trois lettres, s’efforça de croire qu’il s’était vraiment trompé, revint aux adresses, feuilleta les papiers. Mais les lignes se bousculaient. Il ne distinguait plus ce qu’il avait déchiffré tout à l’heure et par ci, par là, il relevait des « Ozilie », « ma femme chérie », « mon épouse aimée » comme des points de certitude…
Bouleversé, il restait sur place.
— Vous êtes malade ?
D’un mot, j’aurais pu le guérir. Ces lettres, c’était Ozilie elle-même qui les avait écrites et fabriquées pour que le prince Evgueny, la croyant mariée, ne songeât plus à l’épouser et, à cause d’elle, à rejeter une couronne, même problématique.
— Pourquoi ? répétait-il. Les femmes se griment donc suivant l’homme à qui elles s’adressent…
— Les hommes aussi, Wisel…
— Ces lettres ne sont pas vieilles, reprit-il. Voyez les timbres : Octobre.
— Je ne parviens pas à lire…
— Elle a menti… Elle était perfide… comme les autres…
— Vous la calomniez… Elle vous expliquera quand vous la verrez.
— Je ne la verrai plus…
Jacques Wisel regardait devant lui. Des gens passaient à côté de cet homme désaxé. Deux femmes qui se donnaient le bras se mirent à rire en le voyant. Il ne pensait plus à moi. Je m’étais éloigné un peu pour mieux l’observer et aussi pour qu’il ne fût pas gêné quand il reviendrait à lui…
Mais déjà il ne me connaissait plus. Que faire ? Je me retirai encore puisque je ne pouvais être pour lui d’aucun secours. Je le surveillai quand même. Comme tout devait chavirer dans son cœur ! Avant de partir, je me retournai : il était resté sur le bord du trottoir, « ses lettres » à la main, insensible à la petite pluie d’hiver qui commençait de tomber sur Paris.
Telle est cette histoire où, à cause d’une lettre égarée, l’on voit le jeune homme qui l’a recueillie ne plus songer qu’à une femme, cette femme rencontrer de son côté ce qu’elle juge l’insaisissable bonheur, s’attarder à sa poursuite, puis le laisser fuir, un journaliste déchiffrer une énigme, poursuivre une Altesse, gagner une partie, échouer ensuite par excès de réussite, un Prince, plein de velléités et d’hésitations, qui a perdu son trône, proclamer par faiblesse et dépit de ne pouvoir le reconquérir, qu’il n’en veut plus et s’attacher, tant est grand son esprit de contradiction, à détruire ce qu’avait échafaudé son premier ministre, où l’on voit encore la même jeune femme, sensible et volontaire, mais qui se croit forte et libre, errer désormais sur les routes du monde. Et son cœur est à prendre. Agences s’abstenir.
Fin
(L’Homêt, 1926).
(Paris, 1928).
Pages | ||
| INTRODUCTION. — Conversation avec l’auteur | ||
PREMIÈRE PARTIE A CAUSE D’UNE LETTRE PERDUE | ||
I. |
— Une rencontre sur la route | |
II. |
— Deux départs pressés | |
III. |
— Dans le rapide | |
IV. |
— Sur les quais de la gare | |
V. |
— Ce qu’on lit sur la lettre | |
VI. |
— Retour à l’expéditeur | |
DEUXIÈME PARTIE LES DÉLÉGUÉS DE SON ALTESSE | ||
I. |
— Première entrevue | |
II. |
— Sur Lonlay-Labbaye | |
III. |
— Deuxième entrevue | |
IV. |
— Lettres de fiançailles | |
TROISIÈME PARTIE LE LIVRE DE BORD DE LONLAY | ||
I. |
— Devant la Grande Marche | |
II. |
— Selon « Sa Noblesse Ozilie » | |
III. |
— Selon le Prince et Ozilie | |
IV. |
— Le pavillon des femmes | |
V. |
— Les confidences d’une dame d’honneur | |
VI. |
— Le Prince n’avait pas tout dit | |
QUATRIÈME PARTIE POUR LA DERNIÈRE HEURE | ||
I. |
— Les confidences d’un officier de service | |
II. |
— Un succès de Floriot | |
III. |
— A quoi songe une « dame d’honneur » ? | |
IV. |
— Lonlay à Genève | |
CINQUIÈME PARTIE LA GRANDE MARCHE ABANDONNÉE | ||
I. |
— L’auteur responsable | |
II. |
— La « petite disciple » | |
III. |
— Un guide pour sortir du parc | |
IV. |
— Disparition des « dames d’honneur » | |
V. |
— Différences de point de vue | |
ÉPILOGUE LE LIVRE DE BORD DE LONLAY (Suite) | ||
I. |
— Une femme a été perdue | |
II. |
— A cause d’une lettre retrouvée | |
| Pour conclure | ||
ACHEVÉ D’IMPRIMER
LE 16 OCTOBRE 1929
PAR L’IMPRIMERIE FLOCH
A MAYENNE (MAYENNE)
