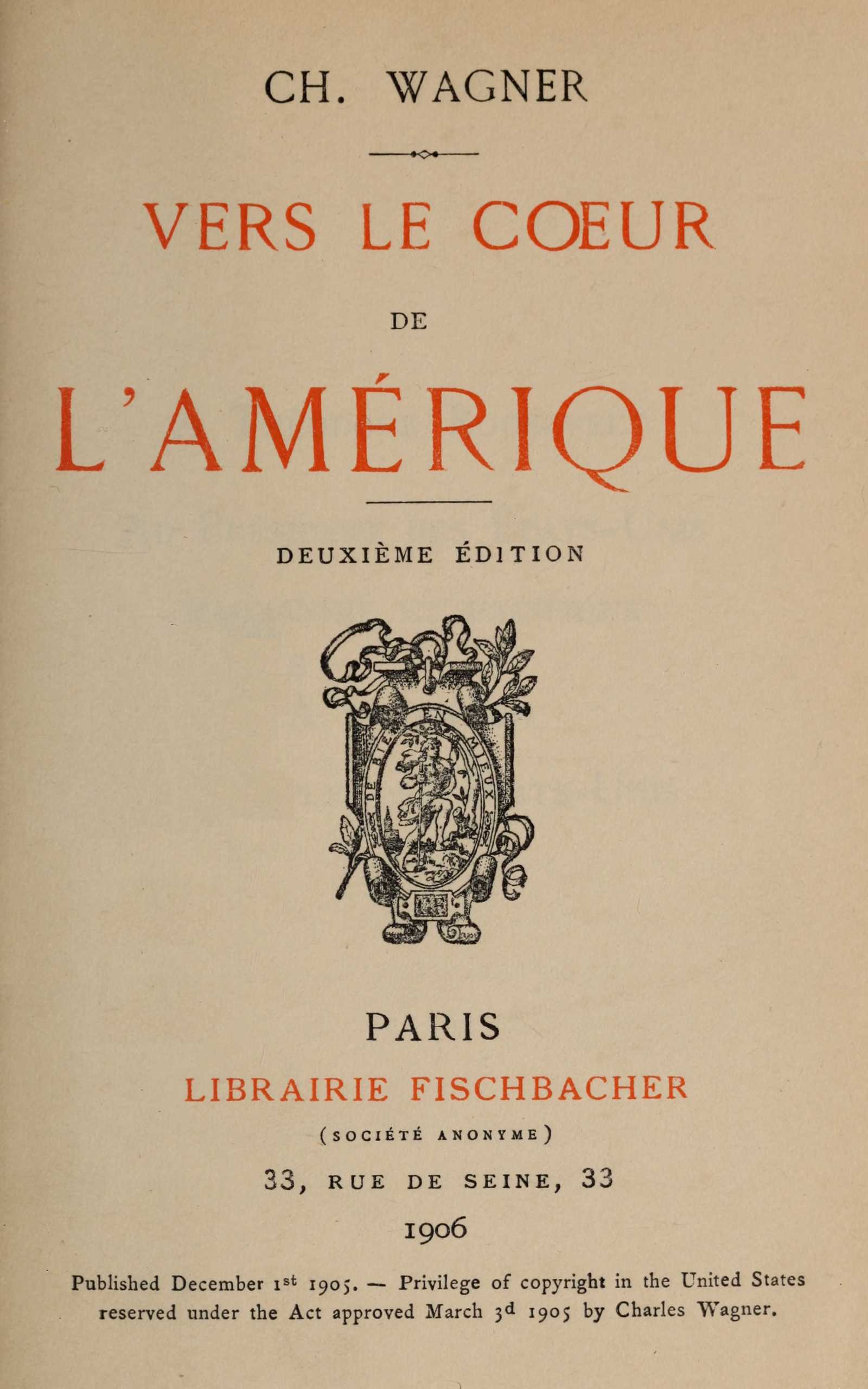
Title: Vers le cœur de l'Amérique
Author: Charles Wagner
Release date: February 2, 2026 [eBook #77841]
Language: French
Original publication: Paris: Fischbacher, 1905
Credits: Laurent Vogel, Robin Tremblay and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This book was produced from images made available by the HathiTrust Digital Library.)
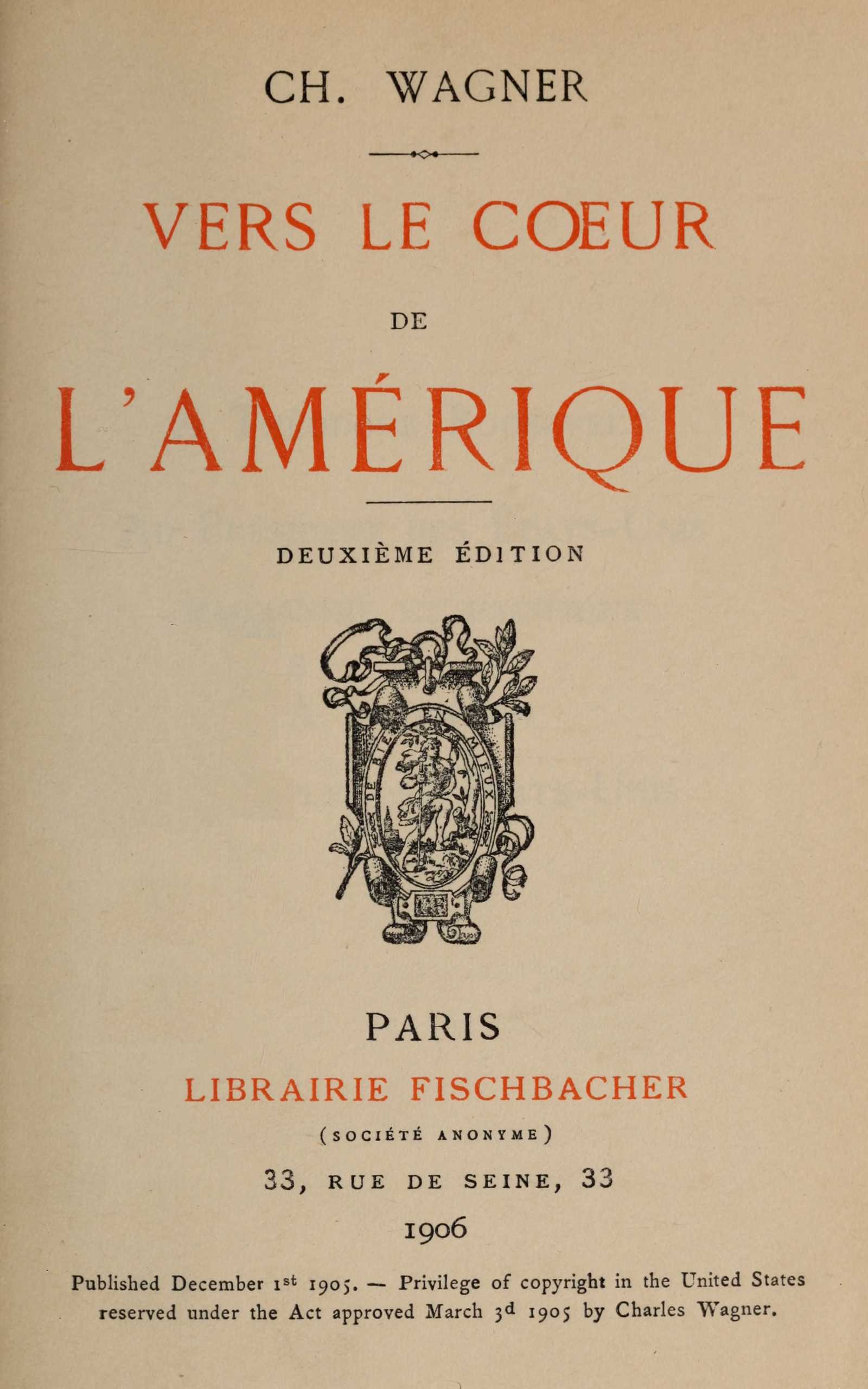
CH. WAGNER
DEUXIÈME ÉDITION
PARIS
LIBRAIRIE FISCHBACHER
(SOCIÉTÉ ANONYME)
33, RUE DE SEINE, 33
1906
Published December 1st 1905. — Privilege of copyright in the United States
reserved under the Act approved March 3d 1905 by Charles Wagner.
A Théodore Roosevelt
Au Président des États-Unis
magnanime et pacifique
A sa maison
au peuple des États-Unis
En allant aux États-Unis j’avais un but précis : me rapprocher du centre vital de ce pays afin d’acquérir une idée des ressorts intimes de son extraordinaire activité. Les observations que comporte un tel sujet sont de nature délicate. Un visiteur, réduit aux moyens ordinaires rencontrerait, pour les faire, des obstacles presque insurmontables. Ces obstacles m’étaient aplanis par un accueil tout familial. Je n’ai pas visité un territoire, j’ai fraternisé avec des âmes. C’est ce qui donne leur signification à ces impressions de voyage. J’ai été réduit, pour les écrire, aux seules ressources du souvenir, n’ayant pas eu le temps de prendre des notes. Mais, toutes fragmentaires qu’elles soient, c’était pour moi un besoin du cœur de les fixer. Je les offre aujourd’hui, en double hommage, à mes concitoyens de France et à tous ces amis d’Amérique dont je ne pourrai jamais oublier l’hospitalité cordiale.
Paris, décembre 1905.
C’était en 1891. Je ne connaissais l’Amérique que très vaguement. Pendant une visite que je faisais à Madame Blaze de Bury, je fus présenté à une jeune Américaine, bien connue dans son pays par ses beaux livres : Grace King, de la Nouvelle Orléans. Elle savait le français. Son esprit en travail et sur bien des points brouillé avec la tradition, s’intéressait aux questions morales et religieuses telles que je les présentais, pour les mettre en contact aussi intime que possible avec la conscience de ce temps. Nous eûmes, dans la suite, de longs entretiens ; Grace King devint une auditrice fidèle de la salle Beaumarchais. Elle écrivit sur mon œuvre missionnaire dans une revue américaine. Avant de quitter Paris, elle me fit connaître Miss L. Sullivan, de New-York, qui, de même que son amie, se mit à fréquenter régulièrement nos réunions. Rentrées dans leurs pays, ces deux jeunes dames ne cessèrent de m’écrire de temps à autre. Grace King me mit en rapport avec la Revue l’« Outlook » et son fondateur M. Lyman Abbott, et traduisit ma Préface américaine à « Jeunesse », premier livre par lequel les éditeurs Dodd Mead et Co, de New-York, firent connaître ma pensée aux États-Unis. A ces noms, il convient d’ajouter celui de Mrs Worthington d’Irvington.
Lorsque en 1901, Miss Marie-Louise Hendee eut traduit « La Vie Simple » pour la maison Mc Clure, Grace King fut chargée de faire précéder le livre d’une introduction biographique. Elle fit cette œuvre avec une exactitude d’informations et une grâce de style dignes de tout éloge. Sa préface, où se trouve l’histoire de ma pensée et une caractéristique de ma libre propagande de l’Évangile perpétuel, était comme un drapeau déployé.
Aujourd’hui que tant d’heureuses rencontres ont suivi ces premières connaissances, j’éprouve un grand bonheur à remonter à ces débuts. Un de mes regrets, en allant visiter les États-Unis, a été de ne pouvoir, faute de temps, pousser une pointe jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Espérons que ce n’est que partie remise.
A partir du moment où « La Vie Simple » parut à New-York, chez Mc Clure, les points de contact se multiplièrent. Ce livre eut la bonne fortune d’intéresser les Américains, en répondant à leur compréhension de la vie et à plusieurs de leurs préoccupations présentes. Il me valut de leur part de nombreux témoignages de sympathie. Nos relations se bornaient là, et je ne songeais pas à les agrandir, en traversant l’Océan. Mais, pendant les vacances de 1902, le Président Roosevelt, par deux fois, d’abord dans un discours à Banghor, puis dans un autre au Temple maçonnique de Philadelphie, à l’occasion du 150me anniversaire de la réception de George Washington, dans la société des maçons américains, voulut bien signaler « La Vie Simple » à ses concitoyens, comme un traité pratique de bonne vie.
Si donc j’ai vu l’Amérique, si j’ai pu y faire un voyage inoubliable, je le dois à son grand Président. Il s’en faut pourtant que ce voyage se soit décidé d’un seul coup, et ait été préparé sans obstacle ni peine. C’est là ce que je demande à exposer en toute brièveté.
Je ne suis pas un écrivain de carrière. L’écrivain, aussi bien que le prédicateur, ne viennent en moi qu’après l’homme. Et l’homme est enraciné dans sa famille et dans son œuvre, enraciné de telle façon que l’idée n’était jamais venue ni à moi, ni à aucun des miens, de ceux de la petite famille ou de la grande, que je puisse partir pour longtemps. Autrefois, à travers la France, l’Alsace, la Belgique, la Suisse, j’avais entrepris quelques tournées de prédications et conférences toujours suivies du plus encourageant succès. Mais les deuils de famille, le travail de plus en plus considérable, à Paris, dans l’œuvre religieuse, sociale, éducationnelle, avaient peu à peu restreint le nombre des tournées. Aucune d’elles d’ailleurs n’avait jamais duré plus d’une quinzaine. Finalement elles s’étaient réduites à deux ou trois jours. Encore, ces absences si brèves ne se produisaient-elles qu’à de longs intervalles. J’étais donc devenu l’homme qui ne part jamais ; l’homme dont c’est le devoir de rester là, toujours. Ainsi pensaient mes amis autour de moi et même certains en Amérique. La revue « Craftsman » de Syracuse[1], ayant entendu parler de mon voyage probable en Amérique, en manifesta de l’étonnement, un étonnement amical certainement, mais un étonnement réel. « Laissez, disait-elle, cet homme où il vit : on ne déracine pas les chênes pour les promener. »
[1] Syracuse, État de New-York.
En moi-même la clarté s’était faite sur ce point : devais-je ou non aller en Amérique ? Ma règle de conduite a toujours été de porter mon ouvrage de semeur, sur les points où je découvrais de la bonne terre. Les lettres et les visites que je recevais d’Amérique avaient créé en moi la conviction qu’un champ immense et réceptif était ouvert, au-delà de l’Océan, aux idées pour lesquelles je luttais et vivais dans mon pays. Or, quiconque peut recevoir de nous, peut aussi nous donner. Toutes les relations entre les esprits des hommes, reposent sur l’échange mutuel. J’étais certain que si j’avais un message pour l’Amérique, elle en avait un autre pour moi, un message qui, dans la suite, pourrait avoir la plus grande influence sur mon activité dans ma patrie. Donc je devais partir, et j’y étais intérieurement décidé.
Mais dans ces sortes de décisions, il convient de se consulter avec les siens. Je fis donc part de mes projets à mes paroissiens, qui me comprirent et m’encouragèrent de leurs vœux.
Puis je consultai ma famille, ma femme et mes enfants. Si des enfants doivent être privés pendant plusieurs mois de la présence de leur père, n’est-il pas juste qu’ils sachent un peu pourquoi ? Comme ils ont une privation à s’imposer, on peut bien leur offrir une explication.
Je me rappellerai toujours ce petit conciliabule, en Touraine, sous les beaux cèdres de la Commanderie[2]. Ma femme, mes deux filles, mon petit Jean étaient près de moi. Les rayons du soleil se jouaient à nos pieds, parmi les ombres mouvantes des branches. J’expliquai que j’avais de la peine à me séparer de mes chéris ; mais que j’avais, pour visiter l’Amérique, de si fortes raisons que je pouvais bien dire que Dieu lui-même m’y appelait. Tout le monde dit : « Oui, Papa, tu dois y aller, et nous ferons de notre mieux afin de te rendre l’absence facile ». Puis nous eûmes une courte et bonne prière, pour placer toutes choses et nous-mêmes entre les mains de Dieu.
[2] C’est le nom de la campagne amie où nous étions alors.
J’avais deux océans à traverser : l’Atlantique et la grammaire anglaise. Chaque fois que je m’étais aventuré dans les eaux anglaises, j’étais revenu découragé. Impossible d’apprendre et surtout de prononcer cette langue. C’est ici que je compris à quel point pour les études et toutes sortes de travaux, l’amour et la nécessité sont d’un secours puissant. Avant mes projets de voyage en Amérique, j’apprenais l’anglais par simple curiosité. Mais depuis que l’idée d’aller en Amérique me hantait, je l’apprenais par amour, par un vrai et profond amour pour ce peuple encore invisible à mes yeux, mais que je pressentais digne d’être beaucoup aimé. Subitement l’anglais me parut un langage délicieux. L’entendre parler, le lire était mon occupation favorite. Mes professeurs, dont je me rappelle surtout le Virginien Mac Bryde, n’avaient qu’à se louer de mon assiduité. Et cependant, au milieu de quelles constantes interruptions je travaillais ! Jamais rien de régulier. Toujours à la merci de l’imprévu du ministère, ou de quelque visiteur importun. Au sein de mes tribulations, je songeais aux Juifs rebâtissant Jérusalem après l’exil et tenant d’une main la truelle, de l’autre la lance. Bien souvent, le soir, fatigué par une longue journée, je me sentais découragé. L’anglais allait moins bien. Je me disais : « je ne l’apprendrai jamais. » Mais le lendemain je recommençais avec une ardeur nouvelle. Sociable comme je le suis, il m’eut paru intolérable de voyager dans un pays sans en parler, ni en comprendre la langue. C’était la condamnation au rôle de sourd et muet. Ensuite, quoiqu’il eût été entendu, en principe, que je ferais en Amérique des conférences françaises, ceux de mes amis qui s’intéressaient le plus vivement à ma venue, déclaraient qu’à moins de parler anglais, je ne me mettrais pas en contact avec le peuple américain lui-même, mais seulement avec certains auditoires select. Coûte que coûte, il fallait donc vaincre cet obstacle de la langue. Ceux que je désirais atteindre, c’était la foule des auditeurs, tels qu’on les voit mêlés dans les réunions où s’assemblent tous les éléments d’une population. A Paris, quelques amis d’une extrême prudence me disaient : « surtout ne vous laissez pas aller à parler anglais en public, vous vous rendriez ridicule ». Des lettres de Genève m’avertissaient dans le même sens. Je crus mieux de déférer au désir de ceux qui m’écrivaient : « Parlez-nous anglais, si pauvres que soient vos moyens en cette langue, pourvu que vous vous fassiez comprendre. » Et je continuai à me jeter dans l’anglais à corps perdu. Comme je me débattais en des difficultés sans cesse renaissantes, je reçus la visite de l’acteur Delorme, du Théâtre de la Renaissance. Il venait m’offrir des leçons de diction en français, comme il en avait donné à beaucoup de mes collègues de l’Église protestante et catholique. Je lui dis : « Retro Satanas ! » et lui citai la parole de Gœthe : « Oui, un comédien peut donner des leçons à un pasteur, si le pasteur est lui-même un comédien. » Comme il tenait déjà la porte, tout navré de ma réception, il dit quelques mots en anglais : — Vous savez l’anglais, lui dis-je. — Non seulement je sais l’anglais, mais j’ai joué Shakespeare aux États-Unis. — Alors vous êtes l’homme qu’il me faut, lui déclarai-je, en le ramenant dans mon bureau. Séance tenante il me donna la première leçon d’improvisation anglaise. Il m’habitua à la prononciation des mots, tel que le comporte le discours public. Et pendant les vacances, à la campagne, nous eûmes ensemble des séances de travail qui durèrent du matin jusqu’au soir et pendant lesquelles j’adressais à mon infatigable et scrupuleux auditeur, des conférences, sermons, speeches de toute nature, m’efforçant de faire passer d’une langue dans l’autre le répertoire total de mes idées. Dans mes moments de loisir, je me parlais anglais à moi-même, et je finis par penser en anglais.
Vers le mois de juin 1903, je reçus, un matin, un petit bleu signé John Wanamaker et me demandant un rendez-vous. Il était rédigé en une écriture décidée, aux caractères nerveux et concis. Je savais deux choses seulement du signataire : la première, qu’il était un des plus grands négociants américains ; la seconde, qu’il aimait beaucoup mon livre : « La Vie Simple, » et en avait distribué d’innombrables volumes. J’allai le trouver ; hélas ! nous ne pûmes causer. Ni son français ni mon anglais ne suffisaient. Et pourtant nous nous comprîmes. En 1904, vers le même mois de juin, nouvelle rencontre. Cette fois nous pûmes avoir une conversation suivie en anglais.
Personne ne me fut plus utile, que John Wanamaker, à partir du moment où mon voyage se trouva décidé. Il me donna tous les conseils et toutes les explications préalables nécessaires et m’invita à venir demeurer à sa campagne de Lindenhurst, durant la première quinzaine de mon séjour en Amérique, afin d’y faire mon acclimatation. Il visita successivement ma famille et mon église, leur promettant de prendre soin du pasteur et du père de famille et de me renvoyer en France, sain et sauf, ce qu’il s’appliqua plus tard à tenir scrupuleusement.
Je m’embarquai sur « La Lorraine », le 10 septembre 1904, emmenant M. X. Kœnig, pour me servir de compagnon et de secrétaire pendant le voyage. Dans ma cabine, parmi les lettres et télégrammes de France qui me souhaitaient un bon voyage, je trouvai un cablogramme d’Amérique signé : John Wanamaker, et conçu en ces termes : « America welcomes you ! »
Dès le premier jour, je rencontrai à bord Mr L. P. Morton, ancien ambassadeur des États-Unis à Paris, et sa famille. Nous nous connaissions depuis un certain temps déjà, et nous pûmes tout à l’aise, en de longues causeries, nous entretenir du pays où j’allais pour la première fois.
Nos modernes transatlantiques sont des merveilles du génie humain. Parmi tous ceux qui se font une ardente concurrence, les moins rapides et les moins confortables eussent paru à nos pères des chefs-d’œuvre de confort. Ce qui me frappa le plus, c’est ce fait qu’un semblable bateau part, ayant en somme embarqué dans ses flancs toutes les questions sociales et même toutes les questions humaines.
D’abord, il promène par l’Océan, nos divisions de classes. Elles sont admirablement caractérisées par les cabines de luxe, les cabines de première avec leur pont séparé par une barrière des cabines de deuxième ; puis les cabines basses où sont logés les passagers de troisième classe désignés sous le nom d’émigrants. Les officiers et les matelots du bord représentent l’armée en ses couches diverses. Le personnel de service masculin et féminin, ainsi que les chauffeurs mécaniciens, cuisiniers, boulangers, sont comme les spécimens de la grande armée des travailleurs.
J’eusse voulu aller des uns aux autres, fréquenter surtout parmi ce peuple nombreux d’émigrants, apprendre leur histoire, les causes de leur départ de la patrie, leurs espérances. Sept grands jours en mer, sans autre occupation que celle d’aller et de venir. Quelle moisson de renseignements à faire en causant familièrement avec les femmes, les hommes, avec tous ! Pourquoi ne l’ai-je pas fait ? C’est bien simple. Mon estomac ne s’est pas trouvé en cette circonstance à la hauteur de mon cœur. Dès l’instant où ce phénomène vulgaire et humiliant qui saisit les marins peu expérimentés, se fut déclaré en ma personne, toute velléité de faire des visites et de fraterniser disparut. Un vague malaise de couleur grisâtre et verdâtre m’envahit dès le deuxième jour et ne se mit à diminuer qu’au quatrième. Pendant un moment de lucidité, je fis une découverte horrifique : j’avais oublié mon anglais. C’est à peine si je trouvais mes mots pour m’expliquer en ma langue coutumière. Quelques termes allemands, semblables à celui de Katzenjammer, flottaient dans le vide de ma mémoire comme des cadres oubliés en un appartement déménagé. D’anglais, plus trace !
Le sixième jour, heureusement, les vents se calment, les nuages se déchirent, un chaud soleil inonde la mer et les ponts. Aussitôt toutes les figures s’éclairent à bord. Tout le long du jour, des voix chantent à l’entrepont. Ce sont des Italiens, hommes, femmes, jeunes gens, qui mêlent leurs voix graves et claires. Je les écoute avec charme. Ces mélodies sont toute une tradition de soleil et de patrie, de poésie et de pauvreté. Ils rappellent les mers bleues, les montagnes violettes, les palmiers, les oliviers, les orangers et les lauriers. Il y a une âme dans ce chant.
Les passagers de première ont un orchestre à leur disposition ; mais eux-mêmes ne chantent pas sur le pont, et surtout l’idée ne leur viendrait pas de chanter ensemble. Pourquoi ?…
Battant et perforant sans relâche le flot amer de son hélice puissante, le navire nous emporte, nous, nos âmes et nos destinées, nos vices et nos vertus. Nous sommes momentanément groupés ; mais nous restons séparés. Au fond, nous ne sommes pas du même bateau. Il y a de la mélancolie à penser que tous ces hommes peuvent respirer le même air, qu’une étroite solidarité matérielle les joint pour quelques jours, que le même naufrage soudain mettrait leurs corps dans le linceul des mêmes flots, et qu’ils ne se sentent pas davantage frères. Un magnifique bâtiment comme un transatlantique est un témoin de notre grandeur mécanique, de notre progrès scientifique. Mais certes on y peut voir des preuves saisissantes de notre pauvreté morale et de notre marasme social. Il y a encore bien des traversées à faire avant d’entrer au port de la Cité fraternelle.
La nuit venue, je m’en fus tout seul à l’avant du bateau, sous les étoiles. Là, on se sent marcher. Il semble qu’un grand aigle vous a pris sur ses ailes et vous emporte à travers les champs de l’air. Tout votre corps est mouvement ; toute votre âme, aspiration.
Derrière le voile de ces ténèbres occidentales, que se cache-t-il pour nous ? Demain blanchiront à l’horizon les rives américaines. Quels hommes y verrons-nous ? quelles rencontres, quelles expériences ferons-nous ?
Et, pareil à un homme qui va vers un peuple, je respire déjà leur air, je les pressens, je tends mes bras vers des amis inconnus.
Mais, tout à coup, en pleine joie d’aborder bientôt, une angoisse affreuse m’étreint le cœur : je songe à mon anglais, et j’entends une voix moqueuse me dire : « Lorsque tu ouvriras la bouche devant ce peuple qui demeure là-bas, ils se regarderont les uns les autres et se demanderont : « Quelle langue parle cet homme ? »
Des feux ! des feux ! feux fixes, feux intermittents ; prunelles démesurées dardant dans la nuit leurs flamboyants regards ; phares tournants, de leurs gerbes balayant l’horizon. Flammes et flammes encore, rouges, vertes. C’est toute la symphonie des signaux, imitant les étoiles, les comètes, les bolides, les éclairs, les torches !
Quelle féerie d’arriver ainsi de nuit et d’être salué par de la lumière ! Et cette lumière c’est de l’humanité. Que dans les ténèbres de l’Océan, loin de la terre, dans l’immense et morne solitude des flots, un simple falot apparaisse : immédiatement cette lumière nous fait penser : un homme est là. A travers toutes les mers du globe, les lumières qui vacillent par la nuit, annoncent des hommes. Elles disent les unes aux autres : voici ton semblable ! Que de pensées dans ces tremblants fanaux !
Et voici la terre ! Rien ne l’indique aux regards, car c’est l’obscurité. Minuit rend semblables et confond dans le même noir le large et le rivage, la plage sablée aux pentes insensibles et la falaise abrupte aux menaçantes arêtes. Sans les hommes, maintenant nous ne verrions que de l’ombre, ombre redoutable où des dangers s’accumulent. Les hommes ont fait de la clarté. Cette clarté oriente et dirige les navires. Toutes ces lumières, c’est de la bonne volonté. Elles renseignent et saluent. Elles disent : voici le chemin, venez et soyez les bienvenus ! Elles annoncent les demeures et les tables de famille, les rues populeuses et les ruches d’affaires où circulent des milliers de travailleurs laborieux.
Le vaisseau ralentit sa marche. On distingue une barque constellée de lumières : elle amène le pilote. Un canot s’en détache et vient vers nous. Le pilote, une ombre noire, monte à bord. C’est un pygmée qui vient prendre place sur le monstre. Et pourtant cette petite ombre qui monte est indispensable au vaisseau monstre. Car cet homme, c’est de la lumière encore. Autre chose est de naviguer sur les vastes déserts liquides, autre chose d’entrer dans un port. Ici il faut connaître la passe. Seul le pilote en sait la direction. Le commandant, avec toute sa science, le timonnier, avec toute son habileté, ont besoin de lui. Et nous voici confiés à sa main.
Lentement, comme pour ne pas réveiller la ville endormie, « La Lorraine » entre dans le port de New-York. Puis les machines stoppent.
Nous dormirons là. Pour la première fois, depuis une semaine, nous voilà au repos.
Et l’on va rejoindre sa couchette, jetant un dernier regard sur toutes ces lumières derrière lesquelles on devine l’Amérique.
Tout est changé ; plus de feux ; ils sont éteints ! C’est le jour ! « La Lorraine » dort encore sur ses ancres. Par le hublot de ma cabine, je vois un gracieux tableau. C’est une colline verte où se remarquent des villas parmi des bouquets d’arbres.
Mais, du pont, un horizon grandiose frappe la vue. Le port de New-York est colossal. La statue de la Liberté que nous avons vue jadis dans un chantier de Paris, et dont la tête dépassait le toit de toutes les maisons voisines, n’est ici qu’une figure de taille ordinaire, malgré la hauteur du piédestal, tant les lignes alentour sont larges et les proportions gigantesques. Des vaisseaux de toute grandeur circulent dans tous les sens. Des Ferry-boats, reliant les lignes ferrées d’une rive à l’autre, transportent ensemble : hommes, chevaux, voitures de maître et de charge, automobiles. On voit passer, alignés sur des enfilées de bateaux plats, des portions entières de trains de marchandises. Tout cela fume, halète, siffle et se signale à coups de sirène. C’est la circulation active de produits de toute nature sous des pavillons du globe entier.
En levant les yeux au-dessus de ce mouvement du port, on est frappé par l’aspect de la ville. Les maisons les plus élevées sont celles bâties dans la partie de la Cité qui avoisine les quais. De loin, ces bâtiments ressemblent à des tours féodales. Ils sont étranges. A les regarder, à mesure que l’on s’approche davantage, on les trouve même franchement laids. L’idée de beauté n’a rien à faire dans cet entassement d’étages. Ce sont, avant tout, des tours de force de l’art de construire ; mais je serais bien étonné que jamais la grâce des lignes puisse parvenir à les pénétrer. Tels quels, ce sont des monuments de la puissance commerciale des États-Unis. Cette puissance, comprimée entre les limites trop étroites, dans les places où elle se concentre, jaillit en hauteur pareille à l’eau qui s’élance en jet, des tuyaux qui l’emprisonnent. Ce sont des manifestations aussi, en leur genre, de cette fougue que rien n’arrête, de ce génie conquérant à qui rien ne paraît impossible et qui a multiplié ses témoins sur toute la surface de ce remuant territoire.
A première vue, je l’avoue, les skyscrapers[3] m’ont heurté franchement comme des productions anormales, des champignons de taille extravagante poussés sur le sol surchauffé de cités titanesques, des excroissances malsaines surgies, par éruption, de la fièvre et de la folie auxquelles aboutit la concurrence enragée pour les biens matériels. Et il pourrait bien y avoir de l’un et de l’autre, un peu de tout, bien et mal, à leur origine. Pour l’amour de l’esthétique, dont la vie humaine ne doit jamais se désintéresser, il est à souhaiter que ces sortes de phénomènes du bâtiment, demeurent à l’état d’exception.
[3] Escaladeurs de ciel.
Cependant, vus de Brooklyn par les soirs d’hiver, la rangée colossale de ces Goliath offre un aspect unique. La difformité de leurs silhouettes trop massives a disparu dans l’ombre. L’obscurité clémente a couvert leur nudité. Luisant alors de tous les feux de leurs milliers de fenêtres, ce ne sont plus que des demeures diaphanes du labeur qui veille. Pendant plusieurs heures elles brillent de tout leur éclat. On sent que le travail bat son plein. Puis, vers les sept et huit heures, lentement les étages s’éteignent. La muraille de feu devient un mur noir, troué seulement de loin en loin par le regard d’une étoile.
Mais j’y pense ; nous n’avons toujours pas débarqué.
Le rivage de New-York, sur toute l’étendue du port, est découpé en stalles comme une écurie. La grande Compagnie transatlantique française a sa place assignée. C’est tout une manœuvre de faire entrer ces Béhémots de l’Océan dans les cases mesurées à leur taille. Ils se comportent à la façon de très gros chevaux, qu’on ferait entrer dans leurs stalles, à reculons.
Enfin, la manœuvre est finie, et le pont jeté. Le premier homme que j’aperçois, en abordant, est John Wanamaker. Sa bienveillante physionomie me paraît un signe tout particulier de bon augure.
Pendant les longues formalités de douane, un essaim de journalistes m’assaillit. C’était la première fois de ma vie que je me trouvais entouré d’autant d’inconnus tenant des carnets en main et me pressant de questions. J’avais beaucoup redouté ce moment, ayant toujours préféré le silence et l’obscurité à la renommée un peu bruyante que nous procurent les feuilles publiques. Mais rien ne me parut plus naturel que de me conformer aux usages locaux. Comme tous mes semblables, d’ailleurs, ces journalistes m’intéressèrent. Il y en avait de différents âges, des jeunes surtout. Je fus agréablement surpris de les trouver si sérieux. Leurs questions étaient intelligentes, précises, mais nullement indiscrètes. Ils me firent l’impression de gens connaissant leur métier et l’exerçant scrupuleusement. Comme on ne peut rien demander de plus à aucun homme, quel qu’il soit, j’éprouvai de suite de la sympathie pour leurs personnes, et nos conversations furent pleines d’abandon.
La curiosité avec laquelle ils m’observaient de la tête aux pieds m’amusa beaucoup. Leurs articles témoignèrent, le jour même, que, ni la coupe rustique de mes vêtements, ni la forme virgilienne de mes souliers ne leur avait échappé.
La légende s’emparant d’un détail de vacances de ma vie de jeune homme, avait fait de moi un berger des Vosges, très récemment encore occupé à garder ses moutons, et qui venait apporter son message de simplicité, lentement conçu dans l’austère solitude des hauteurs. Peut-être s’attendaient-ils à me voir revêtu de quelque costume-programme, à recommander urbi et orbi comme premier et visible indice du retour à la simplicité. J’eus donc d’abord à me défendre de cette tendance au formalisme qui attire les idées dans le domaine matériel. Mais ces interlocuteurs étaient à la fois si intelligents et si désireux de se renseigner exactement sur mes intentions, que j’eus un vrai plaisir à leur expliquer que la simplicité n’était ni dans le vêtement, ni dans la demeure, ni dans la nourriture, mais qu’elle était un état d’esprit qui nous portait à consacrer la vie à son vrai but et à renoncer à tout ce qui nous en éloignait.
Ils me demandèrent : et pour nous autres journalistes, en quoi consiste la « Vie Simple » ? Quel message avez-vous pour nous ? Je leur répondis : « C’est bien simple : ne racontez que ce qui est vrai ».
Je ne sais ce qui se passe en d’autres esprits — nous sommes si différents les uns des autres — mais les toutes premières impressions des choses agissent sur moi avec une extrême énergie. En particulier elles me frappent, si je suis venu de loin dans un milieu suffisamment différent. La première matinée passée dans New-York me trouva particulièrement réceptif. Le voyage est court, de France aux États-Unis : cependant pour celui qui n’a pas beaucoup voyagé, c’est chose étrange de rester sept jours sans poser le pied sur terre ferme. Je ne me lassais donc pas de regarder les rues, le trafic, le train des voitures, tramways, chemins de fer circulant pêle-mêle, se croisant, ou passant au-dessus les uns des autres. Dans certains quartiers de New-York, la circulation d’affaires est considérablement plus intense qu’à Paris. Elle atteint son paroxysme dans le coin de ville avoisinant les gigantesques ponts de Brooklyn. C’est là, à certaines heures surtout où chacun se hâte vers son travail ou vers sa maison, que la fourmilière humaine grouille avec le maximum de célérité. Celui qui, du calme d’une traversée, tombe directement dans cette agitation, éprouve le plus violent contraste. Quelle différence aussi, pour moi, entre ces quartiers où l’humanité coule à flots, tourbillonne en remous et se précipite en cataractes, et le coin ignoré de Bretagne où j’avais passé les dernières semaines, livré à une intense préparation intérieure, et songeant au peuple d’au-delà des eaux !
De ces heurts de la vie, ne nous plaignons jamais ; ce sont d’impressives leçons de choses à recueillir, pourvu que le cœur demeure à son point de vue véritable et que le prochain ne devienne pas pour nous le figurant d’un spectacle. Quel profond intérêt humain la vue de foules inconnues ne doit-elle pas nous inspirer ! Ces passants charrient avec eux tous les fardeaux et tous les problèmes de la société. Ils sont une part du grand drame qui se déroule et dans lequel s’affirment nos destinées. A toute heure, la bataille vogue et se poursuit. Toutes les forces sont à l’action. Vers quel côté penche la balance ?
En même temps que me fascine la foule, des figures de détail me retiennent. Que de types aperçus pour la première fois ! Plus qu’il ne m’était jusqu’alors arrivé, je commence à voir la couleur noire parmi les ensembles qui me coudoient. Déjà, dans le port, la stature puissante et les bras nerveux des nègres m’avaient frappé. Maintenant, c’étaient des femmes, des enfants, croisés à chaque pas, échantillons du fil noir qui fait partie du tissu américain.
Ailleurs, c’étaient de petits camelots qui vendaient des journaux. Le camelot adulte est presque inconnu. Souples et entreprenants, ces garçonnets s’élancent dans les tramways qui passent, dans les wagons des chemins de fer, les traversent en vendant leur marchandise et sautent à terre ensuite avec leurs « cents ».
Dans les trains du chemin de fer aérien, on passe au niveau des étages inférieurs des maisons. Je plains ceux qui demeurent là, dans la fumée, la poussière, le bruit perpétuel de la ferraille et sous les regards des passants. Mais le passant est mis à même, par cette installation, de voir en peu de temps une multitude d’intérieurs. Il regarde les uns défiler rapidement ; pendant un arrêt du train, il plonge à loisir son regard dans les autres et y fait presque une visite. Habitué à pénétrer dans nos intérieurs modestes de Paris, je prenais un intérêt extrême à tout ce que me révélait parfois un simple coup d’œil : arrangement des chambres, physionomie du mobilier, groupes assis à table autour d’un repas.
Dans les cours et jardinets situés par longues rangées, entre les files de maisons, et sur les derrières des habitations ouvrières, on voit immédiatement que les ménagères du peuple lavent beaucoup et tiennent leur linge très blanc. A tous les étages, elles ont, pour le suspendre, un procédé très ingénieux. Des cordes partent des fenêtres des cuisines et vont s’enrouler autour d’une poulie fixée à de hautes poutres de fer ou de bois, vers le milieu de la courette. Par une manœuvre des plus simples, la ménagère suspend ses pièces, une à une, et les fait ensuite avancer, sans se déplacer elle-même. Une fois le linge séché, elle le rentre par une manœuvre inverse. Les jardinets sont en général complètement incultes.
Par contre, ce qui frappe, c’est le beau lierre qui, un peu partout, grimpe aux façades des maisons. Ce lierre perd ses feuilles en hiver. Il n’a donc pas l’inconvénient d’engendrer de l’humidité pendant les mois où le soleil se fait plus rare. Depuis certaines modestes demeures, jusqu’aux maisons les plus riches, cette plante vivace pousse et réjouit la vue. Elle donne aux églises un air familial et accueillant, grimpe aux fenêtres des écoles, et constitue un élément gracieux d’une infinie variété.
New-York est rouge par les briques et la couleur des pierres dont ses maisons sont bâties. Une multitude d’églises, de monuments, de bâtiments publics, sont de ce même grès rouge qui rappelle le grès vosgien et les pierres immortelles de la Cathédrale de Strasbourg.
A un moment de la journée, M. Howland, de la Revue « Outlook », nous prit en automobile et, par un beau soleil, nous fit faire le tour de Fifth Avenue et du Parc. Le parc est immense et situé au cœur de la ville. Il a plusieurs kilomètres de longueur. Le terrain en est ondulé, et par endroits même, accidenté. Les arbres sont rustiques. On a enjolivé aussi peu que possible afin de conserver un caractère agreste à ces sites. Il y a de vrais coins de forêt, tels qu’on pourrait les voir à une grande distance de la ville, des rochers véritables et d’une physionomie suffisamment sauvage. Les oiseaux abondent et les écureuils de même. Ces gracieux petits animaux, qui peuplent tous les parcs américains, sont gris, d’une belle taille, et absolument sans crainte. C’est la preuve des bons procédés du public à leur égard. Ils se livrent à mille ébats et font les délices des enfants. — Quelques équipages circulent par le parc. Mais il n’y a aucune comparaison entre leur nombre et ceux qui roulent par les Champs-Élysées et l’Avenue du Bois de Boulogne.
Il fallut quitter toutes les attrayantes nouveautés qu’offre à un étranger la promenade à travers une ville immense et aller nous occuper d’affaires. Une tournée de conférences est toujours une sérieuse entreprise, surtout s’il s’agit d’en faire beaucoup en peu de temps et de les semer sur un très vaste territoire. Par nécessité, plus que par goût, j’avais dû m’adresser à une maison qui voulût se charger du soin matériel de l’arrangement de la tournée. Allant en Amérique pour la première fois et de plus à mes propres risques et périls, financièrement parlant, je suis heureux de pouvoir exprimer ma satisfaction au sujet de la façon dont la maison J. B. Pond s’acquitta d’une tâche toujours délicate et compliquée de maintes difficultés.
Saturé de bruit, je fus heureux, dans l’après-midi, d’accepter une invitation de mon éditeur M. Mc Clure, pour aller passer le dimanche à sa campagne, de Homestead, située à Ardsley on Hudson.
Hudson river, avec ses horizons de collines et de montagnes, offre le plus beau caractère géographique de l’Est américain. Depuis son embouchure à New-York jusqu’à une grande distance de la mer, ce large fleuve est bordé sur la rive droite par une véritable muraille de rochers, couronnée de forêts et garnie à ses pieds de quelques grosses broussailles qui se nourrissent dans les éboulis lentement amassés par les siècles. Sur l’autre rive, une série de collines à pente douce, s’enchaînent en un ensemble très pittoresque. C’est là que, sur une longueur de plus de cent kilomètres, se suivent, sans interruption, des villages, d’agréables petites villes, des villas et des fermes où une grande partie de la population de New-York demeure en été, souvent même toute l’année.
Washington Irving a fait de ce pays, dans son Sketchbook, des descriptions délicieuses et l’a en grande partie pourvu de toute une tradition, pieusement vivante dans le souvenir de ses compatriotes.
A peine arrivés à Ardsley, Madame Mc Clure proposa une promenade en voiture qui fut dirigée précisément vers Irvington. Nous circulions sur une route large et bien construite, comme on ne les trouve que rarement en Amérique. Beaucoup de voitures légères à roues étroites, garnies de familles en villégiature ou de fournisseurs ambulants : épiciers, fruitiers, marchands de glace, mais presque pas d’automobiles. Le réseau général des routes américaines est en mauvais état. La population circule en chemin de fer et en tramways. On ne peut pas se payer, comme en France et une grande partie de l’Europe, la fantaisie d’aller en automobile d’un bout à l’autre du territoire. Leur usage est donc restreint au voisinage immédiat des villes et, proportionnellement, leur nombre est très inférieur à celui des nôtres. On ne s’en plaint pas, lorsqu’on circule sur une belle route que le trop fréquent passage de voitures à essence transformerait en un royaume de la poussière et du méphitisme pétroléen.
Un petit détour pour un pèlerinage à la maison de Washington Irving, habitée par sa famille. Plusieurs chambres sont restées telles qu’elles étaient de son vivant. La domestique française qui sert dans la maison est toute heureuse de voir des compatriotes et de leur parler.
Washington Irving repose dans le cimetière de Sleepy hollow à travers lequel conduisent plusieurs routes carrossables. Dans ce cimetière, fort grand et en même temps très gracieux, il n’y a pas une seule tombe prétentieuse. Beaux arbres, gazons, pierres de granit, simples, impressives et quelques roses, c’est tout. Et c’est le caractère, en général, des cimetières américains que j’ai vus. Dans un pays où il y a tant de richesse, cette simplicité des cimetières dit beaucoup. Elle marque un sentiment de respect devant l’au-delà et d’égalité dans la mort, un sentiment religieux simple et profond. Pas de signes d’orgueil ou de vanité ; pas de signes d’écrasement ni de désespoir non plus. La mort est envisagée comme elle doit l’être, dans la résignation et dans la foi.
On est si souvent choqué, péniblement impressionné, scandalisé par le luxe des cimetières, ou terrifié par les signes d’une douleur qui ne connaît pas l’espérance. J’aime beaucoup l’atmosphère morale qui règne par les cimetières américains, et mon cœur s’est fait du bien, au souffle qui court sur les tombes de là-bas.
Ce n’est pas tout de savoir vivre. Il faut savoir aussi mourir. Mourir fait partie de la vie. L’aspect du cimetière américain a été pour moi toute une déclaration de principes. Le cœur plein des souvenirs des chers morts, et persuadé que si les morts ne sont rien, les vivants sont un peu moins que rien, je tiens beaucoup à ce que tout ce qui rappelle ceux qui sont allés à Dieu, garde un caractère de haute et vivifiante humanité. La façon dont on pense aux morts et dont on soigne leur mémoire, est un grand chapitre dans l’art de vivre, et les autres chapitres dépendent beaucoup de celui-ci.
En ces premiers instants de mon séjour dans un pays que j’aimais d’avance et dont je venais voir moins la grandeur que le caractère, moins la puissance que l’énergie morale, moins la vie extérieure que la vie intérieure, je fus heureux de recevoir sur les tombes du cimetière de Sleepy hollow ces impressions réconfortantes. Oh ! la belle, la discrète, la tendre et croyante âme de peuple que j’ai senti se découvrir à moi dans ce lieu de repos !
Sur la rive occidentale de l’Hudson, le soleil se couchait. En bas, le fleuve coulait comme une nappe de lave incandescente. Puis venait la barre sombre, gigantesque de longueur, formée par les rochers, à cette heure confondus en une seule masse noire. Et, au-dessus, à travers l’échancrure enflammée de quelques longs stratus, le soleil, embrasant tout l’Ouest, rougeoyait comme un incendie. Je regardais des yeux et de l’âme. Ce qui à cette heure me donnait le plus d’émotion, c’est que pour la première fois, je voyais le soleil se coucher sur le pays du grand Washington.
C’est demain dimanche, me dit M. Mc Clure, le soir à la table de famille ; je pense que vous voudrez bien prêcher dans notre petite église. — Oh non, fut ma réponse, je préfère écouter.
Le lendemain, après l’église, nouvelle question : Ne pourriez-vous pas nous faire un petit culte de famille, cet après-midi ? Cette fois-ci, impossible de refuser, quelle que fût mon appréhension de faire mes débuts en anglais, même devant cinq ou six auditeurs.
Lorsqu’à l’heure fixée, je descendis de ma chambre au salon, je m’y trouvai en présence… d’une cinquantaine de personnes. Je dis à l’oreille de mon hôte : « Monsieur, votre famille est bien nombreuse. » Il y avait là un certain nombre de voisins, gens distingués et instruits, entre autres la bonne et si vraiment modeste Miss Gould, qui a su se faire aimer sur tout le territoire de la République. Mais il s’agissait bien de m’occuper du nom et de la personne de mes auditeurs ! C’est peut-être la première fois de ma vie que j’eusse souhaité d’en avoir moins.
Il fallait bien me résoudre à leur parler. Tout en prenant bien garde à mon discours, dont l’allure chancelante devait rappeler les premiers pas d’un enfant, je hasardais de temps à autre un regard vers la figure de tel et tel auditeur en particulier. Oh surprise et bonheur ! ils avaient évidemment l’air de comprendre. Visiblement ils suivaient l’idée, et je sentais ce quelque chose qui fait savoir à un orateur que l’auditoire saisit sa parole et se l’approprie.
La glace était rompue à partir de ce moment. Tout le monde, après ce discours, fut réellement charmant, rassurant. Pour moi, il eut la valeur d’un événement. Que de fois, en esprit, m’étais-je d’avance représenté cette première épreuve. Maintenant elle était derrière moi. Une lourde pierre m’était enlevée. Le doute sur la valeur de l’instrument indispensable dont j’aurais désormais à me servir tous les jours, faisait place à la confiance.
Lindenhurst, la campagne de John Wanamaker était fixé d’avance, comme le coin de terre américain où se passerait la période, très brève d’ailleurs, d’acclimatation. D’après des instructions précises laissées à New-York par mon hôte, le voyage, jusque-là, fut un petit chef-d’œuvre d’attentions délicates. M. Robert C. Ogden, notable de New-York et associé de M. Wanamaker, nous reçut des mains de M. Mc Clure et nous conduisit au Ferry Boat du Pennsylvanian Rail Road. Là il nous remit aux mains d’un souriant jeune homme qui avait pour consigne de nous conduire à Jenkintown, gare de Lindenhurst, à 9 kilomètres de Philadelphie. Tout le long de la route, ce jeune homme fort bien renseigné se tenait prêt à répondre à toutes les questions que des étrangers peuvent poser. D’ailleurs est-on un étranger dans un pays où un accueil si cordial vous attend partout ? Ils me l’avaient écrit dans leurs lettres : « Vous ne venez pas chez des étrangers, c’est chez des frères que vous allez. Vous serez un hôte national et en même temps un ami ! » De loin, on est tenté de prendre de telles paroles pour des politesses. Si j’avais mieux connu le pays où j’allais, j’eusse pu me dire qu’elles étaient l’expression de la simple vérité.
Sur le pas de sa porte, John Wanamaker nous reçut. Il est impossible de mettre plus de grâce parfaite et de familiale simplicité dans une bienvenue. Le jour même, nous fîmes connaissance d’une partie de sa famille, et le lendemain Mme Wanamaker revenait de la mer. Je les voyais tous pour la première fois, et il me semblait plutôt les revoir après une longue absence. Pas de gêne, pas de glace à rompre, presque pas de connaissance à faire. D’emblée, nous nous trouvions sur un terrain commun d’idées et de sentiments.
A la première heure, le lendemain, selon l’habitude journalière, le chef de famille fit une lecture biblique devant toute la maison réunie, maîtres et serviteurs. Dans sa courte prière, il mentionna les nouveaux hôtes et envoya une pensée à leurs homes lointains.
Puis chacun se rendit à son travail. L’habitude de faire le culte domestique est encore largement répandue aux États-Unis. Je le tiens pour une des manifestations religieuses les plus authentiques et les plus salutaires s’il peut être préservé de la routine et se garder des formules stéréotypées, et rester journellement l’expression fraîche et laïque des sentiments et des pensées qui ressortent de la vie familiale, comme des événements ambiants. Et j’ai toujours senti, à m’y associer, cette grande douceur qui nous vient de la communion des âmes. Prier ensemble en toute vérité et simplicité, en dehors de tout rite prescrit, dans la pure mutualité humaine, c’est bien la plus haute façon de fraterniser.
Lindenhurst est une belle demeure, construite en plusieurs fois. Tout se groupe autour d’un hall central très vaste, d’où monte un large escalier aboutissant au premier étage, à un second hall. La plupart des pièces d’habitation donnent sur ces halls, eux-mêmes habitables, garnis de plantes, de meubles confortables, de belles peintures, sculptures et autres objets d’art d’un goût parfait. Un orgue est placé à moitié hauteur de l’escalier. Au rez-de-chaussée s’ouvrent les galeries de tableaux, très vastes, contenant toutes sortes d’œuvres de maîtres. A la suite est une belle et large salle construite spécialement pour les deux grandes toiles de Munkaczy : Le Christ devant Pilate et le Christ en croix. On ne saurait qualifier cette maison de luxueuse, si par ce mot on désigne un entassement de richesses destinées à faire une impression de faste et de vie somptueuse, mais d’où l’âme est absente, ainsi que la vraie beauté. Lindenhurst est une demeure dont la physionomie et l’organisation font honneur à son habitant, parce que l’habitant fait honneur à la demeure. Elle contient des trésors d’art ; mais ce qui me la rend chère et précieuse avant toute chose, c’est qu’elle abrite une vie d’homme vraiment et absolument dévouée au bien, au travail intelligent et secourable, un homme qui, s’il a dans New-York et Philadelphie deux énormes magasins où se vendent des produits du monde entier, n’a qu’une seule parole et sait la tenir, un seul désir, celui d’employer ses moyens, et de s’employer lui-même de son mieux pour le plus large bien de tous.
Qu’on ne me donne aucune explication ! Je veux regarder par moi-même. Il se peut ainsi que je passe à côté de merveilles sans savoir qu’elles existent. Mais du moins ce que j’aurai vu, ne m’aura été ni préparé ni arrangé par quelqu’habile cicerone désireux de me faire voir les choses à sa façon. C’est ainsi que je compte me promener aujourd’hui autour de Lindenhurst, et demain à travers Philadelphie et l’Amérique.
Le parc est joli, mais d’une étendue modérée. Principe de l’habitant : il ne faut mettre à rien plus de dépense qu’on ne saurait justifier. Le jardinier qui me montre les serres et la collection d’orchidées, fait observer que celle-ci est incomplète, toujours d’après le même principe. Un tel principe vaut les plus rares orchidées.
Je sors du parc et me promène dans une belle campagne ondulée. Partout brille la golden Rod, gracieuse et rustique fleur nationale. Entre les collines, des ravins profonds où circulent des torrents fort capricieux. Aujourd’hui ils dorment, demain ils se réveillent, furieux, et se font un jeu sauvage d’emporter les arbres et les ponts. Un semblable jeu a eu lieu, il y a seulement trois jours. Où est le torrent ? Parti comme un méchant garçon après un mauvais coup. Mais il a semé partout les malheureuses victimes de ses terribles amusements. Il y a quelque chose de fantasque dans la météorologie de ce pays. Les sautes rapides de température, les coups de vent, les excentricités atmosphériques y sont à l’ordre du jour.
A droite et à gauche des routes que nous gagnons progressivement, voici des villas, construites en pierres, en bois, surtout en bois. Elles sont posées sous de beaux platanes et autres essences d’arbres aux larges feuilles, parmi lesquels le maple. Cet arbre qui se retrouve dans les promenades, les parcs, le long des routes, a cela de commun avec le bouleau qu’il y circule au printemps une sève surabondante. On la lui soutire, par les mêmes procédés, pour en faire un sirop exquis. Les Américains en sont très friands et le mangent au déjeuner, avec des crêpes.
De clôtures peu ou point. J’en avais déjà remarqué l’absence dans la campagne de New-York. Les propriétaires ne marquent pas avec excès les limites de leur territoire, par des murs, des grilles, des haies, des palissades, comme cela se voit fréquemment en Europe, où dans certaines contrées la hauteur des murs détruit tout l’horizon. Je n’ai pas aperçu dans toute l’Amérique de ces murs de jardins, déjà irrévérencieux par leur seule hauteur, mais socialement aggravés par les tessons de verre et les culs de bouteille dont leur sommet se hérisse. Une telle armature sur une muraille est une démonstration antiamicale pour les passants. Elle doit exciter aux mauvais sentiments contre le propriétaire, et faire souhaiter qu’il soit volé.
Très souvent des kilomètres entiers de petites et grandes propriétés se suivent, le long des routes et des avenues, sans être séparées par autre chose qu’une petite haie, un sentier bordé de gazon. Du gazon il y en a partout, un gazon serré et permettant aux habitants de s’y livrer à leurs jeux et leurs ébats. Vous rencontrez rarement en Amérique un promeneur proprement dit. Ce charme de l’existence leur semble inconnu. La canne, inséparable compagne du flâneur, est presque introuvable. En revanche, partout, autour des villes et des habitations, sur les collines, sur les gazons des parcs, des joueurs sont installés, jeunes et vieux, hommes et femmes, jouant à des jeux variés, comportant généralement de l’adresse, du mouvement, des cris et souvent une véritable ivresse de joie ou de combat. L’Amérique, cela se remarque dès le premier jour, cherche son plaisir dans le mouvement et la liberté. Mon ami Joseph Elkinton, habitant ce pays accidenté des environs de Philadelphie, et que j’avais vu se livrer autour de sa maison aux jeux que comportait l’automne, m’écrivit après Noël : « Vous devriez nous revoir maintenant. Tout est couvert de neige. Il y a de la glace sur toutes les pièces d’eau. A nos heures de loisir nous descendons les collines en petits traîneaux, nous patinons, et nous avons tous l’air d’Esquimaux. »
Ce qui m’intrigua fort, c’est de voir si peu de jardins proprement dits. Il y a quelques fleurs autour des demeures, des roses mêlent leurs couleurs au fond vert des plantes grimpantes. Mais le jardin est généralement absent. Ce potager qu’adore le Français, ce petit coin près de sa demeure, où le citoyen-campagnard mêle aux fleurs qui sont la beauté et la grâce, le persil et la ciboulette qui représentent l’utilité, vous le chercherez en Amérique sans le trouver autrement qu’à l’état d’exception. Mais tous ceux qui ont un peu de terrain y font paître une vache, quelquefois un petit troupeau. Et des poules multicolores égaient par leur plumage et leur caquetage le voisinage des maisons. Qui demeure dans ces maisons, comment y vit-on ? C’est ce que de prochaines occasions nous révéleront sans doute. Mais elles sont gracieuses, les maisons de campagne américaines, les maisons de bois entourées de galeries couvertes avec leurs fenêtres claires et riantes encadrées de lierre ou de vigne sauvage. Et d’après la physionomie des maisons qui dit bien des choses, je conclus, moi passant rêveur, que ce doivent être des demeures de braves gens.
Pour flâner, sans crainte de s’égarer définitivement, ce qui est toujours désagréable, il faut, après s’être éloigné suffisamment du point où l’on désire revenir, prendre comme règle de tourner à chaque nouveau chemin, toujours à droite ou toujours à gauche. Mon vieux système, ce jour-là, me ramena, au bout de plusieurs heures, dans les jardins de Lindenhurst. On n’est pas rural et jardinier pour rien. Dans ce pays nouveau, chaque légume m’intéressait, et même les herbes du chemin. Il m’était agréable de fouler, le long des sentiers du nouveau monde, les petits trèfles et les plantins qui bordent les chaussées européennes. Ils souriaient à mes pieds comme de vieilles connaissances.
Mais voici une sorte de rotonde où des fauteuils invitent à s’asseoir. Pourquoi pas ? L’air est doux, et la course fut longue. Et bientôt je m’endormis, ayant comme dernières impressions, une brise caressante, soulevant de larges feuilles aux berceaux des vignes chargées de grappes noires, et balançant des poires d’or aux rameaux inclinés des arbres.
A mon réveil, une petite table de jardin était devant moi, toute dressée. Pour assiettes, des feuilles ; pour mets, des fruits. A ce service se reconnaissaient des mains d’enfants. Mais ces petites mains de bonnes fées qui avaient discrètement apporté leurs dons, où donc étaient-elles ? Ma surprise avait des témoins, et des témoins incapables de cacher leurs sentiments. Des rires étouffés partirent de derrière un buisson, et je vis venir à moi une petite fille brune, de sept ou huit ans, pouvant bien être la fille d’un jardinier, et une blonde du même âge, avec de larges yeux bleus et des boucles d’or dévalant sur ses épaules. Celle-là, visiblement, était de la grande maison.
Nous ne fûmes pas longs à devenir amis. Je croquais des poires savoureuses et des raisins au goût de muscat. Et je me délectais à entendre ces voix fraîches parler anglais. Je leur racontai une histoire ; elles dirent : « encore une », et cela devint une série.
— Voulez-vous venir prendre le thé dans ma maison ? dit alors celle qui avait les yeux bleus.
— Très volontiers, et à quelle heure ?
— A cinq heures.
A l’heure indiquée, Mary vint me prendre par la main et me conduire à sa demeure. Car elle avait une maison sous bois, une maison de poupée ; mais dans laquelle on pouvait entrer. Avec un peu de bonne volonté, je parvins à m’introduire par la porte. Et le charme de l’enfance envahit ma pensée. Grâce à une suffisante diplomatie, mes jambes furent casées sous la jolie petite table verte, et en avant la causerie ! Par la fenêtre, on voyait la forêt où couraient quelques chevreuils, sans crainte. Le soleil envoyait des rayons tamisés. Ils dansaient parmi les ombres des feuilles, sur la nappe blanche. Dans la chambre proprette, il y avait un vrai buffet, de la vraie vaisselle. Plusieurs poupées des mieux élevées nous tenaient société. Nous causions comme deux grandes personnes ou comme deux enfants, comme vous préférerez. Les enfants sont, dans le monde, les personnes les plus vraiment sérieuses. Nous autres, toujours quelque chose nous trouble à l’arrière-plan. L’enfant vit pleinement sa vie et la prend absolument au sérieux. Le mieux que les grands puissent faire, c’est de rester enfants ou de le redevenir. Une des joies de mon voyage a été ce five o’ clock tea chez Mary.
Pouvais-je, avant de la quitter, lui refuser de lui raconter encore une histoire ! Non. Je lui racontai donc une histoire de plus, et ce fut un moment de contentement paisible, exquis. Certainement, le plaisir de l’enfant à entendre raconter, ne pouvait pas dépasser celui que j’éprouvais à la voir écouter, écouter avec son âme entière, comme les bois écoutent les sources, comme les fleurs écoutent les abeilles.
Dès la fin de juillet, le Président m’avait invité à venir à la Maison Blanche pour le 26 septembre « To dine and spend the night. »
J’avais souvent pensé d’avance à cette rencontre. Et je me trouvais à la veille. J’allais donc voir l’homme dont la personne s’est conquis dans le monde entier une si vive sympathie et une admiration si sincère. Et la proximité de l’entrevue me donnait à la fois de la joie et de l’angoisse. Quelle impression me produirait le contact personnel ? Et lui, qu’éprouvera-t-il à voir de tout près celui qu’il avait bien voulu honorer de loin, pour son œuvre de semeur et ses idées.
Je relus certains passages de ses livres, me rappelai ses actes, me répétai ses bonnes lettres dont chacune avait été pour moi un événement du cœur, afin de bien fixer dans mon esprit la figure de celui chez qui j’allais.
Dans ces dispositions j’arrivai à la Maison Blanche, le 26 septembre, vers la fin de l’après-midi.
La demeure présidentielle est un bâtiment de style grec aux lignes simples, tout blanc et situé au milieu de jardins immenses. Au delà de ces jardins se trouve le monument de George Washington. Il affecte la forme d’un obélisque colossal dont le jet droit monte comme le symbole d’une grande idée. On entre à la Maison Blanche ainsi que dans une maison privée. Point de garde militaire. L’impression dominante est celle de simplicité. Pour ma part, cette absence complète de faste me produisit plus d’effet que tout ce que j’ai vu de plus grandiose en fait d’exhibition de force et d’autorité autour de la demeure des souverains. Comme habitation, cela laisse peut-être à désirer. De tout temps les familles des Présidents ont eu à se plaindre du manque de confort. Mais la Maison Blanche est maintenant un monument historique. Aucune demeure splendide, aucun palais, quelque riche et beau qu’il soit, ne pourra jamais la remplacer.
Un domestique me conduisit dans ma chambre. Vers les huit heures, je fus averti que le Président me faisait demander.
Je le trouvai avec Mme Roosevelt dans les salons du rez-de-chaussée où sont les portraits des anciens présidents. Il vint à moi les bras tendus. Un instant après, nous étions à table, au nombre de quatre : le Président, Mme Th. Roosevelt et Mme Roosevelt-West, de New-York. C’était le dîner intime.
— Où sont les boys ? dit le Président.
— Ils ont déjà ôté leurs souliers, répondit quelqu’un.
— Qu’ils viennent tout de même dire bonjour à M. Wagner.
Et je vis venir deux jeunes garçons de neuf à onze ans, visiblement fatigués d’une longue course, et dont les yeux présageaient qu’ils dormiraient bientôt.
— J’ai une très importante question à vous poser, dis-je à l’un d’eux : Quand vous dormez, est-ce à mains ouvertes ou à poings fermés ?
— Je ne sais pas, répondit-il, après un moment, puisque je dors.
Le Président rit de bon cœur de cette réponse, la seule qui fût bonne à donner, et les jeunes gens s’empressèrent de gagner leur lit.
— Nous eussions été plus satisfaits, dit le Président, de vous recevoir à Oysterbay, notre home, où nous passons plusieurs mois d’été. Je vous eusse proposé, et vous auriez été homme à accepter, de passer une nuit au dehors à dormir sous les grands arbres. Vous auriez vu trois familles de nos cousins, vivant dans notre voisinage, et leurs enfants et les nôtres au complet, en tout une troupe de dix-sept.
J’exprimai mon regret au Président de n’avoir pu profiter d’une si charmante occasion de connaître tous les chers siens, et l’espoir qu’un jour ou l’autre cette occasion se représenterait.
J’avais, dès les premières salutations, transmis au Président des États-Unis les compliments personnels dont notre Président, M. Émile Loubet, avait bien voulu gracieusement me charger, lorsque je fus lui présenter mes hommages avant mon départ.
Maintenant la conversation s’engageait sur la multitude des sujets qui nous intéressaient : questions d’éducation familiale et culture de l’esprit public ; rapports sociaux ; relations internationales et bonne volonté internationale ; questions religieuses.
Nous parlions tour à tour français, allemand, anglais. A un moment donné, mettant en commun des réminiscences du répertoire de poésie allemande, nous fîmes des citations de divers « Lieder » et en particulier de Vater ich rufe dich !
Sur le terrain des sentiments de famille, je trouvai le Président inépuisable de tendresse et de filial respect. C’est avec émotion et presque les larmes aux yeux qu’il parle de tout ce qui touche au sanctuaire du foyer. Il l’appelle la pierre angulaire de l’humanité. En cela, je le reconnus immédiatement comme un homme de cœur en qui la fibre humaine essentielle est d’une sensibilité et d’une puissance saisissantes. Parlant de ses sentiments religieux, il dit : « Je suis très attaché à ma vieille Dutch Reform-church, et je suis en même temps de l’Église universelle. »
Pour ce qui est de l’esprit public, rien de ce qui peut contribuer à renforcer la bienveillance mutuelle et la cohésion des citoyens ne le laisse indifférent. Doué d’une rare pénétration à qui toutes les finesses de la pensée sont familières, il s’intéresse cependant avant tout aux idées pratiques, semblables au pain de ménage, susceptibles de devenir une nourriture largement répandue. Il aime répéter que ce qui importe à la santé et à la puissance d’un peuple est beaucoup moins l’existence de quelques caractères isolés, d’une extraordinaire hauteur, qu’une bonne moyenne générale dans l’esprit public. Le nerf, l’énergie individuelle, le sentiment de la responsabilité sociale, une décision primordiale de marcher droit et de ne pas se laisser détourner, voilà ce qu’il apprécie avant tout, en y joignant une large disposition sociable qui consiste à n’aller pas jusqu’au bout de son droit, par égard pour le prochain.
On ne saurait s’exprimer d’une façon plus sympathique à l’égard d’un peuple, que le Président, à bien des reprises, ne s’exprima à l’égard du nôtre. Il estime qu’avec un peu plus de clairvoyance, les nations civilisées de ce temps auraient de grandes chances d’éviter les guerres et d’établir leurs affaires sur ce principe, que les intérêts profonds des peuples sont identiques. Si quatre ou cinq des plus puissantes, arrivent, ce qui est en voie de se faire, à établir entre elles le régime de l’entente amiable, elles pourront même empêcher les autres de troubler la paix universelle.
Je voudrais pouvoir fixer ici la physionomie du Président, telle que je l’ai vue. Sa figure, d’une mobilité extraordinaire, est rebelle à la photographie ou à la peinture. Tous ses portraits le trahissent en le figeant dans l’immobilité. Si on ne l’a vu lui-même, on ne peut s’en faire une idée. Chacune de ses paroles s’accompagne d’une expression particulière du visage. Il a surtout un mot qu’il dit souvent, avec un jeu de physionomie typique, c’est le mot : exactly. C’est un vivant qui se met simplement et entièrement dans chacune de ses manifestations. L’abord est bienveillant et sans façon. Point de signes, même légers, annonçant le grand personnage. Ce n’est pas seulement la simplicité démocratique. C’est la large et accueillante simplicité humaine. On sent un homme qui est à toutes les hauteurs : égal aux plus grands, proche des plus humbles. J’éprouvai une pure joie de l’âme à le voir ainsi, car c’est le signe de la vraie grandeur que d’être naturel, dépourvu de prétentions, oublieux des petites précautions de vanité que certains emploient pour donner du relief à leur personne.
Le Président des États-Unis est un homme tout simplement, un des exemplaires qui honorent le plus notre vieille famille. Il donne l’impression d’une force concentrée, d’un ressort tendu. On le sent prêt à faire, sur l’heure, l’effort définitif, à payer de sa personne si la cause le réclame. Au-dessus de sa table de travail, il est représenté à cheval franchissant un obstacle. C’est l’image de son beau tempérament, généreux, vaillant, entreprenant, dévoué jusqu’au sacrifice suprême. Cet homme-là ne reculera devant rien, si ce n’est devant mal faire. Car c’est un scrupuleux autant qu’un décidé et un fort. Ce leader obéit à la loi intérieure. Ce chef d’État républicain, plus armé par la Constitution que la plupart des souverains constitutionnels, a la délicatesse de conscience d’un enfant : c’est un honnête homme, pour dire le seul mot juste. Vous ne lui ferez jamais choisir les sentiers tortueux ; s’il choisit d’aller à un but, soyez sûr qu’il y marchera tout droit.
Avec cela il voit très clair et ne se fait pas d’illusions. Il connaît la vie et les hommes, et les dessous de leurs jeux hypocrites. C’est un réaliste qui croit à la victoire du bien. Mais il sait que cette victoire doit être le prix de la lutte journalière contre les éléments de décomposition. Il a beaucoup agi et beaucoup réfléchi. Son corps, assoupli et aguerri, capable de toutes les fatigues, habitué aux privations, est à son service comme un bon cheval qui ne peut rien refuser à son maître. Pendant qu’il est assis, tranquille, à deviser avec des amis, il ne fait point l’impression du bourgeois confortable. Son repos est une préface à l’action. Il sait que le combat est la loi de la vie. Mais il ne combattra jamais que le bon combat. Et c’est pour cela que ce combatif est un pacifique. Ceux qui l’accusent d’impérialisme ne le connaissent pas. Son patriotisme n’a rien d’agressif ni de menaçant.
S’il veut une Amérique forte, c’est afin de n’être pas à la merci du bon plaisir d’autrui et de pouvoir aimer la paix sans encourir le reproche de faiblesse. En cela, tout le peuple est avec lui. Pacifiques et indomptables, c’est leur caractère.
L’Amérique aime son Président. Il n’y a pas une maison de souverains parmi les plus vieilles, les plus légitimement affectionnées dans leur pays, qui jouisse d’une sympathie aussi profonde et aussi large que la personne et la famille du jeune Président des États-Unis. Tous les âges, toutes les classes sociales le vénèrent. On dirait qu’il est l’ami principal de chaque famille. Sa parole a une autorité inouïe sur tout le territoire, et cela, non par l’effet d’une popularité bruyante et superficielle, mais par l’effet d’un ascendant tranquille et authentique. Aux dernières élections, tout effort tenté contre lui a tourné contre ses adversaires, et depuis sa réélection triomphale, l’équité de son jugement et son absence de rancune politique convertissent à lui ses antagonistes eux-mêmes. Chacun sait qu’il représente la meilleure Amérique. Il a mieux qu’une politique, il a un idéal, et cet idéal est conforme aux plus nobles traditions comme aux plus sérieux intérêts d’avenir de la République. Les destinées du pays sont en bonnes mains.
Je considère comme un extraordinaire privilège d’avoir pu passer de longues heures paisibles sous son toit, à m’entretenir à cœur ouvert avec un homme de sa valeur. Pour ceux qui s’intéressent aux destinées universelles de la famille humaine, c’est un grand soulagement de cœur que de rencontrer au centre vital d’un grand peuple, d’un peuple dont l’influence se fait sentir jusqu’au bout du monde, un caractère de cette trempe, un cœur de cette bonté, une si belle et si compréhensive intelligence. Dans un de ses discours, le Président avait dit : « We hold that the prosperity of each nation is an aid, not a hindrance for the prosperity of other nations ».
Je me rappellerai toujours des paroles comme les suivantes, qui doivent être citées et retenues, et sur lesquelles je termine :
« Reading your books makes me feel more clearly than ever, that fundamentally there are just the same needs for us, on this side of the water as for you on the other. We are all alike at bottom, in needing to cherish the same virtues and to war on the same evils. The brotherhood of nations is no empty phrase[4]. »
[4] En lisant vos livres, j’ai senti, plus clairement que jamais, qu’il y a au fond les mêmes besoins pour nous, de ce côté de l’eau, que pour vous, de l’autre. Nous avons tous le même but, qui est de chérir les mêmes vertus et de combattre les mêmes maux. La fraternité des nations n’est pas une phrase creuse.
Après le dîner, par une température douce et une nuit de lune claire, dont les rayons, caressant au loin les arbres et les gazons, mettent en évidence le jet blanc du monument de Washington, la causerie se prolongeait sous la galerie extérieure de la Maison Blanche, tournée vers les jardins. Le Président introduisit un visiteur qui venait d’arriver, et dit ensuite : Voici un collaborateur qui vient s’occuper avec moi de mon élection… « We have some fighting. » Il avait dit déjà, en faisant allusion à la campagne qui battait son plein : « Si je suis élu, je resterai avec satisfaction ; si je ne le suis pas, je quitterai mon poste avec le sentiment d’y avoir fait mon devoir. » Après un moment, le Président se retira, ainsi que le nouveau venu.
Dans le salon familial où Mme Théodore Roosevelt nous pria ensuite de monter, le premier mot que dirent ces dames fut celui-ci : Parlons français ; nous aimons tant votre langue. En effet, ces dames s’exprimaient avec une aisance parfaite. La conversation roula sur la France, sur plusieurs côtés ignorés et fort intéressants de notre vie nationale, vie de famille et beaucoup d’autres bonnes choses, peu connues à l’étranger ; je m’aperçus que mes interlocutrices prenaient de l’intérêt et du plaisir à ce que je pouvais leur raconter. Et je dis : « Mais, je suis tout prêt à vous faire sur toutes ces choses, à la première occasion, une conférence détaillée, pour vous toutes seules ». Oh ! non, répliqua la Présidente, à une telle conférence nous inviterons beaucoup de monde ; tous nos amis de Washington qui savent goûter une conférence française. Et quel titre donnerez-vous à cette conférence ? — Tout simplement celui-ci : « La France inconnue. »
Et il fut entendu que je donnerais cette conférence lors de ma deuxième visite à Washington, à la fin de ma tournée, en novembre.
Puis la conversation prit un tour entièrement familial. Des questions me furent posées sur la composition de ma famille et l’âge des enfants. Quand on est loin des siens, on éprouve une grande douceur à en parler. Il fut parlé ensuite d’Oysterbay, des enfants du Président, et je vis une quantité de photographies artistiques d’après lesquelles il me fut facile d’avoir une idée de la vie charmante de simplicité que l’on mène là-bas.
Le lendemain, au déjeuner, le Président dit : « Je suis au courant de ce que vous avez comploté hier au soir avec ces dames : une conférence à la Maison Blanche sur la « France inconnue ». Mais n’aurons-nous pas une conférence publique à Washington ?
— Justement, on est en train de l’organiser. C’est l’Union chrétienne des jeunes gens de la ville qui en prend l’initiative.
— Très bien ; en ce cas que ces Messieurs veuillent bien choisir un local pouvant servir de rendez-vous à un auditoire nombreux. Et je viendrai moi-même, vous présenter au public.
Après le déjeûner nous fîmes une promenade à travers les jardins. Je vis les rosiers auxquels Mme Roosevelt donne ses soins elle-même, et la conversation se continua.
Vers les neuf heures, je quittai la Maison Blanche.
Dans le jardin, je rencontrai les plus jeunes fils du Président. J’avais fait un bout de causerie avec eux, le matin, dans le Hall du rez-de-chaussée où ils sculptaient des marrons en forme de figures humaines. Et l’un d’eux m’avait dit : « C’est vous, Monsieur, qui avez écrit des histoires et des farces pour amuser les enfants ; nous ne comprenons pas le français, mais maman nous les a traduites. »
Maintenant, tête nue, en simple blouse de coton bleu, avec quelques livres sous le bras, ils se rendaient à l’école publique.
Pour ma part, je partais, le souvenir plein de cette journée et m’en remémorant les détails. Le Dr Radclyffe, pasteur de l’église que fréquentait autrefois le Président Lincoln, me fit faire un tour à travers Washington et les parcs. Quand il me montra son église, je remarquai que tout le mobilier venait d’être renouvelé. Les bancs étaient flambants neufs. Mais parmi eux un vieux banc demeurait et semblait ressortir par sa couleur plus sombre : c’était le banc de Lincoln.
Quelques instants après, visitant la magnifique bibliothèque de Washington, nous nous trouvions dans la rotonde centrale d’où partent dans tous les sens les salles remplies de livres, et nous examinions l’ingénieux mécanisme par lequel on reçoit les volumes, quelques minutes après les avoir demandés. Un silence religieux régnait par ces espaces studieux, garnis de lecteurs, dont quelques-uns, pour mieux s’isoler, avaient la tête prise entre les deux mains et se bouchaient les oreilles avec les pouces. Tout à coup, sur un balcon supérieur, j’aperçois un groupe de savants français, retour de St-Louis, parmi lesquels se détachait la barbe noire de mon ami Jean Réville. Le plaisir de voir, à cette heure et d’une façon tellement inattendue, ce bouquet de doctes compatriotes, m’arracha un cri spontané de surprise et de contentement. Cette bruyante explosion de joie patriotique fit quelque peu scandale parmi les lecteurs absorbés dans leur attention muette. Je fis amende honorable au bibliothécaire, témoin de l’incident, et des sourires indulgents me prouvèrent que ma transgression était pardonnée.
A Cornwall-on-Hudson demeure M. Lyman Abbott, directeur de la revue « Outlook ». C’est une des figures les mieux connues en Amérique. Non cependant qu’il ait la physionomie typique de l’Américain moyen, soigneusement rasé et vif en couleurs. Représentez-vous plutôt une tête d’ascète au front lumineux, agrandi par la calvitie du sommet de la tête. La figure, plutôt pensive et douce, est relevée par une couronne de cheveux blancs et une longue barbe. On se le représenterait volontiers dans une cellule. C’est un grand travailleur qui a écrit beaucoup de livres, se tient au courant de la philosophie et de la critique et connaît bien l’Europe où il est venu souvent. Mais ce qui le caractérise particulièrement, c’est dans sa personne, sa parole, la forme de sa pensée, une limpide et bienveillante simplicité. Le calme du sage et sa souriante bonté se reflètent sur sa figure. « Je voudrais vous faire voir, m’avait-il écrit en août, un coin de vie rurale et de vie simple chez nous. » Donc, le 29 septembre, nous partions sur un des grands steamers qui font le service de l’Hudson. A peine sortis du port de New-York, la pluie se mit de la partie. L’Hudson avait mis son manteau de brume, et nous naviguions sur une eau grise, entre d’invisibles rivages. Puis la nuit enveloppa le paysage, et c’est par une complète obscurité qu’une voiture nous emporta vers « The Knoll », demeure familiale des Abbott. Des ténèbres du dehors, nous émergeâmes dans la blanche lumière d’une gentille maison de bois, où nous reçut la figure souriante de Mrs Abbott, l’exact pendant de son mari, avec ses traits d’aïeule fins et un peu pâlis.
Après une soirée passée en longues causeries, dans une maison qui constitue un véritable centre intellectuel, par les membres de la famille et leurs amis, tous livrés aux travaux de l’esprit, curieux de musique, d’art et de tout ce qui concerne le mouvement de la pensée et de l’action bonne dans le monde, nous prîmes du repos dans de jolies chambres à coucher, claires, ventilées. Elles étaient ornées seulement de quelques gravures, comme il fait bon d’en regarder, soit qu’on se lève soit qu’on se couche, images pleines de sens et de haute humanité et qui vous communiquent toujours une bonne force. Je me suis souvent, dans la vie, aperçu du fait que les maisons avaient une âme. Celle qui nous accueillait sous ce toit était bienfaisante.
Pendant la nuit, l’accès de mauvaise humeur qui s’était emparé du temps, la veille, se passa. Les collines sortirent fraîches et lumineuses des vapeurs du matin. Le soleil sécha les chemins. Et bientôt, emportés par des routes accidentées, ce fut une course idéale, sans poussière ni chaleur, en voiture découverte. Papa Abbott guidait d’une main exercée. A son joli arabe noir, svelte et léger, il avait joint un auxiliaire pour faciliter la course. Mais il nous fit observer que cet auxiliaire, qui faisait tous les jours autre chose entre d’autres mains, était un cheval de louage quelconque, tandis que son petit cheval noir à lui avait une individualité.
Bientôt nous rejoignîmes un vaste domaine ramassé entre deux longs plis de terrain, et cultivé par une famille amie. Nous pûmes à l’aise en examiner la culture et le bétail. Dans l’écurie, au-dessus de la place où se suspendent les harnais, on voyait, tracées sur les poutres, de belles inscriptions. Toutes fort concises, elles renfermaient des principes d’ordre et de bonne tenue. Nous vîmes la laiterie propre et fraîche. La pièce principale où se conserve le lait n’a pas de plancher, mais une eau pure et froide y court sur de menus cailloux polis. Dans cette eau, les jattes de lait et de crème sont posées.
Le lait est, en général, très bon en Amérique. Il s’en fait une grande consommation. Beaucoup de gens l’emploient comme boisson de table. On vend même dans les gares et les restaurants, du lait baratté dont la légère acidité est fort agréable au goût et qui rafraîchit pendant les chaleurs de l’été. Ce lait paraît aussi sur les tables. Et tout cela est généralement très frais. Le moindre ménage là-bas tient à avoir sa petite provision de glace.
Par la vacherie, la porcherie, nous gagnons les jardins. Hélas ! quoique nous ne fussions que fin septembre, une nuit de gel rigoureux avait grillé toutes les plantes délicates. C’était lamentable à voir.
Au sortir du jardin, entre les lignes molles des collines boisées, où l’automne mettait son or et sa pourpre, dans la féerie flamboyante des feuillages rouges, un sentiment de grande paix vous gagnait. Quelle différence avec le bruit et la poussière de la cité où nous nous mouvions, la veille, à la même heure !
Une courte visite à la maison d’habitation nous fit voir un intérieur confortable aux pièces vastes, boisées, garnies de livres. Autour du perron d’entrée, des citrouilles, alignées, constituaient une sorte de garde très champêtre. Pour monter en voiture, comme pour en descendre, une large pierre sert de degré intermédiaire entre la terre et le marchepied plutôt élevé du véhicule. Cette petite installation, qui évite aux voyageurs de faire une trop large et trop pénible enjambée, se retrouve partout et fait partie de ces mille détails qui indiquent le savoir-vivre pratique.
Une demi-heure après, nous étions dans les plantations de pommes du fermier Shaw à Mountainville. Cet homme de bien nous reçut au pas de sa porte et nous conduisit sur le penchant d’une colline, dans un verger immense. A perte de vue sur le gazon, s’alignaient des pommiers en haut vent, chargés de pommes superbes, vieil or rosé, paille enluminée de grenat. Il y en avait à foison. Les branches basses, pareilles à des mains, semblaient les offrir et dire : « goûtez-nous ! » On ne doit jamais négliger une bonne occasion. Comme je mordais dans ses fruits à belles dents, M. Shaw me dit en souriant : vous aimez donc les pommes ? — Beaucoup, lui répondis-je, et les vôtres ont un goût exquis…
Or, plusieurs mois après, de retour dans ma maison, je reçus, un jour, une caisse de pommes venant d’Amérique. Enveloppées chacune d’un papier-parchemin, elles étaient, après Noël, et restèrent jusqu’à Pâques aussi fraîches qu’au premier jour. Et je pensais, en les croquant, aux penchants des collines automnales, aux gros rouge-gorges américains qui ont la taille des grives de France et qui chantaient ce jour-là dans les buissons, et à la bonne figure de M. Lyman Abbott, dont les coursiers noirs, guidés d’une main sûre, nous emportaient par des paysages variés, où de temps en temps miroitait, au tournant d’une colline, la vaste nappe d’argent de Hudson-River.
Bethany-Church, à Philadelphie, a été pour moi la première révélation d’une vie religieuse manifestée en des formes que je n’avais pas rencontrées encore et dont, par la suite, l’Amérique devait me fournir un grand nombre d’exemples. Je désire consacrer par un signe spécial de reconnaissance, le jour, pour moi à jamais inoubliable, que j’y vécus, le 25 septembre 1904. La veille, j’avais dit à mon cher ami, M. John Wanamaker : Demain, je veux partager votre dimanche en entier. Dès huit heures et demie, par un radieux soleil, nous roulions de Lindenhurst à Philadelphie. La belle lumière du matin revêtait tous les objets de cet éclat béni qui vient en somme de nos âmes croyantes et fait paraître le dimanche plus beau que les autres jours. Je me réjouissais de voir cette douce lumière de dimanche, heureux d’avoir reçu dans ma jeunesse une éducation qui me rendait capable de la discerner, heureux d’être dans un pays où l’on sait ce que ces mots veulent dire : le jour que Dieu a fait. En face de moi, John Wanamaker, oubliant le fardeau de ses prodigieuses affaires, relisait dans la Bible des passages qui devaient être médités ce jour-là. Je remarquai dans son chapeau haute forme une poignée de fleurs. Ce sont les fleurs qu’il emporte tous les dimanches matins, pour les offrir à des malades, le long de la journée.
A neuf heures, nous atteignons Bethany-Church, large bâtiment qui renferme une église, une immense salle pour l’école du dimanche, des locaux variés pour les classes bibliques, les associations de jeunesse, et la Brotherhood, association d’hommes ayant comme but de s’encourager mutuellement à la bonne vie, et qui puise la meilleure partie de ses inspirations dans des passages de l’Ancien et du Nouveau-Testament. Nous fûmes reçus à la porte par quelques membres de la Brotherhood qui nous conduisirent d’abord dans une pièce étroite où se tenaient une cinquantaine d’hommes, chefs et membres de la grande société fraternelle. Salutations, présentations, puis brève discussion sur des sujets de vie religieuse pratique. Personne ne disait un mot inutile. Une sérieuse simplicité pénétrait les paroles, imprégnait les physionomies. On se sentait en compagnie d’hommes de valeur, pour qui le désir de bien employer la vie est le grand but.
Ce n’était là que le prélude d’une réunion plus grande, dans la vaste salle du sous-sol, contenant de huit à neuf cents personnes et qui se remplissait de moment en moment. Lorsque nous y descendîmes, un chant d’hommes nous accueillit à voix bien jointes en un hymne vibrant. Une onde magnétique m’enveloppa et fit tressaillir à travers mon être, je ne sais quelle force supérieure de sympathie. Je me sentais accueilli au sanctuaire de la bonne volonté, de la tendresse humaine. Un appel de la patrie supérieure arrivait jusqu’à moi sur les ailes de ce chant et, pareille à la harpe que touche un souffle de l’esprit, mon âme se mit à chanter en moi. J’adressai quelques paroles du cœur à tous ces nouveaux frères qui m’ouvraient visiblement leurs bras. Leur dessein ferme de se soutenir mutuellement dans la vie me faisait aimer leur contact. Une bonne force rayonnait de leur milieu. Une telle réunion d’hommes est une puissance dans la cité. La volonté de marcher d’accord pour purifier nos cœurs et nos habitudes, pour nous soutenir dans les jours difficiles, n’est-ce pas le plus fort de tous les remparts ?
Mais la réunion était finie, et l’heure venue de nous rendre au grand culte du matin dans la salle supérieure.
Là, m’attendait un spectacle saisissant. Aux deux bouts du large temple, sur des estrades, étaient assis deux chœurs de jeunes filles tout en blanc. La nef, les galeries étaient garnies d’un peuple compact, plein du désir de s’édifier. Toutes les figures disaient : sympathie et attente. Et lorsque les chœurs eurent chanté et que dans un grand silence où j’entendais battre mon cœur, je commençai mon premier sermon anglais, une bonté vraie rayonnant de tout l’auditoire, vint au secours de l’hôte qui parlait une langue, pour lui encore presque étrangère. Cette bonté me portait et me rendait capable de donner, de donner avec joie, tout ce que Dieu dans sa paternelle tendresse m’avait mis dans l’âme pour ces frères. Autour de moi étaient assis les pasteurs de Bethany, le cher Dr Decay, douce et intelligente figure d’un homme qui a beaucoup souffert et qui sait aimer, le Dr Patesson revenant au milieu des siens, après une longue maladie et une douloureuse absence. D’autres membres de l’église se tenaient près d’eux : il me semblait que leurs volontés renforçaient la mienne. Je n’avais jamais senti autant le secours que l’homme peut donner à l’homme. Et pourtant je les voyais presque tous pour la première fois. Comme la vieille parole me paraissait empreinte d’une vérité nouvelle, ce matin-là : « Où deux ou trois s’unissent en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
J’avais pris pour texte la parole de l’Évangile selon saint Jean : « Montre-nous le Père, » et la réponse de Jésus : « Celui qui m’a vu a vu le Père. » Parole immense, renfermant la vérité centrale de l’Évangile qui est celle-ci : « L’endroit du monde où Dieu est le plus près de nous, c’est une conscience d’homme par laquelle il nous parle. » Plus que dans les merveilles de la création, plus que dans les splendeurs du matin, plus que dans le mystère souriant de la voûte étoilée, le Père invisible nous a regardés par les yeux de Jésus. Ces yeux sont deux jours ouverts sur la vie infinie. En regardant dans l’abîme de leur douceur, nous voyons ce qui se passe dans le cœur de Dieu même. Mais une autre vérité découle de celle-là. Non seulement Dieu s’est traduit en humanité dans la personne de Christ, une fois et d’une mémorable façon ; mais il veut toujours se révéler ainsi. Jésus, dans le même passage, dit : « Vous ferez les œuvres que je fais. » Comme lui, chacun de ses vrais disciples montre le Père. Chaque homme est un témoin, un messager. Hélas ! il y a deux sortes de messagers : ceux qui annoncent la nuit et la propagent, par leur cœur froid, leur méchanceté. Ceux-là voilent la face du Père et remplissent le monde de ténèbres. Soyons de la série des messagers du jour, de ceux dont la vie et les paroles annoncent un monde plus beau, augmentent l’espérance et soutiennent la foi. Montrons le Père !
Je fus très édifié par les beaux cantiques que chantèrent ensuite les chœurs.
Après ce radieux matin, plein de bénédictions, je pris quelque repos. Puis vers les deux heures, nous vînmes assister à une séance de Bible-Union. M. John Wanamaker, d’autres et moi-même, nous prîmes la parole pour expliquer des passages de saint Paul, exprimer des expériences personnelles en rapport avec les textes. La Bible, on le comprend de suite, est pour ces hommes une mine d’où s’extrait une provision de force pratique. Ils s’occupent moins de dogmatique d’église ou d’exégèse scientifique, que d’exploitation vivante et intéressée des trésors d’âme cachés dans le Livre. Ces pages qui viennent de si loin et ont inspiré tant de générations de lecteurs, les pénètrent d’un profond respect.
De la chambre haute où se tenait la classe biblique, nous fûmes dans la grande salle de culte où se pressait un public très nombreux, parmi lequel beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles. Les pasteurs firent de brèves allocutions, et de beaux chœurs furent chantés. Ces chants me remplissaient de bonheur, et je répétais en moi-même certains refrains qui, à eux seuls, sont des prières pleines d’âme et de puissance : nearer to thee ! Tout l’ensemble de ces cultes me frappait par les éléments de vie qui s’y manifestaient partout. L’élément liturgique, traditionnel, y a sa large place ; mais il se renouvelle tous les jours au contact de la piété actuelle. Le culte du souvenir s’y mêle à la réalité présente, en une heureuse proportion.
Dans l’intervalle de deux chants, il se fit un silence. Absorbé dans les pensées que me suggérait cette musique, j’ignore pourquoi, juste à ce moment, j’eus le sentiment qu’il ferait bon entendre un solo. Comme une réponse immédiate au désir secret de mon cœur, je vis s’avancer près de moi, sur la plate-forme, une dame vêtue de blanc, et pour moi une inconnue. D’une voix d’alto magnifique, mais toute pénétrée de cette intensité de vie religieuse que le plus bel art seul ne peut jamais atteindre, elle chanta : Si j’étais une voix ! Depuis que j’avais entendu à Kœnigsfeld, à l’église des frères moraves : Herr wie du willst, chanté par une sœur inconnue, je n’avais plus entendu avec pareille force ce son direct de l’âme. Il me prit, il m’emporta sur les hauteurs de l’Évangile éternel où les morts sont vivants, où les aveugles ouvrent leurs yeux, où les langueurs sont guéries, le péché vaincu, l’espérance des saints accomplie. Cette voix me donnait en cette minute un don royal de bonheur supérieur, de pur et divin pressentiment de la vraie vie à travers nos terrestres obscurités. Les vers de Schiller chantaient dans ma mémoire :
La belle voix qui réveillait ainsi en moi, en une heure bénie, un monde de pensées et d’harmonie, était celle de Mme Sarah Macdonald Sheridan. J’ai appris depuis, que cette voix se faisait entendre souvent dans toutes sortes de milieux parmi lesquels il en est de très déshérités. Puisse-t-elle faire aux âmes de nombreux frères le bien qu’elle m’a fait ce jour-là !
Un chant semblable serait capable, je pense, de toucher des cœurs que la parole ordinaire laisse froids, et de porter la bonne nouvelle d’une vie plus humaine, plus haute, plus pure, à des cœurs fermés à nos moyens usuels.
Dans un local voisin de celui où nous étions, l’école du dimanche s’était, en attendant, réunie. M. John Wanamaker en est le surintendant. Il remplit ces fonctions et celles de membre de la Brotherhood, avec un zèle constant. A moins d’être en Europe, il ne manque pour ainsi dire jamais à son poste. Il s’y rend délibérément, toutes autres affaires cessantes. Une telle régularité est un exemple d’un bel effet donné aux milliers d’enfants qui suivent cette école. C’est un encouragement pour les moniteurs et un soutien moral extraordinaire pour les pasteurs. Surtout si le laïque ne se pique pas d’être un théologien, s’il est simplement un homme que la vie, tous les jours, instruit par elle-même, et qui cherche avant tout à mettre l’esprit du Christ dans les relations ordinaires, ce concours est précieux. Il apporte à l’église cet appoint de l’expérience vivante et fraîche, qui corrige heureusement les vétustés des formules et la sécheresse des catéchismes. Les laïques américains sont un des trésors des Églises. Et parmi ces laïques qui savent joindre la parfaite simplicité de cœur au poids que leur confère une situation exceptionnelle, je donne une place toute spéciale à M. John Wanamaker. Puissent les générations nouvelles nous donner des hommes semblables, afin de continuer leur salutaire tradition de largeur d’esprit et de piété agissante.
Quand je regardai l’école du dimanche de Bethany-Church, il me sembla voir devant moi un jardin de Dieu. Plusieurs milliers d’enfants s’y pressaient, frais, vêtus de couleurs claires, depuis les petites filles et les petits garçons de six à sept ans, jusqu’à la jeunesse adulte de dix-huit à vingt ans.
La disposition de cette salle superbe permet de la diviser à volonté, pour isoler les groupes, et donner à chaque catégorie l’enseignement que comporte son âge. Je fus séduit par les tout petits, réunis en très grand nombre autour d’une dame qui les intéressait par de grandes images, des chants simples et alertes, des explications à la hauteur de leur compréhension.
Ces gentils bébés me chantèrent avec beaucoup de conviction une bienvenue où je distinguai le refrain : Good morning to you !
Lorsque vient le moment de la leçon générale, tous les enfants sont réunis par la suppression des cloisons. Cette manœuvre se fait avec rapidité et sans bruit. Dans certaines églises américaines, il suffit de presser un bouton ou de faire mouvoir un levier, pour établir ou supprimer les cloisons. A Bethany, aussitôt que tous les locaux particuliers sont mis en communication, on est frappé du bel ensemble que présente la salle.
Un jet d’eau jaillit au centre, environné de bouquets de verdure. On a devant soi l’image gracieuse d’une jeune génération qui reçoit les enseignements de la tradition évangélique, dans le cadre le plus souriant.
Cette journée dont la paisible et caressante lumière me rappelait le vieux Psaume : « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs », devait se terminer le soir par la communion. Vers les huit heures, nous revînmes à Bethany. Philadelphie s’enveloppait des voiles du couchant ; le calme dominical régnait dans les rues et planait sur les demeures. Des groupes silencieux se dirigeaient partout vers les sanctuaires. Il y avait dans l’atmosphère un souffle d’adoration.
C’était l’heure crépusculaire où commencent à éclore, aux vastes et sombres champs de l’azur, ces fleurs d’éternité que sont les étoiles. Invinciblement, le regard se lève en haut. Je franchis le seuil du temple, silencieux, l’âme pleine d’un sentiment d’au-delà.
Dans l’intérieur, le peuple s’assemblait sans bruit. Les lumières éclairaient sur la grande table la multitude des vases sacrés. Ici étaient les calices et là le pain. Après un hymne, l’ami John Wanamaker me dit à voix basse : « Vous êtes notre hôte ce soir au repas du Seigneur, parlez-nous comme un frère. »
Je n’ai jamais rompu ce pain que le Maître nous apprit à rompre en souvenir de Lui, sans que mon âme fût consacrée à tous les chers morts et à tous les vivants. La grande question, le mystère de notre vie à tous, d’aimer et de souffrir, plane sur ce repas. Plus claire est la vision de la solidarité de la famille humaine, par dessus les barrières de la vie, et par dessus la barrière du tombeau, lorsque nous rompons le pain de l’esprit avec Celui qui marche d’âge en âge au milieu de nous, dans la sainte communion des épreuves et de l’espérance.
Ce soir-là, je Le sentis présent, tout près. Comme Lui, étaient près de moi de chers êtres que j’ai perdus, et tous les absents aimés, demeurés au home lointain. Et le cercle s’élargissait de cette communion, devenant de plus en plus vaste. N’étais-je pas d’ailleurs à Philadelphie, dans la cité de l’amour fraternel, centre de tant de belles traditions, au milieu des fils de Penn et des descendants des Pilgrim-Fathers ? Une invisible nuée de témoins s’amassait dans la pénombre, au-dessus des têtes des vivants.
Au moment donc où je pris la parole, mon inspiration était faite de toutes ces choses-là. Il me fut donné d’interpréter comme je l’éprouvais, la grande solennité de cette heure. Les cœurs se sentirent touchés dans la corde d’or qui vibre sous les sentiments éternels, et nous devînmes vraiment, par un effet sensible de l’Esprit, une seule âme.
C’est au milieu d’un de ces silences où l’on entend passer les ailes des anges consolateurs, que le vénérable pasteur se leva pour prononcer les paroles sacramentelles et bénir le pain et le vin. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Comme au fond des calices altérés se ramasse la goutte de rosée, ces paroles tombaient rafraîchissantes, vivifiantes, sur la soif des âmes. Celui qui veut être tout en tous et qui nous a tous compris et aimés, nous répétait : Je vous nourris de ma substance, je vous abreuve de mon suc. Le fruit de son sacrifice se renouvelait en chacun, et l’on se sentait fortifié par la vertu qui ranime les genoux abattus, éclaire les esprits enténébrés.
La source secrète de la vie supérieure semblait ouverte, et des courants d’eau vive ruisselaient à travers les champs spirituels.
Il est des instants où le voile qui recouvre le grand mystère semble transparent. Nous saisissons la Vie éternelle d’un seul regard, par la foi.
Plus de crainte, ni de doute, ni de discordance, mais une confiance complète, la certitude tranquille, la plénitude de l’harmonie.
Les vallées sont comblées, les montagnes abaissées, les orages apaisés, les distances franchies. Ce qui paraissait loin est tout près, ce qui paraissait perdu est retrouvé.
Ces moments-là sont d’une richesse infinie. Des siècles s’y condensent. On y fait provision de clarté pour les périodes sombres.
Je venais de vivre à Bethany un de ces instants éternels.
Oh ! le cher souvenir que j’en garde et garderai toujours !
Comme je bénis le Père qui me l’accorda, les frères qui m’en fournirent l’occasion !
Et comme Jacob, le matin où il quitta Béthel, je me dis en quittant cette chère maison de prière :
Un des signes extérieurs de la vie religieuse dans une nation, est la fréquentation du culte. A l’heure où se célèbrent les offices, la rue est peuplée d’une foule à l’aspect très particulier. Les passants ont leur psychologie. On éprouve des impressions différentes à regarder passer des files de gens, selon qu’ils vont à la promenade, au cimetière, à leurs affaires quotidiennes, ou reviennent des courses et du spectacle. Un autre esprit anime les hommes, suivant les préoccupations différentes du moment.
Dans les villes américaines, le dimanche matin, les avenues conduisant vers les églises présentent une animation singulière et un aspect calme tout à la fois. Tous ces passants paraissent recueillis. On sent qu’ils savent où ils vont. En allant, ils pensent déjà à ce qu’ils entendront ; en revenant, ils y pensent encore. En un mot, ils font la bonne impression de prendre très au sérieux l’affaire dont pour le moment ils s’occupent.
Point n’est besoin de me signaler ce qu’une semblable démarche, ayant pris place parmi les habitudes, peut avoir de superficiel. Partout la tendance existe à aller du côté où va le grand nombre. La religiosité extérieure des uns peut être une affaire de snobisme, comme l’irréligiosité des autres. L’esprit d’imitation ne perd jamais ses droits.
Je n’ai aucune peine à penser que, parmi ces foules qu’un mouvement large et coutumier emporte vers les églises, il peut se trouver des êtres de routine, des mondains, des hypocrites qui, le dimanche, louent le Seigneur, et en semaine trompent le prochain. Le monde est le monde, les hommes sont les hommes. Nos ombres et nos tares nous suivent partout, comme nos belles qualités. Mais cela dit, afin qu’il soit bien entendu que je ne m’en laisse pas imposer par des manifestations extérieures, je déclare avoir été très impressionné par cette marche vers les sanctuaires, le dimanche.
A New-York, à Philadelphie, à Chicago, partout où j’ai passé un dimanche, j’ai vu la même chose. Admettons que ce soit une habitude ; il y en a de bonnes. Et parmi les meilleures, il y a celle de mettre un jour à part, pour se reposer, se souvenir qu’on n’est pas une bête de somme, et aller se réunir à ses semblables de toute catégorie, afin de penser aux grandes vérités qui dominent la vie, aux lignes essentielles de notre destinée, par où nous sommes unis à travers toutes les distinctions de surface. Dans certaines habitudes visibles se trouvent de réelles et fidèles manifestations de l’invisible.
La vie religieuse en Amérique est représentée par une multitude de sociétés et d’églises diverses, remplissant toute la gamme des idées et des sentiments humains. Entre ces divers groupements existent des contrastes et des contradictions ; mais au fond, leur nombre même est un signe de belle vitalité. On peut légitimement se demander si dans les petits centres plusieurs chapelles ne sont pas un luxe nuisible ; s’il ne conviendrait pas de se rapprocher, pour mieux aspirer au but après tout commun, et cette question se pose tous les jours et de plus en plus avec force. Mais de l’état de choses tel qu’il existe pratiquement, différentes observations également favorables doivent être tirées.
D’abord une entière liberté est le bien commun de toutes les églises. Aucune différence n’est faite en faveur ni au détriment de personne. Les fidèles entretiennent leur culte à leurs frais et l’organisent comme bon leur semble. Au sein de la liberté générale, chacun respecte son voisin. Il est contraire à une pratique universellement adoptée, de prêcher les uns contre les autres. Chacun fait de son mieux et laisse le voisin tranquille. Entre les diverses dénominations, des rapports de cordialité existent et sont en voie d’augmentation. On sent qu’on a besoin les uns des autres, et les occasions de fraterniser sont recherchées avec ardeur. D’année en année se multiplient les points de contact[6]. Il n’en a pas toujours été ainsi. L’histoire américaine a connu des périodes d’intolérance aiguë. Et, certes, on n’aurait pas besoin de chercher longtemps pour trouver des échantillons actuels et vivants d’une mentalité sectaire, déniant le droit au nom de chrétiens à ceux qui pensent autrement que nous. Mais un progrès immense s’est réalisé vers la justice mutuelle, le respect de l’âme et des croyances d’autrui. L’étroitesse devient l’infime exception, la largeur est la règle. L’Amérique a appris la liberté et le respect de la liberté, à l’école de l’histoire. Elle a compris où mène l’autoritarisme religieux, et son tempérament national, tel qu’il s’est lentement formé par la bonne volonté, la persévérance, le désir d’être avant tout équitable envers chacun, s’est de plus en plus nettoyé de la peste sectaire.
[6] Tout récemment il s’est formé une association appelée Ministers Union, ayant pour objet de provoquer des rendez-vous fraternels entre les ministres de tous les cultes, et de cultiver la solidarité religieuse.
Mes livres m’avaient fait connaître au sein des dénominations les plus diverses. Je fus donc invité à donner des conférences et à prêcher dans les églises presbytériennes, épiscopales, méthodistes, unitaires, luthériennes, congrégationalistes, baptistes. J’eus même le rare privilège de prêcher à la synagogue, ce qui constituait en Amérique même, un événement exceptionnel.
Le dernier jour avant mon départ, je reçus une lettre de la Présidente des Dames de Saint-Vincent-de-Paul, me priant de donner une conférence en faveur d’une des œuvres de la Société. Ce fut pour moi un regret très profond que d’être empêché par l’heure imminente du retour en France, de donner une preuve de sincère et fraternelle sympathie à l’église catholique.
Dans les églises protestantes on remarque très couramment un mélange que je considère comme très heureux entre la tradition et la pensée actuelle. Ce fait se remarque déjà dans la forme même des édifices du culte. On s’y sent enveloppé d’un esprit et entouré d’objets où le respect du passé et la piété indépendante et vivante se rencontrent en une alliance heureuse. Naturellement, les exceptions ne manquent pas. Le formalisme et la raideur dogmatique d’une part ; de l’autre la sécheresse rationaliste, l’absence de la fibre mystique et la méconnaissance de l’âme du passé, sont des phénomènes spirituels qui se rencontrent aussi bien que dans notre vieux monde. Mais l’impression d’ensemble est celle d’une piété saine et vivante, respectueuse de l’esprit des traditions, et les continuant avec intelligence dans les plus libres manifestations de la pensée et du sentiment contemporain. Ce fait m’a permis de comprendre largement les chrétiens d’Amérique avec lesquels je pus me rencontrer, et d’être largement compris par eux. J’ai appris à beaucoup les aimer pour leur aménité, l’ouverture de leur esprit, leur chaleur d’âme et leur hardiesse de vues. Libre et laïque disciple de l’Évangile perpétuel, dépensant depuis trente ans ma peine à traduire les hautes et vieilles vérités en langage usuel et assimilable, j’ai parfois eu la douleur, sur mon cher vieux continent, d’être pris pour un démolisseur, alors que, jour et nuit, je taille et pose des pierres pour collaborer, dans la mesure de mes moyens, à bâtir la cité nouvelle de l’âme. Là-bas, toutes les joies spirituelles qu’on éprouve à être profondément compris, m’ont été si richement accordées, que je ne pourrai plus jamais me plaindre des petites amertumes causées par l’étroitesse et ses injustes préventions.
Une foule d’églises américaines sont institutionnelles, c’est-à-dire entourées de tout un ensemble d’œuvres éducatrices et sociales. De vastes sous-sols et des bâtiments adjacents servent aux réunions d’enfants, de jeunes gens, à des cercles de lecture, de couture, à des divertissements variés. Plusieurs fois nous avons vu des tables dressées dans les salles, pour recevoir, le soir, de nombreuses sociétés dans un repas fraternel. Les membres des congrégations se rencontrent ainsi autre part que dans les réunions cultuelles proprement dites. Et l’Église devient un centre où l’isolé trouve une famille ; la jeunesse, des camarades et un milieu favorable à son éducation progressive. Dans beaucoup de ces réunions de sociabilité, le chant et la musique instrumentale sont très cultivés ; les recueils de chants sont bien faits et bien en harmonie avec le sentiment religieux contemporain. Aussi la coopération de chœurs très exercés et de la communauté, dans le chant cultuel, donne-t-elle un résultat qui vous remplit d’admiration. L’ampleur de ces beaux chants pleins d’âme et de force, est un merveilleux élément d’édification. Que de fois leur harmonie m’a transporté, inspiré, reposé !
L’atmosphère de liberté a donné naissance, sur le sol des États-Unis, à un catholicisme d’un genre très particulier, vivant, original, décidé à marcher d’accord avec ce que ce temps a de meilleur. Nous le connaissons en France par un grand nombre de publications, en particulier les livres de Mr l’abbé Klein. Il mérite au plus haut point notre attention et notre sympathie, et contiendrait d’utiles leçons non seulement pour le catholicisme, mais aussi pour le protestantisme de notre vieille Europe. L’esprit de liberté, de hardiesse chrétienne, de large et lumineuse compréhension des devoirs nouveaux des disciples du Christ, y a trouvé des représentants individuels d’une valeur exceptionnelle, et produit des collectivités ne laissant rien à désirer au point de vue de leur puissance pratique pour le progrès moral et religieux. Je me suis fait un devoir et un plaisir de pousser une pointe jusqu’à Saint-Paul, afin d’y présenter mon hommage au vénérable évêque, Monseigneur Ireland. Dans l’esprit où il est représenté par ce grand homme de bien et plusieurs de ses collègues les plus autorisés, le catholicisme est éminemment sympathique. Il est bien Américain, libéral, décidé à vivre en harmonie avec les autres groupements religieux.
A côté de lui, sans doute, un autre catholicisme se forme, particulariste, exclusif, et dont les allures actuelles ne peuvent qu’être déplorées par les amis mêmes de l’Église catholique plus large et plus généreuse, au nombre desquels je me compterai toujours. Cette tentative de mouvement en arrière m’a suggéré certaines réflexions qui s’appliquent aussi bien aux autres groupements religieux qu’au groupement catholique, et sont vraies des deux côtés de l’Océan.
Les Églises ont bien des forces à mettre en ligne. Entre autres, elles ont une grande puissance de résistance à opposer à ce qu’elles croient devoir combattre, et un bel et merveilleux pouvoir d’attraction et d’assimilation pour ce qui leur apparaît comme favorable. Plus une force est considérable, plus elle doit être maniée avec clairvoyance. Les Églises usent-elles toujours de leur influence avec un suffisant discernement de leur devoir et de leur intérêt supérieur ? Il est permis de se le demander. Malgré leur sagesse si ancienne, si merveilleusement raffinée, et que nous voudrions pouvoir respecter, il leur arrive de faire des confusions entre leur force de résistance et leur force d’attraction. Souvent, lorsqu’il s’agirait de mettre en campagne les pouvoirs d’attraction et d’assimilation, elles emploient leurs engins de résistance. Elles opposent une barrière massive à ce qu’elles devraient accueillir. Par une confusion inverse, elles accueillent ce qu’elles devraient combattre.
Les groupements religieux qui ont pris à tâche, parmi nous, de mettre en relief, surtout leurs qualités d’opposition, ont manqué à la fois à ce qu’ils se devaient à eux-mêmes et à leur temps. En considérant la situation actuelle de l’Église catholique, par exemple, ceux qui lui veulent du bien ne sont-ils pas autorisés à penser qu’elle s’est fait du tort en Europe et notamment en France, par une attitude combative à l’égard de quelques principes essentiels du monde moderne, comme la liberté de conscience et d’examen, le droit commun, les principes démocratiques, la critique historique ? C’est cependant à l’adoption de ces principes qu’elle-même, aussi bien que tous les autres groupements religieux contemporains, pourraient devoir une nouvelle évolution, d’une destinée déjà si longue et si magnifique. Pourquoi combattre à outrance ce qui vous sauverait, et garder ou accueillir des idées et des pratiques malsaines ?
Le catholicisme américain est une preuve manifeste de la justesse de nos réflexions. Ce qui l’a fait grand, viable, puissant, c’est l’atmosphère de liberté qu’on respire là-bas.
Un terrible danger menacerait son développement, le jour où des conseillers mal inspirés lui feraient changer sa méthode. Il serait contraire à la sagesse élémentaire de vouloir introduire sur la terre de liberté, les vieux errements qui ont si souvent fait suspecter l’Église par l’Europe libérale.
Le grand problème religieux qui se présente au pays, aujourd’hui, est celui de la transposition de son patrimoine vénérable, en paroles et pensées capables d’être assimilées par la mentalité moderne. Si l’Amérique religieuse, suivant les errements de certains groupements d’Europe, voulait s’abstraire de la pensée de ce temps et se calfeutrer, d’après la méthode des conservatismes caducs et séniles, elle deviendrait, au sein de la nation, un corps isolé, peu à peu dégénéré en corps étranger. Et elle descendrait au rang d’une simple puissance d’inertie, au lieu d’être ce qu’elle a toujours été et ce qu’elle doit rester, la véritable énergie directrice de la nation. Pour guider, inspirer, pénétrer l’esprit public, donner à l’éducation de la jeunesse son orientation, condenser, en un mot, dans un idéal sans cesse renaissant, toutes les meilleures aspirations d’un peuple, il faut rester vivant soi-même, ne rien négliger, ne rien mépriser, unir au pieux souvenir par lequel on garde le meilleur de l’héritage du passé, l’esprit de recherche, de labeur, de liberté par lequel se conquiert l’avenir.
L’Amérique saura résoudre ce problème, parce qu’elle reste prête à recevoir les impulsions nouvelles de l’esprit divin, seul capable, à chacune des étapes successives de l’humanité, de nous inspirer le verbe nécessaire et de nous fournir la manne fraîche dont nos âmes ont besoin. Elle a, dans toutes les dénominations, un grand nombre d’hommes qui sont arrivés à harmoniser, dans leur vie intérieure, le respect des saintes traditions et le devoir de rester en contact avec la vie présente et ses besoins. Ces hommes s’entourent de toutes les lumières qui peuvent les aider à traduire, sans en rien perdre, les vieilles vérités en langage nouveau. Nous avons été heureux de trouver en leurs mains, les livres de notre éminent compatriote Auguste Sabatier, l’un des hommes les plus croyants et les mieux documentés de la société contemporaine. La synthèse des traditions et des aspirations vivantes a trouvé, en lui et dans ses écrits, une expression heureuse. Il est un de ceux à qui l’avenir devra le plus, quand seront frayées les routes, vaincus les obstacles, établis les nouveaux abris de l’âme. L’ayant beaucoup connu et aimé, ayant partagé les souffrances que faisait endurer à ce vaillant pionnier de l’Esprit, la méfiance d’un ecclésiasticisme étroit, j’ai éprouvé une joie profonde à voir que, par la grâce de Dieu, qui ressuscite les morts, ce cher disparu est un de ceux qui aident là-bas à bâtir la cité religieuse de demain.
Lorsque les anciens quittaient leur patrie pour établir quelque part une colonie nouvelle, ils emportaient, avant toutes autres choses, les divinités du Foyer. Car il y a des divinités hautes et lointaines et des divinités familières. On a bien besoin que les faits de la vie domestique, les devoirs, les joies et les douleurs de tous les jours, se passent sous un regard vénéré, sous une protection sanctifiante et rassurante.
Les premiers colons d’Amérique, ceux surtout qui ont le plus contribué à la faire ce qu’elle est devenue, apportèrent la Bible. Beaucoup d’entre eux étaient des victimes de l’étroitesse sectaire. Des persécutions violentes les avaient obligés à quitter le sol natal. Étrangers sur une terre nouvelle où tout était à créer, ils s’étaient arrachés des antiques traditions. C’étaient des déracinés. Mais, heureusement pour eux, ils emportaient le Livre qui est à lui seul une tradition et une patrie.
Lorsqu’ils l’ouvraient, le soir, sous les abris récents que leur activité créait en défrichant les solitudes, des sentiments s’emparaient de leurs cœurs, analogues à ceux qu’éprouve l’homme séparé de son pays et des siens, quand il regarde les étoiles. Il voit ce qu’il avait vu autrefois dans sa patrie. Le même sourire qui rayonnait sur son enfance, et qui rayonne encore sur le pays qu’il a quitté, le salue à cette heure. Tout a changé autour de lui. Comme il est doux pour lui de regarder à ce qui ne change jamais !
En ouvrant la Bible, au centre de la famille, les colons du Nouveau Monde rallumaient leur foyer, ils y retrouvaient les plus doux souvenirs, les pensées les plus réconfortantes. Ce livre ne pleure-t-il pas de toutes les douleurs des hommes ? Ne chante-t-il pas de toutes leurs espérances ? N’est-il pas une carrière inépuisable d’où se peut extraire du granit et du marbre, pour bâtir des cités nouvelles ?
Sans traditions, sans lois publiques, sans organisation, livrés à eux-mêmes, en face de l’immensité des territoires inexplorés, ces premiers colons américains trouvèrent dans le Livre tout ce qui leur manquait. Il les rendait riches, au sein de la pauvreté. Ils l’ont donc aimé plus que d’autres, lui devant davantage, et se trouvant amenés par des circonstances exceptionnelles à mieux mesurer ce qu’ils lui devaient. Et cet amour pour le Livre qui leur a fourni les pierres de leurs cités, la base de leur Constitution, le toit de leur maison, le pain de leur âme, cet amour, où la reconnaissance se mêle à la Foi pieuse et à l’expérience évidente, ils l’ont transmis à leurs successeurs.
Des flots de populations ont beau se déverser sans cesse sur les États-Unis et y apporter du sang et des idées de toutes les contrées, à la racine de la vie nationale, au cœur du pays se trouve, fortement constituée des meilleurs éléments d’une religion large et harmonieuse et des plus solides essences d’une morale foncièrement droite et sûre, la mentalité biblique. Tout le monde comprend le langage de la Bible et ses grandes et impressives images. Dans le langage quotidien, dans le style des écrivains et des journalistes, dans l’enseignement des professeurs, dans les discours des hommes d’État, partout se retrouvent non point des citations textuelles, ni l’odieux patois de Canaan, qui est presque toujours un signe d’hypocrisie, mais d’involontaires réminiscences de la poésie biblique, des couleurs empruntées aux paysages bibliques, aux montagnes de la Bible, des bouffées d’air vivifiant venant du Thabor ou de Golgotha.
Non seulement l’Amérique a ses Sociétés bibliques, ses Bible-houses, ses Bible-classes, pour lire et commenter les Écritures, elle a fondé les Bible Teachers Training schools (écoles pour former des professeurs bibliques). J’ai visité celle de New-York, qui est une petite Université. Le but de ces écoles est de faire connaître le Livre à ceux qui désirent l’interpréter ou l’enseigner.
Parmi les idées directrices de la méthode employée dans ces écoles, se trouvent quelques points dignes d’être notés. Je les transcris du bulletin de l’école de New-York.
« Le plus grand besoin de l’Église est la connaissance des Écritures. L’Unité si désirable de la chrétienté pourrait venir, non de considérations sentimentales ou pratiques, mais d’une plus profonde initiation aux vérités de la foi qui résulterait de l’étude de la Bible elle-même. La Bible doit être étudiée avec le même scrupule scientifique que n’importe quel autre livre, et par les méthodes les mieux qualifiées :
S’efforcer de prendre une vue fraîche des faits, sans se laisser restreindre ni limiter par aucun système, ni doctrine. En même temps, éviter l’erreur consistant à penser que nous ne pouvons rien apprendre de nos prédécesseurs. Car il y a deux tendances néfastes dans l’étude : la première consiste à tout accepter de seconde main, et la deuxième consiste à refuser d’accepter quoi que ce soit des autres.
Ne jamais rien transporter dans les Écritures, mais en tirer tout ce qui s’y trouve réellement contenu ».
Voilà d’excellents principes. Une foule d’amis éclairés de la Bible s’efforcent de s’y conformer. Loin de fuir les travaux scientifiques sur cette matière, ils les recherchent et les divulguent de leur mieux. Et combien ils sont fondés dans leur belle confiance ! La Bible est un livre où la lumière religieuse et la chaleur morale du passé sont contenus, comme dans les mines de charbon sont condensées les végétations d’autrefois avec tout le soleil qu’elles ont bu. De ce soleil emmagasiné on peut refaire de la lumière.
Mais n’allons pas à ce livre avec des idées préconçues. La Bible est le livre le moins exclusif qui soit. Elle est comparable à cette maison du Père dont le Christ parlait, et où il y a beaucoup de demeures. Si les différentes mentalités humaines veulent bien s’installer dans ces demeures et laisser leurs voisins en faire autant, sans prétendre que la partie où chacun s’installe est le tout, de leur cohabitation fraternelle résultera la plus grande richesse de vues. Car la Bible est compréhensive comme nul autre livre. Toutes les heureuses contradictions qui font la vie et le mouvement et que les sectaires excluent méthodiquement de leurs conceptions, s’y trouvent réunies en une harmonie supérieure. Les systèmes nous asphyxient par leur logique. La Bible est un reflet de la vie elle-même, illimitée, sans clôture et où par conséquent on respire librement. L’étude, sans arrière-pensée dogmatique, des Écritures, est le meilleur tonique pour un esprit religieux. Considérée sous cet angle, elle est peut-être autant et plus un livre d’avenir qu’un livre du passé. Certains autoritaires néfastes ont appelé la Bible le livre des Hérétiques, et par là ils pensaient la qualifier comme un livre dangereux en liberté, salutaire seulement en esclavage. Ils ont, pour cela, capté ses francs et vigoureux torrents, pour leur faire tourner les roues de leurs moulins particularistes. Mais il vient toujours un moment où les torrents s’émancipent, emportant les meules, les moulins et les meuniers.
La puissance par excellence, celle dont toutes les manifestations de la substance en activité, les plus amples déploiements de vigueur créatrice, les plus subtiles énergies comme les plus formidables explosions dévastatrices ne sont que de lointains symboles, c’est l’Esprit. La traduction humaine de l’Esprit c’est la Parole, le Verbe. Le Verbe est sacré. Que personne ne touche à sa liberté ! Et le Verbe par excellence, la Parole, ce qu’il a été dit et pensé de meilleur dans le monde où nous sommes, c’est la Bible. En détail, à la naissance de chaque parcelle qui la compose, comme en son ensemble, ce Verbe a subi bien des assauts. On a lutté contre lui avec toutes les armes dont disposent la ruse et la violence. Mais ses plus grands ennemis n’ont pas été les antagonistes profanes, ce sont les amis maladroits, ceux qui essaient de le domestiquer dans leurs sacristies. La Bible est comme les aigles ; il faut lui laisser le libre déploiement de ses ailes. Laissez le Verbe voler et sonner en liberté, et il vous délivrera. C’est le plus hardi, le plus neuf, le plus croyant de tous nos héritages, et en même temps le moins tyrannique et le moins intolérant.
Il y a dans ce livre des multitudes de morts qui sont vivants et qui aspirent à parler aux vivants qui sont morts. Il sera toujours le livre merveilleux de toutes les alliances par lesquelles nous sommes forts, anciennes alliances et alliances nouvelles.
Le meilleur souhait qu’on puisse faire à l’Amérique, c’est qu’elle reste capable de comprendre et d’aimer ce livre et son incommensurable Esprit, afin que, de la vieille et vivace souche des Prophètes et de l’Évangile, des rejetons toujours frais s’élancent à chaque génération qui refleurit.
Et puisque nous sommes sur ce chapitre de la Bible, laissez-moi tracer, en finissant, un parallèle entre deux façons fort différentes de se servir des Écritures.
Pour les uns, la Bible est un arsenal où sont conservées des armes pour assaillir le prochain. Depuis la hache de pierre et la flèche empoisonnée, jusqu’aux explosifs qui rappellent les torpilles, tous les engins de destruction s’y trouvent accumulés. Les sectes et les Églises ont largement puisé dans cette collection. En parcourant la Bible à ce point de vue-là, on pourrait indiquer les passages par lesquels on pourfendit telle doctrine, étrangla telle hérésie. Les champs de bataille, les places d’exécution et de massacres y sont marquées exactement.
Mais la Bible n’a pas été faite pour nous exterminer les uns les autres. Ceux qui l’emploient ainsi, commettent le crime d’abus que l’on peut toujours commettre, en détournant les meilleures choses de leur usage naturel.
Il existe fort heureusement une autre méthode considérant la Bible comme une provision de puissance réconfortante, de clarté d’âme et de tendresse. Pour elle, ces pages antiques rappellent des bienfaits sans nombre. Ici, les malheureux, depuis des siècles, sont venus se réfugier dans les hautes retraites. Là, les courages abattus ont trouvé de quoi se restaurer. Ailleurs, les cœurs torturés par le souvenir des fautes ont trouvé le pardon. Et le livre est riche non seulement de ses propres ressources, mais de tout l’immense capital du bien qu’il a fait.
Cette dernière façon de comprendre les Écritures est de plus en plus largement pratiquée aux États-Unis.
Parmi tous les éléments, si divers, de la population américaine, dont l’accueil demeure gravé dans mon souvenir, je dois une mention particulière à la « Société des Amis ». C’est surtout à Philadelphie, la ville de Penn, que ses fils, encore aujourd’hui, sont nombreux. Peuple de rude et vigoureuse simplicité, plein de mépris pour le mensonge des conventions et les prescriptions formalistes, les Amis, de longue date, prêchent et cultivent la « Vie Simple ». C’est leur idéal. Une vive sympathie les portait donc vers mes idées. Ils y reconnaissaient leur esprit et leurs aspirations séculaires. De mon côté, voici des années que j’avais le désir de les voir. Il m’était arrivé, le long de ma carrière, de fréquenter quelques personnes pratiquant la religion sous cette forme laïque, large et vraiment humaine, et la droiture de leur conscience, leur bonté sans phrases, m’avaient fait une impression extraordinaire. Rien ne conquiert mon âme comme l’absence de prétentions, de circonlocutions et de compliments. Les Quakers ont si bien rompu avec tout formalisme qu’on pourrait presque les trouver formalistes par excès de simplicité. Ainsi, n’est-il pas admis qu’on invite quelqu’un à leurs meetings. Je n’y fus donc en aucune façon invité. Et j’eusse été pour toujours privé du plaisir de m’y rendre, si j’avais attendu qu’on m’y engageât. Il se trouva, comme par hasard, quelqu’un qui me persuada que je devais y aller tout bonnement.
Donc, j’y allai, et personne ne parut y prendre garde.
Dans le local, rien que des bancs. Pas d’orgue, pas de chant, pas d’images. Les fenêtres sont placées de telle sorte qu’elles éclairent la salle très discrètement. Mais on ne peut pas voir ce qui se passe au dehors. Tous les Amis sont laïques, ils n’ont pas de pasteurs. Quand ils se réunissent, chacun prend place en silence, sans s’occuper des voisins. Personne ne regarde autour de soi. N’importe quel visiteur survient, nul ne paraît s’en soucier. Tout le monde reste dans une apparente indifférence. On dirait que les « Amis » ont pris aux vieux stoïciens leur : nil mirari.
L’assemblée commence par se taire. Ni lecture liturgique, ni chant ; on ne dit rien, on pense. Les figures sont caractéristiques, sérieuses et bienveillantes. Un grand calme et une inspiration pacifique domine tout. Jamais je n’ai mieux compris ce que dit le silence d’une assemblée qui, tout entière, pense et se recueille. Si personne ne trouve un motif suffisant pour rompre ce silence, l’assemblée se retire comme elle était venue, une fois le temps raisonnable d’un meeting écoulé. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun assistant de regretter qu’on n’ait point parlé. Les Arabes, dit-on, se méfient des gens loquaces et honorent les silencieux. Les Quakers, en ce point, sont Arabes.
Il me parut évident toutefois que pour moi, venir et repartir silencieusement, serait une faute contre les principes des « Amis », qui consistent à faire ce que l’Esprit nous engage à faire. L’Esprit m’incitait à leur parler. Comme j’avais bien des choses à leur dire, je me levai et parlai de mon banc. Un certain nombre d’hommes et de femmes me répondirent brièvement. Après le meeting, un grand nombre de personnes vinrent causer avec moi, me tutoyant selon leur habitude : « J’ai lu ton livre ». « Je suis content de te rencontrer. »
Chez eux, les Amis sont absolument délicieux. Leur calme fait tant de bien aux âmes de ce temps agité. Je ne me suis pas lassé de contempler la bonne figure à la fois virile et pacifiée de quelques-uns d’entre eux. Un certain vieillard surtout me frappa par la profondeur et la beauté de ses yeux bleus. J’y sentais comme un reflet de la paix divine. Ne rien craindre, ne pas se tourmenter, ne pas se troubler ni se presser : agir avec bon sens, tranquillité et confiance en Dieu, voilà une grande partie de leurs principes. Un autre, c’est de respecter l’esprit en chaque homme. Personne n’a une semblable vénération pour la conscience, et ne montre plus de délicatesse à respecter son intégrité. Pas d’autoritarisme, pas de contrainte. Toute individualité est sacrée en son originalité. Jamais nous n’avons à nous substituer à la conscience d’un autre, pour amener des actes par lesquels il n’est que notre instrument.
On ne peut pas juger des « Amis » par leur nombre aujourd’hui assez limité, ni par leur surface et la place qu’ils prennent dans le monde. Comme ils sont modestes et méprisent la gloire bruyante, ils ne soignent pas la réclame. Il faut donc un certain temps pour se rendre compte de leur valeur comme principe actif dans la société présente.
De fait, par leur honnêteté, leur laborieuse simplicité, leur esprit de contentement et d’ordre, ils se sont créé, de longue date, une place extraordinaire. Plusieurs des plus grandes affaires du pays sont, de père en fils, entre leurs mains. Ce sont des hommes d’affaires scrupuleux et intelligents. Beaucoup d’entre eux ont de grandes fortunes, mais ils n’en font point étalage, et leur générosité discrète honore grandement leur caractère.
Plusieurs des meilleures écoles de Philadelphie et des environs sont entre leurs mains. Dans certaines de ces écoles se trouvent exclusivement des enfants d’Amis. Ailleurs, les Quakers sont éducateurs pour le compte du public.
Beaucoup de besogne et peu de bruit, telle semble être la devise de ces éducateurs. Leur calme est à lui seul une puissance éducative. Rien ne vaut un maître qui ne s’étonne de rien et garde la même humeur tout le long des jours, surtout si cette humeur est invariablement accommodante. Vous ne verrez pas ce personnel enseignant rivaliser de sourires et de chatteries pour la jeunesse. Pas du tout : ils sont tout simplement bons, d’une bonté égale. Une trop démonstrative bonté est un soleil qui alterne facilement avec les bourrasques. C’est parfois de la nervosité souriante, et des nerfs, en éducation, il n’en faut pas.
Bien souvent, en passant par ces tranquilles retraites de l’éducation, un regret s’éveillait en moi, de n’être pas enfant. J’eusse été heureux de partager la vie dont je voyais ici l’organisation, une vie normale, vraiment humaine, et pénétrée, sans ostentation aucune, d’un parfum spirituel qui rappelle les senteurs forestières plutôt que l’encens des sacristies. Ces braves gens ont la pudeur de la religion. Ils l’ont partout présente et nulle part affichée. Leur langage est aussi naturel, aussi exempt que possible de toute pieuse formalité.
Ils aiment les enfants qui sont l’avenir, et savent comment les traiter, sans les gâter ni les opprimer. Ils aiment les morts qui sont le souvenir, et savent les honorer sans empiéter sur les droits de la vie.
Tandis que dans le préau de « Friends select school », à Philadelphie, je voyais filles et garçons jouer et s’amuser, je me promenais dans un terrain voisin, le long d’un vieux mur ensoleillé, garni de buissons, où de petites fauvettes se lustraient les plumes. Là-haut, sur la tour de l’Hôtel de Ville de Philadelphie, la statue colossale de Penn semblait veiller sur la cité, ses parcs, ses deux fleuves, son port toujours en travail de vaisseaux. L’activité de la ville immense battait alentour dans ses vigoureuses artères. Tout à coup, de mon pied, je heurte une pierre de la taille d’une brique. Sur la pierre était un nom, un des grands noms des « Amis d’Amérique ». Je regardai plus attentivement, et je vis d’autres pierres et d’autres noms, juste à la hauteur de l’herbe fauchée. C’était un vieux cimetière. Ils dormaient donc là, les os de ces vaillants pionniers, dont plusieurs avaient tant contribué à bâtir l’Amérique. Ils dormaient là, ces pacifiques qui, de tout temps, avaient subi des persécutions, parce qu’ils voulaient la paix obstinément. Je pensai à leur esprit de sacrifice, à leur foi tranquille, à cet héroïsme presque surhumain qui marque certains épisodes de leur vieille histoire, à leur patience invincible qui rendait leur résistance à toute tyrannie semblable à celle de l’irréductible caillou qu’aucun rouleau ne parvient à écraser. Les cris de joie des enfants vibraient dans mes oreilles, et la poussière des morts tressaillait sous mes pas. Je me sentis parcouru par une impression électrisante de belle et large vie où la fraîcheur matinale s’allie à la solidité traditionnelle. Et sur les tombes des chers anciens je priais pour leur postérité aux regards ouverts, aux joues florissantes, pendant que sur les ailes de la brise et les rayons du soleil m’arrivait un salut mystérieux du Père invisible en qui se joignent et se tiennent les générations.
Pendant la dernière semaine de mon séjour à New-York, je reçus un mot du Rev. Dr Blum, rabbin, d’origine alsacienne, me demandant un rendez-vous. Nous nous vîmes le lendemain. C’était un vendredi. — Vous avez beaucoup d’amis en Israël, me dit M. Blum, et une quantité de ceux qui ont lu vos livres seraient contents de vous voir ; viendriez-vous à la synagogue pour les rencontrer ?
Je lui répondis que rien ne pourrait me faire un plus grand plaisir. Il courut informer le Dr Silvermann, le distingué rabbin de Tempel Emmanuel. Tous deux vinrent ensemble m’inviter à assister aux offices du lendemain, samedi.
Note fut prise du rendez-vous, et une grande joie spirituelle était par moi ressentie à l’idée d’aller célébrer un culte avec les descendants des vieux Prophètes, les fils de la race à qui le monde doit Jésus-Christ et les plus purs trésors de son patrimoine religieux. Je me rappelai tous les chers amis juifs de Paris, et particulièrement une maison qui m’est, entre toutes, près du cœur et où depuis des années, de par la volonté d’une bonne grand’mère qui n’est plus, j’ai été fraternellement associé aux solennités familiales de la fête de Pâques. Une telle invitation s’étendant à un infidèle (pour parler en style orthodoxe), n’était, certes, conforme à aucune règle officielle, mais elle partait d’un si bon esprit, était acceptée avec un cœur si chaud, qu’il m’a toujours semblé qu’un peu d’avenir meilleur était en germe dans l’hospitalité exercée autour de cette table pascale où planent de si vieilles et si vénérables traditions. Je n’ai jamais pu oublier que Jésus a institué le repas de l’alliance nouvelle et mondiale, à la table même où il venait de manger le repas de l’ancienne alliance.
— Voyez, m’avaient dit ces amis, lors de mon départ, ce que font dans le domaine religieux, moral, social, éducationnel, les Juifs américains, et racontez-le-nous en revenant.
Déjà j’avais, au Congrès universel de la Paix de Boston, entendu les discours de rabbins, tels que le Rev. Dr Henry Berkowitz, qui resteront parmi les expressions les plus hautes des sentiments qui se manifestèrent en ces séances mémorables.
J’avais fait, à Pittsbourg, la connaissance du jeune rédacteur du « Jewish Criterion », organe des Juifs progressistes, le rabbin Léonard Levy. C’était à l’occasion d’un congrès des écoles du dimanche, de Pensylvanie. Le rabbin ayant, lui aussi, son école du dimanche, s’intéressait aux questions traitées. Non seulement il siégea sur l’estrade parmi les pasteurs et les organisateurs des réunions, mais un appel de fonds ayant été fait séance tenante pour certaines écoles du dimanche protestantes dans les campagnes, il donna une généreuse souscription personnelle. Le soir, dans sa synagogue de Rodeph Shalom, nous tenions un « peace meeting ». Sur l’estrade, fraternellement réunis, siégeaient des représentants des divers cultes protestants et catholique. A Chicago, quelques jours plus tard, Sinaï Tempel, la vaste synagogue du rabbin Hirsch, avait eu une réunion analogue. Et nous avions tous senti que si jamais la paix devait habiter ce monde, il faudrait que les religions abdiquassent leurs vieilles querelles et le scandale de leurs exclusions antifraternelles, pour donner aux peuples l’exemple de leur entente cordiale et de leur conversion sincère à un sanctuaire supérieur où, de toutes les diversités, se crée l’Unité.
Tous ces souvenirs se réunissaient dans ma mémoire, pendant que j’attendais l’heure d’aller à Tempel Emmanuel, superbe lieu de réunion d’une grande Communauté juive libérale. A l’heure du service, le Président, Mr Seligmann, vieillard octogénaire, et plusieurs autres membres du comité se trouvaient réunis dans la sacristie, en présence du Dr Silvermann.
Nous montâmes sur l’estrade, et le service commença par les chants et prières liturgiques, présentation de la Thorah, etc. Je remarquai que personne ne gardait le chapeau sur la tête, et que la plus grande partie des chants et prières étaient en langue vulgaire.
Le Dr Silvermann fit un sermon sur la « Vie Simple », et la simplicité dans les croyances, comparant une dogmatique trop compliquée à l’armure de Saül, sous laquelle le jeune David étouffait en s’écriant : « Je ne peux pas marcher avec toutes ces choses. » Puis, abrégeant à dessein son allocution, il me présenta à ses auditeurs comme un hôte et me pria, le plus courtoisement du monde, de prendre sa place pour leur parler.
Un si cordial accueil fut fait à mon discours, et des sentiments d’une sympathie si fraternelle se manifestèrent ensuite, qu’il fut impossible de ne pas accepter une deuxième invitation, plus longuement préparée, et devant offrir à un plus grand nombre de membres de la Communauté, l’occasion de s’assembler[7].
[7] Une des personnes que je vis ce jour-là, est Mme veuve Simon Borg, enlevée, depuis, à l’affection de ses sept enfants. C’était une femme d’élite, consacrant sa vie à faire le bien. Dans les conversations que j’eus avec elle, je constatai tant de courage à supporter les misères de la vie, et tant de foi vaillante unie à une si large compréhension des croyances d’autrui, que je garderai d’elle le plus édifiant souvenir.
Hélas ! il ne me restait plus de temps libre, et nous dûmes nous donner rendez-vous pour le dernier soir de mon séjour, vers les dix heures. Je faisais, ce soir-là, une conférence pour la branche française de l’Union chrétienne de Jeunes Gens. A l’issue de cette conférence, quand les rabbins Blum et Silvermann m’amenèrent à la synagogue, une foule de deux mille cinq cents auditeurs s’y pressaient. Ils venaient de passer une heure à entendre de la musique, et un rapport sur une « Fraternité, Brotherhood ». C’est ainsi qu’on appelle en Amérique les « mutualités » à base religieuse.
Le public, au premier regard jeté autour de moi, me parut animé d’une sympathie absolue. C’était l’âme hospitalière du vieil Israël qui rayonnait sur toutes ces figures. Quand je songeai à tout ce que ce peuple a fait et souffert, une émotion intense s’empara de moi. L’antiquité prodigieuse de leur vieille tradition frappa ma pensée. Je m’inclinais en esprit devant plus de trois mille ans d’histoire, couronnés à l’horizon lointain par les pics géants du Prophétisme.
Je choisis un texte dans le Prophète Malachie, et pour rendre hommage à la pensée si large qui inspirait l’hospitalité religieuse dont je jouissais, je prononçai les paroles de ce texte en hébreu. La première était : « N’avons-nous pas tous un même père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? » La deuxième était : « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères ».
Cette parole est la dernière de l’ancien Testament. Elle pourrait servir de formule à la vie normale dans tous les domaines humains. Les « Pères » c’est la tradition ; les « enfants » ce sont les temps nouveaux. Il ne saurait y avoir ni cohésion historique, ni solidité véritable dans l’édifice national, social ou religieux, sans le concours harmonieux de ces deux forces du Souvenir et de l’Avenir. Deux paroles constituent la mentalité supérieure où toutes les énergies salutaires se marient : « Rappelle-toi ! » et « En avant ! ». J’essayai de tirer de cette grande parole quelques-unes des vérités qu’elle contient, et de faire voir en quels termes heureux elle décrit la respectueuse indépendance qui est l’inspiration même de toute liberté féconde. Et puis je terminai à peu près sur l’ordre d’idées que voici : « Nos Pères, les Pères de tout l’Occident religieux, c’est vous, ce sont vos Prophètes, avant-coureurs d’une marche si prodigieuse, que, malgré leur éloignement dans le vénérable passé, ils indiquent encore aujourd’hui les routes de l’Avenir. Nous autres, nous sommes les enfants. Si jamais le cœur des enfants se détournait des pères, ce serait l’ingratitude et le désastre. Aussi, quiconque sait ce que le monde religieux vous doit, ne prononce qu’avec vénération le nom d’Israël.
Mais si vous êtes les Pères, et si tout respect, tout filial honneur vous doit être rendu par nous, ne devez-vous pas aussi reconnaître vos enfants ? Le vieux tronc d’Isaï est solidaire avec la famille nouvelle, dont la parole prophétique marqua d’avance les destinées, dans le passage si rayonnant d’avenir et d’espérance, où il est dit : « Un rejeton sortira de la souche de Jessé ». Jamais je ne l’ai senti avec plus de force que ce soir. Nous avons tous à méditer sur l’esprit large et magnanime qui souffle à travers ce beau texte, afin de nous mettre à l’unisson de ses intentions. Alors nous ferons se rencontrer en une collaboration féconde, l’Ancien Testament et le Nouveau. Ils s’appellent et s’éclairent l’un l’autre et ne sont jamais plus grands que reliés sous la même couverture ».
On a toujours raison de cultiver l’idéal et l’espérance, même au sein d’un milieu terre à terre qui vous traiterait d’utopiste. Quelques années auparavant, dans mon livre « l’Ami », sous le titre de « Haute Église », j’avais formulé le vœu que les diverses familles religieuses, tout en cultivant chacune sa province de croyances particulières, se rencontrassent sur le terrain d’une sereine et bienveillante hospitalité et qu’on s’invitât d’Église à Église comme de maison à maison. Que de sourires cette page naïve avait provoqués parmi les sages de ce monde ! Le soir de Tempel Emmanuel, je compris que nous n’étions pas si loin qu’il pouvait sembler, de ces agapes spirituelles entre hommes de milieux religieux différents. Et je me promis de ne jamais négliger une occasion de rendre possibles ces rendez-vous mutuellement si bienfaisants.
Il était plus de onze heures du soir quand nous sortîmes de cette bonne maison, où les cœurs venaient de se sentir si près les uns des autres. Mais il n’y a pas d’heure tardive qui ne soit bonne encore pour bien faire. Les amis de la synagogue m’amenèrent donc à un de leurs cercles où un souper cordial nous réunit quelques moments encore. Autour de la table étaient assis des membres éminents de la synagogue. Le banquier Seligmann, Président ; le docteur Silvermann et quelques-uns de ses collègues à l’Encyclopédie des sciences juives, qui sera un des plus intéressants monuments d’histoire édifiés par notre temps ; M. Levysson, connu par ses libéralités aux universités et œuvres d’intérêt général ; des professeurs, des instituteurs.
Des speechs furent échangés. Celui qui m’intéressa le plus fut fait par un instituteur, ayant son école dans Eastend, parmi la population juive très dense groupée là, et sans cesse grossie par les expulsions européennes. Cette population crée aux Israélites américains un problème colossal. Dans la réponse que M. Levysson fit à l’instituteur, je compris que la bonne volonté de ces hommes de bien était à la hauteur des devoirs les plus exorbitants. Ils se sentent responsables de ces milliers de frères infortunés, arrachés à leur pays natal, et cherchent non seulement à les empêcher de périr de misère dans les premiers moments de leur arrivée, mais à les soutenir moralement et matériellement, afin de leur ouvrir un horizon nouveau. Quelques jours auparavant, j’avais pu visiter Montefiore home, vaste maison pour incurables de tout âge, située au bord de Hudson-River. On y reçoit indistinctement les pauvres malheureux de toute confession, ainsi qu’à Sinaï-Hospital, fondation nouvelle, d’une étendue considérable, construite selon les règles les plus conformes à l’hygiène. Nous quittâmes le cercle vers une heure du matin, et je gardai de ma rencontre avec ces Israélites américains l’impression d’un milieu actif, intelligent, ouvert à toutes les grandes idées, ayant, sous la forme la plus heureuse, ressenti le souffle vivifiant du nouveau monde.
J’attendais avec une certaine impatience l’occasion de rencontrer des représentants de la race noire.
Un des premiers avec qui je fus en contact personnel, est le cocher qui me fit faire un tour dans Washington et me déclara qu’il avait lu « la Vie simple ». Il ajouta de si bons sourires à ses paroles, que sa figure, illuminée par un éclair de ses dents blanches, me resta gravée dans le souvenir.
Dans les familles, les restaurants, les chemins de fer, les nègres chargés de quelque service, me paraissaient s’en acquitter toujours avec soin et bonne humeur. On peut surtout les observer à l’aise pendant qu’ils vous cirent les souliers. L’Amérique abandonne à chacun le soin de ses souliers. Il est de règle de ne les cirer ni dans les familles, ni dans les hôtels[8]. On les met le matin, tels qu’on les a ôtés le soir, et à la première occasion on se confie aux soins d’un de ces bons nègres qui répètent par les rues : Shine ! shine ! Ils vous offrent un siège, fauteuil commode et souvent royal, rappelant les espèces de trônes sur lesquels vous font monter les cireurs dans la bonne ville de Lyon, et qui sont bien différents, en dignité, de la pauvre caisse offerte comme piédestal par nos commissionnaires parisiens. Si vous désirez être complètement à l’abri, vous êtes invités à pénétrer en quelque sous-sol, ou le plus souvent en un rez-de-chaussée d’hôtel. Pendant l’opération, le client, d’ordinaire pressé, lit son journal ou se livre à quelque occupation urgente. De cela, je me gardai bien. Un homme qui se fait servir doit quelque attention au frère qui lui consacre un moment ses soins. Et quels soins ! Ne vous imaginez pas qu’une boîte à cirage et une brosse en représentent les seuls instruments. Et d’abord l’homme noir qui se courbe vers vos bottes ne fait pas la tête d’un individu qui va fournir une corvée quelconque. Il vous considère comme un objet sur lequel son art et sa bonne volonté vont s’exercer. Primo : nettoyage complet avec une brosse qui emporterait plutôt le cuir lui-même que d’y laisser un atome de crotte. Après cela, cirage délicat, et preste repassage avec des brosses plus douces. Puis vernissage et polissage, au moyen de chiffons de laine et de flanelle, de rudesse graduellement amoindrie. Cela coûte dix cents, cinquante centimes. Le frère noir vous renvoie avec un bon sourire, et vous partez, ayant aux pieds deux miroirs étincelants. Un bon cirage dure une semaine… s’il ne pleut pas.
[8] Je m’en voudrais cependant de ne pas raconter que dans plusieurs maisons nous avons surpris nos amis à cirer nos souliers eux-mêmes, les domestiques n’en ayant pas l’habitude.
Dans les Pullman cars, aussitôt que le train s’approche de la station où vous avez à descendre, le nègre s’empare de votre chapeau, de votre pardessus, de votre parapluie même, il les effleure avec une époussette en chiendent devant laquelle ne saurait subsister aucune poussière. Puis il s’approche de votre personne qu’il invite à se lever et, depuis le col jusqu’aux souliers, la brosse avec une impétueuse bonhomie.
En sleeping, pendant que vous dormez, le nègre veille. Préalablement, il vous a fait votre lit. Le matin, il vous réveille, en vous tapant sur l’épaule. Si le voyageur ne lui adresse pas la parole, le nègre reste muet ; si vous entamez une conversation, il répond volontiers. Après avoir satisfait à vos questions, il vous en pose à son tour : échange de bons procédés.
J’ai beaucoup regardé la figure des nègres. A côté de certains types lippus, aux traits plutôt empreints d’animalité, et qui font merveilleusement pendant à nos abrutis blancs, j’ai rencontré beaucoup de physionomies éclairées, marquées de tous les signes d’une intelligence ouverte, d’une énergique spiritualité. Mais surtout j’ai souvent rencontré une expression que je n’ai jamais observée au même point chez aucun blanc, expression de fidélité, de dévouement, à laquelle la couleur noire donne un cachet spécial et dont l’impression sur mon esprit a été extraordinaire.
A New-York, un matin, pendant que je faisais une bonne causette avec Maurice, magnifique nègre qui venait dès l’aube me sourire et me demander si je n’avais besoin de rien, j’appris, non sans surprise, que nous étions collègues. Maurice était prédicateur, chef d’une congrégation, fondateur d’une école de théologie et, à ses heures, valet de chambre ; sa congrégation étant trop pauvre pour lui assurer la vie matérielle, il gagnait sa subsistance en servant.
Le cumul de ces deux fonctions de serviteur et de prédicateur pourrait bien avoir plusieurs inconvénients. Le verbe indépendant lié à une situation de subalterne ! Le loisir nécessaire à l’étude, pris par des occupations ménagères ! La pensée elle-même, suivant intérieurement son cours, interrompue à chaque instant par un ordre ou un coup de téléphone !
Mais ces inconvénients qui, certes, ne sont pas minces, laissent entrevoir des avantages dont le poids pourrait faire baisser la balance en leur faveur. Après tout, le prédicateur doit chercher la matière de son enseignement dans la vie encore plus que dans les livres. Il lui est moins préjudiciable de manquer d’érudition que d’expérience. Or l’expérience n’est jamais gratuite. Elle se paie fort cher, chaque fois qu’elle a une réelle valeur. La plupart d’entre nous ne sont guère disposés à l’acheter son prix. Ils ne font donc directement que les expériences pour ainsi dire imposées par la nécessité. Les obstacles et les duretés de l’existence, ses douleurs inévitables, en nous coûtant de la peine, augmentent notre faculté d’aider les autres à vivre. Mais il est des expériences d’un genre un peu spécial et qui ne se font presque jamais que par procuration. Tous les prédicateurs sont, en somme, des bourgeois. Nous trouverions contraire à leur dignité qu’il en fût autrement. Et s’ils sortent du peuple, si leurs pères furent paysans, ouvriers, ou serviteurs, ils risquent de s’embourgeoiser. Or à toutes les époques, et à la nôtre surtout, une des grandes questions que nous avons à porter en chaire est la question sociale. Cette question, que vous la regardiez par en dessus, du côté des patrons, ou par en dessous, du côté des ouvriers et des serviteurs, vous ne la voyez que sous un de ses aspects, et donc vous la voyez mal. Pour bien la comprendre, il est nécessaire de se mettre à la fois à la place des uns et des autres. Mais se mettre à la place d’un autre est une de ces opérations que l’on peut bien tenter, ou même s’imaginer d’avoir mené à bonne fin, mais qui, en somme, est du domaine de l’impossible. La meilleure volonté y rencontre des résistances insurmontables. Si la place d’un autre ne devient en toute réalité votre place personnelle, vous ne vous êtes pas complètement mis dans sa situation et ne sauriez éprouver ce qu’il éprouve. Je prends maintenant un homme équitable, ne cherchant que ce qui est juste et droit, comme doit l’être celui qui se mêle de prêcher aux autres ; un homme, en outre, qui aime ses semblables, en raison de leur qualité d’hommes, et non de leur classe particulière. Cet homme est domestique, tout le long du jour. Il doit obéir à ses maîtres et il le fait. Doué de clairvoyance, il considère le train de la maison et le juge à la fois avec bienveillance et pénétration. Mais son rôle lui impose le respect préalable et le silence. Le soir, il est libre ; il est même un maître, revêtu d’une grande autorité. Il parle au nom de Dieu et de l’humanité ; au nom de la sagesse condensée des traditions et de l’expérience vivante du présent. Il a la parole, il dispose du champ illimité de la pensée. Si cet homme a une âme, il est armé, comme nul autre, pour dire des choses pratiques que l’on puisse penser et s’assimiler. Il opère avec des réalités. On sent qu’il connaît le dessus et le dessous des questions, parce qu’il a vécu et vit journellement les deux. Et on ne dira jamais dans quelle forme de son activité il est le plus intéressant, si c’est en qualité de prédicateur valet de chambre, ou de valet de chambre prédicateur. Certes chacun de ces deux hommes a fort besoin de l’autre. Je suis convaincu que le monde avancerait mieux, si les grandes questions ne se débattaient pas, en général, comme par dessus un fossé, entre gens qui ne sont renseignés que sur un des côtés. La vie sociale aurait tout à gagner par la création de traits-d’union humains, en qui vit la compréhension cordiale et profonde, le jugement équitable sur la situation, les droits et les devoirs des deux partis en question. Nous avons généralement deux fractions sociales dont les intérêts semblent opposés : entre elles surgissent des intermédiaires qui, le plus souvent, sont ignorants de l’une des fractions, à moins qu’ils ne soient de simples excitateurs exploitant les deux antagonistes à leur profit. Je voudrais des hommes, aimant et appréciant les deux, et comprenant que les deux doivent ne faire dans le fond qu’un seul.
Une situation contradictoire comme celle du collègue noir que j’eus l’avantage de connaître, pour douloureuse et émotionnante qu’elle soit, peut donc se transformer en une source de progrès humain, à condition que celui qui la subit, s’élève au-dessus de ses avatars momentanés et, sous la livrée de domestique comme dans la chaire, demeure avant tout un homme.
L’occasion de parler à des auditoires nègres, considérée par moi comme un privilège, me fut accordée à Philadelphie, par deux fois. C’étaient des assemblées où se mêlaient tous les âges. Sur les tribunes, une foule d’enfants. Les cantiques furent exécutés avec un entrain merveilleux. Ils adorent tous le chant, et plusieurs arrivent à un rare développement musical. Assis sur la plate-forme, où m’avaient accompagné plusieurs pasteurs nègres et John Wanamaker, je croyais rêver. Des petites têtes crépues qui chantaient de si bon cœur, mes regards se tournaient vers l’auditoire adulte. L’hymne montait, nourri, plein d’âme. Il y avait de la sympathie dans l’air, et du bon accueil. Rarement je me suis senti plus heureux de prêter ma voix à ces vieilles vérités que l’Évangile a frappées à l’ineffaçable effigie de l’universelle humanité. Il me paraissait grand d’une grandeur nouvelle, puisqu’il me servait, sur l’heure, de parfait trait d’union avec les hommes d’une race jusqu’alors inconnue pour moi et, dès le premier instant, l’étincelle heureuse, le courant de vie supérieure que produit le contact des cœurs, se produisirent avec une force toute spontanée. Mon discours terminé, je m’assis, et tous les regards se tournèrent vers John Wanamaker. « Puisque vous êtes parmi nous, lui dit le pasteur de l’Église, permettez-nous de vous exposer quelques desiderata. » Et il lui parla de services, que dans sa situation de négociant, occupant beaucoup de monde, il pourrait rendre à ses paroissiens, en leur offrant du travail et des places. Dans une partie du discours de ce pasteur, on sentait percer les sentiments pénibles qui remplissent le cœur des noirs devant certaines hostilités opiniâtres et certains préjugés de race.
John Wanamaker profita, avec une visible satisfaction, de l’excellente occasion qui s’offrait à lui d’exprimer sa sympathie aux frères noirs. « Quand vous aurez à faire à moi et à ceux, très nombreux en ce pays, qui pensent comme moi, et vous portent un grand intérêt, dites-vous bien ceci : il n’y a pas là de question de race, ni de face, ni de place, mais purement une question de grâce, c’est-à-dire d’aptitudes et de capacités. Vous serez toujours les bienvenus pour occuper une fonction. Mais le tout n’est pas d’avoir la place, il faut la bien remplir. Si, à l’essai, nous nous apercevons que vous avez demandé une situation où vous êtes incapables de vous maintenir avec succès, nous sommes obligés de vous renvoyer comme un vulgaire blanc. Dans ce cas, quelques-uns d’entre vous diront que c’est la couleur de leur face qui leur a fait perdre la place. Non, ils se trompent ; ils avaient eu trop d’ambition. Étant montés trop haut, il leur faut redescendre. Nous vous sommes sympathiques, ayez confiance. Et s’il arrivait qu’une injustice se commît envers l’un de vous, soyez certains que nous découragerions celui qui, sous nos ordres et dans la limite de notre influence, aurait osé manquer, à l’égard de l’un des vôtres, de respect ou d’équité. »
De telles paroles sont l’expression même du sentiment le plus profond. A distance, sur la foi d’articles de journaux, relatant des faits particulièrement odieux, où le préjugé de race s’étale dans sa laideur entière, nous croyons que les noirs et les blancs, sur toute la surface des États-Unis, sont entièrement séparés et ne se mêlent ni ne se rencontrent, même dans les endroits publics, comme les théâtres, les concerts, les églises, les tramways, les chemins de fer et surtout les hôtels. Il y a à cela beaucoup d’exagération. Une foule d’Américains, non seulement ne méprisent ni ne haïssent les nègres, mais se dévouent à leur cause et leur prouvent leur sympathie par tous les moyens. Ces hommes ne se dissimulent pas les difficultés de ce qu’on appelle la question nègre. Mais ils ont un principe très juste en même temps que très judicieux : Plus les questions sont difficiles, plus il faut concentrer de bonne volonté sur leur solution.
Je m’estime heureux d’avoir rencontré un grand nombre de ces hommes, parmi lesquels je nommerai en particulier Mr Robert C. Ogden, de New-York.
Mr Ogden, associé de John Wanamaker, se trouve à la tête du grand magasin que ce dernier possède à New-York. Très absorbé par des affaires colossales, il n’en est pas moins constamment occupé d’œuvres sociales. C’est un de ces hommes, nombreux en Amérique, qui font le plus grand honneur à leur pays. Les affaires, pour eux, sont une fonction sociale. Si elles leur procurent la fortune, la fortune en leur main est un levier pour le bien. Mr Robert C. Ogden s’occupe beaucoup des nègres, en particulier de Hampdenschool, établissement créé et dirigé jadis par le général Armstrong, qui fut le père spirituel de Booker T. Washington. Pendant de longs moments, dans son cabinet de Broadway, Mr Ogden me renseigna sur l’œuvre éducative parmi les noirs, mettant entre mes mains une foule d’ouvrages qui traitent de la question. Non seulement on sent que, en sa qualité de Président du comité de Hampdenschool, il s’intéresse à la maison, personnellement, mais cet intérêt, visiblement, le touche aux entrailles mêmes. Quand il parle des noirs, ses yeux se mouillent. Et cependant c’est un homme fort, d’une taille plus qu’ordinaire et doué d’un grand sang-froid.
Par lui, je fus mis personnellement en rapports avec Booker T. Washington, l’un des hommes que j’étais le plus impatient de rencontrer, dont je me suis senti honoré de toucher la main et dont je me promets bien d’aller plus tard visiter l’école à Tusgegee, dans le Sud. Cette fois, je dus me borner à faire une conférence au profit de Hampdenschool. Organisée par Mr Ogden, cette conférence eut lieu dans la vaste maison, due comme tant d’autres à la générosité universellement connue de Mr Andrew Carnegie, et qui se nomme, en raison de cette origine, Carnegie-Hall.
On avait envoyé de Virginie huit élèves de l’école, entre 20 et 25 ans, afin de chanter devant le public, avant et après la conférence.
Comme on nous présenta les uns aux autres, quelques minutes avant le début, je leur dis, dans le cabinet où nous attendions l’heure de commencer : « Chers amis, si vous voulez me faire un immense plaisir, chantez-moi un morceau dès maintenant. » Immédiatement ils se rangèrent et entonnèrent un double quatuor. Alors il me sembla que le parquet vibrait et que le son magnifique de leurs voix me montait à travers les os et courait dans mes moelles. Jamais je n’ai entendu cette ampleur de basse sortir de poitrines humaines. C’était un orgue vivant.
Quelques instants plus tard, ils se firent entendre dans la grande salle, où ils donnèrent entre autres des mélodies telles que leurs pères en chantaient dans les plantations, du temps de l’esclavage. A travers la mélancolie de ces complaintes, la détresse humaine s’exprime en accents si douloureux et si vrais qu’on oublie presque la musique pour ne penser qu’aux situations dont elle est l’écho.
Je ne suis pas documenté pour aborder le problème nègre. C’est une grande montagne qui pèse sur la conscience des États-Unis. Mais ce qui me rassure, c’est qu’aucune question, quelle qu’elle soit, surgissant dans les limites de la destinée d’une nation, n’est au-dessus des forces de cette nation, si tant est qu’elle est abordée avec tous les moyens de bon sens, de clairvoyance pratique d’une part, et d’autre part, avec équité, bienveillance véritable et fraternelle bonté. Or, de ces qualités pratiques et de ces qualités de cœur, l’Amérique tient en réserve des provisions intarissables. Aucun obstacle, aucune difficulté, aucune fatalité du sang ne prévaudra contre elles.
En attendant, je m’estime heureux de connaître l’homme dont le nom, aujourd’hui, personnifie les espérances comme les charges des frères noirs, l’homme vers qui, de tous les points du territoire américain et du monde, vont les sympathies que nous leur vouons : j’ai nommé Booker T. Washington. Je noterai ici un fait mémorable entre tous et qui doit être conservé.
Le soir du 7 octobre 1904, nous étions réunis dans un banquet final, dernier acte du Congrès de la Paix, de Boston. Six cents convives de tous les États de la République, de tous les pays du monde, se trouvaient à table, dans une salle de fêtes. Nous étions assis, tous ceux qui devaient prendre la parole dans la soirée, à une table spéciale, d’où les orateurs seraient aisément aperçus. Booker Washington était à trois places de moi. Quand vint son tour de parler et qu’il se leva, toute l’immense salle, comme mue par un même sentiment spontané, se leva, afin de lui rendre un hommage unique, un hommage qui, à ce moment, par la qualité des délégués réunis là, devenait une manifestation universelle de toute la Terre civilisée et pacifique.
Booker Washington est un homme de taille moyenne, trapu, à la figure énergique. Quand il se lève pour parler, on sent qu’il porte sur ses épaules le fardeau de sa race. Sa parole est claironnante, chaude, et va droit au but. Il est éloquent, de cette éloquence supérieure qu’inspirent le courage, la sincérité, l’absolu dévouement à une cause. Images parlantes, geste sobre, modération persuasive. On sent que cet homme est une voix au service d’un principe.
Après certaines phrases où il met son énergie totale, quand il ferme la bouche, qu’il a puissante, décidée, on sent à quel point ce qu’il vient de dire est positif et inattaquable. Le geste de son large menton, joint à l’éclair de ses yeux, rappelle alors la parole magnifique de Luther : Das Wort sie sollen lassen stahn !
Le travail atteint en Amérique une intensité extraordinaire. On a travaillé beaucoup, un peu partout, depuis un siècle, et plus qu’on n’avait jamais travaillé dans l’histoire du monde. La construction seule des chemins de fer modernes a remué tant de terre, produit tant de fer et de matériel roulant, exigé l’extraction du sol de tant de houille, que l’ouvrage des dix siècles précédents ne suffirait pas à remplacer le labeur accompli. Dans cet effort de la civilisation, l’Amérique tient le record. Il faut ajouter que nulle part le travail n’est plus honoré que chez elle. Par lui, un homme peut arriver à tout. Et ce sont les hommes, fils de leurs œuvres, qui occupent la première place dans l’opinion générale.
Le travail a produit dans ce pays de grandes richesses, et en produit encore tous les jours, surtout là où un territoire encore neuf se transforme rapidement en une contrée peuplée et industrieuse. Et, certes, la richesse est estimée ; l’argent est l’objet d’un respect général. Disons même que le désir d’en acquérir anime une grande partie de la population, et que l’orgueil des grosses bourses et la gloire de ceux qui les possèdent, dédaignent ceux qui n’ont pas su réussir. C’est là un des côtés sombres de l’Amérique, côté antidémocratique et non sans danger pour l’avenir. Mais c’est un inconvénient qui lui est commun avec d’autres nations et qu’elle rachète d’autre part par des qualités que toutes les nations sont loin de posséder. En général, si ce pays a des tares ou des défauts, nul ne les connaît mieux que lui-même, et c’est avec un scrupule et une persévérance rares qu’il s’attache à les combattre. Ainsi les excès auxquels peut conduire la puissance de l’argent y ont de fort sérieux contrepoids.
En premier lieu, par une excellente habitude qu’adoptent une quantité de gens arrivés aux grandes fortunes, la générosité s’efforce de payer la dette de la richesse. Une fois considéré par ses détenteurs comme un instrument de puissance pour le bien, cet instrument s’exerce de tant de façons, que tout homme juste est obligé de s’incliner avec respect. Les exemples sont nombreux, d’hommes qui administrent leurs biens comme un dépôt de confiance dû au travail de tous, et remis en leurs mains afin de servir à l’intérêt de tous. Ceux-là voient dans la fortune une fonction sociale qui engage au plus haut point leur responsabilité. Il suffit de la connaître un peu dans la personne de ses citoyens les plus riches pour ne plus pouvoir admettre que l’Amérique soit équitablement caractérisée, quand on l’a surnommée le pays du roi dollar. Si elle a ses accapareurs d’or, ses égoïstes gavés, ses corrupteurs qui prétendent gouverner en achetant les consciences, elle a aussi élevé à la hauteur d’un principe le devoir de bien employer son argent. Beaucoup de ses citoyens les plus en évidence par leur situation matérielle, vivent personnellement sans faste et ne se sentiraient pas le droit de faire, pour eux ou leurs enfants, des dépenses exagérées. Ils se savent, en un mot, responsables de l’emploi de leurs biens, soit devant Dieu, soit devant les hommes, et se trouvent par conséquent à l’abri de cette tentation funeste qui vient aux êtres sans « self control », du fait qu’ils peuvent se payer tout ce qu’ils désirent.
Mais ce qui, à mon avis, contrebalance encore, dans cette génération, l’influence néfaste et démoralisatrice des trop grandes fortunes accumulées dans les mains d’un seul, est le fait qu’en Amérique, tout le monde travaille, et les plus riches souvent plus que les autres. Quelques-uns d’entre eux se réduisent, par conscience, au rôle de véritables esclaves, au point que je ne voudrais pas changer avec eux. Mais c’est pour cela même qu’ils méritent d’être respectés et admirés. Il y a une forme très noble de l’abnégation, dans cette façon d’être l’esclave de son devoir d’homme riche.
Pour tout dire, l’oisiveté n’a pas encore acquis son droit de cité, ni surtout son droit au grand soleil. Dans les vieilles sociétés une certaine aristocratie, trop souvent dégénérée, a, depuis de longues générations, perdu l’habitude de travailler, et l’opinion publique y est si bien influencée par l’existence de cette haute et brillante collection d’oisifs, qu’elle considère comme un signe de noblesse le fait qu’on n’a pas besoin de travailler pour vivre. Plus une fortune est loin de sa source, le travail, plus elle est vieille, plus les générations, en passant, se sont habituées à la trouver dans leur berceau, et plus elle semble avoir de quartiers de noblesse. Il arrive ainsi que des classes, en somme parasites, se considèrent comme la fine fleur sociale. A l’abri de cette superstition, les inutiles ont beau jeu, et quiconque peut se créer une vie d’oisif se sent un peu de la race des privilégiés. A la longue, il se développe un état d’esprit démoralisant qui tend à considérer le travail comme une servitude et un amoindrissement de dignité.
De l’autre côté de l’Océan, toutes ces mouches qui ne font pas de miel, quelque diaprées que soient leurs ailes, sont médiocrement appréciées. Elles le sentent et se cachent. L’habitude d’avoir une vie occupée est si générale, que l’homme qui ne fait rien est un corps étranger, un déraciné. Les cités n’offrent pas assez de ressources à ceux qui ont besoin d’être amusés par des moyens raffinés, et ne se contentent pas des distractions simples auxquelles l’homme qui a travaillé est toujours disposé à trouver un grand charme. Ils sont condamnés à l’ennui, et l’ennui finit par les chasser de chez eux, pour aller se joindre, en quelque station cosmopolite du vieux monde, à la foule de ceux que l’oisiveté rassemble.
L’Amérique travaille, honore le travail et sait l’organiser. Chacun, en général, y connaît bien son métier et cherche à y apporter quelque ingénieuse combinaison de sa propre initiative. La routine y enlise moins les esprits. Un certain point d’honneur ne permet pas à l’homme qui s’est engagé pour un travail, de le quitter avant qu’il ne soit fait. Du haut en bas de l’échelle sociale, on a la dignité de sa fonction et la volonté de bien faire ce qu’on a entrepris.
Les difficultés, les commandes imprévues, au lieu d’effrayer, stimulent les industriels, les commerçants et même l’ouvrier ordinaire. Plutôt que d’avouer devant une commande qu’ils n’ont pas ce qu’il faut pour la réaliser, ils se livreront à des tours de force et des combinaisons de génie. De cette disposition aux entreprises hardies et aux travaux faits en dehors des conditions ordinaires, voici un échantillon typique autant que légendaire. Après la destruction de Chicago par l’incendie qui n’en laissa subsister qu’une mince partie, une fois le premier affolement passé, il y eut un extraordinaire déploiement d’énergie. Appel fut fait à toutes les réserves financières, à toutes les ressources de l’activité, pour rebâtir la cité aussi vite et aussi solidement que possible. Un jour, un citoyen se présenta dans les bureaux d’un entrepreneur de bâtiments :
— Il me faut une maison de tel et tel genre.
— Bien, et pour quelle époque ?
— Pour telle date.
— Bien, nous avons à fournir ce jour-là quinze bâtiments, mais tous dans la matinée. Nous inscrivons le vôtre pour l’après-midi ; vous pouvez y compter.
L’Amérique a ses écoles de travail, mais la meilleure, c’est elle-même ; ce sont ses traditions, son entraînement pratique aux carrières. On n’arrive à rien, sans avoir mis la main à la pâte. Pour diriger un travail, il faut l’avoir appris soi-même. La biographie d’une multitude d’hommes arrivés aux grandes affaires commence par quelque besogne simple et modeste qu’ils s’ingéniaient à exécuter aussi bien que possible. Le plus grand honneur est d’avoir commencé avec rien. Le boy énergique qui ne demande qu’à bien faire n’a qu’à regarder autour de lui pour voir des hommes, exemples vivants de ce qu’il peut attendre de la vie, s’il ne ménage pas sa peine. Et c’est là une condition excellente pour encourager chacun à faire de son mieux. Une fois l’impression acquise qu’un jeune homme est un travailleur, toutes les portes lui sont ouvertes, et dès qu’il se montre être the right man on the right place, on ne lui marchande pas son traitement. Règle générale, le travail est bien rémunéré. Il n’est même pas admis qu’un homme donne sa peine pour rien. La parole biblique : « Le travailleur mérite son salaire » est une formule de dignité et non d’esprit mercenaire.
Je ne suis qu’un profane en tout ce qui concerne le commerce et l’industrie, mais j’ai la curiosité des enfants qui, les mains croisées sur le dos, regardent dans la rue le gagne-petit fondre des cuillers d’étain. Que d’usines j’ai visitées dans la vieille Europe, que de métiers j’ai vu exercer ! Quand je suis amené à voir de près l’oisiveté de certaines vies, un ennui mortel s’empare de moi, tant le vide de toute cette vanité me navre. Mais je ne me lasse jamais de regarder le travailleur à son œuvre. Je ne sais quelle haute dignité, quelle majesté l’entoure à mes yeux.
Les travailleurs en Amérique m’ont, en général, semblé dans des conditions hygiéniques favorables. Le peu que le temps m’a permis d’observer dans les imprimeries, les manufactures, les entreprises de construction, me laisse une impression de propreté, de dignité. Une foule d’ingénieux procédés, relatifs non seulement à la mécanique, mais au travail de bureaux, d’emballage, à la manipulation des matières premières, indiquent que l’initiative et la réflexion ne perdent jamais leurs droits. Simplifier, rendre un travail plus facile, plus expéditif et plus propre, un outil plus maniable, une machine plus précise, est une tendance générale qui se remarque à chaque pas. A chaque instant, en se livrant aux mille observations suggérées par l’activité intelligente, l’histoire de l’œuf de Colomb vous revient en mémoire : On se dit : — Tiens, comme c’est simple et ingénieux en même temps ! On s’étonne de ne l’avoir pas trouvé soi-même. Exemple : Les conducteurs de tramways ont à leur disposition une sonnerie d’une simplicité enfantine, pour marquer les places payées, même du bout de la voiture. Cela leur épargne du temps, des démarches et des erreurs ; dès qu’ils touchent un cent, ils le marquent au compteur. A Paris, il faut retourner au compteur chaque fois qu’il s’agit de marquer.
La tradition en toutes choses est si importante que, dans ce pays nouveau, toutes ses traces deviennent précieuses. Dans les maisons industrielles, la tradition est représentée d’une façon très vivante par les portraits des fondateurs de maisons et de leurs directeurs successifs. Le bureau des patrons est une sorte de sanctuaire. On y est envahi par le grand sérieux des affaires. Sur les murs sont les ancêtres, pas bien anciens, naturellement, car ils remontent rarement au-delà de cent ans. Mais ces commerçants, ces industriels, ces ingénieurs ont tous des têtes d’une vénérabilité patriarcale. Leur figure respire la piété, l’honnêteté. Ces physionomies de braves gens énergiques et intelligents sont des pages impressives de l’histoire humaine. A regarder les traits de ces hommes, on comprend que leur trace soit restée sensible dans les affaires par eux créées. L’amour du travail, la probité, les sentiments de justice et d’humanité faisaient pour eux partie de la vie commerciale et industrielle. Ils exerçaient les affaires comme les chevaliers d’autrefois faisaient la guerre : avec leur âme, leur cœur ; et leur maison, était bâtie avec un capital d’honneur et de loyauté qui est, certes, le plus précieux héritage légué à leurs successeurs. A longtemps rêver devant ces portraits d’anciens, on se surprend à se demander quel effet feront à côté d’eux les portraits de la génération actuelle. Et de tout cœur on souhaite aux fils de ressembler aux pères et de continuer, dans les formes nouvelles de la vie de ce temps, l’esprit qui animait leurs ancêtres.
A certains moments de labeur intense, lorsque toutes les cordes de l’activité sont tendues, il se mêle à l’impression d’énergie et de puissance qui se dégage des cités cyclopéennes, une secrète angoisse, comparable à celle qui s’empare involontairement de nous, quand le train roule avec un maximum de vitesse. L’idée d’accidents, de catastrophes possibles se présente à l’esprit. On se demande, au point où en sont arrivées les choses, si cela peut continuer ainsi, et pendant combien de temps, et ce que, dans une pareille fournaise, pourrait devenir la société. Au-dessus d’un certain degré, l’activité devient anormale, et l’organisme humain se détraque.
Les bonnes machines sont pourvues de sifflets d’alarme qui avertissent leurs conducteurs que le danger approche, ou de manomètres qui signalent les pressions exagérées. Ces sortes de signaux existent aussi dans le mécanisme social. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, ils fonctionnent avec insistance. Les citoyens clairvoyants s’en aperçoivent fort bien et poussent leur cri d’alarme. Le déséquilibrement mental, la neurasthénie et l’incapacité de travail, résultat des surmenages et des trop constantes surexcitations, la fièvre de vitesse qui gagne les gens, à mesure que leur marche s’accélère, l’inquiétude provenant de la perpétuelle agitation, les préoccupations où vous plonge l’ardente et inlassable concurrence, le vertige des situations gigantesques trop rapidement acquises, tout cela trouble sérieusement la santé mentale et physique, et arrive à se traduire par une série de ruines ou d’excentricités. On sent que, sans la présence d’une masse formidable de lest, le bateau verrait sa marche compromise par les saccades d’une navigation précipitée et hasardeuse. Heureusement ce lest existe.
Il consiste d’abord dans un capital énorme de bon sens, capable de remettre sans cesse les choses au point ; ensuite dans une grande sincérité à reconnaître les lacunes de la vie sociale et à les combler.
Au secours de ces forces de premier ordre, vient un certain calme, dont on voit se maintenir le régime salutaire au milieu des plus violentes bourrasques. On est rempli d’admiration, lorsqu’on voit la tranquillité d’âme avec laquelle une foule d’hommes se maintiennent au milieu des coups de feu du labeur le plus déconcertant par sa variété et sa quantité.
A ces qualités de fond s’ajoute une bonne hygiène. Le soin que les Américains prennent de leur santé physique les fortifie merveilleusement pour la lutte, et sauvegarde leur énergie cérébrale. Il n’y a aucune comparaison entre eux et nous, sous ce rapport. Non seulement ils ont les jeux en plein air, les sports universellement pratiqués à tous les âges et par tous les sexes, mais ils ont cette fontaine de Jouvence qui s’appelle l’hydrothérapie domestique. Sous ce rapport, ce qui, chez nous, est le luxe des riches est là-bas le pain quotidien de tous. L’Amérique se lave et se douche abondamment, et par l’effet d’un besoin national et d’une habitude devenue une seconde nature. Elle mange ferme le matin et ne se charge pas trop l’estomac le soir. Elle combat de son mieux l’alcool, la vie noctambule, l’air renfermé. Ce n’est pas à dire que ces trois pestes, qui se développent surtout dans les villes monstres, n’y soient connues comme chez nous. Mais elles sont tenues en échec par une lutte persévérante et l’opposition décidée des éléments sains de la nation, unis comme un rempart en face de ces ennemis du genre humain.
A cela s’ajoute que l’Amérique sait organiser le repos et lui maintenir des retraites inviolables. Il y a d’abord le repos de tous les jours, quand les bureaux se ferment et que l’existence familiale et confortable reprend ses droits. On se nettoie du souci des affaires, et à la maison il n’en est plus question. Là s’ouvre un autre monde capable de vous délasser. Pour une foule d’Américains qui se couchent de bonne heure, le soir, la famille, avec sa douceur calmante, corrige et répare les fatigues de la journée.
Et puis, ils ont leur dimanche. Le dimanche est, nous commençons à nous en apercevoir, une des institutions humanitaires les plus précieuses et dont il faut relever les ruines, partout où l’incurie et l’ineptie publiques l’ont laissé s’écrouler. C’est le jour de la liberté, du souvenir pieux, de l’idéal, de la réflexion calme, le jour où l’homme se rappelle qu’il n’est pas une bête de somme et que sa destinée ne se confine pas dans le chemin tournant d’un manège.
Une foule de citoyens américains s’associent, ce jour-là, à l’éducation religieuse et morale de la jeunesse, dans les écoles du dimanche. Une vie animée règne par les églises et se traduit en chants, prières, et toutes les formes d’une sociabilité fraternelle. L’homme couvert des poussières de la semaine, se retrempe et se réconforte aux sources pures d’une pensée sanctifiante et d’une espérance qui aide à supporter les peines et les fatigues. Et ses forces se renouvellent. Avec les éléments de sagesse, de patience, de considération qu’elle peut puiser dans son dimanche respecté, vivifié, rendu plus riche et plus secourable par tout ce que la piété de chaque génération y apporte de nouveau et de rafraîchissant, l’Amérique de la vie intérieure, de celle qui met la paix de l’âme et le contentement d’esprit au-dessus de tout, aura raison de son moi inférieur dévoré par la fièvre ardente des concurrences et par cette soif des richesses que toute nouvelle acquisition ne fait que rendre plus insatiable.
Ce que nous appelons l’école primaire se nomme en Amérique : public school. La première différence frappante, est que cette école est aux mains des femmes. L’instituteur existe certainement ; mais il est rare et remplit le plus souvent les fonctions de directeur, lorsqu’une école est assez importante pour comporter plusieurs classes. On peut se demander quels résultats les dames obtiennent, comme respect et discipline, auprès des classes supérieures, où se trouvent des garçons de quatorze à quinze ans. L’expérience donne à cette question une réponse très satisfaisante. Non seulement les garçons déjà à la limite de l’adolescence, observent, sous une direction féminine, une discipline respectueuse, mais ils se montrent en règle générale plus malléables et plus dociles aux mains d’une institutrice qui connaît bien son métier, que sous la direction d’un instituteur.
Les écoles publiques sont coéducationnelles. Filles et garçons suivent les mêmes leçons. Elles sont largement fréquentées par des élèves de toutes les classes sociales. Les écoles privées, où se fait l’éducation des jeunes enfants, s’attachent ordinairement au programme primaire. Ces écoles, d’ailleurs, sont fort nombreuses. J’en ai vu une à Minneapolis qui m’a laissé une impression caractéristique. En entrant dans le hall principal du rez-de-chaussée, on est frappé par une panoplie d’instruments de musique suspendus au mur. Arrivé un instant avant l’ouverture, j’avais vu les enfants s’ébattre sur le gazon qui entoure l’école. Sur un coup de sonnette donné par la directrice, une vingtaine d’élèves accoururent, décrochèrent les instruments, surtout des violons, et se mirent à jouer une marche alerte. Au son de cette musique, toute la population de l’école entra et se dispersa dans les salles des divers étages. Une fois tout le monde assis, les jeunes musiciens mirent leurs instruments au clou et allèrent prendre leur place.
Généralement, la classe commence par une lecture destinée à recueillir et élever l’esprit. Fort souvent elle est empruntée aux livres saints. Les écoles possèdent quelquefois un grand hall où tous les élèves peuvent se rassembler. Dans ce cas, ils passent ensemble les premières minutes de la journée. Ils chantent, on leur fait une brève allocution souvent suivie d’une prière. Si une communication doit être faite aux enfants, on profite de ce moment-là.
Dans les classes supérieures, l’enseignement civique est l’objet de leçons spéciales où une part importante est abandonnée aux enfants. Ils sont invités à signaler ce qu’ils ont vu ou lu d’intéressant au point de vue du bien général de la cité qu’ils habitent ou du pays dans son ensemble. Généralement la séance est animée. La discussion est admise. Les enfants proposent même de temps à autre d’envoyer une adresse respectueuse à un citoyen qui vient de rendre un service à la société. A la façon vivante dont les élèves prennent part aux séances civiques, on reconnaît qu’ils sont, dès leur jeunesse, attentifs à la politique, dans le sens large et noble de ce terme. La République et ses destinées ; les progrès de la civilisation matérielle ou morale, tout ce qui touche à l’esprit public ou aux intérêts de tous, occupe leur attention.
On s’aperçoit bien vite que la vie nationale du pays est homogène, malgré l’étendue du territoire et la diversité des habitants. Le fond des institutions n’est pas en question. L’idéal démocratique est l’idéal par tous accepté.
Chez nous, l’accord ne s’étant pas encore fait sur la question fondamentale, il y a division dans les esprits, en dépit de l’homogénéité de la population. Dans ces conditions, les questions qui touchent à la chose publique, excitent des animosités et des contradictions. Par amour de la paix, il faut garder le silence à l’école sur des faits d’une grande portée éducative. Les maîtres sembleraient, devant les élèves, prendre parti pour l’une ou l’autre fraction politique ; ils doivent donc se contenter d’enseigner la France, en général, et demeurer ainsi dans l’abstraction. De pénibles expériences nous mettent tous les jours en face de ce fait qu’il y a plusieurs France. Certes, à force de bonne volonté obstinée et d’une vue plus large sur nos intérêts véritables, nous finirons par nous rencontrer sur un terrain commun. Ce jour-là, les maîtres pourront parler, devant les élèves, des hommes et des choses de la patrie, sans que personne les accuse de faire de la politique. Nous jouirons du privilège enviable que l’Amérique possède dès à présent.
L’école publique n’est nulle part plus intéressante que dans les États neufs et les villes en pleine formation. Dans un des larges établissements de Minneapolis, fréquenté par des centaines d’enfants, le directeur voulut bien, à un certain moment, rassembler tous les élèves. En rangs serrés, ils se posèrent le long d’un corridor, les grands collés au mur, les petits tout devant, à la façon des tuyaux d’orgue. J’avais devant moi de la graine de plusieurs nations. Leur origine se reconnaissait à leur chevelure. Scandinaves aux cheveux filasse, rappelant le lin tout blanc que leurs mères, dans les longues nuits septentrionales, filent sur leurs quenouilles ; Irlandais couleur d’acajou, de carotte ou de feu ; Italiens sombres ou châtains ; Allemands blonds. Et toute la gamme des yeux, ces beaux yeux d’enfants que rien n’égale sur la terre en grâce et en vivacité. Je voyais en esprit leurs familles et les vaisseaux qui les avaient apportées, émigrants, de tous les coins de l’horizon, pour les réunir là.
A un signal du maître, ils entonnèrent l’hymne national américain. Je l’ai entendu souvent. Jamais il ne me produisit autant d’effet que ce jour-là. N’avais-je pas devant moi des rejetons de plusieurs peuples ?
Et, cependant, une même ardente et patriotique conviction faisait vibrer toutes les voix, animait toutes les figures. Tous ces chers petits chantaient l’Amérique d’un cœur unanime. Dans leur chant, se transformant pour moi en symbole, je vis l’expression de faits puissants qui honorent grandement la terre hospitalière où ils se produisent. Je vis la contrée au cœur magnanime, vers laquelle accourent ceux pour qui leur propre patrie est souvent inhabitable, faute de pain. Venus des régions noires qu’habitent les privations et la misère, ils ont trouvé une place au champ du travail et au soleil de la dignité humaine. Leurs enfants ont des vêtements propres, une demeure et une bonne nourriture. Ces mines florissantes l’indiquent assez. La contrée d’adoption leur a été favorable, et ils lui sont reconnaissants. Au droit d’asile est venu se joindre le droit de cité, et ils ont conçu la légitime fierté d’être citoyens de la première République du monde.
L’Amérique est une bonne mère qui non seulement est aimée passionnément par ses propres enfants, mais se fait aussi adorer par ses enfants d’adoption. Dès la deuxième génération, tous ces nouveaux arrivés et leurs descendants, sont des Américains, des hommes nouveaux.
Quand on se demande par quels organes l’Amérique résout la grosse question de l’encadrement et de l’assimilation du flot sans cesse renouvelé des émigrants, qui constitue pour elle une ressource et un grave problème tout à la fois, on est de suite frappé de l’importance de l’école publique. C’est elle le principal, le grand organe de digestion et d’assimilation. L’école est l’estomac de l’Amérique. Là viennent se rencontrer les enfants de toutes les races. Elle les prend, les traite par l’esprit large, accueillant, à la fois libéral et discipliné, sévère et bienveillant, qui est comme le tempérament de sa démocratie puissante et pacifique. Une fois imbus de cet esprit, ils sont siens, car c’est un esprit qui élève l’homme, le dignifie, lui inspire la juste fierté et l’amour de l’ensemble auquel il appartient. Et quand alors il chante l’hymne national, où tant de simple et pieux amour du pays et de son histoire se mêle si naturellement à une foi religieuse sincère et tolérante, il exprime son âme elle-même. C’est vrai. Il s’est identifié avec le drapeau étoilé : il descend des Pilgrim fathers : Washington est son ancêtre, et Lincoln est de sa race. Cela s’exprime en trois mots qui se disent là-bas avec une ardeur de conviction particulière : Je suis Américain.
Un jour, à New-York, je demandai au petit Royal Anderson, neveu de ma charmante hôtesse, Miss Louise Sullivan : « Are you a kind boy ? » Il me répondit : « I am an American. » Il eût fallu le voir se rengorger en disant cela.
Dans chaque centre d’une certaine importance existe une high school, elle aussi presque toujours coéducationnelle. Elle est le degré intermédiaire entre l’école primaire et l’Université. C’est là que se prépare aux carrières pratiques la majorité de la jeunesse. En général, ces écoles sont installées en pleine ville, à proximité de tous. Pas plus que l’école primaire, elles ne comportent d’internat. On y enseigne les sciences, la littérature, les arts. Le chant y tient sa place d’honneur, comme dans toutes les écoles de la République. Les bâtiments sont vastes, bien éclairés. Le long des corridors spéciaux sont suspendues une foule de photogravures excellentes, représentant les monuments de l’antiquité, les principaux chefs-d’œuvre de l’architecture en Europe, les tableaux célèbres des grands maîtres et des reproductions en plâtre des œuvres les plus remarquables de la sculpture. Parmi toutes ces choses destinées à former le goût artistique, se remarquent aussi régulièrement les portraits des grands citoyens américains, destinés à personnifier les aspirations et l’idéal du pays, à perpétuer la mémoire des grands faits historiques. Il n’est pas rare, aussi, d’y rencontrer le buste de Napoléon. Déjà je l’avais vu dans les bureaux des négociants, sur les étagères des salons et les frontons des bibliothèques. Maintenant je le retrouvais dans les cabinets des directeurs d’école et à travers les salles de classe. Décidément, il est populaire en Amérique, et il l’est principalement à titre de self-made man. On admire en lui sa prodigieuse activité, sa marche en avant à travers les obstacles, sa destinée colossale qui le mena d’une origine obscure à la situation d’arbitre du monde. Tout cela lui donne un relief extraordinaire aux yeux de ceux qui n’ont pas, comme nous, à liquider le passé néfaste que nous a légué son autoritarisme. Quand on songe quel rôle Napoléon et ses lois ont joué dans notre enseignement, et quelles traces sa main de tyran a laissées dans notre éducation secondaire masculine, on est surpris de voir sa figure dans les libres écoles d’un pays avec l’idéal duquel la férule napoléonienne présente un si terrible contraste.
A côté de la High school, l’Amérique possède une multitude d’établissements, comparables, dans leur programme, à nos lycées et collèges, mais n’en ayant en aucune façon l’organisation ni l’esprit. Ces écoles sont très souvent en dehors des villes, au bord des lacs, au penchant des collines, ou en plein bois. Elles ont des internats, mais qui n’ont pas la rigide monotonie des nôtres, ni la plupart de leurs inconvénients. Le dortoir a presque partout disparu, ainsi que les trop vastes et trop lugubres réfectoires. On préfère bâtir plusieurs maisons de dimensions ordinaires que d’édifier de massives casernes. Chambres à coucher et salles à manger ont un aspect familial. Et sitôt sorti des maisons, les élèves se trouvent au large. Point de préaux enfumés, point de murs. L’affreuse cour, pleine de poussière et garnie de gravier, où poussent quelques arbres étiques, symboles du régime, heureusement à son déclin parmi nous aussi, n’existe pas. On n’a pas l’impression de se trouver au milieu de détenus. Grilles, fenêtres garnies de barreaux, parloirs mornes, où des visiteurs viennent parler bas aux prisonniers, réglements pédants, sinistres roulements de tambour, tout cet ensemble que nous devons au grand homme dont le chapeau et la redingote sont si populaires en Amérique, n’a aucune place dans les mœurs scolaires des États-Unis. A chaque instant du jour, un élève, désireux de quitter la maison, pourrait s’échapper sans tambour ni trompette. Les récréations se prennent sur des prairies sans clôture aucune. La clef des champs est dans la poche d’un chacun. Tout cela manque absolument de contrainte, mais non de discipline et de surveillance. Le caractère et la conduite des enfants sont l’objet d’une vigilance latente, il est vrai, mais constante et effective. La pureté sexuelle des élèves et le respect de leur propre corps, la tenue consciencieuse dans le travail et la sincérité des paroles et des actes préoccupent les maîtres autant et plus que l’instruction elle-même. Si la figure d’un élève témoigne que son état réclame l’infirmerie morale, l’auscultation et la mise en observation ne se font pas attendre. Sans les persécuter, on sait les suivre. Et surtout des efforts constants sont faits pour les amener à se gouverner et se surveiller eux-mêmes. On estime, à juste titre, qu’une moralité provenant seulement de la constante présence du maître, pèche par la base et n’attend que l’occasion favorable pour devenir de l’immoralité. Que tout enfant soit quelqu’un, comprenne sa dignité, se charge de la responsabilité de ses actes et préside sa République intérieure, voilà le but vers lequel l’éducation est dirigée. C’est l’éducation pour la liberté par la discipline personnelle, l’éducation du « self control. »
Dès que le self control commence à s’exercer, la discipline devient facile. Chacun la maintient en ce qui le concerne. Les tristes moyens coërcitifs, par lesquels on affaiblit le ressort de la volonté, sont considérés comme allant complètement à l’encontre du but de l’éducation.
Chaque école a son infirmerie, presque toujours située dans un gracieux pavillon isolé. Une ou plusieurs nurses y président au soin de jeunes patients, qui n’ont pas l’air malheureux.
La mine des écoliers américains, filles et garçons, est en général prospère. On s’en rend compte surtout, lorsqu’ils sont réunis tous ensemble dans les grandes salles où se tiennent les meetings du matin. C’est un plaisir de promener son regard sur ces figures qui respirent la santé et la bonne humeur. Leur hygiène, d’ailleurs, est bien entendue. Jamais de trop longues séances sans un peu de distraction, de jeux ou de gymnastique. Lorsque se prennent les grands exercices en plein air, les enfants se douchent généralement en rentrant au logis, ce qui les empêche de s’endormir en classe ou de se refroidir. Dans les écoles, il y a souvent une interruption de cinq ou dix minutes pendant lesquelles les enfants se dégourdissent sur place. Un piano, posé dans le corridor, donne le signal des mouvements, et au même instant, dans toutes les classes et sans quitter leurs tables, les élèves exécutent, sous la direction du maître, une série de mouvements bien combinés qui rétablissent une bonne circulation, les émoustillent et leur permettent ensuite de rester tranquilles.
Parmi les Universités situées dans les grandes villes, j’ai vu particulièrement celles de New-York, Philadelphie, Boston, Chicago, Minneapolis, Toronto au Canada ; mais, par une combinaison très heureuse, une partie importante de la vie universitaire s’est depuis fort longtemps réfugiée dans le silence et l’air pur des campagnes. Au nombre des établissements de ce dernier genre que j’ai visités et où j’ai séjourné, il faut citer : Harward, Oberlin, Mount Holyoke College, Vassar.
Harward est très connu comme grande Université pour la jeunesse masculine. Aux portes de Boston, ville déjà traditionnelle, pleine de souvenirs studieux et d’un esprit tourné vers les lettres, les sciences et les arts, Harward est en outre richement doté par des amis anciens et nouveaux. Une foule d’illustrations américaines en sont sorties. Le Président Roosevelt y a fait ses études. Harward avec Yale, sa rivale en jeux sportifs et en travaux savants, sont des foyers dont le rayonnement s’aperçoit de loin. Oberlin est moins connu en France. Et cependant l’Université de l’État d’Ohio porte le nom d’un Français illustre, Oberlin, le grand pasteur qui vivait au Ban-de-la-Roche, à la limite du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce pasteur alsacien fut le pionnier d’une piété vivante et originale. Il se servait du pic et de tous les outils routiers et champêtres, aussi bien que du langage ordinaire, pour donner un corps à la doctrine de l’Évangile, et il traduisait la Bible en actes pratiques, en civilisation, en institutions sociales. Cet homme a frappé l’esprit d’un peuple qui a défriché, bâti, civilisé plus que nul autre. Ils en ont fait un de leurs modèles vénérés, et son nom demeure attaché à l’une de leurs Universités. Oberlin-College est situé en pleine campagne, au milieu d’une contrée verdoyante, légèrement ondulée. Une toute petite ville est à côté de l’Université et porte le même nom.
Le long de larges avenues sont situées les maisons des professeurs, comme à Harward et toutes les Universités du même genre. Une série de bâtiments spéciaux, répandus sur un vaste « campus », gazonné et planté d’arbres superbes, renferment les laboratoires, les salles de cours et d’études, les collections, la bibliothèque, le Musée d’Art et le Conservatoire de Musique. Sauf certaines parties de la médecine, qui ont besoin des grandes villes et de la proximité de leurs hôpitaux, toutes les branches du savoir humain y sont enseignées. L’Université est coéducationnelle. Le nombre d’étudiantes est sensiblement égal à celui des étudiants. Au centre des nombreux bâtiments, tapissés de lierre, qui constituent l’ensemble universitaire, une église s’élève où, tous les matins, la population entière de cette jeunesse, s’assemble avec ses maîtres, afin de commencer la journée par une lecture édifiante. Le Conservatoire de Musique, très suivi, fournit des éléments artistiques de premier ordre et contient une salle pour les auditions, dans laquelle se construit en ce moment même un des plus grands orgues des États-Unis. Les étudiants forment des sociétés musicales et chorales, actives tout le long de l’année. Ils sont, en outre, groupés en sociétés de tout genre, où ils poursuivent ensemble la culture scientifique et la culture morale. La presque totalité d’entre eux se rattache en outre aux diverses organisations gymnastiques et athlétiques. Ainsi l’Université est une sorte de ruche bourdonnante en pleine heureuse solitude. C’est un monde, rappelant par son isolement studieux et son travail recueilli, les bois sacrés des muses. Une atmosphère de paix y environne les études qui, par le perpétuel contact d’un grand nombre de jeunes personnes et de jeunes gens laborieux, atteignent un degré d’intensité considérable, sans que la vie physique y perde ses droits. On sent qu’il règne beaucoup de contentement et un salubre esprit ambiant. Toute cette jeunesse porte sur sa figure l’indice d’une existence normale et équilibrée. En somme, elle passe là d’heureuses années. J’ai pu m’en convaincre, non seulement par le train journalier, observé dans les diverses Universités, et par le ton dominant qui y règne, mais encore par les souvenirs que la vie universitaire laisse au cœur de ceux qui l’ont partagée. Partout j’ai rencontré des hommes et des femmes qui en parlent avec émotion et gratitude. Oberlin est un centre plus populaire que Harward ou Yale. Tout ce jeune monde a son avenir à créer et ne doit compter que sur soi-même.
Les étudiants et les étudiantes demeurent dans des maisons séparées, rattachées à l’Université et situées à proximité des cours.
Il n’y a ni cuisines ni salles à manger dans les maisons des étudiants. Les repas sont pris en commun dans celles où sont installées les étudiantes. Les tables sont par groupes de douze à vingt, et il y règne une aimable cordialité. J’ai toujours joui, très spécialement, du coup d’œil d’ensemble sur ces tables, où la présence des deux sexes mettait une note originale dont l’effet sur leur éducation mutuelle est salutaire à tous.
Si jeunes qu’elles soient, comparativement à nos vieilles Universités européennes, les Universités américaines ont leur histoire, pieusement recueillie. On dirait que l’Amérique est d’autant plus ménagère de ses souvenirs, que la région en est moins étendue. Partout, dans les Universités comme dans les écoles primaires, sont conservés, sur des plaques commémoratives, les noms et les traits des fondateurs de laboratoires, de bibliothèques, de musées universitaires, ainsi que les noms des anciens élèves qui se sont distingués dans le monde. Au premier rang figurent les actes de dévouement et d’héroïsme.
Westpoint on Hudson, principale école de guerre des États-Unis, consacre particulièrement le souvenir des morts héroïques. Westpoint est un nid d’aigle assis sur les rochers qui tombent à pic dans le fleuve. Une fois arrivé là-haut, on découvre un plateau très étendu où se trouvent d’immenses casernes, des salles d’étude et de cours et un champ de manœuvres sur lequel, au moment même où nous arrivions, marchait, drapeaux déployés et musique en tête, toute la population de l’école. Ces jeunes gens ont une tenue superbe. La moitié au moins de leur temps se passe aux exercices physiques. Beaucoup d’entre eux, excellents cavaliers, s’entraînent à un jeu spécial consistant à taper sur des boules du haut de leur cheval. Armés de maillets à long manche, ils s’élancent à travers la plaine gazonnée, et l’adresse avec laquelle ils évoluent est, à certains moments, stupéfiante.
Parmi les immenses bâtiments de Westpoint il en est un destiné aux souvenirs guerriers, c’est le Memorial-Hall. Pas un fils de l’Amérique ne tombe sur le champ d’honneur sans que son nom ne soit gravé là. Les généraux ont leurs bustes ou leurs portraits. Des tableaux consacrent certains faits militaires particuliers. Dans ce bâtiment sont de vastes salles où se célèbrent les anniversaires. A certains jours, la population de l’école s’augmente d’hôtes qu’un lien quelconque rattache à l’armée. Ces jours-là sont les grandes dates du sentiment patriotique, un sentiment qui, pour être plus visiblement exprimé dans les fastes de Wespoint, n’en existe pas moins vivace et vibrant à travers toutes les écoles américaines.
Tel est le nom de la première université de femmes, fondée aux États-Unis et dans le monde, aux environs de 1837. Collège, en Amérique, veut toujours dire Université. L’Université du « Chêne sacré » est située dans une jolie campagne ondulée, ayant à l’horizon la Montagne du Chêne sacré et faisant partie de l’État de Massachusetts. On y arrive par un tramway de route, en une demi-heure, depuis le chemin de fer. Un petit village est situé dans le voisinage. Autrement, solitude complète et grand air.
L’ancienne Université tenait en un seul et colossal bâtiment qui a complètement brûlé en 1896. Par cet incendie qui détruisit tout, l’école sembla un moment anéantie dans son principe même. Mais les affections des anciens élèves lui avaient, à travers la République, créé de trop solides appuis, pour qu’elle pût rester ensevelie sous la cendre. On releva donc ces murs, mais d’après un autre plan. Vingt édifices divers remplacèrent l’ancien massif de constructions. Maintenant Holyoke College vous salue de loin, du sourire de ses maisons couvertes de lierre. Ici est la bibliothèque, là le musée de sculpture et de peinture, là encore la gymnastique et les bains. Plus loin, la magnifique église, capable de contenir les deux mille habitants de l’Université ; les serres, l’infirmerie, les laboratoires, les salles de cours, les maisons d’habitation, l’observatoire d’astronomie. Ce dernier me fut expliqué par un astronome féminin qui y passe tout son temps et y fait des cours à certaines heures, tant de jour que de nuit. Quelques bâtiments isolés, très gracieux, servent de logement à ceux des professeurs qui préfèrent la solitude. Il n’y a que des femmes. J’assistai à une leçon de chimie et à la manipulation, par une vingtaine d’étudiantes, d’une certaine quantité de levure de bière. Toutes étaient engoncées dans des tabliers blancs, de la tête aux pieds. Le sérieux, avec lequel elles regardaient leurs tubes et notaient leurs proportions, leur donnait un air d’alchimistes cherchant quelque pierre philosophale. La chimie est là-bas une carrière fort agréable et lucrative pour les femmes, qui se placent couramment dans certaines industries. A la serre, je vis plusieurs jeunes personnes occupées à étudier les fleurs, pendant que d’autres les soignaient. Au musée, une quantité d’élèves faisaient du dessin, de la peinture à l’huile, de la sculpture, des travaux relatifs à l’architecture et la décoration des maisons.
Plusieurs centaines d’élèves accoururent pour écouter ma conférence française. J’eus le plaisir de constater qu’elles comprenaient fort bien notre langue. Leur professeur principal est une jeune personne très distinguée, qui a passé plusieurs années à Paris, et suivi avec assiduité, les cours de Mr Gaston Paris, dont le portrait orne sa chambre. Dans ma conférence anglaise du soir, j’eus devant moi la population de Holyoke tout entière, public gracieux, intelligent, à qui c’est un régal de parler et qui vous soutient et vous inspire par sa bonne sympathie.
Au dîner, j’avais été invité dans la maison de la directrice. Elle y demeure au milieu d’une centaine d’étudiantes. Il y avait six ou sept tables dressées. Les dames servaient elles-mêmes. C’était absolument charmant. J’appris, en m’intéressant à ce détail, que toutes les jeunes personnes s’entraînaient aux travaux pratiques, et qu’une très importante partie du travail de la maison était fait par les étudiantes.
Le personnel de service se trouve ainsi réduit à un minimum. Les études n’y perdent rien. Un peu de travail physique est un délassement et rétablit l’équilibre mental. La bourse y gagne. La pension coûte moins cher, en raison même de cette organisation très pratique. J’eus ainsi le plaisir de voir les corridors de la maison balayés par des jeunes filles fort distinguées et qui, pour tenir un balai, m’en paraissaient un peu plus jolies.
La veille, on m’avait raconté qu’une certaine quantité de courageuses jeunes personnes qui faisaient là leurs études, avaient gagné, comme dames de compagnie, femmes de chambre ou dans d’autres emplois lucratifs, l’argent nécessaire à leurs études. Plusieurs sont actuellement professeurs, qui ont amassé par des leçons particulières le nécessaire pour demeurer à l’Université et y acquérir leurs grades.
Je me trouvais à Holyoke, le soir du jour où le Président Roosevelt fut réélu. L’Université, calme à la surface, était en ébullition intérieure. Dans ma conférence, je fis une allusion au fait passionnant du jour. Le résultat de l’élection était encore inconnu ; je l’envisageai comme certain. Ce fut une explosion de joie dans la salle, mille mouchoirs s’agitèrent avec frénésie, et des trépignements généreux se firent entendre à travers tout l’auditoire. Le lendemain, à la première heure, le résultat une fois acquis, l’ivresse ne connut plus de bornes. Pendant deux heures, on entendit des chants patriotiques, des sérénades, des cris spéciaux qui servent là-bas aux étudiants des deux sexes à manifester leur contentement. Ces cris, où les femmes rendent souvent des points aux hommes, ont une énergie que je qualifierai de sauvage, et je me suis assuré qu’ils venaient bien des anciens Peaux-rouges.
Les femmes ne votent pas aux États-Unis. Pour se dédommager de cette lacune dans la loi, les jeunes filles de Holyoke avaient décidé qu’elles feraient une élection privée, le jour avant l’élection publique. Elles observèrent minutieusement les usages ; firent une campagne électorale avec articles dans le journal de l’Université, meetings et affiches. Au jour dit, le vote fut soumis aux plus strictes formalités et même, pour copier fidèlement les mœurs ambiantes, ces demoiselles désignèrent quelques policemen, ou plus exactement police women « for hindering bribery. » Le résultat de l’élection fut une formidable majorité en faveur de Roosevelt. Quelques jours plus tard, à la Maison Blanche, je racontai ces incidents amusants au Président, qui en rit de bon cœur.
Avant de quitter Holyoke, j’assistai à la pose de la première pierre d’un nouvel et important édifice dont, d’ailleurs, les murs s’élevaient déjà considérablement. Par les chemins qui circulent entre les beaux platanes et les bandes de gazon, je vis s’avancer vers l’église où se célébrait la cérémonie, une longue théorie, toute l’Université et ses hôtes, en costume des grands jours : hermines, toques, robes de docteur. Un chœur, composé de deux cents jeunes filles en surplis blanc, précédait le cortège. La Présidente, assistée de quelques hauts membres d’Universités voisines, fit un speech, et des chœurs merveilleux furent chantés. Le reste du jour fut consacré aux réjouissances générales. Des réjouissances, il y en a souvent. Elles font partie du programme. Les jeux en plein air, l’exercice journalier, une bonne hygiène, une vie normale et pas trop de tracas d’examens, font à ces jeunes et studieuses personnes une vie, en somme, très heureuse.
Parmi les marques de bonne amitié dont le souvenir nous demeure précieux, il est impossible d’oublier celle qui nous vint du Temple-College de Philadelphie et du Dr Conwell, son éminent directeur. Avant de conter comment le doctorat nous fut conféré, présentons M. le Docteur Conwell.
Le Docteur Conwell est de haute stature, maigre, brun, nerveux. Un nez aquilin marque sa figure expressive, où des yeux à la fois bons et pénétrants allument leur flamme sombre. Il a passé une partie de sa vie à voyager autour du monde, exerçant, pendant quelque temps, le périlleux métier de correspondant de guerre en Extrême-Orient. Quand il eut amassé toutes ses expériences, il subit une transformation intérieure d’où son esprit sortit, animé de convictions religieuses ardentes. Il se fit alors prédicateur et professeur, et transporta toute la belle fougue de l’ancien globe-trotter sur le champ de l’action religieuse et sociale. Armé de connaissances pratiques très étendues et d’une vaste érudition, doué d’un tempérament de fer et en même temps d’une souplesse d’intelligence qui le rend large, tolérant, de relations cordiales, il fit profiter son œuvre de toutes ces qualités éminentes. Après de longues années d’un labeur qui ne cesse jamais, et dont une partie est consacrée à faire des conférences sur tous les points de l’immense territoire des États-Unis, on lui doit : l’érection du plus large temple de Philadelphie, appartenant à la dénomination baptiste ; la création d’une université complète ayant un caractère populaire.
Le temple contient plus de trois mille places assises. Mais le Dr Conwell, au courant de tous les moyens de la civilisation, y a fait installer un appareil téléphonique perfectionné qui permet au prédicateur de se faire entendre bien au-delà de la salle où il prêche. Cette installation eut d’abord un but purement humanitaire. Il s’agissait de rendre possible aux malades d’un hôpital voisin, la participation aux offices, sans aucun dérangement pour eux. Une demi-douzaine de récepteurs suspendus en face de la tribune recueillent et transmettent non seulement la voix du prédicateur, mais la musique de l’orgue, les chants des chœurs et de la communauté. Les malades, de leur lit, peuvent, en se fixant sur la tête un casque téléphonique, suivre tous les incidents du culte public. Une fois l’installation faite, ses services s’étendirent bien au-delà du rayon prévu. Tout abonné au téléphone peut, à condition de prévenir la veille, se faire mettre en contact avec le Temple pour la durée du service religieux. On voit d’ici le merveilleux usage qu’un arrangement semblable comporte.
La première fois que je vis le Dr Conwell, c’est en chaire, un dimanche vers les dix heures du soir. Il prêchait, en attendant que je vienne d’un lointain quartier de Philadelphie, pour saluer sa communauté. Son sermon était dirigé contre un certain nombre de crimes sociaux qui consistent à offenser, à dépouiller, à voler Dieu dans la personne des hommes. Il énumérait, avec sévérité, des cas où, par suite de bas intérêts ou d’égoïsme sauvage, nous en arrivons, en pleine civilisation, à priver des enfants et des hommes de leur droit à la vie, à la liberté, à la clarté intellectuelle, au développement moral. Et à chacun de ces cas il s’écriait avec une passion qui prêtait à sa parole un éclat vengeur : « You rob God ! » vous volez Dieu !
Il m’invita plusieurs fois à prendre la parole devant son immense auditoire. Nous eûmes de longues conversations, et je fus mis au courant de l’œuvre magnifique qui s’accomplissait là, ainsi que dans l’université bâtie porte à porte et intitulée Temple-College. Cette université a des centaines d’étudiants, un corps de professeurs, hommes et femmes, très remarquable, et son but spécial est de rendre les études accessibles à quiconque a des capacités. Toute une vaste section ne fonctionne que le soir. Là, des ouvriers, des employés, préalablement entraînés par des études personnelles, viennent suivre des cours. Après avoir suivi ces cours pendant de longues années, ils peuvent acquérir des grades universitaires. Temple-College est une ruche immense et bienveillante où le peuple intelligent peut s’initier à la vie intellectuelle. C’est de cette université qu’on voulait me faire docteur, étendant cette même marque de politesse à mon compagnon de voyage. La qualité et le but d’une semblable œuvre, nous faisaient d’autant mieux apprécier une offre qui fut acceptée avec empressement. La réception fut fixée au 23 novembre. Ce jour-là, entourés de tout le corps de professeurs, nous entrâmes dans la salle bondée d’un public sympathique. Non seulement on désirait nous offrir un témoignage personnel, mais ce témoignage s’adressait à la France elle-même, par dessus notre tête. On nous le fit voir surabondamment. En premier lieu, toute la vaste salle avec ses larges tribunes était littéralement drapée aux couleurs de France mêlées aux couleurs américaines. Puis, comme premier article du programme de la séance, la Marseillaise fut chantée par un quatuor d’une vigueur entraînante. Ensuite, tous les discours contenaient des allusions à la République sœur. Un de ces discours fut prononcé par le maire de Philadelphie, qui profita, en outre, de l’occasion pour déclarer qu’il était lui-même un ancien étudiant de Temple-College. Sa belle carrière avait été ouverte par cette bonne maison où il était possible de faire ses études, le soir, tout en gagnant sa vie le jour.
Aux applaudissements sans cesse renouvelés d’une foule enthousiaste, chaque allusion à la France se transformait en manifestation générale. « Dites bien, et répétez-le, nous enjoignaient tour à tour les orateurs qui se succédaient à la tribune, dites à vos concitoyens en quelle vive amitié nous tenons leur pays, et combien nous désirons qu’il soit fort, prospère, animé de l’esprit qui fait les puissantes démocraties. »
Puis on nous remit des insignes, des toques et des parchemins, afin que de cette heure il nous restât un symbole aux écrins du souvenir.
Je venais de voir, aux environs de Philadelphie, dans une jolie contrée où les champs et les fermes alternent avec des restes de forêts, une magnifique école coéducationnelle dirigée par les « Amis ». Maintenant, me dit frère Joseph Elkinton, négociant, et speaker dans les meetings quakers, venez, que je vous montre une autre maison, celle-là pour enfants et jeunes gens égarés.
Nous partîmes, cahotés, par de mauvais chemins de traverse, et bientôt gagnâmes une sorte de cité, bâtie sur une colline à large dos, et composée d’une vingtaine de maisons. C’était là.
Je n’en croyais pas mes yeux. Pour une maison de correction, cet établissement manquait complètement de physionomie. D’abord, pas de murs, pas même une palissade, pas même un fil de fer ! On entre et on sort comme on veut. Sur une question à ce sujet, le quaker Elkinton me répondit avec un sourire malicieux : « c’est pour empêcher les évasions. » Il paraît que rien n’empêche les gens de s’en aller, comme d’être libres de le faire à toute heure. Cette absence de barrières, de portes, de verrous, de gardiens farouches, me fit beaucoup songer. Et je finis par trouver qu’elle était parfaitement en accord avec les principes de ces « Amis », si humains en toutes choses. En effet, quoiqu’ils soient de vrais croyants, ayant la foi qui transporte les montagnes, ils n’ont pas construit, autour de leur cité spirituelle, de ces murs qui s’appellent des credos. Ils ne voudraient pas qu’un mur empêchât l’esprit de souffler ou le soleil de rayonner. Et la même raison qui fait qu’ils n’ont pas la fibre ecclésiastique, les arrête devant les mesures coercitives, même quand il s’agit de jeunes mauvais drôles. Ah ! que je comprends ces choses, et que cette foi en la liberté me semble belle !
En approchant des maisons, situées sur les deux rangs, le long d’une large avenue avec, au bout, un bâtiment directeur, je remarquai qu’elles étaient toutes tapissées de lierre. Non de lierre comme nous le connaissons ici et qui ne supporte pas les hivers rigoureux de l’Amérique, mais d’un lierre qui perd ses feuilles en automne. Avant de tomber, elles prennent de belles tonalités, variant entre le rose pâle et le pourpre intense. Toutes les maisons en étaient garnies. On eût dit les feux d’un beau couchant, caressant leurs pierres, leurs embrasures de portes et de fenêtres. C’était si gracieux, que ce souriant endroit paraissait un séjour privilégié où l’on récompense la vertu, plutôt qu’un lieu sévère où le vice doit être corrigé. Plus d’une âme imbue des principes classiques de la poigne, eût senti là son mépris s’éveiller.
Joseph Elkinton me montra un bâtiment en construction, où des charpentiers étaient en train de poser des poutres. Ceci, dit-il, est une nouvelle demeure. Ceux qui la construisent sont les aînés de la maison. Ils travaillent sous la direction de quelques hommes du métier. Le système, ici, est de faire faire tous les travaux par les intéressés eux-mêmes.
Nous commençâmes la visite à travers une série de constructions ; nous vîmes des ateliers et des écoles. L’école ne fonctionne que le matin, sauf pour les petits, qui la fréquentent l’après-midi également. Les ateliers ouvrent l’après-midi. Nous regardâmes faire des souliers, des vêtements, des meubles, puis imprimer un journal, laver du linge. Sur une table, des gamins repassaient des chemises avec des fers chauffés à l’électricité. Le même fer, en contact avec un courant, fonctionne indéfiniment : point d’émanations gazeuses ; point de taches de charbon. Toute cette population d’enfants n’avait pas l’air de contrainte que jusqu’ici j’avais toujours remarqué dans les maisons analogues. Nous en vîmes d’autres qui revenaient du labour, marchant en rang comme des soldats, mais leur expression de figure était celle de garçons contents de leur sort. Frère Joseph me dit que le principe fondamental de la maison était de restaurer en chacun le sentiment de la dignité humaine. Jamais on ne leur parle de leur passé. Il est considéré comme oublié et pardonné. On préfère faire vibrer en eux la fibre héroïque, que de les attendrir et les amollir ou de les décourager par le sentiment trop vif et trop persistant de leurs fautes.
Nous visitâmes leurs habitations, propres, visiblement respectées, sans aucune de ces traces de dégradation qui montrent qu’un homme manque de respect à sa propre maison.
Sur la table dressée pour le dîner, verres et vaisselle d’une propreté immaculée, et des serviettes, s’il vous plaît, pliées avec une certaine coquetterie. Tout rappelle que ceux qui s’asseoiront à ces petites tables de six, sont considérés comme des individualités et non comme de simples numéros.
Pendant que nous parcourions le bâtiment de gymnastique, contenant les piscines de bain, un carillon se mit à sonner dans la tour de l’horloge. — Est-il mécanique ? dis-je à Elkinton. — Non, c’est un des jeunes pensionnaires qui le fait sonner. Il est habile musicien, et nous pensons que les mélodies apaisantes ou joyeuses peuvent agir favorablement sur l’esprit des enfants, aux heures surtout où ils se reposent et peuvent écouter tranquillement.
Une fois le tour complet fait, nous pûmes voir, dans le bureau du directeur, les albums nombreux et fort curieux où sont représentées toutes les générations qui ont passé par l’école. Chaque enfant a une courte biographie en deux parties : avant et pendant son entrée à la maison. Au-dessus des détails biographiques sont deux photographies. L’une représente l’élève tel qu’il est entré. Elle se fait toujours à la première heure et, en général, les figures sont pâles et sournoises, ou contraintes et dissimulées. L’autre photographie montre le même élève, tel qu’il était au jour de la sortie. Entre ces deux images il y a souvent des différences frappantes. Pour une minorité qui semble n’avoir pas profité, il y a un nombre énorme de physionomies accusant une transformation complète.
J’eus un long entretien avec le directeur et plusieurs de ses principaux collaborateurs. Tous sont quakers, quoiqu’il n’y ait pas un seul enfant quaker parmi ces pauvres jeunes habitants du refuge. Tous m’ont frappé par la foi en l’homme, en l’enfant. Ils sont bien moins obstinés à mettre en relief la corruption native des gens qu’à découvrir en chacun quelque vestige de l’image de Dieu. Ils aiment ces enfants, sans avoir vis-à-vis d’eux l’air protecteur des justes qui consentent à toucher aux injustes. Ceux-là sont de vrais disciples du Maître qui prenait sur lui les péchés des autres. Ils se frappent la poitrine, parce que des enfants sont tombés, victimes souvent de notre état social vicieux. Et ils les aiment à cause de leur malheur. Par l’effet d’une curiosité très naturelle, je demandai s’il n’y avait pas là quelques jeunes Français. Un garçonnet leva la main. — D’où es-tu ? — De Vincennes. — Et moi, lui répondis-je, je suis de Fontenay-sous-Bois. Et nous échangeâmes une poignée de mains en signe de bon voisinage.
Ces quakers sont de braves gens ; leur mépris austère des formules et des conventions, leur simplicité rude et bienveillante m’a gagné le cœur !
Je les récompensai de tant de bienfaits spirituels, procurés par leur fraternelle compagnie et le spectacle de leur mâle activité, en m’appropriant une jolie inscription fixée au mur dans le cabinet du directeur. Sans autre forme de procès, je la mis dans ma poche.
Et qu’était-ce donc ? Un credo dont la lecture m’avait touché jusqu’aux larmes, intitulé : The school teachers creed. Il commence ainsi : « I believe in boys and girls ! » « Je crois aux jeunes garçons et aux jeunes filles ! » La voilà, la foi en l’homme, sans laquelle toute notre foi s’écroule dans le néant et le pessimisme !
Si vous doutez de l’homme, de son œuvre, du grand labeur sur les sillons de la terre ; si vous ne prenez la présente économie que comme une affaire mal engagée, destinée à la banqueroute et dont l’au-delà seul payera le déficit, vous faites une injure au Dieu en qui vous prétendez croire et que vous pensez glorifier, en niant l’homme. Car l’auteur responsable de ce monde présent, c’est Lui. Son honneur est engagé sur nos têtes. Nous sommes solidaires. Je ne rendrai pas aux chers « Amis » le carton que je leur ai dérobé, et je relirai sans cesse le vaillant, le claironnant schoolteachers creed : « I believe in boys and girls. »
Un jour, je rendais visite à Mr Klopsch, le dévoué rédacteur du Christian Herald, en qui se concentrent tant d’œuvres de miséricorde et d’efforts vers une humanité meilleure. Il me dit : — Viendriez-vous un soir à Bovery-Mission ? Vous vous rencontreriez là avec tout ce que la cité de New-York peut nous montrer de plus lamentable en fait d’hommes sans feu ni lieu.
Rendez-vous fut pris immédiatement pour le lundi, 28 novembre. Vers les onze heures du soir, Mr Klopsch frappa à la porte du cercle où j’avais passé, au milieu d’amis, une de mes rares soirées libres. Il faisait froid. Une brume légère couvrait la ville. Nous roulâmes pendant une heure environ jusqu’à ce que nous eûmes atteint dans East-End, le local de Bovery-Mission.
Dans une salle longue et étroite un public compact se trouvait entassé. Une tribune occupait le fond, surmontée d’un orgue. Sur cette tribune avaient pris place une série de personnes intéressées à la mission, entre autres une dame âgée qui lui consacre son existence entière. Il était minuit. Quand je m’assis au centre de l’estrade, je vis devant moi une barre destinée à servir d’appui aux orateurs. Et j’eus l’impression d’être cité à la barre de quelque invisible tribunal où siégeait la misère, ayant comme assesseurs une vraie cour des miracles, un ramassis de détresses, venues là de tous les bouts de la terre. Je demeurai d’abord en proie à une sorte de stupeur de l’âme. Heureusement l’orgue jouait, et l’assemblée chantait. Cela me permit de regarder cette foule composée des scories des nations. Il n’y avait pas une seule femme. L’aspect de ces gens était celui de vaincus ; mais non de vaincus, fraîchement revenus de quelque bataille, effarés encore des visions horribles de la mêlée. C’étaient des vaincus de vieille date, trop éteints et trop annihilés à présent pour se souvenir. Leurs figures présentaient des types de toutes les patries et montraient en même temps qu’ils n’en avaient plus aucune. A les voir ainsi, on se disait involontairement : A quoi te sert, Italien, ton roi ? Allemand, ton empereur ? Français, ta République ?
Ils étaient tombés en dehors des mailles où tiennent les citoyens réguliers des pays, dans l’immense filet du malheur, et gisaient là, victimes de leur paresse, de leur ivrognerie, de leur manque de caractère, ou de circonstances brutales où s’était brisé, l’esquif de leur vie.
Je leur faisais, de ma place, des visites personnelles, en les observant longtemps, individuellement. Parmi ces centaines d’épaves, pas une méchante figure. Il y avait de la diversité sous l’uniformité sordide des haillons : imberbes et barbus, hirsutes et chauves, et beaucoup plus de borgnes que ne comporte une assemblée d’hommes ordinaires.
Par combien de sentiers divers, leurs vies jadis fraîches et pleines d’espérance avaient-elles abouti à cet écrasement qui, les réduisant en poussière, les condensait comme en un résidu noir au fond de la cornue sociale. Ils me parurent si grands dans leur néant, que toute la gloire de la vie bourgeoise et régulière en fut, sur l’heure, couverte d’une ombre. Une main invisible me retira toutes les provisions sur lesquelles d’ordinaire compte un homme, quand il doit parler à des semblables qui ont un lit pour s’y coucher, une table pour s’y asseoir ; qui portent sur eux ce passeport nommé l’argent et qu’anime le souffle de cette âme sociale : le crédit. — Je me sentais moi-même, par sympathie, réduit à la misère noire, à l’humanité nue, souffrante et blessée, et par là, je devenais leur égal. Et quand je me levai pour les appeler « frères » je vis, assis au milieu d’eux, l’esprit de l’humanité souffrante, le Fils de l’homme qui n’a point où reposer sa tête. Jamais je ne me suis senti plus fortifié par la pensée de pouvoir parler en son nom. Et jamais le jugement de sa parole, à la fois clémente et vengeresse, sur nos vanités, sur le mensonge du christianisme confortable, ne m’a paru plus sévère. Je reçus, ce soir-là, une de ces leçons qui remplissent l’âme de douleur et d’angoisse. Se rendaient-ils compte de l’effet surhumain qu’ils me produisaient ? Évidemment, non. Mais ils écoutèrent de bon cœur ce que je leur disais tout haut, comme j’avais recueilli en silence ce qu’ils me disaient tout bas.
Puis je descendis de la tribune et priai les assistants de lever leurs mains selon qu’ils parlaient une des trois langues : français, anglais, allemand, les seules dans lesquelles je pouvais me faire comprendre. Et les conversations particulières s’engagèrent. Leurs courtes biographies, finissant toutes mal, rappelaient ces séries de messagers de malheur qui arrivent coup sur coup, annonçant chacun une autre catastrophe. Parmi les Français à qui je parlai, se trouvait même un ancien instituteur de Marseille. Il n’avait pas cinquante ans. Des bancs de l’école normale, par quelles hasardeuses pérégrinations était-il venu là ?
Des tasses de café noir circulaient dans les rangs. L’heure de la clôture approchait. Une abondante distribution de pain fut faite à la sortie. Où vont-ils coucher ? me demandai-je, en voyant la noire colonne se disperser dans la brume nocturne. Et leur vision me suivait, lamentable, troublante, posant devant mon esprit le problème douloureux de l’humanité vagabonde.
J’en parlerai comme un simple passant, non comme un enquêteur de métier. A toutes les heures du jour et de la nuit, pendant mon séjour là-bas, l’occasion m’a été fournie de circuler par les rues des grandes villes. J’ai vu les quartiers populaires, commerçants et bourgeois ; en particulier, un coup d’œil donné aux quartiers où les étrangers se groupent et s’entassent, selon leurs nationalités diverses, m’a vivement intéressé. Mais nulle part une exhibition du vice ne m’a choqué.
Chez nous, nous avons les affiches, les petits journaux pornographiques illustrés, tous en bonne place, afin de se faire reconnaître aisément par ceux qui les cherchent, et d’attirer, s’il se peut, l’attention de ceux qui ne les cherchent pas. Nous avons, aux abords des gares, l’embuscade pour surprendre les nouveaux arrivés, peu au courant des usages de la cité monstre, et aux abords des Lycées, les distributions de mauvaises lectures et les enjôleuses de jeunes garçons. Nous jouissons du camelot habile qui attire le client en dessinant sur le trottoir et ensuite, le cercle une fois formé, essaie de placer des cartes licencieuses aux mains des auditeurs.
Enfin, nous avons, la nuit, dans certains quartiers principalement, le raccolage sur le trottoir. Que n’avons-nous pas ? Un père de famille ou une mère peuvent maintenant difficilement prendre le train ou circuler par les rues, sans être gênés à cause de leurs fils ou de leurs filles.
Lorsque nous nous plaignons, on parle de liberté. Dans un pays de liberté, il n’est pas admissible que des entraves soient apportées à la presse, à la circulation des citoyens, à la publicité. Et sous prétexte de liberté, la majorité des citoyens est constamment gênée dans la chose du monde la plus simple, à savoir dans le mouvement journalier, qui veut que l’on puisse, sans inconvénient, sortir de chez soi et se promener par la ville. En somme, nous subissons le contact des pires malpropretés, nous, nos femmes, nos filles, nos fils, par l’effet d’un simple sophisme.
Les États-Unis sont, eux aussi, un pays de liberté. Comparativement à la belle latitude qu’ont là-bas les individus et les associations, nous sommes, en France, de plusieurs siècles en retard. Toutes les initiatives passées chez nous au laminoir des routines et des engrenages administratifs y ont libre cours. Il s’y accomplit tous les jours des choses nouvelles et hardies. En un mot, la liberté y règne dans les institutions, les mœurs, les lois. Mais on n’en tire pas la conclusion qu’il faille livrer les murs aux affiches cyniques, ni la rue aux ébats du scandale. Les jeunes filles sortent sans accompagnement, de jour et de nuit, et personne ne leur manque de respect. Elles ne risquent pas de voir le trottoir barré par des malheureuses qui ne savent pas ce qu’elles font, mais dont le triste métier qu’elles sont incapables de juger, devrait, par la prévoyance sociale, être rangé au nombre des industries insalubres. Ces industries, on les bannit du jour, si on ne peut les supprimer.
Une objection courante est que les vices cachés sont pires que ceux étalés en public, ayant l’hypocrisie en plus. Nous ne le nierons pas. Mais oserait-on affirmer que les sociétés ayant le plus de vices publics soient exemptes de vices cachés ? On peut fort bien cumuler les deux. Chez nous, les rues sont malpropres. Prenez-vous cela pour un indice ou une preuve de la propreté des intérieurs ? Quelle logique !
J’applaudis des deux mains, lorsque des industriels, qui savent l’Amérique curieuse de nouveauté et veulent y importer des produits scabreux, se trouvent arrêtés net par la police. La liberté est-elle faite pour les empoisonneurs ?
Je ne suis pas de ceux qui ont comme idéal d’acclimater chez eux les mœurs de l’étranger. Chaque pays a son tempérament. Mais ici, il s’agit de bon sens ; le bon sens n’est pas une denrée nationale. Tout le monde en vit. Il est contraire au bon sens de laisser la rue s’emplir de miasmes et de pestes ; d’exposer la jeunesse aux pires rencontres ; de permettre au cynisme de s’afficher sur nos murs.
Malgré les plus attentives prévisions, l’imprévu nous guette sans cesse dans la vie. Et cet imprévu finit par prendre une place considérable dans l’existence du conférencier en tournée. De vingt-cinq à trente conférences, premier chiffre sagement fixé, afin d’éviter le surmenage, nous montâmes bientôt au double. Vers le milieu d’octobre, ce maximum se trouvait dépassé. Mais comme tous les jours de nouvelles invitations arrivaient, ces premières conférences ne furent bientôt plus qu’un cadre dans les places disponibles duquel, lentement, se logeaient des séances de moindre importance tombant sur les après-midi et même sur les matinées. Au prix d’un combat, recommençant à chaque courrier, la grande majorité des demandes était finalement écartée. Mais de celles qui ne peuvent se refuser, un noyau irréductible se constituait, et les colonnes, où s’inscrivaient les jours, étaient noires de rendez-vous. Quelquefois, dans la hâte des occupations se pressant les unes les autres, deux séances se trouvaient fixées à la même heure. Alors il fallait se livrer à des prodiges de combinaisons pour contenter tout le monde.
Mais tout travail est rendu facile par la satisfaction qu’on en retire. Si parler est une des plus terribles épreuves de la vie, lorsqu’il s’agit de s’adresser à des indifférents ou de combattre des auditeurs hostiles, c’est, au contraire, une joie sans pareille, si vous avez affaire à des auditoires sympathiques et vibrants. De ces auditoires, l’Amérique nous en a offert une telle multitude et avec une telle régularité, que chaque occasion de prendre la parole était une joie nouvelle.
Voici d’abord les réunions de clubs, presque des soirées de famille. Tout club organise des séances familiales où les membres peuvent amener leurs femmes et leurs enfants adultes. Ces rendez-vous ont un caractère privé. La sociabilité y joue un grand rôle. Avant la conférence, tout le monde cause ensemble. Si le conférencier arrive de bonne heure, il a le temps de faire connaissance, avec ceux qui viennent pour l’écouter. Ensuite, des questions lui sont posées, et la réunion se termine au buffet. Dans de semblables conditions, vous recueillez, en une seule heure, une multitude de renseignements et d’impressions. La parfaite cordialité du public donne d’ailleurs à ces rencontres un charme auquel personne ne saurait être insensible.
Dans une église, un théâtre ou toute autre salle publique, le cadre élargi et différent ne permet plus la même familiarité. Mais, les auditeurs peuvent cependant vous encourager et vous rendre la tâche facile. Rien que l’accueil premier, fût-il silencieux, que vous fait une salle bienveillante, ressemble à une bienvenue et à une invitation de vous trouver chez vous. Combien de choses la figure des auditeurs assemblés ne peut-elle pas dire à l’inconnu qui paraît devant eux ! Je ne me suis pas lassé de regarder les auditoires américains, dans cet instant qui précède la conférence, pendant que le Président de la soirée, introduit l’orateur et que, tout en écoutant le speaker, l’assemblée a les yeux fixés sur l’hôte qui doit parler après lui. Figures souriantes et paternelles de vieillards, figures posées et sérieuses d’hommes et de femmes, attitude attentive de jeunes gens et de jeunes filles. Que de signes silencieux et significatifs se recueillent en une minute ! J’ai trouvé aux auditoires américains un air de bienveillance, de sincérité, de virile droiture. Ils m’ont laissé un souvenir ineffaçable, par la masse compacte de braves gens qu’ils m’ont permis d’entrevoir.
Mais c’est surtout dans les écoles, les universités, devant les auditoires presque exclusivement composés de jeunesse, qu’une véritable révélation m’attendait. J’ai toujours aimé la jeunesse ; j’espère bien, d’année en année, l’aimer mieux, la comprendre et la servir davantage. La jeunesse de ma patrie m’a largement comblé d’affection, de bonne et confiante tendresse. Mais je faisais là-bas une rencontre nouvelle, dans des circonstances difficiles, et je fus heureux de constater que par une sorte de télégraphie sans fil, j’entrai d’emblée en contact avec ces auditoires vibrants et juvéniles.
Je les verrai toujours à Oberlin, Vassar, Mount Holyoke, Boston, Chicago, Philadelphie, New-York, Lafayette, partout enfin, également attentifs et sérieux.
Une chose m’a frappé devant les assemblées de tout âge et les interlocuteurs individuels, c’est que le vrai Américain ignore la blague. Cette corde qui vibre un peu trop souvent chez nous, et dont certains font même un usage exclusif et monotone, leur est inconnue. Non qu’ils ne soient amis du rire ! Bien au contraire. Une sorte de bonne humeur, jeune et saine, les anime. Ils sont prompts à saisir et à souligner d’un sourire discret ou d’une hilarité sonore, tout trait humoristique de la pensée. Mais ils restent sérieux en riant.
Le 27 novembre, un dimanche dont je me souviendrai, car il me mit en contact avec plus de dix mille auditeurs, j’eus entr’autres un coup d’œil merveilleux. Par les soins de l’Union chrétienne de Jeunes Gens, dont l’œuvre admirable rayonne sur le monde entier, un mass-meeting d’hommes avait été convoqué pour l’après-midi à l’Opéra de New-York. En entrant dans la salle, je vis devant moi trois mille hommes. En grande majorité rasés, ils donnaient une impression superbe de santé et de fraîcheur. Leur attitude immobile, attentive d’avance, me les révélait comme une force concentrée, un rempart de volontés décidées. J’eus l’impression de me trouver devant une troupe prête à combattre, dont le courage résolu ne demande qu’à être enflammé par une vibrante harangue. De pareils auditoires transportent et inspirent celui qui doit leur parler ! On se donne à eux volontiers sans restriction. Et dût notre vie semée à larges mains s’y dépenser tout entière, tant mieux ! elle tomberait sur un terrain digne de la meilleure graine. Mais à se mettre en contact avec de si généreuses volontés, on reçoit plus qu’on ne donne, et l’on part chargé de puissance morale, au lieu de se retirer épuisé.
La conférence terminée, une partie du public s’approche de l’orateur. C’est l’heure des poignées de mains et de la fraternité démonstrative. Un soir, dans une de ces grandes universités où des milliers de jeunes filles font leurs études, je vis ainsi passer devant moi la totalité du personnel. Tranquillement assis, je serrais la main à toutes ces enfants studieuses, chère espérance de la mère-patrie. Et je pouvais à loisir observer leurs traits, leurs types divers et tout ce qu’un simple regard vous révèle sur une personne. Bien peu d’entre elles avaient mauvaise mine. Presque toutes, vigoureuses, décidées, souriantes, faisaient plaisir à voir, par cette robustesse qui se joint si bien à la grâce des vingt ans. Et je pensais à leurs parents, à tout ce trésor de tendresse placé sur leurs têtes, à la grande République où elles avaient leurs places d’épouses et de mères. Je faisais avec chacune acte de connaissance individuelle. D’un seul mot elles m’annonçaient, en passant, une foule de choses bonnes et braves qui font aimer l’humanité…
Et voilà comment une tournée, ayant comporté cent cinquante conférences, sermons et discours de tout genre, de nombreuses réceptions et des milliers de kilomètres de chemin de fer, a laissé le souvenir et les effets d’une partie de plaisir.
Le 23 novembre, aux premières heures du matin, j’arrivai à l’asile d’Overbrook, près de Philadelphie, où se trouvent une grande quantité d’aveugles de tous les âges. C’était le lendemain du deuxième jour à Washington, jour très rempli, dont une nuit en sleeping-car avait dissipé les fatigues.
Les murs blancs d’Overbrook resplendissaient au loin dans la campagne où courait une brise caressante et tonique. Bientôt nous nous trouvâmes dans la maison que nous visitâmes en détail. Je songeai que, d’un seul regard jeté dans les ateliers et les cours, j’en voyais plus que les habitants n’en verraient jamais.
Nous aboutîmes à une large salle de réunion, comme il y en a toujours dans les établissements américains. Là se massèrent les pensionnaires des deux sexes, enfants et adultes. Il y avait surtout beaucoup d’enfants.
Mrs Wood, femme dévouée de l’artiste-aveugle du même nom, chanta un superbe solo du « Lobgesang » de Mendelssohn. Son mari exécuta des morceaux d’orgue. L’assemblée aveugle écoutait. Pendant l’instant de silence du début, j’avais été frappé et attristé, par la nuit répandue sur toutes ces faces d’hommes et d’enfants. Les uns portaient des lunettes noires, pour abriter et cacher de pauvres yeux incapables de voir, non de souffrir. Chez d’autres, deux grands creux, vides de regard, semblaient comme des âtres éteints qu’habite le regret du feu. Mais dès que jaillirent les sons de la musique, toute cette nuit fut traversée par de la clarté, et cette clarté révélait du bonheur.
Puis tous se levèrent et entonnèrent un chœur, dirigé par M. Wood, non quelque banal morceau de musique, mais un magnifique ensemble comportant une longue et savante préparation. Tout en écoutant, j’observais ce que j’avais sous les yeux. Les exécutants étaient tout entiers à leur chant. Ils se plongeaient dans l’harmonie comme dans une lumière. A cette heure, ils voyaient.
Quand ils eurent fini de chanter, nous leur parlâmes. C’est une situation très spéciale, si vous êtes habitué à parler du geste et du regard, que de s’adresser à un auditoire pour qui rien n’existe d’un discours que ce qui s’entend. On essaie de mettre tout ce qu’on ressent dans l’unique moyen d’expression auquel on se trouve réduit.
Je dus pourtant ce jour-là et dans cette même séance, apprendre qu’il existe des cas d’isolement bien plus complets que celui de l’aveugle.
Durant les chants déjà, j’avais remarqué, au premier rang, un enfant très jeune, qui restait assis quand les autres se levaient, et ne semblait prendre part à rien, pas plus aux histoires et aux discours, qu’à la musique. Son attitude était celle d’un être écrasé par un malheur surhumain. John Wanamaker que j’avais vu un moment s’asseoir près de cet enfant et le caresser, m’expliqua que le pauvre petit était sourd-muet et aveugle en même temps. Tout ce qui se passait lui était donc étranger. Il me sembla prisonnier d’une sorte de Fatalité. Les drames d’Eschyle ont de ces figurants muets qui sont comme des témoins du malheur gigantesque et aphone. Ce pauvre petit, ployé sous son cumul d’infirmités, me navrait. Pour celui-là tout cri est nul, tout signe visible frappé d’impuissance. Alors, pendant que d’autres amis prenaient la parole, je m’assis près de lui, et tout doucement je lui fis sentir que quelqu’un était là. Il se rapprocha, se serra contre moi ; j’attirai sa tête sur mon cœur, lui passant les mains dans les cheveux, lui caressant les joues. Sa figure sombre commença à se dérider. Sûrement l’enfant prenait de l’intérêt à ma visite personnelle dans sa cellule fermée d’un triple mur, aveugle, muet et sourd. Alors une idée me traversa la tête. Si je lui racontais une histoire ! Je lui pris les mains et lui saisis successivement le pouce et chaque doigt en les levant, les baissant, les pliant, les frottant, les grattant ou soufflant dessus. Puis je les traitai comme des touches de piano et y jouai un morceau. Enfin je me livrai à une série de manipulations qui finirent par faire rire mon pauvre gamin. Et comme, lorsqu’une histoire est finie, les enfants en redemandent une autre, il tendit ses mains pour que je recommence à y tapoter et jouer une autre histoire avec des variantes. Nous eûmes toute une conversation dans ce Volapuck improvisé. Certainement nous nous quittâmes amis.
Les grands malheurs sont de grands mystères. Je ne conseille à personne de vouloir les expliquer. Toujours, par quelque côté, leur immensité nous échappe. Mais le malheur nous dit : Sois bon ! Mis en présence des déficits de la vie, tels qu’ils nous apparaissent dans les pauvres existences tronquées et mutilées, l’homme qui ne ressent pas un besoin ardent de contribuer à payer la dette énorme du malheur, n’est pas un homme.
Si nous comprenions ce que nous dit l’humanité blessée, nous quitterions tous l’iniquité, et la pitié divine nous nettoierait de nos souillures. Somme toute, la seule vraie conclusion humaine à tirer des plus effroyables calamités est toujours la même. L’humanité l’a entrevue dans ses crépuscules et ses nuits. L’Évangile n’en enseigne point d’autre. Que faire devant les montagnes sombres de la souffrance ? Il faut aimer.
Je sortis d’Overbrook, ayant au cœur deux images, celle du garçonnet aveugle, muet et sourd, et celle du grand messager de l’insondable Pitié, disant : « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés ! » A quel enfant couronné de boucles blondes et de bonheur matinal eût-il dit avec plus de douceur qu’à ce pauvre petit écrasé : « Laissez venir à moi les petits ! »
Deux heures plus tard, par une de ces coïncidences qui frappent l’esprit, comme le briquet le silex, je me trouvai dans Archstreet, à Philadelphie, devant plus d’un millier d’enfants que m’avaient amenés les « Amis ». En songeant d’avance à cette réunion, j’avais préparé une allocution. Mais, à cette heure, il m’eût été impossible de la faire. Je la laissai au fond de mes poches. Et très simplement, la méthode pratiquée par les « Amis » s’imposa à moi : Parler selon que le cœur est ému, proclamer tout haut ce que l’Esprit nous dit tout bas.
N’avais-je pas devant moi les plus précieux trésors de la ville ? La nef, les tribunes, tous les coins et recoins de la vaste et silencieuse maison étaient littéralement bondés d’enfants, solides et riants garçons, gracieuses fillettes. Quel capital de vie et d’espérance ! quelles semailles d’énergie ! Je venais de la nuit, et j’étais dans le jour. Oh ! tous ces yeux grands ouverts, yeux d’enfants que n’égale en beauté ni le sourire des fleurs ni la clarté des étoiles ! Comme cette richesse lumineuse me rappelait la noire misère de tout à l’heure ! Sans phrases, je leur dis ce qui m’accablait, pensant que cette sévère leçon de choses leur serait bonne.
« Vous voyez un homme qui sort de rendre visite à une multitude d’enfants aveugles. Ils ne l’ont pas vu. Ils ne se sont jamais vus les uns les autres. Ni les roses de leur jardin, ni l’or rutilant des forêts automnales, ni l’azur du ciel, ni le sourire de leur mère n’existent pour eux. Si chaque jour, une heure durant, un œil leur était prêté, ils s’en serviraient avec tant de soin qu’ils feraient provision d’images pour la série des heures noires.
Vous avez tous ici deux yeux, tout le long des jours. Qu’en faites-vous ? Connaissez-vous seulement la manière de vous en servir ? Savez-vous regarder ? Le monde, sous vos yeux, est un livre ouvert : y lisez-vous ? Que vous dit la fourmi cheminant au soleil parmi les grains de sable étincelants ? Que vous dit le rayon d’argent de la lune, qui tombe sur votre oreiller, le soir, avant que vous ne fermiez les yeux ?
Connaissez-vous les histoires écrites sur la figure des gens ? Vos yeux ont-ils appris à sourire ? Consolent-ils ceux qui pleurent ?
Fixent-ils les gens en face, vos yeux ? Y voit-on votre pensée, comme on voit transparaître les cailloux d’or à travers les sources de cristal ? Ou bien les détournez-vous, honteux de la pensée qu’ils pourraient révéler ?
Avez-vous des yeux de fuyards, craintifs du danger ? Ou savent-ils regarder, fermes et lucides, le péril menaçant ? »
Et c’est ainsi que, par un effet direct de la solidarité humaine, des enfants aveugles avaient fourni de quoi faire réfléchir les clairvoyants.
L’Amérique construit immensément. Mais, parmi tout ce qu’elle construit, je préfère les maisons de bois de ses districts suburbains, avec leur gracieuse physionomie et leur variété infinie. Elles s’appellent couramment homes. Le nombre en est incalculable. Il s’en trouve à la portée de toutes les bourses. Malgré les difficultés invincibles qu’oppose à la demeure individuelle l’accroissement des cités monstres, la lutte pour ce home individuel y est acharnée. Partout, même dans les centres les plus populeux, aussitôt que l’on gagne la périphérie, les toits s’abaissent, les grosses maisons sont remplacées par des habitations, calculées pour une ou deux familles seulement. On voit des rues, interminables, où se suivent, pignon à pignon, des constructions presque identiques, habitées par un seul locataire. Pas de concierge. L’Amérique, même dans les bâtiments très considérables, ne connaît pas le concierge. On est renseigné par des inscriptions et par le nègre qui conduit l’ascenseur. Après la région des rues, où les maisons se pressent les unes contre les autres, comme des cellules dans la ruche, viennent les quartiers spacieux des homes isolés, presque toujours entourés de gazons plantés d’arbres. On y monte par six ou sept marches. Tous ont leur sous-sol clair, pour la cuisine, le calorifère, la cave. Autour du rez-de-chaussée court une galerie couverte, garnie de lierre, de roses, de clématites et autres plantes grimpantes. On appelle cela le « porch ». Pendant toute la belle saison, c’est le lieu de prédilection. Il n’y a pas de formes coquettes et confortables que ce « porch » n’affecte, ainsi d’ailleurs que tout l’extérieur de la maison. Très peu se ressemblent entre elles, tout en ayant un cachet général qui les caractérise toutes. A première vue, la maison américaine se distingue de la nôtre par moins de symétrie et plus de variété. Aucune monotonie dans les fenêtres. Celles-ci diffèrent à la fois de structure et de taille. Elles sont à petits carreaux et à guillotine. Toute l’Amérique ouvre ses fenêtres, de bas en haut, comme des guichets.
Si l’on pénètre dans les intérieurs, on trouve, au rez-de-chaussée, toutes les pièces ouvertes sur un hall d’où monte l’escalier. Les portes ne servent pas et souvent n’existent pas. Il y a un ou deux salons, la plupart du temps très simples, une bibliothèque, une salle à manger. Dans les chambres, outre les rocking chairs et autres sièges commodes, des banquettes fixes sont placées autour des baies.
On se sent attiré vers ces jolis coins clairs. Aux murs, de nombreuses gravures dont beaucoup représentent des monuments européens, des tableaux de grands maîtres. Si nous montons à l’étage supérieur, nous y trouvons les chambres à coucher et les cabinets de bains. Les chambres à coucher se distinguent par l’absence de tapis et tentures. La règle est de n’avoir que des nattes et des carpettes. Pas de rideaux aux lits. Les fenêtres sont garnies, soit de très légers rideaux de mousseline, soit simplement de stores en étoffe ou en bois. Souvent il y a une très fine toile métallique qui permet d’ouvrir la fenêtre sans risquer de faire entrer les moustiques. Car de mouches, moustiques, insectes volants et bourdonnants, l’Amérique est riche. Par les soirs des beaux jours, les coléoptères y volent en abondance, et les cigales y font un ramage tout méridional.
Une chambre à coucher américaine est surtout combinée afin d’éviter la poussière et l’air confiné. Une fois que vous connaissez la manœuvre des fenêtres-guillotine et des accessoires qui les complètent, vous pouvez doser l’aération à volonté. Peu ou point de bibelots. Partout des surfaces lisses sur lesquelles le torchon passe avec facilité. Les appareils de chauffage sont perfectionnés ; mais en général, à travers tout le pays, maisons, écoles, gares, trains, on chauffe trop.
Le lit est exquis. Il me semble n’avoir couché en Amérique que dans un seul lit, tant ils sont égaux pour la structure et le confort. Ce sont des lits de fer, souvent d’une forme très élégante. Le sommier a disparu. Il est avantageusement remplacé par une toile métallique très tendue et faisant ressort, comme nos écoles et nos hôpitaux neufs commencent à en avoir. Les matelas sont de première qualité. L’Amérique ne sait pas seulement travailler, elle sait se coucher et cultive la science de dormir. Regardez les affiches, ouvrez les revues dans la partie « Annonces » qui en occupe la bonne moitié. Vous y verrez toutes sortes de matelas, construits avec un art consommé. Matelas en deux, trois pièces. Matelas en cinq ou six tranches superposées et finissant par offrir ce dosage parfait de la souplesse et de la résistance qui fait qu’on est bien couché. Or, pour les travailleurs, un bon sommeil est si important qu’on ne donnera jamais assez de soin à la place où ils reposent leur tête, lasse de penser, et leurs membres, las de remuer.
Dans toutes les maisons, il y a un cabinet de bains. Un très grand nombre en possèdent plusieurs. Le bathroom, résumé de tous les conforts de la toilette, est une institution nationale. Presque toujours il est contigu à la chambre à coucher. Il y a de l’eau chaude et froide à toute heure. Et pour qui sait l’influence des soins de la peau sur la santé, le système nerveux, la circulation du sang, tout l’ensemble des fonctions organiques, le luxe de la chambre de bains devrait compter parmi les nécessités ordinaires de l’existence. C’est à la fois si parfaitement hygiénique et si agréable qu’on ne saurait assez le louer ni le recommander. Le bathroom est certainement une des sources de la mine florissante d’une foule d’Américains. Tout ce qui concerne la propreté du corps, les soins de la peau est là-bas l’objet d’une préoccupation universelle. Nulle part on ne recommande et n’use plus d’espèces de savons, de poudres, de crèmes.
Rien de plus amusant que de lire à ce sujet les annonces des journaux, ou d’assister à une toilette chez un coiffeur connaissant son métier. Une fois le client rasé, l’artiste capillaire se livre sur sa figure à des manipulations si savantes et si consciencieuses qu’on dirait assister à un embaumement. Comment avoir « red cheeks », des joues rouges ? c’est là une question à laquelle répondent des quantités d’ingénieuses recettes. Sur toute la surface de la République, il est impossible de regarder par la vitrine d’un train, sans voir le portrait, grandeur naturelle, de l’inventeur d’un certain Talcum powder. A la somme fabuleuse de dollars, qu’une semblable réclame suppose, on peut calculer l’étendue de la vente. De tels renseignements feront sourire peut-être certaines de mes compatriotes qui boivent du vinaigre afin de se faire pâlir.
On ne saurait prendre trop de soins de sa vigueur et de sa santé. Nous avons assez de figures pâles et de mines exsangues. Esthétique à part, je ne pense pas faire un mauvais vœu pour la jeunesse de mon pays, en lui souhaitant un teint frais et des joues roses.
Rien ne m’intéresse comme les travaux et la vie du foyer. Aussi ai-je partout demandé à visiter les cuisines. La cuisine est une institution sociale de premier ordre. L’avenir des peuples y mijote, et quand nos femmes ne s’intéresseront plus à la cuisine, ce sera la fin du monde. On m’avait dit : (que ne dit-on pas ?) « Les Américaines sont frivoles, leurs maris les traitent comme des poupées idolâtrées ; les hommes peinent tout le jour, afin d’offrir aux femmes de belles toilettes et une vie oisive ». Un Monsieur grave, le monocle sur l’œil, m’avait déclaré au surplus qu’il n’y avait pas de vie de famille en Amérique, que tout le monde y logeait dans les boardinghouses ; il avait lu tout cela dans un livre. Pour me rendre compte par moi-même de la vérité, il me fallait pénétrer en ami dans les maisons particulières. J’eus cette bonne fortune pendant presque tout mon séjour. Ma conviction ancienne et ardente en faveur de la vie de famille, me faisait d’ailleurs un devoir de m’intéresser aux foyers qui m’accordaient leur bonne hospitalité. Nous parlions donc de tout et aussi de cuisine. Et c’est avec plaisir que ces dames me montraient et m’expliquaient cette officine si importante de la maison et la part qu’elles y prennent. Un jour, avec le Dr Mac Cook, grand savant, qui a écrit des livres admirables sur les araignées et les fourmis, je fis irruption dans la cuisine, au moment où tout le personnel féminin de la maison était occupé à faire des pickles et des tartes. Je fus admis à goûter à tous ces produits, et recueillis de précieuses recettes. Pendant ce temps, le Docteur, malicieusement, me photographiait au milieu des casseroles, l’oreille tendue vers le dogme culinaire.
Au fait, l’immense majorité des femmes américaines s’occupent de leur intérieur avec soin et amour. Les domestiques sont de plus en plus difficiles à avoir. Il s’agit donc d’être au courant soi-même et de savoir mettre la main à la pâte. Ces dames le font de la meilleure grâce du monde. J’ai toujours rencontré un large écho lorsque, dans les discours publics, il m’arrivait de traiter ces sujets, minimes seulement aux yeux ces gens superficiels.
La femme américaine a une autre éducation que la nôtre, une éducation comportant, dès le début de la vie, une plus grande part de liberté. Beaucoup plus de carrières lui sont ouvertes. Sans doute, l’électorat politique ne lui est pas encore accessible, mais elle est si largement mêlée à la vie, et remplit des fonctions si nombreuses, que depuis longtemps elle a pris l’habitude de s’appartenir et d’être quelqu’un. Le nombre des femmes qui n’attendent pas du mariage la fixation de leur destinée, y est donc plus considérable que parmi nous. On y trouvera, plus facilement aussi que sur le vieux continent, des femmes d’un féminisme exclusif, se considérant comme les concurrentes et les adversaires de l’homme, non comme ses alliées. Mais ces exceptions confirment la règle. Et la règle est que les femmes, en Amérique, sont gracieusement et passionnément femmes. Peut-être, dans le ménage normal et moyen, les femmes sont-elles épouses avant tout, et mères ensuite, alors que chez nous, aussitôt les enfants venus, la maternité l’emporte, et les parents mettent les enfants au-dessus d’eux-mêmes dans leur affection. Il est de l’intérêt même des enfants de ne pas occuper le premier rang ; c’est compromettre leur éducation et leur avenir que de leur inspirer une trop haute idée d’eux-mêmes. N’est-il pas logique et salutaire, que les parents fassent marcher en première ligne leur affection mutuelle, et que leur attachement pour les enfants marche en second ? C’est l’ordre naturel : on ne l’intervertit jamais impunément.
L’esprit d’une maison apparaît le mieux dans la façon dont s’y exerce l’hospitalité. Être bon pour les siens, est excellent ; mais la véritable bonté dépasse toujours les mesures de notre vie personnelle et les limites de notre parenté directe. Elle est chaude et rayonnante. J’éprouve une grande douceur à exprimer ici tout ce que j’ai ressenti d’intime bonheur et de satisfaction de cœur dans ces homes américains où je venais pour la première fois.
L’hospitalité s’était d’avance manifestée par la forme amicale des invitations. Et j’avais pris comme règle, dans chaque ville, d’accepter la première qui m’était faite. Ce système me facilita bien des choses et me permit, sans que j’eusse à choisir autrement, d’habiter les intérieurs les plus variés comme idées, situation sociale, occupations.
La cordialité fut partout la même.
Tout d’abord, à la descente même du train, il s’est toujours rencontré un hôte empressé à nous découvrir dans la foule et à nous conduire à son home. Là, nous trouvions tout le monde sur le pont, les petites filles parées, avec des nœuds dans les cheveux, les membres de la famille, les mains tendues. Jamais de glace à rompre. Et lorsque, à table, mon regard faisait le tour des figures jeunes et vieilles, la même question invariablement surgissait dans mon esprit : « Où donc ai-je déjà vu ces visages ? » Ils me semblaient connus, familiers ; je croyais les revoir et non les rencontrer pour la première fois. Et je me rappelais les bonnes lettres reçues en France, quelques mois auparavant, où des inconnus me disaient : « Vous ne venez pas chez des étrangers, mais chez des frères. » De Washington à Chicago, de Boston à Indianapolis, plus cela changeait, plus c’était la même chose. Et cependant, l’hospitalité dans les conditions données n’était pas une sinécure. Elle comportait maison ouverte à de nombreux visiteurs et journalistes ; une correspondance chargée, et des séances ininterrompues au téléphone[9]. Tous ces inconvénients, petits et grands, étaient acceptés avec une complaisance empressée. Bien plus, chacun s’ingéniait à réunir chez lui les amis avec lesquels je pouvais avoir plaisir à me rencontrer.
[9] En écrivant ceci, je pense surtout aux maisons où j’ai passé des semaines entières, comme chez Miss Louise Sullivan à New-York ; C. F. Dole à Boston ; Jenkin Loyd Jones à Chicago.
Cette hospitalité si complète me faisait penser à tout ce que nous avons appris de plus charmant sur l’Orient ancien et les tentes d’Abraham. Je n’ai jamais éprouvé la fraternité humaine sous une forme plus gracieuse. Estimant l’affection et la sympathie au-delà de tout ce qu’un homme peut recevoir de ses semblables ou leur donner, je me sentais comblé de ce que j’appréciais le plus au monde, circulant à travers ce grand pays comme une goutte de sang à travers un cœur.
Combien de jeunes gens et de jeunes filles, ayant lu mon livre, sont venus à moi comme à un frère aîné.
Et nous parlions ensemble de ce qui ne meurt pas, de ce qui nourrit l’âme et fortifie l’espérance.
J’ai bien souvent lutté pour les idées que je défends, et le droit de donner une forme nouvelle à l’antique vérité ; mais que sont les peines à nous causées par les esprits sectaires, devant cette richesse des récompenses du cœur ? Ma patrie m’y avait habitué de longue date, par une grande douceur de rapports avec des concitoyens venus de tous les horizons de la pensée. Maintenant, je retrouvais ces émotions amplifiées, au-delà de l’Océan, parmi ce que l’Amérique compte de plus large, de plus humain, de plus évangélique, dans le sens illimité de ce terme superbe.
Toutes ces joies demeurent aujourd’hui une richesse dans mon souvenir. J’éprouve une intime satisfaction à fixer par quelques traits des heures inoubliables. Et les amis de là-bas retrouveront peut-être dans ces lignes un témoignage du cœur, que les limites des forces humaines m’empêchent de leur envoyer par correspondance individuelle.
Je le définirai d’un seul mot : il est jeune. Non que l’Amérique échappe à tous nos atavismes, à certaines tares séniles, destructives de la joie et de l’énergie. Mais elle a pris un bain de jouvence, dans les conditions mêmes de son histoire, de son développement inouï, qui est un appel perpétuel à l’énergie et à la spontanéité.
La jeunesse vraie a des sentiments vifs et les manifeste avec sincérité. On s’en aperçoit bien vite, en fréquentant de près les citoyens des États-Unis. Si vous leur inspirez de la sympathie, ils ne mettent pas longtemps à le témoigner. Si vous les choquez, ils vous le disent franchement.
Cette rondeur est non seulement une garantie sociale, mais une source de sécurité et de bonne humeur dans les relations. Comme je la préfère aux habitudes plus distinguées, en apparence, et plus fines, mais d’où la sincérité et la bonté sont souvent absentes !
La blague, le sarcasme, tout un ensemble de mouvements d’âme qui représentent ce que l’homme a d’amer, de négatif, de caustique, sont plutôt rares. L’humour les refoule à l’arrière-plan et les remplace avec avantage. La raillerie, aux dépens d’autrui ; l’esprit mordant, qui vit brillamment avec des vols manifestes pratiqués sur le bien et la réputation du voisin, n’y exercent pas, dans la littérature, le journalisme et l’existence quotidienne, un rôle envahissant. S’il arrive aux Américains d’être méchants, ils le sont avec franchise et brutalité.
Comme la jeunesse, ils ont l’espérance hardie, l’initiative prompte, mais ils joignent à ces qualités d’élan, des trésors d’endurance et de patiente sagesse. Leurs enthousiasmes ont des lendemains ; et c’est une de leurs coquetteries de ne pas reculer, quand ils se sont engagés à fond, excepté toutefois s’ils se reconnaissent coupables d’erreur. Avoir gaffé n’est pas selon eux une raison pour gaffer encore, et l’honneur n’exige point que l’on persiste dans les erreurs, une fois démontrées.
Les Américains sont fiers de leur pays. Mais ils ne simulent pas la modestie, ils ne baissent pas la tête, lorsque des compliments leur sont faits. Une de leurs premières demandes aux nouveaux arrivés est : « How do you like America » ? Ils vous posent cette question, comme si vous étiez le premier étranger ayant jamais abordé leurs rivages, et ils écoutent votre réponse avec l’attention et le sérieux d’hommes qui n’auraient encore jamais entendu ce que vous leur dites. Ne sont-ce pas là les signes notoires d’un tempérament juvénile, fait d’entrain généreux, de bonne confiance, et que l’éloge ou le blâme touchent au vif également ? C’est un plaisir véritable de pouvoir dire à des hommes possédant cette franchise de cœur tout le bien qu’on pense de leur patrie et de ses institutions. Mais si, ce qui est inévitable, on formule une critique, une réserve, un avertissement, alors apparaît précisément le trait le plus remarquable de cette mentalité.
Vos paroles sont recueillies avec une conscience, une sincérité, qui constituent pour nous autant de leçons. Ce que j’appellerai : « la meilleure Amérique » est certainement animée du plus vif désir de reconnaître les défauts et les tares nationales, afin de s’efforcer de les corriger. J’ai rarement vu une aussi franche fierté unie à une aussi vraie humilité. Pour moi, l’homme modeste n’est pas celui qui vous repousse de la main et se voile la face quand on fait son éloge mérité ; mais celui qui accepte l’éloge, et sait recevoir le blâme.
Dans cette esquisse du tempérament américain, n’oublions pas la pitié, cette pitié des forts qui présente avec la rudesse vaillante un si beau contraste. Je n’ai pu voir que rapidement les œuvres réparatrices, les asiles de la souffrance et de la vieillesse. Mais le passant lui-même y est saisi par l’esprit de puissante et intelligente tendresse qui souffle à travers ces demeures de la maladie et de la langueur. Les mains de ce peuple ne sont pas seulement créatrices de prodiges du génie industriel, elles sont douces aux blessés et aux vaincus de la vie.
La Pitié s’étend même aux bêtes. Pendant tout mon voyage, je n’ai pas vu maltraiter un cheval.
Un autre signe de jeunesse chez les Américains, c’est qu’ils s’amusent de peu. La jeunesse véritable n’a pas besoin de beaucoup d’objets coûteux, ni de préparatifs compliqués pour être gaie. L’appétit est le meilleur cuisinier, et une certaine capacité personnelle d’être heureux, est la meilleure condition de bonheur. J’ai recueilli une foule de preuves de cette vérité aux États-Unis. Les amateurs de distractions recherchées peuvent trouver qu’on ne s’y amuse pas. Pour eux, un pays est triste, quand ils n’y rencontrent pas le répertoire de leurs gaîtés ordinaires. Mais les contrées les plus enviables sont celles qui s’amusent sans ces adjuvants factices d’une joie trop souvent frelatée. L’Amérique prend son plaisir aux jeux en plein air et aux mille fruits inattendus et quotidiens d’une bonne humeur que le travail entretient et renouvelle sans cesse. On y aime beaucoup, à tous les âges, ce qu’on nomme « fun », c’est-à-dire l’innombrable série de farces, imaginées au jour le jour par l’esprit inventif des gens bienveillants, travailleurs et joyeux d’humeur. On s’y joue constamment des niches qui, pendant un jour ou deux, font événement dans une famille ou même une ville.
L’Amérique a son jour pour le « fun », où la belle et joyeuse humeur, mère des farces toniques et des réconfortantes espiègleries, reçoit les hommages de tout un peuple reconnaissant. Je me trouvais à Minneapolis, lors du Hallowing.
Après ma conférence du soir, faite dans une grande Église, les pasteurs me dirent : « Il y a ici, dans un local situé à l’étage supérieur, une réunion de jeunesse. Cela vous intéresse-t-il ? Nous devons vous prévenir que c’est une réunion extrêmement gaie. » Ami de la jeunesse et de la gaieté, je ne me fis pas inviter deux fois. Une journée sévère et laborieuse m’avait disposé à un bon emploi de cette fin de soirée.
Nous émergeâmes dans la lumière d’une fête qui battait son plein. Donc, tandis qu’en bas nous tenions notre conférence, dans les combles de cette même Église, la jeunesse se livrait à ses ébats, et il n’était venu à l’esprit de personne qu’il y eût là une contradiction. Tout le monde était déguisé. Sur une scène, sommairement installée, on jouait des pièces et on chantait, le public prenant une part active à la représentation, en scandant les refrains. Tout cela était fort jovial et parfaitement convenable. Les producteurs monotones de pièces grivoises et de chansons à double entente, n’ont aucune idée de la richesse illimitée du répertoire de la gaieté humaine. La source de la joie vraie est pure comme le ciel et inépuisable comme la mer.
Quel bon moment nous passâmes dans ce grenier d’église !
Je me vois encore hissé sur une table, sorte de tribune improvisée, d’où se contemplait à l’aise le remous joyeux de la salle. Jeunes gens et jeunes filles, enfants de dix à douze ans, tout ce monde avait l’air d’être les membres d’une seule et même famille. A les regarder ainsi, on se rendait compte que leur joie à tous était réelle. A la même heure, sur tout le vaste territoire de la République, la même fête se célébrait avec mille variantes.
Nous vîmes, en rentrant, devant presque toutes les portes, des potirons illuminés, taillés en figures d’hommes, les unes plus amusantes que les autres.
Les Américains ont encore le « Thanksgiving », fête religieuse, nationale et en même temps familiale. L’esprit du jour comporte un retour sur soi-même à propos des événements de l’année écoulée. C’est un appel au self control et à la reconnaissance. Les temples regorgent d’un public recueilli. L’âme nationale se retrempe et se purifie à sa source, dans la prière et la communion fraternelle. Ceci est le côté sévère de la médaille, en voici maintenant le côté joyeux :
A chaque foyer, les amis se rassemblent, et les repas sont empreints d’un particulier abandon. Pour leur donner un cachet plus simple et plus antique, les chefs de famille font à table une partie du service, ordinairement confié aux domestiques. Ils se tiennent debout, en découpant le Turkey monstre et le cochon de lait traditionnels. L’usage veut que l’on chante pendant le repas. Et parfois, afin de maintenir le chant dans une allure régulière, ceux qui découpent se mettent à battre la mesure avec leur couteau.
Qu’on nous permette une anecdote relative à « La Vie Simple » et à « Thanksgiving ». Ce jour étant un jour de liesse et de festins, les consommations ont une tendance à augmenter de prix. En particulier, le Turkey monte quelquefois au-dessus du prix raisonnable. Un journal humoristique se servit de ce fait, pour mettre un disciple de « La Vie Simple » aux prises avec les marchands. Les caricatures nous le montrent allant d’une boutique à l’autre. Après chaque marchandage infructueux de cochons de lait, dindes ou autres pièces, il déclare : « Après tout, on peut s’en passer. » Et, finalement, il célèbre Thanksgiving avec un sandwich.
L’Amérique aime la France. Un Français qui voyage aux États-Unis recueille aisément les preuves de cette sympathie. J’en ai rencontré moi-même de nombreux témoignages.
Et d’abord, Lafayette n’est pas oublié. On se souvient avec émotion de cette fraternité d’armes, vieille maintenant de plus d’un siècle, et de ces Français qui s’embarquèrent d’enthousiasme, pour aider l’Amérique à conquérir sa liberté.
J’en avais fait l’expérience dès Paris, en une circonstance typique. Me promenant un jour dans le quartier de Reuilly, je croisai un groupe d’Américains qui me posèrent à brûle-pourpoint cette question : Où est le cœur de Lafayette ? Je me gardai bien de leur dire que je ne le savais pas. Ces hommes, venus de l’autre côté de l’océan, me donnaient une leçon d’histoire. Je leur répondis donc : « Permettez, je vous dirai cela de suite », et j’entrai dans un des couvents de la rue de Reuilly. Là, après force questions au personnel, pas plus au courant que moi-même, quelqu’un survint et dit : « Le tombeau de Lafayette est au cimetière des Pères de Picpus, rue de Picpus, no 33 ; son cœur n’a pas été déposé dans une urne à part ; il est resté dans sa poitrine, de sorte qu’il repose avec son corps. » Je communiquai le renseignement aux touristes qui m’attendaient patiemment dans la rue. Ils s’en allèrent fort heureux, et moi tout pensif. Combien de Français connaissent cette tombe ? De la part d’Américains, gens qui nous sont dépeints d’ordinaire comme éminemment pratiques et utilitaires, un tel pèlerinage me semblait une démarche bien touchante. J’ai pu me convaincre que le groupe d’hommes, jadis rencontré rue de Reuilly, n’était pas une sorte d’exception honorable à une règle générale, mais bien un groupe représentatif de l’état d’esprit moyen en Amérique. Non seulement ils n’ont pas oublié Lafayette, mais ils ne manquent pas une occasion d’accentuer toute la bonne volonté qu’ils ressentent à l’endroit de la République sœur.
Que de fois les tribunes où j’avais à parler furent-elles ornées des couleurs françaises et américaines ! A table, par une charmante délicatesse de sentiment, de petits drapeaux français, de taille lilliputienne, décoraient souvent le corsage des dames ou la boutonnière des hommes.
Malgré cette vive sympathie, nous sommes trop peu connus de l’autre côté de l’Atlantique. Certes, beaucoup d’Américains voyagent chaque année sur le continent européen, et séjournent volontiers à Paris ou sur la Côte d’azur ; mais d’autres, infiniment plus nombreux, ne quittent jamais leur pays. Sur ce territoire colossal des États-Unis, demeure une population de quatre-vingts millions d’hommes, dont l’immense majorité n’a jamais vu l’Europe et ne parle qu’une langue : l’anglais. Il se trouve ainsi que l’Amérique nous connaît peu et fort mal. Quoique bien vus, et l’objet d’une bienveillance préalable et traditionnelle, nous n’y jouissons pas d’une réputation flatteuse. Notre politique, de loin, apparaît souvent capricieuse, changeante, sectaire. Les difficultés héréditaires, au milieu desquelles nous cherchons la voie de l’avenir, ne sont pas assez comprises.
Et notre moralité se trouve être l’objet d’étranges préventions. Par notre littérature d’exportation, nous sommes considérés comme un peuple privé de sens moral et de vie familiale. Toute la France est vue à travers une spécialité de romans scabreux et certains établissements boulevardiers où les étrangers vont plus souvent que nos concitoyens.
Si, malgré cette connaissance sommaire et défavorable, nos amis des États-Unis ont pour nous des trésors de bonne volonté, que serait-ce s’ils nous connaissaient mieux ? Car enfin nous sommes de ceux qui gagnent à être connus — ceci dit sans la moindre ironie.
En attendant, bien des Américains, d’Américaines surtout, s’ingénient à apprendre le français avec des résultats inégaux.
Par exemple, un jour qu’un professeur m’avait engagé à parler français à sa classe supérieure de jeunes filles, je m’aperçus bientôt que l’expression des figures ne cadrait pas avec le sens de mes paroles. Alors je leur dis à brûle-pourpoint : « Certainement vous ne me comprenez pas ! » C’était vrai. Je dus continuer mon allocution en anglais.
Je fus plus heureux ailleurs. Des auditoires entiers de jeunes filles écoutèrent et comprirent une conférence française, ou manifestèrent un plaisir extrême à entendre conter des histoires en notre langue. A Vassar College, par exemple, je racontai, pendant toute une soirée, des histoires à une multitude de charmantes jeunes personnes groupées autour de moi. Je les entends encore dire : one more ! La plupart de ces jeunes filles, non seulement s’exprimaient bien en français, mais avaient de fort jolies connaissances en littérature. Elles étaient élèves de M. Charlemagne Bracq, notre distingué compatriote, un des hommes qui travaillent le plus à répandre notre langue aux États-Unis, et ne cesse d’y fonder des bibliothèques où il essaie de grouper nos meilleurs auteurs. Grâce à l’influence de « l’Alliance française », il y a, dans beaucoup de villes, des cercles où se cultive le français. Dans plusieurs d’entre eux, nous avons rencontré un certain nombre de personnes, de dames surtout, assidûment occupées à étudier notre langue.
Des professeurs de français, en assez grand nombre, offrent des leçons particulières, sur toute la surface du territoire. Mais la plupart d’entre eux sont anglais, américains, allemands, russes. Nous eûmes le plaisir cependant de rencontrer des concitoyens à qui l’enseignement du français aux États-Unis avait fourni une jolie carrière. Parmi les livres français préférés par la jeunesse américaine, se trouvent les romans d’Erckmann-Chatrian.
Les personnes qui s’intéressent là-bas au mouvement des idées en France, connaissent presque toutes le nom de Sabatier ; mais il n’y a pour elles qu’un Sabatier. En réalité, nous en possédons trois : Armand Sabatier, le professeur de biologie de Montpellier ; Paul Sabatier, l’auteur de la Vie de Saint François d’Assise, et Auguste Sabatier, l’auteur de : Philosophie de la Religion et de Religions d’autorité et la Religion de l’Esprit. Ces trois hommes et leurs noms donnent lieu aux plus amusants quiproquos. Dans une revue, un article paraît sur Auguste Sabatier. Un portrait accompagne l’article ; mais c’est le portrait de Paul Sabatier. Ailleurs, on se livre à un transport d’admiration, en disant : quelle richesse de vues dans ce Sabatier, qui est à la fois un maître en sciences naturelles, en philosophie religieuse et, par dessus le marché, un historien !
Après tout, à une certaine distance, la confusion des noms est bien pardonnable. Nous en savons quelque chose en France, lorsque nous nous mêlons de parler des hommes marquants parmi les autres nations. Réjouissons-nous donc surtout que notre triple Sabatier jouisse d’un si bon renom aux États-Unis.
A Albany, deux dames fort distinguées, membres de l’enseignement, et dont j’étais l’hôte, me dirent avec un sourire malicieux : « Nous allons vous présenter un de vos compatriotes qui nous enseigne à prononcer le français ». Là-dessus, elles cherchèrent une boîte et dirent : « Notre petit Français est caché-là ». C’était tout simplement un phonographe où se trouvaient enregistrées des conversations courantes. Quand ces dames veulent se faire l’oreille à la prononciation correcte du français, elles remontent leur petit frenchman, qui se met aussitôt à parler avec une grande volubilité. J’ai vu, depuis, dans les annonces de revues, que les dames d’Albany n’étaient en aucune façon une exception, et ne faisaient que pratiquer la méthode très répandue du phonographe professeur.
Deux hommes se cherchent sans se trouver.
Ces deux hommes sont le général Charles Miller et moi.
Le général Miller est Alsacien. Il est même d’Oberhoffen, près de Bischwiller, pays de houblonnières, plaine immense avec, à l’horizon, les Vosges d’une part, et de l’autre la ligne argentée du Rhin, au pied du rempart sombre de la Forêt-Noire. Ce général est donc mon compatriote. Ayant lu mon livre, il avait essayé de me trouver à Paris, à plusieurs reprises. Nous nous étions toujours manqués. Plusieurs lettres avaient été échangées, aussitôt mon voyage en Amérique décidé. Et le général Miller s’offrait pour me faire voir une partie de son pays. Chose entendue. Nous allions donc enfin nous rencontrer.
Le général habite Franklin, où il a de grandes affaires industrielles, et s’occupe avec zèle de l’éducation de la jeunesse, des écoles du dimanche, etc.
Mais il y a plusieurs Franklin en Amérique, et c’est précisément ce que j’ignorais. L’un est en Pensylvanie, c’est le bon ; l’autre dans l’Indiana. Passant par Indianapolis, où je demeurai quarante-huit heures, je demandai à mes hôtes s’ils connaissaient le général Miller, de Franklin. — Parfaitement, il demeure à Franklin, près d’ici ; on y va en tramway. Aussitôt, le général est demandé au téléphone. Nous nous parlons : il accepte à déjeuner pour le lendemain.
A l’heure dite, nous nous trouvons au rendez-vous : il me parle de mon livre, et moi d’Oberhoffen, de Bischwiller, de l’Alsace, du vieux pasteur qui l’a instruit, et dont ma femme est la petite-fille. Pendant ce discours, où l’Alsacien en moi mettait tous les charmes du souvenir, je crus remarquer que le général me regardait d’une façon de plus en plus étrange. Un peu interloqué, je lui posai une question précise : Vous êtes bien, n’est-ce pas, mon général, un Alsacien comme moi, et natif d’Oberhoffen ? — Non, je ne connais ni l’Alsace, ni Oberhoffen ! — Alors vous ne connaissez pas, à plus forte raison, le vieux pasteur Heldt ? — Je n’ai jamais entendu prononcer son nom ! — Mais vous n’êtes donc pas le général Miller ? — Si fait, je suis le général Miller ! — Miller, de Franklin ? — Miller, de Franklin ! — Étrange ! Quelles sont les guerres où vous avez commandé ? Je n’ai jamais commandé nulle part. On m’appelle général. J’ai longtemps été attorney-général.
Il ne nous restait plus qu’à rire du quiproquo et à déjeuner de bon cœur !
Pendant ce temps, le vrai général Miller se demandait anxieusement ce que devenait son oublieux compatriote. Poussé par le labeur de chaque jour, et n’ayant jamais une heure de liberté pour mettre un peu d’ordre dans une correspondance en déroute, j’arrivai jusque fin novembre, sans donner signe de vie au général.
Et j’étais embarqué sur la Savoie, lorsque, au dernier moment, un homme affable et souriant vint se présenter comme le général Miller. C’était bien lui, cette fois. Ayant appris par les journaux le jour de mon départ pour la France, il était venu me dire, en même temps, bonjour et adieu. Voilà ce qui s’appelle avoir bon caractère. Nous rîmes de bon cœur de cette étourderie géographique. Et me voici tenu de la réparer à la première occasion.
« J’irai à Chicago, mais non aux abattoirs », m’étais-je promis à moi-même.
Après une de mes conférences publiques dans cette ville, se présenta devant moi un homme trapu, avec une tête massive, couverte de cheveux blancs. Sa figure respirait la bienveillance. Il parlait anglais et allemand, et me proposa de faire dans sa voiture une promenade à travers Chicago. « Et, si vous le voulez, je vous montrerai mon industrie ». Je m’intéresse à l’industrie, un peu en amateur, mais fort sérieusement, et il m’a toujours paru extrêmement instructif de visiter des usines avec des hommes compétents. J’acceptai donc, et je me voyais déjà le lendemain parmi les métiers d’une filature ou les hauts fourneaux de quelqu’affaire métallurgique.
A l’heure exacte du rendez-vous, mon guide vint me prendre. Il conduisait lui-même et me mena droit aux abattoirs, car il s’appelait Nelson Morris, et se trouvait être un des plus anciens et des plus gros propriétaires de cette entreprise colossale.
Chemin faisant, il me raconta sa vie. Fils d’un pauvre juif allemand, proscrit pour ses idées républicaines en 1848, il avait gagné l’Amérique avec des économies modestes, à grand peine amassées. Il commença par vendre de la viande au panier, quand Chicago n’était qu’une petite ville, et son panier grandit avec la ville, jusqu’à renfermer dans ses larges flancs la viande de 10,000 têtes de bétail par jour. Les avenues de Chicago sont longues : on peut y causer tout à son aise. J’appris donc que Nelson Morris avait au cœur l’intime et gros chagrin d’avoir perdu son fils aîné. Il en pleurait encore. Ce fils avait grandi dans son industrie, et s’en était assimilé tous les détails. En même temps il avait un esprit conciliant et humain qui le faisait aimer de tous ses collaborateurs et ouvriers. Le père ne pouvait plus parler de ses affaires sans que la figure du fils se présentât à son esprit. Son deuil mettait de l’amertume dans tous ses succès passés. C’était une ombre sur sa vie. Nous nous comprenions à demi-mot, et je prenais, chemin faisant, une vive sympathie pour cet inconnu qui me parlait de détresses de l’âme à moi bien connues. Il n’y mêlait, lui, aucune espérance, étant de ceux qui ferment leur horizon du côté de l’invisible et ne pensent pouvoir compter que sur ce qu’il est convenu d’appeler les réalités positives. Il parla de sa maison : « Elle est telle que nous l’avons faite, ma femme et moi, en nous mariant, lorsque nous étions dans une condition modeste. Et nous n’y changeons rien. Tous mes souvenirs sont là ». Cette simplicité avait mon approbation.
Sur ces entrefaites, nous arrivâmes : la vue est d’abord attirée par d’immenses parcs où sans cesse, de toutes les parties de l’Amérique, le bétail arrive. Sur mon observation, que ce bétail me paraissait de mine médiocre, il me dit : « It is Saturday cattle. » En effet, nous étions un samedi et, ce jour-là, paraît-il, on abat ce qui n’a pas trouvé d’acheteur pendant la semaine.
Entre les parcs, des marchands circulent à cheval, pour mieux voir la qualité des troupeaux et faire de bons achats, en connaissance de cause. Puis le bétail monte, par des plans inclinés, jusqu’aux limites fatales où s’accomplit le sacrifice.
J’eus la vision d’un torrent d’êtres emportés vers la mort. Des vastes pâturages de l’ouest, où se passa leur vie paisible, des troupeaux sans nombre, comme autant de ruisselets qui deviennent de larges rivières, s’unissent et roulent vers le même point, pour finir là, en une cataracte rouge, un autre Niagara, intarissable et prêt à porter au loin, par les villes, la force, la santé, la vie.
Toutes ces myriades de brutes muettes meurent pour nous faire vivre.
Et je pensais à tout ce que nous coûtons, à tout ce qui forme l’obscur terreau sur lequel pousse l’humanité. Valons-nous autant de sacrifices ? Menons-nous une vie dont on puisse dire qu’elle rende ce qui s’est dépensé à cause d’elle ? Tout ce que je pus voir et observer d’intéressant, à travers les immenses espaces où nous circulions, disparut devant cette question qui renaissait, troublante et insistante, dans mon for intérieur. Ainsi beaucoup de détails, à coup sûr, m’échappèrent. Et surtout je ne m’aperçus pas des cadeaux que me faisait Nelson Morris, tout le long de cette promenade à travers les conserves, les salaisons et les jambons fumés.
Lorsque je l’eus quitté, je m’aperçus que mes poches étaient bourrées de saucisses.
La rue à cet endroit était pleine de juvéniles camelots, criant leurs journaux. Je me fis parmi eux un grand nombre d’amis à une saucisse la pièce.
Qui est Dean ? Dean est le serviteur toujours attaché à la personne de John Wanamaker. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, sait s’expliquer en plusieurs langues, mais parle peu, afin de mieux observer toutes les occasions de se rendre utile. Il est Anglais d’origine, célibataire, et très bon fils. Sa vieille mère demeure en Europe. Il subvient à ses besoins et va la voir quand il peut. Dean a de bons yeux, point ironiques, ce qui le distingue de beaucoup de serviteurs de grande maison, dont la face rasée laisse voir d’imperceptibles sourires, qui en disent long sur le néant et l’hypocrisie de l’existence mondaine. Dean n’a pas de masque, il fait sa figure personnelle, et il est quelqu’un.
Comme à plusieurs reprises son maître s’est privé de lui, pour me le donner comme gardien, j’ai pu l’apprécier à sa valeur. Du moment où il avait reçu en dépôt ma personne, je lui appartenais. Respectueusement, mais sans faiblesse, il veillait, et ne souffrait point d’infraction à sa consigne.
— « Dean, voici le programme du voyage et les heures des conférences, rendez-vous, invitations. Pensez à tout. » Et je n’avais plus qu’à me laisser vivre. Lorsque j’allai à Washington, Dean fut mon compagnon inséparable, il me conduisit à la Maison Blanche, m’y installa et revint m’y prendre. En chemin de fer, il avait toutes les attentions, surtout celle de me laisser parfaitement tranquille. Il allait s’asseoir dans la pièce des fumeurs, pour cultiver le cigare qu’il adore, et de là veillait sur moi. Si je m’attardais à des causeries après une conférence, Dean surgissait, et je voyais l’heure sur sa figure.
Je dois à la vérité de confesser, que par deux fois j’ai soumis à une rude épreuve la conscience de mon scrupuleux gardien.
La première, c’était à Philadelphie. La journée, très chargée, avait commencé par une conférence à Germantown, devant un auditoire exclusivement féminin. Après la séance, la conversation menaçait de se prolonger. A l’heure précise, fixée pour se rendre à une autre assemblée, Dean vint m’avertir et me conduire à la voiture dont déjà il ouvrait la portière. Mais une de mes interlocutrices me pria aimablement de monter dans la sienne, promettant de suivre exactement celle de Dean. Non sans ennui, l’excellent homme se résigna. Au commencement tout alla bien. Mais, à un certain moment, notre guide s’engagea sur un espace fort étroit, entre le trottoir et une large tranchée que creusaient des ouvriers au milieu de la chaussée. Voyant que la première voiture avançait avec peine, le cocher de la nôtre prit un chemin différent. Ne nous voyant plus, Dean entra dans une agitation extrême, craignant déjà un rendez-vous manqué et se croyant en faute. Il jura ses grands dieux de ne plus permettre jamais le moindre changement de programme.
Un quart d’heure plus tard, nous nous retrouvions, et tout était au mieux.
La seconde irrégularité fut un délit contre le decorum, et le corpus delicti, une paire de gants. Des gants, je m’en suis de tout temps passé, lorsque faire se pouvait. J’en usais jadis, dans les grandes occasions, mais leur contact me produisant une sensation d’asphyxie, je les avais fait disparaître, de mes mains d’abord, de mes poches ensuite. Il y avait plus de quinze ans que je n’en possédais plus. Cependant, pour aller voir le Président des États-Unis, je crus indispensable de m’en racheter une paire.
Mais arrivé à la Maison Blanche, à la minute même où je devais les mettre, impossible de les trouver… je les avais laissés à Philadelphie. Dean ouvrit des yeux démesurés. Je m’efforçai de le rassurer : « Écoutez, lui dis-je, je suis dans la maison, il ne me faut ni chapeau, ni, à la rigueur, de gants. Et d’ailleurs, cela paraîtra plutôt l’effet d’un principe que d’un oubli ».
Je partis, heureux, à la rencontre de mon illustre hôte, pendant que Dean me suivait d’un regard consterné…
Comme on taille au canif un nom dans l’écorce d’un arbre, je grave sur cette page, en signe de réparation, le nom de Dean.
Le train de nuit suivait sa route ardente, entre Chicago et Minneapolis. Déjà, dans chaque sleeping-car, les nègres diligents avaient installé les lits. Les voyageurs étaient couchés. D’aucuns accordaient la basse de leur ronflement au chant des roues sur les rubans vibrants des rails. La tête appuyée sur l’oreiller et tournée vers la vitre, je voyais fuir, en un pâle rayon lunaire, les plaines immenses où l’argent des lacs sans nombre alternait avec la silhouette brune des terres et les lignes sombres des bois. Façon commode de voyager et de considérer les paysages ! Des sites à peine entrevus à travers le blanc voile des vapeurs, la pensée insensiblement glisse vers le souvenir ou le rêve…
Une vision immense passa dans mon esprit. La vue récente des chutes du Niagara en formait le début. Avec un fracas de tonnerre, la cataracte glauque et blanche précipitait à l’abîme les avalanches de ses vagues sans fin et de ses bouillonnantes écumes. C’était comme une course échevelée, vers le gouffre de myriades de flots dont chacun, au bord du précipice, jetait son cri au moment de prendre son élan.
De l’intarissable chute d’eau, renouvelant sans cesse les merveilles de ses larges nappes et de ses pluies fines où voltigent des arcs-en-ciel, peu à peu je passai à la vision d’une cataracte de blés d’or. Ce changement de décor était dû, sans doute, à une influence locale. Ne roulions-nous pas à travers l’immensité des plaines où germent et mûrissent chaque année des moissons de céréales, pareilles, par leur étendue, à des mers où des épis jaunes promènent leurs houles ? N’allions-nous pas à Minneapolis, la ville des moulins, où le jeune Mississipi tourne des milliers de meules ? Un large fleuve, un fleuve de blés d’or, poussait vers elle ses flots intarissables, charriant dans leurs flancs le pain des hommes.
Après ce symbole de richesse nationale, ma fantaisie moitié somnolente, moitié éveillée, en contempla un autre. Par les champs du Texas lointain, une coulée fantastique de coton neigeux descendait, pareille aux nappes immaculées de névés dans les Alpes, portant jusqu’aux extrémités de la terre de quoi filer du fil et tisser des tissus, du beau linge pur et blanc qui fait la joie des yeux.
Mais bientôt le fleuve laiteux du coton fut remplacé par un torrent de sang qui allait éclaboussant ses rives. C’était le récent souvenir de l’horrible cataracte rouge de Chicago. Heureusement elle ne fit que passer.
Et déjà d’une ville couverte d’un nuage de fumée, d’une ville cyclopéenne assise entre des collines de charbon, je vis jaillir une source d’acier. Elle s’échappait de sa prison avec des grondements d’orage. Des étoiles bleues, vertes et or tourbillonnaient au-dessus de sa marche triomphale. De son sein de lave brûlante s’élançaient de longs serpents de feu, dont de noirs cyclopes armés de marteaux assujétissaient au loin les anneaux sur le sol, pour en faire des sentiers de fer. Et le fleuve d’acier se répandait dans les villes, surgissant en charpentes, en armatures, se jetant en travers des cours d’eau et des bras de mer, pour soutenir les tabliers des ponts, se transformant en machines, en outils, en chars, en vaisseaux, infatigable créateur de merveilles.
A ce moment — était-ce l’effet de tout cet acier en fusion ? — je ressentis une soif brûlante qui me tira de ma rêverie.
Dans le filet au-dessus de ma tête il y avait heureusement de quoi calmer cette soif. Une provision de belles pommes aux joues rouges étaient là. A mesure que je les réduisais en cidre frais, le sens de la réalité me revenait.
Mais je me rendais d’autant mieux compte que je venais d’avoir une sorte de vision où la richesse prodigieuse de l’Amérique était figurée par des fleuves non mentionnés sur les cartes.
Ces forteresses ne contiennent ni canons ni explosifs, et cependant c’est en elles que résident la force et la puissance de l’Amérique, les armes de résistance et de combat qui ont affirmé son influence. Elles ont leurs assises dans le cœur et l’esprit des citoyens ; mais, plus que basées sur le roc, elles me paraissent inébranlables.
La première est la foi religieuse, si profondément enracinée dans la mentalité américaine, qu’elle en détermine en quelque sorte la physionomie. Elle la marque d’une empreinte que le souffle matérialiste et irréligieux ne saurait effacer et qui se retrouve encore dans le grand sérieux et l’activité généreuse d’associations qui se tiennent à l’écart de toute croyance religieuse, comme les sociétés de culture éthique. Son influence profonde et calme s’impose jusqu’à cette masse indifférente ou profane, nouvellement débarquée, et dont les racines ne plongent pas dans les traditions du pays. Même les gestes superficiels des êtres de routine et la dévotion intéressée des hypocrites ne sont point capables d’infirmer ce fait. Il est d’une nature si accusée, se vérifie si souvent dans le contact social ou familial, que sa réalité ne saurait être révoquée en doute. L’Amérique est doublement religieuse, et par atavisme et par conviction. Elle porte en elle les forces concentrées et unifiées de la fidélité pieuse aux traditions et de la libre et personnelle communion avec la réserve permanente des vérités. Aussi, quand les grandes occasions de la vie nationale sont consacrées par un culte, ou que les hommes d’État invoquent des sentiments religieux, ce n’est point de la convention, mais l’expression d’une pensée vive ; et quand les citoyens et les enfants de la grande République chantent le chant national, il est une strophe que l’on sent vibrer avec une émotion plus sainte encore que toutes les autres, c’est celle où il est dit : O God our King !
La belle vitalité de sa religion rend l’Amérique juste, tolérante, respectueuse de la foi des autres. Quand la Foi n’est plus qu’un souvenir et une formule, elle devient cassante, exclusive, dure aux convictions d’autrui, méprisante des croyances non officielles. L’anathème est le bâton menaçant, aux mains des vieilles doctrines décrépites.
La deuxième forteresse américaine est la Foi à la Liberté. Oh ! il ne l’ont pas bâtie en un seul jour, cette fière citadelle où flotte au vent le drapeau étoilé de l’indépendance, non seulement acceptée, mais proclamée comme une loi de la vie sociale. Ils ont mis bien du temps et de la peine à la construire. Mais désormais elle est fondée, et personne n’y touchera. Notre vieille Europe nous montre des États dont toute la politique consiste à empêcher le développement normal des hommes et des institutions. La loi y prend la forme d’une prohibition systématique, l’initiative y est taxée d’indiscipline ; l’indépendance d’esprit, de crime de lèse-tradition. L’administration publique y passe le temps à veiller à ce qu’il ne se passe rien de neuf. La peur de la liberté y est non seulement le commencement, mais la somme de la sagesse.
L’Amérique, elle, croit à la Liberté, comme elle croit en Dieu. Mais de même qu’elle croit au Dieu des autres, au droit sacré que possède chacun de l’adorer et de le concevoir à sa façon, elle croit à la liberté des autres. Et sa foi robuste sait supporter les épreuves. Elle n’abandonne pas le culte de la Liberté, parce que des abus odieux ont démontré les inconvénients d’une trop large indépendance. Elle ne musèle pas les honnêtes gens, parce que les criminels et les enragés mordent leur prochain. Elle ne masque pas le soleil, parce qu’il produit des ombres.
En politique, en religion, grand air, liberté, franchise pour tous. Champ illimité à l’initiative individuelle. Dès l’enfance et dès l’école, le caractère est encouragé. Chacun y est provoqué à donner sa mesure totale, à oser être, à s’affirmer dans la plénitude de son originalité. On ne lui demande qu’une chose : respecter le droit du voisin. Mais en ce point, on est d’une sévérité implacable. L’Amérique ne pardonne point les péchés contre la liberté. Si grands et puissants que puissent être ceux qui accaparent à leur profit la part et la liberté de tous, leur sort est fixé d’avance. Un jour ou l’autre, sous les coups répétés tirés de la forteresse de la Liberté, leurs bastions sont réduits en poudre.
La troisième forteresse est la bonne foi. Ne me faites pas dire qu’il n’y a pas de coquins en Amérique. Dans un concours international, elle battrait peut-être le record par un choix de coquineries inédites. Mais il suffit d’échanger un certain nombre de lettres, d’avoir des relations un peu variées, de causer ou collaborer avec la population courante, pour être immédiatement frappé de son respect pour la parole donnée. Ils ont de la conscience, et une conscience si loyale qu’elle se fait jour à travers les plus étranges manœuvres de la corruption. Ce que plusieurs, et parmi les meilleurs éléments, peut-être, dans certains pays considèrent comme une formule de politesse, une promesse en l’air, serait là-bas un manque de sincérité. Ils trouvent plus humain de refuser carrément que de donner, par fausse pitié, des promesses vaines. Pas de compliments, de circonlocutions, de démonstrations superflues ! Les affaires les plus graves se traitent souvent en quelques mots, Cette bonne foi a quelque chose de rassurant et de communicatif. C’est un appel perpétuel à votre propre sérieux. Elle éveille la confiance et en même temps engage la responsabilité.
Certains mots très souvent répétés m’ont toujours paru comme une sorte de monnaie courante de la mentalité d’un peuple. Il est un mot que vous entendez très souvent prononcer aux États-Unis, quand vous racontez une histoire, fournissez un renseignement ou exposez une opinion. Ce mot est : « is that so ? » Il est dit sur un ton de confiance et de bienveillance, et en même temps, il est si sincèrement interrogatif, qu’il est certainement le plus simple et vigoureux appel possible à la loyauté.
La quatrième forteresse est le respect de la femme ; non cette exagération, heureusement exceptionnelle, où tombent certains Américains, qui traitent leur femme comme une poupée de grand prix, mais ce sentiment de déférence et d’égards, qui met au cœur des jeunes gens et des hommes un culte chevaleresque pour la femme, et que je considère comme un des éléments les plus solides dans le bagage moral d’une société.
A l’abri de ce sentiment, femmes et jeunes filles circulent librement, d’un bout du territoire à l’autre. La conscience publique est leur meilleure sauvegarde. Personne ne leur manque de respect. Ainsi leur indépendance et leur personnalité sont mieux à même de se développer. Une part de l’esclavage de la femme provient de cette servitude où la tiennent chez nous les usages reçus. Quelle sujétion pour nos jeunes filles de ne pouvoir sortir seules, quel témoignage de méfiance envers l’élément masculin de la population ou envers elles-mêmes ! Et quelle plaie publique ! Un virus corrupteur en émane, dont les effets néfastes se retrouvent dans l’éducation, dans la littérature, au foyer familial.
Rien ne réconforte comme de voir la puissance que fait rayonner à travers un peuple l’existence de certains principes, traduits en actes journaliers, devenus des habitudes stables. Le meilleur travail que nous puissions faire est de contribuer à créer dans l’esprit public un certain nombre de ces convictions fondamentales auxquelles s’appuie la mentalité de la foule. Que les forteresses tiennent bon, où se conservent l’énergie vitale, la bonne volonté, l’intégrité, la foi !
L’Amérique n’ayant qu’un imperceptible embryon d’armée permanente, on peut bien dire qu’en temps de paix, sa force militaire est invisible. Rien ne l’annonce. On ne voit ni soldats ni officiers nulle part.
Je dois donc me féliciter d’autant plus d’avoir rencontré une occasion d’assister à une réunion exclusivement militaire. Ce fut la quatorzième assemblée annuelle de la médaille de la Légion d’honneur. Le lieu de rendez-vous était Atlantic City. M. John Wanamaker, ayant à porter le toast du Président de la République, au banquet final, me proposa de l’accompagner, ne serait-ce que pour voir, au bord de l’Océan, cette ville composée d’hôtels et de villas, bâtie de toutes pièces en peu d’années.
J’eus l’honneur d’être invité au dîner par le major général O. O. Howard, commandeur pour 1903-1904.
Les armées de terre et de mer étaient représentées. Pas moins de sept généraux et deux cents officiers et soldats prirent place autour de la table.
Ils étaient tous membres de la Légion d’honneur, dont la médaille n’est accordée que sur un vote du Congrès. Pour la recevoir, il est nécessaire d’avoir accompli un acte d’héroïsme personnel. Voici à ce sujet une petite citation empruntée au toast porté par le général L.-G. Estes. « Dans le fracas des charges de cavalerie, dans le tonnerre des duels d’artillerie, dans les assauts furieux de l’infanterie, de merveilleuses victoires s’obtiennent qui semblent dépasser les possibilités des forces humaines. Soutenus par la force morale du nombre, se touchant les coudes avec leurs camarades, nos soldats réalisèrent des actions qui leur valurent l’admiration du monde. Pourtant, les missions des hommes de la Légion d’honneur se sont généralement accomplies dans des conditions tout à fait différentes. Volontairement, ils marchèrent à leur but, souvent seuls, toujours en face du danger imminent et de la mort. Autre chose est de faire son devoir, par l’effet d’un ordre auquel on ne saurait échapper, ou de courir volontairement des risques supplémentaires, dans un esprit de sacrifice patriotique… » L’attitude et les conversations des convives avaient quelque chose d’imposant par sa simplicité même. Pas d’uniformes. Toutes les conversations roulaient sur le passé. Faits d’armes, souvenirs communs ressuscités entre anciens compagnons qui se revoyaient après une longue séparation, pieuse mention faite des morts et amis, propos humoristiques et anecdotes gaies. Les toasts avaient le même cachet à la fois grave et de belle humeur. En général, ces messieurs entraient en matière par une petite remarque joviale ou une histoire destinée à faire rire les convives.
General Horatio C. King, ayant à porter le toast de l’armée des États-Unis et des « Sociétés militaires », commença ainsi : Surtout, ne vous figurez pas qu’ayant deux toasts à porter, je vais réclamer un temps double. Je ne vous attendrirai pas sur le sort du brave, sur la tombe de qui se trouvait cette inscription : « Ci-gît Jonathan Porter qui fut tué d’un coup de pied de cheval. C’est bien fait, bon et fidèle serviteur ! » D’ailleurs, je ne suis pas très en train, ce soir. Ma fatigue est extrême, et cela n’est pas surprenant : je n’ai à peu près rien fait de tout le jour, si ce n’est de pousser sur le quai dans une de vos chaises roulantes, l’aimable lady, assise en face de moi. Néanmoins, j’ai l’espérance de ne pas me montrer aussi stupide que le jeune homme à qui son patron fit le compliment suivant : « Je vous tiens pour le plus stupide compagnon de tout New-York ; je suis sûr que vous ne savez même pas que Mathusalem est mort ! » — « Mort ! balbutia le jeune homme, mort ! Je ne savais même pas qu’il fût malade ! »
Il est fort naturel que la fibre patriotique soit une des plus vibrantes de toutes celles que remue une pareille séance. Mais le patriotisme américain, même celui des hommes de guerre, n’a rien de provoquant ni d’agressif. Ils ne se lassent pas de glorifier leur pays, et il y a de quoi. Écoutez le général S. A. Mulholland, chargé du toast « Our Country ».
« J’ai entendu un jour l’histoire d’un mineur qui tomba dans une crevasse profonde. Ses compagnons, paralysés de frayeur, lui crièrent : « Johnny, êtes-vous tué ? » Une voix répondit de l’abîme : « Non, je ne suis pas tué, mais le choc m’a rendu muet ! »
Lorsque je contemple la grandeur du sujet que je suis appelé à traiter, je suis comme ce malheureux mineur : j’en demeure muet.
Ce soir, en écoutant le bruit des vagues, je me rappelle une scène de mon adolescence. Il y a de cela cinquante ans, je me trouvais à bord d’un bateau allant de New-York à Egg-Harbour, et nous eûmes sur cette côte-ci une accalmie de plusieurs jours. A cette époque, il n’y avait à la place où nous sommes, qu’un phare. Maintenant, une grande cité s’est élevée, avec des édifices splendides, une population nombreuse. Cette ville du bord de l’Océan est le type du merveilleux développement de notre pays en tout sens.
Au temps de la Révolution, nous étions treize petits États, le long de l’Atlantique, et trois millions d’habitants. Quand je me baignai par ici, en 1850, nous étions vingt-cinq États et vingt-cinq millions d’habitants. A l’époque de la guerre de sécession, le pays comptait trente-deux États et trente-deux millions d’habitants, dont quatre millions d’esclaves. Maintenant, nous avons quarante-cinq États, plus de quatre-vingts millions d’habitants, et pas un esclave dans le pays. Ah ! nous ne devons pas seulement aimer notre patrie, mais en être fiers.
L’Amérique, une nation sans armée permanente est cependant si forte, qu’elle commande le respect à tous les autres peuples. Il semble que le Tout-Puissant ait appelé notre pays à l’existence pour révolutionner la terre et prouver à l’Humanité que la vraie forme du gouvernement est celle qui dérive du consentement des gouvernés. Il y a des hommes parmi nous qui regardent l’avenir avec de sombres pressentiments et tremblent pour nos libres institutions. Il est vrai que nos municipalités sont loin d’être ce qu’elles devraient, et les histoires de corruption jusque dans des situations élevées, ne sont, hélas ! que trop vraies. Les pessimistes prévoient des calamités… Mais, malgré cela, ceux qui aiment ce pays ont foi en l’avenir. La corruption de quelques municipalités leur apparaît comme certaines taches sur le soleil de nos libres institutions. Nous pouvons être tranquilles : par la vertu de la grande majorité du peuple, nous verrons ces taches effacées. »
Accentuant la note pacifique qui caractérise le patriotisme américain, l’amiral Geo. W. Melville déclare : « Il nous faut une marine, non pour faire la guerre, mais pour garantir la paix. De nos jours, si l’on veut maintenir la paix, il faut, à toute heure, être prêt à la guerre. C’est une sorte d’assurance que nous payons, et cela coûte moins d’argent et d’hommes que de faire la guerre. »
Le général Théo S. Peck, portant le toast des dames, dit : « En temps de guerre, les vainqueurs aussi bien que les vaincus se sont toujours appuyés sur les femmes. Dans toutes les guerres où les hommes de ce pays ont bataillé pour l’existence et le foyer, les nobles et aimantes femmes, non seulement ont donné tout ce qu’elles avaient (pères, maris, frères, fils, fiancés), mais leurs prières, leur effort, leur sacrifice de tout confort. Elles ont armé les hommes pour la lutte, si bien qu’aucune souffrance ni aucune misère ne leur ont semblé trop dures.
Les femmes des États-Unis, dans la paix comme dans la guerre, marchent pour tout ce qui est bon et vrai. Elles sont aussi prêtes à faire demain des sacrifices à la nation et à son glorieux drapeau, qu’elles l’ont été dans le passé ! »
Dans le toast au Président, M. John Wanamaker dit, en rappelant l’assassinat de Mac-Kinley à Buffalo : « D’une mer à l’autre, tout le pays eut un frisson d’horreur devant ce martyr immolé sur l’autel de la liberté, et tous les yeux se tournèrent vers l’homme, jeune encore, qui se tenait près de la tombe du grand Mac-Kinley[10]. Dans la solennité d’une redoutable crise, conscient de sa responsabilité écrasante, avec une grande dignité, entouré des anciens conseillers de Mac-Kinley, cet homme ayant la crainte de Dieu dans son cœur, et dans son âme, l’amour pour tout le peuple, offrit ses épaules au fardeau, quelque lourd qu’il fût. Les années consacrées à l’étude et à la solitude des montagnes, lui donnaient un esprit sûr, une santé robuste ; et l’héroïque soldat de San-Juan fut désigné par la confiance publique pour être l’exécuteur des intentions du regretté William Mac-Kinley, bien plus, le dépositaire de la volonté des États-Unis ».
[10] Théodore Roosevelt.
A tous les échos virils que cette soirée me laissa, et qui permettent de juger ce qu’il y a de sain et de vigoureux dans ce patriotisme à la fois pacifique et combatif ennemi de tout militarisme et cependant foncièrement martial, j’ajouterai quelques lignes, afin d’en marquer le côté religieux. La note religieuse ne fut absente d’aucun des discours prononcés, dans la soirée, par des hommes appartenant à toutes les dénominations. A dessein, je cite un passage du Général L.-G. Estes relatif à la vertu militaire : « La valeur, le patriotisme, l’honneur, la virilité, ne meurent point. Ils ne cessent pas avec le bruit du canon et ne s’écoulent point avec le sang, quand la vie s’échappe sur les champs de bataille ; ils ne sont point déposés avec le corps et rendus, poussière à la poussière, cendre à la cendre. Ils ne sont point d’essence terrestre. Ils appartiennent à l’âme et relèvent de l’Esprit. Et l’Esprit divin, c’est le souffle de Dieu ; il porte l’emblème de l’Éternité et, comme son divin Créateur, il est éternel. Vaillance, patriotisme, honneur, vertu virile, sont éternels. »
Quand nous quittâmes la salle du banquet, l’Océan chantait au dehors sa vieille et mâle chanson. Et mon souvenir y mêlait ces paroles fermes tombées de la bouche des vaillants défenseurs d’une République sans casernes ni citadelles. D’avoir passé quelques heures parmi les compagnons de Grant et de Lincoln, me produisait l’effet d’un bain d’acier. Un peu de leur âme avait passé dans la mienne. Comme ils avaient raison de dire, en parlant de leur patrie :
« Notre pays est destiné à être un rayonnant exemple de haute civilisation, de réconfort et d’amélioration, non seulement pour ses propres enfants, mais pour toute la famille humaine ![11] »
[11] Allocution du général S. A. Mulholland.
Lorsque j’eus, pour la première fois, la vision de l’Amérique gigantesque, personnifiée dans ses bâtisses monstres, ses entreprises commerciales, sa fièvre d’affaires, ses usines titanesques, le luxe de certaines classes et leurs somptueuses excentricités, j’eus le sentiment d’un contraste violent, douloureux. Décidément, je portais en moi un autre monde que celui qui se révélait par cette civilisation surchauffée, étincelante de fortune ou souillée de sordide misère, et semblant se ruer de tout son effort vers la conquête des biens matériels. Certains soirs, devant des auditoires choisis où brillaient des toilettes recherchées, constellées de pierreries, une intime tristesse traversait mon âme, à l’idée que ce qui faisait la substance même et la moëlle de ma pensée pouvait servir un moment de distraction à des curiosités blasées.
Mais, à aller au fond même des choses, mes impressions pessimistes ne purent pas subsister devant des expériences plus réconfortantes. Parmi les épaves de Bovery mission, comme parmi la fine fleur de la société américaine, d’après une méthode qui m’est devenue une seconde nature, je suis allé partout, droit au centre humain. Le luxe et la misère sont des accidents semblables : au fond demeure l’homme. De la surface, il faut se hâter vers la substance. La substance fondamentale de « la meilleure Amérique » c’est la simplicité.
Je vois dans certains journaux anglais, allemands, français, que le signe distinctif de la vie américaine est l’artificialité. C’est juger du cœur des gens par la couleur de leur gilet, et de leurs idées par la forme de leurs perruques. Des critiques ont soutenu que l’intérêt pris par le public américain à l’idée et au livre de la vie simple était du snobisme pur, du jeu de fantaisie, sans sérieux et sans sincérité. Tout cela est du jugement fragmentaire et superficiel. Un abcès n’est pas un organe, une verrue n’est pas une figure.
Une artificialité très visible et à plusieurs points de vue choquante, flotte il est vrai, comme une écume à la surface de la vie américaine. Mais l’écume n’est pas l’océan. La vie artificielle et compliquée qui sévit en Amérique à un degré inquiétant n’est pas dans le caractère américain. C’est un accident. Toutefois cet accident constitue un danger, et l’un des plus grands que ce pays puisse courir. En se laissant entraîner dans la vie superficielle, cette vie, oublieuse de l’âme, dédaigneuse de la simplicité, l’Amérique est peut-être, plus que d’autres contrées, infidèle à sa nature même. Elle compromet la source où réside le secret de sa puissance, de sa raison d’être dans le monde, le nerf et le ressort de sa belle vigueur. Voilà le fait qui m’a frappé en ma qualité d’ami. Et voyant ce danger, c’est avec une angoisse fraternelle que j’ai recueilli tous les bons symptômes capables de faire espérer que le danger sera écarté. Un mal reconnu est à moitié vaincu.
Si d’un regard clair de sa conscience, l’homme se rend compte qu’il court risque de perdre le fruit de la vie par la façon anormale de l’organiser, il est bien près de changer sa méthode. Les vaisseaux suivent leurs pilotes, et les pilotes leur boussole ; les nations ont pour boussole leur foi et leur idéal. Le véritable idéal américain est la réalisation d’une belle vie, inspirée par le souci du mieux, large et humaine, énergique et bienveillante. Sous l’agitation qui a gagné cet immense territoire, une secrète angoisse est nettement perceptible. Elle ne l’est sans doute pas chez tous également, ni surtout chez ces masses encore nouvelles et insuffisamment assimilées qui entrent comme un gros facteur troublant dans la population générale. Mais partout où l’on prend contact avec les hommes en qui se résume l’amour du pays, le souci du bien public, cette angoisse se fait jour. Elle n’a rien des inquiétudes séniles qu’inspirent aux gens établis leur égoïsme de classe et la peur des nouveautés. Elle tient de cette aimable et salutaire crainte de démériter qui anime la jeunesse généreuse, et perce même à travers ses fougues.
Dans ce qu’elle a de meilleur, l’Amérique sait qu’un pays ne vit ni par son or, ni par sa puissance militaire, ni par sa prospérité industrielle, mais que toutes ces choses, en ce qu’elles ont de bon, se ramènent à quelques vertus fondamentales dont l’humanité ne pourra jamais se passer. Si la source de ces vertus tarit, toute la splendeur extérieure d’une civilisation n’est bientôt plus qu’un fruit plantureux exposé à pourrir sur l’arbre. L’élite du peuple américain en a le sentiment vif, douloureux. Cette élite, heureusement, n’est pas une exquise minorité isolée, perdue dans une masse en décadence, qui n’aurait plus pour agents actifs que les ferments de sa décomposition. C’est une phalange, innombrable et serrée, de braves gens, clairvoyants et décidés, sensibles et courageux, ayant en un mot toutes les qualités d’un ferment virulent capable de pénétrer la pâte.
Ces éléments de santé publique tiennent directement à la vieille et solide tradition démocratique américaine, où se mêlent, en un si heureux dosage, le respect du passé, le conservatisme normal, et l’élan courageux vers l’avenir.
Je ne m’en suis jamais mieux aperçu que lorsque je franchis le seuil d’Independence-Hall, à Philadelphie. Cette maison est un sanctuaire national. Bâtie au siège même du berceau des libertés américaines, datant de l’époque héroïque, elle a vu les assemblées où s’est décidé, au milieu des plus émouvantes péripéties, l’avenir de la nation. Parmi ces menus objets devenus des reliques populaires, dans le cadre de ces murs qui autrefois ont écouté la parole des ancêtres et maintenant la murmurent aux oreilles des petits-fils, devant les portraits de ces hommes qui firent l’Amérique, j’éprouvai la plus intense des émotions religieuses. Il me semblait marcher sur un sol sacré. Quelques-uns des plus purs trésors de l’humanité nouvelle s’étaient élaborés là, au creuset des grandes luttes, dans la fournaise des situations où les hommes et les peuples s’épurent comme l’or. Et tout ce qui m’environnait, c’était l’esprit d’une patriarcale, d’une héroïque simplicité. Des éléments condensés là, en un foyer, est fait le cœur de l’Amérique.
Une fois que l’on tient ce fil, on peut le suivre partout à travers la trame de la vie nationale. Cette tradition n’est pas un souvenir pieux, sorte de relique morte, destinée à sortir de sa châsse, dans les grandes occasions seulement. Elle est mêlée à tous les actes et à toutes les préoccupations de l’existence. C’est un Leitmotiv qui, à chaque instant, reparaît dans la vaste symphonie où se manifeste l’âme populaire.
Si cette âme réagit comme elle le peut et comme elle le fait déjà, largement, contre le crédit excessif que donne l’argent, et contre cette usurpation sociale qui, d’un serviteur qu’il doit être, tend à faire de lui un Roi. Si elle profite de toutes les occasions pour réhabiliter et honorer les petites gens qui savent être heureux et indépendants en limitant leurs désirs. Si la conviction se répand que le faste est un esclavage, le luxe criard une preuve de bêtise, les dépenses irraisonnées une faute sociale, il n’y a pas de doute que l’avenir n’appartienne à la meilleure Amérique.
Pour elle, le message de simplicité n’est pas un cri de réaction ; personne de ceux qui ont pris la peine d’en apprécier le contenu ne s’y est mépris. Il y ont vu un appel à la clairvoyance et à la vigilance, un appel à l’hygiène élémentaire qui convient à la créature humaine.
Peu importe le pays que nous habitons, la langue que nous parlons, la foi religieuse ou sociale que nous professons, nous avons tous besoin de nous convertir à la simplicité. Nous risquons tous de perdre la vie, par la façon absurde de l’organiser. Quand l’accessoire marche avant l’essentiel, l’artificiel et le conventionnel avant le positif, tout l’éclat extérieur dont s’entoure la vie n’est plus que le cadre magnifique du néant.
Les institutions politiques, religieuses, sociales ; la science, l’industrie et l’éducation, tout l’ensemble de l’effort et du travail humain doivent contribuer à rendre l’homme plus largement homme. Mais, si nous n’y prenons garde, tout cela, au lieu d’être un instrument pour réaliser plus de justice, organiser plus d’ordre et de bonheur dans la fraternité, devient une entrave et un esclavage. L’homme succombe, écrasé sous ses œuvres, affaibli et dégradé par ses forces mal dirigées, ses instincts tournés en vices, son savoir en puissance de mort, sa foi transformée en fanatisme, toute fonction privée ou publique déviée de son but.
On affecte souvent de nous dire que l’homme descend du singe. Cela fait à quelques-uns un plaisir choquant ; d’autres s’en affectent outre mesure. Quant à moi, je pense qu’il n’y a là matière ni à s’enorgueillir ni à se troubler. J’ai dit quelque part que je consentirais volontiers à être une fourmi, pourvu que je fusse une fourmi de Dieu. Les chemins de l’Éternel vont de la poussière à l’Esprit. La distance est prodigieuse ; de nombreuses et d’humbles étapes sont nécessaires. A cela, quoi d’étonnant ? Peu m’importe donc le sentier par lequel je dois passer, pourvu qu’il monte.
Ce qu’il faut craindre ce n’est pas le singe du commencement, ancêtre, au surplus problématique, mais c’est celui de la fin, produit hideux qui sortirait à la longue de la sélection de nos tares. Descendre du singe et devenir des hommes, c’est un progrès, et quel progrès ! Mais être l’humanité, avoir donné naissance à Moïse, à Platon, au Christ, avoir dompté les éléments, attelé la foudre à son char, fait de l’éclair son messager, et redevenir des brutes par la férocité des sentiments, la bassesse des instincts, l’obscurcissement de l’intelligence, quelle chute dans les ténèbres ! Cela ne saurait être. Élevons nos résolutions à la hauteur d’une autre destinée. L’humanité parfois s’égare, mais sa soif la ramène aux sources, aux sources pures de la vie authentique et simple.
La date du 22 novembre avait été fixée d’avance pour mon retour à Washington. L’Union chrétienne de jeunes gens de cette ville organisa la conférence publique qui m’avait été demandée, et choisit comme local le théâtre de Lafayette square, situé près de la Maison Blanche. La conférence fut annoncée pour quatre heures de l’après-midi. Le soir du même jour devait avoir lieu ma conférence française, dans les salons de la Maison Blanche.
J’arrivai à Washington vers onze heures du matin. L’ambassadeur de France et Mme Jusserant avaient organisé un déjeuner familial, pour nous faire rencontrer avec quelques amis. Il me fut particulièrement doux de franchir le seuil du petit hôtel de l’ambassade et de me trouver dans une maison où les tableaux, les tapisseries et une grande partie des objets meublants, rappelaient la France. La bonne grâce affectueuse de mes hôtes s’ajoutait à ce charme de la patrie lointaine.
Le Président avait dit en septembre : « Je vous présenterai moi-même à vos auditeurs ». Mais je n’osais compter sur un tel honneur, tant il dépassait toutes mes espérances, et jamais depuis lors aucune allusion n’avait été faite, de ma part, à cette haute parole. J’allais donc à Lafayette square en songeant à toutes les bonnes raisons qui sans doute empêcheraient le Président de s’y trouver. En approchant du théâtre, je vis la place entourée d’une série de policemen de taille colossale, de ces policemen américains, véritables tourelles dont le seul poids est un élément d’ordre, et qui émergent des foules, comme les rochers des flots. Ce n’est pas pour moi que les géants sont venus, pensai-je. Au foyer du théâtre, je rencontrai les jeunes gens, organisateurs de la réunion. « Le Président vient de téléphoner qu’il sera ici dans dix minutes », me dirent-ils. Effectivement, au bout de quelques instants, il arriva en disant : « J’avais dit que je viendrais, me voici ! »
Je ne décrirai pas ce que j’éprouvai, pendant que, silencieux, j’écoutais la parole de celui que, peu de jours auparavant, l’Amérique avait maintenu à son poste par une majorité formidable, inconnue jusqu’alors dans les annales du monde.
Le Président parle comme un chef de famille entouré des siens. Sa parole simple, précise, faisait naître cette clarté qui vient des vérités élémentaires interprétées par un esprit droit.
Beaucoup d’orateurs américains ne gesticulent pas en parlant. Ils observent une attitude immobile qui ne laisse pas d’avoir un côté impressionnant, quoiqu’elle tranche singulièrement sur nos habitudes françaises. Le Président, lui, s’anime en parlant, et son geste parfois devient d’une singulière véhémence.
On sent que ce chef d’État est porté par un idéal à la fois élevé et pratique dont il essaie à toute occasion de mettre en relief quelque trait saillant. Il possède à un éminent degré la faculté de traduire les sentiments, les idées, les lois de la vie en langage universel. Chacune de ses phrases, chaque exemple cité sont frappés au coin de l’humanité supérieure, de celle qui, sans étiquette ni acception de races, de nations ou de classes, est la substance essentielle en chacun de nous. Et cependant, rien de vague ni d’indéterminé dans cette pensée dont la simplicité lumineuse rend la parole limpide. Tout cela est pratique, actuel, riche en couleur locale. Mais toujours l’idéal humain perce sous l’idéal national.
J’aurais voulu reproduire ici, en entier, les paroles du Président, publiées, le lendemain, dans tous les journaux américains. Mais je dois y renoncer, en raison même des termes dans lesquels était conçu ce haut témoignage de sympathie. J’en conserve au cœur le souvenir ému et reconnaissant et il constitue l’une des plus belles récompenses de ma vie.
Le soir, j’arrivai à la Maison Blanche, une bonne demi-heure avant la conférence, et fus introduit dans un salon du rez-de-chaussée où ne tardèrent pas à descendre, d’abord Mme Roosevelt, ensuite le Président. Au courant de la conversation, le Président raconta que Mme Théodore Roosevelt et lui-même, avaient du sang français dans les veines et descendaient de Huguenots, expulsés de leur mère-patrie par les rigueurs de la persécution religieuse.
Déjà les invités de la Maison Blanche, au nombre d’une centaine, étaient réunis dans le salon voisin.
Je fus introduit le dernier. De tout ce que je pouvais éprouver à cette heure, c’est l’émotion patriotique qui l’emportait.
Pouvoir, dans ma langue maternelle, parler de mon pays devant un auditoire si choisi, constituait une douce et suprême satisfaction.
Je me rappelais, en commençant ma conférence, la bonne parole prononcée par le Président : « Jamais vous ne nous direz assez de bien de la France ».
Il existe un très vieux classement des nations, comme il existe une zoologie à l’usage des petits enfants où chaque animal est sommairement qualifié d’un seul mot. Le tigre est féroce, l’âne bête, le chien fidèle et le chat faux. Pour ceux qui aiment et connaissent les animaux, il y a bien à redire sur cette science brève. Mais déplacer les préjugés est quelquefois plus difficile que de transporter les montagnes. L’ethnographie, telle que la pratique la foule, a statué que certains peuples étaient hypocrites, d’autres lourds d’esprit, d’autres adorateurs de l’argent. Les Français sont légers et, en outre, aiment à se disputer entre eux. Notre littérature d’exportation et notre politique intérieure semblent bien un peu donner raison à cette opinion. Mais elle est, en somme, erronée, c’est ce qu’il faut s’attacher à montrer. Comme tous les peuples, nous avons, nous aussi, des qualités par lesquelles nous gagnons à être connus des gens intelligents et bienveillants de toutes les nations. Signaler ces qualités n’est pas un effet de vanité nationale : mais c’est un service rendu au bien général. Il est contraire à l’intérêt international et à la bonne entente, que les peuples se connaissent entre eux surtout par leurs défauts. En se connaissant un peu plus par leurs bonnes qualités, ils auraient plus de motifs de confiance mutuelle. Il faudrait constituer un ordre de courtiers de la bienveillance entre les peuples, dont la méthode consisterait à raconter sur chacun ce qu’il y a de meilleur à en dire. Un peu de réflexion et d’expérience nous enseigne que l’homme ne vit pas de ses maladies, mais des parties restées saines dans sa constitution. Les peuples ne peuvent pas vivre de leurs vices. C’est par leurs vertus qu’ils subsistent. La France non seulement existe, mais elle exerce dans le monde une action permanente. Son génie, son travail, ses idées, son goût entrent comme un facteur essentiel dans la collaboration universelle des nations. Il est évident que la place que nous tenons n’est pas due à notre légèreté. Il doit donc y avoir autre chose. C’est ce qu’il s’agit de chercher et de mettre en relief.
Derrière le pays superficiel et bruyant, tel qu’il s’aperçoit de loin ou se reflète dans les livres et les feuilles publiques potinières, il y a un autre pays, silencieux, laborieux, studieux, une France inconnue qui rachète largement les défauts criards de celle, hélas ! trop connue.
Comme un hôte assis le soir près d’un foyer ami, j’ai voulu, au foyer de la nation américaine, parler de cette France.
J’ai dit notre vie de famille si réelle, notre peuple économe et travailleur, les vaillants petits ménages dans les grandes cités, tels que l’étranger ne les connaît pas et ne saurait les connaître, mais qu’il m’a été donné de voir en si grand nombre. J’ai parlé des paysans, des ouvriers ; fait un parallèle, par exemple, entre le Paris matinal, que les Français eux-mêmes connaissent si peu, et le Paris noctambule que l’étranger ne connaît que trop.
Habitué discret de l’institut Pasteur, ami du regretté M. Duclaux et de beaucoup d’autres chercheurs scientifiques de mon pays, j’ai décrit leur existence réservée, hostile à toute réclame tapageuse, laissant pénétrer un regard aussi vers les chambres de nos étudiants studieux, greniers aimés, comme en contient tant ce grand Paris, où sommeille le capital scientifique de demain.
Il m’a paru ensuite intéressant d’esquisser tout le grand labeur d’éducation entrepris par la troisième République, aux divers degrés de l’enseignement national, au milieu d’obstacles sans nombre, avec une abnégation admirable. En passant, j’ai encadré dans ce tableau la figure d’un des meilleurs pédagogues de tous les temps : Félix Pécaut, à qui des hommages publics ont été rendus à la tribune nationale, mais dont le plus bel éloge est l’empreinte sérieuse et forte laissée au cœur de ses disciples.
M’étant longuement entouré de documents sur les œuvres sociales de France, j’ai indiqué ce que l’initiative privée est parvenue à faire dans ce domaine.
Un autre mouvement méritait d’être mentionné : celui de la pénétration sociale entreprise, depuis une vingtaine d’années, dans une série de mutualités, d’entreprises de collaboration des bonnes volontés entre classes différentes, de rencontres entre les travailleurs de l’esprit et les travailleurs manuels. Parmi les pionniers de la première heure de cette belle œuvre, j’ai nommé T. Fallot, qui venait de mourir, et tracé le profil de ce fils robuste du Ban-de-la-Roche, en qui semblait refleurir de nos jours l’esprit du grand Oberlin.
Pouvais-je oublier ensuite de parler d’une tentative unique en son genre et qui est parvenue à établir, au sein de notre époque troublée et divisée, un rendez-vous courtois de discussion et de mutuel renseignement entre les hommes de bonne volonté venus de tous les horizons de la pensée. J’ai nommé l’Union pour l’action morale, œuvre large et compréhensive, qui serait capable, en se répandant, de fournir une puissante contribution à l’avenir moral de la France.
Enfin, pendant une longue heure, il m’a été donné de parler d’une France profonde, besognant sous les dehors agités de notre vie publique, d’une France recueillie, assoiffée de bonne entente entre concitoyens, recherchant l’unité des intentions à travers la diversité des origines et des groupements, bâtissant la cité, dans un effort constant vers la justice et la bienveillance…
Une réception toute cordiale suivit la conférence.
Belle journée et beau soir… Sur cette impression, il convient de clore ces souvenirs.
Le 1er décembre, je m’embarquai sur la Savoie, entouré d’une multitude d’amis qui venaient me souhaiter bon voyage.
Le dernier à quitter le bord, au moment où déjà tombaient les amarres, fut John Wanamaker.
Des nuées de goëlands, symboles des souhaits et des souvenirs qui accompagnent le voyageur, déployaient leurs grandes ailes au-dessus du sillage bouillonnant.
Je partais avec le sentiment d’avoir visité l’un des pays où se trouvent amassées les plus substantielles réserves de l’Humanité…
Maintenant nous tournions le cap vers le soleil levant. A mesure que nous voguions plus avant, de chères figures émergeaient de l’ombre, les pensées de revoir se précisaient.
Mais surtout grandissait et s’imposait, d’heure en heure, avec plus de puissance, l’image de la Patrie.
La France a jadis contribué à fonder les États-Unis. Avec combien d’obscurités et d’obstacles son bel idéal démocratique, victorieux au delà des mers, n’a-t-il pas encore à lutter à son propre foyer ! Si du secours moral, des exemples réconfortants peuvent lui venir des contrées que jadis fertilisa son génie, c’est justice.
Quand blanchissent les moissons, le moment est venu de se rappeler, et de saluer le semeur.
Dans les lueurs de tes phares, trouant au loin la nuit océanique, je te saluais, France aimée, semeuse infatigable, à qui nulle inclémence du ciel, nulle rudesse des saisons ne fut épargnée, mais qui marches toujours parmi les pionniers d’un avenir meilleur, la main sur la charrue et l’espérance au front.
Pages | |
| Préface | |
| Premiers traits d’union | |
| Obstacles | |
| Où John Wanamaker intervient | |
| En mer | |
| Le salut des feux | |
| Réveil dans le port | |
| Dans les docks | |
| Premier coup d’œil dans New-York | |
| Échappée sur la campagne | |
| Le cimetière de Sleepy hollow | |
| Premier speech anglais | |
| Lindenhurst | |
| Flâneries | |
| Une sieste et ses suites | |
| Séjour à la Maison Blanche. Le Président | |
| Menus souvenirs de la Maison Blanche | |
| « Drive » à Cornwall-on-Hudson | |
| Un jour à Bethany-Church | |
| Vie religieuse | |
| La Bible aux États-Unis | |
| Chez les Quakers | |
| Hôte d’Israël | |
| Frères noirs | |
| Travail, Argent, Affaires | |
| Repos | |
| Écoles | |
| High Schools | |
| Universités | |
| Mount Holyoke-College | |
| Doctorat honoris causa | |
| Un pénitencier quaker | |
| Bovery-Mission | |
| La propreté de la rue aux États-Unis | |
| Conférences et auditoires | |
| Une leçon rapportée des aveugles aux clairvoyants | |
| Homes. — Hospitalité | |
| Tempérament américain | |
| Sympathies françaises | |
| Un plaisant quiproquo | |
| On ne fait pas toujours ce qu’on veut | |
| Dean my Keeper | |
| Vision de fleuves | |
| Forteresses américaines | |
| Un dîner de héros | |
| Simplicité américaine | |
| Adieux à Washington | |
| Conférence à la Maison Blanche |
IMPR. ALSACIENNE ANCt G. FISCHBACH, STRASBOURG. — 1898