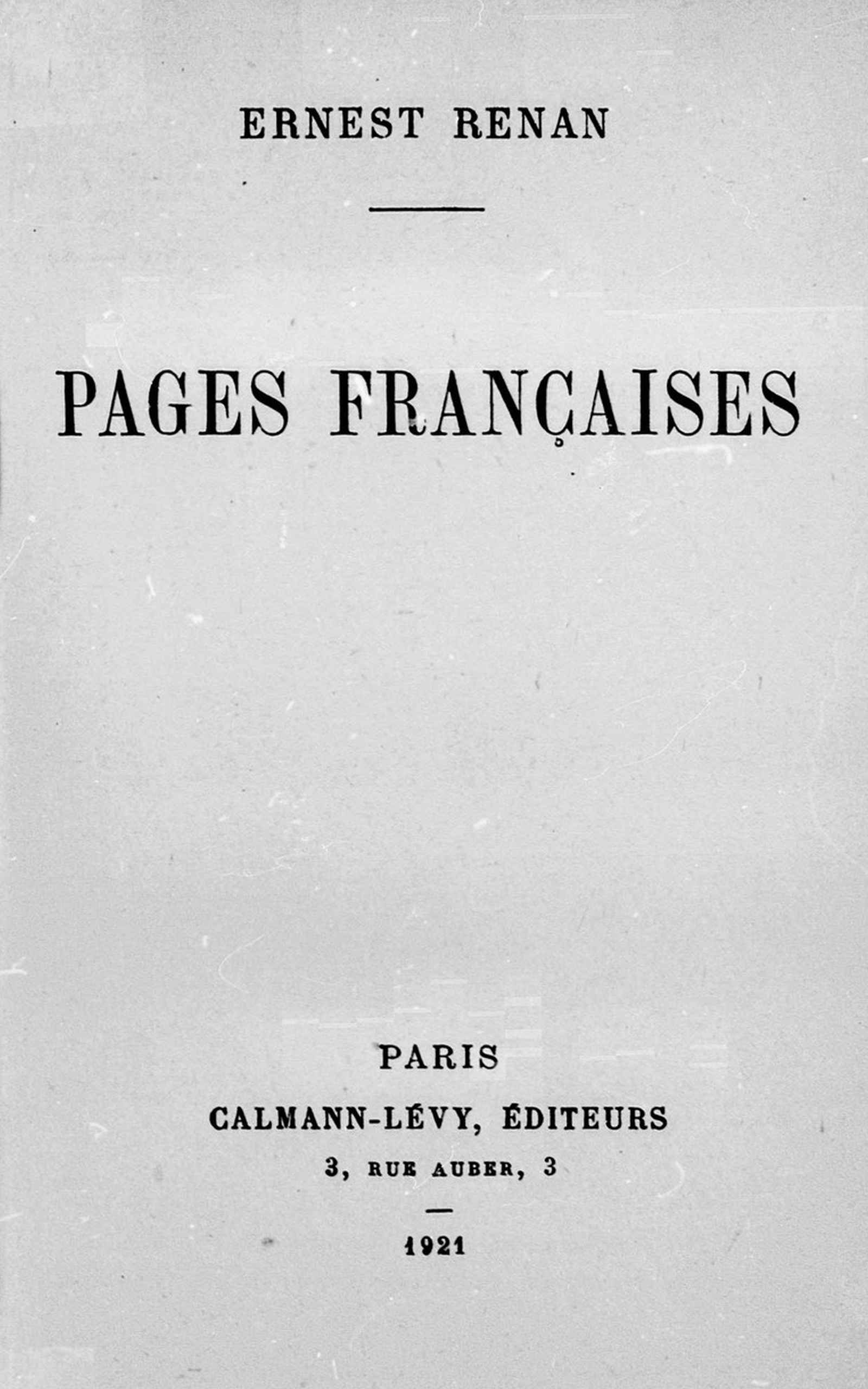
Title: Pages françaises
Author: Ernest Renan
Release date: December 10, 2025 [eBook #77436]
Language: French
Original publication: Paris: Calmann-Lévy, 1921
Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
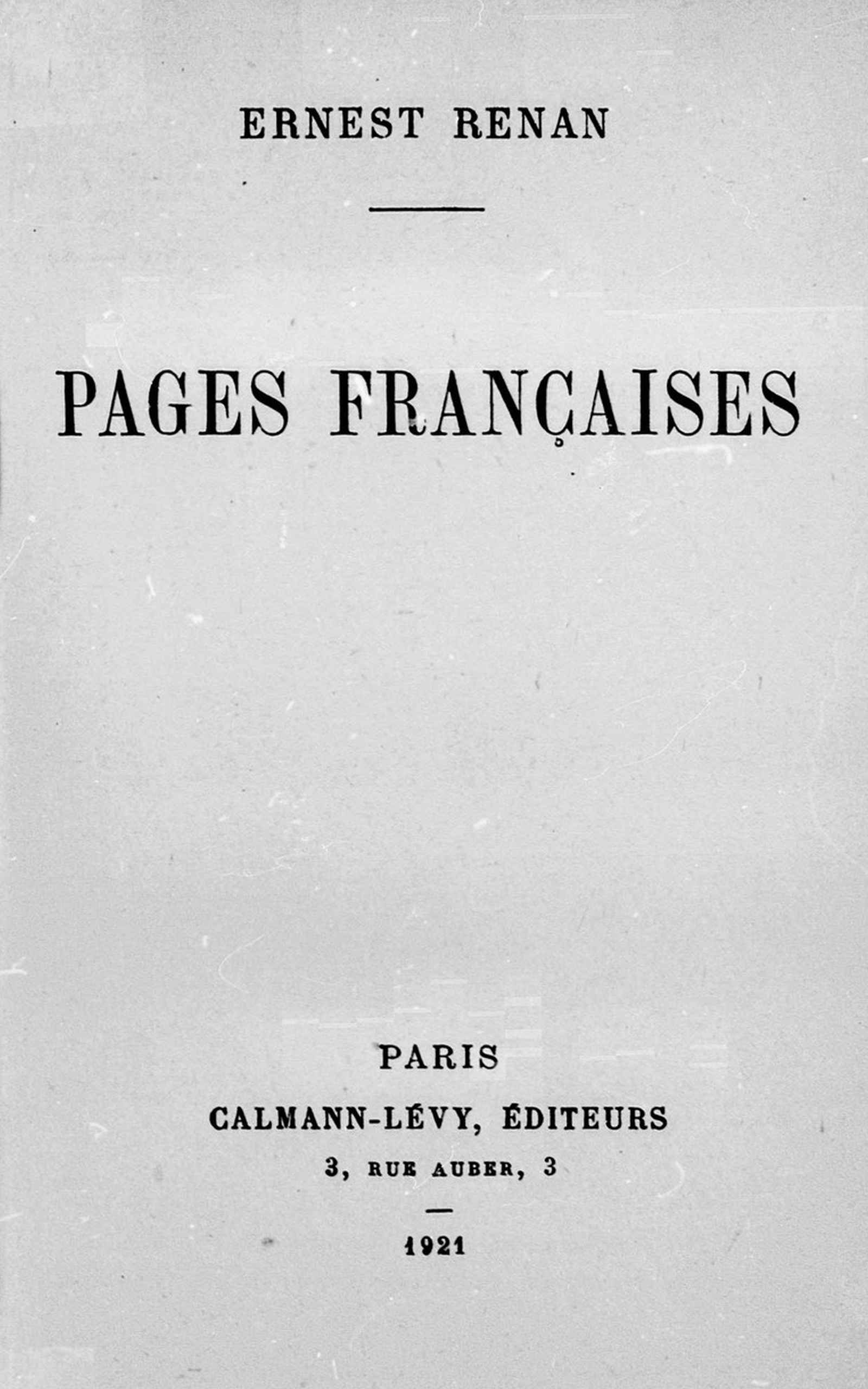
ERNEST RENAN
PARIS
CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS
3, RUE AUBER, 3
1921
ŒUVRES COMPLÈTES D’ERNEST RENAN
HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME
Format in-8o. | |
| LE LIVRE DE JOB, traduit de l’hébreu, avec une étude sur le plan, l’âge et le caractère du poème | 1 vol. |
| LE CANTIQUE DES CANTIQUES, traduit de l’hébreu, avec une étude sur le plan, l’âge et le caractère du poème | 1 — |
| L’ECCLÉSIASTE, traduit de l’hébreu, avec une étude sur l’âge et le caractère du livre | 1 — |
| HISTOIRE GÉNÉRALE DES LANGUES SÉMITIQUES | 1 — |
| HISTOIRE DU PEUPLE D’ISRAËL | 5 — |
| ÉTUDES D’HISTOIRE RELIGIEUSES | 1 — |
| NOUVELLES ÉTUDES D’HISTOIRE RELIGIEUSE | 1 — |
| AVERROËS ET L’AVERROÏSME, essai historique | 1 — |
| ESSAIS DE MORALE ET DE CRITIQUE | 1 — |
| MÉLANGES D’HISTOIRE ET DE VOYAGES | 1 — |
| QUESTIONS CONTEMPORAINES | 1 — |
| LA RÉFORME INTELLECTUELLE ET MORALE | 1 — |
| DE L’ORIGINE DU LANGAGE | 1 — |
| DIALOGUES PHILOSOPHIQUES | 1 — |
| DRAMES PHILOSOPHIQUES, édition complète | 1 — |
| SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE | 1 — |
| FEUILLES DÉTACHÉES | 1 — |
| DISCOURS ET CONFÉRENCES | 1 — |
| L’AVENIR DE LA SCIENCE | 1 — |
| LETTRES INTIMES DE E. RENAN ET HENRIETTE RENAN | 1 — |
| ÉTUDES SUR LA POLITIQUE RELIGIEUSE DU RÈGNE DE PHILIPPE LE BEL | 1 — |
| LETTRES DU SÉMINAIRE (1838-1846) | 1 — |
| MÉLANGES RELIGIEUX ET HISTORIQUES | 1 — |
| CAHIERS DE JEUNESSE (1845-1846) | 1 — |
| NOUVEAUX CAHIERS DE JEUNESSE (1846) | 1 — |
| MISSION DE PHÉNICIE. — Cet ouvrage comprend un volume in-4o de 888 pages de texte, et un volume in-folio, composé de 70 planches, un titre et une table des planches. | |
Format grand in-18. | |
| CONFÉRENCES D’ANGLETERRE | 1 vol. |
| ÉTUDES D’HISTOIRE RELIGIEUSE | 1 — |
| VIE DE JÉSUS, édition populaire | 1 — |
| SOUVENIRS D’ENFANCE ET DE JEUNESSE | 1 — |
| FEUILLES DÉTACHÉES | 1 — |
| FRAGMENTS INTIMES ET ROMANESQUES | 1 — |
| PAGES CHOISIES | 1 — |
Édition illustrée, format in-16 jésus. | |
| MA SŒUR HENRIETTE | 1 vol. |
| PATRICE | 1 — |
En collaboration avec
M. VICTOR LE CLERC | |
| HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE AU XIVe SIÈCLE, 2 vol. gr. in-8. | |
Il a été tiré de cet ouvrage
TRENTE EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE HOLLANDE,
tous numérotés.
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays.
Copyright 1921, by Calmann-Lévy.
L’éditeur du présent volume ne s’est pas dissimulé les inconvénients que présentait l’entreprise de faire un choix, d’un point de vue particulier, dans l’œuvre d’Ernest Renan. Ces fortes constructions, aux arêtes logiques, se prêtaient moins que d’autres au morcellement, et la crainte de trahir une pensée si riche et si complète a plus d’une fois arrêté un travail entrepris à la suggestion d’un de nos universitaires les plus éminents[1].
[1] M. Samuel Rocheblave, professeur à l’Université de Strasbourg.
Deux raisons ont encouragé son achèvement. On a pensé que la réunion sous un volume portatif faciliterait la connaissance de morceaux politiques et sociaux célèbres, cités souvent durant la guerre même, et dispersés dans des volumes dont le public ne se rapproche pas facilement. On a surtout désiré mettre en lumière, au moment le plus glorieux de notre histoire, les réflexions profondes, parfois amères, toujours si passionnément françaises, du grand esprit qui souffrit tant des malheurs et des fautes de son époque. Espérer que ce travail mettra fin à la légende du scepticisme de Renan, si solidement établie par une critique superficielle, serait bien hardi. Il nous suffira de rassembler ces pensées vieilles de plus d’un quart de siècle et auxquelles la mort des deux petits-fils de Renan, tués à l’ennemi en 1914 et 1917, prête un caractère pathétique, pour que les esprits réfléchis y trouvent la réponse à ces banalités.
De préférence à l’ordre chronologique, on a divisé ces morceaux en trois groupes, dont le plus considérable est celui qui concerne la guerre de 1870. En effet, le but de ce volume n’était pas un historique de la pensée de Renan, mais la présentation d’un ensemble touchant les destinées de la France, de l’Europe, le rôle particulier de notre patrie dans l’histoire de la civilisation. Pour marquer clairement le caractère de chaque extrait, on lui a donné un titre tiré du texte même. On y a joint quelques notes explicatives très brèves pour rester dans le caractère presque scolaire d’une publication où on n’a désiré que servir la pensée d’Ernest Renan et la France.
Le morceau de ce volume auquel j’attache le plus d’importance et sur lequel je me permets d’attirer l’attention du lecteur est la conférence : Qu’est-ce qu’une nation ? J’en ai pesé chaque mot avec le plus grand soin ; c’est ma profession de foi en ce qui touche les choses humaines, et quand la civilisation moderne aura sombré par suite de l’équivoque funeste de ces mots : nation, nationalité, race, je désire qu’on se souvienne de ces vingt pages-là. Je les crois tout à fait correctes. On va aux guerres d’extermination, parce qu’on abandonne le principe salutaire de l’adhésion libre, parce qu’on accorde aux nations comme on accordait autrefois aux dynasties le droit de s’annexer des provinces malgré elles. Des politiques transcendants se raillent de notre principe français, que, pour disposer des populations, il faut préalablement avoir leur avis. Laissons-les triompher à leur aise. C’est nous qui avons raison. Ces façons de prendre les gens à la gorge et de leur dire : « Tu parles la même langue que nous, donc, tu nous appartiens », ces façons-là sont mauvaises ; la pauvre humanité, qu’on traite un peu trop comme un troupeau de moutons, finira par s’en lasser.
L’homme n’appartient ni à sa langue, ni à sa race ; il n’appartient qu’à lui-même, car c’est un être libre, c’est un être moral. On n’admet plus qu’il soit permis de persécuter les gens pour leur faire changer de religion ; les persécuter pour leur faire changer de langue ou de patrie nous paraît tout aussi mal. Nous pensons qu’on peut sentir noblement dans toutes les langues, et, en parlant des idiomes divers, poursuivre le même idéal. Au-dessus de la langue, de la race, des frontières naturelles, de la géographie, nous plaçons le consentement des populations, quels que soient leur race, leur langue, leur culte. La Suisse est peut-être la nation de l’Europe la plus légitimement composée. Or, elle compte dans son sein trois ou quatre langues, deux ou trois religions et Dieu sait combien de races. Une nation, c’est pour nous une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant, dans le passé, de souvenirs, de sacrifices, de gloires, souvent de deuils et de regrets communs ; dans le présent, du désir de continuer à vivre ensemble. Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue ou d’appartenir au même groupe ethnographique, c’est d’avoir fait de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir.
(Discours et Conférences, 1887. Préface.)
Ailleurs, la littérature et la société sont choses distinctes, profondément divisées. Dans notre pays, grâce à vous[2], elles se pénètrent. Vous vous inquiétez peu d’entendre annoncer pompeusement l’avènement de ce qu’on appelle une autre culture, qui saura se passer du talent. Vous vous défiez d’une culture qui ne rend l’homme ni plus aimable, ni meilleur. Je crains fort que des races, bien sérieuses sans doute, puisqu’elles nous reprochent notre légèreté, n’éprouvent quelque mécompte dans l’espérance qu’elles ont de gagner la faveur du monde par de tout autres procédés que ceux qui ont réussi jusqu’ici. Une science pédantesque dans sa solitude, une littérature sans gaieté, une politique maussade, une haute société sans éclat, une noblesse sans esprit, des gentilshommes sans politesse, de grands capitaines sans mots sonores, ne détrôneront pas, je crois, de sitôt, le souvenir de cette vieille société française si brillante, si jolie, si jalouse de plaire. Quand une nation, par ce qu’elle appelle son sérieux et son application, aura produit ce que nous avons fait avec notre frivolité, des écrivains supérieurs à Pascal et à Voltaire, de meilleures têtes scientifiques que d’Alembert et Lavoisier, une noblesse mieux élevée que la nôtre au XVIIe et au XVIIIe siècles, des femmes plus charmantes que celles qui ont souri à notre philosophie, un élan plus extraordinaire que notre Révolution, plus de facilité à embrasser les nobles chimères, plus de courage, plus de savoir-vivre, plus de bonne humeur pour affronter la mort, une société, en un mot, plus sympathique et plus spirituelle que celle de nos pères, alors nous serons vaincus. Nous ne le sommes pas encore. Nous n’avons pas perdu l’audience du monde. Créer un grand homme, frapper des médaillons pour la postérité n’est pas donné à tous. Il y faut votre collaboration. Ce qui se fait sans les Athéniens est perdu pour la gloire ; longtemps encore vous saurez seuls décerner une louange qui fasse vivre éternellement.
[2] L’Académie française.
Discours de réception à l’Académie française, 3 avril 1879 (Discours et Conférences.)
Mon cher ami,
Vous m’apprenez qu’un passage de mon discours de réception a été mal accueilli parmi vous comme la voix d’un ennemi. Relisez ce que j’ai dit, et vous verrez combien ce jugement est superficiel. J’ai défendu notre vieil esprit français contre d’injustes reproches qui viennent presque aussi souvent de chez nous que de chez vous. J’ai soutenu contre des novateurs qui sont loin d’être tous Allemands, que notre tradition intellectuelle est grande et bonne, qu’il faut l’appliquer à des ordres de connaissance sans cesse élargis, mais non pas la changer. J’ai exprimé des doutes sur la possibilité pour une dynastie de jouer dans le monde un rôle universel sans bienveillance, sans générosité, sans éclat. J’ai pu aller à l’encontre de certaines opinions des militaires et des hommes d’État de Berlin ; je n’ai pas dit un mot contre l’Allemagne et son génie. Plus que jamais je pense que, si nous avons besoin de vous, vous aussi, à quelques égards, avez besoin de nous. La collaboration de la France et de l’Allemagne, ma plus vieille illusion de jeunesse, redevient la conviction de mon âge mûr, et mon espérance est que, si nous arrivons à la vieillesse, si nous survivons à cette génération d’hommes de fer, dédaigneux de tout ce qui n’est pas la force, auxquels vous avez confié vos destinées, nous verrons ce que nous avons rêvé autrefois, la réconciliation des deux moitiés de l’esprit humain. Oui, sans nous, vous serez solitaires et vous aurez les défauts de l’homme solitaire ; le monde n’appréciera parfaitement de vous que ce que nous lui aurons fait comprendre. Je me hâte d’ajouter que, sans vous, notre œuvre serait maigre, insuffisante. Voilà ce que j’ai toujours dit. Je n’ai nullement changé ; ce sont les événements qui ont si complètement interverti les rôles que nous avons peine à nous reconnaître dans nos affections et dans nos souvenirs.
Personne n’a aimé ni admiré plus que moi votre grande Allemagne, l’Allemagne d’il y a cinquante ou soixante ans, personnifiée dans le génie de Gœthe, représentée aux yeux du monde par cette merveilleuse réunion de poètes, de penseurs, qui a vraiment ajouté un domaine nouveau aux richesses de l’esprit humain. Tous tant que nous sommes, nous lui devons beaucoup, à cette Allemagne large, intelligente et profonde, qui nous enseignait l’idéalisme par Fichte, la foi dans l’humanité par Herder, la poésie du sens moral par Schiller, le devoir abstrait par Kant. Loin que ces acquisitions nous parussent la contradiction de l’ancienne discipline française, elles nous en semblaient la continuation. Nous prenions au sérieux vos grands esprits quand ils reconnaissaient ce qu’ils devaient à notre XVIIIe siècle ; nous admettions avec Gœthe que la France, que Paris étaient des organes essentiels du génie moderne et de la conscience européenne. Nous travaillions de toutes nos forces à bannir de la science et de la philosophie ces mesquines idées de rivalité nationale qui sont le pire obstacle aux progrès de l’esprit humain.
Depuis 1848, époque où les questions commencèrent à se poser avec netteté, nous avons toujours admis que l’unité politique de l’Allemagne se ferait, que c’était là une révolution juste et nécessaire. Nous concevions l’Allemagne devenue nation comme un élément capital de l’harmonie du monde. Voyez notre naïveté ! Cette nation allemande que nous désirions voir entrer comme une individualité nouvelle dans le concert des peuples, nous l’imaginions sur le modèle de ce que nous avions lu, d’après les principes tracés par Fichte et Kant. Nous formions les plus belles espérances où prendrait place dans la grande confédération européenne un peuple philosophe, rationnel, ami de toutes les libertés, ennemi des vieilles superstitions, ayant pour symbole la justice et l’idéal. Que de rêves nous faisions ! Un protestantisme rationaliste s’épurant toujours entre vos mains et s’absorbant en la philosophie, un haut sentiment d’humanité s’introduisant avec vous dans la conduite du monde, un élément de raison plus mûre se mêlant au mouvement général de l’Europe et préparant des bandages à plusieurs des plaies que notre grande, mais terrible Révolution avait laissées saignantes ! Vos admirables aptitudes scientifiques sortaient d’une obscurité imméritée, devenaient un rouage essentiel de la civilisation, et ainsi, grâce à vous et un peu grâce à nous, un pas considérable s’accomplissait dans l’histoire du progrès.
Les choses humaines ne se passent jamais comme le veulent les sages. Aussi les esprits éclairés parmi nous ne furent-ils pas trop surpris de voir proclamer à Versailles, sur les ruines de la France vaincue, cette unité allemande qu’ils s’étaient représentée comme une œuvre sympathique à la France. Grande fut leur douleur en voyant l’apparition nationale qu’ils avaient appelée de leurs vœux indissolublement liée aux désastres de leur pays. Ils se consolaient au moins par la pensée que l’Allemagne, devenue toute-puissante en Europe, allait planter haut et ferme le drapeau d’une civilisation qu’elle nous avait appris à concevoir d’une façon si élevée.
La grandeur oblige, en effet. Une nation a d’ordinaire le droit de se renfermer dans le soin de ses intérêts particuliers et de récuser la gloire périlleuse des rôles humanitaires. Mais la modestie n’est pas permise à tous. Vos publicistes, interprètes d’un instinct profond, ont pu être moins discrets à cet égard que vos hommes d’État et proclamer tout haut que l’ère de l’Allemagne commençait dans l’histoire. La fatalité vous traînait. Il n’est pas permis, quand on est tout-puissant, de ne rien faire. La victoire défère au victorieux, qu’il le veuille ou non, l’hégémonie du monde.
Tour à tour la fortune élève sur le pavois une nation, une dynastie. Jusqu’à ce que l’humanité soit devenue bien différente de ce qu’elle est, toutes les fois qu’elle verra passer un char de triomphe, elle saluera, et les yeux fixés sur le héros du jour, elle lui dira : « Parle, tu es notre chef, sois notre prophète. » La solution des grandes questions pendantes à un moment donné (et Dieu sait si le moment présent se voit obsédé de problèmes impérieux !) est dévolue à celui que les destins désignent. Alexandre, Auguste, Charles-Quint, Napoléon n’avaient pas le droit de se désintéresser des choses humaines ; sur aucune question, ils ne pouvaient dire : « Cela ne me regarde pas ! » Chaque âge a son président responsable, chargé de frapper, d’étonner, d’éblouir, de consoler l’humanité. Autant le rôle du vaincu, obligé de s’abstenir en tout, est facile, autant la victoire impose de devoirs. Il ne sert de rien de prétendre qu’on a le droit d’abdiquer une mission qu’on n’a pas voulue. Le devoir devant lequel on recule vous prend à la gorge, vous tue ; la grandeur est un sort implacable auquel on ne peut se soustraire. Celui qui manque à sa vocation providentielle est puni par ce qu’il n’a pas fait, par les exigences qu’il n’a pas contentées, par les espérances qu’il n’a pas remplies, et surtout par l’épuisement qui résulte d’une force non employée, d’une tension sans résultat.
Faire de grandes choses dans le sens marqué par le génie de l’Allemagne, tel était donc le devoir de la Prusse quand le sort des armes eut mis les destinées de l’Allemagne entre ses mains. Elle pouvait tout pour le bien ; car la condition pour réaliser le bien, c’est d’être fort. Qu’y avait-il à faire ? Qu’a-t-elle fait ? Huit ans, plus de la moitié de ce que Tacite appelait grande mortalis ævi spatium, se sont écoulés depuis qu’elle jouit en Europe d’une supériorité incontestée. Par quels progrès en Allemagne et dans le monde cette période historique aura-t-elle été marquée ?
Et d’abord, après la victoire, la nation victorieuse a bien le droit de trouver chez elle les récompenses de ses héroïques efforts, le bien-être, la richesse, le contentement, l’estime réciproque des classes, la joie d’une patrie glorieuse et pacifiée. En politique, elle a droit surtout au premier des biens, à la première des récompenses, je veux dire à ces libertés fondamentales de la parole, de la pensée, de la presse, de la tribune, toutes choses dangereuses dans un État faible ou vaincu, possibles seulement dans un État fort. Ces grandes questions sociales qui agitent notre siècle ne peuvent être résolues que par un victorieux, se servant du prestige de la gloire pour imposer des concessions, des sacrifices, l’amnistie à tous les partis. Donner la paix, autant que la paix est de ce monde, et la liberté, aussi large qu’il est possible, à cette Europe continentale qui n’a pas encore trouvé son équilibre, fonder définitivement le système représentatif, aborder franchement les problèmes sociaux, élever les classes abaissées sans leur inspirer la jalousie des supériorités nécessaires, diminuer la somme des souffrances, supprimer la misère imméritée, résoudre la délicate question de la situation économique de la femme, montrer par un grand exemple la possibilité de faire face en même temps aux nécessités politiques opposées que l’Angleterre a conciliées, parce que le problème se posait pour elle d’une manière relativement facile : voilà ce qui eût justifié la victoire, voilà ce qui l’eût maintenue. La victoire, en effet, a toujours besoin d’être légitimée par des bienfaits. La force qu’on a déchaînée devient impérieuse à son tour. Dès qu’il a reçu la première salutation impériale, le César appartient à la fatalité jusqu’à sa mort.
De ce programme, que la force des choses semblait vous imposer, qu’avez-vous réalisé ? Votre peuple est-il devenu plus heureux, plus moral, plus satisfait de son sort ? Il est clair que non ; des symptômes comme on n’en a jamais vus après la victoire se sont manifestés parmi vous. La gloire est le foin avec lequel on nourrit la bête humaine ; votre peuple en a été saturé, et il regimbe !… Napoléon Ier, en 1805-1806, avait imposé silence par l’admiration à toute voix opposante ; une centaine de personnes tout au plus murmuraient ; l’idée d’un attentat contre sa personne eût paru un non-sens. Comment se fait-il qu’au lendemain de triomphes comme on n’en avait pas vus depuis soixante ans, votre gouvernement se soit trouvé en présence d’un mécontentement profond ? Pourquoi est-il toujours préoccupé de mesures restrictives de la liberté ? D’ordinaire, on n’a pas à réprimer après la victoire ; la répression est le propre des faibles. Ce qui se passe chez vous, n’importe comment on l’explique, renferme un blâme contre vos hommes d’État. Si votre peuple est aussi mauvais qu’ils le disent, c’est leur condamnation. Apres et durs, comprenant l’État comme une chaîne et non comme quelque chose de bienveillant, ils croient connaître la nature allemande et ne connaissent pas la nature humaine. Ils ont trop compté sur la vertu germanique, ils en verront le bout. On a fait de vous une nation organisée pour la guerre ; comme ces chevaliers du XVIe siècle, bardés de fer, vous êtes écrasés par votre armement. S’imaginer qu’en continuant de subir un pareil fardeau sans en retirer aucun avantage, votre peuple aura la souplesse nécessaire pour les arts de la paix, c’est trop espérer. Ces sacrifices militaires vous mettent dans la nécessité ou de faire la guerre indéfiniment — et vous avez trop de bon sens pour ne pas voir que ces parties à la Napoléon Ier mènent aux abîmes — ou d’avoir une place désavantageuse dans la lutte pacifique de la civilisation. Les agitations socialistes sont, comme la fièvre, à la fois une maladie et un symptôme ; on doit en tenir compte ; il ne suffit pas de les étouffer, il faut en voir la cause et à quelques égards y donner satisfaction. Les erreurs populaires s’affaiblissent par la publicité ; on les fortifie en essayant de ramener le peuple à des croyances devenues sans efficacité. Vos maîtres d’école auront beau revenir au pur catéchisme, cela n’y fera rien. Les lois répressives n’y peuvent pas davantage ; on ne tue pas les mouches à coups de canon.
Et dans l’ordre politique, dans la réalisation de cet idéal de gouvernement constitutionnel qui nous est si cher à tous, quel progrès avez-vous accompli ? En quoi votre vie parlementaire a-t-elle été plus brillante, plus libre, plus féconde que celle des autres peuples ? Je n’arrive pas à le voir, et ici encore, au lieu de cette largeur libérale qui est le propre des forts, je trouve vos hommes d’État surtout préoccupés de restrictions, de répressions, de règlements coercitifs. Non, je le répète, ce n’est pas par ces moyens-là que vous séduirez le monde. La répression est chose toute négative. Et si, pendant que vos hommes d’État sont plongés dans cette ingrate besogne, le paysan français, avec son gros bon sens, sa politique peu raffinée, son travail et ses économies, réussissait à fonder une République régulière et durable ! Ce serait plaisant. L’entreprise est trop difficile et trop périlleuse pour qu’il soit permis d’en escompter le succès ; mais ce qui est incroyable est souvent ce qui arrive. Les soldats écervelés du général Custine, les grenadiers héroïques et burlesques qui semèrent à tous les vents les idées de la Révolution, ont réussi à leur manière.
La gloire nationale est un grand excitateur pour le génie national. Vous avez eu quatre-vingts ans d’un admirable mouvement littéraire, durant lequel on a vu fleurir chez vous des écrivains comparables aux plus grands des autres nations. Comment se fait-il que cette veine soit comme tarie ? Après notre âge littéraire classique du XVIIe siècle, nous avons eu le XVIIIe siècle, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, d’Alembert, Diderot, Condorcet. Où est votre continuation de Gœthe, de Schiller, de Heine ? Le talent ne vous manque certes pas ; mais il y a, selon moi, deux causes qui nuisent à votre production littéraire ; d’abord, vos charges militaires exagérées, et en second lieu, votre état social. Supposez Gœthe obligé de faire son apprentissage militaire, exposé aux gros mots de vos sergents instructeurs. Croyez-vous qu’il ne perdrait pas à cet exercice sa fleur d’élégance et de liberté ? L’homme qui a obéi est à jamais perdu pour certaines délicatesses de la vie ; il est diminué intellectuellement. Votre service militaire est une école de respect exagéré. Si Molière et Voltaire eussent traversé cette école-là, ils y auraient perdu leur fin sourire, leur malignité parfois irrévérencieuse. L’état de conscrit est funeste au génie. Vous me direz que ce régime, nous l’avons adopté de notre côté. Ce n’est peut-être pas ce que nous avons fait de mieux ; en tout cas, on ne voit guère encore venir le jour où nous serons malades par exagération du respect.
Votre état social me paraît aussi très peu favorable à la grande littérature. La littérature suppose une société gaie, brillante, facile, disposée à rire d’elle-même, où l’inégalité peut être aussi forte que l’on voudra, mais où les classes se mêlent, où tous vivent de la même vie. On me dit que vous avez fait depuis dix ans de grands progrès vers cette unité de la vie sociale ; cependant je n’en vois pas encore le principal fruit qui est une littérature commune, exprimant avec talent ou avec génie toutes les faces de l’esprit national, une littérature aimée, admirée, acceptée, discutée par tous. Je n’ignore pas les noms très honorables que vous allez me citer ; je ne peux trouver néanmoins que votre nouvel empire ait réalisé ce qu’on devait attendre d’un gouvernement concentrant en lui toutes les forces du génie allemand. C’était à vous de faire sonner bien haut le clairon de la pensée ; ces accents nouveaux qui devaient faire battre tous les cœurs, nous les attendons et nous ne voyons pas bien comment, de l’état moral que certains faits récents nous ont révélé, sortirait un mouvement de libre expansion et de chaude générosité.
Vous étiez forts et vous n’avez pas fait la liberté ! Votre campagne contre l’ultramontanisme, légitime quand elle s’est bornée à réprimer l’intolérance catholique, n’a pas fait avancer d’un pas la grande question de l’Église et de l’État. Vos ministres sont toujours restés dans le vieux système où l’État confère à l’Église des privilèges et a pour elle des exigences sans voir que ces exigences, qui ont une apparence tyrannique, sont loin d’égaler les privilèges qu’on lui accorde d’une autre main. Certes, vous n’irez pas à Canossa. Léon XIII n’est pas Grégoire VII ; c’est lui qui viendra où vous voudrez. Mais ici encore, nous attendions du grand et du neuf, et nous ne le voyons pas venir.
Je ferais sourire vos hommes d’État si je disais que votre empire, dans ces premières années qui sont toujours les plus fécondes, n’a pas non plus rempli ses devoirs envers l’humanité, et que l’avenir lui demandera compte de beaucoup de questions auxquelles il a tourné le dos comme à des rêves d’idéologues. Nos habitudes d’esprit et notre histoire nous donnent peut-être des idées fausses en ce qui concerne l’idéal d’une grande hégémonie nationale et dynastique. Nous pensons toujours à Auguste, à Louis XIV ; nous ne comprenons pas qu’on règne sur le monde sans grandeur, sans éclat, sans rechercher l’amour du monde et forcer sa reconnaissance. Une nation ou une dynastie dirigeante nous apparaît comme quelque chose de noble, de sympathique, comme une force chargée de patronner tout ce qui est beau, de favoriser le progrès de la civilisation sous toutes ses formes. Éclat, générosité, bienveillance, nous semblent des conditions nécessaires de ces grands règnes momentanés qui sont tour à tour dévolus à chaque nation. Louis XIV n’entendait pas parler d’un homme de mérite, de quelque pays qu’il fût, sans se demander : « Ne pourrais-je pas lui faire une pension ? » Il se croyait le dieu bienfaisant du monde ; l’Europe a vécu pendant cent ans de son soleil en cuivre doré. Vanité des vanités ! L’humanité est quelque chose d’assez frivole ; il faut le savoir si l’on aspire à la gagner ou à la gouverner.
Pour la gagner, il faut lui plaire ; pour lui plaire, il faut être aimable. Or, vos hommes d’État prussiens ont tous les dons, excepté celui-là. Force de volonté, application, génie contenu et obstiné, ils ne se sont montrés inférieurs pour les qualités solides à aucun des grands génies politiques du passé. Mais ils se sont trompés en se figurant qu’avec cela on peut se dispenser de plaire au monde, de le gagner par des bienfaits. Erreur ! On ne s’impose à l’humanité que par l’amour de l’humanité, par un sentiment large, libéral, sympathique, dont vos nouveaux maîtres se raillent hautement, qu’ils traitent de chimère sentimentale et prétentieuse. On ne discute pas contre des poses, contre des modes passagères ; mais il est bien permis de dire qu’une ostentation d’égoïsme et de froid calcul n’a jamais été le ton des grands hommes qui méritent de figurer au Panthéon de l’humanité.
Traitez-moi d’arriéré, mais je ne reconnaîtrai jamais comme ayant réalisé l’ancien idéal allemand ces hommes durs, étroits, détracteurs de la gloire, affectant un terre-à-terre vulgaire et positif, prétextant un dédain de la postérité qu’au fond ils n’ont pas. Dans le passage de mon discours de réception qui vous a blessés, je n’ai pas voulu dire autre chose. Le génie de l’Allemagne est grand et puissant ; il reste un des organes principaux de l’esprit humain ; mais vous l’avez mis dans un étau où il souffre. Vous êtes égarés par une école sèche et froide, qui écrase plus qu’elle ne développe. Nous sommes sûrs que vous vous retrouverez vous-mêmes, et qu’un jour nous serons de nouveau collaborateurs dans la recherche de tout ce qui peut donner de la grâce, de la gaieté, du bonheur à la vie.
16 avril 1879. (Discours et Conférences.)
Certes, il n’est pas défendu de porter envie aux âges où le problème de la fidélité était plus simple et où le devoir se bornait à servir de son mieux un pouvoir établi sur des bases indéniables. Dans les temps les plus troublés, néanmoins, le patriote libéral trouve encore moyen de contribuer au bien de la patrie. Il y aura toujours une France à aimer. Ils nous approuveraient dans nos apparentes faiblesses, ces créateurs de l’unité française qui mirent avant tout le salut de l’État. Le jour où une bande d’idiots profana le tombeau de Richelieu à la Sorbonne, le crâne de notre illustre fondateur tomba sur les dalles, et les enfants du quartier le firent rouler à terre comme un jouet. Vanité des vanités ! dira-t-on ; la voilà finie comme le reste cette pensée altière au succès de laquelle on avait fait servir tant de force, de volonté, tant de savantes combinaisons, tant de crimes. Pas si finie qu’il semble. Si cet œil éteint, où rayonna autrefois le génie, s’était rouvert à la lumière, il eût vu se dessiner sur les murailles voisines des lettres fraîchement tracées : République française, une et indivisible. Sauf un mot, c’était là ce que le grand politique avait voulu. Il n’était donc pas vaincu, malgré l’affront que des misérables faisaient à ses os.
Réponse au discours de M. Cherbuliez à l’Académie française. (Discours et Conférences.)
On raconte que quand la ville d’Antioche fut prise par les Perses sous Valérien, toute la population était rassemblée au théâtre. Les gradins de ce théâtre étaient taillés dans le pied de la montagne escarpée que couronnaient les remparts. Tous les yeux, toutes les oreilles étaient tendus vers l’acteur, quand tout à coup celui-ci se met à balbutier ; ses mains se crispent, ses bras se paralysent, ses yeux deviennent fixes. De la scène où il était, il voyait les Perses, déjà maîtres du rempart, descendre la montagne au pas de course. En même temps, les flèches commencèrent à pleuvoir dans l’enceinte du théâtre et rappelèrent les spectateurs à la réalité.
Notre situation est un peu celle de l’acteur d’Antioche, monsieur[3]. Nous voyons ce que la foule ne voit pas. Cette patrie française, construite au prix de mille ans d’héroïsme et de patience, par la bravoure des uns, par l’esprit des autres, par les souffrances de tous, nous la voyons guidée par une conscience insuffisante, qui ne sait rien d’hier et ne se doute pas de demain. Comme il arrive dans les passages difficiles de montagnes, nous voyons ce que nous avons de plus cher vaciller au bord du précipice, se balancer sur le vide, confié au pas irresponsable d’un être instinctif ! Ah ! chère patrie française ! Ceux qui tremblent sont ceux qui l’aiment. Ses vrais ennemis sont les présomptueux qui flattent ses défauts, renchérissent sur ses erreurs, et qui, sûrs d’avance de l’amnistie des imprévoyants, se montreraient, le lendemain des désastres, frais, légers, alertes, prêts à recommencer. Une nation ne peut durer si elle ne tire de son sein la quantité de raison suffisante pour prévenir les causes de ruine extérieure ou de relâchement intérieur qui la menacent. Les anciens organismes y pourvoyaient d’une manière qui ne suffisait pas toujours pour faire éviter de grandes fautes, mais qui suffisait pour assurer la continuité de l’existence. La question est de savoir si les formes nouvelles où on a renfermé la vie nationale n’amèneront pas pour le cerveau de la France de funestes moments d’étourdissement, de passagères anémies.
[3] M. Victor Cherbuliez.
Je dis passagères ; car il n’est pas possible qu’un pays qui possède dans son sein tant d’esprit, tant de cœur, tant de force de travail, une telle somme de conscience et d’honnêteté, ne surmonte pas les germes de maladie qu’il porte en lui. Les dix justes qui auraient pu sauver Sodome eussent pesé d’un poids bien léger, les jours d’élection, dans les scrutins de cette ville coupable, et pourtant, au jour solennel où l’Éternel compte les siens, ils auraient suffi pour faire absoudre la cité entière. Finissons donc par l’espérance, monsieur. Oui, nous la reverrons encore avant de mourir (vous surtout qui êtes plus jeune que moi), cette vieille France rétablie dans des conditions de vie séculaire, avec ses haines pacifiées, ses horizons rouverts, les ombres de ses victimes apaisées, ses gloires réconciliées. Nous la verrons telle qu’elle fut en ses beaux jours, forte, modérée, raisonnable, relevant le drapeau abandonné du progrès libéral, nullement corrigée de son amour désintéressé pour le bien, instruite cependant par l’expérience et attentive à éviter certaines erreurs où l’indulgence trompeuse du monde, au moins autant que ses défauts, l’avaient engagée.
Réponse au discours de M. Cherbuliez à l’Académie française. (Discours et Conférences.)
Le programme de notre compagnie[4] n’est pas une simple culture littéraire, poursuivie pour elle-même, et n’aboutissant qu’à de frivoles jeux à peine supérieurs à ces difficiles enfantillages où se sont perdues les littératures de l’Orient. Ce sont les choses qui sont belles ; les mots n’ont pas de beauté en dehors de la cause noble ou vraie qu’ils servent. Qu’importe que Tyrtée ait eu ou n’ait pas eu de talent ? Il a réussi ; il valut une armée. La Marseillaise, quoi qu’en disent les musiciens et les puristes, est le premier chant des temps modernes puisque à son jour elle entraîna les hommes et les fit vaincre. Le mérite personnel, à cette hauteur, est peu de chose ; tout dépend de la prédestination, ou, si l’on veut, du succès. Il ne sert de rien de dire qu’un général aurait dû gagner une bataille, s’il la perd. Le grand général (et on en peut dire presque autant du grand politique) est celui qui réussit, et non celui qui aurait dû réussir.
[4] L’Académie française.
Les personnes qui, un moment, ont été surprises de votre élection connaissent donc bien peu l’esprit de notre compagnie. Vous avez cultivé le plus difficile des genres, un genre depuis longtemps abandonné parmi nous, la grande action ; vous avez été du petit nombre de ceux qui ont gardé la vieille tradition française de la vie brillante, glorieuse, utile à tous. La politique et la guerre sont de trop hautes applications de l’esprit pour que nous les ayons jamais négligées. Le maréchal de Villars, le maréchal de Belle-Isle, le maréchal de Richelieu, le maréchal de Beauvau n’avaient pas plus de titres littéraires que vous. Ils avaient remporté des victoires. A défaut de ce titre, devenu rare, nous avons pris le maître par excellence en fait de difficulté vaincue, le joueur hardi qui a toujours gagné son pari dans la poursuite du probable, le virtuose qui a pratiqué avec un tel consommé le grand art perdu de la vie. Si Christophe Colomb existait chez nous de nos jours, nous le ferions membre de l’Académie. Quelqu’un qui est bien sûr d’en être, c’est le général qui nous ramènera un jour la victoire. En voilà un que nous ne chicanerons pas sur sa prose, et qui nous paraîtra tout d’abord un sujet fort académique. Comme nous le nommerons par acclamation, sans nous inquiéter de ses écrits ! Oh ! la belle séance que celle où on le recevra ! Comme les places y seront recherchées ! Heureux celui qui la présidera !…
Réponse au discours de M. de Lesseps à l’Académie française. (Discours et Conférences.)
Nous aimons trop cette vieille mère, dont nous avons sucé tous les instincts, si l’on veut toutes les erreurs, pour oser prendre avec elle le ton rogue de l’homme sûr d’avoir raison. L’amour nous rend inconséquents. Nous voyons les imprudences, et nous suivons tout de même. Il est si triste d’être plus sage que son pays. Par moments, on prend la résolution d’être ferme : on se promet, quand viendront les jours sombres, de se laver les mains des fautes qu’on a déconseillées. Eh bien, non ! quand viennent les jours sombres, on est aussi triste que ceux qui n’avaient rien prévu, et le fait d’avoir eu raison quand presque tout le monde avait tort devient une faible consolation. On ne tient pas rancune à sa patrie. Mieux vaut se tromper avec elle que d’avoir trop raison avec ceux qui lui disent de dures vérités.
La nation qui sait aimer et admirer n’est pas près de mourir. A ceux qui disent que, sous la poitrine de ce peuple, rien ne bat plus, qu’il ne sait plus adorer, que le spectacle de tant d’avortements et de déceptions a éteint en lui toute confiance dans le bien, toute foi en la grandeur, nous vous citons, chers et glorieux confrères ; nous rappelons le culte dont vous êtes l’objet, ces couronnes, ces fêtes qui n’ont coutume d’être décernées qu’à la mort, ces tressaillements de cœur, enfin, que nos foules éprouvent au nom de Victor Hugo, de Ferdinand de Lesseps. Voilà ce qui nous console, ce qui nous soutient, ce qui nous fait dire avec assurance : Pauvre et chère France, non, tu ne périras pas ; car tu aimes encore, et tu es encore aimée.
Réponse au discours de M. de Lesseps à l’Académie française. (Discours et Conférences.)
Ce qu’on appelle indulgence n’est, le plus souvent, que justice. On reproche à l’opinion sa mobilité ; hélas ! jeunes élèves[5], ce sont les choses humaines qui sont mobiles. La largeur d’esprit n’exclut pas de fortes règles de conduite. Tenez toujours invinciblement pour la légalité. Défendez jalousement votre liberté, et respectez celle des autres. Gardez l’indépendance de votre jugement ; mais n’émigrez jamais de votre patrie, ni de fait, ni de cœur. Consolez-vous en tenant ferme à quelque chose d’éternel. Tout se transformera autour de vous. Vous serez peut-être les témoins des changements les plus considérables qu’ait présentés jusqu’ici l’histoire de l’humanité. Mais il y a une chose sûre, c’est que, dans tous les états sociaux que vous pourrez traverser, il y aura du bien à faire, du vrai à chercher, une patrie à servir et à aimer.
[5] Du lycée Louis-le-Grand.
N’oubliez jamais que par votre éducation exceptionnelle, vous avez des devoirs plus stricts que les autres envers la société dont vous faites partie. Pauvre France !… Vous la verrez, j’en suis sûr, vengée, florissante, apaisée. Ayez une règle absolue : c’est de suivre la France, c’est-à-dire la légalité, malgré toutes les objections, toutes les répugnances, toutes les antipathies. Que ce soit là le panache blanc qui vous guide. Ne vous brouillez jamais avec la France. Donnez-lui toujours de bons conseils ; ne vous fâchez pas si elle ne les suit pas. Elle a peut-être eu ses raisons pour cela. Quelque chose de mystérieux agite ce peuple ; suivez-le, même quand il refuse de vous écouter, quand il s’abandonne aux plus indignes. Ne vous croyez pas obligés de prendre des airs consternés, parce que les choses ne vont pas de la façon que vous croyez la meilleure. Que de fois on arrive à se féliciter que l’avis qu’on avait émis n’ait pas été suivi et que les événements vous ait donné tort !
Discours à la distribution des prix du lycée Louis-le-Grand, 1883. (Discours et Conférences.)
Je me propose d’analyser une idée, claire en apparence, mais qui prête aux plus graves malentendus. Les formes de la société humaine sont des plus variées. Les grandes agglomérations d’hommes à la façon de la Chine, de l’Égypte, de la plus ancienne Babylonie ; — la tribu à la façon des Hébreux, des Arabes ; — la cité à la façon d’Athènes et de Sparte ; — les réunions de pays divers à la manière de l’empire achéménide, de l’empire romain, de l’empire carlovingien ; — les communautés sans patrie, maintenues par le lien religieux, comme sont celles des Israélites, des Parsis ; — les nations comme la France, l’Angleterre et la plupart des modernes autonomies européennes ; — les confédérations à la façon de la Suisse, de l’Amérique ; — des parentés comme celles que la race, ou plutôt la langue, établit entre les Germains, les Slaves ; — voilà des modes de groupements qui tous existent, ou bien ont existé, et qu’on ne saurait confondre les uns avec les autres sans les plus graves inconvénients. A l’époque de la Révolution française, on croyait que les institutions de petites villes indépendantes, telles que Sparte et Rome, pouvaient s’appliquer à nos grandes nations de trente à quarante millions d’âmes. De nos jours, on commet une erreur plus grave : on confond la race avec la nation, et l’on attribue à des groupes ethnographiques ou plutôt linguistiques, une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants. Tâchons d’arriver à quelque précision en ces questions difficiles, où la moindre confusion sur le sens des mots, à l’origine du raisonnement, peut produire à la fin les plus funestes erreurs. Ce que nous allons faire est délicat : c’est presque de la vivisection ; nous allons traiter les vivants comme d’ordinaire on traite les morts. Nous y mettrons la froideur et l’impartialité les plus absolues.
I
Depuis la fin de l’empire romain, ou, mieux, depuis la dislocation de l’empire de Charlemagne, l’Europe occidentale nous apparaît divisée en nations, dont quelques-unes, à certaines époques, ont cherché à exercer une hégémonie sur les autres, sans jamais y réussir d’une manière durable. Ce que n’ont pu Charles-Quint, Louis XIV, Napoléon Ier, personne probablement ne le pourra dans l’avenir. L’établissement d’un nouvel empire romain ou d’un nouvel empire de Charlemagne est devenu une impossibilité. La division de l’Europe est trop grande pour qu’une tentative de domination universelle ne provoque pas très vite une coalition qui fasse rentrer la nation ambitieuse dans ses bornes naturelles. Une sorte d’équilibre est établi pour longtemps. La France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie seront encore, dans des centaines d’années, et malgré les aventures qu’elles auront courues, des individualités historiques, les pièces essentielles d’un damier, dont les cases varient sans cesse, mais ne se confondent jamais tout à fait.
Les nations, entendues de cette manière, sont quelque chose d’assez nouveau dans l’histoire. L’antiquité ne les connut pas. L’Égypte, la Chine, l’antique Chaldée, ne furent à aucun degré des nations. C’était des troupeaux menés par un fils du Soleil ou un fils du Ciel. Il n’y eut pas de citoyens égyptiens, pas plus qu’il n’y a de citoyens chinois. L’antiquité classique eut des républiques et des royautés municipales, des confédérations de républiques locales, des empires ; elle n’eut guère la nation au sens où nous la comprenons. Athènes, Sparte, Sidon, Tyr sont de petits centres d’admirable patriotisme ; mais ce sont des cités avec un territoire relativement restreint. La Gaule, l’Espagne, l’Italie, avant leur absorption dans l’empire romain, étaient des ensembles de peuplades, souvent liguées entre elles, mais sans institutions centrales, sans dynasties. L’empire assyrien, l’empire persan, l’empire d’Alexandre ne furent pas non plus des patries. Il n’y eut jamais de patriotes assyriens ; l’empire persan fut une vaste féodalité. Pas une nation ne rattache ses origines à la colossale aventure d’Alexandre, qui fut cependant si riche en conséquences pour l’histoire générale de la civilisation.
L’empire romain fut bien plus près d’être une patrie. En retour de l’immense bienfait de la cessation des guerres, la domination romaine, d’abord si dure, fut bien vite aimée. Ce fut une grande association, synonyme d’ordre, de paix et de civilisation. Dans les derniers temps de l’Empire, il y eut, chez les âmes élevées, chez les évêques éclairés, chez les lettrés, un vrai sentiment de « la paix romaine », opposée au chaos menaçant de la barbarie. Mais un empire, douze fois grand comme la France actuelle, ne saurait former un État dans l’acception moderne. La scission de l’Orient et de l’Occident était inévitable. Les essais d’un empire gaulois, au IIIe siècle, ne réussirent pas. C’est l’invasion germanique qui introduisit dans le monde le principe qui, plus tard, a servi de base à l’existence des nationalités.
Que firent les peuples germaniques, en effet, depuis leurs grandes invasions du Ve siècle jusqu’aux dernières conquêtes normandes au Xe ? Ils changèrent peu le fond des races ; mais ils imposèrent des dynasties et une aristocratie militaire à des parties plus ou moins considérables de l’ancien empire d’Occident, lesquelles prirent le nom de leurs envahisseurs. De là une France, une Burgundie, une Lombardie ; plus tard, une Normandie. La rapide prépondérance que prit l’empire franc refait un moment l’unité de l’Occident ; mais cet empire se brise irrémédiablement vers le milieu du IXe siècle ; le traité de Verdun trace des divisions immuables en principe, et dès lors la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne s’acheminent par des voies, souvent détournées et à travers mille aventures, à leur pleine existence nationale, telle que nous la voyons s’épanouir aujourd’hui.
Qu’est-ce qui caractérise, en effet, ces différents États ? C’est la fusion des populations qui les composent. Dans les pays que nous venons d’énumérer, rien d’analogue à ce que vous trouverez en Turquie, où le Turc, le Slave, le Grec, l’Arménien, l’Arabe, le Syrien, le Kurde sont aussi distincts aujourd’hui qu’au jour de la conquête. Deux circonstances essentielles contribuèrent à ce résultat. D’abord le fait que les peuples germaniques adoptèrent le christianisme dès qu’ils eurent des contacts un peu suivis avec les peuples grecs et latins. Quand le vainqueur et le vaincu sont de la même religion, ou, plutôt, quand le vainqueur adopte la religion du vaincu, le système turc, la distinction absolue des hommes d’après la religion, ne peut plus se produire. La seconde circonstance fut, de la part des conquérants, l’oubli de leur propre langue. Les petits-fils de Clovis, d’Alaric, de Gondebaud, d’Alboin, de Rollon, parlaient déjà roman. Ce fait était lui-même la conséquence d’une autre particularité importante : c’est que les Francs, les Burgundes, les Goths, les Lombards, les Normands, avaient avec eux très peu de femmes de leur race. Pendant plusieurs générations, les chefs ne se marient qu’avec des femmes germaines ; mais leurs concubines sont latines, les nourrices des errants sont latines ; toute la tribu épouse des femmes latines ; ce qui fit que la lingua francie, la lingua gothica n’eurent, depuis l’établissement des Francs et des Goths en terres romaines, que de très courtes destinées. Il n’en fut pas ainsi en Angleterre ; car l’invasion anglo-saxonne avait sans doute des femmes avec elle ; la population bretonne s’enfuit, et, d’ailleurs, le latin n’était plus ou, même, ne fut jamais dominant dans la Bretagne. Si on eût généralement parlé gaulois dans la Gaule, au Ve siècle, Clovis et les siens n’eussent pas abandonné le germanique pour le gaulois.
De là ce fait capital que, malgré l’extrême violence des mœurs des envahisseurs germains, le moule qu’ils imposèrent devint, avec les siècles, le moule même de la nation. France devint très légitimement le nom d’un pays où il n’était entré qu’une imperceptible minorité de Francs. Au Xe siècle, dans les premières chansons de geste, qui sont un miroir si parfait de l’esprit du temps, tous les habitants de la France sont des Français. L’idée d’une différence de races dans la population de la France, si évidente dans Grégoire de Tours, ne se présente à aucun degré dans les écrivains et les poètes français postérieurs à Hugues Capet. La différence du noble et du vilain est aussi accentuée que possible ; mais la différence de l’un à l’autre n’est en rien une différence de race ; c’est une différence de courage, d’habitude et d’éducation transmise héréditairement ; l’idée que l’origine de tout cela soit une conquête ne vient à personne. Le faux système d’après lequel la noblesse dut son origine à un privilège conféré par le roi pour de grands services rendus à la nation, si bien que tout noble est un anobli, ce système est établi comme un dogme dès le XIIIe siècle. La même chose se passa à la suite de presque toutes les conquêtes normandes. Au bout d’une ou deux générations, les envahisseurs normands ne se distinguaient plus du reste de la population ; leur influence n’en avait pas moins été profonde ; ils avaient donné au pays conquis une noblesse, des habitudes militaires, un patriotisme qu’il n’avait pas auparavant.
L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la formation d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L’investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l’origine de toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont été le plus bienfaisantes. L’unité se fait toujours brutalement ; la réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d’une extermination et d’une terreur continuée pendant près d’un siècle. Le roi de France, qui est, si j’ose le dire, le type idéal d’un cristallisateur séculaire ; le roi de France, qui a fait la plus parfaite unité nationale qu’il y ait ; le roi de France, vu de trop près, a perdu son prestige ; la nation qu’il avait formée l’a maudit, et, aujourd’hui, il n’y a que les esprits cultivés qui sachent ce qu’il valait et ce qu’il a fait.
C’est par le contraste que ces grandes lois de l’histoire de l’Europe occidentale deviennent sensibles. Dans l’entreprise que le roi de France, en partie par sa tyrannie, en partie par sa justice, a si admirablement menée à terme, beaucoup de pays ont échoué. Sous la couronne de Saint-Étienne, les Magyars et les Slaves sont restés aussi distincts qu’ils l’étaient il y a huit cents ans. Loin de fondre les éléments divers de ses domaines, la maison de Habsbourg les a tenus distincts et souvent opposés les uns aux autres. En Bohême, l’élément tchèque et l’élément allemand sont superposés comme l’huile et l’eau dans un verre. La politique turque de la séparation des nationalités d’après la religion a eu de bien plus graves conséquences : elle a causé la ruine de l’Orient. Prenez une ville comme Salonique ou Smyrne, vous y trouverez cinq ou six communautés dont chacune a ses souvenirs et qui n’ont entre elles presque rien en commun. Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses. Aucun citoyen français ne sait s’il est Burgunde, Alain, Taïfale, Visigoth ; tout citoyen français doit avoir oublié la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIIe siècle. Il n’y a pas en France dix familles qui puissent fournir la preuve d’une origine franque, et encore une telle preuve serait-elle essentiellement défectueuse, par suite de mille croisements inconnus qui peuvent déranger tous les systèmes des généalogistes.
La nation moderne est donc un résultat historique amené par une série de faits convergeant dans le même sens. Tantôt l’unité a été réalisée par une dynastie, comme c’est le cas pour la France ; tantôt elle l’a été par la volonté directe des provinces, comme c’est le cas pour la Hollande, la Suisse, la Belgique ; tantôt par un esprit général, tardivement vainqueur des caprices de la féodalité, comme c’est le cas pour l’Italie et l’Allemagne. Toujours une profonde raison d’être a présidé à ces formations. Les principes, en pareil cas, se font jour par les surprises les plus inattendues. Nous avons vu, de nos jours, l’Italie unifiée par ses défaites, et la Turquie démolie par ses victoires. Chaque défaite avançait les affaires de l’Italie ; chaque victoire perdait la Turquie ; car l’Italie est une nation, et la Turquie, hors de l’Asie-Mineure, n’en est pas une. C’est la gloire de la France d’avoir, par la Révolution française, proclamé qu’une nation existe par elle-même. Nous ne devons pas trouver mauvais qu’on nous imite. Le principe des nations est le nôtre. Mais qu’est-ce donc qu’une nation ? Pourquoi la Hollande est-elle une nation, tandis que le Hanovre ou le grand-duché de Parme n’en sont pas une ? Comment la France persiste-t-elle à être une nation, quand le principe qui l’a créée a disparu ? Comment la Suisse, qui a trois langues, deux religions, trois ou quatre races, est-elle une nation, quand la Toscane, par exemple, qui est si homogène, n’en est pas une ? Pourquoi l’Autriche est-elle un État et non pas une nation ? En quoi le principe des nationalités diffère-t-il du principe des races ? Voilà des points sur lesquels un esprit réfléchi tient à être fixé, pour se mettre d’accord avec lui-même. Les affaires du monde ne se règlent guère par ces sortes de raisonnement ; mais les hommes appliqués veulent porter en ces matières quelque raison et démêler les confusions où s’embrouillent les esprits superficiels.
II
A entendre certains théoriciens politiques, une nation est avant tout une dynastie, représentant une ancienne conquête, acceptée d’abord, puis oubliée par la masse du peuple. Selon les politiques dont je parle, le groupement de provinces effectué par une dynastie, par ses guerres, par ses mariages, par ses traités, finit avec la dynastie qui l’a formé. Il est très vrai que la plupart des nations modernes ont été faites par une famille d’origine féodale, qui a contracté mariage avec le sol et qui a été en quelque sorte un noyau de centralisation. Les limites de la France en 1789 n’avaient rien de naturel ni de nécessaire. La large zone que la maison capétienne avait ajoutée à l’étroite lisière du traité de Verdun fut bien l’acquisition personnelle de cette maison. A l’époque où furent faites les annexions, on n’avait l’idée ni des limites naturelles, ni du droit des nations, ni de la volonté des provinces. La réunion de l’Angleterre, de l’Irlande et de l’Écosse fut de même un fait dynastique. L’Italie n’a tardé si longtemps à être une nation que parce que, parmi ses nombreuses maisons régnantes, aucune, avant notre siècle, ne se fit le centre de l’unité. Chose étrange, c’est à l’obscure île de Sardaigne, terre à peine italienne, qu’elle a pris un titre royal[6]. La Hollande, qui s’est créée elle-même, par un acte d’héroïque résolution, a néanmoins contracté un mariage intime avec la maison d’Orange, et elle courrait de vrais dangers le jour où cette union serait compromise.
[6] La maison de Savoie ne doit son titre royal qu’à la possession de la Sardaigne (1720). (Note d’E. R.)
Une telle loi, cependant, est-elle absolue ? Non, sans doute. La Suisse et les États-Unis, qui se sont formés comme des conglomérats d’additions successives, n’ont aucune base dynastique. Je ne discuterai pas la question en ce qui concerne la France. Il faudrait avoir le secret de l’avenir. Disons seulement que cette grande royauté française avait été si hautement nationale, que, le lendemain de sa chute, la nation a pu tenir sans elle. Et puis le XVIIIe siècle avait changé toute chose. L’homme était revenu, après des siècles d’abaissement, à l’esprit antique, au respect de lui-même, à l’idée de ses droits. Les mots de patrie et de citoyen avaient repris leur sens. Ainsi a pu s’accomplir l’opération la plus hardie qui ait été pratiquée dans l’histoire, opération que l’on peut comparer à ce que serait, en physiologie, la tentative de faire vivre en son identité première un corps à qui l’on aurait enlevé le cerveau et le cœur.
Il faut donc admettre qu’une nation peut exister sans principe dynastique, et même que des nations qui ont été formées par des dynasties peuvent se séparer de cette dynastie sans pour cela cesser d’exister. Le vieux principe, qui ne tient compte que du droit des princes, ne saurait plus être maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce droit national, sur quel critérium le fonder ? à quel signe le reconnaître ? de quel fait tangible le faire dériver ?
I. — De la race, disent plusieurs avec assurance. Les divisions artificielles, résultant de la féodalité, des mariages princiers, des congrès de diplomates, sont caduques. Ce qui reste ferme et fixe, c’est la race des populations. Voilà ce qui constitue un droit, une légitimité. La famille germanique, par exemple, selon la théorie que j’expose, a le droit de reprendre les membres épars du germanisme, même quand ces membres ne demandent pas à se rejoindre. Le droit du germanisme sur telle province est plus fort que le droit des habitants de cette province sur eux-mêmes. On crée ainsi une sorte de droit primordial analogue à celui des rois de droit divin ; au principe des nations on substitue celui de l’ethnographie. C’est là une très grande erreur, qui, si elle devenait dominante, perdrait la civilisation européenne. Autant le principe des nations est juste et légitime, autant celui du droit primordial des races est étroit et plein de danger pour le véritable progrès.
Dans la tribu et la cité antiques, le fait de la race avait, nous le reconnaissons, une importance de premier ordre. La tribu et la cité antiques n’étaient qu’une extension de la famille. A Sparte, à Athènes, tous les citoyens étaient parents à des degrés plus ou moins rapprochés. Il en était de même chez les Beni-Israël ; il en est encore ainsi dans les tribus arabes. D’Athènes, de Sparte, de la tribu israélite, transportons-nous dans l’empire romain. La situation est tout autre. Formée d’abord par la violence, puis maintenue par l’intérêt, cette grande agglomération de villes, de provinces absolument différentes, porte à l’idée de race le coup le plus grave. Le christianisme, avec son caractère universel et absolu, travaille plus efficacement encore dans le même sens. Il contracte avec l’empire romain une alliance intime, et, par l’effet de ces deux incomparables agents d’unification, la raison ethnographique est écartée du gouvernement des choses humaines pour des siècles.
L’invasion des barbares fut, malgré les apparences, un pas de plus dans cette voie. Les découpures de royaumes barbares n’ont rien d’ethnographique ; elles sont réglées par la force ou le caprice des envahisseurs. La race des populations qu’ils subordonnaient était pour eux la chose la plus indifférente. Charlemagne refit à sa manière ce que Rome avait déjà fait : un empire unique composé des races les plus diverses ; les auteurs du traité de Verdun, en traçant imperturbablement leurs deux grandes lignes du nord au sud, n’eurent pas le moindre souci de la race des gens qui se trouvaient à droite ou à gauche. Les mouvements de frontière qui s’opérèrent dans la suite du moyen âge furent aussi en dehors de toute tendance ethnographique. Si la politique suivie de la maison capétienne est arrivée à grouper à peu près, sous le nom de France, les territoires de l’ancienne Gaule, ce n’est pas là un effet de la tendance qu’auraient eue ces pays à se rejoindre à leurs congénères. Le Dauphiné, la Bresse, la Provence, la Franche-Comté ne se souvenaient plus d’une origine commune. Toute conscience gauloise avait péri dès le IIe siècle de notre ère, et ce n’est que par une vue d’érudition que, de nos jours, on a retrouvé rétrospectivement l’individualité du caractère gaulois.
La considération ethnographique n’a donc été pour rien dans la constitution des nations modernes. La France est celtique, ibérique, germanique. L’Allemagne est germanique, celtique et slave. L’Italie est le pays où l’ethnographie est le plus embarrassée. Gaulois, Étrusques, Pélasges, Grecs, sans parler de bien d’autres éléments, s’y croisent dans un indéchiffrable mélange. Les îles Britanniques, dans leur ensemble, offrent un mélange de sang celtique et germain dont les proportions sont singulièrement difficiles à définir.
La vérité est qu’il n’y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur une chimère. Les plus nobles pays, l’Angleterre, la France, l’Italie, sont ceux où le sang est plus mêlé. L’Allemagne fait-elle à cet égard une exception ? Est-elle un pays germanique pur ? Quelle illusion ! Tout le Sud a été gaulois. Tout l’Est, à partir de l’Elbe, est slave. Et les parties que l’on prétend réellement pures le sont-elles en effet ? Nous touchons ici à un des problèmes sur lesquels il importe le plus de se faire des idées claires et de prévenir les malentendus.
Les discussions sur les races sont interminables, parce que le mot race est pris par les historiens philologues et par les anthropologistes physiologistes dans deux sens tout à fait différents. Pour les anthropologistes, la race a le même sens qu’en zoologie, elle indique une descendance réelle, une parenté par le sang. Or l’étude des langues et de l’histoire ne conduit pas aux mêmes divisions que la physiologie. Les mots de brachycéphales, de dolichocéphales n’ont pas de place en histoire ni en philologie. Dans le groupe humain qui créa les langues et la discipline aryennes, il y avait déjà des brachycéphales et des dolichocéphales. Il en faut dire autant du groupe primitif qui créa les langues et l’institution dites sémitiques. En d’autres termes, les origines zoologiques de l’humanité sont énormément antérieures aux origines de la culture, de la civilisation, du langage. Les groupes aryen primitif, sémitique primitif, touranien primitif n’avaient aucune unité physiologique. Ces groupements sont des faits historiques qui ont eu lieu à une certaine époque, mettons il y a quinze ou vingt mille ans, tandis que l’origine zoologique de l’humanité se perd dans des ténèbres incalculables. Ce qu’on appelle philologiquement et historiquement la race germanique est sûrement une famille bien distincte dans l’espèce humaine. Mais est-ce là une famille au sens anthropologique ? Non, assurément. L’apparition de l’individualité germanique dans l’histoire ne se fait que très peu de siècles avant Jésus-Christ. Apparemment les Germains ne sont pas sortis de terre à cette époque. Avant cela, fondus avec les Slaves dans la grande masse indistincte des Scythes, ils n’avaient pas leur individualité à part. Un Anglais est bien un type dans l’ensemble de l’humanité. Or le type de ce qu’on appelle très improprement la race anglo-saxonne[7], n’est ni le Breton du temps de César, ni l’Anglo-Saxon de Hengist, ni le Danois de Knut, ni le Normand de Guillaume le Conquérant ; c’est la résultante de tout cela. Le Français n’est ni un Gaulois, ni un Franc, ni un Burgunde. Il est ce qui est sorti de la grande chaudière où, sous la présidence du roi de France, ont fermenté ensemble les éléments les plus divers. Un habitant de Jersey ou de Guernesey ne diffère en rien, pour les origines, de la population normande de la côte voisine. Au XIe siècle, l’œil le plus pénétrant n’eût pas saisi des deux côtés du canal la plus légère différence. D’insignifiantes circonstances font que Philippe-Auguste ne prend pas ces îles avec le reste de la Normandie. Séparées les unes des autres depuis près de sept cents ans, les deux populations sont devenues non seulement étrangères les unes aux autres, mais tout à fait dissemblables. La race, comme nous l’entendons, nous autres historiens, est donc quelque chose qui se fait et se défait. L’étude de la race est capitale pour le savant qui s’occupe de l’histoire de l’humanité. Elle n’a pas d’application en politique. La conscience instinctive qui a présidé à la confection de la carte d’Europe n’a tenu aucun compte de la race, et les premières nations de l’Europe sont des nations de sang essentiellement mélangé.
[7] Les éléments germaniques ne sont pas beaucoup plus considérables dans le Royaume-Uni qu’ils ne l’étaient dans la France, à l’époque où elle possédait l’Alsace et Metz. La langue germanique a dominé dans les îles Britanniques, uniquement parce que le latin n’y avait pas entièrement remplacé les idiomes celtiques, ainsi que cela eut lieu dans les Gaules. (Note d’E. R.)
Le fait de la race, capital à l’origine, va donc toujours perdant de son importance. L’histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie. La race n’y est pas tout, comme chez les rongeurs ou les félins, et on n’a pas le droit d’aller par le monde tâter le crâne des gens, puis les prendre à la gorge en leur disant : « Tu es de notre sang ; tu nous appartiens ! » En dehors des caractères anthropologiques, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont les mêmes pour tous. Tenez, cette politique ethnographique n’est pas sûre. Vous l’exploitez aujourd’hui contre les autres ; puis vous la voyez se tourner contre vous-mêmes. Est-il certain que les Allemands, qui ont élevé si haut le drapeau de l’ethnographie, ne verront pas les Slaves venir analyser, à leur tour, les noms des villages de la Saxe et de la Lusace, rechercher les traces des Wiltzes ou des Obotrites, et demander compte des massacres et des ventes en masse que les Othons firent de leurs aïeux ? Pour tous il est bon de savoir oublier.
J’aime beaucoup l’ethnographie ; c’est une science d’un rare intérêt ; mais, comme je la veux libre, je la veux sans application politique. En ethnographie, comme dans toutes les études, les systèmes changent ; c’est la condition du progrès. Les nations changeraient donc aussi avec les systèmes ? Les limites des États suivraient les fluctuations de la science. Le patriotisme dépendrait d’une dissertation plus ou moins paradoxale. On viendrait dire au patriote : « Vous vous trompiez ; vous versiez votre sang pour telle ou telle cause ; vous croyiez être Celte ; non, vous êtes Germain. » Puis, dix ans après, on viendra vous dire que vous êtes Slave. Pour ne pas fausser la science, dispensons-la de donner un avis dans ces problèmes, où sont engagés tant d’intérêts. Soyez sûrs que, si on la charge de fournir des éléments à la diplomatie, on la surprendra bien des fois en flagrant délit de complaisance. Elle a mieux à faire : demandons-lui tout simplement la vérité.
II. — Ce que nous venons de dire de la race, il faut le dire de la langue. La langue invite à se réunir ; elle n’y force pas. Les États-Unis et l’Angleterre, l’Amérique espagnole et l’Espagne parlent la même langue et ne forment pas une seule nation. Au contraire, la Suisse, si bien faite, puisqu’elle a été faite par l’assentiment de ses différentes parties, compte trois ou quatre langues. Il y a dans l’homme quelque chose de supérieur à la langue : c’est la volonté. La volonté de la Suisse d’être unie, malgré la variété de ses idiomes, est un fait bien plus important qu’une similitude de langage souvent obtenue par des vexations.
Un fait honorable pour la France, c’est qu’elle n’a jamais cherché à obtenir l’unité de la langue par des mesures de coercition. Ne peut-on pas avoir les mêmes sentiments et les mêmes pensées, aimer les mêmes choses en des langages différents ? Nous parlions tout à l’heure de l’inconvénient qu’il y aurait à faire dépendre la politique internationale de l’ethnographie. Il n’y en aurait pas moins à la faire dépendre de la philologie comparée. Laissons à ces intéressantes études l’entière liberté de leurs discussions ; ne les mêlons pas à ce qui en altérerait la sérénité. L’importance politique qu’on attache aux langues vient de ce qu’on les regarde comme des signes de race. Rien de plus faux. La Prusse, où l’on ne parle plus qu’allemand, parlait slave il y a quelques siècles ; le pays de Galles parle anglais ; la Gaule et l’Espagne parlent l’idiome primitif d’Albe la Longue ; l’Égypte parle arabe ; les exemples sont innombrables. Même aux origines, la similitude de langage n’entraînait pas la similitude de race. Prenons la tribu proto-aryenne ou proto-sémite ; il s’y trouvait des esclaves qui parlaient la même langue que leurs maîtres ; or l’esclave était alors bien souvent d’une race différente de celle de son maître. Répétons-le : ces divisions de langues indo-européennes, de sémitiques et autres, créées avec une si admirable sagacité par la philologie comparée, ne coïncident pas avec les divisions de l’anthropologie. Les langues sont des formations historiques, qui indiquent peu de choses sur le sang de ceux qui les parlent, et qui, en tout cas, ne sauraient enchaîner la liberté humaine, quand il s’agit de déterminer la famille avec laquelle on s’unit pour la vie et pour la mort.
Cette considération exclusive de la langue a, comme l’attention trop forte donnée à la race, ses dangers, ses inconvénients. Quand on y met de l’exagération, on se renferme dans une culture déterminée, tenue pour nationale ; on se limite, on se claquemure. On quitte le grand air qu’on respire dans le vaste champ de l’humanité pour s’enfermer dans des conventicules de compatriotes. Rien de plus mauvais pour l’esprit ; rien de plus fâcheux pour la civilisation. N’abandonnons pas ce principe fondamental, que l’homme est un être raisonnable et moral, avant d’être parqué dans telle ou telle langue, avant d’être un membre de telle ou telle race, un adhérent de telle ou telle culture. Avant la culture française, la culture allemande, la culture italienne, il y a la culture humaine. Voyez les grands hommes de la Renaissance ; ils n’étaient ni Français, ni Italiens, ni Allemands. Ils avaient retrouvé, par leur commerce avec l’antiquité, le secret de l’éducation véritable de l’esprit humain, et ils s’y dévouaient corps et âme. Comme ils firent bien !
III. — La religion ne saurait non plus offrir une base suffisante à l’établissement d’une nationalité moderne. A l’origine, la religion tenait à l’existence même du groupe social. Le groupe social était une extension de la famille. La religion, les rites étaient des rites de famille. La religion d’Athènes, c’était le culte d’Athènes même, de ses fondateurs mythiques, de ses lois, de ses usages. Elle n’impliquait aucune théologie dogmatique. Cette religion était, dans toute la force du terme, une religion d’État. On n’était pas Athénien si on refusait de la pratiquer. C’était au fond le culte de l’Acropole personnifiée. Jurer sur l’autel d’Aglaure[8], c’était prêter le serment de mourir pour la patrie. Cette religion était l’équivalent de ce qu’est chez nous l’acte de tirer au sort, ou le culte du drapeau. Refuser de participer à un tel culte était comme serait dans nos sociétés modernes refuser le service militaire. C’était déclarer qu’on n’était pas Athénien. D’un autre côté, il est clair qu’un tel culte n’avait pas de sens pour celui qui n’était pas d’Athènes ; aussi n’exerçait-on aucun prosélytisme pour forcer ces étrangers à l’accepter ; les esclaves d’Athènes ne le pratiquaient pas. Il en fut de même dans quelques petites républiques du moyen âge. On n’était pas bon Vénitien si l’on ne jurait point par saint Marc ; on n’était pas bon Amalfitain si l’on ne mettait pas saint André au-dessus de tous les autres saints du paradis. Dans ces petites sociétés, ce qui a été plus tard persécution, tyrannie, était légitime, et tirait aussi peu à conséquence que le fait chez nous de souhaiter la fête au père de famille et de lui adresser des vœux au premier jour de l’an.
[8] Aglaure, c’est l’Acropole elle-même, qui s’est dévouée pour sauver la patrie. (Note d’E. R.)
Ce qui était vrai à Sparte, à Athènes, ne l’était déjà plus dans les royaumes sortis de la conquête d’Alexandre, ne l’était surtout plus dans l’empire romain. Les persécutions d’Antiochus Épiphane pour amener l’Orient au culte de Jupiter Olympien, celles de l’empire romain pour maintenir une prétendue religion d’État furent une faute, un crime, une véritable absurdité. De nos jours, la situation est parfaitement claire. Il n’y a plus de masses croyant d’une manière uniforme. Chacun croit et pratique à sa guise, ce qu’il peut, comme il veut. Il n’y a plus de religion d’État ; on peut être Français, Anglais, Allemand, en étant catholique, protestant, israélite, en ne pratiquant aucun culte. La religion est devenue chose individuelle ; elle regarde la conscience de chacun. La division des nations en catholiques, protestantes, n’existe plus. La religion, qui, il y a cinquante-deux ans, était un élément si considérable dans la formation de la Belgique, garde toute son importance dans le for intérieur de chacun ; mais elle est sortie presque entièrement des raisons qui tracent les limites des peuples.
IV. — La communauté des intérêts est assurément un lien puissant entre les hommes. Les intérêts, cependant, suffisent-ils à faire une nation ? Je ne le crois pas. La communauté des intérêts fait les traités de commerce. Il y a dans la nationalité un côté de sentiment ; elle est âme et corps tout à la fois ; un Zollverein n’est pas une patrie.
V. — La géographie, ce qu’on appelle les frontières naturelles, a certainement une part considérable dans la division des nations. La géographie est un des acteurs essentiels de l’histoire. Les rivières ont conduit les races, les montagnes les ont arrêtées. Les premières ont favorisé, les secondes ont limité les mouvements historiques. Peut-on dire cependant, comme le croient certains partis, que les limites d’une nation sont écrites sur la carte et que cette nation a le droit de s’adjuger ce qui est nécessaire pour arrondir certains contours, pour atteindre telle montagne, telle rivière, à laquelle on prête une sorte de faculté limitante a priori. Je ne connais pas de doctrine plus arbitraire ni plus funeste. Avec cela, on justifie toutes les violences. Et, d’abord, sont-ce les montagnes ou bien sont-ce les rivières qui forment ces prétendues frontières naturelles ? Il est incontestable que les montagnes séparent ; mais les fleuves réunissent plutôt. Et puis toutes les montagnes ne sauraient découper des États. Quelles sont celles qui séparent et celles qui ne séparent pas ? De Biarritz à Tornea, il n’y a pas une embouchure de fleuve qui ait plus qu’une autre un caractère bornal. Si l’histoire l’avait voulu, la Loire, la Seine, la Meuse, l’Elbe, l’Oder auraient, autant que le Rhin, ce caractère de frontière naturelle qui a fait commettre tant d’infractions au droit fondamental, qui est la volonté des hommes. On parle de raisons stratégiques. Rien n’est absolu ; il est clair que bien des concessions doivent être faites à la nécessité. Mais il ne faut pas que ces concessions aillent trop loin. Autrement, tout le monde réclamera ses convenances militaires, et ce sera la guerre sans fin. Non, ce n’est pas la terre plus que la race qui fait une nation. La terre fournit le substratum, le champ de la lutte et du travail ; l’homme fournit l’âme. L’homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu’on appelle un peuple. Rien de matériel n’y suffit. Une nation est un principe spirituel, résultant des complications profondes de l’histoire, une famille spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol.
Nous venons de voir ce qui ne suffit pas à créer un tel principe spirituel : la race, la langue, les intérêts, l’affinité religieuse, la géographie, les nécessités militaires. Que faut-il donc en plus ? Par suite de ce qui a été dit antérieurement, je n’aurai pas désormais à retenir bien longtemps votre attention.
III
Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu’on a consentis, des maux qu’on a soufferts. On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on transmet. Le chant spartiate : « Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes » est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute patrie.
Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l’avenir un même programme à réaliser ; avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques ; voilà ce que l’on comprend malgré les diversités de race et de langue. Je disais tout à l’heure : « avoir souffert ensemble » ; oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes ; car ils imposent des devoirs ; ils commandent l’effort en commun.
Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l’ordre d’idées que je vous soumets, une nation n’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une province : « Tu m’appartiens, je te prends. » Une province, pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu’un en cette affaire a droit d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a jamais un véritable intérêt à s’annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir.
Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t-il, après cela ? Il reste l’homme, ses désirs, ses besoins. La sécession, me direz-vous, et, à la longue, l’émiettement des nations, sont la conséquence d’un système qui met ces vieux organismes à la merci de volontés souvent peu éclairées. Il est clair qu’en pareille matière aucun principe ne doit être poussé à l’excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que dans leur ensemble et d’une façon très générale. Les volontés humaines changent ; mais qu’est-ce qui ne change pas ici-bas ? Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons. A l’heure présente, l’existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n’avait qu’une loi et qu’un maître.
Par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l’œuvre commune de la civilisation ; toutes apportent une note à ce grand concert de l’humanité, qui, en somme, est la plus haute réalité idéale que nous atteignions. Isolées, elles ont leurs parties faibles. Je me dis souvent qu’un individu qui aurait les défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui se nourrirait de vaine gloire, qui serait à ce point jaloux, égoïste, querelleur, qui ne pourrait rien supporter sans dégainer, serait le plus insupportable des hommes. Mais toutes ces dissonances de détail disparaissent dans l’ensemble. Pauvre humanité ! que tu as souffert ! que d’épreuves t’attendent encore ! Puisse l’esprit de sagesse te guider pour te préserver des innombrables dangers dont ta route est semée !
Je me résume, messieurs. L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation. Tandis que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu’exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le droit d’exister. Si des doutes s’élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d’avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre-à-terre. « Consulter les populations, fi donc ! quelle naïveté ! Voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d’une simplicité enfantine. » — Attendons, messieurs ; laissons passer le règne des transcendants ; sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques. Le moyen d’avoir raison dans l’avenir, est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé.
Conférence faite en Sorbonne le 11 mars 1882. (Discours et Conférences.)
Or, à cette époque[9], la France avait bien réellement une religion, c’était le libéralisme, le goût du développement noble de l’humanité, l’estime et la sympathie pour tout ce qui porte les traits de l’homme, la sympathie pour tout ce qui est faible, persécuté, pour tout ce qui essaie de se monter ou de s’affranchir. Naïfs que nous étions ! Nous ne pensions pas que ceux que notre pays aidait le plus à sortir des limbes lui diraient bientôt, comme les rieurs du Calvaire : « Il a délivré les autres et il ne peut se sauver lui-même. Qu’il s’en tire maintenant s’il peut ! » Madame Cornu, indifférente pour l’ingratitude qui ne concernait qu’elle, mais moins indulgente pour l’ingratitude envers les autres, ne pouvait se rappeler sans amertume combien elle avait vu de récents parvenus autrefois suppliants et heureux d’être obligés. Les expériences nous corrigeront-elles et nous feront-elles renoncer à de vieilles vertus dont on réussira bien, à la longue, à déshabituer le monde ? C’est peu probable. Nous sommes trop vieux pour suivre les maximes que semblent vouloir inaugurer les nouveaux maîtres de la mode. Si vraiment le dernier mot de la sagesse et du progrès, c’est de faire fi des droits de l’homme et des droits des peuples, de traiter de chimère toute chevalerie, toute générosité, toute reconnaissance entre les nations, de substituer à notre simple et claire notion de la liberté je ne sais quelles subtilités au moyen desquelles on prouve que la liberté consiste à être aussi gouverné que possible pour son bien, oui, nous aimons mieux être des arriérés que de servir ce progrès-là. Sachons attendre, un jour on nous regrettera. A une maîtresse capricieuse, qui parfois l’agaçait, toujours l’amusait, le monde a préféré un maître. Qu’il fasse l’expérience. Pour nous, restons obstinément libéraux, même envers ceux qui ne le sont pas ; disons comme la Pauline de Corneille :
[9] Vers 1860. Madame Hortense Cornu, sur qui Renan écrivit cet article nécrologique, amie d’enfance de l’empereur Napoléon III, avait, à cette époque, une influence très grande dans le monde politique et intellectuel. Née à Paris le 8 avril 1809, Hortense Albine Lacroix, qui épousa le peintre Sébastien Cornu, mourut à Longpont le 10 juin 1875.
Article sur madame Hortense Cornu. (Feuilles détachées, 1892.)
J’avais fait le rêve de ma vie de travailler, dans la faible mesure de mes forces, à l’alliance intellectuelle, morale et politique de l’Allemagne et de la France, alliance entraînant celle de l’Angleterre, et constituant une force capable de gouverner le monde, c’est-à-dire de le diriger dans la voie de la civilisation libérale, à égale distance des empressements naïvement aveugles de la démocratie et des puériles velléités de retour à un passé qui ne saurait revivre. Ma chimère, je l’avoue, est détruite pour jamais. Un abîme est creusé entre la France et l’Allemagne ; des siècles ne le combleront pas. La violence faite à l’Alsace et à la Lorraine restera longtemps une plaie béante ; la prétendue garantie de paix rêvée par les journalistes et les hommes d’État de l’Allemagne sera une garantie de guerres sans fin.
L’Allemagne avait été ma maîtresse ; j’avais la conscience de lui devoir ce qu’il y a de meilleur en moi. Qu’on juge de ce que j’ai souffert, quand j’ai vu la nation qui m’avait enseigné l’idéalisme railler tout idéal, quand la patrie de Kant, de Fichte, de Herder, de Gœthe s’est mise à suivre uniquement les visées du patriotisme exclusif, quand le peuple que j’avais toujours présenté à mes compatriotes comme le plus moral et le plus cultivé s’est montré à nous sous la forme de soldats ne différant en rien des soudards de tous les temps, méchants, voleurs, ivrognes, démoralisés, pillant comme du temps de Waldstein ; enfin, quand la noble révoltée de 1813, la nation qui souleva l’Europe au nom de la « générosité », a hautement repoussé de la politique toute considération de générosité, a posé en principe que le devoir d’un peuple est d’être positif, égoïste, a traité de crime la touchante folie d’une pauvre nation, trahie par le sort et par ses souverains, nation superficielle, dénuée de sens politique, je l’avoue, mais dont l’unique faute est d’avoir tenté étourdiment une expérience (celle du suffrage universel) dont aucun autre peuple ne se tirera mieux qu’elle. L’Allemagne présentant au monde le devoir comme ridicule, la lutte pour la patrie comme criminelle, quelle triste désillusion pour ceux qui avaient cru voir dans la culture allemande un avenir de civilisation générale ! Ce que nous aimions dans l’Allemagne, sa largeur, sa haute conception de la raison et de l’humanité, n’existe plus. L’Allemagne n’est plus qu’une nation ; elle est à l’heure qu’il est la plus forte des nations ; mais on sait ce que durent ces hégémonies et ce qu’elles laissent après elles. Une nation qui se renferme dans la pure considération de son intérêt n’a plus de rôle général. Un pays n’exerce une maîtrise que par les côtés universels de son génie ; patriotisme est le contraire d’influence morale et philosophique. Nous tous qui avons passé notre vie à nous garder des erreurs du chauvinisme français, comment veut-on que nous épousions les étroites pensées d’un chauvinisme étranger, tout aussi injuste, tout aussi intolérant que le chauvinisme français ? L’homme peut s’élever au-dessus des préjugés de sa nation ; mais erreur pour erreur, il préférera toujours les préjugés patriotiques à ceux qui se présentent comme de menaçantes insultes ou d’injustes dénigrements.
Nul plus que moi n’a toujours rendu justice aux grandes qualités de la race allemande, à ce sérieux, à ce savoir, à cette application, qui suppléent presque au génie et valent mille fois mieux que le talent, à ce sentiment du devoir, que je préfère beaucoup au mobile de vanité et d’honneur qui fait notre force et notre faiblesse. Mais l’Allemagne ne peut se charger de l’œuvre tout entière de l’humanité. L’Allemagne ne fait pas de choses désintéressées pour le reste du monde. Très noble est le libéralisme allemand, se proposant pour objet moins l’égalité des classes que la culture et l’élévation de la nature humaine en général ; mais les droits de l’homme sont bien aussi quelque chose ; or c’est notre philosophie du XVIIIe siècle, c’est notre Révolution qui les ont fondés. La réforme luthérienne n’a été faite que pour les pays germaniques ; l’Allemagne n’a jamais eu l’analogue de nos attachements chevaleresques pour la Pologne, pour l’Italie. La nature allemande, d’ailleurs, semble contenir les deux pôles opposés : l’Allemand doux, obéissant, respectueux, résigné ; l’Allemand ne connaissant que la force, le chef au commandement inexorable et dur, le vieil homme de fer enfin ; jura negat sibi nata. On peut dire qu’il n’y a rien au monde de meilleur que l’Allemand moral, et rien de plus méchant que l’Allemand démoralisé. Si les masses sont chez nous moins susceptibles de discipline qu’en Allemagne, les classes intermédiaires sont moins capables de vilenie ; disons à l’honneur de la France que, pendant toute la dernière guerre, il a été presque impossible de trouver un Français pour jouer passablement le rôle d’espion ; le mensonge, la basse rouerie nous répugnent trop.
La grande supériorité de l’Allemagne est dans l’ordre intellectuel ; mais que là encore elle ne se figure pas tout posséder. Le tact, le charme lui manquent. L’Allemagne a beaucoup à faire pour avoir une société française du XVIIe et du XVIIIe siècle, des gentilshommes comme La Rochefoucauld, Saint-Simon, Saint-Évremond, des femmes comme madame de Sévigné, mademoiselle de la Vallière, Ninon de Lenclos. Même de nos jours, l’Allemagne a-t-elle un poète comme M. Victor Hugo, un prosateur comme madame Sand, un critique comme M. Sainte-Beuve, une imagination comme celle de M. Michelet, un caractère philosophique comme celui de M. Littré ? C’est aux connaisseurs des autres nations à répondre. Nous récusons seulement les jugements injustes de ceux qui ne veulent connaître la France contemporaine que par sa basse presse, par sa petite littérature, par ces mauvais petits théâtres dont le sot esprit, aussi peu français que possible, est le fait d’étrangers et en partie d’Allemands. Si l’on jugeait de l’Allemagne par ses journaux de bas étage, on la jugerait aussi fort mal. Quel plaisir peut-on trouver à se nourrir ainsi d’idées fausses, d’appréciations haineuses et de partialité ? On aura beau dire, le monde sans la France sera aussi défectueux qu’il le serait si la France était le monde entier ; un plat de sel n’est rien, mais un plat sans sel est bien fade. Le but de l’humanité est supérieur au triomphe de telle ou telle race ; toutes les races y servent ; toutes ont à leur manière une mission à remplir.
La Réforme intellectuelle et morale. (1871, Préface.)
L’imprévu est grand dans les choses humaines, et la France se plaît souvent à déjouer les calculs les mieux raisonnés. Étrange, parfois lamentable, la destinée de notre pays n’est jamais vulgaire. S’il est vrai que c’est le patriotisme français qui, à la fin du dernier siècle, a réveillé le patriotisme allemand, il sera peut-être vrai aussi de dire que le patriotisme allemand aura réveillé le patriotisme français sur le point de s’éteindre. Ce retour vers les questions nationales apporterait pour quelques années un temps d’arrêt aux questions sociales. Ce qui s’est passé depuis trois mois, la vitalité que la France a montrée après l’effroyable syncope morale du 18 mars, sont des faits très consolants. On se prend souvent à craindre que la France et même l’Angleterre, au fond travaillée du même mal que nous (l’affaiblissement de l’esprit militaire, la prédominance des considérations commerciales et industrielles), ne soient bientôt réduites à un rôle secondaire, et que la scène du monde européen n’en vienne à être uniquement occupée par deux colosses, la race germanique et la race slave, qui ont gardé la vigueur du principe militaire et monarchique, et dont la lutte remplira l’avenir. Mais on peut affirmer aussi que, dans un sens supérieur, la France aura sa revanche. On reconnaîtra un jour qu’elle était le sel de la terre, et que sans elle le festin de ce monde sera peu savoureux. On regrettera cette vieille France libérale, qui fut impuissante, imprudente, je l’avoue, mais qui aussi fut généreuse, et dont on dira un jour comme des chevaliers de l’Arioste :
O ! gran bontà de’ cavalieri antichi !
Quand les vainqueurs du jour auront réussi à rendre le monde positif, égoïste, étranger à tout autre mobile que l’intérêt, aussi peu sentimental que possible, on trouvera qu’il fut heureux cependant pour l’Amérique que le marquis de Lafayette ait pensé autrement ; qu’il fut heureux pour l’Italie que, même à notre plus triste époque, nous ayons été capables d’une généreuse folie ; qu’il fut heureux pour la Prusse qu’en 1865, aux plans confus qui remplissaient la tête de l’empereur, se soit mêlée une vue de philosophie politique élevée.
Ne jamais trop espérer, ne jamais désespérer, doit être notre devise. Souvenons-nous que la tristesse seule est féconde en grandes choses, et que le vrai moyen de relever notre pauvre pays, c’est de lui montrer l’abîme où il est. Souvenons-nous surtout que les droits de la patrie sont imprescriptibles, et que le peu de cas qu’elle fait de nos conseils ne nous dispense pas de les lui donner. L’émigration à l’extérieur ou à l’intérieur est la plus mauvaise action qu’on puisse commettre. L’empereur romain qui, au moment de mourir, résumait son opinion sur la vie par ces mots : Nil expedit, n’en donnait pas moins pour mot d’ordre à ses officiers : Laboremus.
La réforme intellectuelle et morale.
Une chose connue de tout le monde est la facilité avec laquelle notre pays se réorganise. Des faits récents ont prouvé combien la France a été peu atteinte dans sa richesse. Quant aux pertes d’hommes, s’il était permis de parler d’un pareil sujet avec une froideur qui a l’air cruel, je dirais qu’elles sont à peine sensibles. Une question se pose donc à tout esprit réfléchi. Que va faire la France ? Va-t-elle se remettre sur la pente d’affaiblissement national et de matérialisme politique où elle était engagée avant la guerre de 1870, ou bien va-t-elle réagir énergiquement contre la conquête étrangère, répondre à l’aiguillon qui l’a piquée au vif, et, comme l’Allemagne de 1807, prendre dans sa défaite le point de départ d’une ère de rénovation ? — La France est très oublieuse. Si la Prusse n’avait pas exigé de cessions territoriales, je n’hésiterais pas à répondre que le mouvement industriel, économique, socialiste eût repris son cours ; les pertes d’argent eussent été réparées au bout de quelques années ; le sentiment de la gloire militaire et de la vanité nationale se fût perdu de plus en plus. Oui, l’Allemagne avait entre les mains après Sedan le plus beau rôle de l’histoire du monde. En restant sur sa victoire, en ne faisant violence à aucune partie de la population française, elle enterrait la guerre pour l’éternité, autant qu’il est permis de parler d’éternité, quand il s’agit des choses humaines. Elle n’a pas voulu de ce rôle ; elle a pris violemment deux millions de Français, dont une très petite fraction peut être supposée consentante à une telle séparation. Il est clair que tout ce qui reste de patriotisme français n’aura de longtemps qu’un objectif, regagner les provinces perdues. Ceux même qui sont philosophes avant d’être patriotes ne pourront être insensibles au cri de deux millions d’hommes, que nous avons été obligés de jeter à la mer pour sauver le reste des naufragés, mais qui étaient liés avec nous pour la vie et pour la mort. La France a donc là une pointe d’acier enfoncée en sa chair, qui ne la laissera plus dormir. Mais quelle voie va-t-elle suivre dans l’œuvre de sa réforme ? En quoi sa renaissance ressemblera-t-elle à tant d’autres tentatives de résurrection nationale ? Quelle y sera la part de l’originalité française ? C’est ce qu’il faut rechercher, en tenant a priori pour probable qu’une conscience aussi impressionnable que la conscience française aboutira, sous l’étreinte de circonstances uniques, aux manifestations les plus inattendues.
La réforme intellectuelle et morale.
La France n’a pas perdu le sceptre de l’esprit, du goût, de l’art délicat, de l’atticisme ; longtemps encore, elle fixera l’attention de l’humanité civilisée, et posera l’enjeu sur lequel le public européen engagera ses paris. Les affaires de la France sont de telle nature qu’elles divisent et passionnent les étrangers autant et souvent plus que les affaires de leur propre pays. Le grand inconvénient de son état politique, c’est l’imprévu ; mais l’imprévu est à double face : à côté des mauvaises chances, il y a les bonnes, et nous ne serions nullement surpris qu’après de déplorables aventures, la France traversât des années d’un singulier éclat. Si, lasse enfin d’étonner le monde, elle voulait prendre son parti d’une sorte d’apaisement politique, quelle ample et glorieuse revanche elle pourrait prendre dans les voies de l’activité privée ! Comme elle saurait rivaliser avec l’Angleterre dans la conquête pacifique du globe et dans l’assujettissement de toutes les races inférieures ! La France peut tout, excepté être médiocre. Ce qu’elle souffre, en somme, elle le souffre pour avoir trop osé contre les dieux. Quels que soient les malheurs que l’avenir lui réserve, et dût le sort du Français, comme celui du Grec, du Juif, de l’Italien, exciter un jour la pitié du monde et presque son sourire, le monde n’oubliera point que, si la France est tombée dans cet abîme de misère, c’est pour avoir fait d’audacieuses expériences dont tous profitent, pour avoir aimé la justice jusqu’à la folie, pour avoir admis avec une généreuse imprudence la possibilité d’un idéal que les misères de l’humanité ne comportent pas.
La Monarchie constitutionnelle en France, 1869. (La Réforme intellectuelle et morale.)
La disparition de la France du nombre des grandes puissances serait la fin de l’équilibre européen. J’ose dire que l’Angleterre en particulier sentirait, le jour où un tel événement viendrait à se produire, les conditions de son existence toutes changées. La France est une des conditions de la prospérité de l’Angleterre. L’Angleterre, selon la grande loi qui veut que la race primitive d’un pays prenne à la longue le dessus sur toutes les invasions, devient chaque jour plus celtique et moins germanique ; dans la grande lutte des races, elle est avec nous ; l’alliance de la France et de l’Angleterre est fondée pour des siècles. Que l’Angleterre porte sa pensée du côté des États-Unis, de Constantinople, de l’Inde ; elle verra qu’elle a besoin de la France et d’une France forte.
Il ne faut pas s’y tromper en effet : une France faible et humiliée ne saurait exister. Que la France perde l’Alsace et la Lorraine, et la France n’est plus. L’édifice est si compact, que l’enlèvement d’une ou deux grosses pierres le ferait crouler. L’histoire naturelle nous apprend que l’animal dont l’organisation est très centralisée ne souffre pas l’amputation d’un membre important ; on voit souvent un homme à qui l’on coupe une jambe mourir de phtisie ; de même la France atteinte dans ses parties principales verrait sa vie générale s’éteindre et ses organes du centre insuffisants pour renvoyer la vie jusqu’aux extrémités.
La Guerre entre la France et l’Allemagne. (La Réforme intellectuelle et morale.)
Le patriote allemand, comme le patriote italien, ne se détache pas facilement du vieux rôle universel de sa patrie. Certains Italiens rêvent encore le primato ; un très grand nombre d’Allemands rattachent leurs aspirations au souvenir du saint-empire, exerçant sur tout le monde européen une sorte de suzeraineté. Or la première condition d’un esprit national est de renoncer à toute prétention de rôle universel, le rôle universel étant destructeur de la nationalité. Plus d’une fois le patriotisme allemand s’est montré de la sorte injuste et partial. Ce théoricien de l’unité allemande qui soutient que l’Allemagne doit reprendre partout les débris de son vieil empire refuse d’écouter aucune raison quand on lui parle d’abandonner un pays aussi purement slave que le grand-duché de Posen[10]. Le vrai, c’est que le principe des nationalités doit être entendu d’une façon large, sans subtilités. L’histoire a tracé les frontières des nations d’une manière qui n’est pas toujours la plus naturelle ; chaque nation a du trop, du trop peu ; il faut se tenir à ce que l’histoire a fait et au vœu des provinces, pour éviter d’impossibles analyses, d’inextricables difficultés.
[10] La possession de Posen par la Prusse ne saurait en aucune manière être assimilée à la possession de l’Alsace par la France. L’Alsace est francisée et ne proteste plus contre son annexion, tandis que Posen n’est pas germanisé et proteste. Le parallèle de l’Alsace est la Silésie, province slave de race et de langue, mais suffisamment germanisée, et dont personne ne conteste plus la légitime propriété à la Prusse. (Note d’E. R.)
La Guerre entre la France et l’Allemagne. (La Réforme intellectuelle et morale.)
Une intervention de l’Europe assurant à l’Allemagne l’entière liberté de ses mouvements intérieurs, maintenant les limites fixées en 1815 et défendant à la France d’en rêver d’autres, laissant la France vaincue, mais fière dans son intégrité, la livrant au souvenir de ses fautes et la laissant se dégager en toute liberté et comme elle l’entendrait de l’étrange situation intérieure qu’elle s’est faite, telle est la solution que doivent, selon nous, désirer les amis de l’humanité et de la civilisation. Non seulement cette solution mettrait fin à l’horrible déchirement qui trouble en ce moment la famille européenne, elle renfermerait de plus le germe d’un pouvoir destiné à exercer sur l’avenir l’action la plus bienfaisante.
Comment en effet un effroyable événement comme celui qui laissera autour de l’année 1870 un souvenir de terreur a-t-il été possible ? Parce que les diverses nations européennes sont trop indépendantes les unes des autres et n’ont personne au-dessus d’elles, parce qu’il n’y a ni congrès, ni diète, ni tribunal amphictyonique qui soient supérieurs aux souverainetés nationales. Un tel établissement existe à l’état virtuel, puisque l’Europe, surtout depuis 1814, a fréquemment agi en son nom collectif, appuyant ses résolutions de la menace d’une coalition ; mais ce pouvoir central n’a pas été assez fort pour empêcher des guerres terribles. Il faut qu’il le devienne. Le rêve des utopistes de la paix, un tribunal sans armée pour appuyer ses décisions, est une chimère ; personne ne lui obéira. D’un autre côté, l’opinion selon laquelle la paix ne serait assurée que le jour où une nation aurait sur les autres une supériorité incontestée est l’inverse de la vérité ; toute nation exerçant l’hégémonie prépare par cela seul sa ruine en amenant la coalition de tous contre elle. La paix ne peut être établie et maintenue que par l’intérêt commun de l’Europe, ou, si l’on aime mieux, par la ligue des neutres passant à une attitude comminatoire. La justice entre deux parties contendantes n’a aucune chance de triompher ; mais entre dix parties contendantes la justice l’emporte, car il n’y a qu’elle qui offre une base commune d’entente, un terrain commun. La force capable de maintenir contre le plus puissant des États une décision jugée utile au salut de la famille européenne réside donc uniquement dans le pouvoir d’intervention, de médiation, de coalition des divers États. Espérons que ce pouvoir, prenant des formes de plus en plus concrètes et régulières, amènera dans l’avenir un vrai congrès, périodique, sinon permanent, et sera le cœur d’États-Unis d’Europe liés entre eux par un pacte fédéral. Aucune nation alors n’aura le droit de s’appeler « la grande nation », mais il sera loisible à chacune d’être une grande nation, à condition que ce titre elle l’attende des autres et ne prétende pas se le décerner. C’est à l’histoire qu’il appartiendra plus tard de spécifier ce que chaque peuple aura fait pour l’humanité et de désigner les pays qui, à certaines époques, ont pu avoir sur les autres certains genres de supériorité.
De la sorte, on peut espérer que la crise épouvantable où est engagée l’humanité trouvera un moment d’arrêt. Le lendemain du jour où la faux de la mort aura été arrêtée, que devra-t-on faire ? Attaquer énergiquement la cause du mal. La cause du mal a été un déplorable régime politique qui a fait dépendre l’existence d’une nation des présomptueuses vantardises de militaires bornés, des dépits et de la vanité blessée de diplomates inconsistants ! Opposons à cela le régime parlementaire, un vrai gouvernement des parties sérieuses et modérées du pays, non la chimère démocratique du règne de la volonté populaire avec tous ses caprices, mais le règne de la volonté nationale, résultat des bons instincts du peuple savamment interprétés par des pensées réfléchies. Le pays n’a pas voulu la guerre ; il ne la voudra jamais ; il veut son développement intérieur, soit sous forme de richesse, soit sous forme de libertés publiques. Donnons à l’étranger le spectacle de la prospérité, de la liberté, du calme, de l’égalité bien entendue, et la France reprendra l’ascendant qu’elle a perdu par les imprudentes manifestations de ses militaires et de ses diplomates. La France a des principes qui, bien que critiquables et dangereux à quelques égards, sont faits pour séduire le monde, quand la France donne la première l’exemple du respect de ces principes ; qu’elle présente chez elle le modèle d’un État vraiment libéral, où les droits de chacun sont garantis, d’un État bienveillant pour les autres États, renonçant définitivement à l’idée d’agrandissement, et tous, loin de l’attaquer, s’efforceront de l’imiter.
La Guerre entre la France et l’Allemagne. (La Réforme intellectuelle et morale.)
Le principe des nationalités indépendantes n’est pas de nature, comme plusieurs le pensent, à délivrer l’espèce humaine du fléau de la guerre ; au contraire, j’ai toujours craint que le principe des nationalités, substitué au doux et paternel symbole de la légitimité, ne fît dégénérer les luttes des peuples en exterminations de race, et ne chassât du code du droit des gens ces tempéraments, ces civilités qu’admettaient les petites guerres politiques et dynastiques d’autrefois. On verra la fin de la guerre quand, au principe des nationalités, on joindra le principe qui en est le correctif, celui de la fédération européenne, supérieure à toutes les nationalités ; ajoutons : quand les questions démocratiques, contrepartie des questions de politique pure et de diplomatie, reprendront leur importance. Qu’on se rappelle 1848 ; le mouvement français se reproduisit en secousses simultanées dans toute l’Allemagne. Partout les chefs militaires surent étouffer les naïves aspirations d’alors ; mais qui sait si les pauvres gens que ces mêmes chefs militaires mènent aujourd’hui à l’égorgement n’arriveront pas à éclaircir leur conscience ? Des naturalistes allemands, qui ont la prétention d’appliquer leur science à la politique, soutiennent, avec une froideur qui voudrait avoir l’air d’être profonde, que la loi de la destruction des races et de la lutte pour la vie se retrouve dans l’histoire, que la race la plus forte chasse nécessairement la plus faible, et que la race germanique, étant plus forte que la race latine et la race slave, est appelée à les vaincre et à se les subordonner. Laissons passer cette dernière prétention, quoiqu’elle pût donner lieu à bien des réserves. N’objectons pas non plus à ces matérialistes transcendants que le droit, la justice, la morale, choses qui n’ont pas de sens dans le règne animal, sont des lois de l’humanité ; des esprits si dégagés des vieilles idées nous répondraient probablement par un sourire. Bornons-nous à une observation : les espèces animales ne se liguent pas entre elles. On n’a jamais vu deux ou trois espèces en danger d’être détruites former une coalition contre leur ennemi commun ; les bêtes d’une même contrée n’ont entre elles ni alliances ni congrès. Le principe fédératif, gardien de la justice, est la base de l’humanité. Là est la garantie des droits de tous, il n’y a pas de peuple européen qui ne doive s’incliner devant un pareil tribunal. Cette grande race germanique, bien plus réellement grande que ne le veulent ses maladroits apologistes, aura certes dans l’avenir un haut titre de plus, si l’on peut dire que c’est sa puissante action qui aura introduit définitivement dans le droit européen un principe aussi essentiel. Toutes les grandes hégémonies militaires, celle de l’Espagne au XVIe siècle, celle de la France sous Louis XIV, celle de la France sous Napoléon, ont abouti à un prompt épuisement. Que la Prusse y prenne garde, sa politique radicale peut l’engager dans une série de complications dont il ne lui soit plus loisible de se dégager ; un œil pénétrant verrait peut-être dès à présent le nœud déjà formé de la coalition future. Les sages amis de la Prusse lui disent tout bas, non comme menace, mais comme avertissement : Væ victoribus !
La Guerre entre la France et l’Allemagne. (La Réforme intellectuelle et morale.)
[11] David Strauss (1808-1874), célèbre écrivain allemand, auteur de la Vie de Jésus (1835) et de nombreux écrits théologiques.
Le 18 août 1870, parut dans la Gazette d’Augsbourg, une lettre que M. Strauss me faisait l’honneur de m’adresser sur les événements du temps. Elle se terminait ainsi :
« Vous trouverez peut-être étrange aussi que ces lignes ne vous parviennent que par l’intermédiaire d’un journal. Certes, dans des temps moins agités, je me serais assuré tout d’abord de votre agrément ; mais, dans les circonstances actuelles, avant que ma demande fût parvenue dans vos mains, et votre réponse dans les miennes, le vrai moment aurait passé. Et j’estime d’ailleurs qu’il peut y avoir quelque utilité à ce que, dans cette crise, deux hommes appartenant aux deux nations rivales, indépendants l’un de l’autre et étrangers à tout esprit de parti, échangent leurs vues sans passion, mais en toute franchise, sur les causes et sur la portée de la lutte actuelle ; car les pages que je viens d’écrire n’auront complètement atteint leur but que si elles vous déterminent à un semblable exposé de sentiments, fait à votre point de vue. »
Je me rendis à cette invitation ; le 16 septembre 1870, parut dans le Journal des Débats la réponse que je vais reproduire. La veille avait paru dans le même journal la traduction de la lettre de M. Strauss.
Monsieur et savant maître,
Vos hautes et philosophiques paroles nous sont arrivées à travers ce déchaînement de l’enfer, comme un message de paix ; elles nous ont été d’une grande consolation, à moi surtout qui dois à l’Allemagne ce à quoi je tiens le plus, ma philosophie, je dirai presque ma religion. J’étais au séminaire Saint-Sulpice vers 1843, quand je commençai à connaître l’Allemagne par Gœthe et Herder. Je crus entrer dans un temple, et, à partir de ce moment, tout ce que j’avais tenu jusque-là pour une pompe digne de la Divinité me fit l’effet de fleurs de papier jaunies et fanées. Aussi, comme je vous l’ai écrit au premier moment des hostilités, cette guerre m’a rempli de douleur, d’abord à cause des épouvantables calamités qu’elle ne pouvait manquer d’entraîner, ensuite à cause des haines, des jugements erronés qu’elle répandra et du tort qu’elle fera aux progrès de la vérité. Le grand malheur du monde est que la France ne comprend pas l’Allemagne et que l’Allemagne ne comprend pas la France : ce malentendu ne fera que s’aggraver. On ne combat le fanatisme que par le fanatisme opposé ; après la guerre, nous nous trouverons en présence d’esprits rétrécis par la passion, qui admettront difficilement notre libre et large sérénité.
Vos idées sur l’histoire du développement de l’unité allemande sont d’une parfaite justesse. Au moment où j’ai reçu le numéro de la Gazette d’Augsbourg qui contenait votre belle lettre, j’étais justement occupé à écrire pour la Revue des Deux Mondes un article qui paraîtra ces jours-ci, et où j’exposais des vues identiques aux vôtres. Il est clair que, dès que l’on a rejeté le principe de la légitimité dynastique, il n’y a plus, pour donner une base aux délimitations territoriales des États, que le droit des nationalités, c’est-à-dire des groupes naturels déterminés par la race, l’histoire et la volonté des populations. Or, s’il y a une nationalité qui ait un droit évident d’exister en toute son indépendance, c’est assurément la nationalité allemande. L’Allemagne a le meilleur titre national, je veux dire un rôle historique de première importance, une âme, une littérature, des hommes de génie, une conception particulière des choses divines et humaines. L’Allemagne a fait la plus importante révolution des temps modernes, la Réforme ; en outre, depuis un siècle, l’Allemagne a produit un des plus beaux développements intellectuels qu’il y ait jamais eu, un développement qui a, si j’ose le dire, ajouté un degré de plus à l’esprit humain en profondeur et en étendue, si bien que ceux qui n’ont pas participé à cette culture nouvelle sont à ceux qui l’ont traversée comme celui qui ne connaît que les mathématiques élémentaires est à celui qui connaît le calcul différentiel.
Qu’une si grande force intellectuelle, jointe à tant de moralité et de sérieux, dût produire un mouvement politique correspondant, que la nation allemande fût appelée à prendre dans l’ordre extérieur, matériel et pratique, une importance proportionnée à celle qu’elle avait dans l’ordre de l’esprit, c’est ce qui était évident pour toute personne instruite, non aveuglée par la routine et les partis pris superficiels. Ce qui ajoutait à la légitimité des vœux de l’Allemagne, c’est que le besoin d’unité était chez elle une mesure de précaution justifiée par les déplorables folies du premier empire, folies que les Français éclairés réprouvent autant que les Allemands, mais contre le retour desquelles il était bon de se prémunir, certaines personnes relevant encore ces souvenirs avec beaucoup d’étourderie.
C’est vous dire qu’en 1866 (je parle ici au nom d’un petit groupe de vrais libéraux) nous accueillîmes avec une grande joie l’augure de la constitution d’une Allemagne à l’état de puissance de premier ordre. Ce n’est pas qu’il nous agréât plus qu’à vous de voir ce grand et heureux événement réalisé par l’armée prussienne. Vous avez montré mieux que personne combien il s’en faut que la Prusse soit l’Allemagne. Mais n’importe ; nous avions à cet égard une pensée que, je pense, vous partagez : c’est que l’unité allemande, après avoir été faite par la Prusse, absorberait la Prusse, conformément à cette loi générale que le levain disparaît dans la pâte qu’il a fait lever. A ce pédantisme rogue et jaloux qui nous déplaît parfois dans la Prusse, nous voyions ainsi se substituer peu à peu et succéder en définitive l’esprit allemand, avec sa merveilleuse largeur, ses poétiques et philosophiques aspirations. Ce qu’il y avait de peu sympathique à nos instincts libéraux dans un pays féodal, très médiocrement parlementaire, dominé par une petite noblesse entichée d’une orthodoxie étroite et pleine de préjugés, nous l’oubliions comme vous l’oubliiez vous-même, pour ne voir dans un avenir ultérieur que l’Allemagne, c’est-à-dire une grande nation libérale, destinée à faire faire un pas décisif aux questions politiques, religieuses et sociales, et peut-être à réaliser ce que nous avons essayé en France, jusqu’ici sans y réussir : une organisation scientifique et rationnelle de l’État.
Comment ces rêves ont-ils été déçus ? comment ont-ils fait place à la plus amère réalité ? J’ai expliqué mes idées sur ce point dans la Revue ; les voici en deux mots : on peut faire aussi grande que l’on voudra la part des fautes du gouvernement français, mais il serait injuste d’oublier ce qu’a eu de répréhensible à beaucoup d’égards la conduite du gouvernement prussien. Vous savez que les plans de M. de Bismarck furent communiqués en 1865 à l’empereur Napoléon III, lequel, en somme, y adhéra. Si cette adhésion vint de la conviction que l’unité de l’Allemagne était une nécessité historique, et qu’il était désirable que cette unité se fît avec la pleine amitié de la France, l’empereur Napoléon III eut mille fois raison. Il est à ma connaissance personnelle qu’un mois à peu près avant le commencement des hostilités de 1866, l’empereur Napoléon III croyait au succès de la Prusse, et même qu’il le désirait. Malheureusement, l’hésitation, le goût des actes successivement contradictoires perdirent l’empereur en cette occasion comme en plusieurs autres. La victoire de Sadowa éclata sans que rien fût convenu. Versatilité inconcevable ! Égaré par les rodomontades du parti militaire, troublé par les reproches de l’opposition, l’empereur se laissa entraîner à regarder comme une défaite le résultat qui aurait dû être pour lui une victoire, et qu’en tout cas il avait voulu et amené.
Si le succès justifie tout, le gouvernement prussien est complètement absous ; mais nous sommes philosophes, monsieur ; nous avons la naïveté de croire que celui qui a réussi peut avoir eu des torts. Le gouvernement prussien avait sollicité, accepté l’alliance secrète de l’empereur Napoléon III et de la France. Quoique rien n’eût été stipulé, il devait à l’empereur et à la France des marques de gratitude et de sympathie. Un de vos compatriotes, qui montre en ce moment contre la France plus de passion que je n’aime à en voir chez un galant homme, me disait, à l’époque dont il s’agit, que l’Allemagne devait à la France une grande reconnaissance pour la part réelle, quoique négative, que cette dernière avait prise à sa fondation. Conduit par un principe d’orgueil qui aura dans l’avenir de fâcheuses conséquences, le cabinet de Berlin ne l’entendit pas ainsi. Certes les agrandissements territoriaux, quand il s’agit d’une nation forte déjà de trente ou quarante millions d’hommes, ont peu d’importance ; l’acquisition de la Savoie et de Nice a été pour la France plus fâcheuse qu’utile. On peut regretter cependant que le gouvernement prussien n’ait pas fait céder la rigueur de ses prétentions dans l’affaire du Luxembourg. Le Luxembourg cédé à la France, la France n’eût pas été plus grande ni l’Allemagne plus petite ; mais cette concession insignifiante eût suffi pour satisfaire l’opinion superficielle, qui en un pays de suffrage universel doit être ménagée, et eût permis au gouvernement français de masquer sa retraite. Dans le plus grand château des croisés qui existe encore en Syrie, le Kalaat-el-hosn, se voit, en beaux caractères du XIIe siècle, sur une pierre au milieu des ruines, l’inscription suivante que la maison des Hohenzollern devrait faire graver sur l’écusson de tous ses châteaux :
Dans les causes éloignées de la guerre, un esprit impartial peut donc faire presque égale la part de reproches que méritent d’un côté le gouvernement de la France et d’un autre côté celui de la Prusse. Quant à la cause prochaine, à ce pitoyable incident diplomatique ou plutôt ce jeu cruel de vanités blessées qui, pour venger de chétives querelles de diplomates, a déchaîné tous les fléaux sur l’espèce humaine, vous savez ce que j’en pense[12]. J’étais à Tromsoë, où le plus splendide paysage de neige des mers polaires me faisait rêver aux îles des Morts de nos ancêtres celtes et germains, quand j’appris cette horrible nouvelle ; je n’ai jamais maudit comme ce jour-là le sort fatal qui semble condamner notre malheureux pays à n’être jamais conduit que par l’ignorance, la présomption et l’ineptie.
[12] Renan ignorait à ce moment la falsification de la dépêche d’Ems, qui ne fut connue que par un récit de Bismarck en 1892, puis par la publication de ses Souvenirs (1898).
Cette guerre, quoi qu’on en dise, n’était nullement inévitable. La France ne voulait en aucune façon la guerre. Il ne faut pas juger de ces choses par des déclamations de journaux et des criailleries de boulevard. La France est profondément pacifique ; ses préoccupations sont tournées vers l’exploitation des énormes sources de richesses qu’elle possède et vers les questions démocratiques et sociales. Le roi Louis-Philippe avait vu le vrai sur ce point avec beaucoup de bon sens. Il sentait que la France, avec son éternelle blessure toujours près de se rouvrir (le manque d’une dynastie ou d’une constitution universellement acceptée), ne pouvait pas faire la grande guerre. Une nation qui a rempli son programme et atteint l’égalité ne saurait lutter avec des peuples jeunes, pleins d’illusions et dans tout le feu de leur développement. Croyez-moi, les uniques causes de la guerre sont la faiblesse de nos institutions constitutionnelles et les funestes conseils que des militaires présomptueux et bornés, des diplomates vaniteux ou ignorants ont donnés à l’empereur. Le plébiscite n’y est pour rien ; au contraire, cette étrange manifestation, qui montra que la dynastie napoléonienne avait poussé ses racines jusqu’aux entrailles mêmes du pays, devait faire croire que l’empereur s’éloignerait ensuite de plus en plus des allures d’un joueur désespéré. Un homme qui possède de grands biens territoriaux nous paraît devoir être moins porté à tenter le sort sur un coup de dé que celui dont la richesse est douteuse. En réalité, pour écarter les dangers de conflagration, il suffisait d’attendre. Que de questions, dans les affaires de cette pauvre espèce humaine, il faut résoudre en ne les résolvant pas ! Au bout de quelques années, on est tout surpris que la question n’existe plus. Y eut-il jamais une haine nationale comme celle qui pendant six siècles a divisé la France et l’Angleterre ? Il y a vingt-cinq ans, sous Louis-Philippe, cette haine était encore assez forte ; presque tout le monde déclarait qu’elle ne pouvait finir que par la guerre ; elle a disparu comme par enchantement.
Naturellement, cher monsieur, les libéraux éclairés n’ont eu ici qu’un seul vœu depuis l’heure fatale, voir finir ce qui n’aurait pas dû commencer. La France a eu mille fois tort de paraître vouloir s’opposer aux évolutions intérieures de l’Allemagne ; mais l’Allemagne commettrait une faute non moins grave en voulant porter atteinte à l’intégrité de la France. Si l’on a pour but de détruire la France, rien de mieux conçu qu’un tel plan ; mutilée, la France rentrerait en convulsions, et périrait. Ceux qui pensent, comme quelques-uns de vos compatriotes, que la France doit être supprimée du nombre des peuples, sont conséquents en demandant son amoindrissement ; ils voient très bien que cet amoindrissement serait sa fin ; mais ceux qui croient comme vous que la France est nécessaire à l’harmonie du monde doivent peser les conséquences qu’entraînerait un démembrement. Je puis parler ici avec une sorte d’impartialité. Je me suis étudié toute ma vie à être bon patriote, ainsi qu’un honnête homme doit l’être, mais en même temps à me garder du patriotisme exagéré comme d’une cause d’erreur. Ma philosophie, d’ailleurs, est l’idéalisme ; où je vois le bien, le beau, le vrai, là est ma patrie. C’est au nom des vrais intérêts éternels de l’idéal que je serais désolé que la France n’existât plus. La France est nécessaire comme protestation contre le pédantisme, le dogmatisme, le rigorisme étroit. Vous qui avez si bien compris Voltaire devez comprendre cela. Cette légèreté qu’on nous reproche est au fond sérieuse et honnête. Prenez garde que, si notre tour d’esprit, avec ses qualités et ses défauts, disparaissait, la conscience humaine serait sûrement amoindrie. La variété est nécessaire, et le premier devoir de l’homme qui cherche d’un cœur vraiment pieux à entrer dans les desseins de la Divinité est de supporter, de respecter même les organes providentiels de la vie spirituelle de l’humanité qui lui sont le moins congénères et le moins sympathiques. Votre illustre Mommsen, dans une lettre qui nous a un peu attristés, comparait il y a quelques jours notre littérature aux eaux bourbeuses de la Seine, et cherchait à en préserver le monde comme d’un poison. Quoi ! cet austère savant connaît donc nos journaux burlesques et notre niais petit théâtre bouffon ! Soyez assuré qu’il y a encore, derrière la littérature charlatanesque et misérable qui a chez nous comme partout les succès de la foule, une France fort distinguée, différente de la France du XVIIe et du XVIIIe siècle, de même race cependant : d’abord un groupe d’hommes de la plus haute valeur et du sérieux le plus accompli, puis une société exquise, charmante et sérieuse à la fois, fine, tolérante, aimable, sachant tout sans avoir rien appris, devinant d’instinct le dernier résultat de toute philosophie. Prenez garde de froisser cela. La France, pays très mixte, offre cette particularité que certaines plantes germaniques y poussent souvent mieux que dans leur sol natal ; on pourrait le démontrer par des exemples de notre histoire littéraire du XIIe siècle, par les chansons de geste, la philosophie scolastique, l’architecture gothique. Vous semblez croire que la diffusion des saines idées germaniques serait facilitée par certaines mesures radicales, détrompez-vous ; cette propagande serait alors arrêtée net ; le pays s’enfoncerait avec rage dans ses routines nationales et ses défauts particuliers. — « Tant pis pour lui ! » diront vos exaltés. — « Tant pis pour l’humanité ! » ajouterai-je. La suppression ou l’atrophie d’un membre fait pâtir tout le corps.
L’heure est solennelle. Il y a en France deux courants d’opinion. Les uns raisonnent ainsi : « Finissons cette odieuse partie au plus vite ; cédons tout, l’Alsace, la Lorraine ; signons la paix ; puis haine à mort, préparatifs sans trêve, alliance avec n’importe qui, complaisances sans bornes pour toutes les ambitions russes ; un seul but, un seul mobile à la vie, guerre d’extermination contre la race germanique. » D’autres disent : « Sauvons l’intégrité de la France, développons les institutions constitutionnelles, réparons nos fautes, non en rêvant de prendre notre revanche d’une guerre où nous avons été injustes agresseurs, mais en contractant avec l’Allemagne et l’Angleterre une alliance dont l’effet sera de conduire le monde dans les voies de la civilisation libérale. » L’Allemagne décidera laquelle des deux politiques suivra la France, et du même coup elle décidera de l’avenir de la civilisation.
Vos germanistes fougueux allèguent que l’Alsace est une terre germanique, injustement détachée de l’empire allemand. Remarquez que les nationalités sont toutes des « cotes mal taillées » ; si l’on se met à raisonner ainsi sur l’ethnographie de chaque canton, on ouvre la porte à des guerres sans fin. De belles provinces de langue française ne font pas partie de la France, et cela est très avantageux, même pour la France. Des pays slaves appartiennent à la Prusse. Ces anomalies servent beaucoup à la civilisation. La réunion de l’Alsace à la France, par exemple, est un des faits qui ont le plus contribué à la propagande du germanisme ; c’est par l’Alsace que les idées, les méthodes, les livres de l’Allemagne passent d’ordinaire pour arriver jusqu’à nous. Il est incontestable que, si on soumettait la question au peuple alsacien, une immense majorité se prononcerait pour rester unie à la France. Est-il digne de l’Allemagne de s’attacher de force une province rebelle, irritée, devenue irréconciliable, surtout depuis la destruction de Strasbourg ? L’esprit est vraiment parfois confondu de l’audace de vos hommes d’État. Le roi de Prusse paraît en train de s’imposer la lourde tâche de résoudre la question française, de donner et par conséquent de garantir un gouvernement à la France. Peut-on, de gaieté de cœur, rechercher un pareil fardeau ? Comment ne voit-on pas que la conséquence de cette politique serait d’occuper la France à perpétuité avec 3 ou 400.000 hommes ? L’Allemagne veut donc rivaliser avec l’Espagne du XVIe siècle ? Et sa grande et haute culture intellectuelle, que deviendrait-elle à ce jeu-là ? Qu’elle prenne garde qu’un jour, quand on voudra désigner les années les plus glorieuses de la race germanique, on ne préfère à la période de sa domination militaire, marquée peut-être par un abaissement intellectuel et moral, les premières années de notre siècle, où, vaincue, humiliée extérieurement, elle créait pour le monde la plus haute révélation de la raison que l’humanité eût connue jusque-là !
On s’étonne que quelques-uns de vos meilleurs esprits ne voient pas cela, et surtout qu’ils se montrent contraires à une intervention de l’Europe en ces questions. La paix ne peut, à ce qu’il semble, être conclue directement entre la France et l’Allemagne ; elle ne peut être l’ouvrage que de l’Europe, qui a blâmé la guerre et qui doit vouloir qu’aucun des membres de la famille européenne ne soit trop affaibli. Vous parlez à bon droit de garanties contre le retour de rêves malsains ; mais quelle garantie vaudrait celle de l’Europe, consacrant de nouveau les frontières actuelles et interdisant à qui que ce soit de songer à déplacer les bornes fixées par les anciens traités ? Toute autre solution laissera la porte ouverte à des vengeances sans fin. Que l’Europe fasse cela, et elle aura posé pour l’avenir le germe de la plus féconde institution, je veux dire d’une autorité centrale, sorte de congrès des États-Unis d’Europe, jugeant les nations, s’imposant à elles, et corrigeant le principe des nationalités par le principe de fédération. Jusqu’à nos jours, cette force centrale de la communauté européenne ne s’est guère montrée en exercice que dans des coalitions passagères contre le peuple qui aspirait à une domination universelle ; il serait bon qu’une sorte de coalition permanente et préventive se formât pour le maintien des grands intérêts communs, qui sont après tout ceux de la raison et de la civilisation.
Le principe de la fédération européenne peut ainsi offrir une base de médiation semblable à celle que l’Église offrait au moyen âge. On est parfois tenté de prêter un rôle analogue aux tendances démocratiques et à l’importance que prennent de nos jours les problèmes sociaux. Le mouvement de l’histoire contemporaine est une sorte de balancement entre les questions patriotiques, d’une part, les questions démocratiques et sociales, de l’autre. Ces derniers problèmes ont un côté de légitimité, et seront peut-être en un sens la grande pacification de l’avenir. Il est certain que le parti démocratique, malgré ses aberrations, agite des problèmes supérieurs à la patrie ; les sectaires de ce parti se donnent la main par-dessus toutes les divisions de nationalité, et professent une grande indifférence pour les questions de point d’honneur, qui touchent surtout la noblesse et les militaires. Les milliers de pauvres gens qui en ce moment s’entretuent pour une cause qu’ils ne comprennent qu’à demi ne se haïssent pas ; ils ont des besoins, des intérêts communs. Qu’un jour ils arrivent à s’entendre et à se donner la main malgré leurs chefs, c’est là un rêve sans doute ; on peut cependant entrevoir plus d’un biais par où la politique à outrance de la Prusse pourra servir à l’avènement d’idées qu’elle ne soupçonne pas. Il paraît difficile que cette fureur d’une poignée d’hommes, reste des vieilles aristocraties, mène longtemps à l’égorgement des masses de populations douces, arrivées à une conscience démocratique assez avancée et plus ou moins imbues d’idées économiques (pour eux saintes) dont le propre est justement de ne pas tenir compte des rivalités nationales.
Ah ! cher maître, que Jésus a bien fait de fonder le royaume de Dieu, un monde supérieur à la haine, à la jalousie, à l’orgueil, où le plus estimé est, non pas, comme dans les tristes temps que nous traversons, celui qui fait le plus de mal, celui qui frappe, tue, insulte, celui qui est le plus menteur, le plus déloyal, le plus mal élevé, le plus défiant, le plus perfide, le plus fécond en mauvais procédés, en idées diaboliques, le plus fermé à la pitié, au pardon, celui qui n’a nulle politesse, qui surprend son adversaire, lui joue les plus mauvais tours ; mais celui qui est le plus doux, le plus modeste, le plus éloigné de toute assurance, jactance et dureté, celui qui cède le pas à tout le monde, celui qui se regarde comme le dernier ! La guerre est un tissu de péchés, un état contre nature où l’on recommande de faire comme belle action ce qu’en tout autre temps on commande d’éviter comme vice ou défaut, où c’est un devoir de se réjouir du malheur d’autrui, où celui qui rendrait le bien pour le mal, qui pratiquerait les préceptes évangéliques de pardon des injures, de goût pour l’humiliation, serait absurde et même blâmable. Ce qui fait entrer dans la Walhalla est ce qui exclut du royaume de Dieu. Avez-vous remarqué que ni dans les huit béatitudes, ni dans le sermon sur la montagne, ni dans l’Évangile, ni dans toute la littérature chrétienne primitive, il n’y a pas un mot qui mette les vertus militaires parmi celles qui gagnent le royaume du ciel ?
Insistons sur ces grands enseignements de paix, qui échappent aux hommes dupes de leur orgueil, entraînés par leur éternel et si peu philosophique oubli de la mort. Personne n’a le droit de se désintéresser des désastres de son pays ; mais le philosophe comme le chrétien a toujours des motifs de vivre. Le royaume de Dieu ne connaît ni vainqueurs ni vaincus ; il consiste dans les joies du cœur, de l’esprit et de l’imagination, que le vaincu goûte plus que le vainqueur, s’il est plus élevé moralement et s’il a plus d’esprit. Votre grand Gœthe, votre admirable Fichte ne nous ont-ils pas appris comment on peut mener une vie noble et par conséquent heureuse au milieu de l’abaissement extérieur de sa patrie ? Un motif, du reste, m’inspire un grand repos d’esprit : l’an dernier, lors des élections pour le Corps législatif, je m’offris aux suffrages des électeurs ; je ne fus pas choisi ; mes affiches se voient encore sur les murs des villages de Seine-et-Marne ; on y peut lire : « Pas de révolution, pas de guerre. Une guerre serait aussi funeste qu’une révolution. » Pour avoir la conscience tranquille dans des temps comme les nôtres, il faut pouvoir se dire qu’on n’a pas fui systématiquement la vie publique, pas plus qu’on ne l’a recherchée.
Conservez-moi toujours votre amitié, et croyez à mes sentiments les plus élevés.
Paris, 13 septembre 1870.
(La Réforme intellectuelle et morale.)
Monsieur et savant maître,
A la fin de la lettre que vous m’avez adressée par la Gazette d’Augsbourg, le 18 août 1870, vous m’invitiez à exposer mes vues sur la situation terrible créée par les derniers événements. Je le fis ; ma réponse à votre lettre parut dans le Journal des Débats, le 16 septembre ; la veille, avait été insérée dans le même journal la traduction de votre lettre, telle que nous l’avait envoyée votre excellent interprète français, M. Charles Ritter. Si vous voulez bien réfléchir à l’état de Paris à cette époque, vous reconnaîtrez peut-être que ce journal faisait en cela preuve d’un certain courage. Le siège commença le lendemain, et toute communication entre l’intérieur de Paris et le reste du monde se trouva interrompue pendant cinq mois.
Plusieurs jours après la conclusion de l’armistice, au mois de février 1871, j’appris une nouvelle qui me surprit, c’est que, le 2 octobre 1870, vous aviez fait dans la Gazette d’Augsbourg une réponse à ma lettre du 16 septembre. Vous ne pensiez pas sans doute que le blocus prussien fût aussi rigoureux qu’il l’était ; car, si vous l’aviez su, il est peu probable que vous m’eussiez adressé une lettre publique que je ne pouvais lire et à laquelle je ne pouvais répondre. Le malentendu en ces matières délicates est facile ; il faut que la personne qu’on a interpellée puisse donner des explications et rectifier, s’il y a lieu, les opinions qu’on lui prête. Dans le cas dont il s’agit, la crainte d’un malentendu n’était pas chimérique. Entre bien des rectifications, en effet, que j’aurais à faire à votre réponse du 2 octobre, il en est une qui a de l’importance. Trompé par l’expression de « traités de 1814 » que nous employons souvent en France pour désigner l’ensemble des conventions qui fixèrent les limites de la France à la chute du premier empire, vous avez cru que je demandais après Sedan qu’on revînt sur les cessions de 1815, qu’on nous rendît Saarlouis et Landau. Je suis fâché d’avoir été présenté par vous au public allemand comme capable d’une telle absurdité. Il me semble que, s’il y a une pensée qui résulte clairement de ce que j’ai écrit sur cette funeste guerre, c’est qu’il fallait s’en tenir aux frontières nationales telles que l’histoire les avait fixées, que toute annexion de pays sans le vœu des populations était une faute et même un crime.
Une circonstance augmenta encore mon chagrin. Peu de jours après que j’eus connu l’existence de votre lettre du 2 octobre, j’appris que la Gazette d’Augsbourg n’avait pas inséré la traduction de ma lettre du 16 septembre, si bien que ce journal, après m’avoir invité par votre organe à entrer dans la discussion, après avoir vu le Journal des Débats, dont la position était autrement délicate que la sienne, insérer vos pages hautaines sous le coup de l’émeute populaire, refusait de porter au public allemand victorieux les humbles pages où je réclamais pour ma patrie vaincue un peu de générosité et de pitié. Je sais que vous avez regretté ce procédé ; mais c’est ici que j’admire de quoi est capable votre patriotisme exalté ; car, au lieu de vous retirer d’un débat où la parole était refusée à votre adversaire, vous avez inséré quelques jours après dans cette même Gazette d’Augsbourg une réplique à la lettre que vous m’aviez fait écrire et que vous n’aviez pas eu le crédit de faire publier. Voilà, monsieur, où je vois bien la différence entre nos manières de comprendre la vie. La passion qui vous remplit et qui vous semble sainte est capable de vous arracher un acte pénible. Une de nos faiblesses, au contraire, à nous autres Français de la vieille école, est de croire que les délicatesses du galant homme passent avant tout devoir, avant toute passion, avant toute croyance, avant la patrie, avant la religion. Cela nous fait du tort ; car on ne nous rend pas toujours la pareille, et, comme tous les délicats, nous jouons le rôle de dupes au milieu d’un monde qui ne nous comprend plus.
Il est vrai que vous m’avez fait ensuite un honneur auquel je suis sensible comme je le dois. Vous avez traduit vous-même ma réponse et l’avez réunie dans une brochure à vos deux lettres[13]. Vous avez voulu que cette brochure se vendît au profit d’un établissement d’invalides allemands. Dieu me garde de vous faire une chicane au point de vue de la propriété littéraire ! L’œuvre à laquelle vous m’avez fait contribuer est d’ailleurs une œuvre d’humanité, et, si ma chétive prose a pu procurer quelques cigares à ceux qui ont pillé ma petite maison de Sèvres, je vous remercie de m’avoir fourni l’occasion de conformer ma conduite à quelques-uns des préceptes de Jésus que je crois les plus authentiques. Mais remarquez encore ces nuances légères. Certainement, si vous m’aviez permis de publier un écrit de vous, jamais, au grand jamais, je n’aurais eu l’idée d’en faire une édition au profit de notre hôtel des Invalides. Le but vous entraîne ; la passion vous empêche de voir ces mièvreries de gens blasés que nous appelons le goût et le tact.
[13] Leipzig, Hirzel, 1870. (Note d’E. R.)
Il m’est arrivé depuis un an ce qui arrive toujours à ceux qui prêchent la modération en temps de crise. Les événements ainsi que l’immense majorité de l’opinion m’ont donné tort. Je ne puis vous dire cependant que je sois converti. Attendons dix ou quinze années ; ma conviction est que la partie éclairée de l’Allemagne reconnaîtra alors qu’en lui conseillant d’user doucement de sa victoire, je fus son meilleur ami. Je ne crois pas à la durée des choses menées à l’extrême, et je serais bien surpris si une foi aussi absolue en la vertu d’une race que celle que professent M. de Bismarck et M. de Moltke n’aboutissait pas à une déconvenue. L’Allemagne, en se livrant aux hommes d’État et aux hommes de guerre de la Prusse, a monté un cheval fringant, qui la mènera où elle ne veut pas. Vous jouez trop gros jeu. A quoi ressemble votre conduite ? exactement à celle de la France à l’époque qu’on lui reproche le plus. En 1792, les puissances européennes provoquent la France ; la France bat les puissances, ce qui était bien son droit ; puis elle pousse ses victoires à outrance, en quoi elle avait tort. L’outrance est mauvaise ; l’orgueil est le seul vice qui soit puni en ce monde. Triompher est toujours une faute et en tout cas quelque chose de bien peu philosophique. Debemur morti nos nostraque.
Ne vous imaginez pas être plus que d’autres à l’abri de l’erreur. Depuis un an, vos journaux se sont montrés moins ignorants sans doute que les nôtres, mais tout aussi passionnés, tout aussi immoraux, tout aussi aveugles. Ils ne voient pas une montagne qui est devant leurs yeux, l’opposition toujours croissante de la conscience slave à la conscience germanique, opposition qui aboutira à une lutte effroyable. Ils ne voient pas qu’en détruisant le pôle nord d’une pile on détruit le pôle sud, que la solidarité française faisait la solidarité allemande, qu’en mourant la France se vengera et rendra le plus mauvais service à l’Allemagne. L’Allemagne, en d’autres termes, a fait la faute d’écraser son adversaire. Qui n’a pas d’antithèse n’a pas de raison d’être. S’il n’y avait plus d’orthodoxes, ni vous ni moi n’existerions ; nous serions en face d’un stupide matérialisme vulgaire, qui nous tuerait bien mieux que les théologiens. L’Allemagne s’est comportée avec la France comme si elle ne devait jamais avoir d’autre ennemi. Or le précepte du vieux sage Ama tanquam osurus doit aujourd’hui être retourné ; il faut haïr comme si l’on devait un jour être l’allié de celui qu’on hait ; on ne sait pas de qui on devra quelque jour rechercher l’amitié.
Il ne sert de rien de dire qu’il y a soixante et soixante-dix ans, nous avons agi exactement de la même manière, qu’alors nous avons fait en Europe la guerre de pillage, de massacre et de conquête que nous reprochons aux Allemands de 1870. Ces méfaits du premier empire, nous les avons toujours blâmés ; ils sont l’œuvre d’une génération avec laquelle nous avons peu de chose de commun et dont la gloire n’est plus la nôtre. A tort évidemment, nous nous étions habitués à croire que le XIXe siècle avait inauguré une ère de civilisation, de paix, d’industrie, de souveraineté des populations. « Comment, dit-on, traitez-vous de crimes et de hontes des cessions d’âmes auxquelles ont autrefois consenti des races aussi nobles que la vôtre et dont vous-mêmes avez profité. » — Distinguons les dates. Le droit d’autrefois n’est pas le droit d’aujourd’hui. Le sentiment des nationalités n’a pas cent ans. Frédéric II n’était pas plus mauvais Allemand dans son dédain pour la langue et la littérature allemandes que Voltaire n’était mauvais Français en se réjouissant de l’issue de la bataille de Rosbach. Une cession de province n’était alors qu’une translation de biens immeubles d’un prince à un prince ; les peuples y restaient le plus souvent indifférents. Cette conscience des peuples, nous l’avons créée dans le monde par notre Révolution ; nous l’avons donnée à ceux que nous avons combattus et souvent injustement combattus ; elle est notre dogme. Voilà pourquoi nous autres libéraux français étions pour les Vénitiens, pour les Milanais contre l’Autriche ; pour la Bohême, pour la Hongrie contre la centralisation viennoise ; pour la Pologne contre la Russie ; pour les Grecs et les Slaves de Turquie contre les Turcs. Il y avait protestation de la part de Milan, de Venise, de la Bohême, de la Hongrie, de la Pologne, des Grecs et des Slaves de Turquie, cela nous suffisait. Nous étions également pour les Romagnols contre le pape ou plutôt contre la contrainte étrangère qui les maintenait malgré eux sujets du pape ; car nous ne pouvions admettre qu’une population soit confisquée contre son gré au profit d’une idée religieuse qui prétend qu’elle a besoin d’un territoire pour vivre. Dans la guerre de la sécession d’Amérique, beaucoup de bons esprits, tout en étant peu sympathiques aux États du Sud, ne purent se décider à leur dénier le droit de se retirer d’une association dont ils ne voulaient plus faire partie, du moment qu’ils eurent prouvé par de rudes sacrifices que leur volonté à cet égard était sérieuse.
Cette règle de politique n’a rien de profond ni de transcendant ; mais il faut se garder, à force d’érudition et de métaphysique, de n’être plus ni juste ni humain. La guerre sera sans fin, si l’on n’admet des prescriptions pour les violences du passé. La Lorraine a fait partie de l’empire germanique, sans aucun doute ; mais la Hollande, la Suisse, l’Italie même, jusqu’à Bénévent, et en remontant au delà du traité de Verdun, la France entière, en y comprenant même la Catalogne, en ont aussi fait partie. L’Alsace est maintenant un pays germanique de langue et de race ; mais, avant d’être envahie par la race germanique, l’Alsace était un pays celtique, ainsi qu’une partie de l’Allemagne du Sud. Nous ne concluons pas de là que l’Allemagne du Sud doive être française ; mais qu’on ne vienne pas non plus soutenir que, par droit ancien, Metz et Luxembourg doivent être allemands. Nul ne peut dire où cette archéologie s’arrêterait. Presque partout où les patriotes fougueux de l’Allemagne réclament un droit germanique, nous pourrions réclamer un droit celtique antérieur, et avant la période celtique, il y avait, dit-on, les allophyles, les Finnois, les Lapons ; et avant les Lapons, il y eut les hommes des cavernes ; et avant les hommes des cavernes, il y eut les orangs-outangs. Avec cette philosophie de l’histoire, il n’y aura de légitime dans le monde que le droit des orangs-outangs, injustement dépossédés par la perfidie des civilisés.
Soyons moins absolus ; à côté du droit des morts, admettons pour une petite part le droit des vivants. Le traité de 843, pacte conclu entre trois chefs barbares qui assurément ne se préoccupèrent dans le partage que de leurs convenances personnelles, ne saurait être une base éternelle de droit national. Le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien ne saurait s’imposer à jamais à la volonté des peuples. Il est impossible d’admettre que l’humanité soit liée pour des siècles indéfinis par les mariages, les batailles, les traités des créatures bornées, ignorantes, égoïstes, qui au moyen âge tenaient la tête des affaires de ce bas monde. Ceux de vos historiens, comme Ranke, Sybel, qui ne voient dans l’histoire que le tableau des ambitions princières et des intrigues diplomatiques, pour lesquels une province se résume en la dynastie, souvent étrangère, qui l’a possédée, sont aussi peu philosophes que la naïve école qui veut que la Révolution française ait marqué une ère absolument nouvelle dans l’histoire. Un moyen terme entre ces extrêmes nous paraît seul pratique. Certes nous repoussons comme une erreur de fait fondamentale l’égalité des individus humains et l’égalité des races ; les parties élevées de l’humanité doivent dominer les parties basses ; la société humaine est un édifice à plusieurs étages, où doit régner la douceur, la bonté (l’homme y est tenu même envers les animaux), non l’égalité. Mais les nations européennes telles que les a faites l’histoire sont les pairs d’un grand sénat où chaque membre est inviolable. L’Europe est une confédération d’États réunis par l’idée commune de la civilisation. L’individualité de chaque nation est constituée sans doute par la race, la langue, l’histoire, la religion, mais aussi par quelque chose de beaucoup plus tangible, par le consentement actuel, par la volonté qu’ont les différentes provinces d’un État de vivre ensemble. Avant la malheureuse annexion de Nice, pas un canton de la France ne voulait se séparer de la France ; cela suffisait pour qu’il y eût crime européen à démembrer la France, quoique la France ne soit une ni de langue ni de race. Au contraire, des parties de la Belgique et de la Suisse, et jusqu’à un certain point les îles de la Manche, quoique parlant français, ne désirent nullement appartenir à la France ; cela suffit pour qu’il fût criminel de chercher à les y annexer par la force. L’Alsace est allemande de langue et de race ; mais elle ne désire pas faire partie de l’État allemand ; cela tranche la question. On parle du droit de la France, du droit de l’Allemagne. Ces abstractions nous touchent beaucoup moins que le droit qu’ont les Alsaciens, êtres vivants en chair et en os, de n’obéir qu’à un pouvoir consenti par eux.
Ne blâmez donc pas notre école libérale française de regarder comme une sorte de droit divin le droit qu’ont les populations de n’être pas transférées sans leur consentement. Pour ceux qui, comme nous, n’admettent plus le principe dynastique qui fait consister l’unité d’un État dans les droits personnels du souverain, il n’y a plus d’autre droit des gens que celui-là. De même qu’une nation légitimiste se fait hacher pour sa dynastie, de même nous sommes obligés de faire les derniers sacrifices pour que ceux qui étaient liés à nous par un pacte de vie et de mort ne souffrent pas violence. Nous n’admettons pas les cessions d’âmes ; si les territoires à céder étaient déserts, rien de mieux ; mais les hommes qui les habitent sont des créatures libres, et notre devoir est de les faire respecter.
Notre politique, c’est la politique du droit des nations ; la vôtre, c’est la politique des races : nous croyons que la nôtre vaut mieux. La division trop accusée de l’humanité en races, outre qu’elle repose sur une erreur scientifique, très peu de pays possédant une race vraiment pure, ne peut mener qu’à des guerres d’extermination, à des guerres « zoologiques », permettez-moi de le dire, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie. Ce serait la fin de ce mélange fécond, composé d’éléments nombreux et tous nécessaires, qui s’appelle l’humanité. Vous avez levé dans le monde le drapeau de la politique ethnographique et archéologique en place de la politique libérale ; cette politique vous sera fatale. La philologie comparée, que vous avez créée et que vous avez transportée à tort sur le terrain de la politique, vous jouera de mauvais tours. Les Slaves s’y passionnent ; chaque maître d’école slave est pour vous un ennemi, un termite qui ruine votre maison. Comment pouvez-vous croire que les Slaves ne vous feront pas ce que vous faites aux autres, eux qui en toute chose marchent après vous, suivent vos traces pas pour pas ? Chaque affirmation du germanisme est une affirmation du slavisme ; chaque mouvement de concentration de votre part est un mouvement qui « précipite » le Slave, le dégage, le fait être séparément. Un coup d’œil sur les affaires d’Autriche montre cela avec évidence. Le Slave, dans cinquante ans, saura que c’est vous qui avez fait son nom synonyme d’« esclave » ; il verra cette longue exploitation historique de sa race par la vôtre, et le nombre des Slaves est double du vôtre, et le Slave, comme le dragon de l’Apocalypse, dont la queue balaye la troisième partie des étoiles, traînera un jour après lui le troupeau de l’Asie centrale, l’ancienne clientèle des Gengiskhan et des Tamerlan. Combien il eût mieux valu vous réserver pour ce jour-là l’appel à la raison, à la moralité, à des amitiés de principes ! Songez quel poids pèsera dans la balance du monde le jour où la Bohême, la Moravie, la Croatie, la Servie, toutes les populations slaves de l’empire ottoman, sûrement destinées à l’affranchissement, races héroïques encore, toutes militaires et qui n’ont besoin que d’être commandées, se grouperont autour de ce grand conglomérat moscovite, qui englobe déjà dans une gangue slave tant d’éléments divers, et qui paraît bien le noyau désigné de la future unité slave, de même que la Macédoine, à peine grecque, le Piémont, à peine italien, la Prusse, à peine allemande, ont été le centre de formation de l’unité grecque, de l’unité italienne, de l’unité allemande. Et vous êtes trop sages pour compter sur la reconnaissance que vous doit la Russie. Une des causes secrètes de la mauvaise humeur de la Prusse contre nous est de nous devoir une partie de sa culture. Une des blessures des Russes sera un jour d’avoir été civilisés par les Allemands. Ils le nieront, mais se l’avoueront tout en le niant, et ce souvenir les exaspérera. L’académie de Saint-Pétersbourg en voudra un jour autant à celle de Berlin, pour avoir été tout allemande, que celle de Berlin nous en veut, pour avoir été autrefois à moitié française. Notre siècle est le siècle du triomphe du serf sur son maître ; le Slave a été et à quelques égards est encore votre serf.
Or, le jour de la conquête slave, nous vaudrons plus que vous, de même qu’Athènes sous l’empire romain eut un rôle brillant encore, tandis que Sparte n’en eut plus.
Défiez-vous donc de l’ethnographie, ou plutôt ne l’appliquez pas trop à la politique. Sous prétexte d’une étymologie germanique, vous prenez pour la Prusse tel village de Lorraine. Les noms de Vienne (Vindobona), de Worms (Borbitomagus), de Mayence (Mogontiacum) sont gaulois ; nous ne vous réclamerons jamais ces villes ; mais, si un jour les Slaves viennent revendiquer la Prusse proprement dite, la Poméranie, la Silésie, Berlin, par la raison que tous ces noms sont slaves, s’ils font sur l’Elbe et sur l’Oder ce que vous avez fait sur la Moselle, s’ils pointent sur la carte les villages obotrites ou vélatabes, qu’aurez-vous à dire ? Nation n’est pas synonyme de race. La petite Suisse, si solidement bâtie, compte trois langues, trois ou quatre races, deux religions. Une nation est une grande association séculaire (non pas éternelle) entre des provinces en partie congénères formant noyau, et autour desquelles se groupent d’autres provinces liées les unes aux autres par des intérêts communs ou par d’anciens faits acceptés et devenus des intérêts. L’Angleterre, qui est la plus parfaite des nations, est la plus mêlée, au point de vue de l’ethnographie et de l’histoire. Bretons purs, Bretons romanisés, Irlandais, Calédoniens, Anglo-Saxons, Danois, Normands purs, Normands francisés, tout s’y est confondu.
Et j’ose dire qu’aucune nation n’aura tant à souffrir de cette fausse manière de raisonner que l’Allemagne. Vous savez mieux que moi que ce qui marqua le grand règne de la race germanique dans le monde, du Ve au XIe siècle, ce fut moins d’occuper à l’état de population compacte de vastes pays contigus que d’essaimer l’Europe et d’y introduire un nouveau principe d’autorité. Pendant que le germanisme était maître de tout l’Occident, la Germanie proprement dite avait peu de corps. Les Slaves venaient jusqu’à l’Elbe, le vieux fond gaulois persistait ; si bien que l’empire germanique n’était en partie qu’une féodalité germanique régnant sur un fond slave et gaulois. Prenez garde, en ce siècle de la résurrection des morts, il pourrait se passer d’étranges choses. Si l’Allemagne s’abandonne à un sentiment trop exclusivement national, elle verra se rétrécir d’autant la zone de son rayonnement moral. La Bohême, qui était à demi digérée par le germanisme, vous échappe, comme une proie déjà avalée par un serpent boa, qui ressusciterait dans l’œsophage du monstre et ferait des efforts désespérés pour en sortir. Je veux croire que la conscience slave est morte en Silésie ; mais vous n’assimilerez pas Posen. Ces opérations veulent être enlevées d’emblée, pendant que le patient dort ; s’il vient à se réveiller, on ne le reprend plus. Une suspicion universelle contre votre puissance d’assimilation, contre vos écoles, va se répandre. Un vaste effort pour écarter vos nationaux, que l’on envisagera comme les avant-coureurs de vos armées, sera pour longtemps à l’ordre du jour. L’infiltration silencieuse de vos émigrants dans les grandes villes, qui était devenue un des faits sociaux les plus importants et les plus bienfaisants de notre siècle, va être bien diminuée. L’Allemand, ayant dévoilé ses appétits conquérants, ne s’avancera plus qu’en conquérant. Sous l’extérieur le plus pacifique, on verra un ennemi cherchant à s’impatroniser chez autrui. Croyez-moi, ce que vous avez perdu est faiblement compensé par les cinq milliards que vous avez gagnés.
Chacun doit se défier de ce qu’il y a d’exclusif et d’absolu dans son esprit. Ne nous imaginons jamais avoir tellement raison que nos adversaires aient complètement tort. Le Père céleste fait lever son soleil avec une bienveillance égale sur les spectacles les plus divers. Ce que nous croyons mauvais est souvent utile et nécessaire. Pour moi, je m’irriterais d’un monde où tous mèneraient le même genre de vie que moi. Comme vous, je me suis imposé, en qualité d’ancien clerc, d’observer strictement la règle des mœurs ; mais je serais désolé qu’il n’y eût pas des gens du monde pour représenter une vie plus libre. Je ne suis pas riche ; mais je ne pourrais guère vivre dans une société où il n’y aurait pas de gens riches. Je ne suis pas catholique ; mais je suis bien aise qu’il y ait des catholiques, des sœurs de charité, des curés de campagne, des carmélites, et il dépendrait de moi de supprimer tout cela que je ne le ferais pas. De même, vous autres Allemands, supportez ce qui ne vous ressemble pas ; si tout le monde était fait à votre image, le monde serait peut-être un peu morne et ennuyeux ; vos femmes elles-mêmes supportent avec peine cette austérité trop virile. Cet univers est un spectacle qu’un dieu se donne à lui-même. Servons les intentions du grand chorége en contribuant à rendre le spectacle aussi brillant, aussi varié que possible.
Votre race germanique a toujours l’air de croire à la Walhalla ; mais la Walhalla ne sera jamais le royaume de Dieu. Avec cet éclat militaire, l’Allemagne risque de manquer sa vraie vocation. Reprenons tous ensemble les grands et vrais problèmes, les problèmes sociaux, qui se résument ainsi : trouver une organisation rationnelle et aussi juste que possible de l’humanité. Ces problèmes ont été posés par la France en 1789 et en 1848 ; mais en général, celui qui pose les problèmes n’est pas celui qui les résout. La France les attaqua d’une façon trop simple ; elle crut avoir trouvé une issue par la démocratie pure, par le suffrage universel et par des rêves d’organisation communiste du travail. Les deux tentatives ont échoué, et ce double échec a été la cause de réactions fâcheuses, pour lesquelles il convient d’être indulgent, si l’on songe que l’initiative en pareille matière a bien quelque mérite. Attaquez à votre tour ces problèmes. Créez à l’homme en dehors de l’État et par delà la famille une association qui l’élève, le soutienne, le corrige, l’assiste, le rende heureux, ce que fut l’Église et ce qu’elle n’est plus. Réformez l’Église, ou substituez-y quelque chose. L’excès du patriotisme nuit à ces œuvres universelles dont la base est le mot de saint Paul : Non est Judæus neque Græcus. C’est justement parce que vos grands hommes d’il y a quatre-vingts ans n’étaient pas trop patriotes qu’ils ouvrirent cette large voie, où nous sommes leurs disciples. Je crains que votre génération ultra-patriotique, en repoussant tout ce qui n’est pas germanique pur, ne se prépare un auditoire beaucoup plus restreint. Jésus et les fondateurs du christianisme n’étaient pas des Allemands. Saint Boniface, les Irlandais qui vous ont appris à écrire du temps des Carlovingiens, les Italiens, qui ont été deux ou trois fois nos maîtres à tous, n’étaient pas des Allemands. Votre Gœthe reconnaissait devoir quelque chose à cette France « corrompue » de Voltaire, de Diderot. Laissons ces fanatismes étroits aux régions inférieures de l’opinion. Permettez-moi de vous le dire : vous avez déchu. Vous avez été plus étroitement patriotes que nous. Chez nous, quelques hommes supérieurs ont trouvé dans leur philosophie le calme et l’impartialité ; chez vous, je ne connais personne, en dehors du parti démocratique, qui n’ait été ébranlé dans la froideur de ses jugements, qui n’ait été une fois injuste, qui n’ait recommandé de faire dans l’ordre des relations nationales ce qui eût été une honte selon les principes de la morale privée.
Mais je m’arrête ; on est aujourd’hui trop naïf à parler de modération, de justice, de fraternité, de la reconnaissance et des égards que les peuples se doivent entre eux. La conduite que vous allez être forcés de tenir dans les provinces annexées malgré elles achèvera de vous démoraliser. Vous allez être obligés de donner un démenti à tous vos principes, de traiter en criminels des hommes que vous devrez estimer, des hommes qui n’auront fait autre chose que ce que vous fîtes si noblement après Iéna ; toutes les idées morales vont être perverties. Notre système d’équilibre et d’amphictyonie européenne va être renvoyé au pays des chimères ; nos thèses libérales vont devenir un jargon vieilli. Par le fait des hommes d’État prussiens, la France d’ici longtemps n’aura plus qu’un objectif : reconquérir les provinces perdues. Attiser la haine toujours croissante des Slaves contre les Allemands, favoriser le panslavisme, servir sans réserve toutes les ambitions russes, faire miroiter aux yeux du parti catholique répandu partout le rétablissement du pape à Rome ; à l’intérieur, s’abandonner au parti légitimiste et clérical de l’Ouest, qui seul possède un fanatisme intense, voilà la politique que commande une telle situation. C’est justement l’inverse de ce que nous avions rêvé. On ne sert pas tour à tour deux causes opposées : ce n’est pas nous qui conseillerons la destruction de ce que nous avons aimé, qui donnerons un plan pour trafiquer habilement de la question romaine, qui deviendrons russes et papistes, qui recommanderons la défiance et la malveillance envers les étrangers ; mais que voulez-vous ! nous serions coupables, d’un autre côté, si nous cherchions, en conseillant encore des poursuites généreuses et désintéressées, à empêcher le pays d’écouter la voix de deux millions de Français qui réclament l’aide de leur ancienne patrie.
La France est en train de dire comme votre Herwegh : « Assez d’amour comme cela ; essayons maintenant de la haine. » Je ne la suivrai pas dans cette expérience nouvelle, où l’on peut, au reste, douter qu’elle réussisse ; la résolution que la France tient le moins est celle de haïr. En tous cas, la vie est trop courte pour qu’il soit sage de perdre son temps et d’user sa force à un jeu si misérable. J’ai travaillé dans mon humble sphère à l’amitié de la France et de l’Allemagne ; si c’est maintenant « le temps de cesser les baisers », comme dit l’Ecclésiaste, je me retire. Je ne conseillerai pas la haine, après avoir conseillé l’amour ; je me tairai. Apre et orgueilleuse est cette vertu germanique, qui nous punit, comme Prométhée, de nos téméraires essais, de notre folle « philanthropie ». Mais nous pouvons dire avec le grand vaincu : « Jupiter, malgré tout son orgueil, ferait bien d’être humble. Maintenant, puisqu’il est vainqueur, qu’il trône à son aise, se fiant au bruit de son tonnerre et secouant dans sa main son dard au souffle de feu. Tout cela ne le préservera pas un jour de tomber ignominieusement d’une chute horrible. Je le vois se créer lui-même son ennemi, monstre très difficile à combattre, qui trouvera une flamme supérieure à la foudre, un bruit supérieur au tonnerre. Vaincu alors, il comprendra par son expérience combien il est différent de régner ou de servir. »
Croyez, monsieur et illustre maître, à mes sentiments les plus élevés.
Paris, 15 septembre 1871.
(La Réforme intellectuelle et morale.)
[14] Cette lettre inédite, à notre connaissance, est adressée à l’esthéticien allemand Moriz Carrière, descendant de réfugiés français, et auteur d’un ouvrage en six volumes sur L’Art rattaché au développement de la civilisation et à l’idéal de l’humanité. La lettre de Carrière parut dans le numéro d’avril 1888 de la Deutsche Revue, sous ce titre : Devoirs civilisateurs de la France et de l’Allemagne. Une lettre de paix à Ernest Renan ; elle tient douze pages de la Revue. La réponse de Renan ne fut pas insérée.
Cher Monsieur.
Votre belle lettre, insérée dans la Deutsche Revue, m’a vivement touché. Il y a si longtemps que nous n’avions reçu d’Allemagne des paroles de paix et de sympathie ! Quelques appels que j’avais adressés en ce sens, il y a quelques années, ne m’avaient valu que des réponses ironiques. Il est dans la nature du victorieux de croire la victoire éternelle et de rejeter sans les lire, les observations du vaincu. Cela nous rend d’autant plus précieuses, cher monsieur, les bonnes paroles que vous nous adressez. J’ai vingt fois dit ce que je dois à l’Allemagne. Avant comme après 1870, l’alliance de la France et de l’Allemagne a toujours été notre rêve. L’action commune des deux nations les plus éclairées du monde me paraît nécessaire à l’œuvre générale de l’humanité, et les forces réunies de ces deux grandes masses civilisées ne me semblent pas de trop pour résister à la haine des lumières qui a encore des foyers redoutables en certaines parties de l’Europe et repousser une jeune barbarie venue de l’Est, laquelle ne sera sans danger que si elle trouve toujours devant elle une Europe unie et ferme en ses principes libéraux. La grande culture dont l’Allemagne rationnelle a élevé le drapeau depuis 125 ans ne se suffit pas à elle-même ; il y faut, j’en suis sûr, la collaboration de la France. L’état intellectuel et moral du monde n’a été si médiocre depuis 18 ou 20 ans que parce que l’accord de nos deux races qui est la condition du progrès humain a été profondément troublé. Bénie sera l’heure où cette grande rupture d’harmonie cessera. Vous semblez croire que cette heure est proche… puissiez-vous avoir raison ! Voici pourtant quelques motifs pour lesquels nous hésitons encore à laisser un libre cours à notre joie.
Ce que nous croyons savoir de l’esprit libéral du nouvel empereur d’Allemagne et les hautes aspirations éclairées de la personne admirable qu’un sort privilégié lui a donné pour compagne serait bien de nature en effet à encourager les prévisions les plus optimistes. Si l’accession au trône de l’empereur Frédéric III se faisait dans les conditions ordinaires, si l’on pouvait croire que nous sommes à l’aurore d’un règne durable, croyez bien que nous n’attacherions pas d’importance à quelques paroles écrites d’avance, qui ne pouvaient manquer dans des déclarations officielles. Ce n’est point par des transformations subites, c’est par une marche lente, opérant sous la pression des nécessités du temps, que nous aurions espéré voir s’accomplir le programme de nos rêves. Huit, dix ans peut-être et de graves événements eussent été sans doute nécessaires pour convaincre l’Allemagne qu’elle n’a aucun intérêt à détenir un grand pays malgré lui. Dix ans sont bien peu de chose et toujours nous aurions compté sur l’action d’une pensée bienveillante, pacifique et compatissante, au cœur même de cette grande conscience allemande qui gouverne à l’heure qu’il est les intérêts les plus précieux de l’humanité.
Mais vous savez, cher monsieur, bâtir sur le terrain de telles illusions serait bâtir sur le sable. Le règne qui pour l’accomplissement de nos pieuses chimères devrait être du moins d’un quart de siècle sera peut-être de quelques semaines. Le règne d’un moment aura-t-il une influence durable sur le règne qui suivra, rien n’autorise à le croire. Nous craignons donc qu’il ne faille voir qu’un épisode douloureux dans le touchant spectacle qui tient l’Europe attentive. Nous nous bornons à dire : « Sunt lacrimæ rerum et mentem mortalia tangunt. »
Quel serait, cher monsieur, l’ordre d’idées où il conviendrait d’entrer, si vraiment des changements dans la situation réciproque de l’Allemagne et de la France se laissaient entrevoir ? Pour ceux qui, comme moi, jugent la question d’après un sentiment d’amour et de pitié pour les hommes bien plus que par les prétendues règles des diplomates, le problème est d’une extrême simplicité. Les motifs d’amour-propre et de vanité blessée sont dénués de sens pour une âme élevée ; une seule voix reste perçante, dominante, supérieure aux mille considérations en sens contraire de la politique et de l’intérêt : c’est la voix de l’Alsace et de Metz, nous répétant à diverses reprises et d’une manière claire que c’est malgré elles qu’elles subissent le régime qui leur a été imposé par le traité de Francfort. La France a dépensé des flots de sang pour secourir des peuples envers lesquels elle n’avait nulle obligation, mais qu’elle envisageait comme injustement soumis à une domination contre laquelle ils protestaient. Comment voulez-vous qu’elle soit insensible quand de pareils cris de détresse lui sont adressés par des provinces sœurs qui, il y a quelques années, faisaient corps avec elle, et qui maintenant tendent les mains vers elle ?
Remarquez bien que nous ne disons pas, comme beaucoup de patriotes peu philosophes : « l’Alsace appartient à la France, donc la France doit songer avant tout à la reprendre. » Non, l’Alsace n’appartient pas à la France, mais l’Alsace n’appartient pas non plus à l’Allemagne. L’Alsace appartient à elle-même. Notre devoir à nous autres Français est de lui rendre la disposition d’elle-même. Pour cela, une neutralisation provisoire est nécessaire. Si, au bout d’une telle épreuve, l’Alsace déclare qu’elle veut être Française, elle sera sûrement la bienvenue ; si elle déclare qu’elle veut être Allemande, rien de mieux ; si elle veut rester autonome ou s’adjoindre à la confédération helvétique, rien de mieux encore. Nous ne sommes obligés qu’à une seule chose, c’est que la violence qui a été infligée à une portion de nous-mêmes soit réparée, c’est que l’acte d’abandon que nous avons été obligés de faire dans un moment de nécessité absolue ne pèse pas sur nous comme un reproche sanglant. Des naufragés qui n’avaient plus qu’un radeau pour se sauver ont été obligés de laisser une partie de leurs compagnons sur un îlot désert ; leur premier devoir n’est-il pas de songer avant tout aux camarades qu’ils ont été obligés d’abandonner ?
Ce qui fait la nationalité moderne, ce n’est ni la langue, ni la race, ni la religion, ni même l’histoire, c’est la volonté de vivre ensemble, prouvée par des actes suivis. Nous croyons le développement de la civilisation compromis si les nationalités s’arrogent le privilège des dynasties, si les nations peuvent, comme autrefois les dynasties, s’adjuger, sans les consulter, [les peuples] sur lesquels elles croient avoir des droits. Il est aussi mal de persécuter un pays dans sa langue et dans ses sympathies nationales que dans sa religion. La méconnaissance de ce principe entraînera, nous le croyons, des malheurs incalculables.
La figure du monde passe si vite que ce qui paraissait à un certain jour impossible peut bien vite après devenir un principe secourable et accepté de tous. Votre lettre d’un caractère si élevé prouve que la grande conscience allemande du temps de Herder et de Gœthe vit encore. Vous avez raison de croire que beaucoup d’âmes dans le monde, désabusées sur bien des choses, n’ont plus qu’un désir, celui de voir consolidée après elles cette œuvre de la raison humaine, fruit de tant de larmes, et que tant de passions aveugles menacent en sens opposés. Les vrais croyants de notre siècle entrevoyaient comme une chance hautement favorable à leurs vœux que, pendant des années, deux créatures excellentes, assujetties autant que l’on voudra aux exigences nationales, mais en communion générale avec le bien général de l’humanité, eussent présidé aux destinées du premier empire du monde. Dis aliter visum. Vous nous assurez que, malgré tout, il faut espérer en l’avenir. Puissiez-vous avoir raison ! Croyez, en tout cas, que nous avons été profondément émus de vos bonnes paroles. Ce brin d’olivier, nous arrivant par-dessus les eaux du déluge, nous a fort réjouis dans notre arche, d’où, je vous assure, il nous tarde bien de sortir. Croyez à mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués[15].
[15] Cette lettre est datée du 28 mars 1888. Il est à présumer que Renan en avait eu connaissance à l’avance.
E. RENAN.
Profondément convaincu de ce principe qu’une force organisée et disciplinée l’emporte toujours sur une force non organisée et indisciplinée, je n’eus jamais d’espoir dans les efforts tentés pour continuer la lutte après le 4 septembre. Au mois de novembre, j’insérai dans le Journal des Débats les trois articles que voici[16] :
[16] On a extrait les passages les plus caractéristiques de ces trois articles.
10 NOVEMBRE 1870.
L’étrange situation où nous sommes a cela de particulier que la volonté de la France est devenue tout à fait obscure, et que l’unité même de la conscience française est gravement mise en péril. Le gouvernement de la défense nationale, sorti d’une révolution qui, comme la plupart des révolutions et des coups d’État, fut une erreur politique, n’a jamais été, à beaucoup près, aussi pleinement accepté que les gouvernements issus des révolutions de 1830 et de 1848. Les portions conservatrices du pays n’y ont adhéré qu’à demi ; les partis dits avancés l’ont à peine reconnu ; l’Ouest, le Midi ont montré un esprit d’indépendance qui n’a surpris que les observateurs inattentifs ; à l’heure qu’il est, Lyon, Marseille, Bordeaux sont des communes révolutionnaires, admettant à peine avec le gouvernement de Paris un lien fédéral. Cela devait être. Composé uniquement de membres de la députation parisienne et de personnes appartenant au parti républicain, le gouvernement de la défense nationale ne pouvait avoir la prétention d’être la large expression de la France entière ; il aurait fallu pour cela que, dès son premier jour, il eût admis parmi ses membres des députés de province et qu’il eût groupé autour de lui les hommes éminents de tous les partis. Ce gouvernement, qui, malgré le défaut de son origine, compte dans son sein tant de personnes sages, courageuses et dignes d’estime, avoue, du reste, son vice fondamental avec une franchise qui l’honore : « Le lendemain du jour où le gouvernement impérial s’est abîmé, les hommes que la nécessité a investis du pouvoir ont proposé la paix, et, pour en régler les conditions, ils ont proposé une trêve indispensable à la constitution d’une représentation nationale. Désireux avant tout de s’effacer devant les mandataires du pays et d’arriver par eux à une paix honorable, ils ont voulu que la France pût réunir ses députés pour délibérer sur la paix ; ils ont cherché les combinaisons pouvant permettre à la France d’exprimer sa volonté. »
Ainsi parle avec une haute raison M. Jules Favre. Ajoutons que ce gouvernement, si partiel, si incomplètement accepté, a le pire défaut que puisse avoir un gouvernement : il ne communique pas avec les pays qu’il gouverne. La fausse situation du pouvoir établi à l’Hôtel-de-Ville se montre ici dans tout son jour. Dominé par les nécessités de son origine toute parisienne, il n’a pas osé quitter Paris au moment de l’investissement, ainsi que la logique l’aurait voulu. Il est tout à fait contre nature que le gouvernement central d’un grand pays soit assiégé. Trop sensé pour ne pas voir ce qu’une telle situation avait de faible, le gouvernement de la défense nationale a tâché avec beaucoup de bonne foi de procurer la réunion d’une assemblée investie des pleins pouvoirs du pays.
Une idée paraît avoir préoccupé le gouvernement et une partie du public, c’est que, pour la réunion d’une telle assemblée, un armistice était nécessaire. De là ces tentatives de Ferrières, noblement conçues et noblement racontées ; de là ces essais des puissances neutres provoqués et secondés avec tant de patriotisme et d’élévation d’âme par M. Thiers. Toute espérance de voir conclure un pareil arrangement semble perdue ; mais il est permis de se demander si l’on ne s’était pas exagéré la nécessité de la convention militaire qu’on a poursuivie avec tant de suite et d’insistance. Fallait-il réellement, pour réunir une assemblée nationale, la permission de l’ennemi ? N’y avait-il pas, au contraire, quelque chose de profondément inconstitutionnel, quelque chose de très humiliant et qui même viciait le fond de l’acte électoral, à exécuter l’opération essentielle de la vie politique de la nation grâce à une cédule délivrée par l’ennemi et sous sa surveillance ? Les difficultés soulevées par la Prusse à propos du vote en certaines portions du territoire envahi, qu’elle prétend garder après la paix, avaient quelque chose d’assez conséquent. Il n’est pas naturel qu’un acte de haute hostilité contre la Prusse s’accomplisse sous les yeux d’une sentinelle prussienne. C’est malgré la Prusse et non avec l’agrément de la Prusse que l’Alsace et la Lorraine doivent choisir leurs délégués. Ce choix sera sans aucun doute une protestation contre les projets hautement annoncés par le parti allemand exalté ; une telle protestation n’aurait pas toute sa force si elle avait lieu par suite d’une concession gracieuse de l’ennemi.
Un formalisme méticuleux a pu seul nous faire croire qu’une très sérieuse représentation de la volonté nationale ne pouvait se faire sans que l’ennemi s’y prêtât. L’histoire nous montre au contraire les vrais représentants d’un esprit national naissant sous la pression de l’ennemi. Assurément, pour que les opérations électorales pussent avoir lieu avec les formalités ordinaires, il faudrait que, dans les parties envahies du territoire, le gouvernement prussien y consentît. Ces formalités ont quelque chose de solennel ; un acte public de haute liberté et même de souveraineté ne saurait être accompli en présence de l’ennemi. Mais, dans un moment de suprême nécessité, les formes peuvent être simplifiées. Il faut songer que les trois quarts de la France n’ont pas été atteints par les armées allemandes. Dans ces régions, les élections pourraient se faire selon les règles accoutumées. Dans les départements envahis même, un grand nombre de communes pourraient procéder à des scrutins réguliers. Restent les pays écrasés par les armées étrangères et où tout acte de vie politique est impossible. Dans ces pays, l’opinion publique devrait se faire jour d’une façon irrégulière, mais qui n’en serait peut-être que plus sincère, surtout si l’opération se faisait très rapidement. Il n’est pas admissible que la France se prive d’une fonction essentielle de sa vie nationale, parce qu’elle ne peut l’accomplir avec l’appareil ordinaire et d’une manière uniforme dans toutes les parties du territoire.
La difficulté serait grande si l’on voulait former de la sorte une assemblée de sept ou huit cents membres au scrutin de liste. Une telle élection exigerait un état calme, un pays libre. L’ennemi nous accordât-il toutes les facilités possibles, le gouvernement prussien voulût-il bien s’interdire toute ingérence dans les opérations de scrutin, on peut trouver qu’une élection ainsi accomplie serait sans dignité et sans légitimité. Mais ce n’est pas une assemblée nombreuse qu’il nous faut, à l’heure présente ; ce qu’il nous faut, c’est une délégation exécutive des départements, délégation rapidement formée et promptement rassemblée à Tours ou dans une ville derrière la Loire. Ce qu’il faut, c’est que chaque département, dans huit ou dix jours, ait fait choix d’un délégué muni de ses pleins pouvoirs. Ces délégués, joints aux membres de la fraction du gouvernement résidant à Tours, formeraient une réunion d’une centaine de personnes. Cette réunion se mettrait en rapport, autant qu’il serait possible, avec le gouvernement de Paris ; elle serait investie de tous les droits de la souveraineté nationale ; elle déciderait de la continuation de la guerre ou de la conclusion de la paix. En recevant ses ordres et en les exécutant, nous aurions la certitude d’accomplir un devoir et de nous conformer à la volonté de la France, soit qu’elle nous commandât de nous imposer de nouveaux sacrifices, soit qu’elle nous enjoignît de subir pour elle une cruelle humiliation.
Si l’heure de la paix est venue, un tel gouvernement pourrait la conclure. Nous doutons que le gouvernement de Paris le puisse. On porte toujours les attaches de son point de départ. Un gouvernement qui doit compter sans cesse avec les journaux et les clubs, un gouvernement fondé sur la popularité et obligé de ménager les erreurs qu’impliquent presque toujours les opinions tranchées, ne peut manquer de faire des fautes. Le gouvernement de la défense nationale a su traverser des moments fort difficiles ; mais il n’a pu se défendre d’afficher un programme conforme à ce ton d’assurance, de fierté, de déclamation qu’aime le peuple. Il a dit imprudemment : « Pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forteresses. » Or de très bons patriotes, qui ne consentiraient jamais à condamner des millions de Français à un sort qui leur répugne, peuvent accepter un système de neutralisation où le droit des populations soit suffisamment garanti. Le gouvernement de la défense nationale, en outre, a fait comme tous les gouvernements mis en présence d’une grande fièvre populaire : le plus innocemment du monde, il a contribué à nourrir des illusions ; il a pactisé avec certaines erreurs du public. Aujourd’hui, cela lui coupe à peu près la retraite. Nous doutons qu’il puisse être le gouvernement de la paix. Le péché originel de toute institution démocratique, ce sont les sacrifices qu’on est obligé de faire à l’esprit superficiel de la foule. Comment détruire des espérances qu’on a entretenues, déclarer sans issue une situation qu’on a laissé croire brillante ou assez bonne ? Ajoutons qu’un gouvernement qui ne représente que très imparfaitement la France, un gouvernement assiégé et dont les communications sont coupées avec le pays, ne peut guère traiter pour le pays. Si Paris doit se rendre, il faut que la capitulation lui soit commandée. Si la guerre doit être continuée, il est plus nécessaire encore que nous sachions si la prolongation de la lutte est voulue par le pays entier, et si nous ne lui imposons pas une épreuve au-dessus de ses forces.
On arrive ainsi par toutes les voies à reconnaître la nécessité de constituer une délégation provinciale, dépositaire de la souveraineté de la France, et qui puisse être réunie sans qu’on ait à demander aucune permission à l’ennemi. Il est fâcheux que cette délégation ne se soit pas formée spontanément. Si la France avait eu des états provinciaux ou des conseils généraux sérieux et capables de grande politique qui eussent constitué cette délégation, combien nous serions près du salut ! Un scrutin rapide, et, partout où le scrutin n’est pas possible, une interprétation sagace de l’opinion publique, faite par les citoyens les plus estimés et les plus éclairés, voilà la planche de salut. Le noyau de la délégation, une fois formé par les élus des scrutins réguliers, jugerait les nominations moins régulières et au besoin y suppléerait. L’impartialité serait facile dans les terribles circonstances où nous sommes, surtout si l’on songe qu’une telle délégation aurait un caractère essentiellement temporaire, qu’elle ne traiterait aucune question de politique engageant l’avenir, que ses pouvoirs cesseraient au moment de l’évacuation du territoire, par la nomination régulière d’une constituante.
L’unité de la France est menacée ; la tête, le cœur ne renvoient plus, ne reçoivent plus la vie. Défendons de toutes nos forces cette grande conscience française qui a été un si bel instrument de civilisation, et qui menace de s’éteindre. Défendons-la par une résistance énergique qui, même vaincue, sera notre sauvegarde dans l’avenir ; défendons-la aussi en maintenant l’entente et la solidarité des parties de la nation. Que le gouvernement invite par un décret chaque département à faire sa délégation dans le plus bref délai, qu’il indique le lieu de la réunion, et la France aura une représentation centrale, sans avoir la honte de la devoir à une concession de l’ennemi. Ajoutons que peut-être elle n’en aura jamais eu de meilleure. Le mandat sera trop triste pour que personne ait le courage de le briguer ; les circonstances sont trop solennelles pour laisser une place aux petites intrigues et aux chétives récriminations.
13 NOVEMBRE 1870
… C’est là, dira-t-on, une assemblée de notables, quelque chose d’aristocratique, de peu conforme à notre jalouse et soupçonneuse démocratie. Il est vrai ; mais faisons trêve pour un moment à ces mesquines préoccupations. Quand nous serons sortis de l’abîme, nous reprendrons ces questions ; maintenant, sauvons-nous. Un pays ne se sauve que par des actes de foi et de confiance en l’intelligence et en la vertu de quelques citoyens. Laissez le petit nombre des vrais aristocrates qui existe encore vous tirer de la détresse où vous êtes ; puis vous vous vengerez d’eux en les excluant de vos chambres, de vos conseils électifs. Il faut, au moment présent, des hommes d’élite par l’esprit et le cœur. Ces hommes ne réclament de privilège qu’au moment du péril ; qu’on souffre ce privilège-là. La réunion qu’il s’agit de former aura pour mission de traiter avec un gouvernement essentiellement aristocratique, qui admet hautement la valeur de la supériorité de naissance et de la supériorité du savoir ; acceptez pour un moment l’esprit de votre adversaire ; vous prendrez ensuite votre revanche à loisir.
Certes, il vaudrait mieux que la France trouvât dans ses institutions antérieures la désignation de cette chambre improvisée et intérimaire, On n’a jamais vu plus clairement que ces jours-ci le vide terrible que laisse en un pays le manque d’institutions provinciales et d’une réelle aristocratie locale. Que n’avons-nous depuis longtemps de sérieux conseils généraux ! Si dans quelques départements ces conseils sont réunis et qu’ils veuillent prendre sur eux de choisir un délégué qui paraisse adopté par l’opinion publique, il faut accueillir ce délégué avec empressement. Si, comme on le dit, quelques départements sont en train de faire leurs élections sans avoir attendu l’invitation officielle, tant mieux : ces départements-là sont probablement les plus avancés de la France sous le rapport de l’esprit politique. Toutes les expressions promptes et sincères de l’opinion, qu’on les accueille vite, qu’on les groupe. Pas de minutieuses formalités, pas de petitesses d’amour-propre. Le plus indigne de faire partie d’une telle assemblée serait celui qui s’y porterait candidat. Candidat, grand Dieu ! à une mission de larmes et de deuil !…
28 NOVEMBRE 1870
La plupart des objections qu’on a faites contre notre sentiment reposent sur des malentendus. Ces objections seraient décisives contre la réunion d’une assemblée constituante ; l’élection d’une constituante, en effet, suppose du calme, de la liberté, des discussions préalables. Aussi avons-nous toujours soigneusement maintenu que l’assemblée dont la France a besoin en ce moment doit être distincte de celle qui fixera l’avenir politique du pays. Notre motif pour désirer cette distinction est bien simple. La constituante qui sera chargée un jour de donner un gouvernement à la France sera profondément divisée ; les opinions contraires s’y dessineront avec force ; les républicains, les légitimistes, les orléanistes, les bonapartistes, les cléricaux s’y livreront d’ardents combats ; il faudra qu’avant l’élection toutes ces opinions s’expriment nettement en des programmes, des affiches, des professions de foi, des réunions publiques. Or, à l’heure présente, nous sommes perdus si de telles divisions se font jour. Il faut qu’aujourd’hui tous les partis marchent ensemble, oublient en quelque sorte leur propre existence. Le salut est à ce prix.
Ce que nous avons dit, il y a trois semaines, nous le croyons encore. Nous cesserons cependant de revenir sur le vœu que nous avons exprimé. La situation est changée ; nous sommes à la veille de grandes actions décisives ; attendons et espérons. En insistant davantage, nous aurions l’air de jouer un rôle d’opposition qui est aussi loin que possible de notre pensée dans un moment aussi solennel. Le gouvernement de la défense nationale aurait tort de regarder comme ses ennemis les hommes qui, sans avoir pris aucune part à la journée du 4 septembre, ont voté chaleureusement pour le pouvoir nouveau lors du plébiscite du 3 novembre, continuent de l’envisager comme représentant le principe de l’unité nationale, mais en même temps usent envers lui de l’honnête indépendance d’appréciation dont ils ne se sont jamais départis sous des régimes qui n’avaient pas pour premier principe la liberté de discussion. Peut-être même ce gouvernement a-t-il en nous, surtout depuis le 3 novembre, des soutiens plus fidèles que dans les personnes qui l’ont créé tumultuairement, et dont plusieurs voulaient, quelques jours après, le renverser.
C’est avec peine que nous avons vu le parti démocratique, dans le sein duquel il y a souvent, à côté d’éléments moins purs, beaucoup de patriotisme et de chaleur d’âme, se méprendre sur notre pensée. Comme tous les bons citoyens, nous cherchons, sans aucune prétention à l’infaillibilité, les moyens d’aider notre pauvre patrie à sortir de l’abîme où on l’a plongée. Le parti démocratique a tort de croire que les procédés d’un jacobinisme superficiel suffisent pour cela. Ce parti, dont il ne faut pas songer à se passer, mais qui ne peut régler à lui seul les destinées de la nation, commettrait une faute capitale s’il prétendait gouverner la France sans l’assentiment de la province. C’est un cercle vicieux de premier ordre que de prétendre s’imposer à la majorité d’un pays, quand on a pour principe le suffrage universel. Il est fâcheux aussi que les organes les plus accrédités de ce parti ne prennent pas assez le soin d’examiner les raisons qu’on leur pose, et soient trop portés à voir des ennemis en ceux qui ne partagent pas toutes leurs opinions. Évitons ce qui divise. Nous entrons dans une période de fortes épreuves ; la froideur du jugement est nécessaire en de telles circonstances ; que tous s’efforcent de n’écouter que la raison et le sentiment du devoir.
(La Réforme intellectuelle et morale.)
Voilà près de huit ans écoulés depuis les terribles épreuves que nous avons traversées et il est maintenant permis de voir quelle direction notre pays a définitivement choisie dans l’alternative cruelle où l’avait mis sa destinée. La France avait l’option entre deux partis opposés. Elle pouvait adopter un système de réformes analogues à celles que s’imposa la Prusse après la bataille d’Iéna, réformes austères, tendant à donner à tous les services de la force et de la vigueur, sacrifiant dans une large mesure l’individu à l’État, fortifiant l’État et admettant son action dans tous les ordres : comme condition de ces réformes, un gouvernement plus sérieux que brillant, un parlement réduit au rôle de conseiller intime, une monarchie ayant son droit en dehors de la volonté de la nation ; comme conséquence, l’inégalité sociale, une telle organisation supposant des classes en apparence privilégiées, en réalité mises à part pour le service de la nation. A cette voie de pénitence et de retour en arrière, la France pouvait préférer la continuation du programme démocratique, où l’État, constitué par l’universalité des individus, n’ayant d’autre but que le bonheur des individus entendu comme les individus l’entendent, s’interdit toute visée au delà de ce que conçoit et sent l’universalité des individus. La conséquence d’un pareil état de choses est la poursuite du bien-être et de la liberté, la destruction de tout ce qui reste de privilèges et d’esprit de classe, l’affaiblissement du principe de l’État. L’individu et les groupes subordonnés à l’État, tels que le département et la commune, se trouveront bien d’un tel régime, mais il est à craindre que la nation, la patrie, la France enfin, y perde chaque jour quelque chose de son autorité et de sa forte cohésion.
Il est clair que la seconde hypothèse a complètement remporté la victoire sur la première. A deux tentatives auxquelles n’a manqué ni la hardiesse, ni la résolution d’aller jusqu’au bout, la France a opposé un non absolu. A toute autre tentative du même genre (et il est probable qu’il y en aura), le pays répondra sans doute de la même manière. Une réforme dans le sens monarchique et gouvernemental ne se fera donc pas avec l’assentiment spontané de la France.
(Mélanges d’histoire et de voyages, 1878.)
[17] Dans le drame célèbre, Siffroi, comte palatin, a bu avidement l’eau de Jouvence qui procure des rêves d’outre-tombe, et dont le barde breton Léolin n’a pris que quelques gouttes.
Siffroi, qui a ronflé tout ce temps, se réveille. Victoire ! victoire ! Pendez, brûlez, fusillez. Nous sommes les maîtres ; tout nous est permis pour leur faire signer ce que nous voulons. Générosité ! sentimentalité ! pure sottise !
Désolation ! Les militaires sont trop doux ; nos hommes savent tuer, mais non fusiller. Il faudrait brûler tous les villages, pendre tous les habitants mâles, cela les empêcherait de se défendre. Ah ! ah ! (Il éclate de rire.)
Des prisonniers !… Comprenez-vous qu’on fasse prisonniers des gens qui se défendent ? On aurait dû les fusiller. « Grâce ! mon bon sire, pour mon homme qui a menacé de sa bêche un hussard. » — Très bien, ma bonne femme, vous pouvez être parfaitement assurée que votre mari (il passe le doigt autour du cou) sera pendu. » (Il éclate de rire.)
Ce qui me plaît dans le Bavarois, c’est la facilité avec laquelle il fusille ! Il rencontre quelqu’un, il n’attend pas qu’on tire sur lui, il fait feu le premier.
Il faut être plein de politesse jusqu’au dernier échelon de la potence (Il rit de plaisir) ; mais il faut pendre.
O mollesse des militaires ! si j’exerçais un commandement, je sais ce que je ferais. Si je parvenais à m’emparer des fuyards, je leur enlèverais leur vache et tout ce qu’ils auraient emporté, en les accusant de l’avoir volé et de le cacher dans les bois.
Il faut rendre la guerre aussi cruelle que possible. La sensibilité ! Voilà une chose ridicule !
On fusillera, on pendra, on brûlera. Quand cela sera arrivé quelquefois, les habitants se montreront plus raisonnables, surtout si nos obus les ont déjà convenablement disposés.
Ah ! la bonne odeur ! cela sent l’oignon brûlé ! Des paysans viennent d’être rôtis dans leurs maisons. Sur cent soixante-dix, il y en a cent vingt de sabrés. Coquins, pourquoi avez-vous épargné le reste ? Ne savez-vous pas que la sentimentalité est ridicule ? Une lettre de mon cher ange !… (Mouvement d’attention dans l’auditoire.)
Prospero. — Écoutons ! son ange va lui parler. Nous allons le voir par le côté aimant.
Siffroi. — Ah ! les bons conseils, chère et douce amie ! « Tous les Gaulois fusillés, écharpés, jusqu’aux petits enfants. Je crains qu’il n’y ait pas de Bible en France. Voici le livre des psaumes que je t’envoie afin que tu puisses y lire cette prophétie contre les Français : « Je te le dis, les impies doivent être exterminés. » Merci, tendre épouse, merci !
Pourquoi retarde-t-on le bombardement ? on manquera le moment psychologique. Oh ! les âmes sensibles ! les femmes ! Dire que sans deux femmes, le bombardement serait déjà commencé ! Ah ! que ne suis-je le maître ! Je ne craindrais pas d’être dur ; deux millions d’hommes mourant de faim ! eh bien, ils l’ont voulu !
Voilà des gens qui ramassent des pommes de terre. On ne tire pas dessus ! Oh ! les militaires humains ! Il y a des gens qui gâtent tout, parce qu’ils veulent être loués pour leur humanité.
Et dire que ces farceurs, en nous voyant chez eux, n’ont pas l’air content ! Ah ! les poseurs !
Les Français sont une nation de barbares, avec un vernis insuffisant de civilisation. Nous sommes les hommes, ils sont les femmes. Des femmes ! Ah ! fi donc ! « La bienveillance, envers tout le monde, c’est la justice », a dit un de leurs nigauds. Oui-dà ! Dans le monde que j’ai vu, la malveillance, c’est la justice. Hermann de…, un bas intrigant ! Henri de…, un méchant homme ; Gauthier de…, un ignorant, un sot, un drôle ! et l’empereur, mon maître ? Vieux…, mais non ! chut ! J’ai trop d’esprit !
(Eau de Jouvence, 1880.)
Il faut des éléments très divers pour le développement complet de l’esprit d’une nation ; la foi seule n’y suffit pas, et la critique seule y suffirait encore moins.
Le signe le plus certain de l’affaiblissement d’une société est cette indifférence aux nobles luttes qui fait que les grandes questions politiques paraissent secondaires auprès des questions d’industrie et d’administration.
Le caractère bien plus que l’esprit rapproche les hommes, et les plus grandes diversités d’opinion ne sont rien auprès de la sympathie morale qui résulte de communes espérances et de communes aspirations.
Des deux systèmes de politique qui se partageront éternellement le monde, l’un se fondant sur le droit abstrait, l’autre sur la possession antérieure, la France, pays de logique et d’idées généreuses, a toujours préféré le premier. Qui oserait lui en faire un reproche, puisque c’est à ce glorieux défaut qu’elle doit la splendeur de son histoire et la sympathie du genre humain ?
Ce qui frappe au premier coup d’œil dans les compositions idéales des races celtiques, surtout quand on les compare à celles des races germaniques, c’est l’extrême douceur de mœurs qu’on y respire. Point de ces vengeances effroyables qui remplissent l’Edda et les Niebelungen. Comparez le héros celtique et le héros germain, Beowulf et Pérédur par exemple. Quelle différence ! Là, toute l’horreur de la barbarie dégouttante de sang, l’enivrement du carnage, le goût désintéressé, si j’ose le dire, de la destruction et de la mort ; ici, au contraire, un profond sentiment de la justice, une grande exaltation de la fierté individuelle, il est vrai, mais aussi un grand besoin de dévouement, une exquise loyauté……
L’homme primitif de la Germanie révolte par sa brutalité sans objet, par cet amour du mal, qui ne rend ingénieux et fort que pour haïr et pour nuire. Le héros kymrique, au contraire, même dans ses plus étranges écarts, semble dominé par des habitudes de bienveillance et une vive sympathie pour les êtres faibles.
(Essais de morale et de critique, 1859.)
La philosophie n’exclut pas la foi dans un idéal de justice vers lequel toute conviction sincère a le droit de se tourner avec un sentiment pieux ; mais elle regarde comme un acte d’orgueil de croire qu’on est nécessaire aux plans divins, et que la Providence veille sur nous, quelque faute que l’on commette, quelque peu de souci que l’on ait de s’éclairer.
L’Allemand n’a pas la rhétorique sonore, le journalisme retentissant ; un Lacordaire, un Montalembert n’ont pas de place dans un tel pays. Chez nous, toute l’opinion libérale, sans distinction de doctrine, est avec celui qui résiste ; en Allemagne, l’opposition, la résistance à la loi, sont une cause de défaveur ; la persécution ne donne pas grand prestige, car l’Allemand est pour ce qui est fort : il n’a pas cette générosité, souvent superficielle, il faut le dire, qui nous porte à croire que le faible a toujours raison.
La peine capitale disparaîtra, non par une évolution prématurée, mais par le progrès des mœurs publiques, qui l’effacera de l’usage avant de l’effacer de la loi. Enfin la paix universelle, ce rêve de tant d’âmes honnêtes, plus abusées sur le choix des moyens que sur le but à atteindre, cessera un jour d’être une utopie. Le vrai progrès n’étant possible que par la paix, les nations civilisées comprendront qu’il est de leur intérêt commun de régler leurs différends d’une manière plus rationnelle. Déjà ne voyons-nous pas combien une grande guerre est devenue difficile en Europe, grâce à cet équilibre savamment établi qui fait porter tout le poids sur le point menacé ?
Le XVe et le XVIe siècles en Italie, furent des époques atroces, et ils virent le réveil de l’esprit humain. L’orage n’est pas mauvais pour la croissance des grands arbres ; de très belles choses se créent dans des temps très durs.
L’État ne saurait rester indifférent au bien, puisque ses actes, surtout quand il rend la justice, supposent la distinction du bien et du mal. Peut-il davantage rester indifférent au vrai ! Non certes. Les conditions des sociétés modernes, au point de vue de la guerre, relèvent essentiellement de la science, et la nation qui se mettrait en dehors de la haute culture serait infailliblement vaincue et conquise. La beauté n’est que l’éclat du bien et du vrai, une civilisation complète ne saurait la négliger.
(Mélanges religieux et historiques, Œuvre posthume, 1904.)
L’homme sérieux ne se mêle d’une manière active aux affaires de son temps que s’il y est appelé par sa naissance ou par le vœu spontané de ses concitoyens. Il faut une grande présomption ou beaucoup de légèreté de conscience pour prendre, de gaieté de cœur, la responsabilité des choses humaines quand on n’y est pas obligé. Mais la réflexion spéculative n’implique pas la même témérité. Chacun, dans sa mesure, a pour devoir de songer au bien public et d’y pousser de toute sa force. Celui qui s’occupe des sciences historiques est particulièrement tenu à ce genre d’application. Car, bien que la connaissance du présent soit moins instructive que celle du passé, le présent est aussi une des faces de la réalité ; il mérite d’être étudié. Laisser un pareil soin à ceux qu’on appelle « les hommes politiques » serait chose fâcheuse. L’homme politique est d’ordinaire un homme de parti et de passion. Il est très mal placé pour juger les ensembles, comparer les temps et les pays divers, saisir les mouvements à longue portée et prévoir l’avenir.
(Questions contemporaines, 1868.)
La force d’une société réside en deux choses : d’abord, la vertu populaire, ce grand réservoir de dévouement, de sacrifice, de force morale instinctive, que les races nobles portent en elles, comme un héritage de leurs ancêtres ; en second lieu, l’instruction et le sérieux des classes supérieures. La guerre, dans les temps modernes, étant devenue un problème scientifique et moral, une affaire de dévouement et d’industrie savante, est en somme un bon critérium de ce que vaut une race. Les armées ne pouvant plus guère être que la levée en masse des nations, les frais qu’elles entraînent étant énormes, le principe des grandes nationalités fondées sur un réel patriotisme sera de plus en plus la loi du monde. Une nation sans élan, sans mobile élevé, sans affection pour son gouvernement, sera bien vite lassée de ce jeu terrible. Le perfectionnement des armes, d’un autre côté, étant devenu une des mille applications de la science, mettra de plus en plus la force entre les mains de la raison, qui maîtrise la matière et crée par l’instruction un peuple digne de servir l’esprit. La nation la plus scientifique, celle qui aura les meilleurs mécaniciens, les meilleurs chimistes, les corps officiels les moins routiniers et les moins jaloux, sera la mieux armée. La barbarie, c’est-à-dire la force brute, sans intelligence, est vaincue pour toujours. La victoire définitive sera au peuple le plus instruit et le plus moral, en entendant par moralité la capacité de sacrifice, l’amour du devoir.
(Questions contemporaines.)
Du moment qu’on a rejeté le principe du droit divin des dynasties, il n’y a plus de solide que le principe du droit des peuples ; or, les peuples n’ont d’existence qu’en tant qu’ils sont des groupes naturels formés par la communauté des intérêts. Au lieu de se haïr et de se contrarier, que les nations s’étudient les unes les autres, profitent tour à tour de leurs expériences. Les deux conditions essentielles du salut du monde moderne, les deux conditions qui feront (telle est ma ferme confiance) que la destinée de notre civilisation ne sera pas de disparaître, comme les civilisations de l’antiquité, après un éclat passager, sont, d’une part, la division de l’Europe en plusieurs États, garantie de sa liberté, et, d’autre part, cette profonde fraternité qui fait que les esprits des races les plus diverses s’entendent dans la grande unité de la science, de l’art, de la poésie, de la religion. C’est la Grèce, à la fois si puissante par la solidarité du génie et si divisée en politique, qui doit être notre modèle, et non cet empire romain qui fit périr la civilisation antique sous l’étreinte de son effrayante unité.
(Questions contemporaines.)
Si la France n’est pas mûre pour la liberté, elle ne le sera jamais. L’éducation politique ne se fait point par le despotisme ; un peuple qui a longtemps subi le système administratif s’y enfonce toujours de plus en plus. Je ne me fais pas d’illusion sur les inconvénients qu’entraînerait d’abord un régime qui, pour être bienfaisant, a besoin qu’on en sache longtemps attendre les conséquences ; mais je crois pouvoir dire sans paradoxe que le mal qui résulte de la liberté vaut mieux en un sens que le bien qui résulte du régime administratif. Le bien n’est le bien que quand il sort de la conscience des individus ; le bien imposé du dehors aboutit à la longue au mal suprême, qui est pour une nation la léthargie, le matérialisme vulgaire.
On arrive ainsi de toutes parts à regarder la liberté comme la solution par excellence et comme le remède à presque tous les maux de notre temps. Bien des personnes se sont habituées, sur la foi de quelques sectaires, à croire que la liberté ne convient qu’aux époques où, personne n’étant sûr de posséder la vérité, aucune opinion n’a le droit de repousser les autres d’une manière absolue. C’est là une grave erreur. La liberté est en tout temps la base d’une société durable. D’une part, en effet, la vérité ne se démontre qu’à des auditeurs libres ; d’une autre, la possibilité de mal faire est la condition essentielle du bien. Le monde moderne ne peut échapper au sort des civilisations antiques qu’en laissant à chacun le droit entier de faire valoir à sa guise le talent qu’il a reçu du maître. La dignité de l’homme est en raison de sa responsabilité. Que chacun tienne donc sa destinée entre ses mains ; que la société prenne garde, en prévenant le mal, de rendre du même coup le bien impossible. Quand même il faudrait acheter de nouveau la liberté au prix de la barbarie, plusieurs pensent qu’elle ne serait pas trop chèrement achetée ; car seule la liberté donne aux individus un motif de vivre, et seule elle empêche les nations de mourir.
(Questions contemporaines.)
Dans les voies nouvelles où est entré l’esprit européen depuis cent ans, la France cesserait de garder son rang, si elle s’en tenait à ses vieilles traditions de spirituelle légèreté. Admettons que la France soit aujourd’hui aussi spirituelle qu’elle l’était autrefois ; il est bien sûr au moins que son genre d’esprit n’est pas aussi goûté. Ce n’est plus cet esprit qui fait la loi en Europe. Le groupe nombreux d’hommes intelligents qui travaillent avec ardeur et succès à tirer l’Angleterre de ses habitudes arriérées est tourné tout entier du côté de l’Allemagne. L’Italie, la Grèce, qui s’éveillent, ne vont pas à l’école de la France ; elles vont à l’école de l’Allemagne. La Russie y est depuis cent ans et y reste. Or, c’est justement le privilège de la France de savoir se plier à tout et d’exceller même en ce qu’elle emprunte. La France, à l’heure qu’il est, est assez ignorante : elle croit qu’on lui dit des choses hardies quand on lui parle de choses élémentaires ; mais, qu’on ne s’y trompe pas, demain, elle sera passée maîtresse. On dirait une femme qui d’abord vous écoute sans vous comprendre, puis tout à coup vous prouve par un mot juste, vif, profond, qu’elle a tout compris, et qu’en un moment elle a deviné ce qui vous a coûté de longs efforts. En une heure, la France peut ainsi réparer toutes ses fautes passées. Il y a dans le naïf étonnement que lui inspirent les nouvelles études quelque chose de si spirituel, qu’un pédant même en serait désarmé. Seulement, ne nous imaginons pas que, pour soutenir notre réputation, nous soyons obligés d’être superficiels. Nos pères ne l’étaient pas tant qu’on le dit ; en tout cas, ils l’étaient sans effort. La légèreté a un premier charme ; mais il n’y faut pas trop appuyer. Gardons-nous de ce que madame de Staël a quelque part appelé le pédantisme de la légèreté.
Certes il serait fort puéril d’espérer que la France modifiera son caractère ; il serait même téméraire de le souhaiter. Elle est charmante comme elle est. Aurait-on la baguette des fées, il faudrait trembler avant de toucher à ces choses complexes où tout se tient, où les qualités sortent des défauts, et où l’on ne peut rien changer sans faire crouler l’ensemble. Mais le moyen d’être vraiment soi-même n’est pas de cultiver ses défauts. La grandeur de la France est de renfermer les pôles opposés. La France est la patrie de Casaubon, de Descartes, de Saumaise, de Du Cange, de Fréret. La France a été une nation sérieuse aux époques où elle était la plus spirituelle ; on pourrait même soutenir qu’elle était plus spirituelle quand elle était plus sérieuse, et que ce qu’elle a perdu en solidité, elle ne l’a pas gagné en véritable agrément. Gardons, je le veux bien, la tradition de l’esprit français, mais gardons-la tout entière. N’espérons pas surtout que nous exercerions désormais sur l’Europe l’action que nous avons exercée au XVIIe et au XVIIIe siècle en nous renfermant dans nos vieilles habitudes. La culture intellectuelle de l’Europe est un vaste échange où chacun donne et reçoit à son tour, où l’écolier d’hier devient le maître d’aujourd’hui. C’est un arbre où chaque branche participe à la vie des autres, où les seuls rameaux inféconds sont ceux qui s’isolent et se privent de la communion avec le tout.
(Questions contemporaines.)
Notre amabilité seule suffit pour faire de nous de mauvais républicains. Les charmantes exagérations de la vieille politesse française, la courtoisie qui nous met aux pieds de ceux avec qui nous sommes en rapport, sont le contraire de cette raideur, de cette âpreté, de cette sécheresse que donne au démocrate le sentiment perpétuel de son droit. La France n’excelle que dans l’exquis, elle n’aime que le distingué, elle ne sait faire que de l’aristocratique. Nous sommes une race de gentilshommes ; notre idéal a été créé par des gentilshommes, non, comme celui de l’Amérique, par d’honnêtes bourgeois, de sérieux hommes d’affaires. De telles habitudes ne sont satisfaites qu’avec une haute société, une cour et des princes du sang. Espérer que les grandes et fines œuvres françaises continueraient de se produire dans un monde bourgeois, n’admettant d’autre inégalité que celle de la fortune, c’est une illusion. Les gens d’esprit et de cœur qui dépensent le plus de chaleur pour l’utopie républicaine seraient justement ceux qui pourraient le moins s’accommoder d’une pareille société. Les personnes qui poursuivent si avidement l’idéal américain oublient que cette race n’a pas notre passé brillant, qu’elle n’a pas fait une découverte de science pure ni créé un chef-d’œuvre, qu’elle n’a jamais eu de noblesse, que le négoce et la fortune l’occupent tout entière. Notre idéal à nous ne peut se réaliser qu’avec un gouvernement donnant de l’éclat à ce qui approche de lui, et créant des distinctions en dehors de la richesse. Une société où le mérite d’un homme et sa supériorité sur un autre ne peuvent se révéler que sous forme d’industrie et de commerce nous est antipathique ; non que le commerce et l’industrie ne nous paraissent honnêtes, mais parce que nous voyons bien que les meilleures choses (par exemple, les fonctions du prêtre, du magistrat, du savant, de l’artiste et de l’homme de lettres sérieux) sont l’inverse de l’esprit industriel et commercial, le premier devoir de ceux qui s’y adonnent étant de ne pas chercher à s’enrichir, et de ne jamais considérer la valeur vénale de ce qu’ils font.
(La Réforme intellectuelle et morale.)
La colonisation en grand est une nécessité politique tout à fait de premier ordre. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche et du pauvre. La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure, qui s’y établit pour le gouverner, n’a rien de choquant. L’Angleterre pratique ce genre de colonisation dans l’Inde, au grand avantage de l’Inde, de l’humanité en général, et à son propre avantage. La conquête germanique du Ve et du VIe siècle est devenue en Europe la base de toute conservation et de toute légitimité. Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures ou abâtardies par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité. L’homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé ; sa lourde main est bien mieux faite pour manier l’épée que l’outil servile. Plutôt que de travailler, il choisit de se battre, c’est-à-dire qu’il revient à son premier état. Regere imperio populos, voilà notre vocation. Versez cette dévorante activité sur des pays qui, comme la Chine, appellent la conquête étrangère. Des aventuriers qui troublent la société européenne faites un ver sacrum, un essaim comme ceux des Francs, des Lombards, des Normands ; chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d’ouvriers : c’est la race chinoise, d’une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment d’honneur : gouvernez-la avec justice, en prélevant d’elle pour le bienfait d’un tel gouvernement un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite ; — une race de travailleurs de la terre, c’est le nègre ; soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l’ordre ; — une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l’ergastule comme des nègres et des Chinois, elle se révolte. Tout révolté est chez nous, plus ou moins, un soldat qui a manqué sa vocation, un être fait pour la vie héroïque, et que vous appliquez à une besogne contraire à sa race, mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or la vie qui révolte nos travailleurs rendrait heureux un Chinois, un fellah, êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait, et tout ira bien. Les économistes se trompent en considérant le travail comme l’origine de la propriété. L’origine de la propriété, c’est la conquête et la garantie donnée par le conquérant aux fruits du travail autour de lui. Les Normands ont été en Europe les créateurs de la propriété ; car, le lendemain du jour où ces bandits eurent des terres, ils établirent pour eux et pour tous les gens de leur domaine un ordre social et une sécurité qu’on n’avait pas vus jusque-là.
(La Réforme intellectuelle et morale.)
Le monde marche vers une sorte d’américanisme qui blesse nos idées raffinées, mais qui, une fois les crises de l’heure actuelle passées, pourra bien n’être pas plus mauvais que l’ancien régime pour la seule chose qui importe, c’est-à-dire l’affranchissement et le progrès de l’esprit humain. Une société où la distinction personnelle a peu de prix, où le talent et l’esprit n’ont aucune cote officielle, où la haute fonction n’ennoblit pas, où la politique devient l’emploi des déclassés et des gens de troisième ordre, où les récompenses de la vie vont de préférence à l’intrigue, à la vulgarité, au charlatanisme qui cultive l’art de la réclame, à la rouerie qui serre habilement les contours du Code pénal, une telle société, dis-je, ne saurait nous plaire. Nous avons été habitués à un système plus protecteur, à compter davantage sur le gouvernement pour patronner ce qui est noble et bon. Mais par combien de servitudes n’avons-nous pas payé ce patronage ! Richelieu et Louis XIV regardaient comme un devoir de pensionner les gens de mérite du monde entier ; combien ils eussent mieux fait, si le temps l’eût permis, de laisser les gens de mérite tranquilles, sans les pensionner ni les gêner ! Le temps de la Restauration passe pour une époque libérale ; or certainement nous ne voudrions plus vivre sous un régime qui fit gauchir un génie comme Cuvier, étouffa en de mesquins compromis l’esprit si vif de M. Cousin, retarda la critique de cinquante ans. Les concessions qu’il fallait faire à la cour, à la société, au clergé étaient pires que les petits désagréments que peut nous infliger la démocratie.
(Souvenirs d’enfance et le jeunesse, 1883.)
Dès 1855, on put déjà reconnaître que le progrès, comme l’entendent les sociétés modernes, vient d’en haut et non d’en bas, de la raison et non de l’imagination, du bon sens et non de l’enthousiasme, des hommes sensés et non des illuminés qui cherchent dans de chimériques rapprochements les secrets de la destinée. Certes, le penseur ne peut que saluer avec respect l’homme qui, pénétré d’une haute idée de la vie humaine, proteste contre l’imperfection nécessaire de tout état social et rêve une loi idéale conforme aux nobles besoins de son cœur ; mais tous les efforts humains ne sauraient dépasser la limite du possible. Le monde est le résultat de causes trop compliquées pour qu’on puisse espérer de le faire tenir dans les cadres d’un système absolu. Aucun symbole ne saurait exprimer la marche de l’humanité dans le passé, encore moins contenir la règle de son avenir.
(Nouvelles Études d’histoire religieuse, 1884.)
L’intérêt personnel n’inspire que la lâcheté ; la vanité ne produit rien de solide. L’intérêt personnel et la vanité n’ont ni conseillé un progrès, ni supprimé un abus. On ne se sacrifie que par un acte de foi. Un acte de courage est un acte de foi au premier chef. La certitude de la récompense tuerait le mérite. Nous n’estimons ainsi la haute moralité que si elle a traversé le doute ; nous ne voulons nous décider pour le bien qu’après nous être fait contre lui les avocats du mal. Nous consentons à nous soumettre à l’impératif du devoir, mais à condition qu’il soit bien entendu que nous voyons la faiblesse des arguments qui l’appuient. Là est le secret de l’empire qu’exerce sur nous la femme avec la simplicité de sa foi, son ignorance, sa naïveté d’affirmation. Elle voit au fond mieux que nous. Aucune mère n’a besoin d’un système de philosophie morale pour aimer son enfant. Aucune jeune fille de bonne race n’est chaste en vertu d’une théorie. De même aucun homme courageux ne court à la mort mû par un raisonnement. Nous faisons le bien sans être sûrs qu’en le faisant nous ne sommes pas dupes ; et saurions-nous de science certaine que nous le sommes, nous ferions le bien tout de même. Ces milliers d’êtres que l’univers immole à ses fins marchent bravement à l’autel. Le philosophe qui voit le plus clairement la vanité de toute chose est capable d’être un parfait honnête homme et même, à son jour, un héros.
(Le Prêtre de Nemi, 1885.)
Cette œuvre[18] est bonne, d’abord pour notre chère patrie, que nous devons d’autant plus aimer qu’on la déchire, qu’on la méconnaît davantage. Elle est bonne aussi pour l’humanité. La conservation, la propagation de la langue française importent à l’ordre général de la civilisation. Quelque chose d’essentiel manquerait au monde le jour où ce grand flambeau, clair et pétillant, cesserait de briller. L’humanité serait amoindrie, si ce merveilleux instrument de civilisation venait à disparaître ou à s’amoindrir.
[18] La propagation de la langue française.
Que de choses éternellement bonnes et vraies, mesdames et messieurs, ont été pour la première fois dites en français, ont été frappées en français, ont fait leur apparition dans le monde en français ! Que d’idées libérales et justes ont trouvé tout d’abord en français leur formule, leur définition véritables ! Comme notre langue a dit de belles et bonnes choses, depuis ses bégayements du XIIe siècle jusqu’à nos jours ! L’abolition du servage, les droits de l’homme, l’égalité, la liberté, ont été pour la première fois proclamés en français…
Un fait bien significatif, justement, est le sentiment général des partis rétrogrades, dans le monde entier, pour le français. Ils en ont peur ; ils se barricadent contre lui. On dirait que cette langue porte la peste avec elle, la peste selon les réactionnaires, bien entendu. Allez, allez toujours ! Pauvre France ! Elle aura encore son heure. Qui sait si les propositions de paix et de liberté, qui tireront l’Europe de l’affreux état de haine et de préparatifs militaires où elle est, ne seront pas formulées en français ?
Voilà pourquoi le français peut vraiment être appelé une langue classique, un instrument de culture et de civilisation pour tous. Cette langue améliore ; elle est une école ; elle a le naturel, la bonhomie, elle sait rire, elle porte avec elle un aimable scepticisme mêlé de bonté (sans bonté le scepticisme est une très mauvaise chose). Le fanatisme est impossible en français. J’ai horreur du fanatisme, je l’avoue, surtout du fanatisme musulman ; eh bien ! ce grand fléau cessera par le français. Jamais un musulman qui sait le français ne sera un musulman dangereux. C’est une langue excellente pour douter ; or, le doute sera peut-être dans l’avenir une chose fort nécessaire. Concevez-vous Montaigne, Pascal, Molière, Voltaire, autrement qu’en français ? Ah ! mesdames et messieurs, que de joie s’en irait de ce monde, le jour où le français s’en irait ! Conservez-le, conservez-le.
Conférence faite à l’Alliance pour la propagation de la langue française, le 2 février 1888.
(Feuilles détachées, 1892.)
Il n’y a pas à raisonner avec celui qui pense que l’histoire est une agitation sans but, un mouvement sans résultante. On ne prouvera jamais la marche de l’humanité à celui qui n’est point arrivé à la découvrir. C’est là le premier mot du symbole du XIXe siècle, l’immense résultat que la science de l’humanité a conquis depuis un siècle. Au-dessus des individus, il y a l’humanité, qui vit et se développe comme tout être organique, et qui, comme tout être organique, tend au parfait, c’est-à-dire à la plénitude de son être. Après avoir marché de longs siècles dans la nuit de l’enfance, sans conscience d’elle-même et par la seule force de son ressort, est venu le grand moment où elle a pris, comme l’individu, possession d’elle-même, où elle s’est reconnue, où elle s’est sentie comme unité vivante ; moment à jamais mémorable que nous ne voyons pas, parce qu’il est trop près de nous, mais qui constituera, ce me semble, aux yeux de l’avenir, une révolution comparable à celle qui a marqué une nouvelle ère dans l’histoire de tous les peuples. Il y a à peine un demi-siècle que l’humanité s’est comprise et réfléchie, et l’on s’étonne que la conscience de son unité et de sa solidarité soit encore si faible ! La révolution française est le premier essai de l’humanité pour prendre ses propres rênes et se diriger elle-même. C’est l’avènement de la réflexion dans le gouvernement de l’humanité. C’est le moment correspondant à celui où l’enfant, conduit jusque-là par les instincts spontanés, le caprice et la volonté des autres, se pose en personne libre, morale et responsable de ses actes. On peut, avec Robert Owen, appeler tout ce qui précède période irrationnelle de l’existence humaine, et un jour cette période ne comptera dans l’histoire de l’humanité, et dans celle de notre nation en particulier, que comme une curieuse préface, à peu près ce qu’est à l’histoire de France ce chapitre dont on la fait d’ordinaire précéder sur l’histoire des Gaules. La vraie histoire de France commence à 89 ; tout ce qui précède est la lente préparation de 89, et n’a d’intérêt qu’à ce prix. Parcourez en effet l’histoire, vous ne trouverez rien d’analogue à ce fait immense que présente tout le XVIIIe siècle : des philosophes, des hommes d’esprit, ne s’occupant nullement de politique actuelle, qui changent radicalement le fond des idées reçues, et opèrent la plus grande des révolutions, et cela avec conscience, réflexion, sur la foi de leurs systèmes. La Révolution de 89 est une révolution faite par des philosophes. Condorcet, Mirabeau, Robespierre offrent le premier exemple de théoriciens s’ingérant dans la direction des choses et cherchant à gouverner l’humanité d’une façon raisonnable et scientifique. Tous les membres de la Constituante, de la Législative et de la Convention étaient à du lettre et presque sans exception des disciples de Voltaire et de Rousseau. Je dirai bientôt comment le char dirigé par de telles mains ne pouvait d’abord être si bien conduit que quand il marchait tout seul, et comment il devait aller se briser dans un abîme. Ce qu’il importe de constater, c’est cette incomparable audace, cette merveilleuse et hardie tentative de réformer le monde conformément à la raison, de s’attaquer à tout ce qui est préjugé, établissement aveugle, usage en apparence irrationnel, pour y substituer un système calculé comme une formule, combiné comme une machine artificielle. Cela, dis-je, est unique et sans exemple dans tous les siècles antérieurs ; cela constitue un âge dans l’histoire de l’humanité.
Certes une pareille tentative ne pouvait être de tout point irréprochable. Car ces institutions qui semblent si absurdes, ne le sont pas au fond autant qu’elles le paraissent : ces préjugés ont leur raison, que vous ne voyez pas. Le principe est incontestable : l’esprit seul doit régner, l’esprit seul, c’est-à-dire la raison, doit gouverner le monde. Mais qui vous dit que votre analyse est complète, que vous n’êtes point amené à nier ce que vous ne comprenez pas, et qu’une philosophie plus avancée n’arrivera point à justifier l’œuvre spontanée de l’humanité ? Il est facile de montrer que la plupart des préjugés sur lesquels reposait l’ancienne société, le privilège de la noblesse, le droit d’aînesse, la légitimité, etc., sont irrationnels et absurdes au point de vue de la raison abstraite, que dans une société normalement constituée, de telles superstitions n’auraient point de place. Cela a une clarté analytique et séduisante comme l’aimait le XVIIIe siècle. Mais est-ce une raison pour blâmer absolument ces abus dans le vieil édifice de l’humanité, où ils entrent comme partie intégrante ? Il est certain que la critique de ces premiers réformateurs fut, sur plusieurs points, aigre, inintelligente du spontané, trop orgueilleuse des faciles découvertes de la raison réfléchie.
(L’Avenir de la Science, 1890.)
Si la plupart de ceux qui exercent les fonctions réputées serviles sont réellement abrutis, c’est qu’ils ont la tête vide, c’est qu’on ne les applique à ces nullités que parce qu’ils sont incapables du reste, c’est que cette fonction, purement animale, quelque insignifiante qu’elle soit, les absorbe et les abâtardit encore davantage. Mais s’ils avaient la tête pleine de littérature, d’histoire, de philosophie, d’humanisme, en un mot, s’ils pouvaient, en travaillant, causer entre eux de choses supérieures, quelle différence ! Plusieurs hommes dévoués aux travaux de l’esprit, s’imposent journellement un nombre d’heures d’exercices hygiéniques, quelquefois assez peu différents de ceux que les ouvriers accomplissent par besoin, ce qui, apparemment, ne les abrutit pas. Dans cet état que je rêve, le travail manuel serait la récréation du travail de l’esprit. Que si l’on m’objecte qu’il n’est aucun métier auquel on puisse suffire avec quatre ou cinq heures d’occupation par jour, je répondrai que, dans une société savamment organisée, où les pertes de temps inutiles et les superfluités improductives seraient éliminées, où tout le monde travaillerait efficacement, et surtout où les machines seraient employées non pour se passer de l’ouvrier, mais pour soulager ses bras et abréger ses heures de travail, dans une telle société, dis-je, je suis persuadé (bien que je ne sois nullement compétent en ces matières), qu’un très petit nombre d’heures de travail suffirait pour le bien de la société, et pour les besoins de l’individu : le reste serait à l’esprit. « Si chaque instrument, dit Aristote, pouvait, sur un ordre reçu ou même deviné, travailler lui-même, comme les statues de Dédale ou les trépieds de Vulcain, qui se rendaient seuls, dit le poète, aux réunions des Dieux, si les navettes tissaient toutes seules, si l’archet jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d’ouvriers et les maîtres d’esclaves. »
Cette simultanéité de deux vies, n’ayant rien de commun l’une avec l’autre, à cause de l’infini qui les sépare, n’est nullement sans exemple. J’ai souvent éprouvé que je ne vivais jamais plus énergiquement par l’imagination et par la sensibilité que quand je m’appliquais à ce que la science a de plus technique et en apparence de plus aride. Quand l’objet scientifique a par lui-même quelque intérêt esthétique ou moral, il occupe tout entier celui qui s’y occupe ; quand, au contraire, il ne dit absolument rien à l’imagination et au cœur, il laisse ces deux facultés libres de vaguer à leur aise. Je conçois, dans l’érudit, une vie de cœur très active, et d’autant plus active que l’objet de son érudition offrira moins d’aliment à sa sensibilité : ce sont alors comme deux rouages parfaitement indépendants l’un de l’autre. Ce qui tue, c’est le partage. Le philosophe est possible dans un état qui ne réclame que la coopération de la main, comme le travail des champs. Il est impossible, dans une position où il faut dépenser de son esprit et s’occuper sérieusement de choses mesquines, comme le négoce, la banque, etc. Effectivement, ces professions n’ont pas produit un seul homme qui marque dans l’histoire de l’esprit humain.
(L’Avenir de la Science.)
Le but de l’humanité n’est pas le repos : c’est la perfection intellectuelle et morale. Il s’agit bien de se reposer, grand Dieu ! quand on a l’infini à parcourir et le parfait à atteindre. L’humanité ne se reposera que dans le parfait. Il serait par trop étrange que quelques profanes, par des considérations de bourse ou de boutique, arrêtassent le mouvement de l’esprit, le vrai mouvement religieux. L’état le plus dangereux pour l’humanité serait celui où la majorité se trouvant à l’aise et ne voulant pas être dérangée, maintiendrait son repos au dépens de la pensée et d’une minorité opprimée. Ce jour-là il n’y aurait plus de salut que dans les instincts moraux de la nature humaine, lesquels sans doute ne feraient pas défaut.
La force de traction de l’humanité a résidé jusqu’ici dans la minorité. Ceux qui se trouvent bien du monde tel qu’il est ne peuvent aimer le mouvement, à moins qu’ils ne s’élèvent au-dessus des vues d’intérêt personnel. Ainsi plus s’accroît le nombre des satisfaits de la vie, plus l’humanité devient lourde et difficile à remuer ; il faut la traîner. Le bien de l’humanité étant la fin suprême, la minorité ne doit nullement se faire scrupule de mener contre son gré, s’il le faut, la majorité sotte ou égoïste. Mais pour cela il faut qu’elle ait raison. Sans cela, c’est une abominable tyrannie. L’essentiel n’est pas que la volonté du plus grand nombre se fasse, mais que le bien se fasse. Quoi ! des gens qui, pour gagner quelques sous de plus, sacrifieraient l’humanité et la patrie, auraient le droit de dire à l’esprit : Tu n’iras pas plus loin ; n’enseigne pas ceci, car cela pourrait remuer les esprits et faire tort à notre commerce. La seule portion de l’humanité qui mérite d’être prise en considération, c’est la partie active et vivante, c’est-à-dire celle qui ne se trouve pas à l’aise.
(L’Avenir de la Science.)
Je pousse si loin le respect de l’individualité que je voudrais voir les femmes introduites pour une part dans le travail critique et scientifique, persuadé qu’elles y ouvriraient des aperçus nouveaux, que nous ne soupçonnons pas. Si nous sommes meilleurs critiques que les savants du XVIIe siècle, ce n’est pas que nous sachions davantage, mais c’est que nous voyons de plus fines choses. Eh bien, je suis persuadé que les femmes porteraient là leur individualité, et réfracteraient l’objet en couleurs nouvelles. Les socialistes se trompent grossièrement sur le rôle intellectuel de la femme : ils voudraient en faire un homme. Or, la femme ne sera jamais qu’un homme très médiocre. Il faut qu’elle reste ce qu’elle est, mais qu’elle soit éminemment ce qu’elle est. Elle est diverse de l’homme, mais non inférieure à l’homme. Une femme parfaite vaut un homme parfait. Mais elle doit être parfaite à se manière, et non en ressemblant à l’homme. Elle en diffère comme l’électricité négative et l’électricité positive, c’est-à-dire par le sens et la direction, non par l’essence. Le négatif n’est pas inférieur au positif, mais il va en sens contraire : toute quantité peut être indifféremment considérée comme négative ou positive. Le négatif et le positif réunis forment le complet, ce qui ne désire plus rien. Toute chose désire son complément : le positif attire nécessairement le négatif, l’angle rentrant appelle l’angle saillant. Ainsi la vie est partagée, tous ont la meilleure part, et il y a place pour l’amour.
(L’Avenir de la Science.)
Je suppose une pensée aussi originale et aussi forte que celle du christianisme primitif apparaissant de nos jours. Il semble au premier coup d’œil qu’elle n’aurait aucune chance de fortune. L’égoïsme est dominant, le sens du grand dévouement et de l’apostolat désintéressé est perdu. Le siècle paraît n’obéir qu’à deux mobiles, l’intérêt et la peur. A cette vue, une grande tristesse saisit l’âme : c’en est donc fait ! Il faut renoncer aux grandes choses ; les généreuses pensées ne vivront plus que dans le souvenir des rhéteurs ; la religion ne sera plus qu’un frein que la peur des classes riches saura manier. La mer de glace s’étend et s’épaissit sans cesse. Qui pourra la percer ?
Ames timides, qui désespérez ainsi de l’humanité, remontez avec moi dix-huit cents ans. Placez-vous à cette époque où quelques inconnus fondaient en Orient le dogme qui, depuis, a régi l’humanité. Jetez un regard sur ce triste monde qui obéit à Tibère ; dites-moi s’il est bien mort. Chantez donc encore une fois l’hymne funèbre de l’humanité : elle n’est plus, le froid lui a monté au cœur. Comment ces pauvres enthousiastes rendraient-ils la vie à un cadavre, et sans levier soulèveraient-ils un monde ? Eh bien, ils l’ont fait : trois cents ans après, le dogme nouveau était maître et quatre cents ans après, il était tyran à son tour.
Voilà notre triomphante réponse. L’état de l’humanité ne sera jamais si désespéré que nous ne puissions dire : Bien des fois déjà on l’a crue morte ; la pierre du tombeau semblait à jamais scellée, et le troisième jour, elle est ressuscitée !
(L’Avenir de la Science.)
Le ministre, M. Léon Bourgeois, termine au Sénat, répondant à l’interpellation de M. Fresneau, par la lecture d’une lettre[19] de M. Renan, qu’il avait consulté.
[19] Cette lettre est le dernier morceau que publia Ernest Renan avant sa mort, survenue le 2 octobre 1892. On l’a insérée dans ce volume pour cette raison, mais surtout parce que Renan, considérant le Collège de France comme un rouage essentiel de la vie intellectuelle française, il a paru qu’elle était à sa place dans ce volume.
« … L’expression « l’enseignement que l’on donne au Collège de France » nous a un peu blessés. Nous ne donnons pas un enseignement dogmatique. Nous exposons l’état de la science et les efforts que nous faisons pour faire avancer les questions à l’ordre du jour. Nos auditeurs restent entièrement libres de former leur jugement. Nous leur fournissons pour cela les éléments avec une entière impartialité.
» Cette impartialité, qui est le premier devoir du professeur au Collège de France, se retrouve dans l’ensemble des chaires qui composent notre établissement. Toutes les opinions sont représentées dans nos programmes. Le catholicisme et les opinions les plus conservatrices en philosophie ont chez nous leurs organes. Nous avons eu des maîtres illustres appartenant au protestantisme, à l’israélitisme, à toutes les nuances de la croyance et de la libre-pensée.
» Par votre dernière nomination, vous avez ajouté à toutes ces nuances le positivisme qui, par la place qu’il s’est faite dans le monde contemporain, méritait bien d’avoir aussi sa place parmi nous. Le professeur au Collège de France peut, individuellement, appartenir à telle société religieuse ou philosophique que bon lui semble. En tant que professeur au Collège de France, il n’est d’aucune secte : il est l’homme de la vérité. L’enseignement d’une chaire peut contredire directement l’enseignement d’une autre chaire. Cette variété infinie d’opinion n’empêche pas la plus parfaite confraternité de régner parmi nous ; le public ne paraît pas non plus s’en plaindre ; il trouve dans ces apparentes dissonances la preuve que rien ne lui est caché, et qu’on le met à même de former son opinion en toute liberté.
» Liberté, telle est en effet la loi fondamentale d’un pareil établissement de la part de l’auditeur et de la part du professeur. Le professeur au Collège de France doit respecter tous les symboles, mais il ne doit se tenir lié par aucun. S’il lui arrive d’être en désaccord avec une des opinions religieuses ou philosophiques établies, qu’y faire ? On ne peut être de l’avis de tout le monde. Si le professeur d’hébreu explique tel passage d’Isaïe selon l’interprétation des catholiques, il se mettra en contradiction avec les protestants et avec les israélites qui, dans une telle question, ont bien le droit d’être entendus. Qu’il tâche de se mettre d’accord avec la philologie et la critique, et il aura rempli son devoir.
» Un tel enseignement, neutre entre les diverses opinions théoriques qui se partagent le monde, est ainsi l’image de l’État lui-même, qui, dans ses établissements de haut enseignement, n’a pour mission que d’ouvrir des arènes aux opinions diverses, sans pencher lui-même vers l’une ou vers l’autre.
» Quand l’État fonde ou entretient une chaire, cela ne veut pas dire qu’il garantit pour vrai l’enseignement donné dans cette chaire, mais qu’il le juge utile dans l’état présent de la science.
» L’État n’a pas une chimie, une médecine, une histoire ; mais il tâche de faire ce qu’il faut pour que, dans chaque ordre, les études scientifiques soient en progrès. Tout cela en vertu de ce principe que la vérité scientifique est d’un grand intérêt pour la société et que l’État doit faire, en vue de la recherche originale, quelques sacrifices.
» Ces hauts enseignements libres tiennent une nation à la tête de son siècle, et seuls ils empêchent l’erreur, l’imposture, la superstition de reconquérir le terrain qu’elles ont perdu et qu’elles espèrent toujours reprendre. »
Le ministre, M. Léon Bourgeois, déclare qu’il se reprocherait de rien ajouter à ce magnifique langage : le gouvernement maintiendra le Collège de France comme la place forte de la liberté de l’enseignement individuel.
(Le Temps, 26 mars 1892.)
Paris, 11 décembre 1868[20].
[20] Cette lettre a été adressée à Victor Considérant, disciple de Fourier. Elle a été publiée par madame C. Coignet dans sa brochure sur Victor Considérant, sa vie, son œuvre. Paris, Alcan, 1895.
Monsieur,
Je me suis souvent reproché d’avoir si longtemps attendu pour répondre à vos deux longues et belles lettres. L’achèvement de mon Saint Paul m’a si complètement absorbé cet été que je me suis mis en retard d’une manière scandaleuse avec tous mes devoirs. Pour répondre à de pareilles lettres, formant un véritable livre sur les matières les plus graves, il faudrait un livre aussi. M. Souvestre m’a dit que nous pouvions espérer de vous voir bientôt ; alors nous causerons à loisir, si vous le voulez bien, de ces problèmes dont le principal attrait est peut-être d’être insolubles, et néanmoins qui s’imposent si fortement à l’esprit humain. Vous avez consacré votre vie à la discussion de questions sociales, et je comprends l’intérêt que les origines du christianisme vous inspirent. Ce grand mouvement fut, en effet, pour une part, un événement social, mais il fut, avant tout, un événement religieux, et c’est justement pour cela que l’élément de socialisme qu’il impliquait réussit. La solidité d’une fondation est en raison directe de la quantité de dévouement, de sacrifice, d’abnégation, qui a été déposée dans ses bases. Certains peuples anciens croyaient que, pour qu’un édifice durât, il fallait qu’un homme eût été enterré vivant dans ses fondations ; cela est assez vrai, du moins dans l’ordre moral. L’intérêt temporel ne suffit pas à tirer de l’homme le degré d’héroïsme nécessaire pour les œuvres communes durables et grandes. L’idéalisme aura-t-il un jour la force de faire ce que fit autrefois la croyance à un royaume de Dieu matériel et immédiat ? Il est beau, en tout cas, de protester à la façon des stoïciens de l’ancien monde. Par votre courage et votre vie toute dévouée à la poursuite de ce que vous concevez comme l’idéal, vous vous êtes mis de la noble phalange.
Agréez l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
E. RENAN
rue Vaneau, 29.
En toute chose, mesdames et messieurs, revenons aux traditions qu’un christianisme éclairé et une saine philosophie sont d’accord pour nous enseigner. Le trait le plus glorieux de la France est qu’elle sait mieux qu’aucune autre nation voir ses défauts et se critiquer elle-même. En cela, nous ressemblons à Athènes, où les gens d’esprit passaient leur temps à médire de leur ville et à vanter les institutions de Sparte. Croyons que nous continuerions mal la brillante et spirituelle société des deux derniers siècles en n’étant que frivoles. C’est mal honorer ses ancêtres que de n’imiter que leurs défauts. Prenons garde de pousser à outrance ce jeu redoutable qui consiste à user sans rémission les forces vives d’un pays, à faire comme les cavaliers arabes qui poussent au galop leur cheval jusqu’au bord du précipice, se croyant toujours maîtres de l’arrêter. — Le monde ne tient debout que par un peu de vertu ; dix justes obtiennent souvent la grâce d’une société coupable ; plus la conscience de l’humanité se déterminera, plus la vertu sera nécessaire. L’égoïsme, la recherche avide de la richesse et des jouissances ne sauraient rien fonder. Que chacun donc fasse son devoir, messieurs. Chacun à son rang est le gardien d’une tradition qui importe à la continuation de l’œuvre divine ici-bas. Tous nous sommes frères en la raison, frères devant le devoir, frères devant Dieu. L’égalité absolue n’est pas dans la nature. Il y aura toujours des individus plus forts, plus beaux, plus riches, plus intelligents, plus doués que d’autres. C’est devant Dieu et devant le devoir que l’égalité est parfaite. A ce tribunal, le pauvre courageux et sans envie, l’homme simple mais dévoué, la femme obscure qui remplit bien sa tâche de tous les jours, sont supérieurs au riche qui éblouit le monde par son opulence, à l’homme vain qui remplit la terre de son nom. Il n’y a pas d’autre grandeur que celle du devoir accompli ; il n’y a pas non plus d’autre joie. Étrange est assurément la situation de l’homme placé entre les dictées impérieuses de la conscience morale et les incertitudes d’une destinée que la Providence a voulu couvrir d’un voile. Écoutons la conscience, croyons-la. Si, ce qu’à Dieu ne plaise ! le devoir était un piège tendu devant nous par un génie décevant, il serait beau d’y avoir été trompé. Mais il n’en est rien, et, pour moi, je tiens les vérités de la religion naturelle pour aussi certaines à leur manière que celles du monde réel. Voilà la foi qui sauve, la foi qui nous fait envisager autrement que comme une folle partie de joie les quatre jours que nous passons sur cette terre ; la foi qui nous assure que tout n’est pas vain dans les nobles aspirations de notre cœur ; la foi qui nous raffermit, et qui, si par moments les nuages s’amoncellent à l’horizon, nous montre, par delà les orages, des champs heureux où l’humanité, séchant ses larmes, se consolera un jour de ses souffrances.
La Part de la famille et de l’État dans l’éducation[21].
(La Réforme intellectuelle et morale.)
[21] Conférence faite dans l’ancien Cirque du Prince-Impérial, le 19 avril 1869.
FIN
| AVANT-PROPOS | |
FRANCE ET EUROPE | |
| L’ADHÉSION LIBRE | |
| LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE | |
| LETTRE A UN AMI D’ALLEMAGNE | |
| RICHELIEU | |
| L’ACTEUR D’ANTIOCHE | |
| LE GÉNÉRAL VICTORIEUX | |
| LA VIEILLE MÈRE | |
| AUX JEUNES GENS | |
| QU’EST-CE QU’UNE NATION ? | |
| LE LIBÉRALISME FRANÇAIS | |
| L’ALLIANCE ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE | |
| RÉSURRECTION | |
| APRÈS 1870 | |
| L’AVENIR DE LA FRANCE | |
| DÉMEMBREMENT | |
| IDÉES ALLEMANDES | |
| LES ÉTATS-UNIS D’EUROPE | |
| LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE | |
| LETTRE A M. STRAUSS | |
| NOUVELLE LETTRE A M. STRAUSS | |
| LETTRE A M. MORIZ CARRIÈRE | |
GUERRE DE 1870 | |
| DE LA CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE PENDANT LE SIÈGE | |
| LA DÉCISION DE LA FRANCE | |
| RÊVE DE SIFFROI | |
IDÉES POLITIQUES ET SOCIALES | |
| PENSÉES DÉTACHÉES | |
| L’HISTOIRE ET LE BIEN PUBLIC | |
| LA GUERRE | |
| LE DROIT DES PEUPLES | |
| LA LIBERTÉ | |
| LA TRADITION FRANÇAISE | |
| NOTRE IDÉAL | |
| LA COLONISATION | |
| DEUX SOCIÉTÉS | |
| LES CHIMÈRES | |
| L’ACTE DE FOI | |
| LE FRANÇAIS | |
| LA RÉVOLUTION FRANÇAISE | |
| LE TRAVAIL MANUEL | |
| LA MINORITÉ | |
| LA FEMME | |
| L’AVENIR DE L’HUMANITÉ | |
| LE COLLÈGE DE FRANCE | |
| A VICTOR CONSIDÉRANT | |
| LE DEVOIR | |
E. GREVIN — IMPRIMERIE DE LAGNY — 11076-4-21
DERNIÈRES PUBLICATIONS
vol. | |
ARTHUR-LÉVY | |
| Napoléon et Eugène de Beauharnais | 1 |
RENÉ BAZIN | |
| Baltus le Lorrain | 1 |
TRISTAN BERNARD | |
| Théâtre (tome IV) | 1 |
ALFRED BLANCHET | |
| Ma fille est si bien élevée ! | 1 |
JOHAN BOJER | |
| Les Émigrants | 1 |
GUY CHANTEPLEURE | |
| L’Inconnue bien-aimée | 1 |
MICHEL CORDAY | |
| Dernières Pages inédites d’Anatole France | 1 |
DOMINIQUE DUNOIS | |
| Le pauvre Désir des Hommes | 1 |
JACQUES FONTELROYE | |
| Des Morts au Soleil | 1 |
ANATOLE FRANCE | |
| La Vie en fleur | 1 |
JOHN GALSWORTHY | |
| Loyautés | 1 |
HENRI GRAMAIN | |
| Fanna la Nomade | 1 |
ANATOLE LE BRAZ | |
| Le Gardien du feu | 1 |
PIERRE LOTI | |
| Journal intime | 1 |
VALENTIN MANDELSTAMM | |
| Hollywood | 1 |
DMITRI MEREJKOVSKY | |
| La Fin d’Alexandre Ier | 1 |
JEAN MISTLER | |
| Châteaux en Bavière | 1 |
PIERRE DE NOLHAC | |
| Le Trianon de Marie-Antoinette | 1 |
GUILLAUME RUMORVAN | |
| Sonate comique | 1 |
GEORGE SAND | |
| Journal intime | 1 |
ANDRÉ SAVIGNON | |
| La Dame de la « Sainte-Alice » | 1 |
BERNARD SHAW | |
| Le Disciple du Diable | 1 |
MARCELLE TINAYRE | |
| Figures dans la nuit | 1 |
COLETTE YVER | |
| Le Festin des autres | 1 |