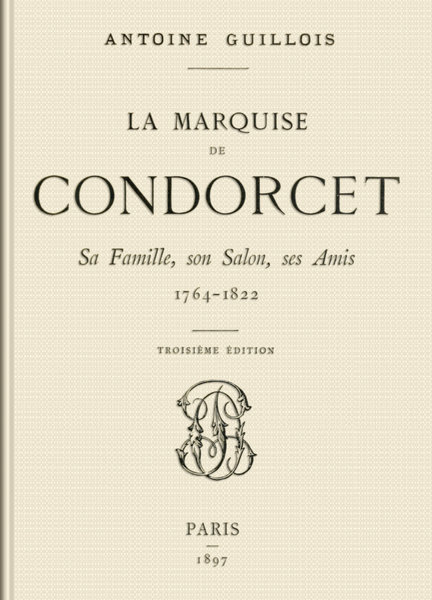
L’image de couverture a été réalisée pour cette édition
électronique.
Elle appartient au domaine public.
Title: La marquise de Condorcet: Sa Famille, son Salon, ses Amis, 1764-1822
Author: Antoine Guillois
Release date: October 10, 2020 [eBook #63435]
Most recently updated: October 18, 2024
Language: French
Credits: Produced by Clarity, Hans Pieterse and the Online
Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by The Internet Archive/Canadian Libraries)
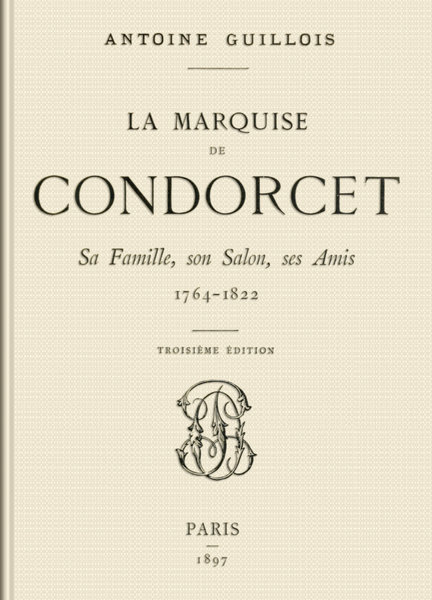
L’image de couverture a été réalisée pour cette édition
électronique.
Elle appartient au domaine public.
LA MARQUISE
DE
CONDORCET
DU MÊME AUTEUR
En préparation:
Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays, y compris la Suède et la Norvège.
S’adresser, pour traiter, à M. Paul Ollendorff, éditeur, 28 bis, rue de Richelieu, Paris.
ANTOINE GUILLOIS
Sa Famille, son Salon, ses Amis
1764-1822
TROISIÈME ÉDITION

PARIS
PAUL OLLENDORFF, ÉDITEUR
28 bis, RUE DE RICHELIEU, 28 bis
1897
Tous droits réservés.
IL A ÉTÉ TIRÉ
Dix exemplaires sur papier de Hollande
Numérotés à la presse
A Monsieur le Vicomte de GROUCHY
MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE
PETIT-NEVEU DE MADAME DE CONDORCET
Si vous ne m’aviez soutenu par vos encouragements de tous les jours, aidé par vos découvertes si heureuses, ce livre, mon cher ami, n’aurait sans doute jamais été publié.
J’aimerais écrire votre nom auprès du mien et consacrer par là cette collaboration précieuse; afin de laisser à l’historien une liberté plus grande et une impartialité qui ne saurait être soupçonnée, vous ne l’avez pas voulu.
Du moins, laissez-moi mettre ces pages sous vos auspices; ce ne sera qu’un bien modeste hommage d’affection et de reconnaissance.
Femme supérieure qui savait charmer et dominer les réunions les plus diverses; sœur par le cœur, la parenté et le génie de celui que Manzoni appelait «l’angélique Cabanis»; épouse de l’un des savants les plus illustres que l’humanité ait produits; exemple sublime, aux heures douloureuses, de dévouement conjugal et d’amour maternel, la marquise de Condorcet synthétise et rappelle une époque qui marquera, en dépit de bien des fautes, une des étapes glorieuses de l’Histoire.
Mme de Condorcet avait été élevée dans une famille noble, mais ouverte aux idées philosophiques, et sa jeunesse avait commencé avec ces années délicieuses dont on a pu dire que ceux qui [p. IV] ne les ont pas vécues ont ignoré ce que c’était que la douceur de vivre. Au milieu d’une société qui, sous les apparences les plus légères, agitait les problèmes les plus graves, à Villette et dans le salon de l’hôtel des Monnaies, la fille du marquis de Grouchy représentait, à la fois, les grâces délicates et les pensées sérieuses.
Sans doute, son imagination et son cœur s’égarèrent dans les utopies et les rêves qui agitaient alors le monde nouveau; mais ses erreurs, toujours désintéressées, ne furent que des illusions généreuses et, au lendemain des malheurs les plus terribles, elle ne renia, du moins, jamais les convictions de sa jeunesse.
Depuis le Consulat jusqu’à sa mort, conformant sa conduite à ses principes et montrant une dignité que beaucoup de ses amis avaient trop oubliée, Mme de Condorcet resta ce qu’elle était à l’aurore de 1789.
Cette unité de sa vie en fait la véritable gloire.
Si les existences cruellement agitées par des événements tragiques inspirent déjà l’intérêt, combien plus l’attention de l’Histoire n’est-elle pas sollicitée quand les acteurs de ces époques troublées [p. V] se sont fait remarquer par l’énergie de leur caractère ou les qualités de leur âme.
De cette pensée est né ce livre.
Bellevue, 16 avril 1896.
Qu’il me soit permis de remercier ici mon excellent ami, le marquis du Paty de Clam et M. le baron Fréteau de Pény qui m’ont laissé puiser, avec tant de générosité, dans leurs archives de famille.
J’exprime aussi toute ma gratitude à M. Fernand d’Orval, à qui je dois communication du portrait de Mme de Condorcet, sa grand’tante.
LA
MARQUISE DE CONDORCET
Le château de Villette.—Les Grouchy.—Le marquis et sa femme.—Vie patriarcale à la campagne.—Les hôtes littéraires à Paris.—Rue Gaillon et rue Royale.—Les Fréteau, Dupaty et d’Arbouville.—Enfance de Sophie.—Son frère Emmanuel.—Sa sœur Charlotte.—Le chevalier de Grouchy.—Grave maladie en 1775.—Lectures et travaux de Sophie.
Sur les confins de la Normandie et de l’Ile-de-France, dans une fertile vallée, à quelques kilomètres de Meulan, s’élève le château de Villette.
Ce n’est pas une ancienne forteresse féodale, mais bien plutôt la maison, large et confortable, d’une de ces familles parlementaires qui arrivaient à l’apogée de leur fortune à la veille de la Révolution.
[p. 2] Une allée de vieux tilleuls conduit, par une pente douce, à la cour d’honneur dont le château, avec ses deux ailes qui s’avancent en demi-cercle, forme le fond. A droite et reliée au château par une galerie qui ressemble à un cloître, c’est la chapelle. A gauche, les communs.
On entre dans la maison par un double escalier en fer à cheval et l’on se trouve dans une pièce immense, ronde et fermée par un dôme élevé. C’est là que donnent les différentes pièces du rez-de-chaussée: salon à six fenêtres s’ouvrant sur le parc; salle à manger ornée de grottes en rocailles et dessus de portes peints en camaïeu; voici une autre grande pièce qui servait autrefois de bibliothèque, puis quelques petits appartements, qui se retrouveront, plus nombreux, au premier étage.
L’escalier qui y conduit part aussi de l’immense vestibule tandis que, dans une niche faisant face au visiteur, se dresse le buste en marbre blanc du vieil Homère.
Une terrasse domine le parc et les rivières, qui sont le véritable joyau de cette demeure seigneuriale.
Le marquis de Grouchy, qui l’habitait avec sa femme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’embellissait tous les jours; il en avait fait un lieu de délices, et Mlle Fréteau, fiancée du président [p. 3] Dupaty, pouvait lui écrire: «Il semble que Flore, Cérès et Neptune se soient plu à embellir cette demeure, dont les propriétaires sont parvenus à faire un petit paradis terrestre.» Villette l’était bien, en effet, et, comme les visiteurs, les animaux eux-mêmes y trouvaient une hospitalité sympathique. Un jour, un essaim d’abeilles vint se fixer dans un des angles du château; les domestiques et les enfants reçurent l’ordre de le respecter et il semble bien que ces bêtes intelligentes en conçurent quelque reconnaissance, car on n’eut jamais aucun accident à déplorer. Aujourd’hui encore, la troupe bourdonnante est attachée aux flancs du château comme pour rappeler que de l’ancienne demeure tous les vieux habitants n’ont pas encore disparu[1].
La terre de Villette était entrée dans la famille de Grouchy, au commencement du règne de Louis XV par le mariage de Nicolas-Pierre de Grouchy, capitaine des vaisseaux du Roi, avec Nicole-Ursule-Elisabeth Cousin qui apportait en dot le château et ses dépendances.
On trouve la famille de Grouchy, qui est d’origine [p. 4] normande, parmi celles qui suivirent Guillaume le Conquérant en Angleterre. En 1248, Robert et Henri de Grouchy prirent part à la croisade de saint Louis. Leurs descendants s’illustrèrent dans les lettres et aux armées.
Nicolas de Grouchy, savant humaniste, fut précepteur de Montaigne, tandis que François de Grouchy, capitaine de cavalerie sous le duc d’Alençon, se montrait un des partisans les plus dévoués d’Henri IV, qu’il reçut à Dieppe avant la bataille d’Arques[2].
François-Jacques, seigneur de Robertot, marquis de Grouchy, ancien page de Louis XV et cornette de cavalerie, avait épousé[3] à l’automne de 1760, Marie-Gilberte-Henriette Fréteau, sœur du conseiller au Parlement de Paris.
Il avait quarante-six ans[4], tandis que sa femme était toute jeune; mais la différence d’âge ne [p. 5] semblait pas aussi grande et un des amis de la famille écrivait, le 30 octobre 1760, à Mme Fréteau, mère de la jeune femme[5]:
«Transpire-t-il quelque chose de plus du culte intérieur de M. de Grouchy? Il cherche à cacher sa dévotion, mais je crois que l’on peut décider qu’il en tient à présent tout plein et tout à travers le cœur. Il me semble qu’il rappelle assez le philosophe marié qui n’ose avouer son amour et que ce même amour trahit sans cesse. Au reste, sa méthode n’est pas mauvaise, car plus on est recueilli plus on a de ferveur et le feu concentré n’en est que plus ardent.»
Sous l’éloge, même dans l’agrément de ces premiers jours, on sent une certaine réserve; le marquis était froid et renfermé. Son caractère était parfois difficile et sa charmante femme ne pouvait pas toujours dissimuler, sinon son chagrin, du moins son ennui.
En parlant de la mère du président Dupaty, elle laissait échapper cette confidence qu’on saisit à travers l’allusion[6]:
«Je suis de votre avis, disait-elle à son beau-frère le président, sur les moyens qui auraient pu [p. 6] la rendre toujours aussi aimable qu’intéressante. La froideur est aux agréments, quelquefois même aux vertus, ce que l’hiver est à la nature. Ses richesses sont resserrées dans son sein, mais son extérieur est sec et aride. Il gèle sur l’écorce. Vous voyez d’où je prends cela. (Et devenant plus explicite, parlant directement de son mari)... Je voudrais qu’il fût destiné à vivre longtemps. Je prends sa vie en masse et je vois que, plus que d’autres, il l’a passée à labourer. Il est vrai qu’il a souvent changé la rosée en brouillard. Qu’importe! je ne lui en suis pas moins attachée.»
Mme de Grouchy, au contraire, était délicieuse. On ne tarissait pas d’éloges sur son compte. Son père[7], quand il parlait d’elle, ne l’appelait que la sublime Grouchy; et son frère, le conseiller, la dépeignait ainsi[8]: «Femme incomparable par l’élévation de son esprit, femme avec l’âme de laquelle je changerais la mienne, s’il était en mon pouvoir.»
En la quittant, après un séjour à Villette, sa jeune sœur Adélaïde,—celle qui sera Mme Dupaty,—disait[9]: «L’habitante de ces lieux ne contribue pas peu à en rendre le séjour agréable. Elle [p. 7] m’a fait passer les jours les plus heureux. On ne peut la quitter quand une fois on la possède. Pour moi, je ne pouvais m’y résoudre. Jugez combien j’ai été sensible à notre séparation.»
La chasse, la promenade à pied et en bateau, la lecture[10] étaient presque les seules occupations des châtelains de Villette qui, dans ces premières années, avant la naissance de leurs enfants, n’avaient d’autre distraction, à la campagne, que d’y recevoir leurs parents et quelques amis intimes comme Lope, Dussaulx et Roucher.
Mme de Grouchy avait deux sœurs: l’une, Félicité, mariée au marquis d’Arbouville, habitait Versailles; l’autre, Adélaïde, avait épousé Dupaty et partageait son temps entre Bordeaux, où son mari était président à mortier, Paris et les nombreux exils auxquels l’esprit aventureux du magistrat l’avait fait condamner.
Nous savons aussi qu’elle avait un frère, le conseiller Fréteau, qui demeurait tantôt à Vaux, près de Melun, tantôt à Paris, rue Gaillon, no 15.
C’est là qu’en hiver toute la famille se réunissait[11], dans cet hôtel qui vit passer les hommes les plus [p. 8] remarquables de l’époque: Turgot, d’Alembert, et plus tard Beaumarchais et Condorcet. Là, qu’un jour, l’abbé Sabatier, membre de l’Académie française, fut condamné à faire, comme gage, une description de la femme et qu’il s’en tira par ces vers spirituels:
Au printemps de 1764, le marquis de Grouchy et sa femme se hâtèrent de gagner Villette, et, quelques jours après leur arrivée, la marquise donnait le jour à une fille qui fut appelée Marie-Louise-Sophie[12].
Cette enfant, dont l’existence devait être si agitée, montra, dès ses premières années, en même temps qu’un extérieur gracieux une âme peu commune. La «jolie Grouchette», comme on [p. 9] l’appelait dans sa famille, savait lire et écrire à l’âge de six ans. «Pour te donner une idée de la petite de Grouchy, écrivait la Présidente à son mari[13], je t’envoie deux petites lettres qu’elle a écrites d’elle-même à sa mère pendant sa dernière absence. Il est aisé de deviner quel germe a donné naissance à un être aussi intéressant. C’est un personnage. Ce sera le portrait de sa mère.»
Et la même Mme Dupaty, le 2 octobre 1770, écrivait à son père[14]: «Notre sœur sublime est toujours aussi aimable et aimante; son aînée se décore et emprunte chaque jour quelque trait de l’âme de sa tendre mère. Elle n’acquiert que trop de ressemblance avec elle, car sa santé est, à mon gré, bien délicate et en bien mauvais état. Pour moi, je n’en dis rien, mais elle m’inquiète. Un jaune universel répandu sur tout son corps me fait appréhender pour elle une jaunisse. Les yeux battus, des lassitudes dans les jambes sembleraient l’annoncer. Elle est encore gaie, cependant, mais mange fort peu. Les autres sont bien gentils et bien portants.»
«Les autres», c’est qu’en effet depuis 1764 M. et Mme de Grouchy avaient eu deux nouveaux [p. 10] enfants; un fils, Emmanuel, qui naquit le 23 octobre 1766 et qui deviendra maréchal d’Empire et une seconde fille, Félicité-Charlotte, venue au monde au mois de mars 1768 et le 27 du même mois, tenue sur les fonts baptismaux par son oncle, le président Dupaty.
Naturellement, dans cette branche de la famille, la filleule du magistrat tiendra désormais une grande place dans les préoccupations et dans la correspondance; mais on n’oubliera pas, cependant, Sophie, «la jolie petite nymphe aux yeux noirs,» comme disait le Président, et, malgré les titres de la cadette à une préférence qui aurait été légitime, c’est l’aînée qui, en secret, restera la plus chérie de toute la famille. Quand il venait à Paris[15], le Président déclarait que Sophie avait une bonne part dans son impatience et dans ses désirs de retrouver les siens.
Cependant, il n’est pas possible de séparer ce que la nature avait si bien uni; et la peinture de la vie patriarcale qu’on menait à Villette ne serait plus exacte si l’on négligeait de rappeler tous ceux qui vivaient dans cet intérieur charmant.
Le 25 mai 1769, la Présidente écrivait à son mari[16]: «Votre filleule devient gentille à manger. [p. 11] Elle court toute seule. Il ne lui manque que la parole. Son esprit voudrait se manifester et trouver une porte de sortie. Il étincelle dans ses grands yeux, dans ses petits mouvements. Mais il faut attendre la nature... Son petit frère est beau comme un ange. C’est un amour aux yeux bleus. Il est doux et avisé à plaisir. Pour votre petite Grouchette, elle est toute prête à monter en graine.»
Mais il faut laisser la parole à la mère elle-même. On y verra mieux que dans tous les récits sa bonté, son esprit et son cœur[17]: «Il ne me reste d’existence, écrivait-elle au Président, que ce qu’il en faut pour l’éducation de mes enfants. Il commence à entrer de l’esprit et du sentiment dans l’âme de ma fille dont les dispositions sont heureuses; mon fils m’astreint par sa jeunesse à ce que l’éducation a de plus sec et de plus aride. Mais il me laisse entrevoir de la sensibilité et l’espoir de l’intelligence.
«Charlotte est un vrai petit bijou pour le caractère; rien de plus caressant, de plus gai, de plus drôle. Ce petit peuple me prend bien des moments que je lui consacre avec plaisir. M. de Grouchy les aime éperdument, vient souvent les voir chez moi et jette un coup d’œil de complaisance et de satisfaction sur les soins que je leur donne.»
[p. 12] Et, une autre fois, elle écrit encore au même correspondant[18]:
«Je vais te parler des miens en bref. D’abord, le bouquet, c’est Charlotte: il est moins frais que de coutume. Un rhume, un mal d’estomac l’ont un peu défleurie; ce n’est rien. La rose blanche,—c’est ma Grouchette,—croît assez et reste sensible aux charmes des arts, de l’esprit et de la vertu. L’Emmanuel mord à la grappe que lui présente son jeune mentor qui a trouvé le chemin du cœur.»
Mais il n’est pas dans l’ordre des choses qu’un pareil bonheur puisse durer longtemps. Au mois de septembre 1775, Sophie fut atteinte d’une petite vérole des plus graves; tous les médecins la condamnèrent. Elle y survécut cependant et cette crise terrible fut, pour elle, salutaire. De cette maladie date une transfiguration physique qui l’ayant trouvée laide, engoncée, de petite taille, la rendit grande, élancée, superbe, douée de cette beauté qu’elle garda jusqu’à ses derniers jours et qui était tellement établie, qu’on ne l’appelait jamais, même parmi ses ennemis, que la belle Sophie de Grouchy et, plus tard, la belle Mme de Condorcet[19].
[p. 13] Aimante comme nous la connaissons, Mme de Grouchy fut bouleversée par la maladie de sa fille. Les lettres où elle en parle sont trop touchantes pour ne pas être données ici[20]; le 13 octobre 1775, de Villette, elle écrivait à sa sœur, Mme Dupaty:
«Le savez-vous, ma chère amie, que je viens d’être menacée du plus terrible sacrifice que la Providence pût m’imposer? Ma fille vient d’avoir la petite vérole de la plus mauvaise qualité et compliquée d’un venin affreux... Jugez de ma situation pendant treize jours, mais surtout pendant une semaine que, l’arrêt prononcé, je n’attendais plus sa vie que d’un miracle. Il n’y a point de termes pour rendre ce déchirement, quand les liens du sang, ces liens brûlants de la maternité, vont être rompus! Hélas! vous l’avez éprouvé, tendre mère, mais l’objet que vous perdiez, quelque intéressant qu’il fût, ne pouvait vous être ce que m’est cette enfant; un attachement de dix années, dont toutes les heures me liaient par des soins et des espérances, un cœur vraiment tendre, sensible et reconnaissant, sentant les besoins de l’amitié et s’élevant à tout par l’action du sentiment et de la raison, développant pendant cette maladie qui a [p. 14] été un supplice infernal par sa nature et par celle des remèdes, un courage bien supérieur à tout ce que je pouvais présumer, voilà ce qu’il fallait perdre et voilà ce qui m’a été rendu. Je n’ai pas d’expressions pour dire ma joie, mais tu peux la mesurer sur mes alarmes qui ont été portées au dernier point. Le ciel a entendu nos vœux. Il nous a rendu ma fille. Hélas! que serais-je devenue s’il m’avait fallu voir tomber cette fleur? La plaie se serait agrandie tous les jours. Les temps, les lieux, les personnes, les secours, la triste nécessité de vivre pour des devoirs aussi sacrés et que je n’entrevoyais plus qu’avec un affreux dégoût, tout m’eût rappelé ma perte, tout aurait enfoncé le poignard. Je ne puis rendre compte, ma chère amie, de tout ce que j’ai ressenti; le souvenir de mille pensées depuis six mois prenait l’apparence de funestes pressentiments. L’idée désespérante de sa perte s’était présentée à moi depuis que je la voyais confirmer de plus en plus les promesses de son bon naturel; j’en avais été poursuivie et je croyais y lire mon cruel destin. Que le cœur d’une mère est neuf à cette vérité si frappante que nos vies ne tiennent à rien! Avec quelle amertume j’en dévorais l’expérience! Je ne finirais pas, chère amie, de te peindre ma douleur. Tout l’accroissait. M. de Grouchy était dans le désespoir du père le plus [p. 15] tendre. Son état m’effrayait. Il me prouvait que tout ce que j’avais attendu, projeté, désiré de cette enfant s’était réalisé pour être impitoyablement brisé... Nous voilà sur la route de la convalescence...»
Quinze jours après, le 28 octobre, Mme de Grouchy écrivait à Dupaty[21]:
«Tu as vu l’abîme dont j’ai mesuré en frémissant la profondeur. Je n’y voyais point de fond en vérité. On ignore comme on aime jusqu’au moment où on est menacé de perdre l’objet de son amour et, dans cet instant, on croit n’avoir pas encore commencé de l’aimer. Quelle tempête dans l’âme de ta pauvre sœur! Elle a vraiment passé des horreurs du désespoir à une joie ravissante, mouvement inconnu à qui n’a pas éprouvé le contraste de voir engloutir ou d’arracher aux flots conjurés une tête chérie.
«Hélas! mon ami, j’ai reconnu peut-être trop, (puisque la vie ne tient qu’à un fil), combien ma fille est nécessaire à mon bonheur. Je me rappelle maintenant dans quel vide je serais si je l’avais perdue. C’est te dire combien son cœur et son esprit sont déjà de niveau aux miens. Tu pardonnes [p. 16] ce langage à une mère qui croit, au moins, pouvoir avouer son courage et sa sensibilité. Nous avançons dans cette convalescence qui a été si laborieuse qu’après les premiers transports de la résurrection, c’était pour moi un nouveau supplice. Elle commence à marcher et à agir seule... Elle sera peu ou point marquée. Il n’y a pas longtemps que je jouis de cette faveur tant l’effroi d’un grand malheur éclipse la peur d’un moindre. Reçois, cher ami, toute la reconnaissance de cette chère enfant. La voilà bien plus liée à la vie que devant. Le tendre intérêt de tant de bons parents échauffe cette jeune âme qui, j’espère, sera toujours susceptible de s’enflammer à l’amour des siens... Mes fleurs sont en bon état. La Charlotte est toujours gentille; mon cadet[22] est plein de vivacité et de santé. Mon grand fils se développe assez bien. Tout cela fait mon ciel; mais il y a des nuages, comme tu vois, même des orages. Mon mari les sent aussi fortement que moi.»
Cette année-là, les Grouchy passèrent à Villette la mauvaise saison[23]. Le 8 décembre, la marquise écrivait au Président:
[p. 17] «Je t’ai laissé sur la convalescence de ma fille qui jouit enfin de toutes ses forces. Il ne lui reste que des traces légères, de rares douleurs de nerfs et un peu de faiblesse dans la vue. Mes trois autres sont assez bien de tous points, à la maigreur près pour Charlotte, quoique avec un assez bon fonds. Mon fils se fortifie bien et se développe assez pour me faire beaucoup espérer sur son compte. La tournure de son Mentor[24], qui a vraiment infiniment des qualités désirables pour ses importantes fonctions, apprivoise son âme plus concentrée, plus froide dans l’origine que celle de ses sœurs. Elle acquiert du tact et de la sensibilité. Il annonce une grande raison, du jugement et l’heureux pronostic de la curiosité. Je suis donc fort contente sur ce point.»
Au printemps de 1776, on envoya Sophie à Vaux-le-Pénil, dans la propriété qui appartenait à son oncle, le conseiller Fréteau. «Bâtie à mi-côte, sous un voile discret de verdure, avec la Seine à ses pieds, Melun tout proche et les masses lointaines de la forêt de Fontainebleau fuyant à l’horizon, sa façade à rotonde indiquait la demeure d’un grand seigneur du XVIIIe siècle, ami des Muses et des arts plus encore que magistrat; les toitures [p. 18] mêmes étaient remplacées par des terrasses à l’Italienne qui faisaient fureur depuis Versailles[25].» Louis XV n’aimait pas cette forme de toits et l’on raconte dans la famille qu’un jour où les carrosses de la cour traversaient les ponts de Melun, le roi avait dit en montrant le château de Vaux: «Voici le coffre à avoine de M. Fréteau.»
Là, Sophie sut conquérir de nouvelles affections et parfaire, grâce à son charme personnel, la bonne opinion qu’elle n’avait donnée, jusque-là, que par ses lettres ou dans les rapides entrevues de Villette.
Après cette maladie et la longue convalescence qui l’avait suivie, Sophie se remit à l’étude, au dessin et à la musique, sous la haute direction de sa mère qui s’occupait de son moral, tandis que l’abbé de Puisié, précepteur d’Emmanuel et du Chevalier, se chargeait de donner quelques leçons techniques à la sœur aînée en même temps qu’à ses élèves.
Sophie était même devenue l’aide et parfois la remplaçante du professeur. Dans un journal personnel qu’elle avait intitulé Gazette et Affiches du Château de Villette, elle racontait toutes les péripéties de l’éducation de ses frères. En parlant du cours de Droit naturel, elle disait: «Les écoliers [p. 19] attendent impatiemment leur maître. Le plus âgé (c’était elle) a gagné une bonne altération de voix à répéter la seconde partie du droit en trois heures d’horloge. Un professeur qui, sans être vieux, n’est pas pour l’âge au no 19, peut donc avoir la poitrine fatiguée, sans qu’inquiétude doive s’en suivre, mais seulement précautions et ménagements[26]. Quand (sic) aux rêves creux, ils ne peuvent convenir à quelqu’un qui est censé savoir bien diriger ses idées, puisqu’il apprend aux autres à se diriger eux-mêmes.»
Et ailleurs: «Avis à ceux qui s’intéressent à M. le chevalier de Grouchy (le plus jeune des deux frères):
«Je soussignée reconnais que ledit chevalier de Grouchy, en l’absence de son Mentor, m’a répété des époques et leçons d’histoire ancienne et qu’il s’est légalement acquitté de ses devoirs.»
Il y a aussi, sur la vie à Villette, quelques anecdotes dont on ne peut saisir toutes les allusions.
«Température du dit lieu et santé des habitants:
«Ce dernier article n’a point éprouvé de changement depuis jeudi dernier. Le temps a été [p. 20] sombre et mauvais. Borée s’est déchaîné dans les airs et les tristes sifflements de ce gros joufflu ont jeté les esprits dans une sombre mélancolie. Gog et Magog et leur docte mère assurent qu’un certain départ de vendredi dernier y a contribué; mais ce n’est qu’un dicton, car y a-t-il matière à regret?
«Spectacles:
—«Arrêt de la basse-cour qui a jugé, condamné et fait exécuter trois gros rats par la main de M. le chevalier de Grouchy, exécuteur ordinaire de la dite engeance. Ils ont été pendus aux applaudissements de la volaille, en place de poulailler.»
Ce n’étaient là que les distractions enfantines d’une grande sœur voulant se mettre à la portée de ses jeunes frères.
Mme de Grouchy, dans son inlassable bonté, en avait trouvé d’autres, plus utiles[27]:
«Il y a, depuis deux jours, un intérêt qui amuse les enfants à la récréation. C’est d’aller faire des fagots de bois pour les porter ensuite chez les pauvres de Villette. Les bénédictions qu’on leur a données hier les ont encouragés et tu aurais été touché de voir partir cette petite horde, Charlotte en tête, chacun armé d’un fagot.»
D’autres fois, on faisait un pain de l’invention [p. 21] de Mme de Grouchy; il y entrait près de moitié de pommes de terre et ce mélange donnait une nourriture excellente. «C’est un grand allègement, disait Fréteau[28], pour les dépenses charitables. Celles-ci ne ruinent jamais et attirent les bénédictions du ciel sur les familles.»
Sophie avait conservé de ces louables habitudes un souvenir charmant et doux, et, bien des années après, dans ses Lettres sur la Sympathie, dont nous aurons à parler longuement, elle disait en évoquant les charités qu’on pratiquait à Villette:
«Vous me l’avez appris, respectable mère, dont j’ai tant de fois suivi les pas sous le toit délabré des malheureux, combattant l’indigence et la douleur! Recevez pour toute ma vie l’hommage que je vous devrai, toutes les fois que je ferai du bien, toutes les fois que j’en aurai l’inspiration et la douce joie. Oui, c’est en voyant vos mains soulager à la fois la misère et la maladie; c’est en voyant les regards souffrants du pauvre se tourner vers vous et s’attendrir en vous bénissant que j’ai senti tout mon cœur et que le vrai bien de la vie sociale, expliqué à mes yeux, m’a paru le bonheur d’aimer les hommes et de les servir.»
Cette vie, si occupée et si charitable, était devenue [p. 22] un modèle pour toute la famille. Au milieu de ce XVIIIe siècle qu’on se représente d’habitude tout autrement, c’est ainsi que les vertus privées avaient joint au parfum le plus délicat le plus généreux des exemples.
«C’est de notre chère Grouchy et de tous les siens, écrivait Dupaty à sa femme[29], que je vais aujourd’hui, ma chère amie, entretenir et intéresser ton cœur. Enfin, je l’ai revue cette chère ressuscitée et ton cœur lui-même aurait de la peine à te peindre avec quelle émotion, quelle joie! Oui, c’est elle, elle encore, toujours elle... Elle a toujours cette heureuse physionomie remplie de son cœur, de son âme, de son esprit qui, sans cesse, s’élancent pour ainsi dire à vous tout à la fois. Tu es toujours aussi vive dans ses entrailles, dans son souvenir. Il y a deux jours que je suis ici et il ne me semble pas qu’il y ait une heure. Il m’est délicieux de me reposer un moment, dans le sein de la nature, de l’amitié et de toutes les vertus, de l’agitation du grand tourbillon qu’on appelle Paris. Je suis enchanté de ses enfants. Leur santé est parfaite. Le fils aîné est plein de raison, de justesse d’esprit, de bons sentiments. Il est vraiment tel que je désirerais mon fils à son âge. Mais aussi [p. 23] quelle éducation, quelle culture, quels soins! Ils ont un excellent mentor qui s’est ouvert une nouvelle route, qui s’occupe des sensations avant de s’occuper des idées, c’est-à-dire des fondements avant le toit. Tout ce qui se fait dans cette aimable demeure est une éducation continuelle. M. et Mme de Grouchy n’ont pas d’autre occupation, ni d’autres plaisirs. Ils mènent la vie patriarcale. On ne peut peindre le tableau; il faut le voir avec attention et souhaiter d’en faire un pareil dans le sein de sa famille ou regretter amèrement de ne pouvoir le faire. Mais, dans les villes, il n’y a pas moyen. Aussi, c’est un deuil ici que de quitter la campagne; c’est pour eux quitter la nature. Mais il faut qu’une demoiselle sache danser et jouer pendant vingt-quatre heures du clavecin. Les lettres de Mlle de Grouchy sont des infidèles; elle est tout autre que ce qu’elles en disent. Elle a infiniment de raison et même d’esprit. J’ai vu des choses écrites par elle avec confiance et liberté que Mme de Sévigné n’eût pas désavouées. C’est à la lettre. Sa mère est parfaitement contente; elle doit l’être. Sans être précisément jolie, sa physionomie est assez agréable et le développement de la jeunesse peut encore faire épanouir quelque bouton caché sous les feuilles. Une taille de nymphe, un air de noblesse et d’élévation répandu dans toute [p. 24] la personne; on ne peut être mieux à quatorze ans. Mais la perle des perles, la rose des roses, la grâce des grâces, c’est la charmante Charlotte. On ne dit pas tant de choses spirituelles et aimables avec des paroles qu’elle en dit avec son regard et son sourire. Le petit dernier est la douceur des anges. Heureuse mère! heureux enfants! Spectacle enchanteur pour qui sait le goûter et comment ne pas le goûter pour peu qu’on ait un cœur. Tout cela me comble de tendresses, de caresses.»
On me pardonnera, j’en suis sûr, d’avoir donné cette longue et jolie lettre qui nous introduit si avant dans l’intimité de cette famille charmante.
Les étrangers subissaient le charme, comme les parents ou les amis. Et si Dupaty s’exprimait comme nous venons de le voir, si le poète Roucher, qui était presque de la famille, disait de Mme de Grouchy à son ami le Président[30]: «N’ai-je pas vu combien elle est aimable? Ne m’a-t-elle [p. 25] point accueilli avec une bonté pleine de grâce? Est-ce que je ne sais point que, pendant ses douleurs, elle s’est souvenue de mon poème et a témoigné quelque regret de ne l’avoir point entendu en entier?» des indifférents, comme un doctrinaire qui venait de passer quelques jours à Villette, pouvaient dire eux aussi[31]: «J’y ai vécu quinze jours. Un paysage délicieux, une société charmante, tous les talents réunis à la beauté dans la personne des nièces de Mme Dupaty, la musique, la peinture, le latin, le grec, toutes les langues, toutes les sciences.»
Mais revenons à Sophie de Grouchy et voyons ce que sa mère elle-même en disait au conseiller Fréteau, son frère[32]: «Mes deux filles me font une société, je dirais presque divine, parce qu’elle porte sur une harmonie et un attrait réciproque bien établi et que, chaque jour, néanmoins, semble fortifier. L’aînée a des ressources personnelles infinies, la plus essentielle de toutes, la religion [p. 26] comme étude. Ce sentiment y tient le premier rang et devient entre elle et moi un lien et un rapport intimes... J’ai du labeur ce qu’il en faut et des jouissances bien précieuses. Nous tâchons, ma fille et moi, d’aider M. de Grouchy dans quelques travaux de terrier; je voudrais même qu’il nous mît plus en état de lui être utiles sur cet objet. Cette vie est tout à fait douce et heureuse.»
En dehors de ces occupations et des études que nous lui connaissons, Sophie faisait quelques lectures pieuses, analysait Télémaque ou les pensées de Marc-Aurèle.
Mais la famille n’allait pas tarder à se séparer; le fils grandissant était parti pour le service et Sophie allait, elle aussi, quitter pour de longs mois cette délicieuse maison de Villette, où elle avait goûté un bonheur qu’elle ne devait plus retrouver.
Les chapitres nobles de Dames.—Le prieuré de Neuville-en-Bresse.—Sophie y est envoyée.—Ses occupations.—Sa correspondance.—Sophie reçoit la visite du président Dupaty.—Son retour à Paris et à Villette.—On cherche à la marier.—Rencontre du marquis de Condorcet chez Dupaty.
Il y avait en France, au moment où éclata la Révolution, dans la considérable hiérarchie des ordres religieux, une institution qui remontait à une très haute antiquité et qu’on appelait les chapitres nobles de dames ou de chanoinesses.
Ceux-ci se subdivisaient en chapitres proprement dits comme celui de Remiremont, en abbayes comme à Maubeuge et en prieurés, comme à Neuville, dans le diocèse de Lyon.
On comptait pour la France vingt-six chapitres qui contenaient six cents chanoinesses et accusaient un revenu de 700,000 livres[33].
[p. 28] Dans les maisons les moins difficiles, il fallait quatre quartiers de noblesse du côté paternel et autant du côté maternel; d’autres chapitres en exigeaient huit, quelques-uns seize. A Remiremont, la noblesse devait toujours remonter au delà de deux cents ans et l’abbesse ne pouvait être choisie que parmi les princesses de sang royal. A Maubeuge, la preuve à faire était de huit générations ascendantes d’une noblesse militaire et chevaleresque, dont l’origine devait se perdre sans interruption dans la nuit des temps. A Bourbourg, dans l’Artois, où la Reine était première chanoinesse, on devait prouver sa noblesse depuis l’an 1400 et produire un acte du XIVe siècle.
Les chanoinesses qui avaient le titre de Madame, faisaient partie de l’état ecclésiastique sans prononcer aucun vœu et conservaient le droit de se marier; elles chantaient l’office au chœur, revêtues [p. 29] de l’aumusse et d’un habit qui ressemblait à celui des chanoines. En dehors des exercices conventuels, elles portaient un costume souvent très élégant et qui n’accusait son côté religieux que par une croix d’or suspendue par un ruban de moire. Dans la maison du chapitre, chaque dame avait son habitation séparée; outre la jouissance de ses biens propres, elle recevait une portion distincte des revenus de la communauté.
Après les dignitaires et les chanoinesses titulaires, il y avait dans chaque chapitre des chanoinesses non prébendées ou postulantes qu’on appelait les nièces; et qui, en attendant une vacance, étaient adoptées par une chanoinesse qui devait leur laisser sa prébende soit à sa mort, soit à sa sortie du chapitre.
Dans la réalité des faits et à une époque où toute la fortune était réservée pour le fils aîné, ce titre de chanoinesse appartenait comme un droit à certaines grandes familles qui trouvaient là un moyen de doter leurs filles ou, du moins, de leur assurer pendant quelques années les revenus d’un canonicat.
C’est ainsi que Lucile de Chateaubriand était entrée au chapitre de L’Argentière d’abord, puis à celui de Remiremont[34]; ainsi que Sophie de Grouchy, [p. 30] qui devait y être remplacée par sa sœur Charlotte, était partie pour Neuville-en-Bresse, où elle allait passer quelques mois qui ne devaient pas être sans influence sur la destinée de son esprit.
Ce fut là, du reste, le seul voyage sérieux qu’elle ait jamais entrepris.
Neuville-les-Dames ou Neuville-en-Bresse[35] était alors un bourg d’un millier d’habitants, construit sur le coteau qui domine la rive droite du Renom; il se trouvait sur la grande route de Lyon à Bourg.
Placé sur les confins du pays de Dombes, au centre d’un triangle formé par les trois villes de Mâcon, de Lyon et de Bourg, Neuville est à 55 kilomètres de la seconde de ces deux villes et à 20 kilomètres de la troisième.
Le pays est étrange, légèrement vallonné; les habitants y sont rares, les bois maigres et chétifs; on est encore dans la Bresse, mais la région ressemble déjà à la plaine de Dombes. Le terrain est [p. 31] sillonné de petits cours d’eau qui forment une quantité considérable d’étangs. Le Renom qui passe à Neuville, avant de se jeter dans la Veyle, parcourt ainsi plus de 40 kilomètres. Quant à la route qui passe dans le bourg, elle monte et descend tour à tour, traversant tantôt de grands bois de chênes et tantôt la chaussée des étangs.
Dans cette plaine triste et marécageuse où la température est toujours fraîche, humide et capricieuse, les yeux ne trouvent pour se reposer que les bois de Tanay et ceux de l’allée de Romans. C’était un but de promenade pour les chanoinesses qui avaient encore, pour se distraire, les visites aux châtelains de Longe et de Châtenay, dont les gentilhommières se dressaient à quelques kilomètres seulement de la petite ville.
Enfin, quand on voulait faire de plus longues excursions, ces dames avaient à choisir entre Châtillon-sur-Chalaronne, tout plein encore des souvenirs de saint Vincent de Paul[36], et Thoissey, ancienne dépendance de l’abbaye de Cluny, où la Grande Mademoiselle avait fondé, en 1680, un collège, qui, au XVIIIe siècle, était à l’apogée de sa réputation[37].
[p. 32] Au centre du bourg, s’élevait le monastère qui ressemblait aux béguinages des Flandres. Les maisons des chanoinesses, dont la plupart subsistent aujourd’hui, entouraient une place fermée qu’on appelle encore le Chapitre. Il y a quelques années, on y voyait les traces des allées carrelées qui, partant du seuil de chacune des maisons, venaient aboutir à l’entrée de la chapelle construite au milieu de la place. Cette chapelle fut détruite en 1793, en même temps que les dernières chanoinesses étaient brutalement chassées de leurs demeures.
La salle des archives ne renferme plus rien. Quant aux maisons qui, toutes, extérieurement, ont la même forme, quelques-unes présentent encore des restes de leur ancienne splendeur: ce sont des salons aux cheminées antiques, des salles aux lambris sculptés, des rampes d’escalier en bois travaillé[38].
Les origines du chapitre noble de Neuville sont assez obscures. On a voulu les faire remonter jusqu’au Ve siècle où saint Romain, abbé de Condat, y aurait établi une règle sous laquelle les religieuses auraient vécu jusqu’à l’époque où elles [p. 33] prirent celle de saint Benoist[39]. Quoiqu’il en soit, il est établi qu’en l’an 1050, il y avait à Neuville un prieuré de Bénédictines, enrichi déjà par des dons superbes et nombreux. Ces dames étaient vêtues comme des femmes en deuil; en 1751, le chapitre fut sécularisé et, quatre ans après, le roi Louis XV accorda aux chanoinesses le titre de comtesses, les autorisant à porter, comme marque distinctive, une croix, attachée à un cordon bleu liséré de rouge, mis en écharpe; la croix représentait d’un côté sainte Catherine, patronne du chapitre, avec cette légende: Genus, Decus et Virtus et, de l’autre côté, la sainte Vierge.
Au chœur, ces dames portaient un manteau à traîne, bordé d’hermine tout autour.
Pour être admise comme chanoinesse titulaire ou comme chanoinesse d’honneur, il fallait prouver [p. 34] neuf générations de noms et d’armes du côté paternel, non compris la présentée, et trois générations du côté maternel. On exigeait, de plus, que la preuve fût faite d’une façon très régulière par devant les comtes de Lyon, commissaires-nés du chapitre de Neuville.
Celui-ci comptait quatre dignitaires qui devaient être âgées de plus de trente ans et qui recevaient, outre leur prébende, un préciput attaché à leur dignité.
La doyenne, élue par le chapitre, faisait, seule, des vœux; c’était, au moment de l’arrivée de Sophie de Grouchy, Mme Marie-Gabrielle de Beaurepaire.
La grande chantre, nommée alternativement par l’archevêque de Lyon et par l’abbesse de Saint-Pierre, était, en 1785, Marie-Gabrielle-Josèphe de Charbonnier-Crangeac.
La secrète, à la nomination alternative de la doyenne et de l’abbé d’Ambournay, s’appelait Marie-Louise-Charlotte de Chastenay-Lenty.
Enfin la grande aumônière, nommée par le roi, était une seconde dame de Charbonnier-Crangeac.
[p. 35] Il y avait, en outre, seize chanoinesses-comtesses prébendées, parmi lesquelles Mmes du Breuil, de Buffévant, de Varenne, de Chazeron.
Parmi les vingt-six chanoinesses non prébendées, on voyait les noms de Mmes de Damas, de Fontenoy, de Durfort, de Grouchy, de Fénelon, de Saxe de Lusace, de Monestay, de Forbin, de Lévis de Mirepoix, de la Clayette, etc.
Etaient reçues en expectative ou figuraient parmi les chanoinesses d’honneur, Mmes de Foudras, de Menthon, de Polignac, de la Rivière, de Chevigné et de Saint-Phalle.
Toutes ces dames n’étaient pas ensemble à Neuville; et le chapitre, composé en tout de cinquante-six personnes, n’était guère en réalité que de quarante chanoinesses ou postulantes.
Le marquis de Grouchy avait dû adresser à Mme de Beaurepaire la demande d’admission et les titres originaux de noblesse et de filiation, sans compter 400 livres pour les frais de la première preuve, 800 livres par an pour les dépenses de la demoiselle et 900 livres pour sa table, jusqu’à ce qu’elle entrât en ménage, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle eût sa maison particulière où, alors, elle vivrait à son compte. C’est à ce moment que la chanoinesse devenait prébendée; on arrivait à cette dignité par rang d’ancienneté, mais il fallait, [p. 36] auparavant, faire encore de nouveaux frais, 2 000 livres environ, pour la réception et les preuves[40].
Au mois de septembre 1784, Sophie accompagnée de sa gouvernante, Mme Beauvais, arriva à Neuville. Elle était attendue par Mme de Buffévant qui allait être, pour elle, pendant tout son séjour au chapitre, comme une seconde mère.
Mme Victorine de Chastenay, dans ses Mémoires[41], a raconté comment elle fut reçue au chapitre noble d’Epinal; sauf quelques détails insignifiants, la cérémonie d’introduction de Sophie de Grouchy fut la même: «Elle tenait, à la fois, de la chevalerie et de l’institution monastique. Les preuves de noblesse étaient discutées et admises par les généalogistes du chapitre; elles étaient jurées et publiées à la cérémonie par trois chevaliers dont les noms avaient été prouvés dans les admissions de leurs parentes. La nouvelle reçue leur présentait, en reconnaissance, un nœud d’épée. Je me souviens qu’à l’heure de vêpres, tout le chapitre (ces dames étaient vingt en tout) se rendit à la maison de ma [p. 37] tante pour m’y prendre; j’avais une robe noire. L’un des chevaliers me donna la main; la musique de la garnison précédait. Quand nous fûmes dans le chœur de l’église, on me fit mettre à genoux; l’abbesse me dit: «Que me demandez-vous, ma fille?—Le pain et le vin de saint Goëry (patron du chapitre), pour servir Dieu et la sainte Vierge.» On me fit manger d’un biscuit, mouiller mes lèvres dans une coupe; on me passa le grand cordon avec la croix au bout, le long manteau bordé d’hermine, l’aumusse, le voile noir. Tout me fut remis en un instant. On chanta le Te Deum, puis le cortège revint dans le même ordre et un bal s’ouvrit chez ma tante.»
C’était là une des distractions ordinaires de ces couvents mondains[42]. «On danse au chapitre d’Ottmarsheim, en Alsace. Au chapitre d’Alix, près de Lyon, les chanoinesses vont au chœur en paniers, habillées comme dans le monde, sauf que leur robe est de soie noire et que leur manteau est doublé d’hermine. Près de Sarrelouis, les chanoinesses de Loutre dînent avec des officiers et ne sont rien moins que prudes... Les vingt-cinq chapitres nobles de femmes sont autant de salons permanents et de rendez-vous incessants de belle [p. 38] compagnie qu’une mince barrière ecclésiastique sépare à peine du grand monde où ils se sont recrutés.»
Sophie prit sa large part des fêtes qu’on donnait à Neuville et, après six semaines de bals ininterrompus, au mois de juin 1785, elle tomba sérieusement malade. On craignit pour sa vue, d’autant plus qu’à la folie du plaisir, elle joignait une furie de travail qui s’accommode peu, d’ordinaire, avec les distractions excessives. «La chanoinesse, écrivait Mme Dupaty au Président[43], exerce toujours tous ses talents, en dépit du mal aux yeux. Elle traduit, seule, du Tasse et le sublime Young. Ses yeux font son tourment. On n’y voit d’autre remède que le repos et comment obtenir l’oisiveté des âmes ardentes et actives comme ma nièce.» Et une autre fois[44]: «On a des nouvelles de Sophie qui me peinent. Ses yeux gonflent tous les soirs d’une manière à faire craindre que ce ne soient des symptômes de goutte sereine. Il est affreux de n’acquérir presque jamais à ce degré qu’aux dépens du physique. Elle s’est forcée, cette jeune personne, et on se ressent tôt ou tard de ces excès de travail.»
En dehors de la littérature, Sophie s’adonnait à [p. 39] la philosophie et elle lisait, avec délices, les œuvres de Voltaire et de Jean-Jacques. La règle de Neuville, on le voit, n’était guère sévère, et les chanoinesses pouvaient, sans crainte des observations, demander les objets les plus coquets ou les livres les moins pieux. Sophie réclamait à sa tante Dupaty[45], mais en recommandant bien qu’on n’en parlât pas à Mme de Grouchy, des velours noirs, des boucles, des gants en tricot blanc fourré et «une paire d’anneaux d’oreilles, en perles, comme ceux que nous a proposés, un jour, un garçon de la boutique de la Perle, rue du Petit-Lion. Ces anneaux ne sont que des perles enfilées dans un fil d’or ou à peu près. Ils coûtent 6 livres.»
De son côté, Charlotte, qui, en 1787, avait pris à Neuville la place de Sophie, demandait qu’on profitât d’un voyage du vicomte de Fénelon, père des chanoinesses, pour lui envoyer des bottines en peau verte, comme il était à la mode d’en porter[46]. «Ne pourriez-vous pas, chère petite tante, joindre à votre envoi un volume d’œuvres de M. de Chabanon dont j’ai vu l’analyse dans un des derniers Mercures. Je désire bien cette nouveauté qui doit être agréable comme l’esprit de l’auteur. Il me semble qu’il est connu du petit oncle.»
[p. 40] On est confondu de la nature des études et des réflexions de ces jeunes filles[47]: «Je lis Condillac, écrivait une autre fois Charlotte à son oncle le Président. Il a une raison bien lumineuse et cette sage pénétration du cœur des hommes qui fait trouver toutes les causes des événements et ne laisse au hasard, au merveilleux et à la fausse gloire que l’intrinsèque, c’est-à-dire bien peu. Il cherche tout dans la vertu, la providence et l’enchaînement des circonstances, causes bien plus sûres et par lesquelles on juge du prix de chaque chose.»
Au mois de mars 1785, le président Dupaty était parti pour l’Italie, d’où il devait rapporter ces Lettres qui ont obtenu un si grand succès au moment de leur apparition et qui, aujourd’hui, sont trop oubliées.
A son retour, au mois d’août, il passa par Lyon et fit un léger détour pour aller embrasser sa charmante nièce. «Elle espère que tu te reposeras un peu chez elle, lui écrivait la présidente[48]. Elle a bien des choses à verser dans ton cœur. La solitude où elle me sait fait qu’elle s’est un peu épanchée dans le mien.» Et le 25 août[49]: «Je ne [p. 41] veux pas troubler ton joli comité avec ma nièce. Dis-lui bien tous nos cœurs et nos pensées pour elle et embrasse-la à la manière de l’amitié.»
Sophie, de son côté, écrivait à sa tante[50]: «J’espère le petit oncle dans le courant de ce mois. Je voudrais bien qu’il me donnât deux ou trois jours; une solitaire exilée en mérite bien autant que quelques rares édifices ou quelques chefs-d’œuvre de peinture.»
La réunion de l’oncle et de la nièce fut touchante. Dupaty trouvait, dans cette rencontre, un avant-goût des douceurs familiales dont il était privé depuis près de six mois. Il s’abandonna aux sentiments les plus doux, admira les progrès de Sophie et conçut, dès lors, pour elle une affection qui devait subsister jusqu’à sa mort et se traduire même dans ses dernières volontés.
Le 26 août 1785, il était à Neuville, d’où il écrivait à la Présidente[51]:
«Voilà encore un pas vers toi, ma chère amie. J’espère qu’avant peu je n’en ferai plus. Il ne faut pas moins que cette espérance pour me faire continuer ma route. Car, comme je suis bien ici! Quelle aimable retraite! Quelles charmantes conversations pleines de toi, de ta sœur, de nos [p. 42] enfants, de tout ce que nous aimons l’un et l’autre, de tout ce que nous aimons en même temps! Mon cœur commence à s’ouvrir et à renaître. Il semble qu’en entrant dans l’Italie, il s’était fermé, du moins pour ses plaisirs, pour ses doux plaisirs, car il est resté toujours ouvert pour ses peines, pour les peines de l’absence qui vont finir. J’ai trouvé ta nièce plus intéressante que jamais. Il n’y a rien à ajouter à sa raison que, peut-être, d’en retrancher quelque chose; car, elle s’occupe trop. C’est toujours la solitude, la retraite, les livres, toutes les connaissances et, à travers tout cela, Villette, les siens, les nôtres; enfin, son cœur et nos cœurs. Je t’en parlerai plus en détail, quand je serai à côté de toi. A présent, j’aime mieux que nous parlions de toi, ce ne sera pas pour longtemps encore. J’attends demain mon compagnon de voyage qui me conduira à Dijon où je le déposerai... Je compte arriver à Paris mercredi prochain, au plus tard jeudi. Compte sur tes doigts, tandis que je compterai dans mon cœur. Comme il bat! Il me semble que tu es déjà là avec nos chers enfants. Je ne peux concevoir que je ne reçoive pas de tes nouvelles. Il me semble que j’ai passé tout ce mois dans l’autre monde. Ouvre donc bien tes bras au pauvre revenant... Mon ange, je suis bien ici; je mange, je dors, je démaigris, [p. 43] je me repose, j’aime et l’on m’aime et, peut-être même, je plais un peu. Du moins, ces dames veulent bien me le faire croire. Ta nièce est aimée, considérée, honorée; elle est unique ici, tu m’entends. Adieu, mon ange. Il n’y aura plus de moi pour toi que moi-même. Je ne t’écrirai plus.
«J’ai revu avec plaisir Mme Beauvais[52]; elle est toujours la même pour ta nièce. C’est un trésor. C’est un grand repos pour le cœur maternel.»
De son côté, Sophie nous a gardé le témoignage des sentiments que cette visite du président avait laissés dans son cœur. Deux jours après le départ de son oncle, elle lui écrivait avec cette facilité et cette grâce qui la rapprochaient, disait Dupaty, de Mme de Sévigné[53]:
«Voici, cher petit oncle, un paquet que vous deviez recevoir ici, qui venait vous y chercher et qui vous y trouve, car j’y suis encore. Je ne vous parlerai point de l’impression que m’ont fait votre passage ici, vos conversations, votre confiance, votre intérêt, votre départ. J’espère que vous en trouverez aisément l’idée dans votre cœur et je sens que j’aurais peine à vous la rendre. Vous m’avez rendu l’absence plus douloureuse que [p. 44] jamais. Je ne peux me reposer que dans l’idée que vous parlez de moi, que vous reportez au milieu de ma famille un cœur tout plein d’elle et de besoin d’elle, un cœur que l’usage enivrant de la liberté n’a point éloigné, n’a point distrait des jouissances qui l’ont précédée. Charlotte me mande votre arrivée. Si ce tableau de joie universelle ne me portait au jour de mon retour, il serrerait mon âme au lieu de l’épanouir. J’ai, au moins, acquis une grande jouissance; c’est de pouvoir parler avec Mme de Buffévant, la seule ici à qui mon cœur parle, d’un des objets qui l’attachent. Je ne dirai pas qu’elle vous connaît, mais elle a assez retenu de vous pour se plaire comme moi à en parler. Concevez-vous comment ces conversations si pleines et si intéressantes se sont passées, cher petit oncle? Pour moi, j’y touche encore et j’y toucherai longtemps, car jamais je n’ai goûté d’un mélange aussi délicieux d’âme, d’esprit, de goût, de philosophie et de littérature. J’aime encore davantage Montesquieu depuis que je vous l’ai entendu lire, sans doute parce que vous le lisez comme il se lisait lui-même...
«Quel plaisir j’aurai à parcourir l’Italie avec des yeux comme les vôtres, c’est-à-dire les yeux de l’âme et du goût! Charlotte me mande que vous n’avez pas été fatigué de votre route; nous nous [p. 45] flattons d’y avoir contribué en vous faisant assez aimer la station de Neuville pour y prendre quelque repos et quelque plaisir. Je vous laisse à penser si c’est une ou plusieurs qui se flattent ainsi. Adieu, cher petit oncle. Embrassez pour moi tout ce que vous aimez qui est aussi tout ce que j’aime. Je vois d’ici tous les petits génies plus radieux que jamais. Je vois... Ah! je vois trop et pas assez. Faites-moi voir, au moins, que vous aimez toujours Sophie et que l’absence ne lui enlèvera rien de l’intérêt et de la confiance à laquelle vous l’avez si promptement et si heureusement habituée.»
Malgré ses travaux, ses lectures, ses distractions mêmes, Sophie ne pouvait vaincre la sérieuse mélancolie qui s’était emparée de son esprit. «Songez, disait-elle[54], à cette affreuse solitude d’une absence qui s’étend sur tous les objets que l’on chérit. Songez combien, après les lettres, il me reste de sensibilité, de désirs, de besoins à satisfaire. Songez à ce cabinet solitaire où vous pouvez dire avoir vu dans quelques papiers et quelques livres les seuls objets qui occupent et charment, ici, ma vie.»
Mais, n’y avait-il que la solitude ou n’étaient-ce pas aussi la fatigue des plaisirs mondains, l’austérité [p. 46] des réflexions, l’inactivité du corps et l’effet des lectures philosophiques qui, à défaut des cruelles expériences de la vie, avaient hâté l’éclosion de cette crise morale qui prend la jeune fille dans toute sa grâce un peu légère pour en faire une femme sérieuse, charmante toujours, mais déjà désillusionnée et comme envahie par la connaissance prématurée de la vie et de ses angoisses.
Ses grands yeux, hier insouciants, aujourd’hui interrogateurs et curieux, révélaient le changement qui s’était produit dans cette âme d’élite, et sa physionomie, du jour au lendemain, devint si différente qu’à son retour à Villette ce fut à peine si Mme de Grouchy put reconnaître sa fille chérie.
Dans cette disposition d’esprit, la moindre cause amène des tristesses incompréhensibles ou des rêveries interminables; la lourdeur des jours d’orage ou la neige qui couvre la terre, les plaintes du vent dans les arbres de la forêt et surtout les jours sombres et courts de l’hiver, tout devient sujet de mélancolie et source de larmes.
Sophie le disait avec éloquence[55]:
«Je trouve bien heureux les gens sur lesquels l’hiver ne fait aucune impression. Quant à moi, ce jour sombre, ce froid qui resserre tous les corps, [p. 47] ce deuil de la nature me jettent dans une mélancolie et un absorbement affreux. Il ne fait qu’augmenter au milieu des plaisirs qui occupent ici le grand nombre. Je ne me plains pas de ne pas m’y plaire, mais de n’y trouver rien de ce qui me plaît. Rien ne remplit ce vide affreux où se perd le sentiment de toute jouissance. Si le cœur pouvait changer aisément d’objet, Mme de Buffévant me le ferait éprouver. Elle commence à m’aimer comme j’aime ceux que je regrette, ou plutôt, comme ils m’aiment, car, comme eux, elle me voit au delà de ce que je suis.» Et elle termine par ce mot qui fait réfléchir quand on songe à la conduite que Mme Suard devait tenir un jour envers Condorcet: «N’est-il pas bien téméraire d’espérer que vous ne m’oubliez pas auprès de vos amis, chère tante? Je n’oublie point les bontés de Mme Suard. Sentir ce qui est aimable est mon seul titre auprès d’elle. Il sera tout-puissant si vous le faites valoir.»
Pendant que Sophie était à Neuville, des amis avaient songé à la marier avec un capitaine aux gardes, veuf depuis dix-huit ans, très riche, âgé de cinquante ans, «mais frais, ingambe, figure honnête, belles dents[56]». M. de Claye, qui avait 30.000 livres de rentes en bonnes terres, [p. 48] sans compter sa place et un logement aux Tuileries, promettait d’avantager sa femme de presque toute cette fortune s’il n’avait point d’enfants; dans le cas contraire, il lui assurait un douaire de 6.000 livres. En retour, il n’exigeait que 80.000 livres de dot. Ce projet d’union plaisait au marquis de Grouchy qui permit à sa femme de disposer, en faveur de Sophie, d’une partie de sa propre fortune.
Mais le président et sa femme et aussi Mme de Grouchy s’inquiétaient de la grande différence des âges. Mme Dupaty faisait remarquer à son mari l’extérieur froid et triste du futur. «Que sont la fortune et l’aisance, disait-elle[57], sans le contentement du cœur et la confiance mutuelle?» Et de son côté, le Président écrivait[58]: «Il est bien difficile que Sophie puisse trouver non pas le bonheur, mais même un état neutre dans une union pareille, avec son goût pour l’étude, son aversion pour les gênes du monde, sa manière de penser si solide à plusieurs égards et surtout la fermeté et l’indépendance absolues de son caractère.»
Quant à Mme de Grouchy, pour gagner du temps, elle exigea d’abord que Sophie fût reçue chanoinesse, ce qui demandait encore cinq mois. «Il est [p. 49] absolument essentiel, disait-elle[59], que Sophie ne quitte pas Neuville sans son état. Si elle partait avant que son stage soit fini, elle perdrait l’avantage d’y rentrer, si cette affaire-ci ne réussissait pas, et ma fille se trouverait ainsi sans état. Il faut aussi que rien ne se termine avant que les prétendus aient fait connaissance l’un de l’autre.»
On n’avait pas cru pouvoir cacher à Sophie le projet qui la regardait si directement, mais sa mère, son oncle et sa tante avaient présenté, en même temps, toutes les sages réflexions si naturelles en pareil cas. Elle ne refusa pas de suite, mais, après avoir demandé à réfléchir afin de bien voir le «fort et le faible de cette affaire», elle se rendit aux raisons de sa famille et abandonna d’autant plus volontiers ce projet que le prétendu, qui cherchait la fortune, ne montrait de son côté aucune impatience d’aboutir.
Emmanuel, en revanche, avait épousé Mlle de Pontécoulant, au mois de mai 1785. La cérémonie avait eu lieu à Villette; mais Sophie, alors à Neuville, et Charlotte, qui était malade, n’y avaient pas assisté.
Comme une des conditions du mariage était que le jeune officier, toutes les fois qu’il ne serait [p. 50] pas au service, vivrait à Pontécoulant, Sophie, dans ses lettres, déplorait cet éloignement. Le 10 août 1785, elle écrivait à Mme Dupaty[60]:
«Pour un moment de solitude (c’est-à-dire, je pense, pour un moment, ma chère tante, où vous n’aurez rien de mieux à faire que de me lire): l’on a beau dire, l’idée du bonheur de ceux qu’on aime ne tient lieu qu’à demi de leur présence. Je ne vois rien qui puisse remplacer la vie et la sérénité que son établissement au milieu de nous aurait répandus dans l’existence générale. On jouit faiblement de ce qu’on a, on est vivement frappé et occupé de ce qui manque et, en général, on est difficile à rendre heureux.»
Le jeune ménage avait quitté Villette dès le lendemain de la cérémonie; mais Emmanuel avait promis de revenir passer quelques semaines auprès de ses parents. Cette visite, annoncée pour le mois de septembre, avait entraîné quelques embellissements, quelques réparations dans la demeure familiale. Le 4 juillet, Mme Dupaty qui se trouvait à cette date chez sa sœur, écrivait au Président[61]:
«Je ne suis pas contente de la santé de M. de Grouchy. Il s’affaiblit et souffre. On n’atteint pas impunément soixante-dix ans en menant la vie qu’il [p. 51] mène, car il est le premier piqueur de sa maison. Il nous a fait des promenades délicieuses pour la marche et dans le bosquet gauche tu trouveras de quoi égarer complètement ta rêverie. En m’y promenant avec lui, je lui dis que sa jeune belle-fille serait bien flattée des jouissances qu’il lui avait préparées. Il me répondit que ce n était pas pour elle, mais pour nous qui aimions Villette. Je répondis tout ce qu’on peut répondre à cela.»
Le Président, à son retour d’Italie, s’était rencontré à Villette avec le futur maréchal et sa jeune femme; avec eux, le 3 décembre 1785, il avait quitté «l’aimable vallon». Il racontait ainsi à sa femme ce petit voyage[62]:
«Nous sommes arrivés hier à deux heures et demie. J’ai dîné chez M. de l’Etang. Le ménage a dîné à la casa. J’ai été enchanté de lui pendant la route et dans la petite heure que nous avons passée, tous trois, à Saint-Germain, en attendant le déballage. Je conterai cela au cœur maternel. Il y a bien du bon sous les ailes de ce joli zéphir. Il faut que jeunesse s’use et se passe et que l’expérience, le grand maître de tous les hommes, achève ou plutôt commence notre éducation civile. On a [p. 52] découvert ses défauts, on en gémit, on veut les corriger. Quoi de mieux que de les corriger? J’ai dit, je crois, ce qu’il fallait dire et la petite couleuvre m’a non seulement embrassé, elle m’a baisé la main. Lui, a dit: «Mon oncle aime réellement notre bonheur. Aimons-le donc bien.» La petite couleuvre a été mieux que vous ne l’avez vue tous. Sa timidité qui est extrême, soyez-en sûrs, a laissé percer plusieurs rayons de son âme et de son esprit qui m’ont charmé.»
Cependant, les mois d’exil avançaient et l’on songeait à rappeler de Neuville la triste Sophie[63]; «Ma fille aînée, écrivait Mme de Grouchy au Président, me coûte 9.000 livres depuis vingt mois; non pas du fond de son état, mais des accessoires, y compris son trousseau. Il faut que la seconde en coûte autant à peu près dans le même espace. Je ne suis pas en état d’en faire le quart. On promet du secours. Je veux avoir la foi malgré des promesses qui n’ont pas eu un denier d’effet pour l’aînée.
«Quelle angoisse pour la cadette de manquer ce décorum, cette apparence d’état et d’existence! Quelle tête assez mûre à cet âge pour ne pas croire quelque bien dans une sphère nouvelle! Et aussi [p. 53] de quel droit lui ferions-nous manquer l’avantage très éloigné, mais certain, d’une prébende dans un âge où l’aisance est nécessaire. Et, en vérité, la situation de mes filles est telle et elle peut devenir si fâcheuse, si le meilleur ordre de choses possible n’arrive pas, que cette vue n’est rien moins qu’à négliger.»
Enfin, le 18 avril, la date du retour de Sophie est fixée[64]: «M. de Grouchy en parle tous les jours. Il voulait qu’elle ne fût que trois jours à Paris. Je lui ai fait entendre qu’il lui en fallait plus afin qu’elle pût aller à Versailles. On voit qu’il la désire. Il est vrai qu’il y a peu de pères comme lui. Si elle ménage bien l’impression du retour,—et je n’en doute pas,—elle en verra les fruits. Je ne suis point fâchée de jouir d’abord de ma fille seule. Il y a assez longtemps que j’en suis privée.»
Voici donc Sophie de Grouchy revenue à Villette. Mais que de changements dans ces vingt mois! En partant pour Neuville, elle avait la foi; elle n’avait lu que des livres de piété, Télémaque et Marc-Aurèle. A son retour, elle ne croyait plus; Voltaire et Jean-Jacques étaient devenus ses auteurs préférés. Elle se plaignait du grand nombre des damnés et de la faible quantité des élus, ce qui était inconciliable, [p. 54] disait-elle, avec l’existence d’un Dieu plein de bonté! Cependant, durant six mois, elle supplia ce Dieu de lui rendre la foi; mais ce fut en vain[65].
Mme de Grouchy, qui était très pieuse, brûla les livres rapportés de Neuville; c’était inutile, car Sophie en connaissait à fond le contenu. Du reste, avec le temps, les rôles changeront: celle qui avait déjà pris une si grande influence sur un des magistrats les plus éclairés de son temps, celle qui devancera Condorcet lui-même par les audaces de son esprit, saura convertir sa mère à ses idées et dicter sa conduite à ses derniers moments!
Quelques mois seulement devaient s’écouler entre le retour de Sophie et son mariage. Cette période fut remplie par les œuvres de charité et par les soins donnés à l’éducation de Charles Dupaty, fils aîné du Président.
Elle retourna chez les pauvres qu’elle avait l’habitude de visiter avant son départ, leur apportant, avec les secours matériels, les consolations morales plus précieuses encore.
Un jour, comme un des gardes du château s’était empoisonné en mangeant des champignons, elle se rendit chez lui en grande hâte et ne quitta [p. 55] la maison qu’après cinq heures de soins intelligents qui sauvèrent le pauvre garçon[66].
C’est ainsi que la charité survécut, jusqu’à son dernier jour, aux sentiments pieux à jamais disparus.
En dehors des instants qu’elle donnait à ces généreuses occupations, presque tous ses moments étaient pris par les leçons de Charles Dupaty; Sophie recommençait avec lui ce qu’elle avait fait pour ses deux frères, tant l’instruction était devenue chez elle comme une véritable vocation.
Il faut l’entendre raisonner sur ces matières de pédagogie; elle saura dissimuler la mauvaise humeur paternelle, «l’enfant ayant plus besoin d’être encouragé que grondé[67]».
«Je vous ai promis, écrivait-elle au Président[68], de m’occuper de Charles, cher petit oncle, et du soin touchant de préparer son âme à l’activité constante qui peut, seule, lui faire tirer parti de sa position, de son âge, de ses talents et de votre exemple. Je me suis acquittée de mes promesses avec ce doux plaisir qu’on trouve à servir un être qu’on aime et des sentiments qu’on partage. Je [p. 56] suis très contente de Charles. Le voilà, je crois, disposé à prendre le genre de vie le plus propre à vous assurer un fils digne de vous et à lui la gloire de soutenir le nom que vous lui donnez... Il s’habituera à la règle si nécessaire dans l’âge où le développement de tous les besoins jette bien de l’incertitude dans la volonté; il ploiera son caractère à une nécessité et se liera insensiblement au besoin de la vie de la pensée, si utile à tous les âges et à toutes les positions. Voilà ce que je lui ai fait sentir et ce qu’il a saisi avec l’avidité d’une âme qui sent sa voie... La sensibilité, quand on lui parle de vous, annonce un sentiment profond de vénération et d’attachement. Je crois que vous enflammerez aisément son âme en lui montrant ce que vous espérez, en lui parlant du bonheur d’avoir un fils qui puisse flatter votre tendresse et mériter un jour que, confondant les noms, les vertus et le mérite dans une douce erreur, on flotte et on hésite... (puis, elle conseillait que, pour favoriser son goût de la lecture, on lui donnât souvent les moyens de se former une petite bibliothèque). C’est la première propriété que doit chérir et désirer un jeune homme dont l’âme se développe... Quel charme j’éprouverais, cher petit oncle, si, dans ces moments pénibles, je pouvais servir réellement votre tendresse et contribuer à former une [p. 57] âme digne de la vôtre, c’est-à-dire une âme qui lui ressemblât.»
Dupaty traversait, en effet, une de ces époques cruelles dont son existence de magistrat fut semée et Sophie l’aidait, par ses encouragements, dans ces terribles heures. Beaumarchais, qui l’aimait, le lui disait[69]: «J’irai vous voir après-demain matin et nous arrangerons ensemble un dîner d’amitié. Le comte de Lauraguais mérite d’en être; malgré les écarts de son imagination, il a un vrai génie et un excellent cœur. Il vous estime, il vous aime. Il admire aussi la belle chanoinesse que le ciel vous a envoyée pour vous inspirer dans vos ouvrages et vous soutenir dans les persécutions. Adieu, mon ami; l’apprenti de Molière embrasse l’égal de Démosthène.»
Avec Sophie, la joie et la gaieté étaient rentrées à Villette. Les enfants du Président ne voulaient pas quitter leur grande cousine: «Papa s’occupe tous les jours de leurs plaisirs ici, écrivait-elle[70], et du moment où l’aimable petite tante pourra respirer l’air embaumé de ses bosquets. Il en a fait de charmants. Dans les uns, il vous offrira le parfum des fleurs; dans ceux-ci, un ombrage épais; dans [p. 58] d’autres, mille jeunes arbustes dont la végétation rapide nous rappelle, sans cesse, ce que fait, tous les jours, près de vous, la nature pour le plaisir de vos yeux et le charme de votre cœur.»
Cette vie tranquille n’était traversée que par les visites des amis ou des parents; dans la même lettre, Sophie racontait à son oncle le passage de son frère Emmanuel à Meulan: «Nous avons été les attendre. Voici le détail de notre entrevue avec les âmes du Nord qui occupaient le fond de la voiture; mine froncée de la part de la dame; le père de descendre de la voiture dans la cuisine de l’auberge et d’accorder quelques paroles à miss Charlotte. Quant à Sophie, elle s’en est passée et a été, pendant les cinq minutes de la rencontre, sous le nuage qui, comme vous le pensez, n’a pas distillé de rosée, mais a, du moins, été moins ténébreux que le premier aspect ne l’avait fait imaginer. Nous ne les avons pas retardés d’une minute. Mon frère, que j’ai à peine embrassé, a donné un regard de sentiment et de regret à ces premiers lieux où il a vécu, à ces premiers êtres qui l’ont aimé et qui l’aimeront peut-être plus que tous ceux qu’il rencontrera dans sa vie. Le fouet a claqué. Sophie a regardé Charlotte et, sérieusement, nous avons regagné le vallon et, pour y entrer sereins, nous avons parlé de l’heureux [p. 59] jour où cette chère petite tante qui nous a tant inquiétés y reviendra elle-même. Ce ne sera pas pour le coup des âmes du Nord que nous irons attendre.»
Un jour, cependant, le 22 août 1786, il y eut, à Villette, une terrible alarme. Un chien qui s’était échappé du château de Rueil[71], situé dans les environs, vint se réfugier dans les communs du château. Il mordit Charles Dupaty, malgré les efforts courageux de Sophie qui s’était exposée bravement en voulant éloigner l’animal que l’on croyait enragé. On renvoya, de suite, l’enfant à Paris, non sans conseiller au Président un traitement qui fait sourire aujourd’hui[72], c’est-à-dire d’envoyer l’enfant à la mer, «précaution efficace dans les trois fois vingt-quatre heures et à laquelle on fera succéder la médication par le mercure».
Cet accident, qui n’entraîna, d’ailleurs, aucune suite fâcheuse, eut un grand retentissement, car Beaumarchais, de Saint-Lubin, le 1er septembre, écrivait au Président[73]: «J’ai reçu, mon ami, avec un serrement de cœur horrible, l’affreuse nouvelle du malheur de votre fils. De consolations, je n’en [p. 60] ai point à vous donner là-dessus. Heureux encore si vous pouvez pleurer! Je prie le chevalier Dudon de m’envoyer des détails sur son état. Il m’a mandé qu’on espérait que le chien n’était qu’en colère. S’est-on emparé de l’animal? C’est là, je l’avoue, une bien triste façon d’intéresser la nation et de réchauffer son ardeur pour votre vengeance. Mais si l’art de M. Sabatier vous rend votre cher enfant, je crois connaître assez les Français pour vous assurer que vous leur êtes devenu doublement précieux par ce double malheur et qu’on n’apprendrait pas, sans un cri général d’indignation, qu’on vous eût refusé au conseil la fière justice qui vous est due. Je vous porte dans mon cœur et vous prie de me mettre aux pieds de la mère désolée de votre fils.»
Le courage dont Sophie avait fait preuve ce jour-là avait eu pour témoin le marquis de Condorcet qui, depuis quelques semaines, était souvent l’hôte de M. et Mme de Grouchy. Après avoir admiré la beauté, les manières distinguées, l’esprit brillant et cultivé de Sophie, il n’avait pas tardé à découvrir en elle un caractère élevé, un cœur droit et une âme forte. La première rencontre avait eu lieu, à Paris, rue de Gaillon, dans le salon où Dupaty aimait à réunir les littérateurs, les philosophes et les savants. Là, M. et Mme de Grouchy [p. 61] avaient invité Condorcet à venir les voir à Villette aussi souvent qu’il voudrait.
Condorcet définissait le monde «une dissipation sans plaisir, une vanité sans motif, une oisiveté sans repos». S’il fréquentait chez Dupaty et chez les Grouchy, c’est parce qu’il savait bien que chez eux, il ne perdrait pas son temps[74].
La famille de Condorcet était originaire du Dauphiné; ses armes étaient: d’azur, au dragon volant d’or, armé et lampassé de sable à la bordure du même.
Son père était capitaine de cavalerie, et son oncle occupait le siège de Lisieux, après avoir été successivement évêque de Gap et d’Auxerre. Sa mère, une demoiselle de Gaudry, était d’une dévotion ardente.
De plus, Condorcet était allié au cardinal de Bernis et à Mgr d’Yse de Saléon, archevêque de Vienne.
Sous des apparences froides, timides et même [p. 62] embarrassées, Condorcet était avec ses amis d’une gaieté douce et spirituelle; malgré l’audace et la sévérité de ses doctrines, il était bon et affectueux. D’Alembert mourant le choisit parmi tous ses amis pour lui léguer la mission de pourvoir aux besoins de ses deux domestiques, et ce legs fut scrupuleusement exécuté par Condorcet lui-même, par Sophie et, plus tard, par le général et par Mme O’Connor.
«La bonté brillait dans ses yeux, dit Grimm, et il aurait eu plus de tort qu’un autre de n’être pas honnête homme, parce qu’il aurait trompé davantage par sa physionomie qui annonçait les qualités les plus paisibles et les plus douces.»
Il répandait autour de lui le parfum des vertus sérieuses, à ce point qu’on a pu dire de son intelligence[75], «en rapport avec sa personne, que c’était une liqueur fine, imbibée dans du coton».
Cependant, Condorcet était susceptible de haines vigoureuses, et cet homme, qui allait entrer dans une famille dont les attaches parlementaires étaient nombreuses, ne détestait rien plus que les parlements et particulièrement celui de Paris. «J’ai parcouru la liste des assassinats juridiques commis par le parlement de Paris,» écrivait-il à Target, [p. 63] en avril 1775; et il disait à Turgot, en octobre ou novembre 1774, lors du rappel de l’ancien parlement: «On dit qu’il va revenir sans conditions, c’est-à-dire avec son insolence, ses prétentions et ses préjugés. Quelque corrompu que soit le nouveau parlement[76], cependant, à ce qu’il me semble, ce qu’il y a de plus contraire au bien public, c’est de confier le droit de juger de la vie des citoyens à une troupe d’assassins. Or, ces assassins ont assassiné le chevalier de la Barre, l’huissier Moriceau, le prêtre Ringuet. Ils ont assassiné Lally pour avoir le plaisir d’humilier la noblesse militaire, et tous ces assassinats juridiques ont été commis en moins de vingt ans, et ils n’en ont pas eu un remords! Ils n’ont pas perdu un degré d’insolence!»
Dans cette haine, le marquis de Condorcet se rencontrait avec Sophie de Grouchy. N’avait-elle pas inspiré à Charles Dupaty, au cours de ses leçons, le mépris de la magistrature? Les Fréteau, qui ne partageaient pas ces sentiments, ne pouvaient s’y habituer; aussi, au moment où Dupaty remportait, dans l’affaire des Roués, un succès si retentissant, le conseiller Fréteau, son beau-frère et son ami, lui écrivait[77]: «Le bruit de ton [p. 64] triomphe n’a-t-il pas enflammé Charles? Ne l’a-t-il pas réconcilié avec nos devoirs et notre état? J’ai regretté qu’il ne t’ait pas suivi à Rouen et qu’il n’ait pas mêlé ses larmes à celles de tes admirateurs.»
Il y avait donc bien des idées communes entre Condorcet et Sophie; bien des passions aussi, bien des générosités de cœur et des enthousiasmes d’esprit. Le philosophe s’en rendit compte plus vite que la jeune fille et vivement épris par ses grâces et ses qualités sérieuses, il chargea Dupaty de la demander pour lui en mariage à ses parents.
M. et Mme de Grouchy y consentirent avec bonheur.
Le mariage.—Les calomnies de Lamartine et de Michelet.—Installation à l’Hôtel des Monnaies.—Revenus de Condorcet.—Les hôtes du salon.—Mort de Dupaty.—Le Président laisse ses papiers à Sophie.—Fondation du Lycée.—Condorcet y professe les mathématiques.—Sophie assiste aux leçons.—La maison de Mme Helvétius à Auteuil.
Dans le monde, on s’étonna beaucoup de ce mariage. Le futur avait quarante-trois ans et la jeune fille n’en avait que vingt-deux. Mais ce n’était pas là cependant le motif de la surprise générale.
Un géomètre qui se mariait semblait enfreindre un principe de droit.
D’Alembert, à la nouvelle du mariage de Lagrange, ne lui avait-il pas écrit, le 21 septembre 1767: «J’apprends que vous avez fait ce qu’entre nous, philosophes, on appelle le saut [p. 66] périlleux... Un grand mathématicien doit, avant toutes choses, savoir calculer son bonheur. Je ne doute donc pas qu’après avoir fait ce calcul vous n’ayez trouvé comme solution le mariage.»
Mais la beauté, la grâce et l’esprit de Sophie de Grouchy vainquirent les préjugés mondains, et la duchesse d’Anville, mère du duc de la Rochefoucauld, vint dire à Condorcet: «Nous vous pardonnons[78].»
Emporté par la passion, le savant ne demanda aucune dot et se contenta d’un simple contrat verbal. Ce ne fut que par un acte postérieur que le marquis de Grouchy fit don à sa fille, par avancement d’hoirie, d’une somme de 30.000 livres.
D’ailleurs, la générosité de Condorcet se montrait dans les plus petits détails; il voulut donner à Charlotte, sa jeune belle-sœur, une bague de 25 [p. 67] louis, somme énorme à cette époque. Sophie écrivait à ce propos à sa tante Dupaty[79]: «Je suis bien touchée de cette nouvelle attention de M. de Condorcet et en jouis encore plus que celle qui en sera l’objet... Je fais une réflexion à laquelle je vous prie de vous arrêter, chère petite tante, et que je ferai certainement agréer à M. de Condorcet. C’est qu’il faut absolument partager par la moitié le cadeau qu’il veut faire à ma sœur et employer l’autre à en faire un à mon frère. Il n’y aurait aucune raison recevable aux yeux de son amour-propre et même de son amitié pour que Charlotte reçût un cadeau de vingt-cinq louis et qu’on n’eût point songé à lui... Je suis sûre qu’à la réflexion M. de Condorcet goûtera cet arrangement dont sa reconnaissance pour Charlotte (qu’il a su m’avoir poussée à ce mariage) lui a dérobé la convenance en ne portant ses idées que vers elle. Adieu, chère tante, il est minuit et il faut se lever demain. Sûrement, vous serez une des premières pensées de ma reconnaissance et de mon amitié.»
La bénédiction nuptiale fut donnée le 28 décembre 1786, aux jeunes époux, dans la chapelle du château de Villette, par le curé de Condécourt[80]; [p. 68] le marquis de La Fayette, maréchal de camp, major général au service des États-Unis, demeurant à Paris, rue Bourbon et le marquis du Puy-Montbrun, brigadier des armées du roi, grand-croix honoraire de l’ordre de Malte, étaient les témoins du mari; du côté de la jeune fille, son oncle Dupaty, président à mortier au parlement de Bordeaux, remplissait le même office.
Au milieu des signatures où les Dupaty se rencontraient avec les Fréteau, les Grouchy, les Pontécoulant, les Condorcet et les d’Arbouville, il en est une touchante, c’est celle d’un modeste secrétaire de Condorcet, Louis Cardot[81], dont le nom brillera d’un doux éclat aux époques douloureuses prochaines.
Se conformant à ses habitudes généreuses, la nouvelle mariée voulut que ce jour de fête fût embelli par une bonne action, et elle prit à son service le fils de Bradier, l’un des trois Roués que Dupaty venait d’arracher à la mort[82].
[p. 69] La calomnie des pamphlétaires, négligeant le désintéressement dont Condorcet avait fait preuve au moment de son mariage, s’est attaquée à la mémoire du savant et, par contre-coup, elle a cherché à atteindre aussi l’honorabilité de Mme de Condorcet.
Ces récits ne mériteraient aucune créance et, depuis longtemps, seraient oubliés si Lamartine et Michelet ne les avaient repris pour leur compte, leur donnant ainsi une importance telle que l’histoire, aujourd’hui, est contrainte de les réfuter.
Dans l’Histoire des Girondins[83], Lamartine a raconté que le duc de la Rochefoucauld, à l’occasion du mariage de Sophie, avait donné 100.000 francs à Condorcet ou, du moins, qu’il en servait la rente, soit 5.000 livres, au jeune ménage. Après Varennes, lorsque Condorcet et la Rochefoucauld se brouillèrent, le philosophe aurait réclamé très vivement cette somme à son ancien ami.
Arago, dans les pages qui suivent sa biographie de Condorcet[84], réfute ainsi l’allégation du poète-historien:
[p. 70] «Deux voies s’offraient à moi; je pouvais consulter des contemporains et amis désintéressés du fils de la respectable duchesse d’Anville et recourir ensuite à des documents écrits. M. Feuillet, bibliothécaire de l’Institut et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, avait été secrétaire intime du duc de La Rochefoucauld jusqu’à la catastrophe effroyable qui enleva ce bon citoyen à la France. Au moment ou j’écrivais la biographie de Condorcet, je demandai à M. Feuillet de vouloir bien m’éclairer sur les bruits relatifs à la pension et à la demande du capital qui étaient aussi venus à mes oreilles. Il me répondit sans hésiter qu’il n’en avait personnellement aucune connaissance. Ce renseignement négatif et du plus haut prix est corroboré par l’examen minutieux que j’ai fait du compte de tutelle de Mme O’Connor. Je trouve là des détails très circonstanciés sur le passif et sur l’actif de la succession à diverses époques, sur la vente opérée par Condorcet au moment de son mariage d’une petite propriété située près de Mantes, nommée Denmont; sur l’acquisition qu’il fit, avec une partie du prix de la vente, de fermes près Guise provenant de l’abbaye de Corbie. Il est mention dans ce compte, à l’article du passif, de mémoires très peu importants de menuiserie, de serrurerie, etc. Je cite cette [p. 71] circonstance pour montrer avec quel scrupule, avec quelle minutie cet acte est rédigé. J’y trouve aussi, dans l’actif, l’origine, je dirais presque la filiation de petites rentes de 3, 4 et 5 francs.
«Je n’y vois, au contraire, aucune trace d’une augmentation de revenus correspondant à 1786, année du mariage de Condorcet, ni rien qui puisse faire croire à une augmentation de capital de 100.000 francs qui aurait eu lieu à l’époque de la rupture de Condorcet et du duc de La Rochefoucauld.
«Il faudrait renoncer à toute logique pour supposer qu’après cette simple remarque il restera quelque chose de l’horrible calomnie qu’on a voulu faire peser sur la mémoire de Condorcet.»
M. Isambert qui fut avocat à la cour de cassation et qui joua un rôle actif dans les partages de famille entre les petits enfants de Condorcet, n’est pas moins affirmatif qu’Arago. Il a examiné tous les actes, notamment la liquidation du 2 juillet 1807[85], et il affirme que la fortune de Condorcet ne reçut aucun accroissement soit à l’époque de son mariage, soit depuis.
Michelet, dans son livre sur les Femmes de la [p. 72] Révolution, a parlé d’un roman d’amour, antérieur au mariage du 28 décembre 1786 et dont Sophie aurait été l’héroïne; les noms de la Rochefoucauld, de La Fayette, de l’abbé Fauchet, d’Anacharsis Clootz ont été prononcés; Sophie aurait prévenu loyalement son mari que son cœur n’était pas libre et elle n’aurait aimé réellement Condorcet qu’après trois ans de mariage et lorsque le philosophe aurait conquis son cœur par ses enthousiasmes généreux, au lendemain de la prise de la Bastille.
Sans insister sur l’impossibilité où les pamphlétaires se sont trouvés de préciser leurs accusations, qu’on dise donc si la vie de Villette, dont nous avons minutieusement retracé tous les détails, se prêtait à une pareille intrigue; qu’on dise aussi, quelque opinion sévère que l’on puisse professer à son égard, si Condorcet aurait été homme à supporter de pareilles conditions!
Il vaut mieux en croire ce que les apparences criaient aux yeux de tous. Charlotte de Grouchy, qui avait assisté aux préliminaires et à la cérémonie du mariage, écrivait à sa tante Dupaty, au moment où elle se préparait à partir pour le chapitre de Neuville[86]:
«Je vois dans l’union de Sophie, dans l’amitié [p. 73] de M. de Condorcet un nouvel appui précieux pour mon âme trop sensible et pour ma vie qui va avoir un si grand besoin d’appui. Un sentiment douloureux va me suivre encore à Neuville; celui que je laisse le bonheur derrière moi et que je n’en aurai, là, d’autre que l’espérance.»
Le jeune ménage s’installa, de suite, à l’Hôtel des Monnaies, quai de Conti. Condorcet y habitait déjà et il y avait logé sa mère et un de ses oncles maternels, tous deux morts à cette date de 1786. Ses revenus s’élevaient à environ 18.000 livres de rentes qui se décomposaient ainsi: 5.000 livres d’appointements comme inspecteur des monnaies, 11.000 livres en terres, provenant pour les deux tiers de l’héritage de son oncle, et 2.000 livres en rentes viagères, qui venaient de la succession du père de Condorcet.
Le brave Cardot gérait cette petite fortune, dont le savant ne s’occupait guère.
Le salon de l’Hôtel des Monnaies, à cette époque où l’esprit de société tenait une si grande place en France, ne tarda pas à devenir le rendez-vous des philosophes, des savants et des littérateurs. Et non seulement les Français illustres s’y réunissaient, mais la demeure de Sophie, qui s’ouvrait en même temps que le salon de Mme de Staël, était rapidement devenue le centre de l’Europe éclairée.
[p. 74] La grande génération du XVIIIe siècle se faisait chaque jour de plus en plus rare; les Voltaire, les Diderot, les d’Alembert, les Helvétius étaient morts: leurs héritiers s’appelaient Dupaty, Chamfort, Beaumarchais, Roucher, Garat et tant d’autres moins illustres, mais célèbres cependant, qui aimaient à se grouper autour du dernier des grands survivants, dans le salon qu’y tenait sa femme, maîtresse de maison exquise de bonté, charmante de jeunesse, rayonnante de grâce et d’amabilité.
Aux admirables perfections d’un corps superbe, la marquise de Condorcet joignait une figure malicieuse et spirituelle qui restera curieuse et fine, alors même que les grands chagrins l’auront voilée d’une douceur mélancolique; des sourcils accentués, indice d’une volonté puissante; des yeux grands et noirs; un menton gracieux; un nez légèrement retroussé, aux ailes frémissantes; une bouche un peu grande, mais habituée au sourire; le visage ovale, cher aux grands artistes, qu’encadrait une chevelure abondante et fine; au repos, l’air rêveur des femmes qui ont cueilli la pervenche avec Jean-Jacques; dans la conversation, l’étincelle qui jaillit et qui traduit dans un regard tout l’esprit de Voltaire, résumant ainsi dans une même physionomie ce double caractère, si rarement réuni, qui personnifie le XVIIIe siècle; telle était Sophie [p. 75] qui, calme et victorieuse, a pris place dans le cortège des beautés éternelles, chers et doux fantômes, ombres légères et insaisissables, qui ont gardé le privilège d’être aimées d’amour à travers les âges.
Cette femme délicieuse allait présider, pendant plusieurs années, les dernières assises de l’esprit français.
Son mari était timide, ombrageux, sauvage; elle lui donna le goût du monde et de ses fêtes. Chez son oncle Fréteau, elle avait connu les deux Trudaine: elle voulut les recevoir à son tour et ceux-ci amenèrent, à l’Hôtel des Monnaies, le plus sublime des poètes, alors dans tout le charme de sa jeunesse, le divin Chénier.
Roucher, un de ses hôtes les plus assidus, ne se séparait guère de Cabanis, et le jeune docteur était entré, à son tour, dans ce salon, en attendant qu’il devînt le beau-frère de la marquise.
Que d’autres illustrations se donnaient rendez-vous au quai Conti! et Morellet, et La Fayette, et Volney, et Charles de Constant, et les Suard, «le petit ménage,» comme on disait, tandis que Condorcet, aveugle comme tous les idéologues, définissait ainsi celle qui devait le trahir un jour et le faire mourir[87]: «Je donnerais la moitié de ma [p. 76] géométrie pour le talent que possède Mme Suard, sans le savoir: elle est éloquente dès qu’elle est émue, dès qu’on blesse son cœur ou son goût. Aussi, je remarque que les femmes dont l’adresse modère l’amour-propre évitent de la blesser.»
Les étrangers de passage à Paris sollicitaient l’honneur d’être présentés à Condorcet et à la femme qui savait si bien faire les honneurs de sa maison. C’est ainsi que la marquise fut saluée, pendant ces années, par les souverains et les hommes d’État de toute l’Europe et de l’Amérique: par Christian VII, roi de Danemarck, disciple de Rousseau, esprit déjà faible et qui devait finir dans la déchéance physique la plus cruelle; par ce baron de Gleichen, ancien ambassadeur du monarque danois, mais qui chez Mmes Geoffrin, de Graffigny et Helvétius, avait conquis ses grandes lettres de naturalisation française; par Adam Smith, qui avait connu autrefois Condorcet chez Turgot et qui, à ce second voyage, venait admirer celle qui devait, après sa mort, traduire si éloquemment sa Théorie des sentiments moraux. Grimm ne vient-il pas chercher chez Sophie de nouveaux matériaux pour ses inépuisables correspondances? Voici Alfieri, le tragique, qui va épouser la comtesse d’Albany, veuve du dernier des Stuarts; il salue la France, «terre de la Liberté,» en attendant [p. 77] qu’effrayé il la maudisse dans son pamphlet le misogallo. Celui-ci c’est Mackintosh, tout jeune alors, pas encore marié, préludant déjà aux enthousiasmes futurs par ses doctrines libérales que la Révolution fera éclore.
Dans ce coin, c’est Dumont, le pasteur genevois, demain l’ami et le conseil de Mirabeau; il cause avec Jean-Baptiste Clootz, baron du Val-de-Grâce, prussien riche de 100.000 livres de rentes, parent des Montesquiou-Fezensac, reçu dans les meilleures sociétés, lui qui fut l’ami des Diderot, des d’Alembert, des Jean-Jacques et des Franklin. Ce promeneur mélancolique, c’est Beccaria qui ne peut se distraire de cette épouse qu’il adore et qu’il brûle d’aller rejoindre à Milan, où elle l’attend avec tant d’impatience.
Thomas Payne, le héros de la guerre d’Indépendance, expose bruyamment des idées et des inventions qui, en Angleterre, lui vaudront la prison et ruine.
Cet original, c’est David Williams qui a fondé à Chelsea une chapelle desservie par les prêtres de la nature et qui, à ce premier voyage, est tout entier aux Condorcet, tandis que, dans quelques années, il viendra travailler, chez Mme Roland, à la constitution définitive rêvée par les Girondins.
Voici encore les lords Stormon et Stanhope, [p. 78] Mylord Dear, Bache-Franklin, Jefferson et tant d’autres, qui, «après avoir reçu les théories de la France, viennent, dans le salon de Condorcet, en chercher, en discuter les applications[88]».
C’est qu’en effet bien que l’heure fatidique de 1789 n’ait pas encore sonné, la Révolution est commencée dans les faits et dans les esprits. Sophie prend sa large part du mouvement; elle pousse Condorcet à l’assaut de la vieille société; Dupaty la suit. Fréteau résiste et s’effraye. «J’envoie quelques lignes à Mme de Condorcet, écrit-il de Troyes où il est en exil[89], mais je ne puis partager sa joie sur les changements.»
Le secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences s’est, en effet, mis en avant, sans hésitation, dans toutes les questions politiques. Le public s’inquiète de sa manière de voir et cherche à connaître le fond de ses pensées. Rien ne dut plus étonner Dupaty que cette lettre que lui écrivait un de ses amis, Midy d’Andé, et où un véritable questionnaire était dressé[90]: «Dites-moi, je vous prie, et pour cause, qu’est-ce que M. de Condorcet? C’est un homme d’esprit, de l’Académie française, etc. Je sais tout cela. Mais ce n’est pas cela que je [p. 79] demande. Est-ce un homme? un homme d’honneur, sur la parole duquel on puisse compter? Est-il bon citoyen? Ne fronde-t-il pas les opérations du ministre principal? J’ai la bonhomie de penser qu’il vaut mieux être gouverné par un seul que par plusieurs et qu’un bon citoyen ne doit rien faire ni dire qui puisse nuire aux projets généreux du ministre, en vue du bien public. Il a déjà assez à faire pour vaincre les obstacles naturels, sans qu’on en jette de nouveaux sur son chemin. En deux mots, j’ai besoin de savoir si M. de Condorcet est partisan ou détracteur des intentions connues de M. de Toulouse? Votre réponse sera entre nous deux, vous pouvez y compter.»
Le 17 septembre 1788, le président Dupaty, dont la santé était chancelante depuis longtemps, mourait presque subitement à Paris. Ce fut un deuil cruel pour Sophie et pour toute la famille de Grouchy. Charlotte, alors à Neuville, s’exprime ainsi dans une lettre à son cousin Charles[91]: «Charles, mon cher Charles, est-ce vrai? Est-il vrai que ton père n’est plus? Est-il vrai que tu l’as perdu, que ta jeunesse est sans guide, que sa gloire ne t’éclairera plus, que tu ne seras plus l’espoir de son cœur, l’objet de sa complaisance et de [p. 80] ses projets?... Fais-moi voir ton cœur, ton cœur qui lui promettait tant! Que je revoie une fois cet esprit, cette plume vivante et énergique, cette âme immortelle en toi. Quel plus touchant hommage à sa mémoire que son fils le rappelant, que son fils vivant pour celle qui lui a donné la vie!»
On trouva dans les dossiers du Président la note suivante:
«Tous mes papiers seront remis, sans exception, après ma mort, à Mme la marquise de Condorcet qui en disposera à son gré. Ce 14 septembre 1787. Le président Dupaty.»
Ce legs de conscience ne fut pas exécuté; mais la faute n’en doit être imputée ni à Mme de Condorcet, ni à son mari. La présidente Dupaty, mal conseillée, prétendit que son devoir de tutrice ne lui permettait pas de souscrire à un pareil désir. Ce fut en vain que Condorcet écrivit à Fréteau[92]: «Mon cher oncle, j’ignore quelle est la valeur légale de la disposition de M. Dupaty; mais je sais que dans toutes les familles honnêtes ces sortes de dispositions sont respectées jusqu’au scrupule. J’en ignorais l’existence jusqu’à mon retour à Paris où ma femme, en rangeant quelques fragments que son [p. 81] oncle lui avait confiés, a trouvé enveloppé et non cacheté le papier dont je vous ai envoyé l’exacte copie. Le sens m’en paraît très clair, c’est évidemment une disposition de confiance et, par conséquent, aucun billet, aucun titre de propriété, d’aucune espèce, ne peut y être compris... Rien de plus simple qu’une telle disposition; il est naturel de laisser ses papiers à une personne de ses amies qu’aucune des relations qu’on a pu avoir ne peut offenser et qui verra tout avec l’indulgence de l’amitié. Il est naturel encore qu’un homme occupé toute sa vie de littérature et de philosophie, laissant des ouvrages commencés, en rende dépositaire un homme de sa famille qui a toujours cultivé les lettres et la philosophie, surtout lui connaissant des opinions assez conformes aux siennes et une grande tolérance pour celles qui y sont contraires. Si cette disposition faite en faveur d’une jeune femme peut paraître extraordinaire à des esprits difficiles, l’usage qu’elle en fait en la remettant à un mari de mon âge doit dissiper tous les nuages. J’ose croire aussi ma réputation assez bien établie pour être sûr qu’aucun créancier ne me supposera l’intention de lui dérober une partie de son gage et que, si quelqu’un d’eux témoignait de la défiance, elle ne serait pas sincère, d’autant plus que la disproportion très grande de la masse des [p. 82] dettes et de celle des biens ne peut leur laisser aucun motif raisonnable d’inquiétude.
«Mme Dupaty connaît mon amitié pour elle et pour ses enfants. Nous avons été assez heureux pour lui donner des preuves de notre zèle pour la gloire ou les intérêts de son mari et pour ceux de ses enfants et, sûrement, elle a une âme naturellement trop sensible et trop bonne, un cœur naturellement trop droit et trop pur pour nous faire l’injure de voir avec regret ce dépôt passer dans nos mains. Elle sait bien que nous n’en ferons jamais qu’un usage auquel sa tendresse maternelle et son attachement pour la mémoire de son mari puisse applaudir. Elle doit penser que nous prendrons les précautions nécessaires pour que ces papiers retournent à leur source en cas d’accident et cette assurance doit lui ôter la seule inquiétude qu’elle puisse avoir.
«M. Dupaty a fait cette disposition en partant pour aller achever à Rouen la noble et courageuse action qui lui assure l’immortalité[93]. Je n’y vois point de trace de précipitation, mais seulement peut-être le manque de ces précautions multipliées qu’inspire la défiance, lorsqu’on a le malheur de ne pouvoir compter après soi sur l’amitié et les [p. 83] égards de sa famille, malheur que M. Dupaty était éloigné d’avoir à craindre...
«Voilà, mon cher oncle, ce que je pense sur l’objet dont vous m’avez parlé. J’espère que la manière un peu différente dont nous l’envisageons n’altérera point ni vos bontés, ni votre amitié. Je vous abandonnerais volontiers mon opinion par déférence pour vos lumières comme par le désir de ne rien faire qui ne vous soit agréable, s’il était en mon pouvoir de consentir à sacrifier la confiance d’un homme qui n’est plus.
«Adieu, mon très cher oncle, nous vous prions tous deux d’agréer les assurances de notre tendre et inviolable attachement.»
C’était là le langage de la raison et du respect pour la volonté des morts. Cependant Fréteau n’en fut guère touché[94]: «Je sais, mon cher neveu, répond-il à Condorcet, et je reconnais que M. Dupaty partageait quelques-unes de vos opinions; mais, d’une part, il ne les avait pas toutes, à beaucoup près; par exemple vos idées sur la parfaite sécurité où doivent être toutes les nations de l’Europe à l’égard des entreprises du despotisme et sur le danger imminent qu’elles doivent apercevoir, au contraire, dans les aristocraties, l’affectaient [p. 84] douloureusement. Il en pleurait dans mon sein, il n’y a pas trois mois, en me remettant les écrits où vous publiiez ces aperçus pendant que la magistrature était réduite au silence et une foule des membres de la noblesse renfermés dans les châteaux. Au surplus, il savait aussi que ma nièce usait encore quelquefois de la liberté que vous vouliez bien lui laisser de ne pas partager toutes vos opinions et il a pu croire qu’en la choisissant personnellement pour dépositaire et pour arbitre de l’usage à faire de ses compositions, il ne lui interdisait pas le droit de déférer sur ce point à ses propres lumières, à celles d’une veuve si bien méritante, à celles de ses tantes, de ses oncles, concurremment avec les vôtres, quoique d’une manière toujours subordonnée à vos idées. Si ma nièce en usait ainsi, si même elle s’arrêtait à ce que l’écrit en question peut avoir d’irrégulier dans la tournure pour laisser à sa tante la disposition des papiers de confiance, comme elle fera de ceux d’affaires, elle ne paraîtrait à personne avoir exposé cette confiance du testateur à être compromise ou troublée. Peut-être même louerait-on (au moins quelques esprits assez droits le pensent ainsi), peut-être louerait-on cette réunion de sa part à des cœurs dont l’attachement si ancien n’est point équivoque et auquel on ne croirait point que vous eussiez fait à tort le sacrifice de la [p. 85] confiance exclusive d’un homme qui n’est plus. Quand je dis «vous», mon cher neveu, c’est que je ne vous sépare pas de ma nièce qui n’est aux yeux de personne ce que vous appelez une jeune femme et qui ne pense pas, sans doute, que j’aie supposé le besoin d’aucun appui extérieur à une raison aussi ferme et aussi exercée que la sienne.»
Dans une lettre qu’elle adressait à de Sèze, son conseil[95], la présidente Dupaty laissait parfaitement voir les motifs de sa résolution et le fond de sa pensée: «Ma nièce et son mari, homme de lettres et philosophe connu par des maximes fort opposées à celles de la magistrature, ou leurs héritiers peuvent, soit en ce moment, soit à quelque autre époque voisine de l’établissement de mes enfants, disposer de ces papiers d’une manière qui compromette la mémoire de leur père, déjà si fortement attaquée par l’envie, la prévention ou la malignité et qui, par là, nuise à mes enfants... Malgré tout mon respect pour les volontés du défunt qui, depuis trois ans environ, était l’ami très intime de ma nièce et jusqu’à un certain point de son mari, je crois ne pas devoir obéir à cette loi de rigueur qui semble un peu pénible pour moi après une union de dix-neuf ans qu’autant que le titre en est valable...»
[p. 86] En réalité, la Présidente très pieuse n’avait confiance ni en Condorcet, ni en Sophie. Elle l’avait bien montré, dès le lendemain de la mort du Président, en rappelant auprès d’elle sa fille Eléonore[96] que Dupaty, au contraire, s’il avait vécu, aurait voulu laisser sous la direction de Mme de Condorcet le plus longtemps possible.
Sophie s’en était montrée très affectée. Cette jeune fille l’aimait, pourquoi la séparer d’elle? «Comment voulez-vous, écrivait-elle à sa tante[97], qu’elle ait pour vous la confiance, l’attrait qu’elle avait pour son père? Comment voulez-vous entrer dans son cœur pour la diriger, pour y faire germer la piété, pour gouverner le développement de sa sensibilité? Comment voulez-vous la rendre heureuse et devenir son amie en l’éloignant de celle qu’elle a déjà, en lui demandant après la perte qu’elle a faite de s’imposer à elle-même une seconde perte? Ah! permettez que je m’arrête ici et que je parle à votre cœur. De bonne foi, peut-il se flatter d’obtenir par de pareils moyens la confiance et l’amour?
«Vous manquez absolument le but essentiel de mon oncle. En attirant à lui cette enfant, ce but [p. 87] était aussi chrétien que raisonnable. Il voulait: 1o développer sa sensibilité, persuadé qu’un être très sensible et surtout une femme ne pouvait manquer d’avoir, un jour, la douceur, la bonté, le besoin du bonheur de tout ce qui dépend d’elle, enfin toutes les qualités aimables et toutes les vertus domestiques, nécessaires au sexe; 2o il voulait surtout s’emparer en quelque sorte de cette sensibilité, l’occuper par la confiance, par l’amitié, par l’étude, de manière à ce qu’Eléonore pût arriver à l’âge d’être mariée sans que son cœur eût fait de choix et en faire, d’accord avec elle, un qui pût lui convenir et lui assurer à la fois le bonheur si rarement réuni de l’amour et de la vertu, du penchant et du devoir... Il est une réponse secrète que vous faites tout bas, que vous ne m’articulerez point et à laquelle je ne refuserai point de répondre. Vous me craignez sous le rapport de la religion. Vous craignez mon influence et celle de M. de Condorcet. Quant à cette dernière, vous auriez raison de la craindre si le caractère de M. de Condorcet, son amitié pour vous, son respect pour l’enfance, pour l’opinion d’un chacun et son indifférence extrême sur cet objet ne vous assuraient qu’il ne le traitera jamais d’aucune manière devant aucun de vos enfants. Quant à moi, je puis vous répondre et que vous n’avez point à craindre [p. 88] la contrariété de mes opinions avec vos principes et que, dans les détails, les différences qui s’y trouvent ne seront jamais l’objet de ma critique. Vous avez pu voir que, depuis que je suis ici, je n’ai rien conseillé à Eléonore sans vous en parler et je vous promets encore cette déférence quelque mal reconnue qu’elle soit par votre méfiance. Loin de jamais l’éloigner des grandes vues de la religion et de l’influence qu’elle doit avoir sur la conduite, je l’y entretiendrai toujours, non pas à la vérité par les mêmes moyens, mais par des motifs que je crois plus touchants et plus efficaces.»
Pour en revenir au legs des papiers du Président, disons que Mme de Grouchy avait pris énergiquement vis-à-vis de sa sœur, la défense de sa fille et de son gendre. «Cette disposition, disait-elle[98], est aussi sacrée que naturelle. Elle est sacrée puisqu’elle est celle de ton mari et qu’elle porte sur l’objet dont la propriété était celle de son être même; ce sont ses ouvrages. Elle est naturelle, puisqu’il les remet aux personnes auxquelles il les communiquait tous les jours, qui par l’analogie de leurs pensées et des siennes en faisaient le plus de cas, de qui il agréait les conseils et qui se faisaient un devoir de lui faire adopter les tiens... Quel prix [p. 89] n’attachait-il pas à ses pensées et à ceux qui en tenaient pour ainsi dire le fil?
«Permets-moi d’appeler un moment, ici, ce trop malheureux ami. Que ne souffrirait-il pas en voyant ce gage d’estime et de confiance menacé d’être pesé au poids de la loi? De quel œil te verrait-il y soumettre ses intentions les plus chères?... N’hésite pas sur une volonté qui ne peut souffrir de doutes sérieux, mais dont il serait réellement trop offensant pour sa mémoire et pour nous que l’exécution ne fût pas immédiatement due à ta propre adhésion. C’est ton cœur même que j’atteste: je le connais trop pour douter que la volonté de ton mari et ton estime pour mes enfants n’y triomphent d’un scrupule que la réflexion détruit et que la raison et le sentiment proscrivent également.»
En vain, le 22 décembre, Mme de Grouchy revenait à la charge: «S’il était, dit-elle[99], une loi assez absurde pour priver un homme de la liberté si naturelle, du droit si légitime de disposer de ses ouvrages parce qu’il laisse femme et enfants, il serait inouï que ce fût la veuve du magistrat qui a le plus sauvé d’hommes de l’injustice ou de l’abus des lois, qui invoquât contre lui l’une des plus oppressives et [p. 90] des plus tyranniques, puisque c’est le cœur, l’esprit, l’âme de l’homme qu’elle opprime!»
Malgré toutes ces raisons la présidente Dupaty s’obstina dans sa résolution, motivée, disait-elle, par des droits anciens et imprescriptibles. Mme de Condorcet en fut profondément affligée; mais comme, avec elle, le cœur l’emportait toujours, ce fut elle qui se soumit en écrivant que son affection pour la Présidente et ses enfants n’en serait nullement changée[100]: «Tout ce que nous pouvons avoir d’amis et de moyens de vous servir ainsi que vos enfants n’en est pas moins à vous, ma chère tante, et quoique notre zèle attende à l’avenir que vous l’avertissiez, vous le trouverez également actif lorsque vous le réclamerez.»
C’est ainsi que se termina, sans conséquences fâcheuses, et grâce à la générosité de Sophie, cette affaire qui aurait pu troubler et séparer à jamais une famille aussi unie.
Au commencement de 1786, quelques amateurs de lettres ayant à leur tête Monsieur, le comte d’Artois, MM. de Montmorin et de Montesquiou avaient créé, au coin des rues Saint-Honoré et de Valois, un centre de réunions littéraires et savantes qui prit le nom de Lycée.
[p. 91] La Harpe et Condorcet, bien que brouillés depuis la mort de Voltaire[101], étaient les deux hommes remarquables du nouvel établissement.
Les cours de la Harpe, admirablement faits, avaient lieu l’après-midi à deux heures; ses leçons de littérature devinrent rapidement des leçons d’enthousiasme révolutionnaire.
En même temps, Garat et Marmontel enseignaient l’histoire; Condorcet et Lacroix, les mathématiques; Fourcroy, la chimie et l’histoire naturelle; De Parcieux, la physique. «Pour la première fois, en France, dit Sainte-Beuve, l’enseignement tout à fait littéraire commençait et se mettait en frais d’agrément.»
Au bout de bien peu de temps et la mode s’en mêlant, le Lycée obtint un succès prodigieux[102]. On y compta bientôt plus de 700 souscripteurs, et de ce nombre, dit Grimm, «les femmes les plus [p. 92] distinguées de la cour et de la ville». C’était, avec l’élite des jeunes dames, des gens d’esprit, des littérateurs, tout ce qu’il y avait de plus brillant à cette florissante époque de Louis XVI.
Sophie de Condorcet, qu’un de ses admirateurs[103] avait salué du titre de Vénus Lycéenne, devint parmi les jeunes auditrices, la plus assidue et la plus remarquée.
Elle venait écouter son mari proclamant à l’ouverture de son cours de mathématiques que «toutes les prétentions naissent également de l’ignorance de l’homme et de l’ignorance plus grande qu’il suppose à ceux devant lesquels il les montre».
Sophie retrouvait au Lycée tous ceux qui se pressaient, le soir, dans ses salons: Garat, Grimm, Ginguené, Chénier, Lemercier. Elle y tenait une véritable cour. Aussi, l’on ne manqua pas de la chansonner, elle et les jolies femmes qui l’imitaient:
Dans la belle saison, Sophie quittait l’hôtel des Monnaies soit pour retourner à Villette, où elle avait laissé tant de souvenirs, soit pour aller passer quelques jours à Auteuil, chez une femme illustre et bonne, qui devait l’aimer bientôt comme une seconde mère.
Condorcet, plusieurs années avant son mariage, avait été conduit par Turgot, chez Mme Helvétius, dans cette petite maison d’Auteuil «où l’on fêtait encore les saints de l’Encyclopédie». Dupaty, Roucher, Franklin s’y donnaient rendez-vous et, dans cette calme retraite, Condorcet avait goûté, avec les joies de l’amitié, la douceur des longues causeries dans un milieu sympathique où sa timidité n’avait rien à redouter.
Anne Catherine de Ligniville, d’une de ces quatre familles illustres qu’on appelait les Grands chevaux de Lorraine, était née en 1719; sans fortune et comme elle avait vingt frères ou sœurs, ses parents avaient accepté avec empressement la proposition de Mme de Graffigny, tante de l’enfant, qui ne demandait qu’à l’adopter en se chargeant [p. 95] de son éducation et de sa présentation dans le monde. En 1740, la tante et la nièce, celle-ci dans toute la splendeur de ses vingt ans, arrivaient à Paris. Logées rue d’Enfer, elles recevaient, parmi beaucoup de beaux esprits, Turgot et Helvétius; celui-ci déjà riche et célèbre, celui-là petit abbé en Sorbonne.
Frappé de la beauté de Mlle de Ligniville, Helvétius la demanda en mariage: l’union fut célébrée le 17 août 1751.
Les jeunes époux partagèrent leur temps entre les terres de Voré et de Lumigny et l’hôtel de la rue Sainte-Anne qui s’ouvrait tous les mardis aux gens de lettres et aux philosophes.
Devenue veuve, après avoir marié ses deux filles et réglé ses affaires, Mme Helvétius s’établit à Auteuil dans une maison qu’elle venait d’acheter à Quentin de la Tour, le fameux pastelliste.
Elle aimait la retraite, mais détestait la solitude. Aussi, dans sa maison ensoleillée, remplie d’oiseaux et des plus beaux angoras du monde, voulut-elle avoir auprès d’elle, à demeure, deux vieux amis de son mari, les abbés Lefebvre de la Roche et Morellet.
Il y avait aussi une chambre toujours prête pour le jeune ménage du poète Roucher et pour la petite Eulalie que Mme Helvétius avait rebaptisée [p. 96] du joli surnom de Minette qu’elle avait porté, elle-même, dans sa jeunesse.
Roucher conduisit à Auteuil Dupaty et Cabanis; celui-ci ne tarda pas à devenir, comme La Roche et Morellet, le commensal ordinaire de la maison.
Enfin, au printemps de 1777, Franklin, qui demeurait à Passy, était entré en relations avec sa voisine par l’intermédiaire de Turgot et de Malesherbes.
Le patriarche, bientôt l’intime ami de celle qu’il appelait si joliment Notre-Dame d’Auteuil, y avait rencontré les deux filles de Mme Helvétius, Mmes de Mun et d’Andlau et il les avait nommées les Étoiles. Comme Turgot, il avait demandé la main de sa nouvelle amie; mais, pas plus que le ministre, il n’avait pu rompre le veuvage de Mme Helvétius. On connaît la lettre charmante qu’il lui écrivit à cette occasion[104]; on sait moins qu’ayant voulu s’expliquer les causes de l’influence exercée par Mme Helvétius sur les hommes d’État, les poètes, les savants qu’elle recevait et charmait, il se répondit en lui écrivant à elle-même.
«Ce n’est pas que vous affichiez des prétentions à aucune de leurs sciences, et, quand vous le feriez, la ressemblance des études ne fait pas [p. 97] toujours que les gens s’entr’aiment. Ce n’est pas que vous preniez quelque peine pour les engager; une simplicité sans art est la partie frappante de votre caractère. Je n’essaierai pas d’expliquer la chose par l’histoire de cet ancien à qui l’on demandait pourquoi les philosophes recherchaient la connaissance des rois, tandis que les rois ne recherchent point celle des philosophes, et qui répondit que les philosophes savaient ce qui leur manquait et non pas toujours les rois. Cependant, la comparaison est bonne en ceci, que nous trouvons dans votre douce société cette charmante bienveillance, cette aimable attention à obliger, cette disposition à plaire et à se plaire que nous ne trouvons pas toujours dans notre société les uns les autres. Ce charme sort de vous; il a son influence sur nous tous, et, dans votre compagnie, nous ne nous plaisons pas seulement avec vous, nous nous plaisons mieux les uns les autres, nous nous plaisons à nous-mêmes.»
Le départ de Franklin, en 1785, laissa un grand vide chez Mme Helvétius. Le patriarche n’oublia ni sa vieille amie, ni les membres de l’«Académie des belles-lettres d’Auteuil» et, de Philadelphie, en 1788, il écrivait à Morellet «Toutes les fois que, dans mes rêves, je me transporte en France pour y visiter mes amis, c’est d’abord à Auteuil que je vais.»
[p. 98] Ces amis, c’étaient La Rochefoucauld, Lavoisier, Le Veillard[105], Chamfort, Cabanis, Roucher, Le Ray de Chaumont[106], Mme Brillon, «la Brillante,» comme disait Franklin qui lui dédia quelques-uns de ses petits traités de morale, véritables chefs-d’œuvre de bon sens et de philosophie pratique.
Tel était le milieu hospitalier où Mme de Condorcet fut reçue à partir de 1787; accueillie d’abord en considération de l’estime affectueuse qu’on avait pour son mari, elle sut bientôt conquérir pour elle-même les sympathies les plus vives.
Bien que tout près de la grande ville, on en était assez loin cependant pour sentir l’influence pacifique des larges horizons dans des campagnes boisées.
Aussi, dans l’intervalle des agitations qui précédèrent la grande tourmente, Sophie vint jouir plusieurs fois, et toujours avec délices, de ce calme précieux; elle en garda pour l’humble village une sincère reconnaissance et quand les événements l’obligèrent à quitter Paris, ce fut à Auteuil qu’elle vint se fixer, assurée d’y rencontrer de bons amis et d’y retrouver, croyait-elle, une tranquillité, qu’hélas! elle ne devait plus connaître.
Le foyer de la République.—Condorcet et sa femme se séparent de leurs anciens amis.—Naissance d’une fille.—Pamphlets contre le marquis et sa femme.—Les Girondins chez Condorcet et chez Julie Talma.—Etablissement à Auteuil avec Jean Debry auprès de Cabanis.—Lettres sur la Sympathie.—Mort de la marquise de Grouchy chez Condorcet.—Mise en arrestation de Condorcet.
Condorcet ne s’était pas présenté aux États généraux; mais la situation qu’il occupait, ses relations dans le monde philosophique, ses travaux appréciés de l’Europe savante, tout contribuait à lui créer une place à part, dans le mouvement général qui entraînait les esprits.
Attaché, pour quelques mois seulement, au groupe constitutionnel ou Société de 89, il servait les idées nouvelles dans le Journal de Paris et dans la Feuille villageoise.
Mais c’était surtout sa maison, devenue bien vite un foyer politique, qui lui assurait une influence prépondérante; Mme de Staël semblait destinée à présider les salons de la Constituante; [p. 100] chez Mme de Condorcet, on sentait, sans pouvoir préciser comment, qu’on dépasserait rapidement les timides réformes pour se lancer à corps perdu dans les rêves généreux et dans les entreprises les plus aventureuses. Et de fait, pendant la Législative et les premiers mois de la Convention, la royauté de Sophie alla tous les jours grandissante.
Condorcet, après avoir contemplé son admirable épouse, aurait voulu que toutes les femmes fussent admises au droit de cité. Il invoquait les exemples d’Elisabeth d’Angleterre, de Marie-Thérèse, de Catherine de Russie et ajoutait[107]: «La princesse des Ursins ne valait-elle pas un peu mieux que Chamillart? Croit-on que la marquise du Châtelet n’eût pas écrit une dépêche aussi bien que M. Rouillé? Mme de Lambert aurait-elle fait des lois aussi absurdes et aussi barbares que celles du garde des sceaux d’Armenonville contre les protestants, les voleurs domestiques, les contrebandiers et les nègres?»
Du reste, dans la famille, tout le monde se mettait à l’unisson de Condorcet et de sa femme; le vieux marquis de Grouchy s’était fait nommer avec Berthier, alors major de la garde nationale de Versailles, un des deux commissaires recenseurs [p. 101] des citoyens actifs des villages[108]; c’était une mission difficile, ingrate même, sans grand honneur et sans aucun profit. Mais, on s’occupait de la chose publique et rien ne semblait plus enviable à cette époque d’enthousiasme et d’illusions.
Il n’y avait pas jusqu’à la sage Mme Fréteau qui ne fût prise, elle aussi, de l’envie des réformes. Elle ne voulait plus que le roi conservât sa maison militaire, et il fallait que son neveu, le futur maréchal, la rassurât par cette lettre scellée d’un cachet étrangement prophétique. (Il représentait un nœud avec cette légende: Dénouera qui pourra)[109]: «Vous avez donc bien envie, ma chère tante, que ce pauvre roi n’aie plus de maison militaire. En vérité, vous n’êtes pas brave; je serais même tenté de me moquer un peu de vous. Une ombre vous fait peur. Sept ou huit cents gardes du corps, dangereux dans un pays où il y a quatre à cinq millions de gardes nationales! Enfin, sur la perte de son état, comme sur celle de sa fortune, il faudra bien prendre son parti. C’est en cultivant mon esprit et mon cœur que je chercherai à me mettre au-dessus des privations qu’impose le malaise actuel.»
Bien qu’il ne fût pas député à l’Assemblée [p. 102] constituante, Condorcet y passait de longues heures, dans les couloirs, et sa femme, pendant ce temps-là, suivait, dans une loge, les séances intéressantes.
La marquise de Créquy,—dont les Mémoires, on le sait, sont loin d’être authentiques,—a raconté, à propos de Sophie, cette anecdote, certainement arrangée et dont il faut lui laisser toute la responsabilité: «Je me trouvais, dit-elle, dans une tribune placée près de la porte; arrive une espèce de tricoteuse, en gants de soie[110], qui riait à grande bouche en causant avec un jouvenceau, couleur de rose et blond, qu’elle endoctrinait en philosophisme et qui rougissait quelquefois, le cher enfant! Les voilà qui s’asseyent et la conversation continue. J’entends qu’il est question de l’Ecriture sainte et la dame se met à dire, avec un air de malice et d’enjouement séducteur, que si la chaste Suzanne avait été une vieille femme, entre deux jeunes gens, elle aurait eu plus de mérite.» Mme de Créquy affecta de ne pas la connaître et quitta la loge sans saluer. «On vint me dire ensuite, ajoute-t-elle, que c’était Mme de Condorcet.»
Un décret royal du 13 août 1790 supprima la place d’inspecteur des monnaies; mais Condorcet [p. 103] gardait son logement du quai Conti, où il devait habiter encore plusieurs mois.
Ainsi dégagé de toute fonction officielle, il se fit aussitôt nommer membre de la municipalité parisienne; il connaissait les services qu’on pouvait rendre dans cette place modeste, mais honorée de la considération publique. C’est ainsi qu’à Auteuil, Lefebvre de la Roche avait été nommé maire, et Cabanis, premier officier municipal. Leurs concitoyens, sans nul doute, avaient voulu les remercier de leur bienfaisance inépuisable et de la part que tous deux avaient prise à la rédaction des cahiers de 1789 pour la paroisse d’Auteuil. N’a-t-on pas le droit de croire aussi que ce témoignage de confiance s’adressait plus encore à la généreuse châtelaine qui les abritait sous son toit?
Au mois de mai 1790, Mme de Condorcet donnait le jour à une fille Alexandrine-Louise-Sophie, qui fut appelée toute sa vie du nom d’Elisa qu’elle n’avait pas reçu.
Au commencement de 1791, Condorcet, nommé commissaire de la Trésorerie, dut résigner ses fonctions municipales.
Deux mois après la mort de Mirabeau, qui venait d’être emporté par un mal que Cabanis, dévoué comme le meilleur des fils, n’avait pu vaincre, le roi, affolé, avait tenté cette fuite, si piteusement [p. 104] échouée dans l’auberge de Varennes, et son arrestation avait amené, dans les idées de Condorcet, un changement considérable.
Le philosophe s’était aussitôt prononcé pour la République; il avait donné sa démission de commissaire de la Trésorerie et quitté l’hôtel des Monnaies pour aller loger rue de Lille, numéro 50, au coin de la rue de Bellechasse.
C’est de là que, le dimanche 17 juillet 1791, Mme de Condorcet partit, accompagnée de sa fille, à peine âgée d’un an, pour se rendre au Champ-de-Mars; le peuple s’y était donné rendez-vous pour signer une pétition qui demandait la déchéance du roi. Les constitutionnels formaient encore la majorité dans l’Assemblée constituante et ils décidèrent que la Fayette et Bailly se mettraient à la tête de la Garde nationale et des troupes pour marcher contre les manifestants. La foule, inoffensive et calme, était composée de beaucoup de femmes et d’enfants; à côté de Mme de Condorcet, on voyait Mme Roland. Par quelle fatalité des coups de fusil furent-ils tirés? Bailly dut proclamer la loi martiale et une décharge de mousqueterie laissa de nombreux morts sur le terrain. La Fayette n’évita de plus grands malheurs qu’en se précipitant, au galop de son cheval, à la gueule des canons chargés à mitraille. Cet acte d’inutile [p. 105] énergie coûta la vie, d’après les historiens les plus modérés, à plus de quatre cents personnes et acheva de détruire la popularité de La Fayette, de Bailly et de l’Assemblée.
Condorcet garda de cette journée une impression inoubliable et, pendant sa proscription, dans une sorte de justification de sa conduite politique antérieure, il s’écriait, en arrivant au récit de cet événement: «Ma fille unique, âgée d’un an, manqua d’être victime de cette atrocité, et cette circonstance augmentant encore mon indignation, je la montrai assez hautement pour m’attirer la haine de tout ce qui avait alors quelque pouvoir.»
Avant de se séparer, l’Assemblée nationale voulut indiquer à Louis XVI un certain nombre d’hommes parmi lesquels le roi devait choisir le précepteur du prince royal. Condorcet fut désigné malgré lui[111] et mis sur la liste qui portait déjà les noms de Roucher, Bernardin de Saint-Pierre, Berquin, Sieyès, Ducis, Lacépède, Lacretelle, Malesherbes, Necker et Robespierre lui-même qui avait intéressé à sa cause Mme de Lamballe, sans pouvoir emporter la place qui fut donnée, le 18 avril 1792, à M. de Fleurieu. En même temps, on avait proposé à Mme de Condorcet d’être gouvernante du [p. 106] jeune prince tandis que son mari aurait été premier précepteur. Tous deux refusèrent presque dans les mêmes termes, quoiqu’ils ne se fussent pas entretenus de ces propositions[112].
Condorcet et sa femme avaient toujours refusé de se rendre à la cour[113]; leurs idées avancées leur avaient fermé bien des salons; La Rochefoucauld et les membres de la Société de 89 ne pardonnaient pas au philosophe ses idées républicaines; Malesherbes eut même un mot sanglant: «Si je tenais en mon pouvoir M. de Condorcet, dit-il, je ne me ferais aucun scrupule de l’assassiner.» Il y eut des séparations cruelles. Comment pouvait-il en être autrement quand des amis intimes, comme Cabanis et Roucher, en arrivaient à ne plus même s’adresser la parole!
Le débordement d’injures fut à son comble lorsque Condorcet se présenta aux suffrages des électeurs chargés de nommer les députés à l’Assemblée législative. On lui reprocha, entre autres choses, d’avoir fréquenté secrètement la cour et particulièrement Monsieur, au moment même où il attaquait le plus violemment la famille royale dans ses écrits. La chose vint à ses oreilles; il fit une enquête et il établit facilement que le visiteur [p. 107] mystérieux était le comte d’Orsay, premier maréchal des logis de la maison de Monsieur.
Puis, on fit courir sur son compte et sur celui de Mme de Condorcet des vers qui furent l’origine des calomnies qui ont été répétées depuis:
Les pamphlets, partis d’abord du monde royaliste, avaient été repris par Marat. Lamartine et Michelet s’en firent l’écho; M. A. G. de Cassagnac, dans son Histoire des Girondins, les aggrava encore: «Mme de Condorcet, dit-il, n’aimait pas son mari qui n’avait pas de passion pour elle; mais il y avait des degrés entre cette situation domestique et des efforts tentés en commun pour que la jeune mariée devînt la favorite du vieux roi (Louis XV). Les contemporains racontent cette odieuse aventure avec des détails si précis qu’il serait bien difficile de les rejeter entièrement.» Qu’il nous suffise de faire remarquer que Mme de Condorcet avait à peine dix ans à la mort de Louis XV!
Honte à ceux qui inventent de pareilles atrocités! leur conduite toutefois trouve sinon une excuse, [p. 108] du moins une explication dans les passions terribles de l’époque où ils vécurent. Mais, que penser de ceux qui vont rallumer des cendres éteintes et, sans critique historique, répéter de semblables absurdités?
Quoi qu’il en soit de ces attaques, Condorcet fut élu par les Parisiens et, le 1er octobre 1791, il entrait comme député à l’Assemblée législative. Un rôle important l’y attendait: c’est ainsi qu’il rédigea la déclaration du 29 décembre 1791 adressée aux gouvernements qui menaçaient la France; ainsi que le 20 avril 1792, jour de la déclaration de guerre à l’Autriche, il déposa sur le bureau de l’Assemblée ce célèbre rapport sur l’instruction publique qui restera son principal titre de gloire politique[114].
Mme de Condorcet continuait à l’aider et à le soutenir; dans une fête qu’elle donna rue de Lille, entre le 20 juin et le 10 août, elle reçut quatre cents Marseillais, dont elle fit si bien la conquête qu’elle aurait pu, si sa parole avait été écoutée dans les conseils de la Gironde, sauver, par eux, la Patrie et la Liberté.
[p. 109] On sait la place occupée par Condorcet dans les événements qui suivirent le 10 août; sa recommandation en faveur de Danton qu’il réussit à faire nommer ministre; son Exposé tendant à la convocation d’une Convention nationale et à la suspension de la dignité royale.
Il était devenu populaire et cinq départements l’envoyèrent à la Convention[115], qui, au bruit du canon victorieux de Valmy, allait proclamer cette République que depuis longtemps il rêvait de donner à son pays.
Comme s’il eût éprouvé le besoin de se reposer et de marquer une étape dans sa vie, ce fut le moment que Condorcet choisit pour aller s’établir définitivement, avec sa femme et sa fille, dans ce joli village d’Auteuil où il avait goûté jusqu’alors tant d’instants délicieux.
Déjà le 5 août, il y avait assisté avec Mme de Condorcet, à l’inauguration de la nouvelle maison commune; tous deux avaient suivi ce cortège de jeunes filles, escortées des gardes nationales voisines, qui étaient venues couronner les bustes de Voltaire et de Rousseau et quand on arriva à celui d’Helvétius, quand la musique joua l’air
Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille?
[p. 110] M. et Mme de Condorcet furent de ceux, parents et amis du philosophe, qui, après avoir orné de fleurs la statue, s’embrassèrent devant la foule émue.
Le 10 août, ils étaient encore chez Mme Helvétius.
«On sonne le tocsin, dit Condorcet dans son Fragment de justification, j’étais à Auteuil. Je me rendis à Paris. J’arrivai à l’Assemblée quelques moments avant le roi. Je la trouvai plus inquiète qu’effrayée, courageuse mais sans dignité. Je n’étais point dans la confidence et seulement un peu après la canonnade un de mes amis vint me dire que l’Assemblée serait respectée.»
Condorcet avait amené avec lui, à Auteuil, sa femme, sa fille, sa belle-mère et sa belle-sœur, Félicité-Charlotte. D’après les registres de la municipalité, Condorcet avait deux chevaux et un carrosse. On se logea chez la citoyenne Pignon, au no 2 de la grande rue du village dans une maison qu’habitait déjà le législateur Jean Debry. Mlle de Grouchy occupait, moyennant deux cents livres par an, deux chambres qui avaient vue sur la grande rue et sur la cour. Son mobilier était succinct: une table ronde en acajou, à dessus de marbre blanc, avec couvercle en maroquin et drap vert, une baignoire en cuivre en sabot, une bergère de [p. 111] vieux damas vert et sa housse, un lit, quelques fauteuils et quelques chaises[116].
C’est dans cette maison où Condorcet espérait trouver la sécurité et le calme que se passèrent ses dernières heures de joie.
Si «le foyer de la République», comme a dit un contemporain, était dans le salon de Mme de Condorcet, soit à l’hôtel des Monnaies, soit rue de Lille, il y avait encore, dans Paris, d’autres maisons où se réunissaient les Girondins; Condorcet, bien que retiré maintenant à Auteuil, au moins pendant la belle saison, car il retourna rue de Lille pendant l’hiver de 1792-1793, ne pouvait pas cependant abandonner ses amis et souvent il dut venir à Paris pour les voir, pour causer et s’entretenir avec eux de la conduite politique à suivre dans les circonstances difficiles que l’on traversait.
Il y avait bien le salon de Mme Roland; mais Condorcet ne s’y sentait guère attiré; il goûtait peu la femme du ministre et celle-ci le lui rendait bien. N’avait-elle pas écrit à Bancal des Issarts: «Condorcet n’est pas sans mérite; mais c’est un intrigant.»
Il y avait aussi les maisons de Mmes Lameth et [p. 112] Mathieu Dumas; mais on y rencontrait trop de montagnards que ces dames cherchaient, infructueusement du reste, à ramener aux idées modérées.
Chez Mme Robert, née de Kéralio, les partisans de la faction d’Orléans étaient les maîtres.
Mlles Théroigne de Méricourt et Lacombe ne savaient que remuer les foules et recevaient une Société trop mélangée.
Il ne restait donc que la maison de Julie Talma, où la Gironde était sûre de trouver un accueil sympathique et sincère.
Là, rue Chantereine, dans un petit hôtel que Bonaparte victorieux devait acheter un jour, Julie Carreau, devenue en 1790 Mme Talma[117], aimait à recevoir les littérateurs, les artistes et les hommes politiques.
Elève médiocre de Vestris, elle n’avait jamais pu s’élever au-dessus des danseuses doubles[118]; mais femme spirituelle et gracieuse, pleine de charme et de décence, elle avait su attirer et conserver [p. 113] chez elle Chamfort, David, Mirabeau, Vergniaud, Ducos, Condorcet, Guadet, Lavoisier, Marie-Joseph Chénier, successeurs des Ségur et des Narbonne, ses amis d’avant 1789.
«C’est au milieu de ces hommes, disait Talma à M. Audibert, que j’ai puisé une lumière nouvelle, que j’ai entrevu la régénération de mon art. Je travaillais à monter sur la scène, non plus un mannequin monté sur des échasses, mais un Romain réel, un César homme, s’entretenant de sa ville avec ce naturel qu’on met à parler de ses propres affaires; car, à tout prendre, les affaires de Rome étaient un peu celles de César.»
La conversation se prolongeait souvent jusqu’à la nuit et alors les invités couchaient rue Chantereine. «Quelles soirées charmantes j’ai passées dans cette douce société!» disait Arnault[119].
C’est que la maîtresse de la maison savait s’effacer et faire valoir les autres autant qu’elle-même. «Cette femme, a dit Benjamin Constant qui l’a bien connue[120], dont la logique était précise et serrée lorsqu’elle parlait sur les grands sujets qui intéressent les droits et la dignité de l’espèce humaine, avait la gaîté la plus piquante, la plaisanterie la plus légère; elle ne disait pas souvent des mots [p. 114] isolés qu’on pût retenir et citer et c’était encore là, selon moi, l’un de ses charmes. Les mots de ce genre, frappants en eux-mêmes, ont l’inconvénient de tuer la conversation; ce sont pour ainsi dire des coups de fusil qu’on tire sur les idées des autres et qui les abattent... Telle n’était pas la manière de Julie. C’était pour les autres, autant que pour elle, qu’elle discutait ou plaisantait. Ses expressions n’étaient jamais recherchées; elle saisissait admirablement le véritable point de toutes les questions sérieuses ou frivoles. Elle disait toujours ce qu’il fallait dire et l’on s’apercevait avec elle que la justesse des idées est aussi nécessaire à la plaisanterie qu’elle peut l’être à la raison.»
Le 16 octobre 1792, Julie offrit au général Dumouriez une fête qui est restée célèbre par le rôle désagréable et inattendu que vint y jouer l’odieux Marat[121]. On avait construit dans le jardin un pavillon qui prolongeait les salons du rez-de-chaussée. La compagnie était brillante et plus nombreuse [p. 115] que d’habitude. Soudain Marat, accompagné des citoyens Monteau, Bentabolle, Dubuisson et Proly, entre comme un furieux et s’adressant à Dumouriez: «Nous ne devions pas nous attendre à te rencontrer dans une semblable maison, au milieu d’un ramas de concubines et de contre-révolutionnaires.» Talma s’avance et dit: «Citoyen Marat, de quel droit viens-tu chez moi insulter nos femmes et nos sœurs?»—«Ne puis-je, ajoute Dumouriez, me reposer des fatigues de la guerre au milieu des arts et de mes amis, sans les entendre outrager par des épithètes indécentes?» Et il tourna le dos à l’énergumène. «Cette maison est un foyer de contre-révolutionnaires,» hurle Marat qui sort en proférant mille menaces, tandis que Dugazon le suit en jetant des parfums sur une pelle rougie au feu, «afin de purifier, dit-il, l’air que ce monstre infectait par sa présence».
La fête s’acheva gaiement, mais le lendemain on criait dans les rues «les détails de la fête donnée au traître Dumouriez par les aristocrates chez l’acteur Talma, avec les noms des conspirateurs qui s’étaient proposés d’assassiner l’Ami du peuple[122]».
Le général, héros involontaire de cette aventure, [p. 116] a été injustement sévère pour Mme de Condorcet dans ses Mémoires[123]. Après avoir parlé de Mme Roland, il ajoute: «Plusieurs autres femmes se sont montrées sur les tréteaux de la Révolution, mais d’une manière moins décente et moins noble que Mme Roland, excepté Mme Necker qui peut, seule, lui être comparée mais qui, vu son âge et son expérience, était plus utile à son mari et moins agréable à ses entours. Toutes les autres, à commencer par Mlle La Brousse, la prophétesse du Chartreux Don Gerle, Mmes de Staël, Condorcet, Coigny, Théroigne, etc., ont joué le rôle commun d’intrigantes comme les femmes de la cour ou de forcenées comme les poissardes.»
Il est impossible de comprendre le sentiment qui a pu inspirer une telle alliance de noms étonnés de se trouver ensemble; les éditeurs des Mémoires le reconnaissent eux-mêmes dans une note. Dumouriez a méconnu à la fois les devoirs de l’historien et les convenances sociales.
Le conventionnel Pierre Choudieu était plus juste quand il écrivait, le 5 novembre 1833[124]: «La marquise de Condorcet, beaucoup plus modeste que Mme Roland, avait le bon esprit de ne pas chercher à amoindrir le mérite de son mari. Sans paraître [p. 117] avoir aucune prétention, elle a eu peut-être plus d’influence qu’aucune autre femme sur tous les Girondins qui, seuls, formaient sa société, car Sieyès n’y a paru, à ma connaissance, qu’une seule fois pour déterminer les Girondins à voter la mort du roi.»
La mémoire de Condorcet est pure de cette tache; car il se prononça pour la peine la plus grave qui ne serait pas la mort[125].
Il jouissait encore d’une grande influence à la Convention; le 16 février 1793, il avait présenté un projet de constitution qui paraissait favorablement accueilli et, le 26 mars, il était nommé membre du premier comité de Salut public. C’est en cette qualité qu’il eut à recommander son ami La Chèze, consul de France, au delà des Alpes[126].
[p. 118] En revanche, cette nomination au comité de Salut public fut mal interprétée à l’étranger; aussi, Condorcet ne tarda-t-il pas à apprendre que les Académies de Berlin et de Pétersbourg l’avaient rayé de la liste de leurs membres.
Mais les événements se précipitaient. Les journées des 31 mai et 2 juin, contre lesquelles il protesta, fermèrent à Condorcet les portes de la Convention. Moralement enveloppé dans la ruine des Girondins, il voulut cependant défendre encore une fois son projet de constitution que l’Assemblée venait de repousser. En écrivant son Appel aux citoyens français sur le projet de la nouvelle Constitution, il signait sa condamnation.
Au mois de septembre 1792, il avait pu servir encore utilement les Fréteau, en faisant relâcher son neveu injustement arrêté[127]; maintenant, il ne [p. 119] pouvait plus rien en faveur du marquis de Grouchy ou du futur maréchal: l’un, inquiété par les autorités locales de Villette en attendant son emprisonnement à Sainte-Pélagie; l’autre, menacé de révocation et devant fournir à tout propos des certificats constatant qu’il n’avait pas quitté son poste à l’armée[128].
Quant à lui, Condorcet se sentait personnellement menacé; mais il refusait d’écouter les conseils de ses amis. «Mme Suard, dit Mme O’Connor[129], insinue que mon père avait pensé à émigrer; ma mère et mon oncle Cabanis m’ont toujours dit qu’il ne voulut jamais en entendre parler pour lui, bien qu’il ait prévu et prédit à ses amis le règne de la Terreur.»
Il passait tout son temps à Auteuil, au milieu des siens, avec Cabanis et Jean Debry.
[p. 120] Cette tranquille intimité, dans une retraite studieuse, n’était ni sans charmes, ni sans douceur. Cabanis, que l’on a pu sans blasphème comparer à Fénelon, trouvait, dans sa bonté infinie, les attentions les plus délicates. Ce tendre rêveur, ardent cependant lorsqu’il s’agissait de défendre ses idées, connaissait toute la générosité du cœur de Sophie et il voyait, dans le courage de cette femme supérieure, sinon les moyens de sauver le philosophe, du moins un secours assuré pour les jours où les circonstances deviendraient plus difficiles et plus dangereuses.
L’énergie ingénieuse de Mme de Condorcet complétait à merveille la bienveillance un peu mélancolique de Cabanis. Aussi, la pure sympathie, née avant 1789 entre ces deux âmes d’élite, grandissait-elle chaque jour au contact des événements.
Sophie, loin de s’en cacher s’en montrait fière et heureuse; elle trouvait dans son intimité la muse inspiratrice de ces lettres immortelles, dédiées à Cabanis et si peu connues aujourd’hui. «Elles furent achevées dans ce pâle Elysée d’Auteuil, plein de regrets, d’ombres aimées. Elles parlent bas ces lettres; la sourdine est mise aux cordes sensibles[130].»
Lorsqu’elles parurent, pour la première fois, en [p. 121] l’an VI, elles accompagnaient la traduction par Mme de Condorcet de la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith; elles purent être légèrement retouchées à cette époque, mais la vraie date, celle qui les explique, est l’année 1793, où elles furent composées. La première de ces lettres débute ainsi:
«L’homme ne me paraît point avoir de plus intéressant objet de méditation que l’homme, mon cher Cabanis. Est-il, en effet, une occupation plus satisfaisante et plus douce que celle de tourner les regards de notre âme sur elle-même, d’en étudier les opérations, d’en tracer les mouvements, d’employer nos facultés à s’observer et à se deviner réciproquement, de chercher à reconnaître et à saisir les lois fugitives et cachées que suivent notre intelligence et notre sensibilité? Aussi, vivre souvent avec soi me semble la vie la plus douce, comme la plus sage; elle peut mêler aux jouissances que donnent les sentiments vifs et profonds les jouissances de la sagesse et de la philosophie...»
On sent, dans ces lettres, les longues conversations avec Cabanis sur l’origine et la nature de la douleur physique. Sophie en arrive même à parler des maladies imaginaires et elle cite l’exemple d’une femme qu’elle avait connue qui, pour avoir [p. 122] lu un article sur la Pulmonie, se croyait atteinte de cette maladie.
«De pareils exemples, ajoute-t-elle, ne sont pas rares, surtout dans cette classe d’individus auxquels la mollesse et l’oisiveté de leur vie laissent peu de moyens pour se soustraire aux égarements d’une imagination trop active.»
Elève de Rousseau,—on verra tout à l’heure combien elle le préférait à Voltaire,—Mme de Condorcet lui empruntait et ses doctrines et les formes du langage: «L’école de la douleur et de l’adversité, disait-elle, est efficace pour rendre les hommes plus compatissants et plus humains. Que cette école vous serait nécessaire, riches et puissants qui êtes séparés de l’idée même de la misère et de l’infortune par la barrière presque insurmontable de la richesse, de l’égoïsme et de l’habitude du pouvoir!» Pour elle, la sensibilité commençait la sympathie, la réflexion la complétait et la sympathie était la source de tous les bonheurs de l’homme, parce qu’elle engendrait la vertu: «Vous voyez, mon cher Cabanis, que si la nature nous a environnés d’une foule de maux, elle les a, en quelque sorte, compensés en faisant quelquefois de nos douleurs mêmes la source la plus profonde de nos jouissances. Bénissons ce rapport sublime qui se trouve entre les besoins moraux de quelques hommes et [p. 123] les besoins physiques des autres, entre les malheurs auxquels la nature et nos vices nous soumettent et les penchants de la vertu qui n’est heureuse qu’en les soulageant.»
Quand elle parle des sympathies individuelles, qui ne sont autre chose que l’amitié, Mme de Condorcet est heureuse, on le sent, de s’adresser à son «cher Cabanis, qui, dévoué sans choix et sans effort à ses travaux et à ses affections, est peut-être par le sentiment habituel de la raison et de la vertu trop loin des hommes pour apercevoir leurs erreurs, ou, du moins, pour en discerner les profondes racines», et elle lui dit:
«Elles (ces sympathies naturelles) sont plus intimes entre ces âmes mélancoliques et réfléchies qui se plaisent à se nourrir de leurs sentiments, à les goûter dans le recueillement, qui ne voient dans la vie que ce qui les y a attachées et qui restent concentrées dans leurs affections, sans pouvoir désirer au delà, car, quelque insatiable que soit le cœur humain, il n’épuise jamais le vrai bonheur quand il veut s’y arrêter.»
S’agit-il de la beauté et de l’amour, son langage n’est pas moins éloquent, sa philosophie moins saine ou moins élevée:
«La beauté, dit-elle, inspire, à sa seule vue, un sentiment agréable. Une belle personne est, à tous [p. 124] les yeux, un être doué du pouvoir de contribuer au bonheur de tout ce qui a quelque rapport avec elle... On ne peut guère douter que la beauté ou, du moins, quelque agrément et quelque intérêt dans la figure ne soit nécessaire à l’amour. Les exceptions en sont assez rares parmi les hommes et le goût du plaisir en est presque toujours la cause. Si elles le sont moins parmi les femmes, cela vient des idées morales de pudeur et de devoir qui les accoutument, dès l’enfance, à veiller leurs premières impressions, à ne pas se déterminer par les avantages de la figure et à leur préférer presque toujours certaines qualités et quelquefois certaines convenances morales. L’amour peut avoir des causes très différentes et il est d’autant plus grand qu’il en a davantage. Quelquefois, c’est un seul charme, une seule qualité qui touche notre sensibilité et qui la soumet; souvent (et trop souvent!) c’est à des dons étrangers au cœur qu’elle se prend; plus délicate et plus éclairée, elle ne s’attache qu’à la réunion de ce qui peut la satisfaire et par un tact aussi sûr que celui de la raison et de la prudence, elle ne cède à l’amour que lorsqu’il est l’empire même de tout ce qui mérite d’être aimé. Alors, l’amour devient une véritable passion, même dans les âmes les plus pures, même dans les êtres qui sont le moins esclaves des impressions et des besoins des sens.
[p. 125] «Alors, d’innocentes caresses peuvent longtemps lui suffire et ne perdent rien de leur charme et de leur prix quand on les a passées; alors, le bonheur d’être aimé est la jouissance la plus nécessaire, la plus désirée; alors, toutes les idées du bonheur et de la volupté ne naissent que d’un seul objet, en dépendent toujours et sont anéanties à l’égard de tout autre.»
Mais, qu’il y a loin de cet amour idéal à certains mariages qui ne sont que «des conventions et des marchés de fortune dont la conclusion rapide ne permet de reconnaître que longtemps après si les convenances personnelles s’y rencontrent et où le prix de l’amour, commandé plutôt qu’obtenu, est adjugé en même temps que la dot, avant que l’on sache si l’on peut aimer et surtout s’aimer... C’est donc la société qui, en mettant trop longtemps des entraves aux unions qu’un goût mutuel eût formées, en établissant entre les deux sexes (sous prétexte de maintenir la vertu) des barrières qui rendaient presque impraticable cette connaissance mutuelle des esprits et des cœurs, nécessaire cependant pour former des unions vertueuses et durables, en excitant et en intéressant la vanité des hommes à la corruption des femmes, en rendant plus difficiles les plaisirs accompagnés de quelque sentiment, en étendant la honte au delà de ce qui la mérite [p. 126] réellement, comme l’incertitude de l’état des enfants, la violation d’une promesse formelle, des complaisances avilissantes, une facilité qui annonce la faiblesse et le défaut d’empire sur soi-même; ce sont, dis-je, tous ces abus de la société qui ont donné naissance aux passions dangereuses et corrompues qui ne sont pas l’amour et qui l’ont rendu si rare.» Mais si la Société est coupable,—c’est, on le sait, la thèse chère à Rousseau,—la Nature ne l’est pas: «Cessons donc, mon cher Cabanis, de reprocher à la Nature d’être avare de grands hommes; cessons de nous étonner de ce que les lois générales de la nature même soient encore si peu connues. Combien de fois, dans un siècle, l’éducation achève-t-elle de donner à l’esprit la force et la rectitude nécessaires pour arriver aux idées abstraites?»
Elève de Rousseau, fille de Voltaire et de son siècle, Sophie de Condorcet, s’il est permis de continuer cette image, préférait secrètement son professeur à son père; on le sent, à travers toutes les réticences, et de telle façon qu’on ne s’y peut tromper:
«Rousseau a parlé davantage à la conscience, Voltaire à la raison. Rousseau a établi ses opinions par la force de sa sensibilité et de sa logique, Voltaire par les charmes piquants de son esprit. L’un [p. 127] a instruit les hommes en les touchant, l’autre en les éclairant et les amusant à la fois. Le premier, en portant trop loin quelques-uns de ses principes, a donné le goût de l’exagération et de la singularité; le second, se contentant trop souvent de combattre les plus funestes abus avec l’arme du ridicule, n’a pas assez généralement excité contre eux cette indignation salutaire qui, moins efficace que le mépris pour châtier le vice, est cependant plus active à le combattre. La morale de Rousseau est attachante quoique sévère et entraîne le cœur même en le réprimant; celle de Voltaire, plus indulgente, touche plus faiblement peut-être parce qu’imposant moins de sacrifice, elle nous donne une moins haute idée de nos forces et de la perfection à laquelle nous pouvons atteindre; Rousseau a parlé de la vertu avec autant de charme que Fénelon et avec l’empire de la vertu même; Voltaire a combattu les préjugés religieux avec autant de zèle que s’ils eussent été les seuls ennemis de notre félicité; le premier renouvellera d’âge en âge l’enthousiasme de la liberté et de la vertu; le second éveillera tous les siècles sur les funestes effets du fanatisme et de la crédulité. Cependant, comme les passions dureront autant que les hommes, l’empire de Rousseau sur les âmes servira encore longtemps les mœurs quand celui de Voltaire sur [p. 128] les esprits aura détruit les préjugés qui s’opposaient au bonheur des sociétés.»
L’éloquente conclusion de la dernière lettre, tout en affirmant le pouvoir de la morale et de la vertu, trahit bien l’irrémédiable regret jusqu’au sein des spéculations de la philosophie:
«On ne trouve la douceur de la vie que dans la bienfaisance, la bonne foi, la bonté et en faisant ainsi de ses dieux pénates un asile où le bonheur force l’homme à goûter avec délices sa propre existence. Jouissances intimes et consolantes, attachées à la paix et aux vertus cachées! Plaisirs vrais et touchants qui ne quittez jamais le cœur que vous avez une fois attendri! Vous dont le sceptre tyrannique de la vanité nous éloigne sans cesse! Malheur à qui vous dédaigne et vous abandonne! Malheur surtout à ce sexe comblé un moment des dons les plus brillants de la Nature et pour lequel elle est ensuite si longtemps marâtre, s’il vous néglige ou s’il vous ignore! Car c’est avec vous qu’il doit passer la moitié de sa vie et oublier, s’il est possible, cette coupe enchantée que la main du temps renverse pour lui au milieu de sa carrière.»
Mme de Condorcet n’allait pas tarder à faire par elle-même l’expérience cruelle de la douleur.
Dans les premiers jours de juin, sa mère tomba [p. 129] subitement malade chez elle. Le 8, Fréteau écrivait à sa femme[131]:
«Le mauvais temps et l’absence des voitures de toutes les places ne m’ont permis d’arriver à Auteuil que tout au soir. Ma sœur était aux abois. Les médecins Cabanis et Portail avaient cru l’émétique nécessaire. (La malade avait la gangrène à la jambe...) Elle n’a plus que des élans vers les objets de son affection. Notre enfant, tes filles, les siennes, ta tendresse, voilà ce qui lui a fourni les choses les plus touchantes à me dire, mais par demi-phrases. Je suis pénétré de cet affreux spectacle.»
Le 10 juin, la marquise de Grouchy expirait dans les bras de sa fille dont la douleur fut déchirante. Deux jours après, Mlle Fréteau en rendait compte ainsi à son frère[132]: «Ma prédiction ne s’est trouvée que trop vraie, mon cher ami. Ma tante n’est plus. Elle est morte lundi, à 4 heures après midi. Papa nous a mandé que sa fille (Mme de Condorcet) est tombée dans des convulsions telles qu’il n’en a jamais vu de semblables. Si on ne l’eût jetée à l’instant dans le bain, elle serait expirée. Juge de sa douleur, mon cher ami. Ce [p. 130] qu’il y a de plus chagrinant, mon frère, c’est que les instances de papa tendant à procurer à ma tante des consolations spirituelles ont été vaines. Quelle circonstance alarmante! Gémissons, prions pour elle. Voilà les services que nous pouvons lui rendre. Acquittons-nous-en, mon cher ami, voilà le retour que nous devons à sa tendresse[133].»
Condorcet et les autres parents, disent les registres de la paroisse d’Auteuil, assistèrent à la cérémonie et à l’inhumation qui fut faite au cimetière du village[134].
Pendant ce temps, le marquis de Grouchy était à Villette, très malade lui-même. Aussitôt les derniers devoirs rendus à sa mère, Mme de Condorcet partit avec Charlotte pour rejoindre, dans le manoir paternel, son frère Emmanuel qui [p. 131] venait d’être privé de son commandement en Normandie[135].
Mais elle ne resta que peu de jours à Villette, ayant été rappelée à Auteuil par la situation de son mari qui s’aggravait tous les jours.
Condorcet, bien qu’il fût encore en liberté, ne se faisait plus d’illusions et il se préparait à tout événement comme en témoigne ce billet de son ami: «A Auteuil, ce jourd’huy, 30 juin 1793, à minuit, Condorcet proscrit par l’exécrable faction du 31 mai dernier, avant de se dérober au poignard des assassins, a partagé avec moi, comme don de l’amitié qui nous unit, le poison qu’il conserve pour demeurer en tout événement seul maître de sa personne. Jean Debry.»
En effet, sur la dénonciation de Chabot, le 8 juillet 1793, Condorcet était décrété d’accusation à cause de son écrit Aux Français, sur le projet de la nouvelle Constitution.
Les scellés furent mis sur ses papiers rue de Lille et à Auteuil. La Roche n’avait pu éviter cette formalité, mais il avait, du moins, prévenu Condorcet qui s’échappa.
Le philosophe trouva asile, la première nuit, [p. 132] chez Mme Helvétius. Mais comme il était dangereux de rester plus longtemps dans la maison même du maire chargé de procéder contre lui, il se rendit le lendemain chez Garat, qui n’hésita pas à recevoir le proscrit à l’hôtel même du ministère.
La maison de la rue Servandoni.—Mme Vernet.—Derniers jours de Condorcet.—Visites de Sophie au proscrit.—Testament du philosophe et conseils à sa fille.—Mort de Condorcet.—Sophie fait des portraits et vend de la lingerie.—Ses biens confisqués.—Elle élève sa fille et soutient sa sœur.—Belle lettre à propos de la mort de Fréteau.—Sophie traduit la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith et publie ses Lettres sur la Sympathie ainsi que les œuvres de son mari.—Union de Charlotte de Grouchy avec Cabanis.
Le 21 juillet 1793, Félicité Fréteau écrivait à son frère Emmanuel[136]: «Tu sais que ma cousine Sophie vient d’éprouver un nouveau malheur en se voyant obligée d’être séparée d’une personne qui lui était aussi chère. Elle a supporté cet événement avec autant de courage que le premier et elle est toujours à sa maison de campagne d’Auteuil.»
[p. 134] Sur les instances de Cabanis, deux jeunes médecins, Pinel et Boyer, avaient découvert, au no 21 de la rue des Fossoyeurs, tout près du Luxembourg et de l’église Saint-Sulpice, un appartement où Condorcet pouvait demeurer sans avoir à redouter les perquisitions et les visites domiciliaires. La maison était modeste d’apparence; assez grande cependant, puisque, divisée en plusieurs petites chambres louées ordinairement à des étudiants en médecine, elle rapportait un revenu de 2 500 francs[137].
La propriétaire s’appelait Rose-Marie Brichet; elle était veuve de Louis-François Vernet, sculpteur, proche parent des grands peintres. Comme son mari, Mme Vernet était née en Provence, dans les environs de Marseille; elle avait le cœur chaud, l’imagination vive, le caractère franc et ouvert. Sa bienfaisance touchait à l’exaltation.
[p. 135] Agée d’environ quarante-cinq ans, simple de manières, Mme Vernet était très énergique. De taille moyenne, elle avait des traits fins et réguliers et une physionomie mobile. D’abord, on lui cacha le nom de l’hôte nouveau qu’elle allait recevoir. «Est-il honnête homme, dit-elle? Est-il vertueux?—Oui, madame.—En ce cas, qu’il vienne!»
Et ce fut ainsi que Condorcet pénétra dans cette maison où il allait se tenir caché pendant près de dix mois.
Mme Vernet, «la bonne maman Vernet,» comme disait Jean Debry, ne voulut rien recevoir, pas même de cadeau, pour prix de l’hospitalité dangereuse qu’elle allait accorder au philosophe[138].
Dans la même maison demeuraient J.-B. Sarret, cousin de Mme Vernet avec laquelle il était marié secrètement; Marcoz, le conventionnel, qui, non seulement ne dénonça jamais Condorcet, mais qui [p. 136] s’ingéniait à lui procurer des journaux et des nouvelles; un inconnu, grand ennemi de la Révolution, qui s’effrayait des moindres bruits de la rue et quitta sa retraite après le 9 thermidor. Mme Vernet, même en 1830, ne consentit jamais à satisfaire la curiosité légitime de la famille de Condorcet sur le compte de ce compagnon de captivité. L’excellente femme ne répondait que par de vagues généralités et elle ajoutait avec un sourire un peu triste: «Depuis cette époque, je ne l’ai pas revu. Comment voulez-vous que je me rappelle son nom?»
Un autre commensal de Condorcet, qui avait joué un rôle dans l’histoire de la Révolution, était l’abbé Lambert, aumônier en 1789 de la garde nationale parisienne. Il avait été sous-diacre à la messe patriotique du 14 juillet 1790 et l’évêque Gobel devait l’envoyer pour assister, inutilement du reste, Marie-Antoinette et le duc d’Orléans au pied de l’échafaud. Ce fut aussi l’abbé Lambert qui reçut les confidences suprêmes de quelques-uns des Girondins. Peu de jours après, le prêtre avait dû quitter le costume ecclésiastique et se réfugier à son tour chez Mme Vernet. Quels durent être ses entretiens avec le philosophe!
Une bonne, Manon, faisait le service des proscrits.
Pendant cette captivité volontaire, l’emploi de [p. 137] chaque heure, était prévu avec une régularité presque monacale.
Condorcet travaillait dans son lit jusqu’à midi; puis, il se levait et dînait. La journée, jusqu’à 7 ou 8 heures du soir, était occupée par les lectures et les conversations; à 8 heures, le philosophe soupait, puis se remettait au travail jusqu’à 10 heures.
La soirée se terminait par de nouveaux entretiens auxquels prenaient part Mme Vernet et le bon Sarret.
Le 3 octobre, Condorcet avait été compris dans le décret qui renvoyait devant le tribunal révolutionnaire quarante et un membres de la Convention. Déclaré contumace, il avait été mis hors la loi et ses biens avaient été confisqués.
La femme d’un homme déclaré hors la loi ne pouvait pas coucher dans la capitale. Sophie, deux fois par semaine, déguisée en paysanne, venait donc, à pied, d’Auteuil à Paris, avec l’espoir, trop souvent déçu, de passer quelques instants auprès du proscrit.
Pour franchir la barrière, elle se mêlait à la foule qui allait voir la guillotine et, afin de ne pas être remarquée, elle accompagnait cette foule jusqu’à la place de la Révolution.
Quelle joie lorsqu’un avis secret la prévenait qu’elle pouvait aller rejoindre son mari pendant [p. 138] quelques heures! Comme elle cherchait à le consoler! Avec quel amour elle prodiguait au captif, devenu subitement un vieillard, les soins du corps et de l’âme[139]!
Son influence, déjà si grande aux jours de la prospérité, ne connaissait plus de limites; Condorcet était froid et timide, elle en avait fait un homme plein de sensibilité et de chaleur. Comme il s’épuisait à rédiger une justification de sa conduite politique, Sophie remarqua bien vite combien ce travail le faisait souffrir moralement et physiquement et, obtenant du philosophe qu’il y renoncerait, elle lui fit entreprendre cette Esquisse des progrès de l’esprit humain qui est restée un des plus beaux titres philosophiques et littéraires de l’illustre rêveur[140].
[p. 139] Puis, comme l’a dit Cabanis, «descendant des plus hautes régions du calcul et de la philosophie, il ne dédaignait pas de rédiger des leçons d’arithmétique pour les instituteurs et les enfants des classes indigentes de la société».
Mais le travail ne pouvait plus l’arracher à ses tristes pensées. L’idée de la mort ne le quittait pas, et il interrompit son labeur pour écrire ces avis d’un proscrit et ces conseils à sa fille, où l’on retrouve le cœur, la générosité, et la haute raison de son admirable épouse.
C’est pour son Elisa qu’il écrivait ces Avis d’un proscrit, admirable testament qui honore à jamais sa mémoire et qui commence par ces lignes sublimes: «Mon enfant, si mes caresses, si mes soins ont pu, dans ta première enfance, te consoler quelquefois, si ton cœur en a gardé le souvenir, puissent ces conseils, dictés par ma tendresse, être reçus de toi avec une douce confiance et contribuer à ton bonheur.
«Dans quelque situation que tu sois, quand tu liras ces lignes que je trace loin de toi, indifférent à ma destinée, mais occupé de la tienne et de celle [p. 140] de ta mère, songe que rien ne t’en garantit la durée.»
«Prends l’habitude du travail...» Et après avoir insisté sur cette source de bonheur, Condorcet cherchait à détourner sa fille de la personnalité et de l’égoïsme; il lui parlait de «l’habitude des actions de bonté» et il lui traçait pour ainsi dire tout un code merveilleux de générosité et de bienfaisance.
Quelquefois la poésie, ce cri des grandes douleurs, lui dictait des vers où il exprimait les mêmes sentiments d’amour et de regret pour les deux êtres qui lui étaient si chers.
Au mois de décembre 1793, il avait adressé à sa femme une pièce qu’il avait intitulée Le Polonais exilé en Sibérie:
Sa fille se rappellerait-elle de lui? C’était là sa grande préoccupation:
Ailleurs, il défendait sa mémoire:
[p. 141] Et revenant à sa délicieuse Sophie:
Tenant déjà dans sa main la coupe fatale, il écrivait[141]: «Je ne puis regretter la vie que pour ma femme et mon Elisa; elles en auraient embelli les derniers instants. Ma vie pouvait leur être utile; elle était chère à Sophie. Je périrai comme Socrate et Sidney pour avoir servi la liberté de mon pays.»
Le lendemain du jour où il traçait ces lignes, il inscrivait ces pensées sur la feuille de garde d’une histoire d’Espagne[142]:
«Les conseils que j’ai écrits pour Elisa, des Lettres de sa mère sur la Sympathie, serviront à son éducation morale. D’autres fragments de sa mère donneront sur le même objet des vues très utiles[143].»
Il était persuadé que non seulement il n’échapperait pas à la mort, mais que Sophie elle-même ne tarderait pas à le suivre sur l’échafaud. Aussi, [p. 142] ce testament, adressé à Mme Vernet, débutait-il ainsi: «Si ma fille est destinée à tout perdre, je prie sa seconde mère (Mme Vernet) d’écouter ces derniers désirs d’un père innocent et malheureux... Je recommande de lui parler souvent de nous; d’entretenir le souvenir qu’elle en conserve; de lui faire lire, quand il en sera temps, nos instructions dans les originaux mêmes.
«... Si elle conserve Sophie, je prie celle-ci d’apprendre à Elisa à connaître, à aimer sa seconde mère. Je prie celle-ci de lui parler de la tendresse de sa mère pour moi et de son courage pendant tout le temps de cette longue persécution. Je ne dis rien de mes sentiments pour la généreuse amie à qui cet écrit est destiné; en interrogeant son cœur, en se mettant à ma place, elle les connaîtra tous.»
Le philosophe terminait en recommandant qu’on éloignât de sa fille tout sentiment de vengeance; «c’est au nom de son père que ce sacrifice sera réclamé». Puis, il conseillait à Elisa d’apprendre l’anglais, parce que si Mme Vernet venait à lui manquer, elle devrait passer en Angleterre, chez milord Stanhope ou, en Amérique, chez Bache, petit-fils de Franklin, ou chez Jefferson.
Ces trois hommes excellents, on se le rappelle, étaient des hôtes assidus et choyés du salon de l’Hôtel des Monnaies.
[p. 143] L’heure fatale, dont le philosophe avait depuis plusieurs mois le terrible pressentiment, approchait. Le 5 germinal an II (25 mars 1794), Condorcet apprit qu’une visite domiciliaire serait faite le lendemain chez Mme Vernet et il résolut aussitôt de quitter sa retraite pour aller se cacher dans les environs de Paris. Il prévint de sa détermination sa bienfaitrice, et, comme celle-ci se récriait, il ajouta: «Plus j’admire votre courage, plus mon devoir d’honnête homme m’impose de ne point en abuser. La loi est positive. Vous êtes hors la loi puisque vous me cachez. Si on me découvrait chez vous, vous auriez la même fin triste que moi. Je ne puis plus rester.» Et cette femme sublime de répondre: «La Convention, Monsieur, a le droit de mettre hors la loi. Elle n’a pas le pouvoir de mettre hors de l’humanité. Vous resterez.»
Mais l’idée de Condorcet était irrévocable et il était bien décidé à quitter,—ce sont ses propres expressions,—«le réduit que le dévouement sans bornes de son ange tutélaire avait transformé en paradis».
Il dut employer la ruse pour tromper la sublime surveillance de Mme Vernet. Le philosophe était descendu, le matin du 25 mars, au rez-de-chaussée de la maison; il causait avec Sarret et mêlait du latin à sa conversation, comme pour en détourner [p. 144] sa bienfaitrice. Celle-ci, cependant, résistait. Alors, il déclara avoir oublié sa tabatière et pendant que Mme Vernet montait au second étage pour aller la chercher, il s’élança dans la rue, vêtu d’une veste d’ouvrier et d’un gros bonnet de laine. Il était 10 heures du matin. Sarret se précipita sur ses pas, tandis que Mme Vernet, prévenue par un cri de la domestique, se trouvait mal sans pouvoir tenter un dernier effort pour le retenir.
Tout le monde connaît cette cruelle odyssée, la visite chez Suard, la démarche de Garat, le passeport donné par Cabanis, la porte de Suard fermée alors qu’il avait promis de la laisser ouverte[144], la nuit passée dans les carrières de Clamart; enfin, le 27 mars, l’arrestation, à Bourg-la-Reine, du philosophe qui avait pris le nom de Pierre Simon, heureux présage, disait-il, parce que c’était celui du père nourricier de sa fille. A 4 heures du [p. 145] soir, le surlendemain, le geôlier le trouva étendu à terre et sans vie. Un médecin déclara que le prisonnier avait succombé à une attaque d’apoplexie sanguine; en réalité, il s’était empoisonné.
La question de savoir si Condorcet avait avancé sa fin ou s’il était mort naturellement a été fort discutée. Le billet de Jean Debry, du 30 juin 1793, serait à lui seul une preuve concluante. De plus, Cabanis a toujours déclaré que Condorcet s’était empoisonné. Il y a, dans les archives de l’Institut, une lettre que M. Fayolle écrivait à Arago, le 28 février 1842, qui n’est pas moins concluante: «C’est de Garat, dit-il, que j’ai appris que Cabanis avait remis à plusieurs personnes de ses amis, en 1793, ce poison (l’opium combiné avec le stramonium), qu’il appelait le pain des frères. Comme Bonaparte, à une certaine époque, voyait Cabanis chez Mme Helvétius, à Auteuil, ce médecin lui donna du poison en question sous la forme de [p. 146] bâtons de sucre d’orge[145]. Je tiens tous ces détails de Garat et M. Feuillet[146] doit les connaître.»
On trouva sur «Pierre Simon, natif de Ribemont, district de Saint-Quentin, âgé de cinquante ans, ayant demeuré rue de Lille,... une montre en argent à aiguilles d’or, marquant heure et minutes, secondes, quantième et semaine, boîte marquée d’un G[147], un livre d’Horace en latin, un petit cachet d’acier, un porte-crayon en argent, un rasoir à manche d’ivoire, un couteau à manche de corne et son tire-bouchon, une petite paire de ciseaux».
Pendant plusieurs mois, on ignora la mort de Condorcet. Sa famille le croyait passé en Suisse, tandis que ses biens étaient vendus comme propriétés d’émigré.
Sophie, ruinée, avait d’abord songé à se rendre à Villette, auprès de son père. Un passeport délivré par la municipalité d’Auteuil en fait foi; mais elle s’était bien vite ravisée, en songeant que son devoir était de rester aussi près que possible du proscrit.
[p. 147] Après avoir rendu la liberté à chacun de ses domestiques, renvoyé sa femme de chambre et la gouvernante anglaise de sa fille, elle restait seule pour subvenir au service et aux besoins de trois personnes: Elisa, âgée de trois ans; Charlotte de Grouchy, sa sœur, toujours malade, et Mme Beauvais, la vieille gouvernante que nous connaissons depuis Neuville et qui était devenue incapable du moindre travail.
Du peu d’argent qui lui restait, Mme de Condorcet acheta, au no 352 de la rue Saint-Honoré, tout près de la maison de Robespierre, une petite boutique de lingerie où elle établit Auguste Cardot, le jeune frère du secrétaire de son mari. A l’entresol, au-dessus de la porte cochère, elle avait un petit atelier où elle peignait des tableaux, des miniatures et des camées. Quelquefois aussi, elle pénétrait dans les retraites où se cachaient les proscrits et dans les cachots pour reproduire les traits des malheureux condamnés qui n’avaient plus que ce souvenir à léguer à leur famille. Souvent pour gagner la bienveillance des geôliers, des soldats ou des municipaux, elle dut peindre, dans la fumée des corps de garde, ces brutes avinées qui n’avaient aucun respect pour ses délicatesses de femme, ni pour ses malheurs d’épouse.
Des paroles cruelles qui retentirent alors à ses [p. 148] oreilles, Sophie conserva toute sa vie un douloureux et terrible souvenir!
Jusqu’au 9 thermidor, elle crut, chaque jour, qu’elle serait arrêtée à son tour. Elle eut de fréquentes visites du comité révolutionnaire d’Auteuil. Un jour, il y eut une perquisition chez elle; on lui dit même de préparer son paquet pour aller en prison. Mais elle s’en tira encore une fois en faisant le portrait de chacun des membres du comité.
Enfin, le soin de sa sûreté et le désir de sauvegarder, s’il était possible, la fortune de sa fille, l’obligèrent à faire une démarche qui lui fut très pénible.
Le 14 janvier 1794, elle se présenta devant la municipalité d’Auteuil pour lui faire connaître son intention de divorcer et de continuer à vivre dans la commune «comme une artiste qui cherche à subsister paisiblement par ses travaux[148]».
C’est que Mme de Condorcet avait des ennemis redoutables. Aux Jacobins, le 27 novembre 1793, [p. 149] Hébert l’avait dénoncée personnellement. Voici comment il s’était exprimé[149]: «Il en est un autre aussi que les femmes veulent sauver parce que,—et il faut en convenir,—il est joli; c’est celui que Marat appelait le furet de la Gironde, car on sent que celui qui, dans une affaire aussi astucieuse, aussi compliquée, celui qui faisait le métier de furet ne jouait pas le rôle le moins important. Ses liaisons avec Mme de Condorcet lui garantissent le parti de toutes les femmes de sa clique. C’est Ducos, c’est celui-là que les femmes ont pris sous leur sauvegarde.
«Il est bien singulier que jamais on n’ait voulu comprendre dans une affaire tous ceux qui y ont trempé.»
De même que, dans la bonne fortune, elle n’avait jamais laissé entendre un seul mot intéressé, Sophie, en réponse à ces odieuses accusations, n’eut jamais une parole de haine ou de sévérité.
On n’en est que plus libre pour juger d’anciens amis comme Morellet qui disait d’elle[150]: «La femme de Condorcet, une des plus belles, des plus [p. 150] spirituelles et des plus instruites qui aient jamais brillé parmi son sexe, retirée à Auteuil, est réduite à faire de petits portraits pour vivre, et à peine peut-on la plaindre quand on sait que, non seulement elle a partagé les fautes de son mari, mais qu’elle l’a poussé aux plus grandes de celles qu’il a faites, s’il est permis d’employer un terme aussi faible que celui de faute pour qualifier tout ce qu’on peut reprocher à Condorcet.»
En revanche, Sophie avait gardé quelques amis dévoués et vigilants: Garat, Laplace, Lacroix[151], La Roche et, avant tous les autres, l’excellent Cabanis.
Hélas! combien ils étaient plus nombreux, ceux qui, hôtes autrefois du Salon des Monnaies, avaient disparu dans la tourmente: prisonniers de la Nation ou, déjà, morts sur l’échafaud!
La persécution frappait surtout le talent et la vertu. En prison, Malesherbes qui expie dans les cachots son amour ancien de la Liberté et son héroïsme récent! A Saint-Lazare, le vertueux Roucher qui attend l’échafaud en dirigeant l’éducation de son Eulalie, devenue la plus charmante et la plus instruite des jeunes filles!
Et Volney, et Daunou, en prison, eux aussi!
[p. 151] Chamfort, moins courageux, devance l’heure fatale, en se frappant d’un rasoir sous les yeux de ses gardiens.
Le sensible Ginguené, élève enthousiaste de Rousseau, va rejoindre Roucher sous les verrous de Saint-Lazare. Il a épousé une amie de Sophie; il l’appelle sa Nancy[152], et échange avec elle, pendant sa captivité, une correspondance touchante.
Ginguené, pour se préparer à la mort, traduisait le dialogue de Platon sur l’immortalité de l’âme; il disait à Nancy: «Le tableau simple et touchant de la mort de l’homme juste, résigné à son sort et consolant lui-même ses inconsolables amis, est une des plus belles choses que l’antiquité nous ait laissées. Puisque nul n’est à l’abri de la ciguë, il importe à tout le monde d’apprendre comment un sage doit la boire.»
Le 8 messidor[153]: «N’oublie pas que c’est de ton courage que dépend celui que je puis avoir; [p. 152] que mon parti est pris depuis longtemps sur tout ce qui me regarde, mais que je ne puis supporter l’idée de tes souffrances et que si je viens une fois à penser que tu ne peux les supporter toi-même, ce sera bientôt fait de moi. Adieu, chère et unique amie, tu m’occupes à tous les instants du jour et je te dirais que tu m’empêches de songer à mes peines si l’idée des tiennes ne m’était mille fois plus difficile à supporter. Reçois les tristes embrassements de ton pauvre Pierre.»
Le malheureux captif avait d’autres préoccupations que celle de sa propre sécurité. Le 30 messidor, il avait aperçu Nancy et il l’avait trouvée malade. Il faut lui laisser la parole: «O ma tendre amie, d’où est donc venue l’impression de tristesse qui s’est répandue tout à coup sur cette entrevue où je ne me promettais que joie et délices? Je t’ai vue là comme une ombre désolée ou plutôt comme la veuve de ton pauvre ami. Ah! rassure-moi. J’en ai besoin. Dis-moi que, sous tes voiles, si j’avais pu lire dans tes yeux, j’y aurais vu l’expression du plaisir. La fatigue, sans doute, peut-être l’attente... Ah! mon cœur ne pouvait y suffire. J’aurais voulu m’élancer, voler à toi, te serrer dans mes bras. Par malheur, un homme était auprès de moi et cet homme, surtout dans le moment où nous sommes, m’est infiniment suspect. Je n’ai pu [p. 153] qu’agiter mon mouchoir avec le moins d’affectation que j’ai pu. Je te dévorais des yeux, mais ta démarche pénible! la lenteur de tes mouvements! O mon amie! La tendresse de ton pauvre Pierre s’est-elle alarmée sans raison? Je l’espère. Je voyais aux fenêtres et à la porte de la maison neuve quelques personnes qui t’observaient. J’ai craint que tu ne fusses trop remarquée. Je t’ai fait un geste que tu as entendu! Tu es rentrée dans la petite rue. Tu t’es retournée. Je t’ai envoyé le baiser d’adieu. Tu te soutenais à peine. Chère, ô mille fois chère Nancy, tout mon cœur s’est brisé quand je t’ai vue t’éloigner tristement et partir. Avant de te voir, je ne m’étais, dans mon agitation, livré qu’au bonheur dont j’allais jouir. Depuis que tu as disparu, je ne me suis plus occupé que des dangers et des fatigues où tu venais de t’exposer. Trois lieues par cette chaleur excessive! Trois autres lieues pour le retour! Il y a de quoi en être malade et tout cela pour voir quelques instants l’infortuné captif! Ah! tout l’excès de sa tendresse pourra-t-il jamais payer de telles preuves d’amour? Oh! si j’avais encore la liberté d’écrire dont nous avons joui quelque temps, que de choses j’aurais à dire! Comme mon cœur est plein! Que de larmes ont coulé de mes yeux sans le soulager! Le tien est habitué à l’entendre. Ma Nancy, ma chère Nancy! [p. 154] que les paroles sont de froids interprètes!... Quel pressant besoin j’ai de savoir de tes nouvelles! Jusque-là je n’aurai pas un instant de repos. Hélas! je n’en ai plus, je n’en aurai plus que nous ne soyons réunis. Que d’obstacles nous séparent encore!... (Il faut rassembler des pièces qui convaincront de l’innocence de Ginguené...) Alors, tous les jours la robe blanche[154], alors les tendres soins, les sollicitations de mon ami. Alors, le pauvre Pierre pourra se livrer à l’espérance de se revoir dans tes bras!...»
Avec les premiers jours de thermidor, l’espérance qui, chez Roucher et Chénier, disparaissait vaincue par la cruelle réalité, l’espérance renaissait dans le cœur de Ginguené. Il connaissait, certainement, tandis que d’autres l’ignoraient, le complot libérateur, pressenti et attendu pour le 9 thermidor. C’est ainsi qu’il écrivait, le 3:
«Adieu, tendre et chère amie, conserve, comme moi, beaucoup d’espérance. Ne fais plus rien dire à personne puisque tous sont avertis et aux aguets... Je fais des vœux pour que cette décade finisse, et surtout pour qu’elle finisse heureusement pour nous. Mais nos vœux ne font rien sur la lenteur, [p. 155] ni la rapidité du temps, ni sur les événements qu’il amène. Chère et unique amie, adieu!»
Et le lendemain: «Que tous nos amis veillent et surtout auprès du comité de sûreté générale, mais sans rien demander, même sans rien dire. Être tout à fait oublié, ce sera tout gagner. Si je ne l’étais pas, il faut tâcher de le savoir et d’y porter vite remède. Il s’agit désormais de peu de jours; ainsi, que tous les bons anges soient, nuit et jour, sous les armes... Inaction surveillante, voilà le mot.»
A Auteuil même, la tyrannie se faisait sentir. Deux amis intimes de Cabanis, l’excellent La Roche et Destutt de Tracy étaient arrêtés et menacés, eux aussi, de l’échafaud.
Parmi les accusations portées contre le maire d’Auteuil figurait, en bonne place, celle d’avoir favorisé l’évasion de Condorcet.
Des Girondins qui se rencontraient autrefois chez Julie Talma, quelques-uns à peine survivaient et ils étaient traqués comme des bêtes fauves! On ignorait leur sort. C’est ainsi que Mme de Condorcet avait pu rester aussi longtemps dans l’ignorance de celui de son mari.
Quand elle n’eut plus aucun doute, quand, des indices rapprochés, elle tira la preuve du décès du philosophe, sa douleur fut horrible.
[p. 156] Cabanis fit des prodiges et la sauva; mais elle était frappée pour la vie, et ni le travail, ni la misère, ni l’éducation de sa fille ne purent la distraire de son malheur.
«Ce qu’elle avait souffert en 1793 et 1794, dit Mme O’Connor[155], avait profondément altéré sa santé. Elle n’en pouvait parler sans une émotion extrême qui la rendait toujours malade.»
Bien des années après, une fille de Cabanis, Mme Joubert écrivait[156]: «La conversation tombait fréquemment, cela se conçoit, sur les Girondins; mais on n’en parlait jamais devant ma tante (Mme de Condorcet). Ces souvenirs étaient trop cruels!»
Un écho des douleurs de Sophie se retrouve dans cette admirable lettre qu’elle écrivait, le 26 octobre 1794, à sa tante, Mme Fréteau, qui avait, elle aussi, perdu son mari dans la tourmente[157]:
«Quoique je doive une réponse à Félicité[158], ma chère tante, c’est à vous que je veux écrire et je l’aurais fait depuis un mois si je n’eusse été malade et surchargée d’affaires. J’avais besoin de [p. 157] vous dire combien j’ai souffert avec vous, comme je pense que vous avez souffert avec moi, et ne pouvant m’étendre sur les inexprimables douleurs qui nous sont communes, je voulais vous parler de vos enfants qui en sont l’unique consolation. Je les ai trouvés tous deux dignes du respectable nom qu’ils portent et aussi bons, aussi raisonnables, aussi instruits que la mère la plus tendre et la plus difficile le peut désirer. J’ai joui bien profondément pour vous de les voir répondre aussi complètement à leur éducation et à vos vœux. Jouissez-en vous-même. Je sais par ma douloureuse expérience que le sentiment maternel est le seul baume de nos douleurs, et si peut-être vous éprouvez quelque inquiétude sur les ressources nécessaires à sept enfants, du moins votre cœur n’éprouve pas le mortel effroi qui saisit quelquefois le mien en n’en ayant qu’un seul à serrer entre mes bras.
«Le comité de sûreté générale m’a réintégrée dans mon ancien domicile en vertu du décret qui défend les poursuites contre les députés hors la loi.
«Ensuite, le comité des finances, à ma requête, a suspendu la vente des biens qui, heureusement, n’était qu’au quart et non entamée pour le mobilier de Paris. Maintenant, je fais devant et par les tribunaux rectifier l’extrait mortuaire de mon malheureux mari qui, lorsqu’il fut pris, ne déguisa que [p. 158] son nom et donna d’ailleurs tous les moyens d’être reconnu[159]. Ensuite, je redemanderai au nom de ma fille et au mien son héritage et, comme on a rendu complètement à d’autres mis aussi hors la loi et n’ayant pas subi de jugement, j’espère qu’on nous rendra de même. Je ne vois malheureusement dans tout cela et la position de vos enfants rien de commun que l’innocence des pères. Peut-être le temps leur sera-t-il plus favorable?
«J’ai chargé Emmanuel[160] de vous dire que, du moment où j’aurais recouvré notre fortune, je prierais vos enfants de me regarder comme leur seconde mère, de croire que tout ce qui est à moi et à ma fille est à eux. Je ne puis jouir de rentrer dans l’aisance qu’en adoucissant les malheurs semblables aux miens. Mon intention est d’élever Clémentine, la seconde fille de mon frère[161] et, sans doute, vous ne me refuserez pas le bonheur d’offrir quelquefois à vos enfants des ressources que leur père et vous m’eussiez sans doute offertes dans le cas où la [p. 159] fortune vous eût été plus favorable qu’à moi. J’ai prié Emmanuel, quoique mon dîner soit toujours un fort mauvais dîner, de venir le partager avec moi du moment que votre chère maman[162] sera retournée et j’espère qu’il aura assez d’amitié pour moi pour ne trouver que du plaisir à me procurer ce plaisir-là. Adieu, ma chère tante, embrassez pour moi vos chères petites. La mienne se souvient de Félicité et est toujours bien portante. Vos petites jumelles[163] vont-elles toujours bien?»
La levée des scellés et la rentrée en possession des diverses propriétés deviennent à cette époque, dans toutes les familles, une des grosses préoccupations. Les formalités sont interminables; mais on entrevoit, cependant, une éclaircie et ce rayon suffit pour rendre quelque espoir. Mme de Condorcet est soumise à la règle commune.
Le 12 novembre 1794, Félicité Fréteau écrivait à sa mère[164]: «Sophie est venue à moitié chemin d’Auteuil à Chaillot au-devant de moi. Elle m’a témoigné la plus vive sensibilité et nous nous sommes embrassées avec la plus douce émotion. Elle m’a appris que sa position était la même que la nôtre et que son mari est mort de la manière la [p. 160] plus malheureuse il y a environ six mois. Elle est pleine de courage et de résignation. C’est nous qui lui avons appris qu’on allait lever les scellés chez elle. Elle n’avait pas encore fait la moindre démarche. Il me paraît qu’elle est mal conseillée. Je lui ai indiqué la marche que nous avons tenue et elle m’a prié de la conduire demain chez le citoyen qui nous a été si utile. Je lui ai promis et je vais la prendre demain à 8 heures. Elisa est infiniment jolie, mais très mignonne. Elles m’ont toutes deux prié de vous parler d’elles et de leur tendre intérêt. Elles m’ont fait mille instances pour rester deux jours avec elles; mais je n’ai pas cru devoir y consentir et je suis revenue le soir.»
Et, le lendemain, la même correspondante écrivait encore à Mme Fréteau[165]: «La pauvre Sophie est bien à plaindre. Elle a perdu hier son portefeuille qui contenait 600 livres, fruit de son travail. Depuis trois mois, du reste, elle a beaucoup à se louer de nous avoir vues. Elle va recouvrer son mobilier et ses tableaux. Elle est aussi bonne et plus belle que jamais. Elle vous dit mille choses tendres. Son enfant est charmante et des plus aimables. Dites à Octavie qu’elle a cinq ans, qu’elle épelle et travaille supérieurement..... J’oubliais de vous [p. 161] prier de dire à mon frère que le jour où j’ai vu Sophie elle se disposait à faire le voyage de Paris exprès pour le voir ayant appris qu’il était malade.»
Le 22 novembre[166]: «Les fermes de Sophie sont en vente et peut-être même vendues. Elle est vraiment sans ressources.»
Enfin, au mois de janvier 1795, Mme de Condorcet obtenait une partie de la justice qui lui était due. Emmanuel Fréteau écrivait à sa mère[167]:
«M. Lemor[168] a été hier à Auteuil. Sophie est [p. 162] réintégrée dans ses biens. Quant à la partie vendue, la Nation lui rendra ce qu’elle a reçu du prix et elle recevra le reste de l’acheteur. Tout cela se fait à muchepot. Les députés ne veulent pas être importunés.»
Sophie n’avait pas encore recouvré toute sa fortune; elle allait demander à sa plume de nouvelles ressources pour assurer son existence et celle des siens. Cependant puisqu’elle retrouvait une modique partie de son ancienne aisance, elle se décida aussitôt à régler ce qu’elle considérait comme des dettes sacrées. C’est ainsi qu’elle reprit, jusqu’à leur mort, le paiement des 300 livres de rente annuelle que son mari servait aux domestiques de d’Alembert; puis elle distribua 16.000 livres, payables à sa volonté, mais avec intérêt à 5 p. 100, à ses propres serviteurs. «C’est moins, dit-elle[169], de son propre mouvement qu’elle a contracté ces obligations qu’en exécution des intentions de M. de Condorcet; ces rentes et donations, quoique disproportionnées à la fortune qu’il a laissée, sont de faibles marques de reconnaissance relativement aux preuves courageuses d’attachement qu’il a reçues des personnes ci-dessus dénommées [p. 163] qui, tandis que M. de Condorcet était hors la loi, sollicitaient à l’envi d’être chargées de prendre pour lui les soins nécessaires qui les mettaient dans le même péril que lui.»
Ces affaires réglées, Mme de Condorcet, tout en conservant à Auteuil son principal établissement, meubla, à Paris, un petit appartement rue de Matignon[170].
Elle retrouva bien vite quelques-unes de ses anciennes relations. Sa famille recommençait à avoir en elle une protectrice d’une bonté inépuisable[171].
Quant à Julie Talma, dont le salon, après le 9 thermidor, avait eu encore quelque éclat[172], elle venait de se brouiller avec le grand acteur. Après lui avoir renvoyé ses costumes, ses casques et ses armures, elle vint demander à Mme de Condorcet, [p. 164] rue de Matignon, une hospitalité que la veuve du philosophe s’empressa de lui accorder[173].
La société française se reprenait à la vie et, au lendemain de la Terreur, il semblait que chacun éprouvât le besoin d’affirmer sa jeunesse et sa joie. On respirait enfin; et de suite, passant de l’extrême douleur à une joie excessive, on vit, dans tous les mondes, comme un renouveau et une résurrection. Le bal des victimes fut une des manifestations les plus significatives de ce nouvel état de choses; il faut reconnaître que les historiens n’ont pas exagéré; mais leurs jugements seraient moins sévères peut-être s’ils s’étaient bien rendu compte de l’état des esprits à cette époque.
A Auteuil, malgré la tristesse de Mme Helvétius qui ne put jamais oublier ses amis disparus, la joie fut grande quand on vit revenir La Roche, Tracy et Ginguené, qui s’établit dans la grande rue du village pour être plus près de ses amis[174].
[p. 165] Sophie subit, malgré elle, l’influence de ces joyeuses réunions: Isabey faisait, en même temps le portrait d’Elisa et celui de Mme Tallien[175]; de là, dans son atelier, des rencontres qui forçaient Mme de Condorcet, pour quelques instants du moins, à se distraire.
Puis c’étaient des journées passées chez Mmes de Boufflers dont le parc s’étendait sous les fenêtres de Mme Helvétius; des courses au bord de la Seine, pour assister aux fêtes données par les enfants de l’école de Mars; des promenades au Ranelagh; toutes les inutiles occupations de l’oisiveté mondaine.
Quand Sophie s’arrachait à ces distractions, c’était pour retrouver dans l’intimité Cabanis, Jean Debry, Baudelaire et Mailla-Garat qui, tous deux, lui inspirèrent de tendres sentiments[176].
On retrouve comme un écho de cette vie familiale dans la correspondance de Nancy Ginguené; le 20 thermidor de l’an III, elle écrivait à [p. 166] Mme Guadet[177]: «Mon mari a eu l’occasion de voir Jean Debry. Ils ont parlé de vous, mon aimable amie, et vous pouvez penser de quelle manière. Il conserve bien chèrement le portrait de votre ami[178]... Mme de Condorcet que je vis hier et qui me trouva à vous écrire me pria de la rappeler à votre souvenir. Elle est toujours belle malgré tous les chagrins qu’elle a éprouvés. La petite Elisa est aussi charmante.»
Cependant, la Convention rappelait dans son sein Isnard, Louvet, Pontécoulant, Larivière, La Revellière-Lépeaux, tous les proscrits de la Terreur, et Marie-Joseph Chénier s’écriait, dans une improvisation sublime qui répondait déjà aux atroces calomnies: «Pourquoi ne s’est-il pas trouvé de cavernes assez profondes pour soustraire aux bourreaux l’éloquence de Vergniaud et le génie de Condorcet?»
En vertu d’une loi historique fatale, le pouvoir appartenait maintenant aux vaincus et aux opprimés de la veille. Les Idéologues,—c’est eux-mêmes qui se donnèrent ce nom,—arrivaient au [p. 167] Gouvernement dans les conditions les plus difficiles. Tout était à reconstruire. Ces honnêtes gens qui sortirent de la Révolution avec un renom d’intégrité incontestée ont été victime de cette iniquité qui traitait de sensualistes des gens comme Daunou, Tracy et Cabanis, la sobriété même. En réalité, les Idéologues tiraient tout de la réflexion et de l’analyse; l’intellectuel et l’abstrait étaient leurs seuls domaines. Cette débauche d’abstraction et cet excès de métaphysique ne convenaient pas au caractère national.
Certes, l’idée était généreuse qui voulait installer dans le gouvernement des hommes la raison à la place de la force, la générosité et l’initiative au lieu de l’égoïsme et de la routine. Mais cette théorie qui trouva sa forme dans la philosophie et dans la littérature républicaines de l’an III ne faisait qu’augmenter la méfiance qui a séparé de tous temps les théoriciens des hommes d’action. La pensée pure, qui éclate d’autant plus qu’on la comprime, survit à l’œuvre des politiques, mais ses fidèles doivent savoir d’avance qu’incompris de leurs contemporains, ils sembleront toujours les adversaires des régimes mêmes qu’ils auront fondés.
La constitution de l’an III fut l’œuvre de Daunou et la Charte des Idéologues. Ces aimables rêveurs pouvaient croire de bonne foi à sa durée; [p. 168] mais auraient-ils dans la pratique du pouvoir les qualités indispensables de science, de force et d’énergie? Des Chénier pourraient-ils organiser une Université française et des Ginguené ou des Garat occuper des ambassades? Et les Grouchy, les Moreau, les Joubert pourraient-ils lutter victorieusement avec le génie même de la Guerre?
Le 18 brumaire répondit à toutes ces questions et l’enthousiasme qu’il provoqua, surtout chez les philosophes d’Auteuil, est la preuve même de l’impuissance des théories humaines aux prises avec les événements.
En l’an III, l’ombre de Condorcet planait sur l’Assemblée[179]; elle était aux Ecoles Normales, à l’Institut, dans les conseils du gouvernement; elle inspirait la Décade, où le monde nouveau cherchait un évangile.
Mme de Condorcet le comprit et elle apporta elle-même sa part dans l’héritage en publiant ses Lettres sur la Sympathie[180] et en donnant une première édition des œuvres du philosophe.
[p. 169] En tête de l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain[181], Sophie s’exprimait ainsi:
«Condorcet proscrit voulut un moment adresser à ses concitoyens un exposé de ses principes et de sa conduite comme homme public. Il traça quelques lignes; mais prêt à rappeler trente années de travaux utiles et cette foule d’écrits où, depuis la Révolution, on l’avait vu attaquer constamment toutes les institutions contraires à la liberté, il renonça à une justification inutile. Etranger à toutes les passions, il ne voulut pas même souiller sa pensée par le souvenir de ses persécuteurs et, dans une sublime et continuelle absence de lui-même, il consacra à un ouvrage d’une utilité générale et durable le court intervalle qui le séparait de la mort...
«Puisse ce déplorable exemple des talents perdus pour la Patrie, pour la cause de la Liberté, pour les progrès des lumières, pour leurs applications bienfaisantes aux besoins de l’homme civilisé, exciter des regrets utiles à la chose publique! Puisse cette mort qui ne servira pas peu dans l’histoire à caractériser l’époque où elle est arrivée, inspirer un attachement inébranlable aux droits dont [p. 170] elle fut la violation! C’est le seul hommage digne du sage, qui, sous le glaive de la mort, méditait en paix l’amélioration de ses semblables; c’est la seule consolation que puissent éprouver ceux qui ont été l’objet de ses affections et qui ont connu toute sa vertu!»
L’année 1796 réservait à Sophie une de ses dernières et de ses plus grandes joies.
Cabanis qui avait traversé la Terreur, non sans être inquiété et menacé chaque jour d’arrestation, et qui n’avait dû la liberté qu’à l’amour des habitants d’Auteuil pour celui qui était à la fois leur médecin et leur bienfaiteur; Cabanis qui saluait ainsi le 9 thermidor[182]: «Que de bénédictions pour la Convention nationale! Et que de jouissances pour ceux de ses membres qui contribuent plus directement à ces actes humains et justes! Oui, c’est maintenant que la République est impérissable!» Cabanis venait de demander la main de Charlotte-Félicité de Grouchy, sœur de Mme de Condorcet. Il la connaissait depuis de longues années et savait tout ce qu’il pourrait trouver en elle d’amour et de fidélité. Eprise des arts et des choses de l’esprit, elle disait[183]: «La musique est une amie de l’âme [p. 171] et il est difficile d’en trouver d’aussi intimes parmi les choses inanimées. Le vallon de Villette en présente aussi à la paresse et à la rêverie. Mais la nature est si belle qu’elle ne permet point de tristesse. On est forcé de rester à la mélancolie... La santé de maman est toujours bien faible et son âme bien vive et bien bonne. Je me fais un plaisir d’en reposer l’activité et d’en distraire les peines par ma présence qu’elle chérit et qu’elle goûte bien.»
Charlotte avait vécu trop longtemps auprès de Condorcet pour ne pas partager toutes ses opinions philosophiques. C’étaient aussi les idées de Cabanis et aucun nuage ne pouvait séparer les jeunes époux qui se marièrent le 25 floréal de l’an IV[184] et se fixèrent aussitôt chez Mme Helvétius dans un pavillon au fond du parc.
A ce moment même, le général Bonaparte remportait, en Italie, ses premières victoires. Au printemps de 1795, Volney et La Revellière-Lépeaux l’avaient présenté à Barras; ce fut l’origine de sa fortune et les Idéologues, on le voit, n’y furent pas étrangers. Ils continuèrent quelque temps encore à l’observer avec un curieux et bienveillant intérêt. «Depuis le débarquement de Bonaparte, disait [p. 172] Eymar[185], il y a une pyramide de plus en Egypte.» A l’Institut, Chénier célébrait le héros «à qui la France devait l’éclat de ses triomphes et la grandeur de ses destinées»; Garat le dépeignait «comme un philosophe qui aurait paru un instant à la tête des armées».
Bonaparte, en retour, donnait des gages à l’Idéologie. Sieyès, Cabanis, Volney lui-même étaient gagnés.
Deux femmes, seules, restèrent sur la réserve: Mmes Helvétius et de Condorcet.
La première, recevant un jour à Auteuil la visite du jeune triomphateur qui s’étonnait de la petitesse de son parc, lui répondit: «Vous ne savez pas, général, tout le bonheur qu’on peut trouver dans trois arpents de terre!»
La seconde, à ce mot du consul: «Je n’aime pas que les femmes se mêlent de politique,» répliquait par cette spirituelle parole: «Vous avez raison, général; mais, dans un pays où on leur coupe la tête, il est naturel qu’elles aient envie de savoir pourquoi.»
Mme de Condorcet recouvre ses biens.—Le Muséum.—Rencontre de Fauriel.—La Maisonnette.—Le Consulat et l’Empire.—L’opposition se donne rendez-vous chez Mme de Condorcet.—Mariage d’Elisa de Condorcet avec le général O’Connor.—Mort de Cabanis.—Les hôtes de la Maisonnette.—Benjamin Constant, Manzoni, Ginguené, Guizot.—Le procès du maréchal de Grouchy en 1816: rôle de sa sœur.—La marquise de Condorcet se retire du monde.—Rentrée à Paris.—Ses bonnes œuvres.—Sa mort.
La mode n’était plus d’aller au Lycée; les jeunes filles, les jeunes femmes, les savants et quelques-uns de ces oisifs qui ne méprisent pas les choses de l’esprit se rencontraient maintenant aux leçons de botanique du Muséum et aux herborisations dans la plaine de Gentilly. Ce retour au culte de la nature était un dernier hommage, pacifique celui-là, rendu par la Révolution finissante à Jean-Jacques Rousseau.
C’est au Muséum qu’un matin de l’automne de 1801 Fauriel avait rencontré Mme de Condorcet. Bientôt, s’était établie entre eux une de ces liaisons [p. 174] discrètes que le XVIIIe siècle admettait, sans penser à les critiquer. On les considérait comme une sorte de mariage morganatique. Malgré la Révolution, les préjugés étaient encore tenaces; le vieux marquis de Grouchy avait déjà vu d’un assez mauvais œil le mariage de sa seconde fille avec Cabanis et il n’était guère disposé à supporter une nouvelle mésalliance. Mme de Condorcet, de son côté, tout en ne tenant pas à son titre de marquise, ne voulait pas, du moins, changer le nom illustre de son mari, contre celui d’un homme qui n’était encore connu que par des fonctions remplies à la police, sous la direction de Fouché.
A ne voir que le grand portrait de Fauriel dû au crayon de Mme de Condorcet[186], on ne comprend guère la passion qu’une femme, admirablement belle et remarquablement intelligente, pouvait éprouver pour cet homme, aux cheveux frisés et presque crépus, qui n’avait dans son extérieur aucune apparence de distinction; l’œil est rêveur et méditatif peut-être, mais il y manque la flamme qui anime et qui embellit les physionomies, même les plus vulgaires.
Quoi qu’il en soit, Fauriel, qui était intelligent et instruit, dut à cette bonne fortune l’honneur d’être [p. 175] introduit dans la société d’Auteuil. Cabanis, toujours excellent, fut charmé des dispositions laborieuses de ce nouvel ami et il se donna tout entier, tandis que Fauriel semblait se réserver et attendre.
Au printemps, le médecin-philosophe lui écrivait de Villette[187]:
«Oui, venez voir nos riches prairies, nos blés admirables, notre verdure aussi riche que fraîche et riante. Les insectes qui bourdonnent ici appellent la rêverie et invitent à un calme heureux; ceux qui carillonnent, ailleurs, ne produisent pas toujours le même effet; je n’en excepte pas même les journalistes dont vous me parlez. M. de Grouchy vous destine une chambre à côté de la mienne. Vous savez combien ce voisinage me sera précieux.»
Et à quelques jours de là[188]:
«Nous vous attendons après-demain ou dimanche au plus tard avec Mme de Condorcet. Vous trouverez la campagne superbe, et paisible, et douce, ce qui arrive rarement au superbe. C’est dans ce genre d’impressions et dans les beautés poétiques ou littéraires qu’il faut chercher la source de cet enthousiasme et de ce sentiment élevé de la nature humaine, dont les hommes qui ne sont pas [p. 176] rapetissés et énervés, comme le dit Longin, ont besoin pour passer la vie heureusement; on ne les trouve point ailleurs. La culture de la vertu, l’amitié, les lettres, la campagne: voilà les vrais biens et plus on avance vers le terme de cette courte vie, plus on sent que les passions factices de la société et les tableaux qu’on y a sans cesse sous les yeux sont peu propres à satisfaire le cœur. Je vous avouerai même que les travaux philosophiques me ramènent trop vers ce monde moral si mal arrangé: j’ai porté ici un manuscrit que je me suis hâté de rempaqueter, après y avoir jeté un coup d’œil. J’ai, de même, repoussé Tacite que j’avais pris avec moi pour le relire: il me reportait trop à Rome. C’est Homère, c’est Virgile, c’est la Bible, ce sont enfin des poètes et quelques écrivains de prose qui s’en approchent pour la perfection, auxquels j’ai promis et voué tout le temps que je serai ici. Vous voyez que nous sommes à l’unisson.
«Venez donc au plus tôt: ma femme et moi nous vous embrassons tendrement; nous vous prions aussi d’offrir mille amitiés de notre part à Sophie. Elisa a écrit une lettre charmante à son grand papa: elle l’était surtout parce qu’elle annonçait votre arrivée prochaine à nous tous.»
Ces harmonies de la campagne, évoquées avec tant de grâce mélancolique, cette retraite [p. 177] méditative et studieuse partagée entre les livres et la nature, allaient saisir victorieusement Fauriel et l’arracher à la société de Mme de Staël, qu’il avait beaucoup fréquentée jusque-là. Elle s’en plaignait en lui reprochant son «amitié paresseuse» et sa quasi-indifférence: «Cette amitié, lui écrivait-elle, qui ne s’excuse de rien que de son empressement, qui est beaucoup plutôt insistante que négligente, celle qui se retient d’écrire au lieu de s’exciter, cette amitié-là est beaucoup plus aimable et je vous l’ai crue pour moi; mais à présent, j’en doute et j’ai raison d’en douter. Ce qui fait donc que si nous parlons sérieusement, solidement, comme deux bons vieux hommes, je suis très reconnaissante de ce que vous êtes pour moi; mais, si je reviens à ma nature de femme encore jeune et toujours un peu romanesque, même en amitié, j’ai un nuage sur votre souvenir, que vos arguments ne dissiperont pas.»
Mme de Condorcet n’avait eu qu’à se montrer pour être victorieuse: il en était aujourd’hui comme au temps de la Constituante. La rivalité qui régnait entre ces deux femmes supérieures et le malaise qui en résultait ne pouvait donc étonner personne.
Il y avait d’ailleurs bien des motifs de brouille et de séparation. Mme de Staël était une chrétienne, parfois militante; Mme de Condorcet, Cabanis et [p. 178] Tracy étaient dans de tout autres idées. Ils ne pouvaient se comprendre. Cette lettre de Mme de Staël à Tracy en est la preuve: «Vous me dites, Monsieur, que vous ne me suivez pas dans le Ciel, ni dans les tombeaux. Il me semble qu’un esprit aussi supérieur que le vôtre et détaché de tout ce qui est matériel par la nature de ses travaux, doit se plaire dans les idées religieuses, car elles complètent tout ce qui est grand, elles apaisent tout ce qui est sensible et, sans cet espoir, il me prendrait je ne sais quelle invincible terreur de la vie et de la mort.»
Une autre source de mauvaise entente entre le monde d’Auteuil et Mme de Staël, c’était la rancune mal dissimulée que la fille de Necker avait vouée à Condorcet et à sa mémoire.
Dès l’année 1776, le philosophe avait écrit à Voltaire pour lui dire tout ce qu’il pensait de la médiocrité et de l’insuffisance du Genevois. Depuis, Condorcet n’avait cessé d’être un juge inexorable pour l’étranger qui avait supplanté Turgot au ministère. Lors du second passage de Necker aux affaires, cet avènement n’avait pas été sans rapports avec la disgrâce qui avait retiré à Condorcet la place qu’il occupait à l’hôtel des Monnaies.
Mme de Staël n’ignorait aucun de ces détails. Elle se plaisait à dire que le philosophe offrait, au [p. 179] plus haut degré, les caractères de l’esprit de parti. Elle cherchait depuis longtemps l’occasion de venger son père et crut la trouver en publiant, dans son livre de la Littérature, quelques lignes sur «un homme diversement célèbre», qui n’était autre que Condorcet. Talleyrand avait senti l’inconvenance du procédé, puisqu’il écrivait à son ancienne amie, le 18 février 1797: «Votre ouvrage est superbe... Les Condorcet[189] sont à la campagne; ils n’en reviennent que dans huit jours. Je n’ai vu personne qui ait pu me dire ce que le diversement célèbre avait fait sur eux. Il est probable qu’ils ne se portent pas pour choqués; car il sortira un bon extrait de la maison Helvétius qui est un écho de Condorcet[190].»
[p. 180] Il ne sortit aucun bon extrait. Faut-il s’en étonner?
Mais, au contraire, Chénier répondit: «Condorcet fut sans doute et restera diversement célèbre, puisqu’il était à la fois habile dans les sciences mathématiques, profond dans les sciences morales et politiques, éclairé en littérature, écrivain distingué, philosophe illustre et grand citoyen; il est bien vrai qu’il aimait les vertus, le génie, les opinions de Turgot; qu’il admirait son administration et qu’il n’avait pas, à beaucoup près, les mêmes sentiments pour un ministre dont le nom n’est pas sans célébrité[191]. A cet égard, les panégyriques exagérés peuvent convenir à l’amour filial; mais entre-t-il aussi dans ses droits d’inculper gravement et sans motifs admissibles un des premiers hommes du XVIIIe siècle?»
[p. 181] Malgré tout, Mme de Staël rendait justice à sa rivale et, à l’occasion des Lettres sur la Sympathie, elle lui écrivait ces lignes remarquables[192]:
«Canton Léman, Coppet,
ce 20 mai. 1er prairial.
«Je viens de lire, Madame, les huit lettres que vous avez ajoutées à la traduction de Smith, et elles m’ont fait un si grand plaisir que j’ai besoin de vous en parler.
«Vous êtes une personne insensible à la louange, mais vous ne le serez pas à atteindre le but que vous vous êtes proposé: Convaincre et toucher. Vous me savez trop facile à l’émotion pour compter comme un succès celle que j’ai éprouvée, mais mon père est moins mobile et, dans la lecture que je viens de lui faire de votre ouvrage, il n’a cessé de remarquer et les pensées réfléchies et les sentiments heureusement exprimés. Vous serez plus obligée que jamais de me passer mon impression de respect en vous voyant. Il y a, dans ces lettres, une autorité de raison, une sensibilité vraie, mais dominée qui fait de vous une femme à part. Je me crois du talent et de l’esprit, mais je ne gouverne rien de ce que je possède. J’appartiens à mes [p. 182] facultés, mais je n’en puis garder l’usage. Enfin, je vous ai admirée, et dans vous, et par un retour sur moi. Et comme j’ai la bonne nature de n’être point jalouse, je n’ai eu que du plaisir en pensant que je connaissais et que j’aimais une personne si rare. Si j’avais en moi la possibilité du bonheur, elles (les fameuses lettres) l’auraient développée; c’est du calme sans froideur, de la raison sans sécheresse. C’est ce qui compose dans toute la nature l’idéal du bien et du beau, la réunion de quelques contraires. Oh! que nous sommes loin de toutes ces institutions sociales qui doivent former l’homme tel que vous le voulez. J’ai un besoin extrême de causer avec vous.
«Parlez-moi de vos lettres quand je vous reverrai. Votre caractère vous les a inspirées, et elles doivent confirmer votre caractère. Que vous dirais-je de ce pays? Il est couvert de malheureux comme le reste de la terre. Pour moi, je suis tout à fait ruinée. Notre revenu entier était en dîmes. Ne me disiez-vous pas qu’on parlait de moi parce que j’étais riche? J’ai droit au silence actuellement. Je mène depuis quatre mois une vie de courage, mais j’étais où mon devoir marquait ma place. A présent, je voudrais retrouver du bonheur. Mais, déjà, la coupe n’est-elle pas renversée? Enfin, quoi qu’il m’arrive, vous m’avez fait retrouver un plaisir [p. 183] depuis longtemps perdu, l’émotion et l’admiration que le cœur et la vertu font éprouver.
«Parlez de moi, je vous prie, à Gallois et à Cabanis. Notre famille poétique[193] est toujours loin de vous!»
Le 25 mars 1800, naissait à Auteuil, dans la maison de Mme Helvétius, Annette Paméla Cabanis qui eut pour parrain Destutt de Tracy. Mais cette année, qui avait commencé sous d’heureux auspices, devait bientôt se continuer dans les larmes. Mme Helvétius, parvenue à l’âge de quatre-vingt-un ans, avait conservé l’habitude de se lever de très bonne heure. A la fin de l’hiver, elle contracta un catarrhe dont ne purent la guérir les soins empressés de Cabanis et de Roussel.
Elle avait auprès d’elle, dans ses derniers jours, Cabanis et sa femme, La Roche et Gallois, le tribun, qui habitait chez elle depuis 1793. Ces fidèles amis ne la quittèrent pas un instant. Le 13 août, l’agonie commença dans la matinée. Mourante, elle pressait encore sur son cœur déjà glacé les mains de Cabanis qui, comme d’habitude, l’appelait sa bonne mère. «Je la suis toujours,» murmura-t-elle; ce fut son dernier mot.
Suivant ses dernières volontés, elle fut enterrée [p. 184] au bout de son parc, dans un caveau qu’elle avait fait construire, à l’extrémité droite du pavillon où Cabanis avait passé les premiers temps de son mariage.
Celui-ci était inconsolable de cette perte et, le 16 fructidor, il écrivait à Gérando: «Mon cher ami, je n’ai point répondu à votre lettre amicale parce que, d’après son contenu, je vous attendais d’un moment à l’autre. Mais, comme vous ne venez point, je ne veux pas que vous puissiez me croire indifférent aux témoignages touchants de votre amitié; j’y suis, au contraire, infiniment sensible et j’attache un très grand prix aux sentiments qui les ont dictés.
«Vous ne pouvez pas savoir à quel point est irréparable la perte que j’ai faite; mais votre excellent cœur, en s’associant à mes regrets, m’offre le seul genre de consolations qui puisse me toucher véritablement. Recevez-en ma sincère et éternelle reconnaissance.»
Bien que Mme Helvétius eût laissé, en mourant, la jouissance de sa maison à La Roche et à Cabanis, ceux-ci, cependant, n’eurent pas le courage de continuer à y vivre comme par le passé.
La Roche, qui fit partie du Corps législatif jusqu’en 1803, quitta Auteuil à cette date et se retira à Orville, dans le Pas-de-Calais, où il mourut en 1806.
[p. 185] Cabanis, de son côté, ne fit plus que de rares apparitions dans cette propriété où il avait connu toutes les extrémités des joies et des douleurs humaines. Il se rendit à Villette, auprès de son beau-père, en attendant qu’il s’installât séparément au château de Rueil, situé tout près de la terre des Grouchy.
Depuis 1798, Mme de Condorcet, tout en gardant son pied à terre d’Auteuil[194], était devenue propriétaire d’une maison sur le coteau qui domine Meulan et les bords de la Seine; jusqu’en 1800, elle n’y vint qu’en passant, mais, après la mort de Mme Helvétius, elle s’y fixa presque toute l’année, ne conservant plus à Paris qu’un appartement qu’elle habitait pendant les quelques mois de la mauvaise saison.
Toute la famille se trouvait donc réunie autour [p. 186] de Villette, dans ce petit coin de terre béni où la nature embellissait encore les affections et les joies de la famille.
La Maisonnette,—c’est ainsi que Mme de Condorcet baptisa son riant ermitage,—est construite auprès des ruines de l’ancien château fort de Meulan. En 1638, la reine Anne d’Autriche y avait fondé un couvent, dirigé par les Annonciades jusqu’en 1793, époque où il fut vendu comme bien national[195]. Dans une partie des bâtiments, conservée par l’acquéreur de la Nation, fut prise la maison actuelle qui est restée, à l’extérieur comme à l’intérieur, ce qu’elle était à la fin du siècle dernier.
Un cloître, au rez-de-chaussée dont il dessert toutes les pièces, occupait tout le fond de la maison. Le salon et la salle à manger, boisés, [p. 187] s’ouvraient sur un jardin planté d’arbres élevés et de massifs de verdure[196]; un grand escalier et un autre plus petit, conduisaient au premier étage où se trouvent les chambres à coucher. «La maison, point trop petite, dit Guizot, était modeste et modestement arrangée... Sur les derrières et au-dessus de la maison, un jardin planté sans art, mais coupé par des allées montantes le long du coteau et bordées de fleurs. Au haut du jardin, un petit pavillon, bon pour lire seul ou pour causer à deux. Au delà de l’enceinte, toujours en montant, des bois, des champs. D’autres maisons de campagne, d’autres jardins dispersés sur un terrain inégal. Dès le premier moment, le séjour de la Maisonnette me plut.»
Dans l’intérieur de la propriété se trouve une chapelle, construite au Xe siècle et dédiée à sainte Avoie. Sophie y laissait venir en pèlerinage les paysans des environs.
Enfin, un souterrain voûté qui part de la maison conduit dans la campagne.
Mais le joyau de la Maisonnette est la terrasse d’où l’œil contemple une vue admirable. Au premier plan, Meulan et ses deux églises; dans la [p. 188] vallée, la Seine coulant au milieu de vertes prairies; l’Ile-Belle entourée de grands peupliers; et, au loin, quelques hauteurs, dernière ceinture de la vallée de la Seine, qui se dessinent à l’horizon.
C’était la demeure du Sage; une halte heureuse dans la vie.
Mme de Condorcet avait rêvé d’y passer ses dernières années dans l’intimité de Mailla-Garat, avec lequel elle était liée depuis 1798. Au printemps de 1800, pendant un voyage que le tribun fit à Villiers et à Paris, elle lui écrivait[197]:
«Ce 10, soir (de Meulan).
«Tu auras un bien beau temps pour cette fête qui n’est pas la mienne, mon Mail. Puisses-tu, en jouissant, cette nuit, de la beauté de ce ciel prêt à se parer de mille feux, en regardant cette lune argentée, en respirant cet air frais qui s’élève pour moi des bords de la Seine, penser à ta Sophie qui, seule, loin de toi, sacrifie de bon cœur le bonheur de te voir (cependant si nécessaire) aux plaisirs de distraction et d’amitié que tu as été chercher. Puisse l’image de ton amie, moins agréable sans doute que celles que cette fête t’aura offertes, s’embellir à tes yeux par d’assez touchants souvenirs [p. 189] pour rester la seule image qui se soit offerte à ton réveil et qui ait charmé ton goût et tes pensées. Les miennes sont bien mélancoliques aujourd’hui, ainsi que je l’avais prévu, et cette horloge qui sonne si vite les heures de notre union ici les amène aujourd’hui plus lentement, ce me semble, qu’à l’ordinaire... (Elle s’occupe à embellir la Maisonnette.) La dépense s’élevât-elle au plus haut degré, jamais rien ne nous rapportera tant de bonheur et jamais rien n’aura ajouté un charme plus nécessaire aux charmes divers de cette retraite. Je t’écris à cette fenêtre où la Seine se découvre parée des fraîches saulaies de l’Ile-Belle; en voyant couler paisiblement ces eaux dont les bords suivent des courbes si douces au regard, j’espère que notre vie coulera paisiblement, ici, comme ces eaux, et que le charme de cette nature, si riante et si belle, s’unira toujours à toutes les impressions heureuses et faciles que nous éprouverons dans ce séjour. Cher ami, reviens-y bien vite m’ôter cette vague anxiété que je ressens toujours loin de toi, que l’occupation ne saurait charmer et que l’espérance même ne suspend qu’à demi... Adieu, mon âme; je vais m’endormir en pensant à toi aussi tendrement que si tu pensais beaucoup à moi à Villiers. Tu devrais bien prononcer mon nom aux hôtes du lieu, afin que ta petite femme ne soit pas un être [p. 190] inconnu aux personnes pour lesquelles tu peux la quitter quelques moments. Adieu encore, toi que le cœur le moins passionné ne pouvait, ce me semble, aimer sans passion. Adieu, être attirant qui as su charmer une vie flétrie par tous les malheurs et que j’espère n’avoir aimé d’abord avec trouble que pour sentir davantage le bonheur de l’aimer avec confiance et avec paix.»
Et, quelques jours après cette première lettre, pendant la même absence, elle lui écrivait encore:
«Je viens de recevoir ta lettre, mon Mail. Quoique bien tendre, elle ne me rend pas cette présence si chère et si nécessaire et qui me manque tant! Pourquoi mon Mail ne me parle-t-il pas de ce qu’il fait, de ce qu’il voit, comme je lui parle de ce que je fais, de ce que je vois et de ma manière de sentir tout ce qui n’est pas lui? Serait-il possible qu’en te conjurant de m’aimer je t’éloignasse de la première base de tout sentiment, de cette confiance intime qui, seule, prouve le besoin que l’on a de ce qu’on aime? Ah! cruel, quel mauvais moyen tu as pris pour rendre la paix à mon pauvre cœur et pour lui persuader que des enfantillages peuvent inspirer l’accent des sentiments les plus tendres et les plus profonds! Un peu de sincérité coûte donc trop à ton sexe!
[p. 191] «Laissons ces douleurs que tu ne veux pas seulement adoucir. Crois, mon Mail, que l’espoir toujours renaissant, bien malgré moi, de lire enfin dans ton âme est la seule cause du vœu inutile et certainement importun que je t’exprime trop souvent à cet égard. Je t’aime bien plus pour ton bonheur que tu ne crois, et si je n’étais persuadée que ton cœur et ta vie absolument à moi seraient bien plus complètement au travail et à cette gloire que ton imagination rêve si souvent et dont tu as tous les moyens, sois sûr que par une justice rigoureuse sur moi-même, comme par une résignation facile à l’amour, je subirais sans murmure les pertes que j’ai faites et les privations de ta présence avec tous les risques qu’elles font courir à mon bonheur.
«Je ferme les yeux de ce côté pour te dire que nos prairies verdissent, que nos arbustes de la Maisonnette promettent bien des fleurs, que l’air est plein de ces parfums légers du printemps qui portent dans l’âme l’attendrissement et la sérénité. Où es-tu, mon cher bonheur, et pourquoi ne respirai-je pas à côté de toi toutes ces impressions délicieuses de la nature renaissante? Puisse, du moins, cette lettre arriver dans un moment où tu les regrettes et surtout où la fatigue d’autres impressions ne soit pas la seule cause qui te les fasse [p. 192] regretter! Il est si différent de goûter les plaisirs vrais par ce que d’autres ont épuisé et étourdi! Cher Mail, penses-tu un peu à moi dans ces rues, dans ces salons, dans ces jeux, dans ces spectacles? Va, si jamais était là un être plus capable que moi de faire ton bonheur, estime-moi assez pour me le dire. Mais s’il n’y a là que le bruit, que de l’étourdissement, reviens, reviens tout à fait à celle qui t’adore et qui t’aime trop pour pouvoir te l’exprimer!»
Sophie avait comme le pressentiment de la nouvelle douleur qui la menaçait. Pendant ce voyage, en effet, Mailla-Garat avait fait la connaissance de Mme de Coigny, et il s’était laissé prendre aux charmes de celle qu’André Chénier avait immortalisée sous le nom de la Jeune Captive.
Ce fut pour Mme de Condorcet une cruelle rupture; mais elle avait l’âme trop haute pour récriminer et, de la Ferrière, où elle avait été passer quelques jours chez son frère, le général, elle écrivait à l’infidèle ce touchant billet:
«... Mon tendre ami, tu me garderas la petite part que la tendresse peut avoir à côté de l’amour. Puisses-tu être heureux! Ménage ta santé et conserve quelques forces pour le travail sans lequel je suis persuadée que tu ne seras jamais heureux. Adieu, je te presse contre mon cœur. Le tien peut [p. 193] se reposer sur l’idée de ne jamais perdre une amie.»
Enfin, le 30 fructidor 1800, dans une lettre scellée de son cachet ordinaire, qui portait ces mots La Vérité, elle s’exprimait ainsi:
«... Cher Mailla, tu me fais sur mon silence envers Mme de Coigny des reproches inouïs. Mon cœur est vis-à-vis d’elle au-dessus des faiblesses ordinaires, et certes, s’il n’y était pas, je ne t’aurais pas averti qu’un acquéreur se présentait pour la maison que tu désirais qu’elle habite; mais, si ces faiblesses ordinaires à presque toutes les femmes dans ma situation étaient dans mon cœur et dans ma conduite, devrais-tu les traiter avec cette sèche rigueur? Tu me demandes de t’écrire un mot chaque jour. Cher ami, c’est pour ne pas faire passer les impressions qui accablent ma santé dans ta vie que je ne t’écris pas tous les jours et retarde la douceur de te voir. Ingrat! L’amour étouffe dans ton cœur jusqu’à cette tendresse qui devait, disais-tu, être à l’abri de tout, et c’est le mien seul, que tu dépouilles successivement de tous les biens que tu lui avais donnés, qui te conserve la réalité de celui-là.»
C’est dans l’année qui avait suivi cette séparation que Mme de Condorcet avait rencontré Fauriel. Elle reprit avec lui le rêve ébauché.
[p. 194] On avait, au printemps de 1802, proposé à Fauriel de quitter la France pour aller occuper un poste diplomatique, il se hâta de refuser.
Personne ne l’en blâma et, le 9 mai, de Vitteaux, Benjamin Constant lui écrivait: «Il y a une complication de destinée qu’il est impossible de débrouiller et avec laquelle on roule en souffrant sans jamais prendre terre pour regarder autour de soi. Peut-être au reste, le bonheur est-il presque impossible, du moins à moi, puisque je ne le trouve pas auprès de la meilleure et de la plus spirituelle des femmes[198]. Je m’aperçois que le superlatif est malhonnête et je le rétracte pour l’habitante de la Maisonnette.
«Je veux cesser mes tristes exclamations et vous parler de vous qui êtes heureux et qui, au milieu des nuages de toute espèce qui couvrent notre horizon, m’offrez un point de vue consolant et doux. Oh! soignez bien cette plante rare qu’on nomme le bonheur! C’est si difficile à acquérir et c’est peut-être impossible à retrouver!»
L’hiver, à Paris, dans son appartement de la Grande Rue Verte[199], tout près de la maison de Lucien [p. 195] Bonaparte, Mme de Condorcet avait rouvert un salon plus intime que celui de l’hôtel des Monnaies ou de la rue de Lille, mais où les étrangers cependant se rencontraient avec le monde politique qui prenait son mot d’ordre au Tribunat ou à l’Institut.
C’est ainsi que Fauriel, au mois de décembre 1801, avait amené rue Verte le philologue Hase, qui allait donner à Sophie des leçons d’allemand[200]: «C’était le 18 frimaire 1801, écrit Hase à son ami Erdmann; cherche ce jour et marque-le, c’est un des plus importants dans la vie de ton ami. Car, je te l’avoue, le sens droit de cette admirable femme, sa joie des progrès tout-puissants que fait le génie de l’Humanité vers un beau but, sa connaissance des grands événements de la Révolution où elle a joué elle-même un rôle nullement insignifiant (la veille du 10 août, Condorcet, son mari, reçut chez lui quatre cents Marseillais et elle fut la reine de la fête), peut-être aussi son amabilité, toutes ces choses [p. 196] n’ont point manqué d’exercer leur influence sur moi.»
Les idéologues avaient pris, eux aussi, l’habitude de se retrouver chez Mme de Condorcet, lorsqu’elle était à Paris. Et non seulement les philosophes d’Auteuil comme Garat, Tracy, Cabanis, Volney, Le Couteulx de Canteleu, tous compris dans la première liste des sénateurs, mais encore les amis de Mme de Staël, comme Benjamin Constant, qui, dans ses voyages en France, ne manquait jamais de venir saluer la veuve du philosophe. Vers novembre 1804, Constant écrivait[201]: «J’ai rencontré à dîner Gallois et O’Connor. Celui-ci est un esprit fin, ayant dans ses plaisanteries plus de légèreté que les étrangers n’en ont d’ordinaire et par cela même ayant un peu du défaut français de plaisanter sur ses propres opinions. Plus ambitieux qu’ami de la liberté, mais ami de la liberté parce que c’est le refuge des ambitieux sans succès. Je passe la soirée chez Mme de Condorcet.»
Et, à la même époque à peu près: «Je fais visite à Mme de Condorcet chez qui je rencontre Baggesen, avec qui j’entre en conversation.»
Si les adversaires de Napoléon aimaient à se [p. 197] retrouver chez Mme de Condorcet, c’est qu’elle était restée fidèle aux opinions politiques de son mari. Le Premier Consul l’ignorait si peu que, lors de la publication du Parallèle entre César, Cromwell et Bonaparte, ayant eu au conseil d’Etat une discussion avec l’amiral Truguet, vieux républicain, Napoléon conclut ainsi: «Tout cela est bon à dire chez Mme de Condorcet ou chez Mailla-Garat[202].»
Sophie, quand elle voyait ses amis, effrayés et découragés, cherchait à les consoler, et c’est ainsi qu’elle écrivait à l’un d’eux[203]:
«... Je désire vivement que tes nouvelles ne soient pas, comme ta dernière lettre, une suite d’impressions aussi extrêmes que douloureuses; car, quand il serait vrai que la chose publique irait aussi mal, c’est se mettre dans une mauvaise disposition pour la défendre que de se laisser aller à tant de lamentations, à tant d’abattement et surtout à l’idée absurde qu’un revers de la liberté en France anéantirait toute liberté sur notre globe...
«... Adieu, mon Mail; tu m’as attristée par-dessus la tristesse de l’absence. Je t’embrasse de toute mon âme.»
Les Idéologues, cependant, avaient approuvé le [p. 198] 18 brumaire; quelques-uns, comme Cabanis, y avaient pris une part considérable. Tous avaient accepté des places au Sénat, au Tribunat ou au Conseil d’Etat; La Fayette, d’ailleurs, sans rien vouloir pour lui-même, y avait poussé les héritiers de la Gironde[204].
Mais, ces amis incorrigibles de la liberté n’avaient pas tardé à s’apercevoir du sort réservé à leur idole; et ils n’avaient pas été plutôt installés dans leurs nouvelles fonctions qu’ils avaient commencé à conspirer.
Bonaparte, il est vrai, n’était pas homme à rester inactif en face d’eux. Avec la promptitude du génie, il vit aussitôt quels étaient les plus dangereux de ses adversaires et, comme à l’armée, il frappa promptement et au bon endroit.
Un jour, il s’écria devant ses intimes[205]: «Ils sont douze ou quinze métaphysiciens bons à jeter à l’eau; c’est une vermine que j’ai sur mes habits; mais je ne me laisserai pas traiter comme Louis XVI. Ils [p. 199] sont comme de petits chiens qui attaquent la citadelle de Strasbourg. Il n’est pas nécessaire d’avoir cent hommes pour discuter des lois faites par trente.»
Le lendemain, vingt tribuns étaient éliminés; ils se nommaient Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Andrieux, Daunou, Ginguené, Desrenaudes, Laromiguière, le moins bruyant des tribuns, Chénier, qui l’était le plus, Parent-Réal, Mailla-Garat[206], Isnard, «tous les restes encore vivaces des pouvoirs civils[207]». «Les autres, dit Thiers, moins connus, gens de lettres ou d’affaires, anciens conventionnels, anciens prêtres, n’avaient eu d’autre titre pour entrer au Tribunat que l’amitié de Sieyès et de son parti. Le même titre les en fit sortir.»
La classe des sciences morales et politiques à l’Institut, autre refuge de l’idéologie, était supprimée par prétérition lors de la réorganisation du 24 janvier 1803; ses anciens membres furent dispersés dans les autres classes.
La mutilation du Tribunat et la suppression de [p. 200] la classe des sciences morales eurent leur contre-coup au Luxembourg et se traduisirent par la fameuse conspiration de 1802, appelée aussi complot du Sénat.
Sous le Directoire, Garat, Cabanis, Tracy, Thurot, Gallois, Jacquemont, Le Breton, Laromiguière, Chénier, Andrieux, Ginguené, Benjamin Constant et Daunou se réunissaient, le tridi de chaque décade, chez un restaurateur de la rue du Bac sous prétexte d’y dîner; mais en réalité, pour y parler politique et philosophie[208]. Ces réunions s’étaient continuées pendant le Consulat. Naturellement, on y épargnait peu le Premier Consul. Jacquemont, parent de La Fayette, avait été éliminé du Tribunat, en même temps que Daunou, Ginguené, Chénier, etc. Il était chef du bureau des sciences au ministère de l’Intérieur et connaissait intimement Moreau, Pichegru et les chefs du parti royaliste. Daunou était souvent appelé au ministère sous prétexte d’affaires, mais, en réalité, pour s’entretenir du complot dont le but était le renversement de Bonaparte[209]. Bernadotte en était l’âme; Mmes de Staël et Récamier s’y trouvaient naturellement mêlées.
[p. 201] Cabanis et Tracy furent-ils gagnés à cette cause qui était celle des Bourbons? On l’a dit, sans en fournir aucune preuve. Fauriel, dans les Derniers jours du Consulat[210], prétend que Fouché, aidé par ce triste intrigant qui s’appelait Méhée de la Touche, eut l’idée de compromettre, dans la conspiration de Moreau, les quelques membres du Sénat qui s’étaient fait remarquer par leur opposition au Premier Consul. Mais aucun ne prêta l’oreille aux insinuations du ministre de la Police: «Soit qu’ils eussent, ajoute Fauriel, des informations qui les fissent se tenir en garde, soit qu’ils fussent résolus à s’abstenir de toute détermination qui eût exigé de leur part du dévouement et du courage, ils écartèrent les émissaires de Fouché et restèrent paisibles.» Fauriel, qui n’avait pas destiné ces pages à la publicité, parlait de ses meilleurs amis avec un ton qui montre bien quelle était la fausseté instinctive de son caractère; mais, du moins, en découvrant le rôle provocateur de Fouché, dont il fut l’ami et le secrétaire, il se garde d’avouer la culpabilité des sénateurs. Que Ginguené et Daunou soient entrés dans la conjuration, que Volney, dont le dévouement aux Bourbons est hors de doute, [p. 202] y ait trempé aussi, que Garat, qui l’a avoué[211], ait pris part au complot, la chose est certaine. Mais les sentiments républicains de Cabanis et de Tracy auraient dû suffire à les protéger contre cette imputation calomnieuse.
Quoi qu’il en soit, Fouché fit savoir que le complot était découvert; à partir de ce jour, les dîners du Tridi cessèrent et les Idéologues ne se virent plus que chez Cabanis ou chez Mme de Condorcet, tandis que les royalistes que Daunou accompagnait[212] retournèrent chez Mathieu de Montmorency et chez Mme de Staël.
C’est qu’en effet les deux oppositions ne se ressemblaient guère, ni dans leur personnel, ni dans leurs moyens d’action, ni dans le but poursuivi.
Celle qui se groupait autour de Mme de Staël était plutôt internationale et royaliste; on le vit bien en [p. 203] 1814. Elle comptait, dans ses rangs, des préfets comme MM. de Barante, de Castellane et Rougier de la Bergerie.
L’autre, celle qui avait son centre chez Mme de Condorcet, était composée des débris vaincus de la Révolution, elle était philosophique, mais purement française. On y voyait d’anciens conventionnels, comme Riouffe[213] ou comme Jean Debry, préfet du Jura, qui ne se servait de son influence que pour protéger des littérateurs comme Charles Nodier ou pour placer des amis de Sophie et de Mme Vernet. «Au souvenir des derniers jours de M. de Condorcet se trouve tellement joint le vôtre, lui écrivait en 1811[214] Mme de Condorcet, que je viens vous recommander un ami de Mme Vernet, Emeric. Pourriez-vous le placer dans votre département ou le recommander à Quinette.»
Quant à Gérando, il avait traversé le monde d’Auteuil; il s’y était heurté aux idées antireligieuses [p. 204] des Idéologues et, voulant rester dans l’opposition était passé dans le camp de Mme de Staël.
En dehors de ces hommes politiques, Mme de Condorcet et Fauriel recevaient encore des amis de Cabanis, médecins comme lui, quelques-uns savants distingués, tous gens d’esprit et littérateurs qui savaient causer et plaire, quel que fût leur auditoire.
Ils se nommaient Pinel, Boyer, Alibert, Richerand, Roussel et avaient pour interprète le plus éloquent, après Cabanis, cet excellent Pariset qui, en 1803, dans une lettre à Fauriel, traçait la ligne de conduite à suivre dans les circonstances que l’on traversait[215]. Il y parlait de cette doctrine secrète qu’il faut réserver pour soi et pour le petit nombre, viatique nécessaire qui aide à passer la vie sans jamais sacrifier l’honneur ni la vérité.
La dernière intervention des amis de Mme de Condorcet, dans le domaine de la politique active, s’exerça au moment du procès de Moreau[216]; quelques jours après, l’Empire était proclamé.
Mais la veuve du philosophe était trop intelligente pour se contenter d’une opposition stérile et bavarde; elle n’y donnait pour ainsi dire que ses [p. 205] loisirs et consacrait la plus importante partie de sa vie à la lecture et aux travaux de l’esprit.
C’était l’époque où Cabanis publiait son livre sur les Rapports du physique et du moral de l’homme. Il y travaillait, depuis plusieurs années, sous les yeux bienveillants, mais attentifs de sa belle-sœur. Cet ouvrage eut un immense succès. Benjamin Constant en disait à Fauriel[217]: «Je lis, autant que mon impuissance de méditation me le permet, le livre de Cabanis et j’en suis enchanté. Il y a une netteté dans les idées, une clarté dans les expressions, une fierté contenue dans le style, un calme dans la marche de l’ouvrage qui en font, selon moi, une des plus belles productions du siècle. Le fond du système a toujours été ce qui m’a paru le plus probable, mais j’avoue que je n’ai pas une grande envie que cela me soit démontré. J’ai besoin d’en appeler à l’avenir contre le présent et surtout à une époque où toutes les pensées qui sont recueillies dans les têtes éclairées n’osent en sortir, je répugne à croire que le monde étant brisé tout ce qu’il contient serait détruit. Je pense avec Cabanis qu’on ne peut rien faire des idées de ce genre comme institutions. Je ne les crois pas même nécessaires à la morale. Je suis convaincu que ceux qui s’en [p. 206] servent sont le plus souvent des fourbes et que ceux qui ne sont pas des fourbes jouent le jeu de ces derniers et préparent leur triomphe. Mais il y a une partie mystérieuse de la nature que j’aime à conserver comme le domaine de mes conjectures, de mes espérances et même de mes imprécations contre quelques hommes.»
Le livre souleva des tempêtes. Mais, dans tous les camps, on se plut à reconnaître l’élégance du style, l’imagination riche et féconde, la raison supérieure qui faisaient de Cabanis le premier des écrivains de son époque.
A cette date de 1802, on trouve dans les papiers de Mme de Condorcet[218] quelques pensées détachées qui rappellent bien l’auteur des Lettres sur la Sympathie.
«Le génie et la naïveté parlent la même langue,» disait-elle.
Ou bien:
«Les véritables auteurs sont ceux qu’on peut méditer. Fort loin de là, il en est beaucoup aujourd’hui qu’on ne peut que chercher à comprendre.»
Et encore, cette règle de conduite:
«N’avoir d’autre caractère que son âme.»
[p. 207] Cette habitude d’écrire ainsi ses pensées était devenue pour bien des jeunes filles et des jeunes femmes, une mode à laquelle elles sacrifiaient. Témoin Mlle de Meulan, et aussi Eulalie Roucher, mariée depuis quelques années, avec un collègue de Fauriel dans les bureaux de Fouché[219]. Mme de Condorcet avait connu Eulalie à Villette et à Auteuil; plus âgée qu’elle de dix ans, elle s’était souvent occupée de la fille du poète avec cette délicatesse qui est, dans la première jeunesse, comme le prélude de ce sentiment qui sera un jour l’amour maternel. Jeunes femmes, toutes deux s’étaient retrouvées au cours de botanique de Desfontaines et aux excursions dans la campagne de Gentilly.
Eulalie qui, à seize ans, parlait et écrivait l’italien, l’anglais et le latin, avec une pureté qui émerveillait les amis de son père[220], était digne par l’esprit comme par le cœur de Mme de Condorcet; l’ancienne amitié avait bien vite reconquis tous ses droits, et Eulalie était reçue à Auteuil ou à la Maisonnette, comme la meilleure et la plus aimée des compagnes.
Cabanis avait envoyé à Eulalie un exemplaire de son livre, et comme celle-ci l’en avait remercié en [p. 208] rappelant l’ancienne liaison de Roucher et de Cabanis, le médecin-philosophe lui répondait[221]:
«Oui, Madame, le souvenir de votre père me sera toujours cher! Ses grands talents, ses malheurs, l’amitié dont il m’avait honoré autrefois, me feront toujours prendre un vif intérêt à tout ce qui lui a appartenu et je n’oublierai jamais les années de votre enfance où j’ai eu l’avantage d’observer les premières lueurs de cet esprit si distingué que vous avez déployé depuis. Votre suffrage, madame, et celui de vos amis, est une digne récompense de travaux entrepris pour éclairer les hommes.»
Dans ces charmantes réunions de deux femmes si bien faites pour se comprendre, Eulalie avait soumis à son amie quelques-unes de ses pensées et Mme de Condorcet s’en était montrée enchantée. C’est que, sous bien des rapports, leur destinée, d’abord heureuse, puis traversée par d’affreux malheurs, se ressemblait.
Il y avait quelque chose des désillusions que toutes deux avaient éprouvées dans cette pensée d’Eulalie[222]:
[p. 209] «L’âme, après de longs chagrins ou de grandes passions ressemble à un vase rempli d’une eau trouble. Parvient-on à l’éclaircir, il faut bien prendre garde de la remuer et de l’agiter encore. Le bonheur de notre vie peut dépendre de cette précaution.»
Et comme ici on reconnaît bien la jeune femme, élevée, avec Sophie, à l’école du XVIIIe siècle:
«La mémoire du cœur est assurément la moins périssable puisqu’elle s’exerce par nos sensations. Une odeur, un souffle, un aspect ramènent la vivacité des événements passés avec une force inconcevable qui ne pouvait se retrouver que là et peut-être une seule fois dans la vie. C’était le dépôt de ce souvenir.»
Mais il ne faudrait pas croire que les soucis de la politique ou les spéculations plus hautes de la pensée aient détourné Sophie de ce qu’elle regardait, [p. 210] dans le fond de son âme, comme le plus doux et le plus précieux des devoirs.
Jamais Mme de Condorcet n’avait quitté sa fille, ni confié à personne le soin de son éducation. Après avoir assuré le sort matériel d’Elisa, elle n’avait plus eu qu’un seul but: élever Mlle de Condorcet de manière à la rendre digne de son nom et telle que son père l’aurait voulu voir s’il avait vécu.
Depuis longtemps, elle connaissait et recevait chez elle un Irlandais réfugié en France, le général O’Connor. C’était un des meilleurs amis de Cabanis, estimé de tous ceux qui le connaissaient[223]; il avait mis son épée à la disposition de la France et de l’Empereur, croyant par là servir la liberté. A la fin de 1804, il commandait une division à l’armée de Brest où Cabanis lui écrivait[224]:
«On croit ici, généralement, que l’expédition va partir et que vous allez, enfin, en Irlande.
«Vous savez combien j’ai à cœur le succès de cette entreprise, indépendamment de la gloire des armées françaises dont il est bien naturel que je sois très jaloux. Combien n’ai-je pas besoin de vous voir mettre à fin le noble plan de liberté de [p. 211] votre pays auquel vous avez consacré toute votre vie et toutes vos facultés!...
«Adieu, mon excellent et digne ami, ma femme et tous nos amis communs vous font mille tendres compliments et quant à moi vous savez que je vous suis dévoué pour toujours, c’est-à-dire pour la vie.»
En 1807, rentré à Paris et ayant définitivement quitté l’armée, O’Connor demanda et obtint la main de Mlle de Condorcet. Le mariage eut lieu au mois de juillet. Elisa n’avait que dix-sept ans; mais la maturité précoce de son esprit la rapprochait de l’homme distingué qu’elle allait épouser. Sa physionomie et ses allures évoquaient invinciblement le souvenir de son père; elle était dans toute la fraîcheur de la jeunesse, mais rien dans sa personne et dans sa figure un peu masculine ne rappelait l’admirable beauté de Mme de Condorcet[225].
[p. 212] Le jeune ménage s’établit d’abord à Auteuil dans l’ancienne maison de Mme Helvétius; mais, il ne tarda pas à quitter le village et partagea désormais son temps entre la Maisonnette, Villette et les propriétés du général.
Par une véritable et cruelle fatalité, jamais un événement heureux ne se produisit dans la vie de Mme de Condorcet sans qu’il fût presque aussitôt suivi d’une revanche du sort.
Depuis longtemps, la faible santé de Cabanis préoccupait les siens. Lui-même savait que les heures lui étaient comptées; aussi se hâtait-il d’écrire à Fauriel cette Lettre sur les causes premières, qu’il ne voulait plus retarder, disait-il à Ginguené[226] «parce qu’il sentait qu’il n’avait plus un moment à perdre».
Cette dernière œuvre marquait un retour sensible aux doctrines spiritualistes; Cabanis y admettait «dans les forces actives de l’Univers une [p. 213] intelligence et une volonté»; il parlait d’un «ordonnateur suprême» et prêchait, avec Platon, la confiance dans la mort «qui ne peut rien apporter que d’heureux». Les stoïciens avaient en lui un adversaire respectueux, mais convaincu; nul philosophe n’a mieux que lui mis en lumière les contradictions de leur cœur et de leur esprit: «Si la douleur n’était point un mal, disait-il, elle ne le serait pas plus pour les autres que pour nous-mêmes. Nous devrions la compter pour rien dans eux comme dans nous... O Caton! Pourquoi te vois-je quitter ta monture, y placer ton familier malade et poursuivre à pied, sous le soleil ardent de la Sicile, une route longue et montueuse? O Brutus! pourquoi, dans les rigueurs d’une nuit glaciale, sous la toile d’une tente mal fermée, dépouilles-tu le manteau qui te garantit à peine du froid pour couvrir ton esclave frissonnant de la fièvre à tes côtés? Ames sublimes et adorables, vos vertus elles-mêmes démentent ces opinions exagérées, contraires à la nature, à cet ordre éternel que vous avez toujours regardé comme la source de toutes les idées saines, comme l’oracle de l’homme sage et vertueux, le guide sûr de toutes nos actions.»
Le mercredi, 22 avril 1807, Cabanis se promenait dans son jardin d’Auteuil, avec Richerand, [p. 214] lorsqu’il fut pris subitement d’une congestion cérébrale. Il ne tarda pas à reprendre connaissance; mais il fallait quitter, au plus vite, le voisinage de Paris et, après un court séjour à la Maisonnette, puis à Villette, il alla se fixer tout près de là, à Rueil, sur le territoire de la commune de Seraincourt[227]. Restant ainsi dans le centre de ses affections et auprès des pauvres qu’il aimait et qu’il connaissait tous, il put encore faire quelques sorties. Cependant, il dépérissait et s’entretenait de sa fin avec une parfaite sérénité, répétant cette sentence d’Hoffmann que «l’apoplexie nerveuse est la récompense accordée par la nature aux longs travaux de l’esprit».
Au mois de novembre 1807, Ginguené se rendit à Rueil pour y passer quelques jours auprès de son ami. Il a raconté, lui-même, dans son journal intime[228], cette visite:
«Cabanis était hors d’état de travailler. Obligé de vivre de régime, il y mettait surtout son esprit; c’est ce qu’il y a de plus pénible pour quelqu’un qui fait un si grand et un si bon usage du sien... Je [p. 215] trouvai Cabanis mieux que je ne m’y attendais, mangeant de bon appétit, dormant paisiblement, chassant tous les jours pendant quelques heures, causant comme à son ordinaire, pourvu que la conversation ne devînt pas trop animée, ce que ses amis avaient soin d’éviter; mais ne pouvant écrire même une lettre, sans fatigue et sans étourdissements. Sa femme était un ange de vigilance, de patience et de tendresse; son neveu Georges Montagu en était un autre. La petite Annette mettait, au milieu de ce tableau, du mouvement et de la gaieté: Aminthe était à Paris, en pension. Mme de Condorcet et Fauriel étaient à la Maisonnette, près Meulan. Rueil est à une lieue dans les terres. Ils y venaient souvent. Cela formait une société pleine d’intérêt et de charme, dont Cabanis était l’âme, tout malade qu’il était. Je fus reçu à bras ouverts et m’établis là pour six jours, comme si c’eût été pour la vie. Ils passèrent bien rapidement. Le matin, levé de bonne heure, je travaillais jusqu’au déjeuner. La causerie, la promenade et une ou deux heures de travail remplissaient le reste de la matinée; le soir, on me faisait lire des fables et elles reçurent des approbations et des encouragements bien faits pour me donner quelque confiance.
«Je quittai Rueil avec beaucoup de regret et de [p. 216] tristesse. Je sentis un grand serrement de cœur en embrassant mon cher Cabanis. Je l’embrassais pour la dernière fois. J’allai coucher le soir à la Maisonnette pour partir de Meulan le lendemain matin de bonne heure. Je revins avec la bonne Mme Vernet, cette généreuse provençale, qui s’est immortalisée en donnant, pendant plusieurs mois, l’hospitalité au malheureux Condorcet. Je l’avais trouvée à la Maisonnette. Mme de Condorcet continue de lui témoigner toute la reconnaissance et tous les égards qu’elle mérite. Elle était avec son triste visage qui ne la quitte point. Je la reconduisis chez elle en voiture, rue des Fossoyeurs. Je l’ai revue quelquefois depuis avec plaisir. C’est tout le feu, toute la franchise et toute la cordialité provençales.»
Au printemps de 1808, un nouveau mieux se produisit; Cabanis se reprit à la vie et écrivit ou plutôt dicta, le 22 février, cette lettre touchante pour son ami Ginguené[229]:
«Qu’il y a de temps, mon cher et excellent ami, que nous n’avons reçu de vos nouvelles et que nous avons de reproches à nous faire d’avoir pu être si longtemps sans vous en demander, ainsi que de celles de Mme Ginguené, que nous comprenons [p. 217] toujours sous ce mot vous. Nous avons su que vous aviez été incommodé, mais nous espérons que cela n’est rien. Les articles que vous mettez dans le Mercure sont d’un homme bien portant, et vous paraissez d’autant plus vigoureux que d’autres morceaux, placés à côté, ont des caractères maladifs assez remarquables. Dites-nous pourtant au vrai ce qu’il en est.
«Voilà de bien beaux jours; quoique froids encore, ils annoncent déjà le printemps, et cette annonce m’est doublement et triplement précieuse, en ce qu’elle nous donne l’espoir prochain de vous revoir à Rueil. Vous nous l’avez promis, et vous n’êtes pas homme à ne pas tenir votre promesse. Commencez donc, je vous prie, à faire sur cela vos projets et vos calculs d’amitié; tous nos vœux seraient remplis, si Mme Ginguené voulait bien être de moitié dans cette partie.
«Je compte, d’ici à peu de temps, faire une petite course à Auteuil, et vous devez être bien sûr que je n’oublierai pas la rue du Cherche-Midi, et surtout les excellents amis qui l’habitent. Mais cette course sera extrêmement courte et elle ne sera que pour mes amis les plus intimes; car je me trouve trop bien du séjour de la campagne pour ne pas vouloir en compléter les effets; je reviendrai aussitôt retrouver notre bon air et nos eaux parfaites. [p. 218] Si vous étiez homme à me suivre, vous seriez bien aimable.
«Mme de Condorcet et Fauriel viennent de passer avec nous une partie assez considérable de l’hiver; ils nous l’ont rendu extrêmement agréable. Mme de Condorcet a pourtant été et elle est encore assez incommodée d’une bouffée rhumatismale qui s’est terminée par une éruption très démangeante. Nous avons parlé bien souvent de vous ainsi que de Mme Ginguené. Vos charmantes fables et l’espoir de les voir bientôt publiées ont été plus d’une fois le sujet de ces entretiens...
«Je ne vous dis pas, mon bon ami, tout ce que ma femme me charge de vous dire. Sachez uniquement que tout Rueil vous est dévoué de cœur, moi en particulier qui vous aime, comme je vous estime, c’est-à-dire du fond de mon âme. Parlez de nous, je vous en prie, à Mme Ginguené. Dites pour moi un mot d’amitié à Garat. Adieu, mon cher et bon ami, je suis tout à vous pour la vie et par delà, s’il y a un par-delà.»
Le 5 mai, après une promenade avec sa femme, Cabanis se mit tranquillement au lit, dormit quelques heures et fut saisi, vers minuit, d’une nouvelle attaque qui l’emporta, malgré les secours les plus prompts.
Une cérémonie religieuse eut lieu à Auteuil, [p. 219] le 14 mai, puis le corps du grand médecin fut transporté au Panthéon, en présence des députations du Sénat, de l’Institut et de l’Ecole de médecine. Les pompes de la douleur officielle ne furent rien à côté du chagrin de sa famille, de ses amis et des pauvres d’Auteuil et de Villette, qui le pleurèrent comme un père tendrement aimé.
Le cœur de Cabanis manque sous les tristes voûtes du Panthéon; il repose à Auteuil, dans un coin de verdure, auprès du corps de Mme Cabanis et tout à côté des restes de Mme Helvétius.
Après cette mort, les dernières années silencieuses de l’Empire ne furent guère marquées pour Mme de Condorcet que par les visites, rares mais choisies, qu’elle recevait à la Maisonnette.
Tantôt, c’était Manzoni qui venait avec sa mère, fille de Beccaria, passer plusieurs étés chez la veuve du philosophe. Alors, dans les promenades sur la terrasse ou le long du coteau de Sainte-Avoie, Manzoni célébrait devant ses hôtes les immortelles beautés de la poésie et de l’art, ou bien, il leur déclamait, avant de les écrire, ses beaux vers sur la mort d’Imbonati. Il y avait cependant un terrain où le poète ne pouvait pas s’entendre avec ses amis; c’était quand la conversation tombait sur le [p. 220] maître de l’Europe pour lequel Manzoni n’avait pas assez d’admiration[230].
Après son mariage, en 1808, il vint revoir la Maisonnette et demanda à Fauriel d’être le parrain de son premier enfant[231].
Tantôt, Fauriel introduisait chez son amie Baggesen, ce Danois à l’esprit si original, au cœur toujours inquiet des moindres choses de la vie. L’auteur de la Parthénéide s’était logé près de Marly et il avait baptisé son habitation du nom de Violette; les lettres de ses correspondants ne lui parvenaient pas et il s’en plaignait à Fauriel:
«Le nom de Violette n’y fait rien; c’est Marly-la-Machine qui décide, qui depuis longtemps ne s’appelle plus Marly-le-Roi et qui n’est pas encore appelé Marly-l’Empereur. Continuez toutefois d’omettre la Violette pour l’avenir; ce n’était naturellement qu’un badinage de ma part de vous donner cette adresse, une mauvaise plaisanterie, si vous voulez, en pensant à Villette, d’où je m’imaginais que vous pourriez, de temps en temps, dater [p. 221] vos lettres... Pour ce qui regarde ma Violette, j’y renonce dès à présent dans tous les actes publics, mais rien au monde ne m’y fera renoncer dans les cas privés. Je dirai là-dessus comme disait certain évêque: «En public, Madame, vous serez obligée de m’appeler Monsieur, mais, en particulier, vous pouvez m’appeler Monseigneur.» N’ai-je pas fait planter une quantité innombrable de violettes au pied de la butte que je viens de faire moi-même dans le jardin, uniquement pour justifier ce nom? Et n’ai-je pas daté toutes les lettres que j’ai écrites depuis un mois de Violette par cette même raison? Il est vrai que, jusqu’à présent, il n’y a que vous, Mme de Condorcet, ma femme et moi qui sachions ce nom; mais mes trois fils grandissent et le sauront un jour, mon meilleur ami M... le saura et puis la postérité. C’est tout ce qu’il me faut. Les violettes craignent le grand jour; c’est au sein de l’amour, de l’amitié et de la poésie qu’elles se cachent.»
Une autre fois, c’était Guizot qui venait à la Maisonnette pour y travailler sans distractions et qui, à chacun de ses voyages, apportait avec lui six ou sept cents volumes[232].
Puis, Sismondi qu’une communauté de goûts [p. 222] et d’études amenait en 1813 chez Fauriel et chez Guizot.
Enfin, un autre commensal, Benjamin Constant venait à la Maisonnette à chacun de ses voyages en France; c’était l’une des plus vieilles relations de Mme de Condorcet; il avait suivi auprès d’elle les cours du Lycée, fréquenté chez Suard et chez Mme Necker et conspiré avec Bernadotte, dans les environs du 18 brumaire.
En 1806, Mme de Staël était à Acosta, chez les Castellane; elle terminait Corinne et cherchait à régler des affaires d’intérêt assez embrouillées. Elle appela auprès d’elle pour l’y aider Fauriel et Benjamin; le premier arriva de la Maisonnette qui était toute proche: on se rappela les entretiens d’autrefois, mais le charme était rompu et la séparation fut sans amertume. Le second avait traversé toute la France; un orage de cœur éclata et l’ancien ami de Mme de Staël ne trouva autre chose à faire que de se sauver. Rentré à Paris, il écrivait[233]: «Je passe une soirée très douce chez Mme de Condorcet avec Cabanis et Fauriel.»
En 1809, Sophie vint passer quelques jours à Paris. Elle quittait rarement Fauriel; les deux [p. 223] lettres qu’elle lui écrivit dans cette circonstance méritent donc d’être données[234]:
«Je suis arrivée ici accompagnée par le soleil et j’y ai trouvé le feu bien établi en bas et dans ma chambre. Du reste, des soins simples pour moi qui m’y laissent presque aussi libre que si j’étais seule. Ma belle-sœur venait de recevoir une lettre de mon frère (le général de Grouchy) d’Als, du 19; Alphonse (fils du général), pris par Châtelet, s’est échappé au bout de dix jours et a rejoint le général Zusca qui l’a envoyé à l’Empereur lui rendre compte de l’Etat du Tyrol. L’Empereur l’a bien reçu et lui a dit qu’il n’avait pas son père avec lui parce qu’il se confiait plus à lui qu’à personne pour mener sa cavalerie et qu’il n’en savait pas moins qu’il avait pris un bidet de poste pour arriver à temps à la bataille de Piave, etc., etc... Mon frère ajoute: «On s’occupe à prendre Raab, place fortifiée qui nécessiterait des pièces de siège dont nous manquons. Les affaires avancent peu. La sanglante et glorieuse bataille du 14 n’a pas eu autant de résultats qu’il eût été à désirer. Enfin, ce n’est que dans un avenir terriblement éloigné qu’on peut entrevoir la fin de cette guerre, à moins que les Russes n’y prennent une part active.»
[p. 224] «J’ai trouvé le cabinet occupé par de la musique et du dessin, le tout assez passable pour me mettre en train, si j’avais la force de l’être. L’air d’ici me semble bon, mais un affreux bouillon m’a fait passer une affreuse nuit.
«Adieu. Désirer de te voir vient si fort après désirer qu’il ne te coûte pas un moment de gêne que je te répète: Ne viens pas. Mille choses à nos amis.»
Et une autre fois:
«Bon sommeil et néanmoins douleurs cruelles pour quatre lignes. J’ai envoyé les clefs hier. A jeudi, Nâfsi[235], et n’oublie pas de faire envoyer une paire de draps bons jeudi...—P.-S. Salut, douce retraite, parfum des fleurs, aimables ombrages, paix pour le travail et tout ce dont il double le charme.»
Paris, on le voit, ne lui faisait pas oublier la maison bénie où, dans l’amour et l’étude, elle avait presque retrouvé le calme heureux de son enfance.
L’affaire Malet, en 1812, fut un premier coup de tonnerre dans le ciel, déjà chargé d’orage, de l’Empire. Napoléon, dans un discours fameux, reprocha aux amis de Mme de Condorcet une conspiration [p. 225] à laquelle ils n’avaient certainement pas pris part[236].
Ils n’en restèrent pas moins patriotes et français au moment des désastres. Mais la Restauration ne leur en sut aucun gré. Les restes déjà décimés des Idéologues furent les premières victimes des Bourbons; on les chassa de l’Institut, de l’Université[237]; tous ceux qui tenaient une plume indépendante furent condamnés à l’exil.
Eulalie se rendit chez le préfet de police Anglès pour demander la grâce de son mari qui subvenait aux besoins de cinq enfants en bas âge et comme le fonctionnaire lui répondait: «Pas de pitié pour lui, madame.»—«Oh! monsieur, s’écria la fille de Roucher, vous me faites frémir. Je crois entendre encore les assassins de mon père!»
Mme de Condorcet et sa sœur furent dénoncées, traquées par la police. On représentait Mme Cabanis comme «une jacobine déterminée qui détestait et tournait en ridicule le roi et la famille royale». On voulut la priver de la pension qu’elle touchait comme veuve de sénateur[238].
[p. 226] Mais ce fut sur le maréchal de Grouchy que retomba toute la haine du nouveau gouvernement.
La cause principale qui détermina la mise du nom de Grouchy sur la liste de proscription et de mort du 24 juillet 1815 fut sa nomination de maréchal à la suite de la capture du duc d’Angoulême[239].
Traduit, le 19 octobre 1816, devant le premier conseil de guerre de la première division militaire, sous l’inculpation de trahison, crime qui entraînait la mort, Grouchy, en fuite, fut déclaré contumace. On procéda néanmoins au jugement. A l’audience assistaient Mme de Grouchy, le colonel et le vicomte de Grouchy, ses deux fils, Mme la marquise de Condorcet, sa sœur.
Le colonel défendit son père en ces termes[240]:
«A qui fera-t-on croire que, pour prétendre à [p. 227] cette récompense (le grade de maréchal de France), il eut besoin de nouveaux titres, celui qui, maréchal de camp en 1792, lieutenant général en 1793, général en chef en 1795, a, pendant vingt-cinq ans, commandé des divisions, des corps d’armée et, dans quelques campagnes, l’arme entière de la cavalerie; celui qui s’est trouvé à soixante batailles, à plus de cent combats où la victoire fut, dans presque tous, arrosée de son sang; celui qui disait au chef du gouvernement, fatigué de ses réclamations en faveur des émigrés: «Je ne vous ai pas encore demandé autant de radiations que j’ai reçu de blessures pour la patrie et vous me faites souvenir que j’en compte vingt et une.»
«Quand mon père gémit sous le poids d’une accusation terrible, interdirait-on à la piété filiale de lui rendre une justice que lui rendra l’équitable postérité? Elle dira de lui, messieurs, qu’étranger à toute faction, uniquement dévoué à sa patrie, la seule prérogative qu’il réclama jamais fut celle de se présenter le premier sur tous les champs de bataille et qu’au milieu des souvenirs honorables qu’il emporte dans son exil, le plus cher à son cœur fut d’avoir ramené des bords de la Dyle, à travers 200.000 ennemis, 40.000 Français invaincus jusque sous les murs de la capitale.»
Après ces paroles, il fut donné lecture d’une [p. 228] consultation que Mme de Condorcet avait obtenue de MM. Chaix d’Est-Ange, Delavigne, Billecocq et Tripier et qui concluait à l’incompétence du conseil de guerre, le maréchal de Grouchy, en sa qualité de colonel général des chasseurs, étant devenu grand-officier d’Empire et, dès lors, justiciable de la Chambre des Pairs.
L’incompétence fut prononcée; mais le lendemain, 20 octobre 1816, le capitaine rapporteur remplissant les fonctions de procureur du roi se pourvut devant un conseil de revision qui renvoya Grouchy devant un nouveau conseil de guerre. Celui-ci se déclara incompétent à son tour.
Dès le début de 1816, le maréchal était passé en Amérique; c’est de là qu’il donna l’ordre de vendre Villette et ses dépendances. Mais, tandis que Mme de Condorcet ne cessait de s’occuper de lui, en retour Grouchy écrivait des lettres pleines du nom de Sophie et du souvenir le plus touchant pour cette sœur dévouée[241].
A partir de 1817, Mme de Condorcet vécut très retirée et ne s’occupa plus que d’œuvres de bienfaisance et de charité. Elle ne faisait plus à la Maisonnette que de courtes apparitions et s’était établie à Paris au no 68 de la rue de Seine.
[p. 229] Les douleurs aiguës et presque continuelles d’une névralgie qui avait son siège dans la tête n’avaient atteint ni sa beauté, ni son esprit, et Firmin Didot, comme aux beaux jours du Consulat, lui offrait un volume des Bucoliques sur lequel il avait écrit ces vers[242]:
Mme de Condorcet avait eu la joie de revoir son frère le maréchal dont l’exil avait cessé. Mais un nouveau chagrin avait suivi ce court bonheur; elle en faisait part, en ces termes, à son neveu Ernest de Grouchy, alors élève à la pension Hix[243]:
«Mardi, 29 janvier 1822.
«La nuit du départ de mon frère, le feu a pris au bâtiment de la Ferrière[244], à 2 heures du matin et [p. 230] à 4 il ne restait plus que les murs. Meubles, linge, bibliothèque, papiers relatifs à ses campagnes, tout son ménage d’Amérique, tout ce qu’il avait rapporté d’effets curieux ou précieux des quatre coins de l’Europe où il a fait la guerre, ses habits, ses armes, tout a été consumé.
«Dis-le à M. Hix et prends le temps d’écrire à ce sujet à ton oncle ce que ton cœur t’inspirera, où se trouvera sûrement le regret de n’avoir aucun sacrifice à lui offrir.
«Je t’embrasse, cher enfant.»
Dans les premiers jours de septembre 1822, la maladie prit un caractère des plus graves; au milieu de ses cruelles souffrances, Mme de Condorcet ne retrouvait quelque force que pour s’entretenir des besoins et du sort futur de ceux qu’elle avait coutume de secourir, et lorsque sa langue devint embarrassée, ce furent encore les noms de ces personnes qu’elle prononça le mieux et qu’elle répéta le plus souvent.
Le 8 septembre, elle s’éteignit, après avoir demandé pour ses funérailles la plus grande simplicité.
[p. 231] Quelques jours après, Mme Ginguené écrivait sur le cahier où elle notait ses pensées[245]:
«La veuve de l’illustre Condorcet vient de mourir. Toutes les ressources de l’art le plus habile n’ont pu que prolonger de quelques moments cette existence précieuse à ceux qui l’ont connue. Mme de Condorcet fut peut-être la plus belle femme de son époque; elle fut certainement une des plus spirituelles et des meilleures de son temps. Elle eut toutes les vertus sans un seul préjugé.
«Mme de Condorcet est morte le dimanche 8 septembre. Elle demanda à être enterrée avec les pauvres et sans cérémonie religieuse. Huit ou dix parents et amis ont accompagné les restes de cette excellente femme au Père-Lachaise. Sa tombe est près l’avenue où repose mon pauvre ami[246].»
Guizot, le 12 septembre, écrivait à Fauriel[247]: [p. 232] «Mon pauvre ami, je n’ai su qu’hier soir le coup qui vous a frappé; je vous ai cherché chez vous. J’étais loin de m’attendre à ce malheur; depuis quelques jours au contraire, j’étais tranquille. Aussi, n’envoyions-nous plus, tous les matins, savoir des nouvelles... Ma femme partage tous mes sentiments et veut que je vous le répète bien. Adieu, mon pauvre ami, je vous embrasse, le cœur bien serré.»
De son côté, Emmanuel de Grouchy, de Fribourg, le 6 octobre 1822, s’adressait au même correspondant[248]:
«Quelque douloureuse que dût être notre entrevue, je la désirais vivement; quelque amères qu’eussent été les larmes que nous aurions versées ensemble, j’aurais souhaité avoir l’occasion de vous témoigner tous mes sentiments d’estime et d’affection. C’est en obéissant religieusement aux vœux constants de l’amie dont la perte est irréparable pour nous, vœux toujours partagés par vous et qui tendaient à ce que je devinsse un homme digne de ce nom que je tâcherai de vous prouver ces sentiments et qu’en même temps je mériterai [p. 233] votre intérêt que je réclame au nom et en la mémoire de notre amie. Le neveu et l’objet constant des soins de Mme de Condorcet ne saurait vous être indifférent.»
Immense fut la douleur de Mme O’Connor qui consacra à la mémoire de sa mère quelques pages touchantes.
Quant à Mme Cabanis, elle écrivait le 3 septembre 1823, à son frère Henri, que nous avons connu chevalier de Malte avant 1789[249]: «Le 8 de ce mois, il y aura un an que nous avons perdu cette chère Sophie de Condorcet; je la regrette sans cesse. Après mon mari et mes enfants, elle était ce que j’aimais le plus au monde. Elle aurait, ainsi que mon mari, bien aimé le mariage qu’Annette vient de faire...»
Faut-il ajouter, hélas! que Fauriel, qui avait dû à Sophie le bonheur et l’aisance de la vie, fut le moins affligé de tous ceux qui l’avaient connue. Son testament, en date du 19 octobre 1823[250], montre qu’il n’avait pas attendu longtemps pour se consoler. Pas un souvenir n’était laissé, pas un mot [p. 234] n’était dit pour la fille ou pour les petits-enfants de Mme de Condorcet[251].
Il semble même qu’on l’importunait en lui rappelant des souvenirs qui auraient dû lui être bien chers. Le 30 mars 1842, Mme Cabanis, qui, elle, n’oubliait pas, lui renvoyait des objets qui avaient appartenu à Sophie et lui écrivait:
«Mon ami, voici encore une restitution que je vous fais. Des livres à vous qui remplissent ce panier et d’autres livres, encore à vous, qui sont en liasse. Quoique ces envois réveillent dans votre âme des souvenirs qui ont un côté douloureux, ils y remuent aussi, j’en suis sûre, une masse de tendresse imperturbable et qui doit être profonde et douce jusqu’à votre dernier jour.»
Déjà, le 20 octobre 1838, elle lui disait: «Quelques relations avec vous m’auraient conservé quelques parcelles de ces richesses dont, autrefois, mon âme et mon esprit se sont nourris.»
L’ingratitude de Fauriel, triste exemple de la faiblesse humaine, est restée unique; elle ne peut atteindre que lui.
Le souvenir aimé de Mme de Condorcet, gardé [p. 235] comme un culte par tous ceux qui l’ont approchée, vivra au contraire.
C’est que, à l’éternelle beauté dont elle fut l’un des types les plus parfaits, elle sut joindre la douceur qui charme, l’esprit qui pénètre et la charité qui purifie.
JUSTIFICATION DE LA CONDUITE
DU MARÉCHAL DE GROUCHY EN MARS 1815[252]
Mon cher Maréchal,
J’apprends avec bien du plaisir votre nomination: elle m’est un sûr garant que le sort de chacun de nous sera le moins défavorable possible.
Jusques à ce moment, j’ai pensé qu’il ne convenait point que je fisse de démarches directes près de S. M. Maintenant, je réclame de l’attachement que vous m’avez toujours témoigné de me guider à cet égard.
Voici un exposé de ma conduite depuis le mois de mars dernier. Je vous demande instamment d’engager le Roi à y jeter les yeux: il y verra que mon expédition du Midi m’a donné l’apparence de torts qui, dans leur réalité, sont moins graves qu’on ne l’imagine. Il y verra aussi comme je me suis conduit, dans ces dernières circonstances.
[p. 238] Si on doit licencier l’armée, je ne saurais croire que S. M. laisse sans traitement celui qui, entré au service en 1779, est arrivé au premier grade militaire, sans avoir acquis d’autre fortune que son état.
Si on conserve l’armée, je vous demande de me faire confirmer dans mon grade par S. M. Les sentiments que j’ai partagés avec le reste ou, du moins, la majorité de l’armée, ne sauraient, ce me semble, me dépouiller des titres que j’ai acquis par tant de campagnes et de blessures.
Comme je présume qu’on ne m’emploiera pas, dans ces premiers moments, je me retirerai à la campagne, pendant quelques mois. Quoi qu’il en soit, mon cher Maréchal, comme j’ai bien à cœur de causer avec vous, sur ma position, et cela, en particulier, faites-moi dire par mon aide de camp si vous pouvez me recevoir, un de ces soirs, et si vous trouvez bon que j’aille chez vous, en frac.
Agréez, mon cher Maréchal, le renouvellement de mes affectueux sentiments.
Le Maréchal Comte de Grouchy,
rue Ville-Lévêque, no 26.
Le 10 juillet 1815.
J’étais à soixante lieues de Paris lors du débarquement de Napoléon: aussitôt que j’en fus informé, je me rendis en poste dans la capitale, et j’allai prendre [p. 239] les ordres de M. le duc de Berri qui commandait l’armée. Il me reprocha publiquement, dans les termes les plus durs, d’avoir tardé à venir, et m’annonça qu’il n’avait point de fonctions à me donner.
J’écrivis à S. M. pour me plaindre des reproches injustes que me faisait M. le duc de Berri et pour demander à être employé: ma lettre resta sans réponse. Alors, je me déterminai à voir Monsieur en audience particulière; je lui témoignai combien j’étais douloureusement affecté de l’injure gratuite que m’avait faite M. le duc de Berri, mais j’ajoutai que je n’en étais pas moins désireux de servir la cause du Roi.
Cette dernière démarche fut encore inutile; on me laissa sans ordres et sans fonctions à Paris.
Napoléon y arriva. Je n’avais point été au-devant de lui: il m’envoya chercher, me demanda si je ne partageais pas l’opinion du reste de l’armée, et m’engagea à ne pas me séparer de mes compagnons d’armes. Le Roi avait quitté la France, renvoyé les généraux qui l’accompagnaient, licencié sa maison. La nation paraissait, comme l’armée, prononcée dans le vœu de reconnaître Napoléon; il n’existait d’autre gouvernement que le sien; je n’avais jamais été employé par le Roi; il ne m’avait confié ni commandement de troupes, ni celui d’aucune province; je n’avais prêté d’autre serment depuis son retour que celui pour la Croix de Saint-Louis; mes demandes de servir récidivées à diverses époques et au moment même du départ du Roi, avaient été rejetées: j’ai donc pu me croire libre, et j’ai suivi l’impulsion générale.
Des troubles éclatèrent dans le Midi: Napoléon me donna ordre de m’y rendre pour les apaiser et y faire [p. 240] déployer les couleurs arborées alors dans le reste de la France. Je témoignai de la répugnance à me charger de cette mission, sachant que M. le duc d’Angoulême était encore dans cette partie du royaume.
Napoléon exigea que je partisse; je ne le fis que lorsqu’il m’eût donné l’assurance que si le sort des armes mettait à même d’empêcher M. le duc d’Angoulême de s’embarquer, il le renverrait; et qu’il m’eût dit que son intention était de faire contraster la générosité de sa conduite envers ce prince avec le sort que les alliés annonçaient vouloir lui réserver. Il ajouta seulement que peut-être il le garderait comme gage du retour de l’impératrice Marie-Louise. Je partis le cœur navré, mais il fallait ou renoncer à mon état ou obéir.
Les ordres successifs que m’adressa Napoléon réitéraient tous l’injonction d’empêcher le prince de sortir de France, et il envoya près de moi un de ses aides de camp pour assurer l’exécution de ses ordres, si je balançais à y obtempérer.
Le lieutenant général Gilly ayant conclu sans ma participation avec M. le duc d’Angoulême la capitulation de la Pallud, j’en fus informé en entrant au village de la Douzère, distant de trois lieues de la Pallud. Mes instructions ne me permettant pas de ratifier la principale clause de cette capitulation qui était le départ du prince, je me vis obligé de me rendre au Saint-Esprit où il devait passer, afin de m’opposer à son départ. Mais, au lieu d’y aller directement par terre, je m’embarquai sur le Rhône, avec un vent contraire, afin que le prince eût le temps de partir pour Cette avant que je fusse au Saint-Esprit. J’arrivai dans cette ville dix [p. 241] heures plus tard que je n’aurais dû y être, malheureusement le prince avait tardé à se mettre en marche: il était encore à la Pallud quand j’arrivai au Saint-Esprit; j’étais accompagné de l’aide de camp de Napoléon qui ne me quittait pas et qui eût rompu la capitulation si je l’eusse ratifiée. Je fus donc, malgré moi, forcé de retenir le prince jusqu’à ce que j’eusse reçu l’autorisation de le laisser aller, autorisation que je demandai avec instance et en rappelant ce qui m’avait été dit à cet égard. En outre, je donnai à M. de Damas, aide de camp du prince, la positive assurance que si, contre toutes les apparences, la politique de Napoléon pouvait être changée, je ferais moi-même évader le prince et j’ajoutai que je dévouerais ma tête pour sauver la sienne. M. de Damas, avec lequel je m’abouchai tous les jours pendant le temps que je passai au Saint-Esprit, fut témoin de ce que je souffrais, fut dépositaire de mes résolutions et connut tous mes sentiments. J’invoque avec confiance son témoignage.
Je quittai le Saint-Esprit pour marcher contre Marseille. Pendant la durée de ma mission dans le Midi, pas une arrestation ne fut faite par mes ordres, pas une goutte de sang ne fut versée. Napoléon, en rendant compte des événements, mutila ou altéra mes rapports, me prêta des expressions injurieuses que je ne m’étais pas permises et me donna des torts que je n’ai pas eus.
Rappelé du Midi, j’ai d’abord commandé l’armée des Alpes; à Fleurus, l’aile droite de l’armée du Nord et, depuis, j’ai été placé à la tête de cette armée. Des ouvertures m’ont été faites à Soissons pour lui faire prendre la cocarde blanche; j’ai répondu que la disposition [p. 242] des esprits ne permettait pas de penser que le chef de l’armée pût lui faire quitter les couleurs nationales.
Arrivé sous Paris après une retraite glorieuse, je me suis hâté de résigner le commandement, afin de donner l’exemple de la soumission et pour n’avoir point à me reprocher d’avoir coopéré à des événements dont le résultat pouvait être que le Roi ne rentrât dans la capitale que sur des monceaux de cadavres et après une bataille dont l’issue eût probablement amené l’incendie et le sac de Paris. Mon abandon du commandement est un des mobiles de l’état actuel des choses; j’ai fait tout ce qu’il était en mon pouvoir de faire pour que l’autorité royale fût reconnue de l’armée, en lui faisant envisager que le salut de la France se trouvait dépendre maintenant du retour de S. M. MM. Fouché, de Vitrolles, Oudinot ont connaissance de ces faits et les déclareront s’ils sont interpellés à cet égard.
Ayant commandé les armées françaises comme Maréchal, n’étant point un des fauteurs du retour de Napoléon, ne pouvant être grevé d’aucune culpabilité quant à l’expédition du Midi, suite inévitable de la position dans laquelle j’étais et qui m’a été commune avec la plupart des chefs de l’armée, j’ose espérer que Sa Majesté me laissera le titre que trente-cinq années de services m’ont fait obtenir, qu’elle me conservera mon état qui est ma seule fortune et, si la France est dans le cas de combattre pour son indépendance, je forme le vœu d’être placé de nouveau à la tête des armées; j’y servirai avec autant de fidélité que de zèle. Dans ce premier moment, je crois devoir [p. 243] donner une marque de déférence en me retirant à la campagne et je réitère ici au Roi les assurances de la soumission la plus absolue et du plus profond respect.
Le Maréchal Comte de Grouchy.
Le 12 juillet 1815.
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y Z
[1] Le château de Villette qui, après la mort du marquis de Grouchy, devint la propriété du maréchal fut vendu par celui-ci, sous la Restauration, à l’époque de son exil en Amérique. Il était, récemment encore, la propriété de Mme la comtesse de Castelbajac, née de Thermes.
[2] Les Grouchy possédaient les fiefs de Monterollier, de Robertot, de la Chaussée, etc. Ils portaient d’or fretté de six pièces d’azur, en cœur, sur le tout d’argent à trois trèfles de sinople (lettres patentes de décembre 1671);—sur la généalogie de cette famille, voir les Mémoires du Maréchal de Grouchy, Dentu, Paris, 1873, t. I, p. IV et seq.; mais consulter surtout à la bibliothèque nationale, au département des Manuscrits, fonds latins 17803, no 60 et, au cabinet des Titres, no 1397, un travail très important de M. le vicomte de Grouchy. Celui-ci est encore l’auteur des Vies de Nicolas de Grouchy (Caen 1878) et de Thomas de Grouchy, sieur de Robertot; cette dernière en collaboration avec le comte de Marsy (Gand, 1886).
[3] En secondes noces. De son premier mariage, il n’avait pas eu d’enfants.
[4] Il était né en octobre 1714.
[5] Les lettres que je donne sont toutes, sauf mention contraire, inédites. Celle-ci provient des archives Fréteau de Pény. A l’avenir je me bornerai à indiquer la source.
[6] Archives du Paty de Clam.
[7] Fréteau de Saint-Just, conseiller maître des comptes, décédé le 30 août 1771.
[8] Archives du Paty de Clam.
[9] Archives du Paty de Clam.
[10] Villette, 27 avril 1762. Fréteau à sa mère, née Lambert.—Archives Fréteau de Pény.
[11] Les Grouchy demeuraient bien rue Royale, mais ils passaient presque toutes leurs soirées rue Gaillon où la maison était plus grande et plus commode pour les réceptions.
[12] Le docteur Robinet, dans Condorcet: sa vie, son œuvre (Paris, May et Motteroz, p. 80) dit que Sophie de Grouchy naquit «au mois de septembre 1766, et non pas en 1764, comme dit Isambert». C’est là une erreur. D’abord, M. Isambert, ami très intime de la famille O’Connor ne pouvait pas se tromper sur un point aussi sérieux. De plus, le maréchal qui fut le second enfant du marquis de Grouchy, naquit le 23 octobre 1766, ce qui rend impossible la naissance de Sophie au mois de septembre de la même année. Enfin, Mme de Grouchy, dans une lettre datée de 1775, dit qu’elle jouit de la présence de sa fille depuis dix ans; et Dupaty, en décembre 1777, disait que sa nièce avait près de quatorze ans. Le doute n’est donc pas possible.
[13] Sans autre date que «Jeudi, 22, 1770». Archives du Paty de Clam.
[14] Archives Fréteau de Pény.
[15] De Bussac, 2 novembre 1774. Archives du Paty de Clam.
[16] Archives du Paty de Clam.
[17] Archives du Paty de Clam. Sans date.
[18] Archives du Paty de Clam. 10 avril 1775.
[19] Mme O’Connor, fille de Mme de Condorcet, a laissé sur sa mère une notice manuscrite qui est aujourd’hui à la bibliothèque de l’Institut. Il résulte de ce document que la maladie de Sophie serait arrivée au couvent de Neuville. Il est certain que Mlle de Grouchy fut malade à Neuville, après quelques excès de fatigue. Mais la crise qui la transforma est de 1775, et les lettres, toutes datées, que nous donnons sont formelles sur ce point.
[20] Toutes trois sont extraites des Archives du Paty de Clam.
[21] Mme de Grouchy tutoyait le Président, ami intime de son frère et qu’elle avait beaucoup vu, chez ses parents, quand il était au collège avec Fréteau.
[22] Henri-François, qui naquit à Villette en 1773 et qui, destiné à l’ordre de Malte, fut connu dans la famille sous le nom de chevalier de Grouchy. Il fut baptisé à Condécourt le 21 juillet 1773.
[23] Ils le faisaient assez souvent depuis la naissance des enfants, car Sophie, jusqu’à dix-huit ans, ne passa que trois hivers à Paris. (Notice de Mme O’Connor.)
[24] L’abbé de Puisié, dont il sera question un peu plus loin.
[25] Notice sur M. l’abbé Fréteau de Pény, par M. des Glajeux.
[26] Cette phrase a été donnée par M. Isambert dans sa biographie de Mme de Condorcet (Hoefer-Didot). Ce qui suit a été copié sur l’original par M. le docteur Robinet qui a bien voulu me le communiquer et à qui je suis heureux d’adresser ici tous mes remerciements.
[27] Archives du Paty de Clam.—La présidente à son mari, 13 novembre 1784.
[28] A sa femme, 23 juin 1787. Archives Fréteau de Pény.
[29] Villette, 26 décembre 1777. Archives du Paty de Clam.
[30] Montfort-l’Amaury, 18 janvier 1777. Archives du Paty de Clam.—Roucher terminait ainsi: «Je viens dans mon dernier voyage à Paris de renouveler l’enthousiasme que j’y excitai il y a deux ans. C’est mon nouveau mois de mars qui m’a valu ce dangereux honneur. La reine veut m’entendre et je paraîtrai dans cet incompréhensible pays au commencement du carême.»—Le 17 mars 1774, Mme de Grouchy écrit à Dupaty: «Ecoute mon infortune. J’avais demain à dîner Farges, l’abbé de Ris, Dussaulx, Lope et autres, les Petitval, d’Arbouville, enfin mille oreilles, pour entendre Roucher sur sa promesse et voilà que son crachement de sang le travaille de sorte que les duchesses d’Anville, de Rohan et moi, sommes au filet. Cela me fâche d’autant que le fond est triste pour le faillant. Je n’aime point cette habitude de cracher du sang. J’espère qu’il va enrayer sur le débit...»
Et le 24 mars 1775, la même correspondante écrit au Président: «Hier, Roucher m’acquitta un peu ses promesses. Nous étions douze. Hélas! Il ne voulut nous dire qu’un chant, celui de Septembre, étonnant comme les autres, mais qui nous laisse trop affamés de beautés. Il part demain pour fuir la fatigue. Il est tué.»
[31] C’était un ancien précepteur de la famille. Sa lettre sans date et sans signature fait partie des archives du Paty de Clam.
[32] Archives Fréteau de Pény. Villette, 26 décembre 1780.
[33] D’Expilly ne comptait que vingt-quatre chapitres, avec six cents sujets et 350.000 L. seulement de revenus.—V. dans la Grande Encyclopédie (publiée sous la direction de M. Berthelot), aux mots Chanoinesses et France ecclésiastique, les deux articles si documentés de M. le pasteur E.-H. Vollet.—Voir encore Les chapitres nobles de Dames, recherches historiques, généalogiques, etc., par Ducas (Paris, 1843, 1 vol. in-8o, extrait du tome XXI du Nobiliaire universel de France, de Saint-Allais); le Dictionnaire des ordres religieux (collection Migne, Paris, 1847-1859, 4 vol. in-8o); la France chevaleresque et chapitrale, par le vicomte de G. (Gabrielly), Paris, 1786, in-12; les mémoires historiques d’Amelot de la Houssaye (Amsterdam 1722, t. I); pour chaque province, consulter aussi le Catalogue des Gentilshommes ayant pris part aux assemblées pour les élections aux Etats-Généraux de 1789, publié par Ed. de Barthélemy et L. de Laroque (Paris, Dentu, 1865, 2 vol. in-8o). Enfin sur les chapitres de Pontsay et de Remiremont, voir aux Archives départementales des Vosges, série G.
[34] Lucile de Chateaubriand, par M. Anatole France, p. XIX.
[35] Ou Neuville-sur-Renom. Cette commune compte aujourd’hui 1.643 habitants; elle fait partie de l’arrondissement de Trévoux et du canton de Châtillon-sur-Chalaronne (département de l’Ain). Dans la région, sillonnée de canaux, de petites rivières et d’étangs, la culture, il y a quelques années encore, était intermittente; pendant deux ans, on labourait; puis, la troisième année, on laissait inonder le terrain qui rapportait alors un poisson renommé. Il en résultait que la topographie extérieure changeait constamment dans cette plaine élevée, en moyenne, de 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd’hui, les assèchements progressifs ont diminué considérablement le nombre des étangs et assaini le pays.
[36] Il avait été curé du pays en 1617.
[37] Supprimé en 1791, il fut rétabli en 1824 et existe encore aujourd’hui à l’état d’institution libre. Thoissey est à 17 kilomètres de Neuville, Châtillon, à six seulement.
[38] La plus grande partie de ces renseignements sur l’état actuel du chapitre de Neuville est due à M. P. Carrel, curé de Neuville-aux-Dames, qui a bien voulu répondre aux questions de l’auteur avec une obligeance inépuisable.
[39] Sur l’histoire du chapitre noble de Neuville, consulter une brochure de M. Henri Bouchot (Bourg, imprimerie Villefranche) et une notice de M. l’abbé Gourmand, ancien curé de Neuville.—Voir aussi les archives de Bourg, de Dijon, de Chambéry et de Turin (jusqu’en 1601, la Bresse a appartenu aux ducs de Savoie); le Catalogue des Gentilshommes, etc., publié par E. de Barthélemy et L. de Laroque (Livraison Bourgogne); Le Nobiliaire Universel de France, par Ducas et Saint-Allais (Paris, 1843, t. XXI, p. 455); enfin, La France ecclésiastique pour l’année 1789 par Duchesne (Paris, 1788, p. 177 à 179). M. le pasteur E.-H. Vollet, qu’on ne consulte jamais qu’avec tant de profit sur ces questions d’histoire religieuse, a fait remarquer à l’auteur, qui est heureux de remercier ici son savant correspondant, que les renseignements contenus dans la France ecclésiastique pour 1789, sont inexacts en ce qui concerne l’antiquité du chapitre de Neuville, mais que, pour le reste, ils ont une réelle valeur. Dans Le Cardinal de Bernis depuis son ministère, M. Frédéric Masson a parlé, page 475, d’une des chanoinesses de Neuville, Julie du Puy-Montbrun, nièce du cardinal de Bernis. Or, le chapitre de Neuville dépendait du diocèse de Lyon dont le cardinal était chanoine.
[40] Avant l’époque où le Roi, par la réunion de l’abbaye de Tournus (1781), rendit les frais beaucoup moins onéreux pour les familles, il en coûtait de 30 à 40.000 livres de plus: il fallait, en effet, acquérir une adoption ou un emplacement dans le chapitre. Les adoptions coûtaient de 20 à 30.000 livres et si l’on était obligé de faire bâtir sur un emplacement, la dépense pouvait aller à 40.000 livres.
[41] Correspondant du 25 février 1896, p. 674. Louise-Marie-Victoire de Chastenay, née en 1771, au château d’Essarois, près de Châtillon-sur-Seine.
[42] Taine. L’ancien Régime.
[43] 4 août 1785. Archives du Paty de Clam.
[44] 8 juin 1785. Archives du Paty de Clam.
[45] 3 décembre 1785. Archives du Paty de Clam.
[46] 1er avril 1788. Archives du Paty de Clam.
[47] 9 octobre 1787. Archives du Paty de Clam.
[48] 10 août 1785. Archives du Paty de Clam.
[49] Archives du Paty de Clam.
[50] Archives du Paty de Clam. 10 août 1785.
[51] Archives du Paty de Clam.
[52] Gouvernante de Sophie; femme de confiance de la famille de Grouchy, passée, depuis, au service de la marquise de Condorcet.
[53] Neuville, 4 septembre 1785. Archives du Paty de Clam.
[54] Même lettre.
[55] 3 décembre 1785, De Neuville, à la présidente Dupaty. Archives du Paty de Clam.
[56] 4 mars 1785. La présidente à son mari. Archives du Paty de Clam.
[57] 10 mars 1785. Archives du Paty de Clam.
[58] 17 mars 1785. Archives du Paty de Clam.
[59] 28 mars et 5 avril 1785. Archives du Paty de Clam.
[60] Archives du Paty de Clam.
[61] Archives du Paty de Clam.
[62] 4 décembre 1785. Archives du Paty de Clam.—On verra plus loin que Sophie ne partageait pas l’enthousiasme du Président pour sa belle-sœur.
[63] 10 ou 11 avril 1786. Archives du Paty de Clam.
[64] 18 avril 1786. Mme de Grouchy au Président. Archives du Paty de Clam.
[65] Détail donné par Mme O’Connor dans sa notice sur sa mère (Bibliothèque de l’Institut).
[66] 12 octobre 1786. La Présidente à son mari. Archives du Paty de Clam.
[67] La Présidente à son mari, s. d. Archives du Paty de Clam.
[68] Sophie au Président, s. d. Archives du Paty de Clam.
[69] Beaumarchais à Dupaty, Paris, 29 novembre (1786). Archives du Paty de Clam.
[70] Sophie au Président, s. d. Archives du Paty de Clam.
[71] C’était la propriété de M. Chopin de Seraincourt. C’est là que Cabanis mourut le 6 mai 1808.
[72] 22 août 1786. Mme de Grouchy au Président. Archives du Paty de Clam.
[73] Archives du Paty de Clam.
[74] Mme O’Connor, dans sa Notice sur sa mère, dit que Dupaty invita Sophie à venir passer un automne chez lui à la campagne et que c’est là que Condorcet fit sa connaissance. Il y a là une légère erreur. Jamais Dupaty n’eut de campagne à lui aux environs de Paris. Particulièrement pendant l’été et l’automne de 1786, il resta à Paris, rue de Gaillon, ne faisant que de rares apparitions soit à Villette, soit à Vaux, chez ses beaux-frères.—Jérôme Lalande est plus dans la vérité quand il prétend que c’est en voyant Sophie prodiguer les soins les plus touchants au jeune fils de Dupaty, mordu par un chien enragé, que Condorcet s’éprit d’elle.
[75] C’est Mme Roland qui le définissait ainsi.
[76] Le Parlement Maupeou.
[77] Archives Fréteau de Pény.
[78] Tout le monde cependant ne fut pas aussi bienveillant; car les Mémoires de Bachaumont, à la date du 28 décembre 1786, s’expriment ainsi: «Il en était amoureux depuis quelque temps et voilà la cause du zèle avec lequel il a défendu les trois Roués et les deux magistrats leurs protecteurs.
«La semaine dernière, l’Académie des Sciences, suivant l’usage, reçoit notification de ce mariage. On nomme des députés pour aller féliciter Condorcet. On en prenait dans la classe de géométrie, dans celle d’Astronomie. «Messieurs,—s’écrie Dionis du Séjour, le farceur de la compagnie,—ce n’est pas parmi ces Messieurs qu’il faut choisir; c’est tout ce qu’il y a de mieux et de plus fort en anatomie qu’il faut envoyer à notre confrère.» Plaisanterie qui a d’autant plus fait rire que Condorcet a trente ans de plus que la demoiselle, jeune, jolie, bien découplée et morceau de dure digestion pour ce nouvel époux.»
[79] De Villette, s. d. Archives du Paty de Clam.
[80] Guillin, curé. Les bans avaient été publiés à Saint-André-des-Arcs.
[81] Cardot était, en même temps, commis au contrôle général. Il travaillait pour Condorcet le dimanche toute la journée, et tous les jours, de 6 heures à 11 heures du soir.
[82] Le jour même, ce jeune homme remit ces vers à son bienfaiteur:
Lardoise, un des trois Roués, reçut, lui aussi, de la part de Condorcet, des preuves d’intérêt; il donna bien des ennuis à son sauveur et à la famille de Dupaty, après la mort du Président.
[83] Il faut constater que cette imputation, maintenue, malgré les protestations de la famille, dans les premières éditions, ne figura plus, du vivant même de Lamartine, dans les derniers tirages de cette Histoire des Girondins.
[84] Elles sont intitulées: Remarques sur divers passages de l’Histoire des Girondins, relatifs à Condorcet.
[85] A l’occasion du mariage d’Elisa de Condorcet avec le général O’Connor, la succession de Condorcet, restée jusque-là indivise entre sa femme et sa fille, fut liquidée.
[86] De Villette, vendredi. Archives du Paty de Clam. Charlotte resta à Neuville jusqu’à 1789.
[87] Mémoires historiques sur la vie de M. Suard, etc., et sur le XVIIIe siècle par D.-J. Garat. Paris, 1820, 2 vol. in-8o.
[88] Michelet. Les Femmes de la Révolution.
[89] 31 août 1787, à sa femme. Archives Fréteau de Pény.
[90] Rouen, 25 décembre 1787. Archives du Paty de Clam.
[91] 15 octobre 1788. Archives du Paty de Clam.
[92] Villette, 13 octobre 1788. Archives du Paty de Clam.
[93] En allant plaider la cause des trois hommes injustement condamnés à la roue, il les sauva.
[94] 25 octobre 1788. Archives du Paty de Clam.
[95] 8 novembre 1788. Archives du Paty de Clam.
[96] Eléonore Dupaty épousa, en 1797, Armand Elie de Beaumont, fils du grand avocat et père de l’illustre savant.
[97] Septembre 1788.—Archives du Paty de Clam.
[98] Villette, 25 octobre 1788. Archives du Paty de Clam.
[99] 22 décembre 1788. Archives du Paty de Clam.
[100] Archives du Paty de Clam.
[101] La Harpe, au lendemain de la mort de Voltaire, s’était montré plus que sévère pour le philosophe qui n’avait eu (c’est Voltaire lui-même qui parle) «que des entrailles paternelles émues de tendresse pour chacun des succès» du critique; c’était, au moins, de mauvais goût; mais c’était bien dans les habitudes de la Harpe. Condorcet s’emporta et, dans le Journal de Paris, dénonça la mauvaise action du critique; celui-ci en perdit la direction du Mercure.
[102] Il ne fallut pas moins que la Révolution pour fixer les idées ailleurs.—Les cours furent interrompus en 1793 et ne furent repris qu’après la Terreur, sans que le Lycée ait pu retrouver, dans cette deuxième période, son antique splendeur.—Il y eut des scènes terribles, en 1792 et 1793, et sans parler des cours faits par La Harpe, en bonnet rouge, qu’il soit permis de rappeler qu’un nommé Varlet vint lire à la tribune du Lycée un poème sur l’odieux Marat.
[103] Anacharsis Clootz.
[104] V. Le Salon de Mme Helvétius, p. 43 et seq.
[105] Savant, propriétaire des eaux de Passy, premier maire de ce village pendant la Révolution, Le Veillard est surtout célèbre par les soins filiaux qu’il prodigua à Franklin, pendant son séjour en France.
[106] Le Ray de Chaumont, ancien directeur de l’Hôtel des Invalides, grand ami des Américains, logea, chez lui, à Passy, Franklin sans vouloir rien accepter en échange.
[107] Journal de la Société de 89.
[108] Archives du vicomte de Grouchy.
[109] Pontécoulant, 27 novembre 1789. Archives Fréteau de Pény.
[110] Les tricoteuses n’avaient pas encore fait leur apparition au temps de la Constituante et qu’est-ce qu’une tricoteuse en gants de soie?
[111] Notice manuscrite de Mme O’Connor sur Mme de Condorcet. (Bibliothèque de l’Institut.)
[112] Notice manuscrite sur Mme de Condorcet.
[113] Ibidem.
[114] Ce fameux plan créait les Ecoles primaires,—les Ecoles Secondaires,—les Instituts (ou Collèges),—les Lycées (ou Facultés) et la Société nationale des sciences et arts (véritable embryon de l’Institut de France), chargée de la Direction générale de l’Enseignement public.—Il est facile de voir ce que la Convention et l’Empire surtout ont pris dans le projet de Condorcet pour leurs organisations de l’Instruction publique et de l’Université impériale.
[115] Il opta pour le département de l’Aisne, où il avait des intérêts.
[116] Déclaration par la citoyenne Félicité-Charlotte Grouchy, majeure, devant la municipalité, de son intention d’être imposée séparément de ses sœur et beau-frère, 4 janvier 1794.
[117] Ce mariage, célébré au civil le 30 avril 1790, ne le fut à l’église que le 19 avril 1791. Talma avait dû en appeler à l’Assemblée nationale du refus du curé de Saint-Sulpice (Moniteur universel, 1790, p. 796). Julie avait sept ans de plus que Talma et possédait une grande fortune.—De ce mariage naquirent Tell, Castor et Pollux, tous trois morts en bas âge.
[118] Etats de l’Opéra de 1773 à 1776, communiqués avec une bonne grâce charmante par M. Nuitter.
[119] Souvenirs d’un sexagénaire, t. II, p. 133.
[120] Lettre sur Julie imprimée à la suite des Mélanges de Littérature.
[121] M. Thiers a raconté que cette scène s’était passée chez Mlle Candeille; c’est une erreur, Mlle Candeille était chez Julie, ce soir-là, et elle était au piano, quand arriva Marat. Celui-ci est formel sur ce point. Vergniaud et Lasource ne le furent pas moins dans leurs interrogatoires au Tribunal révolutionnaire.—Sur Julie, consulter le dictionnaire de Jal au mot Talma; les Souvenirs d’une actrice (Louise Fusil); les Souvenirs d’un sexagénaire, par Arnault; l’ouvrage de C. Vatel sur Vergniaud; enfin, et surtout, les articles très remarquables de M. Victor du Bled sur les Comédiens français pendant la Révolution et l’Empire, dans la Revue des Deux-Mondes des 15 avril, 1er août et 15 novembre 1894.
[122] Voir le Journal des Débats de la Société des Jacobins, no 285, 19 octobre 1792.—C’est la version donnée par Marat lui-même de sa conduite dans cette soirée.
[123] Tome III, p. 375.
[124] Revue Blanche, 15 mai 1896, p. 452.
[125] Le Dictionnaire de la Conversation, à l’article Condorcet, raconte, d’après un témoin oculaire, dit-il, que Condorcet, membre du Comité de la Commune, ayant assisté à un conseil sur les subsistances, conseil présidé par Louis XVI, aurait été frappé des connaissances du roi en cette matière et de la sagesse des mesures qu’il avait proposées. «Après l’avoir écouté, nous nous sommes tous regardés avec étonnement et nous n’avons réellement rien trouvé de mieux à faire que d’adopter ses vues.» Tout cela est parfaitement possible; mais il est bien difficile d’admettre, comme Aubert-Vitry voudrait le faire croire, que Condorcet ait remporté de cette séance,—en dehors du cas particulier en discussion,—l’impression que Louis XVI était un prince très éclairé, très instruit et plein de sens.
C’est chez Mme Dupaty qu’Aubert-Vitry aurait recueilli cette anecdote de la bouche même de Condorcet!
[126] Tilly, chargé d’affaires à Gênes, agent royaliste, écrivait le 27 juillet 1793 (sa lettre est évidemment très postérieure aux faits qu’elle relate, car, en juillet 1793, Condorcet était proscrit): «Pendant que Belleville avait harangué le roi des Lazzaroni en faveur de ses compatriotes, le marquis et la marquise de Condorcet avaient harangué le ministre de la marine en faveur de La Chèze (consul).» (Archives des affaires étrangères. Gênes, 1793, fo 178.) La Chèze, député de Brive à la Constituante, s’était établi, grâce à son amitié avec Cabanis, chez Mme Helvétius, en 1789. Il fut cause de la brouille de Cabanis avec Morellet et du départ de celui-ci. (Voir les Mémoires de Morellet et le Salon de Mme Helvétius.) Mme de Condorcet et les O’Connor conservèrent des relations avec La Chèze et, en juillet 1810, une lettre du général O’Connor à Parent-Réal (collection Fréd. Masson) montre que le gendre de Condorcet s’occupait encore, à cette date, des intérêts pécuniaires de Mme La Chèze.
[127] Emmanuel Jean-Baptiste Fréteau, né le 5 novembre 1775, allait atteindre sa dix-septième année quand, après les journées de septembre, il fut réquisitionné comme tous ceux qui avaient plus de seize ans. On l’envoya à Caen avec son précepteur; mais tous deux furent arrêtés à Houdan. Ils songèrent à se recommander de Condorcet qui obtint leur mise en liberté.—14 septembre 1792, Mme Fréteau à son fils: «Tu auras sans doute rendu grâces, ainsi que nous, à celui qui a protégé ton innocence et sans l’appui et le secours duquel tu aurais pu courir de grands dangers. Sans doute vous aurez écrit à M. de Condorcet pour le remercier.» Archives Fréteau de Pény.
[128] Voir, sur toute cette période, les Mémoires du Maréchal de Grouchy, 23 avril: «La santé de ton respectable père, dit Mme de Grouchy à son fils, est troublée par la persévérance des calomnies que l’évidence même ne peut désarmer.»
[129] 8 mars 1842. Lettre à Isambert (Bibliothèque de l’Institut).
[130] Michelet. Les Femmes de la Révolution, p. 87.
[131] Archives Fréteau de Pény.
[132] 12 juin 1793. Félicité à Emmanuel Fréteau. Archives Fréteau de Pény.
[133] Il paraît bien que l’influence de Condorcet fut, ici, toute-puissante. M. Louis Amiable, dans une brochure sur Lalande franc-maçon (Paris, Charavay frères, 1889), dit, à trois reprises, pages 30 et 31, que Condorcet appartint comme franc-maçon à la loge des IX sœurs. J’ai eu entre les mains presque tous les papiers de cette loge dont mon arrière-grand-père, le poète Roucher, fut orateur et premier secrétaire et je puis affirmer que Condorcet ne figure dans aucun des tableaux de la Loge et, notamment, dans celui de 1784, où il serait inscrit certainement.
Condorcet fit-il partie d’une autre Loge ou n’appartint-il jamais à la franc-maçonnerie, comme c’est mon opinion personnelle, c’est là une question intéressante, compliquée d’un fait difficilement explicable, je le reconnais; mais elle n’est encore résolue ni dans un sens, ni dans l’autre.
[134] Premier registre de la paroisse d’Auteuil, folio 5.
[135] 23 juin 1793.—Félicité à Emmanuel Fréteau. Archives Fréteau de Pény. Ce ne fut que quelque temps après que le marquis de Grouchy fut arrêté et enfermé à Sainte-Pélagie.
[136] Archives Fréteau de Pény.
[137] Cette maison porte aujourd’hui le no 15 de la rue Servandoni. Elle est restée extérieurement et intérieurement, à peu près dans le même état qu’en 1794. Elle conserva son no 21 jusqu’en 1841; c’est de là, évidemment, qu’est venue l’erreur du docteur Robinet qui, dans son Condorcet, dit que la maison où le philosophe vécut en 1793-1794 est la maison portant le no 21 actuel de la rue Servandoni. Le même auteur dit que Mme Vernet était née Marie-Rose Boucher; c’est Rose-Marie Brichet que l’on trouve dans les actes que le propriétaire actuel, M. Saunière, a bien voulu me communiquer. Cette maison porte une plaque commémorative très peu apparente, à cause de l’étroitesse de la rue, du manque de recul et de la hauteur où on l’a placée.
La rue Servandoni n’a pris ce nom qu’en 1807; jusque-là, elle s’appelait rue des Fossoyeurs. C’est donc pour être très précis, au no 21 de la rue des Fossoyeurs que Condorcet habita.
[138] Mme O’Connor, dans une courte notice sur Mme Vernet, dit qu’elle avait dû être très jolie. «Jamais on ne sut son âge, mais, à son décès, en mars 1832, elle avait plus de quatre-vingts ans.» En manuscrit à la bibliothèque de l’Institut.—Voici comment les papiers de Condorcet se trouvent dans ce riche dépôt; ils furent d’abord conservés par Mme de Condorcet, puis transmis par elle à sa fille, Mme O’Connor, qui les donna à François Arago, au moment où l’illustre astronome se chargea d’écrire l’éloge de Condorcet et de donner une édition de ses œuvres. Mme Laugier, nièce de François Arago, remit à son tour ces papiers à M. Ludovic Lalanne, bibliothécaire de l’Institut, avec mission de les offrir à la bibliothèque qu’il dirige avec tant de science et d’amabilité.
[139] Parfois les anciens serviteurs de Condorcet purent aussi pénétrer auprès de lui et lui apporter, avec des nouvelles des siens, leurs soins dévoués et affectueux.
[140] Sur le manuscrit autographe de la Justification, Sophie a écrit: «Quitté à ma prière pour écrire l’Esquisse des progrès de l’esprit humain.» Condorcet fit plusieurs fois passer, sous le voile de l’anonyme, des mémoires patriotiques au comité de Salut public. A propos du livre de Condorcet, imprimé en l’an VII, et intitulé: Moyen d’apprendre à compter sûrement et avec facilité, il y eut un regrettable débat entre Mme de Condorcet et J.-B. Sarret qui avait publié, à la même époque, une arithmétique élémentaire. Celui-ci fut injustement accusé de s’être approprié le manuscrit de Condorcet pour le publier sous son nom. Un verdict de l’Institut, choisi comme arbitre, innocenta complètement Sarret de tout soupçon de plagiat. Celui-ci ne conserva de cette affaire aucun mauvais souvenir puisqu’il donna, à quelque temps de là, une notice très bienveillante sur Condorcet. Pendant les huit mois de la captivité du philosophe, Sarret n’avait cessé, disait-il, d’admirer sa douceur, sa patience, le calme de son âme, sa résignation à un sort immérité, «je pourrais dire son indifférence pour lui-même, car les objets de ses plus vives sollicitudes étaient la République, sa femme, son enfant et ses amis.»
[141] Fragment (mars 1794) qui était resté entre les mains de Mme Vernet.
[142] Testament (mars 1794).
[143] Cet ouvrage est, malheureusement, non seulement inédit, mais très probablement perdu pour toujours. Malgré toutes mes recherches dans les papiers de famille, je n’ai rien pu trouver à ce sujet. Quant aux Mémoires de Condorcet, en 2 vol. in-8o parus en 1824, ai-je besoin de dire qu’ils sont absolument apocryphes et, par conséquent, indignes de toute confiance.
[144] Sarret ne voulut quitter le philosophe qu’à la porte de Suard, à Fontenay-aux-Roses. Suard reçut Condorcet en lui disant de revenir le soir par une porte dérobée: il lui prêta un volume d’Horace et consentit à recevoir le portrait d’Elisa que Condorcet avait sur lui et qu’il voulait faire parvenir par cette voie à Mme de Condorcet. Le soir, à l’heure convenue, la porte était fermée. Voilà comment Suard reconnaissait l’hospitalité qu’il avait reçue autrefois à la Monnaie, où Condorcet l’avait logé avant son mariage! On a cherché à laver la mémoire de Suard de ce forfait. Je crois qu’on l’a fait inutilement. Ce n’était un mystère pour personne qu’avant le mariage de Mme Suard, Condorcet en avait été éperdument épris; Suard le savait et ne le pardonna jamais à Condorcet. De plus, tous ceux qui ont connu Mme O’Connor savent à quel point elle était persuadée de ce crime. On ne pouvait pas, me dit un de ses vieux amis, prononcer le nom de Suard devant elle. Mme Vernet, écrivant vers 1825, à Mme O’Connor, disait: «Ce monstre de Suard.» (Bibliothèque de l’Institut.)
La même Mme Vernet, dans des vers adressés à la mémoire de Condorcet, s’exprimait ainsi:
[145] Depuis 1808, Napoléon portait sur lui, dans un sachet, le poison préparé par Cabanis. En 1812, il reçut d’Yvan, son chirurgien, un poison d’une formule différente. (Frédéric Masson. Revue de famille, 1er mars 1893.)
[146] Bibliothécaire de l’Institut en 1842.
[147] Ce sont les termes du procès-verbal d’arrestation. Ce détail permit de reconnaître l’identité du philosophe. Il avait échangé sa montre, en avril 1792, contre celle de son beau-frère, le général de Grouchy.
[148] Le divorce fut prononcé le 18 mai, c’est-à-dire plus de six semaines après la mort ignorée de Condorcet «pour cause de séparation de fait depuis plus de six mois, la dame Grouchy étant domiciliée dans la commune depuis deux ans et demi et ledit Condorcet étant séparé d’elle depuis plus de dix mois par son évasion». Signé: «P.-J.-G. Cabanis, médecin, trente-six ans, domicilié à Auteuil, témoin et Benoît, officier public.»—Le divorce fut une précaution que prirent, à cette époque, beaucoup de femmes d’émigrés. Mme de La Fayette n’agit pas ainsi. Elle revendiqua toujours très haut son titre de Citoyenne La Fayette, et le général, plus tard, s’en montrait fier. (Voir dans ses Mémoires, t. V, sa lettre à M. de Maubourg.)
[149] Journal des Débats et de la Correspondance de la Société des Jacobins, amis de la Constitution de 1793, séante aux Jacobins à Paris, no 524, 9e jour, 2e mois de l’an second. (Séance du septidi brumaire.)—Ducos fut condamné à mort le 9 brumaire an II.
[150] Mémoires, t. II, p. 106.
[151] Elle conservait même une influence pour le bien. C’est ainsi qu’en novembre 1793, elle recommandait son neveu Fréteau à Laplace et à Lacroix, alors professeur d’artillerie à Besançon. Archives Fréteau de Pény.
[152] Nancy est l’abréviation anglaise de Suzanne, nom alors fort à la mode. La belle-sœur de Brissot s’appelait Nancy Dupont. Les extraits de la correspondance de Ginguené que nous donnons ici sont inédits. Ils ont été recueillis par l’auteur, dans les papiers de Ginguené gracieusement communiqués par M. Parry, fils de James Parry, fils adoptif de Ginguené et de sa femme.
[153] Ces lettres sont écrites sur de petits morceaux de papier que Ginguené cachait dans un ourlet du linge sale qu’il renvoyait. Sur la note ostensible du linge, il soulignait la première lettre de la pièce où se trouvait le billet. C’est à peu près le système qu’employait André Chénier pour envoyer aux siens ses immortelles poésies.
[154] C’est ainsi que s’habillait Mme Ginguené quand elle allait devant la prison pour chercher à apercevoir le captif. Elle était ainsi plus reconnaissable.
[155] Dans la notice manuscrite déjà citée qui se trouve à la bibliothèque de l’Institut.
[156] Vergniaud par C. Vatel, t. I, p. LXVIII.
[157] Archives Fréteau de Pény. Cette lettre est scellée d’un cachet de cire rouge portant ces mots: La Vérité.
[158] Félicité Fréteau, qui devint la vicomtesse de Mazancourt.
[159] Cette rectification fut prononcée par jugement du 12 ventôse an III. Le 21 pluviôse an III, dans le «procès-verbal des déclarations reçues pour la rectification» apparaissent comme témoins Cabanis et Joseph-François Baudelaire, demeurant à Auteuil. Acte dressé par Jean Libert, juge de paix du canton de Passy.—Ce Baudelaire, allié aux Condorcet, était le père du poète.
[160] Emmanuel Fréteau, qui fut élève d’artillerie, aide de camp de Menou et quitta l’armée pour entrer dans la magistrature.
[161] Mariée à M. Filleul de Fosse. Elle devint presque folle; un jour, on la trouva morte dans un fossé en Normandie.
[162] Mme Colin de Plancy.
[163] Nées après la mort de M. Fréteau.
[164] Archives Fréteau de Pény.
[165] Archives Fréteau de Pény.
[166] Archives Fréteau de Pény. Le 8 messidor an IV, le conseil des Cinq-Cents déclarait: «Considérant qu’après avoir coopéré à établir la liberté et à fonder la République, ils l’ont scellée de leur sang et sont morts victimes de leur dévouement à la Patrie et de leur respect pour les droits de la nation,» c’est le préambule du décret qui accordait un secours annuel de 2.000 francs aux veuves des Girondins Valazé, Pétion, Carra, Buzot, Gorsas, Brissot, Salle et Gardien, réduites à l’indigence. Mme de Condorcet ne reçut rien.—Les Archives nationales renferment certains documents relatifs aux scellés de Condorcet, à leur levée, etc. F7. 4652. 27 pluviôse: Le Comité de sûreté générale ordonne que les scellés soient mis sur les papiers de Condorcet. 21 frimaire an III: levée desdits scellés.—Sans date: Marie-Louise Sophie Grouchy, veuve Condorcet, expose qu’on a levé les scellés, mais pas le séquestre des biens à cause de la communauté entre elle et son mari.—Sans date: Grouchy, général de brigade, réclame la levée des scellés sur les effets de Cardot pour en extraire les contrats de rente à lui confiés pour en toucher les arrérages. 6 nivôse 1793: Le Comité de sûreté générale fait droit à cette réclamation et Cardot est extrait de prison pour assister à la levée des scellés.—Sans date: Le citoyen Cardot informe le Comité que s’étant présenté à la section le 21 fructidor lors de l’Assemblée primaire, il en fut rejeté comme désarmé et ayant voulu représenter qu’un décret de la Convention l’y autorisait, le citoyen Rossignol l’a mis à la porte en le maltraitant et l’a consigné au corps de garde.—Sans date: Cardot, négociant, rue Saint-Denis, 28, section des Amis de la Patrie, renouvelle sa plainte.
[167] 5 janvier 1795. Archives Fréteau de Pény.
[168] Précepteur des enfants Fréteau. En effet, en nivôse de l’an III, le département de l’Aisne reçut un arrêté ordonnant de surseoir à la vente des biens de Condorcet.
[169] En manuscrit à la bibliothèque de l’Institut.
[170] Il est impossible de comprendre comment Tallien put dire aux Cinq-Cents: «Il y a quatre jours que la veuve de Condorcet est inscrite sur la liste des émigrés.» Journal de Paris, no 162, 12 ventôse an VI, p. 672.
[171] «Sophie m’a donné hier soir une lettre pour Garat.» Emmanuel Fréteau à sa mère, 23 novembre 1794.—«Je dois me trouver ce soir chez Sophie où il y aura quelques personnes qui peuvent m’être fort utiles.» Le même à la même, 30 novembre 1794.—«Je dîne aujourd’hui avec Sophie chez un des commissaires de l’Instruction publique.» Id., 24 février 1795. Archives Fréteau de Pény.
[172] Correspondance inédite de Mallet du Pan avec la cour de Vienne (Edition André, 1884), I, 269, note. De Turin, août 1795: «Le parti dominant Girondin Républicain tient sa cabale principale chez Julie Talma. Sieyès, Chénier, Louvet, Guyomard, Bailleul décident là le destin de l’Etat.» Même renseignement, p. 272, Berne, 2 août 1795.
[173] Séparés de fait depuis 1795, Julie et Talma ne furent officiellement divorcés que le 6 février 1801.
[174] 3 brumaire an II. Déclaration de contribution aux charges de la Commune. Le village, d’ailleurs, n’est pas heureux. D’un rapport de police du 11 nivôse an III, j’extrais ceci: «Un officier de paix a entendu dire, ce matin, au café de la Régence, par une blanchisseuse demeurant à Auteuil, que sept personnes traversant hier la glace de la Seine, près de Longchamps ont été englouties avec le pain qu’elles apportaient à leurs familles; que, dans ces cantons, des malheureux passaient quelquefois deux jours sans pain.» Nécessité de s’occuper de cette disette qui pourrait amener des rassemblements aux barrières. (Tableaux de la Révolution française, par A. Schmidt, Leipzig, 1867-1870, t. II, p. 257.)
[175] Je dois à M. Elie de Beaumont, ancien magistrat, la très gracieuse communication de ses papiers de famille. C’est là que j’ai trouvé ces détails sur les occupations et la vie mondaine de Sophie de 1795 à 1797. Les lettres sont échangées entre Pauline Le Couteulx de Canteleu, qui devint vicomtesse de Noailles, et son amie Eléonore Dupaty qui épousa le fils du grand Elie de Beaumont.
[176] Baudelaire habitait Auteuil; c’était un ancien prêtre devenu voltairien.
[177] Cette lettre justifie le mot de Vatel que «la correspondance de Mme Ginguené était remarquable par le naturel et par l’agrément du style».
[178] Les Girondins avaient échangé leurs portraits. Jean Debry avait celui de Guadet, tandis que celui-ci avait reçu l’image de Jean Debry. C’est ainsi que le portrait de ce conventionnel se trouve aujourd’hui entre les mains de Mme Lacombe-Guadet.
[179] Sur la proposition de Daunou, la Convention souscrivit à 3.000 exemplaires de l’Esquisse des progrès de l’esprit humain et ordonna la distribution de cet ouvrage de Condorcet dans toute l’étendue de la République.—Archives de l’Arsenal: 1er pluviôse an VI: Le ministre de l’intérieur Letourneur autorise la remise à la veuve de Condorcet de 540 exemplaires confisqués de l’Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions. 2 ventôse: Mme de Condorcet reconnaît avoir reçu ces volumes.
[180] Elles parurent à la suite de sa traduction de la Théorie des sentiments moraux, d’Adam Smith.
[181] An III (1795).
[182] 24 thermidor. Lettre à Jean Debry.
[183] Villette, 4 juillet 1789, à son cousin Charles Dupaty. Archives du Paty de Clam.
[184] 14 mai 1796. Xe arrondissement. Témoins: Mailla-Garat et Dominique Garat, tous deux hommes de lettres.
[185] Eymar qui appartenait à la noblesse avait adopté les idées nouvelles. On le voyait souvent à Auteuil. Il mourut préfet de Genève en 1800.
[186] Il se trouve aujourd’hui dans la salle principale de la bibliothèque de l’Institut.
[187] Manuscrit à la bibliothèque de l’Institut.
[188] Manuscrit à la bibliothèque d’Avignon (Musée Calvet). Collection Requien.
[189] Les Condorcet, c’est-à-dire Mme de Condorcet, Cabanis et sa femme; car Elisa était trop jeune pour qu’on se préoccupât de son jugement.
[190] Talleyrand, à son retour, s’était établi à Auteuil, chez Mme de Boufflers, d’abord, et, ensuite, au château de la Thuilerie, chez son ami le général d’Arçon. Mme de Staël vint, plusieurs fois, y visiter l’ancien évêque d’Autun: elle y rencontrait Daunou, Cabanis et Tracy. Mais, ce ne fut là qu’une époque très courte pendant laquelle les idéologues et la fille de Necker suivirent la même ligne politique.—Sur ce séjour de Talleyrand, à Auteuil, on trouve des renseignements du plus haut intérêt dans un ouvrage rare: Souvenirs d’histoire contemporaine; Episodes militaires et politiques, par le baron Paul de Bourgoing, sénateur, ancien ambassadeur, ancien pair de France. Paris, Dentu, 1864, in-8o. Page 50 et suivantes, M. de Bourgoing raconte que son père chargé de mission à Copenhague, vit en Scanie le roi de Suède Gustave IV qui, hostile d’abord à la France, puis subjugué par le génie du premier consul, fit des ouvertures à Bourgoing père et lui parla même, comme au nom de plusieurs autres souverains, de la possibilité de voir un jour Bonaparte monter sur le trône. Bourgoing, sans rien répondre de positif, fit part, dans ses lettres particulières, de ces ouvertures à Talleyrand: «C’est à Auteuil que lui fut adressée cette partie confidentielle de la correspondance du ministre en Danemark. Ma mère et mes sœurs avaient passé quelques semaines de la belle saison dans cette maison de campagne de l’habile ministre. M. de Talleyrand s’empressa de porter à Malmaison l’information de ces instances indirectes.»
Bourgoing ayant été nommé ministre en Suède prononça, lors de sa réception à la cour, un discours où l’on crut voir l’annonce de l’Empire. Le premier consul se mit en colère et disgracia Bourgoing d’autant que, dans l’intervalle, Gustave IV avait changé d’avis sur le premier consul et sur la France.
On voit combien, dans ces années, Auteuil était un centre politique où tout se traitait, affaires extérieures ou intérieures: presque tous les événements graves de l’époque furent préparés ou discutés dans ce petit village.
[191] Necker.
[192] Manuscrit à la bibliothèque de l’Institut.
[193] Le groupe Chateaubriand, Fontanes, Joubert, etc.
[194] A cause de la présence de Mme Cabanis et de son mari, Mme de Condorcet venait encore par moments à Auteuil; mais ce village lui rappelait de trop tristes souvenirs et, dès qu’elle eut recouvré sa fortune, elle chercha une nouvelle habitation. La proximité fatigante de Paris fut aussi pour quelque chose dans la résolution qu’elle prit de se transporter à la Maisonnette.—Le 28 septembre 1806, Mme de Rémusat écrivait à son mari, alors à Mayence: «Je pense à toi dans cette petite retraite d’Auteuil qui me plairait si elle était plus solitaire. Mais il faut convenir que ma mère a raison et que les oisifs de Paris ont trop beau jeu pour y venir importuner à tous les moments du jour. On nous accable de visites et nous nous réfugierons à Paris pour y vivre plus seules et plus économiquement.» La même correspondante, le 4 octobre, donnait la contre-partie: «Ce que j’aime d’Auteuil, c’est que la vérité seule y arrive et qu’on ne vous raconte les faux bruits que lorsqu’ils sont démentis.» Lettres de Mme de Rémusat (II, p. 19 et 26).
[195] La propriété appartint donc successivement aux rois de France, aux Annonciades, à la Nation, à la municipalité de Meulan et à Chévremont, acquéreur de la Nation. Entre celui-ci et Mme de Condorcet se placent cinq acquéreurs. Le 9 juillet 1823, Mme O’Connor la vendit à M. Loiselet pour 22.000 francs. Depuis 1860, elle est dans la famille de M. Roger, le propriétaire actuel. Mme de Condorcet, les 6 prairial et 25 fructidor de l’an VI, acheta la plus grande partie de la propriété pour 8.600 livres. Elle compléta par l’acquisition de la chapelle Sainte-Avoie avec un terrain de 30 ares, 62 centiares, le 5 août 1807, moyennant 2.400 francs.
Ces renseignements sont dus à l’obligeance du propriétaire actuel, M. Roger, que je suis heureux de remercier ici pour ses communications si précises.—Une histoire locale raconte que les Mémoires d’Outre-Tombe furent rédigés à la Maisonnette. Jusqu’au mois de novembre 1817, ils sont datés de la Vallée-aux-Loups. Après cette date et tant que vécut Mme de Condorcet, Chateaubriand ne vint pas à la Maisonnette. Postérieurement à 1823, je n’ai rien trouvé qui confirme, ni qui infirme l’allégation de l’historien.
[196] Guizot, dans les Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, t. I, ch. VII, a donné une description de la Maisonnette au temps de Mme de Condorcet. Cette description est encore vraie aujourd’hui tant les choses ont peu changé.
[197] Inédit. Cette lettre et les suivantes font partie de la collection de l’auteur.
[198] Mme de Charrière.
[199] La Grande Rue Verte est devenue, par ordonnance du 4 novembre 1846, rue de Penthièvre, mais a repris son ancien nom de 1848 à 1852. En 1690, on l’appelait chemin des Marais; en 1734, il n’y avait encore aucune construction; en 1750, elle s’appelle rue du Chemin-Vert, puis Grande Rue Verte. La Petite Rue Verte est devenue rue de Matignon. Mme de Condorcet demeura quelque temps, en 1805, au no 2 de cette rue, chez Mailla-Garat. Elle habita aussi rue de Marigny. Dans une lettre de 1806, elle donne cette adresse: Grande Rue Verte, près de la Caserne. Enfin, à l’Annuaire du Commerce de 1812, je la vois inscrite: Grande Rue Verte, no 30. Elle quitta le faubourg Saint-Honoré à la fin de sa vie, puisqu’elle mourut, 68, rue de Seine.
[200] Deutsche Rundschau de décembre 1881. Hase naquit en 1780, se fixa en France où il fut attaché d’abord à la Bibliothèque nationale, puis devint professeur de langues orientales et membre de l’Institut.
[201] Journal intime de Benjamin Constant et lettres à sa famille et à ses amis, précédés d’une introduction par Melegari. Paris, Ollendorff, 1895, p. 93, 102 et 107.
[202] Mémoires sur le Consulat (par Thibaudeau), p. 34.
[203] Mailla-Garat. Lettre inédite, de la collection de l’auteur.
[204] Les Mémoires du général La Fayette, et spécialement le Ve volume qui comprend (p. 148 et suivantes), une notice intitulée: Mes rapports avec le Premier Consul, sont à consulter avec fruit sur ce rôle unique joué par La Fayette dans l’opposition. Ses relations avec Cabanis y sont analysées avec finesse et bienveillance.
[205] Mémoires sur le Consulat par Thibaudeau. Napoléon regardait tous les philosophes comme des boudeurs d’Auteuil (le mot est de lui), mûrs pour le Sénat, et il pensait volontiers, comme Chateaubriand, que l’Institut était une «tanière de philosophes».
[206] Il habitait Auteuil en 1796 et avait alors vingt-huit ans. Il était neveu de Dominique Garat. Lors de sa nomination au Tribunat, on avait dit:
Mailla-Garat fut, dans la suite, employé par Daunou, aux Archives; ami de Mme de Coigny, il demeurait chez elle.
[207] Daunou.
[208] Taillandier p. 121-122.
[209] Taillandier avoue ces entretiens. V. aussi les Mémoires de Rovigo, de Thibaudeau et de Fouché, l’Histoire de France de Bignon, Dix ans d’exil, par Mme de Staël, et les Mémoires d’outre-tombe.
[210] Nous employons ce titre très ingénieux donné par M. Lalanne et non par Fauriel au curieux manuscrit trouvé dans les archives de l’Institut.
[211] Garat, avec sa belle inconscience, écrivait dans son ouvrage sur Moreau: «A cette époque, il fallait tout le courage des conspirations pour oser seulement se communiquer ses pensées. Moreau, que je ne connaissais guère que par sa gloire, et moi qui ne lui étais connu que par quelques lignes écrites, garantie si peu sûre des vrais sentiments d’un homme, nous ouvrîmes nos âmes tout entières l’un à l’autre. Sans cesse occupés de la chose publique, nous avions sans cesse le besoin de nous voir. Nous nous réunissions à l’une des barrières de Paris, chez un ami commun, dans un appartement à la fois chambre à coucher, bibliothèque et salon d’un homme de lettres. C’est là que, seul, couvert d’une redingote et à pied, se rendait le vainqueur de Hohenlinden.»
[212] Taillandier, p. 117 et 118.
[213] Préfet, légionnaire et baron, Honoré Riouffe, dit Toussaint, était né à Rouen, le 1er avril 1764. Il avait fréquenté, autrefois, chez Julie Talma et avait même correspondu avec elle, à l’époque où il était acteur au Théâtre de la République à Rouen.
[214] Je dois communication de cette lettre à M. le professeur Pingaud dont les travaux sur la Révolution sont si remarqués. Dans les papiers de Jean Debry, il a trouvé quatre lettres de Mme de Condorcet: celle que nous venons de donner en partie; deux autres lettres de 1811, toujours relatives à Emeric; et une lettre datée de Meulan, an VII, dans laquelle Mme de Condorcet félicite Jean Debry du mariage de sa fille et l’invite à venir la voir dans sa nouvelle propriété.
[215] Cette lettre, véritable profession de foi, a été donnée dans le Salon de Mme Helvétius, p. 180, 181 et 182.
[216] Sur le procès de Moreau et le rôle qu’y jouèrent les Idéologues, voir l’ouvrage cité dans la note précédente aux pages 186 et 187.
[217] Genève, 3 frimaire an XI.
[218] Archives du Paty de Clam. De 1801 à 1804, Mme de Condorcet s’occupe aussi, avec Cabanis et Garat, de la publication des œuvres complètes de son mari.
[219] Marc-François Guillois, rédacteur au Moniteur, connu par des travaux littéraires, dont quelques-uns furent entrepris en collaboration avec le père de Paul de Saint-Victor.
[220] V. Pendant la Terreur: Le poète Roucher.
[221] A Mme Guillois, Auteuil, 11 germinal an XIII.
[222] Papiers de famille de l’auteur.—Voici encore quelques-unes de ces pensées d’Eulalie: «Je ne connais point de remède au défaut de tact. C’est un vice de l’organisation du cœur. Si ce premier avertissement plus prompt que la pensée ne la devance pas, tout est dit.»—«Quel dommage qu’il y ait pour l’homme que son génie inspire des lendemains comme pour le vulgaire. Un aujourd’hui de plusieurs jours ferait naître des chefs-d’œuvre que sa vie ne produira jamais. L’âme et l’esprit ont leurs crises comme la nature. Tous les grands mouvements sont rares; leur fait est d’enfanter toujours quelque chose d’extraordinaire.»—«Enthousiasme, confiance, bonté exquise, délicatesse de cœur, vivacité de tout, beau idéal, fraîcheur de sentiments, tous fruits impossibles à conserver sur un arbre que les orages du monde ont battu et souvent renversé pour toujours.»—N’est-ce pas la pensée et presque la phrase de Sophie sur «la coupe enchantée que la main du temps renverse pour la femme au milieu de sa carrière»?
[223] On a vu, plus haut, ce que pensait de lui Benjamin Constant.
[224] Auteuil, 21 brumaire an XIII. Bibliothèque de l’Institut.
[225] Mme O’Connor eut cinq garçons qu’elle allaita tous; les trois premiers moururent jeunes. Elle mourut subitement en 1859; son mari était mort le 26 avril 1852. Il fut inhumé dans le parc du Bignon.—Une lettre d’O’Connor à Parent-Réal, en juillet 1810 (collection Frédéric Masson), dans laquelle le général s’occupe des intérêts de Mme Lachèze, est écrite sur le papier des armées républicaines et orné du bonnet phrygien. Tout O’Connor est dans ce détail.—Je dois aux recherches si heureuses de M. le vicomte de Grouchy la communication de diverses pièces concernant les intérêts d’Elisa: 6 brumaire an VI (27 octobre 1797): Mme de Condorcet, agissant comme tutrice, demande à vendre des biens dans l’Aisne, près de Saint-Quentin, pour 25.000 francs.—12 thermidor an VI: Mme de Condorcet demande qu’on fixe le montant de l’éducation de sa fille. Le revenu net des terres situées dans l’Aisne, dans l’Orne et à Ribemont, déduction faite d’une rente de 3.800 francs, étant de 9.900 francs, la dépense de la mineure Condorcet est fixée à 4.000 francs.—28 mai 1803, nomination d’une tutrice (Mme de Condorcet) et d’un subrogé tuteur (Larroque, homme de lois); membres du conseil de famille: des Forges de Beaussé, messager d’État; Lachèze, juge au tribunal de cassation; Grouchy, général de division et Laromiguière.—26 juillet 1806 (Archives nationales, AA, 45, no 1349). Lettre de Mme de Condorcet, relativement à des biens dans l’Orne qui lui ont été repris et qui, d’après les intentions de l’Empereur, doivent être échangés contre d’autres domaines et non pas contre de l’argent.
[226] 23 janvier 1807.
[227] Le marquis de Grouchy était très âgé et lui-même gravement malade. Cabanis craignit de le fatiguer par sa présence; de là, son établissement à Rueil. M. de Grouchy, d’ailleurs, ne tarda pas à mourir; il s’éteignit, le 23 avril 1808, à 8 heures du matin, âgé de quatre-vingt-treize ans et demi.
[228] Dont quelques extraits ont été donnés, pour la première fois, par l’auteur dans le Salon de Mme Helvétius.
[229] Papiers de famille de l’auteur.
[230] Chateaubriand, dans les Mémoires d’outre-tombe, a cité un fragment d’une des belles pièces de Manzoni sur Napoléon: «Il éprouva tout: la gloire plus grande après le péril, la fuite et la victoire, la royauté et le triste exil, deux fois dans la poudre, deux fois sur l’autel. Il se nomma. Deux siècles, l’un contre l’autre armés, se tournèrent vers lui, comme attendant leur sort. Il fit silence et s’établit arbitre entre eux.»
[231] Ce fut une fille, Juliette-Claudine, du nom de Fauriel qui s’appelait Claude.
[232] Il y passa tout l’été et l’automne de 1820, pendant que Mme de Condorcet était retenue à Paris par sa santé.
[233] Journal intime de Benjamin Constant. Ollendorff, 1895, p. 118. Le lendemain, il se rencontre encore avec Fauriel chez Mme Récamier.
[234] En manuscrit à la bibliothèque de l’Institut. Ces deux billets sont écrits sur un papier dans le filigrane duquel on voit le profil de Napoléon, empereur des Français et roi d’Italie.
[235] Mot arabe qui signifie: ma chère âme ou mon cher cœur. Fauriel avait appris quelques mots de cette langue à Mme de Condorcet.
[236] Voir cette sortie contre l’Idéologie dans le Moniteur du 21 décembre 1812 ou dans la Correspondance de Napoléon, XXIV, p.398-399.
[237] Ou du conseil d’État, comme Guizot.
[238] Archives nationales. F. 7. 6788. 20 octobre 1815. «Le sieur Bontemps est arrêté pour loger chez lui la sœur du général Grouchy. Bontemps, employé au ministère de la marine, rue des Vieilles-Tuileries, ayant loué partie de sa maison à la dame Cabanis, sœur du général Grouchy, qui reçoit habituellement chez elle sa belle-sœur. Cette dernière a avoué à un sieur Boutard, demeurant en face, qu’elle était inquiète de son mari jusqu’à ce qu’il fût arrivé à destination. Il y a huit ans que Mme Cabanis demeure rue des Vieilles-Tuileries, no 47. La somme de 6.000 livres de sa pension pourrait être mieux employée. La rue des Vieilles-Tuileries, faubourg Saint-Germain, est extrêmement mal habitée. Tous les soirs, on chante des horreurs contre la famille de Bourbon.»
[239] Voir aux pièces annexes l’explication donnée par Grouchy de sa conduite dans ces circonstances.
[240] Mémoires du maréchal de Grouchy, t. V, p. 14 et seq.
[241] Mémoires du maréchal de Grouchy, t. V, p. 46 et circà.
[242] Manuscrit à la bibliothèque de l’Institut.
[243] Lettre communiquée par M. le vicomte de Grouchy. La pension Hix, alors située 10, rue de Matignon, et plus tard, 5, rue de Berri, avait une réputation considérable; en dehors des jeunes de Grouchy, elle compta comme élèves Alfred de Vigny et les enfants de Barante, de Ségur, de Wagram, de Valmy, Tascher de la Pagerie, etc. Cette pension suivait les cours du collège Bonaparte, aujourd’hui Lycée Condorcet. Ernest de Grouchy, ancien préfet, ancien député, officier de la Légion d’honneur, est mort en 1879. Il était le beau-père du général de Miribel.
[244] Propriété du maréchal de Grouchy, en Normandie. On voit, par la suite de cette lettre, que Mme de Condorcet continuait à exercer son influence douce, mais pénétrante et très réelle sur tous ceux qui l’approchaient.
[245] Sur Mme Ginguené, en dehors de ce qui a été dit d’elle, soit dans ce volume, soit dans le Salon de Mme Helvétius, je signalerai l’ouvrage de Lady Morgan, intitulé France, 1817, au t. II, p. 276 à 282, il est longuement question de Nancy Ginguené; signalons toutefois l’erreur qui place à Eaubonne une propriété qui, effectivement, était située à Saint-Prix. A part ce détail, la description est parfaitement exacte.
[246] Ginguené était mort le 16 novembre 1816; sa femme mourut le 14 octobre 1832. La tombe de Mme de Condorcet est des plus simples: «Ici repose Marie-Louise-Sophie Grouchy, veuve Condorcet, décédée à Paris, le 8 septembre 1822.» Elle est placée tout près de Nicolo, Cherubini, Bellini, Boïeldieu, Chopin, Lakanal, Lesueur, Denon, Regnault de Saint-Jean-d’Angély, Delille, Target, Saint-Lambert, Elzéar de Sabran et Suard!
[247] Préface par M. Lud. Lalanne des Derniers jours du Consulat, p. v.
[248] Manuscrit à la bibliothèque de l’Institut. Emmanuel de Grouchy, chargé d’affaires de France à Turin, officier de la Légion d’honneur, est mort en 1839. Il était le père de M. le vicomte de Grouchy.
[249] Lettre communiquée par Mme la générale de Miribel, petite-nièce de Mme de Condorcet. Cette lettre annonce le mariage d’Annette Cabanis avec son cousin Charles Dupaty, le sculpteur, membre de l’Institut. Henri de Grouchy demeurait, à cette époque, à Vigny, près de Meulan: toujours le même joli coin!
[250] En manuscrit à la bibliothèque de l’Institut. Il ne mourut qu’en 1844.
[251] Et cependant, Mme O’Connor jeune fille s’intéressait aux moindres indispositions de Fauriel qu’elle appelait le Gentleman; plus tard et jusqu’en 1822, les enfants O’Connor écrivaient à Fauriel comme au plus aimé des grands-pères. Les lettres manuscrites qui sont à l’Institut en font foi.
[252] Cette pièce et la suivante ont été communiquées à l’auteur par M. le vicomte de Grouchy.
| A M. le vicomte de Grouchy | I |
| Préface | III |
| LIVRE PREMIER LA CHANOINESSE |
|
| CHAPITRE PREMIER ENFANCE DE SOPHIE DE GROUCHY |
|
| Le château de Villette. — Les Grouchy. — Le marquis et sa femme. — Vie patriarcale à la campagne. — Les hôtes littéraires à Paris. — Rue Gaillon et rue Royale. — Les Fréteau, Dupaty et d’Arbouville. — Enfance de Sophie. — Son frère Emmanuel. — Sa sœur Charlotte. — Le chevalier de Grouchy. — Grave maladie en 1775. — Lectures et travaux de Sophie. | 1 |
| CHAPITRE II LA CHANOINESSE DE NEUVILLE |
|
| Les chapitres nobles de Dames. — Le prieuré de Neuville-en-Bresse. — Sophie y est envoyée. — Ses occupations. — Sa correspondance. — Sophie reçoit la visite du président Dupaty. — Son retour à Paris et à Villette. — On cherche à la marier. — Rencontre du marquis de Condorcet, chez Dupaty. | 27 |
| [p. 254]
LIVRE II LE SALON DE L’HÔTEL DES MONNAIES |
|
| CHAPITRE PREMIER PREMIÈRES ANNÉES DU MARIAGE DE CONDORCET |
|
| Le mariage. — Les calomnies de Lamartine et de Michelet. — Installation à l’Hôtel des Monnaies. — Revenus de Condorcet. — Les hôtes du Salon. — Mort de Dupaty. — Le Président laisse ses papiers à Sophie. — Fondation du Lycée. — Condorcet y professe les mathématiques. — Sophie assiste aux leçons. — La maison de Mme Helvétius à Auteuil. | 65 |
| CHAPITRE II LE SALON DE SOPHIE AU DÉBUT DE LA RÉVOLUTION |
|
| Le foyer de la République. — Condorcet et sa femme se séparent de leurs anciens amis. — Naissance d’une fille. — Pamphlets contre le marquis et sa femme. — Les Girondins chez Condorcet et chez Julie Talma. — Etablissement à Auteuil avec Jean Debry auprès de Cabanis. — Lettres sur la sympathie. — Mort de la marquise de Grouchy chez Condorcet. — Mise en arrestation de Condorcet. | 99 |
| LIVRE III LES ANNÉES DOULOUREUSES |
|
| CHAPITRE PREMIER PROSCRIPTION ET MORT DE CONDORCET. — RUINE DE SOPHIE |
|
| La maison de la rue Servandoni. — Mme Vernet. — Derniers jours de Condorcet. — Visites de Sophie au proscrit. — Testament du philosophe et conseils à sa fille. — Mort de Condorcet. — Sophie fait des portraits et vend de [p. 255] la lingerie. — Ses biens confisqués. — Elle élève sa fille et soutient sa sœur. — Belle lettre à propos de la mort de Fréteau. — Sophie traduit la théorie des sentiments moraux d’Adam Smith et publie ses lettres sur la sympathie ainsi que les œuvres de son mari. — Union de Charlotte de Grouchy avec Cabanis. | 133 |
| CHAPITRE II LA MAISONNETTE ET PARIS. — MORT DE LA MARQUISE DE CONDORCET |
|
| Mme de Condorcet recouvre ses biens. — Le muséum. — Rencontre de Fauriel. — La Maisonnette. — Le Consulat et l’Empire. — L’opposition se donne rendez-vous chez Mme de Condorcet. — Mariage d’Elisa de Condorcet avec le général O’Connor. — Mort de Cabanis. — Les hôtes de la Maisonnette: Benjamin Constant, Manzoni, Ginguené, Guizot. — Le procès du maréchal de Grouchy en 1816: rôle de sa sœur. — La marquise de Condorcet se retire du monde. — Rentrée à Paris. — Ses bonnes œuvres. — Sa mort. | 173 |
| Pièces annexes. | 237 |
| Index alphabétique. | 245 |
ÉVREUX, IMPRIMERIE DE CHARLES HÉRISSEY
Au lecteur.
L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée, mais quelques erreurs clairement introduites par le typographe ou à l'impression ont été corrigées. Ces corrections sont soulignées en pointillés dans le texte. Placez le curseur sur le mot pour voir l'orthographe originale.
La ponctuation a été tacitement corrigée à quelques endroits.