L'ILLUSTRATION
SAMEDI 10 JANVIER 1891
49º Année.--Nº 2498
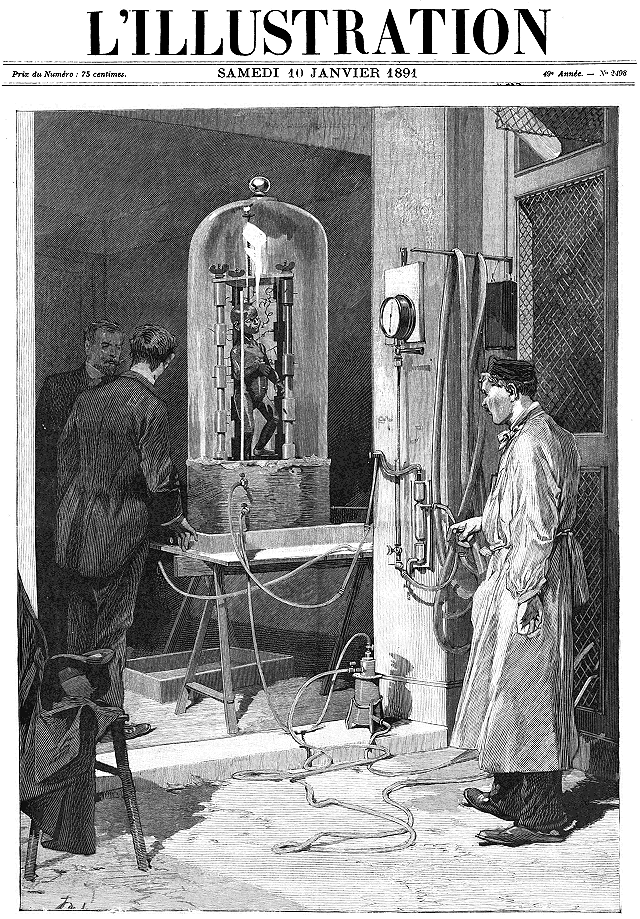
LA MÉTALLISATION DES CORPS
(Voir l'article explicatif page 40.)
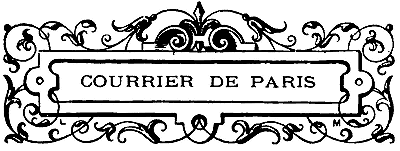
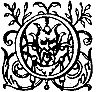 N n'a pas, à mon avis, assez parlé de l'invention nouvelle du citoyen
Maxime Lisbonne. Après la Taverne du Bagne, où des garçons vêtus en
galériens servaient des chopes de bière aux consommateurs; après les
Frites Révolutionnaires, où des gamins costumés en gendarmes montaient
à cheval pour livrer des pommes de terre frites à la clientèle, voici
que M. Lisbonne fonde un établissement de pâtisserie, une fabrique de
brioches qu'il appelle les Brioches politiques.
N n'a pas, à mon avis, assez parlé de l'invention nouvelle du citoyen
Maxime Lisbonne. Après la Taverne du Bagne, où des garçons vêtus en
galériens servaient des chopes de bière aux consommateurs; après les
Frites Révolutionnaires, où des gamins costumés en gendarmes montaient
à cheval pour livrer des pommes de terre frites à la clientèle, voici
que M. Lisbonne fonde un établissement de pâtisserie, une fabrique de
brioches qu'il appelle les Brioches politiques.
C'est un railleur, M. Lisbonne, une sorte d'Aristophane en action. Il résume toute une époque dans une étiquette. Les Brioches politiques! on pourrait croire à une revue de fin d'année. Non pas, il s'agit de brioches authentiques, cuites à point, savoureuses, et qu'on peut manger en sortant du théâtre. Mais le titre est bon, il est bien trouvé.
Que de politiciens ont fait, sans le vouloir, des brioches, tandis que M. Lisbonne les fabrique en sachant très bien ce dont il s'agit!
Je souhaite, au début de l'année 1891, que M. Lisbonne soit le seul à nous donner des Brioches politiques. Ces brioches, c'est généralement le public qui les paye, sans les avoir commandées, et il les trouve presque toujours un peu lourdes. M. Lisbonne aura rendu un grand, un signalé service à son pays, s'il garde, à lui seul, la spécialité de ces brioches-là.
Les nouveaux sénateurs se garderont d'en fabriquer, j'espère. Ils ont fleuri, le dimanche 4 janvier, par un jour de dégel, et, n'y eut-il eu pour les saluer que la température plus clémente, ils eussent été les biens reçus. Le froid, qui tue les pauvres, commençait à ennuyer les gens riches, et, quand on ne fait point partie du club des Patineurs, on ne tient pas essentiellement à avoir l'onglée. Le dégel, ce bon dégel--qui sera peut-être remplacé par une nouvelle gelée lorsque paraîtront ces lignes--l'aimable dégel a été le bienvenu. Les Parisiens ont pu, sans craindre les engelures, aller acheter leurs journaux pour voir si M. de Freycinet était élu.
Il l'était, et glorieusement. La destinée de M. de Freycinet est d'être toujours élu, et, comme ministre de la guerre, de toujours vaincre. Heureux homme, dont on célèbre tous les succès en criant: Vive l'armée!
Et, les élections terminées, on a abordé un tout autre sujet de conversation: l'affaire Fouroux, la fameuse affaire depuis longtemps célèbre sous le titre du scandale de Toulon. Elle aura plus intéressé que l'affaire Eyraud qui finit, elle, par être un jouet de l'année, un petit joujou, une malle en fer blanc que débitent les camelots à dix centimes le bibelot. Il y a un secret pour ouvrir la malle et, le secret trouvé, on rencontre un petit bonhomme en plomb qui représente plus ou moins bien l'huissier Gouffé. Étrange post-scriptum d'un drame odieux: cet assassinat devenant une question à deux sous, dont s'amusent les enfants!
Le scandale de Toulon n'est pas encore passé à l'état de sinistre joujou. Il n'est encore qu'un sujet de conversation, un de ces thèmes courants qu'on met sur le tapis, ou plutôt sur la nappe, au dessert.
--Que pensez-vous de Fouroux?
--Quel est le rôle exact de Mme Audibert?
--Fallait-il le cacher ou fallait-il avouer?
--Avez-vous vu jouer une pièce qui est de Labiche, je crois, et qui s'appelle: Doit-on le dire?
Il est bien certain que peu de causes célèbres sont aussi intéressantes que celles-là. Tout procès où il y a un grand rôle de femme, comme dans une pièce bien faite, est dramatique et attachant.
Or, dans celui-ci, il y en a deux, et M. Fouroux a pu dire que c'est parce qu'il se trouvait entre deux femmes qu'il a été perdu.
Où ai-je lu que ce procès, du premier mot au dernier, tenait dans l'exclamation du maire de Toulon: Et ma position? Rien n'est plus vrai. C'est sa position qui l'a poussé; à la fameuse noyade du fardeau de Mme de Jonquières. C'est sa position qui l'a empêché de fuir, c'est sa position qui l'a désigné à ceux qui l'ont arrêté au milieu d'une représentation théâtrale. Il n'aurait pas été Monsieur le Maire, c'est à dire l'homme chargé de représenter la Loi et de donner l'Exemple, il n'eût pas regardé comme un lieu de salut le logis louche d'une sage-femme, il eût continué à aimer (puisque cela s'appelle l'amour), et la peur du scandale ne l'eût pas conduit à un scandale pire.
Je sais bien que c'est, au bout du compte, la morale de tous les jours, la simple morale des bonnes gens, qui triomphe:
--Voulez-vous éviter un scandale? Restez tranquille, et quand on fait des ménages, comme maire, on ne doit pas en défaire, comme homme!
C'est naïf, et, comme on dit dans les ateliers, c'est tout à fait coco, mais c'est plus sûr. Et l'amour, qui excuse tout, n'excuse pas les vilenies. D'autant qu'en ces affaires, l'amour moderne se double toujours d'une question de banck-notes. On ne prend pas seulement la femme d'autrui, on lui emprunte encore son argent. Le réalisme fin de siècle ne perd jamais ses droits dans ces drames de passion contemporaine. Le proverbe anglais peut se dire non seulement Time, mais Love is money.
Comme l'affaire Gouffé, ce drame de Toulon était, du reste, fortement escompté par le journalisme et le reportage. Les rois et les maîtres du monde, ces reporters, je vous dis! Ils nous font boire en piquette de verjus tout le vin de l'actualité. On ne peut plus mourir sans qu'ils s'en mêlent. Un romancier populaire, F. du Boisgobey, est-il transporté dans la maison des Frères de Saint-Jean de Dieu? Vite, un reporter se rend rue Oudinot et compte les oreillers qui soutiennent la tête du malade. Il nous décrit les angoisses du pauvre homme, paralysé, voulant écrire un roman et ne pouvant pas. Toute agonie devient publique. M. de Goncourt, qui nous donne les menus intellectuels des maisons où il dîne, a donné le ton. C'est le maître des maîtres, le reporter des reporters.
--Mon cher, me disait un de ces lévriers de l'actualité, il n'y a plus le rideaux pour nous maintenant!
Il n'y en a point, dans tous les cas, pour le pauvre du Boisgobey qui, paraît-il--c'est toujours le reporter qui parle--n'a d'autre consolation que le regard triste de son chien qui veille à ses côtés et couve son maître de ses bons yeux effrayés... Ah! les chiens! Charlet avait bien raison de les préférer. Au moins, ils n'écrivent pas d'interviews, les chiens, ils ne font pas de copie avec les derniers moments de leur maître paralysé!
On me dira que cette réflexion est naïve, mais je vous jure que j'éprouve quelque plaisir à la faire. La publicité devient une tyrannie. On serait presque tenté de dire la même chose de la charité.
Les cartons de quêtes affluent chez les bons célibataires comme moi qui se croyaient quittes avec un sac de marrons glacés envers les présidentes de five o'clock. Mais, pour quelques tasses de thé prises dans l'année, combien d'invitations à passer au comptoir de charité ou à glisser un louis sous une enveloppe! Les bals de charité sont à la fois le tourment et le charme de l'hiver.
C'est comme les dîners de compatriotes et d'anciens camarades. Ils sont nombreux plus que copieux. Les provinces s'entendent pour manger des plats du pays. Les Parisiens se groupent pour fêter ce parisien de Molière. Les lycées et collèges ont leur banquet annuel. Les corporations s'entendent pour festoyer en commun et boire à la prospérité de leur état, les médecins aux malades et les peintres à la vente en Amérique. Au fond, c'est le triomphe de l'indigestion.
Je ne sais quel médecin disait: «Je n'ai pas besoin de savoir s'il y a des bals masqués ouverts à Paris: je le vois.
--A quoi?
--Au nombre plus grand de malades qui entrent dans les hôpitaux.
Cela n'a l'air de rien, en effet, une nuit de fête à Paris, un bal de l'Opéra, une redoute travestie, mais la laryngite et la broncho-pneumonie, qui n'y sont pas invitées, s'y invitent elles-mêmes, et les nuits de bals se soldent par des recrudescences de souffrances.
Le vieux Guy-Patin disait déjà de son temps:
--Le carnaval est mon pourvoyeur!
Nous allons entrer dans ce Carnaval, ou du moins le premier bal de l'Opéra est annoncé. On a beau dire que c'en est fait de ces bals masqués, vous voyez qu'ils durent encore.
--On prétend, disait un bon provincial que j'écoutais naguère, on assure qu'il n'y a plus d'aventures au bal de l'Opéra. Quelle erreur! Moi qui vous parle, j'en ai eu une!
--Vraiment?
--Comme je vous le dis!
--Et laquelle?
--Oh! la plus simple du monde: je m'y suis marié!
Et comme on gardait autour de lui un silence discret et d'un respect modéré:
--Oui, marié, dit-il, et avec la plus honnête fille de Paris.
Il faut lui laisser son illusion. Mais, après tout, l'improbable est possible. Un philosophe parisien, grand amateur de statistique morale, a calculé qu'il se trouve une honnête femme sur cent au bal de l'Opéra. Oh! mais non pas seulement une honnête femme dans le sens courant du mot; non, une bonne mère de famille qui, par hasard, a eu la curiosité de cet inconnu. C'est cette honnête femme qu'il s'agit de trouver dans le tas bruyant et grouillant. Et ce n'est pas facile.
Mais si les provinciaux, les barons de Gondremarck étrangers et les tout jeunes, tout jeunes gens ont encore la superstition du bal de l'Opéra, les Parisiens s'en soucient fort peu et ils s'inquiètent beaucoup plus des grandes premières à l'horizon que des descendants des Clodoches ou des pas nouveaux de la Goulue, préceptrice de Mlle Réjane. Le Mage à l'Opéra et Thermidor à la Comédie-Française hypnotisent les curiosités bien plus sûrement que M. Liégeois hypnotiserait Gabrielle Bompard. Avoir une place pour le Mage! Obtenir un fauteuil pour Thermidor!
Il paraît que tous les comédiens de Paris s'intéressent au drame de M. Sardou plus qu'à aucune autre pièce. Et la raison en est bien simple: le héros (les journaux nous l'ont assez répété) le héros de l'œuvre est un comédien. A travers l'acteur La Bussière, tous les acteurs de la capitale pourront se croire des sauveurs. Ils avaient déjà leur saint: le comédien Saint-Genest; ils auront leur d'Artagnan. Il paraît que ce La Bussière fut, au 9 thermidor, le terre-neuve d'un tas de suspects. Il sauva la future impératrice Joséphine qui lui fit, par reconnaissance, une pension, ce qui n'empêcha point le brave homme de finir dans un asile d'aliénés.
Vous verrez qu'il se trouvera des gens pour dire que La Bussière n'a jamais existé ou qu'il n'a jamais sauvé personne. Mais les comédiens n'entendront pas de cette oreille-là et ils élèveraient un monument à La Bussière que je n'en serais pas étonné.
Un monument! Pourquoi pas?--Le drame de M. Sardou n'en sera pas moins le monument le plus sûr. Et voilà qu'on va parler du cabotin ignoré autant qu'on parlerait de César, d'Alexandre, d'Antoine ou de Cléopâtre. C'est un rude tremplin de renommée que le théâtre.
Ce qui n'empêche pas un comique de talent, mais de peu de voix--celui dont Augustine Brohan a dit: «Il parle trop bas. C'est un excellent comique pour chambre de malades»--de s'écrier de temps à autre:
--Ce qui me navre, c'est que rien de nous ne survivra!
Qu'il se console: il y a si peu d'acteurs qui ont réellement vécu!
Rastignac.
NOTES ET IMPRESSIONS
Les femmes s'élèvent plus haut que nous dans la grandeur morale, mais
tombent plus vite et plus bas dans les abîmes: elles ont plus de passion
et n'ont point d'honneur.
Octave Feuillet.
*
* *
La passion nous mène assez vite sans qu'on lui aide.
Octave Feuillet.
*
* *
L'espoir est comme le ciel des nuits: il n'est pas de coin si sombre ou
l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile.
Octave Feuillet.
*
* *
A mesure que la civilisation avance, la poésie décline.
Macaulay.
*
* *
C'est le sort habituel de ceux qui osent de ne pouvoir compter sur la
justice de leurs contemporains.
Jules Ferry.
*
* *
La coquetterie est l'art de marcher sur les frontières de la pudeur sans les franchir.
*
* *
Un journal est une chaire où l'on ne prêche que des convertis.
G.-M. Valtour.
LA SOCIÉTÉ PARISIENNE
LE MONDE FINANCIER
L'emprunt d'État qui marque le début de la nouvelle année met en lumière le monde de la finance. C'est le cas ou jamais de braquer son objectif et d'essayer de le photographier.
Nous sommes déjà bien loin du temps où les financiers avaient un quartier à eux (la Chaussée-d'Antin), des habitudes, des allures, une élégance à part, des préjugés particuliers, et où ils formaient une caste tout aussi distincte des autres, tout aussi fermée, dans son genre, que le faubourg Saint-Germain.
Sous la monarchie de Juillet, la société parisienne, fort embourgeoisée pourtant, était encore divisée par catégories, qui n'avaient pas la moindre velléité de se mélanger et de se confondre, et les hauts barons de la finance, cantonnés, par la force des choses, dans leur élément et leur milieu, imbus de certaines traditions, orgueilleux à leur manière, n'aspiraient pas plus à frayer habituellement avec l'aristocratie de naissance qu'ils n'en entrevoyaient la possibilité.
De nos jours, la situation est changée. Les plus opulents et Les plus influents d'entre eux, grâce à la transformation de nos mœurs mondaines, font partie intégrante de cette élite un peu vague qu'on est convenu d'appeler la société, et quelques-uns même, par leur luxe, par leurs relations, par leur notoriété, y tiennent le haut du pavé.
Tous, cependant,--singulière anomalie--n'appartiennent pas à la coterie la plus brillante et la plus en vue, ne participent point aux honneurs de la haute vie et, en dépit de leur grande fortune, ont une existence et des salons empreints d'un cachet spécial, constituant un groupe séparé, très-différent des autres fractions du high life.
C'est affaire de relief personnel, d'influence, de chic, de hasard et, bien souvent aussi, de goûts, de caractère et de tempérament. Il est des personnalités financières, que je pourrais citer, qui n'auraient qu'à vouloir pour figurer d'emblée au premier rang du monde élégant et fashionable et qui ne s'en soucient à aucun degré. Il en est d'autres, en revanche, qui mettent tout en œuvre pour y être admis et qui n'y parviennent qu'imparfaitement ou, tout au moins, péniblement.
Toutefois, le plus grand nombre, pour peu qu'il le désire et le recherche, fréquente aujourd'hui chez les duchesses, et y est traité sur le même pied que les gentilshommes de vieille roche, voire avec une nuance parfois assez marquée de déférence, de courtoisie et d'attentions. La ligne de démarcation est, en tous cas, complètement effacée, et l'on peut dire hardiment que, désormais, la fusion est accomplie.
Mais, de ce que le monde financier est actuellement au niveau des autres, de ce qu'il s'amalgame et fait en quelque sorte corps avec eux, il ne s'ensuit pas qu'il ait cessé d'exister ni qu'il ait entièrement perdu son individualité et sa couleur. Il a, au contraire, une physionomie propre, une tournure d'esprit, des façons, des idées qui lui appartiennent, qui se retrouvent dans l'intimité et qui, en dehors du grand tourbillon mondain auquel il se mêle, en font un tout original et relativement homogène.
Il renferme, en outre, des personnalités saillantes, qui occupent une place assez importante sur la scène parisienne et qui méritent d'être signalées.
LES PRINCES DE LA FINANCE
C'est leur ensemble qui compose ce que, dans le langage des affaires, on désigne sous le nom de haute banque. Les uns comptent parmi les illustrations de la société juive, dont j'ai parlé dans un de mes précédents articles; les autres, qui ont eu pour point départ et pour principal appui un noyau de protestants rigides et laborieux, en majorité d'origine étrangère, sont venus de différents points de l'horizon, et sont arrivés par des voies diverses au faîte de la prospérité et des grandeurs. C'est de ces derniers seuls que j'ai à m'occuper ici.
Aucune féodalité n'a jamais été plus puissante, plus hautaine et plus exclusive que celle de la haute banque. C'est peut-être le seul milieu où, présentement, l'on trouve une hiérarchie bien établie et des usages aristocratiques invétérés. Non pas assurément que, pour y être reçu, il soit nécessaire de prouver trente-deux quartiers de noblesse; mais il faut, si l'on est banquier ou homme d'affaires, être classé dans la première catégorie, ne participer qu'à des entreprises d'un certain ordre et avoir une réputation d'honorabilité financière solidement établie.
Autant les princes de la finance se montrent faciles et accueillants envers les oisifs jouissant de quelque notoriété, autant ils sont méticuleux, difficiles et intransigeants en ce qui concerne la fréquentation de leurs collègues ou de ceux d'entre les financiers qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme leurs inférieurs.
Les Hottinguer, les Mallet, les Pillet-Will, les André, sont encore moins accessibles au commun des mortels de la finance que les plus grandes maisons du noble faubourg et rien n'est plus curieux, dans ce siècle égalitaire, que de voir le prestige extraordinaire que ces grands Pontifes de l'argent ont conservé aux yeux des humbles de leur corporation. Disons, pourtant, pour être juste, qu'ils ne le doivent pas seulement au chiffre imposant de leur fortune, au pouvoir dont ils disposent par ce fait, et que leur droiture, leur correction, leur dignité, y sont aussi pour quelque chose.
La famille des Hottinguer est une véritable dynastie.
Ils sont six, ni plus ni moins, tous membres du Jockey-Club, tous très lancés, très répandus et très bien placés dans le monde.
Leur chef, le baron Rodolphe, a été un des fringants cocodès du second empire. Aujourd'hui marié, il se consacre tout entier à son intérieur, à la haute direction de ses importantes affaires et aux réceptions mondaines, pour lesquelles il a un goût très accentué. Devenu aussi paisible et sérieux, je dirai presque aussi taciturne, qu'il était jadis gai et en train, il a pris dans son extérieur un je ne sais quoi de froid et de guindé derrière lequel il dissimule un fonds de bonhomie, de cordialité et de bonne camaraderie, que les années n'ont point entamé.
Ses dîners, triés sur le volet avec un soin et une préoccupation de l'élégance que d'aucuns trouvent excessifs, sont des plus brillants et des plus courus. Il n'y a que la fine fleur de la crème qui y soit priée. J'ajoute que la baronne, toujours très belle et l'une des femmes les plus aimables qu'il soit possible de rencontrer, fait les honneurs de son magnifique hôtel avec une grâce captivante et contribue plus que tout le reste à l'éclat exceptionnel de son salon.
Le comte Pillet-Will est le contemporain du baron Hottinguer, dont il a été, dans sa jeunesse, le compagnon de plaisirs. Il est, lui aussi, de souche protestante; mais, par suite de l'abjuration de son père au catholicisme, il est né catholique et on le dit catholique fervent.
Très absorbé par l'administration de capitaux considérables, éloigné du monde depuis un certain temps par des considérations d'ordre privé, il a un peu restreint son train de maison, naguère des plus somptueux, raréfié surtout ses soirées et ses dîners, et il occupe la plus grande partie de ses loisirs en allant au Jockey-Club, où il est l'un des membres les plus actifs du comité.
Les Mallet, les André, les Girod, représentent, en ce moment, la banque protestante pure et, bien qu'ayant une existence très fastueuse et très large, ne prennent pas une part bruyante au mouvement mondain.
M. Alfred André, qui est une autorité et une puissance dans le clan de la religion réformée, est également un des deux ou trois piliers les plus solides et les plus considérables de la haute banque.
Quant à M. Edouard André, dont la position de fortune est hors de pair, il n'a jamais été dans les affaires. Après avoir servi dans la garde impériale, il est rentré dans la vie privée, a été nommé député sous l'empire et a épousé, comme on sait, Mlle Jacquemard. Les fêtes qu'il a données, à diverses reprises, dans son habitation princière du boulevard Haussmann ont eu trop de retentissement pour qu'il soit nécessaire d'y revenir.
A ce groupe se rattache M. Michel Heine, qui n'a d'israélite que le nom et dont la charmante fille, après avoir été duchesse de Richelieu, s'est remariée récemment avec le prince souverain de Monaco.
Le frère aîné de M. Michel Heine, M. Armand Heine, un bourru bienfaisant, mort depuis plusieurs années, a laissé, de son côté, une fille pleine d'esprit, de distinction et de mérite, qui a épousé, l'an dernier, un jeune et sémillant député, bien connu sur le turf, M. Achille Fould.
Que dire de M. Ed. Joubert, de M. Blount, du baron de Soubeyran, de M. Germain, de M. Donon, etc., etc., qui tous, à des degrés divers, doivent être catalogués dans le livre d'or--c'est bien le cas de le dire--dans l'almanach de Gotha du monde de la haute finance?
M. Joubert, une physionomie sympathique s'il en fut, un esprit éminent, un cœur généreux, qui a fait bien des ingrats, est très lancé dans les régions les plus huppées et les plus en vue, où il est fort goûté et fort apprécié. C'est le financier swell. Son fils est fiancé à Mlle de Chevigné.
M. Blount, un type accompli de galant homme et d'aimable vieillard, un Anglais de la bonne école, a été de tout temps choyé et estimé par ce qu'il y a de plus pur et de plus chatouilleux dans la bonne compagnie. Son fils s'est allié à Mlle de la Rochette, fille de feu le célèbre sportman.
Le baron de Soubeyran a, par sa femme, Mlle de Saint-Aulaire, un pied dans l'aristocratie de naissance. Froid, sec, gourmé, mais poli et de façons excellentes, il a le masque et la tournure d'un diplomate plutôt que d'un banquier. Trop occupé et trop préoccupé pour aimer le monde, il reçoit peu et ne fait que de courtes apparitions dans les salons en vogue.
M. Germain est encore plus un homme politique remarquable qu'un financier de haute volée. Par ses relations et sa manière de vivre, il appartient dans une égale mesure à ces deux branches de la société.
Enfin, M. Donon, très âgé, s'est confiné dans les joies de la famille. Il a fait de sa fille une comtesse en la mariant avec M. de Kergorlay et il se perfectionne paisiblement dans l'art d'être grand-père.
LES BANQUIERS
Je veux désigner par là tous les chefs de maisons de banque et grands spéculateurs professionnels, quels qu'ils soient, qui ne peuvent pas prétendre à être inscrits sur la liste des princes de la finance.
Le nombre en est grand, les variétés infinies et les bornes dans lesquelles ils sont renfermés malaisées à tracer. Ils se voient beaucoup entre eux avec autant de tenue et d'étiquette, mais avec plus de luxe et de profusion que la plupart de ceux qui ont la prétention de donner le ton à la société parisienne et s'amusent davantage que qui que ce soit.
En outre, ils vont, quand bon leur semble, et selon les conditions personnelles dans lesquelles ils se trouvent, un peu partout, sauf, peut-être, chez les sommités de la haute banque, et ils rivalisent constamment de faste et d'élégance raffinée.
Le milieu qui a pour centre et pour pivot M. et Mme Gaston Ménier, les Laveyssière et quelques autres, personnifie ce genre de société. Nulle part il y a plus de jolies personnes, plus de ravissantes toilettes, plus de recherche et de confortable, plus d'animation et d'entrain.
Je citerai aussi, dans le même ordre d'idées, M. et Mme de Werbrouck. Cette dernière, née princesse Souzo, joint aux charmes corporels une grande originalité dans l'esprit et une amabilité qui ne se dément jamais.
LE MONDE DE LA BOURSE
En d'autres termes, la compagnie des agents de change, des coulissiers, des intermédiaires en général et de tout ce qui gravite dans leur orbite.
Je ne sais pourquoi, les membres de cette corporation, qui renferme beaucoup d'individualités puissamment riches, d'un niveau social élevé et d'une parfaite distinction, tels que furent les Moreau, les Dreux, les Mahon, les Dutilleul, tels que sont les Hart, les Giraudeau et une foule d'autres, fraient peu ou point avec les banquiers.
C'est une tradition qui remonte à une époque fort éloignée et qui s'est maintenue, sans qu'on en comprenne très bien la raison d'être.
Toujours est-il que c'est là une coterie à part, d'un caractère tranché, d'une composition spéciale, et qui, tout en ne le cédant en rien, comme faste et comme élégance, à celle de la Banque, s'en différencie par certaines nuances et, surtout, par les attaches professionnelles de ceux qui en font partie.
A vrai dire, je ne crois pas que cette classification subsiste bien longtemps. Elle est, sans qu'il y paraisse, en train de s'effacer comme toutes les autres, et rien ne me surprendrait moins que de la voir cesser prochainement.
Qui vivra verra.
Tom.
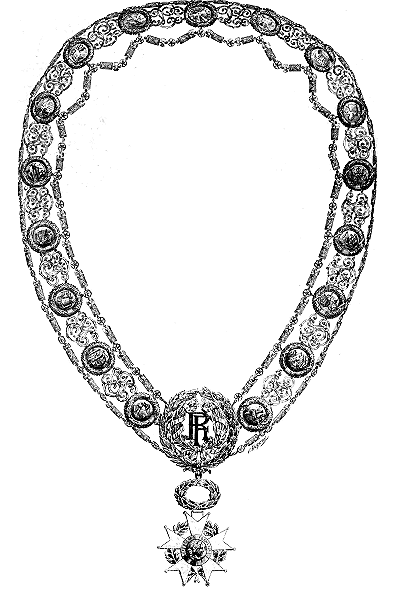
LE GRAND COLLIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
L'Ordre national de la Légion d'honneur comporte, on le sait, comme insigne, une croix à cinq branches double: d'argent pour les chevaliers, d'or pour les grades supérieurs, elle est attachée par un sumple ruban pour les premiers, et par un ruban surmonté d'une rosette pour les officiers; les commandeurs la portent en sautoir: les grands officiers, sur le côté droit de la poitrine, sous forme de plaque ou étoile en argent diamanté, et les grands-croix, suspendue à un large ruban en écharpe passant sur l'épaule droite.
Mais il existe encore un autre insigne, unique celui-là, le grand collier, qui personnifie et représente en quelque sorte l'ordre tout entier, et ne peut être porté que par le chef de l'État en raison même de sa fonction, et parce qu'elle le constitue en même temps chef souverain et grand-maître de l'ordre.
C'est c'est ce collier de la Légion d'honneur que nous reproduisons ici d'après le dessin original et officiel du bijou qui existe dans la salle du conseil de l'ordre à la Grande-Chancellerie. Au bas du document on lit: «Vu et approuvé, le 11 juillet 1881, Jules Grévy», et au-dessous: «Pour exécution, général Faidherbe».
Comme l'indique cette date le grand collier n'existait plus depuis la chute de l'empire, sous la présidence de M. Grévy, il fut reconstitué sur le modèle actuel par le bijoutier de l'ordre.
Le bijou est en or massif ciselé. Il se compose de deux rangs de faisceaux consulaires séparés entre eux par des étoiles, et entre lesquels courent dix-sept attribut différents, enfermés dans des couronnes de chêne et laurier et représentant les arts, les sciences, l'agriculture, le commerce, l'industrie, etc..., etc.; ces attributs sont séparés eux-mêmes les uns des autres par les lettres H. P. entrelacées (Honneur et Patrie).
L'ensemble forme un collier dont les deux extrémités inférieures viennent se rejoindre sur une double couronne de chêne, laurier et palmes enrubannées, contenant à son centre le monogramme R. F. A la double couronne pend la croix réglementaire. Ce bijou a coûté dix mille francs.
Il doit servir au chef de l'État dans les grandes cérémonies et se transmet à son successeur. La remise lui en est faite officiellement par le grand-chancelier lui-même. Le grand collier de la Légion d'honneur n'est donc pas l'insigne d'un grade personnel, il ne confère aucun privilège, ne comporte aucun traitement.
Ajoutons que dans la pratique le président de la République ne met
jamais le grand collier qui ferait d'ailleurs un singulier effet sur
l'habit noir et ne se comprend guère qu'avec le grand manteau d'hermine
d'un souverain En grande cérémonie, le Président porte l'insigne de
grand-croix, qui lui appartient en propre, dont il est et dont il reste
de droit titulaire, même lorsqu'il est descendu du pouvoir. C'est ainsi
que parmi les 70 grands-croix actuels l'almanach national contient les
noms de M. le maréchal de Mac-Mahon, qui l'était d'ailleurs bien avant
sa présidence, et celui de M. Grévy.
Hacks.
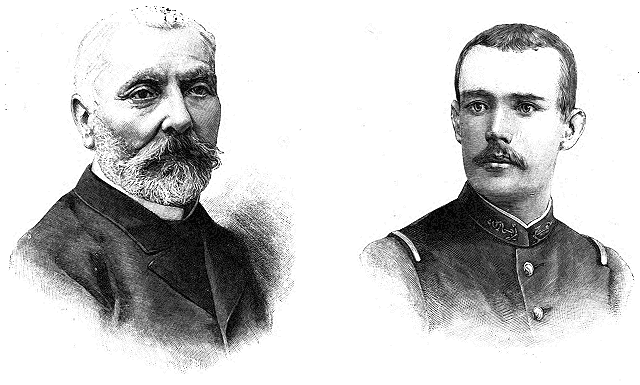
L'AMIRAL AUBE D'après une
LE LIEUTENANT PLAT
photographie de M. Pirou.
tué au Tonkin le 13 novembre 1890.
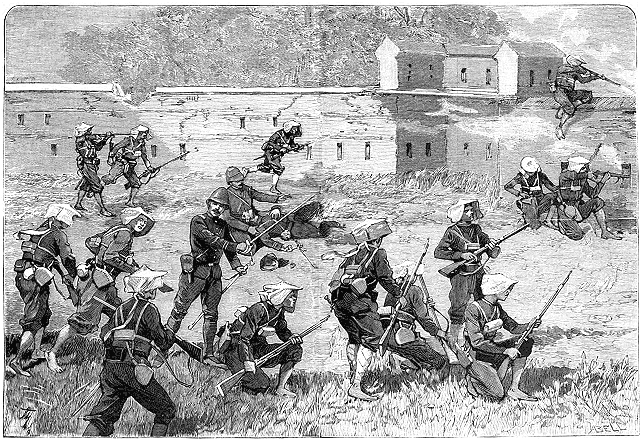
AU TONKIN.--Mort du lieutenant Plat, de l'infanterie de
marine, à la prise de Long-Sat.
VOYAGE SUR LA PLANÈTE MARS
Suite.--Voir notre dernier numéro.
III
Les canaux sont quelquefois complètement invisibles, dans les meilleures conditions d'observation. Cela paraît arriver de préférence vers le solstice austral de la planète.
Leur largeur est très différente. Ainsi le Nilosyrtis mesure quelquefois 5° ou 300 kilomètres de largeur, tandis que d'autres mesurent moins de 1° ou 60 kilomètres.
Quelques-uns sont d'une immense longueur, plus du quart du méridien, plus de 5,400 kilomètres.
Tous changent de largeur.
Tous, ou presque tous, se dédoublent.
C'est le procédé de ce dédoublement qui est encore le plus curieux. En deux jours, en 24 heures et quelquefois moins, la transformation est opérée, et simultanément sur toute la longueur du canal. Quand la transformation va avoir lieu, le canal, jusque-là simple et net comme une ligne noire, devient nébuleux, plus large qu'il n'était. Puis cette nébulosité se transforme en deux lignes droites parallèles, comme si une multitude de soldats dispersés s'étaient tout d'un coup, à un signal donné, rangés sur deux colonnes. La distance entre les deux canaux parallèles résultant de la gémination est en moyenne de 60° ou 360 kilomètres.
Elle n'est quelquefois que de 3° ou 180 kilom. pour de petits canaux très minces; quelquefois, au contraire, elle s'élève à 10°, 12° et même davantage, c'est-à-dire à 600, 700 kil. et plus, pour des canaux longs et larges.
Quand un canal double est coupé en deux sections par un autre canal, si l'une des bandes est plus large ou plus intense d'un côté de l'intersection, l'autre bande le sera aussi, comme le montre la figure ci-après.
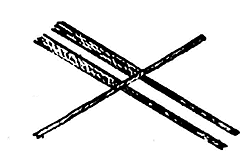
Fig. 11.
Si l'une d'elles est très mince ou peu visible d'un côté de l'intersection, il en est de même de l'autre, et dans ce cas il arrive parfois que l'une des deux manque complètement et que le canal paraît double d'un côté et simple de l'autre.
Le canal transversal agit donc sur le premier.
Quelquefois les deux lignes sont régulières et leurs axes parfaitement parallèles, mais le tout est entouré d'une espèce de pénombre. En général, au contraire, les deux lignes sont tracées avec une régularité absolue et offrent une netteté toute géométrique. Il y a plus, le dédoublement d'un canal fait disparaître les irrégularités qui auraient pu exister dans un canal simple, et même des canaux sensiblement courbes donnent naissance à des géminations parfaitement droites, comme il est arrivé pour la Jamuna en 1882 et pour la Boreosyrtis en 1888.
L'aspect d'une gémination change souvent suivant les époques. En 1882, par exemple, deux bandes de l'Euphrate montraient une sensible convergence vers le nord, tandis qu'en 1888 les deux bandes étaient équidistantes tout du long. L'intervalle entre deux bandes varie également ainsi que la largeur de ces bandes, suivant les années.
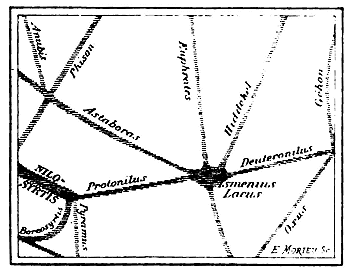
Fig. 12.--Lac formé par l'intersection de plusieurs
canaux.
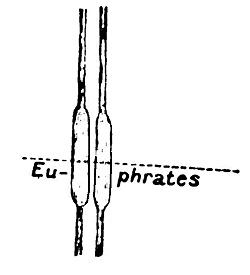

Fig. 13.
Fig. 14.
Aux points d'intersection où les canaux, simples ou doubles, se rencontrent, on remarque souvent une tache qui donne l'idée d'un lac. L'aspect de ces nouds change d'une manière analogue à celle des canaux. Lorsque les canaux qui, aboutissent à un nœud sont tous invisibles, le nœud est invisible aussi, ou s'annonce tout au plus par une ombre légère et diffuse. L'apparition des canaux, simples ou doubles, donne naissance à une tache confuse, qui parfois se dédouble dans la direction du canal le plus fort. Ainsi, par exemple, en 1881, le canal Protonilus, qui est coupé par l'Euphrate, était double et épais; le lac Isménius, formé par cette intersection, s'est montré sous l'aspect de la fig. 13. En 1888, au contraire, après la gémination de l'Euphrate, ce lac a offert l'aspect de la fig. 14.
Ensuite il reprit sa forme ovale habituelle.
Un phénomène identique a été observé sur le lac de la Lune en 1879 et 1882.
Si nous admettons ces observations--et il paraît difficile de s'y refuser--nous devons en conclure que tout cela est fort variable. La cause productrice de ces géminations n'opère pas seulement le long des canaux, mais encore sur des taches de forme quelconque, pourvu qu'elles ne soient pas trop vastes. Cette cause paraît étendre sa puissance même sur les mers permanentes. Nous en avons eu une nouvelle preuve cette année par le dédoublement horizontal du rivage dessiné fig. 15.
Cette tendance à diviser un espace sombre par une bande jaune se manifeste aussi par la production d'isthmes réguliers qui se forment en certains endroits de l'hémisphère boréal de la planète.
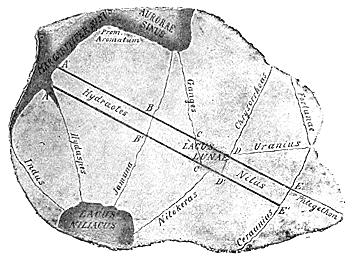
Fig. 15.
Ces variations ont un rapport avec les saisons. Considérons encore, par exemple, celles que M. Schiaparelli a observées sur le grand canal Hydraotes-Nilus. Lorsque ce grand canal est double, et se présente sous l'aspect de la fig. 15, on voit qu'il est traversé d'abord en B par la Jamuna, ensuite en C par le Gange, en D par Chrysorrhoas et en E par un quatrième, qui tous d'ailleurs changent aussi de largeur et deviennent doubles en certaines époques. Voici le procédé du dédoublement de ce grand canal.
En 1879, l'équinoxe de printemps est arrivé sur Mars le 22 janvier. Un mois auparavant, le 21 décembre, le Lacus Lunæ s'assombrit et s'agrandit.
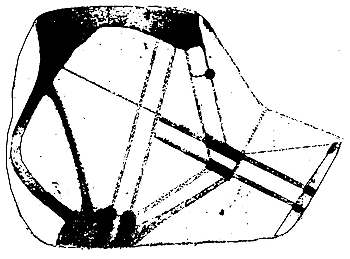
Fig. 16.--Lac double formé par l'intersection de canaux
dédoublés.
Le surlendemain, 23 décembre, il prend la forme d'un trapèze CC' DD' formé par quatre bandes noires; au milieu, l'île est bien définie et de la couleur jaune ordinaire; Nilus est simple dans la direction D' E'. Le 26 décembre, il est double, les deux traits parfaitement égaux, mais moins larges et moins sombres que les deux côtés du Lac de la Lune.
Les observations relatives à ce procédé de dédoublement sont reprises au retour de la planète, en 1881. Cette année le même équinoxe est arrivé le 9 décembre. Le Lac de la Lune ainsi que le Gange sont bien marqués; le Nil est simple, rien en C D. Le 11 janvier, il devient double; le 13, il en est de même du Gange; le 19, le Lac de la lune a repris la forme trapézoïdale avec son île jaune au centre. Le 23 février, Hydraotes est doublé dans la section Bc B' c', mais reste simple dans la section AB (fig. 16).
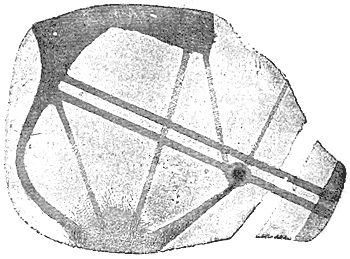
Fig. 17.--Canaux dédoublé? et élargis sur tout leur
parcours.
Ces curieuses constatations sont reprises en 1886. Le 27 mars. Hydraotes et Nilus sont vus clairement doubles, comme le montre la fig. 17; les deux bandes sont très larges (environ 4° ou 240 kilomètres), d'une couleur rougeâtre plus foncée que le fond jaune environnant; leur intervalle est de 9° ou 10°. Nilokéras, que nous avons vu mince comme un fil sur la fig. 15, est très large et aboutit à un gros point noir placé en C'. Les autres canaux: Hydaspes, Jamuna, Gange, Chrysorrhoas, Fortuna, sont visibles, mais aucun d'eux ne paraît double, le 31 mars, solstice boréal.
Ces variations montrent une certaine suite régulière. Elles sont d'ailleurs certaines et incontestables.
IV
Tels sont les faits qui viennent d'être observés sur la planète Mars. Nos lecteurs les connaissent maintenant avec précision. Ce ne sont point là des conceptions imaginaires, mais des observations authentiques, et peut-être même aura-t-on trouvé notre exposition un peu techique et dépourvue d'ornements: elle n'en a que plus de valeur intrinsèque.
Avouons maintenant qu'il est plus facile de les décrire que de les expliquer. Nous n'avons rien d'analogue sur la Terre.
L'eau, cet élément mobile par excellence, doit y jouer un grand rôle. Elle existe certainement dans l'atmosphère et à la surface de Mars, puisque l'analyse spectrale le démontre et que nous la voyons sous forme de nuages et de neiges; la photographie a même saisi sur le fait cette année, au mois d'avril dernier, une tempête de neige qui en 24 heures a couvert sur Mars un territoire plus grand que celui des États-Unis. Peut-être pourrions-nous imaginer que l'eau existe là dans un cinquième état, intermédiaire entre le brouillard et le liquide. Sur la Terre, elle nous présente quatre états bien différents: l'état solide de la glace et de la neige (qui sont déjà différents l'un de l'autre), l'état liquide habituel à la température et à la pression atmosphérique moyennes, l'état vésiculaire des brouillards et des nuages, et l'état invisible de la vapeur transparente.
Nous pourrions imaginer une cinquième forme, l'état visqueux, qui permettrait d'expliquer ces formations variables dont la durée pourtant atteint plusieurs mois. Mais pourquoi ces lignes droites et pourquoi ces dédoublements? Nous n'avons pas encore trouvé; mais il n'est pas interdit de chercher.
Sans avoir la prétention d'expliquer ces bizarres phénomènes, il nous a
paru intéressant de les exposer tels qu'ils viennent d'être observés.
Assurément ils nous transportent sur un autre monde, bien différent de
celui que nous habitons, quoique offrant avec lui de sympathiques
analogies. Au point de vue de l'atmosphère, des saisons, des climats,
des conditions météorologiques, Mars paraît habitable, aussi bien et
même mieux que la Terre, et peut fort bien être actuellement habité par
une race humaine très supérieure à la nôtre, étant, selon toute
probabilité, plus ancienne et plus avancée. L'industrie de ces êtres
inconnus est-elle entrée pour quelque chose dans le tracé de ces canaux
rectilignes qui se dédoublent en certaines saisons? Reste-t-elle
étrangère à ces variations si soudaines et si énigmatiques que nous
observons d'ici? Il faudra sans doute encore bien des années
d'observation pour découvrir exactement ce qui se passe chez nos voisins
du ciel.
Camille Flammarion.
QUESTIONNAIRE
N° 16.--Paris et Province.
Quels sont les Avantages et les Inconvénients de la Vie de Paris et de la Vie de province?
(14 Juin 1890.)
Le Comble de la Curiosité: Un jeune homme oisif a passé des nuits d'hiver dans une diligence qui stationne sur la place en étoile, pour le seul plaisir de savoir où allaient les gens qui sortaient de chez eux et qui rentraient tard.--Un Rural.
En Province, on connaît le passé, le présent et l'avenir, comme la sorcière qui dit la bonne aventure aux autres et qui ne connaît pas la sienne; on est au courant de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce que vous pensez; de votre position, de votre fortune et de vos relations. On compte les visites de Madame, ses sorties et ses entrées; on tient note du nombre exact de ses robes et de ses chapeaux, et combien elle les a mis de fois dans l'année. On sait quel journal reçoit Monsieur, le menu des repas par les achats au marché, les acquisitions dans les magasins et les boutiques. On voit tout, on entend tout, on sait tout; ce qu'on ne voit pas, on le devine; on invente ce qui peut exister et même ce qui n'existe pas. On a beau murer sa vie privée, c'est comme si on habitait une maison de verre, ou si les voisins possédaient l'Anneau de Gygès. --Une Abeille de la ruche.
Et comment s'en défendre? On chatouille, on pince, on griffe, on mord, on déchire à belles dents. Personne n'échappe à la sagacité malveillante, personne ne trouve grâce devant la jalousie haineuse, nul n'est épargné; tout le monde en fait autant, du haut en bas, et partout c'est la même chose. Le prédicateur fulmine en chaire dans ses sermons à personnalités sur la médisance; les belles Madames vont à la grand'messe en musique comme à l'Opéra, aux places réservées et en toilettes à tout éteindre, pour voir et pour être vues. Le menu fretin des ouailles ne donne pas sa part au chat en sortant de l'église; si les gros mangent les petits, les petits les piquent: il y a des arêtes.--Colombe noircie.
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'échapper longtemps à la curiosité active et pénétrante d'un microcosme où domine l'élément féminin. Toutes les personnes qui le composent se connaissent à fond, et elles n'ont guère d'autre sujet d'entretien, d'étude et d'observation, que les menus événements d'une existence fermée, oisive, monotone et insignifiante. La conversation languit souvent, faute d'aliments substantiels, et tourne dans le cercle vicieux du serpent qui se mord la queue.--Pigeonne.
On n'a pas tous les jours une nouvelle proie à se mettre sous la dent. C'est une manne tombée du ciel que la découverte d'une flirtation platonique. On comprend qu'une intrigue, même la plus innocente, sur un théâtre aussi vide et aussi exigu, soit le point de mire de tous les regards, le sujet favori de tous les papotages. On s'y cramponne, on le retourne dans tous les sens et sous toutes les faces. L'œil attentif devient alors un microscope qui voit une poutre dans la paille du voisin, d'un fil on fait un câble, qui se tresse en filet de Vulcain, et les actes les plus banals sont pesés dans des balances en toile d'araignée. Par exemple, comme renseignements, c'est complet; aucune police de l'Europe n'est comparable à l'ingéniosité des gens d'une Petite ville, c'est une justice à leur rendre.--Le Père Spicace.
Il y a des êtres, et ils ne sont pas assez rares, à qui le bonheur ou le plaisir des autres cause une véritable souffrance, et qui se crèveraient un œil pour aveugler le voisin. Il semble qu'être heureux, ou seulement le paraître, est une injure qu'on leur fait, et cette espèce, qui se rencontre à tous les degrés de l'échelle, a cette perspicacité instinctive particulière aux animaux malfaisants. Un esprit vulgaire n'a pas assez d'étoffe pour être bon; là où il y a une intelligence étroite et bornée, il n'y a pas de ressource, et on peut affirmer ce principe, que toutes les bêtes sont méchantes. L'envie est la maladie nationale de la Province; elle se révèle par la joie secrète qu'inspire le malheur des autres.
C'est ici que fleurit l'engeance des plaigneurs qui, sous prétexte de consolations, avec des phrases doucereuses et perfides, sous lesquelles percent la sécheresse du cœur et la fausseté du caractère, ravivent la blessure et retournent le fer dans la plaie.--Vinaigriot.
Un Provincial n'a pas l'habitude de raconter ses projets et de prendre l'avis du conseil de la commune pour les exécuter, ce qui fait que les gens en sont parfois réduits aux suppositions. A défaut de la réalité, l'imagination travaille, les langues vont bon train, chacun s'ingénie à deviner; mais, comme on dit, où il n'y a rien le roi perd ses droits; à la fin de tous les bavardages, chacun en est pour ses frais et l'appétit de curiosité n'est pas calmé, faute d'aliment solide. Comme on connaît les saints, on les honore, dit un autre proverbe, et quand on est du pays, on n'élève pas les commérages à la hauteur de la calomnie. On garde ses secrets, et on en est quitte pour répondre d'un air bon enfant aux questionneurs indiscrets: «Vous voulez tout savoir et ne rien payer.»--Codex.
Pont-à-Mousson n'est qu'une toute petite ville, monsieur, moins grande que Carcassonne, moins connue que Brives-la-Gaillarde et moins célèbre que Landerneau; eh bien, on pourrait en faire le tour, sans y rencontrer une personne aussi curieuse qu'un journaliste.--Jean Suie.
Le monde le plus raffiné ne supporte pas volontiers le spectacle du bonheur, le vulgaire ne pardonne même pas le plaisir des fêtes dont il a sa part. C'est l'éternelle histoire du Chien du jardinier, qui ne mange pas de pommes, et qui ne permet pas aux autres d'y toucher.
Est-ce qu'on laisse tranquilles deux êtres qui s'aiment, dans un salon de Paris? Est-ce qu'un garçon de charrue peut aimer en paix une fille de ferme, dans un village? A Paris on se dérobe, au hameau on se cache; en Province, c'est impossible, sous le feu de mille paires d'yeux d'Argus. Si on traverse une rue: «Tiens, où va-t-il? Qu'est-ce qu'il va faire par là?» Si vous fréquentez une maison, c'est qu'il y a anguille sous roche et on cherche la femme; si les visites sont régulières, on la trouve, et si elles continuent, on la nomme.--Lucrèce.--E. Teignoir.
La grande différence de Paris et d'une Petite ville, c'est que le Parisien voit tout à travers le journal, tandis que le Provincial voit tout par ses yeux, et examine avec une profonde attention ce qui se passe dans sa ville. Le plus petit événement, le moindre changement, tout est un sujet de curiosité et de conversation, tout se remarque et se discute, une maison qu'on bâtit, un arbre abattu sur la promenade, le départ et l'arrivée du train, le passage d'une voiture, la présence d'un étranger ou d'un commis-voyageur. Toute la Province se résume en deux mots: «Voir et Savoir.»--Argus.
A Paris, le voisin n'existe pas; quand on veut s'amuser de son prochain et rire des choses comiques, il faut aller au Palais-Royal ou aux Variétés. Ici, on a le plaisir du spectacle journalier, chez soi, chez les autres, à l'église, au marché, à la promenade, dans la rue, partout. Il est vrai que lorsqu'on a la comédie sous les yeux, on est à la fois spectateur et acteur, et les autres s'amusent de moi comme je me divertis d'eux. Riez les uns des autres, et faites à autrui ce qu'on vous fait; c'est le libre-échange, un prêté pour un rendu avec des intérêts sémitiques. Cela ne tire pas à conséquence et n'empêche pas les sentiments, au contraire. On a besoin des voisins, aussi bien pour s'entraider que pour se distraire. Il faut se connaître, s'aimer et se servir depuis longtemps, pour s'éplucher avec délices et se rendre service à l'occasion.--Mère Michel.
A Paris, on reste rarement chez soi, en famille; on se mêle au mouvement de la vie générale, on appartient à tout le monde; on est sceptique, égoïste, indifférent, mais on n'est pas haineux. On ne peut haïr des inconnus; ceux qu'on connaît sont nombreux, et on les voit rarement, rapidement, sans intimité.
La jalousie, l'envie, la haine, l'espionnage, la malveillance, la calomnie, exigent des loisirs et de l'activité. En dehors du Travail et du Plaisir, on n'a le temps de rien, les heures sont dévorées, et on les dépense autrement qu'à s'occuper des autres et de leurs affaires. A part les concierges, les domestiques et les fournisseurs, gens intéressés à savoir, les locataires d'une maison ne se connaissent pas même de nom, et le deuxième étage ignore ce qui se passe au-dessus de sa tête et sous ses pieds. Le commérage est circonscrit et localisé dans un cercle très restreint, la maison et les abords; pour les maisons voisines, on est un inconnu; aux extrémités de la rue, on serait un étranger; quand on change de quartier, c'est absolument comme si on changeait de pays. Mais les hommes sont partout les mêmes, on est aussi curieux dans les capitales que dans les petites villes; seulement, en province, on patauge dans une mare; à Paris, on glisse sur un lac, et quand on potine ensemble, c'est à la manière des cygnes qui acceptent le voisinage des canards.--Loque à terre.
Paris a une capacité d'attention, c'est trois jours; les nouvelles ne durent jamais plus longtemps, et les absents vont vite. Toutefois, ce serait une erreur de croire et il serait inexact de dire que le monde oublie; le monde n'oublie rien. Ce qui est vrai, c'est que son attention étant toujours sollicitée par des sujets nouveaux, il ne s'occupe pas longtemps de la même chose; mais il revient volontiers, et le moindre incident remet sur le tapis une histoire qu'on croyait bien enterrée ou passée à l'état légendaire. Enfin, s'il juge trop souvent d'après les on-dit et sur les apparences, c'est qu'il ne connaît pas les personnes, ne peut vérifier les faits et aller au fond des choses.--Un Stendhalien.
On passerait vingt ans à Paris sans connaître la France. Le fond de tous
les récits est vague et incertain; ce qui passe pour avéré le jour est
souvent démenti le soir; on n'est jamais absolument sûr de rien. En
province, il est facile de voir, d'écouter, de se renseigner, et
d'acquérir une certitude suffisante sur les gens et les choses.--Félix
qui pottit.
Charles Joliet.
(A suivre)
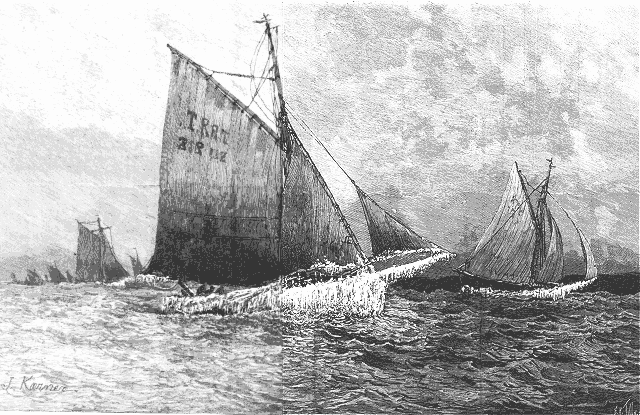
L'HIVER DE 1890-91.--Les bateaux de pêche couverts de
glace
LE DUC DE LEUCHTENBERG

S. A. I. LE DUC DE LEUCHTENBERG
Décédé à Paris le 6 janvier1894. --Photographie Bergamasco, à Saint-Pétersbourg.
Le duc Nicolas de Leuchtenberg vient de mourir à Paris: il était né en 1843. C'était une des plus éminentes personnalités de l'aristocratie russe. Grand, svelte, blond, sa physionomie respirait une grave mélancolie que les souffrances de sa dernière maladie avait accentuée encore. Depuis deux ans, en effet, il souffrait cruellement d'une affection des amygdales et les secours de la science étaient impuissants.
Le mal avait fait de tels progrès dans ces derniers temps que toute nourriture était devenue intolérable; la sonde même ne trouvait plus à pénétrer dans le larynx encombré par les tumeurs: et, dans cet état désespéré, les trois médecins du duc, les docteurs Dieulafoy, Poirrier et Garrigue, avaient imaginé, pour le réconforter, de lui persuader qu'il était victime d'un mal héréditaire sans danger, et dont la science saurait bientôt venir à bout.
*
* *
Le duc Nicolas aimait beaucoup Paris et la France. Son titre de duc de Leuchtenberg révélait, d'ailleurs, qu'il avait du sang français dans les veines, puisque ce titre fut conféré en 1847 par le roi de Bavière a son gendre Eugène de Beauharnais, fils de l'impératrice Joséphine. Par sa mère, la grande-duchesse Marie de Russie, le duc Nicolas était le petit-fils du tsar Nicolas Ier et par conséquent cousin au deuxième degré du tsar actuel. On ne saurait souhaiter une parenté plus brillante; la mort du duc Nicolas met en deuil, du reste, non seulement la cour de Russie, mais aussi les cours de Suède, de Bavière, de Wurtemberg et de Portugal. Mais le défunt avait d'autres distinctions que celles de la race: son esprit ouvert, cultivé, éclairé, s'intéressait beaucoup aux arts et aux lettres. Le duc Nicolas fréquentait à Paris un grand nombre de salons mondains et littéraires, et notamment celui de Mme la princesse Mathilde. Avant sa maladie, il suivait assidûment les conférences de la Sorbonne et du Collège de France, il était l'ami de tous nos grands savants, et s'était fait recevoir membre de toutes les Sociétés scientifiques de la capitale.
Dans la guerre russo-turque, le duc Nicolas de Leuchtenberg avait commandé le 27e régiment des dragons de Kiew; il s'était conduit très brillamment, et c'est depuis lors qu'il avait fixé sa résidence à Paris. Il s'était uni, par un mariage morganatique, avec Mme Nadedja Serguiéevna, veuve Akinson, née Annenkof, sœur de Mme la vicomtesse Eugène Melchior de Vogué. A l'occasion de ce mariage, le tzar avait conféré à Mlle Nadedja Serguiéevna le titre de comtesse de Beauharnais. Deux fils, âgés de vingt-deux ans et de vingt ans, sont issus de cette union; ce sont les ducs Georges et Nicolas: l'un suit à Paris les cours de l'École des mines, l'autre est élève à l'École de droit. Ils ont reçu du tzar, il y a deux mois, l'autorisation de porter les titres des ducs de Leuchtenberg.
Comme on le voit, le défunt duc avait tenu à ce que ses deux enfants fussent élevés à Paris: Parisien très lettré et très raffiné lui-même, il voulait qu'ils arrivassent à connaître, comme lui, toutes les finesses de notre littérature et de notre langue, et qu'ils apprissent, comme lui, à aimer notre pays.
Le corps du duc sera conduit à Saint-Pétersbourg et inhumé dans le caveau de la famille impériale.
M. FOUROUX
La cour d'assises du Var juge en ce moment une cause qui a beaucoup occupé l'attention publique. Un double attrait a fait de ce procès en avortement un scandale célèbre: d'abord, l'attrait malsain mais réel qui s'attache à tous les crimes où la passion a joué un rôle essentiel; ensuite, le principal accusé, M. Fouroux, ancien officier de marine, était maire de Toulon quand l'avortement a été perpétré. Il avait même failli être député. Il a été arrêté dans la loge municipale du théâtre, cette arrestation du premier magistrat d'une ville de cent mille âmes n'a pas laissé de causer quelque sensation.
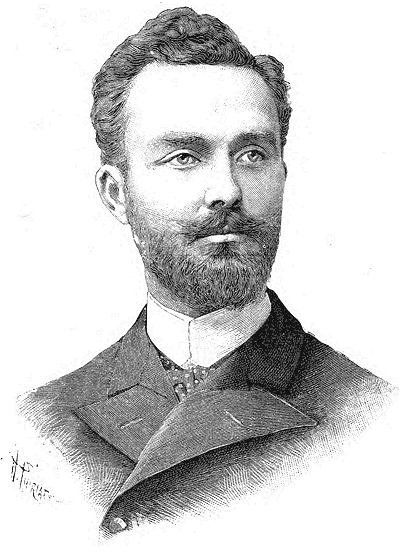
M. FOUROUX
Les accusés sont au nombre de quatre: M. Fouroux, Mme de Jonquières, Mme Audibert et Mme Laure, sage-femme. En quelques mots, voici les faits relevés par l'acte d'accusation:
M. Fouroux entretenait depuis assez longtemps des relations intimes avec Mme de Jonquières, Agée de trente-six ans, épouse d'un lieutenant de vaisseau. Au printemps dernier, Mme de Jonquières s'aperçut qu'elle était enceinte. A cette époque, son mari était en mer.
Effrayé des conséquences que pouvait avoir cette grossesse et du scandale qui en résulterait, M. Fouroux demanda à une ancienne «amie», Mme Audibert, de lui prêter ses soins officieux pour prévenir tout esclandre. Mme Audibert, très obligeante, trouva, après quelques recherches, une sage-femme--la nommée Laure--dont la discrétion, l'habileté et la complaisance rendraient tout repos au ménage illégitime des deux principaux accusés.
Mme Laure fut appelée et Mme de Jonquières fut confiée à ses soins. C'est le 11 juin dernier que cette dernière entra en traitement chez la sage-femme: elle avait été accompagnée jusqu'au second étage de la maison par M. Fouroux lui-même. Elle y resta jusqu'au 15 juillet, avec une courte interruption pendant laquelle Mme de Jonquières et M. Fouroux vinrent à Paris. L'avortement fut consommé.
Comment le crime a-t-il été découvert? Ici entrent en scène mille faits obscurs et compliqués que les débats qui viennent de commencer tireront sans doute au clair. Une enquête a été ouverte; Mme de Jonquières, interrogée, a tout avoué: et c'est ainsi que les quatre accusés comparaissent devant le jury du Var pour avoir commis «les crimes prévus par les articles 3, 17, 50 et 60 du Code pénal».
M. Fouroux n'a que trente ans. Né de petits bourgeois, il a suivi les cours de l'École navale, est devenu enseigne de vaisseau et a donné sa démission pour rentrer à Toulon, sa ville natale, et s'y livrer uniquement à la politique. Nommé maire de Toulon il y a deux ans, il a échoué aux élections législatives de 1889. Il s'était présenté dans la seconde circonscription de Toulon, contre MM. Magnier et Cluseret; au second tour il se désista en faveur de M. Magnier et M. Cluseret fut élu. Il s'occupait activement de tenter de nouveau les chances du scrutin à la première vacance qui se produirait dans le Var, et songeait dans ce but à former un journal.
A la mairie, Fouroux s'intéressait surtout aux grands travaux d'embellissement et d'assainissement qui ont de tout temps préoccupé la municipalité de cette ville sans égouts, sans canalisations sérieuses, livrée A toutes les épidémies. Il avait su acquérir ainsi, parmi ses concitoyens, une certaine popularité.
SCHERZETTO POUR PIANO
Par
ALFRED MUTEL
LA COMBE DE PÉGUÈRE
Quand on monte de Pierrefitte à Cauterets, dans le défilé de roches sombres qui, de chaque côté, forment de gigantesques murailles, à pic le plus souvent, et quelquefois surplombant, on aperçoit de temps en temps, au caprice du chemin, une montagne verte qui semble devoir barrer la gorge à un moment donné: c'est Péguère, au pied duquel est bâti Cauterets.
Sur la face qui regarde le village, c'est une montagne comme tant d'autres des Pyrénées, et même plus belle que beaucoup d'autres avec ses pentes raides plantées de hêtres qui montent superbes jusqu'à ce que les pins les remplacent; son aspect est honnête, solide; de tout temps certainement elle a été ce qu'on la voit aujourd'hui, et jusqu'à la fin du monde elle restera ce quelle est. Cependant, quand on la longe pour continuer après Cauterets vers le Pont d'Espagne, on s'aperçoit qu'on lui a accordé confiance un peu vite, et que sa face pourrait bien être trompeuse. En effet, de ce côté, les éboulis de rochers blanchissent partout le gazon des escarpements et un couloir d'avalanche arrive à une paroi à pic, au-dessous de laquelle se trouve un cône de déjection formé d'un amas considérable de pierres brisées avec d'énormes blocs épars ça et là jusque dans le lit du Gave qu'ils ont déplacé.
Evidemment cette montagne avec son air placide n'est pas ce quelle paraît, et n'a d'une éternelle solidité que l'apparence; en réalité elle s'effondre.
A quelles époques remontaient ces éboulis? Sans plus s'inquiéter, on s'était dit volontiers que cela datait des temps préhistoriques, et sur ces pentes en mouvement on avait construit l'établissement de la Raillère, tandis que, de l'autre côté du Gave, on avait successivement bâti les bains du Petit-Saint-Sauveur et du Pré, ainsi que la buvette de Mauhourat. Si quelques chutes de rochers et de pierres se produisaient de temps en temps, surtout avec les grandes pluies, comme elles suivaient l'ancien couloir, on n'en prenait pas autrement souci.
*
* *
Les choses en étaient là lorsqu'un matin de mai, en 1885, les gens de service de la Raillère, en arrivant le matin pour prendre leur travail, virent avec stupéfaction que la toiture de leur établissement avait été criblée la nuit par une volée de mitraille.
Il n'y avait pas à chercher bien loin d'où venait ce bombardement: de la combe de Péguère.
L'émoi fut vif; la saison commençait. On se remua, et tout bas on cria au secours.
L'administration répondit en nommant une commission composée d'ingénieurs des mines, des ponts-et-chaussées, etc., qui devait visiter la montagne malade et indiquer les remèdes à appliquer; depuis des centaines d'années elle guérissait des générations de baigneurs avec ses sources, à son tour de se soigner. C'était là des personnages considérables par leurs situations officielles au moins, et l'administration aurait certainement fait de son mieux. Mais leur grandeur même les attacha au rivage du Gave. Quand il aurait fallu aller tâter le pouls de la montagne à l'endroit même où il battait, on délibéra en examinant de loin son sommet; d'ailleurs n'était-elle pas réputée inaccessible? et son air se trouvait tout à fait d'accord avec sa réputation: tout d'abord une grande paroi à pic, polie par les eaux et par les pierres, puis au-dessus des pentes croulantes. Le résultat de ces délibérations fut qu'il n'y avait de pratique qu'à laisser agir les forces de la nature: quand tout ce qui était en mouvement serait tombé, on aviserait.
En pleine montagne ce prudent conseil aurait pu être adopté. Mais en laissant les forces de la nature agir sur les pentes de Péguère, elles écrasaient tout simplement les baigneurs, et dans un temps donné emportaient les établissements construits aux abords du couloir parmi lesquels il s'en trouve un bâti au griffon d'une source, celle de la Raillière, dont la réputation universelle attire tous les ans 12 ou 15,000 malades.
Il est vrai que l'on pouvait descendre cette source et en établir la distribution à un endroit où elle ne serait pas menacée: cela aussi fut proposé, et même un commencement d'exécution eut lieu. Mais qui ne sait que les eaux minérales et surtout thermales prises à leur source ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on conduit à une certaine distance pour la commodité des malades, la paresse des médecins ou les avantages de? bateliers? Que perdent-elles en route? Quelquefois toutes leurs qualités.
Descendre la Raillère et les autres sources en danger, c'était la ruine de Cauterets à bref délai, ainsi que de toute la contrée.
Heureusement le pays avait un député qui ne s'occupait pas seulement des affaires personnelles de ses électeurs influents, mais qui avait souci aussi des intérêts généraux de son arrondissement, et son nom--M. Alicot--ne doit pas être omis ici, car si les forces de la nature n'ont point été abandonnées à leur caprice et au hasard, comme on le proposait, c'est à son initiative, à ses démarches, à son insistance, qu'on le doit: ce qui, soit dit en passant, n'a pas empêché ce même arrondissement, et particulièrement les Cauterésiens, de le lâcher aux dernières élections. Il agit auprès du ministre et demanda l'intervention du service forestier; n'y a-t-il pas dans nos codes une loi sur le reboisement des forêts? jamais plus belle occasion de l'appliquer ne s'était présentée.
Je ne sais pas s'il est bien juste de dire que le service forestier accepta cette tâche d'autant plus volontiers que les mines et les ponts-et-chaussées s'étaient récusés, mais le certain, c'est que, sans trop savoir à quoi il s'engageait, il ne recula pas: on verrait à l'œuvre.
Ce qu'il vit, quand les études commencèrent sous la direction de M. Demontzey, inspecteur général des forêts avec le concours de MM. Loze, inspecteur de reboisement, et François Delon, garde-général au même service, c'est qu'on se trouvait en présence d'une montagne en dislocation.
Et cet état de dislocation rendit même les études du terrain assez difficiles pour qu'on dût s'attacher avec les cordes à ceux des blocs éboulés qui, momentanément arrêtés dans leur chute, trouvaient un point de résistance suffisant pour porter le poids d'un homme.
On arriva ainsi au pied d'une combe formée de blocs granitiques entassés dans un enchevêtrement gigantesque qui reposait sur une couche de pierrailles et de sable; c'était un véritable chaos mouvant amoncelé à 15 ou 1,800 mètres d'altitude. Quand il pleuvait, ou quand les neiges fondaient, ces pierrailles et ce sable se trouvaient entraînés. Et quand il faisait sec, c'était le sable seul qui coulait continuellement, comme il l'eût fait dans un immense sablier.
*
* *
Elles étaient réellement considérables, les difficultés, et telles, qu'après l'examen on pouvait les considérer comme insurmontables: l'altitude à laquelle on devait travailler variait entre 1,700 et 2,800 mètres: la montagne inaccessible manquait d'eau; à cette hauteur la neige commençait en septembre pour ne disparaître qu'en juin; enfin il fallait travailler dans un couloir au-dessous duquel se trouvaient des établissements thermaux fréquentés, de 5 heures du matin à 6 heures du soir, pendant les quelques mois où le travail était possible, et aussi au-dessus d'un chemin, celui de la Raillère Mauhourat, qui, pendant l'été, est littéralement couvert de buveurs et de voitures; qu'un bloc partit, qu'une pierre échappât aux ouvriers, et une catastrophe se produisait.
De plus, on se trouvait en présence d'un phénomène géologique dont on ne connaissait pas la cause: était-il dû à des tremblements de terre? à la nature même du granit craquelé? à des dépôts sédimentaires, ou bien encore à la fameuse faille des Pyrénées? On n'en savait rien.
La première idée qui se présenta fut de construire un barrage au bas de la combe, un peu avant que la montagne soit coupée par un à-pic de 4 ou 500 mètres, qui la réunit au Gave; si on pouvait le bâtir assez solide et assez haut, il arrêterait les blocs en mouvement, exactement comme les grands barrages retiennent les eaux, celles du Furens à Saint-Etienne, en Algérie celles du Sig.
Avant d'entreprendre un pareil travail, on eut heureusement l'idée d'organiser des expériences pour se rendre compte de la trajectoire des blocs, et alors on constata qu'il suffisait de mettre une pierre en mouvement pour qu'elle en entraînât avec elle des centaines, des milliers d'autres, qui se précipitaient avec des bonds effrayants; des blocs de granit de 20 mètres cubes passaient à 30 mètres au-dessus du sol de la combe. Quel barrage, si bien construit qu'il fût, résisterait à la poussée de ce bombardement?
Du grandiose on se rabattit sur le simple et le petit. Ce qui semblait faire l'instabilité de ces masses de rochers, c'était la fuite du sable: qu'on parvint à l'arrêter, et tout s'arrêtait en même temps.
Mais comment produire cet arrêt? On pensa à employer un système de petits murs en pierres sèches, car le manque d'eau rendait tout autre système de maçonnerie impraticable et on le combinerait avec des gazonnements auxquels on aurait recours toutes les fois que la pente du terrain le permettrait; mais, au lieu de commencer le travail par la base comme cela se fait ordinairement, on l'entreprendrait par le sommet, puisqu'il était impossible de placer des ouvriers dans le fond de la combe où ils seraient infailliblement écrasés par les pierres toujours en marche.
Si c'était beaucoup d'avoir trouvé le traitement à employer, les moyens d'exécution ne présentaient pas moins de difficultés; ce n'était pas dans des conditions ordinaires de travail qu'on se trouvait placé, mais en pleine montagne, à une altitude variant entre 1,500 et 2,000 mètres, sur des pentes considérées jusqu'à ce jour comme à peu près inaccessibles; il fallait un chemin pour que les ouvriers pussent arriver à un chantier et il fallait un petit chemin de fer Decauville pour apporter les blocs qui entreraient dans la maçonnerie, ainsi que les plaques de gazon qu'on irait prendre sur une autre montagne, celle de Cambasque, pour en garnir les pentes mouvantes de Péguère; enfin il fallait aussi construire, à une certaine hauteur, des baraquements où, du lundi au samedi, logeraient les ouvriers qui ne pouvaient pas tous les matins commencer leur journée par cette ascension.
Ce fut la route muletière qu'on attaqua d'abord, en allant l'amorcer à une lieue environ de Cauterets, un peu après la cascade du Ceriset; aujourd'hui elle a atteint 1,900 mètres, et elle sera terminée l'année prochaine. Tracé sur le versant sud du val de Jeret, en pleine forêt, elle monte en lacets par des pentes très douces et à certains endroits on se trouve sur des corniches d'où l'on a des à-pics de 500 mètres au-dessus du Gave qui bouillonne dans son étroite vallée. Je l'ai suivie par une belle matinée d'août, et bientôt elle sera sans conteste une des plus agréables promenades des Pyrénées; douce aux jambes, gaie aux yeux avec ses fleurs qui la bordent, bien boisée, car, contrairement à ce qui se passe habituellement, on n'a abattu d'arbres que tout juste ce qu'il fallait pour qu'elle se glissât sous l'ombrage de ceux qu'on a respectés--faisant ainsi œuvre de forestiers et non d'ingénieurs toujours prompts aux abattis.
Quand cette route muletière fut assez avancée, elle servit à apporter les rails du chemin de fer qu'on ne pouvait pas monter à dos d'hommes par les glissoirs des avalanches et l'on commença le traitement de la combe.
La première chose à entreprendre était de la débarrasser des blocs instables, déjà en mouvement ou menaçant de se détacher; et cette opération était celle qui exigeait le plus de coup d'œil et de prudence, car on s'exposait à mettre tout le sommet de la montagne en marche, sans trop prévoir où les morceaux iraient.
Attachés par des cordes aux parties solides, les ouvriers--qui tout d'abord se firent prier--entreprirent cette besogne, et au moyen du levier, de la poudre ou de la dynamite selon les circonstances, ils précipitèrent, en commençant par le sommet, tous les blocs qu'on ne pouvait pas consolider; puis, le terrain déblayé, pour soutenir les blocs plus solides et les pierrailles ou même les parties déclives sur lesquelles l'herbe n'avait pas chance de reprendre, on construisit des murs de soutènement en maçonnerie sèche, de 5 à 6 mètres de hauteur, s'étageant les uns au-dessus des autres; et, cela fait, on plaqua toutes les pentes avec des gazons bien feutrés dans lesquels on respectait soigneusement les touffes de rhododendrons et d'airelles qui s'y trouvaient; on les fixa avec des piquets jusqu'à ce que les racines se fussent implantées dans le sable.
Depuis que le travail est commencé avec cette double combinaison de murs et de gazonnements, c'est-à-dire depuis quatre ans, il est arrivé à la moitié de la combe à peu près; mais, comme les difficultés ont beaucoup diminué par cette raison que la combe se rétrécit vers son goulot, il semble qu'il faudra moins de temps pour l'achever qu'on en a pris pour l'amener au point où l'on en est. Le chemin muletier va être terminé; on connaît la montagne; et les ouvriers qui, au début, étaient rares pour travailler dans la combe, sont aussi nombreux maintenant et aussi résolus qu'on peut le désirer.
Car, malgré le danger très réel, il n'y a jamais eu d'accidents depuis le premier jours des travaux: pas un ouvrier n'a été blessé; et, dans la saison des bains, pas un des nombreux baigneurs qui se suivent en procession sur le chemin qui longe la base du couloir n'a été effrayé par la chute d'un bloc maladroitement échappé. C'est alors à de certaines heures où les buvettes et les bains sont habituellement fermés qu'on fait partir les blocs qui doivent tomber, et pendant ces heures la route est barrée; lorsqu'elle est ouverte aucun de ceux qui circulent là tranquillement en digérant leur verre d'eau ne se doutent qu'à 1,000 ou 1,100 mètres au-dessus de leur tête s'exécutent des travaux considérables, qui à Paris ou dans un rayon moins éloigné solliciteraient la curiosité générale et la visite de tous les reporters du monde; mais c'est dans les Pyrénées qu'ils s'accomplissent, et vous savez, les Pyrénées, ça n'est pas précisément parisien.
Les deux vues que nous donnons montrent l'une la besogne qu'il y avait à entreprendre et l'autre le résultat obtenu. Dans la première un ouvrier retient le wagon chargé, la voie étant légèrement inclinée de manière à ne rendre la traction nécessaire qu'au retour des wagons vides. Dans l'autre, les travaux de soutènement sont à peu près terminés. La photographie a été prise au moment où un des ouvriers va donner, au moyen de la corne d'appel, le signal d'arrêt de la circulation sur la route de la Raillière, tandis qu'un autre dresse le drapeau rouge réglementaire.
*
* *
Quoi que nous ayons dit, Paris aurait pu se faire, jusqu'à un certain point, l'idée des travaux entrepris, car à l'Exposition, dans le pavillon des forêts, un diorama en représentait une petite partie, celle du sommet, en ce moment terminée. Mais, bien que rendu avec beaucoup de chic, ce diorama ne parlait pas, et c'était là son tort, puisque la plupart de ceux qui passaient devant lui ne comprenaient rien à ce qu'il voulait représenter.
Est-ce qu'un jour, dans un groupe de visiteurs qui certainement avaient souci de la fortune de la France, cette exclamation ne fut pas lâchée devant ce diorama;
--C'est pitié de voir gaspiller l'argent des contribuables dans de pareils travaux de fortification, exécutés par des forestiers.
Il est vrai que devant le diorama qui faisait pendant à celui-là et représentait la canalisation de torrents dans les Basses-Alpes, un président de section, s'adressant à ses jurés, leur disait:
--Maintenant, messieurs, nous arrivons à un curieux exemple de la culture de la vigne dans les Alpes.
Je sens que cette observation, qui a cependant été entendue par de
nombreux témoins, peut paraître un peu forte; est-ce la rendre
vraisemblable de dire quelle appartient à un architecte... parisien?
Hector Malot.
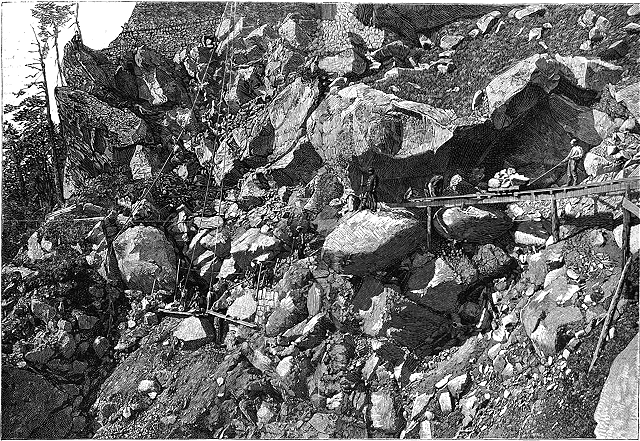
UNE MONTAGNE QUI S'ÉCROULE.--Commencement des travaux de
soutènement de la combe de Péguère (Pyrénées).
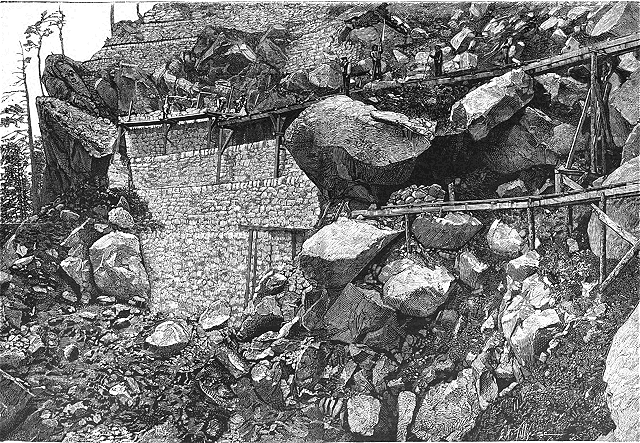
UNE MONTAGNE QUI S'ÉCROULE.--Vue prise au cours des
travaux de soutènement. (Voir l'article page 35.)
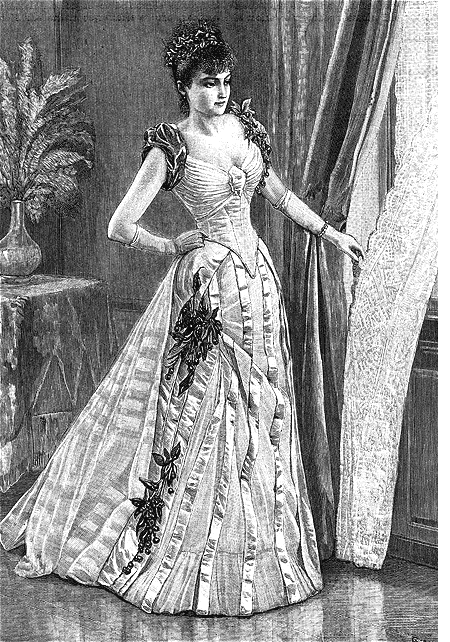
LA MODE
On a dîné beaucoup en décembre: on dansera beaucoup en janvier, les fêtes officielles préludant aux fêtes mondaines qui attendent le dernier glas du carnaval pour chanter leurs premiers fredons.
La robe du soir est donc à l'ordre de l'année nouvelle. Déjà habillées d'hiver pour les visites du matin, les Parisiennes songent désormais aux robes de gala par lesquelles, cet hiver, elles conquerront une beauté nouvelle, une séduction neuve et originale.
Elles sont bien jolies, les robes du soir qui s'achèvent dans l'atelier de nos grands faiseurs, avec leur grâce souple de fourreaux chatoyants, le long desquels glissent les pierreries. Jolies, à une seule critique près: je veux parler de la manche que quelques femmes portent, avec le corsage décolleté, tout à fait longue et boutonnée au poignet. C'est là une erreur regrettable et une incontestable faute de goût. Car, pour garder sa ligne pure, le corsage du soir devrait être absolument sans manches. Moins il est empâté d'étoffe, plus le bras s'allonge élégant, et la simple épaulette, sertissant la blancheur des épaules de sa ligne lumineuse, suffit à l'encadrer, en ce genre de toilette. Ou bien, pour le demi-décolleté--la demi-peau!--la manche Louis XV, arrêtée au-dessus du coude et l'enchâssant d'une mousse de dentelle, de façon à laisser libre l'avant-bras que moule le long gant de saxe.
Tout ce qui, en dehors de cela, engonce le bras et en rompt la ligne, est assurément de goût médiocre. Le «gigot» a été, sous Louis-Philippe, une mauvaise plaisanterie de quelque couturière naturaliste--le couturier n'était pas encore inventé!...--Et la manche Valois, bouffante du haut, boutonnée au poignet, qui s'accordait peut-être avec l'époque, est aujourd'hui due aux ultra-maigres qui possèdent, pour bras, une paire d'échalas.
La robe du soir, donc, pour être logique et gracieuse, doit être sans manches; ou, du moins, avoir le moins de manches possible. Elle se fait de deux sortes: légère pour les très jeunes femmes, lourde pour celles qui ont passé vingt-cinq ans ou qui ne dansent plus.
*
* *
La robe lourde est en velours, en satin ou en lampas. Le satin est très à la mode, cette année. Aussi le velours de nuance tendre, bleu clair, vert pâle ou maïs. Peu de garniture, bien entendu. Mais des broderies d'or ou de pierreries au corsage et en panneau à la jupe assez longue, unie derrière, drapée devant.
Le satin et les velours mêlés sont d'un effet fort heureux. Le velours, alors, forme le dos du corsage, s'allonge sur la jupe en ailes étroites, ainsi que les pans d'un très long habit. Le satin est couvert de broderies.
Mais il y a toujours, dans le mélange des étoffes, beaucoup de fantaisie, partant beaucoup d'imprévu. La robe tout en satin, comme la robe tout en velours, est bien plus correcte, bien plus classique. Combien est élégant du satin rose de Chine, avec une fine broderie d'or et d'argent en entredeux, au-dessus de l'ourlet, courant sur le côté, en fermeture au petit corsage, tout brodé, comme une cuirasse! Ou, sur du satin jaune d'or, l'ourlet brodé et pailleté d'or, avec l'étoffe ramagée, en relief, de tout petits bouquets également brodés d'or. Encore bien aristocratique en sa simplicité somptueuse, une robe en peau de soie blanche que garnit, en fichu, enchâssant la gorge, du vieux point de Venise.
Le même point de Venise, rattaché en godets, forme draperie autour de la jupe et il enferme les hanches, noué à la pointe du corsage, comme le fichu l'est à la poitrine.
Les robes lourdes, portées aux premières fêtes, sont celles d'aujourd'hui. Les robes légères seront celles de demain. En voici une de crêpe blanc, que rayent d'étroits rubans de même nuance. Par derrière, la jupe ronde, comme presque toutes les jupes légères, est montée à gros plis plats, et le ruban, passé en sens inverse, coupe en travers chaque pli, de haut en bas. Le corsage décolleté, à longue pointe, est en satin crème avec un fichu noué de crêpe. Pour manches, des branches de cerisier en épaulières. Les mêmes branches, en grappes, retiennent la jupe sur le côté. Dans les cheveux, petite couronne de cerises sertissant le chignon.
*
* *
Une autre toilette est de satin rose. Une draperie de crêpe hortensia festonne au bord de la jupe, toute frangée de violettes: le tout voilé par une jupe de crêpe rose, tout unie et ourlée, en bas, de plusieurs plis plats. Le corsage en crêpe, froncé à la vierge, avec gorgerette de violettes. Une robe de crêpe blanc, avec fond de peau de soie, est plus simple encore: pour toute garniture, à la jupe, trois rangs de broderie, pointillée d'argent, cerclant l'ourlet. Au corsage, la gorgerette, aussi de broderie, descend en pointe devant et derrière. Les manches, nouées de satin, faites d'un seul bouillon de crêpe. Une autre, en tuile lilas, est couverte, devant, de larges chevrons de satin lilas qui forment comme un corps d'abeille; tandis que, derrière, les bandes de satin descendent toutes droites. Le corsage tout en satin, avec draperie de crêpe et guirlande-sautoir de lilas. Des lilas aussi dans la jupe, en longues grappes.
Je finis par une toilette en quelque sorte intermédiaire, le crêpe de
Chine tenant le milieu entre la robe lourde et la robe légère, plus
souple que la première, moins habillée que la seconde, très facile à
porter et convenant aux réceptions de demi-gala. Celui-ci de nuance
mauve, la jupe drapée, plissée en bas comme un tablier d'enfant. Des
nœuds de velours lilas soutiennent les draperies, formant sur le côté
des demi-guirlandes. Le dos et la traîne en tulle mauve, coupé de bandes
de crêpe de Chine, le devant du corsage tout drapé, en crêpe de Chine,
noué de velours lilas.
Violette.

Les élections sénatoriales.--On a procédé dimanche dernier, conformément à la Constitution, au renouvellement d'un tiers du Sénat. Il y avait à pourvoir à la vacance de 81 sièges, sur lesquels 65 étaient occupés par des républicains et 16 par des conservateurs. Le scrutin a donné les résultats suivants: 75 républicains, 6 conservateurs.
Les républicains ont donc gagné 10 sièges, qui se répartissent ainsi: 2 dans le Pas-de-Calais, 1 dans la Seine-Inférieure. 1 dans le Tarn-et-Garonne et 3 dans la Vienne.
En conséquence, sur les 300 membres qui composent le Sénat, on comptera 238 républicains et 55 monarchistes. Il y a encore une élection à venir, celle de l'Inde, qui aura lieu demain, et six sièges à pourvoir par suite de décès. Comme il est probable que ces derniers seront occupés par des sénateurs appartenant à la même opinion que ceux dont ils prendront la succession, le Sénat sera définitivement constitué de la façon suivante: 244 républicains et 56 monarchistes.
Le scrutin du 4 janvier a fait entrer à la Chambre Haute sept députés: MM. Maxime Lecomte, Deprez, Vignancourt, Vilar, Dautresme, R. Waddington, Brugnot.
Sur les 74 républicains élus, 29 sont nouveaux. Ce sont, outre les 7 députés qui viennent d'être cités: MM. Camescasse. ancien préfet de police, Gomot, Barrière, Jean Dupuy, directeur du Petit Parisien, Levrey, Brusset, Leporché, Gravier, Ranc, Lefèvre, Lesouef, P. Casimir Périer, Regismantet, Léo Aymé, Rolland, Angles, Edmond Magnier, directeur de l'Événement, Couteaux, Thezard, Salomon, Jules Ferry, Joigneaux.
Dans le département de la Seine, seuls M. de Freycinet, président du Conseil, et M. Poirier ont été nommés au premier tour. Ont été élus ensuite, au troisième tour, MM. Tolain, Ranc et Alexandre Lefèvre.
La première chose à constater, c'est que depuis 1876, année à laquelle remonte l'institution du Sénat, la majorité républicaine de cette assemblée n'a fait que progresser.
Aux élections des inamovibles en décembre 1876 et aux élections générales de janvier 1877, il y eut 114 républicains élus et 156 conservateurs.
Aux élections de janvier 1879, lors du premier renouvellement par tiers des sénateurs élus par les départements, il y eut 82 élections qui donnèrent la majorité aux républicains. Ceux-ci se trouvèrent alors au nombre de 160 et les conservateurs au nombre de 140.
En janvier 1882, les républicains enlevèrent 66 sièges sur 79 et la majorité républicaine du Sénat atteignit alors 190 membres. En 1885, les républicains gagnèrent encore 25 sièges, en sorte que la minorité conservatrice fut réduite à 90 membres.
Enfin, en tenant compte des élections partielles de 1888 et des résultats de dimanche dernier, on constate que, depuis 1876, les républicains ont gagné 99 sièges perdus par les conservateurs.
Il y là un mouvement intéressant à signaler; cependant l'opinion publique se montre généralement moins frappée des questions d'ordre général que de celles qui concernent les personnes. Aussi l'attention s'est-elle portée cette fois moins sur l'ensemble des élections que sur deux candidats qui, à des titres divers, occupent une place importante sur la scène politique, M. de Freycinet et M. Jules Ferry.
On ne doutait pas de l'élection de M. de Freycinet, qui ne compte plus ses victoires, quel que soit le terrain sur lequel il se présente. Si, à l'Académie, il ne l'a emporté qu'au troisième tour--et on n'a vu là qu'une suprême coquetterie de l'illustre compagnie qui a voulu laisser croire que cette candidature était discutée--ici le président du Conseil a triomphé, et haut la main, au premier tour. Il obtient 579 suffrages sur 654 votants, c'est-à-dire une majorité inconnue dans les précédentes élections de la Seine. C'est presque l'unanimité. Elle s'explique par les séductions qu'exerce le talent de cet homme politique habitué à résoudre tous les problèmes en mathématicien doublé d'un orateur, mais on assure aussi que les délégués sénatoriaux ont voulu surtout acclamer en lui le ministre de la guerre, c'est-à-dire celui qui personnifie aujourd'hui la défense nationale. S'il en est ainsi, il n'y a qu'à s'incliner, le mobile principal des électeurs de la Seine étant de ceux qui ne sauraient être discutés, et on ne peut que constater une fois de plus, avec une nouvelle allégresse, la promptitude avec laquelle s'apaisent toutes les querelles de partis quand le patriotisme est en jeu.
L'élection de M. Jules Ferry a une réelle importance à un tout autre point de vue. Il représente la politique coloniale inaugurée par la nouvelle république et, en ce qui concerne la politique intérieure, il a été considéré longtemps comme l'homme d'État le mieux armé pour résister aux prétentions excessives des radicaux ou des socialistes. Plus d'une fois, le sénateur des Vosges sera amené à prendre la parole pour s'expliquer sur ce qu'on appelle les «aventures» de notre politique coloniale dont on le rend, avec injustice parfois, personnellement responsable. Mais il est permis de se demander si l'attente générale ne sera pas trompée, quand M. Jules Ferry sera appelé à prendre rang dans les questions qui divisent les esprits. Depuis le moment où il a dû se tenir à l'écart, bien des événements se sont produits qui ont modifié profondément la classification des partis et il est probable que l'ancien ministre aura quelque peine à reconnaître lui-même la voie dans laquelle il doit s'engager, s'il veut remplir le rôle pour lequel l'opinion s'imagine qu'il a été créé. Quoi qu'il en soit, son intervention dans les débats parlementaires est attendue avec curiosité.
Election législative.--L'élection de l'arrondissement de Saint-Flour, (Cantal), a donné les résultats suivants: M. Bory, vice-président du conseil général, républicain, élu par 6.353 voix, contre 3.165 à M. Andrieux, ancien député.
Conseil municipal de Paris.--La commission des finances du conseil municipal avait fait croire que, rompant avec de vieilles habitudes, cette assemblée discuterait et voterait le budget de la préfecture de police. Il n'en a rien été et, en séance, le conseil a émis son vote annuel, c'est-à-dire qu'il a refusé les crédits nécessaires à la police de la capitale.
Ce n'est pas tout, le conseil a voté le rétablissement d'un chapitre du budget qui, sous couleur de bonne comptabilité, détache une partie des services administratifs qui doivent dépendre de la direction préfectorale pour la placer sous le contrôle immédiat du consul.
Le ministre de l'intérieur a fait signer dès le lendemain par le président de la République deux décrets qui annulent ces deux décisions. Le conflit que l'on croyait écarté se trouve donc renaître avec plus de violence que jamais.
Mais, en revanche, il n'est que juste de porter à l'actif du conseil municipal une décision qui sera très généralement approuvée. La majorité a réduit de 146,000 francs à 20,000 le crédit affecté aux bataillons scolaires. C'est leur suppression à brève échéance, car ce crédit de 20,000 fr. ne peut servir qu'à couvrir les frais de liquidation de cette fâcheuse institution. Elle disparaîtra sans laisser de vifs regrets, même parmi ceux qui l'ont inventée, ou patronnée au début.
Amérique du Nord. La récolte des Sioux.--Les Indiens poursuivent la lutte avec cet acharnement et ce mépris de la vie dont l'Illustration a donné une idée dans un de ses derniers numéros, en montrant les épreuves terribles par lesquelles consentent à passer ceux d'entre eux qui veulent acquérir le titre de guerrier. La guerre à laquelle ils se livrent sera d'autant plus meurtrière qu'elle ne répond en rien aux règles que se sont imposées les peuples civilisés. Les Indiens se postent sur un point, attendent au passage les troupes fédérales ou les attirent dans une embuscade, et, après avoir dirigé sur l'ennemi un feu bien nourri, n'hésitent pas à se retirer dans des régions à peu près inaccessibles.
C'est un combat de ce genre qui a eu lieu la semaine dernière. Un courrier arrivé à Omaka avait apporté la nouvelle que les Indiens avaient entouré et incendié la mission de Clay Creek, ou se trouvaient des prêtres, des religieuses et plusieurs centaines d'enfants. Un régiment de cavalerie, envoyé immédiatement sur les lieux, a trouvé l'école en feu; la mission, qui est à une certaine distance de l'école, n'était pas encore atteinte.
La cavalerie a failli être enveloppée par les Indiens, dont la plupart se tenaient en embuscade, tandis que cinq ou six cents d'entre eux occupaient l'attention des soldats. Au moment où l'enveloppement était presque complet, un autre régiment de cavalerie est arrivé et a pu disperser les révoltés qui ont pris la fuite dans toutes les directions. Les troupes ont dû rentrer à Pine Ridge, sans avoir, en somme, obtenu de résultats sérieux.
Aussi le général qui commande l'expédition a-t-il été obligé d'adopter un plan dont l'exécution demandera un certain temps. Il se propose d'organiser un mouvement combiné, grâce auquel il pourra entourer complètement le camp principal des Peaux-Rouges et les mettre dans la nécessité de se soumettre en les réduisant par la famine.
Déjà les Indiens souffrent terriblement de la faim, et aussi du froid. Les expéditions qu'ils entreprennent de temps à autre ont moins pour but de rencontrer les troupes fédérales que de piller les fermes afin de s'y approvisionner de bétail et de chevaux; en présence des difficultés, chaque jour plus grandes, qu'ils rencontrent, quelques-uns ont déjà été amenés à faire leur soumission, car tous ne sont pas des guerriers et il y a là des vieillards, des femmes, des enfants, qui cèdent aux souffrances qui leur sont imposées. Les guerriers eux-mêmes, d'ailleurs, eux qui ne craignent ni le fer ni le feu, résisteront-ils à la faim?
La pêche dans la mer de Behring.--On a vu dernièrement, par le message du président des États-Unis, que la question de la pêche dans la mer de Behring était loin d'être résolue. Les négociations avec le gouvernement anglais continuent, mais sans amener des résultats appréciables, et la prochaine campagne va commencer sans qu'une solution soit intervenue.
Or, on affirme que les armateurs anglais qui pratiquent cette pêche arment leur flottille, mais en prenant la précaution dangereuse d'embarquer sur leurs navires des armes et des munitions, de façon à permettre aux équipages de répondre par la force, s'ils étaient inquiétés dans l'exercice de ce qu'ils considèrent comme leur droit. Il y a donc à prévoir des conflits sérieux, si, comme on l'assure d'autre part, le gouvernement des États-Unis est décidé à la résistance.
Chine: les réceptions diplomatiques. --Les mœurs de la Chine subissent peu à peu une transformation qui permet de croire que, dans un avenir, encore assez éloigné il est vrai, ce pays rentrera dans la loi commune qui règle les rapports qu'ont entre eux tous les peuples civilisés. Evidemment le grand empire d'Extrême-Orient reste encore fermé à l'étranger, mais petit à petit les points de contact s'établissent et par la force des choses la règle d'État en vertu de laquelle les étrangers sont tenus à l'écart devient moins absolue.
A ce point de vue il convient de signaler le décret que vient de rendre l'empereur pour établir d'une façon définitive dans quelles conditions doivent avoir lieu les réceptions accordées au corps diplomatique. L'empereur dit notamment:
«....Conformément aux précédents créés par S. M. l'empereur Tung-Tchen et désireux de montrer notre empressement à l'égard des puissances, nous voulons augmenter le nombre de nos réceptions. Nous décrétons donc qu'une réception en l'honneur des ministres et chargés d'affaires étrangers aura lieu dans le courant de la première lune de l'année prochaine et que le Tsong-Li-Yamen prendra d'avance les ordres nécessaires pour fixer le jour de cette réception. Le lendemain un banquet sera offert au corps diplomatique. Cette cérémonie sera répétée tous les ans à la même époque. De plus, à chacune des fêtes d'État qui doivent être des occasions de réjouissances pour tous, le Tsong-Li-Yamen recevra des ordres à l'effet d'offrir un banquet au corps diplomatique.
«Ces dispositions montrent que nous avons le plus sincère désir d'entretenir et d'affermir continuellement nos bonnes relations avec les pays amis.»
Sans exagérer la portée de ce document, il est permis de remarquer le ton de courtoisie et même de cordialité dans lequel il est écrit. A ce point de vue il a une signification qui méritait d'être notée au passage.
La pêche des moules.--On sait que la pêche et le commerce des moules étaient interdits pendant plusieurs mois de l'année. D'une part, on espérait ainsi aider à la reproduction de ces mollusques; d'autre part on estimait qu'il y avait danger pour la santé publique à permettre le commerce des moules à l'époque du frai.
L'administration vient de lever ces interdictions et dorénavant on pourra pratiquer toute l'année la pêche des moules, à pied et en bateau, sur les moulières dont le préfet maritime ou le chef de service de la marine aura autorisé l'exploitation.
Ce décret est intéressant à mentionner, en ce qu'il tend à détruire un préjugé très répandu, comme on en jugera par le passage suivant du rapport adressé à ce sujet au président de la République par le ministre de la marine.
«Quant à la toxicité des moules pendant le frai, elle méritait de retenir l'attention et je ne me suis décidé à écarter ce second motif par lequel se défendait subsidiairement le régime des décrets de 1853 et 1859 qu'après avoir eu recours aux lumières des savants les plus autorisés. Le comité consultatif des pêches maritimes, dans un rapport publié au Journal officiel du 26 mai 1889, a démontré que les accidents causés par l'ingestion des moules sont excessivement rares et qu'ils ne se produisent que lorsque ces mollusques ont séjourné dans les eaux stagnantes ou souillées des ports, mais qu'il n'y a aucune corrélation à établir entre l'époque du frai et la nocivité de ces coquillages. Le comité consultatif d'hygiène publique, consulté à son tour sur cette question, l'a résolue dans un sens absolument identique, à la date du 10 mars dernier.
Nécrologie.--M. A. Peyrat, sénateur.
Le vice-amiral Aube, ancien ministre de la marine.
M. Charles Sanson, ancien commissaire-général de la section tunisienne à l'Exposition universelle.
M. Andouillé, ancien inspecteur des finances, sous-gouverneur honoraire de la Banque de France.
M. A. Saillard, ingénieur civil, président de l'association des anciens élèves de l'école des Hautes-Études commerciales.
M. le baron Gustave Ambert, frère du général récemment décédé, ancien trésorier général.
M. Boulart, ancien député, président du comité royaliste des Landes.
M. de Cazaneuve, président du tribunal de Villeneuve-sur-Lot.
Mme veuve Nathalie Vattier, née Barely, connue sous le pseudonyme de V. Vattier d'Ambroyse, auteur de plusieurs livres d'éducation pour les jeunes filles.
M. Mackensie Grieves, membre du Jockey-Club, connu comme un des meilleurs cavaliers de Paris.
LES THÉÂTRES
Opéra-Comique: l'Amour vengé, deux actes, de M. Augé de Lassus, musique de M. de Meaupou.
A la dernière soirée de l'an de grâce 1890, la direction de l'Opéra-Comique a payé sa dette envers M. Crescent, lequel, vous ne l'ignorez pas, a fondé un prix et pour les auteurs dramatiques, et pour les musiciens. Aux termes de l'acte de donation, le poésie et la partition couronnés doivent être représentés dans l'année. Le théâtre reçoit dix mille francs du ministère à la condition que l'ouvrage sera joué dix fois. Commercialement parlant, l'affaire est rémunératrice, et pourtant, on ne peut croire quelles difficultés elle rencontre dans son exécution. Il semble, à voir les résistances de l'administration, que ce soit là une des clauses les plus pénibles de son cahier des charges. A bien prendre la chose, le théâtre a le plus grand intérêt à ce concours dont le but est de lui révéler des auteurs inconnus. Les manuscrits arrivent en quantité invraisemblable. Par centaines. Les partitions sont moins nombreuses, mais les juges ont encore à décider entre une vingtaine d'ouvrages. Jusqu'à ce jour, les grandes espérances dans l'inconnu ont été déçues; les révélations subites ne se sont pas manifestées; mais qui sait? les surprises viendront peut-être; en tout cas, cette fois encore, la tentative n'a pas été sans succès, et le public a accueilli avec une grande faveur les deux actes de M. Augé de Lassus dont M. de Meaupou a écrit la musique.
La pièce a pour titre: l'Amour vengé.
Les méfaits commis par l'Amour contre les hommes et contre les dieux sont en si grand nombre que Jupiter, dans un accès de justice et de morale, fait prendre Éros, et l'attache à un arbre avec des chaînes de roses. Le captif fait retentir les bois de ses gémissements et de ses lamentations à ce point que le bon Silène, appelé par ses cris, s'approche du malheureux, et touché de ses larmes consent à le délivrer. Silène met pourtant une condition à cet acte généreux: il veut être aimé par la toute-puissance d'Éros. La chose est d'autant plus facile que l'Amour trouve un double bénéfice à cet acte: il paye sa dette de reconnaissance envers Silène d'abord, et il se venge ensuite du maître des dieux, qui a abusé de sa puissance envers lui, simple immortel. Éros inspire donc une folle passion pour Silène à la belle Antiope, que Jupiter poursuit. Aussi, quand le roi de l'Olympe déclare sa flamme à la belle, celle-ci lui répond-elle, avec tout le respect du à son rang, quelle le vénère, mais quelle aime Silène: le coup a porté, et l'amour-propre de Jupiter s'indigne d'un tel choix et d'une telle préférence.
La vengeance d'Éros va plus loin encore: le dieu malin montre au dieu puissant le groupe amoureux dans la joie de leurs ébats; Jupiter ne se possède plus, et, pendant qu'Antiope va cherche des fruits pour déjeuner sur l'herbe en compagnie de Silène, Jupiter se saisit du maître ivrogne et lui ordonne de renoncer à l'amour d'Antiope, sinon il deviendra plus affreux encore que par le passé. Silène se le tient pour dit et, à son retour, Antiope, étonnée, ne trouve plus qu'un amoureux transi qui se refuse à ses caresses. L'humiliation est entrée au cœur de la femme dédaignée. Au fond, Éros est bon diable, et, à la prière de Jupiter, il se laisse toucher. Il parle à Antiope en faveur du maître des dieux, et elle oublie rapidement Silène qui, du reste, aura le vin pour se consoler.
Sur ce poème mythologique M. de Meaupou a écrit une fort agréable partition, dont l'originalité peut être discutée, mais dont l'élégance et le goût, ne sauraient être mis en question. Il y a là un musicien des plus délicats et des plus distingués. Il serait fâcheux que le talent de M. de Meaupou ne fût pas mis une seconde fois à l'épreuve. Le succès me semble assuré d'avance après cette première expérience de la scène, j'en ai pour garant et les couplets de Silène, et les duos d'amour de Silène et de Jupiter avec Antiope, et le quartetto très scénique qui a eu les honneurs de la soirée.
C'est M. Fugère qui tient le rôle difficile de Silène. M. Fugère est à
coup sûr un des meilleurs chanteurs et un des meilleurs comédiens qu'ait
eu, et depuis longtemps, l'Opéra-Comique. Chaque création nouvelle
affirme son autorité. Il est parfait sous les traits de ce dieu des
buveurs qui, avec un comédien moins sûr de lui-même, pouvait facilement
tourner à la caricature. La majesté de Jupiter se perd dans le jeu
hésitant de M. Carbone; mais la voix de ténor de ce chanteur ne manque
ni d'accent ni de chaleur. Une gracieuse personne, Mme Bernaërt, joue
agréablement le rôle d'Antiope. Quant à Éros, il est représenté par Mlle
Chevalier qui est une chanteuse de talent et une comédienne des plus
intelligentes; mais ces qualités de l'art auraient été insuffisantes,
dans le rôle déshabillé de l'Amour, si la nature ne s'était chargée de
parfaire le personnage. C'est complet.
M. Savigny.
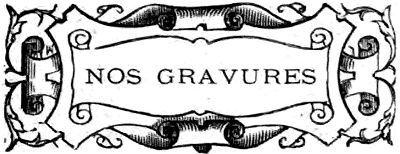
L'ANTHROPOPLASTIE GALVANIQUE
Les hommes se sont toujours montrés jaloux de rendre à leurs morts un culte particulier et cependant ils n'ont jamais accordé qu'un intérêt très médiocre à la conservation des cadavres. Les Égyptiens assuraient, il est vrai, la conservation des morts par des soins méticuleux. Daubenton et plus récemment Czermak nous renseignent à cet égard. Il existait, dans l'ancienne Égypte, des officines spéciales où les cadavres étaient soumis à des manipulations plus ou moins compliquées: les corps étaient immergés dans des bains antiputrescibles, puis enveloppés par les parents avec des milliers de bandelettes. Mais on peut affirmer que l'embaumement égyptien était pour ainsi dire une exception: les riches seuls pouvaient y prétendre. A notre époque, l'art des embaumements n'a pas fait de grands progrès. On se contente le plus ordinairement de pousser dans les artères du cadavre une injection stérilisante dont la composition varie, et on se préoccupe peu de ce qui adviendra. Au surplus, de même qu'en Égypte, au temps de Ptolémée, ce mode de conservation n'est appliqué que très exceptionnellement.
Faut-il rechercher dans l'imperfection des procédés le peu de goût que nous paraissons avoir pour la momification ou l'embaumement? Obéissons-nous fatalement à une loi de la nature, à cette loi formulée dans ces paroles de l'évangile: pulvis es et in pulverem reverteris? Le docteur Variot, un des médecins les plus distingués des hôpitaux de Paris, répond à ces deux questions en proposant à ses contemporains l'emploi des procédés galvanoplastisques pour obtenir des momies indestructibles. Le Dr Variot métallise notre cadavre tout entier: il l'enferme dans une enveloppe de bronze, de cuivre, de nickel, d'or ou d'argent, suivant les caprices ou la fortune de ceux qui nous survivent. Donc plus de putréfaction et plus de poussière. Voilà une invention qui pique votre curiosité? Vous voulez savoir comment procède le Dr Variot?
Jetez les yeux sur les dessins que nous avons fait exécuter dans le laboratoire de la Faculté de médecine où M. Variot poursuit ses recherches. Dans un double cadre à quatre montants, réunis en haut et en bas par des plateaux carrés, vous voyez le corps d'un enfant sur notre dessin de première page, le cadre est disposé sous une cloche pneumatique; sur celui ci-dessus il est placé dans un bain de sulfate de cuivre. Le corps de l'enfant a été perforé à l'aide d'une tige métallique. Une des extrémités de cette tige butte contre la voûte du crâne, tandis que l'autre est enfoncée comme un pivot dans une douille de métal de l'appareil située au centre du plateau inférieur du cadre. Le cadre support est un cadre conducteur de l'électricité. Les montants et les fils conducteurs ont été soigneusement isolés avec du caoutchouc, de la gutta ou de la paraphine. Le courant électrique est fourni par une petite batterie de trois piles thermo-électriques Chaudron. Un contact métallique dentelé, en couronne, descend du plateau supérieur et appuie légèrement sur le vertex du petit cadavre; la face plantaire des deux pieds et la paume des mains reposent sur deux contacts. En outre, des contacts ont été échelonnés sur les quatre montants métalliques du cadre, pour être appliqués aux points voulus, avec la possibilité de les déplacer à volonté.
Avant de plonger cet appareil dans le bain galvanoplastique, il faut rendre le corps bon conducteur de l'électricité. A cet effet, l'opérateur badigeonne la peau du cadavre avec une solution de nitrate d'argent, ou bien encore il pulvérise cette solution sur la surface cutanée au moyen d'un instrument très connu: le pulvérisateur dont vous vous servez, mesdames, pour vous parfumer. Cette opération faite, la peau est devenue d'un noir opaque; le sel d'argent a pénétré jusque dans le derme. Mais ce sel d'argent il faut le réduire, c'est-à-dire le séparer de son oxyde. On y parvient avec beaucoup de difficulté.

Immersion du sujet dans le bain galvanique.
Le double cadre est placé sous une cloche dans laquelle on fait le vide au moyen d'une trompe à eau et ou on fait pénétrer ensuite des vapeurs de phosphore blanc dissous dans le sulfure de carbone. C'est une opération dangereuse, comme toutes les opérations où le phosphore en dissolution jolie un rôle quelconque. C'est le détail de cette opération qui est fidèlement rendu par notre grand dessin. A droite nu garçon de laboratoire veille au fonctionnement régulier de la trompe. Vous voyez à gauche de l'opérateur une sorte de marmite en fonte aux parois très épaisses et dans laquelle la solution de phosphore est soumise, au moyen d'une petite lampe à gaz, à une température assez élevée pour en assurer la vaporisation.
Quand les vapeurs phosphorées ont réduit la couche de nitrate d'argent, la peau du cadavre est d'un blanc grisâtre; elle est comparable à la surface d'une statue de plâtre qu'on aurait rendue conductrice. Il n'y a plus qu'à procéder aussi rapidement que possible à la métallisation. A cet effet, le cadre double est immergé dans le bain de sulfate de cuivre. Nous n'avons pas à décrire cette opération que tout le monde connaît. Sous l'influence du courant, électrique, le dépôt métallique se fait d'une façon ininterrompue; les molécules de métal viennent se déposer sur la peau du cadavre, et y forment bientôt une couche continue, l'opérateur doit régler avec grand soin les envois d'électricité afin d'éviter un dépôt métallique grenu et sans cohérence. En déplaçant à propos les contacts, il substituera à la peau une écorce de cuivre qui se moulera sur toutes les parties sous-jacentes. En surveillant attentivement l'épaisseur du dépôt jeté sur le visage, sur les mains, sur toutes les parties délicates du corps, il obtiendra un moule fidèle qui rappellera exactement les détails de conformation et les teintes de la physionomie. Un bon dépôt de 1/2 à 3/4 de millimètre d'épaisseur offre une solidité suffisante pour résister au ploiement et aux chocs extérieurs. L'épaisseur de 1/2 à 3/4 de millimètre d'épaisseur ne doit pas être dépassée pour l'enveloppement métallique du visage et des mains qui seront, ainsi rigoureusement moulés. Sur le tronc, l'abdomen, les premiers segments des membres, le cou, la conservation intégrale des formes plastiques est beaucoup moins importante; aussi, si on le juge utile pour consolider la momie métallique, on atteindra une épaisseur de dépôt de 1 millimètre à 1 millimètre et demi.
Quel est l'avenir réservé à ce procédé de momification que le Dr Variot
appelle l'anthropoplastie galvanique? On ne saurait le dire. Il est
infiniment probable que les cadavres métallisés ne figureront jamais
qu'en très petit nombre dans nos nécropoles et que longtemps, longtemps
encore, nous subirons cette loi de la nature que nous rappelions en
commençant: pulvis es et in pulverem reverteris. Nous sommes
poussière, et nous retournerons en poussière! L'inventeur de
l'anthropoplastie n'accorde d'ailleurs à la métallisation totale du
cadavre qu'une importance mince. Le but de ses recherches était surtout
de donner aux musées et aux laboratoires de nos Facultés de médecine des
pièces anatomiques en parfait état de conservation, des pièces très
fidèles, très exactes, plutôt que d'arracher nos cadavres aux vers du
tombeau.
Marcel Edant.
L'AMIRAL AUBE
La mort, en enlevant l'amiral Aube, vient de clore cruellement une belle carrière de marin. Elle avait commencé en 1840. Le jeune Aube n'avait alors que quatorze ans. il était né en 1826 à Toulon, où son père était le fondé de pouvoirs du trésorier-payeur général du Var. Il se distingua au Sénégal, étant lieutenant de vaisseau: de 1870 à 1878. il fit à bord du Seigneley une remarquable campagne dans le Pacifique: il était capitaine de vaisseau. Ensuite, il commanda la Saône en escadre: il fut promu contre-amiral en 1880 et fut nommé gouverneur de la Martinique. Il était à peine en fonctions quand éclata une terrible épidémie de fièvre jaune: le fléau, qu'il combattit avec courage, l'atteignit lui-même dans ses plus chères affections en emportant Mme Aube. L'amiral ne tarda pas à quitter son gouvernement pour commander en second l'escadre d'évolution. Il fut nommé vice-amiral.
Mais la partie active et pratique de la carrière de l'amiral Aube n'est pas la partie essentielle, bien qu'il y ait déployé de grandes qualités d'énergie, de décision, de bravoure, et qu'il y ait montré une rare connaissance de la mer. Depuis sa jeunesse, l'amiral Aube avait été préoccupé d'idées de réformes importantes: il fut appelé à les mettre en lumière et à les appliquer comme ministre de la marine le 7 janvier 1886; il resta au ministère jusqu'en mai 1887.
Nous vîmes alors à la tribune du parlement cette figure énergique de marin, nullement banale ni conforme au type courant du «loup-de-mer» classique. Son visage aux traits saillants et droits, dont le dessin énergique était accusé encore par les cheveux blancs, plantés drus et taillés en brosse; son œil clair et net, sa haute stature, constituaient une physionomie qu'on n'oubliait point. Il avait dans son regard--l'avons-nous dit?--un peu de cet éclat aigu et fixe qui illumine la face des penseurs. Tout de suite, on vit que l'amiral Aube ne passerait pas, indifférent et inactif, dans une administration qui ne lui semblait pas en harmonie avec les progrès modernes. Comme tous les novateurs, il fut ardemment discuté. Il avait des partisans très dévoués, il eut des adversaires irréconciliables, il était un voyant pour les premiers, il n'était qu'un visionnaire pour les seconds. L'expérience--j'entends: une expérience complète, longue et décisive--n'a pas encore terminé ce débat passionné et passionnant.
LA MORT DU LIEUTENANT PLAT
L'infanterie de marine vient de faire une nouvelle perte au Tonkin: c'est celle du lieutenant Plat, tué à la prise de Long-Sat, le 13 novembre dernier.
Notre gravure, exécutée d'après un croquis fait sur les lieux par un officier du corps expéditionnaire, le lieutenant Brezzi, représente le moment où ce malheureux jeune homme tombe mortellement frappé près du fortin où il s'était courageusement placé pour mieux prendre le dessin de l'intérieur du village, occupé par les pirates. M. Plat était officier d'ordonnance du général Godin, et, depuis son arrivée au Tonkin, il avait excité l'admiration de ses chefs et de ses camarades par son infatigable entrain et sa grande intelligence. Du reste, cet officier s'était déjà fait connaître par un remarquable voyage au Fouta-Djalon, qu'il avait fait en 1887-88 en Afrique. On peut lire le récit de cette belle exploration dans l'intéressant ouvrage: Deux compagnes au Soudan français, que vient de publier le colonel Gallieni, sous les ordres duquel le lieutenant Plat avait accompli ses travaux au Soudan. Cette mort fait un grand vide dans l'infanterie de marine, mais on sait que les trous sont vite comblés dans cette arme d'élite, qui cependant n'en est plus à compter ses pertes, depuis notre installation au Tonkin.
LES BATEAUX DE PÊCHE PENDANT L'HIVER
L'Illustration consacrait, dans son dernier numéro, une série de dessins à ceux pour qui les rigueurs de l'hiver sont la source d'une joie nouvelle, les patineurs, qui ne sont jamais si heureux que lorsque le thermomètre leur assure une «belle gelée.» Mais, à côté de ces privilégiés qui regardent comme un plaisir de trouver un climat sibérien à la porte du Bois de Boulogne, combien sont nombreux ceux qui souffrent de cette température exceptionnelle dans nos climats!
Au premier rang de ces victimes du froid, il faut sans contredit placer les marins, pour qui la gelée, quand elle est assez forte pour agir sur l'eau de mer, est une véritable torture. Ceux qui ont passé le cap Horn dans la saison des glaces ou qui ont séjourné sur les bancs de Terre Neuve en hiver racontent, comme une des épreuves les plus pénibles de leur existence toujours si rude, les douleurs de ces terribles campagnes. Les embruns jaillissent sur l'avant du bateau: partout où ils viennent se projeter, la glace se forme; la voile et les focs ne sont plus qu'une masse compacte, ainsi que les haubans qui prennent l'aspect d'arcs-boutants de cristal.
Nous n'en sommes pas tout à fait là encore sur nos côtes, mais nous en approchons et les amateurs de pittoresque n'ont qu'à se rendre sur notre littoral de Normandie pour avoir une idée de la navigation au Cap Horn. Les barques de pêche représente notre collaborateur Kœrner, rentrent au port, l'avant recouvert d'une véritable cuirasse de glace et ornées stalactites qui pendent le long du beaupré et des ralingues de foc, évoquant, dans ces régions que nous ne connaissons guère que sous l'aspect ensoleillé de l'été, le tableau d'une expédition au pôle Nord.
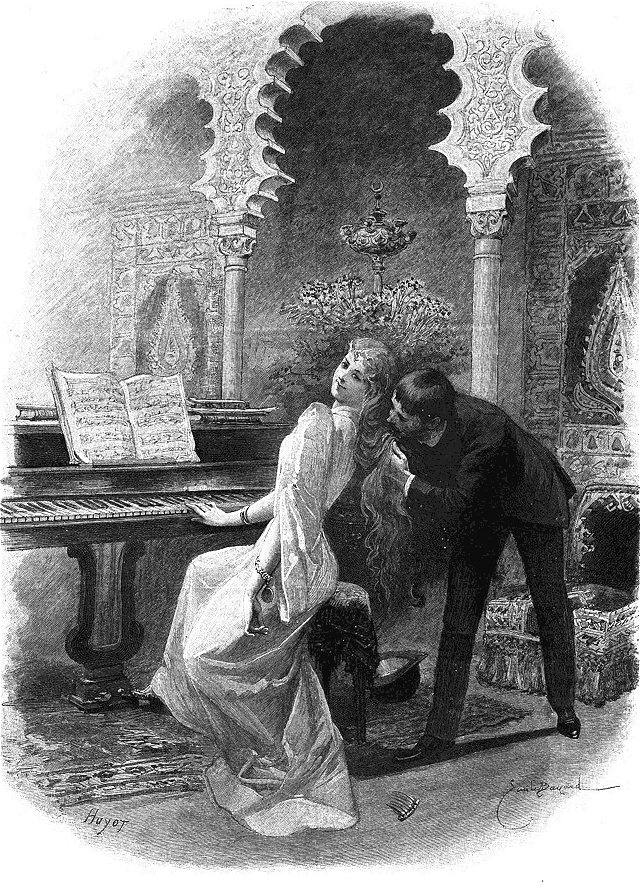
CHARME DANGEREUX
PAR
ANDRÉ THEURIET
Illustrations d'ÉMILE BAYARD
Suite Voir nos numéros depuis le 13 décembre 1890.
XI
Dès qu'elle eut tourné l'angle de la rue, Thérèse parcourut d'un regard anxieux la portion lumineuse du boulevard Dubouchage et tressaillit en apercevant une rapide silhouette qui s'élançait chez le costumier, dont le magasin encore éclairé s'ouvrait non loin de l'avenue de la Gare. Elle devina Jacques plutôt qu'elle ne le reconnut et elle résolut d'épier le moment où il reparaîtrait sur le trottoir.--En face du magasin, de l'autre côté de la chaussée, il y avait entre deux platanes un banc noyé dans l'ombre des façades voisines. Thérèse s'y assit et s'y dissimula de son mieux. Novice à ce métier d'espion dont elle avait honte, elle s'effarait au moindre bruit. Elle s'imaginait que le regard de chaque passant se fixait sur elle avec une curiosité soupçonneuse--injurieuse peut-être--et elle tremblait que quelque chercheur d'aventures, enhardi par l'obscurité, n'eût la tentation de s'arrêter et de lui parler. Un quart d'heure s'écoula, un quart d'heure d'angoisse, puis la porte du costumier se rouvrit; dans la projection blafarde produite par l'éclairage intérieur, Thérèse vit surgir un moine blanc et ses derniers doutes s'évanouirent. Jacques n'avait même pas pris la précaution de se masquer; il stationna un moment sur les marches pour rabattre son capuchon sur sa tête nue, puis, retroussant sa robe, il s'éloigna dans la direction de la place Masséna. Malgré l'émotion qui l'oppressait et lui paralysait les jambes, la jeune femme fit effort sur elle-même et le suivit.
D'un pas allègre il longeait les arcades, sans se douter de l'espionnage auquel il était soumis. Il traversa la place pleine d'un va-et-vient de masques et ne ralentit sa marche qu'à l'angle du pont et du quai. A quelque distance, derrière lui, l'ombre noire de Thérèse côtoyait prudemment le mur du parapet. Quand Jacques arriva au square des Phocéens, il resta un moment indécis et piétinant sur place comme quelqu'un qui attend avec impatience. Thérèse profita de ce qu'il lui tournait le dos pour se glisser parmi les massifs du square, et là, invisible, mais pouvant facilement distinguer ce qui se passait sur le quai, elle attendit à son tour. La solitude et le silence de ce jardin contrastaient avec les joyeuses rumeurs qui bourdonnaient dans la direction de la rue Saint-François-de-Paule. Les chants des masques montaient au loin, mêlés à des bouffées de musique; plus près, aux abords du pont des Anges, la plainte très douce de la Méditerranée sur les galets coupait mélancoliquement le brouhaha de la fête. Neuf heures sonnèrent. Le trot de deux chevaux retentit sur le pont et, entre les branches à demi-effeuillées des poivriers, Thérèse aperçut un équipage entièrement drapé de blanc, qui vint stopper sur le quai. En même temps elle vit Jacques se détacher du trottoir, traverser la chaussée et courir vers la mystérieuse voiture.--Blanche sur le fond blanc du landau, une femme se souleva à demi et fit un signe de la main; un valet de pied revêtu d'un domino ouvrit la portière au moine qui, d'un bond, prit place à côté de l'élégante forme féminine. Puis le laquais remonta sur son siège et, au pas, le landau gagna la rue Saint-François-de-Paule, tandis que Thérèse, dont les genoux fléchissaient, s'asseyait consternée sur l'un des bancs du square...
Etait-ce possible? Après quinze mois de mariage!... Être réduite, non plus même à se débattre contre de vagues soupçons, mais à constater dans les conditions les plus humiliantes le mensonge et l'infidélité de l'homme en qui elle avait religieusement placé toute sa confiance, toute sa tendresse! Elle tordait l'une dans l'autre ses mains glacées et cherchait à se faire du mal, comme si la douleur physique eût eu le don de chasser ce cauchemar atroce... Hélas! non, ce n'était pas un mauvais rêve, Thérèse vivait en pleine réalité--une réalité brutale dont l'étreinte la meurtrissait impitoyablement.--Elle entendait les bruits de fête du carnaval, elle distinguait encore le trot des chevaux qui emportaient Jacques et Mme Liebling vers le Corso, et le grincement des roues sur le sable se répercutait dans son cerveau endolori. Elle n'eut eu qu'à se lever et à courir pour rattraper les coupables et prendre Jacques en flagrant délit de traîtrise... Mais à quoi bon?... Elle en avait assez vu pour qu'il ne lui restât plus la moindre incertitude. L'écroulement était total; elle était saturée de souffrances et n'avait plus la force d'en supporter de nouvelles. D'ailleurs, elle ne pouvait laisser plus longtemps seules Mme Moret et Christine. Il ne fallait pas que les deux femmes se doutassent de ce qui passait; c'eût été pour la petite mère un coup trop rude, et pour Christine trop de satisfaction. A la pensée de ce qui arriverait si la conduite de Jacques était connue de Mme Moret, Thérèse se retrouvait courageuse.--Non, cette tragédie devait rester cachée au fond de son cœur. L'humanité lui commandait d'éviter un éclat capable de tuer cette vieille mère qui la chérissait comme sa fille et qui croyait en son fils comme en Dieu. L'explication aurait lieu avec Jacques seulement; ils auraient à chercher ensemble une solution qui ménagerait la tendresse de Mme Moret tout en sauvegardant la dignité de l'offensée. Et, d'un pas précipité, emportant sa désolation au milieu des rumeurs de la fête, Thérèse gagna la rue Carabacel par le chemin le plus court.
Pendant ce temps, le landau de Mme Liebling descendait lentement la rampe de la rue Saint-François-de-Paule.
--Vous le voyez, murmurait Mania, répondant par une légère pression à l'étreinte fiévreuse de Jacques, j'ai tenu parole... A propos, n'avez-vous point de loup?... Oui... Eh bien, masquez-vous.
--Vous avez peur d'être vue avec moi? demanda ce dernier tout en obéissant.
--Non, certes... Sachez que la peur du qu'en dira-t-on ne m'a jamais arrêtée. Ce que j'en fais est surtout dans votre intérêt... Croyez-vous bien utile que les journaux de Nice publient demain que vous vous êtes promené avec moi au Corso?... Vous devriez au contraire me remercier de ma générosité. Je vous épargne de la sorte sinon des remords, du moins les reproches... légitimes d'une personne qui vous est chère!
Tandis qu'elle lui parlait de ce ton demi-railleur et demi-sérieux qui lui était familier, Jacques haussait les épaules et se mordait les lèvres. En ce moment, cette allusion directe à ses devoirs de mari gâtait son bonheur en remuant au fond de lui de fâcheux scrupules. Il se renfonça avec humeur dans un coin du landau et garda un silence embarrassé.
La voiture prenait la file et s'engageait dans la piste du Corso, au milieu de la foule tassée de chaque côté de la chaussée et sur les gradins de l'amphithéâtre. La lune n'était pas levée, et sous un ciel diamanté d'étoiles les tribunes demeuraient enveloppées dans une ombre crépusculaire. Le fond de la place avait l'air d'un lac noir où s'agitaient des masses confuses. A travers les gradins de l'estrade, des vendeurs de moccoletti circulaient, offrant leurs paquets de minces cierges emmanchés à des roseaux. Çà et là, une lueur trouait la nuit; les moccoletti jetaient dans l'obscurité le scintillement falot de leurs lumignons soufflés à chaque instant, puis se rallumant pour s'éteindre encore. En bas, des pierrots blafards se trémoussaient au milieu de la piste où alternaient deux orchestres. En cette pénombre, des voitures de masques, vagues et silencieuses comme des fantômes, défilaient, drapées de blanc, éclairées de lanternes blanches, capricieusement décorées: l'une d'elles était enguirlandée de virginales fleurs d'amandier; une autre, vaste berceau tendu de mousseline, contenait un pâle foisonnement de nourrices et de bébés; une troisième, capitonnée de fourrures, traînait des hôtes disparaissant sous des pelisses neigeuses. Le landau de Mania, drapé de peluche, était couvert d'un tapis de juliennes et de violettes blanches; du milieu de cette jonchée odorante surgissait à demi la jeune femme, coiffée d'une toque de peau de cygne, emmitouflée dans sa pelisse de chèvre du Thibet et semblable à une Nixe Scandinave.
Les masques des voitures et les dominos des tribunes se lançaient des boules de papier qui s'émiettaient tout à coup en l'air, et des giboulées floconnantes s'éparpillaient sur les blanches apparitions de ce fantastique défilé. Les danses mêmes des masques autour des équipages prenaient des apparences de rêve sous la tremblante clarté des étoiles ou à la clignotante lueur des moccoletti. Peu à peu Jacques se laissait gagner par cette voluptueuse fantasmagorie. L'aspect de ces blancheurs duvetées et fuyantes, la musique berceuse des valses, lui donnaient des sensations toutes neuves. Ces airs de danse, entendus autrefois et accompagnant maintenant de leur mélodie familière l'étrange défilé des masques pâlissants, lui remuaient mollement le cœur. Il lui semblait assister à la résurrection des heures de jeunesse dont il n'avait pas joui; les joies entrevues à vingt ans, ardemment convoitées et dont il avait fait son deuil, apparaissaient tout à coup à sa portée, comme évoquées par une baguette féerique, et facilement réalisables. Sous les blanches fourrures qui l'enveloppaient, il sentait le contact tiède du corps de Mania. A la discrète et brève clarté des moccoletti, il distinguait le scintillement des yeux de la jeune femme et le mobile sourire de ses lèvres. Il n'osait point parler, comme s'il eût craint qu'au son de ses paroles tout ce délicieux rêve ne se fondit ainsi qu'un givre; mais sa main avait cherché celle de Mania, et, l'ayant rencontrée, ne la quittait plus.
Prise également sans doute par la nouveauté charmante du spectacle, étourdie par ce lent tournoiement à travers des ombres fuyantes, heureuse de savourer un plaisir non encore goûté, Mme Liebling ne retirait pas sa main. Les deux paumes se touchaient, les doigts s'étreignaient...
--Merci! murmura Jacques d'une voix étouffée.
--Rapidement elle lui posa sur les lèvres le bout de son éventail de plumes.
--Ne parlez pas! chuchota-t-elle, vous feriez envoler le charme.
Elle oubliait elle-même à ce moment son scepticisme à l'endroit de l'amour et se sentait mollement inclinée à s'attendrir; mais elle gardait sa répugnance pour les phrases sentimentales. Les déclarations sans cesse pareilles à l'aide desquelles les amoureux se croient obligés de traduire ce qu'ils éprouvent lui avaient toujours paru d'une banalité ridicule et, au milieu de cette blanche féerie du Corso, elle souhaitait que rien de vulgaire ne gâtât la joie exquise et rare qu'elle ressentait. Elle se trouvait dans cette disposition d'âme où la femme est remuée jusque dans le tréfonds de son être et où, pour un amant, le silence est le plus puissant des auxiliaires. A cet instant, sans que Jacques s'en doutât, sous cette lumière assoupie, dans ce doux tournoiement mystérieux, son cœur s'alanguissait et s'en allait amoureusement vers lui. Elle se livrait presque mentalement; ses yeux se fermaient, ses lèvres devenaient froides. Elle eût voulu être devinée et, sans qu'un mot fût prononcé, emportée dans une longue, silencieuse et berceuse étreinte...
Après avoir deux fois longé la piste, le landau gagnait le Cours où les pâles files de piétons et d'équipages se fondaient comme de la neige dissoute dans l'éblouissante phosphorescence de la lumière électrique. Les rayons incandescents traversaient dans toute sa longueur la rue Saint-François-de-Paule et baignaient d'une coulée d'argent en fusion la lente procession des voitures. Sous cette clarté métallique et vibrante, les jolies femmes emmitouflées de dentelles, les moines blafards et les pierrots enfarinés apparaissaient comme des personnages de la Comedia dell'arte. Cela donnait une impression à la fois sensuelle et tendre, pareille à celle que laissent les comédies de Musset ou les mélodies de Mozart. Involontairement Jacques se remémora la représentation de Don Juan; il revit Mania entrant dans sa loge, tandis que Faure et la Ludkoff chantaient «La ci darem la mano». Au moment où le landau passait devant l'Opéra-Municipal, il se pencha vers Mme Liebling et lui dit:
--C'est là que je vous ai aperçue pour la première fois... Comme vous étiez belle, et comme le duo de Zerline et de Don Juan était en harmonie avec votre beauté!... Je n'entendrai plus jamais la musique de Mozart sans vous avoir devant les yeux.
L'intensité de la lumière, éclairant la rue comme en plein jour, avait tiré Mania de son rêve alangui. Elle dégagea sa main, et hochant la tête:
--Ah! soupira-t-elle. Don Juan!... Cette musique-là est l'image de la vie: le trio des masques, la chanson de Zerline, la sérénade, puis l'arrivée du Commandeur à travers les danses; les dominos et les musiciens qui s'enfuient épeurés; le séducteur qui s'enfonce dans les dessous et, finalement, le rideau qui tombe...--Elle eut un sourire désabusé, puis regardant Jacques droit dans les yeux:
--Voici également la fin de la fête et le moment des adieux, ajouta-t-elle pendant que le landau, après avoir gravi la rue, débouchait sur le quai presque désert.
Jacques tressaillit, et, lui saisissant brusquement le bras:
--Non, s'écria-t-il, ne nous quittons pas ainsi... Accordez-moi encore une heure, je vous ai à peine parlé!
--Le silence est d'or, interrompit Mania en secouant de nouveau la tête... Mais soit! promenons-nous encore une heure, puisque vous le désirez, et causons raisonnablement, comme des camarades... Où voulez-vous aller? Je ne vous propose pas de retourner au Corso; il ne faut pas rêver deux fois le même rêve.
--J'irai où vous voudrez, répondit-il enchanté, peu m'importe, pourvu que je sois près de vous!
--Baptiste, dit la jeune femme en se penchant vers le cocher, conduisez-nous sur la route de Villefranche.
Le cocher dirigea ses chevaux vers la place Garibaldi. Mania s'était enveloppée dans sa pelisse et avait ôté son loup.
--Comme vous êtes belle! murmura Jacques, en se démasquant à son tour et en la contemplant de l'air d'un homme en extase.
--De grâce, pas de compliments, sinon je rentre à la maison!... Non, parlez-moi de vous, de votre peinture et de vos études. Voilà qui m'intéressera bien plus que vos fleurettes à la française.
Et, commençant la première, elle se mit à l'interroger curieusement sur son enfance, sur son village et ses années de début à Paris.--Jacques, dérouté par ce caprice qui coupait court aux tendres effusions dont il avait rêvé de remplir cette heure de tête-à-tête, répondit d'abord très laconiquement, puis, peu à peu aiguillonné par les réflexions spirituellement suggestives dont Mania entremêlait ses interrogations, il s'échauffa et devint éloquent en causant des choses qui le touchaient intimement. Il conta ses premières impressions en face de la nature, et ses joies solitaires lorsqu'il étudiait au milieu des bois ou dans l'atelier de Lechantre. Il parla de la façon dont il comprenait son art, de ses luttes pour serrer de plus près la vérité, et il énuméra ses projets de tableaux. Il voulait, dans une série de grandes toiles, retracer toute la vie campagnarde: la fenaison, la moisson, les semailles, les amours villageois, un enterrement de jeune fille.
Tandis qu'il discourait, ses yeux pétillaient, son front s'illuminait, ses traits irréguliers prenaient une originale expression de beauté intellectuelle, et Mania, penchée vers lui, écoutait avec un intérêt croissant les confidences de cette âme d'artiste enthousiaste et naïve. Cette mondaine raffinée goûtait avec un renouveau d'émotion la verdeur sauvage, la sincérité absolue, d'un esprit à la fois élémentaire et merveilleusement doué. En entendant le peintre décrire avec amour ses friches natales, embaumées de serpolet, ou ses champs labourés exhalant au soleil leur bonne odeur de terre, elle retrouvait en elle-même les sensations d'une enfance passée au milieu des plaines galiciennes et ses yeux se mouillaient.--Au moment où il se dépitait du tour que prenait la conversation, Jacques, à son insu, agissait plus fortement sur le cœur de Mme Liebling que s'il lui eût adressé la plus brûlante des déclarations.
Pendant cette première partie de l'entretien, le landau descendait la rue Ségurane et longeait le port, dont les feux rouges et jaunes luisaient dans l'obscurité. On distinguait confusément un fouillis de mâts, de vergues et de cheminées. Toutes ces lignes noires surgissaient de l'ombre et s'entrecroisaient sur le ciel plus clair.--Maintenant les chevaux gravissaient la rampe de Montboron, bordée de jardins en fleurs et de villas endormies. Quand ils arrivèrent au sommet de la montée, la lune déjà échancrée se leva au-dessus du Mont-Gros et éclaira d'une tranquille lumière les découpures de la côte jusqu'à la presqu'île du cap Ferrat. La mer très calme étalait sa nappe d'argent, estompée tout au fond par une brume légère. On la voyait ourler d'un liseré blanc les roches de la presqu'île, puis reparaître, scintillante, au-delà de cette langue de terre et se confondre au loin avec les bleuâtres contours des montagnes. Sur cette blancheur laiteuse, l'architecture des terrasses et les massifs des jardins ressortaient en masses foncées et vigoureuses. Ça et là un rayon de lune piquant dans ce noir des taches d'une clarté vive mettait en lumière le feuillage vernissé d'un magnolia ou l'épanouissement d'une touffe de roses. Le vent s'était assoupi. Une paix profonde enveloppait la route solitaire et, par intervalles, une bouffée aromatique se répandait comme une caresse dans l'air transparent.
--Oui, certes, continuait Jacques, j'aime la peinture; elle m'a donné de grandes joies, mais aucune n'est comparable à celle que j'éprouve en ce moment sous ce beau ciel, par une nuit enchantée, auprès de vous... si près que la tête me tourne à l'odeur de ces tubéreuses qui sont à votre corsage!
En même temps, d'un geste hardi il s'empara de l'une des tiges fleuries qui émergeaient dans l'entrebâillement de la pelisse, il la portait à ses lèvres et la cachait dans son froc de moine.
--Vous retombez dans votre vieux péché, dit Mania en fronçant le sourcil; ne pouvez-vous donc causer une demi-heure avec une femme sans débiter des compliments ou sans commettre une inconvenance?
--Soit, je suis fou, balbutia-t-il, est-ce ma faute si vos yeux me grisent comme un vin trop fort?
--J'en suis désolée en ce cas, répliqua-t-elle gravement, car vous ne devez pas vous enivrer de ce vin-là.
--Et pourquoi? s'écria-t-il impétueusement.
--Parce que vous n'êtes pas libre, répartit-elle.
--Libre! murmura-t-il irrité, qui donc est libre en ce monde?... Il m'est impossible de ne pas vous aimer et vous ne pouvez m'en empêcher... Toute passion sincère est irrésistible.
--Voilà de beaux principes! reprit-elle en raillant; supposez un instant que quelqu'un soit très amoureux de Mme Jacques Moret et lui tienne ce même langage... Seriez-vous charmé qu'il mît votre théorie en pratique?
Jacques se mordait les lèvres et redevenait silencieux. Cette nouvelle allusion à Thérèse lui faisait éprouver un sentiment de honte et de gêne. Il était à la fois agacé et choqué. Tout ce qu'il y avait en lui de délicat et de loyal souffrait d'entendre prononcer le nom de l'honnête femme qu'il méditait de tromper, par celle qui avait provoqué cette trahison. Cela lui semblait une profanation plus coupable presque que la trahison elle-même. Puis, par un singulier dédoublement de sa propre pensée, il songeait avec ennui que l'évocation de la pure image de Thérèse au milieu de son galant tête-à-tête allait fatalement interrompre le courant amoureux qui s'était établi entre Mania et lui, et l'obliger à recommencer son siège. Il s'exaspérait de cette malencontreuse allusion et, n'ayant pu l'arrêter sur les lèvres de Mme Liebling, il s'efforçait du moins en gardant un silence boudeur de laisser tomber la conversation.
--Vous ne répondez pas, poursuivit malicieusement Mania, vous sentez vous-même qu'il n'y a rien à répondre.
Il eut un geste d'impatience.
--En effet, madame, répliqua-t-il amèrement, vous êtes la logique en personne!... Il s'était rejeté dans le coin du landau et persistait dans son humeur taciturne, il regardait avec dépit les chevaux descendre au trot la rampe de Villefranche. Il se disait que dans quelques minutes on atteindrait le bourg et que, docile aux ordres de sa maîtresse, le cocher rebrousserait chemin. Il calculait la rapidité du retour, regrettait la fuite de ces minutes précieuses qui ne se retrouveraient plus et, tout en s'obstinant dans son mutisme, il se désolait de ce silence et de l'occasion perdue.--Il y a chez l'homme un fonds de naïveté candide qui le rend moralement supérieur à la femme, et qui pourtant dans les luttes de la vie de tous les jours constitue un état d'infériorité. Jacques était convaincu de la sincérité des objections de Mania, tandis que celui-ci ne les avait soulevées qu'avec le secret espoir de les voir réfutées. Elle observait le peintre du coin de l'œil et souriait énigmatiquement. Quand elle eut constaté que son compagnon s'entêtait à garder le silence, elle comprit qu'elle avait dépassé le but.
--Qu'avez-vous? demanda-t-elle, vous boudez?
--Moi?... pas le moins du monde, seulement je réfléchis...
--Et a quoi pensez-vous?
--Je pense que vous êtes une froide statue et que vous ne m'aimez pas!
--Voilà une galante découverte!... Pour ne pas être en reste avec vous, je vais vous en confier une autre que j'ai faite: c'est que vous aimez trop votre femme pour qu'il vous soit possible d'aimer fortement ailleurs.
--Vous savez bien le contraire, protesta-t-il, vous savez bien que vous m'avez ensorcelé!
--Oui, je joue le rôle de la méchante fée, tandis que la fée du foyer demeure dans le fond de votre cœur, pure, impeccable, religieusement adorée.
--Qu'en savez-vous?
--Ne l'ai-je point vu tout à l'heure? Vous êtes devenu morose rien qu'à la pensée qu'elle put appliquer pour son compte vos théories sur la passion irrésistible.
--Ce n'est pas la même chose.
--Naturellement... Elle, la sainte madone, doit rester inattaquable et immaculée dans son sanctuaire... Mais Mme Liebling, une étrangère un peu coquette, un peu excentrique, et d'ailleurs séparée de son mari... oh! celle-là, on peut lui faire la cour sans scrupules, on peut chercher à la compromettre, et, en supposant qu'elle succombe, cela ne tire pas à conséquence!... Et si Mme Liebling, qui n'est pas une sotte et sait se défendre contre ses propres faiblesses, hésite à livrer sa personne à quelqu'un qui ne lui donnerait en échange qu'un morceau de son cœur, on l'accuse d'être incapable de tendresse, et on l'appelle «une froide statue»...
Elle s'interrompit pour s'adresser au cocher:
--Baptiste, voici Villefranche... Il est temps de rentrer!
Dans le creux du rocher, la petite ville endormie étageait au-dessus de la mer ses maisons dont le clair de lune blanchissait les façades. Le landau tourna lentement, puis les chevaux effleurés par le fouet de Baptiste remontèrent au petit trot la côte qu'ils venaient de descendre.
--Vous souvenez-vous, reprit Mania en plongeant ses yeux brillants dans ceux de Jacques, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de mon caractère, la première fois que nous avons causé ensemble à la villa Endymion?
--Oui, vous m'avez avoué que vous aviez le cœur sensible... Je crois que vous vous vantiez un peu.
--C'est possible... Mais j'ai ajouté que j'étais affreusement exclusive... Je n'ai pas changé... Tout ou rien, et, si je commettais la folie d'aimer, je n'admettrais pas le partage. Je voudrais qu'on fût à moi sans arrière-pensée, sans compromission.
En même temps elle le regardait d'un air de défi.
--Ainsi, murmura-t-il, captivé par cet attirant regard, vous aimeriez celui qui satisferait à ces conditions?
Le landau filait maintenant avec rapidité sur la route plane, et Jacques, les yeux attaches aux yeux de Mania, se sentait entraîné vers un inconnu plein de promesses. Il était arrivé à ce degré d'exaltation où les reniements ne coûtent plus rien, où l'âme maîtrisée par le désir est prête à tous les abandons, à toutes les apostasies.
--Permettez, rectifia Mme Liebling, j'ai simplement dit que si j'aimais, j'exigerais en retour qu'on m'appartint tout entier.
--M'aimeriez-vous, balbutia-t-il, si je vous jurais de tout oublier pour vous?
--Tout? répéta-t-elle avec un sourire incrédule, c'est beaucoup vous aventurer.
--Que m'importe tout ce qui n'est pas vous!
--Vous vous donneriez sans regret?
--Sans regret.
--Sans partage?
--Corps et âme... en esclave.
Elle éclata de rire.
--Vous ne me croyez pas? s'exclama-t-il, choqué.
--Si fait, mais j'ai peur que vous ne ressembliez aux enfants qui promettent tout ce qu'on veut pour avoir une dragée, et qui ne se souviennent plus de rien, dès qu'ils l'ont obtenue.
Il eut un geste irrité. Ce rire et ce sarcasme intempestifs l'énervaient cruellement. Le dépit lui serrait le gosier et lui mettait presque des larmes dans les yeux.
--Non, vous ne m'aimez pas! grommela-t-il avec rage, sans quoi vous n'auriez pas le cœur de plaisanter en un pareil moment.
Elle fut émue de l'expression tragique de ses traits et comprit qu'elle l'avait exaspéré. La colère et l'amour l'avaient transfiguré. La clarté lunaire pâlissait encore son visage et faisait mieux ressortir la carrure du front sous les cheveux noirs, l'amertume passionnée des lèvres sous la barbe frisante, le feu sombre des yeux humides. Mania le trouva vraiment beau; elle éprouva le même voluptueux frisson qui l'avait secouée lorsqu'une demi-heure avant il avait parlé de sa vie à la campagne--et la mystérieuse source de la tendresse se rouvrit en elle. Elle le regarda plus affectueusement et lui tendit les mains.
Il les serra avec emportement et ne les lâcha plus.
--Vrai! balbutia-t-il, vous ne vous moquez pas?... Vous m'aimez un peu?
--Comment osez-vous en douter? répondit-elle très bas, et la sourdine caressante de cette réponse à peine articulée en doubla encore le prix.
Dans l'éblouissement qui l'affolait, Jacques attirait la jeune femme vers lui et voulait la serrer dans ses bras. Elle l'arrêta d'un regard, et se reculant:
--Soyez plus calme, je vous en prie... Songez que nous voici à Nice et que la route n'est plus déserte.
Le landau avait en effet dépassé Montboron, et croisait a chaque instant des voitures qui revenaient du Corso.
--Déjà! se récria Jacques, et c'est à peine si j'ai pu vous dire le quart de ce que j'ai dans le cœur... Déjà vous quitter? Quand et où vous reverrai-je?
--Mais, répliqua-t-elle, quand vous voudrez, chez moi... Ne vous ai-je pas dit qu'on m'y trouvait tous les soirs, de cinq à sept heures?...
--Oui, soupira-t-il, à l'heure de tout le monde, au milieu de votre cercle habituel... Ne comprenez-vous pas, si vous m'aimez un peu, que l'amour veut plus d'intimité, et ne me permettrez-vous pas de me retrouver avec vous dans les mêmes conditions que ce soir?
--Oh! s'exclama-t-elle, vous êtes bien exigeant, pour un nouveau converti! Avant d'avoir pleine confiance en vous, laissez-moi mettre un peu votre beau zèle à l'épreuve... D'ailleurs mon salon n'est pas aussi fréquenté que vous l'imaginez; en y venant vers six heures, vous risquerez fort de m'y trouver seule quelquefois... Vous voyez, je suis bonne personne... Et maintenant, en quoi endroit désirez-vous que je vous dépose?...
La voiture longeait le port. Jacques pensa à Francis Lechantre et au yacht du baron Herder. Il réfléchit à l'impossibilité de rentrer rue Carabacel en robe de moine, et, comme le magasin du costumier devait être fermé à pareille heure, il résolut d'aller trouver Francis, afin de le charger de la restitution de son travestissement.
--Je descendrai ici, répondit-il à Mania. J'ai un ami qui est à bord de l'Hébé, et j'ai besoin de lui parler.
--Je comprends, dit railleusement Mme Liebling; cela s'appelle, je crois, en France, se procurer un alibi!... Enfin, ce soir, je suis disposée à l'indulgence... Good by!
--A bientôt... Je vous adore! chuchota-t-il en lui baisant la main. Il sauta sur le quai, et le landau partit au grand trot.
Il découvrit assez rapidement l'Hébé, et, s'adressant à un matelot qui était de planton à l'arrière, il demanda Francis Lechantre.--Le paysagiste n'était pas rentré. Jacques pénétra dans l'intérieur du roof, enleva son costume, sous lequel il avait eu la précaution de garder son veston, puis, faisant un paquet du froc, il le remit au matelot avec un bout de billet pour Lechantre.
Quant il eut retraversé la passerelle, et qu'il se retrouva sur le quai désert, il lui sembla qu'il avait laissé, avec son travestissement, un peu de l'ivresse qui tout à l'heure lui bouillonnait dans la tête. En même temps que la fraîcheur de la nuit lui tombait sur les épaules, de mélancoliques réflexions lui assombrissaient l'esprit. «Cette entrevue avec Mania, si ardemment souhaitée, était maintenant déjà dans le passé, et que lui en restait-il?... Une vague promesse d'amour. Il revenait de ce rendez-vous plus épris que jamais, le cœur plus gonflé de désirs, mais avec la conscience d'avoir obtenu bien peu.» Si cette réflexion l'attrista et le découragea un instant, elle eut du moins le résultat de diminuer ses remords. Il envisagea peu à peu son infidélité avec plus d'indulgence, en se disant qu'il n'avait aucun gros péché à se reprocher, et allégé en pensant que, le lendemain, il pourrait soutenir le regard de Thérèse sans trop d'embarras, il hâta le pas dans la direction du Paillon.--«Il est onze heures, songeait-il, et je trouverai la maison endormie. Tant mieux! Je n'aurai ce soir aucune explication à donner ni aucun mensonge à inventer.» Néanmoins, quand il fut sur le Pont-Neuf, il s'attarda, accoudé au parapet, afin d'être plus sûr, en rentrant, de n'être dérangé par personne.--La fête était terminée, mais des rumeurs tumultueuses, des cris de masques en goguette, emplissaient encore les rues avoisinantes. Sous la blanche clarté de la lune, il eut de nouveau la vision du Corso et de Mania, étendue parmi ses fourrures dans le landau qui courait le long de la Corniche, puis il regretta de s'être montré trop timide et de n'avoir pas assez profité de la liberté de cette heure irretrouvable. Brusquement, il quitta le pont et gagna d'un trait l'angle de la rue Carabacel. Avec d'infinies précautions il introduisit son passe-partout dans la serrure, franchit en tâtonnant le vestibule. Tout l'appartement semblait plongé dans le sommeil. A pas de velours, il se glissa dans le couloir, ouvrit doucement la porte de sa chambre et resta soudain interdit.--Près d'une lampe à demi-baissée, Thérèse était assise au coin de la cheminée, et, immobile, le regardait entrer.
XII
Dès le premier coup d'œil jeté sur sa femme, Jacques comprit qu'elle le soupçonnait et prévit la possibilité d'une explication pénible. Toutefois, persuadé que la jalousie de Thérèse était purement instinctive et ne se fondait que sur de vagues suspicions, il résolut de payer d'audace et de répondre à ses interrogations du ton dégagé et avec l'assurance d'un homme qui n'a rien a se reprocher.
--Comment! s'écria-t-il, tu n'es pas couchée?
En entendant venir son mari, Thérèse avait eu d'abord grand'peine à réprimer un mouvement d'indignation. Mais, quand elle eut rapidement constaté l'aplomb du coupable, elle reprit possession d'elle-même et préféra, avant d'éclater, le laisser s'embarrasser dans ses propres mensonges. D'ailleurs elle ne pouvait croire encore à une complète duplicité et peut-être s'attendait-elle, de la part de Jacques, sinon à une soudaine expression de repentir, du moins à quelques marques de confusion.
--Non, répondit-elle, j'étais inquiète et je n'ai pas voulu m'endormir avant de te savoir rentré... T'es-tu amusé à ta soirée?
--Mais oui, assez, répliqua-t-il, enchanté du tour que prenait l'interrogatoire.
--A quoi avez-vous passé votre temps?
--Nous avons fait un whist et bu du thé.
--C'est un divertissement médiocre... Etiez-vous nombreux?
--Quatre en tout, moi compris.
--J'imaginais que vous étiez peut-être allés au Corso... Il n'y avait pas de dames avec vous? ajouta Thérèse sarcastiquement.
--Quelle idée! A quel propos me demandes-tu cela?
--Mon Dieu, en carnaval, c'eût été tout naturel... Et puis, poursuivit-elle en accentuant ironiquement ses paroles et en fixant ses yeux sur le veston de Jacques, cela m'expliquerait la provenance de ces fleurs qui décorent ta boutonnière...
Jacques, déconcerté, abaissa un regard sur son veston et y aperçut les tubéreuses dérobées à Mania. Il avait oublié de les enlever avec sa robe de moine.
--Hein! balbutia-t-il, interdit, ces tubéreuses... Ah! oui, une plaisanterie de Lechantre.
Cette fois, Thérèse ne put se contenir.
--Tenez, dit-elle en éclatant, ne vous empêtrez pas davantage dans vos mensonges... Vous n'êtes pas encore fait a ce métier-là!
--Moi, je mens? protesta-t-il en rougissant.
--Oui, vous mentez, affirma Thérèse, et j'en ai honte pour vous... Vous n'étiez pas chez le baron Herder, mais au Corso... Vous n'y êtes pas allé en compagnie de Lechantre, mais bien en tête-à-tête avec une femme... N'essayez pas de nier... Je vous ai suivi, je vous ai vu sortir de chez le costumier et monter dans le landau de cette dame!
Devant ces accusations articulées avec preuves à l'appui, Jacques perdait contenance. Il sentit que toute dénégation devenait inutile. En même temps, de désagréables réflexions se succédèrent rapidement dans son esprit. Il eut conscience du désastre qui menaçait la paix de son intérieur conjugal, de la peine qu'il infligeait à Thérèse et du chagrin qu'éprouverait la petite mère, si elle venait à savoir ce qui se passait. Puis, simultanément, il songea que la découverte de ce commencement d'infidélité le forcerait à rompre toute relation avec Mania Liebling et cela acheva de le troubler en l'exaspérant. Il s'irrita contre lui-même, contre l'espionnage de la jeune femme, contre la fatalité qui donnait la proportion d'une faute irrémissible à ce qu'il se plaisait à considérer comme un péché véniel.--Après tout, selon son indulgente estimation, son crime se réduisait à une flirtation un peu vive; l'infidélité n'avait pas été consommée et il lui semblait souverainement injuste qu'on poussât ainsi les choses au tragique. Furieux d'avoir été mis dans son tort, il ne trouvait d'autre moyen de se tirer d'affaire que de prendre à son tour l'offensive. Aussi, quand Thérèse surexcitée par son silence eut ajouté d'un ton provocant:
--Cette dame était la baronne Liebling, ayez donc le courage de l'avouer!
Il répliqua avec emportement:
--Eh! oui, c'était Mme Liebling... Tu le sais bien, puisque tu as pris la peine de m'espionner... Si c'est Christine qui t'a donné ce joli conseil, je lui en fais mon compliment!... C'était Mme Liebling, à qui j'avais promis hier de lui rendre visite dans sa voiture... Le cas n'est pas pendable, j'imagine, la chose s'étant passée en landau découvert, devant des milliers de personnes... Je ne t'en aurais pas fait mystère, si, dès le début, tu n'avais manifesté une jalousie enfantine. En me taisant, j'ai simplement voulu ménager des susceptibilités qui, permets-moi de te le dire, ne sont guère de mise dans ce pays-ci et dans le monde où nous vivons.
Alors, avec un redoublement de mauvaise humeur, il lui laissa entendre qu'ayant épousé un artiste, elle devait se soumettre à certaines obligations qu'impose la nécessité de se créer des relations.--Un peintre ne devait pas être jugé d'après les préventions qui ont cours chez les bourgeois, et ce qui semblait une énormité à Rochetaillée était considéré dans le monde comme une action fort innocente. Une femme exposée à rencontrer chaque jour des modèles dans l'atelier de son mari devait montrer un esprit plus tolérant et se défaire de ces mesquines idées provinciales.--Se grisant de ses propres paroles et s'obstinant à plaider les circonstances atténuantes, il ne s'apercevait pas de la cruauté de son argumentation et il aurait continué longtemps ainsi si Thérèse ne lui avait impétueusement coupé la parole:
--Taisez-vous! murmura-t-elle, ne sentez-vous pas que vos propos me déchirent le cœur? Ils sont si différents de ceux que vous me teniez dans le jardin du Prieuré, lorsque vous me demandiez de vous épouser!... En ce temps-là, c'était moi qui me trouvais trop paysanne pour vivre dans votre milieu, et c'était vous qui me rassuriez en me répétant que j'étais la meilleure femme que pût désirer un artiste... Il n'y a pas trois mois, vous aviez le monde en aversion et vous me proposiez de vivre dans la plus absolue solitude... Le changement a été prompt! Celle qui a transformé vos goûts m'a du même coup enlevé votre cœur, et vous osez me reprocher d'être jalouse de cette créature?... Et quand je suis navrée de vos mensonges, quand je pleure notre bonheur détruit, notre intimité brisée par une étrangère, vous ne craignez pas de railler mon étroitesse d'esprit et mes préjugés de province! Ah! ma province, mon pauvre petit Prieuré, pourquoi ne m'y avez-vous pas laissée?... Je ne connaîtrais pas l'atroce chagrin que vous me causez aujourd'hui...
Elle s'était rassise et pleurait silencieusement. En voyant ces larmes muettes glisser entre les doigts et rouler sur les bras nus de Thérèse, Jacques fut lentement attendri. Le souvenir des heureux jours du Prieuré, évoqués douloureusement par la jeune femme, acheva de lui retourner le cœur. Sa poitrine se serra, ses nerfs se détendirent et tout d'un coup il s'agenouilla près de Thérèse; il écarta les mains qu'elle tenait appuyées contre sa figure et voulut, en signe de repentir, poser ses lèvres sur les yeux mouillés de l'affligée. Mais d'un geste découragé elle le repoussa et se rejeta en arrière.
--Non, dit-elle, laissez-moi... Ne comprenez-vous pas qu'en ce moment vos caresses me sont odieuses?... Vous avez encore sur vous l'odeur de cette femme à qui, sans doute, vous en avez prodigué de pareilles...
--Thérèse, protesta-t-il, je te jure que tu te trompes... Rien de ce que tu supposes n'est arrivé... Oui, il est vrai, j'ai rencontré hier à la redoute Mme Liebling et, dans un moment d'étourderie, j'ai accepté l'offre d'une place dans sa voiture... Une fois l'engagement pris, j'ai eu peur de passer pour ridicule si je ne le tenais pas. Je suis allé au rendez-vous et mon seul tort est de te l'avoir caché; mais, pendant cette promenade, tout s'est borné à de banales galanteries. Je n'aurais pas dû me prêter aux fantaisies d'une femme coquette et un peu excentrique, mais je t'en demande humblement pardon... C'est toi seule que je chéris et toi seule qui possède le meilleur de moi-même.
Hélas! au moment où il murmurait cette amende honorable, il voyait, entre lui et Thérèse, l'image de Mania s'interposer comme pour donner un démenti à ses protestations. Tandis qu'il parlait, sa pensée, invinciblement, retournait sur la route de Villefranche; il ne pouvait s'empêcher de penser à la blanche forme de Mme Liebling penchée vers lui, à l'attirante caresse de ses yeux, à son bras nu qu'il avait un moment tenu prisonnier entre ses mains, et il sentait que, bon gré malgré, cette apparition tentatrice viendrait, ainsi qu'un regret, se glisser jusque dans l'intime tête-à-tête de la vie conjugale. Thérèse aussi, d'ailleurs, semblait en avoir l'intuition, car elle ne se laissa point fléchir. Les supplications de Jacques n'avaient ni cet élan ni cet accent convaincu qui vont droit au cœur et en font jaillir une source de pardonnante tendresse.--La jeune femme hocha tristement la tête.
--Le mal est fait, reprit-elle, et toutes vos protestations ne le répareront pas. Vous avez vous-même tué la confiance que j'avais en vous, et, quoi que vous me juriez maintenant, je me dirai toujours: «Puisqu'il m'a trompée une fois, pourquoi ne me tromperait-il pas encore?» Du moment où vous avez pu m'abuser par un mensonge, qui m'assure maintenant de votre sincérité?... Ah! continua-t-elle en se tordant les mains, c'est cela qui est plus cruel encore que votre infidélité! Ce qui est affreux, c'est d'être obligée de douter de l'homme en qui on croyait, c'est de sentir diminuer d'heure en heure l'estime et l'affection qu'on avait pour lui...
Il s'élança vers elle et chercha à lui prendre les mains:
--Tu ne m'aimes plus, toi, Thérèse?... Non, ce n'est pas possible!
--Ah! répliqua-t-elle avec désespoir, ne me demande pas ce qui se passe en moi... tout ce que je puis te dire, c'est que c'est navrant... Je ne sais ce qui arrivera et si j'aurai assez de résignation pour te pardonner... Mais il y a dans mon cœur quelque chose de brisé, quelque chose de mort et qui ne revivra jamais... Plus jamais! répéta-t-elle avec un sanglot dans la gorge.
Jacques l'écoutait de l'air énervé et mortifié d'un homme qui a condescendu à demander son pardon, et qui voit ses avances repoussées. Au derniers mots qu'elle prononça, il tourna rageusement les talons et, ses yeux tombant tout à coup sur sa boutonnière où était encore fixée la tubéreuse, il arracha violemment la fleur et la broya dans ses doigts.
--Rassurez-vous, poursuivit Thérèse se méprenant sur la signification de ce geste de dépit, personne ne s'apercevra de rien... J'ai trop de fierté pour étaler devant les autres un pareil chagrin... Je serais désolée que votre mère se doutât un seul instant que je ne vous aime plus, et vous comprendrez vous-même qu'en sa présence nous devons tous deux nous comporter de façon à ce que la pauvre femme garde ses illusions... C'est assez d'une malheureuse ici!... Soyez certain qu'il ne dépendra pas de moi que les apparences soient sauvées... Bonsoir.
Elle avait allumé un bougeoir et posait déjà sa main sur le bouton de la porte.
--Thérèse! s'écria Jacques en lui tendant la main, ne sois pas impitoyable, ne me quitte pas ainsi!
Une femme plus souple ou plus adroite aurait compris, à ce moment, qu'en se montrant indulgente, elle pouvait encore reconquérir sinon tout l'amour d'autrefois, du moins le meilleur de l'affection conjugale; mais Thérèse était bien la fille du rocheux pays langrois; elle avait l'opinion têtue de cette race excessive dans ses enthousiasmes comme dans ses rancunes. Elle ne sut pas profiter de cette minute propice pour regagner par un pardon le cœur hésitant de son mari. Aveuglée par la douleur que lui causait sa blessure, elle acheva d'ouvrir la porte et, sans se retourner, elle disparut.
Jacques eut un nouveau mouvement d'irritation. Il se promena un instant avec agitation à travers sa chambre, puis il haussa les épaules et se déshabilla.
--Après tout, murmurait-il intérieurement, en se jetant dans son lit, si j'ai eu des torts, j'ai cherché à les réparer... Est-ce ma faute, si elle ne veut rien entendre?...
Inconsciemment, au fond de lui, une sourde satisfaction se mêlait à son dépit. L'implacabilité de la jeune femme mettait ses scrupules plus à l'aise. Si fâcheuse qu'elle fût, la situation devenait plus nette et lui permettait de s'abandonner avec moins de remords à sa passion pour Mania.--Il dormit mal, comme on peut le penser, et se réveilla avec une lourde inquiétude sur le cœur. Dès qu'il fut habillé, il se glissa hors de la maison et courut trouver Francis Lechantre, à bord de l'Hébé.
Le paysagiste sommeillait encore dans sa confortable cabine. Au bruit que fit Jacques, il se frotta les yeux et se dressa sur son séant.
--Hé! dit-il, c'est toi, gamin?... Tu viens savoir si ton froc est chez le costumier?... Rassure-toi; hier, en rentrant, j'ai donné des instructions à mon matelot et tout est en ordre... Pendant que tu courais la prétentaine, j'étais moi-même allé au Corso avec la Peppina... Ah! mon fils, elle est tout plein gentille, cette petite bouquetière!... Elle vous a une verdeur... et un appétit!... C'est merveille de lui voir engloutir un risotto et des ravioli!... avec ça, des idées d'un drôle!... Positivement, elle me rajeunit... Mais parlons de toi; comment vont les affaires?
--Mal, répondit Jacques; et tout d'une traite il raconta à Lechantre comment, la veille, Thérèse, l'ayant suivi, l'avait vu monter dans la voiture de Mme Liebling.
--Diable! marmonna Francis, voilà qui est fâcheux... Thérèse doit avoir une crâne opinion de mon caractère, et je n'oserai plus me présenter devant elle.
--Oh! tranquillisez-vous! Elle n'aura même pas l'air de se douter de votre complicité... Elle est bien trop fière!... Ce n'est qu'à moi qu'elle réserve ses reproches. Nous avons eu hier une scène pénible et nous voilà brouillés.
--Bah! vous vous raccommoderez... Du moment que tu as liquidé ton Autrichienne, ta conscience doit être tranquille et tu obtiendras vite ton pardon... Une femme n'est pas longtemps jalouse d'un amour défunt et enterré... Tu en as fini, n'est-ce pas, avec la dame aux pavots rouges?
--Fini! se récria Jacques, pas le moins du monde.
--Ah! ça, voyons, reprit Lechantre en s'étirant, je ne parle pourtant pas hébreu... N'était-ce pas pour dénouer ta chaîne que tu avais hier un rendez-vous?
--Pardonnez-moi, répondit Jacques, je vous ai trompé... Je n'avais que ce moyen de m'assurer votre appui, et je vous ai fait croire...
--Tu t'es fichu de moi, galopin! interrompit le paysagiste en sautant hors du lit; ainsi tu n'a pas rompu avec ta baronne?
--Au contraire, je suis plus pris que jamais.
--Tu es fou! cria Francis en s'habillant; comment! tu es marié à une femme charmante... que je cite toujours comme une exception... à une femme jeune, belle, intelligente, sensée, parfaite enfin!... Et tu la trompes avec une aventurière qui, si attrayante qu'elle soit, ne va pas à la cheville de Thérèse!... C'est le comble de l'aveuglement et de l'idiotisme!...
--Soit, je suis idiotement et aveuglément amoureux, repartit Jacques; mais, vous le savez, la passion ne raisonne pas... Mme Liebling, qui n'est pas une aventurière ainsi que vous paraissez le croire, mais une femme du meilleur monde, a un charme étrange, unique... tout l'opposé de celui de Thérèse, et cette étrangeté exerce sur moi une séduction quasi surnaturelle... Vous pensez bien que j'ai lutté contre cet ensorcellement... Mais j'ai beau me débattre, dès qu'elle me regarde ma volonté ne m'appartient plus... Elle me possède et je sens que je ne puis me passer d'elle.
--A-t-elle été ta maîtresse, au moins?
--Jamais.
--Tant pis! répliqua cyniquement Lechantre, ça aurait rompu le charme... Te voilà dans de beaux draps!... Thérèse n'est pas d'humeur à s'accommoder d'un amour en partie double; quant à moi, si tu t'imagines que je vais t'aider à la tromper, tu me prends pour un autre, mon garçon!
--Je ne vous réclame rien de pareil, riposta Jacques, piqué... Tout ce que je réclame de votre amitié, c'est de rester neutre... Il y a pourtant, reprit-il après un moment d'hésitation, une chose dont je voudrais vous prier et qui rendrait service à Thérèse aussi bien qu'à moi.
--Laquelle?
--Ce serait de venir le plus souvent possible chez nous, tant que ma mère et Christine demeureront à Nice. Dans l'état d'esprit où nous sommes, Thérèse et moi, si nous restons seuls en face l'un de l'autre, il me semble impossible que maman et ma sœur ne s'aperçoivent pas de notre brouille, et c'est ce qu'il faut éviter, à tout prix... Votre présence, cher maître, votre entrain, ôteront tout prétexte à des froissements et à une froideur qui ne manqueraient pas de sauter aux yeux, si nous étions livrés à nous-mêmes.
--Tu as raison, répondit le paysagiste, il ne faut pas que la maman Moret se doute de tes folies, elle en serait trop désolée, la brave femme!... Du moment qu'il s'agit de mettre de l'huile dans les rouages pour les empêcher de grincer, tu peux compter sur moi... Seulement, tout ça n'est qu'un palliatif. Il vaudrait bien mieux te raccommoder avec ta femme et envoyer au diable Mme Liebling... Quand je serai parti, comment feras-tu?
--Est-ce que je sais! s'exclama Jacques avec humeur... Et, de fait, il était plus inquiet et troublé qu'il ne le montrait. Pris entre le remords de sa conduite envers Thérèse et le désir de revoir Mania, il se trouvait en proie à un désarroi moral qui réagissait sur son système nerveux. Il avait la fièvre et éprouvait de nouveau dans la région du cœur ces désordres qui l'avaient alarmé à Paris.
Tout en discourant, Lechantre avait terminé sa toilette et, bravement, il accompagna Jacques rue Carabacel.
Ainsi quelle l'avait promis, Thérèse restait assez maîtresse d'elle-même pour que personne ne se doutât de ses tourments. La pâleur plus mate de son visage, la couleur plus foncée de ses yeux, révélèrent à Jacques et à Francis seuls les souffrances de la nuit. Elle fit bon accueil au paysagiste et ne parut pas lui garder rancune de son mensonge de la veille. Intérieurement au contraire, elle se félicitait de son arrivée. De même que Jacques, elle comptait sur l'entrain de Lechantre pour faire illusion à Mme Moret et à Christine. Celui-ci, en effet, tranquillisé par l'apparente cordialité de la jeune femme, s'évertuait à jeter des notes gaies et réveillantes dans ce milieu où chacun, sauf la petite mère et lui, était trop absorbé par des préoccupations personnelles pour se mêler activement à la conversation. La gaieté factice du déjeuner calma peu à peu les angoisses de Jacques et le soulagea momentanément du poids qui l'oppressait. Quand on se leva de table, il prit sa boîte à aquarelle et proposa une promenade à Cimiès.
--Pendant que M. Lechantre, dit-il, montrera à ces dames l'amphithéâtre romain et le couvent, je commencerai une étude des ruines vues à travers les massifs des oliviers. Il y a longtemps que ce paysage me hante et je veux profiter du soleil pour le peindre.
La journée se passa sans accroc et le soir Jacques emmena sa mère et sa sœur sur le Cours où elles assistèrent au feu d'artifice et à l'embrasement du mannequin qui représentait Carnaval. Le lendemain, Lechantre, fidèle à son rôle de boute-en-train, offrit aux trois dames de les conduire à Monte-Carlo et à Menton. Jacques s'excusa de leur fausser compagnie: «son étude venait bien et il ne voulait pas la lâcher.» Il monta en effet à Cimiès, travailla jusqu'à quatre heures, mais, au moment où le soleil commençait à décliner, il remisa son panneau et sa boîte chez le portier du couvent, sauta dans la première voiture qu'il rencontra et se fit conduire chez Mme Liebling.
Le petit hôtel occupé par Mania était situé entre cour et jardin et précédé d'un perron de marbre blanc où s'enchevêtraient des roses grimpantes. Une sorte d'atrium décoré de cinéraires bleus communiquait avec un salon éclairé par un plafond vitré. Tout autour de cette pièce, dont la disposition rappelait un peu les patios de Séville, régnait une arcade intérieure, sur laquelle ouvraient les portes du reste de l'appartement. Au milieu, dans une vasque de marbre garnie d'azalées, un mince jet d'eau jaillissait et retombait avec un frais gazouillement. Çà et là, autour des sveltes colonnes de la galerie, des tables chargées de livres et de bibelots, un piano à queue, des divans et des fauteuils, de grandes lampes dressées au centre de jardinières fleuries, donnaient un caractère d'intimité à ce salon spacieux, qui tenait du boudoir et de l'atelier.
Lorsque le valet de pied eut annoncé Jacques Moret, Mania, qui causait près du piano avec Sonia Nakwaska et quelques jeunes gens, se leva, échangea une poignée de main avec le peintre et le présenta à ses amis. Jacques, pendant toute l'après-midi, avait rêvé aux délices d'un tête-à-tête avec Mme Liebling. Il se délectait d'avance à la pensée de retrouver les grisantes sensations de leur promenade nocturne à Villefranche, et il fut cruellement désappointé à la vue de cette joyeuse compagnie qui fumait des cigarettes, buvait du thé et devisait bruyamment des petits scandales de Nice. Mania, à la fois enjouée et ironique, dirigeait la conversation en femme du monde experte, excitait la verve de ses hôtes, cherchait à les mettre successivement en relief et paraissait s'amuser de ces légères médisances, pleines d'allusions dont le sens échappait à l'artiste. Celui-ci, vexé de se voir traiter comme le demeurant des visiteurs, confondu de l'aisance et du sang-froid de Mme Liebling, se demandait si la promenade au Corso n'était pas un songe, et si cette mondaine aux propos frivoles, aux coquetteries savantes, était bien la même femme avec laquelle il avait passé une heure enchantée au clair de lune. Il devenait maussade, parlait à peine, et, espérant toujours que ces insipides causeurs partiraient les premiers, il restait cloué sur son fauteuil. A la fin, comme personne ne bougeait, il se leva brusquement et prit congé, Mania l'accompagna familièrement jusque dans le vestibule.
--Qu'avez-vous? murmura-t-elle en lui lançant un de ses regards charmeurs, on dirait que vous êtes fâché.
--On le serait à moins, répondit-il, je comptais vous trouver seule, et je tombe au milieu d'une bande de bavards!
--Je ne peux pourtant pas mettre les gens à la porte, répliqua-t-elle en riant; un autre jour, vous serez plus heureux... A bientôt, n'est-ce pas?
Jacques s'en revint attristé et mécontent rue Carabacel. Les promeneurs n'étaient pas encore de retour, et quand ils rentrèrent, le peintre tisonnait pensivement au coin du feu.
--Eh bien! demanda Lechantre, et cette aquarelle?... En es-tu content?
--Pas trop, repartit Jacques, je me heurte à des difficultés d'exécution que je ne prévoyais pas... Il faudra, M. Lechantre, que vous me donniez demain un conseil...
--Allons, pensa Thérèse, si son métier le préoccupe, c'est qu'il songe moins à cette femme... Peut-être y a-t-il encore de l'espoir!...
Trompée par la réponse et les airs méditatifs de son mari, elle se sentit moins inflexible, plus inclinée à pardonner, au cas où le coupable viendrait sérieusement à résipiscence. Comme pour l'encourager dans ces indulgentes dispositions, Jacques l'emmena le lendemain matin à Cimiès avec Lechantre et Christine, la maman Moret, fatiguée de la course de Menton, ayant déclaré qu'elle désirait se reposer. Ils déjeunèrent sous la tonnelle d'une auberge, et Jacques, remis en train par les conseils du paysagiste, travailla trois heures d'affilée. Mais, quand on fut de retour à la maison, il sortit sous couleur de reconduire Lechantre, et ne rentra que vers sept heures.
Ne se tenant pas pour battu, il s'arrangea chaque jour pour s'esquiver à la tombée du crépuscule et pour courir, tout enfiévré, rue de la Paix. Le temps devint pluvieux, et les averses lui ôtèrent le prétexte de sortir pour travailler à son aquarelle.--Il passait ses après-midi claquemuré dans le salon, en compagnie de la petite mère qui tricotait, de Christine qui bâillait sur un livre, et de Thérèse qui, tout en tirant l'aiguille, observait à la dérobée l'agitation mal déguisée de son mari. Lechantre s'employait de son mieux pour égayer ses amis; mais, dès que sonnaient cinq heures, Jacques se montrait plus agacé et inquiet. Il s'habillait en hâte, déclarait qu'il avait besoin de respirer l'air, et, une fois dehors, il s'acheminait vers l'hôtel de Mania, espérant toujours la trouver seule, et chaque fois se rencontrant avec quelque visiteur importun. Tantôt c'était la comtesse Acquasola, complètement décavée, et venant emprunter dix louis à Mme Liebling; tantôt il se heurtait à Flaminius Ossola, qui consultait Mania sur un article destiné à la Gazette des étrangers, et qui, ravi de causer avec le peintre, ne bougeait plus de sa chaise. Jamais Jacques ne pouvait jouir d'un paisible quart-d'heure de solitude. Il s'en revenait dépité, nerveux et irritable, à son logis.
--Jacques est bien changé, remarquait perfidement Christine, autrefois il avait le caractère plus égal; maintenant il s'emporte pour un rien, et ne desserre les dents que pour bougonner.
--En effet, ajoutait la petite mère, il est devenu un peu fantasque, et on dirait que les choses ne marchent pas à son idée... Mon Dieu! il est pourtant ici comme un coq en pâte!... Thérèse, vous doutez-vous de ce qui peut le contrarier?...
--Non, répondait celle-ci en affectant la surprise, je ne sais...
Hélas! elle ne le savait que trop et, après avoir espéré un moment qu'il se guérirait de sa passion, elle devinait maintenant l'étendue et la virulence du mal. Toutes ces sorties à heure fixe, ces retours maussades suivis d'accès de mauvaise humeur, ne lui laissaient plus de doute sur l'état du cœur de Jacques. Quand il s'échappait de la maison à la nuit, elle se disait: «Il va voir cette femme...», et son imagination cruellement allumée par la jalousie lui peignait l'artiste aux genoux de Mme Liebling. En dépit de ses efforts pour feindre l'indifférence, ses traits prenaient par moments une expression désolée, et les yeux inquisiteurs de Christine se fixaient curieusement sur elle. Quand Jacques rentrait pour dîner, le regard assombri, les lèvres serrées, le geste fiévreux, elle songeait avec une amère satisfaction que Mania le faisait souffrir à son tour, puis une réflexion mortifiante l'exaspérait de nouveau: «Quelle diabolique influence cette étrangère devait exercer sur lui, pour qu'il supportât sans se décourager ses dédains et ses coquetteries!» Elle s'irritait en pensant que, là-bas, dans la maison de la Viennoise, il se montrait empressé, aimable, séduisant, et qu'il réservait pour le logis conjugal ses maussaderies et ses accès d'humeur. Parfois elle était tentée de s'élancer vers Jacques, de le tirer à l'écart et de lui dire: «Sachez donc au moins mieux jouer la comédie; si ce n'est pas pour moi, que ce soit pour votre mère!» La fierté l'emportait sur son indignation, et, refermant en son cœur sa jalousie grondante, elle se condamnait au silence; mais quand elle rentrait seule, la nuit, dans sa chambre, ou Jacques n'apparaissait plus, elle s'abandonnait à de violentes crises de désespoir, et enfonçait sa tête sous ses oreillers pour que personne ne l'entendit pleurer.
Les nuits de Jacques n'étaient guère meilleures. Les visites quotidiennes chez Mania surexcitaient sa passion sans la contenter. Obligé de se taire en présence des fâcheux qu'il rencontrait chez Mme Liebling, contraint de dissimuler son dépit en rentrant rue Carabacel, il était encore tourmenté par la crainte d'éveiller les soupçons de Mme Moret et de Christine. Il désirait le départ des deux femmes, tout en le redoutant, car il prévoyait qu'une fois seul avec Thérèse, il se trouverait fatalement acculé à une périlleuse alternative: provoquer un éclat désastreux ou renoncer à ses assiduités près de Mania...
Un soir de la fin de février, après avoir, le cœur tremblant, sonné à la porte du petit hôtel de la rue de la Paix, il eut, en pénétrant dans le salon, un tressaillement joyeux.--Mania était seule; assise au piano, elle jouait une tsardâs hongroise. Elle était vêtue d'une matinée de crépon rose à manches larges et portait ses cheveux d'or relevés sur le front, noués en un chignon très lâche, qui retombait sur la nuque. Cet ajustement d'une négligence raffinée faisait mieux valoir encore la vivacité de son visage mobile et l'éclat de ses yeux verts.
--Eh bien! dit-elle en se tournent à demi vers Jacques et en souriant, cette fois vous ne vous plaindrez pas!... Tous mes amis sont à Monte-Carlo et je n'attends personne avant le dîner.
Comme le peintre transporté s'élançait impétueusement vers elle et saisissait ses bras nus pour les porter à ses lèvres, elle l'arrêta d'un impérieux regard:
--Pas de folies! ajouta-t-elle, je ne vous permets de rester qu'à la condition de vous asseoir tranquillement près de moi... Si vous êtes sage, je vous jouerai et vous chanterai tout ce que vous voudrez.
Il obéit et elle se remit au piano. Elle était en voix ce jour-là et elle lui chanta les Deux grenadiers de Schumann, puis des airs bohémiens de la Petite-Russie, à la fois imprégnée de passion sensuelle et de tristesse. Par instants, elle s'interrompait, lui jetait un regard scintillant et murmurait:
--Hein! est-ce beau?
Possédée par le démon de la musique, elle s'exaltait peu à peu. Dans le feu de l'exécution, son peigne mal assujetti se détacha et la masse de ces cheveux dénoués roula sur ses épaules. Ne pouvant plus se maîtriser, grisé de mélodie et de désir, Jacques se précipita, saisit à poignée les cheveux d'or et les couvrit de baisers.--Mania, enivrée elle-même, parut se complaire à cette caresse et resta un moment sans bouger, puis inclinant la tête de côté comme pour fuir ces lèvres trop passionnées:
--Laissez mes cheveux, dit-elle câlinement, et ramassez-moi mon peigne.
Elle se leva, prit le peigne que lui tendait Jacques et tordant rapidement sa chevelure fauve:
--Vous avez mis ma coiffure en bel état!... Je n'ai que le temps de réparer le désordre avant l'arrivée de la baronne Pepper.
--Comment! s'écria-t-il tristement, elle va venir?... Vous m'aviez fait espérer que vous ne recevriez personne!
--Vous m'avez mal comprise... J'ai invité la petite baronne à dîner avec le docteur Jacobsen.
--Ah! grommela-t-il, trouverai-je donc toujours quelqu'un entre vous et moi! J'aime mieux renoncer à vous voir que de subir chaque jour ce supplice.
Elle haussa doucement les épaules et le calmant de son regard enjôleur:
--Grand enfant! Tenez, j'ai pitié de vous... Je serai libre demain après-midi. S'il fait beau temps, allez m'attendre au cap Ferrat, près de la pièce d'eau... J'y serai à deux heures et nous passerons le reste de la journée à Saint-Jean, ou je vous permets de m'offrir un lunch...
Il restait silencieux. Ce nom de Saint-Jean lui remettait en mémoire l'après-midi où il y était venu avec Thérèse et il éprouvait une sorte de pudeur à ne point retourner au même endroit avec Mania.
--Comment! s'écria-t-elle, voilà que vous hésitez maintenant?
Tandis qu'elle parlait, le valet de pied parut au seuil du salon et annonça:
--Mme la baronne Pepper!
--Vite, décidez-vous! murmura impatiemment Mme Liebling, dois-je ou non aller demain au cap Ferrat?
--Oui, se hâta-t-il de balbutier, demain... près de la pièce d'eau...
--Il lui serra la main, salua précipitamment la petite baronne et sortit.
XVI
En quittant l'hôtel de la rue de la Paix, Jacques leva les yeux vers le ciel qui commençait à s'étoiler et dont la limpidité promettait pour le lendemain une belle journée. Puis il réfléchit à la façon dont il s'y prendrait pour s'assurer la libre disposition de son après-midi. Il prévoyait qu'il se heurterait à plus d'un obstacle: Mme Moret et Christine devaient repartir à la fin de la semaine et il leur semblerait au moins étrange que Jacques s'éloignât d'elles précisément à la veille de leur départ. Il se voyait forcé de passer pour un mauvais fils ou de renoncer au tête-à-tête qu'il avait si ardemment sollicité, et, comme il arrive le plus souvent lorsque la passion est en jeu, ce fut l'amour qui l'emporta sur le devoir. Jacques décida qu'à tout prix il trouverait un prétexte pour aller au rendez-vous assigné par Mania. Il ne pouvait plus compter cette fois sur la complicité de Lechantre; le paysagiste ayant pris le parti de Thérèse, il était évident qu'il refuserait net de se prêter à une nouvelle tromperie. Et cependant l'appui de Francis était nécessaire; seul il pouvait suppléer Jacques près des trois femmes et leur servir de cavalier en son absence. Il importait donc de manœuvrer assez adroitement pour que Lechantre devînt un auxiliaire utile, à son insu.
Le lendemain, le soleil se leva dans un azur immaculé. Jacques, à l'aspect de ce ciel radieux, sentit son désir flamber plus violemment au-dedans de lui et se répéta que, coûte que coûte, il fallait que l'après-midi lui appartînt. Lechantre avait promis de venir déjeuner en famille. Vers dix heures, il apparut, la mine souriante, la boutonnière fleurie, et portant dans ses mains une énorme botte de roses et d'œillets.
--Bonjour, maman Moret, s'écria-t-il en embrassant la petite mère, bonjour, Thérèse, bonjour tourtous, comme on dit au pays... En venant du port, j'ai traversé le marché et je vous ai apporté ce bouquet de printemps... Quelle lumière, n'est-ce pas? et quel soleil!... Le ciel est d'un bleu si appétissant qu'on en mangerait... Sais-tu, gamin, que voilà un temps à souhait pour ton aquarelle?
--J'y pensais ce matin, répondit Jacques, saisissant avec empressement la perche que son ami lui tendait ingénument, et je regrettais de ne pouvoir en profiter.
--Mon garçon, la peinture à l'eau est comme la galette de chez nous, il ne faut pas la laisser refroidir... Si tu attends trop longtemps, tu ne seras plus en train. Pourquoi n'irais-tu pas aujourd'hui à Cimiès achever ton étude?
A force de se fourvoyer dans de fausses situations, Jacques avait fait de notables progrès en hypocrisie. Il répliqua avec un bel aplomb:
--Non, ce n'est pas possible... maman parle de partir dans deux jours et je ne veux pas la laisser seule tout un après-midi.
--Seule! sapristi, ne suis-je pas là, moi?... se récria Francis, je tiendrai compagnie à ces dames et je les promènerai pendant que tu piocheras.
--M. Lechantre a raison, reprit bonne maman Moret, je m'en voudrais toute ma vie de te faire perdre ton temps, Jacques, et si Thérèse est consentante, tu iras à ta besogne sans t'inquiéter de nous.
Thérèse gardait le silence. Quelque chose lui criait intérieurement que Jacques n'était pas sincère et elle se demandait si tout cela n'était point prémédité de concert avec Lechantre. La jalousie la rendait de plus en plus méfiante. A la pensée que le paysagiste était complice, il lui vint au cœur un mortel dégoût; elle ne se sentit même plus le courage de déjouer cette ruse grossière, qu'elle croyait combinée par les deux amis en vue de la tromper.
--Moi? repartit-elle d'un air indifférent, je suis de votre avis, maman, et Jacques est libre d'employer son temps de la façon la plus agréable.
Sans se douter des soupçons qui pesaient sur lui, Lechantre insista de nouveau sur la nécessité d'achever promptement l'aquarelle. Il fut convenu qu'on avancerait le déjeuner et que, dès la dernière bouchée, Jacques partirait pour Cimiès, tandis que Francis offrirait aux dames une promenade en voiture.
Grâce à cette combinaison, le peintre se trouva libre de quitter son logis avant midi. Il s'éloigna ostensiblement dans la direction de Cimiès, mais, dès qu'il eut atteint le boulevard Carabacel, il courut à la gare, prit le train d'Italie, descendit à la station de Beaulieu et arriva sur le plateau du cap Ferrat, bien avant l'heure indiquée pour le rendez-vous.
Il se promena d'abord allègrement le long des allées dessinées autour d'un bassin central par les soins de la Compagnie des eaux. De cet endroit, son regard plongeait sur les deux routes carrossables, puis sur la mer bleue et scintillante qui battait doucement les talus rocheux de la presqu'île. L'air était admirablement transparent. Un soleil, très chaud pour la saison, baignait de poudroiements d'or les ondulations du sol couvert de buissons de lentisques, parmi lesquels, çà et là, un pin étendait son parasol d'un vert foncé. Jacques, dont le cœur sautait à la pensée de jouir bientôt de la compagnie de Mania, de l'avoir toute à lui dans cette solitude, marchait dans une sorte de rêve lumineux. Il respirait à pleins poumons l'air parfumé d'odeurs résineuses, écoutait le bruissement des insectes dans les bruyères, regardait la mer sur laquelle planaient de grands oiseaux aux ailes éployées, et de temps en temps consultait sa montre.
Bien qu'il se fut promis d'être patient, il s'inquiétait déjà. Dans le calme profond de la presqu'île ensoleillée, il entendit deux heures sonner à un lointain clocher de village. Peu après, une voiture surgit du fond de la route qu'elle gravit lentement.--Le cœur de Jacques ne fit qu'un saut et ses yeux se fixèrent avidement sur cet équipage qui ne paraissait encore que comme une tache grise sur la route blanche. Bientôt les formes se précisèrent, la voiture se rapprocha et, avec un pénible sentiment de déception, il s'aperçut qu'elle traînait un chargement de vieilles Anglaises. Alors son impatience se changea en une douloureuse anxiété. Toute l'espérance qui lui gonflait le cœur s'abattit soudain comme une voile par un calme plat. Il se mit à remuer au fond de lui des doutes cruels, des suppositions mortifiantes.--Peut-être Mania, au dernier moment, avait-elle renoncé à son projet? Ou bien, à l'heure du départ, quelque visite de fâcheux lui était-elle arrivée?... D'ailleurs, avec une nature aussi fantasque, aussi mobile que celle de Mme Liebling, il fallait s'attendre à de continuelles surprises. Jacques se demandait si, la veille, en s'apercevant de ses hésitations, Mania ne s'était pas repentie de son premier mouvement. Alors il se reprocha de n'avoir point paru assez ravi de la proposition; il s'irrita contre lui-même et ses sottes tergiversations.

Tout à coup, il lui vint à l'esprit que les deux routes se croisaient non loin du plateau et que peut-être Mme Liebling avait pris celle qui contournait la pointe. Le sang lui afflua brusquement à la tête, il craignit une méprise et se dirigea précipitamment vers la croisée des chemins; mais, tout en courant, il cherchait à se remémorer ce qui avait été convenu au moment où l'on annonçait la baronne Pepper, et il se rappelait que par deux fois il avait été question de la pièce d'eau.--Ce réservoir était le seul qui existât dans toute l'étendue de la pointe et il était impossible que Mania eût fait erreur. Il tourna les talons et revint sur ses pas, très nerveux, encore à demi perplexe, fouillant des yeux les moindres plis de terrain, tressaillant à un lointain bruit de roues, jusqu'à ce qu'à force d'écarquiller les yeux et de tendre son attention il eut une sorte d'éblouissement et s'assit sur un banc en se répétant avec dépit:
--Non, c'est fini... Elle ne viendra plus!
Accoudé au dossier du banc, énervé par l'enfièvrement de l'attente, il regardait maintenant sans voir; ses oreilles bourdonnaient et il n'osait plus s'illusionner. Un léger grincement de sable le tira de son abattement, il se retourna et aperçut à quelques pas de lui Mania qui souriait.
Abritée sous une ombrelle blanche et un grand chapeau fleuri de violettes russes, elle était vêtue d'une robe de laine couleur héliotrope. Un ample voile noir noué par derrière enveloppait comme un masque transparent sa figure légèrement rosée où les yeux brillaient d'un éclat d'émeraude.
--Ah! s'écria-t-il après un profond soupir, c'est vous enfin!...
Dans son exclamation, un reste de colère se mêlait à une explosion de joie farouche. Cette sauvagerie ne déplut pas à Mania.
--Vous vous impatientiez? dit-elle en glissant son bras sous le sien; je ne suis pourtant pas en retard... Seulement j'ai quitté ma voiture à l'entrée de la presqu'île et je suis montée à pied.
--Je croyais que vous ne viendriez plus et que vous vous étiez moquée de moi!
--Comme vous êtes injuste!... Je pensais que vous seriez heureux de n'avoir pas mon cocher sur le dos, et voyez... Je me suis tellement dépêchée que j'en suis essoufflée.
En effet, son corsage se soulevait et s'abaissait, agité par une respiration plus courte. Il regarda avec ravissement cette poitrine exquisement modelée; l'essoufflement de Mania tendait l'étoffe de la robe et accusait davantage les contours très purs du buste; il pressa plus fort le bras qui s'appuyait sur le sien et balbutia:
--Pardon... Merci d'être venue!
Ils marchaient d'un pas rythmé sur le chemin plein de soleil: ils étaient si étroitement serrés l'un contre l'autre qu'ils semblaient ne faire qu'un. Le vent, en passant sur les buissons de romarins, leur apportait, avec l'odeur des plantes aromatiques, la rumeur des vagues sautant contre les rochers de la côte, et Jacques, avec une tendre effusion, remerciait de nouveau Mania de la joie infinie dont il se sentait inondé. Plein d'une candide confiance rustique, il lui ouvrait toute son âme et lui contait l'impression quelle avait faite sur lui dès la première minute où il l'avait aperçue à l'opéra. Il lui disait comme il l'avait admirée pendant cette représentation de Don Juan, dans cette loge où elle avait l'air d'une reine et où elle lui paraissait trôner à des hauteurs inaccessibles.
--Et, ajouta-t-il en la contemplant d'un œil ébloui, quand je songe que cette adorable reine est là, tout près de moi, et qu'elle me permet de l'aimer, je suis pris d'une telle confusion que j'ai envie de me jeter à genoux pour baiser la place où vos pieds se sont posés!
Elle écoutait avec un indulgent sourire cette caressante musique d'amour et elle se glorifiait d'avoir conquis ce cœur enthousiaste, ce sauvage artiste qui, pareil à un farouche Hippolyte, s'était d'abord dérobé en la bravant. Pendant quelques minutes, ils goûtèrent l'un et l'autre une voluptueuse félicité, un bonheur inaltéré. Mais le bonheur est comme un papillon assoupi à la pointe d'un roseau: dès qu'on parle, il s'éveille et prend sa volée.--Quand ils furent près de la route qui coupe la presqu'île et qu'ils arrivèrent en vue de Saint-Jean, l'aspect du petit port et du village où il avait passé une si douce journée avec sa femme ressuscita dans le cœur de Jacques des impressions douloureuses. L'image mélancolique de Thérèse se dressa devant lui. A travers les branches des pins, il distinguait le verger de citronniers où il lui avait juré qu'il ne pourrait vivre sans elle. Le remords lui rentra dans l'âme et sa joie se mélangea d'une lie amère. Peu à peu il laissa tomber la conversation. En repassant dans ces chemins où planait le souvenir de Thérèse, il avait la sensation de quelqu'un qui traverse un cimetière et n'ose plus élever la voix.--Mania remarqua très vite sa distraction; elle en fut piquée et d'un ton railleur:
--Qu'avez-vous? demanda-t-elle... Vous vous plaigniez de ne me trouver jamais assez seule, de ne pouvoir jamais me parler librement, et vous devenez muet, maintenant que nous sommes en tête-à-tête!
Mais déjà il avait conscience de cette intempestive préoccupation et il essayait de la secouer.
--Pardonnez-moi, murmura-t-il; le bonheur aussi absorbe et rend taciturne.
Et, tout en articulant péniblement cette excuse, il s'apercevait que, même auprès de Mania qu'il aimait passionnément, son équivoque situation l'obligeait à mentir. Il en était réduit à manquer de sincérité aussi bien avec la femme qu'il trahissait qu'avec celle qu'il prétendait adorer. Ainsi ce bonheur dont il se vantait, ce bonheur tant cherché et pour lequel il avait odieusement abandonné Thérèse, était déjà gâté par des gouttes d'amertume. Il n'avait duré dans toute sa plénitude que quelques courtes minutes, et ces minutes s'étaient envolées avec une rapidité d'étoiles filantes; elles avaient été rejoindre d'autres minutes aussi éphémères. Toutes ces sensations joyeuses ou tristes n'étaient plus qu'un souvenir, une ombre impalpable, et c'était là ce qui constituait le meilleur de la vie...
Il étreignit convulsivement le bras de Mania, comme s'il eût craint de voir s'évanouir à son tour, ainsi qu'un météore, cette enchanteresse à laquelle il venait de sacrifier ses plus pures affections, et lui saisissant la main, il y déposa des baisers gros de soupirs.
--Je vous aime comme un fou! dit-il.
--Et vous vous conduisez aussi comme un fou. répliqua-t-elle en souriant; je crois que le soleil vous monte à la tête et que nous ferons bien de nous reposera l'ombre... Descendons à Saint-Jean; c'est là que ma voiture doit m'attendre, et nous y trouverons sans doute un restaurant où nous punirons nous arrêter.
La figure de Jacques se rembrunit. Il lui répugnait de conduire Mme Liebling dans cette même auberge où il avait dîné avec Thérèse. Cela lui semblait une profanation cruelle et inutile.
Il serait préférable de gagner Beaulieu, objecta-t-il... il n'y a à Saint-Jean que des cabarets indignes de vous.
--Beaulieu! se récria-t-elle, y pensez-vous?... Nous risquerions d'y tomber au milieu de ce monde de fâcheux qui vous agaçait si fort, et demain tout Nice serait au courant de notre escapade... Non, non... Je me rappelle qu'il y a ici un hôtel où les Niçois vont le dimanche manger de la bouillabaisse. En semaine, l'endroit doit être peu fréquenté et, en tout cas, nous ne courrons pas le danger d'y être reconnus, car il n'y vient que de petites gens.
La façon dédaigneuse dont elle prononçait ce mots: «de petites gens»
impressionna désagréablement le peintre. Son cœur de plébéien s'indigna
de cette qualification méprisante jetée à la classe dont, en somme, il
faisait partie. N'était-il pas né de ces «petites gens» qu'elle traitait
avec tant de mépris?... Il entrevit plus clairement l'abîme qui le
séparait, lui paysan, fils de paysan, de cette patricienne si
orgueilleuse du sang bleu qui lui coulait dans les veines, et il
pressentit que l'amour même ne comblerait pas le fossé profond que
l'hérédité et l'éducation avaient creusé entre eux. Cela assombrit
encore son humeur et il eut des velléités de révolte.--Pourtant, après
un instant de réflexion, il comprit la justesse et la sagesse des
raisons qui faisaient agir Mme Liebling et il se résigna à la suivre à
Saint-Jean.
(A suivre).
André Theuriet.

