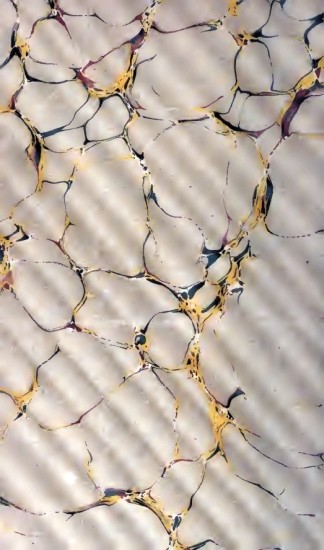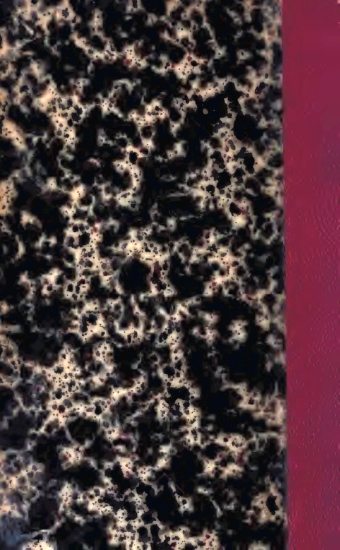Title: Lettres à Madame Viardot
Author: Ivan Sergeevich Turgenev
Annotator: E. Halpérine-Kaminsky
Release date: December 18, 2011 [eBook #38335]
Language: French
Credits: Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This book was
produced from scanned images of public domain material
from the Internet Archive.)
LETTRES
A MADAME VIARDOT

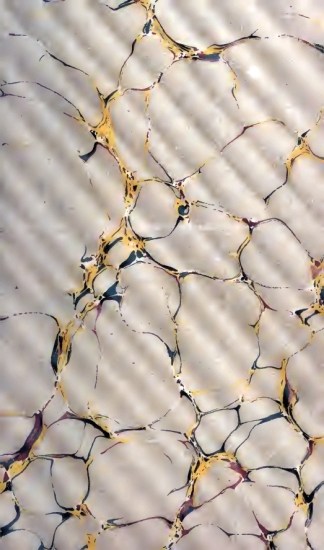
Eugène FASQUELLE, Éditeur, 11, rue de Grenelle, Paris
AUTRES OUVRAGES D'IVAN TOURGUENEFF
DANS LA BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER
à 3 fr. 50 le volume.
PÈRES ET ENFANTS. Précédé d'une lettre à l'éditeur par Prosper MÉRIMÉE, de l'Académie française (5º édition), 1 volume.
CORRESPONDANCE (Lettres à ses amis de France); Avec notes d'HALPÉRINE-KAMINSKY (3º mille), 1 volume.
Il a été tiré du présent ouvrage
10 exemplaires numérotés sur papier de Hollunde.
Paris.—L. MARETUEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.—15203.
———
———
PARIS
BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER
EUGÈNE FASQUELLE, ÉDITEUR
11, RUE DE GRENELLE, 11
——
1907
Tous droits réservés.
Les lettres du grand écrivain russe Ivan Sergueïevitch Tourgueneff à Mme Pauline Viardot, l'illustre cantatrice, ont leur histoire.
Égarées ou dérobées, au moment où la guerre de 1870 obligea la famille Viardot à quitter Bade pour Londres, ces lettres ont été retrouvées plus d'un quart de siècle après.
Naturellement, Mme Viardot désirait rentrer en possession de documents dont elle ne s'était jamais volontairement dessaisie, et auxquels elle avait tous les droits moraux et juridiques. D'autre part, les motifs qu'avançait le possesseur actuel pour garder les lettres n'étaient pas sans valeur non plus. Il avait trouvé le précieux paquet—parmi des papiers peu importants—dans une caisse qu'il avait achetée à un bouquiniste de Berlin; celui-ci, à son tour, l'avait acquise de la veuve d'un médecin français, paraît-il; ici, s'arrête mon investigation sur l'origine de la caisse.
Quoi qu'il en soit, le dernier acquéreur, admirateur dévoué de Tourgueneff, se fit un devoir de conserver comme un dépôt sacré la correspondance que le hasard mettait entre ses mains jusqu'au jour où il pourrait la rendre publique, et il estimait que ce jour ne pourrait venir qu'après la mort de la destinataire des lettres.
Comme, en définitive, le possesseur des lettres était moins préoccupé d'une question pécuniaire que du désir d'entourer cette publication de meilleures conditions littéraires possibles, je finis par le persuader des avantages réels qu'il y aurait à la faire du vivant et sous les auspices de la célèbre artiste.
C'est ainsi qu'après deux ans de pourparlers je pus obtenir la restitution de tout le paquet des lettres, datées de 1846 à 1871, et que j'édite avec l'autorisation et sous le contrôle de Mme Viardot.
Une partie de ce qui nous a été livré paraît seulement. Par une réserve à mon avis excessive, Mme Viardot ne laisse passer que les pages ayant, non seulement un attrait public indiscutable, mais encore contenant le moins d'appréciations flatteuses pour la créatrice, universellement admirée, de tant de personnages de l'imagination lyrique; elle écarta aussi des passages, des lettres entières, émaillés de saillies spirituelles, jamais méchantes, contre des personnes connues, ou semés de détails d'un caractère privé.
Pour moi, qui ai lu le tout, presque tout serait à donner. Rien, en effet, qui ne soit attachant dans l'échange suivi de pensées entre ces natures d'artistes, liées d'amitié et de sympathie intellectuelle. C'est un véritable journal intime, écrit à l'intention d'une âme sœur, commencé à l'âge d'homme et terminé seulement à la mort de l'auteur[1].
Tourgueneff rencontra pour la première fois M. et Mme Viardot à Saint-Pétersbourg en 1843: il était à peine âgé de vingt-cinq ans. Je l'ai dit ailleurs[2]: M. Viardot, qui avait précédemment séjourné en Russie, cherchait à familiariser les Français avec les chefs-d'œuvre de la littérature russe. Il était connu par de savantes études d'art et de littérature étrangère. Mme Viardot, très jeune encore,—elle avait vingt-deux ans,—était déjà la célèbre cantatrice, acclamée dans toutes les capitales de l'Europe. Ce couple d'artistes devait produire une vive et durable impression sur la nature esthétique de Tourgueneff.
Le futur auteur des Récits d'un chasseur, à cette époque obscure encore, reçut de ses nouveaux amis l'accueil le plus cordial, au point qu'on est tenté de croire qu'ils avaient deviné le talent du romancier avant ses compatriotes. En effet, quatre ans plus tard, comme il l'a raconté lui-même, Tourgueneff se trouva à l'étranger, dénué de toutes ressources. Sa mère, mécontente de son départ et blessée de le voir, lui, un gentilhomme de vieille souche, embrasser la carrière littéraire, s'était refusée à subvenir à ses besoins. Dans cette situation, il trouva auprès de la famille Viardot la plus large hospitalité, et Courtavenel, leur propriété de Rosay en Brie, fut, selon sa propre expression, son berceau littéraire. «C'est ici, raconte-t-il à son ami Fet[3], que, n'ayant pas les moyens de vivre à Paris, je passais l'hiver tout seul, me nourrissant de bouillon de poulet et d'omelettes qui m'étaient préparés par une vieille domestique. C'est ici que, pour gagner de l'argent, j'ai écrit la plupart de mes Récits d'un chasseur, et c'est ici encore, comme vous l'avez vu, qu'est venue demeurer ma fille de Spasskoïé[4]».
Cette petite fille étant très malheureuse en Russie, Tourgueneff se confia à Mme Viardot, qui lui conseilla de la faire venir et prit soin de son éducation.
Sauf ses rares visites à Pétersbourg, à Moscou ou à sa propriété de Spasskoïé, l'écrivain russe, depuis 1847, ne cessa d'habiter la France. Mais qu'il s'en aille seulement à Versailles, à Courtavenel, ou reste à Paris, en l'absence de Mme Viardot faisant ses tournées à travers l'Europe, vite il note ses impressions et lui en fait part comme dans un journal intime.
Grâce à M. et Mme Viardot, il fut mis en relation avec le monde artistique et littéraire français; c'est chez eux qu'il rencontra pour la première fois George Sand. Peu à peu, le cercle de ses connaissances s'étendit à Mérimée, Sainte Beuve, Théophile Gautier, Flaubert, Paul de Saint-Victor, Taine, Renan, Jules Simon, Victor Hugo, Augier, Jules Janin, Maxime Du Camp, Edmond About, les frères Goncourt, Gavarni, Scherer, Charles Blanc, Fromentin, Nefftzer, Broca, Berthelot, Francisque Sarcey, etc., etc., et, plus tard, à Zola, Daudet, Guy de Maupassant et les autres jeunes romanciers de l'école naturaliste. L'élément théâtral n'était pas moins bien représenté dans les salons de la créatrice d'Orphée.
Les impressions variées nourries par ce milieu et par les fréquents voyages à travers l'Europe, tant de Tourgueneff que de Mme Viardot, devaient donc se refléter dans leur correspondance. Aussi, outre sa valeur propre, biographique ou anecdotique, ajoute-t-elle un chapitre intéressant à l'histoire littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle. Nous en publions la partie qui commence en 1846, bien que le «Journal» débute certainement vers 1843; du moins les premières lettres, parmi celles que j'ai eues entre les mains, datent de mars 1844 et, par leur caractère familier, font présumer l'existence de plus anciennes. Tourgueneff ne parle-t-il pas, dans la lettre de 1846, qu'on trouvera ci-dessous, de «vieux amis, des amis de trois ans»? Encore un coup, je regrette, avec tous les admirateurs du maître russe, ces suppressions sévères; puisse l'accueil que fera le public à la série que nous lui livrons rendre M{me} Viardot plus clémente à l'avenir[5]!
E. HALPÉRINE-KAMINSKY.
Saint-Pétersbourg, ce 8/20 novembre 1846.
J'ai hâte de répondre à la bonne lettre que vous m'avez écrite tous les deux, mes chers amis[6]. Elle m'a fait un plaisir véritable, en me prouvant que vous n'avez pas changé envers moi. Je vous remercie en même temps de tous les renseignements que vous me donnez sur votre vie passée et future. Si le sort ne m'est pas tout à fait contraire, j'espère pouvoir faire un petit voyage en Europe l'année prochaine, dès le mois de janvier, si bien qu'il ne serait pas impossible que vous, Madame, ayez un spectateur de plus à l'«Opern-Haus[7]».
Je lis tous les articles des journaux prussiens qui vous concernent, je vous prie de le croire—et j'ai été bien heureux et bien content de votre triomphe dans la Norma. Ceci me prouve que vous avez fait des progrès, c'est-à-dire de ces progrès comme en font les maîtres et qu'ils ne cessent de faire jusqu'à la fin. Vous êtes parvenue à vous approprier l'élément tragique, le seul dont vous n'étiez pas encore entièrement maîtresse (car pour le pathétique, ceux qui vous ont vue dans la Somnambula savent à quoi s'en tenir), et je vous en félicite de tout mon cœur. Quand on a la noble ambition qui vous anime et une nature aussi richement douée que la vôtre, il n'est pas de couronne à laquelle on n'ait le droit d'aspirer, par la grâce de Dieu.
Le choix des opéras que vous allez donner à l'«Opern-Haus» me paraît admirable (il va sans dire que je préférerais les Huguenots au Camp de Silésie). Pour l'Iphigénie, j'oserais vous conseiller de relire avec attention la tragédie de ce nom, de Gœthe, d'autant plus que vous avez affaire à des Allemands, qui, presque tous, la savent par cœur, et dont la manière de comprendre ou de représenter Iphigénie est par cela même irrévocablement fixée. Du reste, la tragédie de Gœthe est certainement belle et grandiose, et la figure qu'il a tracée est d'une simplicité antique, chaste et calme—peut-être trop calme, surtout pour vous, qui, grâce à Dieu, nous venez du Midi. Cependant, comme il y a aussi beaucoup de calme dans votre caractère, je crois que ce rôle vous ira à merveille, d'autant plus que vous n'avez pas besoin de faire un effort pour vous élever à tout ce qu'il y a de noble, de grand et de vrai dans la création de Gœthe,—tout cela se trouvant naturellement en vous. Iphigénie elle-même n'était pas une «fille du Nord»; un poisson n'a pas de mérite à rester calme...
Vous prononcez bien l'allemand, vous ne le francisez pas;—au contraire, vous exagérez un tant soit peu l'accentuation,—mais je suis sûr qu'avec votre application ordinaire vous avez déjà fait disparaître ce léger défaut.
Pardon, mille fois pardon de ces conseils de pédant; vous savez qu'ils prennent leur source dans le vif intérêt que je prends à vos moindres faits et gestes; et puis il n'y a que la perfection qui puisse vous convenir et nous contenter quand nous vous écoutons... Prenez-vous-en à vous-même... pourquoi nous avoir gâtés?
Mon Dieu, comme j'aurais été heureux de vous entendre cet hiver!... Il faudra que j'en vienne à bout d'une manière ou d'une autre.
Dans la lettre que j'ai écrite à madame votre mère, j'ai donné quelques détails sur le théâtre d'ici, ce qui me dispense de revenir là-dessus. Je préfère vous féliciter sur l'emploi de votre temps à la campagne... Oui, certes, je suis bien curieux de voir de votre ouvrage[8]... Patience!
Je n'ai pas encore reçu le petit livre de Viardot (que je remercie beaucoup de son bon souvenir), mais je l'ai déjà lu, et j'y ai retrouvé cet esprit sobre et fin, ce style élégant et simple dont la tradition semble vouloir se perdre en France. A propos de littérature, le prince Karol du dernier roman de Mme Sand (Lucrezia Fioriani), paraît être Chopin.
Je vous dirai (si cela peut vous intéresser) que nous avons réussi à fonder un journal à nous, qui paraîtra dès la nouvelle année et qui s'annonce sous des auspices très favorables. Je n'y participe qu'en qualité de collaborateur[9].
Je travaille beaucoup pour le moment, et je ne vois presque personne. Ma santé est bonne, mes yeux ne s'empirent pas, ce qui est déjà un grand bonheur. J'ai trois petites chambres assez jolies où je vis en vrai solitaire avec mes livres, que je suis enfin parvenu à rassembler des quatre parties du monde—mes espérances et mes souvenirs. J'aurais bien voulu avoir ici l'excellent cheval que je montais à la campagne, mais la vie est si chère à Pétersbourg! C'était une jument anglaise bai clair, admirable d'allure, de douceur, de force et de vigueur. J'ai eu de même le bonheur de faire l'acquisition d'un excellentissime chien de chasse, ou plutôt d'une chienne. Elle se nomme Pif (drôle de nom, n'est-ce pas? pour une chienne); ma jument, au contraire, a été baptisée par une vieille Anglaise qui demeure chez ma mère Queen Victoria. J'avais un autre chien, un griffon, monstre de laideur, bon à rien, mais qui s'était attaché à moi. Celui-là répondait au nom de Paradise Lost... Voilà bien du bavardage et de l'enfantillage. J'en rougis et vous prie de l'excuser.
Il faut que vous me promettiez de m'écrire le lendemain de votre première représentation allemande; d'ici là, si l'envie vous en prend, tant mieux. De mon côté, maintenant que la digue est rompue, je vais vous inonder de lettres. J'écris cette fois-ci à votre adresse, car je ne sais si Viardot est encore à Berlin. Il est cependant étrange que nos lettres se soient perdues!
Mille—non—un million d'amitiés à tous les vôtres. Je crois que vous n'avez pas besoin de mes protestations d'amitié et de dévouement pour y croire; nous sommes déjà de vieux amis, des amis de trois ans. Je suis et serai toujours le même; je ne veux pas, je ne puis pas changer.
Permettez-moi de vous serrer bien amicalement les mains; je fais les vœux les plus sincères pour votre bonheur.
A revoir, un beau jour; ah! je crois bien qu'il sera beau, ce jour-là!
Louise[10] n'est pas encore assez grande demoiselle pour se formaliser d'un gros baiser que je donne à sa petite joue rondelette. Adieu, encore une fois.
Votre tout dévoué,
YVAN TOURGUENEFF.
Paris, 19 octobre 1847.
Savez-vous, Madame, que vos charmantes lettres rendent la besogne très difficile à ceux qui ont prétendu à l'honneur de correspondre avec vous? J'en suis d'autant plus embarrassé qu'une légère indisposition (maintenant entièrement dissipée) m'ayant retenu dans ma chambre tous ces jours-ci, je ne puis vous envoyer, comme j'en avais l'intention, une petite revue de tout ce qui se passe à Paris. Me voilà donc réduit à mes propres ressources, comme la Médée de Corneille. C'est fort inquiétant.... Mais n'importe! je compte sur votre indulgence.... Ah! mais—sans plaisanter!—quelle abominable chose que l'abus de la parole! Voilà une phrase qui, à force d'avoir été répétée, ne veut plus rien dire; et quand on l'emploie très sérieusement, on s'expose à n'être pas cru. Enfin! comme dit votre mari—je commence par le commencement.
Je commence par vous dire que nous sommes tous très enchantés de l'heureux commencement de vos pérégrinations, et que nous attendons avec impatience les nouvelles de votre début. Nous voyons d'ici tomber les fleurs et nous entendons les bravos. Hélas!... Vous savez ce que veut dire cet hélas!
Eh bien, vous voilà donc au fond de l'Allemagne! Il faut espérer que ces braves «Bürger» sauront mériter leur bonheur. Vous êtes à Dresde.... N'étions-nous pas hier à Courtavenel? Le temps passe toujours vite, qu'il soit rempli ou vide, mais il arrive lentement... comme une clochette de troïka russe.
Vous avez probablement parcouru Diderot. Il faut avoir lu ses paradoxes pour s'en amuser, les réfuter et les oublier. Il raffermit—à ses dépens—dans son lecteur le sentiment du vrai et du beau. Votre esprit si droit, si simple, et si sérieux dans sa finesse et sa grâce, n'a pas dû goûter beaucoup le babil capricieux, miroitant et dilettantisque du «Platon français» (jamais homme ne fut plus mal surnommé). Cependant on y pêche par-ci par-là quelques idées neuves et hardies, ou plutôt quelques germes d'idées fécondes. Son dévouement à la liberté de l'intelligence; son encyclopédie, voilà ce qui le fera vivre. Son cœur est excellent; mais quand il le fait parler, il y fourre de l'esprit et le gâte. Décidément les feux d'artifice du paradoxe ne vaudront jamais le bon soleil de la vérité. Et cependant, quoi de plus quotidien que le soleil? (Pas à Paris, par exemple!) Ma foi! vive le soleil! Vive tout ce qui est bon pour tout le monde!
Mendelssohn est donc mort. Ce que vous en avez dit dans votre lettre à madame votre mère nous a paru à tous bien juste. Je ne le connais presque pas; d'après ce que j'ai entendu de lui, je suis tout prêt à l'estimer,—beaucoup l'aimer... c'est une autre affaire. On ne fait de belles choses qu'avec le talent et l'instinct réunis: avec la tête et le cœur; j'ose croire que chez Mendelssohn la tête prédomine. Je puis me tromper... mais, du reste, vous savez que je ne tiens pas obstinément à mes erreurs, quand on me met le nez dessus—ce qui n'est pas difficile, vu les proportions de cet organe. Je suis éducable.
Et à propos, comment va die deutsche Sprache[11]? Parfaitement, j'imagine. J'ai déjà pris un maître d'espagnol: el señor Castelar. J'ai beaucoup travaillé tous ces temps-ci; je viens d'expédier un gros paquet à notre Revue[12]. C'est que je tiens à tenir mes promesses. J'achève de lire en ce moment un livre de Daumer sur les mystères du christianisme. Ce Daumer est une espèce de fou qui veut à toute force prouver que le christianisme primitif, judaïque, considéré comme secte, n'est autre chose que le culte de Moloch renouvelé; que les premiers chrétiens sacrifiaient et mangeaient des victimes humaines, et que Judas n'a trahi son maître que parce qu'il ne pouvait vaincre l'horreur que lui inspirait un pareil repas. Daumer dépense beaucoup d'érudition pour prouver que cette horrible coutume s'est maintenue dans l'Église jusqu'au quatorzième siècle! Ce ne sont que des folies; mais ce qu'il y a de vrai dans son idée—c'est le côté sanglant, triste, anti-humain de cette religion, qui devrait être toute d'amour et de charité. Vous ne sauriez vous imaginer l'effet pénible que font toutes ces légendes de martyrs qu'il vous raconte les unes après les autres, toutes ces flagellations, ces processions, ces ossements adorés, ces autodafés, ce mépris féroce de la vie, cette horreur des femmes, toutes ces plaies et tout ce sang!... C'est tellement pénible que je ne veux plus vous en parler....
Dans ma prochaine lettre, je vous donnerai des nouvelles sur l'Opéra National, sur la Cléopâtre de Mme de Girardin (qui a réussi, à mon grand regret), etc., etc. Cependant, dès aujourd'hui, je puis vous dire que j'ai assisté hier soir à la première représentation de Didier, l'honnête homme, nouvelle pièce de Scribe, aux Variétés. La donnée n'en est pas neuve, mais c'est parfaitement manigancé.... Ferville y a été admirable de vérité, de noblesse et de sensibilité. Or, il paraît qu'une pièce identiquement pareille a été donnée hier au soir au Gymnase sous le nom de Jérôme le maçon. C'est Bouffé qui y remplissait le rôle de Ferville. Je ne sais comment ces beaux esprits se sont rencontrés, mais il est de fait que le Gymnase a fait relâche avant-hier et a répété jour et nuit pour être prêt le même jour que l'autre théâtre. J'irai voir ce Jérôme, et vous ferai part de mes impressions.—Bouffé est certainement bien plus Mendelssohn que Ferville,—mais Ferville est peut-être plus Rossini que lui. Enfin nous verrons, et si j'ai dit une bêtise, je serai le premier à crier mon mea culpa.
Sur ce, Madame, je prie Dieu de vous avoir en sa sainte et bonne garde. Portez-vous bien surtout et n'oubliez pas vos amis, qui vous sont bien dévoués, ce qui n'est pas étonnant le moins du monde, car enfin... ma foi, à quoi l'absence serait-elle bonne, si on ne pouvait pas même en profiter pour dire aux personnes ce qu'on pense d'elles?... Mais je m'arrête à l'idée que vous devez avoir pour le moment un bourdonnement perpétuel de compliments dans les oreilles, et je me borne à vous dire... enfin tout ce que vous voulez....
J'espère que votre mari se porte bien, qu'il va chasser à outrance et nous écrire un joli petit article là-dessus. Je lui serre la main ainsi qu'à vous, et j'embrasse la petite Louise de tout mon cœur.... Si Mme Schumann se souvient d'un gros monsieur russe qu'elle a vu à Berlin, dites-lui que ce gros monsieur la salue....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il faut cependant finir cette lettre! Je vais la porter à madame votre mère pour qu'elle y mette quelques mots.
Bonjour, portez-vous bien de toutes les façons; et voilà.
Votre tout dévoué,
IV. TOURGUENEFF.
Paris, le 8 décembre 1847.
Je commence par vous remercier, Madame, pour la bonne et charmante lettre que madame votre mère m'a remise de votre part. Vous faites bien de vous souvenir de vos vieux amis; ils vous en sont tellement reconnaissants! Danke, danke.
Tous les détails que vous nous donnez de votre vie à Dresde sont lus et relus mille fois; les Dresdennois sont décidément un bon peuple....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avant tout, il faut que je vous dise que «maman[13]» se porte très bien et Mlle Antonia[14] aussi, et Mme Sitchès aussi; le papa Sitchès[15] tousse un peu, mais ce n'est pas du tout étonnant. Des 900.000 habitants de Paris, il y en a 899.999 qui ont la grippe, et le seul qui ne l'ait pas, c'est Louis-Philippe, car ce monsieur a tous les bonheurs. Cependant, pardon! je m'oubliais; je n'ai pas la grippe non plus; mais c'est que moi aussi, je ne puis pas me plaindre de mon sort.
El hermano de Vd[16] va très bien de même; il a fait magnifiquement relier un exemplaire de sa méthode, qu'il destine à la reine Christine, pour qu'elle apprenne à sa fille l'art de faire des fioritures et des transpositions.
A propos de musique, j'ai entendu Mme Alboni dans Sémiramide. Elle y a eu un très grand succès. Sa voix a entièrement changé de caractère depuis Pétersbourg; de brutale qu'elle était, elle est devenue trop molle, molle; elle chante à la Rose Chéri, maintenant; elle fait bien les agilités; le timbre de sa voix est excessivement doux et insinuant, mais pas d'énergie, pas de mordant. Comme actrice, elle est nulle; sa figure placide et grasse se refuse à toute expression dramatique; elle se borne de temps en temps à froncer péniblement le sourcil. Ce qu'elle a dit de mieux a été le In si barbara sciagura. Les Parisiens en sont enchantés. Mme Grisi, talonnée par l'émulation, s'est surpassée; elle m'a vraiment fait plaisir. Coletti n'a pas été mauvais non plus, quoique, en général, je trouve qu'il chante en père de famille.
Hier, je suis allé, avec le jeune Le Roy d'Étiolles[17], à l'Opéra-Comique; on y donnait la Dame blanche. Quelle jolie musique, galante, spirituelle et chevaleresque! C'est moins brillant, mais peut-être plus français encore qu'Auber; Boïeldieu est pâle quelquefois, mais jamais vulgaire (ce qui n'arrive que trop souvent au papa de la Muette)....
Vernet m'a fait un très grand plaisir dans la vieille pièce: le Père de la débutante. Tous les acteurs français sont essentiellement réalistes, mais personne ne l'est aussi finement, aussi «brovontement», disait un Allemand, que Vernet. Il contente à la fois l'instinct et l'esprit du spectateur; il transporte d'aise le connaisseur, il fait rire et sourire. Quel dommage qu'il se fasse vieux! Voilà quelqu'un qui s'entend à créer.—Il y a des artistes qui parviennent à se débarrasser de leur individualité; mais à travers la personne qu'ils représentent, on voit cependant l'acteur qui s'efface, qui s'observe, et cette espèce de contrainte réagit sur vous. Vous étiez encore ainsi à Pétersbourg, mais déjà alors votre talent brisait ses dernières entraves (je me rappelle maintenant les premières représentations de la Somnambule), et depuis?...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vous me dites que vous vous êtes mise à lire Uriel Acosta, de Gutzkow. N'est-ce pas que ce fantôme, que cet ouvrage pénible d'un homme d'esprit sans talent, tout farci d'allusions et de préoccupations politiques, religieuses, philosophiques, vous a déplu? Et puis, tous ces effets criards, ces coups de théâtre,—y a-t-il quelque chose de plus dégoûtant qu'une brutalité qui n'est pas naïve?
L'ombre de Shakespeare pèse sur les épaules de tous les auteurs dramatiques; ils ne peuvent se défaire de leurs réminiscences; ils ont trop lu, les malheureux, et pas du tout vécu! Ce n'est qu'en Allemagne qu'il a été possible qu'un écrivain déjà connu (M. Mundt, le mari de la sœur de Müller) se soit vu réduit à afficher dans les gazettes qu'il désirait une épouse (ce fait est littéralement vrai).
On ne peut plus rien lire par le temps qui court. Gluck disait d'un opéra qu'il puait la musique (puzza musica). Tous les ouvrages qu'on fait aujourd'hui puent la littérature, le métier, la convention. Pour trouver une source encore vive et pure, il faut remonter bien haut. Le prurit littéraire, le bavardage de l'égoïsme qui s'étudie et s'admire soi-même, voilà la plaie de notre temps. Nous sommes comme les chiens qui retournent à leurs vomissements.
C'est l'Écriture qui le dit, naïvement, cette fois. Il n'y a plus ni Dieu ni Diable, et l'avènement de l'Homme est encore loin.
Parmi tout ce qui écrivaille maintenant en Allemagne, Feuerbach[18] est le seul homme, le seul caractère et le seul talent.
Voici encore un bon et bel ouvrage; et pas littéraire, Dieu merci! le deuxième volume de la Révolution française, par Michelet. Cela part du cœur, il y a du sang, de la chaleur là-dedans; c'est un homme du peuple qui parle au peuple,—c'est une belle intelligence et un noble cœur. Le deuxième volume est infiniment supérieur au premier. C'est tout l'inverse pour le livre de Louis Blanc.
Je crains cependant que ma lettre ne devienne trop longue, et, malgré tout le plaisir que j'ai à babiller devant vous, je ne voudrais pas abuser de votre complaisance. Je n'ajouterai plus que quelques mots. Je mène ici une vie qui me plaît excessivement: toute la matinée, je travaille; à deux heures, je sors, je vais chez maman où je reste une demi-heure, puis je lis les journaux, je me promène; après dîner, je vais au théâtre ou je retourne chez maman; le soir, quelquefois, je vois des amis, surtout M. Annenkoff[19], un charmant garçon aussi fin d'esprit qu'il est gros de corps; et puis je me couche, et voilà....
Adieu, Madame... je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Rappelez-moi, s'il vous plaît, au bon souvenir de votre mari; je vais lui écrire un de ces jours; j'espère qu'il se porte à merveille. Je vous serre la main bien cordialement, et je reste pour toujours.
Votre dévoué
IV. TOURGUENEFF.
Paris, 14 décembre 1847.
Bravo, Madame, bravo, evviva! Je ne puis commencer ma lettre autrement. Encore une grande victoire! Vous avez fait à Dresde et à Hambourg ce que la Diète vient de faire contre le Sonder-Bund: après avoir enfoncé les ailes, vous allez mettre le centre (Berlin) en pleine déroute. Et puis vous irez, comme César, à la conquête de la Grande-Bretagne. (Tudieu! quel ton épique!) Vous nous avez fait aussi beaucoup de plaisir en nous racontant votre voyage de Berlin à Hambourg. En général, ce qu'il y a surtout de charmant dans les lettres que vous écrivez à madame votre mère—ce sont les détails que vous nous donnez... les détails, mais c'est le coloris, la lumière du tableau.—Ne nous envoyez pas de simples dessins ou des grisailles—chacune de vos lettres est relue une dizaine de fois—toujours deux fois de suite à haute voix. (C'est moi qui fais l'office de lecteur). Et puis, après l'avoir dévorée en bloc, on se met à l'éplucher par-ci par-là; l'appétit revient en mangeant, et on recommence. Je ne puis vous cacher que vous faites des fautes d'orthographe en espagnol! mais ce n'est qu'un charme de plus....
A propos, il y a encore une chose dans vos lettres qui nous rend bien contents: c'est de voir que vous vous portez bien (je crache trois fois[20]). Aussi—ne fût-ce que par émulation—nous nous portons, tous tant que nous sommes, à merveille.... Ce que c'est que l'émulation!
Je regrette de me voir forcé de vous le dire, Madame, mais cette fois-ci je n'ai absolument aucune nouvelle intéressante à vous communiquer.
Toute cette semaine, je ne suis presque pas sorti de chez moi; j'ai travaillé à force; jamais les idées ne m'étaient venues si abondamment; elles se présentaient par douzaines. Je me faisais l'effet d'un pauvre diable d'aubergiste de petite ville qui se voit tout à coup assailli par une avalanche de visiteurs; il finit par perdre la tête et ne plus savoir où loger son monde.
Avant-hier, j'ai lu une des choses que je venais de terminer à deux amis russes; ces messieurs ont ri à se tordre.... Ça me faisait un effet extrêmement étrange et fort agréable.... Décidément je ne me savais pas si drôle que ça—et puis il ne suffit pas de terminer une chose, il faut la copier (voilà une corvée!) et l'expédier. Aussi les éditeurs de ma Revue vont-ils ouvrir de grands yeux en recevant coup sur coup des gros paquets de lettres! J'espère qu'ils en seront contents. Je prie très humblement mon bon ange (tout le monde en a un, à ce qu'on dit) de continuer à m'être favorable—et je vais continuer de mon côté à abattre de la besogne. C'est une excellente chose que le travail.
Écoutez, Madame: si après la réception de cette lettre, vous avez encore à chanter le Barbier, intercalez-y l'air de Balfe.... je veux qu'on me pende si le public ne casse pas les banquettes. Je connais les Hambourgeois (Ich kenne meine Pappenheimer), il leur faut quelque chose d'épicé.
Depuis deux ou trois jours, nous avons ici un temps superbe. Je fais de grandes promenades avant dîner aux Tuileries. J'y regarde jouer une foule d'enfants, tous charmants comme des Amours et si coquettement habillés! Leurs caresses gravement enfantines, leurs petites joues roses mordillées par les premiers froids de l'hiver, l'air placide et bon des bonnes, le beau soleil rouge à travers les grands marronniers, les statues, les eaux dormantes, la majestueuse couleur gris sombre des Tuileries, tout cela me plaît infiniment, me repose et me rafraîchit après une matinée de travail. J'y rêve—non pas vaguement, à l'allemande, à ce que je fais, à ce que je vais faire.... Je ne manque jamais (c'est-à-dire les trois ou quatre fois que j'y ai été) d'aller faire ma visite au lion de Barye, qui se trouve à l'entrée des Tuileries, du côté de la rivière—mon groupe favori. Le soir, je vais chez «bonne maman»; nous y avons passé, il y a quelques jours, cinq ou six heures avec Manuel[21] à faire mille extravagances. Cela nous a fait penser à Courtavenel, à Mascarille, à Jodelet, etc., etc. Vous n'êtes pas la seule qui y pensiez, Madame.... Vous souvenez-vous du jour où nous regardions le ciel si pur à travers les feuilles dorées des trembles?... Ah! mais, je n'en finirais pas si je me mettais sur ce chapitre.
Mon Dieu, que c'est donc beau, l'automne!... pas quand il fait sale et crotté (vos «pflia pflia» sont parfaits de vérité), mais quand le ciel est bien transparent, bien pacifique. Il y a du Louis XIV vieillard dans un beau jour d'automne.... Vous allez vous moquer de ma comparaison. Eh bien, tant mieux! Riez même, riez aux éclats à montrer toutes vos dents. Vous savez ce que vous disait votre vieux monsieur de Mecklembourg sur la route de Berlin à Hambourg!
J'ai promis à madame votre mère de lui porter ma lettre... il faut lui laisser de la place. J'aurais dû y penser d'avance et resserrer davantage mes lignes. C'est pour le coup que vous aurez le droit de me nommer bavard.
Je vais écrire, l'un de ces jours, une lettre à votre mari. Le deuxième volume de Michelet est un chef-d'œuvre. Louis Blanc se couvre de ridicule par sa querelle avec Eugène Pelletan.
Je salue bien amicalement le grand chasseur. Que Dieu vous conserve tous! Je vous souhaite tout le bonheur imaginable; je vous serre fortement la main, je vous refélicite et je reste:
Votre ami dévoué,
IV. TOURGUENEFF.
P.-S.—N'ayant pas trouvé madame votre mère à la maison, je ferme cette lettre de peur de retard. J'écris cela dans la boutique d'un épicier, et je vais cacheter ma lettre avec sa cire et le sceau de ses armes.
19 décembre 1847.
Madame,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madame votre mère (qui se porte bien, ainsi que nous tous) m'a raconté votre dernière lettre de Hambourg. Ah! Madame! Madame! ne vous fiez pas à une belle journée de décembre, c'est bien traître, il fait humide «le long de la rivière». J'espère que votre mal de gorge se sera dissipé bien vite et que les Huguenots ont eu le même succès que le Barbier. Du reste, je ne crois pas que vous vous amusiez beaucoup à Hambourg. On n'y voit que des «marchants», toujours parlant de chemins de fer, actions, emprunts et autres choses fort productives et fort stupides. Je suis sûr qu'au fond de votre âme vous devez ressentir un secret dépit de devoir amuser de pareilles gens, car vous ne faites que les amuser. Ils ne sont pas capables de sentir autre chose en vous écoutant; ils réservent tout leur sérieux pour la hausse et la baisse. Cependant ils vous applaudissent, ils crient, ils battent des mains. Ils font leur devoir—et on ne les en remercie pas...
Ce que vous nous dites de l'effet qu'a produit sur vous le Joseph de Méhul me fait bien vivement regretter qu'on ne puisse l'entendre ici; dans ce grand diable de Paris, on ne donne que de grands diables d'opéras, comme Jérusalem....
Au moment où je vous écris ces lignes, une bande de musiciens ambulants se met à chanter le Mourir pour la patrie, de Gossec.... Dieu, que c'est beau! j'en ai les larmes aux yeux. Ah ça, mais décidément les vieux musiciens valaient mieux que ceux d'à présent. Quelle énergie sérieuse! quelle conviction! quelle simplicité grandiose! Chanté en 93 par des centaines de voix, cet hymne a dû faire battre bien des cœurs.
En général, depuis quelque temps, je me détourne de plus en plus du temps présent; il est vrai qu'il offre peu d'attraits! Je me jette à corps perdu dans le passé. Je lis maintenant Calderon avec acharnement (en espagnol, comme de raison); c'est le plus grand poète dramatique catholique qu'il y ait eu, comme Shakespeare, le plus humain, le plus antichrétien. Sa Devocion de la Cruz est un chef-d'œuvre. Cette foi immuable, triomphante, sans l'ombre d'un doute ou même d'une réflexion, vous écrase à force de grandeur et de majesté, malgré tout ce que cette doctrine a de répulsif et d'atroce. Ce néant de tout ce qui constitue la dignité de l'homme devant la volonté divine, l'indifférence pour tout ce que nous appelons vertu ou vice avec laquelle la grâce se répand sur son élu—est encore un triomphe pour l'esprit humain; car l'être qui proclame ainsi avec tant d'audace son propre néant s'élève par cela même à l'égal de cette Divinité fantastique, dont il se reconnaît être le jouet. Et cette Divinité—c'est encore l'œuvre de ses mains. Cependant, je préfère Prométhée, je préfère Satan, le type de la révolte et de l'individualité. Tout atome que je suis, c'est moi qui suis mon maître; je veux la vérité et non le salut; je l'attends de mon intelligence et non de la grâce.
N. B.—Excusez toutes ces fio-ratures[22].
Malgré tout, Calderon est un génie bien extraordinaire et vigoureux surtout. Nous autres, faibles descendants de puissants ancêtres, nous arrivons tout au plus à être gracieux dans notre faiblesse.... Je pense au Caprice de Musset (qui continue à faire fureur ici). Mais je pense aussi en même temps que je continue à ne pas avoir de nouvelles à vous donner; et cependant il s'est passé des choses assez intéressantes. M. Michelet a ouvert son cours, Mme Alboni a chanté hier la Cenerentola (je l'entendrai aujourd'hui dimanche); on parle beaucoup d'une fille électrique ou magnétique qui fait, pendant son sommeil, en écoutant la musique, des gestes qui y ont rapport (à la musique), etc., etc., etc.
Mais que voulez-vous, je tourne à l'ours; je ne sors presque pas de ma chambre,—je travaille avec une ardeur incroyable.... J'espère que ce ne sera pas du temps perdu. Cependant j'ai l'intention de me secouer un peu et de courir à Paris; il faut cependant en avoir une idée.
J'ai reçu des lettres de mes éditeurs qui me font toutes sortes de beaux compliments sur mon activité; en même temps ils m'ont envoyé le dernier numéro de notre Revue; j'y ai trouvé une admirable nouvelle d'un monsieur Grigorovitch[23]....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J'écrirai demain une lettre à votre mari, que je vous prie de saluer bien amicalement de ma part. Je n'ai pas encore rempli la commission de Louise—et pour cause; ce qui ne m'empêche pas de l'embrasser sur les deux joues. Pour vous, Madame, vous connaissez mon refrain ordinaire; je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon, de beau, de grand et de noble dans ce monde... du reste, c'est vous souhaiter ce que vous possédez déjà. Soignez-vous bien, soyez heureuse, gaie et contente, vous et tous les vôtres.
Vous ne restez pas à Hambourg plus de quatre à cinq jours, n'est-ce pas? Ma prochaine lettre vous y trouvera peut-être encore.
Que Dios bendiga a Ud, leben sie recht, recht wohl; boudté zdorovy i pomnité nass[24].
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Paris, ce 25 décembre 1847.
Nous étions tous, je vous l'avouerai, Madame, un peu inquiets de ne pas recevoir de vos nouvelles (il est vrai que vous nous aviez gâtés), quand votre lettre du 21, avec tous ses charmants détails, nous a comblés de joie. J'ai fait l'office de lecteur, comme de coutume, et je puis vous assurer que jamais mes yeux ne se portent mieux que quand ils ont à déchiffrer vos lettres, d'autant plus que vous écrivez parfaitement bien pour une célébrité. Du reste, votre écriture varie à l'infini; quelquefois elle est jolie, fine, perlée—une vraie petite souris qui trottine; d'autres fois, elle marche hardiment, lestement, à grandes enjambées; souvent il lui arrive de s'élancer avec une rapidité, avec une impatience extrêmes, et alors, ma foi, les lettres deviennent ce qu'elles peuvent.
Vous faites très bien de nous décrire vos costumes; nous autres réalistes, nous tenons au coloris. Et puis...! et puis, tout ce que vous faites est bien fait. Vos succès à Hambourg nous causent une joie infinie; bravo, bravo! N'est-ce pas que nous sommes bons de vous encourager?
Je vous remercie de tout mon cœur pour le bon et affectueux conseil que vous me donnez dans votre lettre à Mme Garcia. Ce que vous dites de la «quabra dura» qu'on remarque toujours dans une œuvre interrompue est bien vrai—«das sind goldene Worte». Aussi, depuis que je suis à Paris, je n'ai jamais travaillé qu'à une chose à la fois et j'en ai conduit plusieurs à bon port, je l'espère du moins. Il ne s'est pas passé de semaine que je n'aie envoyé un gros paquet à mes éditeurs.
Depuis la dernière lettre que je vous ai écrite, j'ai encore lu un drame de Calderon, la Vida es sueno[25]. C'est une des conceptions dramatiques les plus grandioses que je connaisse. Il y règne une énergie sauvage, un dédain sombre et profond de la vie, une hardiesse de pensées étonnante, à côté du fanatisme catholique le plus inflexible. Le Sigismond de Calderon (le personnage principal), c'est le Hamlet espagnol, avec toute la différence qu'il y a entre le Midi et le Nord. Hamlet est plus réfléchi, plus subtil, plus philosophique; le caractère de Sigismond est simple, nu et pénétrant comme une épée; l'un n'agit pas à force d'irrésolution, de doute et de réflexions; l'autre agit—car son sang méridional le pousse—mais tout en agissant, il sait bien que la vie n'est qu'un songe.
Je viens de commencer maintenant le Faust espagnol, el Magico prodigioso[26]; je suis tout encalderonisé. En lisant ces belles productions, on sent qu'elles ont poussé naturellement sur un sol fertile et vigoureux; leur goût, leur parfum, est simple; le graillon littéraire ne s'y fait pas sentir. Le drame en Espagne a été la dernière et la plus belle expression du catholicisme naïf et de la société qu'il avait formée à son image. Tandis que dans le temps de crise et de transition où nous vivons, toutes les œuvres artistiques ou littéraires ne représentent tout au plus que les opinions, les sentiments individuels, les réflexions confuses et contradictoires, l'éclectisme de leurs auteurs; la vie s'est éparpillée; il n'y a plus de grand mouvement général, excepté peut-être celui de l'industrie, qui, considérée sous le point de vue de la soumission progressive des éléments de la nature au génie de l'homme, deviendra peut-être la libératrice, la régénératrice du genre humain. Aussi, à mon avis, les plus grands poètes contemporains sont les Américains qui vont percer l'isthme de Panama et parlent d'établir un télégraphe électrique à travers l'Océan. Une fois la révolution sociale consommée—vive la nouvelle littérature!...
Une grande partie de ces réflexions m'est venue à l'esprit l'autre soir, pendant que j'assistais à la représentation d'une revue de l'année 1847, le Banc d'huîtres, au Palais-Royal. C'était amusant, et je riais.... Mais, bon Dieu! que c'était maigre, pâle, timide et mesquin à côté de ce qu'aurait pu en faire—je ne dis pas Aristophane—mais quelqu'un de son école! Une comédie fantastique, extravagante, railleuse et émue, impitoyable pour tout ce qu'il y a de faible et de mauvais dans la société et dans l'homme même, et finissant par rire de sa propre misère, s'élevant jusqu'au sublime pour s'en moquer encore, descendant jusqu'au stupide pour le glorifier, le jeter à la face de notre orgueil.... que ne donnerait-on pour y assister! Mais non, nous sommes voués au Scribe à perpétuité.
Je ne désespère pas de vous lire les Oiseaux ou les Grenouilles d'Aristophane en en retranchant tout ce qui est par trop cynique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi vous voilà donc à Berlin; vos deux premières campagnes sont terminées, et vous vous trouvez, maintenant au milieu d'un peuple déjà conquis.
Vous allez débuter dans une semaine. Je connais quelqu'un qui se mettra à étudier les journaux de Berlin. Il y a dans les Didaskalia de Francfort un article enthousiaste sur vous, daté de Hambourg. A propos, l'Illustration annonce votre engagement au Grand-Opéra pour l'hiver prochain. On écrit de Pétersbourg que le théâtre italien y est à l'agonie. J'ai parlé dans une lettre à votre mari de la Cerenentola et de Mme Alboni.
J'espère que vous allez vous porter tous, mari, femme et enfant, comme des anges, ou comme nous, car nous allons très bien, mais très bien.
Bonjour, Madame. Au risque de vous ennuyer en vous répétant toujours la même chose, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, de plus grand et de plus beau sur la terre; vous savez si mes vœux sont bien sincères... Portez-vous bien, soyez heureuse.
Votre tout dévoué
IV. TOURGUENEFF.
P.-S.—Que Dios bendiga Vd.
Paris, ce 11 janvier 1848.
Je viens de recevoir à l'instant la lettre que vous m'avez envoyée sous le couvert de Mme Garcia. Je remercie votre mari, de son bon souvenir. Quant à ce qu'il me dit de la situation de la France, je ne demande pas mieux que d'avoir tort, et d'être détrompé le plus vite possible.
Mes petites nouvelles (qui, du reste, sont dans un genre diamétralement opposé à celui de Florian) ne méritent pas l'honneur d'une traduction; mais l'offre que me fait et señor Louis est trop flatteuse pour que je ne m'abonne pas, dès à présent, à en profiter plus tard, quand j'aurai fait enfin quelque chose de bon, si Apollon veut que ce bonheur m'arrive[27]. En même temps je souhaite au grand chasseur... halte-là! je ne lui souhaite rien. Si lui, l'homme raisonnable par excellence, ne s'est pas laissé infecter par les superstitions de ma chère patrie, je ne suis pas Russe pour rien, moi, et ne veux pas lui gâter son plaisir.
Les articles sur la Norma m'ont fait éprouver ce que les Allemands nomment Wehmuth. En vous comparant avec vous-même d'il y a un an, MM. les critiques semblent remarquer un changement, un développement dans la manière dont vous faites ce rôle. Et moi—ay de mi—je ne puis savoir ce qu'ils veulent dire. Je ne vous ai pas vue dans la Norma depuis Saint-Pétersbourg. Diese Entwickelungstufe ist mir entgangen. Je suis prêt à crier: Au voleur! comme Mascarille. Au fond, je ne suis pas chagriné. Rellstab et Kossack parlent tous les deux «von einer milderen Darstellung»; je sais bien que ce n'est pas là une Milde à la Lind; je suis persuadé, au contraire, que cela doit être très beau, très vrai et très poignant. Oui, les grandes souffrances n'abattent pas les grandes âmes, elles les rendent plus calmes, plus simples, elles les assouplissent, sans leur rien faire perdre de leur dignité. «Les coups de marteau», dit Pouchkine quelque part, «brisent le verre et forgent l'acier», l'acier plus souple et plus fin que le fer. Ceux qui ont passé par là, ceux qui ont su souffrir (j'allais dire ceux qui ont eu ce bonheur, car c'en est un que l'égoïste, par exemple, ou le lâche ne connaissent pas) en gardent une empreinte qui les ennoblit—s'ils y résistent.
Dieu! que j'aurais été content d'assister à une représentation de la Norma! Cette femme au cœur si haut placé et si naïf, si droit, si vrai, en lutte avec son amour et sa destinée, ces grands et simples mouvements des passions dans une âme primitive, ce cruel et doux mélange de tout ce qu'il y a de plus cher dans la vie,—et dans la mort,—cette explosion délirante de la fin, cette intelligence si forte et si fière, qui, au moment de mourir, se laisse enfin envahir tout entière par la tendresse la plus vive, par l'enthousiasme du sacrifice,—n'en parlons plus. Je tâcherai de vous «reconstruire» dans la Norma d'après l'idée que j'ai de votre talent, d'après mon souvenir... Il est vrai que je ne suis plus rompu comme autrefois à cet exercice allemand par excellence... enfin j'essayerai.
Vous me parlez aussi du Roméo, du troisième acte; vous avez la bonté de me demander des remarques sur Roméo. Que pourrais-je vous dire que vous n'auriez déjà su et senti d'avance? Plus je réfléchis à la scène du troisième acte, plus il me semble qu'il n'y a qu'une manière de la rendre—la vôtre. On ne peut s'imaginer quelque chose de plus affreux que de se trouver devant le cadavre de tout ce qu'on aime; mais le désespoir qui vous saisit alors doit être tellement terrible que, s'il n'est pas retenu et glacé par la ferme résolution de se donner la mort à soi-même, ou par tout autre grand sentiment, l'art n'est plus en état de le rendre. Des cris entrecoupés, des sanglots, des évanouissements, c'est de la nature, ce n'est pas de l'art. Le spectateur lui-même n'en serait pas ému, de cette émotion profonde et poignante qui vous fait verser avec délices des larmes quelquefois bien amères. Tandis que de la manière dont vous voulez faire Roméo (d'après ce que vous m'écrivez), vous produirez sur votre auditoire une impression ineffaçable. Je me souviens de l'observation fine et juste que vous fîtes un jour sur les petits mouvements agités et contenus que se donne Rachel tout en gardant une attitude calme et grandiose; cela n'était peut-être chez elle que du savoir-faire; mais, en général, c'est le calme provenant d'une forte conviction ou d'un sentiment profond, le calme qui enveloppe pour ainsi dire de tous côtés les élans désespérés de la passion, qui leur communique cette pureté de lignes, cette beauté idéale et réelle; la vraie, la seule beauté de l'art. Et ce qui prouve la vérité de cette remarque, c'est que la vie elle-même—dans de rares moments, il est vrai, dans les moments où elle se dégage de tout ce qu'elle a d'accidentel et de commun—s'élève au même genre de beauté. Les plus grandes douleurs, avez-vous dit dans votre lettre, sont les plus calmes; et les plus calmes sont les plus belles, pourrait-on ajouter. Mais il s'agit de savoir réunir les deux extrêmes, ou sinon on paraîtra froid. Il est plus facile de ne pas attenter à la perfection, plus facile de rester à mi-chemin, d'autant plus que la plupart des spectateurs ne demandent pas autre chose, ou plutôt ne sont pas habitués à autre chose; mais vous n'êtes ce que vous êtes que par cette noble tendance à ce qu'il y a de plus haut, et, croyez-moi,—ist der Pünkt getroffen,—tous les cœurs, même les plus vulgaires, bondissent et s'élancent. A Pétersbourg, il fallait être soi-même un peu artiste pour sentir tout ce que vos intentions avaient de magnifique; vous avez grandi depuis lors; vous êtes devenue compréhensible pour tout le monde, sans cesser cependant d'avoir beaucoup de choses réservées aux élus.
Je vous écris cela tout chaud, tout bouillant; vous aurez la bonté de suppléer—avec votre finesse de divination ordinaire—à ce que mes expressions auront d'inexact et d'incomplet. Je n'ai pas le temps de faire du style; je n'en ai pas même la volonté. Je ne veux que vous dire ce que je pense.
Je dois finir ma lettre, et je ne vous ai pas parlé de ce qui se fait à Paris. Je le ferai dans une autre lettre, très prochaine, si vous le voulez bien. . . . . . . . . . . .
Tout le monde se porte bien. J'ai été hier aux Italiens; on donnait la Donna del Lago, de Rossini. Quelle délicieuse musique (malgré quelques longueurs et quelques vieilleries)! Mais aussi quel libretto! Mlle Alboni y a été bien dans les andante et très molle dans les allegro. Elle et Mlle Grisi ont dit à ravir le petit duo du deuxième acte. Mario a bien chanté son air. Les chœurs ont été détestables. (Quel dommage! le chœur des Bardes est magnifique, autant qu'on en pouvait juger)........
Portez-vous bien, vous tous que j'aime beaucoup.
Je reste votre tout dévoué
IVAN. TOURGUENEFF.
Paris, 17/5 janvier 1848.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ah! Madame, quelle bonne chose que les longues lettres! comme celle que vous venez d'écrire à «bonne maman», par exemple! Avec quel plaisir on en commence la lecture! C'est comme si l'on entrait en été dans une longue allée bien verte et bien fraîche. Ah! se dit-on, il fait bon ici; et on marche à petits pas, on écoute babiller les oiseaux. Vous babillez bien mieux qu'eux, Madame; continuez ainsi, s'il vous plaît; sachez que vous ne trouverez jamais de lecteurs plus attentifs et plus gourmands.—Vous imaginez-vous, Madame, votre mère au coin de son feu, me faisant lire à haute voix votre lettre qu'elle a eu déjà presque le temps d'apprendre par cœur? C'est alors que sa figure est bonne à peindre!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vous ai-je dit dans ma dernière lettre que j'ai assisté à un concert du Conservatoire? On n'y a donné que Mendelssohn. La Symphonie en la m'a beaucoup plu. C'est élégant, fort, élevé. L'exécution a été monstrueusement parfaite; il est impossible d'imaginer quelque chose de plus étonnant. . . . . . . . . . . . . . . .
Aujourd'hui, mardi, vous allez probablement chanter Roméo, et au moment où j'écris (il est onze heures et demie), vous devez être dans une jolie petite agitation. Je fais les vœux les plus sincères pour votre réussite. Il me semble qu'elle sera complète. Pourquoi ne puis-je être à Berlin aujourd'hui? Ah! pourquoi? pourquoi?
Ah çà! mais décidément, depuis quelque temps, je ne vous donne plus aucune nouvelle de Paris. Il est vrai que je me tiens coi dans mon trou. Voyons, cependant.
J'ai été l'un de ces jours au Jardin d'Hiver, qui est en effet une admirable chose.—Figurez-vous un espace immense, rempli de fleurs, d'arbres, de statues, et recouvert à une hauteur prodigieuse par un immense dais en verre, soutenu par une foule de colonnes en fer de fonte, fines et sveltes; au fond, un superbe jet d'eau. Le seul drawback ou désagrément que j'y ai éprouvé a été une odeur de dalle mouillée, odeur chaude et légèrement nauséabonde. On dit aussi que la pluie y pénètre trop facilement. Mais j'imagine qu'un beau bal au Jardin d'Hiver doit être un spectacle éblouissant.
Votre mari vous a certainement parlé du nouveau roman de Mme Sand, que le Journal des Débats publie dans son feuilleton: François le Champi. C'est fait dans la meilleure manière: simple, vrai, poignant. Elle y entremêle peut-être un peu trop d'expressions de paysan; ça donne de temps en temps un air affecté à son récit. L'art n'est pas un daguerréotype, et un aussi grand maître que Mme Sand pourrait se passer de ces caprices d'artiste un peu blasé. Mais on voit clairement qu'elle en a eu jusque par-dessus la tête des socialistes, des communistes, de Pierre Leroux et autres philosophes; qu'elle en est excédée et qu'elle se plonge avec délices dans la fontaine de Jouvence de l'art naïf et terre à terre. Il y a entre autres, tout au commencement de la préface, une description en quelques lignes d'une journée d'automne... C'est merveilleux. Cette femme a le talent de rendre les impressions les plus subtiles, les plus fugitives, d'une manière ferme, claire et compréhensible; elle sait dessiner jusqu'aux parfums, jusqu'aux moindres bruits... Je m'exprime mal; mais vous me comprenez. La description dont je vous parle m'a fait penser au chemin bordé de peupliers qui conduit au Jarriel, le long du parc; je revois les feuilles dorées sur le ciel d'un bleu pâle, les fruits rouges de l'églantier dans les haies, le troupeau de moutons, le berger avec ses chiens et une foule d'autres choses!...
Paris a été mis en émoi pendant quelques jours par le discours fanatique et contre-révolutionnaire de M. de Montalembert; la vieille pairie a applaudi avec rage aux invectives que l'orateur adressait à la Convention. Encore un symptôme—et des plus graves—de l'état des esprits. Le monde est en travail d'enfantement... Il y a beaucoup de gens intéressés à le faire avorter. Nous verrons.
A propos d'enfantement: la petite chienne de Mlle Jenny est morte en couche; pauvre petite bête! elle a dû beaucoup souffrir. Ce décès a fait contremander un vendredi.
Vous avez donc de la neige et des traîneaux; nous n'avons que de la boue et de la pluie. Je vois d'ici le bon Hermann Müller-Strübing[28] entrer chez vous, une branche de lilas à la main. Donnez donc à madame votre mère une petite description de votre appartement; cela aidera beaucoup l'imagination de vos amis, qui, je vous le promets, prend bien souvent son vol du côté de Berlin.
Eh bien! et Mme Lange, continue-t-elle à vous plaire? Donnez-nous-en des nouvelles.
Et les dames Kaminski[29]?
Je travaille beaucoup et avec assez de fruit.
J'ai déjà lu presque tout le Gil Blas en espagnol, je traduis Manon Lescaut et je suis entré en correspondance avec un autre élève de mon maître[30], correspondance anonyme et n'ayant d'autre but que celui de nous perfectionner dans l'étude de la «magnifica lengua castellana». Mais voyez quelle chance! dans une lettre, je me suis un peu égayé (je ne sais plus à quel propos) sur le compte du gouvernement autrichien, et il se trouve que mon correspondant est un juif de Vienne fort patriote. Du reste, mon maître m'assure que c'est un bon garçon et qu'il ne l'a pas pris eu mauvaise part.
En même temps, je travaille à une comédie[31] destinée à un acteur de Moscou. Vous voyez que je ne perds pas mon temps. (N. B. Vous voyez aussi que j'utilise les marges.)
Sur ce, je vous salue tous bien amicalement; l'un de ces quatre matins, je répondrai à l'aimable lettre du señor don Louis.
Portez-vous bien.
Votre dévoué
IVAN. TOURGUENEFF.
Paris, samedi 29 avril 1848.
Guten Morgen und tausend Dank, theuerste Madame.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Je vous dirai donc, Madame, que tous ces jours-ci il a fait un temps brumeux, maussade, pleurnicheur et maladif, froidiuscule, pour ne pas dire froid—very gentlemanlike, c'est-à-dire atroce! J'attendrai un soleil plus propice pour aller à Fontainebleau; jusqu'à présent, nous n'avons eu qu'un genuine english tun, warranted to produce a gentle and confortable heat. Cependant, ça ne m'a pas empêché d'aller hier à l'Exposition. Savez-vous que dans toute cette grande diablesse d'Exposition il n'y a qu'une petite esquisse de Delacroix qui m'ait véritablement plu? Un lion qui dévore une brebis dans une forêt. Le lion est fauve, hérissé, superbe; il s'est bien commodément couché, il mange avec appétit, avec sensualité, avec toute tranquillité d'esprit; et quelle vigueur dans le coloris, ce coloris sale et chaud, tacheté et lumineux à la fois, qui est particulier à Delacroix! Il y a aussi deux autres tableaux de lui: la Mort de Valentin (dans Faust) et la Mort du Christ, deux abominables croûtes—si j'ose m'exprimer ainsi! Du reste... rien; quelle triste Exposition pour inaugurer la République!
Le soir, j'ai été voir les Cinq Sens, ballet. C'est inimaginablement absurde. Il y a, entre autres, une scène de magnétisme (Grisi magnétise M. Petitpa pour lui faire naître le sens du goût) qui est quelque chose de colossal en fait de stupidité! Il y avait beaucoup de monde, on a beaucoup applaudi. Grisi a fort bien dansé, en effet. Mais c'est ennuyeux, un ballet—des jambes, des jambes et puis des jambes,... c'est monotone.
Avant le ballet, on a donné le deuxième acte de Lucie avec Poultier!!... Partheaux!!!... et une demoiselle Rabi, ou Riba, ou Ribi ou Raba—enfin un nom parfaitement anonyme. Cette demoiselle anonyme avait une peur atroce, mais sa voix est fort mauvaise; il est vrai de dire qu'elle est laide, ce qui ne l'empêche pas d'être vieille. . . . . . . .
Dimanche 30 avril.
Bonjour, Madame. Quand on met le matin le nez à la fenêtre... tiens, c'est un vers! Eh bien, puisqu'il est venu tout seul, il faut lui faire la politesse de lui donner un compagnon...
«Peut-être on ne voit rien—quelque chose peut-être!»
C'est du Hugo tout pur. Mais je voulais dire autre chose,—je voulais dire que quand (oh! la maudite plume!) on met le matin le nez à la fenêtre et qu'on respire l'air du printemps,—on ne peut s'empêcher de désirer être heureux. La vie—cette petite étincelle rougeâtre dans l'océan sombre et muet de l'Éternité!—ce seul moment qui vous appartient, etc., etc., etc., c'est bien commun, et cependant c'est vrai. (Demain je m'achèterai d'autres plumes; celles-ci sont détestables et me gâtent le plaisir que j'ai de vous écrire.) Voyons cependant.—(Ah! grâce à Dieu, en voilà une qui est passable!) Qu'ai-je fait hier, samedi? J'ai lu un livre dont j'avais souvent parlé avec beaucoup d'éloges, sans le connaître, je le confesse. Les Provinciales de Pascal. C'est admirable de tous points. Bon sens, éloquence, verve comique, tout y est. Et cependant, c'est l'ouvrage d'un esclave, d'un esclave du catholicisme,—«les chérubins, ces glorieux composés de tête et de plume», «ces illustres faces volantes, qui sont toujours rouges et brûlantes», du jésuite Le Moine, m'ont fait rire aux éclats.
Puis, je suis allé voir l'exposition des figures représentant la République, ou plutôt de sept cents esquisses représentant cette figure, et j'en suis revenu indigné, comme tout le monde. C'est une abomination inimaginable! Quel concours! Où es-tu, jury?
Puis j'ai passé ma soirée chez T..., dont je vous ai déjà parlé. Nous y avons mené une conversation plus ou moins intéressante, mais fort pénible. Connaissez-vous de ces maisons où il est impossible de causer à esprit couché, où la conversation devient une série de problèmes qu'on résout à la sueur de son intellect, où les maîtres de la maison ne se doutent pas que souvent la plus délicate des attentions est de ne pas faire attention à ses convives, où il y a de la glu à chaque parole? Quel supplice! C'est un relais de poste qu'une pareille conversation, et c'est vous qui faites le cheval.
Puis, en me couchant, j'ai lu le Voyage autour de ma chambre du comte de Maistre, autre chose que je ne connaissais pas; mais ce voyage m'a fort peu plu; c'est une imitation de Sterne,—faite par un homme de beaucoup d'esprit,—et j'ai remarqué qu'en fait d'imitation, les plus spirituelles sont précisément les plus détestables, quand elles se prennent au sérieux. Un sot copie servilement; un homme d'esprit sans talent imite prétentieusement et avec effort, avec le pire de tous les efforts, avec celui de vouloir être original. Une pensée captive qui se débat, triste spectacle!
Les imitateurs de Sterne me sont surtout en horreur,—des égoïstes remplis de sensibilité, qui se mijotent, se lèchent et se plaisent, tout en se donnant des airs de simplicité et de bonhomie. (Topffer est un peu dans ce genre.)
L'expédition de mon ami Herwegh[32] a fait un fiasco complet, on a fait un massacre atroce de ces pauvres diables d'ouvriers allemands; le chef en second, Bornstedt, a été tué; pour Herwegh, on le dit de retour à Strasbourg avec sa femme. S'il vient ici, je lui conseillerai de relire le Roi Lear, surtout la scène entre le roi, Edgar et le fou, dans la forêt. Pauvre diable! il aurait dû ne pas commencer l'affaire ou se faire tuer comme l'autre...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votre mari revient-il à Paris? M. Bastide se trouve sur la liste des élus.
Mme Sitchès m'a donné de vos nouvelles. J'espère, Madame, que vous aurez la bonté de m'écrire bientôt.
A demain...
Lundi 1er mai, 11 h. du soir.
J'ai profité du beau temps qu'il a fait aujourd'hui pour aller à Ville-d'Avray, petit village au delà de Saint-Cloud. Je crois que j'y louerai une chambre. J'ai passé plus de quatre heures dans les bois—triste, ému, attentif, absorbant et absorbé. L'impression que la nature fait sur l'homme seul est étrange... Il y a dans cette impression un fonds d'amertume fraîche comme dans toutes les odeurs des champs, un peu de mélancolie sereine comme dans les chants des oiseaux. Vous comprenez ce que je veux dire, vous me comprenez bien mieux que je ne me comprends moi-même. Je ne puis voir sans émotion une branche couverte de feuilles jeunes et verdoyantes se dessiner nettement sur le ciel bleu—pourquoi? Oui, pourquoi? Est-ce à raison du contraste entre ce petit brin vivant, qui flotte au gré du moindre souffle, que je puis briser, qui doit mourir, mais qu'une sève généreuse anime et colore, et cette immensité éternelle et vide, ce ciel qui n'est bleu et rayonnant que grâce à la terre? (Car hors de notre atmosphère il fait un froid de 70 degrés et fort peu clair. La lumière se centuple au contact de la terre.) Ah! je ne puis pas souffrir le ciel,—mais la vie, la réalité, ses caprices, ses hasards, ses habitudes, sa beauté fugitive... j'adore tout cela. Je suis attaché à la glèbe, moi. Je préférerais contempler les mouvements précipités de la patte humide d'un canard, qui se gratte le derrière de la tête au bord d'une mare, ou les gouttes d'eau longues et étincelantes tombant lentement du museau d'une vache immobile qui vient de boire dans un étang, où elle est entrée jusqu'au genou—à tout ce que les chérubins (ces illustres faces volantes) peuvent apercevoir dans les cieux...
Mardi 2 mai, 9 h. 1/2 du matin.
Je me trouvais hier soir dans une disposition d'esprit philosophicopanthéistique. Voyons autre chose aujourd'hui. Je veux parler de vous, ce qui prouve... que j'ai bien plus d'esprit aujourd'hui.
Vous débutez dans les Huguenots; c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on ne vous fasse faire que des rôles dramatiques. Si vous chantiez la Somnambula?... C'est le meilleur rôle de Mlle Lind; elle y débute—eh bien, après? Je crois pouvoir répondre d'un grand succès. Vous irez l'entendre après-demain; vous m'écrirez, n'est-ce pas, l'impression qu'elle vous aura faite? Dans tous les cas, ne vous laissez pas enfermer dans la spécialité des rôles dramatiques. Les journaux disent que c'est le 6, samedi, que vous débutez, est-ce vrai? Il y aura quelqu'un ce soir-là à Paris qui sera... je ne dis pas inquiet, mais enfin... qui ne sera pas dans son assiette ordinaire. Quelle drôle d'expression, être dans son assiette, comme un mets! Et qui nous mange? les dieux? et si l'on dit de quelqu'un qu'il est inquiet, qu'il n'est pas dans son assiette ordinaire; cette inquiétude provient peut-être de la possibilité d'être mangé par un autre Dieu que le sien. Je dis des bêtises. Les hommes nous broutent, et Dieu nous mange!!!
J'ai été avant-hier soir voir Frédérick Lemaître dans Robert Macaire. La pièce est mal faite et ignoble, mais Frédérick est l'acteur le plus puissant que je connaisse. Il en est effrayant. Robert Macaire, c'est encore un Prométhée, mais le plus monstrueux de tous. Quelle insolence, quelle audace effrontée, quel aplomb cynique, quel défi à tout et quel mépris de tout! Le public est parfait de tenue: calme, froid et digne. Ma parole d'honneur, le dernier gamin jouit du talent de Frédérick en artiste, et trouve le rôle dégoûtant. Mais aussi quelle vérité accablante, quelle verve!... Mais, voyez-vous, le sens moral et le sens du beau sont deux bosses qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Heureux qui les possède toute deux.
Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je vais sortir dans une heure pour ne rentrer que fort tard dans la journée. Il faut que je me trouve une petite chambre hors Paris. Ce qui m'a empêché de me décider pour Ville-d'Avray, c'est qu'il faut traverser la Seine (pour y aller) sur un pont de bateaux et à pied,—les mariniers ayant profité de la Révolution de Février pour détruire le pont du chemin de fer—et cela prend beaucoup de temps.
Je tâcherai de me faufiler dans les tribunes de l'Assemblée nationale le jour de l'ouverture. Si j'y réussis, je vous promets la description la plus fidèle. De votre côté, Madame, quand vous serez bien casée, vous me décrirez votre maison et votre salon. Faites cela, s'il vous plaît, pojalouïsta[33].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et maintenant, Madame, permettez-moi de vous serrer la main.
Mille amitiés à Mme Garcia, à votre mari, Mlle Antonia et Louise. Leben Sie wohl.
Ihr ergebener Freund.
IV. TOURGUENEFF.
Relation exacte de ce que j'ai vu dans la journée de lundi 15 mai (1848).
Je sortis de chez moi à midi.—La physionomie des boulevards ne présentait rien d'extraordinaire; cependant, sur la place de la Madeleine se trouvaient déjà deux à trois cents ouvriers avec des bannières.
La chaleur était étouffante. On parlait avec animation dans les groupes. Bientôt, je vis un vieillard d'une soixantaine d'années grimper sur une chaise, dans l'angle gauche de la place, et prononcer un discours en faveur de la Pologne. Je m'approchai; ce qu'il disait était fort violent et fort plat; cependant, on l'applaudit beaucoup. J'entendis dire près de moi que c'était l'abbé Chatel.
Quelques instants plus tard, je vis arriver de la place de la Concorde le général Courtois monté sur son cheval blanc (à la La Fayette); il s'avança dans la direction des boulevards en saluant la foule et se prit tout à coup à parler avec véhémence et force gestes; je ne pus entendre ce qu'il dit. Il retourna ensuite par où il était venu.
Bientôt parut la procession; elle marchait sur seize hommes de front, drapeaux en tête; une trentaine d'officiers de la garde nationale de tous grades escortaient la pétition. Un homme à longue barbe (que je sus plus tard être Huber) s'avançait en cabriolet.
Je vis la procession se dérouler lentement devant moi (je m'étais placé sur les marches de la Madeleine) et se diriger vers l'Assemblée nationale... Je ne cessai de la suivre du regard. La tête de la colonne s'arrêta un instant devant le pont de la Concorde, puis arriva jusqu'à la grille. De temps à autre, un grand cri s'élevait: Vive la Pologne! cri bien plus lugubre à entendre que celui de: Vive la République! l'o remplaçant l'i.
Bientôt on put voir des gens en blouse monter précipitamment les marches du palais de l'Assemblée; on dit autour de moi que c'étaient les délégués qu'on faisait introduire. Cependant, je me rappelai, que, peu de jours auparavant, l'Assemblée avait décrété ne pas recevoir les pétitionnaires à la barre, comme le faisait la Convention; et quoique parfaitement édifié sur la faiblesse et l'irrésolution de nos nouveaux législateurs, je trouvai cela un peu extraordinaire.
Je descendis de mon perchoir et marchai le long de la procession, qui s'était arrêtée jusqu'à la grille de la Chambre. Toute la place de la Concorde était encombrée de monde. J'entendis dire autour de moi que l'Assemblée recevait en ce moment les délégués, et que toute la procession allait défiler devant elle. Sur les marches du péristyle se tenaient une centaine de gardes mobiles, sans baïonnettes au bout des fusils.
Écrasé par la chaleur, j'entrai un moment aux Champs-Élysées; puis je revins à la maison, avec l'intention de prendre Herwegh. Ne l'ayant pas trouvé, je retournai sur la place de la Concorde; il pouvait être trois heures. Il y avait toujours un monde fou sur la place; mais la procession avait disparu; on en voyait seulement la queue et les dernières bannières de l'autre côté du pont. J'avais à peine dépassé l'obélisque que je vis venir en courant un homme sans chapeau, en habit noir, l'angoisse sur la figure, qui criait aux personnes qu'il rencontrait: «Mes amis, mes amis, l'Assemblée est envahie, venez à notre secours; je suis un représentant du peuple!»
Je m'avançai aussi vite que je pus jusqu'au pont, que je trouvai barré par un détachement de gardes mobiles. Une confusion incroyable se répandit tout à coup dans la foule. Beaucoup s'en allaient; les uns affirmaient que l'Assemblée était dissoute, d'autres le niaient; enfin, un brouhaha inimaginable.
Et cependant les dehors de l'Assemblée ne présentaient rien d'extraordinaire; les gardes la gardaient, comme si rien ne s'était passé. Un instant, nous entendîmes battre le rappel, puis tout se tut. (Nous sûmes plus tard que c'était le président lui-même qui avait ordonné de cesser de battre le rappel, par prudence, ou par lâcheté.)
Deux grandes heures se passèrent ainsi! Personne ne savait rien de positif, mais l'insurrection paraissait avoir réussi.
Je parvins à faire une trouée dans la haie des gardes du pont et je me plaçais sur le parapet. Je vis une masse de monde, mais sans bannières, courir le long des quais, de l'autre côté de la Seine...
—Ils vont à l'Hôtel de Ville! s'écria quelqu'un près de moi; c'est encore comme au 24 février.
Je redescendis avec l'intention d'aller à l'Hôtel de Ville... Mais dans ce moment nous entendîmes tout à coup un roulement prolongé de tambour, et un bataillon de la garde mobile apparut du côté de la Madeleine et vint fondre au pas de charge sur nous. Mais comme, à l'exception d'une poignée d'hommes dont l'un était armé d'un pistolet, personne ne leur fit résistance, il s'arrêtèrent devant le pont, après avoir conduit les émeutiers au poste.
Cependant, même alors, rien ne paraissait décidé; je dirai plus: la contenance de ces gardes mobiles était passablement indécise. Pendant une heure au moins avant leur arrivée et un quart d'heure après, tout le monde croyait au triomphe de l'insurrection; on n'entendait que les mots: «C'est fini!» prononcés d'une façon joyeuse ou triste, suivant la façon de penser de ceux qui les prononçaient.
Le commandant du bataillon, homme d'une figure éminemment française, joviale et résolue, fit à ses soldats un petit discours terminé par ces mots: «Les Français seront toujours Français. Vive la République!» Cela ne le compromettait pas.
J'ai oublié de vous dire que, pendant ces deux heures d'angoisse et d'attente dont je vous ai parlé, nous avions vu une légion de gardes nationaux s'enfoncer lentement dans l'avenue des Champs-Élysées et traverser la Seine sur le pont qui se trouve vis-à-vis des Invalides. Ce fut cette légion qui prit les émeutiers par derrière et les délogea de l'Assemblée.
Cependant le bataillon de gardes mobiles, venu de la Madeleine, avait été reçu par les bourgeois avec des transports de joie... Les cris de: «Vive l'Assemblée nationale» recommencèrent avec une nouvelle force. Tout à coup, le bruit se répandit que les représentants étaient rentrés dans la salle. Ce fut un changement à vue. Le rappel éclata de toutes parts; les gardes mobiles (mobiles en effet!) mirent leurs bonnets sur les pointes de leurs baïonnettes (ce qui, par parenthèse, produisit un effet prodigieux) et crièrent: «Vive l'Assemblée nationale!» Un lieutenant-colonel de la garde nationale accourut haletant, rassembla une centaine de personnes autour de lui et nous raconta ce qui s'est passé;
«L'Assemblée est plus forte que jamais! s'écria-t-il. Nous avons écrasé les misérables... Oh! messieurs, j'ai vu des horreurs... des députés insultés, battus!...»
Dix minutes plus tard, tous les abords de l'Assemblée furent encombrés de troupes; des canons arrivaient lourdement au grand trot des chevaux; des troupes de ligne, des lanciers... L'ordre, le bourgeois, avait triomphé, avec raison, cette fois.
Je restai encore sur la place jusqu'à six heures... Je venais d'apprendre qu'à l'Hôtel de Ville aussi le gouvernement avait remporté la victoire... Je ne dînai ce jour-là qu'à sept heures.
De toute la foule de choses qui me frappèrent, je n'en citerai que trois: ce fut en premier lieu l'ordre extérieur qui ne cessa de régner autour de la Chambre; ces joujoux de carton, appelés soldats, gardèrent l'insurrection aussi scrupuleusement que possible; après l'avoir laissé passer, ils se refermèrent sur elle. Il est vrai de dire que l'Assemblée, de son côté, se montra au-dessous de tout ce qu'on pouvait en attendre; elle écouta Blanqui pérorer pendant une demi-heure, sans protester! Le président ne se couvrit pas! Pendant deux heures, les représentants ne quittèrent pas leurs sièges, et ce ne fut que quand on les en chassa qu'ils partirent. Si cette immobilité avait été celle des sénateurs romains devant les Gaulois, ça aurait été superbe; mais non, leur silence était le silence de la peur; ils siégeaient, le président présidait... Personne, M. d'Adelsward excepté, ne protestait... et Clément Thomas lui-même n'interrompit Blanqui que pour demander gravement la parole!...
Ce qui me frappa aussi, ce fut de voir la manière dont les marchands de coco et de cigares circulaient dans les rangs de la foule: avides, contents et indifférents, ils avaient l'air de pêcheurs amenant un filet bien chargé.
Troisièmement, ce qui m'étonna beaucoup moi-même, ce fut l'impossibilité dans laquelle je me trouvai de me rendre compte des sentiments du peuple dans un pareil moment; ma parole d'honneur, je ne pouvais deviner ce qu'ils désiraient, ce qu'ils redoutaient, s'ils étaient révolutionnaires ou réactionnaires, ou simplement amis de l'ordre. Ils avaient l'air d'attendre la fin de l'orage.—Et cependant je m'adressai souvent à des ouvriers en blouse... Ils attendaient... ils attendaient!... Qu'est-ce que c'est donc que l'histoire?... Providence, hasard, ironie ou fatalité?...
IV. TOURGUENEFF.
Hyères, vendredi 20 octobre 1848.
Bonjour, madame. Me voilà enfin parvenu au but de mes pérégrinations! Je suis arrivé hier après un séjour de deux jours à Toulon, où j'avais été retenu par une légère indisposition, parfaitement dissipée maintenant, et qui, du reste, n'avait absolument rien de commun avec feu ma névralgie—car j'ai lieu d'espérer qu'elle est bien morte cette fois.—J'occupe une jolie petite chambre à l'hôtel d'Europe, donnant sur une terrasse d'où j'ai une vue magnifique: une large plaine verdoyante, toute couverte d'orangers, d'oliviers, de figuiers et de mûriers (je suis vraiment bien fâché de toutes ces terminaisons en iers), parmi lesquels s'élèvent de temps en temps les éventails, ou plutôt les plumeaux étranges des palmiers. Cette plaine, que bordent à droite et à gauche d'assez hautes collines, se termine par un bras de mer au delà duquel s'étendent et bleuissent à la façon de Capri les îles d'Hyères. Une rangée de pins à parasol court le long du rivage. Tout cela serait charmant, si ce n'était la pluie qui ne cesse de tomber depuis quatre jours, et qui dans ce moment même enveloppe toute cette belle plaine d'un brouillard uniforme, terne et gris.
Je compte rester ici une dizaine de jours. J'espère que cette pluie ne durera pas éternellement—ou si elle dure, ma foi, je travaillerai à faire trembler.
Je vous ai envoyé ma dernière lettre de Marseille, le jour de mon départ pour Toulon—il faut que je vous raconte ce que j'ai fait depuis. Pas grand'chose.... Voyons cependant.
Je suis arrivé à Toulon de grand matin, après un voyage de nuit assez désagréable, par de mauvais chemins.—Toulon est une assez jolie ville, pas trop sale, ce qui veut beaucoup dire en France.—Il faisait un temps assez extravagant, de grosses nuées chargées de pluie passaient lourdement sur la ville, en laissant échapper de véritables torrents d'eau, qui, vu l'absence de vent, tombait presque perpendiculairement; puis une fois la bourrasque passée, un vigoureux soleil, radieux et gai, venait frapper les maisons et les rues ruisselantes.
Toulon est entouré de hautes montagnes d'un gris jaunâtre; rien n'était charmant comme de les voir sortir peu à peu à la lumière, à travers les derniers brouillards de l'ondée qui s'en allait. Je m'embarquai dans un petit bateau à voile et je fis une tournée dans la rade qui est fort belle et spacieuse. Nous passâmes devant la frégate le Muiron, qui ramena Napoléon d'Égypte et qu'on garde soigneusement dans le port; il y avait une vingtaine de vaisseaux de guerre dans la rade.—Pendant les cinq quarts d'heure que dura mon excursion, il survint deux ou trois ondées, toujours sans vent; le jeu de couleurs qui se faisait avant, pendant et après, sur la mer, était quelque chose de magnifique. Elle prenait tantôt une teinte d'encre de Chine nacrée avec des reflets bleuâtres, puis elle devenait d'un bleu vert sombre ou bleu clair avec de petites paillettes d'or; à droite, elle était d'un blanc laiteux; à gauche, près des rochers, d'un gris noir, avec des franges d'écume... et tout cela changeait, se déplaçait à chaque instant, selon qu'on tournait la tête ou que les nuages passaient.
Je rentrai enfin et je m'acheminai vers l'Arsenal, avec l'intention de voir les forçats; mais aussitôt que je déclinai ma qualité d'étranger, et surtout de Russe, on me refusa rigoureusement l'entrée.—Il était venu, à ce qu'il paraît, de nouveaux ordres, très sévères. Là-dessus, je m'en fus à mon hôtel et m'apprêtais déjà à partir pour Hyères, quand je fus pris d'une espèce d'attaque nerveuse à l'estomac, qui me força de rester.—J'envoyai chercher un médecin qui m'administra des calmants, m'ordonna le repos, et, vingt-quatre heures plus tard, c'est-à-dire hier à quatre heures, je partais, parfaitement rétabli, frais et dispos, pour Hyères, où j'arrivais juste à temps pour me mettre à table avec un Anglais roux, horriblement gêné dans ses mouvements par une cravate en crinoline de deux pieds de hauteur, un vieux monsieur phtisique à la figure repoussante—un bouc avec des yeux de perroquet—et un vieux capitaine de chasseurs d'Afrique, un bon diable, qui ne demanderait cependant pas mieux que de manger les socialistes tout crus, vu la grande habitude qu'il en a contractée avec les Bédouins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comment allez-vous? Que faites-vous? Comment vous portez-vous? Bien, n'est-ce pas?... Je dîne chez vous dimanche 5; voulez-vous accepter cette invitation?—C'est convenu, le 5, dans votre petit salon chinois, vous aurez un convive de plus à table. Je demande pour ce jour-là une charlotte russe.
La pluie semble vouloir cesser; mais le ciel est encore tout gris d'un bout à l'autre, sans la moindre petite échappée de lumière. Aujourd'hui, après mon excursion à la poste, je suis entré à l'église, qui est très ancienne et très bien conservée. L'intérieur en est triste et sombre; la lumière y pénètre à peine à travers les vitraux coloriés—il n'y en a pas un qui soit blanc. Au moment où j'entrais, tous les prêtres (il y en avait plusieurs en grand costume de deuil) s'apprêtaient a chanter le Requiem devant un cercueil recouvert d'un drap noir et entouré de cierges jaunes; une centaine de personnes se tenaient immobiles sur les chaises. Les prêtres et les enfants de chœur se mirent à psalmodier d'une voix criarde et fausse... Décidément, je préfère le grand air, le bûcher et les jeux des anciens.
A propos d'anciens, je me propose d'aller l'un de ces jours sur une des îles avec l'Odyssée et d'y rester un temps indéfini......
J'ai encore une comédie sur le tapis, que je veux finir avant de quitter Hyères. Il faut cependant que je vous en traduise une dans le courant de l'hiver.—C'est que j'ai un peu peur de vous, savez-vous? N'importe, il le faudra.
Eh bien? et Jeanne la Folle, la donne-t-on enfin? Je ne vois pas la moindre petite annonce dans les journaux. Aurez-vous déjà eu quelques «glimpses» de la musique du Prophète à l'époque de mon retour? C'est ce que nous verrons. Et maintenant donnez-moi votre main, que je la serre bien fort, bien fort; que Dieu vous bénisse un million de fois.
Mille amitiés à tous les vôtres. Que fait Viardot? Se porte-il bien? A revoir donc—à table—le 5.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Versailles, mercredi 10 janvier 1849.
Bonjour, Madame, comment vous portez-vous? Bien, n'est-ce pas? Eh bien! je ne vais pas mal non plus. Le bon Müller, avec lequel j'ai passé presque toute la journée d'hier, a dû vous le dire.
Il y doit y avoir dans l'air de Paris quelque chose de désagréable à mes nerfs. Le scélérat de Paris! Je l'aime, cependant. Je vous avoue que je m'ennuie un peu à Versailles—mais j'y tiendrai bon, je traduis, je lis Saint-Simon, je me promène, je vais au café lire les journaux—et déjà les habitués, vieux bourgeois caducs, qui le premier jour me regardaient en dessous et de côté, comme le font d'habitude les sangliers acculés dans les tableaux de chasse—commencent à me soulever leurs chapeaux. Je les vois faire leur interminable partie de domino entrecoupée aux mêmes endroits par les mêmes plaisanteries—à un sou le cent!—et je me demande ce que c'est que la vie, dirait M. Victor Hugo. Non, je ne demande rien, je regarde ces «plantes bulbeuses», et leur air de tranquillité inaltérable et simplement bête m'inspire une espèce d'ennui résigné—c'est aussi du chloroforme, cela... qu'on vienne m'extraire une molaire!
Vous attendez-vous à ce que je vous dise quelque chose de Versailles? oui? Eh bien, vous serez attrapée. Vous connaissez mon culte de l'imprévu, et ici je ne saurais dire que des choses usées jusqu'à la corde et que tout le monde a entendues et répétées mille fois. Du reste, avec les mots suivants, que je vais vous écrire: grandeur, solitude, silence, statues blanches, arbres nus, fontaines glacées, grands souvenirs, longues avenues désertes—avec ces mots que vous remuerez comme les pierres d'un kaléidoscope—avec votre imagination et votre esprit (oh, oh!) vous serez parfaitement en état de vous dire à vous-même tout ce que j'aurais pu vous écrire, et mille millions de fois mieux encore (j'ai hâte d'ajouter ces dernières paroles, car sans cela ma phrase devenait d'une fatuité à faire trembler), si vous ne préférez pas vous occuper d'autre chose, ce que je ne puis m'empêcher de vous conseiller.
J'ai cependant été chez H. Vernet; son tableau est faible et froid.
J'ai fait la connaissance de deux chiens, l'un communicatif, gai, étourdi, peu ou point d'éducation, spirituel, railleur et quelque peu mauvais sujet, au mieux avec tout le monde et, pour dire le vrai, sans véritable dignité; l'autre doux, rêveur, paresseux et gourmand, nourri des lectures de Lamartine, insinuant et dédaigneux en même temps. Ils fréquentent le même café que moi. Le premier appartient (si un chien peut appartenir!!!) à un petit chirurgien d'armée très maigre, très laid et très revêche; le second a pour maîtresse la dame du comptoir, vieille petite femme, édentée à force d'être bonne.—Il y en a qui vous font cet effet-là.—J'ai invité le premier à venir me voir, mais il prétend que son maître lui donnerait le fouet; je n'ai pu lui opposer de bonne raison et me suis contenté de lui donner un morceau de sucre qu'il a croqué à l'instant même en remuant sa queue avec politesse et vivacité.
Sur ce, je baise vos belles mains et reste à tout jamais
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Paris, dimanche soir, juin 1849.
Bonsoir, Madame. Comment vous portez-vous à Courtavenel? Je vous donne en mille de deviner ce à quoi.... Mais je suis bon de vous le donner en mille—car vous l'avez déjà deviné à la vue de ce morceau de papier de musique. Oui, Madame, c'est moi qui ai composé ce que vous voyez—musique et paroles, ma parole! Ce que cela m'a coûté de peine, de sueur au front, d'agonie mentale, se refuse à la description. J'ai trouvé l'air assez vite—vous comprenez: l'inspiration!—mais ensuite le trouver sur le piano—et puis l'écrire.... J'en ai déchiré quatre ou cinq brouillons; et même maintenant je ne suis pas sûr de ne pas avoir écrit quelque chose de monstrueusement impossible. En quel ton est-ce, s'il vous plaît? J'ai dû rassembler à grand'peine tout ce qui a surnagé de bribes musicales dans ma mémoire, je vous assure; la tête m'en fait mal; quel travail! Enfin cela vous fera rire peut-être pendant deux minutes.
Du reste, je me porte bien mieux que je ne chante;—je vais sortir demain pour la première fois. Voyons, arrangez à cela une basse comme pour les notes que j'écrivais au hasard. Si votre frère Manuel m'avait vu à l'ouvrage—cela l'aurait fait penser aux vers qu'il composait sur le pont de Courtavenel en faisant des ronds de jambe convulsifs et en agitant ses bras d'une manière gracieuse et arrondie. Saperlotte! c'est aussi difficile que ça de composer de la musique? Meyerbeer est un grand homme!!!
Lundi.
A mon réveil, j'ai trouvé votre lettre et ne suis plus en train de plaisanter. Quel malheur! Quand on pense ce qu'il y a de mauvaises choses inutiles dans le monde—le choléra, la grêle, les rois, les soldats, etc., etc.! Dieu serait-il un misanthrope?
A propos de choléra, il poursuit ses ravages avec fureur; tantôt c'était le chaud qui le favorisait, maintenant c'est le froid qui le développe. Il s'accommode de tous les régimes, ce gaillard-là.—Pour moi, je sens sa griffe se retirer, mais lentement; on m'avait permis de sortir aujourd'hui,—ne voilà-t-il pas qu'il me survient une espèce de fluxion à la joue! De par tous les diables,—où ai-je pu prendre du froid,—moi qui ne sors pas de ma chambre? Je me vois obligé de la garder encore aujourd'hui.
Le désastre survenu à Courtavenel me rappelle une scène pénible dont j'ai été témoin en Russie. Toute une famille de paysans était sortie en chariot pour aller faire la récolte d'un champ à eux, situé à quelques verstes de leur village; et ne voilà-t-il pas qu'une grêle épouvantable vient détruire de fond en comble tous les épis! Ce champ si beau n'était qu'une mare de boue. Je vins à passer par là; ils étaient tous silencieusement assis autour de leur téléga; les femmes pleuraient; le père, tête nue et la poitrine découverte, ne disait rien. Je m'approchai d'eux, je tâchai de les consoler, mais à mon premier mot, le paysan se laissa lentement tomber la face sur la terre et de ses deux mains ramena sa chemise de grosse toile grise sur la tête. Ça a été le dernier geste de Socrate mourant: dernière et muette protestation de l'homme contre la cruauté de ses semblables ou la brutale indifférence de la nature. C'est qu'elle l'est: elle est indifférente; il n'y a de l'âme qu'en nous et peut-être un peu autour de nous... c'est un faible rayonnement que la vieille nuit cherche éternellement à engloutir. Cela n'empêche pas cette scélérate de nature d'être admirablement belle; et le rossignol peut nous causer de charmantes extases, pendant qu'un malheureux insecte à demi broyé se meurt douloureusement dans son gésier. Sagre-gorgon, que c'est noir!—je crois que j'ai été trop éloquent,—mais ça ne fait rien.
Voyons, que faut-il vous dire encore avant de finir? Ah! que je suis fort reconnaissant à Mme Sitchès de l'intérêt qu'elle me témoigne et que je ne suis pas un ingrat, que je serai fort content de la revoir jeudi, si faire se peut. Car partir avant ce jour-là—, il ne faut pas y penser. Du reste, je vous prie de dire de ma part mille amitiés à tout le monde, et à M. Maurice Sand entre autres, s'il le veut bien et s'il ne m'a pas oublié.
Portez-vous bien, amusez-vous, et que Dieu vous bénisse.
A propos, j'ai trouvé trois sujets; il est vrai qu'ils sont tous très mauvais, mais en persévérant je trouverai quelque chose peut-être.
A revoir, après-demain. En attendant, je vous serre les mains bien amicalement.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, mercredi.
Voici, Madame, votre second bulletin.
Tout le monde se porte parfaitement; l'air de la Brie est décidément fort sain. Il est onze heures et demie du matin; nous attendons avec impatience le facteur, qui va, je l'espère, nous donner de bonnes nouvelles.
La journée d'hier a été moins uniforme que celle d'avant-hier. Nous avons fait une grande promenade, et puis le soir, pendant que nous jouions au whist, il est survenu un grand événement. Voici ce que c'était: un gros rat s'était introduit dans la cuisine, et Véronique, dont il avait dévoré la veille le chausson (quel animal vorace! passe encore si c'était celui de Müller), avait eu l'adresse de boucher le trou qui lui servait de retraite avec deux grosses pierres et un torchon. Elle accourt; elle nous announce la grande nouvelle. Nous nous levons tous, nous nous armons de bâtons et nous entrons dans la cuisine. Le malheureux s'était réfugié sous l'armoire du coin; on l'en chasse,—il sort. Véronique lui lance un coup sans l'atteindre; il rentre sous l'armoire et disparaît. On cherche, on cherche dans tous les coins,—pas de rat. On se donne inutilement au diable—enfin, Véronique s'avise d'ouvrir un tout petit tiroir... une grande queue grise s'agite rapidement dans l'air,—le rusé coquin s'était fourré là!—Il descend comme l'éclair,—on veut le frapper,—il disparaît de nouveau. Cette fois-ci, on recherche pendant une demi-heure,—rien! Et remarquez qu'il n'y a que très peu de meubles dans la cuisine. De guerre lasse, nous nous retirons,—nous nous remettons au whist.—Voilà que Véronique entre en portant le cadavre de son ennemi avec des pincettes.—Imaginez-vous où il s'était caché! Il y avait sur une table dans la cuisine une chaise et sur cette chaise une robe de Véronique,—il s'était glissé dans une des manches.—Notez que j'ai remué cette robe quatre ou cinq fois pendant nos recherches. N'admirez-vous pas la présence d'esprit, le rapide coup d'œil, l'énergie du caractère de cette petite bête? Un homme, dans un pareil péril, aurait cent fois perdu la tête. Véronique allait sortir et abandonner la partie quand, par malheur, une des manches de sa robe remua imperceptiblement... le pauvre rat avait mérité de «sauver sa viande».
Ce dernier mot me rappelle que je viens de lire dans le National une fâcheuse nouvelle: il paraît qu'on a arrêté plusieurs démocrates allemands.—Müller serait-il du nombre?—J'ai peur aussi pour Herzen[34]. Donnez-m'en des nouvelles, je vous prie.—La réaction est tout enivrée de sa victoire et va maintenant se montrer dans tout son cynisme.
Le temps est très doux aujourd'hui, mais en juin on désirerait autre chose qu'un ciel laiteux et un petit vent dont on ne sait pas s'il n'est pas trop frais. Vous nous ramènerez les beaux jours.—Nous ne vous attendons pas avant samedi.
Nous y sommes résignés.... Une petite note de la direction dans le journal ne nous laisse pas d'illusions là-dessus.—Patience! mais que nous serons heureux de vous revoir!...
Je vais laisser un peu de place pour Louise, ainsi que pour les autres. (Suivent les lettres de Louise et de Berthe.)
P. S.—Nous venons de recevoir enfin la lettre (trois heures et demie). Dieu merci, tout allait bien mardi.—Au nom du ciel, soignez-vous.—Mille amitiés à vous et aux autres.
Tausend Grüsse.
Jhr IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, 19 juin 1849.
Bonjour, Madame; comment vous portez-vous?—Tous les habitants de Courtavenel se portent bien et vous saluent. Ils m'ont chargé de vous rendre compte de la journée d'hier. Le voici, ce compte:
Après votre départ, tout le monde est allé se coucher, et on a dormi jusqu'à dix heures; puis on s'est levé, on a assez silencieusement déjeuné, on a joué au billard sans se dépêcher, puis on s'est mis à l'ouvrage: Mlle Berthe avec Louise, M. Sitchès avec le journal, Mme Sitchès je ne sais où, et moi dans le petit cabinet, où je me suis mis à réfléchir sur le sujet en question. J'ai réfléchi une heure, puis j'ai lu de l'espagnol, puis j'ai écrit une demi-page du sujet, puis je suis allé dans le grand salon, où j'ai vu avec étonnement qu'il n'était que deux heures. Alors, j'ai travaillé trois quarts d'heure avec Louise, qui commence à oublier un peu son allemand, mais qui a très peu de fautes d'orthographe dans la dictée; ensuite, je suis allé me promener seul, et, à mon retour, toute la compagnie (et moi avec) est allée se promener jusqu'au dîner, qui a eu lieu à cinq heures. Après le dîner, le temps, qui jusque-là semblait traîner la patte comme une perdrix blessée, m'a paru moins long; il est vrai que j'ai dormi jusqu'à neuf heures, grâce à la fatigue que mes deux promenades m'avaient causée. A neuf heures, on nous a apporté du thé—ou plutôt du vulnéraire suisse de Razay, que nous avons bu en assaisonnant cette frugale collation par une petite conversation honnête et modérée sur des sujets parfaitement connus et fort peu intéressants. Berquin et Marmontel, ou tout autre auteur de livres moraux et instructifs, auraient été édifiés, j'en suis sûr, en voyant notre maintien modeste et plein de bon goût, notre déférence l'un pour l'autre, qu'un léger assoupissement ne rendait que plus agréable. Enfin, après avoir joui pendant près d'une heure de la société de nos semblables, plaisir pour lequel on prétend que l'homme est né, nous nous levâmes, nous nous acheminâmes vers la salle à manger, nous prîmes nos luminaires, nous nous souhaitâmes une bonne nuit et nous nous couchâmes dans nos lits, où nous dormîmes sur-le-champ.
Ce matin, il fait un temps très bon, très doux; j'ai fait une assez grande promenade avant le déjeuner, et je vous écris maintenant entre le déjeuner et le billard, de crainte que le facteur ne vienne plus tôt qu'à l'ordinaire. Nous l'attendrons demain avec plus d'impatience.
Je vous serre la main très fort, bien fort. Mille amitiés à Viardot et aux autres amis...
Une heure.—Le facteur n'est pas venu encore, j'ajoute quelques paroles. Il fait un temps charmant, et Courtavenel est bien joli, bien aimable aujourd'hui. J'ai passé toute la matinée dans le parc. Que faites-vous dans cet instant? C'est une question que nous nous faisons tous les quarts d'heure... Tout le monde se porte aujourd'hui encore mieux qu'hier. Encore une fois bon jour, portez-vous bien, et à revoir.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, jeudi 19 juin 1849, 8 h. 1/2 du soir.
Madame,
Les joncs ont vécu! vos fossés sont propres, et l'humanité respire. Mais ça n'a pas été sans peine. Nous avons travaillé comme des nègres pendant deux jours—et j'ai le droit de dire nous; car j'en sais aussi quelque chose. Si vous m'aviez vu, hier surtout, crotté, mouillé, mais radieux! Les joncs étaient très longs et très difficiles à arracher, d'autant plus difficiles qu'ils étaient plus cassants. Enfin, la chose est faite!
Depuis trois jours, je suis seul à Courtavenel; eh bien! je vous jure que je ne m'y ennuie pas. Le matin, je travaille beaucoup, je vous prie de le croire, et je vous en fournirai la preuve.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A propos, entre nous soit dit, votre nouveau jardinier est un peu paresseux; il avait presque laissé périr les lauriers-roses faute de les arroser, et les plates-bandes étaient dans un mauvais état; je ne lui ai rien dit, mais je me suis mis à arroser les fleurs moi-même et à arracher les mauvaises herbes. Cet appel muet, mais éloquent, a été compris, et depuis quelques jours tout est rentré dans l'ordre. Il parle avec trop de volubilité et il sourit trop; mais sa femme est une bonne petite femme qui ne fait pas la paresseuse. Ne trouvez-vous pas cette dernière phrase d'une outrecuidance inouïe dans la bouche d'un grandissime paresseux comme moi?
Vous n'avez pas oublié le petit coq blanc? Eh bien, c'est, un démon que ce coq. Il se bat avec tout le monde, avec moi surtout; je lui présente un gant, il s'élance, s'y accroche et se laisse porter comme un bouledogue. Mais j'ai remarqué que chaque fois, après le combat, il s'approche de la porte de la salle à manger et crie comme un forcené jusqu'à ce qu'on lui ait donné à manger. Ce que je prenais pour du courage en lui, ne serait-ce que l'impertinence d'un farceur qui sait bien qu'on plaisante et qui se fait payer sa peine? Oh! illusions! voilà comme on vous perd... Monsieur de Lamartine, venez me chanter ça.
Ces détails de basse-cour et de campagne doivent vous faire sourire, vous qui vous trouvez à la veille de chanter le Prophète à Londres... Cela doit vous sembler bien idyllique, bien jatte de lait... Et cependant je m'imagine que vous aurez assez de plaisir à lire ces détails.—Voyez quel aplomb!
Ainsi décidément vous allez chanter le Prophète, et c'est vous qui faites tout, qui dirigez tout... N'allez pas vous fatiguer outre mesure. Au nom du ciel, que je sache d'avance le jour de la première représentation... Ce soir-là, on ne se couchera pas avant minuit à Courtavenel. Je vous l'avoue, je m'attends à un très, très, très grand succès.—Que Dieu vous protège, vous bénisse et vous conserve une excellente santé.—Voilà tout ce que je lui demande; le reste est votre affaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comme, après tout, j'ai beaucoup de temps disponible à Courtavenel, j'en profite pour faire des bêtises, parfaitement ineptes. Je vous assure, de temps en temps, cela m'est nécessaire; sans cette soupape de sûreté, je risquerais un beau jour de devenir très bête pour tout de bon.
Par exemple, j'ai composé hier soir de la musique sur les paroles suivantes:
| Un jour une chaste bergère |
| Vit dans un fertile verger, |
| Assis sur la verte fougère, |
| Un jeune et pudique étranger. |
| Timide, ainsi qu'une gazelle, |
| Elle allait fuir quand, tout à coup, |
| Aux yeux effrayés de la belle |
| S'offre un épouvantable loup. |
| A l'aspect de sa dent qui grince, |
| La bergère se trouva mal. |
| Alors, pour la sauver, le prince |
| Se fit manger par l'animal. |
Proposez au célèbre auteur de l'Offrande de composer de son côté de la musique là-dessus. J'enverrai la mienne, et nous verrons qui l'emportera, vous serez juge.
A propos, je vous demande pardon de vous écrire de pareilles stupidités.
Vendredi 20, 10 h. du soir.
Bonsoir, Madame, que faites-vous à cette heure? Je suis assis devant la table ronde du grand salon.... Le plus profond silence règne dans la maison; on n'entend que le chuchotement de la lampe.
J'ai vraiment très bien travaillé aujourd'hui; j'ai été surpris par une pluie d'orage pendant ma promenade.
Dites à Viardot qu'il y a beaucoup de cailles cette année.
Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Jean sur le Prophète. Il m'a dit des choses très judicieuses, entre autres que «la théorie est la meilleure des pratiques». Si l'on disait cela à Müller, c'est pour le coup qu'il rejetterait sa tête de côté et en arrière, en ouvrant la bouche et levant les sourcils. Le jour de mon départ de Paris, ce pauvre diable n'avait que deux francs cinquante; je ne pouvais rien lui donner, malheureusement.
Écoutez, j'ai beau ne pas avoir den politischen Pathos, mais il y a une chose qui me révolte: c'est l'ambassade du général Lamoricière au quartier général de l'empereur Nicolas[35]. C'est trop, c'est trop, je vous assure. Pauvres Hongrois! Un honnête homme finira par ne plus savoir où vivre: les nations jeunes sont encore barbares, comme mes chers compatriotes, ou bien, si elles se lèvent et veulent marcher, on les écrase comme les Hongrois; et les nations vieilles se meurent et empestent, pourries et gangrenées qu'elles sont. Ce serait le cas de chanter avec Roger: «Et Dieu ne tonne pas sur ces têtes impies?» Mais baste! Et puis, qui est-ce qui a dit que l'homme est destiné à être libre? L'histoire nous prouve le contraire. Ce n'est pas par esprit de courtisanerie que Gœthe a écrit son fameux vers:
Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.
C'est tout bonnement un fait, une vérité qu'il énonçait en observateur exact de la nature qu'il était.
A demain.
Ce qui n'empêche pas que vous soyez quelque chose de bien excellent.... Voyez-vous, s'il n'y avait pas encore par-ci par-là des êtres comme vous sur la terre, on se vomirait soi-même... A demain.
Samedi 21.
Bonjour, Madame, et adieu. Il fait un vilain temps, voilà tout ce qu'il y a de nouveau. Je vous serre les mains très fort. Mille amitiés à Viardot et à tout le monde. A revoir.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, samedi 4 juillet 1849.
Bonjour, Madame. Je n'ai reçu qu'aujourd'hui la lettre que vous m'avez écrite mardi; je ne sais à quoi attribuer ce retard. Vous ne me dites pas si le Prophète marche maintenant avec plus d'ensemble, mais je crois que cela s'entend de soi-même. Vous verrez que vous irez à quinze représentations. Les offres (ou plutôt c'est mieux que des offres) de Liverpool sont très belles; ces Anglais ne se refusent rien. Je continue à ne pas recevoir signe de vie de chez moi; du reste, je me porte bien et suis fort content de mon sort. Le temps a été assez beau tous ces jours-ci.
J'ai reçu avant-hier la visite du docteur Fougeux. Nous avons fait une partie de billard, je l'ai promené en bateau. Je rame mieux que lui, qui cependant se vante d'avoir été dans son temps le meilleur canotier de Bercy. Il a dû l'oublier depuis ce temps-là, car je suis loin d'être fort. A propos de bateau, il faut que je vous dise que malheureusement l'eau décroît beaucoup dans les fossés; elle fuit plus que jamais du côté de la fontaine, malgré la terre glaise dont on avait cru boucher le conduit. Il faudrait refaire la bonde, ce qui ne serait déjà pas si difficile, en l'entourant de pierres en forme de digue. Il faut aussi que je vous dise que les fossés n'ont pas été curés du tout; il y a énormément de vase au fond. Le père Négros me disait l'autre jour, en montrant le poing à un être imaginaire: «Ah! si l'on me volait comme on vole M. Viardot!» Il doit en savoir quelque chose. Du reste, les riches sont là pour être volés. Mais c'est que vous n'êtes pas encore riche pour pouvoir l'être en conscience. Je crains bien qu'à votre retour il ne soit plus possible de faire le tour des fossés; déjà, maintenant, il est assez difficile de passer par-dessous le pont du Diable,—c'est ainsi que j'ai surnommé le pont qui conduit à la ferme. Dans tous les cas, le grand Océan nous restera,—le côté des fossés qui longe la roule à partir de la tourelle. J'ai reconduit M. Fougeux jusqu'à Blandureau. Il m'a appris que Mlle Laure ne pouvait pas me souffrir. Il paraît que l'on se fait des ennemis sans savoir pourquoi. Le docteur m'a invité de venir demain déjeuner chez lui.
Lundi.
J'ai déjeuné hier chez M. Fougeux. Il y avait M. Magi, que vous connaissez, qui m'a semblé un bon diable, bien tranquille; un docteur de Paris, dans le genre de M*** de Pétersbourg, et le frère de Fougeux; il m'a fait penser à un autre frère, auquel il ressemble beaucoup. Fougeux nous a fait boire de vingt vins différents; vers la fin du déjeuner tout le monde parlait à la fois avec beaucoup de chaleur et avec cette espèce de fièvre de répéter des choses parfaitement insignifiantes, qui s'empare d'une réunion de personnes se connaissant peu et se convenant encore moins, dont le vin a échauffé la tête. Chacun secoue son sac à lieux communs, ce qui produit beaucoup de poussière. Puis nous allâmes faire le tour des boulevards de Rozay; eh, eh! Rozay n'est pas déjà si laid! Le gros Fougeux est décidément un bon garçon, et puis il ne se prend pas au sérieux, ce qui est toujours fort agréable. Les gens qui se prennent au sérieux peuvent devenir de grands politiques,—de grands hommes, si vous voulez,—mais leur société est aussi lourde à supporter, Gœthe l'a dit: Ver sich selbst nicht zum Besten haben kann, gehört gewiss nicht zum Besten. Il y a une rivière à Rozay, cela m'a fort surpris. Je croyais qu'en Brie il n'y avait que des mares avec des joncs, mais sans eau.
Voici ce que j'ai lu depuis que je suis à Courtavenel:
1º Les deux volumes du Manuel d'histoire, de M. Ott. Ce M. Ott est un démocrate de l'école de M. Bucbez,—un démocrate catholique,—Cette alliance hors nature ne peut produire que des monstres;
2º Une histoire russe, de M. Oustrialoff. Comment diable cette histoire-là se trouve-t-elle à Courtavenel? C'est détestable, mais cela m'a rafraîchi la mémoire sur beaucoup de dates et de faits;
3º L'Histoire du moyen âge, de Rotteck. Indiciblement mauvais. Libéralisme éventé, nauséabond et faux. Style emphatique et plat. Des gens de cette espèce finissent par devenir des membres de la droite d'un parlement de Francfort. Je ne dis pas cela pour Rotteck,—il est mort,—heureusement! Mais une foule de gens ejusdem farinæ lui ont malheureusement survécu;
4º Les Lettres de Lady Montague (écrites en 1717). Livre charmant, plein de grâce, d'esprit et de franchise, et qui fait aimer celle qui l'a écrit, malgré son extraction;
5º Doña Isabel de Solis, novela historica, de D. Martinez de la Rosa. J'ai lu ceci pour m'exercer dans la langue espagnole. Mais j'en demande pardon à vos compatriotes, si toute leur littérature contemporaine est de cette force-là... C'est enfantin. Il n'y a que les extraits des chroniques qui soient intéressants;
6º Histoire de la guerre en Espagne depuis 1807, par le général Sarrazin. C'est écrit avec clarté, mais la haine que ce Français porte aux Français est un peu trop violente pour être naturelle. Le général S... me fait tout l'effet d'un gredin;
7º Mémoires de Bausset, sur Napoléon. C'est l'ouvrage d'un valet de chambre distingué,—si un valet de chambre peut l'être.—Des faits intéressants;
8º Traduction des Géorgiques de Virgile, par Delille. Je ne sais plus si c'était M. Martin ou M. Nisard qui l'avait louée en ma présence. Je n'ai pu l'achever; c'est vraiment trop fade, et puis ces alexandrins coulent avec une facilité dégoûtante; c'est fluide et insipide comme de l'eau. L'original n'est pas une merveille non plus; toute cette littérature latine est factice et froide, une vraie littérature de littérateur;
9º La Pucelle, de Voltaire! Eh bien! savez-vous qu'en général c'est très ennuyeux, surtout la partie qui est censée ne pas devoir l'être. Mais de charmants mots, des allusions hardies et spirituelles, des railleries sanglantes révêlent le maître;
10º Un gros ouvrage de M. Damas Hinard sur Napoléon. Une compilation de tous ses jugements sur les événements, les personnes, les choses. Quelle grande et forte organisation que ce Napoléon, quelle force de caractère, quelle suite et quelle unité dans la volonté! Et en même temps jamais homme n'appartint plus au passé. Il le résume complètement, mais il tourne le dos à l'avenir, à cet avenir qui se débattra longtemps sous les chaînes qu'il lui a forgées. La monarchie se mourait en Europe: il a organisé l'autorité, le gouvernement, ce hideux fantôme, qui, impuissant à produire, vide et bête avec le mot Ordre à la bouche, une épée dans une main et de l'or dans l'autre, nous écrase tous sous ses pieds de fer. Saperlotte! quelle image orientale! Excellente transition pour arriver au
11º Coran. Je viens de le commencer. Il y a de la grandeur et du bon sens dans ce livre; mais je prévois que la boursouflure orientale et le vague de la langue prophétique m'en dégoûteront bientôt.
Vous voyez qu'après tout je n'ai pas perdu mon temps; car tous ces livres susnommés, je les ai, non pas parcourus, mais lus, ce qui s'appelle lus. A propos de livres, il faut que Viardot sache que je lui ai arrangé sa bibliothèque, que es un primor. De son côté, Jean[36] ne fait que frotter, laver, nettoyer, huiler, épousseter, balayer et cirer du matin au soir. Ah! si le jardinier lui ressemblait!
Mardi.
Vous ignorez probablement, mais vous le saurez quand je vous le dirai, que je ne me couche jamais avant minuit. Eh bien! hier, j'allais quitter le salon, quand j'ai tout à coup entendu deux profonds soupirs bien distincts qui ont retenti, ou plutôt passé comme un souffle à deux pas de moi. Sultan[37] était couché depuis longtemps, j'étais parfaitement seul. Cela m'a donné une légère horripilation. En traversant le corridor, je me suis demandé ce que j'aurais fait si j'avais senti une main tout à coup saisir la mienne: et j'ai dû m'avouer que j'aurais poussé un cri d'aigle. On est décidément moins brave la nuit que le jour. Je voudrais savoir si les aveugles ont peur des revenants. Avant de me coucher, je fais chaque soir une petite promenade dans la cour. Hier je me suis placé sur le pont et j'ai écouté. Voilà les différents sons que j'ai entendus:
Le bruit du sang dans les oreilles et de la respiration.
Le frôlement, le chuchotement continuel des feuilles.
Le cri des cigales; il y en avait quatre dans les arbres de la cour.
Des poissons venaient faire à la surface de l'eau un petit bruit, qui ressemblait à un baiser.
De temps en temps une goutte tombait avec un petit son argentin.
Une branche se cassait; qui l'avait cassée?
Ce bruit sourd... sont-ce des pas sur la route? Est-ce le murmure d'une voix?
Et puis tout à coup le soprano suraigu d'un cousin, qui vient vous tinter à l'oreille...
A propos de cousins, les rougets me dévorent cette année. Depuis quelques jours j'en suis plein, et je me gratte à haute voix.
A propos, ou non, au contraire... cela ne fait rien. Il faut que je vous dise qu'ayant trouvé sous le tapis vert du piano votre gros livre de musique, je me suis permis de l'ouvrir et de le parcourir. Malheureusement ma main droite ne joue pas assez bien du piano pour pouvoir me donner, ne fût-ce qu'une idée de la mélodie; cependant j'ai tâché de déchiffrer certains morceaux que vous ne nous avez jamais chantés. Autant que je puis en juger, vous avez été distinguée de tous temps; mais ce que vous faisiez auparavant était bien moins franc.—P. e. je trouve la première phrase de l'Hirondelle et Le prisonnier charmante: «Hirondelle gentille, qui voltige à la grille du cachot noir, vole, vole sans crainte, autour de cette enceinte.» C'est très bien jusqu'ici; mais «j'aime à te voir»..... ça me reste dans le gosier comme un os; j'ai beau le chanter en voix de poitrine, en voix de fausset, en fermant les yeux et en inclinant un peu la tête sur l'épaule, comme on fait quand on veut juger avec impartialité: impossible! Il y a surtout cet ut qui me désole. J'ai même essayé de le remplacer: impossible, toujours aussi impossible! Et le commencement de la phrase est si joli! C'est égal, je préfère la Luciole, ou Marie et Julie, ou la nuit et le jour. De qui sont les paroles intitulées Songes? Il y a là trois vers qui me plaisent bien:
| Où languissante et blessée |
| On voit dans l'onde glacée |
| Tomber la biche aux abois. |
Je ne sais pourquoi, mais il me semble voir les grands arbres bruns, la terre couverte de givre, les feuilles mortes jonchant l'allée, et la surface du petit étang immobile, la biche qui tombe sur le bord et les chiens qui arrivent de loin et dont les aboiements retentissent joyeusement dans l'air clair et sec.—Allez-vous composer, cette année-ci? J'ai essayé deux ou trois fois de faire des paroles, mais, hélas! mon Pégase n'est plus qu'un vieux cheval couronné qui ne peut faire un pas. L'autre jour, je vois un corbeau gris dans les champs; l'aspect de ce compatriote m'émeut; je lui ôte mon chapeau et lui demande des nouvelles de mon pays. En vérité, j'étais presque touché. Tiens, me dis-je, faisons une jolie petite pièce de vers là-dessus. Quelque chose de simple, de gracieux; enfin faisons du Béranger, quoi! Je me suis battu les flancs pendant deux heures sans pouvoir seulement rimer deux vers. Enfin le désespoir m'a pris, et voici ce dont je suis accouché:
| Corbeau, corbeau, |
| Tu n'es pas beau, |
| Mais tu viens de mon pays: |
| Eh bien! retourne-z-y. |
Je doute fort que vous mettiez cela en musique.
En fouillant dans les cahiers de musique, j'ai trouvé deux cahiers où il n'y en avait point: c'étaient des poésies russes copiées par vous et le commencement d'une grammaire. Ça m'a semblé bien drôle tout de même. Seriez-vous encore en état de lire ce que vous y avez écrit? C'est à Vienne, n'est-ce pas, avec M. Sollogoub[38], que vous vous êtes occupée de cela?
Vy ponimaïetié po Rousski? ili oujé pozabyli[39]?
Voyons: qu'est-ce que c'est que cela?
Je bavarde aujourd'hui comme une pie restée vieille fille.... A propos, savez-vous que j'ai lu dans les lettres de lady Montague qu'en Turquie une jeune fille, morte fille, est censée se trouver dans un état de réprobation, la femme étant sur terre pour faire des petits? Voyez-vous, le bon et le mauvais, c'est comme l'Orient et l'Occident: ce qui est à l'Orient ici est à l'Occident plus loin: c'est selon le point où l'on se trouve.
Ainsi donc Mlle Antonia[40] est devenue depuis hier Mme Léonard[41]. Ah! vous ne pourrez plus la faire manger à table plus qu'elle ne l'aurait voulu! Je ne pouvais m'empêcher de rire sous cape quand je vous voyais prendre un air grave pour lui faire avaler le reste d'une côtelette: Mme Pauline Viardot: «Antonita, vamos...»—Mme Garcia (avec beaucoup de précipitation et d'énergie): «Come, come, tu no comes nada.»—M. Sitchès[42] (en secouant un peu la tête): «Es menester comer, hija.»—Mlle Antonia (avec vivacité): «Sea por el amor de Dios, padre.»—Mais je babille trop. A demain.
Mercredi soir.
Imaginez-vous ce qui m'arrive! J'avais l'intention ce matin d'achever cette quatrième page et de vous envoyer la lettre (d'autant plus qu'il y a une semaine que je vous ai écrit pour la dernière fois). Voilà tout à coup qu'on annonce le frère de M. Fougeux, qui vient s'installer ici jusqu'à cinq heures! Et moi, stupide, au lieu d'envoyer tout bonnement cette lettre inachevée (elle n'est déjà pas mal longue), je n'en fais rien, je remets à demain. Cette quatrième page m'a retenu; pourquoi? je ne le saurais dire. Enfin, je vous en demande pardon, et pour vous prouver la sincérité de mon repentir, je m'engage à écrire une feuille de plus! Mais grand maladroit que je suis! je deviens stupide, ma parole d'honneur! Comme si c'était une tâche pour moi que de vous écrire... Allons, allons, je patauge, je m'embrouille, qu'on me jette à la porte et qu'il n'en soit plus question... Mais je rentre par la fenêtre et je continue.
Je commence par vous remercier mille fois pour votre charmante lettre; je l'ai lue et relue. Je vous avoue que je n'aurais pas été fâché de vous voir faire Fidès en Italien; mais quand on est gueux comme Job, on ne peut pas penser à des excursions en Angleterre!
Ah! M. Louis Blanc... mais c'est un charmant homme, et je vais relire ses livres. Fidès est donc allée aux nues.... Tant mieux, tant mieux. J'en suis bien content, parole d'honneur.... Attendez, je vais me lever et faire une cabriole en signe de réjouissance. Voilà qui est fait.
Vous avez la bonté de me demander des nouvelles de ma santé; je me porte à merveille et je prie Dieu de veiller sur vous! Oh! oui, soyez bien portante, soyez heureuse, gaie, contente, admirée, aimée, célèbre: je sais bien que vous êtes tout cela, mais cela ne m'empêche pas de me donner le plaisir de vous le souhaiter...
Attendez: je vous ai énuméré tous les ouvrages que j'ai lus; mais vous me demanderez peut-être si je n'ai fait que lire. Madame, j'ai fait une comédie en un acte[43]; Madame je vous jure par les mânes de mes ancêtres, qui étaient probablement laids comme des boucs et puants comme des singes, que j'ai écrit, copié et expédié une comédie en un acte, une comédie de cinquante pages! Et la traduction? direz-vous[44]. Ah! voilà. Imaginez-vous qu'en partant pour Courtavenel, au lieu du cahier qui renferme ma première comédie, j'en emporte un autre. Ça a été même, je l'avoue, la seconde raison de mon voyage à Paris. Je voulais rapporter le bon cahier. Mais, à mon grand étonnement, j'appris, rue Laffitte, nº 11, que Mme Sitchès avait emporté les clefs de son appartement à Bruxelles, à telles enseignes que je dus me promener tout le jour, mon chapeau gris sur la tête, ce qui faisait sourire les passants qui me prenaient pour un rapin vieux et gras. N'ayant pas de cahier, je ne puis faire de traduction; mais dans cinq ou six jours—après le retour de Mme Sitchès,—j'irai à Paris pour vingt-quatre heures et je rapporterai le cahier. Je serais allé à Paris rien que pour cela, mais j'ai encore autre chose à y faire.
Et mon argent qu'on s'obstine à ne pas m'envoyer!
Pour en revenir à M. Fougeux frère, il faut avouer que jamais personne ne m'a scié le dos comme lui; il a fini par me réciter par cœur des fragments de Rousseau et de La Bruyère. «Monsieur, me disait-il, remarquez cette phrase: Un trône était indigne d'elle»; et il la répétait quarante fois. «Voilà une idée; on sait à quoi s'en tenir. Voilà une idée enfin. Voilà une idée.» Je finissais par lui achever ses phrases; mais il les reprenait. Pourquoi se donne-t-on tant de peine d'être bête? C'est vrai: je crois que personne n'est bête naturellement. Mais à force d'art, on parvient à tout. J'ai vu le moment où il allait rester dîner. C'est que je dîne, savez-vous? Comment? je n'en sais rien. Mais je dîne, et très bien. J'espère bien le savoir un jour, quand j'aurai de l'argent. Dites-moi: votre costume de Fidès (je ne parle pas du premier) est le même qu'à Paris, n'est-ce pas?
Vous avez raison dans ce que vous dites à propos de votre buste; cependant un sculpteur de talent pourrait en faire une belle chose. Si l'on fait des lithographies ou des gravures des Fidès à Londres, rapportez-les. Je serais bien content de recevoir une lettre de Chorley[45]. Et vous êtes bien bonne de me dire ce que vous me dites.
Jeudi.
Il a fait un orage cette nuit avec de grands coups de tonnerre; le feuillage des arbres est encore tout troublé, pour parler à la Chénier; l'air est rafraîchi et extrêmement doux. Je m'attends à recevoir aujourd'hui une lettre de M. et Mme Sitchès qui m'annonce leur arrivée. Courtavenel n'a jamais été aussi propre, grâce aux soins paternels de Jean. Il paraît que Mlle Berthe[46] va venir aussi.
Un levreau d'une assez jolie taille s'est noyé avant-hier dans les fossés. Comment et pourquoi? C'est ce qu'on ne saurait dire. Se serait-il suicidé! Cependant, à son âge, on croit encore au bonheur. Du reste, il paraît qu'on a vu des exemples d'animaux se suicidant. Il paraît qu'un chien s'est noyé exprès en Angleterre,—mais en Angleterre cela se conçoit. Je ne devrais pas médire de ce pays-là, après tout; je crois qu'on vous y aime. Le nom de Mme Jameson ne m'est pas inconnu; je crois qu'elle fait des romans historiques. Ne trouvez-vous pas que la remarque suivante, faite par lady Montague, en 1717, à Paris, est encore juste maintenant:
«Very commonly the entrance of a gentleman or a lady into a room is accompanied with a grin, which is designed to express complacence and social pleasure, but really shews nothing mare than a certain contortion of muscles that must make a stranger laugh. The French grin is equally remots from the chearful serenity of a smile and thu cordial mirth of an honest English horse-laugh.»
On peut remarquer la même chose quand deux personnes se quittent ou s'abordent dans la rue; le changement subit de la contenance me frappe toujours. Du reste tout le monde le fait (les Anglais exceptés), moi tout le premier. Or, voyez ce que peut l'influence de l'homme! Le chien, qui est l'animal qu'il a le plus corrompu, a fini par imiter ces contorsions affectées et ridicules; je suis persuadé que la manière dont ces animaux s'abordent n'est pas dans leur nature; c'est le fruit de la civilisation. Mais les imitateurs ayant la rage d'outrer toujours, au lieu de sourire en montrant les dents et clignant les yeux, eux... Je n'ai pas besoin d'achever: rappelez-vous le dessin hardi de votre frère.
A propos de votre frère, dites-lui que je lui serre la main bien fortement. Dites lui surtout qu'il faut-être de bonne humeur, ne fût-ce que pour la santé, quitte à briser quelque meuble de temps en temps. Sait-il déjà speak english? Et l'allemand? Il l'a probablement abandonné! Sans cela, je lui dirais que ce n'est pas pour rien qu'on dit Gold verdienen; car verdienen vient de dienen[47].
Je fais tous les jours une grande promenade avant dîner, accompagné de Sultan. Je crains bien que cette année, il n'y ait moins de gibier que les années précédentes. Les grandes pluies du mois de juin ont fait beaucoup de tort aux couvées. Je trouve souvent des couples de perdrix sans petits. Savez-vous que les perdrix jouent très bien la comédie? Elles savent très bien feindre d'être blessées, de pouvoir voler à peine, elles crient, elles piaillent, le tout pour attirer le chien après elles et le détourner de l'endroit où se trouvent les petits. L'amour maternel a failli coûter bien cher avant-hier à l'une d'elles: elle a si bien jouée son rôle que Sultan l'a happée. Mais comme c'est un perfect gentleman, il n'a fait que l'humecter de sa salive et lui ôter quelques plumes; j'ai rendu la liberté à cette mère courageuse et trop bonne actrice. Ce que c'est cependant que le théâtre. Voilà un acteur qui m'émeut, qui me fait verser des larmes: il se met à pleurer lui-même, et me fait rire peut-être. Et cependant, s'il ne fait que jouer, que feindre, je ne crois pas qu'il puisse m'émouvoir complètement; il faut, à ce qu'il paraît, un certain mélange de nature et d'art.... Vous devez le savoir. Eh bien, non, vous ne le savez pas, ou du moins vous ne sauriez l'expliquer, malgré que vous soyez «the subtlest tragedian of the world.» Décidément on ne fait très bien que ce dont on ne peut se rendre entièrement compte; c'est pour cela qu'il vous arrive de courir après vous-même. En poussant cette maxime jusqu'au paradoxe, on peut dire que pour bien faire quelque chose, il ne faut pas le savoir.
Le facteur est venu, et pas de lettre de Paris. Ce sera alors pour demain. Sur ce, je vous salue tous tant que vous êtes, à commencer par Viardot. Que Dieu vous bénisse et veille sur vous. Je vous serre bien cordialement la main. A revoir.
Votre tout dévoué
IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, jeudi matin, 12 juillet 1849.
Me voilà donc à Courtavenel, sous votre toit! Nous sommes arrivés ici hier soir, par un temps superbe. Le ciel était d'une sérénité admirable.
Les feuilles des arbres avaient un éclat à la fois métallique et huileux, la luzerne paraissait frisée sous les rayons obliques et rouges du soleil. Il y avait une foule d'hirondelles au-dessous de l'église de Rozay; elles se posaient à chaque instant sur les ferrures de la croix, en ayant soin de tourner leur poitrine blanche du côté de la lumière.
J'espérais une lettre et je regardais le long de la rue si le facteur ne m'en apportait pas une. Mais il n'y avait que le journal d'arrivé.
Courtavenel me paraît assez endormi; l'herbe avait poussé sur les petits chemins de la cour; l'air dans les chambres était très enroué (je vous assure) et de mauvaise humeur; nous le réveillâmes. J'ouvris les fenêtres, je frappai les murailles comme je vous le vis faire une fois; j'apaisai Cuirassier[48], qui, selon son habitude, s'élançait sur nous avec la férocité d'une hyène, et, quand nous nous mîmes à table, la maison avait déjà repris son air bienveillant et hospitalier. Ce matin, le parc est aussi riant que jamais, et les joncs dans le fossé se balancent aussi agréablement que toujours, sans se douter que dans peu de temps, ils vont être impitoyablement arrachés et leur cendre livrée au vent. Le messager a déjà reçu les ordres concernant le bateau. Ainsi me voilà donc de nouveau à Courtavenel, et dès après-demain j'y vais rester tout seul avec Véronique[49]. Si j'allais l'épouser, pour la récompenser de ses services, vu que toute autre monnaie n'est pour moi qu'une chimère à l'heure qu'il est!
Je veux travailler, je vous jure que je veux travailler. Aujourd'hui nous allons, avec M. Sitchès, pêcher des tanches à Maisonfleurs[50]. Nous nous assiérons à l'ombre du grand chêne, et naturellement nous penserons beaucoup à vous. Que faites-vous en cet instant? Probablement vous vous préparez à chanter. J'attends, nous attendons une lettre aujourd'hui; nous sommes tous bien impatients de savoir quelque chose de définitif sur le Prophète. Mais, voyons, n'admirez-vous pas la belle et grande feuille de papier que je prends pour vous écrire? Hein? M'avez-vous jamais écrit sur du papier pareil? Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens un extérieur de rodomont... et, au fond, je suis un bien petit garçon; j'ai la queue entre les jambes et je suis assis très mesquinement et très piètrement sur le derrière, comme un chien qui sent qu'on se moque de lui et qui regarde vaguement de côté en clignant des yeux comme s'il y avait du soleil; ou plutôt je suis un peu triste et un peu mélancolique, mais cela ne fait rien, je suis tout de même bien content d'être à Courtavenel, le papier vert saule de ma chambre me réjouit la vue, et je suis tout de même bien content. Mais je reprendrai ma lettre plus tard.
Cinq heures.
Nous revenons de la pêche avec cinquante tanches. Nous avons reçu votre petit billet. Cette fatigue se dissipera bientôt... Mais comment? serait-il possible qu'on ne donnât pas le Prophète? Je vous avoue que cela me chagrinerait, non pour l'argent que vous perdriez, mais parce que cela aurait l'air d'une reculade devant le succès de Mlle Sontag... Enfin, nous verrons. Portez-vous bien, voilà, le principal. Je ne suis pas en train d'écrire; nous allons dîner; il fait un temps très charmant. A demain.
Vendredi, neuf heures du matin.
Voilà ce que c'est que de remettre. Le facteur est venu si tôt aujourd'hui qu'il m'a surpris dans mon lit. Je vous écris ces mots à la hâte. Les nouvelles que vous donnez sont loin d'être bonnes. Enfin, tous mes vœux vous accompagnent. Le bateau sera ici après-demain. J'envoie ci-joint un papier pour Viardot. Je me remettrai à écrire ce soir, à l'instant même une lettre immense; aussi pourquoi le facteur est-il venu si tôt? Au nom du ciel, soignez votre chère santé! Courtavenel est charmant, nous allons le tenir dans l'état le plus coquet du monde. Je vais travailler comme un nègre; vous aurez la traduction.
Au revoir, je salue tout le monde et je reste à jamais
Votre tout dévoué
IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, samedi 14 juillet 1849.
Bonjour, Madame, und liebe Freundin.
Il fait toujours un temps splendide. Nous nous portons tous très bien et nous pensons beaucoup à vous; voici tout ce qu'il y a de nouveau à Courtavenel. Ce que vous nous dites du Prophète nous a fait beaucoup réfléchir... Nous nous sommes entretenus là-dessus avec beaucoup de gravité. Pour ma part, je suis persuadé qu'on vous le fera chanter une douzaine de fois, et que vous ne reviendrez pas si tôt que vous le dites; je vous jure que je le désire de tout mon cœur; vous êtes capable de ne pas y croire, mais je vous l'assure. Il faut que vous fassiez courir les Anglais; il faut qu'ils vous applaudissent à tout rompre, qu'ils disent de leur voix de gorge: She is wonderful; quite extraordinary. Oh yes, oh yes! Tout cela est nécessaire, et quand vous viendrez à Courtavenel, après tous vos triomphes, vous jouirez doublement et du beau temps et de la propretés de vos fossés, et du bateau, et de la fameuse traduction que vous savez... Voilà ce que j'appelle parler le langage de la raison.
Merci pour votre charmante description de la Linda. Il faut, voyez-vous, que vous enfonciez aussi cette étoile rétrospective, cette renommée de conserve; je ne l'ai jamais entendue cependant.
Hier, après souper, il y a eu une discussion politique des plus fougueuses entre Don Pablo[51] et sa femme... Elle attaquait Espartero[52], lui le défendait assez mal, il faut l'avouer, plutôt par des Que sabes tu! et Calla, majadera, que par des raisons solides... Mais la petite femme était terrible... Savez-vous que c'est un grand enfant gâté que votre oncle? Ils ont l'intention de partir après demain, et je vais rester seul.
C'est drôle, seul à Courtavenel, dans cette grande maison... Nous attendons Jean demain.
Tous ces jours-ci le temps a été très beau, mais il a fait un grand vent qui, de temps à autre, devenait très fort et très persistant. L'agitation qu'il produisait dans les feuilles allait très bien aux peupliers; ils étincelaient très fièrement au soleil. Il faut vous dire que j'ai remarqué une chose: c'est que le peuplier immobile a l'air très écolier et très bête, à moins que ce ne soit le soir, sur le fond rose du ciel, quand les feuilles paraissent presque noires... mais, dans ce cas-là, tout doit se tenir coi, il n'y a que les feuilles au sommet des arbres qui ont la permission de se remuer un peu.
A propos, je me suis amusé à découvrir dans les environs des arbres ayant de la physionomie, de l'individualité, et je leur ai donné des noms; à votre retour je pourrai vous les montrer, si vous le désirez. Il y a le marronnier de la cour, que j'ai surnommé Hermann, je lui cherche sa Dorothée. Il y a un bouleau à Maisonfleurs, qui ressemble beaucoup à Gretchen; un chêne a été baptisé Homère, un orme l'aimable vaurien, un autre la vertu effarouchée, un saule Mme Vanderborght.
Lundi 16.
Nous nous attendions à recevoir des lettres aujourd'hui, mais non. Cela nous fait croire que les répétitions ont probablement commencé, et que vous ne voulez pas nous écrire avant qu'il y ait quoique chose de définitif. Votre santé est parfaitement et entièrement rétablie, n'est-ce pas?
M. et Mme Sitchès ne partent que demain. Jean est arrivé hier soir avec Comorn[53]. Ce matin, nous nous sommes levés tous à trois heures et demie pour aller pêcher. Nous avons pris à nous 118 poissons. M. Sitchès 80, moi 38. Nous avons vu le soleil se lever derrière le bois. On peut ne pas être vertueux et trouver du plaisir à voir un lever de soleil. Il y eut un moment charmant: nous étions placés près du chêne à gauche; je lève les yeux, il était éclairé par en dessous, le soleil était encore bien bas. C'était très joli et très original. Cela n'a duré qu'un instant... En général, je trouve que les arbres éclairés ont quelque chose de fantastique et de mystérieux qui parle à l'imagination. C'est pourquoi j'aime beaucoup les illuminations dans un jardin.... Mais, assez parler d'arbres comme cela.
Le bateau est arrivé! Il est moins élégant que je ne l'avais cru; mais il n'est pas mal. Je viens de m'exercer à ramer pendant, deux heures... je commence à m'y faire. Il faut, comme pour nager, des mouvements réguliers et pas violents... J'ai fait faire à M. et Mme Sitchès cinq fois le tour des fossés; puis j'ai promené Sultan, qui n'a pas paru prendre un grand plaisir à ce genre d'amusement. Du reste, il se porte bien, il est gros et gras. Véronique ne peut le voir sans lui dire qu'il est un voleur, un grand voleur, mais il ne fait pas semblant de la comprendre. J'aime beaucoup à la mettre sur ce chapitre pendant qu'il est là. On voit très bien à sa figure, à sa manière modeste de s'asseoir, de détourner à demi la tête et d'agiter imperceptiblement la queue, sans qu'on l'appelle, qu'il sait parfaitement de quoi il s'agit...—«Voyez-vous, monsieur», me dit Véronique en s'animant beaucoup, «voyez-vous l'air de sainte nitouche qu'il se donne? Eh bien! ce chien est un voleur, un très grand voleur, et on a beau le lui dire, il n'en rougit même pas (textuel); il est rusé, ce chien, ah! je crois bien.» Alors je m'adresse à Sultan et je lui répète ce propos de Véronique, mais c'est à peine s'il secoue les oreilles.—«Vous perdez votre peine, monsieur», continue Véronique, «ce chien n'a pas de conscience.» Pendant mes promenades, je le fais entrer dans les luzernes; avant-hier, il a pris une perdrix sur son nid. Sans lui faire de mal, je la lui ai reprise et l'ai lâchée. Toutes les autres bêles de la maison, les singes, les oiseaux le chat, se portent à merveille.
Et demain la grande extermination des joncs. Demain je reste seul avec Véronique et Jean. Jean m'aidera dans la grande œuvre de destruction. A demain!
Mardi 17.
M. et Mme Sitchès sont partis ce matin pour Paris. Mais la croisade contre les joncs est remise à demain, à la demande de Jean, qui avait beaucoup à faire aujourd'hui. Me voici donc seul; eh bien, je ne vais pas m'ennuyer, j'en suis sûr. Je vais beaucoup travailler, ah! mais beaucoup. Par exemple, aujourd'hui je n'ai rien fait, j'ai flâné tout le jour... mais demain! J'espère bien recevoir une lettre demain.
Mercredi 18.
Eh bien, non, il n'y a pas de lettres... Pourquoi?... Et je ne reçois pas de journaux anglais. J'ai été trop gueux pour pouvoir m'abonner. Patience! il faut espérer que tout va bien. Le facteur attend, il est encore venu une heure trop tôt; je dois terminer cette lettre. Mille amitiés à Viardot, à Manuel[54], à tout le monde.
Je vous serre les mains avec beaucoup d'affection, et que le ciel veille sur vous.
Soyez heureuse et portez-vous bien. Adieu.
IV. TOURGUENEFF.
Courtavenel, samedi, 28 juillet 49.
Bonsoir, Madame, guten Abend, theuerste Freundin.
Dix heures et demie du soir.—J'inscris ces mots avec une certaine fierté. Vous voyez qu'on ne se couche pas avec les poules. Je viens de faire un tour de parc. Il fait une belle nuit, une quantité incroyable d'étoiles. Les grandes, celles dont la lumière est bleue, et qui ont l'air de cligner des yeux, font bien autour de la cime des peupliers tandis que la lune regarde à travers les branches noires...
A l'heure qu'il est vous chantez, car j'imagine qu'on va donner le Prophète trois fois par semaine; vous verrez que votre succès ne fera que croître et embellir comme à Paris. J'espère que vos collaborateurs se tiennent mieux maintenant.
Pour revenir à mes étoiles, vous savez qu'il n'y a rien de plus commun que de les voir inspirer des sentiments religieux; du moins c'est ce qu'on trouve dans tous les livres d'éducation. Eh bien! je vous assure que ce n'est pas là l'effet qu'elles produisent sur quelqu'un qui les regarde simplement et sans parti pris. Les milliers de mondes, jetés à profusion dans les profondeurs les plus reculées de l'espace, ne sont autre chose que l'expansion infinie de la vie, de cette vie qui occupe tout, pénètre partout, fait germer sans but et sans nécessité tout un monde de plantes et d'insectes dans une goutte d'eau. C'est le produit d'un mouvement irrésistible, involontaire, instinctif, qui ne peut pas faire autrement; ce n'est pas une œuvre réfléchie. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Ah! je n'en sais rien, mais je sais que, pour le moment, elle est tout, elle est en pleine floraison, en vigueur; je ne sais si cela durera longtemps, mais enfin pour le moment cela est, cela fait couler mon sang dans mes veines sans que j'y sois pour quelque chose, et cela fait surgir les étoiles comme des boutons sur la peau, sans qu'il lui en coûte davantage, ou sans qu'elle en ait un plus grand mérite. Cette chose indifférente, impérieuse, vorace, égoïste, envahissante, c'est la vie, la nature, c'est Dieu; nommez-la comme vous voulez, mais ne l'adorez pas: entendons-nous, quand elle est belle, quand elle est bonne (ce qui n'arrive pas toujours)—adorez-la pour sa beauté, pour sa bonté, mais ne l'adorez pas, ni pour sa grandeur, ni pour sa gloire! (Voyez les livres d'éducation, dont je parlais ci-dessus). Car, 1º il n'y a rien de grand ni de petit pour elle; 2º il n'y a pas plus de gloire dans la création qu'il n'y a de gloire dans une pierre qui tombe, dans l'eau qui coule, dans un estomac qui digère; tout cela ne peut pas faire autrement que de suivre la LOI de son existence qui est la VIE.
Ouf! voilà de la philosophie spéculative! Je ne veux pas relire mon griffonnage. Secouons-nous et passons à autre chose. Mais j'y pense, je continuerai demain. En attendant, que Dieu vous bénisse, ou que la Vie vous soit propice; mais dans tous les cas, que vous soyez heureuse et bien portante.
Dimanche soir.
Il a fait aujourd'hui un temps superbe. J'ai passé presque toute la journée dehors; j'ai navigué sur les fossés. A propos! vous serez peut-être étonnée que j'aie pu faire un voyage à Paris, vu l'état de ma bourse; mais c'est que Mme Sitchès, en partant, m'a laissé trente francs, dont vingt-six ont filé. Du reste, je vis ici comme dans un château enchanté; on me nourrit, on me blanchit, que faut-il de plus pour un homme seul?
J'espère que cette disette d'argent va bientôt cesser et qu'on finira par se dire là-bas: Ah ça! mais avec quoi vit-il donc?
J'ai vraiment beaucoup travaillé ces jours-ci. Je vous montrerai les feuilles à votre retour. Je ne m'ennuie pas un seul instant; décidément je mène une vie très agréable.
Lundi.
Aujourd'hui, par exemple, elle l'est un peu moins... Figurez-vous qu'il n'a pas cessé de pleuvoir un seul instant pendant tout le jour. Hein! qu'en dites-vous? Cela descendait, cela descendait, dru et droit, serré, et même maintenant. Il est onze heures du soir. Oui, Madame, onze heures! j'entends la gouttière vomir des torrents dans le fossé. Mais, par compensation, j'ai reçu aujourd'hui de Paris le Musical World et le Britannia, où j'ai trouvé des articles sur le Prophète, que j'ai dégustés avec beaucoup de plaisir. Si vous m'envoyez un Illustrated sous bande, envoyez-moi donc aussi le numéro de l'Athenæum. (A propos, mille choses à Chorley.)
Bonne nuit, je vais me coucher.
Mardi, 31 juillet.
Voilà ce maudit facteur qui s'avise de nouveau de venir à huit heures et demie du matin! Que le diable l'emporte! Je voudrais cependant achever vite cette page. Voyons! que vous dire? Qu'il ne pleut pas, que je pense bien souvent à vous; que Courtavenel a maintenant l'air bien gracieux et bien propre, que Jean frotte, nettoie, lave et balaye partout, que toutes les bêtes de la maison se portent bien, y compris votre très humble serviteur, que je m'attends à une lettre demain, que je vous souhaite santé, bonheur et gaieté, que je prie le Dieu bon de vous bénir mille fois et vous de me pardonner une lettre aussi incohérente, que je salue très amicalement Viardot et les amis, et que je reste à tout, jamais
Votre
TOURGUENEFF.
Courtavenel, samedi 11 août 1849.
Bonjour, Madame. Eh bien, je continue à rester seul à Courtavenel et je viens de recevoir une lettre de Melle Berthe, dans laquelle elle me dit qu'elle attend de jour en jour l'arrivée de M. et Mme Sitchès. J'espère que Mme Garcia va venir ici; que ferait-elle toute seule à Bruxelles?
Dimanche.
Depuis hier je suis mère, je connais les joies de la maternité, j'ai une famille! Trois charmants petits jumeaux, doux, caressants, gentils, que je nourris moi-même et que je soigne avec un véritable plaisir. Ce sont trois petits levrauts que j'ai achetés à un paysan. Pour les avoir, j'ai donné mon dernier franc! Vous ne sauriez croire comme ils sont jolis et familiers.
Ils commencent déjà à grignoter les feuilles de laitue que je leur présente, mais leur principale nourriture est du lait. Ils ont l'air si innocent et si drôle quand ils relèvent leurs petites oreilles! Je les tiens dans la cage où nous avions mis le hérisson. Ils viennent à moi dès que je leur tends les mains, ils grimpent sur moi, ils me farfouillent dans la barbe avec leurs petits museaux, ornés de longues moustaches. Et puis, ils sont si propres, tous les mouvements sont si gentils! Il y en a un surtout, le plus gros, qui a un air grave à mourir de rire. Il paraît que je suis devenu non seulement mère, mais vieille femme, car je rabâche. Malheureusement, ils seront déjà assez grands le jour de votre arrivée; ils perdront de leur grâce. Enfin, je tâcherai qu'ils fassent honneur à mon éducation.
J'ai dîné hier chez Fougeux. Eh bien, son frère n'est pas si ennuyeux que je l'avais cru; il le devient moins quand on le connaît davantage,—ce qui est consolant. Fougeux est un très bon diable; il est né grand-père... Et il n'est pas marié! Je suis allé et revenu sur le dos de Comorn, qui a encore le pied assez sûr pour son âge. Il faisait noir dans la forêt de Blandureau. (Je suis revenu à neuf heures.)
Lundi.
J'ai fait cette nuit un rêve assez drôle, comme j'en fais quelquefois; je vais vous le raconter. Il me semblait que je marchais le long d'une route bordée de peupliers. Il faisait sombre, j'étais très fatigué, et pour arriver au gîte il fallait chanter cinq cents fois de suite: A la voix de ta mère... Je me hâtais d'en finir avec ma tâche et j'en perdais le compte; vous savez comme l'on s'obstine en rêve. Tout à coup, je vois venir à moi une grande figure blanche qui me fait signe de la suivre; je me dis: Tiens! c'est mon frère Anatole (je n'en ai jamais eu de ce nom-là). Je trouve cela tout naturel et je le suis. Quelques instants plus tard, il me semble que nous sommes exposés à un grand vent; je jette un regard autour de moi, et, malgré l'obscurité, je puis distinguer que nous nous trouvons sur la cime d'un rocher extrêmement élevé et dominant sur la mer.—Mais où allons-nous? demandai-je à mon conducteur.—Nous sommes des oiseaux, répond-il, partons.—Comment, des oiseaux? répliquai-je.—Mouchez-vous, me dit-il. En effet, je veux me moucher et je trouve un long bec au beau milieu de mon visage avec une poche au-dessous, comme chez un pélican. Mais, dans ce moment même, le vent m'enlève. Je ne saurais vous décrire le frémissement de bonheur que j'éprouvai en déployant l'envergure de mes grandes ailes; je montai contre le vent, en jetant un grand cri de triomphe, et puis je me lançai en bas vers la mer en frappant l'air par saccades, comme le font les mouettes. J'étais oiseau dans ce moment-là, je vous assure, et maintenant, à l'heure où je vous écris, je n'ai pas un souvenir plus distinct de mon dîner d'hier que de mes sensations d'oiseau: c'est parfaitement clair et net, non seulement dans la mémoire de ma cervelle, si l'on peut s'exprimer ainsi, mais dans celle de tout mon corps; ce qui prouve que «la vida es sueño, y el sueño es la vida». Mais ce que je ne saurais vous peindre, c'est le spectacle qui se déroulait autour de moi, pendant que je planais ainsi dans l'air: c'était la mer, immense, agitée, sombre, avec des points lumineux; çà et là des vaisseaux à peine visibles glissant sur les vagues; des hautes falaises; parfois un grand bruit montait jusqu'à moi; je me laissais tomber. Le mugissement devenait plus distinct et me faisait peur; je remontais dans les nuages qui me semblaient rouler avec fracas, chassés par le vent. De temps en temps, une immense gerbe d'eau toute blanche s'élançait du sein de la mer, et je sentais l'écume rejaillir sur mon visage, puis, tout à coup, de grandes lueurs s'étendaient au loin au-dessous de moi... Ah! me disais-je, ce sont les éclairs marins (!) découverts par Galilée... Ils ne vont pas si vite que les éclairs de l'air parce que l'eau est plus lourde et plus difficile à déplacer. A la lueur de ces éclairs, je voyais la mer illuminée jusqu'au fond; je voyais de gros poissons noirs avec de grosses têtes, monter lentement jusqu'à la surface... Je me disais qu'il fallait que je tombasse dessus parce que c'était ma nourriture. Mais je sentais une secrète horreur qui m'en empêchait... Et puis ils étaient trop gros. Tout à coup, je vois la mer blanchir et sautiller comme de l'eau qui bout, une teinte rose se répand autour de moi... C'est le soleil qui se lève, me, dis-je, fuyons, il va tout brûler. Mais j'avais beau me jeter de côté et d'autre, tout devenait éclatant, lumineux, insupportable aux yeux, de grosses bulles brillantes montaient dans l'air, je sentais une chaleur étouffante, mes plumes commençaient à roussir. J'aperçois le haut du disque du soleil qui occupait tout l'horizon et flamboyait comme une fournaise, une angoisse insupportable me saisit et je m'éveille. Il faisait déjà jour; je voyais devant moi le papier vert saule de ma chambre, et je ne comprenais pas encore où j'étais....
Mais est-ce permis de décrire un rêve aussi longuement que cela? Vous allez vous moquer de moi, et vous aurez raison. Il est vrai qu'il n'y a pas abondance de matières à Courtavenel.
Lundi soir.
Le frère de Fougeux est encore venu dîner aujourd'hui. Décidément, il n'est pas bête et il n'est pas non plus très ennuyeux; cependant je trouve que je le vois trop souvent. Du reste, je crois qu'il va quitter bientôt ces beaux lieux, comme dirait le pauvre M. Guy[55]. Il ne fait rien, n'a pas de profession, et malgré cela il est tout encroûté de préjugés nationaux, bonapartistes, littéraires et judiciaires. Si, du moins, il avait profité de son indépendance pour se délivrer de tout ce fatras! Mais non. Un Allemand l'aurait plutôt fait. Béranger a dit avec raison:
| Philosophe |
| De mince étoffe, |
| Ton œil ne peut se détacher |
| Du vieux coq de ton vieux clocher. |
Mardi.
Je ne reçois qu'aujourd'hui votre billet avec la lettre de M. Chorley, à laquelle je m'empresserai de répondre demain. Dites à Viardot (je lui écrirai aussi l'un de ces jours) que la chasse va être ouverte le 25. Faut-il que je fasse des démarches pour son permis de chasse? Du reste, tout va bien, et je prie le bon Dieu de vous bénir mille fois et de vous ramener saine et sauve en France.
Toujours point de nouvelles de M. et Mme Sitchès. Bonjour; portez-vous bien et soyez heureuse...
Votre,
I. TOURGUENEFF.
Courtavenel, jeudi, 16 août 49.
Bonjour, Madame: guten Morgen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Et en effet, ils sont arrivés hier soir tous les deux. Je parle de M. et Mme Sitchès. J'ai été bien content de les voir. Et puis ils avaient l'air si heureux, ils me contaient une foule de choses, les moindres détails de leur voyage, et surtout du mariage avec une volubilité si joyeuse! Ils m'ont montré le portrait de Léonard qui m'a l'air d'un bon diable. Je me suis fait raconter par eux comment ils ont revu Mlle Antonia, ce qu'ils lui ont dit, ce qu'elle leur a répondu; comment ils ont vu pour la première fois M. Léonard, ce qu'il leur a dit, ce qu'ils lui ont répondu, l'habit qu'il portait, le chapeau qu'il tenait à la main et leurs habits à eux, et puis ensuite, en s'élevant à des détails plus importants, les préparatifs du jour de noce, etc., etc., ils ont dû tout me décrire; et ils le faisaient, ils se répétaient avec délices, ils imitaient la manière de regarder, le son de voix de Léonard, et je les écoutais avec un véritable intérêt; car le bonheur est contagieux. Enfin j'espère que tout ceci continuera aussi bien que cela a commencé. Aujourd'hui le torrent est devenu ruisseau; nous parlons encore, mais la veine s'épuise.
Mlle Berthe arrive demain avec Louise. Courtavenel commence à se remplir. Je ne dînerai plus en tête à tête avec moi-même.
Vendredi.
Madame! permettez-moi de prendre un ton solennel à la hauteur des circonstances. Madame! un fléau terrible, semblable à ces plaies d'Égypte dont parle l'Écriture sainte, est venu s'abattre sur les «beaux lieux» que vous habitez, ou plutôt que vous n'habitez pas. Il ne nous a pas frappés à l'improviste, il nous avait déjà souvent menacés de ses fureurs... que dis-je? nous avions plus d'une fois éprouvé l'effet de ses coups... (c'est du Racine, cela). Mais cette fois-ci le cruel a dépassé les prévisions les plus sinistres, ébranlé les cœurs les plus fermes et répandu au loin la stupeur du désespoir. Madame! ce fléau, c'est les rougets, ou ce sont les rougets, comme vous voulez. Votre cœur sensible a dû le deviner. Madame! dans l'espace d'une heure, madame votre tante, qui, remarquez-le bien, n'était pas sortie de toute la journée, en a pris cinquante, cincuenta fünfzig fifty! sur son visage et sur son cou! Elle nous les a montrés; nous les avons comptés. Elle en prenait avec son mouchoir par deux, par trois, par cinq! Tous nos corps ne sont plus qu'une plaie comme celui d'Hippolyte.... Je me gratte avec les dix doigts jusqu'à faire ruisseler le sang. J'espère que cela ne durera pas. Ce serait trop épouvantable! Nous attendons Mlle Berthe avec impatience,—para dar á comer á los bichos, comme dit le seigneur D. Pablo,—peut-être qu'elle fera une diversion utile. Jamais cela n'a été aussi fort. Pourvu que la rage de ces animaux infernaux soit assouvie avant votre arrivée!
Le frère de M. Fougeux est décidément a bore (vous savez ce que cela veut dire en anglais) de la première classe. Il est venu me rougetter le jour de l'arrivée de votre tante. Jamais rien d'aussi lourdement suffisant, d'aussi prétentieusement vide, d'aussi solennellement niais ne s'est étalé sous la calotte des cieux. Connaissez-vous cet atroce petit sourire qui voudrait être malicieux et qui n'est que contraint, ce sourire tout saturé d'amour-propre, qui voltige si constamment sur les lèvres des sots contents d'eux-mêmes? Eh bien, ce sourire-là ne quitte pas la face blême de ce monsieur. Ce qui m'étonne dans tout cela, c'est ma bonhomie. Je fais la conversation pendant des heures à cet être-là; je l'ai cru même moins ennuyeux que je ne l'avais senti.... Et il y a des personnes qui prétendent que j'ai l'esprit tourné à la satire. Imaginez-vous qu'il a la manie de répéter de la prose par cœur. Nous parlions de descriptions.... «Monsieur», me dit-il avec son air magistral, toute description est superflue à moins qu'elle ne soit comme celle de Fénelon dans Télémaque qui dit: «La nature n'était qu'un vaste jardin.» Vaste jardin! Monsieur, vaste jardin! Voilà une idée neuve, belle, touchante, qui parle à mon âme.» Et pendant une demi-heure le monstre n'a cessé de répéter cette phrase divine, adorable, etc. Quel être insupportable! Il a dû être né dans une vieille cave humide des amours d'une vieille araignée et d'un crapaud paralytique. Je me figure le Dieu de l'Ennui sous la figure d'une araignée toute poudreuse. En un mot, que les rougets le mangent! Je ne puis faire de vœu plus cruel. Mais il paraît qu'ils sont inconnus à Rozay. Courtavenel en serait-il la patrie exclusive?
Samedi soir.
Mlle Berthe est arrivée hier avec Louison. Louise a très bonne mine, et Mlle Berthe n'a pas non plus l'air très maladif. La petite nous a montré ses prix et son ruban vert. Je lui trouve les manières un peu «je m'en fiche pas mal», mais cela se fera, car c'est une bonne et douce nature au fond, malgré son petit rire de casse-noisette.
Le jardinier, voyant tout ce monde arriver, s'est mis à travailler un peu; Jean frotte plus que jamais; enfin, Courtavenel est tout pimpant, à l'heure qu'il est. Mais si l'on n'y met pas ordre, dans quinze jours les fossés seront remplacés par une belle ceinture de vase bien noire. Je ne sais si le jardinier est un rouge, mais il a bien les trois défauts principaux de ce parti auquel, du reste, je me fais honneur d'appartenir; c'est-à-dire qu'il est bavard, paresseux et propre à rien. Quel mauvais jardinier je ferais!... En y réfléchissant, je ne sais pas qui je ferais bon. Est-ce du français? Ma foi, je m'en bats l'œil.
Il y a longtemps que je n'ai reçu de lettre de vous! C'est un peu ma faute, mais à tout péché miséricorde. Bitte, bitte...
Dimanche.
Rien de nouveau depuis hier. Cependant les rougets paraissent ralentir leur fureur. Il était temps. Je devenais, comme dit Annibal dans l'Aventurière, si laid à nu que je n'osais m'y mettre.
J'ai promené ces dames en bateau; j'ai composé des chansons pour Louise.
Ainsi, vous nous revenez dans quinze jours!
Le facteur vient, et il faut que je lui donne ma lettre... Vous tenez plus que votre parole, car voici deux lettres que vous avez déjà reçues depuis... Enfin! J'attendrai. Que Dieu vous bénisse mille fois et conserve votre santé. Tout à vous.
IVAN. TOURGUENEFF.
P.-S.—J'écrirai à Viardot demain. Les lièvres sont morts!
16 mai 1850.
Je suis à Courtavenel. Je vous avouerai que je suis heureux, comme un enfant, d'y être. Je suis allé dire bonjour à tous les endroits auxquels j'avais dit déjà adieu avant de partir. La Russie attendra; cette immense et sombre figure, immobile et voilée comme le sphinx d'Œdipe. Elle m'avalera plus tard. Je crois voir son gros regard inerte se fixer sur moi avec une attention morne, comme il convient à des yeux de pierre. Sois tranquille, sphinx, je reviendrai à toi, et tu pourras me dévorer à ton aise si je ne devine pas l'énigme! Laisse-moi en paix pendant quelque temps encore! Je reviendrai à tes steppes!...
Il a fait très beau aujourd'hui. Gounod s'est promené tout le jour dans le bois de Blondureau à la recherche d'une idée; mais l'inspiration, capricieuse comme une femme, n'est pas venue, et il n'a rien trouvé. C'est du moins ce qu'il m'a dit lui-même. Il prendra sa revanche demain. Dans ce moment il est couché sur la peau d'ours en mal d'enfant. Il a une obstination et une ténacité dans son travail qui font mon admiration. Le vide de la journée d'aujourd'hui le rend très malheureux; il pousse des soupirs gros comme le bras et n'est pas capable de se distraire de sa préoccupation. Dans sa désolation, il s'en prend au texte. J'ai tâché de le remonter et je crois y être parvenu. Il est très dangereux de se laisser aller sur cette pente: on finit par se croiser les doigts sur le ventre, et l'on se dit: «Mais tout cela est atroce!»—J'ai reçu ses doléances un peu en riant, car je sais que tous ces petits nuages disparaissent au premier souffle et je suis très flatté d'être le confident de ces petites douleurs de création...
IV. TOURGUENEFF.
Tourgueneff fit la connaissance de Gounod chez les Viardot et conserva, toute sa vie, des relations amicales avec lui; mais aucune correspondance n'en est restée. Mme Charles Gounod m'écrivit en effet: «...Gounod avait une admiration profonde pour cet illustre poète. Souvent il a eu l'occasion de le rencontrer dans des maisons amies, mais je crois que là se sont bornées leurs relations intimes, car, parmi la nombreuse correspondance de Gounod, que je viens de classer tout dernièrement, je n'ai trouvé aucune signature de Tourgueneff.»
La composition qui préoccupait Gounod au moment où Tourgueneff écrivait à Mme Viardot était Sapho, son premier opéra, représenté le 10 avril 1851. Le livret, comme on sait, est d'Emile Augier. Sous le coup du malheur qui venait de le frapper,—la mort de son frère,—Gounod s'était retiré, en compagnie de sa mère, dans la propriété de ses amis, M. et Mme Viardot. Dans ses Mémoires d'un Artiste, récemment publiés, l'auteur de Faust raconte que c'est grâce à la promesse spontanée de l'illustre cantatrice de chanter sa première œuvre que, jeune et ignoré, il a pu obtenir d'Emile Augier, déjà célèbre, d'écrire le livret et traiter d'avance avec la direction de l'Opéra. Instruite du deuil qui venait de l'atteindre, Mme Viardot, qui se trouvait en Allemagne, lui écrivit aussitôt pour l'engager à aller trouver la tranquillité et la solitude dont il avait besoin dans sa propriété de Courtavenel.
«Je suivis son conseil, ajoute Gounod, et nous partîmes, ma mère et moi, pour cette résidence où se trouvait la mère de Mme Viardot (Mme Garcia, la veuve du célèbre chanteur), en compagnie d'une sœur de Mme Viardot et d'une jeune fille (l'aînée des enfants), aujourd'hui Mme Heritte, remarquable musicienne compositeur. Je rencontrai là aussi un homme charmant, Ivan Tourgueneff, l'éminent écrivain russe, excellent et intime ami de la famille Viardot. Je me mis au travail dès mon arrivée.»
E. H.-K.
Paris, lundi 24 juin 1850.
Je ne veux pas quitter la France, mon cher et bon ami[56] sans vous avoir dit combien je vous aime et vous estime, et combien je regrette la nécessité de cette séparation[57]. J'emporte de vous le souvenir le plus affectueux; j'ai su apprécier l'excellence et la noblesse de votre caractère, et, croyez-moi, je ne me sentirai véritablement heureux que quand je pourrai de nouveau, à vos côtés, le fusil à la main, parcourir les plaines bien-aimées de la Brie. J'accepte votre prophétie; je veux y croire. La patrie a des droits sans doute; mais la véritable patrie n'est-elle pas là où l'on a trouvé le plus d'affection, où le cœur et l'esprit se sentent plus à l'aise? Il n'y a pas d'endroit sur la terre que j'aime à l'égal de Courtavenel. Je ne saurais jamais vous dire combien j'ai été touché de tous les témoignages d'amitié que j'ai reçus depuis quelques jours; je ne sais vraiment pas par quoi je les ai mérités; mais ce que je sais, c'est que j'en garderai le souvenir dans mon cœur aussi longtemps que je vivrai. Vous avez en moi, mon cher Viardot, un ami dévoué à toute épreuve.
Allons, vivez heureux; je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon au monde. Nous nous reverrons un jour; ce sera un jour heureux pour moi, et qui me dédommagera amplement de toutes les tristesses qui m'attendent. Je vous remercie de vos bons conseils et vous embrasse avec effusion.
Soyez heureux, mon bon et cher Viardot, et n'oubliez par votre ami
IV. TOURGUENEFF.
Tourguenevo[58], lundi 9 septembre 1850.
Bonjour, chère, bonne, noble, excellente amie, bonjour, ô vous qui êtes ce qu'il y a de meilleur au monde! Donnez-moi vos chères mains pour que je les embrasse. Cela me fera beaucoup de bien et me mettra en bonne humeur. Là, c'est fait. Maintenant nous allons causer.
Il faut donc que je vous dise que vous êtes un ange de bonté et que vos lettres m'ont rendu le plus heureux des hommes. Si vous saviez ce que c'est qu'une main amie qui vient vous chercher de si loin pour se poser si doucement sur vous! La reconnaissance qu'on en ressent va jusqu'à l'adoration. Que Dieu vous bénisse mille fois! J'ai bien besoin d'affection dans cet instant, je suis tellement isolé ici. Aussi je ne saurais vous dire combien j'aime ceux que j'aime et qui ont de l'affection pour moi.
Jeudi.
J'ai été forcé d'interrompre cette lettre il y a trois jours, et je m'empresse de revenir à vous, aussitôt que je puis le faire. Des affaires de famille, ou plutôt des embarras de famille, en ont été la cause. Je commence à croire que tout tire à sa fin; aussi ne vous en parlerai-je que quand j'aurai un résultat à annoncer bon ou mauvais.
J'ai fait un petit voyage à trente verstes d'ici; je suis allé voir une de mes «anciennes flammes», dont c'était la fête. L'ancienne flamme a diablement changé et vieilli (elle s'est mariée depuis et est devenue mère de trois enfants). Son mari est un monsieur fort maussade et fort tatillon. Je pardonne à mon ancienne flamme son mari, ses enfants, et même la teinte couperosée de son visage. Mais ce que je ne lui pardonne pas, c'est d'être devenue insignifiante, endormie et plate; c'est surtout de s'être accroché une fausse queue en cheveux noirs, tandis que les siens sont bruns, presque blonds, et de l'avoir fait si négligemment qu'on voyait le nœud qui était gros comme le poing, et dont les deux bouts, l'un noir et l'autre blond, retombaient avec grâce à gauche et à droite. Elle s'est mise à jouer du piano, mais le malheureux instrument était faux à faire frémir, faux de cette fausseté doucereuse qui est la pire de toutes, et elle ne s'en apercevait pas et elle jouait des pièces de musique horriblement vieillies, et elle les jouait très mal... Hélas! Trois fois hélas! Mon ancienne flamme n'est pas même de la fumée à l'heure qu'il est: un peu de cendre refroidie, voilà tout. Ce que c'est que de nous!
J'ai passé la nuit dans sa maison. Avant de me coucher, j'ai relu vos lettres; je vous suis bien reconnaissant de m'en écrire de si bonnes! Si vous saviez combien c'est bon et doux, une lettre de vous! Quel esprit charmant, fin et juste, quel grand et noble cœur s'y révèle à chaque ligne! J'ai du plaisir à vous le dire, ayez-en à le lire, car c'est bien vrai ce que je vous dis là, vous pouvez m'en croire.
Pour la petite Pauline[59], vous savez déjà que je suis décidé à suivre vos ordres, et je ne pense plus qu'aux moyens de le faire vite et bien. Je vous écrirai de Moscou et de Pétersbourg jour par jour tout ce que je ferai pour elle. C'est un devoir que je remplis, et je le remplis avec bonheur du moment que vous vous y intéressez. Si Dios quiere, elle sera bientôt à Paris.
Vous êtes mon bon ange, vous. Le mot de bon ange me fait penser à la romance du Domino noir, et puis je vous vois marchant sur l'herbe à Courtavenel, une guitare à la main, et montrant «la belle Inès» à Mlle Antonia, et ma mémoire locale me retrace à l'instant même le ciel, les arbres de là-bas, votre robe à dessins bruns, votre chapeau gris. Je crois sentir sur mon visage le souffle de la légère brise d'automne qui chuchotait dans les pommiers au-dessus de nous. Qu'est-il devenu, ce temps charmant?... Il faut que je parle d'autre chose.
Il est fort possible que j'aurais eu de Mme Pasta l'opinion que vous me supposez, si je l'avais entendue à Pétersbourg au commencement de mon éducation musicale, mais je n'ai pas eu ce bonheur. Je ne l'ai vue ni entendue, mais me voilà maintenant fixé sur ce que je dois penser d'elle.
Vous me demandez en quoi réside le «Beau». Si, en dépit des ravages du temps qui détruisent la forme sous laquelle il se manifeste, il est toujours là... C'est que le Beau est la seule chose qui soit immortelle, et qu'aussi longtemps qu'il reste un vestige de sa manifestation matérielle, son immortalité subsiste. Le Beau est répandu partout, il s'étend même jusque sur la mort. Mais il ne rayonne nulle part avec autant d'intensité que dans l'individualité humaine; c'est là qu'il parle le plus à l'intelligence, et c'est pour cela que, pour ma part, je préférerai toujours une grande puissance musicale servie par une voix défectueuse, à une voix belle et bête une voix dont la beauté n'est que matérielle.
Avec quelle impatience n'attends-je pas votre opinion sur le deuxième acte de Sapho! Si Gounod n'est pas une grande puissance musicale, s'il n'a pas du génie, je renonce à toute espèce de jugement sur les hommes et les talents. Je ne puis m'empêcher de vous porter envie; pensez à moi, quand cette belle musique vous remuera l'âme, pensez à moi si vous le pouvez. La musique de Gounod me fait penser que la Juive, surtout la musique échue en partage à Rachel, est, je ne dirai pas peu de chose, mais à côté du vrai et de la beauté. Vous avez eu un grand succès, et cependant je suis bien sûr que cette déclamation lourde et forcée a dû vous laisser une grande fatigue et un grand vide dans l'âme. On a beau parler de science, de coloris national, etc., le souffle divin n'est pas là. Ce n'est pas immortel, comme toute beauté véritable doit l'être. Le Vallon est immortel.
Vous souvenez-vous d'une petite fille de cinq ans, fort extraordinaire, dont je vous ai parlé dans une de mes lettres? Je l'ai revue et je continue à trouver cette enfant un petit être bien singulier. Imaginez-vous la plus jolie petite figure qu'il soit possible de voir; des traits d'une finesse inouïe, un sourire charmant et des yeux comme je n'en ai jamais vu, des yeux de femme tantôt doux et caressants, tantôt perçants et observateurs, une physionomie qui change d'expression à chaque instant, et dont chaque expression est étonnante de vérité et d'originalité. Elle a un bon sens, une justesse de sensations et de sentiment merveilleuse; elle réfléchit beaucoup et ne ruse jamais, c'est surprenant de voir avec quelle rectitude d'instinct son petit cerveau marche à la vérité. Elle juge parfaitement tout ce qui l'entoure, à commencer par ma mère, et avec tout cela, c'est un enfant, un véritable enfant. Il y a des moments où son regard prend une teinte rêveuse et triste qui vous serre l'âme. Mais en général elle est fort gaie et fort calme. Elle m'aime beaucoup et me regarde quelquefois avec des yeux tellement doux et tendres que j'en suis tout ému.
Elle se nomme Anne et est la fille naturelle de mon oncle, du frère de mon père, et d'une paysanne. Ma mère l'a recueillie chez elle et l'a traitée en poupée. Je me suis bien promis de me charger avec le temps de son éducation. Je vais avoir toute une famille sur les bras! Elle a des airs de tête et des mouvements de sourcils quand on lui dit quelque chose qui la frappe, qui font mon admiration. Elle a l'air de soumettre ce qu'elle entend à son petit raisonnement, et puis elle vous fait des réparties étonnantes. Je vais vous conter un de ses traits. C'était encore à Moscou. Elle était restée près d'une heure dans ma chambre, ma mère l'en punit sans songer que c'était moi qui l'avais emmenée, et tout en lui défendant de me dire pourquoi on l'avait punie. J'entre dans le cabinet de ma mère, je vois la petite dans un coin, fort triste et silencieuse; j'en demande la raison: ma mère me conte une histoire de désobéissance, de caprice; j'y vais, je m'approche d'elle et lui adresse un petit mot de reproche. Elle détourne la tête sans mot dire. Je sors et ne rentre que fort tard. Le lendemain de très bonne heure, la petite entre dans ma chambre, s'assied tranquillement sur ma chaise, me regarde quelque temps en silence et m'adresse cette question à brûle-pourpoint:
—Vous avez cru hier ce qu'a dit maman de moi?
—Oui.
—Eh bien, vous avez eu tort, voici pourquoi j'ai été punie... J'avais promis de ne pas vous le dire, et je ne vous l'aurais pas dit, si vous n'aviez pas cru maman.
—As-tu pleuré pendant la punition?
Elle releva la tête d'un petit air fier et me dit en clignant des yeux: «Oh! non.» Puis elle ajouta après un moment de silence ou de réflexion, car chez elle c'est tout un:—Mais j'ai pleuré quand vous vous êtes approché de moi dans le cabinet.
—Ah! c'est donc pour cela que tu as détourné la tête?
—Vous l'avez remarqué, et vous n'avez pas vu que je pleurais?
Elle poussa un gros soupir, vint m'embrasser et s'en alla.
Je vous jure que je n'ai pas ajouté un seul mot à ce qu'elle a dit; mais si vous aviez vu sa petite figure pendant toute cette explication! On y lisait tant de travail de sa pensée, la lutte de ses sentiments. Elle est blonde et très blanche; ses yeux sont d'un gris bleu nuancé de noir; ses dents sont de vraies petites perles. Elle est très aimante et très sensible; avec cela, peu ou point de mémoire, aussi sait-elle à peine son alphabet. Je vous assure que c'est une bien étrange petite créature, et je l'étudie avec intérêt. Elle n'a pas encore cinq ans.
Samedi, 2/14 septembre.
C'est aujourd'hui jour de poste chez nous, chère et bonne amie; je vais donc vous envoyer cette lettre qui, malgré ma promesse, ne ressemble guère à un volume. Mais enfin, vous êtes l'indulgence même, et je vous enverrai une autre lettre, mardi prochain, d'autant que je compte pouvoir vous donner quelques bonnes nouvelles. Il fait un bien vilain temps ici, j'espère que vous en avez un superbe à Courtavenel: pas de pluie, mais un ciel gris et froid, un vent idem, et dans les intervalles de rafales on entend le petit tintement aigre des mésanges dans les bouleaux; l'arrivée des mésanges, comme le départ des grues et des oies sauvages, présage le froid. A propos de grues, nous en voyons tous les jours des bandes qui s'en vont de leur vol régulier et lent vers le Midi. Vous rappelez-vous les vers du Faust:
| Wenn über Flächen über Seen, |
| Der Kranich nach der Heimath strebt. |
L'emploi du mot streben est bien heureux, essayez un peu de le traduire en français!...
Je ne connais rien de plus solennel que le cri des grues, qui semble vous tomber des nuages sur la tête. C'est éclatant, sonore, puissant et très mélancolique. Il semble vous dire: «Adieu, pauvres petits roquets d'hommes qui ne pouvez changer de place; nous allons au Midi, là où il va faire bon et chaud maintenant. Vous, restez dans la neige et la misère!... Patience!»
Je vous envoie cette lettre directement d'ici; jusqu'à présent je vous les ai envoyées par le comptoir d'Iazykoff. Je ne sais si vous les recevez bien exactement. Je vais faire cet essai. Le messager attend sous la fenêtre. C'est un écuyer de mon frère, très beau garçon et très content de faire cette commission qui lui rapporte toujours quelque chose,—va, mon garçon, porte cette lettre. Et vous, mes chers amis, soyez bien assurés que le jour où je cesserai de vous aimer, tendrement, profondément, j'aurai cessé d'exister. Que le bon Dieu vous bénisse tous et vous rende heureux. Je vous baise les mains avec dévotion. Soyez heureuse, bénie et bien portante!
Votre vieil ami,
I. TOURGUENEFF.
Moscou, midi 1/13 janvier 1851.
Bonjour, chère et bonne madame Viardot. Je ne veux pas commencer mon année sans invoquer ma douce et chère patronne et sans appeler sur elle toutes les bénédictions du Ciel.
Hélas! se peut-il que toute cette année s'écoule sans que j'aie le bonheur de vous revoir? C'est une idée bien cruelle et à laquelle il faut cependant que je m'habitue...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous avons passé la soirée d'hier chez un de mes amis, et quand minuit a sonné, vous vous imaginez bien à qui j'ai mentalement porté mon toast! Tout mon être s'est élancé vers mes amis, mes chers amis de là-bas... Que le Ciel veille sur eux et les garde!... Mon cœur est toujours là-bas, je le sens. A demain. Il faut que je sorte, j'ai quelques visites à faire. J'ai une foule de choses à vous communiquer. Ce n'est pas sans raison que je suis resté si longtemps à Moscou. J'ai mené à bonne fin une entreprise assez difficile et délicate. Je vous parlerai de tout cela demain. Aujourd'hui soir, on donne une de mes comédies manuscrites chez la comtesse Sollohoub, un théâtre de société. On m'a engagé d'assister à la représentation, mais je me garderai bien de le faire; je craindrais trop d'y jouer un personnage ridicule. Je vous dirai quel aura été le résultat. A demain. Mais je veux me mettre à vos pieds et embrasser le pan de votre robe dès aujourd'hui, chère, chère, bonne, noble amie. Que le Ciel vous protège!
Mercredi, 3 janvier.
Il paraît que ma comédie a eu un très grand succès avant-hier, car on la répète aujourd'hui, et je viens de recevoir une invitation pressante d'y aller ce soir. Cette fois-ci j'irai; je ne veux pas avoir l'air de me donner des airs.
J'ai donné hier un dîner d'adieu à mes amis, nous étions en tout vingt personnes. Il faut avouer que vers la fin de la soirée nous étions tous on ne peut plus animés. Il y avait entre autres un acteur comique d'un très grand talent, M. Sadofski, qui nous a fait mourir de rire, en improvisant des scènes, des dialogues de paysans, etc... Il a beaucoup d'imagination et une vérité de jeu, d'intonation et de geste, que je n'ai presque jamais rencontrée aussi parfaite. Il n'y a rien de si bon à voir que l'art devenu nature.
Je vous avais promis hier de vous dire pourquoi je suis resté à Moscou beaucoup plus longtemps que je ne m'y attendais. Voici en peu de mots la raison: Il y avait deux personnes, deux femmes à éloigner de la maison, où elles mettaient la discorde à chaque instant. Pour l'une d'elles la chose n'a pas été difficile (c'était une veuve d'une quarantaine d'années, que ma mère avait eue près d'elle pendant les derniers mois de sa vie), on l'a largement payée et priée d'aller chercher une autre maison que la nôtre. L'autre était cette jeune fille que ma mère avait adoptée, une vraie Mme Lafarge, fausse, méchante, rusée et sans cœur. Il me serait impossible de vous dire tout ce que cette petite vipère a fait de mal. Elle avait entortillé mon frère, qui, dans sa bonté naïve, la prenait pour un ange: elle est allée jusqu'à calomnier odieusement son propre père, et puis, quand j'ai réussi par le plus grand des hasards à saisir le fil de toute cette intrigue, elle a tout avoué, elle nous a bravés avec une insolence, un aplomb qui m'a fait penser à Tartufe ordonnant, chapeau en tête, à Orgon, de quitter sa maison. Il était impossible de la garder plus longtemps, et cependant nous ne pouvions pas la mettre sur le pavé... Son propre père refusait de la prendre chez lui (il est marié et a une grande famille). Notre situation était très embarrassante. Enfin, heureusement, il s'est trouvé une personne, un docteur, ami du père de la demoiselle, qui a consenti à s'en charger en la prévenant d'avance qu'elle serait gardée à vue. Mon frère et moi, nous lui avons donné une lettre de change de 60.000 francs payables dans trois ans avec 6 p. 100 d'intérêt, toute la garde-robe de ma mère, etc., etc. Elle nous a donné un reçu, et nous en voilà quittes! Ouf! ça a été une lourde charge. Je ne sais ce qui devait résulter de son séjour chez mon frère, mais je sais que nous ne respirons que depuis qu'elle n'est plus là. Quelle mauvaise et perverse nature, à dix-sept ans! Cela promet. Il est vrai qu'elle a reçu une éducation détestable... Enfin, n'en parlons plus, elle est contente et nous aussi. Cependant, je vous avoue que je ne suis pas fait pour de pareilles opérations! J'y mets assez de sang-froid et de résolution, mais cela me détraque les nerfs horriblement. J'ai trop pris l'habitude de vivre avec de bonnes et honnêtes gens. La méchanceté, la perfidie surtout ne me fait pas peur, mais elle me soulève le cœur. Il m'a été impossible de travailler pendant ces derniers quinze jours.
Vendredi 5.
Hé bien, en effet, j'ai eu un grand succès avant-hier. Les acteurs ont été détestables, surtout la jeune première (une princesse Tcherkassky), ce qui n'a empêché ni le public d'applaudir à outrance, ni moi d'aller les remercier avec effusion derrière les coulisses. J'ai été, malgré tout, assez content d'avoir assisté à cette représentation. Je crois que ma pièce aura du succès sur le théâtre, puisqu'elle a plu, malgré le massacre des dilettanti. (On la donne à Pétersbourg le 20, ici le 18.) C'est tout de même drôle de se voir jouer.
Je pars demain, mais je vous écrirai encore avant de partir. Il me tarde d'avoir une lettre de vous. On ne me les envoie plus à Moscou, elles m'attendent à Pétersbourg... A demain.
Lundi 8.
L'homme propose et Dieu dispose, chère madame Viardot. Je devais partir samedi, et me voilà encore à Moscou. J'ai attrapé une toux, et, aussi longtemps qu'elle durera, il me sera impossible de quitter ma chambre. J'espère qu'elle passera dans peu de jours. Ce contretemps m'est assez désagréable, mais il faut s'y résigner.
Hier, Diane a mis bas sept petits, blancs et jaunes comme elle, six chiens et une chienne. Sa tendresse de mère va jusqu'à la férocité, et elle fait des yeux terribles quand je touche à un de ses petits. Les autres n'osent pas seulement s'approcher d'elle. Je vous envoie cette lettre aujourd'hui, je vous écrirai encore une fois avant de partir. J'espère que je pourrai le faire jeudi.
Il y a plus de deux mois que la petite Pauline[60] est à Paris. Comment va-t-elle, et fait-elle des progrès?
Je suis certain de trouver des détails qui la concernent dans vos lettres qui m'attendent à Pétersbourg, car je suis sûr qu'il y en a là-bas au moins deux. Je vous aime et vous embrasse tous. Tiens, une idée. Si j'écrivais à Gounod au lieu de vous écrire avant mon départ? C'est ce que je ferai. Ainsi, adieu jusqu'à Pétersbourg.
Votre
IVAN. TOURGUENEFF.
Moscou, mercredi 17/29 janvier 1851.
Je relève de maladie, comme Jodelet dans les Précieuses ridicules, chère et bonne amie; j'ai eu une fièvre catarrhale assez forte, qui m'a mis sur le flanc pendant quatre jours. Ce qui m'est surtout désagréable, c'est le retard que cette maladie a apporté à mon voyage, et ce qu'il y a surtout de désagréable dans ce retard, c'est qu'il me prive de vos lettres qui m'attendent à Pétersbourg et que j'ai eu la bêtise de ne pas faire venir ici; j'espérais toujours pouvoir partir. Il est très probable que je resterai ici une semaine encore; vous ne sauriez croire quel vide me fait l'absence de vos lettres; il y a longtemps que je ne reçois pas de vos nouvelles, j'en suis tout désorienté.
On donne demain une comédie que j'ai composée pour les acteurs de Pétersbourg, mais que Stchepkine[61] m'a demandée pour son bénéfice.
Je n'ai rien à refuser à ce brave et digne homme. Si je ne me sens pas trop mal, j'irai à la première représentation. Jusqu'à présent je ne ressens pas la moindre agitation. Nous verrons demain. Il paraît que la jeune première est détestable. Enfin, nous verrons.
Adieu, jusqu'à demain, chère et bonne amie; je vous invoque et me mets sous votre protection, chère patronne.
Jeudi, une heure du matin.
C'est donc pour ce soir; cela commence à me faire un peu d'effet. Malheureusement je me sens plus mal qu'hier et le docteur vient de me conseiller de ne pas sortir ce soir. Ce serait cependant désagréable... Mon frère y va avec sa femme.—C'est une petite comédie en un acte qui a pour titre: Une Provinciale. La donnée en est simple, tout dépend du jeu des deux acteurs principaux. L'un est bon, à ce que l'on dit; l'autre (ou plutôt l'actrice) est très mauvais. La salle sera pleine. Stchepkine vient de m'envoyer un billet pour loge d'en haut. Je crois que j'irai, quoique je me sente mal; j'ai une chaleur de tous les diables.
Sept heures du soir.
J'ai quatre-vingts pulsations par minute, et je vais au théâtre. Je ne puis pas rester à la maison. Je vous serre les deux mains bien fort. Que vous écrirai-je en rentrant?
Onze heures.
Par exemple je m'attendais à tout, hormis à un tel succès! Imaginez-vous qu'on m'a rappelé avec des vociférations telles, que je me suis enfui tout éperdu, comme si j'avais mille diables à mes trousses, et mon frère vient de m'apprendre que le vacarme a duré un grand quart d'heure et n'a cessé que quand Stchepkine est venu annoncer que je n'étais pas au théâtre. Je regrette beaucoup de m'être enfui, car on a pu croire que je faisais la petite bouche.
Ma pièce a été assez bien jouée par tout le monde, la jeune première exceptée, qui a été détestable; mais en revanche, l'acteur chargé du rôle principal a été charmant. C'est un jeune acteur qui se nomme Choumski; il a fait un grand pas dans l'opinion du public, je suis enchanté de lui on avoir fourni l'occasion. Au moment où la toile s'est levée, j'ai prononcé tout bas votre nom, il m'a porté bonheur. Mais il faut que je me couche, car j'ai une fièvre de cheval.
Vendredi, 2 heures.
L'excursion d'hier ne m'a pas fait beaucoup de mal; j'ai passé une mauvaise nuit, il est vrai, mais aujourd'hui je me sens assez bien. J'ai vu aujourd'hui plusieurs de mes amis qui sont venus me féliciter; il paraît que mon succès a été en effet très grand; la salle était comble, et on a vu de mes ennemis (littéraires) applaudir à tout rompre. Tant mieux, tant mieux. Le bon Stchepkine est venu m'embrasser et me gronder sur ma fugue. J'ai l'intention d'envoyer un petit cadeau à Choumski, cela lui fera plaisir. On donne, demain la même pièce à Pétersbourg. C'est cependant agréable d'avoir un succès. Allons, il faut que cela me serve d'éperon.
Imaginez-vous que je viens d'apprendre par un monsieur qui arrive de Pétersbourg que le comptoir Yazykoff a plusieurs lettres à mon nom, qu'on n'envoie pas à Moscou, parce qu'on s'attend d'heure en heure à mon arrivée; cela me cause un dépit dont je ne saurais vous donner une idée. Dieu! Dieu! Dieu! que je suis bête!
Permettez-moi de vous remercier pour mon succès d'hier; je m'imagine que si je n'avais pas prononcé votre nom, la chose aurait pris une tout autre tournure; je suis si heureux de rattacher toute ma vie à votre cher et bon souvenir, à votre influence. Je vous embrasse les mains avec reconnaissance et tendresse. Que le Ciel veille sur vous! A demain.
IVAN. TOURGUENEFF.
Lundi.
Je ne vous ai pas écrit ni samedi, ni dimanche; j'étais languissant, pour ne pas dire bête. On répète ma pièce ce soir, on ne joue ici la comédie que trois fois par semaine. Je compte sortir aujourd'hui en voiture; il fait un temps superbe.
Les yeux des petits de Diane se sont enfin ouverts à la lumière; ils sont très drôles, très gentils et très bien portants.
Ce serait bien le diable si je devais rester ici plus d'une semaine! J'ai une foule de visites, etc.; ce sont des compliments à perte de vue. Je vous le dis, parce que je sais que cela vous fera plaisir. Je suis sûr que vous me parlez dans vos lettres de Sapho, des répétitions commencées (car j'espère bien qu'elles le sont); et dire que je n'en sais rien par ma faute! Mais je les aurai, ces lettres, dans quatre jours. Je vous écrirai un volume et pour Gounod. Je vous répète, je ne quitterai pas Moscou sans lui avoir écrit une longue lettre.
Que fait la petite Pauline? Est-elle sage? Apprend-elle le français et le piano?
Adieu; je vous embrasse tous avec une tendresse indicible. Je commence par vous; puis Viardot; puis Gounod; puis Mme Garcia[62]; puis Mme Gounod; puis Mme Berthe; puis «el mujer Marinero Español y su muyler»; puis Manuel; puis Louise[63], puis tout le monde, tous les amis et je finis par vous. Mes chers amis, mon cœur est avec vous. Adieu. Portez-vous-bien; soyez heureux et contents et n'oubliez pas votre fidèle ami
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, 21 février 1852.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Il m'est impossible de continuer cette lettre comme je l'avais commencée. Un bien grand malheur nous a frappés: Gogol est mort à Moscou, mort après avoir tout brûlé,—tout,—le deuxième tome des Ames Mortes, une foule de choses achevées ou commencées,—tout enfin. Il vous serait difficile d'apprécier toute la grandeur de cette perte si cruelle, si complète. Il n'y a pas de Russe dont le cœur ne saigne dans cet instant. C'était plus qu'un simple écrivain pour nous: il nous avait révélés à nous-mêmes. Il était dans plus d'un sens le continuateur de Pierre le Grand pour nous. Ces paroles peuvent vous paraître exagérées, dictées par la douleur. Mais vous ne le connaissez pas; vous ne connaissez que les moindres de ses ouvrages et même si vous les connaissiez tous, il vous serait difficile de comprendre ce qu'il était pour nous. Il faut être Russe pour le sentir. Les esprits les plus pénétrants parmi les étrangers, un Mérimée par exemple, n'ont vu en Gogol qu'un humoriste à la façon anglaise. Sa signification historique leur a complètement échappé. Je le répète, il faut être Russe pour savoir ce que nous avons perdu...
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, 1er/13 mai 1852.
A Monsieur et à Madame Viardot.
Mes chers amis,
Cette lettre vous sera remise par une personne qui part d'ici dans quelques jours, ou bien elle l'expédiera à Paris après avoir franchi la frontière, de sorte que je puis vous parler un peu à cœur ouvert et sans craindre la curiosité de la police.
Je commence par vous dire que si je n'ai pas quitté Saint-Pétersbourg depuis un mois c'est bien contre mon gré. Je suis aux arrêts d'une maison de police, par ordre de l'Empereur, pour avoir fait imprimer dans un journal de Moscou un article, quelques lignes sur Gogol. Ça n'a été qu'un prétexte, l'article en lui-même étant parfaitement insignifiant. Il y a longtemps qu'on me regarde de travers. On s'est accroché à la première occasion venue. Je ne me plains pas de l'Empereur[64], l'affaire lui a été si perfidement présentée, qu'il n'aurait pu agir autrement. On a voulu mettre un terme sur tout ce qui se disait sur la mort de Gogol, et on n'a pas été fâché, en même temps, de mettre l'embargo sur mon activité littéraire.
Dans quinze jours d'ici on m'expédiera à la campagne, où je dois rester jusqu'à nouvel ordre. Tout cela n'est pas gai comme vous voyez; cependant je dois dire qu'on me traite fort humainement; j'ai une bonne chambre, des livres; je puis écrire. J'ai pu voir du monde dans les premiers jours. Maintenant c'est défendu, car il en venait trop. Le malheur ne fait pas fuir les amis, même en Russie. Le malheur, à dire vrai, n'est pas très grand. L'année 1852 n'aura pas eu de printemps pour moi, voilà tout. Ce qu'il y a de plus triste dans tout cela, c'est qu'il faut dire un adieu définitif à toute espérance de faire un voyage hors du pays; du reste je ne me suis jamais fait d'illusion là-dessus. Je savais bien, en vous quittant, que c'était pour longtemps, si ce n'est pour toujours. Maintenant je n'ai qu'une ambition, c'est qu'on me permette d'aller et de venir dans l'intérieur de la Russie. J'espère que cela ne me sera pas refusé! L'Héritier[65] est très bon, je lui ai écrit une lettre dont j'attends quelque bien.
Vous savez que l'Empereur est parti. On avait mis aussi les scellés sur mes papiers, ou plutôt on a cacheté les portes de mon appartement, qu'on a ouvert dix jours plus tard sans rien examiner. Il est probable qu'on savait qu'il ne s'y trouvait rien de défendu.
Il faut avouer que je m'ennuie passablement dans mon trou. Je profile de ce loisir forcé pour travailler du polonais, que j'avais commencé à étudier il y a six semaines. Il me reste encore quatorze jours de réclusion. Je les compte, allez!
Voici, mes chers amis, les nouvelles, peu agréables, que j'ai à vous donner. J'espère que vous m'en donnerez de meilleures. Ma santé est bonne, mais j'ai ridiculement vieilli. Je pourrais vous envoyer une mèche de cheveux blancs, sans exagération. Cependant je ne perds pas courage. A la campagne, la chasse m'attend! Puis, je vais tâche d'arranger mes affaires; je continuerai mes études sur le peuple russe, sur le peuple le plus étrange et le plus étonnant qu'il y ait au monde. Je travaillerai à mon roman avec d'autant plus de liberté d'esprit que je ne le destinerai pas à passer sous les griffes de la censure. Mon arrestation va probablement rendre impossible la publication de mon ouvrage à Moscou. Je le regrette, mais que faire?
Je vous prie de m'écrire souvent, mes chers amis, vos lettres contribueront beaucoup à me donner du courage pendant ce temps d'épreuves. Vos lettres et le souvenir des jours passés de Courtavenel, voilà tout mon bien. Je ne m'appesantis pas là-dessus, crainte de m'attendrir. Vous le savez bien, mon cœur est avec vous, je puis le dire, maintenant surtout... Ma vie est finie, le charme n'y est plus. J'ai mangé tout mon pain blanc; mâchons ce qui reste de pain bis, et prions le Ciel qu'il soit «bien bon» comme disait Vivier[66].
Je n'ai pas besoin de vous dire que tout ceci doit rester parfaitement secret; la moindre mention, la moindre allusion dans un journal quelconque suffirait pour m'achever.
Adieu, mes chers et bons amis; soyez heureux, et votre bonheur me rendra aussi content que je puis l'être. Portez-vous bien, ne m'oubliez pas, écrivez-moi souvent, et soyez bien persuadés que ma pensée est toujours avec vous. Je vous embrasse tous, et je vous envoie mille bénédictions. Cher Courtavenel, je te salue aussi, toi! Écrivez-moi souvent. Je vous embrasse encore. Adieu!
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé[67], 13 octobre 1852.
Imaginez-vous un ouragan, une trombe de neige qui ne tombe pas, qui se précipite, qui tourbillonne, obscurcit l'air tout en étant blanche, et couvre déjà la terre à hauteur d'homme. Voilà le temps qu'il fait à l'heure qu'il est, chère madame Viardot. Vous autres, Européens, vous ne sauriez vous faire une idée de ce que c'est qu'une métielle russe. Heureusement qu'il ne fait pas très froid, sans cela que de victimes! Il y a deux ans, neuf cents personnes périssaient dans le seul gouvernement de Toula par une métielle semblable à celle-ci. Mais de mémoire d'homme on n'en a pas vu de pareille à cette époque! Il paraît que pour nous consoler du détestable été que nous venons de subir, l'hiver veut arriver plus tôt que de coutume. C'est l'histoire du monsieur qui épouse une femme laide et pauvre, mais bête! Et cependant je ne suis pas triste malgré le temps affreux, malgré cet avant-goût des six mois d'isolement complet qui m'attendent. Je me sens au contraire tout ému et réjoui: c'est que j'ai devant moi la chère lettre que vous m'avez écrite à votre retour d'Angleterre à Courtavenel.
Ma chère et bonne amie, je vous supplie de m'écrire souvent; vos lettres me rendaient toujours heureux, mais c'est surtout maintenant qu'elles me sont devenues nécessaires; me voici cloué à la campagne pour je ne sais combien de temps, réduit à mes propres ressources. Pas de musique, pas d'amis; que dis-je? pas même de voisins pour s'ennuyer ensemble! Les Tutcheff[68] sont d'excellentes gens, mais nous nageons dans des eaux trop différentes. Que me reste-t-il? Je crois vous l'avoir dit plus d'une fois: le travail et les souvenirs. Mais pour que l'un me soit facile et les autres moins amers, il me faut vos lettres avec ces bruits de vie heureuse et active, avec cette odeur de soleil et de poésie qu'elles m'apportent... Je sens ma vie qui s'enfuit goutte à goutte comme l'eau d'un robinet à demi fermé; je ne la regrette pas; qu'elle s'épuise... qu'en ferais-je? Il n'est donné à personne de retourner sur les traces du passé, mais j'aime à me le rappeler, ce passé charmant et insaisissable, par une soirée comme celle-ci, où, en écoutant les hurlements désolés de la bise sur toute cette neige amoncelée, il me semble... Fi! je ne veux ni m'attrister ni vous attrister aussi par contre-coup... Tout ce qui m'arrive est encore très supportable, il faut se raidir sous le faix pour le moins sentir... Mais écrivez-moi souvent.
| Et de tristesse couronnée |
| La terre entre dans son sommeil... |
Cette phrase de l'Automne de Gounod me chante dans la tête depuis le commencement de cette lettre; son Automne est adorable. Je me sens tout pénétré d'attendrissement, il faut s'y arracher, car à quoi bon?
Je viens d'ouvrir pour un instant la porte de mon balcon... Brrrrr! quelle bouffée de froid sombre, de vent glacial et de neige... Diane, qui s'était levée, recule d'horreur... Ah! pauvre petite, tu n'es pas habituée à un climat pareil. Pauvre Française, va! Allons, mettons-nous l'un à côté de l'autre et pensons à Courtavenel. A demain.
Mardi.
Aujourd'hui, il fait un temps étrange, mais assez agréable. L'air est rempli de brouillard; pas le moindre vent, tout est blanc, le ciel et la terre; la neige fond à petit bruit. On entend partout le chuchotement de gouttelettes d'eau qui tombent; il fait très doux. Nous allons, mes deux chasseurs et moi, faire une excursion à quelques verstes d'ici; nous espérons tuer pas mal de lièvres.
J'ai commencé, selon votre désir, un petit traité sur le Jeu du paysan, qui remplira au moins quatre pages, et que je vous enverrai mardi prochain; je ne croyais pas que cela pût devenir aussi long... Mon chasseur vient d'entrer en me disant: «Ah, monsieur, il faut partir; la terre prend un bain tiède après la métielle d'hier.» J'ai fait atteler deux traîneaux, nous allons inaugurer le traînage.
Dites à Viardot que j'ai lu sa lettre avec grand plaisir. Le petit conte de la fin est plaisamment imaginé; mais ces sortes de choses sont comme tous les tours de force des pianistes, toute la difficulté (et tout le mérite) gît dans l'exécution. Mais, un jour ou l'autre, nous verrons.
Adieu, chère amie, à bientôt. Mille amitiés à tout le monde.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 28 octobre 1852.
C'est aujourd'hui mon jour de naissance, chère madame Viardot, et c'est pour cela que je vous écris. J'ai trente-quatre ans. Je croyais n'en avoir que trente-trois, mais j'ai découvert l'un de ces jours un petit carnet de ma mère, où nos naissances (celle de mon frère et la mienne) ont été inscrites par elle, le jour même. J'y ai trouvé l'inscription suivante: «Aujourd'hui, 28 Octobre 1818, je suis accouchée d'un fils nommé Jean, à Orel, à midi.» J'ai donc trente-quatre ans bel et bien sonnés... Diable, diable, diable, c'est que je ne suis plus jeune, mais du tout, du tout... Enfin!
Je crois vous avoir parlé dans ma dernière lettre d'une métielle russe; aujourd'hui c'est un véritable ouragan. C'est tellement affreux et horrible que ça en devient beau. La maison tremble et craque, et puis ces ténèbres blanches qui tourbillonnent devant les fenêtres... Mon pauvre frère devait arriver aujourd'hui chez moi directement d'un assez long voyage, j'espère qu'il aura trouvé un abri quelque part. Tutcheff et sa femme sont revenus hier, en même temps que moi. J'ai fait une excursion de deux jours à Orel, ville qui se trouve à 55 verstes de chez moi. J'ai tâté un tant soit peu de la vie de province dans un chef-lieu de gouvernement, c'est passablement triste. Je suis bien décidé à ne pas mettre le nez dehors et à travailler dans mes quatre murs. A demain, chère amie.
1er novembre.
Je ne vous ai pas écrit ces jours-ci, mais il faut que je vous écrive aujourd'hui... c'est encore un anniversaire, et savez-vous lequel? Il y a aujourd'hui juste neuf ans que je vous ai vue pour la première fois chez vous, à Pétersbourg, dans la maison Demidoff. Je me souviens de cette première visite comme si elle avait eu lieu hier. C'était le matin. Je n'étais pas venu seul; le petit major Komaroff m'accompagnait... Eh bien, malgré le ridicule achevé de ce personnage, j'ai toujours du plaisir à penser à lui; sa figure éveille une foule d'idées et de souvenirs; le hasard l'a associé à ce temps si regretté et éloigné de moi; je sens renaître en moi les impressions de cette saison de 1843 à 1844... Neuf années! Hélas! il y en aura dix, que je n'aurai pas plus d'espoir de vous revoir que je n'en ai maintenant...
Ce qui me manque ici surtout, c'est d'entendre de la musique; voilà six mois que j'en suis sevré, mais complètement. Mme Tutcheff semble vouloir l'abandonner; j'ai eu hier toutes les peines du monde à la mettre au piano. Je l'ai priée de jouer le final de Don Juan. Elle déchiffre bien et a le sens musical, mais elle aime à se l'enfermer dans sa coquille, surtout depuis la mort de sa fille. Puis elle aime trop son mari, et n'est heureuse qu'auprès de lui! Elle me rappelle quelquefois ces petites perruches vertes, dites inséparables qui se tiennent constamment côte à côte. Malheureusement, son mari n'aime la musique que modérément, on plutôt, il l'aime, comme beaucoup de monde, pour tout autre chose que pour ce qui est musique en elle. Il y a, par exemple, des peintres dont les jouissances musicales proviennent du sentiment du coloris, de l'harmonie des lignes, etc. La plupart des littérateurs ne recherchent, en fait de musique, que des impressions littéraires; ce sont, en général, de mauvais auditeurs et de mauvais juges. Tutcheff, qui n'a aucune spécialité, n'aime, en fait de musique, que ce qui ébranle vaguement certaines sensations, certaines idées en lui, c'est-à-dire qu'au fond, il l'aime peu, qu'il peut très bien s'en passer, et qu'il préfère le connu. Personne ici n'a la faim musicale qui me tourmente. La sœur de Mme Tutcheff, jeune personne très bornée, très sentimentale et très contente d'elle-même, me donne sur les nerfs par ses extases, qui arrivent invariablement dès la première note, et qu'elle a l'air de distribuer toutes chaudes et toutes prêtes, comme les galettes du Gymnase; sa sœur est une nature bien plus élevée et plus sérieuse, mais un peu sèche... Et puis, je le répète, il y a ce terrible absorbant de mari!—Tout cela fait que je reste privé de musique. Cependant, je compte aller l'un de ces jours chez un de nos voisins (à 50 verstes d'ici), qui a tout un orchestre avec un maître de chapelle allemand. Mais je ne puis me figurer ce que peut être un orchestre... acheté, car ce voisin a acheté les musiciens en masse[69]... Je vous en parlerai.
Chère bonne madame Viardot, aujourd'hui, comme il y a neuf ans, comme dans neuf autres années encore, je suis à vous de cœur, vous le savez bien!
4 novembre.
Chère madame Viardot, bonjour. J'espère que je vais bientôt recevoir une lettre de vous; il y a aujourd'hui trois semaines que la dernière m'est parvenue. Je n'ai rien de nouveau à vous raconter. Il fait toujours un temps affreux. J'ai tant persécuté Mme T... qu'elle s'est mise hier au piano et, avec l'aide de sa sœur, elle m'a joué plusieurs fois de suite l'ouverture de Coriolan de Beethoven (à quatre mains). Quel chef-d'œuvre! je ne connais pas d'ouverture qui vaille celle-là.
Vous devez être déjà de retour à la rue de Douai; dites-moi comment vous passez vos journées. Vos samedis continuent-ils? Que lisez-vous? Pour moi, je suis plongé jusqu'au cou dans les chroniques russes. Je ne lis pas autre chose quand je ne travaille pas. Comment trouvez-vous cette fin d'une vieille chanson russe? (Il s'agit d'un jeune homme assassiné et caché «sous un buisson»).
| Ce n'est pas une hirondelle |
| Qui s'agite autour de son nid; |
| C'est une mère qui s'agite autour de son fils. |
| Elle pleure—c'est comme une rivière qui coule; |
| Sa sœur pleure—c'est comme un ruisseau qui court; |
| Sa jeune femme pleure—c'est comme la rosée qui tombe; |
| Le soleil se lèvera; il sèchera la rosée! |
Vous ne sauriez croire ce qu'il y a de grâce, de poésie et de fraîcheur dans ces chansons; je vous en enverrai quelques-unes traduites. Cette promesse me rappelle une autre traduction... Tiens! Et le Jeu du paysan que je ne vous envoie pas! Vous l'aurez dans une semaine, cela me servira de prétexte pour vous écrire encore une fois.
D'ici là, soyez heureuse et bien portante. Mille amitiés à tout le monde.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 20 février 1853.
Chère madame Viardot.
J'ai appris par une lettre de la princesse Mestchersky le départ de votre mari, et par l'Abeille du Nord[70] le jour de votre bénéfice; je vous avoue, sans vouloir vous faire le moindre reproche, que j'eusse préféré savoir tout cela par vous. Mais vous vivez dans un tourbillon qui prend tout votre temps, et pourvu que vous ne m'oubliiez pas, je ne demande rien.
Votre pauvre mari n'a donc pas été en état de résister au climat de Pétersbourg? Il faut espérer qu'il se porte parfaitement à l'heure qu'il est. La princesse Mestchersky m'écrit aussi que vous avez l'intention de demeurer à Moscou dans la maison d'une princesse Galitzine; est-ce vrai? L'argent que je dois à votre mari (150 roubles pour le fusil, 400 pour la pension de Pauline jusqu'au 1er mars 54, et 35 roubles qu'il avait dépensés en plus de ce que je lui avais envoyé, en tout 585 roubles argent), sera chez moi dans trois jours, je vous l'enverrai mardi prochain, c'est-à-dire le 24 février, et vous l'aurez à Pétersbourg avant votre départ pour Moscou.
N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me donner votre adresse à Moscou, et surtout, n'oubliez pas mon photographe!
Je suis très content que vous ayez fait la connaissance de la princesse Mestchersky; sous une enveloppe un peu anglaise et dévote, elle cache un cœur très dévoué et très aimant. Et puis elle a beaucoup d'esprit, et du plus fin. Vous avez décidément fait sa conquête, malgré quelques préventions qu'on lui avait données contre vous et que votre premier abord a dissipées. Elle a été de tout temps très bonne envers moi, et c'est peut-être la seule personne sur laquelle je puisse compter sérieusement à Pétersbourg.
Je n'ai vraiment aucune nouvelle à vous donner de moi; ma santé est passable et je travaille beaucoup. Le dégel a interrompu toute espèce de communication, et je ne vois absolument personne. Heureusement, les journaux arrivent, quoique plus tard que de coutume. Je fais aussi beaucoup de lectures.
Je compte recevoir une lettre dimanche et je vous écrirai un peu plus au long mardi. C'est demain l'anniversaire de la mort de Gogol, et il ne veut pas me sortir de la tête. Je crains de mettre un peu de tristesse dans ma lettre et je préfère l'interrompre.
Adieu, chère amie. Je vous baise les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, le 12/24 mai 1853.
Voici donc que je vous écris de nouveau à Paris, à Londres, à quinze jours de distance d'ici, chère et bonne madame Viardot, à un mois d'aller et de revenir pour une lettre! Il était cruel de vous savoir à Pétersbourg et de ne pas vous voir, mais il était doux de recevoir une réponse dans dix jours. Enfin! comme dit votre mari, il faut s'y résigner.
J'ai reçu votre lettre de Moscou. J'ai été bien étonné d'apprendre que vous n'aviez pas reçu de mes nouvelles. Je vous avais cependant écrit tous les dix jours. Je vais décidément mieux depuis quelque temps; j'ai même été en état de faire une excursion de chasse à 150 verstes d'ici, et j'ai tué pas mal de doubles.
Comment allez-vous après toutes ces courses par chemin de fer? J'attends avec anxiété la lettre que vous m'avez probablement écrite avant de partir pour Varsovie. Je l'aurai probablement demain. Dieu veuille que cette affaire de théâtre à Londres, dans laquelle vous vous embarquez, vous mène à bon port! Il est probable que vous n'aurez que des comparses autour de vous et que tout le poids de la lutte pèsera sur vos seules épaules. Enfin nous saurons tout cela bientôt, j'espère.
Vous continuez à garder le silence sur votre réengagement à Pétersbourg. Je viens de lire dans les journaux que Mlle de la Grange y va. Décidément vous ne revenez plus. Cela m'attristerait beaucoup si je ne pouvais encore garder quelque illusion sur la probabilité de mon retour à Pétersbourg pour l'hiver; mais je ne suis que trop sûr de rester ici[71].
N'abandonnez pas votre projet de venir donner des concerts en Russie l'année prochaine... Votre dernier triomphe, surtout à Moscou, doit vous y encourager. Si vous venez avec V... à Moscou, j'espère bien que vous ferez une pointe jusque chez moi. Mon jardin est splendide à l'heure qu'il est, la verdure y est éclatante, c'est une jeunesse, une fraîcheur, une vigueur dont on ne saurait se faire une idée; j'ai une allée de grands bouleaux devant mes fenêtres, leurs feuilles sont encore légèrement plissées; elles gardent encore l'empreinte de l'étui, du bourgeon qui les renfermait il y a quelques jours; cela leur donne l'air de fête d'une robe toute neuve, où des plis de l'étoffe se voient. Tout mon jardin est plein de rossignols, de loriots, de grives, c'est une bénédiction! Si je pouvais m'imaginer que vous vous y promènerez un jour! Ce n'est pas impossible... mais ce n'est guère probable.
Vous recevrez ma lettre à Londres. N'oubliez pas de demander à Chorley s'il en a reçu une de moi en février, où je lui demande des explications définitives sur un certain auteur du nom de Chenston (il sait de quoi il s'agit). Pourquoi ne me dit-il pas son opinion sur Gogol, et comment va sa santé?
Le 13 mai.
Je vous avais désigné ce jour comme étant celui de la naissance de petite Pauline[72]; d'après un document que j'ai reçu dernièrement, elle est née le 26 avril (8 mai) 1842. Elle a quinze jours de plus que je ne le croyais. Je ne crois pas du reste qu'il soit nécessaire de changer la date. Donnez-moi de ses nouvelles[73]. Dans quatre ou cinq jours, j'écrirai une longue lettre à maman Garcia. Je vous prie de lui embrasser les mains de ma part. Les yeux de Mme Tutcheff vont mieux depuis quelque temps, et nous faisons beaucoup de musique. Elle déchiffre très bien, et a un sentiment très juste de ce qui est beau et vrai. Sa sœur, au contraire, a une tendance naturelle vers ce qui est doucereux et commun, et les larmes lui viennent avec une facilité désespérante... Heureusement qu'elle joue la seconde partie, la basse. Elle a des doigts de coton, et quand elle s'embrouille, elle tâche encore de donner à une note quelconque une expression suave. C'est affreux! Le jeu de Mme T... a beaucoup de fermeté et de rythme. A force de faire répéter mademoiselle, certaines pièces vont très bien. Nous sommes plongés maintenant dans Mozart jusqu'au cou. Je dis nous, car je me tiens derrière les chaises de ces dames, je tourne les feuillets, et je fais le maître de chapelle. Dans les moments d'enthousiasme, je ne puis m'empêcher d'émettre des espèces de sons horriblement faux, sous prétexte de chant, ce qui cause des crispations nerveuses à tous les assistants.
Je me suis remis à mon roman[74]. J'ai six semaines devant moi jusqu'à l'ouverture définitive de la chasse.
Adieu, theuerste Freudin. Soyez heureuse. Mille amitiés à V... J'embrasse tendrement vos chères mains et suis à jamais.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
P.-S.—Avez-vous remis les deux exemplaires de mon livre[75]?
Bellefontaine, le 27 août 1857, jeudi.
Mon cher ami[76],
Je suis arrivé ici à 11 heures et demie, après une très facile traversée, et j'ai trouvé le prince arrivé de Russie de la veille. Il compte faire l'ouverture de la chasse le 4 septembre et il nous engage dès le 3 pour trois ou quatre jours. Il paraît qu'il y a immensément de gibier (j'ai parlé à son garde): perdrix, lièvres, lapins, faisans, chevreuils. Il faudra, d'après ce qu'il dit, détruire trois à quatre cents lièvres, les voisins se plaignent beaucoup; le reste à l'avenant. On m'a préparé deux chiens, que je vais essayer, et j'espère en acheter un. Voici donc comment s'arrangera l'affaire: Je reviendrai à Courtavenel le 29 ou le 30; et le 3, nous partirons ensemble. On arrive à Melun à 10 heures et le chemin de fer repart à 10 heures et demie; c'est très commode.
Mille choses à tout le monde et à revoir.
IV. TOURGUENEFF.
Paris, 16 octobre 1857.
Mon cher ami,
Notre voyage est retardé d'un jour, c'est demain que nous partons. J'ai vu Templier[77], je lui ai parlé de notre traduction[78]. Il dit qu'il ne pourrait pas la faire paraître avant celle de Marmier[79], qui sera un peu retardée par l'envoi des épreuves à Rome.
Il y a dans le Journal des Débats un grand article de M. Ratisbonne sur Manin, très bien fait.
Voici les quelques lignes que je vous propose d'ajouter à la fin des Grands Bois[80]:
«—Allons donc, Yegor», s'écria Kondrate, qui, pendant ce temps, s'était installé sur le devant de la téléga, «viens t'asseoir à côté de moi. A quoi rêves-tu? Est-ce à ta vache?»
«—Sa vache!» répétais-je en levant les yeux sur le grave et placide visage de Yegor. Il semblait rêver en effet et regardait au loin dans la campagne qui commençait à s'assombrir déjà.
«—Oui», continua Kondrate, «il a perdu sa dernière vache cette nuit. Il n'a pas de chance, il faut l'avouer.»
«Yegor s'assit sans mot dire dans la téléga, et nous partîmes... Il savait ne pas se plaindre, lui.»
Quant aux Trois Rencontres[81], je vais tâcher de vous l'envoyer de Rome. Mais le volume est déjà assez rempli comme cela, et vous pouvez le considérer comme terminé, dès à présent.
Mille amitiés à tout Courtavenel. Je vous serre cordialement la main.
Votre tout dévoué.
IV. TOURGUENEFF.
P.-S.—Si vous mettez le Rossignol[82], effacez la phrase: «Dieu qui m'a donné la voix, lui a ôté l'esprit.»
Spasskoïé, 7 juillet/25 juin 1858.
Chère amie,
Je reviens à Spasskoïé après une absence de quatre jours et je trouve votre lettre qui m'annonce la triste nouvelle[83]! Je n'osais pus vous parler de mes pressentiments; je m'efforçais de me persuader à moi-même que tout pouvait encore bien finir,—et voilà qu'il n'est plus! Je le regrette beaucoup pour lui-même; je regrette tout ce qu'il a emporté avec lui; je ressens profondément la cruelle douleur que cette perte vous a causée, et le vide que vous ne remplirez que bien difficilement. Il vous aimait bien! Viardot et Louise doivent être bien tristes aussi tous les deux. Quand la mort frappe dans nos rangs, les amis qui restent doivent se resserrer encore plus étroitement; ce n'est pas une consolation que je vous offre, c'est une main amie que je vous tends, c'est un cœur bien dévoué qui vous dit de compter sur lui comme sur celui qui vient de cesser de battre.
Je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que j'ai vu Scheffer; il avait si bon air que l'idée d'une dernière entrevue ne pouvait pas même se présenter à mon esprit. Il était en train de peindre un Christ avec la Samaritaine; je m'assis derrière lui et nous causâmes longuement. Je lui racontai mon voyage en Italie (c'était dans les premiers jours du mois de mai). Jamais je ne l'ai vu plus affable et de meilleure humeur. Quel coup terrible pour sa fille!
Je suis trop sous l'impression de cette funèbre nouvelle pour vous parler beaucoup de moi. Je vous dirai en deux mots que j'ai passé trois journées fort agréables chez des amis[84]: deux frères et une sœur, excellente personne qui se sent très malheureuse. Elle a été forcée de se séparer de son mari, espèce de Henri VIII campagnard fort dégoûtant; elle a trois enfants qui viennent très bien, surtout depuis que le papa n'est plus là. Il les traitait fort durement par système; il se donnait le plaisir de les élever à la spartiate, tout en menant un train de vie directement opposé. Ces choses-là arrivent souvent: on se donne ainsi les agréments du vice et de la vertu,—ceux de la vertu par procuration.
Des deux frères, l'un est assez insipide, l'autre est un charmant garçon, paresseux, phlegmatique, peu causeur, et, en même temps, très bon, très tendre et délicat de goût et de sentiment, un être véritablement original. Le troisième frère (le comte L. Tolstoï, celui dont je vous ai parlé comme d'un de nos meilleurs écrivains, cela vous fait sourire et vous rappelle Fet, que je vais voir demain, car il est mon voisin;—mais pour Tolstoï: il est sérieusement et pour tout de bon un talent hors ligne, et j'espère bien un jour vous en convaincre en vous traduisant son Histoire d'une enfance. Je ferme ici cette interminable parenthèse). Le troisième frère, dis-je, qui devait venir, n'est pas venu. La sœur est assez bonne musicienne; nous avons joué du Beethoven, du Mozart, etc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 21 juillet 1858.
Chère et bonne madame Viardot,
Je commence ma lettre par une nouvelle affligeante pour tous les Russes. Le peintre Ivanoff, dont je crois vous avoir parlé dans mes lettres de Rome, vient de mourir du choléra à Saint-Pétersbourg.
Pauvre homme! après vingt-cinq années de travail, de privations, de misère, de réclusion volontaire, au moment où son tableau venait d'être exposé, avant d'avoir reçu une récompense quelconque, avant même de s'être convaincu du succès de cette œuvre à laquelle il avait voué toute sa vie,—la mort, une mort subite comme un coup d'apoplexie, mais plus cruelle, car elle ne frappe pas à la tête! Un méchant article de journal qui lui disait des injures, puis des dédains calculés, voilà tout ce que sa patrie lui a offert dans le court espace de temps qui s'est écoulé entre son retour et sa mort. Quant à son tableau[85], il appartient certainement à cette époque de l'art où nous sommes entrés depuis un siècle et plus, et qui est, il faut bien l'avouer, une époque de décadence. Ce n'est plus de la peinture pure et simple, c'est de la philosophie, de la poésie, de l'histoire, de la religion. Il y a des défauts déplorables, mais c'est pourtant une grande chose, une œuvre sérieuse, élevée, et dont il faut désirer l'influence en Russie, ne fût-ce que comme réaction à l'école fondée par Bruloff[86]...
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 30 juillet 1858.
...Voici ce que j'ai fait pendant les neuf jours qui viennent de se passer: J'ai beaucoup travaillé à un roman que j'ai commencé et que j'espère finir pour le commencement de l'hiver[87]; puis je suis allé à la chasse à 150 verstes d'ici et j'y ai perdu inutilement cinq jours, car les marais étaient encore vides, le temps de la migration des doubles et des bécassines n'est pas encore commencé. Je m'occupe en même temps, avec mon oncle, de l'arrangement de mes rapports avec les paysans: à partir de l'automne, ils seront tous mis à l'obroc, c'est-à-dire que je leur céderai la moitié des terres pour une redevance annuelle, et je louerai des travailleurs pour cultiver les miennes. Ce ne sera qu'un état transitoire, en attendant la décision des comités[88]: mais rien de définitif ne saurait être fait d'ici là.
Je viens de vous mentionner un roman que je suis en train d'écrire. Que j'aurais été heureux de vous en soumettre le plan, de vous exposer les caractères, le but que je me suis fixé, etc.; comme j'aurais recueilli précieusement les observations que vous m'auriez faites! Cette fois-ci, j'ai longtemps médité mon sujet, et j'éviterai, je l'espère, les solutions impatientes et brusques qui vous choquaient à bon droit. Je me sens en veine de travail, et pourtant l'ardeur de la jeunesse est déjà loin de moi; j'écris avec un certain calme qui m'étonne: pourvu que l'œuvre ne s'en ressente pas! Qui dit froid, dit médiocre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, le 31 mars/12 avril 1859.
Me revoici dans mon vieux nid, chère et bonne madame Viardot! mais je n'y suis que pour trois semaines. Cette idée m'est surtout consolante, quand je jette un regard par la fenêtre: de la neige et de la boue par terre, de la pluie dans l'air, un grand drap blanc mouillé et sale en guise de ciel, un vent qui gémit comme un enfant malade; c'est vilain! Il est vrai que cela peut, cela doit changer d'un moment à l'autre. Nous aurons des feuilles et de l'herbe dans une semaine, dans cinq jours peut-être! Pour le moment, il n'y a que la présence des corbeaux noirs au bec blanc, des alouettes et des grives, qui nous annonce le printemps. Autres indices: les mouches commencent à sortir de leur léthargie, les moineaux se chamaillent et babillent plus que jamais, une bande d'oies sauvages traverse le ciel, une bouffée de vent, plus chaude qu'à l'ordinaire, nous apporte l'odeur des bourgeons qui se gonflent déjà sur les branches des saules. Cependant vous ne quittez ni pelisse, ni cache-nez, ni bottes fourrées. Les chemins sont impraticables; débâcle générale des rivières! Gare à ceux qui tombent malades en ce moment-ci! pour eux, ni médicaments ni médecins! Molière dirait que c'est précisément ce qui peut les sauver. Impossibilité complète d'aller voir ses voisins, ou de recevoir leurs visites! Mais j'y pense, nous n'avons pas de voisins. Le seul que nous possédions, un bon et charmant garçon, vient de mourir; ce souvenir m'attriste.
J'étais en train de dire mille folies. Les bécasses ne sont pas encore arrivées. Ma chienne et moi nous les attendons avec impatience. Ma chienne Boubout (fille de la pauvre Diane) a dû faire des études de philosophie allemande pendant l'hiver qui vient de s'écouler: je lui trouve le regard d'une profondeur, et toute la physionomie d'une gravité!... C'est extraordinaire! Elle pourrait poser pour le portrait de Lélio, comme expression.
Je suis curieux comment Lady Macbeth vous a réussi. C'est un beau rôle, grand, simple (malgré la ruse de la dame), profond, et pourtant difficile, presque dangereux. Mais, comme dit Lear dans la tragédie de Shakespeare (vous souvenez-vous de la lecture de cette tragédie à Courtavenel sous un acacia en fleurs, et puis dans le coupé de la diligence avec Laure endormie, vous souvenez-vous?): le danger et moi, nous sommes deux lions nés le même jour et dans la même litière; mais je suis l'aîné et le plus fort des deux. Si nous faisions Macbeth à Courtavenel? Je demande à être l'ombre de Banquo, elle ne parle pas.
Je me trouve, à l'heure qu'il est, dans les douleurs de l'enfantement. J'ai un sujet de roman dans ma tête que je tourne et retourne sans cesse; mais jusqu'à présent l'enfant s'obstine à se présenter par les... Voyez dans un dictionnaire de médecine quelle est la moins bonne manière de se présenter... Patience, l'enfant naîtra, peut-être, viable, malgré tout.
A revoir, avant six semaines, je l'espère. Mille bonnes choses à Viardot, à tous les amis. Quant à vous, je vous baise les mains.
Votre,
IV. TOURGUENEFF.
Berlin, hôtel de Saint-Pétersbourg,
ce 11 janvier 1864, jeudi.
Chère et bonne madame Viardot, me voici donc écrivant ma première lettre! L'absence a réellement commencé... Enfin il faut se résigner et penser au retour.
Il y a deux heures que je suis arrivé ici, et je sors d'un lit où je n'ai pas pu dormir, mais où je me suis réchauffé, ce qui était bien nécessaire, vu l'horrible froid de cette nuit. A 4 heures du matin, une espèce de spectre tout blanc de givre (c'était le conducteur) a entr'ouvert la portière pour nous annoncer d'une voix rauque qu'il faisait plus de 18, dix-huit degrés Réaumur! Pourvu que vous n'ayez rien de pareil à Bade! Dieu sait ce qui m'attend en Russie! Aussi vais-je m'acheter une chancelière plus vaste et un second (pardon!) caleçon de flanelle.
J'ai fait une partie de la route avec le descendant dégénéré de Mandrin, le comte Fleuring, qui m'a raconté avec beaucoup de lenteur l'attentat commis il y a quelque temps sur le roi de Prusse à Bade. Il m'a tout naturellement demandé de vos nouvelles, etc. J'ai pu constater qu'il dort très bien en chemin de fer et qu'il ronfle.
Il n'y a nulle part de la neige, mais de la glace partout. Le Mein, à Francfort, charriait d'énormes blocs... J'ai la figure en compote. Voilà à peu près toutes mes impressions de voyage jusqu'à présent.
Je n'ai pas encore vu Pietsch[89]. Je vais de ce pas m'habiller, déjeuner et sortir. Je pars ce soir, et je ne m'arrêterai plus jusqu'à Pétersbourg: cette dent demande à être vite arrachée. Maintenant, mes commissions.
1º Delenda est Carthago, il faut mettre de la flanelle, je veux dire du feutre, dans votre petit salon, des deux côtés et au-dessus de la fenêtre.
2º Des bourrelets partout, utiliser les doubles croisées. La première fenêtre du salon n'a pas été achevée. La salle à manger surtout!
3º Envoyez la métronomisation (quel mot!) de vos mélodies sans tarder.
4º Des nouvelles de vous, de Viardot, des enfants, de tout le monde, du chat; pas de promenade sur l'étang par ce froid-ci.
J'enverrai un télégramme d'ici à Botkine[90]. Je vous écrirai maintenant de la frontière prussienne.
Et maintenant mille et mille souvenirs et amitiés. Je vous baise tendrement les mains.
IV. TOURGUENEFF.
Berlin, hôtel de Saint-Pétersbourg,
jeudi, 14 janvier 1864.
Il est sept heures un quart du soir, chère madame Viardot; dans ce moment vous êtes tous réunis au salon. Vous faites de la musique, Viardot sommeille au coin du feu, les enfants dessinent, et moi, dont le cœur est aussi dans ce salon bien-aimé, je me prépare à redormir encore un peu, si c'est possible, avant de me mettre en route pour Kœnigsberg (le train part à dix heures trois quarts).
J'ai vu Pietsch chez lui, et je l'attends pour prendre une tasse de thé avec moi. Il vous adore plus que jamais; il est très triste et découragé, le pauvre garçon! Pauvre est le mot, hélas! Il m'a fait mille questions sur vous, sur vos enfants, etc., etc... J'ai vu aussi sa femme, qui est bien maigre, et les enfants, qui sont bien jolis. Dites à Viardot qu'il est formellement défendu d'importer un fusil en Russie, et que le sien va faire un séjour forcé chez Pietsch, auquel, du reste, je le recommanderai particulièrement.
Je me fais l'effet d'un homme qui rêve: je ne puis m'habituer à l'idée que je suis déjà si loin de Bade, et les personnes et les objets passent devant moi, sans avoir l'air de me toucher. Une fois à Pétersbourg, je vais travailler des pieds et des mains pour me débarrasser au plus vite.
J'achèverai cette lettre demain à Kœnigsberg, ou sur la frontière et je vous l'enverrai. En attendant, je vous serre la main, et j'ai le cœur bien gros.
Le 15, à une heure.
Me voici à Kœnigsberg. Je pars dans une demi-heure.
Mille amitiés.
IV. TOURGUENEFF.
Bade, hélas non! Saint-Pétersbourg!
Lundi, 18 janvier 1864, Hôtel de France.
Chère et bonne madame Viardot, ma main, en mettant ce nom chéri de Bade au haut de la page, a trahi mes constantes pensées... Je ne suis que trop à Saint-Pétersbourg! Et pourtant, l'instant présent est le plus doux de la journée; c'est celui où je cause avec vous. Je vais donc vous raconter ce que j'ai fait.
J'ai eu des visites de littérateurs dans la matinée, ce qui m'a empêché de sortir de bonne heure: puis, toutes les rues avoisinantes étaient pleines de troupes qui se rendaient à la parade de l'Épiphanie. Il m'a été impossible de pousser jusque chez la comtesse Lambert[91], que je verrai demain pour sûr; j'ai fait deux ou trois visites, puis j'ai dîné chez mon bon Annenkoff[92] avec quelques vieux amis. De là, je suis allé au théâtre entendre l'opéra de M. Séroff, Judith. Eh bien, je dois dire que c'est une œuvre remarquable, malgré des longueurs et des gaucheries impossibles, une exécution pitoyable, des décors idem. Cela procède en droite ligne de Wagner; mais il y a je ne sais quel souffle de passion et de grandeur, où se révèle une physionomie musicale fort intéressante et même originale. La grande scène qui précède le meurtre d'Holopherne m'a vraiment frappé. Mais imaginez-vous (je vous vois rire d'ici) qu'au cinquième acte, Judith arrive la tête de son monsieur à la main, la montre au peuple, puis chante un air avec accompagnement d'arpège sur les harpes, un air bleu de ciel, et qu'il y a même un jeune homme en turban et camard qui l'épouse dans cet instant! Si cette Judith est gravée, je vous l'apporterai. Je suis très curieux de savoir votre opinion. M. Séroff est né des entrailles de Wagner, il est vrai, mais ce n'est pas un trop mauvais fils. On me mène demain soir chez lui.
Le matin je vais au Sénat et je laisse les deux pages suivantes pour y écrire ce qui m'y sera arrivé. J'ai vu au théâtre le prince W..., qui m'a dit avec la gravité qui le distingue: «Wagner a la mélodie chromatique, et Séroff l'a diatonique.» Et je suis allé prendre le thé chez Milutine[93].
Mardi 19/7 janvier 1864.
Avant toute autre chose, merci pour la petite lettre que vous m'avez écrite et qui m'est arrivée ce matin. Elle m'a fait le plus grand plaisir; j'ai des nouvelles de vous et de ce Bade bien-aimé. Merci.
J'ai fait ma visite au Sénat aujourd'hui entre midi et une heure: on m'a introduit avec une certaine pompe dans une grande chambre, où j'ai vu six vieux messieurs en uniforme, avec des crachats. On m'a tenu debout pendant une heure, on m'a lu les réponses que j'avais envoyées. On m'a demandé si je n'avais rien à ajouter, puis on m'a renvoyé en me disant de venir lundi pour être confronté avec un autre monsieur. Tout le monde a été très poli et très silencieux, ce qui est un excellent signe; et, d'après tout ce qu'on dit, l'affaire va se terminer encore plus vite que je ne l'espérais. Tant mieux[94]!
Du Sénat, je suis allé voir ma vieille amie, la comtesse Lambert, que j'ai trouvée souffrante, comme de coutume, mais peu changée. Sa vie est trop triste... Elle a eu du plaisir à me voir et s'est mise à pleurer. Pauvre femme! J'ai redîné chez Annenkoff, et j'ai passé la soirée chez Séroff; je reviens de là. Il nous a joué des fragments de son nouvel opéra, Rognéda; le sujet est tiré de nos anciennes annales. Eh bien, ou je me trompe lourdement, ou ce petit homme bizarre et nerveux a un fort grand talent[95]. Deux chœurs surtout, et un air d'adolescent d'une pureté vraiment mozartesque, m'ont transporté... Ma foi! j'ai dit le mot, je le laisse. C'est pour le coup que j'aurais voulu, moi aussi, vous avoir à mes côtés pour pouvoir contrôler mes impressions et lire dans vos traits la confirmation, ou peut-être la négation de mes sentiments. Cette Rognéda me paraît devoir devenir bien supérieure à Judith; il y a beaucoup plus de franchise et d'originalité, et l'influence de Wagner se fait-bien moins sentir[96]. Il se démenait comme un diable devant son piano et chantait d'une voix impossible. Ce Séroff est un très grand coloriste et manie l'orchestre d'une façon magistrale. Enfin, je suis revenu sous le charme et j'y suis encore.
Il faut que vous m'écriviez sans perdre de temps les dates exactes de votre séjour à Leipzig, Erfurt, etc., pour que je sache où vous écrire. Il ne fait pas froid du tout ici; j'espère qu'il ne gèle pas si fort à Bade et que les petits ont repris leur traîneau. Travaillez-vous beaucoup? Dites mille choses de ma part à tout le monde. Je vous baise les mains.
Der Ihrige
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, 31/19 janvier 1864.
Theuerste, beste Freundin,
J'ai reçu aujourd'hui votre lettre datée du petit salon; je vous en ai écrit deux à Leipzig, en les adressant à P. V. beruhmte Sängerin[97], an Gewandhaus; j'espère qu'elles vous seront parvenues. Si pourtant vous ne les aviez pas reçues, je me borne à vous dire que mon affaire avec le Sénat est finie, et que j'ai reçu l'assurance qu'on ne me refuserait pas la permission d'aller où bon me semble, même hors du pays, ce qui fait que dans un mois je quitte Pétersbourg.
Mon pied ne me fait plus mal du tout et ma toux a disparu. A l'exception de deux ou trois jours de froid, le temps a été très doux depuis mon arrivée ici.
J'ai assisté hier à une excellente représentation de Fidelio: tous les rôles étaient remplis par les premiers sujets. Calzolari faisait Florestan, et Mme Barbot est un peu insuffisante comme voix et comme jeu surtout dans la grande scène: mais il y a un je ne sais quel souffle poétique dans ce qu'elle fait. C'est trop élégant quelquefois, et trop français; elle se donne beaucoup de peine et chante avec conscience. Bocco et le tyran (Angiolini et Evenardi) étaient parfaits. Le vieux Botkine se pâmait à mes côtés, et je dois dire que la musique m'a fait un effet extraordinaire; j'ai applaudi comme un claqueur.
Aujourd'hui, j'ai entendu le quatuor 127 (posthume) de Beethoven, joué à la perfection par Wieniawski et Davidoff. C'était bien autre chose que Maurin et Chevillard. Wieniawski a énormément gagné depuis que je l'ai entendu pour la dernière fois; il a joué la Chaconne de Bach pour violon seul, de façon à pouvoir se faire entendre même après l'incomparable Joachim.
Je commence à croire que ma nouvelle ne paraîtra pas; mes amis sont un peu effrayés et murmurent le mot d'«absurde»! Vous pouvez vous imaginer ce que dira le public[98]! Je regrette un peu la somme assez ronde que cette machine m'aurait rapportée; mais il ne faut pas s'exposer à ce qu'on vous paye moins plus tard... Je suis tout stupéfait moi-même des profonds calculs que je fais là.
Un littérateur de mes amis, du nom de Droujinine, est mort ce matin; il y a longtemps qu'il était malade (de la poitrine), et je l'ai vu quelques jours après mon arrivée: c'était un spectre. Il s'est endormi tranquillement, il n'a pas souffert. La mort est une grande et terrible chose, et si elle pouvait entendre ce qu'on lui dit, je la supplierais de me laisser encore sur la terre. Je veux vous voir encore, et pendant longtemps, si c'est, possible. O ma chère amie, vivez longtemps et laissez-moi vivre auprès de vous tous. Adieu, à après-demain. Dites mille choses à Viardot et à Mlle ***. Quant à vous, je vous baise les mains avec Innbrunst.
Der Ihrige
IV. TOURGUENEFF.
Paris, 16 février 1865.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....Je n'ai été à aucun théâtre. Décidément, cela ne m'amuse pas d'y aller... seul. J'ai assisté à l'ouverture des Chambres, dans la grande Salle des États du Louvre. Nous étions pressés comme des harengs. Trois choses m'ont frappé: le caractère exclusivement militaire de cette cérémonie (le seul passage applaudi est celui où l'on parle d'un nouvel arc de triomphe à ériger), l'absence complète et absolue de jolies figures féminines, et le timbre de la voix de l'empereur. Si on pouvait noter des voix comme on dessine des têtes, on dirait que c'est un professeur suisse qui parle,—un professeur de botanique ou de numismatique. Le discours en lui-même est très anodin, très pacifique—et ambigu, cela va sans dire.
L'impératrice avait une robe fort laide, mais elle a beaucoup de grâce et de dignité. Le prince impérial a l'air bien chétif et bien éteint. Le prince Napoléon a une vraie tournure de Tibère ou de Domitien. Je devais dîner avec lui hier chez Bixio, mais j'ai refusé cet honneur. Je ne l'aime pas du tout, et puis il a parlé avec trop de mépris de mes pauvres Russes. Rien de plus ridicule que certaines figures encapuchonnées, affublées d'uniformes: les toques rouges, jaunes, bariolées, dorées des avocats et des juges avaient un faux air oriental à mourir de rire. Que de cordons, de plaques, de dorures, de casques, de panaches! Grand Dieu! et dire que toute cette friperie fait de l'effet!... Que dis-je? elle conduit le monde...
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 1er juillet 1865.
Chère et bonne madame Viardot,
...Je suis tout enchanté de ce que M. Rietz[99] (dont je regrette beaucoup de n'avoir pas fait la connaissance) vous a dit. Cela doit vous donner des ailes. C'est bien autre chose que ce que nous autres, dilettantillons, avons pu vous dire,—et si vous ne faites pas des sonates, si je ne trouve pas à mon retour quelque bel adagio à peu près achevé, il me faudra vous gronder. Je m'imagine, en effet, que l'idée musicale doit se déployer avec plus d'ampleur et de liberté quand on n'a pas un cadre tracé d'avance, d'une couleur, d'une forme déjà déterminées, et déterminées par un autre.
Allons! au travail! Je ne l'ai tant admiré et encouragé que depuis que je ne fais rien moi-même. Eh bien, non! Je vous donne ma parole d'honneur que si vous vous mettez à faire des sonates, je reprendrai ma besogne littéraire. «Passez-moi la casse, je vous passerai le séné.» Un roman pour une sonate: cela vous va-t-il? Dieu! quelle perspective d'activité fiévreuse se dévoile devant moi. Il y en a pour tout l'hiver.....
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, rue Karavannaïa,
lundi 4/16 mars 1867.
Chère madame Viardot,
Je vais dire ce que j'ai fait depuis deux jours. J'ai vu le pauvre Milutine, il parle sans trop d'effort, mais il prend constamment un mot pour un autre. Il a oublié les lettres, les chiffres, il m'a demandé si je voulais donner ma voiture à un aqueduc, c'est-à-dire mon roman à une revue: Vanitas vanitum et omnia vanitas! Lui si brillant, si intelligent, si énergique... un enfant qui balbutie! Son bras et sa jambe sont complètement immobiles... l'homme peut survivre, mais Milutine est mort.
Mon pied va beaucoup mieux, je n'ai presque plus besoin de canne, et cela malgré le froid horrible qu'il fait: vingt et vingt-deux degrés! Botkine et moi nous avons passé la soirée d'hier chez Mme Abaza. Elle a organisé des chœurs de jeunes demoiselles, et cela ne marche pas trop mal. Nous y avons trouvé Rubinstein et sa femme. Il a joué comme un lion, en secouant un peu trop sa crinière... musicalement parlant. On a beaucoup parlé de vous.
Mes deux machines font beaucoup de bruit à Pétersbourg, on voudrait me faire lire à droite et à gauche, mais j'ai autre chose à faire. J'écrirai à Bade, à Viardot, à Marianne[100] et à Mme Anstett, dès demain.
Aujourd'hui j'embrasse tout le monde et vous serre cordialement les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, Karavannïa, 5/17 mars 1864.
Chère et bonne madame Viardot,
J'ai reçu hier le télégramme de Viardot qui m'annonce votre arrivée à Bade. Je pars demain pour Moscou, et j'espère y trouver une lettre de vous ou de Viardot, peut-être des deux.
Mon pied est revenu à son état chronique, ni bien, ni trop mal; je marche sans bâton à peu près, mais je boite, et il me semble qu'il est devenu plus court que l'autre. Espérons qu'il sera remis complètement pour l'époque de la chasse.
J'ai eu un très grand plaisir avant-hier soir; Mme Niessen-Saloman m'a invité de venir assister à une des soirées que le Conservatoire donne une ou deux fois par mois. J'y ai entendu une Mlle Lavroska[101] chanter avec beaucoup de goût et une belle voix de mezzo-soprano votre Tsvetok[102] (Fleur desséchée), et Schopote (le Murmure), Suda! (Evocation)[103]. Le public, très difficile d'ailleurs, a applaudi à tout rompre. Mme Niessen m'a chargé de mille choses pour vous. Le vieux Pétroff[104], qui se trouvait aussi à cette soirée, m'a parlé de vous avec des larmes dans les yeux, et m'a assuré qu'il ne se passait pas de jour sans qu'il ne pensât à vous. Tout cela m'a fait naturellement beaucoup de plaisir, et je vous le dis, parce que je suis sûr que cela vous en fera aussi.
IV. TOURGUENEFF.
Dimanche soir.
Je suis allé voir ce matin Mme Skobeleff, qui parle de vous avec enthousiasme. Olga, sa seconde fille, qui par parenthèse a grandi énormément, a joué du piano d'une façon charmante, avec un sentiment poétique et musical fort rare dans le monde où elle vit. Il faut espérer qu'elle ne fera pas comme sa sœur, qui a complètement abandonné la musique.
J'ai oublié de vous dire que nous avons eu hier soir une séance de quatuors chez Mme Abaza. On a commencé par un trio de Rubinstein, joué par lui-même (et j'avoue que sa manière de vouloir toujours changer le piano en orchestre finit par me donner sur les nerfs). Puis on a joué un Schumann et deux Beethoven de la dernière époque, très bien, ma foi! Botkine a fait ronron. Mme Rubinstein est venue avec son mari, elle est toujours aussi gentille. Rubinstein quitte décidément le Conservatoire, malgré toutes les génuflexions qu'on exécute devant lui. J'ai vu à la même soirée Mme de Radhen, dame d'honneur de Mme la grande-duchesse Hélène, qui est toujours aussi aimable et qui, je crois, a beaucoup d'affection pour vous.
Je n'ai pas perdu mon temps ici. J'ai travaillé plusieurs scènes de mon roman[105]; j'ai tout arrangé avec mon intendant. Je ne m'arrêterai à Moscou que le temps nécessaire pour voir Katkoff[106] et lui remettre mon manuscrit qu'on mettra à l'impression aussitôt... Mais je rabâche, je crois vous avoir déjà parlé de tout cela.
Lundi soir.
Mon départ a été retardé d'un jour. Il y a un papier d'affaire à refaire. Je pars demain senza dubbio.
Ce soir je suis à un grand concert de la musique d'avenir russe, car il y en a aussi. Mais c'est absolument pitoyable, vide d'idées, d'originalité. Ce n'est qu'une mauvaise copie de ce qui se fait en Allemagne. Avec cela une outrecuidance renforcée de tout le manque de civilisation qui nous distingue. Tout le monde est jeté dans le même sac: Rossini, Mozart et jusqu'à Beethoven... Allez donc!... c'est pitoyable...
Je pars demain à deux heures. Je vous écrirai de Moscou. En attendant, je dis mille et mille bonnes choses à tout le monde et vous embrasse tendrement les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, jeudi 9/21 mars 1867.
Me voici donc ici, theuerste Freundin! installé dans une bonne chambre avec un jardin tout enseveli sous des édredons de neige; devant ma fenêtre, et au delà des arbres, une petite église byzantine rouge avec des toits verts, dont la sonnerie m'a réveillé ce matin.
Il y a aujourd'hui trois semaines que j'ai quitté Bade... puissé-je être de retour dans quatre! Je vais y travailler de toutes mes forces... Une fois le voyage de Spasskoïé derrière moi, le reste ira plus facilement. Vous pouvez croire que je me soigne beaucoup pour éviter toute espèce de retard. Le pied va assez bien.
Et vous, que faites-vous? Jamais je n'ai eu aussi peu de nouvelles de vous que pendant cette absence. Je sais par un télégramme de Viardot, envoyé il y a une semaine, que vous étiez arrivés à Bade; mais ensuite que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Ma pensée s'occupe incessamment de ces questions. Je n'ai pas trouvé de lettre chez Katkoff; peut-être en viendra-t-il une aujourd'hui.
Vendredi matin.
Non, il n'est pas arrivé de lettre, j'ai envoyé hier un télégramme avec réponse; je ne puis pas rester dans cette incertitude. La réponse n'est pas encore venue... elle viendra pourtant.
Je pars demain pour Spasskoïé. Mon manuscrit est déjà à l'imprimerie. Je compte être de retour dans une semaine. Ecrivez-moi à l'adresse de Massloff. Mon pied va presque bien, je n'ai plus de canne.
Vendredi 2 heures.
La réponse est venue enfin; elle m'a tranquillisé, quoique j'eusse désiré au mot de «santés» une autre épithète que «passables». La grande question n'est pas résolue, elle le sera probablement sous peu de jours. Je ne puis vous dire quelle sehnsucht j'ai pour Bade et combien chaque jour me semble long et pesant!
J'ai passé la soirée d'avant-hier chez M. Pissemsky, un de nos bons littérateurs[107]. Je ne sais si vous vous rappelez quelques fragments d'un roman que je vous ai traduit et qui vous ont frappée par leur verve brutale. Il y avait plusieurs dames chez lui; dans le nombre une Mlle Savitzki, qui, à ce qu'on dit, a un talent d'actrice hors ligne, et dont la figure, quoique laide, avait en effet quelque chose de remarquable, des sourcils et des yeux tragiques.
J'ai écrit à Viardot une petite lettre dans laquelle je donne quelques détails sur mes faits et gestes depuis mercredi, jour de mon arrivée chez l'ami Massloff.
J'ai vu mon frère, qui est aussi en train de s'acheter une maison à Moscou; il a l'air mieux portant et plus dispos que dans ces derniers temps.
Hier au soir, je suis allé chez le long W..., pour voir sa sœur, une princesse T..., très aimable femme; Mme W... parle de Bade avec le plus vif regret. J'ai fait chorus, comme vous pouvez bien l'imaginer.
A propos, le bruit s'était répandu ici que Z... avait tué son valet de chambre. Mme Anstett serait-elle passée par là?... Ayez la bonté de saluer de ma part cette bonne femme et dites-lui que je lui écrirai dès mon retour de la campagne. Oh! Mme Anstett, et Pégase, et la gare d'Oos, quand vous reverrai-je?
Ecrivez-moi, je vous en prie, donnez-moi quelques détails. Mille amitiés à tout le monde et les souvenirs les plus affectueux pour vous.
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, 14/26 mars 1867.
Ouf! chère madame Viardot, quelles journées je viens de passer! Je vais vous les raconter en détail. Vous vous rappelez que je devais partir samedi pour Spasskoïé; je me suis mis en route, en effet, vers cinq heures et demie, avec un valet de chambre et mon intendant. Il y a un chemin de fer qui va d'ici à une ville nommée Serpoukhoff, à 90 verstes de Moscou; un traîneau ouvert m'y attendait pour continuer le voyage. Je ne me sentais pas bien dès le matin; à peine établi dans un wagon, je fus pris par une toux violente qui ne fit que croître et embellir; arrivé à la gare de Serpoukhoff, qui se trouve à quatre verstes de la ville, je m'installai pourtant dans mon traîneau; mais grâce aux épouvantables oukhabi (vous savez ce que c'est)[108] de ces affreuses quatre verstes, j'atteignis Serpoukhoff avec une vraie fièvre de cheval. Impossible de songer à continuer le voyage. Je passai une nuit blanche dans une misérable chambre d'auberge, avec cent pulsations à la minute et une toux qui me brisait la poitrine, et dès sept heures du matin, je dus, dans ce triste état, me soumettre de nouveau à la torture des oukhabi et regagner plus mort que vif le chemin de fer et Moscou. La maison de Massloff me sembla un vrai paradis après cet enfer. J'envoyai chercher vite un médecin et, grâce aux sudorifiques, purgatifs et autres médicaments, me voici aujourd'hui capable de vous écrire et de vous raconter mes misères. Cela n'a été qu'une assez forte bronchite; dans trois ou quatre jours, il n'y paraîtra plus.
Mais voyez-vous le contretemps! Le voyage de Spasskoïé est plus indispensable que jamais. J'ai envoyé mon intendant prendre les devants; il faut que je recommence ma tentative, et nous sommes ici en Russie, à la veille du temps où toutes les communications cessent, grâce à la fonte des neiges. Si mon oncle voulait être raisonnable et laisser les choses s'arranger par écrit! Mais il ne le sera pas, ne le voudra pas. J'ai pourtant rassemblé toutes mes forces, je lui ai écrit aujourd'hui une longue lettre: peut-être fera-t-elle quelque impression sur lui[109]. Mais je me console à l'idée que cela aurait pu être plus grave. Je vous tiendrai au courant de ce qui m'arrivera.
J'ai eu un autre grand plaisir en rentrant avant-hier à la maison: j'ai trouvé vos deux lettres; celle que vous aviez adressée à Pétersbourg et l'autre, avec l'adresse de Massloff (fort exactement écrite), et la lettre de Viardot. Si l'inventeur du télégraphe électrique est un grand homme, l'inventeur de l'écriture, Cadmus, je crois, n'est pas à dédaigner. Quelle charmante chose que cette feuille de papier qui vient à vous à travers l'espace et qui apporte l'empreinte physique et morale d'une vie qui vous est chère! J'ai lu et relu ces chères lettres et je crois que c'est ce qui m'a guéri. Vous verrez que je finirai par devenir amoureux de la reine et de toute la maison royale de Prusse; ils sont vraiment bien gentils avec vous. Cela leur fait beaucoup d'honneur, mais je ne leur en suis pas moins reconnaissant.
On me promet de m'apporter demain les premières épreuves de mon roman[110]. Quand je pense que toutes les choses pour lesquelles je suis venu en Russie ne font que commencer... Il ne faut pas que je m'appesantisse trop sur ces pensées, ma fièvre me reprendrait.
Je continuerai demain, j'espère être en état de vous dire que je suis guéri. Mon pied est à peu près revenu à son état normal; j'inaugure la botte dans trois ou quatre jours, quand je pourrai sortir.
Mercredi.
Ma bronchite a disparu ou à peu près; elle a été courte et bonne. Je recommence après-demain l'assaut de Sébastopol. Je ne resterai que deux jours à Spasskoïé; je vous écrirai encore d'ici là. Oh! quelle corvée, quelle corvée que tout ce voyage! Enfin, pourvu que tout aille bien chez vous. Mille amitiés au bon Viardot (j'espère que son lumbago a disparu comme ma bronchite), à tout le monde; je vous serre les deux mains de toute la force de mon attachement. Portez-vous bien.
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, 17/29 mars 1867.
Chère madame Viardot, theurste Freundin, ma grippe a disparu et ne m'a laissé qu'une toux stomachique qui cèdera à son tour à l'influence du printemps, quand il viendra, ou plutôt à celle de l'air de Bade, que je compte bien respirer avant vingt jours.
L'impression a commencé avec vigueur, et je passe ma journée à relire des épreuves. C'est peu agréable d'avoir ainsi son nez constamment enfoui dans sa propre odeur, mais c'est indispensable.
Si je n'avais pas ce boulet de voyage à Spasskoïé accroché à mon pied, quelle bonne fugue je pourrais faire immédiatement! Mais ce voyage est inévitable; et par quels chemins, par quel temps, eterni Dei! Dans ce moment même, nous avons un ouragan de neige qui fait mal au cœur à voir. Il n'y a de vert ici devant les fenêtres que les toits des maisons.
On parle beaucoup ici de ce qui se passe en France, des derniers débats à la Chambre; on croit généralement que c'est le commencement de la fin, et l'on est persuadé en même temps que dès que l'Exposition sera à peu près finie, votre maître essayera de sortir de sa cruelle position par un coup de tête désespéré, où la question d'Orient (et nous par conséquent) jouera un grand rôle.
En attendant, nous sommes ici en pleine fièvre de chemin de fer. Les commissions pleuvent de tous côtés, les compagnies surgissent partout. On pourra aller de Moscou à Mtsensk dès le mois de septembre (pas maintenant, hélas!), et dans trois ans je pourrai faire le voyage de chez moi sans même toucher Moscou, directement par Vilna, Vitebsk et Orel. Tout ceci est parfait, mais pour le moment, les oukhabi m'attendent gueule béante. Si ces affreux précipices étaient tout droits encore! Mais ils ont de faux mouvements dans leur fond, qui vous font éprouver à s'y méprendre l'effet du roulis d'un vaisseau, plus les tapes que l'on reçoit sur le sommet de la tête et sur les flancs, les reins, etc. Je n'oublierai pas de sitôt les charmantes quatre verstes qui séparent Serpoukhoff de la gare du chemin de fer! Elles m'attendent encore de pied ferme, ces scélérates de verstes! Enfin! enfin! patience!!
Portez-vous bien, je vous en conjure, vous tous à Bade. Je répondrai à Viardot; dites-lui que je le remercie de sa bonne lettre. J'espère qu'il est enfin parvenu à abattre des bécasses. Le temps continue ici à être à la diable; les épreuves vont ferme.
Mille millions de bonnes choses à tout le monde; j'embrasse vos chères mains.
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, 19/31 mars 1867.
Chère et bonne madame Viardot, votre charmante lettre, avec son parfum printanier, avec ses petits brins d'herbe et de fleurs, est venue bien à propos. J'étais dans un mauvais moment et j'avais besoin d'une bonne bouffée comme celle-ci.
Mon pied me fait mal depuis vingt-quatre heures, on dirait que c'est une rechute, et pourtant je suis aussi prudent que possible.
J'ai reçu, non pas une lettre, mais un hurlement de mon oncle qui me traite d'assassin pour n'être pas venu à Spasskoïé, comme si cette grippe, qui m'a saisi au passage, n'eût été qu'une invention de ma part! Que ne donnerais-je pour avoir cet infernal voyage de Spasskoïé derrière moi! Et voici les chemins qui deviennent impraticables, la fonte des neiges s'établit, on ne pourra plus aller bientôt ici sur patins, ni sur roues. Que faire, bon Dieu! Je ne puis pas cependant me risquer dans ces casse-cou, avec cette goutte qui me reprend, avec la toux qui ne me lâche pas encore! D'un autre côté, me voici embarqué dans la publication de mon roman; cela va me retenir à Moscou pendant une semaine encore. Quand je pense que si je n'avais pas cette excursion à Spasskoïé devant moi, rien ne s'opposerait à ce que je fusse à Bade dans quinze jours! C'est là seulement que je serai guéri.
19 mars/1er avril.
J'ai passé une partie de la nuit à écrire deux longues lettres à mon oncle et à mon nouvel intendant, qui doit se trouver dans une situation horriblement embarrassante. Il y a un proverbe russe qui compare les exhortations inutiles à des pois chiches qui rebondissent, lancés contre une muraille. Je crains bien que mon oncle soit cette muraille et que mes pois chiches vont me sauter au nez.
Je me suis traîné hier matin à un concert de musique de chambre avec Laub, Cossmann (qui par parenthèse me dit de le mettre à vos pieds), et M. Rubinstein[111]. On a joué un délicieux quatuor de Mozart, en si bémol majeur de Beethoven et l'ottetto de Mendelssohn. Laub est un peu trop uniformément doux pour Beethoven, M. Rubinstein joue mieux que son frère, plus simplement et plus correctement. L'ottetto de M... m'a semblé faible et vide après les deux autres. C'est de la littérature musicale fort bien faite,—un article de la Revue des Deux Mondes,—tandis que les deux colosses sont des poètes von gottes gnaden et font des choses qui ne doivent pas mourir. Le public a été très chaud. Serge Wolkoff s'est approché de moi et m'a demandé de vos nouvelles; il est presque aussi blanc que moi. C'est pourtant bizarre comme la vie s'en va vite, vite, vite.
J'ai dû faire une lecture de ma petite nouvelle hier soir chez Katkoff. Il y avait beaucoup de monde, peu sympathique. J'ai débuté et fini par une quinte de toux longue d'une aune. Je crois que cette bagatelle a plu. Katkoff me l'a retenue pour sa revue, c'est le principal[112]. Il m'a réitéré la promesse de me faire délivrer les dernières épreuves vendredi[113]. Je pourrai quitter Moscou dès dimanche. Que ferai-je la semaine prochaine? Je vois bien qu'il faudra avaler la couleuvre. Enfin, vous le saurez d'avance.
Merci, mille fois merci pour vos chères lettres: elles me sont bien nécessaires, elles me donnent du courage. J'embrasse les enfants, je dis mille amitiés à Viardot, à Louise, à tout le monde: et je fais comme Cossmann, je me mets à vos pieds.
Portez-vous bien et au revoir.
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, 4 avril/23 mars 1867.
O theuerste Freundin, que vous êtes donc bonne de m'écrire si souvent! Depuis que je suis ici, je ne puis me défendre d'une impression étrange: il me semble que je suis en prison; et je suis emprisonné en effet par le mauvais temps, par la neige sale et vilaine qui rend les rues impraticables, et puis ma jambe, qui me permet à peine de me traîner dans les vastes chambres de la maison que j'habite... et cette toux qui ne me lâche pas... Eh bien! vos lettres sont comme des messagers de liberté! Elles semblent me dire que, dans peu de jours, toutes ces entraves tomberont et je redeviendrai ce que j'ai été jusqu'à présent. Je compte les instants... onze jours encore... c'est bien long. Oh! que j'en ai assez de cet hiver interminable, de tout ce que je vois, de tout ce qui m'entoure!...
Voyons, je vais vous raconter quelque chose. J'ai lu deux fois l'Histoire du lieutenant; la première fois chez M. Katkoff, qui me l'a immédiatement achetée, et où j'ai été cruellement agacé par Mme X..., qui n'a cessé de se gratter le nez, de s'arranger, de se tasser, de se frotter les yeux et le ventre (elle est grosse de son quinzième enfant), pendant tout le temps. J'étais assis auprès d'elle et je ne voyais qu'elle, car je tenais mon nez plongé dans mon cahier; je l'ai trouvée fort laide et disgracieuse, ce qu'elle est du reste, lecture à part. La seconde fois, ça a été chez la femme du prince Tcherkaski, du même prince T... qui a été ministre de l'Intérieur en Pologne, et qui a donné sa démission après la maladie de Milutine. On était en petit comité, des gens d'esprit s'intéressant peu aux choses littéraires, des dames sur le retour et dévotes, sans fiel pourtant, et un imbécile à la mode, bon enfant et enthousiaste. Le long Wassittchikoff était du nombre; ce n'est pas pourtant lui l'imbécile. Ma petite plaisanterie a plu tout en scandalisant un peu... Je dois ajouter que faire une lecture est une vraie corvée pour moi, je ne puis m'empêcher d'avoir un secret sentiment de honte. Et après-demain donc!... lecture publique avec tout le bataclan... Je vous donnerai tous ces détails...
Je termine brusquement cette lettre, car il faut que je l'envoie sur-le-champ à la poste. Ma santé n'est pas trop fameuse non plus... Mon pied me fait mal, je tousse... Enfin! patience... patience!...
J'embrasse toute la maisonnée et vous serre les deux mains avec toute la force d'un attachement inaltérable.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, Comptoir des Apanages.
6 avril/25 mars 1867.
Si j'étais le comte Michel Wilhorski, chère madame Viardot, je serais fermement convaincu que l'année de 1867 est une année «climatérique» pour moi. Tout va à la diable et je reçois toujours einen Strich durch die Rechnung. Vous savez déjà que je devais lire aujourd'hui en séance publique un fragment de mon roman: eh bien! hier soir, vers dix heures, j'ai été pris d'une attaque de goutte à l'orteil tellement violente, que rien de tout ce que j'ai eu jusqu'à présent ne peut s'y comparer: j'ai souffert toute la nuit comme un damné, et ce n'est que depuis une heure ou deux que l'accès se calme. Naturellement, la lecture est tombée à l'eau. A une heure et demie, au moment où le public «accourait en foule» (il paraît en effet qu'il y avait foule), j'étais couché sur le dos, et mon pied nu levé vers le ciel. Dites à Didie[114] de faire un dessin là-dessus. L'accès se calme à l'heure qu'il est, mais ce qui me tourmente, c'est qu'il ait pu avoir lieu, après plus de trois mois de maladie: quand cela finira-t-il, et sur quoi puis-je compter?
Voilà mon départ de Moscou retardé, car il faut que je tienne ma promesse et que je fasse cette malencontreuse lecture, et mon arrivée à Bade, retardée aussi: ce n'est plus le 15 que je pourrai revoir ces endroits chéris! Et si je pouvais me reprocher la moindre imprudence! Mais rien, une vie exemplaire, une vie d'ascète, de saint Jean-Baptiste... et crac! un accès... Vous comprendrez aisément, et sans que j'aie besoin de vous l'expliquer, combien tout ceci m'est pénible... Oh! vilaine, vilaine année climatérique!
Dimanche.
Cela va mieux, mais je ne puis pas encore marcher, c'est-à-dire poser le pied à terre, je suis obligé de me traîner le genou sur une chaise; pourtant je ne désespère pas de pouvoir faire ma diablesse de lecture mercredi, de façon que je pourrai m'en aller jeudi... Mais je ne veux plus rien prévoir, je ne veux plus employer le futur; tout me crève toujours dans la main.
Je viens d'avoir encore une longue conversation avec Katkoff, qui, après des compliments à perte de vue sur mon roman, a fini par me dire qu'il craint qu'on ne reconnaisse dans Irène[115] une certaine personne, qu'en conséquence il me conseille de retrancher le personnage. J'ai refusé net, pour deux raisons: la première, c'est que son idée n'a pas le sens commun et que je ne veux pas, pour lui complaire, gâter toute une besogne; la deuxième, c'est que toutes les épreuves sont corrigées et revues et que ce serait tout un travail à refaire, qui prendrait encore dix jours de temps. Assez de Moscou comme cela! Je vous jure que je me sens ici comme en prison.
Dimanche soir.
Je viens de recevoir votre lettre ainsi que celle de Viardot... Pauvres petits enfants, avec leur poisson d'avril!.... Je n'ai pas pu y contribuer, et Massembach est dans un piètre état... L'année 1867 aura, vous verrez, la même influence pernicieuse sur mon second architecte, et un beau matin patatras! on entendra un grand bruit dans la vallée de Thiergarten... c'est la belle maison de M. Turkaneff ou Dourganif[116] qui sera écroulée... Et je ne verserai pas de flammes.
Rien de nouveau depuis ce matin. Le temps est exécrable, toujours cette sale neige devant les yeux... Oh! comment faire pour s'en aller! Je ne dis plus rien, je ne fais plus de projets. Was geschehen soll, wird geschehen, comme dirait notre profond professeur de philosophie, Wender, à Berlin.
En attendant, le pauvre goutteux embrasse tout le monde et se recommande à vos prières.
Je répondrai à Viardot avant de m'en aller, et je vous embrasse les mains avec la plus affectueuse amitié.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, 9 avril/28 mars 1867.
Année climatérique, année climatérique, chère madame Viardot, je ne sors pas de là. Voici que mon pied va mieux et ma lecture ratée samedi doit avoir lieu demain mercredi. Autre misère: M. Katkoff me fait de si grandes difficultés pour mon malencontreux roman, que je commence à croire qu'on ne pourra pas le publier dans sa revue. M. Katkoff veut à toute force faire d'Irène une vertueuse matrone et de tous les généraux et autres messieurs qui figurent dans mon roman, des citoyens exemplaires; vous voyez que nous ne sommes pas près de nous entendre. J'ai fait quelques concessions, mais, aujourd'hui, j'ai fini par dire: «Halte là!» Nous verrons s'il cédera. Quant à moi, je suis bien décidé à ne plus reculer d'une semelle. Les artistes doivent avoir aussi une conscience et je ne veux pas que la mienne me fasse des reproches. Enfin, vous voyez quel embrouillamini que tout cela, et vendredi, coûte que coûte, je dois pourtant partir. Je vous jure que quand je me verrai enfin à Bade, je pousserai un ouf! à faire trembler toutes les montagnes de la Forêt Noire.
Cela se gâte aussi, naturellement, du côté de mon oncle. Avec tout cela, le temps est mauvais et toujours cette neige devant les yeux, j'en deviendrai malade!
Mais parlons d'autre chose. Je suis véritablement épris de la reine de Prusse, et si jamais elle me donnait sa main à baiser, je le ferais avec le plus grand plaisir. Il est impossible d'être plus gracieuse, et on sent qu'elle a pour vous une véritable affection, ce qui la rend charmante à mes yeux. Avec tout cela, il n'est pas impossible que votre marche militaire ne retentisse sur un champ de bataille... dans les environs du Rhin. On est très inquiet ici; la baisse terrible à Paris que le télégraphe nous a annoncée aujourd'hui commence à faire rêver les plus insouciants et l'on se dit que, malgré l'Exposition, Français et Prussiens pourraient bien en venir aux mains pendant le cours de l'été. Il ne faut pas s'y tromper; si cela arrivait, la Russie se mettrait franchement du côté de la Prusse, comme en 1815. L'opinion publique est très antifrançaise dans notre pays, et voyez la bizarrerie: dans ce conflit, ce serait le Prussien qui représenterait le progrès, la civilisation et l'avenir, et le Français, le fils du Français de 1830, la routine et le passé!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je sais que c'est insupportablement long et ennuyeux de copier de la musique; mais faites-le, et pour Gérard et pour l'éditeur de Berlin. Je suis sûr que cela aura grand succès et vous encouragera à continuer.
Si Dieu me prête vie, dans une semaine à pareille heure j'aurai déjà franchi la frontière, mais on ne peut rien savoir de positif. En attendant, mille et mille amitiés à tout le monde; je vous embrasse les mains avec tendresse.
IV. TOURGUENEFF.
Moscou, mercredi 10 avril 1867.
Chère madame Viardot,
Un ouragan de neige souffle, geint, gémit, hurle depuis ce matin à travers les rues désolées de Moscou; les branches s'entre-choquent et se tordent comme des désespérées, des cloches tintent tristement au travers: nous sommes en plein grand Carême... Quel joli petit temps! quel charmant pays!
Je pars dans une heure pour ma lecture, j'aurai un public furieux d'être venu de si loin (tout est loin à Moscou), par une tempête pareille pour entendre des balivernes... Gare au fiasco! Enfin, espérons toujours qu'on ne sifflera pas; et si on siffle, eh bien, on sera à l'unisson du dehors. Je ne crois pas que j'en dormirai moins bien, ou plus mal.
Est-ce vraiment vrai que je m'en vais après-demain? Cela me paraît impossible...
Mercredi soir.
Eh bien, je dois le dire avec une rude franchise: j'ai eu un très grand succès. J'ai lu le chapitre «Chez Goubareff», vous savez: où il y a tout ce tas de gens qui font des commérages révolutionnaires, puis le premier entretien de mon héros avec Potougouine, le philosophe russe[117]. On a beaucoup ri, on a applaudi, j'ai été reçu et reconduit par des battements de mains vigoureux et unanimes. Il y avait trois à quatre cents personnes. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il paraît que j'ai très bien lu; je recevais des compliments de tous côtés. Tout cela m'a fait plaisir, et j'ai eu surtout du plaisir à penser que je vous le dirais.
Et vous, chère madame Viardot, qu'avez-vous fait aujourd'hui à Strasbourg? Vous a-t-on fait une ovation en règle? Vous me direz tout cela de vive voix. Oh! que c'est bon de pouvoir se dire cela!... Si rien ne vient mettre des bâtons dans les roues, je pars d'ici après-demain, vendredi; et je vous jure que je ne resterai pas à Pétersbourg une seconde de plus que le strict nécessaire.
L'affaire Katkoff s'est arrangée; j'ai sacrifié une scène, peu importante d'ailleurs, et j'ai sauvé le reste. Le principal demeure intact, mais voilà le véritable revers de la médaille en littérature. Enfin, il faut se consoler à l'idée que cela pouvait être pire, et que les 2.000 roubles me restent.
J'ai aussi vendu ma nouvelle édition[118]. J'ai fait des affaires tout plein, et je rapporte pas mal d'argent. Ça m'a été d'autant plus nécessaire que je ne dois pas espérer en recevoir de sitôt de Spasskoïé: mon nouvel intendant y a trouvé, littéralement, le chaos; il y a des dettes auxquelles je ne m'attendais pas. Il faudra continuer à battre le fer pendant qu'il est chaud, c'est-à-dire il faudra travailler, écrire, pendant que je me sens en train: j'ai promis pour la nouvelle édition une immense préface d'une centaine de pages, dans laquelle je raconterai mes souvenirs littéraires et sociaux pendant vingt-cinq ans, car il y aura au printemps de l'année suivante juste un quart de siècle que je fais imprimer; il est vrai que les vers par lesquels j'ai débuté en 1843 étaient bien médiocres. Enfin, c'est un prétexte pour raconter ses souvenirs. La même année 1843 m'offre une date bien plus mémorable et plus chère pour moi: c'est en novembre 1843 que j'eus le bonheur de faire votre connaissance, il y a bientôt un quart de siècle aussi, vous voyez. Espérons que notre amitié fêtera sa cinquantaine... Oh! oh! et que dira ma goutte?...
Jeudi matin.
La bourrasque a cessé, mais elle a laissé partout des monceaux de neige. Cette neige fond, parce qu'il y a trois ou quatre degrés au-dessus de zéro, mais, pour le moment, on se croirait au cœur même de l'hiver. Mon pied va décidément mieux; mais comme il ne faut pas que l'année climatérique perde ses droits, ma toux est revenue avec violence. Mais elle ne m'empêchera pas de partir demain. Je vous écrirai dès mon arrivée à Pétersbourg. Dans une semaine, je suis peut-être! à Bade! En attendant, j'embrasse tout le monde et je me mets à vos pieds.
IV. TOURGUENEFF.
Paris, hôtel Byron, mercredi minuit
[25 mars 1868].
Chère madame Viardot,
Je rentre de la représentation de Hamlet à l'Opéra. Je me hâte de dire que Nilsson[119] est vraiment charmante, et qu'on ne peut rien voir de plus gracieux que sa grande scène au quatrième acte. Comme physique, comme manières, imaginez-vous Mlle Holmsen extrêmement idéalisée: elle a aussi ces petits mouvements brusques de la tête et des bras, cette sorte de raideur et de saccadé dans la prononciation; il paraît que c'est suédois, mais le tout est attrayant, pur et virginal, d'une virginité presque amère, herb, comme disent les Allemands. La voix est jolie, mais je crains qu'elle ne puisse résister longtemps à «l'urlo francese». Faure est toujours «magistral», d'une tenue et d'une diction irréprochables. Le libretto est tout simplement absurde! Au dernier acte, le spectre de papa apparaît au su et au vu de tout le monde, même du roi criminel, et ordonne à Hamlet d'aller percer le flanc de ce tyran, ce que l'autre exécute à la satisfaction générale, et le tyran se fait tuer avec résignation, comme un lièvre dans une battue, le spectre étant le batteur et Hamlet le chasseur. Les décors sont admirabilissimes, les costumes aussi, la mise en scène splendide. Jamais je n'ai rien vu de plus beau que la représentation de la pièce devant la cour au quatrième acte... Mais il faut voir Nilsson. La salle était pleine, et au premier rang, dans une loge, l'Empereur et l'Impératrice... qui sont restés jusqu'à la fin!
J'ai assidûment lorgné l'ami de Viardot, et je l'ai trouvé aussi laid que possible. J'ai pu enfin découvrir sa bouche sous ses moustaches, qui est lippue, de la même couleur que la peau du visage, repoussante; mais le sourire lentement goguenard, qui se promène de l'œil droit, ou plutôt du coin de l'œil droit le long de la joue flasque et ridée, est le même, et que Viardot le sache bien, ce que cet homme a eu d'intelligence n'a pas bronché, j'en mettrai ma main au feu après l'avoir vu. C'est un être blasé, fatigué, mais pas du tout malade. Il y a eu une dizaine de cris de «Vive l'Empereur!» à son entrée, parmi les Romains. Voilà tout.
J'ai reçu ce matin les gentils billets de mes deux petites amies, auxquelles je répondrai ce soir même. Mille amitiés à tout le monde. Je vous baise les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, jeudi 13/25 juin 1868,
onze heures du soir.
Me voici enfin ici, chère et bonne madame Viardot, au terme de mon «hardi voyage». Je suis arrivé vers neuf heures du soir, Feth[120] et G... m'ont retenu presque de force, et j'ai trouvé mon intendant qui s'est laissé pousser une barbe magnifique.
Il a une très belle tête maintenant, mon vieux chasseur Athanase, qui tombe en ruine de décrépitude, et l'ex-médecin de ma mère, un certain Porphyre, avec lequel j'ai fait mon premier voyage en Allemagne[121] et qui est venu affermer une petite terre que j'ai dans le gouvernement d'Orel[122].
La maison est toute blanchie à la chaux et repeinte, tout est en ordre, pas trop indigne en un mot de votre visite et de celle de Didie qui aura lieu... dans deux ans?
Je ne suis pas encore allé au jardin; je ferai demain une grande promenade et nous aurons de longues conversations avec l'intendant. On viendra m'attaquer avec des demandes, je suis bien résolu d'opposer une résistance inflexible. Je ne veux pas perdre une minute et j'espère bien n'être plus ici dans quinze jours.
L'impression que me fait la Russie maintenant est désastreuse; je ne sais si cela provient de la famine qu'on vient de traverser, mais il me semble que je n'ai jamais vu les habitations aussi misérables, aussi ruinées, les visages aussi hâves, tout aussi triste... des cabarets partout et une irrémédiable misère! Spasskoïé est le seul village que j'ai vu jusqu'à présent où les toits en chaume ne soient pas béants, et Dieu sait s'il y a loin de Spasskoïé au moindre village de la Forêt Noire!
J'écris tout ceci, et quand je pense à la distance énorme, infinie qui nous sépare, je sens que mon sang se glace. Je vous en conjure, portez-vous bien, tous, tant que vous êtes, toute la maison!
Je vais me coucher avec une sensation bizarre... Je ne crois pas que je m'endorme de sitôt; les vieux murs semblent me regarder comme un étranger, et je le suis en effet. Dormez bien, là-bas, dans le cher «Thiergarten», et pensez à moi. A demain.
Vendredi 11/26 juin, dix heures du matin.
Eh bien! non... j'ai très bien dormi et je me suis réveillé fort tard. Je viens de faire une grande promenade dans le jardin qui m'a semblé immense; je crois que toute la vallée du Thiergarten y tiendrait. Des souvenirs d'enfance sont venus m'assaillir; cela ne manque jamais. Je m'y suis vu tout petit garçon, beaucoup plus jeune que Paul[123], courant dans les allées, me couchant entre les plates-bandes pour y voler des fraises. Voici l'arbre où j'ai tué mon premier corbeau, voici la place où j'ai trouvé cet énorme champignon; où j'ai été témoin de la lutte d'une couleuvre et d'un crapaud, lutte qui m'a fait pour la première fois douter de la bonne Providence. Puis sont venus des souvenirs de jeune étudiant, d'homme fait... J'ai visité le tombeau de la pauvre Diane[124]; la pierre que j'y avais mise a disparu. Tous les arbres ont grandi d'une façon extraordinaire pendant ces trois années; c'est à n'en pas croire ses yeux! Les tilleuls sont magnifiques, l'herbe grouille de fleurs, mais elle est moins haute que d'habitude; le printemps a été très froid et cela dure jusqu'à présent. Si cela continue ainsi et s'il ne vient pas de pluie, ce sera de nouveau une mauvaise année. Il y a encore par-ci par-là quelques restes de lilas en fleurs. Je vous envoie deux ou trois de ces fleurs.
J'envoie à Didie une tête d'étude; c'est une religieuse quêteuse qui s'en va de village en village... Avouez que cette figure-là ne laisse rien à désirer.
J'espère qu'on m'apportera quelque chose de la poste aujourd'hui. Mille choses à Viardot, mille tendresses à tous; je vous baise les deux mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 2 juillet/20 juin 1868.
Chère madame Viardot,
Ainsi Wagner a triomphé! Eh bien, j'en suis ravi, et puisque vous avez trouvé de grandes beautés dans la partition, il faut crier bravo! au public, c'est un nouvel art qui commence. Je vois des manifestations analogues jusque dans notre littérature (le dernier roman de Léon Tolstoï[125] a du Wagner). Je sens que cela peut être très beau, mais c'est autre chose que tout ce que j'ai aimé autrefois, ce que j'aime encore, et il me faut un certain effort pour m'arracher de mon Standpunkt. Je ne suis pas tout à fait comme Viardot, je puis le faire encore, mais l'effort est indispensable, tandis que l'autre art m'enlève et m'emporte comme un flot.
Il m'est venu en tête à ce propos ces jours derniers la comparaison suivante: on peut par exemple exciter la compassion en décrivant ou on représentant (Laocoon) la souffrance; et on peut aussi atteindre le vrai!... C'est plus sensuel, mais cela empoigne quelquefois davantage... Wagner est un des fondateurs de l'école du gémissement, de là vient la force et la pénétration de ses effets. Cette comparaison cloche comme toutes les comparaisons... mais exprime assez bien ce que je veux dire.
La reine est encore à Bade! et c'est gentil... Vous verrez qu'elle y sera encore pour la reprise de Krakamiche[126], qui doit avoir lieu le 20 juillet sans faute.
Mon rhume de cerveau est plus éternuant que jamais; il paraît que je n'en serai quitte qu'en quittant la Russie. Je n'aurai pas longtemps à attendre. Mille choses à tout le monde. Je vous baise les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Spasskoïé, 5 juillet/23 juin 1868.
Theureste, beste Freundin,
Vous voilà donc seule à Bade au moment où je vous écris. Ce serait le moment de travailler en effet, si vous aviez un libretto[127]. J'ai essayé de chercher quelques sujets, mais l'immense rhume de cerveau qui ne me quitte pas depuis dix jours m'a complètement abruti. Il faisait jusqu'ici un temps horriblement désagréable, froid, aigre, humide: on dirait que le bon Dieu a chargé quelque vieille fille bien acariâtre de présider à la température. Oh! mon Dieu, quelle différence entre Bade et cela!!
Le flot de gens qui me considèrent comme une vache à lait monte chaque jour. Ce sont pour la plupart des pauvres diables, des meurt-de-faim, d'anciens domestiques, etc... Refuser est presque impossible... mais il y a une limite à tout. Je me défends à l'aide de mon brave Kichinsky, l'intendant, tant que je puis, mais je laisse des plumes.
Nous avons aujourd'hui la première belle journée, et j'ai passé des heures entières dehors, à cuire mon misérable rhume au soleil. Je crois que cela m'a réussi jusqu'à un certain point. Assis sur un banc (comme dans la première lettre de ma nouvelle: Faust), j'ai dû penser à Viardot; inondée par la lumière la plus pure, tout imprégnée de parfums, de beauté, de tranquillité apparente, la terre autour de moi offrait un vrai champ de carnage: tout s'entre-dévorait avec frénésie, avec rage. J'ai sauvé la vie à une petite fourmi qu'une plus grosse fourmi entraînait, roulait dans le sable, avec des soubresauts de tigre, malgré une résistance désespérée. A peine avais-je délivré la petite, qu'avisant un moucheron à demi mort, elle l'empoigna avec la même férocité; cette fois-ci je laissai faire. Détruire ou être détruit; il n'y a pas de milieu: détruisons!
Il faisait admirablement beau, malgré cela; et si vous venez un jour à Spasskoïé, je vous mènerai à ce banc. Deux magnifiques pins d'une espèce rare, poussent, collés l'un à l'autre (ils sont déjà très grands, ils m'ont fait penser à Didie et Marianne[128]), au milieu d'une jolie pelouse; au delà, à travers les branches pendantes des bouleaux se montre l'étang, le grand étang ou plutôt le lac de Spasskoïé... Vous verrez, c'est très joli. Il y a des rossignols, qui ne chantent presque plus malheureusement, des fauvettes, des grives, des loriots, des tourterelles, des pinsons, des chardonnerets, et beaucoup de moineaux et de corbeaux; c'est un ramage incessant, auquel vient se mêler de loin le chant des cailles dans les blés... Vous verrez, c'est très joli. Il faut venir en masse.
Lundi.
Je compte les jours, il en reste douze. On commence déjà à faire les préparatifs du départ, ce que je puis voir du reste, aux flots de plus en plus nombreux des pétitionnaires. C'est une vraie cour des miracles! D'où sortent tous ces boiteux, ces aveugles, ces manchots, ces êtres décrépits et que la faim rend tout hérissés? Quelle profonde misère partout! La sainte Russie est loin d'être la Russie florissante; du reste, un saint n'est pas tenu à l'être.
Vous recevrez cette lettre deux jours avant mon arrivée, je puis donc dire au revoir. Mille choses à tout le monde.
Je vous baise les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Cologne, hôtel du Dôme, 18/6 février 1871,
minuit.
Ecco mi al fine in Badi... Colonia, bien chère amie.
Tout a marché comme sur des roulettes, la mer était divine! J'ai trouvé Cologne et l'hôtel épouvantablement pleins de monde; dans ce moment on chante des chansons patriotiques dans la grande salle que vous connaissez. Le garçon vient de me dire que des masses de soldats arrivent de Berlin, du fond de l'Allemagne; il y en a vingt mille seulement à Cologne et plus de cent mille d'ici à Mayence. On croit ici que les Français n'accepteront pas les conditions de Bismarck, et on se prépare à les écraser définitivement. D'où sort cette tourbe innombrable? Dans la gare il y avait des tas de soldats dormant sur des paillassons, assis, debout... tous robustes, gras, roses, comme si le sang des Français qu'ils s'apprêtent à verser leur colorait les joues d'avance... C'est effrayant à voir, je vous assure. Un Allemand avec lequel je voyageais m'a dit: «Vor lauter Sieg gehen wir su Guande—aber wenn die Franzosen den Krieg fortsetzen wollen... Gott sei ihnen gnaedig! Frankreich wird aus gerottet[129]!» Il paraît que Bismarck a fixé le jour du 24 février comme fin de l'armistice, pour pouvoir entrer précisément ce jour-là à Paris... Cela lui ressemble.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je pars d'ici demain à 9 heures et j'arrive le soir à 8 heures et demie à Bade; naturellement je vous écrirai aussitôt.
Tout aussi naturellement, j'ai bien souvent pensé à vous et à toute la chère maison de Devonshire Place[130]. Dans ce moment, vous devez déjà être rentrée de votre soirée; je suis sûr que vous avez très bien chanté. Vous avez reçu mon télégramme d'Ostende, n'est-ce pas? Je vais me coucher. Je vous baise les mains.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, dimanche 26/14 février 1871,
minuit et demi.
Ma chère madame Viardot,
Je viens d'une soirée chez Mme Séroff[131], où Louise[132] a chanté des choses de Schumann, le Doppelgänger, la Gretchen, etc. Ce qui m'a fait plaisir dans le concert, c'est avant tout, votre élève Mlle Lavrofska[133], dont la voix est très belle et qui chante avec goût et mesure, en vraie cantatrice; puis une basse, M. Melnikoff, une voix jeune et mordante. Le reste est détestable. Mlle Levitski a la voix déjà complètement abîmée. Un grand final de Rousslane[134] m'a semblé fort beau, original et poétique. L'orchestre, les chœurs, de beaux moyens, mais le directeur est un sabreur: le public chaud, mais sans discernement et même brutal. La salle est vaste, belle, et mauvaise pour la voix.
Dans le courant de la journée j'ai fait la connaissance d'un jeune sculpteur russe de Wilna, doué d'un talent hors ligne. Il a fait une statue d'Ivan le Terrible, assis, négligemment vêtu, une Bible sur les genoux, plongé dans une rêverie terrible et sinistre. Je trouve cette statue tout bonnement un chef-d'œuvre de compréhension historique, psychologique, et d'une magnifique exécution. Et cela a été fait par un petit jeune homme, pauvre comme un rat d'église, maladif, n'ayant commencé à travailler et à apprendre à lire et à écrire qu'à vingt-deux ans; il avait été jusque-là un ouvrier... Spiritus fiat ubi vult. Il y a certainement du génie dans ce pauvre garçon malingre. On l'envoie en Italie pour sa santé. Il s'appelle Antokolsky; c'est un nom qui restera[135].
J'ai dîné tranquillement chez mon vieil ami Annenkoff.
A demain!
Lundi 27 février, minuit.
Je reviens du club d'échecs, où j'ai lu les télégrammes officiels... Ainsi l'Alsace, la Lorraine perdues, cinq milliards... Pauvre France! Quel coup terrible et comment s'en relever? J'ai bien vivement pensé à vous et à ce que vous avez dû ressentir... C'est enfin la paix, mais quelle paix! Ici, tout le monde est plein de sympathie pour la France, mais ce n'est qu'une amertume de plus...
Au revoir, chère amie; portez-vous bien, écrivez-moi.
Der Ihrige,
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, 19 février/3 mars 1871.
Ma chère madame Viardot,
Je vais vous raconter ce que j'ai fait ces deux jours. Hier, j'ai dîné chez M. P..., une espèce de fin merle pétersbourgeois, qui, ayant épousé la fille naturelle de Stieglitz, le banquier, est devenu énormément riche, habite un palais, donne des dîners raffinés, etc. J'y ai trouvé Frédro radieux et pimpant et la jolie poseuse Mme Z... qui n'est plus aussi jolie qu'elle l'était naguère, mais qui pose toujours. Frédro a naturellement beaucoup parlé de vous, de Weimar, de Wagner; quant à moi, j'ai pu me convaincre que mon Roi Lear des steppes[136] avait eu beaucoup de succès dans le public.
Je suis rentré à la maison et j'ai écrit un article sur ce petit sculpteur de génie Antokolsky. Il faut battre la caisse pour lui et faire en sorte que la commande que la cour lui a faite soit enfin exécutée, et qu'il ait un peu d'argent pour s'en aller en Italie. Ce matin, l'article a paru.
Aujourd'hui étant le jour anniversaire de l'émancipation des paysans, j'ai reçu une invitation au dîner annuel par le comité ayant pris part aux travaux qui ont fait aboutir cette grande réforme. J'ai été le seul invité en dehors des membres du comité, ce qui est un très grand honneur pour moi et le seul de ce genre qui puisse me toucher. Ces messieurs ne se sont pas contentés de cela; ils ont bu à ma santé! J'aurais peut-être dû m'y attendre et préparer un speech, mais n'ayant pas eu cette pensée, j'ai balbutié, avec mon éloquence ordinaire, quelques paroles inintelligibles... Enfin ils ont pu voir que j'étais ému, car je l'étais en effet, et voilà[137].
Beaucoup de personnes viennent me voir; il est évident que si certaines personnes me tiennent pour mort et s'étonnent que je ne me fasse pas enterrer, d'autres ont conservé de l'amitié pour moi, sempre bene!
Ici on est très content que la paix ait été faite; on plaint beaucoup la France, et on s'attend à ce qu'elle montre de l'élasticité et de l'énergie dans sa régénération; on accepte parfaitement la République (je ne parle naturellement que de ceux qui l'aiment).
Mon intendant m'annonce l'assemblée générale des aspirants à prendre mon bien en fermage, pour le 5 mars de notre style; involontairement cela me fait l'effet d'une volée de corbeaux, qui, le bec grand ouvert, attendent leur proie. Je tâcherai de laisser le moins de viande possible, comme dirait Müller.
A demain. Je suis pas mal fatigué, je me porte bien, mais je dors mal dans ce diable de Pétersbourg, dans ces chambres où il fait si chaud. Mille et mille amitiés à tous. Je vous baise les mains avec la tendresse la plus tendre.
Der Ihrige,
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg,
lundi 22 février/6 mars 1871.
Chère madame Viardot,
Avant toute chose, laissez-moi vous dire combien j'ai été heureux de recevoir votre lettre du 25, avec tous les détails sur les deux concerts du 23 et du 24! Vous avez pris une glorieuse revanche, et combien je regrette de n'y pas avoir assisté! Maintenant la mauvaise époque est passée, la voix est en ordre et tout marchera bien. Je suis très heureux et je vous félicite de tout mon cœur.
Passons maintenant à mes faits et gestes depuis vendredi soir.
Ce jour-là, après vous avoir écrit ma lettre, je suis allé à un raout chez une comtesse P...; beaucoup de personnes connues, quelques jolies figures, des conversations peu intéressantes. Samedi matin, visites et courses. A 4 heures, je reçois l'invitation d'aller chez la grande-duchesse Hélène; elle me fait attendre jusqu'à 5 heures un quart; conversation politique. Elle a beaucoup vieilli. Puis dîner littéraire chez mon éditeur. Il me comble de civilités; puis je vais à une réunion du comité pédagogique, où une jeune demoiselle de dix-neuf ans (fille d'un professeur de mes amis, M. K...) défend une thèse d'histoire avec une science, un aplomb et une éloquence rares, devant deux cents personnes. Voilà certes du nouveau, et pas l'ombre de pédantisme, une naïveté d'enfant, une si grande absence de préoccupation personnelle, que cela ôte toute timidité. C'est phénoménal! On l'a applaudie à tout rompre. Il y a eu beaucoup de demoiselles dans l'auditoire, des institutrices.
Hier matin, séance pour mon portrait, mais pas chez M. Gay, chez un autre peintre, du nom de Makovsky[138], qui ne m'en a demandé qu'une, et qui a fait quelque chose de fort remarquable comme peinture. Je suis arrivé à l'âge de cinquante-deux ans sans qu'on ait fait mon portrait à l'huile, et voilà qu'on en fait deux à la fois. Puis concert de Rubinstein à l'assemblée de la noblesse; un monde fou; il joue comme toujours; immenses applaudissements. Auer y a joué aussi, mais j'avoue que j'ai surtout admiré ses yeux et toute sa physionomie. Le morceau pour orchestre intitulé Don Quichotte est assez bien; seulement l'élément comique, le Sancho Pança, manque complètement. Il a introduit des fragments d'airs espagnols, en les choisissant assez vulgaires. Je crois me rappeler qu'il vous les avait demandés ainsi. Puis, dîner tranquille et patriarcal chez Annenkoff, réception de votre bonne et chère lettre... On joue aux cartes le soir, je rentre d'assez bonne heure, et voilà!
Je commence à me lasser de Pétersbourg. J'ai dû y rester pour prendre un peu l'air du pays; maintenant il faut partir et pousser, talonner les affaires, pour revenir au plus vite! Mon intendant doit m'envoyer de l'argent. Borisoff[139] m'attend à Moscou, et nous partirons probablement ensemble pour la campagne.
J'ai dû promettre de faire une lecture publique, très courte, samedi prochain (pour un but de bienfaisance). Lundi, dans une semaine, je file.
Nous sommes en plein dégel. La neige a disparu, ou plutôt elle est devenue noire, et nous pataugeons dans une horrible boue. C'est très laid au soleil.
A demain chère amie...
Der Ihrige,
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, hôtel Demouth,
8 mars/21 février 1871.
Chère madame Viardot,
Il y a de cela une heure, au moment de sortir de chez Annenkoff, le postillon est venu à ma rencontre, avec deux lettres, l'une de vous, l'autre des petites. Vous dire le plaisir que cela m'a fait est superflu!
Vous avez chanté hier à Liverpool et vous chanterez demain à Manchester... Je vous accompagne de toute l'intensité de ma pensée, mais je n'ai plus peur pour vous; je suis persuadé que maintenant cela ira comme sur des roulettes.
Je vais vous raconter ma vie pendant hier et aujourd'hui. Règle générale, ma journée commence de très bonne heure par un envahissement de vieux amis, vieilles connaissances, ou bien de personnes qui veulent m'exploiter d'une façon ou d'une autre, ou qui ont affaire à moi. Ce matin il est venu entre autres une vieille mendiante polonaise, qui m'a soutiré cinq roubles. Non, jamais, depuis que le monde est monde, il n'y a eu de figure plus typique dans son genre, et si j'étais peintre je lui donnerais volontiers vingt-cinq roubles pour la faire poser! Ensuite viennent les excursions, qui, par la boue horrible dont toutes les rues sont remplies, et vu que cette fois-ci je ne me permets pas le luxe d'une voiture, présentent des difficultés de locomotion considérables; puis arrive le moment du dîner.
Hier j'ai dîné chez la vieille comtesse Protassoff, une dame très affable et «bon enfant», où j'ai trouvé cinq ou six personnes assez agréables; tout le monde est enragé contre les Allemands, mais à quoi cela a-t-il servi? Le soir je suis allé chez un M. J..., le frère de celui que vous avez vu à Bade et qui est si ennuyeux; celui-ci est encore plus beau—il a volcan de cheveux gris sur la tête—et encore plus ennuyeux! J'y ai trouvé plusieurs adeptes de la nouvelle école musicale russe (pas Cui, malheureusement), mais le grand Balakireff qu'ils reconnaissent pour leur chef; le grand Balakireff a assez mal joué quelques fragments d'une fantaisie à orchestre de Rymsky-Korsakoff (vous vous rappelez, on vous a envoyé quelques jolies romances de lui); cette fantaisie sur un sujet de légende russe, assez bizarre, m'a semblé en effet en avoir, de la fantaisie. Puis le grand Balakireff a assez mal joué des réminiscences de Liszt et de Berlioz, qui, lui surtout, est pour ces messieurs l'Absolu et l'Idéal. Je crois, après tout, que c'est un homme intelligent. Kein talent, doch ein character.
Ce, matin j'ai été plus envahi que jamais, puis j'ai eu ma dernière séance chez M. Gay. J'en dois une encore à M. Makovsky. Le portrait de M. Gay est d'une ressemblance frappante à ce que disent tous les amis et à ce que je crois moi-même. Puis j'ai fait des visites littéraires, c'est-à-dire ennuyeuses, mais il le fa-a-allait, comme dit Bilboquet. Puis j'ai dîné tout seul, pour la première fois depuis mon arrivée ici, dans un petit restaurant sous terre, au-dessous du sol je veux dire, et je suis allé chez papa Annenkoff. Hier, oui, j'ai oublié! j'ai fait une assez longue visite à l'Hermitage[140] où j'ai admiré de nouveau les chefs-d'œuvre dont cette galerie est pleine: les Potter, les Rembrandt, etc., etc. En fait de choses nouvelles, il y a une merveilleuse petite Vierge de Léonard (dans la galerie Litta), des vases admirables de la collection Campana, et surtout un petit sphynx assis (un sujet de lampe) venu des fouilles de Kertch[141] qui est bien une des choses les plus fascinatrices qu'on puisse voir; il est peint et d'une conservation étonnante. J'aurais bien désiré que Viardot eût vu ce sphynx! Puis sont venues les deux lettres chez Annenkoff, et voilà!
Et maintenant, à demain. Mille embrassades à tout le monde.
Der Ihrige,
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, vendredi 10 mars 1871.
Chère et bien-aimée madame Viardot,
Je vous avais dit que ma lecture de demain était tombée à l'eau. Malheureusement ce n'était qu'un faux bruit, et je lis en effet, entre Mlle Lovato, chantant: «Ce n'est pas dans le nez que ça me chatouille», et une autre demoiselle de la même force; c'est tout à fait café chantant; mais le but m'étant très sympathique (c'est pour les blessés français, on n'en parle pas sur l'affiche, mais tout le monde le sait...), je passe outre. On a mis mon nom en vedette, et l'on me voit rayonner à côté «d'huîtres fraîches», etc.
J'ai pensé à votre arrivée à Brighton et me suis senti très flatté d'une pareille similitude! Avec tout cela, je crains qu'il n'y ait que fort peu de monde, car le public ici est trop bourré de concerts, tableaux vivants, etc. Demain, je vous dirai le résultat.
Et maintenant parlons de mes faits et gestes. Séance pour les portraits (ils sont achevés maintenant, Dieu merci!), séance pour des photographies (ce n'est pas moi qui paye, je vous prie de le croire!), visites littéraires, pour affaires, visites reçues et rendues; c'est un brouhaha que ma vie ici; et je serai bien content quand je roulerai vers la tranquille Moscou et vers Spasskoïé, plus tranquille encore. Tout cela est nécessaire; mais quand ce sera fini, ce sera bien agriable, comme dit Thérésa.
J'ai dîné hier, jeudi, avec trois jeunes littérateurs, et la conversation a été vive et animée. Nous n'avons bu qu'une bouteille de vin! J'ai dû passer ensuite la soirée chez une femme bien ennuyeuse, que vous connaissez je crois, Mme M..., cette personne qui a de si grosses joues, et elle a été digne de sa réputation. Aujourd'hui, dîner chez un comte A..., pas mal ennuyeux aussi, mais plein de bonnes intentions envers la littérature; il est en train de fonder une vaste entreprise lexico-encyclopédique; il est très riche, et il faut encourager cela (pas la richesse, mais les entreprises). De là, je suis allé dans un autre salon, politico-littéraire aussi, mais d'une couleur un peu plus tranchée, de façon que je me rends compte des différentes nuances de ce qu'on peut appeler l'opinion publique dans la Cara patria. Il y a pas mal de choses que je vous dirai de vive voix.
Samedi soir.
Eh bien, ma chère et bonne madame Viardot, la lecture a eu lieu, mais ça a été autre chose que je n'avais cru. Un peu café chantant, en effet, de la musique exécrable, mais un public énorme, bouillant de jeunesse: apothéose de Garibaldi en tableau vivant, lecture par une dame de Souvenirs d'un séjour parmi les Garibaldiens, déclamation par une grosse dinde, à la voix fêlée, des Deux Grenadiers de Schumann, qui, comme vous vous le rappelez peut-être, se terminent par la Marseillaise; alors explosion de bravos frénétiques, cris de: «Vive la France!» tempête, en un mot, qui a duré dix minutes. Un acteur français a, il est vrai, dit les Deux Gendarmes, mais une actrice française a déclamé les Pigeons de la République, et ce mot a fait courir le frisson habituel.
Quant à moi, je dois avouer que jamais je n'ai été l'objet de pareilles—pardon du mot!—ovations. Je vous le dis parce que je sais que cela vous fera plaisir, et j'ai pensé à vous pendant tout le temps que je me tenais là, confus, rouge, un sourire impassible sur la face, en présence de cette foule qui hurlait... Ça me faisait l'effet d'une grosse pluie d'orage, rapide et violente, qu'on recevrait sur ses épaules nues. J'ai lu le fragment des Mémoires d'un chasseur intitulé Bourmistr; je crois avoir assez bien lu, mes nerfs s'étaient détendus pendant tout ce tapage, et j'étais calme, puis le public était si bienveillant!
Vous voilà revenue de Liverpool; peut-être aurais-je quelque nouvelle de vous demain.
En attendant, mille amitiés. Je vous baise les mains.
IV. TOURGUENEFF.
Saint-Pétersbourg, samedi 11 mars 1871.
Je continue ma lettre, chère madame Viardot.
Après dîner je suis allé au concert de la Société russe. Symphonie nº 3 de Beethoven, assez brutalement jouée, et puis... vous allez vous étonner... et en même temps vous rendrez justice à ma bonne foi: on a donné l'ouverture des Maîtres chanteurs et l'entr'acte, qui m'ont fait le plus grand plaisir! L'entr'acte surtout est grandiose, c'est de la puissante musique, il faut l'avouer. Le public a beaucoup applaudi et l'entr'acte a été redemandé.
Un petit musicien que vous connaissez, et qui se nomme Ch. Lenz, m'a entraîné du concert chez un de nos meilleurs acteurs, M Samoïloff, où je devais rencontrer Rubinstein. Il y était en effet. Il a pris les Allemands (!) en horreur, et veut rester en Russie. Comme il faut toujours qu'il entreprenne quelque chose, il s'est mis en tête de fonder une société, un «Orpheum» ou «Verein», où se réunirait toute l'intelligence artistico-littéraire de Pétersbourg. Cette idée a été longuement débattue, et on a fini par décider qu'on ferait une soirée d'épreuve, jeudi prochain (on a choisi ce jour-là, parce que je pars vendredi), et on a fait des listes d'invitation, des circulaires. J'ai dû signer la circulaire littéraire. Il ne sortira naturellement rien de tout cela; du reste cela ne me regarde pas, puisque je n'habite pas la Russie; mais enfin, cela a amusé Rubinstein, et il est entier en diable et têtu comme un mulet. J'ai rencontré sa femme: elle a très bonne mine; il paraît que son garçon continue à être splendide.
J'ai l'idée de vous envoyer mes textes russes du Gaertner et de Es ist ein schlechtes Wetter. J'ai choisi ces deux-là, comme étant de beaucoup les plus difficiles. Le cheval de la princesse, Blanc de neige, est devenu noir comme l'acier, mais c'est aussi dans la nature.
Faites-vous chanter cela par Mme Gourieff, vous verrez si cela va bien...
J'ai dîné paisiblement chez mon vieux Annenkoff; après dîner, j'ai eu une entrevue avec un monsieur, pour le fermage de mes biens, et peut-être pour la vente de l'un deux. Ce monsieur est un galant homme, que je connais depuis longtemps et qui a de l'argent.
Le tourbillon de Pétersbourg, où je suis tombé et d'où je compte me retirer bien vite, ne me fait oublier un instant ni Londres, ni mon retour, ni tout ce que j'aime au monde, et plus que jamais. Je ne serai heureux que quand j'aurai franchi le seuil de Devonshire Place, 30!
J'ai reçu une lettre de Lewis, qui me parle d'un de vos samedis, auquel il aurait assisté, et d'un autre où il comptait retourner. Il semble vous avoir pris en affection.
A demain, theuerste Freundin. Mille amitiés à tous.
Votre
IV. TOURGUENEFF.
Nous terminons ici la publication des lettres de Tourgueneff à Mme Viardot. L'illustre artiste n'a pas cru possible, pour des motifs divers, de rendre public le reste de la correspondance, plus d'une centaine de lettres se rapportant à la même époque (de 1844 à 1871). Mais les pages publiées—outre leur charme intime—peuvent déjà servir de contribution appréciable à l'étude de la vie intérieure de Tourgueneff qui doit nous intéresser, pour le moins, autant que celle de ses créations.
Des biographes russes ont mis déjà à profit les lettres parues dans mon ouvrage sur Tourgueneff d'après sa correspondance, et ils ont pu élucider certains côtés du problème psychologique et moral que présente l'âme d'un artiste, aussi grand par l'esprit et le cœur, doué d'une aussi rare puissance évocatrice que l'est l'auteur de cette correspondance.
Notre tâche ne fut pas vaine.
E. H.-K.
| Notes sur la transcription |
|---|
| On a effectué les corrections suivantes: |
| Clément Thomas lui-même n'interromptit=>Clément Thomas lui-même n'interrompit |
| le lond du rivage=>le long du rivage |
| que Dieu vons bénisse=>que Dieu vous bénisse |
| Ç'a a été le dernier geste de Socrate mourant=>Ça a été le dernier geste de Socrate mourant |
| elle nous aunonce=>elle nous announce |
| Je viens de m'excercer=>Je viens de m'exercer |
| n'est pas capable de se distraire de sa préoccution=>n'est pas capable de se distraire de sa préoccupation |
| l'engager à aller trouver la tranquilité=>l'engager à aller trouver la tranquillité |
| J'ai donc trentre-quatre ans=>J'ai donc trente-quatre ans |
| Notre voyage est redardé d'un jour=>Notre voyage est retardé d'un jour |
| Voici les quelques lignes que je vous proprose=>Voici les quelques lignes que je vous propose |
| au-desus de la fenêtre=>au-dessus de la fenêtre |
| Mais imaginezvous=>Mais imaginez-vous |
| Wieniaswki a énormément gagné=>Wieniawski a énormément gagné |
| Vanitas vanitum et onmia vanitas!=>Vanitas vanitum et omnia vanitas! |
| A propos, le bruit s'était répaudu ici>=A propos, le bruit s'était répandu ici |
| Je crains bien que mon oncle soit cette muraille et que mes poils chiches vont me sauter au nez.=>Je crains bien que mon oncle soit cette muraille et que mes pois chiches vont me sauter au nez. |
| Avec tout cela, il n'est impossible=>Avec tout cela, il n'est pas impossible |
| Vous voilà donc seul à Bade=>Vous voilà donc seule à Bade |
[1] En septembre 1883.
[2] Voir Ivan Tourgueneff d'après sa correspondance avec ses amis français, par E. Halpérine-Kaminsky (Fasquelle, éditeur).
[3] Poète russe renommé, auteur de Souvenirs sur Tourgueneff.
[4] Terre de Tourgueneff, dans le gouvernement d'Orel.
[5] Le présent recueil contient également les huit lettres que Mme Viardot a bien voulu me communiquer en plus de celles qui constituent le paquet qui lui a été restitué, lettres que j'avais déjà insérées dans le volume: Ivan Tourgueneff d'après sa correspondance avec ses amis français. Toutes les lettres de Tourgueneff à Mme Viardot dont la publication a été autorisée par la destinataire sont donc réunies ici.
[6] M. et Mme Viardot.
[7] L'Opéra de Berlin.
[8] Il s'agit évidemment des compositions de musique de Mme Viardot.
[9] Allusion à la fameuse revue russe le Contemporain, sous la direction du poète Nekrassov et de Panaïev, et dont les principaux collaborateurs étaient, avec Tourgueneff: Tolstoï, Ostrovky, Grigorovitch, le critique Belinsky, etc.
[10] La fille aînée de Mme Viardot, devenue plus tard Mme Heritte.
[11] La langue allemande.
[12] Probablement ses premiers Récits d'un chasseur, parus en 1847 dans le Contemporain.
[13] Mme Garcia, mère de Mme Viardot.
[14] Cousine germaine de Mme Viardot. Cantatrice, élève, je crois, de M. Manuel Garcia, frère de Mme Viardot.
[15] Le frère de Mme Garcia, mère de Mme Viardot.
[16] M. Manuel Garcia.
[17] Fils d'un médecin fameux de l'époque.
[18] L'auteur de: Essence du christianisme, etc.
[19] Critique russe, ami de Tourgueneff et plus tard son exécuteur testamentaire.
[20] Allusion aux superstitions populaires russes qui veulent qu'on crache lorsqu'on constate la bonne santé d'une personne.
[21] M. Garcia, le frère de Mme Viardot, artiste renommé, comme toute la famille Garcia, inventeur du laryngoscope.
[22] Jeu de mots expliqué par les ratures assez nombreuses de cette partie de la lettre.
[23] Romancier, ou plutôt auteur de nouvelles, devenu plus tard célèbre.
[24] Une phrase en espagnol, une en allemand et une en russe contenant le même souhait; la dernière, en caractères russes, signifie: «Portez-vous bien et souvenez-vous de nous.»
[25] La Vie est un songe.
[26] Le Magicien prodigieux.
[27] Louis Viardot traduisit en effet, en collaboration avec l'auteur, plusieurs des nouvelles de Tourgueneff, notamment les Récits d'un chasseur, d'autres sous le titre de Scènes de la vie russe, etc.
[28] Savant naturaliste allemand.
[29] La famille du général comte Serge Kaminsky, fils du maréchal russe qui servit en qualité de volontaire dans l'armée française en 1758 et 1759. Le comte Serge avait habité Orel, ville où est né Tourgueneff.
[30] D'espagnol.
[31] Probablement le Célibataire, comédie en trois actes.
[32] Poète et militant politique allemand qui, sous l'influence des idées de la révolution de Février à Paris, se porta, à la tête d'une colonne d'ouvriers armés, et, à l'aide des révolutionnaires de Bade, pénétra dans la ville, mais fut repoussé par les troupes wurtembergeoises.
[33] En russe: «Je vous en prie.»
[34] Le célèbre écrivain socialiste russe.
[35] On le sait aujourd'hui, le général Lamoricière avait pour mission de conclure une entente entre la République de 1848 et l'empereur Nicolas Ier.
[36] Domestique de M. et Mme Viardot.
[37] Le vieux chien de chasse de M. Viardot.
[38] Il s'agit probablement du romancier russe de ce nom.
[39] Phrase en lettres russes qui signifie: «Comprenez-vous le russe? ou l'avez-vous oublié?»
[40] Cousine germaine de Mme Viardot.
[41] Léonard, célèbre violoniste.
[42] Le frère de Mme Garcia.
[43] Un déjeuner chez le maréchal de la noblesse, la seule comédie en un acte de Tourgueneff, datée de 1849.
[44] Allusion probable à la traduction, faite par l'auteur en collaboration avec Louis Viardot, du Commensal, comédie en deux actes, écrite en 1848, et parue en français sous le titre primitif de le Pain d'autrui dans le volume: Scènes de la vie russe (Paris, 1858).
[45] Critique musical de l'Athenæum de Londres.
[46] Belle-sœur de Mme Viardot.
[47] Gold verdienen, gagner de l'argent (ou de l'or—gold); verdienen—gagner;—dienen—servir.
[48] Le chien de garde.
[49] La vieille cuisinière de Courtavenel.
[50] Petit bois près de Courtavenel.
[51] M. Sitchès.
[52] Général espagnol.
[53] Vieux cheval de M. et Mme Viardot.
[54] Le frère de Mme Viardot.
[55] Un familier de la maison.
[56] A M. Louis Viardot.
[57] La nouvelle de la mort de sa mère a obligé Tourgueneff de partir pour la Russie afin de mettre en ordre les affaires de la succession.
[58] Propriété patrimoniale de Tourgueneff.
[59] La fille de Tourgueneff.
[60] La fille de Tourgueneff confiée par lui à Mme Viardot.
[61] Le célèbre acteur, ami de Gogol et créateur du principal rôle de Revisor (le rôle du maire).
[62] La mère de Mme Viardot.
[63] Le frère et la fille de Mme Viardot.
[64] Nicolas Ier.
[65] Le grand-duc Alexandre Nicolaïevitch, plus tard Alexandre II.
[66] Eugène Vivier, le célèbre corniste improvisateur, homme de beaucoup d'esprit et dont les traits amusaient souvent Tourgueneff et toute la famille Viardot. Les journaux en ont parlé récemment à l'occasion de sa mort.
[67] On sait (voir Tourgueneff d'après sa correspondance, par E. Halpérine-Kaminsky) que Tourgueneff a été exilé dans sa propriété de Spasskoïé à la suite de son article sur la mort de Gogol, en 1852. Cette réclusion a duré jusqu'à la fin de 1854; rendu libre grâce à l'intervention du grand-duc héritier (plus tard Alexandre II), Tourgueneff revint en France.
[68] M. Tutcheff a été un poète d'une rare finesse et de grâce.
[69] Il faut se souvenir que le servage n'était pas encore aboli à cette époque en Russie.
[70] Journal russe, Mme Viardot était à ce moment en représentation à Saint-Pétersbourg.
[71] On se souvient que Tourgueneff a été exilé dans ses terres à la suite de son article sur Gogol.
[72] La fille de Tourgueneff.
[73] Mme Viardot s'était chargée de la surveillance de son éducation.
[74] Roudine, probablement.
[75] Scènes de la vie russe, 2e série, traduite, en collaboration de l'auteur, par Louis Viardot.
[76] A M. Louis Viardot.
[77] L'un des directeurs de la maison d'édition Hachette.
[78] La deuxième série des Scènes de la vie russe.
[79] Xavier Marmier avait traduit un volume des nouvelles de Tourgueneff, sous le même titre de Scènes de la vie russe (1re série).
[80] Un récit de Tourgueneff, qu'il traduisit en commun avec M. Viardot et qui parut dans le recueil: Scènes de la vie russe, en 1858 (2e série).
[81] Autre récit de Tourgueneff.
[82] Idem.
[83] La mort du célèbre peintre Arry Scheffer.
[84] Dans la propriété de Léon Tolstoï, à Yasnaïa Poliana, qui n'est pas très éloignée de Spasskoïé.
[85] Le tableau dont parle Tourgueneff est la fameuse «Apparition du Christ», à laquelle le peintre russe a travaillé pendant plus d'un quart de siècle et qui est son principal titre de gloire.
[86] Représentant russe de l'art académique.
[87] Il s'agit de A la Vielle, roman traduit en français sous le titre de: Un Bulgare.
[88] Les Comités institués par Alexandre II pour préparer la réforme de l'affranchissement des serfs, affranchissement proclamé par l'Empereur le 19 février 1861.
[89] Critique d'art et de littérature allemand.
[90] Pierre Botkine, littérateur et grand ami de Tourgueneff.
[91] Tourgueneff faisait grand cas du jugement littéraire de la comtesse et soumettait parfois à son appréciation ses écrits; bien que portant un nom français, elle est d'origine russe.
[92] Critique littéraire et biographique de Tourgueneff. Il fut plus tard son exécuteur testamentaire.
[93] Le comte Nicolas Milutine, célèbre homme d'État, l'un des principaux artisans de l'affranchissement des serfs et d'autres réformes libérales du règne d'Alexandre II.
[94] Tourgueneff fut accusé de pactiser avec les révolutionnaires russes réfugiés à l'étranger, et il fut mandé par le gouvernement à Saint-Pétersbourg pour se justifier devant une commission du Sénat, érigée pour la circonstance en tribunal suprême.
[95] Les prévisions de Tourgueneff se sont réalisées: Séroff est devenu l'un des plus puissants représentants de l'école musicale russe.
[96] Rognéda est en effet considérée comme le chef-d'œuvre de Séroff.
[97] Pauline Viardot, célèbre cantatrice.
[98] Il s'agit évidemment du récit Assez! le seul publié en 1864.
[99] Chef d'orchestre au Gewandhaus de Leipzig.
[100] La fille de Mme Viardot.
[101] Devenue célèbre depuis.
[102] Titres écrits en caractères russes.
[103] Compositions, sur paroles russes, de Mme Viardot.
[104] Chanteur au théâtre italien.
[105] Fumée.
[106] Publiciste fameux, alors directeur libéral de la revue moscovite le Messager russe. Il devint plus tard réactionnaire et joua un rôle considérable sous le règne d'Alexandre III.
[107] Le public français sait aujourd'hui, par les traductions publiées, la grande valeur de cet écrivain.
[108] Excavations et fondrières de route.
[109] L'oncle paternel de Tourgueneff avait été longtemps l'intendant de ses biens; mais il les avait si mal gérés que Tourgueneff dut, malgré les liens de parenté, confier l'administration de Spasskoïé à un nouveau gérant, tout en indemnisant son oncle d'une forte somme.
[110] Fumée.
[111] Nicolas Rubinstein, frère d'Antoine, également pianiste fameux, et plus tard directeur du conservatoire de Moscou.
[112] Il s'agit de l'Histoire du lieutenant Yergounov.
[113] Les épreuves de Fumée.
[114] L'une des filles de Mme Viardot.
[115] L'héroïne de Fumée.
[116] Tourgueneff; l'architecte en question était un Allemand qui a construit la villa de Tourgueneff à Bade.
[117] Épisodes de Fumée.
[118] De ses œuvres complètes à ce moment.
[119] Christine Nilsson, la célèbre cantatrice, qui avait débuté avec un éclatant succès, en 1864, au Théâtre-Lyrique de Paris.
[120] Le célèbre poète russe, ami de Tourgueneff et de Tolstoï.
[121] En 1838.
[122] Ce Porphyre eut une destinée peu banale: il avait accompagné Tourgueneff en Allemagne en qualité de groom; son jeune maître, s'étant aperçu de ses capacités intellectuelles, le prépara et le fit entrer à la Faculté de médecine de Berlin. Ses études médicales achevées, Porphyre, malgré son titre de docteur, malgré l'invitation pressante de Tourgueneff de rester en Allemagne, où il était amoureux et sur le point d'épouser une Berlinoise,—revint avec Tourgueneff à Spasskoïé et demeura serf de Mme Tourgueneff mère jusqu'à la mort de celle-ci.
[123] Le fils de M. et Mme Viardot.
[124] La chienne.
[125] Guerre et Paix.
[126] Krakamiche le dernier des sorciers, est un des trois contes fantastiques (les deux autres sont: l'Ogre, Conte de fée et Trop de femmes) écrits en français par Tourgueneff, et dont la musique a été composée par Mme Viardot. Pleines de gaieté et d'esprit, ces opérettes ont été représentées à Bade, dans l'intimité de la famille Viardot, et les rôles ont été tenus par les élèves de Mme Viardot, souvent par l'illustre cantatrice, et même par Tourgueneff, qui incarnait l'ogre, le sorcier ou le pacha. Assistaient à ces représentations les nombreux amis ou connaissances de tous les pays qui habitaient à Bade, parfois le roi, plus tard empereur, Guillaume Ier, et la reine de Prusse, ainsi que leur petit-fils, aujourd'hui Guillaume II.
[127] En composant la musique sur un livret de Tourgueneff.
[128] Les deux filles cadettes de M. et Mme Viardot.
[129] «Nous périrons à force de victoires; mais si les Français veulent continuer la guerre... que Dieu leur vienne en aide! la France sera exterminée!»
[130] La famille de Mme Viardot habitait pendant la guerre l'Angleterre.
[131] La femme du grand compositeur russe, auteur de Rognéda, etc.
[132] La fille aînée de Mme Viardot.
[133] Devenue plus tard célèbre.
[134] Opéra de Glinka.
[135] On sait combien la prédiction de Tourgueneff se réalisa: Antokolsky (mort il y a quelques années) est devenu le plus grand sculpteur russe, chef d'une nouvelle école, et sa gloire fut consacrée à l'Exposition universelle de 1878, où, seul parmi les artistes étrangers, il reçut la médaille d'honneur. Plus tard, il fut élu membre étranger de l'Institut de France et eut les plus hautes récompenses en Russie. A rapprocher un autre fait de divination esthétique de Tourgueneff: il avait prédit à Tolstoï sa glorieuse carrière dès le début. En 1854, au moment de l'apparition de l'Adolescence (2e partie de l'ouvrage: Enfance, Adolescence, Jeunesse, traduit en français sous le titre de Mes Mémoires), Tourgueneff écrivit à un ami: «Je me réjouis fort du succès de l'Adolescence. Que Dieu prête longue vie à Tolstoï, et j'en ai le ferme espoir, il vous étonnera tous: c'est un talent de premier ordre.» Voir également, dans la lettre à Mme Viardot du 19 janvier 1864, le jugement de Tourgueneff sur le compositeur Séroff.
[136] Récit de Tourgueneff.
[137] On sait que la publication, en 1847-1850, de ses Récits d'un chasseur avait produit une impression ineffaçable sur le public russe et notamment sur le tzar Alexandre II, libérateur des serfs en 1861. Tourgueneff contribua donc grandement à cet affranchissement.
[138] Depuis, on a connu à Paris ce peintre de réel talent.
[139] Un ami intime de Tourgueneff, mort jeune.
[140] Ermitage, la galerie impériale de tableaux.
[141] Ville en Crimée.
| Extrait du Catalogue de la BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER à 3 fr. 50 le volume | |
|---|---|
| EUGÈNE FASQUELLE, ÉDITEUR, 11, RUE DE GRENELLE | |
| ————— | |
| MÉMOIRES—SOUVENIRS—CORRESPONDANCE | |
| CHARLES ALEXANDRE | |
| Souvenirs sur Lamartine. | 1 vol |
| PAUL ALEXIS | |
| Emile Zola. Notes d'un ami. | 1 vol |
| THÉODORE DE BANVILLE | |
| Mes souvenirs. | 1 vol |
| MARIE BASHKIRTSEFF | |
| Journal, | 2 vols |
| ÉMILE BERGERAT | |
| Théophile Gautier. Biographie, entretiens, souvenirs. | 1 vol |
| PHILARÈTE CHASLES | |
| Mémoires, | 2 vols |
| LEON DAUDET | |
| Alphonse Daudet. | 1 vol |
| EUGÈNE DELACROIX | |
| Lettres. | 2 vols |
| ALIDOR DELZANT | |
| Les Goncourt, | 1 vol |
| GUSTAVE FLAUBERT | |
| Correspondance. | 4 vols |
| JULES DE GONCOURT | |
| Lettres. | 1 vol |
| E. ET J. DE GONCOURT | |
| Journal. Mémoires de la Vie litteraire. | 9 vols |
| VICTOR HUGO | |
| Choses vues. | 1 vol |
| PIERRE LANFREY | |
| Correspondance. | 1 vol |
| L. DE MONTLUC | |
| Correspondance de Juarez et de Montluc. | 1 vol |
| PAUL DE MUSSET | |
| Biographie d'Alfred de Musset. | 1 vol |
| HENRI REGNAULT | |
| Correspondance. | 1 vol |
| STENDHAL | |
| Journal, | 1 vol |
| LÉON TOLSTOÏ | |
| Correspondance inédite. | 1 vol |
| IVAN TOURGUENEFF | |
| Correspondance. | 1 vol |
| ÉMILE ZOLA | |
| Correspondance.—LETTRES DE JEUNESSE | 1 vol |
| 4433. — Imp. Motteroz et Martinet, rue Saint-Benoît, 7, Paris. | |