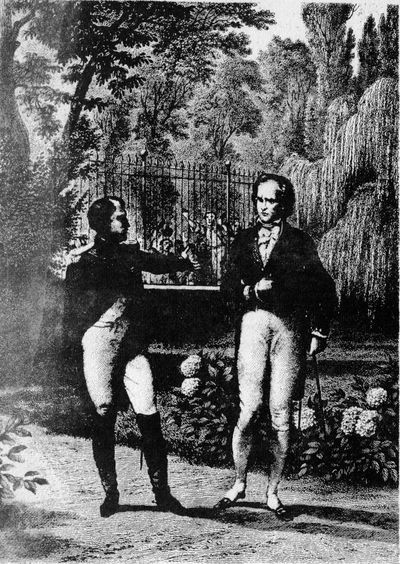
Napoléon et Benjamin Constant.
Title: Mémoires d'Outre-Tombe, Tome 4
Author: vicomte de François-René Chateaubriand
Editor: Edmond Biré
Release date: May 23, 2008 [eBook #25575]
Most recently updated: January 3, 2021
Language: French
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/25575
Credits: Produced by Mireille Harmelin, Christine P. Travers and
the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net (This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale
de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Notes au lecteur de ce ficher digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
Note 25: La date de l'exclusion de Jacques-Antoine Manuel de la Chambre des députés n'était pas lisible, il s'agit probablement du 2 Mars.
NOUVELLE ÉDITION
Avec une Introduction, des Notes et des Appendices
PAR
Edmond BIRÉ
PARIS
LIBRAIRIE GARNIER FRÈRES
6, RUE DES SAINTS-PÈRES, 6
KRAUS REPRINT
Nendeln/Liechtenstein
1975
Reprinted by permission of the original publishers
KRAUS REPRINT
A Division of
KRAUS-THOMSON ORGANIZATION LIMITED
Nendeln/Liechtenstein
1975
Printed in Germany
Lessingdruckerei Wiesbaden
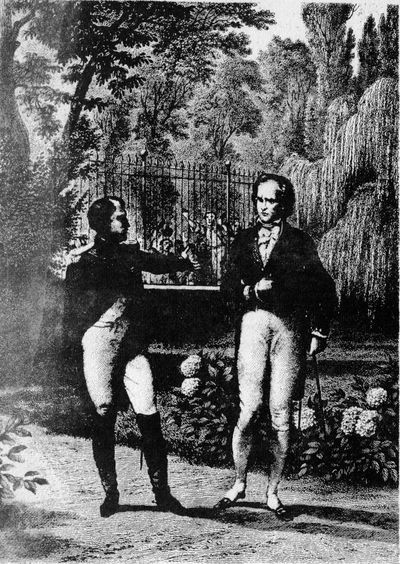
Napoléon et Benjamin Constant.
Les Cent-Jours à Paris. Effet du passage de la légitimité en France. — Étonnement de Bonaparte. — Il est obligé de capituler avec les idées qu'il avait crues étouffées. — Son nouveau système. — Trois énormes joueurs restés. — Chimères des libéraux. — Clubs et fédérés. — Escamotage de la République: l'Acte additionnel. — Chambre des représentants convoquée. — Inutile Champ de Mai. — Soucis et amertumes de Bonaparte. — Résolution à Vienne. — Mouvement à Paris. — Ce que nous faisions à Gand. — M. de Blacas. — Bataille de Waterloo. — Confusion à Gand. — Quelle fut la bataille de Waterloo. — Retour de l'Empereur. — Réapparition de La Fayette. — Nouvelle abdication de Bonaparte. — Scènes orageuses à la Chambre des Pairs. — Présages menaçants pour la seconde Restauration. — Départ de Gand. — Arrivée à Mons. — Je manque ma première occasion de fortune dans ma carrière politique. — M. de Talleyrand à Mons. Scène avec le roi. — Je m'intéresse bêtement à M. de Talleyrand. — De Mons à Gonesse. — Je m'oppose avec M. le comte Beugnot à la nomination de Fouché comme ministre: mes raisons. — Le duc de Wellington l'emporte. — Arnouville. — Saint-Denis. — Dernière conversation avec le roi.
Je vous fais voir l'envers des événements que l'histoire ne montre pas; l'histoire n'étale que l'endroit. Les Mémoires ont l'avantage de présenter l'un et l'autre côté du tissu: sous ce rapport, ils peignent mieux l'humanité complète en exposant, comme les tragédies (p. 002) de Shakespeare, les scènes basses et hautes. Il y a partout une chaumière auprès d'un palais, un homme qui pleure auprès d'un homme qui rit, un chiffonnier qui porte sa hotte auprès d'un roi qui perd son trône: que faisait à l'esclave présent à la bataille d'Arbelles la chute de Darius?
Gand n'était donc qu'un vestiaire derrière les coulisses du spectacle ouvert à Paris. Des personnages renommés restaient encore en Europe. J'avais en 1800 commencé ma carrière avec Alexandre et Napoléon; pourquoi n'avais-je pas suivi ces premiers acteurs, mes contemporains, sur le grand théâtre? Pourquoi seul à Gand? Parce que le ciel vous jette où il veut. Des petits Cent-Jours à Gand, passons aux grands Cent-Jours à Paris.
Je vous ai dit les raisons qui auraient dû arrêter Bonaparte à l'île d'Elbe, et les raisons primantes ou plutôt la nécessité tirée de sa nature qui le contraignirent de sortir de l'exil. Mais la marche de Cannes à Paris épuisa ce qui lui restait du vieil homme. À Paris le talisman fut brisé.
Le peu d'instants que la légalité avait reparu avait suffi pour rendre impossible le rétablissement de l'arbitraire. Le despotisme muselle les masses, et affranchit les individus dans une certaine limite; l'anarchie déchaîne les masses, et asservit les indépendances individuelles. De là, le despotisme ressemble à la liberté, quand il succède à l'anarchie; il reste ce qu'il est véritablement quand il remplace la liberté: libérateur après la Constitution directoriale, Bonaparte était oppresseur après la Charte. Il le sentait si bien qu'il se crut obligé d'aller plus loin que Louis XVIII et de (p. 003) retourner aux sources de la souveraineté nationale. Lui, qui avait foulé le peuple en maître, fut réduit à se refaire tribun du peuple, à courtiser la faveur des faubourgs, à parodier l'enfance révolutionnaire, à bégayer un vieux langage de liberté qui faisait grimacer ses lèvres, et dont chaque syllabe mettait en colère son épée.
Sa destinée, comme puissance, était en effet si bien accomplie, qu'on ne reconnut plus le génie de Napoléon pendant les Cent-Jours. Ce génie était celui du succès et de l'ordre, non celui de la défaite et de la liberté: or, il ne pouvait rien par la victoire qui l'avait trahi, rien pour l'ordre, puisqu'il existait sans lui. Dans son étonnement il disait: «Comme les Bourbons m'ont arrangé la France en quelques mois! il me faudra des années pour la refaire.» Ce n'était pas l'œuvre de la légitimité que le conquérant voyait, c'était l'œuvre de la Charte; il avait laissé la France muette et prosternée, il la trouvait debout et parlante: dans la naïveté de son esprit absolu, il prenait la liberté pour le désordre.
Et pourtant Bonaparte est obligé de capituler avec les idées qu'il ne peut vaincre de prime abord. À défaut de popularité réelle, des ouvriers, payés à quarante sous par tête, viennent, à la fin de leur journée, brailler au Carrousel Vive l'Empereur! cela s'appelait aller à la criée. Des proclamations annoncent d'abord une merveille d'oubli et de pardon; les individus sont déclarés libres, la nation libre, la presse libre; on ne veut que la paix, l'indépendance et le bonheur du peuple; tout le système impérial est changé; l'âge d'or va renaître. Afin de rendre la pratique conforme à la (p. 004) théorie, on partage la France en sept grandes divisions de police; les sept lieutenants sont investis des mêmes pouvoirs qu'avaient, sous le Consulat et l'Empire, les directeurs généraux: on sait ce que furent à Lyon, à Bordeaux, à Milan, à Florence, à Lisbonne, à Hambourg, à Amsterdam, ces protecteurs de la liberté individuelle. Au-dessus de ces lieutenants, Bonaparte élève, dans une hiérarchie de plus en plus favorable à la liberté, des commissaires extraordinaires, à la manière des représentants du peuple sous la Convention.
La police que dirige Fouché apprend au monde, par des proclamations solennelles, qu'elle ne va plus servir qu'à répandre la philosophie, qu'elle n'agira plus que d'après des principes de vertu.
Bonaparte rétablit, par un décret, la garde nationale du royaume, dont le nom seul lui donnait jadis des vertiges. Il se voit forcé d'annuler le divorce prononcé sous l'Empire entre le despotisme et la démagogie, et de favoriser leur nouvelle alliance: de cet hymen doit naître, au Champ de Mai, une liberté, le bonnet rouge et le turban sur la tête, le sabre du mameluck à la ceinture et la hache révolutionnaire à la main, liberté entourée des ombres de ces milliers de victimes sacrifiées sur les échafauds ou dans les campagnes brûlantes de l'Espagne et les déserts glacés de la Russie. Avant le succès, les mamelucks sont jacobins; après le succès, les jacobins deviendront mamelucks: Sparte est pour l'instant du danger, Constantinople pour celui du triomphe.
Bonaparte aurait bien voulu ressaisir à lui seul l'autorité, mais cela ne lui était pas possible; il trouvait des hommes disposés à la lui disputer: d'abord (p. 005) les républicains de bonne foi, délivrés des chaînes du despotisme et des lois de la monarchie, désiraient garder une indépendance qui n'est peut-être qu'une noble erreur; ensuite les furieux de l'ancienne faction de la montagne: ces derniers, humiliés de n'avoir été sous l'Empire que les espions de police d'un despote, semblaient résolus à reprendre, pour leur propre compte, cette liberté de tout faire dont ils avaient cédé pendant quinze années le privilège à un maître.
Mais ni les républicains, ni les révolutionnaires, ni les satellites de Bonaparte, n'étaient assez forts pour établir leur puissance séparée, ou pour se subjuguer mutuellement. Menacés au dehors d'une invasion, poursuivis au dedans par l'opinion publique, ils comprirent que s'ils se divisaient, ils étaient perdus: afin d'échapper au danger, ils ajournèrent leur querelle; les uns apportaient à la défense commune leurs systèmes et leurs chimères, les autres leur terreur et leur perversité. Nul n'était de bonne foi dans ce pacte; chacun, la crise passée, se promettait de le tourner à son profit; tous cherchaient d'avance à s'assurer les résultats de la victoire. Dans cet effrayant trente et un, trois énormes joueurs tenaient la banque tour à tour: la liberté, l'anarchie, le despotisme, tous trois trichant et s'efforçant de gagner une partie perdue pour tous.
Pleins de cette pensée, ils ne sévissaient point contre quelques enfants perdus qui pressaient les mesures révolutionnaires: des fédérés s'étaient formés dans les faubourgs et des fédérations s'organisaient sous de rigoureux serments dans la Bretagne, l'Anjou, le Lyonnais et la Bourgogne; on entendait chanter la (p. 006) Marseillaise et la Carmagnole; un club, établi à Paris, correspondait avec d'autres clubs dans les provinces; on annonçait la résurrection du Journal des Patriotes[1]. Mais, de ce côté-là, quelle confiance pouvaient inspirer les ressuscités de 1793? Ne savait-on pas comment ils expliquaient la liberté, l'égalité, les droits de l'homme? Étaient-ils plus moraux, plus sages, plus sincères (p. 007) après qu'avant leurs énormités? Est-ce parce qu'ils s'étaient souillés de tous les vices qu'ils étaient devenus capables de toutes les vertus? On n'abdique pas le crime aussi facilement qu'une couronne; le front que ceignit l'affreux bandeau en conserve des marques ineffaçables.
L'idée de faire descendre un ambitieux de génie du rang d'empereur à la condition de généralissime ou de président de la République était une chimère: le bonnet rouge, dont on chargeait la tête de ses bustes pendant les Cent-Jours, n'aurait annoncé à Bonaparte que la reprise du diadème, s'il était donné à ces athlètes qui parcourent le monde de fournir deux fois la même carrière.
Toutefois, des libéraux de choix se promettaient la victoire: des hommes fourvoyés, comme Benjamin Constant, des niais, comme M. Simonde-Sismondi[2], parlaient de placer le prince de Canino[3] au ministère de l'intérieur, le lieutenant général comte Carnot au ministère de la guerre, le comte Merlin[4] à celui de la (p. 008) justice. En apparence abattu, Bonaparte ne s'opposait point à des mouvements démocratiques qui, en dernier résultat, fournissaient des conscrits à son armée. Il se laissait attaquer dans des pamphlets; des caricatures lui répétaient: Île d'Elbe, comme les perroquets criaient à Louis XI: Péronne. On prêchait à l'échappé de prison, en le tutoyant, la liberté et l'égalité; il écoutait ces remontrances d'un air de componction. Tout à coup, rompant les liens dont on avait prétendu l'envelopper, il proclame de sa propre autorité, non une constitution plébéienne, mais une constitution aristocratique, un Acte additionnel aux constitutions de l'Empire[5].
La République rêvée se change par cet adroit escamotage dans le vieux gouvernement impérial, rajeuni de féodalité. L'Acte additionnel enlève à Bonaparte le (p. 009) parti républicain et fait des mécontents dans presque tous les autres partis[6]. La licence règne à Paris, l'anarchie dans les provinces; les autorités civiles et militaires se combattent; ici on menace de brûler les châteaux et d'égorger les prêtres; là on arbore le drapeau blanc et on crie Vive le roi! Attaqué, Bonaparte recule; il retire à ses commissaires extraordinaires la nomination des maires des communes et rend cette nomination au peuple. Effrayé de la multiplicité des votes négatifs contre l'Acte additionnel, il abandonne sa dictature de fait et convoque la Chambre des représentants en vertu de cet acte qui n'est point encore accepté. Errant d'écueil en écueil, à peine délivré d'un danger, il heurte contre un autre: souverain d'un jour, comment instituer une pairie héréditaire que l'esprit d'égalité repousse? Comment gouverner les (p. 010) deux Chambres? Montreront-elles une obéissance passive? Quels seront les rapports de ces Chambres avec l'assemblée projetée du Champ de Mai, laquelle n'a plus de véritable but, puisque l'Acte additionnel est mis à exécution avant que les suffrages eussent été comptés? Cette assemblée, composée de trente mille électeurs, ne se croira-t-elle pas la représentation nationale?
Ce Champ de Mai, si pompeusement annoncé et célébré le 1er juin[7], se résout en un simple défilé de troupes et une distribution de drapeaux devant un autel méprisé. Napoléon, entouré de ses frères, des dignitaires de l'État, des maréchaux, des corps civils et judiciaires, proclame la souveraineté du peuple à laquelle il ne croyait pas[8]. Les citoyens s'étaient imaginé qu'ils fabriqueraient eux-mêmes une constitution dans ce jour solennel, les paisibles bourgeois s'attendaient qu'on y déclarerait l'abdication de Napoléon en (p. 011) faveur de son fils, abdication manigancée à Bâle entre les agents de Fouché et du prince de Metternich: il n'y eut rien qu'une ridicule attrape politique. L'Acte additionnel se présentait, au reste, comme un hommage à la légitimité; à quelques différences près, et surtout moins l'abolition de la confiscation, c'était la Charte.
Ces changement subits, cette confusion de toutes choses, annonçaient l'agonie du despotisme. Toutefois l'empereur ne peut recevoir du dedans l'atteinte mortelle, car le pouvoir qui le combat est aussi exténué que lui; le Titan révolutionnaire, que Napoléon avait jadis terrassé, n'a point recouvré son énergie native; les deux géants se portent maintenant d'inutiles coups; ce n'est plus que la lutte de deux ombres.
À ces impossibilités générales se joignent pour Bonaparte des tribulations domestiques et des soucis de palais; il annonçait à la France le retour de l'impératrice et du roi de Rome, et l'une et l'autre ne revenaient point. Il disait à propos de la reine de Hollande, devenue par Louis XVIII duchesse de Saint-Leu: «Quand on a accepté les prospérités d'une famille, il faut en embrasser les adversités.» Joseph, accouru de la Suisse, ne lui demandait que de l'argent; Lucien l'inquiétait par ses liaisons libérales; Murat, d'abord conjuré contre son beau-frère, s'était trop hâté, en revenant à lui, d'attaquer les Autrichiens: dépouillé du royaume de Naples et fugitif de mauvais augure, il attendait aux arrêts, près de Marseille, la catastrophe que je vous raconterai plus tard.[9]
(p. 012) Et puis l'empereur pouvait-il se fier à ses anciens partisans et ses prétendus amis? ne l'avaient-ils pas indignement abandonné au moment de sa chute? Ce Sénat qui rampait à ses pieds, maintenant blotti dans la pairie, n'avait-il pas décrété la déchéance de son bienfaiteur? Pouvait-il les croire, ces hommes, lorsqu'ils venaient lui dire: «L'intérêt de la France est inséparable du vôtre. Si la fortune trompait vos efforts, des revers, sire, n'affaibliraient pas notre persévérance et redoubleraient notre attachement pour vous[10].» Votre persévérance! votre attachement redoublé par l'infortune! Vous disiez ceci le 11 juin 1815: qu'aviez-vous dit le 2 avril 1814? que direz-vous quelques semaines après, le 19 juillet 1815?
Le ministre de la police impériale, ainsi que vous l'avez vu, correspondait avec Gand, Vienne et Bâle; les maréchaux auxquels Bonaparte était contraint de donner le commandement de ses soldats avaient naguère prêté serment à Louis XVIII; ils avaient fait contre lui, Bonaparte, les proclamations les plus violentes[11]: depuis ce moment, il est vrai, ils avaient réépousé leur sultan; mais s'il eût été arrêté à Grenoble, qu'en auraient-ils fait? Suffit-il de rompre un serment pour rendre à un autre serment violé toute sa force? Deux parjures équivalent-ils à la fidélité?
Encore quelques jours, et ces jureurs du Champ de Mai rapporteront leur dévouement à Louis XVIII dans les salons des Tuileries; ils s'approcheront de la (p. 013) sainte table du Dieu de paix, pour se faire nommer ministres aux banquets de la guerre[12]; hérauts d'armes et brandisseurs des insignes royaux au sacre de Bonaparte, ils rempliront les mêmes fonctions au sacre de Charles X[13], puis, commissaires d'un autre pouvoir, ils mèneront ce roi prisonnier à Cherbourg, trouvant à peine un petit coin libre dans leur conscience pour y accrocher la plaque de leur nouveau serment. Il est dur de naître aux époques d'improbité, dans ces jours où deux hommes causant ensemble s'étudient à retrancher des mots de la langue, de peur de s'offenser et de se faire rougir mutuellement.
Ceux qui n'avaient pu s'attacher à Napoléon par sa gloire, qui n'avaient pu tenir par la reconnaissance au bienfaiteur duquel ils avaient reçu leurs richesses, leurs honneurs et jusqu'à leurs noms, s'immoleraient-ils maintenant à ses indigentes espérances? S'enchaîneraient-ils à une fortune précaire et recommençante, les ingrats que ne fixa point une fortune consolidée par des succès inouïs et par une possession de seize années de victoires? Tant de chrysalides qui, entre deux printemps, avaient dépouillé et revêtu, quitté et repris la peau du légitimiste et du révolutionnaire, du napoléonien et du bourboniste; tant de paroles données et faussées; tant de croix passées de la poitrine du chevalier à la queue du cheval, et de la queue du cheval à la poitrine du chevalier; tant de preux changeant de bandières, et (p. 014) semant la lice de leurs gages de foi-mentie; tant de nobles dames, tour à tour suivantes de Marie-Louise et de Marie-Caroline, ne devaient laisser au fond de l'âme de Napoléon que défiance, horreur et mépris; ce grand homme vieilli était seul au milieu de tous ces traîtres, hommes et sort, sur une terre chancelante, sous un ciel ennemi, en face de sa destinée accomplie et du jugement de Dieu.
Napoléon n'avait trouvé de fidèles que les fantômes de sa gloire passée; ils l'escortèrent, ainsi que je vous l'ai dit, du lieu de son débarquement jusqu'à la capitale de la France. Mais les aigles, qui avaient volé de clocher en clocher de Cannes à Paris, s'abattirent fatiguées sur les cheminées des Tuileries, sans pouvoir aller plus loin.
Napoléon ne se précipite point, avec les populations émues, sur la Belgique, avant qu'une armée anglo-prussienne s'y fût rassemblée: il s'arrête; il essaye de négocier avec l'Europe et de maintenir humblement les traités de la légitimité. Le congrès de Vienne oppose à M. le duc de Vicence l'abdication du 11 avril 1814: par cette abdication Bonaparte reconnaissait qu'il était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, et en conséquence renonçait, pour lui et ses héritiers, aux trônes de France et d'Italie. Or, puisqu'il vient rétablir son pouvoir, il viole manifestement le traité de Paris, et se replace dans la situation politique antérieure au 31 mars 1814: donc c'est lui Bonaparte qui déclare la guerre à l'Europe, et non l'Europe à Bonaparte. Ces arguties logiques de procureurs diplomates, comme je l'ai fait remarquer à propos de (p. 015) la lettre de M. de Talleyrand, valaient ce qu'elles pouvaient avant le combat.
La nouvelles du débarquement de Bonaparte à Cannes était arrivée à Vienne le 6 mars[14], au milieu d'une fête où l'on représentait l'assemblée des divinités de l'Olympe et du Parnasse. Alexandre venait de recevoir le projet d'alliance entre la France, l'Autriche et l'Angleterre: il hésita un moment entre les deux nouvelles, puis il dit: «Il ne s'agit pas de moi, mais du salut du monde.» Et une estafette porte à Saint-Pétersbourg l'ordre de faire partir la garde. Les armées qui se retiraient s'arrêtent; leur longue file fait volte-face, et huit cent mille ennemis tournent le visage vers la France. Bonaparte se prépare à la guerre; il est attendu à de nouveaux champs catalauniques: Dieu l'a ajourné à la bataille qui doit mettre fin au règne des batailles.
Il avait suffi de la chaleur des ailes de la renommée de Marengo et d'Austerlitz pour faire éclore des armées dans cette France qui n'est qu'un grand nid de soldats. Bonaparte avait rendu à ses légions leurs surnoms d'invincible, de terrible, d'incomparable; sept armées reprenaient le titre d'armées des Pyrénées, des Alpes, du Jura, de la Moselle, du Rhin: grands souvenirs qui servaient de cadre à des troupes supposées, à des triomphes en espérance. Une armée véritable était réunie à Paris et à Laon; cent cinquante batteries attelées, dix mille soldats d'élite entrés dans la garde; dix-huit mille marins illustrés à Lutzen et à Bautzen; trente mille vétérans, officiers (p. 016) et sous-officiers, en garnison dans les places fortes; sept départements du nord et de l'est prêts à se lever en masse; cent quatre-vingt mille hommes de la garde nationale rendus mobiles; des corps francs dans la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté; des fédérés offrant leurs piques et leurs bras; Paris fabriquant par jours trois mille fusils: telles étaient les ressources de l'empereur. Peut-être aurait-il encore une fois bouleversé le monde, s'il avait pu se résoudre, en affranchissant la patrie, à appeler les nations étrangères à l'indépendance. Le moment était propice: les rois qui promirent à leurs sujets des gouvernements constitutionnels venaient de manquer honteusement à leur parole. Mais la liberté était antipathique à Napoléon depuis qu'il avait bu à la coupe du pouvoir; il aimait mieux être vaincu avec des soldats que de vaincre avec des peuples. Les corps qu'il poussa successivement vers les Pays-Bas se montaient à soixante-dix mille hommes.
Nous autres émigrés, nous étions dans la ville de Charles-Quint comme les femmes de cette ville: assises derrière leurs fenêtres, elles voient dans un petit miroir incliné les soldats passer dans la rue. Louis XVIII était là dans un coin complètement oublié; à peine recevait-il de temps en temps un billet du prince de Talleyrand revenant de Vienne, quelques lignes des membres du corps diplomatique résidant auprès du duc de Wellington en qualité de commissaires, MM. Pozzo di Borgo,[15] de Vincent,[16] (p. 017) etc., etc. On avait bien autre chose à faire qu'à songer à nous! Un homme étranger à la politique n'aurait jamais cru qu'un impotent caché au bord de la Lys serait rejeté sur le trône par le choc des milliers de soldats prêts à s'égorger: soldats dont il (p. 018) n'était ni le roi ni le général, qui ne pensaient pas à lui, qui ne connaissaient ni son nom ni son existence. De deux points si rapprochés, Gand et Waterloo, jamais l'un ne parut si obscur, l'autre si éclatant: la légitimité gisait au dépôt comme un vieux fourgon brisé.
Nous savions que les troupes de Bonaparte s'approchaient; nous n'avions pour nous couvrir que nos deux petites compagnies sous les ordres du duc de Berry, prince dont le sang ne pouvait nous servir, car il était déjà demandé ailleurs. Mille chevaux, détachés de l'armée française, nous auraient enlevés en quelques heures. Les fortifications de Gand étaient démolies; l'enceinte qui reste eût été d'autant plus facilement forcée que la population belge ne nous était pas favorable. La scène dont j'avais été témoin aux Tuileries se renouvela: on préparait secrètement les voitures de Sa Majesté; les chevaux étaient commandés. Nous, fidèles ministres, nous aurions pataugé derrière, à la grâce de Dieu. Monsieur partit pour Bruxelles, chargé de surveiller de plus près les mouvements.
M. de Blacas était devenu soucieux et triste; moi, pauvre homme, je le solaciais. À Vienne on ne lui était pas favorable; M. de Talleyrand s'en moquait; les royalistes l'accusaient d'être la cause du retour de Napoléon. Ainsi, dans l'une ou l'autre chance, plus d'exil honoré pour lui en Angleterre, plus de premières places possibles en France: j'étais son unique appui. Je le rencontrais assez souvent au Marché aux chevaux, où il trottait seul; m'attelant à son côté, je me conformais à sa triste pensée. Cet homme que j'ai (p. 019) défendu à Gand et en Angleterre, que je défendis en France après les Cent-Jours, et jusque dans la préface de la Monarchie selon la Charte, cet homme m'a toujours été contraire: cela ne serait rien s'il n'eût été un mal pour la monarchie. Je ne me repens pas de ma niaiserie passée; mais je dois redresser dans ces Mémoires les surprises faites à mon jugement ou à mon bon cœur.
Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand par la porte de Bruxelles; j'allais seul achever ma promenade sur la grande route. J'avais emporté les Commentaires de César et je cheminais lentement, plongé dans ma lecture. J'étais déjà à plus d'une lieue de la ville, lorsque je crus ouïr un roulement sourd: je m'arrêtai, regardai le ciel assez chargé de nuées, délibérant en moi-même si je continuerais d'aller en avant, ou si je me rapprocherais de Gand dans la crainte d'un orage. Je prêtai l'oreille; je n'entendis plus que le cri d'une poule d'eau dans les joncs et le son d'une horloge de village. Je poursuivis ma route: je n'avais pas fait trente pas que le roulement recommença, tantôt bref, tantôt long et à intervalles inégaux; quelquefois il n'était sensible que par une trépidation de l'air, laquelle se communiquait à la terre sur ces plaines immenses, tant il était éloigné. Ces détonations moins vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un combat. Je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblon. Je traversai le chemin et je m'appuyai debout contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du (p. 020) côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier, et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo!
Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans la mêlée: le péril, le feu, la cohue de la mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer; mais seul sous un arbre, dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui paissaient autour de moi, le poids des réflexions m'accablait: Quel était ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-il là en personne? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou l'autre armée, quelle serait la conséquence de l'événement pour les peuples, liberté ou esclavage? Mais quel sang coulait! chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français? Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt, dont allaient jouir les plus implacables ennemis de la France? S'ils triomphaient, notre gloire n'était-elle pas perdue? Si Napoléon l'emportait, que devenait notre liberté? Bien qu'un succès de Napoléon m'ouvrît un exil éternel; la patrie l'emportait dans ce moment dans mon cœur; mes vœux étaient pour l'oppresseur de la France, s'il devait, en sauvant notre honneur, nous arracher à la domination étrangère.
Wellington triomphait-il? La légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui (p. 021) venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français! La royauté aurait donc pour carrosses de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés! Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices?... Ce n'est là qu'une bien petite partie des idées qui me tourmentaient. Chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. À quelques lieues d'une catastrophe immense, je ne la voyais pas, je ne pouvais toucher le vaste monument funèbre croissant de minute en minute à Waterloo, comme du rivage de Boulaq, au bord du Nil, j'étendais vainement mes mains vers les Pyramides.
Aucun voyageur ne paraissait; quelques femmes dans les champs, sarclant paisiblement des sillons de légumes, n'avaient pas l'air d'entendre le bruit que j'écoutais. Mais voici venir un courrier: je quitte le pied de mon arbre et je me place au milieu de la chaussée; j'arrête le courrier et l'interroge. Il appartenait au duc de Berry et venait d'Alost: «Bonaparte est entré hier (17 juin) dans Bruxelles, après un combat sanglant. La bataille a dû recommencer aujourd'hui (18 juin). On croit à la défaite définitive des alliés, et l'ordre de la retraite est donné.» Le courrier continua sa route.
Je le suivis en me hâtant: je fus dépassé par la voiture d'un négociant qui fuyait en poste avec sa famille; il me confirma le récit du courrier.
Tout était dans la confusion quand je rentrai à Gand: on fermait les portes de la ville; les guichets seuls demeuraient entre-bâillés; des bourgeois mal (p. 022) armés et quelques soldats de dépôt faisaient sentinelle. Je me rendis chez le roi.
Monsieur venait d'arriver par une route détournée: il avait quitté Bruxelles sur la fausse nouvelle que Bonaparte y allait entrer, et qu'une première bataille perdue ne laissait aucune espérance du gain d'une seconde. On racontait que les Prussiens ne s'étant pas trouvés en ligne, les Anglais avaient été écrasés.
Sur ces bulletins, le sauve qui peut devint général: les possesseurs de quelques ressources partirent; moi, qui ai la coutume de n'avoir jamais rien, j'étais toujours prêt et dispos. Je voulais faire déménager avant moi madame de Chateaubriand, grande bonapartiste, mais qui n'aime pas les coups de canon: elle ne me voulut pas quitter.
Le soir, conseil auprès de Sa Majesté: nous entendîmes de nouveau les rapports de Monsieur et les on dit recueillis chez le commandant de la place ou chez le baron d'Eckstein[17]. Le fourgon des diamants de la (p. 023) couronne était attelé: je n'avais pas besoin de fourgon pour emporter mon trésor. J'enfermai le mouchoir de soie noire dont j'entortille ma tête la nuit dans mon flasque portefeuille de ministre de l'intérieur, et je me mis à la disposition du prince, avec ce document important des affaires de la légitimité. J'étais plus riche dans ma première émigration, quand mon havresac me tenait lieu d'oreiller et servait de maillot à Atala; mais en 1815 Atala était une grande petite fille dégingandée de treize à quatorze ans, qui courait le monde toute seule, et qui, pour l'honneur de son père, avait fait trop parler d'elle.
Le 19 juin, à une heure du matin, une lettre de M. Pozzo, transmise au roi par estafette, rétablit la vérité des faits. Bonaparte n'était point entré dans Bruxelles; il avait décidément perdu la bataille de Waterloo. Parti de Paris le 12 juin, il rejoignit son armée le 14. Le 15, il force les lignes de l'ennemi sur la Sambre. Le 16, il bat les Prussiens dans ces champs de Fleurus où la victoire semble à jamais fidèle aux Français. Les villages de Ligny et de Saint-Amand sont emportés. Aux Quatre-Bras, nouveau succès: le duc de Brunswick reste parmi les morts[18]. Blücher en pleine retraite se rabat sur une réserve de trente mille hommes, aux ordres du général de Bulow[19]; le (p. 024) duc de Wellington, avec les Anglais et les Hollandais, s'adosse à Bruxelles.
Le 18 au matin, avant les premiers coups de canon, le duc de Wellington déclara qu'il pourrait tenir jusqu'à trois heures, mais qu'à cette heure, si les Prussiens ne paraissaient pas, il serait nécessairement écrasé: acculé sur Planchenois et Bruxelles, toute retraite lui était interdite. Surpris par Napoléon, sa position militaire était détestable; il l'avait acceptée et ne l'avait pas choisie.
Les Français emportèrent d'abord, à l'aile gauche de l'ennemi, les hauteurs qui dominent le château d'Hougoumont jusqu'aux fermes de la Haye-Sainte et de Papelotte; à l'aile droite, ils attaquèrent le village de Mont-Saint-Jean; la ferme de la Haye-Sainte est enlevée au centre par le prince Jérôme. Mais la réserve prussienne paraît vers Saint-Lambert à six heures du soir: une nouvelle et furieuse attaque est donnée au village de la Haye-Sainte; Blücher survient avec des troupes fraîches et isole du reste de nos troupes déjà rompues les carrés de la garde impériale. Autour de cette phalange immortelle, le débordement des fuyards entraîne tout parmi des flots de poussière, de fumée ardente et de mitraille, dans des ténèbres sillonnées de fusées à la congrève, au milieu des rugissements de trois cents pièces d'artillerie et du galop précipité de vingt-cinq mille chevaux: c'était comme le sommaire (p. 025) de toutes les batailles de l'Empire. Deux fois les Français ont crié: Victoire! deux fois leurs cris sont étouffés sous la pression des colonnes ennemies. Le feu de nos lignes s'éteint; les cartouches sont épuisées; quelques grenadiers blessés, au milieu de trente mille morts, de cent mille boulets sanglants, refroidis et conglobés à leurs pieds, restent debout appuyés sur leur mousquet, baïonnette brisée, canon sans charge. Non loin d'eux l'homme des batailles écoutait, l'œil fixe, le dernier coup de canon qu'il devait entendre de sa vie. Dans ces champs de carnage, son frère Jérôme combattait encore avec ses bataillons expirants accablés par le nombre, mais son courage ne peut ramener la victoire.
Le nombre des morts du côté des alliés était estimé à dix-huit mille hommes, du côté des Français à vingt-cinq mille; douze cents officiers anglais avaient péri; presque tous les aides de camp du duc de Wellington étaient tués ou blessés; il n'y eut pas en Angleterre une famille qui ne prît le deuil. Le prince d'Orange[20] avait été atteint d'une balle à l'épaule; le baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche, avait eu la main percée. Les Anglais furent redevables du succès aux Irlandais et à la brigade des montagnards écossais que les charges de notre cavalerie ne purent (p. 026) rompre. Le corps du général Grouchy, ne s'étant pas avancé, ne se trouva point à l'affaire. Les deux armées croisèrent le fer et le feu avec une bravoure et un acharnement qu'animait une inimitié nationale de dix siècles. Lord Castlereagh, rendant compte de la bataille à la Chambre des lords, disait: «Les soldats anglais et les soldats français, après l'affaire, lavaient leur mains sanglantes dans un même ruisseau, et d'un bord à l'autre se congratulaient mutuellement sur leur courage.» Wellington avait toujours été funeste à Bonaparte, ou plutôt le génie rival de la France, le génie anglais, barrait le chemin à la victoire. Aujourd'hui les Prussiens réclament contre les Anglais l'honneur de cette affaire décisive; mais, à la guerre, ce n'est pas l'action accomplie, c'est le nom qui fait le triomphateur: ce n'est pas Bonaparte qui a gagné la véritable bataille d'Iéna[21].
Les fautes des Français furent considérables: ils se trompèrent sur des corps ennemis ou amis; ils occupèrent trop tard la position des Quatre-Bras; le maréchal Grouchy, qui était chargé de contenir les Prussiens avec ses trente-six mille hommes, les laissa passer sans les voir: de là des reproches que nos généraux se sont adressés. Bonaparte attaqua de front selon sa coutume, au lieu de tourner les Anglais, et s'occupa avec la présomption du maître, de couper la retraite à un ennemi qui n'était pas vaincu.
Beaucoup de menteries et quelques vérités assez curieuses ont été débitées sur cette catastrophe. Le mot: La garde meurt et ne se rend pas, est une invention (p. 027) qu'on n'ose plus défendre[22]. Il paraît certain qu'au commencement de l'action, Soult fit quelques observations stratégiques à l'empereur: «Parce que Wellington vous a battu, lui répondit sèchement Napoléon, vous croyez toujours que c'est un grand général.» À la fin du combat, M. de Turenne[23] (p. 028) pressa Bonaparte de se retirer pour éviter de tomber entre les mains de l'ennemi: Bonaparte, sorti de ses pensées comme d'un rêve, s'emporta d'abord; puis tout à coup, au milieu de sa colère, il s'élance sur son cheval et fuit[24].
Le 19 juin cent coups de canon des Invalides avaient annoncé les succès de Ligny, de Charleroi, des Quatre-Bras; on célébrait des victoires mortes la veille à Waterloo. Le premier courrier qui transmit à Paris la nouvelle de cette défaite, une des plus grandes de l'histoire par ses résultats, fut Napoléon lui-même: il rentra dans les barrières la nuit du 21; on eût dit de ses mânes revenant pour apprendre à ses amis qu'il n'était plus. Il descendit à l'Élysée-Bourbon: lorsqu'il arriva de l'île d'Elbe, il était descendu aux Tuileries; ces deux asiles, instinctivement choisis, révélaient le changement de sa destinée.
Tombé à l'étranger dans un noble combat, Napoléon eut à supporter à Paris les assauts des avocats (p. 029) qui voulaient mettre à sac ses malheurs: il regrettait de n'avoir pas dissous la Chambre avant son départ pour l'armée; il s'est souvent aussi repenti de n'avoir pas fait fusiller Fouché et Talleyrand. Mais il est certain que Bonaparte, après Waterloo, s'interdit toute violence, soit qu'il obéît au calme habituel de son tempérament, soit qu'il fût dompté par la destinée; il ne dit plus comme avant sa première abdication: «On verra ce que c'est que la mort d'un grand homme.» Cette verve était passée. Antipathique à la liberté, il songea à casser cette Chambre des représentants que présidait Lanjuinais, de citoyen devenu sénateur, de sénateur devenu pair, depuis redevenu citoyen, de citoyen allant redevenir pair. Le général La Fayette, député, lut à la tribune une proposition qui déclarait: «la Chambre en permanence, crime de haute trahison toute tentative pour la dissoudre, traître à la patrie, et jugé comme tel, quiconque s'en rendrait coupable.» (21 juin 1815.)
Le discours du général commençait par ces mots:
«Messieurs, lorsque pour la première fois depuis bien des années j'élève une voix que les vieux amis de la liberté reconnaîtront encore, je me sens appelé à vous parler du danger de la patrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voici l'instant de nous rallier autour du drapeau tricolore, de celui de 89, celui de la liberté, de l'égalité et de l'ordre public.»
L'anachronisme de ce discours causa un moment d'illusion; on crut voir la Révolution, personnifiée dans La Fayette, sortir du tombeau et se présenter pâle et ridée à la tribune. Mais ces motions d'ordre, (p. 030) renouvelées de Mirabeau, n'étaient plus que des armes hors d'usage, tirées d'un vieil arsenal. Si La Fayette rejoignait noblement la fin et le commencement de sa vie, il n'était pas en son pouvoir de souder les deux bouts de la chaîne rompue du temps. Benjamin Constant se rendit auprès de l'empereur à l'Élysée-Bourbon; il le trouva dans son jardin. La foule remplissait l'avenue de Marigny et criait: Vive l'Empereur! cri touchant échappé des entrailles populaires; il s'adressait au vaincu! Bonaparte dit à Benjamin Constant: «Que me doivent ceux-ci? je les ai trouvés, je les ai laissés pauvres.» C'est peut-être le seul mot qui lui soit sorti du cœur, si toutefois l'émotion du député n'a pas trompé son oreille. Bonaparte, prévoyant l'événement, vint au-devant de la sommation qu'on se préparait à lui faire; il abdiqua pour n'être pas contraint d'abdiquer: «Ma vie politique est finie, dit-il: je déclare mon fils, sous le nom de Napoléon II, empereur des Français.» Inutile disposition, telle que celle de Charles X en faveur de Henri V: on ne donne des couronnes que lorsqu'on les possède, et les hommes cassent le testament de l'adversité. D'ailleurs l'empereur n'était pas plus sincère en descendant du trône une seconde fois qu'il ne l'avait été dans sa première retraite; aussi, lorsque les commissaires français allèrent apprendre au duc de Wellington que Napoléon avait abdiqué, il leur répondit: «Je le savais depuis un an.»
La Chambre des représentants, après quelques débats où Manuel[25] prit la parole, accepta la nouvelle (p. 031) abdication de son souverain, mais vaguement et sans nommer de régence.
Une commission exécutive est créée[26]: le duc d'Otrante la préside; trois ministres, un conseiller d'État et un général de l'empereur la composent et dépouillent (p. 032) de nouveau leur maître: c'était Fouché, Caulaincourt, Carnot, Quinette[27] et Grenier[28].
Pendant ces transactions, Bonaparte retournait ses idées dans sa tête: «Je n'ai plus d'armée, disait-il, je n'ai plus que des fuyards. La majorité de la Chambre des députés est bonne; je n'ai contre moi que La Fayette, Lanjuinais et quelques autres. Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé; si, au lieu d'une levée, on dispute, tout sera perdu. La nation n'a pas envoyé les députés pour me renverser, mais pour me (p. 033) soutenir. Je ne les crains point, quelque chose qu'ils fassent; je serai toujours l'idole du peuple et de l'armée: si je disais un mot, ils seraient assommés. Mais si nous nous querellons, au lieu de nous entendre, nous aurons le sort du Bas-Empire.»
Une députation de la Chambre des représentants étant venue le féliciter sur sa nouvelle abdication, il répondit: «Je vous remercie: je désire que mon abdication puisse faire le bonheur de la France; mais je ne l'espère pas.»
Il se repentit bientôt après, lorsqu'il apprit que la Chambre des représentants avait nommé une commission de gouvernement composée de cinq membres. Il dit aux ministres: «Je n'ai point abdiqué en faveur d'un nouveau Directoire; j'ai abdiqué en faveur de mon fils: si on ne le proclame point, mon abdication est nulle et non avenue. Ce n'est point en se présentant devant les alliés l'oreille basse et le genou en terre que les Chambres les forceront à reconnaître l'indépendance nationale.»
Il se plaignait que La Fayette, Sébastiani[29], Pontécoulant[30], (p. 034) Benjamin Constant, avaient conspiré contre lui, que d'ailleurs les Chambres n'avaient pas assez d'énergie. Il disait que lui seul pouvait tout réparer, mais que les meneurs n'y consentiraient jamais, qu'ils aimeraient mieux s'engloutir dans l'abîme que de s'unir avec lui, Napoléon, pour le fermer.
Le 27 juin, à la Malmaison, il écrivit cette sublime lettre: «En abdiquant le pouvoir, je n'ai pas renoncé (p. 035) au plus noble droit du citoyen, au droit de défendre mon pays. Dans ces graves circonstances, j'offre mes services comme général, me regardant encore comme le premier soldat de la patrie.»
Le duc de Bassano lui ayant représenté que les Chambres ne seraient pas pour lui: «Alors je le vois bien,» dit-il, «il faut toujours céder. Cet infâme Fouché vous trompe, il n'y a que Caulaincourt et Carnot qui valent quelque chose; mais que peuvent-ils faire, avec un traître, Fouché, et deux niais, Quinette et Grenier, et deux Chambres qui ne savent ce qu'elles veulent? Vous croyez tous comme des imbéciles aux belles promesses des étrangers; vous croyez qu'ils vous mettront la poule au pot, et qu'ils vous donneront un prince de leur façon, n'est-ce pas? Vous vous trompez[31].»
Des plénipotentiaires furent envoyés aux alliés. Napoléon requit le 29 juin deux frégates, stationnées à Rochefort, pour le transporter hors de France; en attendant il s'était retiré à la Malmaison.
Les discussions étaient vives à la Chambre des pairs. Longtemps ennemi de Bonaparte, Carnot, qui signait l'ordre des égorgements d'Avignon sans avoir le temps de le lire, avait eu le temps, pendant les Cent-Jours, d'immoler son républicanisme au titre de comte. Le 22 juin, il avait lu au Luxembourg une lettre du ministre de la guerre, contenant un rapport exagéré sur les ressources militaires de la France. Ney, nouvellement arrivé, ne put entendre ce rapport sans colère. Napoléon, dans ses bulletins, avait parlé du maréchal avec un mécontentement mal déguisé, et Gourgaud (p. 036) accusa Ney d'avoir été la principale cause de la perte de la bataille de Waterloo. Ney se leva et dit: «Ce rapport est faux, faux de tous points: Grouchy ne peut avoir sous ses ordres que vingt à vingt-cinq mille hommes tout au plus. Il n'y a plus un seul soldat de la garde à rallier: je la commandais; je l'ai vu massacrer tout entière avant de quitter le champ de bataille. L'ennemi est à Nivelle avec quatre-vingt mille hommes; il peut être à Paris dans six jours: vous n'avez d'autre moyen de sauver la patrie que d'ouvrir des négociations.»
L'aide de camp Flahaut[32] voulut soutenir le rapport du ministre de la guerre; Ney répliqua avec une nouvelle véhémence: «Je le répète, vous n'avez d'autre voie de salut que la négociation. Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai aux États-Unis.»
À ces mots, Lavallette et Carnot accablèrent le maréchal de reproches; Ney leur répondit avec dédain: (p. 037) «Je ne suis pas de ces hommes pour qui leur intérêt est tout: que gagnerai-je au retour de Louis XVIII? d'être fusillé pour crime de désertion; mais je dois la vérité à mon pays.»
Dans la séance des pairs du 23, le général Drouot[33], rappelant cette scène, dit: «J'ai vu avec chagrin ce qui fut dit hier pour diminuer la gloire de nos armes, exagérer nos désastres et diminuer nos ressources. Mon étonnement a été d'autant plus grand que ces discours étaient prononcés par un général (p. 038) distingué (Ney), qui, par sa grande valeur et ses connaissances militaires, a tant de fois mérité la reconnaissance de la nation.»
Dans la séance du 22, un second orage avait éclaté à la suite du premier: il s'agissait de l'abdication de Bonaparte; Lucien insistait pour qu'on reconnût son neveu empereur. M. de Pontécoulant interrompit l'orateur, et demanda de quel droit Lucien, étranger et prince romain, se permettait de donner un souverain à la France. «Comment, ajouta-t-il, reconnaître un enfant qui réside en pays étranger?» À cette question, La Bédoyère[34], s'agitant devant son siège:
«J'ai entendu des voix autour du trône du souverain heureux; elles s'en éloignent aujourd'hui qu'il est dans le malheur. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître Napoléon II, parce qu'ils veulent recevoir la loi de l'étranger, à qui ils donnent le nom d'alliés.
«L'abdication de Napoléon est indivisible. Si l'on (p. 039) ne veut pas reconnaître son fils, il doit tenir l'épée, environné de Français qui ont versé leur sang pour lui, et qui sont encore tout couverts de blessures.
«Il sera abandonné par de vils généraux qui l'ont déjà trahi.
«Mais si l'on déclare que tout Français qui quittera son drapeau sera couvert d'infamie, sa maison rasée, sa famille proscrite, alors plus de traîtres, plus de manœuvres qui ont occasionné les dernières catastrophes et dont peut-être quelques auteurs siègent ici.»
La Chambre se lève en tumulte: «À l'ordre! à l'ordre! à l'ordre! mugit-on blessé du coup.—Jeune homme, vous vous oubliez! s'écria Masséna.—«Vous vous croyez encore au corps de garde?» disait Lameth.
Tous les présages de la seconde Restauration furent menaçants: Bonaparte était revenu à la tête de quatre cents Français, Louis XVIII revenait derrière quatre cent mille étrangers; il passa près de la mare de sang de Waterloo, pour aller à Saint-Denis comme à sa sépulture.
C'était pendant que la légitimité s'avançait ainsi que retentissaient les interpellations de la Chambre des pairs; il y avait là je ne sais quoi de ces terribles scènes révolutionnaires aux grands jours de nos malheurs, quand le poignard circulait au tribunal entre les mains des victimes. Quelques militaires dont la funeste fascination avait amené la ruine de la France, en déterminant la seconde invasion de l'étranger, se débattaient sur le seuil du palais; leur désespoir prophétique, leurs gestes, leurs paroles de la (p. 040) tombe, semblaient annoncer une triple mort: mort à eux-mêmes, mort à l'homme qu'ils avaient béni, mort à la race qu'ils avaient proscrite.
Tandis que Bonaparte se retirait à la Malmaison avec l'Empire fini, nous, nous partions de Gand avec la monarchie recommençante. Pozzo, qui savait combien il s'agissait peu de la légitimité en haut lieu, se hâta d'écrire à Louis XVIII de partir et d'arriver vite, s'il voulait régner avant que la place fût prise: c'est à ce billet que Louis XVIII dut sa couronne en 1815.
À Mons, je manquai la première occasion de fortune de ma carrière politique; j'étais mon propre obstacle et je me trouvais sans cesse sur mon chemin. Cette fois, mes qualités me jouèrent le mauvais tour que m'auraient pu faire mes défauts.
M. de Talleyrand, dans tout l'orgueil d'une négociation qui l'avait enrichi, prétendait avoir rendu à la légitimité les plus grands services et il revenait en maître. Étonné que déjà on n'eût point suivi pour le retour à Paris la route qu'il avait tracée, il fut bien plus mécontent de retrouver M. de Blacas avec le roi. Il regardait M. de Blacas comme le fléau de la monarchie; mais ce n'était pas là le vrai motif de son aversion: il considérait dans M. de Blacas le favori, par conséquent le rival; il craignait aussi Monsieur et s'était emporté lorsque, quinze jours auparavant, Monsieur lui avait fait offrir son hôtel sur la Lys. Demander l'éloignement de M. de Blacas, rien de plus naturel; l'exiger, c'était trop se souvenir de Bonaparte.
(p. 041) M. de Talleyrand entra dans Mons vers les six heures du soir, accompagné de l'abbé Louis: M. de Ricé, M. de Jaucourt et quelques autres commensaux, volèrent à lui. Plein d'une humeur qu'on ne lui avait jamais vue, l'humeur d'un roi qui croit son autorité méconnue, il refusa de prime abord d'aller chez Louis XVIII, répondant à ceux qui l'en pressaient par sa phrase ostentatrice: «Je ne suis jamais pressé; il sera temps demain.» Je l'allai voir; il me fit toutes ces cajoleries avec lesquelles il séduisait les petits ambitieux et les niais importants. Il me prit par le bras, s'appuya sur moi en me parlant: familiarités de haute faveur, calculées pour me tourner la tête, et qui étaient, avec moi, tout à fait perdues; je ne comprenais même pas. Je l'invitai à venir chez le roi où je me rendais.
Louis XVIII était dans ses grandes douleurs: il s'agissait de se séparer de M. de Blacas; celui-ci ne pouvait rentrer en France; l'opinion était soulevée contre lui; bien que j'eusse eu à me plaindre du favori à Paris, je ne lui en avais témoigné à Gand aucun ressentiment. Le roi m'avait su gré de ma conduite; dans son attendrissement, il me traita à merveille. On lui avait déjà rapporté les propos de M. de Talleyrand: «Il se vante,» me dit-il, «de m'avoir remis une seconde fois la couronne sur la tête et il me menace de reprendre le chemin de l'Allemagne: qu'en pensez-vous, monsieur de Chateaubriand?» Je répondis: «On aura mal instruit Votre Majesté; M. de Talleyrand est seulement fatigué. Si le roi y consent, je retournerai chez le ministre.» Le roi parut bien aise; ce qu'il aimait le moins, c'étaient les (p. 042) tracasseries; il désirait son repos aux dépens même de ses affections.
M. de Talleyrand au milieu de ses flatteurs était plus monté que jamais. Je lui représentai qu'en un moment aussi critique il ne pouvait songer à s'éloigner. Pozzo le prêcha dans ce sens: bien qu'il n'eût pas la moindre inclination pour lui, il aimait dans ce moment à le voir aux affaires comme une ancienne connaissance; de plus il le supposait en faveur près du czar. Je ne gagnai rien sur l'esprit de M. de Talleyrand, les habitués du prince me combattaient; M. Mounier même pensait que M. de Talleyrand devait se retirer. L'abbé Louis, qui mordait tout le monde, me dit en secouant trois fois sa mâchoire: «Si j'étais le prince, je ne resterais pas un quart d'heure à Mons.» Je lui répondis: «Monsieur l'abbé, vous et moi nous pouvons nous en aller où nous voulons, personne ne s'en apercevra; il n'en est pas de même de M. de Talleyrand.» J'insistai encore et je dis au prince: «Savez-vous que le roi continue son voyage?» M. de Talleyrand parut surpris, puis il me dit superbement, comme le Balafré à ceux qui le voulaient mettre en garde contre les desseins de Henri III: «Il n'osera!»
Je revins chez le roi où je trouvai M. de Blacas. Je dis à Sa Majesté, pour excuser son ministre, qu'il était malade, mais qu'il aurait très certainement l'honneur de faire sa cour au roi le lendemain. «Comme il voudra, répliqua Louis XVIII: je pars à trois heures;» et puis il ajouta affectueusement ces paroles: «Je vais me séparer de M. de Blacas; la place sera vide, monsieur de Chateaubriand.»
(p. 043) C'était la maison du roi mise à mes pieds. Sans s'embarrasser davantage de M. de Talleyrand, un politique avisé aurait fait attacher ses chevaux à sa voiture pour suivre ou précéder le roi: je demeurai sottement dans mon auberge.
M. de Talleyrand, ne pouvant se persuader que le roi s'en irait, s'était couché: à trois heures on le réveille pour lui dire que le roi part; il n'en croit pas ses oreilles: «Joué! trahi!» s'écria-t-il. On le lève, et le voilà, pour la première fois de sa vie, à trois heures du matin dans la rue, appuyé sur le bras de M. de Ricé. Il arrive devant l'hôtel du roi; les deux premiers chevaux de l'attelage avaient déjà la moitié du corps hors de la porte cochère. On fait signe au postillon de s'arrêter; le roi demande ce que c'est; on lui crie: «Sire, c'est M. de Talleyrand.—Il dort, dit Louis XVIII.—Le voilà, sire.—Allons!» répondit le roi. Les chevaux reculent avec la voiture; on ouvre la portière, le roi descend, rentre en se traînant dans son appartement, suivi du ministre boiteux. Là M. de Talleyrand commence en colère une explication. Sa Majesté l'écoute et lui répond: «Prince de Bénévent, vous nous quittez? Les eaux vous feront du bien: vous nous donnerez de vos nouvelles.» Le roi laisse le prince ébahi, se fait reconduire à sa berline et part.
M. de Talleyrand bavait de colère; le sang-froid de Louis XVIII l'avait démonté: lui, M. de Talleyrand, qui se piquait de tant de sang-froid, être battu sur son propre terrain, planté là, sur une place à Mons, comme l'homme le plus insignifiant: il n'en revenait pas! Il demeure muet, regarde s'éloigner le carrosse, (p. 044) puis saisissant le duc de Lévis par un bouton de son spencer: «Allez, monsieur le duc, allez dire comme on me traite! J'ai remis la couronne sur la tête du roi (il en revenait toujours à cette couronne), et je m'en vais en Allemagne commencer la nouvelle émigration.»
M. de Lévis écoutant en distraction, se haussant sur la pointe du pied, dit: «Prince, je pars, il faut qu'il y ait au moins un grand seigneur avec le roi.»
M. de Lévis se jeta dans une carriole de louage qui portait le chancelier de France: les deux grandeurs de la monarchie capétienne s'en allèrent côte à côte la rejoindre, à moitié frais, dans une benne mérovingienne.
J'avais prié M. de Duras de travailler à la réconciliation et de m'en donner les premières nouvelles. «Quoi! m'avait dit M. de Duras, vous restez après ce que vous a dit le roi?» M. de Blacas, en partant de Mons de son côté, me remercia de l'intérêt que je lui avais montré.
Je retrouvai M. de Talleyrand embarrassé; il en était au regret de n'avoir pas suivi mon conseil, et d'avoir, comme un sous-lieutenant mauvaise tête, refusé d'aller le soir chez le roi; il craignait que des arrangements eussent lieu sans lui, qu'il ne pût participer à la puissance politique et profiter des tripotages d'argent qui se préparaient. Je lui dis que, bien que je différasse de son opinion, je ne lui en restais pas moins attaché, comme un ambassadeur à son ministre; qu'au surplus j'avais des amis auprès du roi, et que j'espérais bientôt apprendre quelque chose (p. 045) de bon. M. de Talleyrand était une vraie tendresse, il se penchait sur mon épaule; certainement il me croyait dans ce moment un très grand homme.
Je ne tardai point à recevoir un billet de M. de Duras; il m'écrivait de Cambrai que l'affaire était arrangée, et que M. de Talleyrand allait recevoir l'ordre de se mettre en route: cette fois le prince ne manqua pas d'obéir.
Quel diable me poussait? Je n'avais point suivi le roi qui m'avait pour ainsi dire offert ou plutôt donné le ministère de sa maison et qui fut blessé de mon obstination à rester à Mons; je me cassais le cou pour M. de Talleyrand que je connaissais à peine, que je n'estimais point, que je n'admirais point; pour M. de Talleyrand qui allait entrer dans des combinaisons nullement les miennes, qui vivait dans une atmosphère de corruption dans laquelle je ne pouvais respirer!
Ce fut de Mons même, au milieu de tous ses embarras, que le prince de Bénévent envoya M. de Perray toucher à Naples les millions d'un de ses marchés de Vienne.[35] M. de Blacas cheminait en même temps avec l'ambassade de Naples dans sa poche, et d'autres millions que le généreux exilé de Gand lui avait donnés à Mons. Je m'étais tenu dans de bons rapports avec M. de Blacas, précisément parce que tout le monde le détestait; j'avais encouru l'amitié de M. de Talleyrand pour ma fidélité à un caprice de son humeur; Louis XVIII m'avait positivement appelé auprès de sa personne, et je préférai (p. 046) la turpitude d'un homme sans foi à la faveur du roi: il était trop juste que je reçusse la récompense de ma stupidité, que je fusse abandonné de tous, pour les avoir voulu servir tous. Je rentrai en France n'ayant pas de quoi payer ma route, tandis que les trésors pleuvaient sur les disgraciés: je méritais cette correction. C'est fort bien de s'escrimer en pauvre chevalier quand tout le monde est cuirassé d'or; mais encore ne faut-il pas faire des fautes énormes: moi demeuré auprès du roi, la combinaison du ministère Talleyrand et Fouché devenait presque impossible; la Restauration commençait par un ministère moral et honorable, toutes les combinaisons de l'avenir pouvaient changer. L'insouciance que j'avais de ma personne me trompa sur l'importance des faits: la plupart des hommes ont le défaut de se trop compter; j'ai le défaut de ne me pas compter assez: je m'enveloppai dans le dédain habituel de ma fortune; j'aurais dû voir que la fortune de la France se trouvait liée dans ce moment à celle de mes petites destinées: ce sont de ces enchevêtrements historiques fort communs.
Sorti enfin de Mons, j'arrivai au Cateau-Cambrésis; M. de Talleyrand m'y rejoignit: nous avions l'air de venir refaire le traité de paix de 1559 entre Henri II de France et Philippe II d'Espagne.
À Cambrai, il se trouva que le marquis de La Suze, maréchal des logis du temps de Fénelon, avait disposé des billets de logement de madame de Lévis, de madame de Chateaubriand et du mien: nous demeurâmes dans la rue, au milieu des feux de joie, de la foule circulant autour de nous et des habitants qui (p. 047) criaient: Vive le roi! Un étudiant, ayant appris que j'étais là, nous conduisit à la maison de sa mère.
Les amis des diverses monarchies de France commençaient à paraître; ils ne venaient pas à Cambrai pour la ligue contre Venise[36], mais pour s'associer contre les nouvelles constitutions; ils accouraient mettre aux pieds du roi leurs fidélités successives et leur haine pour la Charte: passeport qu'ils jugeaient nécessaire auprès de Monsieur; moi et deux ou trois raisonnables Gilles, nous sentions déjà la jacobinerie.
Le 28 juin, parut la déclaration de Cambrai. Le roi y disait: «Je ne veux éloigner de ma personne que ces hommes dont la renommée est un sujet de douleur pour la France et d'effroi pour l'Europe.» Or voyez, le nom de Fouché était prononcé avec gratitude par le pavillon Marsan! Le roi riait de la nouvelle passion de son frère et disait: «Elle ne lui est pas venue de l'inspiration divine.» Je vous ai déjà raconté qu'en traversant Cambrai après les Cent-Jours, je cherchai vainement mon logis du temps du régiment de Navarre et le café que je fréquentais avec La Martinière: tout avait disparu avec ma jeunesse.
De Cambrai, nous allâmes coucher à Roye: la maîtresse de l'auberge prit madame de Chateaubriand pour madame la Dauphine; elle fut portée en triomphe dans une salle où il y avait une table mise de trente couverts: la salle, éclairée de bougies, de chandelles et d'un large feu, était suffocante. L'hôtesse ne voulait (p. 048) pas recevoir de payement, et elle disait: «Je me regarde de travers pour n'avoir pas su me faire guillotiner pour nos rois[37].» Dernière étincelle d'un feu qui avait animé les Français pendant tant de siècles.
Le général Lamothe, beau-frère de M. Laborie, vint, envoyé par les autorités de la capitale, nous instruire qu'il nous serait impossible de nous présenter à Paris sans la cocarde tricolore. M. de Lafayette et d'autres commissaires, d'ailleurs fort mal reçus des alliés, valetaient d'état-major en état-major, mendiant près des étrangers un maître quelconque pour la France: tout roi, au choix des Cosaques, serait excellent, pourvu qu'il ne descendît pas de saint Louis et de Louis XIV.
À Roye, on tint conseil: M. de Talleyrand fit attacher deux haridelles à sa voiture et se rendit chez Sa Majesté. Son équipage occupait la largeur de la place, à partir de l'auberge du ministre jusqu'à la porte du (p. 049) roi. Il descendit de son char avec un mémoire qu'il nous lut: il examinait le parti qu'on aurait à suivre en arrivant; il hasardait quelques mots sur la nécessité d'admettre indistinctement tout le monde au partage des places; il faisait entendre qu'on pourrait aller généreusement jusqu'aux juges de Louis XVI. Sa Majesté rougit et s'écria en frappant des deux mains les deux bras de son fauteuil: «Jamais!» Jamais de vingt-quatre heures.
À Senlis, nous nous présentâmes chez un chanoine: sa servante nous reçut comme des chiens; quant au chanoine, qui n'était pas saint Rieul, patron de la ville, il ne voulut seulement pas nous regarder. Sa bonne avait ordre de ne nous rendre d'autre service que de nous acheter de quoi manger, pour notre argent: le Génie du christianisme me fut néant[38]. Pourtant Senlis aurait dû nous être de bon augure, puisque ce fut dans cette ville que Henri IV se déroba aux mains de ses geôliers en 1576: «Je n'ai de regret,» s'écriait en s'échappant (p. 050) le roi, compatriote de Montaigne, «que pour deux choses que j'ai laissées à Paris: la messe et ma femme.»
De Senlis nous nous rendîmes au berceau de Philippe-Auguste, autrement Gonesse[39]. En approchant du village, nous aperçûmes deux personnes qui s'avançaient vers nous: c'était le maréchal Macdonald et mon fidèle ami Hyde de Neuville. Ils arrêtèrent notre voiture et nous demandèrent où était M. de Talleyrand; ils ne firent aucune difficulté de m'apprendre qu'ils le cherchaient afin d'informer le roi que Sa Majesté ne devait pas songer à franchir la barrière avant d'avoir pris Fouché pour ministre[40]. L'inquiétude me gagna, car, malgré la manière dont Louis XVIII s'était prononcé à Roye, je n'étais pas très rassuré. Je questionnai le maréchal: «Quoi! monsieur le maréchal, lui dis-je, est-il certain que nous ne pouvons rentrer qu'à des conditions si dures?—Ma foi, monsieur le vicomte, me répondit le maréchal, je n'en suis pas bien convaincu.»
Le roi s'arrêta deux heures à Gonesse. Je laissai (p. 051) madame de Chateaubriand au milieu du grand chemin dans sa voiture, et j'allai au conseil à la mairie. Là fut mise en délibération une mesure d'où devait dépendre le sort futur de la monarchie. La discussion s'entama: je soutins, seul avec M. Beugnot, qu'en aucun cas Louis XVIII ne devait admettre dans ses conseils M. Fouché. Le roi écoutait: je voyais qu'il eût tenu volontiers la parole de Roye; mais il était absorbé par Monsieur et pressé par le duc de Wellington.
Dans un chapitre de la Monarchie selon la Charte, j'ai résumé les raisons que je fis valoir à Gonesse. J'étais animé; la parole parlée a une puissance qui s'affaiblit dans la parole écrite: «Partout où il y a une tribune ouverte, dis-je dans ce chapitre, quiconque peut être exposé à des reproches d'une certaine nature ne peut être placé à la tête du gouvernement. Il y a tel discours, tel mot, qui obligerait un pareil ministre à donner sa démission en sortant de la Chambre. C'est cette impossibilité résultante du principe libre des gouvernements représentatifs que l'on ne sentit pas lorsque toutes les illusions se réunirent pour porter un homme fameux au ministère, malgré la répugnance trop fondée de la couronne. L'élévation de cet homme devait produire l'une de ces deux choses: ou l'abolition de la Charte, ou la chute du ministère à l'ouverture de la session. Se représente-t-on le ministre dont je veux parler, écoutant à la Chambre des députés la discussion sur le 21 janvier, pouvant être apostrophé à chaque instant par quelque député de Lyon, et toujours menacé du terrible Tu es ille vir! Les hommes de cette sorte ne peuvent être employés ostensiblement (p. 052) qu'avec les muets du sérail de Bajazet, ou les muets du Corps législatif de Bonaparte. Que deviendra le ministre si un député, montant à la tribune un Moniteur à la main, lit le rapport de la Convention du 9 août 1795; s'il demande l'expulsion de Fouché comme indigne en vertu de ce rapport qui le chassait, lui Fouché (je cite textuellement), comme un voleur et un terroriste, dont la conduite atroce et criminelle communiquait le déshonneur et l'opprobre à toute assemblée quelconque dont il deviendrait membre?[41]»
Voilà les choses que l'on a oubliées!
Après tout, avait-on le malheur de croire qu'un homme de cette espèce pouvait jamais être utile? il fallait le laisser derrière le rideau, consulter sa triste expérience; mais faire violence à la couronne et à l'opinion, appeler à visage découvert un pareil ministre aux affaires, un homme que Bonaparte, dans ce moment même, traitait d'infâme, n'était-ce pas déclarer qu'on renonçait à la liberté et à la vertu? Une couronne vaut-elle un pareil sacrifice? On n'était plus maître d'éloigner personne: qui pouvait-on exclure après avoir pris Fouché?
Les partis agissaient sans songer à la forme du gouvernement qu'ils avaient adoptée; tout le monde parlait de constitution, de liberté, d'égalité, de droit des peuples, et personne n'en voulait; verbiage à la mode: on demandait, sans y penser, des nouvelles de la Charte, tout en espérant qu'elle crèverait bientôt. Libéraux et royalistes inclinaient au gouvernement absolu, (p. 053) amendé par les mœurs: c'est le tempérament et le train de la France. Les intérêts matériels dominaient; on ne voulait point renoncer à ce qu'on avait, dit-on, fait pendant la Révolution; chacun était chargé de sa propre vie et prétendait en onérer le voisin: le mal, assurait-on, était devenu un élément public, lequel devait désormais se combiner avec les gouvernements, et entrer comme principe vital dans la société.
Ma lubie, relative à une Charte mise en mouvement par l'action religieuse et morale, a été la cause du mauvais vouloir que certains partis m'ont porté: pour les royalistes, j'aimais trop la liberté; pour les révolutionnaires, je méprisais trop les crimes. Si je ne m'étais trouvé là, à mon grand détriment, pour me faire maître d'école de constitutionnalité, dès les premiers jours les ultras et les jacobins auraient mis la Charte dans la poche de leur frac à fleurs de lis, ou de leur carmagnole à la Cassius.
M. de Talleyrand n'aimait pas M. Fouché; M. Fouché détestait et, ce qu'il y a de plus étrange, méprisait M. de Talleyrand: il était difficile d'arriver à ce succès. M. de Talleyrand, qui d'abord eût été content de n'être pas accouplé à M. Fouché, sentant que celui-ci était inévitable, donna les mains au projet; il ne s'aperçut pas qu'avec la Charte (lui surtout uni au mitrailleur de Lyon) il n'était guère plus possible que Fouché.
Promptement se vérifia ce que j'avais annoncé: on n'eut pas le profit de l'admission du duc d'Otrante, on n'en eut que l'opprobre; l'ombre des Chambres approchant suffit pour faire disparaître des ministres trop exposés à la franchise de la tribune.
(p. 054) Mon opposition fut inutile: selon l'usage des caractères faibles, le roi leva la séance sans rien déterminer; l'ordonnance ne devait être arrêtée qu'au château d'Arnouville.
On ne tint point conseil en règle dans cette dernière résidence; les intimes et les affiliés au secret furent seuls assemblés. M. de Talleyrand, nous ayant devancés, prit langue avec ses amis. Le duc de Wellington arriva: je le vis passer en calèche; les plumes de son chapeau flottaient en l'air; il venait octroyer à la France M. Fouché et M. de Talleyrand, comme le double présent que la victoire de Waterloo faisait à notre patrie. Lorsqu'on lui représentait que le régicide de M. le duc d'Otrante était peut-être un inconvénient, il répondait: «C'est une frivolité.» Un Irlandais protestant,[42] un général anglais étranger à nos mœurs et à notre histoire, un esprit ne voyant dans l'année française de 1793 que l'antécédent anglais de l'année 1649, était chargé de régler nos destinées! L'ambition de Bonaparte nous avait réduits à cette misère.
Je rôdais à l'écart dans les jardins d'où le contrôleur général Machault, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, était allé s'éteindre aux Madelonnettes[43]; car la mort dans sa grande revue n'oubliait alors personne. Je n'étais plus appelé; les familiarités de l'infortune commune avaient cessé entre le souverain et le sujet: (p. 055) le roi se préparait à rentrer dans son palais, moi dans ma retraite. Le vide se reforme autour des monarques sitôt qu'ils retrouvent le pouvoir. J'ai rarement traversé sans faire des réflexions sérieuses les salons silencieux et déshabités des Tuileries, qui me conduisaient au cabinet du roi: à moi, déserts d'une autre sorte, solitudes infinies où les mondes mêmes s'évanouissent devant Dieu, seul être réel.
On manquait de pain à Arnouville; sans un officier du nom de Dubourg et qui dénichait de Gand comme nous, nous eussions jeûné. M. Dubourg alla à la picorée[44], il nous rapporta la moitié d'un mouton au logis du maire en fuite.[45] Si la servante de ce maire, (p. 056) héroïne de Beauvais demeurée seule, avait eu des armes, elle nous aurait reçus comme Jeanne Hachette.
Nous nous rendîmes à Saint-Denis: sur les deux bords de la chaussée s'étendaient les bivouacs des Prussiens et des Anglais; les yeux rencontraient au loin les flèches de l'abbaye: dans ses fondements Dagobert jeta ses joyaux, dans ses souterrains les races successives ensevelirent leurs rois et leurs grands hommes; quatre mois passés, nous avions déposé là les os de Louis XVI pour tenir lieu des autres poussières. Lorsque je revins de mon premier exil en 1800, j'avais traversé cette même plaine de Saint-Denis; il n'y campait encore que les soldats de Napoléon; des Français remplaçaient encore les vieilles bandes du connétable de Montmorency.
Un boulanger nous hébergea. Le soir, vers les neuf heures, j'allai faire ma cour au roi. Sa Majesté était (p. 057) logée dans les bâtiments de l'abbaye: on avait toutes les peines du monde à empêcher les petites filles de la Légion d'honneur de crier: Vive Napoléon! J'entrai d'abord dans l'église; un pan de mur attenant au cloître était tombé: l'antique abbatial n'était éclairé que d'une lampe. Je fis ma prière à l'entrée du caveau où j'avais vu descendre Louis XVI: plein de crainte sur l'avenir, je ne sais si j'ai jamais eu le cœur noyé d'une tristesse plus profonde et plus religieuse. Ensuite je me rendis chez Sa Majesté: introduit dans une des chambres qui précédaient celle du roi, je ne trouvai personne; je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup une porte s'ouvre: entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur; le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr; l'évêque apostat fut caution du serment.
Le lendemain, le faubourg Saint-Germain arriva: tout se mêlait de la nomination de Fouché déjà obtenue, la religion comme l'impiété, la vertu comme le vice, le royaliste comme le révolutionnaire, l'étranger comme le Français; on criait de toute part: «Sans Fouché point de sûreté pour le roi, sans Fouché point de salut pour la France; lui seul a déjà sauvé la patrie, lui seul peut achever son ouvrage.» La vieille duchesse de Duras était une des nobles dames les plus animées à l'hymne; le bailli de Crussol[46], survivant (p. 058) de Malte, faisait chorus; il déclarait que si sa tête était encore sur ses épaules, c'est que M. Fouché l'avait permis. Les peureux avaient eu tant de frayeur de Bonaparte, qu'ils avaient pris le massacreur de Lyon pour un Titus. Pendant plus de trois mois les salons du faubourg Saint-Germain me regardèrent comme un mécréant, parce que je désapprouvais la nomination de leurs ministres. Ces pauvres gens, ils s'étaient prosternés aux pieds des parvenus; ils n'en faisaient pas moins grand bruit de leur noblesse, de leur haine contre les révolutionnaires, de leur fidélité à toute épreuve, de l'inflexibilité de leurs principes, et ils adoraient Fouché.
Fouché avait senti l'incompatibilité de son existence ministérielle avec le jeu de la monarchie représentative: comme il ne pouvait s'amalgamer avec les éléments d'un gouvernement légal, il essaya de rendre les éléments politiques homogènes à sa propre nature. Il avait créé une terreur factice; supposant des dangers imaginaires, il prétendait forcer la couronne à reconnaître les deux Chambres de Bonaparte et à recevoir la déclaration des droits qu'on s'était hâté de parachever; on murmurait même quelques mots sur la nécessité d'exiler Monsieur et ses fils; le chef-d'œuvre eût été d'isoler le roi.
On continuait à être dupe: en vain la garde nationale passait par-dessus les murs de Paris et venait protester de son dévouement; on assurait que cette (p. 059) garde était mal disposée. La faction avait fait fermer les barrières afin d'empêcher le peuple, resté royaliste pendant les Cent-Jours, d'accourir, et l'on disait que ce peuple menaçait d'égorger Louis XVIII à son passage. L'aveuglement était miraculeux, car l'armée française se retirait sur la Loire, cent cinquante mille alliés occupaient les postes extérieurs de la capitale, et l'on prétendait toujours que le roi n'était pas assez fort pour pénétrer dans une ville où il ne restait pas un soldat, où il n'y avait plus que des bourgeois, très capables de contenir une poignée de fédérés, s'ils s'étaient avisés de remuer. Malheureusement le roi, par une suite de coïncidences fatales, semblait le chef des Anglais et des Prussiens; il croyait être environné de libérateurs, et il était accompagné d'ennemis; il paraissait entouré d'une escorte d'honneur, et cette escorte n'était en réalité que les gendarmes qui le menaient hors de son royaume: il traversait seulement Paris en compagnie des étrangers dont le souvenir servirait un jour de prétexte au bannissement de sa race.
Le gouvernement provisoire formé depuis l'abdication de Bonaparte fut dissous par une espèce d'acte d'accusation contre la couronne: pierre d'attente sur laquelle on espérait bâtir un jour une nouvelle révolution.
À la première Restauration j'étais d'avis que l'on gardât la cocarde tricolore: elle brillait de toute sa gloire; la cocarde blanche était oubliée; en conservant des couleurs qu'avaient légitimées tant de triomphes, on ne préparait point à une révolution prévoyable un signe de ralliement. Ne pas prendre la cocarde blanche (p. 060) eût été sage; l'abandonner après qu'elle avait été portée par les grenadiers mêmes de Bonaparte était une lâcheté: on ne passe point impunément sous les fourches caudines; ce qui déshonore est funeste: un soufflet ne vous fait physiquement aucun mal, et cependant il vous tue.
Avant de quitter Saint-Denis je fus reçu par le roi et j'eus avec lui cette conversation:
«Eh bien? me dit Louis XVIII, ouvrant le dialogue par cette exclamation.
«Eh bien, sire, vous prenez le duc d'Otrante?
—Il l'a bien fallu: depuis mon frère jusqu'au bailli de Crussol (et celui-là n'est pas suspect), tous disaient que nous ne pouvions pas faire autrement: qu'en pensez-vous?
—Sire, la chose est faite: je demande à Votre Majesté la permission de me taire.
—Non, non, dites: vous savez comme j'ai résisté depuis Gand.
—Sire, je ne fais qu'obéir à vos ordres; pardonnez à ma fidélité: je crois la monarchie finie.»
Le roi garda le silence; je commençais à trembler de ma hardiesse, quand Sa Majesté reprit:
«Eh bien, monsieur de Chateaubriand, je suis de votre avis.»
Cette conversation termine mon récit des Cent-Jours..[Lien vers la Table des Matières]
Bonaparte à la Malmaison. — Abandon général. — Départ de la Malmaison. — Rambouillet. — Rochefort. — Bonaparte se réfugie sur la flotte anglaise. — Il écrit au prince régent. — Bonaparte sur le Belléphoron. — Torbay. — Acte qui confine Bonaparte à Sainte-Hélène. — Il passe sur le Northumberland et fait voile. — Jugement sur Bonaparte. — Caractère de Bonaparte. — Si Bonaparte nous a laissé en renommée ce qu'il nous a ôté en force. — Inutilité des vérités ci-dessus exposées. — Île de Sainte-Hélène. — Bonaparte traverse l'Atlantique. — Napoléon prend terre à Sainte-Hélène. — Son établissement à Longwood. — Précautions. — Vie à Longwood. — Visites. — Manzoni. — Maladie de Bonaparte. — Ossian. — Rêveries de Napoléon à la vue de la mer. — Projets d'enlèvement. — Dernière occupation de Bonaparte. — Il se couche et ne se relève plus. — Il dicte son testament. — Sentiments religieux de Napoléon. — L'aumônier Vignale. — Napoléon apostrophe Antomarchi, son médecin. — Il reçoit les derniers sacrements. — Il expire. — Funérailles. — Destruction du monde napoléonien. — Mes derniers rapports avec Bonaparte. — Sainte-Hélène depuis la mort de Napoléon. — Exhumation de Bonaparte. — Ma visite à Cannes.
Si un homme était soudain transporté des scènes les plus bruyantes de la vie au rivage silencieux de l'Océan glacé, il éprouverait ce que j'éprouve auprès du tombeau de Napoléon, car nous voici tout à coup au bord de ce tombeau.
Sorti de Paris le 25 juin, Napoléon attendait à la Malmaison l'instant de son départ de France. Je retourne à lui: revenant sur les jours écoulés, anticipant sur les temps futurs, je ne le quitterai plus qu'après sa mort.
La Malmaison, où l'empereur se reposa, était vide. Joséphine était morte[47]; Bonaparte dans cette retraite (p. 062) se trouvait seul. Là il avait commencé sa fortune; là il avait été heureux; là il s'était enivré de l'encens du monde; là, du sein de son tombeau, partaient les ordres qui troublaient la terre. Dans ces jardins où naguère les pieds de la foule râtelaient les allées sablées, l'herbe et les ronces verdissaient; je m'en étais assuré en m'y promenant. Déjà, faute de soins, dépérissaient les arbres étrangers; sur les canaux ne voguaient plus les cygnes noirs de l'Océanie; la cage n'emprisonnait plus les oiseaux du tropique: ils s'étaient envolés pour aller attendre leur hôte dans leur patrie.
Bonaparte aurait pu cependant trouver un sujet de consolation en tournant les yeux vers ses premiers jours: les rois tombés s'affligent surtout, parce qu'ils n'aperçoivent en amont de leur chute qu'une splendeur héréditaire et les pompes de leur berceau: mais que découvrait Napoléon antérieurement à ses prospérités? la crèche de sa naissance dans un village de Corse. Plus magnanime, en jetant le manteau de pourpre, il aurait repris avec orgueil le sayon du chevrier; mais les hommes ne se replacent point à leur origine quand elle fut humble; il semble que l'injuste ciel les prive de leur patrimoine lorsqu'à la loterie du sort ils ne font que perdre ce qu'ils avaient gagné, et néanmoins la grandeur de Napoléon vient de ce qu'il était parti de lui-même: rien de son sang ne l'avait précédé et n'avait préparé sa puissance.
À l'aspect de ces jardins abandonnés, de ces chambres déshabitées, de ces galeries fanées par les fêtes, de ces salles où les chants et la musique avaient cessé, Napoléon pouvait repasser sur sa carrière: il se pouvait (p. 063) demander si avec un peu plus de modération il n'aurait pas conservé ses félicités. Des étrangers, des ennemis, ne le bannissaient pas maintenant; il ne s'en allait pas quasi-vainqueur, laissant les nations dans l'admiration de son passage, après la prodigieuse campagne de 1814; il se retirait battu. Des Français, des amis, exigeaient son abdication immédiate, pressaient son départ, ne le voulaient plus même pour général, lui dépêchaient courriers sur courriers, pour l'obliger à quitter le sol sur lequel il avait versé autant de gloire que de fléaux.
À cette leçon si dure se joignaient d'autres avertissements: les Prussiens rôdaient dans le voisinage de la Malmaison; Blücher, aviné, ordonnait en trébuchant de saisir, de pendre le conquérant qui avait mis le pied sur le cou des rois. La rapidité des fortunes, la vulgarités des mœurs, la promptitude de l'élévation et de l'abaissement des personnages modernes ôtera, je le crains, à notre temps, une partie de la noblesse de l'histoire: Rome et la Grèce n'ont point parlé de pendre Alexandre et César.
Les scènes qui avaient eu lieu en 1814 se renouvelèrent en 1815, mais avec quelque chose de plus choquant, parce que les ingrats étaient stimulés par la peur: il se fallait débarrasser de Napoléon vite: les alliés arrivaient; Alexandre n'était pas là, au premier moment, pour tempérer le triomphe et contenir l'insolence de la fortune; Paris avait cessé d'être orné de sa lustrale inviolabilité; une première invasion avait souillé le sanctuaire; ce n'était plus la colère de Dieu qui tombait sur nous, c'était le mépris du ciel: le foudre s'était éteint.
(p. 064) Toutes les lâchetés avaient acquis par les Cent-Jours un nouveau degré de malignité; affectant de s'élever, par amour de la patrie, au-dessus des attachements personnels, elles s'écriaient que Bonaparte était aussi trop criminel d'avoir violé les traités de 1814. Mais les vrais coupables n'étaient-ils pas ceux qui favorisèrent ses desseins? Si, en 1815, au lieu de lui refaire des armées, après l'avoir délaissé une première fois pour le délaisser encore, ils lui avaient dit, lorsqu'il vint coucher aux Tuileries: «Votre génie vous a trompé; l'opinion n'est plus à vous; prenez pitié de la France. Retirez-vous après cette dernière visite à la terre; allez vivre dans la patrie de Washington. Qui sait si les Bourbons ne commettront point de fautes? qui sait si un jour la France ne tournera pas les yeux vers vous, lorsque, à l'école de la liberté, vous aurez appris le respect des lois? Vous reviendrez alors, non en ravisseur qui fond sur sa proie, mais en grand citoyen pacificateur de son pays.»
Ils ne lui tinrent point ce langage: ils se prêtèrent aux passions de leur chef revenu; ils contribuèrent à l'aveugler, sûrs qu'ils étaient de profiter de sa victoire ou de sa défaite. Le soldat seul mourut pour Napoléon avec une sincérité admirable; le reste ne fut qu'un troupeau paissant, s'engraissant à droite et à gauche. Encore si les vizirs du calife dépouillé s'étaient contentés de lui tourner le dos! mais non: ils profitaient de ses derniers instants; ils l'accablaient de leurs sordides demandes; tous voulaient tirer de l'argent de sa pauvreté.
Oncques ne fut plus complet abandon; Bonaparte y (p. 065) avait donné lieu: insensible aux peines d'autrui, le monde lui rendit indifférence pour indifférence. Ainsi que la plupart des despotes, il était bien avec sa domesticité; au fond il ne tenait à rien: homme solitaire, il se suffisait; le malheur ne fit que le rendre au désert de sa vie.
Quand je recueille mes souvenirs, quand je me rappelle avoir vu Washington dans sa petite maison de Philadelphie, et Bonaparte dans ses palais, il me semble que Washington, retiré dans son champ de la Virginie, ne devait pas éprouver les syndérèses de Bonaparte attendant l'exil dans ses jardins de la Malmaison. Rien n'était changé dans la vie du premier; il retombait sur ses habitudes modestes; il ne s'était point élevé au-dessus de la félicité des laboureurs qu'il avait affranchis; tout était bouleversé dans la vie du second.
Napoléon quitta la Malmaison[48] accompagné des généraux Bertrand,[49] Rovigo et Beker,[50] ce dernier en (p. 066) qualité de surveillant ou de commissaire. Chemin faisant, il lui prit envie de s'arrêter à Rambouillet. Il en partit pour s'embarquer à Rochefort, comme Charles X pour s'embarquer à Cherbourg; Rambouillet, retraite inglorieuse où s'éclipsa ce qu'il y eut de plus grand, en race et en homme; lieu fatal où mourut François Ier; où Henri III, échappé des barricades, coucha tout botté en passant; où Louis XVI a laissé son ombre! Heureux Louis, Napoléon et Charles, s'ils n'eussent été que les obscurs gardiens des troupeaux de Rambouillet!
Arrivé à Rochefort,[51] Napoléon hésitait: la commission exécutive envoyait des ordres impératifs: «Les garnisons de Rochefort et de La Rochelle doivent,» disaient les dépêches, «prêter main-forte pour faire embarquer Napoléon... Employez la force... faites-le partir... ses services ne peuvent être acceptés.»
Les services de Napoléon ne pouvaient être acceptés! Et n'aviez-vous pas accepté ses bienfaits et ses chaînes? Napoléon ne s'en allait point; il était chassé: et par qui?
Bonaparte n'avait cru qu'à la fortune; il n'accordait au malheur ni le feu ni l'eau; il avait d'avance innocenté les ingrats: un juste talion le faisait comparaître devant son système. Quand le succès cessant (p. 067) d'animer sa personne s'incarna dans un autre individu, les disciples abandonnèrent le maître pour l'école. Moi qui crois à la légitimité des bienfaits et à la souveraineté du malheur, si j'avais servi Bonaparte, je ne l'aurais pas quitté; je lui aurais prouvé, par ma fidélité, la fausseté de ses principes politiques; en partageant ses disgrâces, je serais resté auprès de lui, comme un démenti vivant de ses stériles doctrines et du peu de valeur du droit de la prospérité.
Depuis le 1er juillet, des frégates l'attendaient dans la rade de Rochefort: des espérances qui ne meurent jamais, des souvenirs inséparables d'un dernier adieu, l'arrêtèrent. Qu'il devait regretter les jours de son enfance alors que ses yeux sereins n'avaient point encore vu tomber la première pluie? Il laissa le temps à la flotte anglaise d'approcher. Il pouvait encore s'embarquer sur deux lougres qui devaient joindre en mer un navire danois (c'est le parti que prit son frère Joseph); mais la résolution lui faillit en regardant le rivage de France. Il avait aversion d'une république; l'égalité et la liberté des États-Unis lui répugnaient. Il penchait à demander un asile aux Anglais: «Quel inconvénient trouvez-vous à ce parti? disait-il à ceux qu'il consultait.—«L'inconvénient de vous déshonorer,» lui répondit un officier de marine: vous ne devez pas même tomber mort entre les mains des Anglais. Ils vous feront empailler pour vous montrer à un schelling par tête.»
Malgré ces observations, l'empereur résolut de se livrer à ses vainqueurs. Le 13 juillet, Louis XVIII étant déjà à Paris depuis cinq jours, Napoléon envoya au (p. 068) capitaine du vaisseau anglais le Bellérophon cette lettre pour le prince régent:
«Altesse Royale, en butte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique, et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois, que je réclame de Votre Altesse Royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis.
«Rochefort, 13 juillet 1815.»
Si Bonaparte n'avait pendant vingt ans accablé d'outrages le peuple anglais, son gouvernement, son roi et l'héritier de ce roi, on aurait pu trouver quelque convenance de ton dans cette lettre; mais comment cette Altesse Royale, tant méprisée, tant insultée par Napoléon, est-elle devenue tout à coup le plus puissant, le plus constant, le plus généreux des ennemis, par la seule raison qu'elle est victorieuse? Il ne pouvait pas être persuadé de ce qu'il disait; or ce qui n'est pas vrai n'est pas éloquent. La phrase exposant le fait d'une grandeur tombée qui s'adresse à un ennemi est belle; l'exemple banal de Thémistocle est de trop.
Il y a quelque chose de pire qu'un défaut de sincérité dans la démarche de Bonaparte; il y a oubli de la France: l'empereur ne s'occupa que de sa catastrophe individuelle; la chute arrivée, nous ne comptâmes plus pour rien à ses yeux. Sans penser qu'en donnant la préférence à l'Angleterre sur l'Amérique, son choix (p. 069) devenait un outrage au deuil de la patrie, il sollicita un asile du gouvernement qui depuis vingt ans soudoyait l'Europe contre nous, de ce gouvernement dont le commissaire à l'armée russe, le général Wilson, pressait Kutuzof, dans la retraite de Moscou, d'achever de nous exterminer: les Anglais, heureux à la bataille finale, campaient dans le bois de Boulogne. Allez donc, ô Thémistocle, vous asseoir tranquillement au foyer britannique, tandis que la terre n'a pas encore achevé de boire le sang français versé pour vous à Waterloo! Quel rôle le fugitif, fêté peut-être, eût-il joué au bord de la Tamise, en face de la France envahie, de Wellington devenu dictateur au Louvre? La haute fortune de Napoléon le servit mieux: les Anglais, se laissant emporter à une politique étroite et rancunière, manquèrent leur dernier triomphe; au lieu de perdre leur suppliant en l'admettant à leurs bastilles ou à leurs festins, ils lui rendirent plus brillante pour la postérité la couronne qu'ils croyaient lui avoir ravie. Il s'accrut dans sa captivité de l'énorme frayeur des puissances: en vain l'Océan l'enchaînait, l'Europe armée campait au rivage, les yeux attachés sur la mer.
Le 15 juillet, l'Épervier transporta Bonaparte au Bellérophon. L'embarcation française était si petite que du bord du vaisseau anglais on n'apercevait pas le géant sur les vagues. L'empereur, en abordant le capitaine Maitland, lui dit: «Je viens me mettre sous la protection des lois de l'Angleterre.» Une fois du moins le contempteur des lois en confessait l'autorité.
La flotte fit voile pour Torbay: une foule de barques (p. 070) se croisaient autour du Bellérophon; même empressement à Plymouth. Le 30 juillet, lord Keith délivra au requérant l'acte qui le confinait à Sainte-Hélène: «C'est pis que la cage de Tamerlan,» dit Napoléon.
Cette violation du droit des gens et du respect de l'hospitalité était révoltante; si vous recevez le jour dans un navire quelconque, pourvu qu'il soit sous voile, vous êtes Anglais de naissance; en vertu des vieilles coutumes de Londres, les flots sont réputés terre d'Albion. Et un navire anglais n'était point pour un suppliant un autel inviolable, il ne plaçait point le grand homme qui embrassait la poupe du Bellérophon sous la protection du trident britannique! Bonaparte protesta; il argumenta de lois, parla de trahison et de perfidie, en appela à l'avenir: cela lui allait-il bien? ne s'était-il pas ri de la justice? n'avait-il pas dans sa force foulé aux pieds les choses saintes dont il invoquait la garantie? n'avait-il pas enlevé Toussaint-Louverture et le roi d'Espagne? n'avait-il pas fait arrêter et détenir prisonniers pendant des années les voyageurs anglais qui se trouvaient en France au moment de la rupture du traité d'Amiens? Permis donc à la marchande Angleterre d'imiter ce qu'il avait fait lui-même, et d'user d'ignobles représailles; mais on pouvait agir autrement.
Chez Napoléon, la grandeur du cœur ne répondait pas à la largeur de la tête: ses querelles avec les Anglais sont déplorables; elles révoltent lord Byron. Comment daigna-t-il honorer d'un mot ses geôliers? On souffre de le voir s'abaisser à des conflits de paroles avec lord Keith à Torbay, avec sir Hudson Lowe à Sainte-Hélène, publier des factums parce qu'on lui (p. 071) manque de foi, chicaner sur un titre, sur un peu plus, sur un peu moins d'or ou d'honneurs. Bonaparte, réduit à lui-même, était réduit à sa gloire, et cela lui devait suffire: il n'avait rien à demander aux hommes; il ne traitait pas assez despotiquement l'adversité; on lui aurait pardonné d'avoir fait du malheur son dernier esclave. Je ne trouve de remarquable dans sa protestation contre la violation de l'hospitalité que la date et la signature de cette protestation: «À bord du Bellérophon, à la mer. Napoléon.» Ce sont là des harmonies d'immensité.
Du Bellérophon, Bonaparte passa sur le Northumberland. Deux frégates chargées de la garnison future de Sainte-Hélène l'escortaient. Quelques officiers de cette garnison avaient combattu à Waterloo. On permit à cette explorateur du globe de garder auprès de lui M. et madame Bertrand, MM. de Montholon[52], (p. 072) Gourgaud et de Las Cases[53], volontaires et généreux passagers sur la planche submergée. Par un article des instructions du capitaine, Bonaparte devait être désarmé: Napoléon seul, prisonnier dans un vaisseau, au milieu de l'Océan, désarmé! quelle magnifique terreur de sa puissance[54]! Mais quelle leçon du ciel (p. 073) donnée aux hommes qui abusent du glaive! La stupide amirauté traitait en sentencié de Botany-Bay le grand convict de la race humaine: le prince Noir fit-il désarmer le roi Jean?
L'escadre leva l'ancre. Depuis la barque qui porta César, aucun vaisseau ne fut chargé d'une pareille destinée. Bonaparte se rapprochait de cette mer des miracles, où l'Arabe du Sinaï l'avait vu passer. La dernière terre de France que découvrit Napoléon fut le cap la Hogue; autre trophée des Anglais.
L'empereur s'était trompé dans l'intérêt de sa mémoire, lorsqu'il avait désiré rester en Europe; il n'aurait bientôt été qu'un prisonnier vulgaire ou flétri: son vieux rôle était terminé. Mais au delà de ce rôle une nouvelle position le rajeunit d'une renommée nouvelle. Aucun homme de bruit universel n'a eu une fin pareille à celle de Napoléon. On ne le proclama point, comme à sa première chute, autocrate de quelques carrières de fer et de marbre, les unes pour lui fournir une épée, les autres une statue; aigle, on lui donna un rocher à la pointe duquel il est demeuré au soleil jusqu'à sa mort, et d'où il était vu de toute la terre.
Au moment où Bonaparte quitte l'Europe, où il abandonne sa vie pour aller chercher les destinées de sa mort, il convient d'examiner cet homme à deux existences, de peindre le faux et le vrai Napoléon: ils se confondent et forment un tout, du mélange de leur réalité et de leur mensonge.
De la réunion de ces remarques il résulte que Bonaparte était un poète en action, un génie immense dans la guerre, un esprit infatigable, habile et sensé (p. 074) dans l'administration, un législateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagination des peuples, et tant d'autorité sur le jugement des hommes positifs. Mais comme politique ce sera toujours un homme défectueux aux yeux des hommes d'État. Cette observation, échappée à la plupart de ses panégyristes, deviendra, j'en suis convaincu, l'opinion définitive qui restera de lui; elle expliquera le contraste de ses actions prodigieuses et de leurs misérables résultats. À Sainte-Hélène il a condamné lui-même avec sévérité sa conduite politique sur deux points: la guerre d'Espagne et la guerre de Russie; il aurait pu étendre sa confession à d'autres coulpes. Ses enthousiastes ne soutiendront peut-être pas qu'en se blâmant il s'est trompé sur lui-même. Récapitulons:
Bonaparte agit contre toute prudence, sans parler de nouveau de ce qu'il y eut d'odieux dans l'action, en tuant le duc d'Enghien: il attacha un poids à sa vie. Malgré les puérils apologistes, cette mort, ainsi que nous l'avons vu, fut le levain secret des discordes qui éclatèrent dans la suite entre Alexandre et Napoléon, comme entre la Prusse et la France.
L'entreprise sur l'Espagne fut complètement abusive: la Péninsule était à l'empereur; il en pouvait tirer le parti le plus avantageux: au lieu de cela, il en fit une école pour les soldats anglais, et le principe de sa propre destruction par le soulèvement d'un peuple.
La détention du pape et la réunion des États de l'Église à la France n'étaient que le caprice de la tyrannie par lequel il perdit l'avantage de passer pour le restaurateur de la religion.
(p. 075) Bonaparte ne s'arrêta pas lorsqu'il eut épousé la fille des Césars, ainsi qu'il l'aurait dû faire: la Russie et l'Angleterre lui criaient merci.
Il ne ressuscita pas la Pologne, quand du rétablissement de ce royaume dépendait le salut de l'Europe.
Il se précipita sur la Russie malgré les représentations de ses généraux et de ses conseillers.
La folie commencée, il dépassa Smolensk; tout lui disait qu'il ne devait pas aller plus loin à son premier pas, que sa première campagne du Nord était finie, et que la seconde (il le sentait lui-même) le rendrait maître de l'empire des czars.
Il ne sut ni computer les jours, ni prévoir l'effet des climats, que tout le monde à Moscou computait et prévoyait. Voyez en son lieu ce que j'ai dit du blocus continental et de la Confédération du Rhin; le premier, conception gigantesque, mais acte douteux; la seconde, ouvrage considérable, mais gâté dans l'exécution par l'instinct de camp et l'esprit de fiscalité. Napoléon reçut en don la vieille monarchie française telle que l'avaient faite les siècles et une succession ininterrompue de grands hommes, telle que l'avaient laissée la majesté de Louis XIV et les alliances de Louis XV, telle que l'avait agrandie la République. Il s'assit sur ce magnifique piédestal, étendit les bras, se saisit des peuples et les ramassa autour de lui; mais il perdit l'Europe avec autant de promptitude qu'il l'avait prise; il amena deux fois les alliés à Paris, malgré les miracles de son intelligence militaire. Il avait le monde sous ses pieds et il n'en a tiré qu'une prison pour lui, un exil pour sa famille, la perte de toutes ses conquêtes et d'une portion du vieux sol français.
(p. 076) C'est là l'histoire prouvée par les faits et que personne ne saurait nier. D'où naissaient les fautes que je viens d'indiquer, suivies d'un dénoûment si prompt et si funeste? Elles naissaient de l'imperfection de Bonaparte en politique.
Dans ses alliances, il n'enchaînait les gouvernements que par des concessions de territoire, dont il changeait bientôt les limites; montrant sans cesse l'arrière-pensée de reprendre ce qu'il avait donné, faisant toujours sentir l'oppresseur; dans ses envahissements, il ne réorganisait rien, l'Italie exceptée. Au lieu de s'arrêter après chaque pas pour relever sous une autre forme derrière lui ce qu'il avait abattu, il ne discontinuait pas son mouvement de progression parmi des ruines: il allait si vite, qu'à peine avait-il le temps de respirer où il passait. S'il eût, par une espèce de traité de Westphalie, réglé et assuré l'existence des États en Allemagne, en Prusse, en Pologne, à sa première marche rétrograde il se fût adossé à des populations satisfaites et il eût trouvé des abris. Mais son poétique édifice de victoires, manquant de base et n'étant suspendu en l'air que par son génie, tomba quand son génie vint à se retirer. Le Macédonien fondait des empires en courant, Bonaparte en courant ne les savait que détruire; son unique but était d'être personnellement le maître du globe, sans s'embarrasser des moyens de le conserver.
On a voulu faire de Bonaparte un être parfait, un type de sentiment, de délicatesse, de morale et de justice, un écrivain comme César et Thucydide, un orateur et un historien comme Démosthène et Tacite. Les discours publics de Napoléon, ses phrases de (p. 077) tente ou de conseil sont d'autant moins inspirées du souffle prophétique que ce qu'elles annonçaient de catastrophes ne s'est pas accompli, tandis que l'Isaïe du glaive a lui-même disparu: des paroles niniviennes qui courent après des États sans les joindre et les détruire restent puériles au lieu d'être sublimes. Bonaparte a été véritablement le Destin pendant seize années: le Destin est muet, et Bonaparte aurait dû l'être. Bonaparte n'était point César; son éducation n'était ni savante ni choisie; demi-étranger, il ignorait les premières règles de notre langue: qu'importe, après tout, que sa parole fût fautive? il donnait le mot d'ordre à l'univers. Ses bulletins ont l'éloquence de la victoire. Quelquefois dans l'ivresse du succès on affectait de les brocher sur un tambour; du milieu des plus lugubres accents, partaient de fatals éclats de rire. J'ai lu avec attention ce qu'a écrit Bonaparte, les premiers manuscrits de son enfance, ses romans, ensuite ses brochures à Buttafuoco, le souper de Beaucaire, ses lettres privées à Joséphine, les cinq volumes de ses discours, de ses ordres et de ses bulletins, ses dépêches restées inédites et gâtées par la rédaction des bureaux de M. de Talleyrand. Je m'y connais: je n'ai guère trouvé que dans un méchant autographe laissé à l'île d'Elbe des pensées qui ressemblent à la nature du grand insulaire:
«Mon cœur se refuse aux joies communes comme à la douleur ordinaire.»
«Ne m'étant pas donné la vie, je ne me l'ôterai pas non plus, tant qu'elle voudra bien de moi.»
(p. 078) «Mon mauvais génie m'apparut et m'annonça ma fin, que j'ai trouvée à Leipsick.»
«J'ai conjuré le terrible esprit de nouveauté qui parcourait le monde.»
C'est là très certainement du vrai Bonaparte.
Si les bulletins, les discours, les allocutions, les proclamations de Bonaparte se distinguent par l'énergie, cette énergie ne lui appartenait point en propre: elle était de son temps, elle venait de l'inspiration révolutionnaire qui s'affaiblit dans Bonaparte, parce qu'il marchait à l'inverse de cette inspiration. Danton disait: «Le métal bouillonne; si vous ne surveillez la fournaise, vous serez tous brûlés.» Saint-Just disait: «Osez!» Ce mot renferme toute la politique de notre Révolution; ceux qui font des révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau.
Les bulletins de Bonaparte s'élèvent-ils au-dessus de cette fierté de parole?
Quant aux nombreux volumes publiés sous le titre de Mémoires de Sainte-Hélène, Napoléon dans l'exil, etc., ces documents, recueillis de la bouche de Bonaparte, ou dictés par lui à différentes personnes, ont quelques beaux passages sur des actions de guerre, quelques appréciations remarquables de certains hommes; mais en définitive Napoléon n'est occupé qu'à faire son apologie, qu'à justifier son passé, qu'à bâtir sur des idées nées, des événements accomplis, des choses auxquelles il n'avait jamais songé pendant le cours de ces événements. Dans cette compilation, où le pour et le contre se succèdent, où chaque opinion (p. 079) trouve une autorité favorable et une réfutation péremptoire, il est difficile de démêler ce qui appartient à Napoléon de ce qui appartient à ses secrétaires. Il est probable qu'il avait une version différente pour chacun d'eux, afin que les lecteurs choisissent selon leur goût et se créassent dans l'avenir des Napoléons à leur guise. Il dictait son histoire telle qu'il la voulait laisser; c'était un auteur faisant des articles sur son propre ouvrage. Rien donc de plus absurde que de s'extasier sur des répertoires de toutes mains, qui ne sont pas, comme les Commentaires de César, un ouvrage court, sorti d'une grande tête, rédigé par un écrivain supérieur; et pourtant ces brefs commentaires, Asinius Pollion le pensait, n'étaient ni exacts ni fidèles. Le Mémorial de Sainte-Hélène est bon, toute part faite à la candeur et à la simplicité de l'admiration.
Une des choses qui a le plus contribué à rendre de son vivant Napoléon haïssable était son penchant à tout ravaler: dans une ville embrasée, il accouplait des décrets sur le rétablissement de quelques comédiens à des arrêts qui supprimaient des monarques; parodie de l'omnipotence de Dieu, qui règle le sort du monde et d'une fourmi. À la chute des empires il mêlait des insultes à des femmes; il se complaisait dans l'humiliation de ce qu'il avait abattu; il calomniait et blessait particulièrement ce qui avait osé lui résister. Son arrogance égalait son bonheur; il croyait paraître d'autant plus grand qu'il abaissait les autres. Jaloux de ses généraux, il les accusait de ses propres fautes, car pour lui il ne pouvait jamais avoir failli. Contempteur de tous les mérites, il leur reprochait durement leurs erreurs. Après le désastre de Ramillies, (p. 080) il n'aurait jamais dit, comme Louis XIV au maréchal de Villeroi: «Monsieur le maréchal, à notre âge on n'est pas heureux.» Touchante magnanimité qu'ignorait Napoléon. Le siècle de Louis XIV a été fait par Louis le Grand: Bonaparte a fait son siècle.
L'histoire de l'empereur, changée par de fausses traditions, sera faussée encore par l'état de la société à l'époque impériale. Toute révolution écrite en présence de la liberté de la presse peut laisser arriver l'œil au fond des faits, parce que chacun les rapporte comme il les a vus: le règne de Cromwell est connu, car on disait au Protecteur ce qu'on pensait de ses actes et de sa personne. En France, même sous la République, malgré l'inexorable censure du bourreau, la vérité perçait; la faction triomphante n'était pas toujours la même; elle succombait vite, et la faction qui lui succédait vous apprenait ce que vous avait caché sa devancière: il y avait liberté d'un échafaud à l'autre, entre deux têtes abattues. Mais lorsque Bonaparte saisit le pouvoir, que la pensée fut bâillonnée, qu'on n'entendit plus que la voix d'un despotisme qui ne parlait que pour se louer et ne permettait pas de parler d'autre chose que de lui, la vérité disparut.
Les pièces soi-disant authentiques de ce temps sont corrompues; rien ne se publiait, livres et journaux, que par l'ordre du maître: Bonaparte veillait aux articles du Moniteur; ses préfets renvoyaient des divers départements les récitations, les congratulations, les félicitations, telles que les autorités de Paris les avaient dictées et transmises, telles qu'elles exprimaient une opinion publique convenue, entièrement différente de l'opinion réelle. Écrivez l'histoire d'après (p. 081) de pareils documents! En preuve de vos impartiales études, cotez les authentiques où vous avez puisé: vous ne citerez qu'un mensonge à l'appui d'un mensonge.
Si l'on pouvait révoquer en doute cette imposture universelle, si des hommes qui n'ont point vu les jours de l'Empire s'obstinaient à tenir pour sincère ce qu'ils rencontrent dans les documents imprimés, ou même ce qu'ils pourraient déterrer dans certains cartons des ministères, il suffirait d'en appeler à un témoignage irrécusable, au Sénat conservateur: là, dans le décret que j'ai cité plus haut, vous avez vu ses propres paroles: «Considérant que la liberté de la presse a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses; que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite, etc.» Y a-t-il quelque chose à répondre à cette déclaration?
La vie de Bonaparte était une vérité incontestable, que l'imposture s'était chargée d'écrire.
Un orgueil monstrueux et une affectation incessante gâtent le caractère de Napoléon. Au temps de sa domination, qu'avait-il besoin d'exagérer sa stature, lorsque le Dieu des armées lui avait fourni ce char dont les roues sont vivantes?
Il tenait du sang italien; sa nature était complexe: les grands hommes, très petite famille sur la terre, ne trouvent malheureusement qu'eux-mêmes pour (p. 082) s'imiter. À la fois modèle et copie, personnage réel et acteur représentant ce personnage, Napoléon était son propre mime; il ne se serait pas cru un héros s'il ne se fût affublé du costume d'un héros. Cette étrange faiblesse donne à ses étonnantes réalités quelque chose de faux et d'équivoque; on craint de prendre le roi des rois pour Roscius, ou Roscius pour le roi des rois.
Les qualités de Napoléon sont si adultérées dans les gazettes, les brochures, les vers, et jusque dans les chansons envahies de l'impérialisme, que ces qualités sont complètement méconnaissables. Tout ce qu'on prête de touchant à Bonaparte dans les Ana, sur les prisonniers, les morts, les soldats, sont des billevesées que démentent les actions de sa vie[55].
La Grand'mère de mon illustre ami Béranger n'est qu'un admirable pont-neuf: Bonaparte n'avait rien du bonhomme. Domination personnifiée, il était sec; cette frigidité faisait antidote à son imagination ardente, il ne trouvait point en lui de parole, il n'y trouvait qu'un fait, et un fait prêt à s'irriter de la plus petite indépendance: un moucheron qui volait sans son ordre était à ses yeux un insecte révolté.
Ce n'était pas tout que de mentir aux oreilles, il fallait mentir aux yeux: ici, dans une gravure, c'est Bonaparte qui se découvre devant les blessés autrichiens, là c'est un petit tourlourou qui empêche l'empereur de passer, plus loin Napoléon touche les pestiférés de Jaffa, et il ne les a jamais touchés; il traverse (p. 083) le Saint-Bernard sur un cheval fougueux dans des tourbillons de neige, et il faisait le plus beau temps du monde.
Ne veut-on pas transformer l'empereur aujourd'hui en un Romain des premiers jours du mont Aventin, en un missionnaire de liberté, en un citoyen qui n'instituait l'esclavage que par amour de la vertu contraire? Jugez à deux traits du grand fondateur de l'égalité: il ordonna de casser le mariage de son frère Jérôme avec mademoiselle Patterson, parce que le frère de Napoléon ne se pouvait allier qu'au sang des princes; plus tard, revenu de l'île d'Elbe, il revêt la nouvelle constitution démocratique d'une pairie et la couronne de l'Acte additionnel.
Que Bonaparte, continuateur des succès de la République, semât partout des principes d'indépendance, que ses victoires aidassent au relâchement des liens entre les peuples et les rois, arrachassent ces peuples à la puissance des vieilles mœurs et des anciennes idées; que, dans ce sens, il ait contribué à l'affranchissement social, je ne le prétends point contester: mais que de sa propre volonté il ait travaillé sciemment à la délivrance politique et civile des nations; qu'il ait établi le despotisme le plus étroit dans l'idée de donner à l'Europe et particulièrement à la France la constitution la plus large; qu'il n'ait été qu'un tribun déguisé en tyran, c'est une supposition qu'il m'est impossible d'adopter.
Bonaparte, comme la race des princes, n'a voulu et n'a cherché que la puissance, en y arrivant toutefois à travers la liberté, parce qu'il débuta sur la scène du monde en 1793. La Révolution, qui était la nourrice (p. 084) de Napoléon, ne tarda pas à lui apparaître comme une ennemie; il ne cessa de la battre. L'empereur, du reste, connaissait très bien le mal, quand le mal ne venait pas directement de l'empereur; car il n'était pas dépourvu du sens moral. Le sophisme mis en avant touchant l'amour de Bonaparte pour la liberté ne prouve qu'une chose, l'abus que l'on peut faire de la raison; aujourd'hui elle se prête à tout. N'est-il pas établi que la Terreur était un temps d'humanité? En effet, ne demandait-on pas l'abolition de la peine de mort lorsqu'on tuait tant de monde? Les grands civilisateurs, comme on les appelle, n'ont-ils pas toujours immolé les hommes, et n'est-ce pas par là, comme on le prouve, que Robespierre était le continuateur de Jésus-Christ?

Napoléon à St. Hélène.
L'empereur se mêlait de toutes choses; son intellect ne se reposait jamais; il avait une espèce d'agitation perpétuelle d'idées. Dans l'impétuosité de sa nature, au lieu d'un train franc et continu, il s'avançait par bonds et haut-le-corps, il se jetait sur l'univers et lui donnait des saccades; il n'en voulait point, de cet univers, s'il était obligé de l'attendre: être incompréhensible, qui trouvait le secret d'abaisser, en les dédaignant, ses plus dominantes actions, et qui élevait jusqu'à sa hauteur ses actions les moins élevées. Impatient de volonté, patient de caractère, incomplet et comme inachevé, Napoléon avait des lacunes dans le génie: son entendement ressemblait au ciel de cet autre hémisphère sous lequel il devait aller mourir, à ce ciel dont les étoiles sont séparées par des espaces vides.
On se demande par quel prestige Bonaparte, si (p. 085) aristocrate, si ennemi du peuple, a pu arriver à la popularité dont il jouit: car ce forgeur de jougs est très certainement resté populaire chez une nation dont la prétention a été d'élever des autels à l'indépendance et à l'égalité; voici le mot de l'énigme:
Une expérience journalière fait reconnaître que les Français vont instinctivement au pouvoir; ils n'aiment point la liberté; l'égalité seule est leur idole. Or, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au cœur des Français, militairement inclinés vers la puissance, démocratiquement amoureux du niveau. Monté au trône, il y fit asseoir le peuple avec lui; roi prolétaire, il humilia les rois et les nobles dans ses antichambres; il nivela les rangs, non en les abaissant, mais en les élevant: le niveau descendant aurait charmé davantage l'envie plébéienne, le niveau ascendant a plus flatté son orgueil. La vanité française se bouffit aussi de la supériorité que Bonaparte nous donna sur le reste de l'Europe; une autre cause de la popularité de Napoléon tient à l'affliction de ses derniers jours. Après sa mort, à mesure que l'on connut mieux ce qu'il avait souffert à Sainte-Hélène, on commença à s'attendrir; on oublia sa tyrannie pour se souvenir qu'après avoir vaincu nos ennemis, qu'après les avoir ensuite attirés en France, il nous avait défendus contre eux; nous nous figurons qu'il nous sauverait aujourd'hui de la honte où nous sommes: sa renommée nous fut ramenée par son infortune; sa gloire a profité de son malheur.
Enfin les miracles de ses armes ont ensorcelé la jeunesse, en nous apprenant à adorer la force brutale. (p. 086) Sa fortune inouïe a laissé à l'outrecuidance de chaque ambition l'espoir d'arriver où il était parvenu.
Et pourtant cet homme, si populaire par le cylindre qu'il avait roulé sur la France, était l'ennemi mortel de l'égalité et le plus grand organisateur de l'aristocratie dans la démocratie.
Je ne puis acquiescer aux faux éloges dont on insulte Bonaparte, en voulant tout justifier dans sa conduite; je ne puis renoncer à ma raison, m'extasier devant ce qui me fait horreur ou pitié.
Si j'ai réussi à rendre ce que j'ai senti, il restera de mon portrait une des premières figures de l'histoire; mais je n'ai rien adopté de cette créature fantastique composée de mensonges; mensonges que j'ai vus naître, qui, pris d'abord pour ce qu'ils étaient, ont passé avec le temps à l'état de vérité par l'infatuation et l'imbécile crédulité humaine. Je ne veux pas être une sotte grue et tomber du haut mal d'admiration. Je m'attache à peindre les personnages en conscience, sans leur ôter ce qu'ils ont, sans leur donner ce qu'ils n'ont pas. Si le succès était réputé l'innocence; si, débauchant jusqu'à la postérité, il la chargeait de ses chaînes; si, esclave future, engendrée d'un passé esclave, cette postérité subornée devenait le complice de quiconque aurait triomphé, où serait le droit, où serait le prix des sacrifices? Le bien et le mal n'étant plus que relatifs, toute moralité s'effacerait des actions humaines.
Tel est l'embarras que cause à l'écrivain impartial une éclatante renommée; il l'écarte autant qu'il peut, afin de mettre le vrai à nu; mais la gloire revient (p. 087) comme une vapeur radieuse et couvre à l'instant le tableau.
Pour ne pas avouer l'amoindrissement de territoire et de puissance que nous devons à Bonaparte, la génération actuelle se console en se figurant que ce qu'il nous a retranché en force, il nous l'a rendu en illustration. «Désormais, ne sommes-nous pas, dit-elle, renommés aux quatre coins de la terre? un Français n'est-il pas craint, remarqué, recherché, connu à tous les rivages?»
Mais étions-nous placés entre ces deux conditions, ou l'immortalité sans puissance, ou la puissance sans immortalité? Alexandre fit connaître à l'univers le nom des Grecs; il ne leur en laissa pas moins quatre empires en Asie; la langue et la civilisation des Hellènes s'étendirent du Nil à Babylone et de Babylone à l'Indus. À sa mort, son royaume patrimonial de Macédoine, loin d'être diminué, avait centuplé de force. Bonaparte nous a fait connaître à tous les rivages; commandés par lui, les Français jetèrent l'Europe si bas à leurs pieds que la France prévaut encore par son nom, et que l'Arc de l'Étoile peut s'élever sans paraître un puéril trophée; mais avant nos revers ce monument eût été un témoin au lieu de n'être qu'une chronique. Cependant Dumouriez avec des réquisitionnaires n'avait-il pas donné à l'étranger les premières leçons, Jourdan gagné la bataille de Fleurus, Pichegru conquis la Belgique et la Hollande, Hoche passé le Rhin, Masséna triomphé à Zurich, Moreau à Hohenlinden; tous exploits les plus difficiles à obtenir et qui préparaient les autres? (p. 088) Bonaparte a donné un corps à ces succès épars; il les a continués, il a fait rayonner ces victoires: mais, sans ces premières merveilles, eût-il obtenu les dernières? il n'était au-dessus de tout que quand la raison chez lui exécutait les inspirations du poète.
L'illustration de notre suzerain ne nous a coûté que deux ou trois cent mille hommes par an; nous ne l'avons payée que de trois millions de nos soldats; nos concitoyens ne l'ont achetée qu'au prix de leurs souffrances et de leurs libertés pendant quinze années: ces bagatelles peuvent-elles compter? Les générations venues après ne sont-elles pas resplendissantes? Tant pis pour ceux qui ont disparu! Les calamités sous la République servirent au salut de tous; nos malheurs sous l'Empire ont bien plus fait: ils ont déifié Bonaparte! cela nous suffit.
Cela ne me suffit pas à moi, je ne m'abaisserai point à cacher ma nation derrière Bonaparte; il n'a pas fait la France, la France l'a fait. Jamais aucun talent, aucune supériorité ne m'amènera à consentir au pouvoir qui peut d'un mot me priver de mon indépendance, de mes foyers, de mes amis; si je ne dis pas de ma fortune et de mon honneur, c'est que la fortune ne me paraît pas valoir la peine qu'on la défende; quant à l'honneur, il échappe à la tyrannie: c'est l'âme des martyrs; les liens l'entourent et ne l'enchaînent pas; il perce la voûte des prisons et emporte avec soi tout l'homme.
Le tort que la vraie philosophie ne pardonnera pas à Bonaparte, c'est d'avoir façonné la société à l'obéissance passive, repoussé l'humanité vers les temps de dégradation morale, et peut-être abâtardi les caractères (p. 089) de manière qu'il serait impossible de dire quand les cœurs commenceront à palpiter de sentiments généreux. La faiblesse où nous sommes plongés vis-à-vis de l'Europe, notre abaissement actuel, sont la conséquence de l'esclavage napoléonien: il ne nous est resté que les facultés du joug. Bonaparte a dérangé jusqu'à l'avenir; point ne m'étonnerais si l'on nous voyait, dans le malaise de notre impuissance nous amoindrir, nous barricader contre l'Europe au lieu de l'aller chercher, livrer nos franchises au dedans pour nous délivrer au dehors d'une frayeur chimérique, nous égarer dans d'ignobles prévoyances, contraires à notre génie et aux quatorze siècles dont se composent nos mœurs nationales. Le despotisme que Bonaparte a laissé dans l'air descendra sur nous en forteresses.
La mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté d'un rire sardonique, de la regarder comme vieillerie tombée en désuétude avec l'honneur. Je ne suis point à la mode, je pense que sans la liberté il n'y a rien dans le monde; elle donne du prix à la vie; dussé-je rester le dernier à la défendre, je ne cesserai de proclamer ses droits. Attaquer Napoléon au nom de choses passées, l'assaillir avec des idées mortes, c'est lui préparer de nouveaux triomphes. On ne le peut combattre qu'avec quelque chose de plus grand que lui, la liberté: il s'est rendu coupable envers elle et par conséquent envers le genre humain.
Vaines paroles! mieux que personne, j'en sens l'inutilité. Désormais toute observation, si modérée qu'elle soit, est réputée profanatrice: il faut du courage (p. 090) pour oser braver les cris du vulgaire, pour ne pas craindre de se faire traiter d'intelligence bornée, incapable de comprendre et de sentir le génie de Napoléon, par la seule raison qu'au milieu de l'admiration vive et vraie que l'on professe pour lui, on ne peut néanmoins encenser toutes ses imperfections. Le monde appartient à Bonaparte; ce que le ravageur n'avait pu achever de conquérir, sa renommée l'usurpe; vivant il a manqué le monde, mort il le possède. Vous avez beau réclamer, les générations passent sans vous écouter. L'antiquité fait dire à l'ombre du fils de Priam: «Ne juge pas Hector d'après sa petite tombe: «l'Iliade, Homère, les Grecs en fuite, voilà mon sépulcre: je suis enterré sous toutes ces grandes actions.»
Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte, c'est une figure légendaire composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple; c'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées du moyen âge que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel; les autres portraits disparaîtront. Bonaparte appartenait si fort à la domination absolue, qu'après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. Ce dernier despotisme est plus dominateur que le premier, car si l'on combattit Napoléon alors qu'il était sur le trône, il y a consentement universel à accepter les fers que mort il nous jette. Il est un obstacle aux événements futurs: comment une puissance sortie des camps pourrait-elle s'établir après lui? n'a-t-il pas tué en la surpassant toute gloire militaire? Comment un gouvernement libre pourrait-il (p. 091) naître, lorsqu'il a corrompu dans les cœurs le principe de toute liberté? Aucune puissance légitime ne peut plus chasser de l'esprit de l'homme le spectre usurpateur: le soldat et le citoyen, le républicain et le monarchiste, le riche et le pauvre, placent également les bustes et les portraits de Napoléon à leurs foyers, dans leurs palais ou dans leurs chaumières; les anciens vaincus sont d'accord avec les anciens vainqueurs; on ne peut faire un pas en Italie qu'on ne le retrouve; on ne pénètre pas en Allemagne qu'on ne le rencontre, car dans ce pays la jeune génération qui le repoussa est passée. Les siècles s'asseyent d'ordinaire devant le portrait d'un grand homme, ils l'achèvent par un travail long et successif. Le genre humain cette fois n'a pas voulu attendre; peut-être s'est-il trop hâté d'estomper un pastel. Il est temps de placer en regard de la partie défectueuse de l'idole la partie achevée.
Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eu et n'a jamais prétendu établir; il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier et puissant, un code de lois adopté en divers pays, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente, et sur laquelle nous vivons encore; il est grand pour avoir ressuscité, éclairé et géré supérieurement l'Italie; il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre du sein du chaos, pour avoir relevé les autels, pour avoir réduit de furieux démagogues, d'orgueilleux savants, des littérateurs anarchiques, des athées voltairiens, des orateurs de carrefours, des égorgeurs de prisons et de rues, des claquedents (p. 092) de tribune, de clubs et d'échafauds, pour les avoir réduits à servir sous lui; il est grand pour avoir enchaîné une tourbe anarchique; il est grand pour avoir fait cesser les familiarités d'une commune fortune, pour avoir forcé des soldats ses égaux, des capitaines ses chefs ou ses rivaux, à fléchir sous sa volonté; il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, pour avoir su, lui, se faire obéir par trente-six millions de sujets, à l'époque où aucune illusion n'environne les trônes; il est grand pour avoir abattu tous les rois ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'ait été la différence de leur discipline et de leur valeur, pour avoir appris son nom aux peuples sauvages comme aux peuples civilisés, pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le précédèrent, pour avoir rempli dix années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre.
Le fameux délinquant en matière triomphale n'est plus; le peu d'hommes qui comprennent encore les sentiments nobles peuvent rendre hommage à la gloire sans la craindre, mais sans se repentir d'avoir proclamé ce que cette gloire eut de funeste, sans reconnaître le destructeur des indépendances pour le père des émancipations: Napoléon n'a nul besoin qu'on lui prête des mérites; il fut assez doué en naissant.
Ores donc que, détaché de son temps, son histoire est finie et que son épopée commence, allons le voir mourir: quittons l'Europe; suivons-le sous le ciel de son apothéose! Le frémissement des mers, là où ses vaisseaux caleront la voile, nous indiquera le lieu (p. 093) de sa disparition: «À l'extrémité de notre hémisphère, on entend, dit Tacite, le bruit que fait le soleil en s'immergeant, sonum insuper immergentis audiri.»
Jean de Noya, navigateur portugais, s'était égaré dans les eaux qui séparent l'Afrique de l'Amérique. En 1502, le 18 août, fête de sainte Hélène, mère du premier empereur chrétien, il rencontra une île par le 16e degré de latitude méridionale et le 11e de longitude; il y toucha et lui donna le nom du jour de la découverte.
Après avoir fréquenté cette île quelques années, les Portugais la délaissèrent; les Hollandais s'y établirent, et l'abandonnèrent ensuite pour le cap de Bonne-Espérance; la Compagnie des Indes d'Angleterre s'en saisit; les Hollandais la reprirent en 1672; les Anglais l'occupèrent de nouveau et s'y fixèrent.
Lorsque Jean de Noya surgit à Sainte-Hélène, l'intérieur du pays inhabité n'était qu'une forêt. Fernand Lopez, renégat portugais, déporté à cette oasis, la peupla de vaches, de chèvres, de poules, de pintades et d'oiseaux des quatre parties de la terre. On y fit monter successivement, comme à bord de l'arche, des animaux de toute la création.
Cinq cents blancs, quinze cents nègres, mêlés de mulâtres, de Javanais et de Chinois, composent la population de l'île. James-Town en est la ville et le port. Avant que les Anglais fussent maîtres du cap de Bonne-Espérance, les flottes de la Compagnie, au retour des Indes, relâchaient à James-Town. Les matelots étalaient leurs pacotilles au pied des palmistes, (p. 094) une forêt muette et solitaire se changeait, une fois l'an, en un marché bruyant et peuplé.
Le climat de l'île est sain, mais pluvieux: ce donjon de Neptune, qui n'a que sept à huit lieues de tour, attire les vapeurs de l'Océan. Le soleil de l'équateur chasse à midi tout ce qui respire, force au silence et au repos jusqu'aux moucherons, oblige les hommes et les animaux à se cacher. Les vagues sont éclairées la nuit de ce qu'on appelle la lumière de mer, lumière produite par des myriades d'insectes dont les amours, électrisés par les tempêtes, allument à la surface de l'abîme les illuminations d'une noce universelle. L'ombre de l'île, obscure et fixe, repose au milieu d'une plaine mobile de diamants. Le spectacle du ciel est semblablement magnifique, selon mon savant et célèbre ami M. de Humboldt[56]: «On éprouve, dit-il, je ne sais quel sentiment inconnu, lorsqu'en approchant de l'équateur, et surtout en passant d'un hémisphère à l'autre, on voit s'abaisser progressivement et enfin disparaître les étoiles que l'on connut dès sa première enfance. On sent qu'on n'est point en Europe, lorsqu'on voit s'élever sur l'horizon l'immense constellation du Navire, ou les nuées phosphorescentes de Magellan.
«Nous ne vîmes pour la première fois distinctement,» continue-t-il, «la croix du Sud que dans la nuit du 4 au 5 juillet, par les 16 degrés de latitude.
«Je me rappelais le passage sublime de Dante que les commentateurs les plus célèbres ont appliqué à cette constellation:
(p. 095) «Io mi volsi a man destra[57], etc.
«Chez les Portugais et les Espagnols, un sentiment religieux les attache à une constellation dont la forme leur rappelle ce signe de la foi, planté par leurs ancêtres dans les déserts du Nouveau Monde.»
Les poètes de la France et de la Lusitanie ont placé des scènes de l'élégie aux rivages du Mélinde et des îles avoisinantes. Il y a loin de ces douleurs fictives aux tourments réels de Napoléon sous ces astres prédits par le chantre de Béatrice et dans ces mers d'Éléonore et de Virginie. Les grands de Rome, relégués aux îles de la Grèce, se souciaient-ils des charmes de ces rives et des divinités de la Crète et de Naxos? Ce qui ravissait Vasco de Gama et Camoëns ne pouvait émouvoir Bonaparte: couché à la poupe du vaisseau, il ne s'apercevait pas qu'au-dessus de sa tête étincelaient des constellations inconnues dont les rayons rencontraient pour la première fois ses regards. Que lui faisaient ces astres qu'il ne vit jamais de ses bivouacs, qui n'avaient pas brillé sur son empire? Et cependant aucune étoile n'a manqué à sa destinée: la moitié du firmament éclaira son berceau; l'autre était réservée à la pompe de sa tombe.
La mer que Napoléon franchissait n'était point cette mer amie qui l'apporta des havres de la Corse, des sables d'Aboukir, des rochers de l'île d'Elbe, aux rives de la Provence; c'était cet Océan ennemi qui, (p. 096) après l'avoir enfermé dans l'Allemagne, la France, le Portugal et l'Espagne, ne s'ouvrait devant sa course que pour se refermer derrière lui. Il est probable qu'en voyant les vagues pousser son navire, les vents alizés l'éloigner d'un souffle constant, il ne faisait pas sur sa catastrophe les réflexions qu'elle m'inspire: chaque homme sent sa vie à sa manière, celui qui donne au monde un grand spectacle est moins touché et moins enseigné que le spectateur. Occupé du passé comme s'il pouvait renaître, espérant encore dans ses souvenirs, Bonaparte s'aperçut à peine qu'il franchissait la ligne, et il ne demanda point quelle main traça ces cercles dans lesquels les globes sont contraints d'emprisonner leur marche éternelle.
Le 15 août, la colonie errante célébra la Saint-Napoléon à bord du vaisseau qui conduisait Napoléon à sa dernière halte. Le 15 octobre, le Northumberland était à la hauteur de Sainte-Hélène. Le passager monta sur le pont; il eut peine à découvrir un point noir imperceptible dans l'immensité bleuâtre; il prit une lunette; il observa ce grain de terre ainsi qu'il eût autrefois observé une forteresse au milieu d'un lac. Il aperçut la bourgade de Saint-James enchâssée dans des rochers escarpés; pas une ride de cette façade stérile à laquelle ne fût suspendu un canon: on semblait avoir voulu recevoir le captif selon son génie.
Le 16 octobre 1815, Bonaparte aborda l'écueil, son mausolée, de même que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb aborda le Nouveau Monde, son monument: «Là, dit Walter Scott, à l'entrée de l'océan Indien, Bonaparte était privé des moyens de faire un second avatar ou incarnation sur la terre.»
(p. 097) Avant d'être transporté à la résidence de Longwood, Bonaparte occupa une case à Briars[58] près de Balcombe's cottage. Le 9 décembre, Longwood, augmenté à la hâte par les charpentiers de la flotte anglaise, reçut son hôte. La maison, située sur un plateau de montagnes, se composait d'un salon, d'une salle à manger, d'une bibliothèque, d'un cabinet d'étude et d'une chambre à coucher. C'était peu: ceux qui habitèrent la tour du Temple et le donjon de Vincennes furent encore moins bien logés; il est vrai qu'on eut l'attention d'abréger leur séjour. Le général Gourgaud, M. et madame de Montholon avec leurs enfants, M. de Las Cases et son fils, campèrent provisoirement sous des tentes; M. et madame Bertrand s'établirent à Hutt's-Gate, cabine placée à la limite du terrain de Longwood.
Bonaparte avait pour promenoir une arène de douze milles; des sentinelles entouraient cet espace, et des vigies étaient placées sur les plus hauts pitons. Le lion pouvait étendre ses courses au delà, mais il fallait alors qu'il consentît à se laisser garder par un bestiaire anglais. Deux camps défendaient l'enceinte excommuniée: le soir, le cercle des factionnaires se resserrait sur Longwood. À neuf heures, Napoléon consigné ne pouvait plus sortir; les patrouilles faisaient la ronde; des cavaliers en vedette, des fantassins plantés çà et là, veillaient dans les criques et (p. 098) dans les ravins qui descendaient à la grève. Deux bricks armés croisaient, l'un sous le vent, l'autre au vent de l'île. Que de précautions pour garder un seul homme au milieu des mers! Après le coucher du soleil, aucune chaloupe ne pouvait mettre à la mer; les bateaux pêcheurs étaient comptés, et la nuit ils restaient au port sous la responsabilité d'un lieutenant de marine. Le souverain généralissime qui avait cité le monde à son étrier était appelé à comparaître deux fois le jour devant un hausse-col. Bonaparte ne se soumettait point à cet appel; quand, par fortune, il pouvait éviter les regards de l'officier de service, cet officier n'aurait osé dire où et comment il avait vu celui dont il était plus difficile de constater l'absence que de prouver la présence à l'univers.
Sir George Cockburn, auteur de ces règlements sévères, fut remplacé par sir Hudson Lowe. Alors commencèrent les pointilleries dont tous les Mémoires nous ont entretenus. Si l'on en croyait ces Mémoires, le nouveau gouverneur aurait été de la famille des énormes araignées de Sainte-Hélène, et le reptile de ces bois où les serpents sont inconnus. L'Angleterre manqua d'élévation, Napoléon de dignité. Pour mettre un terme à ses exigences d'étiquette, Bonaparte semblait quelquefois décidé à se voiler sous un pseudonyme, comme un monarque en pays étranger; il eut l'idée touchante de prendre le nom d'un de ses aides de camp tué à la bataille d'Arcole[59]. La France, l'Autriche, la Russie, désignèrent des commissaires à la résidence de Sainte-Hélène[60]: le captif était accoutumé (p. 099) à recevoir les ambassadeurs des deux dernières puissances; la légitimité, qui n'avait pas reconnu Napoléon empereur, aurait agi plus noblement en ne reconnaissant pas Napoléon prisonnier.
Une grande maison de bois, construite à Londres, fut envoyée à Sainte-Hélène; mais Napoléon ne se trouva plus assez bien portant pour l'habiter. Sa vie à Longwood était ainsi réglée: il se levait à des heures incertaines; M. Marchand, son valet de chambre, lui faisait la lecture lorsqu'il était au lit; quand il s'était levé matin, il dictait aux généraux Montholon et Gourgaud, et au fils de M. de Las Cases. Il déjeunait à dix heures, se promenait à cheval ou en voiture jusque vers les trois heures, rentrait à six et se couchait à onze. Il affectait de s'habiller comme il est peint dans le portrait d'Isabey: le matin il s'enveloppait d'un cafetan et entortillait sa tête d'un mouchoir des Indes.
Sainte-Hélène est située entre les deux pôles. Les navigateurs qui passent d'un lieu à l'autre saluent cette première station, où la terre délasse les regards fatigués du spectacle de l'Océan et offre des fruits et la fraîcheur de l'eau douce à des bouches échauffées par le sel. La présence de Bonaparte avait changé cette île de promission en un roc pestiféré: les vaisseaux étrangers n'y abordaient plus; aussitôt qu'on les signalait à vingt lieues de distance, une croisière les allait reconnaître et leur enjoignait de passer au large; on n'admettait en relâche, à moins d'une tourmente, que les seuls navires de la marine britannique.
(p. 100) Quelques-uns des voyageurs anglais qui venaient d'admirer ou qui allaient voir les merveilles du Gange visitaient sur leur chemin une autre merveille: l'Inde, accoutumée aux conquérants, en avait un enchaîné à ses portes.
Napoléon admettait ces visites avec peine. Il consentit à recevoir lord Amherst à son retour de son ambassade de la Chine. L'amiral sir Pulteney Malcolm lui plut: «Votre gouvernement, lui dit-il un jour, a-t-il l'intention de me retenir sur ce rocher jusqu'à ma mort?» L'amiral répondit qu'il le craignait. «Alors ma mort arrivera bientôt.—J'espère que non, monsieur; vous vivrez assez de temps pour écrire vos grandes actions; elles sont si nombreuses, que cette tâche vous assure une longue vie.»
Napoléon ne se choqua point de cette simple appellation, monsieur; il se reconnut en ce moment par sa véritable grandeur. Heureusement pour lui, il n'a point écrit sa vie; il l'eût rapetissée: les hommes de cette nature doivent laisser leurs mémoires à raconter par cette voix inconnue qui n'appartient à personne et qui sort des peuples et des siècles. À nous seuls vulgaires il est permis de parler de nous, parce que personne n'en parlerait.
Le capitaine Basil Hall[61] se présenta à Longwood: Bonaparte se souvint d'avoir vu le père du capitaine à Brienne: «Votre père, dit-il, était le premier Anglais (p. 101) que j'eusse jamais vu; c'est pourquoi j'en ai gardé le souvenir toute ma vie.» Il s'entretint avec le capitaine de la récente découverte de l'île de Lou-Tchou: «Les habitants n'ont point d'armes, dit le capitaine.—Point d'armes! s'écria Bonaparte.—Ni canons ni fusils.—Des lances au moins, des arcs et des flèches?—Rien de tout cela.—Ni poignards?—Ni poignards.—Mais comment se bat-on?—Ils ignorent tout ce qui se passe dans le monde; ils ne savent pas que la France et l'Angleterre existent; ils n'ont jamais entendu parler de Votre Majesté.» Bonaparte sourit d'une manière qui frappa le capitaine: plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau.
Ces différents voyageurs remarquèrent qu'aucune trace de couleur ne paraissait sur le visage de Bonaparte: sa tête ressemblait à un buste de marbre dont la blancheur était légèrement jaunie par le temps. Rien de sillonné sur son front, ni de creusé dans ses joues; son âme semblait sereine. Ce calme apparent fit croire que la flamme de son génie s'était envolée. Il parlait avec lenteur; son expression était affectueuse et presque tendre; quelquefois il lançait des regards éblouissants, mais cet état passait vite: ses yeux se voilaient et devenaient tristes.
Ah! sur ces rivages avaient jadis comparu d'autres voyageurs connus de Napoléon.
Après l'explosion de la machine infernale, un sénatus-consulte du 4 janvier 1801 prononça sans jugement, par simple mesure de police, l'exil outre-mer de cent trente républicains[62]: embarqués sur la frégate (p. 102) la Chiffonne et sur la corvette la Flèche, ils furent conduits aux îles Seychelles et dispersés peu après dans l'archipel des Comores, entre l'Afrique et Madagascar: ils y moururent presque tous. Deux des déportés, Lefranc et Saunois, parvenus à se sauver sur un vaisseau américain, touchèrent en 1803 à Sainte-Hélène: c'était là que douze ans plus tard la Providence devait enfermer leur grand oppresseur.
Le trop fameux général Rossignol[63], leur compagnon d'infortune, un quart d'heure avant son dernier soupir s'écria: «Je meurs accablé des plus horribles douleurs; mais je mourrais content si je pouvais apprendre que le tyran de ma patrie endurât les mêmes souffrances![64]» Ainsi jusque dans l'autre hémisphère les imprécations de la liberté attendaient celui qui la trahit.
L'Italie, arrachée à son long sommeil par Napoléon, tourna les yeux vers l'illustre enfant qui la voulut rendre à sa gloire et avec lequel elle était retombée sous le joug. Les fils des Muses, les plus nobles et les plus reconnaissants des hommes, quand ils n'en sont pas les plus vils et les plus ingrats, regardaient Sainte-Hélène. Le dernier poète de la patrie de Virgile chantait le dernier guerrier de la patrie de César:
(p. 103) Tutto ei provó, la gloria
Maggior dopo il periglio,
La fuga e la vittoria.
La reggia e il triste esiglio:
Due volte ne la polvere,
Due volte sugli altar.
Ei si nomo: due secoli,
L'un contro l' altro armato,
Sommessi a lui si volsero,
Come aspettando il fato:
Ei fè silenzio ed arbitro
S' assise in mezzo a lor[65].
«Il éprouva tout, dit Manzoni, la gloire plus grande après le péril, la fuite et la victoire, la royauté et le triste exil: deux fois dans la poudre, deux fois sur l'autel.
«Il se nomma: deux siècles l'un contre l'autre armés se tournèrent vers lui, comme attendant leur sort: il fit silence, et s'assit arbitre entre eux.»
Bonaparte approchait de sa fin; rongé d'une plaie intérieure, envenimée par le chagrin, il l'avait portée, cette plaie, au sein de la prospérité: c'était le seul héritage qu'il eût reçu de son père; le reste lui venait des munificences de Dieu.
Déjà il comptait six années d'exil; il lui avait fallu moins de temps pour conquérir l'Europe. Il restait presque toujours renfermé, et lisait Ossian de la traduction italienne de Cesarotti. Tout l'attristait sous (p. 104) un ciel où la vie semblait plus courte, le soleil restant trois jours de moins dans cet hémisphère que dans le nôtre. Quand Bonaparte sortait, il parcourait des sentiers scabreux que bordaient des aloès et des genêts odoriférants. Il se promenait parmi les gommiers à fleurs rares que les vents généraux faisaient pencher du même côté, ou il se cachait dans les gros nuages qui roulaient à terre. On le voyait assis sur les bases du pic de Diane, du Flay Staff, du Leader Hill, contemplant la mer par les brèches des montagnes. Devant lui se déroulait cet Océan qui d'une part baigne les côtes de l'Afrique, de l'autre les rives américaines, et qui va, comme un fleuve sans bords, se perdre dans les mers australes. Point de terre civilisée plus voisine que le cap des Tempêtes. Qui dira les pensées de ce Prométhée déchiré vivant par la mort, lorsque, la main appuyée sur sa poitrine douloureuse, il promenait ses regards sur les flots! Le Christ fut transporté au sommet d'une montagne d'où il aperçut les royaumes du monde; mais pour le Christ il était écrit au séducteur de l'homme: «Tu ne tenteras point le fils de Dieu.»
Bonaparte, oubliant une pensée de lui, que j'ai citée (ne m'étant pas donné la vie, je ne me l'ôterai pas), parlait de se tuer; il ne se souvenait plus aussi de son ordre du jour à propos du suicide d'un de ses soldats. Il espérait assez dans l'attachement de ses compagnons de captivité pour croire qu'ils consentiraient à s'étouffer avec lui à la vapeur d'un brasier: l'illusion était grande. Tels sont les enivrements d'une longue domination; mais il ne faut considérer, dans les impatiences de Napoléon, que le degré de souffrance (p. 105) auquel il était parvenu. M. de Las Cases ayant écrit à Lucien sur un morceau de soie blanche, en contravention avec les règlements, reçut l'ordre de quitter Sainte-Hélène[66]: son absence augmenta le vide autour du banni.
(p. 106) Le 18 mai 1817, lord Holland, dans la Chambre des pairs, fit une proposition au sujet des plaintes transmises en Angleterre par le général Montholon: «La postérité n'examinera pas, dit-il, si Napoléon a été justement puni de ses crimes, mais si l'Angleterre a montré la générosité qui convenait à une grande nation.» Lord Bathurst combattit la motion.
Le cardinal Fesch dépêcha d'Italie deux prêtres[67] à son neveu. La princesse Borghèse sollicitait la faveur de rejoindre son frère: «Non, dit Napoléon, je ne veux pas qu'elle soit témoin de mon humiliation et des insultes auxquelles je suis exposé.» Cette sœur aimée, germana Jovis, ne traversa pas les mers; elle mourut aux lieux où Napoléon avait laissé sa renommée.
Des projets d'enlèvement se formèrent: un colonel (p. 107) Latapie, à la tête d'une bande d'aventuriers américains, méditait une descente à Sainte-Hélène. Johnston, hardi contrebandier, prétendit dérober Bonaparte au moyen d'un bateau sous-marin. De jeunes lords entraient dans ces projets; on conspirait pour rompre les chaînes de l'oppresseur; on aurait laissé périr dans les fers, sans y penser, le libérateur du genre humain. Bonaparte espérait sa délivrance des mouvements politiques de l'Europe. S'il eût vécu jusqu'en 1830, peut-être nous serait-il revenu; mais qu'eût-il fait parmi nous? il eût semblé caduc et arriéré au milieu des idées nouvelles. Jadis sa tyrannie paraissait liberté à notre servitude; maintenant sa grandeur paraîtrait despotisme à notre petitesse. À l'époque actuelle tout est décrépit dans un jour; qui vit trop, meurt vivant. En avançant dans la vie, nous laissons trois ou quatre images de nous, différentes les unes des autres; nous les revoyons ensuite dans la vapeur du passé comme des portraits de nos différents âges.
Bonaparte affaibli ne s'occupait plus que comme un enfant: il s'amusait à creuser dans son jardin un petit bassin; il y mit quelques poissons: le mastic du bassin se trouvant mêlé de cuivre, les poissons moururent. Bonaparte dit: «Tout ce qui m'attache est frappé.»
Vers la fin de février 1821. Napoléon fut obligé de se coucher et ne se leva plus. «Suis-je assez tombé!» murmurait-il: «je remuais le monde et je ne puis soulever ma paupière!» Il ne croyait pas à la médecine et s'opposait à une consultation d'Antomarchi[68] (p. 108) avec des médecins de James-Town. Il admit cependant à son lit de mort le docteur Arnold. Du 13 au 27 avril, il dicta son testament; le 28, il ordonna d'envoyer son cœur à Marie-Louise; il défendit à tout chirurgien anglais de porter la main sur lui après son décès. Persuadé qu'il succombait à la maladie dont avait été atteint son père, il recommanda de faire passer au duc de Reichstadt le procès-verbal de l'autopsie: le renseignement paternel est devenu inutile; Napoléon II a rejoint Napoléon Ier.
À cette dernière heure, le sentiment religieux dont Bonaparte avait toujours été pénétré se réveilla. Thibaudeau, dans ses Mémoires sur le Consulat, raconte, à propos du rétablissement du culte, que le premier consul lui avait dit: «Dimanche dernier, au milieu du silence de la nature, je me promenais dans ces jardins (la Malmaison); le son de la cloche de Ruel vint tout à coup frapper mon oreille, et renouvela toutes les impressions de ma jeunesse; je fus ému, tant est forte la puissance des premières habitudes, et je me dis: S'il en est ainsi pour moi, quel effet de pareils souvenirs ne doivent-ils pas produire sur les hommes simples et crédules? Que vos philosophes (p. 109) répondent à cela!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et, levant les mains vers le ciel: Quel est celui qui a fait tout cela?»
En 1797, par sa proclamation de Macerata, Bonaparte autorise le séjour des prêtres français réfugiés dans les États du pape, défend de les inquiéter, ordonne aux couvents de les nourrir, et leur assigne un traitement en argent.
Ses variations en Égypte, ses colères contre l'Église dont il était le restaurateur, montrent qu'un instinct de spiritualisme dominait au milieu même de ses égarements, car ses chutes et ses irritations ne sont point d'une nature philosophique et portent l'empreinte du caractère religieux.
Bonaparte, donnant à Vignale les détails de la chapelle ardente dont il voulait qu'on environnât sa dépouille, crut s'apercevoir que sa recommandation déplaisait à Antomarchi; il s'en expliqua avec le docteur et lui dit: «Vous êtes au-dessus de ces faiblesses: mais que voulez-vous, je ne suis ni philosophe ni médecin; je crois à Dieu; je suis de la religion de mon père. N'est pas athée qui veut. . . . . . . Pouvez-vous ne pas croire à Dieu? car enfin tout proclame son existence, et les plus grands génies l'ont cru. . . . . . Vous êtes médecin. . . . . ces gens-là ne brassent que de la matière: ils ne croient jamais rien.»
Fortes têtes du jour, quittez votre admiration pour Napoléon; vous n'avez rien à faire de ce pauvre homme: ne se figurait-il pas qu'une comète était venue le chercher, comme jadis elle emporta César? (p. 110) De plus, il croyait à Dieu; il était de la religion de son père; il n'était pas philosophe; il n'était pas athée; il n'avait pas, comme vous, livré de bataille à l'Éternel, bien qu'il eût vaincu bon nombre de rois; il trouvait que tout proclamait l'existence de l'Être suprême; il déclarait que les plus grands génies avaient cru à cette existence, et il voulait croire comme ses pères. Enfin, chose monstrueuse! ce premier homme des temps modernes, cet homme de tous les siècles, était chrétien dans le XIXe siècle! Son testament commence par cet article:
«Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de cinquante ans.»
Au troisième paragraphe du testament de Louis XVI on lit:
«Je meurs dans l'union de notre sainte mère l'église catholique, apostolique et romaine.»
La Révolution nous a donné bien des enseignements; mais en est-il un seul comparable à celui-ci? Napoléon et Louis XVI faisant la même profession de foi! Voulez-vous savoir le prix de la croix? Cherchez dans le monde entier ce qui convient le mieux à la vertu malheureuse, ou à l'homme de génie mourant.
Le 3 mai, Napoléon se fit administrer l'extrême-onction et reçut le saint viatique. Le silence de la chambre n'était interrompu que par le hoquet de la (p. 111) mort mêlé au bruit régulier du balancier d'une pendule: l'ombre, avant de s'arrêter sur le cadran, fit encore quelques tours; l'astre qui la dessinait avait de la peine à s'éteindre. Le 4, la tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva: presque tous les arbres de Longwood furent déracinés. Enfin, le 5, à six heures moins onze minutes du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Les derniers mots saisis sur les lèvres du conquérant furent: «Tête... armée, ou tête d'armée.» Sa pensée errait encore au milieu des combats. Quand il ferma pour jamais les yeux, son épée, expirée avec lui, était couchée à sa gauche, un crucifix reposait sur sa poitrine: le symbole pacifique appliqué au cœur de Napoléon calma les palpitations de ce cœur, comme un rayon du ciel fait tomber la vague.
Bonaparte désira d'abord être enseveli dans la cathédrale d'Ajaccio, puis, par un codicille daté du 16 avril 1821, il légua ses os à la France: le ciel l'avait mieux servi: son véritable mausolée est le rocher où il expira: revoyez mon récit de la mort du duc d'Enghien. Napoléon, prévoyant à ses dernières volontés l'opposition du gouvernement britannique, fit choix éventuellement d'une sépulture à Sainte-Hélène.
Dans une étroite vallée appelée la vallée de Slane ou du Géranium, maintenant du Tombeau, coule une source; les domestiques chinois de Napoléon, fidèles comme le Javanais de Camoëns, avaient accoutumé d'y remplir des amphores: des saules pleureurs pendent (p. 112) sur la fontaine; une herbe fraîche, parsemée de tchampas, croît autour. «Le tchampas, malgré son éclat et son parfum, n'est pas une plante qu'on recherche, parce qu'elle fleurit sur les tombeaux,» disent les poésies sanscrites. Dans les déclivités des roches déboisées, végètent mal des citronniers amers, des cocotiers porte-noix, des mélèzes et des conises dont on recueille la gomme attachée à la barbe des chèvres.
Napoléon se plaisait aux saules de la fontaine; il demandait la paix à la vallée de Slane, comme Dante banni demandait la paix au cloître de Corvo. En reconnaissance du repos passager qu'il y goûta les derniers jours de sa vie, il indiqua cette vallée pour l'abri de son repos éternel. Il disait en parlant de la source: «Si Dieu voulait que je me rétablisse, j'élèverais un monument dans le lieu où elle jaillit.» Ce monument fut son tombeau. Du temps de Plutarque, dans un endroit consacré aux nymphes aux bords du Strymon, on voyait encore un siège de pierre sur lequel s'était assis Alexandre.
Napoléon, botté, éperonné, habillé en uniforme de colonel de la garde, décoré de la Légion d'honneur, fut exposé mort dans sa couchette de fer; sur ce visage qui ne s'étonna jamais, l'âme, en se retirant, avait laissé une stupeur sublime. Les planeurs et les menuisiers soudèrent et clouèrent Bonaparte en une quadruple bière d'acajou, de plomb, d'acajou encore et de fer-blanc; on semblait craindre qu'il ne fût jamais assez emprisonné. Le manteau que le vainqueur d'autrefois portait aux vastes funérailles de Marengo servit de drap mortuaire au cercueil.
(p. 113) Les obsèques se firent le 28 mai. Le temps était beau; quatre chevaux, conduits par des palefreniers à pied, tiraient le corbillard; vingt-quatre grenadiers anglais, sans armes, l'environnaient; suivait le cheval de Napoléon. La garnison de l'île bordait les précipices du chemin. Trois escadrons de dragons précédaient le cortège; le 20e régiment d'infanterie, les soldats de marine, les volontaires de Sainte-Hélène, l'artillerie royale avec quinze pièces de canon, fermaient la marche. Des groupes de musiciens, placés de distance en distance sur les rochers, se renvoyaient des airs lugubres. À un défilé, le corbillard s'arrêta; les vingt-quatre grenadiers sans armes enlevèrent le corps et eurent l'honneur de le porter sur leurs épaules jusqu'à la sépulture. Trois salves d'artillerie saluèrent les restes de Napoléon au moment où il descendit dans la terre: tout le bruit qu'il avait fait sur cette terre ne pénétrait pas à deux lignes au-dessous.
Une pierre qui devait être employée à la construction d'une nouvelle maison pour l'exilé est abaissée sur son cercueil comme la trappe de son dernier cachot.
On récita les versets du psaume 87: «J'ai été pauvre et plein de travail dans ma jeunesse; j'ai été élevé, puis humilié... j'ai été percé de vos colères.» De minute en minute le vaisseau amiral tirait. Cette harmonie de la guerre, perdue dans l'immensité de l'Océan, répondait au requiescat in pace. L'empereur, enterré par ses vainqueurs de Waterloo, avait ouï le dernier coup de canon de cette bataille; il n'entendit point la dernière détonation dont l'Angleterre troublait et honorait son sommeil à Sainte-Hélène. Chacun se (p. 114) retira, tenant en main une branche de saule comme en revenant de la fête des Palmes.
Lord Byron crut que le dictateur des rois avait abdiqué sa renommée avec son glaive, qu'il allait s'éteindre oublié. Le poète aurait dû savoir que la destinée de Napoléon était une muse, comme toutes les hautes destinées. Cette muse sut changer un dénoûment avorté en une péripétie qui renouvelait son héros. La solitude de l'exil et de la tombe de Napoléon a répandu sur une mémoire éclatante une autre sorte de prestige. Alexandre ne mourut point sous les yeux de la Grèce; il disparut dans les lointains superbes de Babylone. Bonaparte n'est point mort sous les yeux de la France; il s'est perdu dans les fastueux horizons des zones torrides. Il dort comme un ermite ou comme un paria dans un vallon, au bout d'un sentier désert. La grandeur du silence qui le presse égale l'immensité du bruit qui l'environna. Les nations sont absentes, leur foule s'est retirée; l'oiseau des tropiques, attelé, dit Buffon, au char du soleil, se précipite de l'astre de la lumière; où se repose-t-il aujourd'hui? Il se repose sur des cendres dont le poids a fait pencher le globe.
Imposuerunt omnes sibi diademata, post mortem ejus.
. . . et multiplicata sunt mala in terra (Machab.).
«Ils prirent tous le diadème après sa mort... et les maux se multiplièrent sur la terre.»
Ce résumé des Machabées sur Alexandre semble être fait pour Napoléon: «Les diadèmes ont été pris et les maux se sont multipliés sur la terre.» Vingt années se sont à peine écoulées depuis la mort de Bonaparte, et déjà la monarchie française et la monarchie (p. 115) espagnole ne sont plus. La carte du monde a changé; il a fallu apprendre une géographie nouvelle; séparés de leurs légitimes souverains, des peuples ont été jetés à des souverains de rencontre; des acteurs renommés sont descendus de la scène où sont montés des acteurs sans nom; les aigles se sont envolés de la cime du haut pin tombé dans la mer, tandis que de frêles coquillages se sont attachés aux flancs du tronc encore protecteur.
Comme en dernier résultat tout marche à ses fins, le terrible esprit de nouveauté qui parcourait le monde, disait l'empereur, et auquel il avait opposé la barre de son génie, reprend son cours; les institutions du conquérant défaillent; il sera la dernière des grandes existences individuelles; rien ne dominera désormais dans les sociétés infimes et nivelées; l'ombre de Napoléon s'élèvera seule à l'extrémité du vieux monde détruit, comme le fantôme du déluge au bord de son abîme: la postérité lointaine découvrira cette ombre par-dessus le gouffre où tomberont des siècles inconnus, jusqu'au jour marqué de la renaissance sociale.
Puisque c'est ma propre vie que j'écris en m'occupant de celles des autres, grandes ou petites, je suis forcé de mêler cette vie aux choses et aux hommes, quand par hasard elle est rappelée. Ai-je traversé d'une traite, sans m'y arrêter jamais, le souvenir du déporté qui, dans sa prison de l'Océan, attendait l'exécution de l'arrêt de Dieu? Non.
La paix que Napoléon n'avait pas conclue avec les rois ses geôliers, il l'avait faite avec moi: J'étais fils (p. 116) de la mer comme lui, ma nativité était du rocher comme la sienne. Je me flatte d'avoir mieux connu Napoléon que ceux qui l'ont vu plus souvent et approché de plus près.
Napoléon à Sainte-Hélène, cessant d'avoir à garder contre moi sa colère, avait renoncé à ses inimitiés; devenu plus juste à mon tour, j'écrivis dans le Conservateur cet article:
«Les peuples ont appelé Bonaparte un fléau; mais les fléaux de Dieu conservent quelque chose de l'éternité et de la grandeur du courroux divin dont ils émanent: Ossa arida... dabo vobis spiritum et viveris. Ossements arides, je vous donnerai mon souffle et vous vivrez. Né dans une île pour aller mourir dans une île, aux limites de trois continents; jeté au milieu des mers où Camoëns sembla le prophétiser en y plaçant le génie des tempêtes, Bonaparte ne se peut remuer sur son rocher que nous n'en soyons avertis par une secousse; un pas du nouvel Adamastor à l'autre pôle se fait sentir à celui-ci. Si Napoléon, échappé aux mains de ses geôliers, se retirait aux États-Unis, ses regards attachés sur l'Océan suffiraient pour troubler les peuples de l'ancien monde; sa seule présence sur le rivage américain de l'Atlantique forcerait l'Europe à camper sur le rivage opposé[69].»
Cet article parvint à Bonaparte à Sainte-Hélène; une main qu'il croyait ennemie versa le dernier baume sur ses blessures; il dit à M. de Montholon:
(p. 117) «Si, en 1814 et en 1815, la confiance royale n'avait point été placée dans des hommes dont l'âme était détrempée par des circonstances trop fortes, ou qui, renégats à leur patrie, ne voient de salut et de gloire pour le trône de leur maître que dans le joug de la Sainte Alliance; si le duc de Richelieu, dont l'ambition fut de délivrer son pays de la présence des baïonnettes étrangères, si Chateaubriand, qui venait de rendre à Gand d'éminents services, avaient eu la direction des affaires, la France serait sortie puissante et redoutée de ces deux grandes crises nationales. Chateaubriand a reçu de la nature le feu sacré: ses ouvrages l'attestent. Son style n'est pas celui de Racine, c'est celui du prophète. Si jamais il arrive au timon des affaires, il est possible que Chateaubriand s'égare: tant d'autres y ont trouvé leur perte! Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est grand et national doit convenir à son génie, et qu'il eût repoussé avec indignation ces actes infamants de l'administration d'alors[70].»
Telles ont été mes dernières relations avec Bonaparte.—Pourquoi ne conviendrais-je pas que ce jugement chatouille de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse. Bien de petits hommes à qui j'ai rendu de grands services ne m'ont pas jugé si favorablement que le géant dont j'avais osé attaquer la puissance.
Tandis que le monde napoléonien s'effaçait, je m'enquérais des lieux où Napoléon lui-même s'était évanoui. Le tombeau de Sainte-Hélène a déjà usé un des (p. 118) saules ses contemporains: l'arbre décrépit et tombé est mutilé chaque jour par les pèlerins. La sépulture est entourée d'un grillage en fonte; trois dalles sont posées transversalement sur la fosse; quelques iris croissent aux pieds et à la tête; la fontaine de la vallée coule encore là où des jours prodigieux se sont taris. Des voyageurs apportés par la tempête croient devoir consigner leur obscurité à la sépulture éclatante. Une vieille s'est établie auprès et vit de l'ombre d'un souvenir; un invalide fait sentinelle dans une guérite.
Le vieux Longwood, à deux cents pas du nouveau, est abandonné. À travers un enclos rempli de fumier, on arrive à une écurie; elle servait de chambre à coucher à Bonaparte. Un nègre vous montre une espèce de couloir occupé par un moulin à bras et vous dit: «Here he dead, ici il mourut.» La chambre où Napoléon reçut le jour n'était vraisemblablement ni plus grande ni plus riche.
Au nouveau Longwood, Plantation House, chez le gouverneur, on voit le duc de Wellington en peinture et les tableaux de ses batailles. Une armoire vitrée renferme un morceau de l'arbre près duquel se trouvait le général anglais à Waterloo; cette relique est placée entre une branche d'olivier cueillie au jardin des Olives et des ornements de sauvages de la mer du Sud: bizarre association des abuseurs des vagues. Inutilement le vainqueur veut ici se substituer au vaincu, sous la protection d'un rameau de la Terre sainte et du souvenir de Cook; il suffit qu'on retrouve à Sainte-Hélène la solitude, l'Océan et Napoléon.
(p. 119) Si l'on recherchait l'histoire de la transformation des bords illustrés par des tombeaux, des berceaux, des palais, quelle variété de choses et de destinées ne verrait-on pas, puisque de si étranges métamorphoses s'opèrent, jusque dans les habitations obscures auxquelles sont attachées nos chétives vies! Dans quelle hutte naquit Clovis? Dans quel chariot Attila reçut-il le jour? Quel torrent couvre la sépulture d'Alaric? Quel chacal occupe la place du cercueil en or ou en cristal d'Alexandre? Combien de fois ces poussières ont-elles changé de place? Et tous ces mausolées de l'Égypte et des Indes, à qui appartiennent-ils? Dieu seul connaît la cause de ces mutations liées à des mystères de l'avenir: il est pour les hommes des vérités cachées dans la profondeur du temps; elles ne se manifestent qu'à l'aide des siècles, comme il y a des étoiles si éloignées de la terre que leur lumière n'est pas encore parvenue jusqu'à nous.
Mais tandis que j'écrivais ceci le temps a marché; il a produit un événement qui aurait de la grandeur, si les événements ne tombaient aujourd'hui dans la boue. On a redemandé à Londres la dépouille de Bonaparte; la demande a été accueillie: qu'importent à l'Angleterre de vieux ossements? Elle nous fera tant que nous voudrons de ces sortes de présents. Les dépouilles de Napoléon nous sont revenues au moment de notre humiliation; elles auraient pu subir le droit de visite; mais l'étranger s'est montré facile: il a donné un laissez-passer aux cendres.
La translation des restes de Napoléon est une faute contre la renommée. Une sépulture à Paris ne vaudra (p. 120) jamais la vallée de Slane: qui voudrait voir Pompée ailleurs que dans le sillon de sable élevé par un pauvre affranchi, aidé d'un vieux légionnaire[71]? Que ferons-nous de ces magnifiques reliques au milieu de nos misères? Le granit le plus dur représentera-t-il la pérennité des œuvres de Bonaparte? Encore si nous possédions un Michel-Ange pour sculpter la statue funèbre? Comment façonnera-t-on le monument? Aux petits hommes des mausolées, aux grands hommes une pierre et un nom. Du moins, si on avait suspendu le cercueil au couronnement de l'Arc de Triomphe, si les nations avaient aperçu de loin leur maître porté sur les épaules de ses victoires? L'urne de Trajan n'était-elle pas placée à Rome au haut de sa colonne? Napoléon, parmi nous, se perdra dans la tourbe de ces va-nu-pieds de morts qui se dérobent en silence. Dieu veuille qu'il ne soit pas exposé aux vicissitudes de nos changements politiques, tout défendu qu'il est par Louis XIV, Vauban et Turenne! Gare ces violations de tombeaux si communes dans notre patrie! Qu'un certain côté de la Révolution triomphe, et la poussière du conquérant pourra rejoindre les poussières que nos passions ont dispersées: on oubliera le vainqueur des peuples pour ne se souvenir que de l'oppresseur des libertés. Les os de Napoléon ne reproduiront pas son génie, ils enseigneront son despotisme à de médiocres soldats.
Quoi qu'il en soit, une frégate a été fournie à un (p. 121) fils de Louis-Philippe[72]: un nom cher à nos anciennes victoires maritimes la protégeait sur les flots. Parti de Toulon, où Bonaparte s'était embarqué dans sa puissance pour la conquête de l'Égypte, le nouvel Argo est venu à Sainte-Hélène revendiquer le néant. Le sépulcre, avec son silence, continuait à s'élever immobile dans la vallée de Slane ou du Géranium. Des deux saules pleureurs, l'un était tombé; lady Dallas, femme d'un gouverneur de l'île, avait fait planter en remplacement de l'arbre défailli dix-huit jeunes saules et trente-quatre cyprès; la source, toujours là, coulait comme quand Napoléon en buvait l'eau. Pendant toute une nuit, sous la conduite d'un capitaine anglais nommé Alexander, on a travaillé à percer le monument. Les quatre cercueils emboîtés les uns dans les autres, le cercueil d'acajou, le cercueil de plomb, le second cercueil d'acajou ou de bois des îles et le cercueil de fer-blanc, ont été trouvés intacts. On procéda à l'inspection de ces moules de momie sous une tente, au milieu d'un cercle d'officiels dont quelques-uns avaient connu Bonaparte.
«Lorsque la dernière bière fut ouverte, les regards s'y plongèrent. Ils vinrent, dit l'abbé Coquereau, se heurter contre une masse blanchâtre qui couvrait le corps dans toute son étendue. Le docteur Gaillard, la touchant, reconnut un coussin de satin blanc qui garnissait à l'intérieur la paroi supérieure du cercueil: il s'était détaché et enveloppait la dépouille comme un linceul . . . . . . . . . Tout le corps paraissait couvert comme d'une (p. 122) mousse légère; on eût dit que nous l'apercevions à travers un nuage diaphane. C'était bien sa tête: un oreiller l'exhaussait un peu; son large front, ses yeux dont les orbites se dessinaient sous les paupières, garnies encore de quelques cils; ses joues étaient bouffies, son nez seul avait souffert, sa bouche entr'ouverte laissait apercevoir trois dents d'une grande blancheur; sur son menton se distinguait parfaitement l'empreinte de la barbe; ses deux mains surtout paraissaient appartenir à quelqu'un de respirant encore, tant elles étaient vives de ton et de coloris; l'une d'elles, la main gauche, était un peu plus élevée que la droite; ses ongles avaient poussé après la mort: ils étaient longs et blancs; une de ses bottes était décousue et laissait passer quatre doigts de ses pieds d'un blanc mat[73].»
Qu'est-ce qui a frappé les nécrobies? L'inanité des choses terrestres? la vanité de l'homme? Non, la beauté du mort; ses ongles seulement s'étaient allongés, pour déchirer, je présume, ce qui restait de liberté au monde. Ses pieds, rendus à l'humilité, ne s'appuyaient plus sur des coussins de diadème; ils reposaient nus dans leur poussière. Le fils de Condé était aussi habillé dans le fossé de Vincennes; cependant Napoléon, si bien conservé, était arrivé tout juste à ces trois dents que les balles avaient laissées à la mâchoire du duc d'Enghien.
(p. 123) L'astre éclipsé à Sainte-Hélène a reparu à la grande joie des peuples: l'univers a revu Napoléon; Napoléon n'a point revu l'univers. Les cendres vagabondes du conquérant ont été regardées par les mêmes étoiles qui le guidèrent à son exil: Bonaparte a passé par le tombeau, comme il a passé partout, sans s'y arrêter. Débarqué au Havre, le cadavre est arrivé à l'Arc de Triomphe, dais sous lequel le soleil montre son front à certains jours de l'année. Depuis cet Arc jusqu'aux Invalides, on n'a plus rencontré que des colonnes de planches, des bustes de plâtre, une statue du grand Condé (hideuse bouillie qui pleurait), des obélisques de sapin remémoratifs de la vie indestructible du vainqueur. Un froid rigoureux faisait tomber les généraux autour du char funèbre, comme dans la retraite de Moscou. Rien n'était beau hormis le bateau de deuil qui avait porté en silence sur la Seine Napoléon et un crucifix.
Privé de son catafalque de rochers, Napoléon est venu s'ensevelir dans les immondices de Paris. Au lieu de vaisseaux qui saluaient le nouvel Hercule, consumé sur le mont Œta, les blanchisseuses de Vaugirard rôderont alentour avec des invalides inconnus à la grande armée. Pour préluder à cette impuissance, de petits hommes n'ont rien pu imaginer de mieux qu'un salon de Curtius en plein vent. Après quelques jours de pluie, il n'est demeuré de ces décorations que des bribes crottées. Quoi qu'on fasse, on verra toujours au milieu des mers le vrai sépulcre du triomphateur: à nous le corps, à Sainte-Hélène la vie immortelle.
Napoléon a clos l'ère du passé: il a fait la guerre (p. 124) trop grande pour qu'elle revienne de manière à intéresser l'espèce humaine. Il a tiré impétueusement sur ses talons les portes du temple de Janus; et il a entassé derrière ces portes des monceaux de cadavres, afin qu'elles ne se puissent rouvrir.
En Europe je suis allé visiter les lieux où Bonaparte aborda après avoir rompu son ban à l'île d'Elbe. Je descendis à l'auberge de Cannes[74] au moment même que le canon tirait en commémoration du 29 juillet; un de ces résultats de l'incursion de l'empereur, non sans doute prévu par lui. La nuit était close quand j'arrivai au golfe Juan; je mis pied à terre à une maison isolée au bord de la grande route. Jacquemin, potier et aubergiste, propriétaire de cette maison, me mena à la mer. Nous prîmes des chemins creux entre des oliviers sous lesquels Bonaparte avait bivouaqué: Jacquemin lui-même l'avait reçu et me conduisait. À gauche du sentier de traverse s'élevait une espèce de hangar: Napoléon, qui envahissait seul la France, avait déposé dans ce hangar les effets de son débarquement.
Parvenu à la grève, je vis une mer calme que ne (p. 125) ridait pas le plus petit souffle; la lame, mince comme une gaze, se déroulait sur le sablon sans bruit et sans écume. Un ciel émerveillable, tout resplendissant de constellations, couronnait ma tête. Le croissant de la lune s'abaissa bientôt et se cacha derrière une montagne. Il n'y avait dans le golfe qu'une seule barque à l'ancre, et deux bateaux: à gauche on apercevait le phare d'Antibes, à droite les îles de Lérins; devant moi, la haute mer s'ouvrait au midi vers cette Rome où Bonaparte m'avait d'abord envoyé.
Les îles de Lérins, aujourd'hui îles Sainte-Marguerite, reçurent autrefois quelques chrétiens fuyant devant les Barbares. Saint Honorat venant de Hongrie aborda l'un de ces écueils: il monta sur un palmier, fit le signe de la croix, tous les serpents expirèrent, c'est-à-dire le paganisme disparut, et la nouvelle civilisation naquit dans l'Occident.
Quatorze cents ans après, Bonaparte vint terminer cette civilisation dans les lieux où le saint l'avait commencée. Le dernier solitaire de ces laures fut le Masque de fer, si le Masque de fer est une réalité. Du silence du golfe Juan, de la paix des îles aux anciens anachorètes, sortit le bruit de Waterloo, qui traversa l'Atlantique, et vint expirer à Sainte-Hélène.
Entre les souvenirs de deux sociétés, entre un monde éteint et un monde prêt à s'éteindre, la nuit, au bord abandonné de ces marines, on peut supposer ce que je sentis. Je quittai la plage dans une espèce de consternation religieuse, laissant le flot passer et repasser, sans l'effacer, sur la trace de l'avant-dernier pas de Napoléon.
À la fin de chaque grande époque, on entend quelque (p. 126) voix dolente des regrets du passé, et qui sonne le couvre-feu: ainsi gémirent ceux qui virent disparaître Charlemagne, saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Que ne pourrais-je pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis de deux ou trois mondes écoulés? Quand on a rencontré comme moi Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la tombe de Sainte-Hélène? Pourquoi ai-je survécu au siècle et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie? Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée? Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie? Je me décourage de durer. Ah! si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux Arabes de rivage, que j'ai rencontrés en Afrique! Assis les jambes croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée dans leur burnous, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux, parmi l'azur du ciel, le beau phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage; bercés du murmure de la vague, ils entr'oublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer: ils vont mourir.[Lien vers la Table des Matières]
Changement du monde. — Années de ma vie 1815, 1816. — Je suis nommé pair de France. — Mon début à la tribune. — Divers discours. — Monarchie selon la Charte. — Louis XVIII. — M. Decazes. — Je suis rayé de la liste des ministres d'État. — Je vends mes livres et ma Vallée. — Suite de mes discours en 1817 et 1818. — Réunion Piet. — Le Conservateur. — De la morale des intérêts matériels et de celle des devoirs. — Année de ma vie 1820. — Mort du duc de Berry. — Naissance du duc de Bordeaux. — Les dames de la halle de Bordeaux. — Je fais entrer M. de Villèle et M. de Corbière dans leur premier ministère. — Ma lettre au duc de Richelieu. — Billet du duc de Richelieu et ma réponse. — Billets de M. de Polignac. — Lettres de M. de Montmorency et de M. Pasquier. — Je suis nommé ambassadeur à Berlin. — Je pars pour cette ambassade.
Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas terminé avec Napoléon? Aurais-je dû parler d'autre chose? Quel personnage peut intéresser en dehors de lui? De qui et de quoi peut-il être question, après un pareil homme? Dante a eu seul le droit de s'associer aux grands poètes qu'il rencontre dans les régions d'une autre vie. Comment nommer Louis XVIII en place de l'empereur? Je rougis en pensant qu'il me faut nasillonner à cette heure d'une foule d'infimes créatures dont je fais partie, êtres douteux et nocturnes (p. 128) que nous fûmes d'une scène dont le large soleil avait disparu.
Les bonapartistes eux-mêmes s'étaient racornis. Leurs membres s'étaient repliés et contractés; l'âme manqua à l'univers nouveau sitôt que Bonaparte retira son souffle; les objets s'effacèrent dès qu'ils ne furent plus éclairés de la lumière qui leur avait donné le relief et la couleur. Au commencement de ces Mémoires je n'eus à parler que de moi: or, il y a toujours une sorte de primauté dans la solitude individuelle de l'homme; ensuite je fus environné de miracles: ces miracles soutinrent ma voix; mais à cette heure plus de conquête d'Égypte, plus de batailles de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna, plus de retraite de Russie, plus d'invasion de la France, de prise de Paris, de retour de l'Île d'Elbe, de bataille de Waterloo, de funérailles de Sainte-Hélène: quoi donc? des portraits à qui le génie de Molière pourrait seul donner la gravité du comique!
En m'exprimant sur notre peu de valeur, j'ai serré de près ma conscience; je me suis demandé si je ne m'étais pas incorporé par calcul à la nullité de ces temps, pour acquérir le droit de condamner les autres; persuadé que j'étais in petto que mon nom se lirait au milieu de toutes ces effaçures. Non: je suis convaincu que nous nous évanouirons tous: premièrement parce que nous n'avons pas en nous de quoi vivre; secondement parce que le siècle dans lequel nous commençons ou finissons nos jours n'a pas lui-même de quoi nous faire vivre. Des générations mutilées, épuisées, dédaigneuses, sans foi, vouées au néant qu'elles aiment, ne sauraient donner l'immortalité; (p. 129) elles n'ont aucune puissance pour créer une renommée; quand vous cloueriez votre oreille à leur bouche vous n'entendriez rien: nul son ne sort du cœur des morts.
Une chose cependant me frappe: le petit monde dans lequel j'entre à présent était supérieur au monde qui lui a succédé en 1830; nous étions des géants en comparaison de la société de cirons qui s'est engendrée.
La Restauration offre du moins un point où l'on peut retrouver de l'importance: après la dignité d'un seul homme, cet homme passé, renaquit la dignité des hommes. Si le despotisme a été remplacé par la liberté, si nous entendons quelque chose à l'indépendance, si nous avons perdu l'habitude de ramper, si les droits de la nature humaine ne sont plus méconnus, c'est à la Restauration que nous en sommes redevables[76]. Aussi me jetai-je dans la mêlée pour, autant que je le pouvais, raviver l'espèce quand l'individu fut fini.
Allons, poursuivons notre tâche! descendons en gémissant jusqu'à moi et à mes collègues. Vous m'avez vu au milieu de mes songes; vous allez me voir dans mes réalités: si l'intérêt diminue, si je tombe, lecteur, soyez juste, faites la part de mon sujet!
(p. 130) Après la seconde rentrée du roi et la disparition finale de Bonaparte, le ministère étant aux mains de M. le duc d'Otrante et de M. le prince de Talleyrand, je fus nommé président du collège électoral du département du Loiret[77]. Les élections de 1815 donnèrent (p. 131) au roi la Chambre introuvable. Toutes les voix se portaient sur moi à Orléans, lorsque l'ordonnance qui m'appelait à la Chambre des pairs[78] m'arriva. Ma carrière d'action à peine commencée changea subitement de route: qu'eût-elle été si j'eusse été placé dans la Chambre élective? Il est assez probable que cette carrière aurait abouti, en cas de succès, au ministère de l'intérieur, au lieu de me conduire au ministère des affaires étrangères. Mes habitudes et mes mœurs étaient plus en rapport avec la pairie, et quoique celle-ci me devînt hostile dès le premier moment, à cause de mes opinions libérales, il est toutefois certain que mes doctrines sur la liberté de la presse et contre le vasselage des étrangers donnèrent à la noble Chambre cette popularité dont elle a joui tant qu'elle souffrit mes opinions.
Je reçus en arrivant le seul honneur que mes collègues m'aient jamais fait pendant mes quinze années de résidence au milieu d'eux: je fus nommé l'un des quatre secrétaires pour la session de 1816. Lord Byron n'obtint pas plus de faveur lorsqu'il parut à la Chambre des lords, et il s'en éloigna pour toujours; j'aurais dû rentrer dans mes déserts.
Mon début à la tribune fut un discours sur l'inamovibilité des juges: je louais le principe, mais j'en blâmais l'application immédiate[79]. Dans la révolution de 1830 les hommes de la gauche les plus dévoués à (p. 132) cette révolution voulaient suspendre pour un temps l'inamovibilité.
Le 22 février 1816, le duc de Richelieu nous apporta le testament autographe de la reine; je montai à la tribune, et je dis:
«Celui qui nous a conservé le testament de Marie-Antoinette[80] avait acheté la terre de Montboisier: juge de Louis XVI, il avait élevé dans cette terre un monument à la mémoire du défenseur de Louis XVI, il avait gravé lui-même sur ce monument une épitaphe en vers français à la louange de M. de Malesherbes. Cette étonnante impartialité annonce que tout est déplacé dans le monde moral[81].»
Le 12 mars 1816, on agita la question des pensions ecclésiastiques. «Vous refuseriez, disais-je, des aliments au pauvre vicaire qui consacre aux autels le reste de ses jours, et vous accorderiez des pensions à Joseph Lebon, qui fit tomber tant de têtes, à François Chabot, qui demandait pour les émigrés une loi si simple qu'un enfant pût les mener à la guillotine, à Jacques Roux, lequel, refusant au Temple de recevoir le testament de Louis XVI, répondit à l'infortuné monarque: Je ne suis chargé que de te conduire à la mort[82].»
(p. 133) On avait apporté à la Chambre héréditaire un projet de loi relatif aux élections; je me prononçai pour le renouvellement intégral de la Chambre des députés[83]; ce n'est qu'en 1824, étant ministre, que je le fis entrer dans la loi.
Ce fut aussi dans ce premier discours sur la loi d'élections, en 1816, que je répondis à un adversaire: «Je ne relève point ce qu'on a dit de l'Europe attentive à nos discussions. Quant à moi, messieurs, je dois sans doute au sang français qui coule dans mes veines cette impatience que j'éprouve quand, pour déterminer mon suffrage, on me parle des opinions placées hors ma patrie; et si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irais vivre à Constantinople.»
Le 9 avril 1816, je fis à la Chambre une proposition relative aux puissances barbaresques. La Chambre décida qu'il y avait lieu de s'en occuper. Je songeais déjà à combattre l'esclavage, avant que j'eusse obtenu cette décision favorable de la pairie qui fut la première intervention politique d'une grande puissance en faveur des Grecs: «J'ai vu, disais-je à mes collègues, les ruines de Carthage; j'ai rencontré parmi ces ruines les successeurs de ces malheureux chrétiens pour la délivrance desquels saint Louis fit le sacrifice de sa vie. La philosophie pourra prendre sa part de la gloire attachée au succès de ma proposition et se (p. 134) vanter d'avoir obtenu dans un siècle de lumières ce que la religion tenta inutilement dans un siècle de ténèbres[84].»
J'étais placé dans une assemblée où ma parole, les trois quarts du temps, tournait contre moi. On peut remuer une chambre populaire; une chambre aristocratique est sourde. Sans tribune, à huis clos devant des vieillards, restes desséchés de la vieille Monarchie, de la Révolution et de l'Empire, ce qui sortait du ton le plus commun paraissait folie. Un jour, le premier rang des fauteuils, tout près de la tribune, était rempli de respectables pairs, plus sourds les uns que les autres, la tête penchée en avant et tenant à l'oreille un cornet dont l'embouchure était dirigée vers la tribune. Je les endormis, ce qui est bien naturel. Un d'eux laissa tomber son cornet; son voisin, réveillé par la chute, voulut ramasser poliment le cornet de son confrère; il tomba. Le mal fut que je me pris à rire, quoique je parlasse alors pathétiquement sur je ne sais plus quel sujet d'humanité.
Les orateurs qui réussissaient dans cette Chambre étaient ceux qui parlaient sans idées, d'un ton égal et monotone, ou qui ne trouvaient de sensibilité que pour s'attendrir sur les pauvres ministres. M. de Lally-Tolendal tonnait en faveur des libertés publiques: il faisait retentir les voûtes de notre solitude de l'éloge de trois ou quatre lords de la chancellerie anglaise, ses aïeux, disait-il. Quand son panégyrique de la liberté de la presse était terminé, arrivait un mais (p. 135) fondé sur des circonstances, lequel mais nous laissait l'honneur sauf, sous l'utile surveillance de la censure.
La Restauration donna un mouvement aux intelligences; elle délivra la pensée comprimée par Bonaparte: l'esprit, comme une cariatide déchargée de l'architecture qui lui courbait le front, releva la tête. L'Empire avait frappé la France de mutisme; la liberté restaurée la toucha et lui rendit la parole: il se trouva des talents de tribune qui reprirent les choses où les Mirabeau et les Cazalès les avaient laissées, et la Révolution continua son cours.
Mes travaux ne se bornaient pas à la tribune, si nouvelle pour moi. Épouvanté des systèmes que l'on embrassait et de l'ignorance de la France sur les principes du gouvernement représentatif, j'écrivais et je faisais imprimer la Monarchie selon la Charte. Cette publication a été une des grandes époques de ma vie politique: elle me fit prendre rang parmi les publicistes; elle servit à fixer l'opinion sur la nature de notre gouvernement. Les journaux anglais portèrent cet écrit aux nues; parmi nous, l'abbé Morellet même ne revenait pas de la métamorphose de mon style et de la précision dogmatique des vérités.
La Monarchie selon la Charte est un catéchisme constitutionnel: c'est là que l'on a puisé la plupart des propositions que l'on avance comme nouvelles aujourd'hui. Ainsi ce principe, que le roi règne et ne gouverne pas, se trouve tout entier dans les chapitres IV, V, VI et VII sur la prérogative royale.
Les principes constitutionnels étant posés dans la première partie de la Monarchie selon la Charte, (p. 136) j'examine dans la seconde les systèmes des trois ministères qui jusqu'alors s'étaient succédé depuis 1814 jusqu'à 1816; dans cette partie se rencontrent des prédictions depuis trop vérifiées et des expositions de doctrines alors cachées. On lit ces mots, chapitre XXVI, deuxième partie: «Il passe pour constant, dans un certain parti, qu'une révolution de la nature de la nôtre ne peut finir que par un changement de dynastie; d'autres, plus modérés, disent par un changement dans l'ordre de successibilité à la couronne.»
Comme je terminais mon ouvrage, parut l'ordonnance du 5 septembre 1816: cette mesure dispersait le peu de royalistes rassemblés pour reconstruire la monarchie légitime[85]. Je me hâtai d'écrire le post-scriptum qui fit faire explosion à la colère de M. le duc de Richelieu et du favori de Louis XVIII, M. Decazes.
Le post-scriptum ajouté, je courus chez M. Le Normant, mon libraire: je trouvai en arrivant des alguazils et un commissaire de police qui instrumentaient. Ils avaient saisi des paquets et apposé des scellés. Je n'avais pas bravé Bonaparte pour être intimidé par M. Decazes: je m'opposai à la saisie; je déclarai, comme Français libre et comme pair de France, que je ne céderais qu'à la force: la force arriva et je me retirai. Je me rendis le 18 septembre chez MM. Louis-Marthe Mesnier et son collègue, notaires royaux; je protestai à leur étude et je les requis de consigner ma déclaration du fait de l'arrestation de mon ouvrage, (p. 137) voulant assurer par cette protestation les droits des citoyens français. M. Baude[86] m'a imité en 1830.
Je me trouvai engagé ensuite dans une correspondance assez longue avec M. le chancelier, M. le ministre de la police et M. le procureur général Bellart[87], jusqu'au 9 novembre, jour que le chancelier m'annonça l'ordonnance rendue en ma faveur par le tribunal de première instance, laquelle me remit en possession de mon ouvrage saisi. Dans une de ses lettres, M. le chancelier me mandait qu'il avait été désolé de voir le mécontentement que le roi avait exprimé publiquement de mon ouvrage. Ce mécontentement venait des chapitres où je m'élevais contre (p. 138) l'établissement d'un ministre de la police générale dans un pays constitutionnel[88].
Dans mon récit du voyage de Gand, vous avez vu ce que Louis XVIII valait comme fils de Hugues Capet; dans mon écrit, Le roi est mort: vive le roi! j'ai dit les qualités réelles de ce prince[89]. Mais l'homme n'est pas un et simple: pourquoi y a-t-il si peu de portraits fidèles? parce qu'on a fait poser le modèle à telle époque de sa vie; dix ans après, le portrait ne ressemble plus.
Louis XVIII n'apercevait pas loin les objets devant lui ni autour de lui; tout lui semblait beau ou laid d'après l'angle de son regard. Atteint de son siècle, il est à craindre que la religion ne fût pour le roi très-chrétien qu'un élixir propre à l'amalgame des drogues de quoi se compose la royauté. L'imagination libertine qu'il avait reçue de son grand-père aurait pu inspirer quelque défiance de ses entreprises; mais il se connaissait, et quand il parlait d'une manière affirmative, il se vantait en se raillant de lui-même. Je lui parlais un jour de la nécessité d'un nouveau mariage pour M. le duc de Bourbon, afin de rappeler la race des Condé à la vie: il approuvait fort cette idée, quoiqu'il ne se souciât guère de ladite résurrection; mais à ce propos il me parla de M. le comte d'Artois et me dit: «Mon frère pourrait se remarier sans rien changer à la succession au trône, il ne ferait que (p. 139) des cadets; pour moi, je ne ferais que des aînés: je ne veux point déshériter M. le duc d'Angoulême.» Et il se rengorgea d'un air capable et goguenard; mais je ne prétendais disputer au roi aucune puissance.
Égoïste et sans préjugés, Louis XVIII voulait sa tranquillité à tout prix: il soutenait ses ministres tant qu'ils avaient la majorité; il les renvoyait aussitôt que cette majorité était ébranlée et que son repos pouvait être dérangé: il ne balançait pas à reculer dès que, pour obtenir la victoire, il eût fallu faire un pas en avant. Sa grandeur était de la patience; il n'allait pas aux événements, les événements venaient à lui.
Sans être cruel, ce roi n'était pas humain; les catastrophes tragiques ne l'étonnaient ni ne le touchaient pas: il se contenta de dire au duc de Berry, qui s'excusait d'avoir eu le malheur de troubler par sa mort le sommeil du roi: «J'ai fait ma nuit.» Pourtant cet homme tranquille, lorsqu'il était contrarié, entrait dans d'horribles colères; enfin, ce prince si froid, si insensible, avait des attachements qui ressemblaient à des passions: ainsi se succédèrent dans son intimité le comte d'Avaray, M. de Blacas, M. Decazes; madame de Balbi, madame du Cayla: toutes ces personnes aimées étaient des favoris; malheureusement, elles ont entre leurs mains beaucoup trop de lettres.
Louis XVIII nous apparut dans toute la profondeur des traditions historiques; il se montra avec le favoritisme des anciennes royautés. Se fait-il dans le cœur des monarques isolés un vide qu'ils remplissent (p. 140) avec le premier objet qu'ils trouvent? Est-ce sympathie, affinité d'une nature analogue à la leur? Est-ce une amitié qui leur tombe du ciel pour consoler leurs grandeurs? Est-ce un penchant pour un esclave qui se donne corps et âme, devant lequel on ne se cache de rien, esclave qui devient un vêtement, un jouet, une idée fixe liée à tous les sentiments, à tous les goûts, à tous les caprices de celui qu'elle a soumis et qu'elle tient sous l'empire d'une fascination invincible? Plus le favori a été bas et intime, moins on le peut renvoyer, parce qu'il est en possession de secrets qui feraient rougir s'ils étaient divulgués: ce préféré puise une double force dans sa turpitude et dans les faiblesses de son maître.
Quand le favori est par hasard un grand homme, comme l'obsesseur Richelieu ou l'inrenvoyable Mazarin, les nations en le détestant profitent de sa gloire ou de sa puissance; elles ne font que changer un misérable roi de droit pour un illustre roi de fait.
Aussitôt que M. Decazes[90] fut nommé ministre, les voitures encombrèrent le soir le quai Malaquais, pour (p. 141) déposer dans le salon du parvenu ce qu'il y avait de plus noble dans le faubourg Saint-Germain. Le Français aura beau faire, il ne sera jamais qu'un courtisan, n'importe de qui, pourvu que ce soit un puissant du jour.
Il se forma bientôt en faveur du nouveau favori une coalition formidable de bêtises. Dans la société démocratique, bavardez de libertés, déclarez que vous voyez la marche du genre humain et l'avenir des choses, en ajoutant à vos discours quelques croix d'honneur, et vous êtes sûr de votre place; dans la société aristocratique, jouez au whist, débitez d'un air grave et profond des lieux communs et des bons mots arrangés d'avance, et la fortune de votre génie est assurée.
Compatriote de Murat, mais de Murat sans royaume, M. Decazes nous était venu de la mère de Napoléon[91]. Il était familier, obligeant, jamais insolent; il me voulait du bien, je ne sais pourquoi je ne m'en souciai pas: de là vint le commencement de mes disgrâces. Cela devait m'apprendre qu'on ne doit jamais manquer de respect à un favori. Le roi le combla de bienfaits et de crédit, et le maria dans la suite à une personne (p. 142) très bien née, fille de M. de Sainte-Aulaire[92]. Il est vrai que M. Decazes servait trop bien la royauté; ce fut lui qui déterra le maréchal Ney dans les montagnes d'Auvergne où il s'était caché.
Fidèle aux inspirations de son trône, Louis XVIII disait de M. Decazes: «Je l'élèverai si haut qu'il fera envie aux plus grands seigneurs.» Ce mot, emprunté d'un autre roi, n'était qu'un anachronisme: pour élever les autres, il faut être sûr de ne pas descendre; or, au temps où Louis XVIII était arrivé, qu'était-ce que les monarques? S'ils pouvaient encore faire la fortune d'un homme, ils ne pouvaient en faire la grandeur; ils n'étaient plus que les banquiers de leurs favoris.
Madame Princeteau, sœur de M. Decazes, était une agréable, modeste et excellente personne; le roi s'en était amouraché en perspective. M. Decazes le père, que je vis dans la salle du trône en habit habillé, l'épée au côté, chapeau sous le bras, n'eut cependant aucun succès.
Enfin, la mort de M. le duc de Berry accrut les inimitiés de part et d'autre et amena la chute du favori. J'ai dit que les pieds lui glissèrent dans le sang[93], ce (p. 143) qui ne signifie pas, à Dieu ne plaise! qu'il fut coupable du meurtre, mais qu'il tomba dans la mare rougie qui se forma sous le couteau de Louvel.
J'avais résisté à la saisie de la Monarchie selon la Charte pour éclairer la royauté abusée et pour soutenir la liberté de la pensée et de la presse; j'avais embrassé franchement nos institutions et j'y suis resté fidèle.
Ces tracasseries passées, je demeurai saignant des blessures qu'on m'avait faites à l'apparition de ma brochure. Je ne pris pas possession de ma carrière politique sans porter les cicatrices des coups que je reçus en entrant dans cette carrière: je m'y sentais mal, je n'y pouvais respirer.
Peu de temps après, une ordonnance contre-signée (p. 144) Richelieu me raya de la liste des ministres d'État[94], et je fus privé d'une place réputée jusqu'alors inamovible; elle m'avait été donnée à Gand, et la pension attachée à cette place me fut retirée: la main qui avait pris Fouché me frappa.
J'ai eu l'honneur d'être dépouillé trois fois pour la légitimité: la première, pour avoir suivi les fils de saint Louis dans leur exil; la seconde, pour avoir écrit en faveur des principes de la monarchie octroyée, la troisième, pour m'être tu sur une loi funeste au moment que je venais de faire triompher nos armes: la campagne d'Espagne avait rendu des soldats au drapeau blanc, et si j'avais été maintenu au pouvoir, j'aurais reporté nos frontières aux rives du Rhin[95].
Ma nature me rendit parfaitement insensible à la perte de mes appointements; j'en fus quitte pour me remettre à pied et pour aller, les jours de pluie, en fiacre à la Chambre des pairs. Dans mon équipage populaire, sous la protection de la canaille qui roulait autour de moi, je rentrai dans les droits des prolétaires dont je fais partie: du haut de mon char, je domine le train des rois.
(p. 145) Je fus obligé de vendre mes livres; M. Merlin les exposa à la criée, à la salle Sylvestre, rue des Bons-Enfants[96]. Je ne gardai qu'un petit Homère grec, à la marge duquel se trouvaient des essais de traductions et des remarques écrites de ma main. Bientôt il me fallut tailler dans le vif; je demandai à M. le ministre de l'intérieur la permission de mettre en loterie ma maison de campagne: la loterie fut ouverte chez M. Denis, notaire. Il y avait quatre-vingt-dix billets à 1,000 francs chaque: les numéros ne furent point pris par les royalistes; madame la duchesse d'Orléans, douairière, prit trois numéros; mon ami M. Lainé, ministre de l'intérieur, qui avait contre-signé l'ordonnance du 5 septembre et consenti dans le conseil à ma radiation, prit, sous un faux nom, un quatrième billet. L'argent fut rendu aux souscripteurs; toutefois, M. Lainé refusa de retirer ses 1,000 francs; il les laissa au notaire pour les pauvres.
Peu de temps après, ma Vallée-aux-Loups fut vendue, comme on vend les meubles des pauvres, sur la place du Châtelet[97]. Je souffris beaucoup de cette (p. 146) vente; je m'étais attaché à mes arbres, plantés et grandis, pour ainsi dire, dans mes souvenirs. La mise à prix était de 50,000 francs; elle fut couverte par M. le vicomte de Montmorency[98], qui seul osa mettre une surenchère de cent francs: la Vallée lui resta. Il a depuis habité ma retraite; il n'est pas bon de se mêler à ma fortune: cet homme de vertu n'est plus.
Après la publication de la Monarchie selon la Charte et à l'ouverture de la nouvelle session au mois de novembre 1816, je continuai mes combats. Je fis à la Chambre des pairs, dans la séance du 23 de ce mois, une proposition[99] tendante à ce que le roi fût humblement supplié de faire examiner ce qui s'était passé aux dernières élections. La corruption et la violence du ministère dans ces dernières élections étaient flagrantes.
(p. 147) Dans mon opinion sur le projet de loi relatif aux finances (21 mars 1817), je m'élevai contre le titre XI de ce projet: il s'agissait des forêts de l'État que l'on prétendait affecter à la caisse d'amortissement et dont on voulait vendre ensuite cent cinquante mille hectares. Ces forêts se composaient de trois sortes de propriétés: les anciens domaines de la couronne, quelques commanderies de l'ordre de Malte et le reste des biens de l'Église. Je ne sais pourquoi, même aujourd'hui, je trouve un intérêt triste dans mes paroles; elles ont quelque ressemblance avec mes Mémoires:
«N'en déplaise à ceux qui n'ont administré que dans nos troubles, ce n'est pas le gage matériel, c'est la morale d'un peuple qui fait le crédit public. Les propriétaires nouveaux feront-ils valoir les titres de leur propriété nouvelle? On leur citera, pour les dépouiller, des héritages de neuf siècles enlevés à leurs anciens possesseurs. Au lieu de ces immuables patrimoines où la même famille survivait à la race des chênes, vous aurez des propriétés mobiles où les roseaux auront à peine le temps de naître et de mourir avant qu'elles aient changé de maîtres. Les foyers cesseront d'être les gardiens des mœurs domestiques; ils perdront leur autorité vénérable; chemins de passage ouverts à tout venant, ils ne seront plus consacrés par le siège de l'aïeul et par le berceau du nouveau-né.
«Pairs de France, c'est votre cause que je plaide ici et non la mienne: je vous parle pour l'intérêt de vos enfants; moi je n'aurai rien à démêler avec la postérité; je n'ai point de fils; j'ai perdu le (p. 148) champ de mon père, et quelques arbres que j'ai plantés ne seront bientôt plus à moi.[100]»
Par la ressemblance des opinions, alors très vives, il s'était établi une camaraderie entre les minorités des deux Chambres. La France apprenait le gouvernement représentatif: comme j'avais la sottise de le prendre à la lettre et d'en faire, à mon dam, une véritable passion, je soutenais ceux qui l'adoptaient, sans m'embarrasser s'il n'entrait pas dans leur opposition plus de motifs humains que d'amour pur comme celui que j'éprouvais pour la Charte; non que je fusse un niais, mais j'étais idolâtre de ma dame, et j'aurais traversé les flammes pour l'emporter dans mes bras. Ce fut dans cet accès de constitution que je connus M. de Villèle en 1816. Il était plus calme; il surmontait son ardeur; il prétendait aussi conquérir la liberté; mais il en faisait le siège en règle; il ouvrait méthodiquement la tranchée: moi, qui voulais enlever d'assaut la place, je grimpais à l'escalade et j'étais souvent renversé dans le fossé.
Je rencontrai pour la première fois M. de Villèle[101] (p. 149) chez madame la duchesse de Lévis. Il devint le chef de l'opposition royaliste dans la Chambre élective, comme je l'étais dans la Chambre héréditaire. Il avait pour ami son collègue M. de Corbière[102]. Celui-ci ne le quittait plus, et l'on disait Villèle et Corbière, comme on dit Oreste et Pylade, Euryale et Nisus.
Entrer dans de fastidieux détails pour des personnages dont on ne saura pas le nom demain serait d'une vanité idiote. D'obscurs et ennuyeux remuements, qu'on croit d'un intérêt immense et qui n'intéressent personne; des tripotages passés, qui n'ont déterminé aucun événement majeur, doivent être laissés à ces béats heureux, lesquels se figurent être ou avoir été l'objet de l'attention de la terre.
Il y avait pourtant des moments d'orgueil où mes démêlés avec M. de Villèle me paraissaient être à moi-même les dissensions de Sylla et de Marius, de César et de Pompée. Avec les autres membres de l'opposition, nous allions assez souvent, rue Thérèse, passer la soirée en délibération chez M. Piet[103]. Nous (p. 150) arrivions extrêmement laids, et nous nous asseyions en rond autour d'un salon éclairé d'une lampe qui filait. Dans ce brouillard législatif, nous parlions de la loi présentée, de la motion à faire, du camarade à porter au secrétariat, à la questure, aux diverses commissions. Nous ne ressemblions pas mal aux assemblées des premiers fidèles, peintes par les ennemis de la foi: nous débitions les plus mauvaises nouvelles; nous disions que les affaires allaient changer de face, que Rome serait troublée par des divisions, que nos armées seraient défaites.
M. de Villèle écoutait, résumait et ne concluait point: c'était un grand aideur d'affaires; marin circonspect, il ne mettait jamais en mer pendant la tempête, et, s'il entrait avec dextérité dans un port connu, il n'aurait jamais découvert le Nouveau Monde. Je remarquai souvent, à propos de nos discussions sur la vente des biens du clergé, que les plus chrétiens d'entre nous étaient les plus ardents à défendre les doctrines constitutionnelles. La religion est la source de la liberté: à Rome, le flamen dialis ne portait qu'un anneau creux au doigt, parce qu'un anneau plein avait quelque chose d'une chaîne; dans son vêtement (p. 151) et sur sa tête le pontife de Jupiter ne devait souffrir aucun nœud.
Après la séance, M. de Villèle se retirait, accompagné de M. de Corbière. J'étudiais beaucoup d'individus, j'apprenais beaucoup de choses, je m'occupais de beaucoup d'intérêts dans ces réunions: les finances, que j'ai toujours sues, l'armée, la justice, l'administration, m'initiaient à leurs éléments. Je sortais de ces conférences un peu plus homme d'État et un peu plus persuadé de la pauvreté de toute cette science. Le long de la nuit, dans mon demi-sommeil j'apercevais les diverses attitudes des têtes chauves, les diverses expressions des figures de ces Solons peu soignés et mal accompagnés de leurs corps: c'était bien vénérable assurément; mais je préférais l'hirondelle qui me réveillait dans ma jeunesse et les Muses qui remplissaient mes songes: les rayons de l'aurore qui, frappant un cygne, faisaient tomber l'ombre de ces blancs oiseaux sur une vague d'or; le soleil levant qui m'apparaissait en Syrie dans la tige d'un palmier, comme le nid du phénix, me plaisaient mieux.
Je sentais que mes combats de tribune, dans une Chambre fermée, et au milieu d'une assemblée qui m'était peu favorable, restaient inutiles à la victoire et qu'il me fallait avoir une autre arme. La censure étant établie sur les feuilles périodiques quotidiennes, je ne pouvais remplir mon dessein qu'au moyen d'une feuille libre, semi-quotidienne, à l'aide de laquelle j'attaquerais à la fois le système des ministres et les opinions de l'extrême gauche imprimées dans la Minerve (p. 152) par M. Étienne[104]. J'étais à Noisiel, chez madame la duchesse de Lévis, dans l'été de 1818, lorsque mon libraire M. le Normant me vint voir. Je lui fis part de l'idée qui m'occupait; il prit feu, s'offrit à courir tous les risques et se chargea de tous les frais. Je parlai à mes amis MM. de Bonald et de la Mennais, je leur demandai s'ils voulaient s'associer: ils y consentirent, et le journal ne tarda pas à paraître sous le nom de Conservateur.[105]
La révolution opérée par ce journal fut inouïe: en (p. 153) France, il changea la majorité dans les Chambres; à l'étranger, il transforma l'esprit des cabinets.
Ainsi les royalistes me durent l'avantage de sortir du néant dans lequel ils étaient tombés auprès des peuples et des rois. Je mis la plume à la main aux plus grandes familles de France. J'affublai en journalistes les Montmorency et les Lévis; je convoquai l'arrière-ban; je fis marcher la féodalité au secours de la liberté de la presse. J'avais réuni les hommes les plus éclatants du parti royaliste, MM. de Villèle, de Corbière, de Vitrolles[106], de Castelbajac[107], etc. Je (p. 154) ne pouvais m'empêcher de bénir la Providence toutes les fois que j'étendais la robe rouge d'un prince de l'Église sur le Conservateur pour lui servir de couverture, et que j'avais le plaisir de lire un article signé en toutes lettres: le cardinal de La Luzerne[108]. Mais il arriva qu'après avoir mené mes chevaliers à la croisade constitutionnelle, aussitôt qu'ils eurent conquis le pouvoir par la délivrance de la liberté, aussitôt qu'ils furent devenus princes d'Édesse, d'Antioche, de Damas, ils s'enfermèrent dans leurs nouveaux États avec Léonore d'Aquitaine, et me laissèrent me morfondre au pied de Jérusalem dont les infidèles avaient repris le saint tombeau.
Ma polémique commença dans le Conservateur, et dura depuis 1818 jusqu'en 1820, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement de la censure, dont le prétexte fut la mort du duc de Berry. À cette première époque de ma polémique, je culbutai l'ancien ministère et fis entrer M. de Villèle au pouvoir.
Après 1824, quand je repris la plume dans des brochures et dans le Journal des Débats, les positions (p. 155) étaient changées. Que m'importaient pourtant ces futiles misères, à moi qui n'ai jamais cru au temps où je vivais, à moi qui appartenais au passé, à moi sans foi dans les rois, sans conviction à l'égard des peuples, à moi qui ne me suis jamais soucié de rien, excepté des songes, à condition encore qu'ils ne durent qu'une nuit!
Le premier article du Conservateur peint la position des choses au moment où je descendis dans la lice.[109] Pendant les deux années que dura ce journal, j'eus successivement à traiter des accidents du jour et à examiner des intérêts considérables. J'eus occasion de relever les lâchetés de cette correspondance privée que la police de Paris publiait à Londres. Ces correspondances privées pouvaient calomnier, mais elles ne pouvaient déshonorer: ce qui est vil n'a pas le pouvoir d'avilir; l'honneur seul peut infliger le déshonneur. «Calomniateurs anonymes, disais-je, ayez le courage de dire qui vous êtes; un peu de honte est bientôt passée; ajoutez votre nom à vos articles, ce ne sera qu'un mot méprisable de plus.»
Je me moquais quelquefois des ministres et je donnais cours à ce penchant ironique que j'ai toujours réprouvé en moi.
Enfin, sous la date du 5 décembre 1818, le Conservateur contenait un article sérieux sur la morale des intérêts et sur celle des devoirs: c'est de cet article, qui fit du bruit, qu'est née la phraséologie des intérêts (p. 156) moraux et des intérêts matériels, mise d'abord en avant par moi, adoptée ensuite par tout le monde. Le voici fort abrégé; il s'élève au-dessus de la portée d'un journal, et c'est un de mes ouvrages auquel ma raison attache quelque valeur. Il n'a point vieilli, parce que les idées qu'il renferme sont de tous les temps.
«Le ministère a inventé une morale nouvelle, la morale des intérêts; celle des devoirs est abandonnée aux imbéciles. Or, cette morale des intérêts, dont on veut faire la base de notre gouvernement, a plus corrompu le peuple dans l'espace de trois années que la révolution dans un quart de siècle.
«Ce qui fait périr la morale chez les nations, et avec la morale les nations elles-mêmes, ce n'est pas la violence, mais la séduction; et par séduction j'entends ce que toute fausse doctrine a de flatteur et de spécieux. Les hommes prennent souvent l'erreur pour la vérité, parce que chaque faculté du cœur ou de l'esprit a sa fausse image: la froideur ressemble à la vertu, le raisonner à la raison, le vide à la profondeur, ainsi du reste.

Assassinat du Duc de Berry.
«Le dix-huitième siècle fut un siècle destructeur; nous fûmes tous séduits. Nous dénaturâmes la politique, nous nous égarâmes dans de coupables nouveautés en cherchant l'existence sociale dans la corruption de nos mœurs. La révolution vint nous réveiller: en poussant le Français hors de son lit, elle le jeta dans la tombe. Toutefois, le règne de la terreur est peut-être, de toutes les époques de la révolution, celle qui fut la moins dangereuse à la (p. 157) morale, parce qu'aucune conscience n'était forcée: le crime paraissait dans sa franchise. Des orgies au milieu du sang, des scandales qui n'en étaient plus à force d'être horribles; voilà tout. Les femmes du peuple venaient travailler à leurs ouvrages autour de la machine à meurtre comme à leurs foyers: les échafauds étaient les mœurs publiques et la mort le fond du gouvernement. Rien de plus net que la position de chacun: on ne parlait ni de spécialité, ni de positif, ni de système d'intérêts. Ce galimatias des petits esprits et des mauvaises consciences était inconnu. On disait à un homme: «Tu es royaliste, noble, riche: meurs;» et il mourait. Antonelle[110] écrivait qu'on ne trouvait aucune charge contre tels prisonniers, mais qu'il les avait condamnés comme aristocrates: monstrueuse franchise, qui nonobstant laissait subsister l'ordre moral; car ce n'est pas de tuer l'innocent comme innocent qui perd la société, c'est de le tuer comme coupable.
«En conséquence, ces temps affreux sont ceux des grands dévouements. Alors les femmes marchèrent héroïquement au supplice; les pères se livrèrent pour les fils, les fils pour les pères; des secours inattendus s'introduisaient dans les prisons, et le prêtre que l'on cherchait consolait la victime auprès du bourreau qui ne le reconnaissait pas.
«La morale sous le Directoire eut plutôt à combattre la corruption des mœurs que celle des doctrines; (p. 158) il y eut débordement. On fut jeté dans les plaisirs comme on avait été entassé dans les prisons; on forçait le présent à avancer des joies sur l'avenir, dans la crainte de voir renaître le passé. Chacun, n'ayant pas encore eu le temps de se créer un intérieur, vivait dans la rue, sur les promenades, dans les salons publics. Familiarisé avec les échafauds, et déjà à moitié sorti du monde, on trouvait que cela ne valait pas la peine de rentrer chez soi. Il n'était question que d'arts, de bals, de modes; on changeait de parures et de vêtements aussi facilement qu'on se serait dépouillé de la vie.
«Sous Bonaparte la séduction recommença, mais ce fut une séduction qui portait son remède avec elle: Bonaparte séduisait par un prestige de gloire, et tout ce qui est grand porte en soi un principe de législation. Il concevait qu'il était utile de laisser enseigner la doctrine de tous les peuples, la morale de tous les temps, la religion de toute éternité.
«Je ne serais pas étonné de m'entendre répondre: Fonder la société sur un devoir, c'est l'élever sur une fiction; la placer dans un intérêt, c'est l'établir dans une réalité. Or, c'est précisément le devoir qui est un fait et l'intérêt une fiction. Le devoir qui prend sa source dans la Divinité descend d'abord dans la famille, où il établit des relations réelles entre le père et les enfants; de là, passant à la société et se partageant en deux branches, il règle dans l'ordre politique les rapports du roi et du sujet; il établit dans l'ordre moral la chaîne des services et des protections, des bienfaits et de la reconnaissance.
(p. 159) «C'est donc un fait très positif que le devoir, puisqu'il donne à la société humaine la seule existence durable qu'elle puisse avoir.
«L'intérêt, au contraire, est une fiction quand il est pris, comme on le prend aujourd'hui, dans son sens physique et rigoureux, puisqu'il n'est plus le soir ce qu'il était le matin; puisqu'à chaque instant il change de nature; puisque, fondé sur la fortune, il en a la mobilité.
«Par la morale des intérêts chaque citoyen est en état d'hostilité avec les lois et le gouvernement, puisque, dans la société, c'est toujours le grand nombre qui souffre. On ne se bat point pour des idées abstraites d'ordre, de paix, de patrie; ou si l'on se bat pour elles, c'est qu'on y attache des idées de sacrifices; alors on sort de la morale des intérêts pour rentrer dans celle des devoirs: tant il est vrai que l'on ne peut trouver l'existence de la société hors de cette sainte limite!
«Qui remplit ses devoirs s'attire l'estime; qui cède à ses intérêts est peu estimé: c'était bien du siècle de puiser un principe de gouvernement dans une source de mépris! Élevez les hommes politiques à ne penser qu'à ce qui les touche, et vous verrez comment ils arrangeront l'État; vous n'aurez par là que des ministres corrompus et avides, semblables à ces esclaves mutilés qui gouvernaient le Bas-Empire et qui vendaient tout, se souvenant d'avoir eux-mêmes été vendus.
«Remarquez ceci: les intérêts ne sont puissants que lors même qu'ils prospèrent; le temps est-il rigoureux, ils s'affaiblissent. Les devoirs, au contraire, (p. 160) ne sont jamais si énergiques que quand il en coûte à les remplir. Le temps est-il bon, ils se relâchent. J'aime un principe de gouvernement qui grandit dans le malheur: cela ressemble beaucoup à la vertu.
«Quoi de plus absurde que de crier aux peuples: Ne soyez pas dévoués! n'ayez pas d'enthousiasme! ne songez qu'à vos intérêts! C'est comme si on leur disait: Ne venez pas à notre secours, abandonnez-nous si tel est votre intérêt. Avec cette profonde politique, lorsque l'heure du dévouement arrivera, chacun fermera sa porte, se mettra à la fenêtre et regardera passer la monarchie[111].»
Tel était cet article sur la morale des intérêts et sur la morale des devoirs.
Le 3 décembre 1819, je remontai à la tribune de la Chambre des pairs: je m'élevai contre les mauvais Français qui pouvaient nous donner pour motif de tranquillité la surveillance des armées européennes. «Avions-nous besoin de tuteurs? viendrait-on encore nous entretenir de circonstances? devions-nous encore recevoir, par des notes diplomatiques, des certificats de bonne conduite? et n'aurions-nous fait que changer une garnison de Cosaques en une garnison d'ambassadeurs?»
Dès ce temps-là je parlais des étrangers comme j'en ai parlé depuis dans la guerre d'Espagne; je songeais à notre affranchissement à une heure où les libéraux mêmes me combattaient. Les hommes opposés d'opinion font bien du bruit pour arriver au silence! Laissez venir quelques années, les acteurs descendront (p. 161) de la scène et les spectateurs ne seront plus là pour blâmer ou pour applaudir.
Je venais de me coucher le 13 février au soir, lorsque le marquis de Vibraye[112] entra chez moi pour m'apprendre l'assassinat du duc de Berry. Dans sa précipitation, il ne me dit pas le lieu où s'était passé l'événement. Je me levai à la hâte et je montai dans la voiture de M. de Vibraye. Je fus surpris de voir le cocher prendre la rue de Richelieu, et plus étonné encore quand il nous arrêta à l'Opéra: la foule aux abords était immense. Nous montâmes, au milieu de deux haies de soldats, par la porte latérale à gauche, et, comme nous étions en habits de pairs, on nous laissa passer. Nous arrivâmes à une sorte de petite antichambre: cet espace était encombré de toutes les personnes du château. Je me faufilai jusqu'à la porte d'une loge et je me trouvai face à face de M. le duc d'Orléans. Je fus frappé d'une expression mal déguisée, jubilante, dans ses yeux, à travers la contenance contrite qu'il s'imposait; il voyait de plus près le trône. Mes regards l'embarrassèrent; il quitta la place et me tourna le dos. On racontait autour de moi les détails du forfait, le nom de l'homme, les conjectures des divers participants à l'arrestation; (p. 162) on était agité, affairé: les hommes aiment ce qui est spectacle, surtout la mort, quand cette mort est celle d'un grand. À chaque personne qui sortait du laboratoire ensanglanté, on demandait des nouvelles. On entendait le général A. de Girardin[113] raconter qu'ayant été laissé pour mort sur le champ de bataille, il n'en était pas moins revenu de ses blessures: tel espérait et se consolait, tel s'affligeait. Bientôt le recueillement gagna la foule; le silence se fit; de l'intérieur de la loge sortit un bruit sourd: je tenais l'oreille appliquée contre la porte; je distinguai un râlement; ce bruit cessa: la famille royale venait de recevoir le dernier soupir d'un petit-fils de Louis XIV! J'entrai immédiatement.
Qu'on se figure une salle de spectacle vide, après la catastrophe d'une tragédie: le rideau levé, l'orchestre désert, les lumières éteintes, les machines immobiles, les décorations fixes et enfumées, les comédiens, les chanteurs, les danseuses, disparus par les trappes et les passages secrets!
J'ai donné dans un ouvrage à part la vie et la mort de M. le duc de Berry. Mes réflexions d'alors sont encore vraies aujourd'hui:
«Un fils de saint Louis, dernier rejeton de la branche aînée, échappe aux traverses d'un long exil et (p. 163) revient dans sa patrie; il commence à goûter le bonheur; il se flatte de se voir renaître, de voir renaître en même temps la monarchie dans les enfants que Dieu lui promet: tout à coup il est frappé au milieu de ses espérances, presque dans les bras de sa femme. Il va mourir, et il n'est pas plein de jours! Ne pourrait-il pas accuser le ciel, lui demander pourquoi il le traite avec tant de rigueur? Ah! qu'il lui eût été pardonnable de se plaindre de sa destinée! Car, enfin, quel mal faisait-il? Il vivait familièrement au milieu de nous dans une simplicité parfaite, il se mêlait à nos plaisirs et soulageait nos douleurs; déjà six de ses parents ont péri; pourquoi l'égorger encore, le rechercher, lui, innocent, lui si loin du trône, vingt-sept ans après la mort de Louis XVI? Connaissons mieux le cœur d'un Bourbon! Ce cœur, tout percé du poignard, n'a pu trouver contre nous un seul murmure: pas un regret de la vie, pas une parole amère n'a été prononcée par ce prince. Époux, fils, père et frère, en proie à toutes les angoisses de l'âme, à toutes les souffrances du corps, il ne cesse de demander la grâce de l'homme, qu'il n'appelle pas même son assassin! Le caractère le plus impétueux devient tout à coup le caractère le plus doux. C'est un homme attaché à l'existence par tous les liens du cœur; c'est un prince dans la fleur de l'âge; c'est l'héritier du plus beau royaume de la terre qui expire, et vous diriez que c'est un infortuné qui ne perd rien ici-bas.»
Le meurtrier Louvel était un petit homme à figure sale et chafouine, comme on en voit des milliers sur (p. 164) le pavé de Paris. Il tenait du roquet; il avait l'air hargneux et solitaire. Il est probable que Louvel ne faisait partie d'aucune société; il était d'une secte, non d'un complot; il appartenait à l'une de ces conjurations d'idées, dont les membres se peuvent quelquefois réunir, mais agissent le plus souvent un à un, d'après leur impulsion individuelle. Son cerveau nourrissait une seule pensée, comme un cœur s'abreuve d'une seule passion. Son action était conséquente à ses principes: il avait voulu tuer la race entière d'un seul coup. Louvel a des admirateurs de même que Robespierre. Notre société matérielle, complice de toute entreprise matérielle, a détruit vite la chapelle élevée en expiation d'un crime. Nous avons l'horreur du sentiment moral, parce qu'on y voit l'ennemi et l'accusateur: les larmes auraient paru une récrimination; on avait hâte d'ôter à quelques chrétiens une croix pour pleurer.
Le 18 février 1820, le Conservateur[114] paya le tribut de ses regrets à la mémoire de M. le duc de Berry. L'article se terminait par ce vers de Racine:
Si du sang de nos rois quelque goutte échappée![115]
Hélas! cette goutte de sang s'écoule sur la terre étrangère!
M. Decazes tomba. La censure arriva, et, malgré l'assassinat du duc de Berry, je votai contre elle: ne voulant pas qu'elle souillât le Conservateur, ce journal finit par cette apostrophe au duc de Berry:
(p. 165) «Prince chrétien! digne fils de saint Louis! illustre rejeton de tant de monarques, avant que vous soyez descendu dans cette dernière demeure, recevez notre dernier hommage. Vous aimiez, vous lisiez un ouvrage que la censure va détruire. Vous nous avez dit quelquefois que cet ouvrage sauvait le trône: hélas! nous n'avons pu sauver vos jours! Nous allons cesser d'écrire au moment que vous cessez d'exister: nous aurons la douloureuse consolation d'attacher la fin de nos travaux à la fin de votre vie[116].
M. le duc de Bordeaux vint au monde le 29 septembre 1820. Le nouveau-né fut nommé l'enfant de l'Europe[117] et l'enfant du miracle[118], en attendant qu'il devînt l'enfant de l'exil.
(p. 166) Quelque temps avant les couches de la princesse, trois dames de la halle de Bordeaux, au nom de toutes les dames leurs compagnes, firent faire un berceau et me choisirent pour les présenter, elles et leur berceau, à madame la duchesse de Berry. Mesdames Dasté, Duranton, Aniche[119], m'arrivèrent. Je m'empressai de demander aux gentilshommes de service l'audience d'étiquette. Voilà que M. de Sèze crut qu'un tel honneur lui appartenait de droit: il était dit que je ne réussirais jamais à la cour. Je n'étais pas encore réconcilié avec le ministère, et je ne parus pas digne de la charge d'introducteur de mes humbles ambassadrices. Je me tirai de cette grande négociation comme de coutume, en payant leur dépense.
Tout cela devint une affaire d'État; le cancan passa dans les journaux. Les dames bordelaises en eurent connaissance et m'écrivirent à ce sujet la lettre qui suit:
«Bordeaux, le 24 octobre 1820.
«Monsieur le vicomte,
«Nous vous devons des remercîments pour la bonté que vous avez eue de mettre aux pieds de madame la duchesse de Berry notre joie et nos respects: pour cette fois du moins on ne vous aura (p. 167) pas empêché d'être notre interprète. Nous avons appris avec la plus grande peine l'éclat que M. le comte de Sèze a fait dans les journaux; et si nous avons gardé le silence, c'est parce que nous avons craint de vous faire de la peine. Cependant, monsieur le vicomte, personne ne peut mieux que vous rendre hommage à la vérité et tirer d'erreur M. de Sèze sur nos véritables intentions pour le choix d'un introducteur chez son Altesse Royale. Nous vous offrons de déclarer dans un journal à votre choix tout ce qui s'est passé; et comme personne n'avait le droit de nous choisir un guide, que jusqu'au dernier moment nous nous étions flattées que vous seriez ce guide, ce que nous déclarerons à cet égard ferait nécessairement taire tout le monde.
«Voilà à quoi nous sommes décidées, monsieur le vicomte; mais nous avons cru qu'il était de notre devoir de ne rien faire sans votre agrément. Comptez que ce serait de grand cœur que nous publierions les bons procédés que vous avez eus pour tout le monde au sujet de notre présentation. Si nous sommes la cause du mal, nous voilà prêtes à le réparer.
«Nous sommes et nous serons toujours de vous,
«Monsieur le vicomte,
«Les très-humbles et très-respectueuses servantes,
«Femmes Dasté, Duranton, Aniche.»
(p. 168) Je répondis à ces généreuses dames qui ressemblaient si peu aux grandes dames:
«Je vous remercie bien, mes chères dames, de l'offre que vous me faites de publier dans un journal tout ce qui s'est passé relativement à M. de Sèze. Vous êtes d'excellentes royalistes, et moi aussi je suis un bon royaliste: nous devons nous souvenir avant tout que M. de Sèze est un homme respectable, et qu'il a été le défenseur de notre roi. Cette belle action n'est point effacée par un petit mouvement de vanité. Ainsi gardons le silence: il me suffit de votre bon témoignage auprès de vos amis. Je vous ai déjà remerciées de vos excellents fruits: madame de Chateaubriand et moi nous mangeons tous les jours vos marrons en parlant de vous.
«À présent permettez à votre hôte de vous embrasser. Ma femme vous dit mille choses, et moi je suis
«Votre serviteur et ami,
«Chateaubriand.
«Paris, 2 novembre 1820.»
Mais qui pense aujourd'hui à ces futiles débats? Les joies et les fêtes du baptême sont loin derrière nous. Quand Henri naquit, le jour de Saint-Michel, ne disait-on pas que l'archange allait mettre le dragon sous ses pieds? Il est à craindre, au contraire, que l'épée flamboyante n'ait été tirée du fourreau que pour faire sortir l'innocent du paradis terrestre, et pour en garder contre lui les portes.
(p. 169) Cependant, les événements qui se compliquaient ne décidaient rien encore. L'assassinat de M. le duc de Berry avait amené la chute de M. Decazes[120], qui ne se fit pas sans déchirements. M. le duc de Richelieu ne consentit à affliger son vieux maître que sur une promesse de M. Molé[121] de donner à M. Decazes une mission lointaine. Il partit pour l'ambassade de Londres où je devais le remplacer[122]. Rien n'était fini. M. de Villèle restait à l'écart avec sa fatalité, M. de Corbière. J'offrais de mon côté un grand obstacle. Madame de Montcalm[123] ne cessait de m'engager à la paix: j'y étais très disposé, ne voulant sincèrement que sortir des affaires qui m'envahissaient, et pour lesquelles j'avais un souverain mépris. M. de Villèle, quoique plus souple, n'était pas alors facile à manier.
Il y a deux manières de devenir ministre: l'une brusquement et par force, l'autre par longueur de temps et par adresse; la première n'était point à l'usage de M. de Villèle: le cauteleux exclut l'énergique, mais il est plus sûr et moins exposé à perdre (p. 170) la place qu'il a gagnée. L'essentiel dans cette manière d'arriver est d'agréer maints soufflets et de savoir avaler une quantité de couleuvres: M. de Talleyrand faisait grand usage de ce régime des ambitions de seconde espèce. En général, on parvient aux affaires par ce que l'on a de médiocre, et l'on y reste par ce que l'on a de supérieur. Cette réunion d'éléments antagonistes est la chose la plus rare, et c'est pour cela qu'il y a si peu d'hommes d'État.
M. de Villèle avait précisément le terre à terre des qualités par lesquelles le chemin lui était ouvert: il laissait faire du bruit autour de lui, pour recueillir le fruit de l'épouvante qui s'emparait de la cour. Parfois il prononçait des discours belliqueux, mais où quelques phrases laissaient luire l'espérance d'une nature abordable. Je pensais qu'un homme de son espèce devait commencer par entrer dans les affaires, n'importe comment, et dans une place non trop effrayante. Il me semblait qu'il lui fallait être d'abord ministre sans portefeuille, afin d'obtenir un jour la présidence même du ministère. Cela lui donnerait un renom de modération, il serait vêtu parfaitement à son air; il deviendrait évident que le chef parlementaire de l'opposition royaliste n'était pas un ambitieux, puisqu'il consentait pour le bien de la paix à se faire si petit. Tout homme qui a été ministre, n'importe à quel titre, le redevient: un premier ministère est l'échelon du second; il reste sur l'individu qui a porté l'habit brodé une odeur de portefeuille qui le fait retrouver tôt ou tard par les bureaux.
Madame de Montcalm m'avait dit de la part de son frère qu'il n'y avait plus de ministère vacant; mais (p. 171) que si mes deux amis voulaient entrer au conseil comme ministres d'État sans portefeuille, le roi en serait charmé, promettant mieux pour la suite. Elle ajoutait que si je consentais à m'éloigner, je serais envoyé à Berlin. Je lui répondis qu'à cela ne tenait; que quant à moi j'étais toujours prêt à partir et que j'irais chez le diable, dans le cas que les rois eussent quelque mission à remplir auprès de leur cousin; mais que je n'acceptais pourtant un exil que si M. de Villèle acceptait son entrée au conseil. J'aurais voulu aussi placer M. Lainé auprès de mes deux amis. Je me chargeai de la triple négociation. J'étais devenu le maître de la France politique par mes propres forces. On ne se doute guère que c'est moi qui ai fait le premier ministère de M. de Villèle et qui ai poussé le maire de Toulouse dans la carrière.
Je trouvai dans le caractère de M. Lainé une obstination invincible. M. de Corbière ne voulait pas une simple entrée au conseil; je le flattai de l'espoir qu'on y joindrait l'instruction publique. M. de Villèle, ne se prêtant qu'avec répugnance à ce que je désirais, me fit d'abord mille objections; son bon esprit et son ambition le décidèrent enfin à marcher en avant: tout fut arrangé. Voici les preuves irrécusables de ce que je viens de raconter; documents fastidieux de ces petits faits justement passés à l'oubli, mais utiles à ma propre histoire:
(p. 172) «20 décembre[124], trois heures et demie.
«À M. LE DUC DE RICHELIEU.
«J'ai eu l'honneur de passer chez vous, monsieur le duc, pour vous rendre compte de l'état des choses: tout va à merveille. J'ai vu les deux amis: Villèle consent enfin à entrer ministre secrétaire d'État au conseil, sans portefeuille, si Corbière consent à entrer au même titre, avec la direction de l'instruction publique. Corbière, de son côté, veut bien entrer à ces conditions, moyennant l'approbation de Villèle. Ainsi, il n'y a plus de difficultés. Achevez votre ouvrage, monsieur le duc; voyez les deux amis; et quand vous aurez entendu ce que je vous écris, de leur propre bouche, vous rendrez à la France la paix intérieure, comme vous lui avez donné la paix avec les étrangers.
«Permettez-moi de vous soumettre encore une idée: trouveriez-vous un grand inconvénient à remettre à Villèle la direction vacante par la retraite de M. de Barante[125]? il serait alors placé dans une position plus égale avec son ami. Toutefois, il m'a positivement dit qu'il consentirait à entrer au conseil sans portefeuille, si Corbière avait l'instruction publique. Je ne dis ceci que comme un moyen de plus de satisfaire complètement les royalistes, et (p. 173) de vous assurer une majorité immense et inébranlable.
«J'aurai enfin l'honneur de vous faire observer que, c'est demain au soir qu'a lieu chez Piet la grande réunion royaliste, et qu'il serait bien utile que les deux amis pussent demain au soir dire quelque chose qui calmât toutes les effervescences et empêchât toutes les divisions.
«Comme je suis, monsieur le duc, hors de tout ce mouvement, vous ne verrez, j'espère, dans mon empressement que la loyauté d'un homme qui désire le bien de son pays et vos succès.
«Agréez, je vous prie, monsieur le duc, l'assurance de ma haute considération.
«Chateaubriand.»
«Mercredi[126]
«Je viens d'écrire à MM. de Villèle et de Corbière, monsieur, et je les engage à passer ce soir chez moi, car dans une œuvre aussi utile il ne faut pas perdre un moment. Je vous remercie d'avoir fait marcher l'affaire aussi vite; j'espère que nous arriverons à une heureuse conclusion. Soyez persuadé, monsieur, du plaisir que j'ai à vous avoir cette obligation, et recevez l'assurance de ma haute considération.
«Richelieu.»
«Permettez-moi, monsieur le duc, de vous féliciter de l'heureuse issue de cette grande affaire, et de (p. 174) m'applaudir d'y avoir eu quelque part. Il est bien à désirer que les ordonnances paraissent demain: elles feront cesser toutes les oppositions. Sous ce rapport je puis être utile aux deux amis.
«J'ai l'honneur, monsieur le duc, de vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
«Chateaubriand.»
«Vendredi.
«J'ai reçu avec un extrême plaisir le billet que M. le vicomte de Chateaubriand m'a fait l'honneur de m'écrire. Je crois qu'il n'aura pas à se repentir de s'en être rapporté à la bonté du Roi, et s'il me permet d'ajouter au désir que j'ai de contribuer à ce qui pourra lui être agréable. Je le prie de recevoir l'assurance de ma haute considération.
«Richelieu.»
«Ce jeudi.
«Vous savez sans doute, mon noble collègue, que l'affaire a été conclue hier soir à onze heures, et que tout s'est arrangé sur les bases convenues entre vous et le duc de Richelieu. Votre intervention nous a été fort utile: grâces vous soient rendues pour cet acheminement vers un mieux qu'on doit désormais regarder comme probable.
«Tout à vous pour la vie,
«J. De Polignac.»
(p. 175) «Paris, mercredi 20 décembre, onze heures et demie du soir.
«Je viens de passer chez vous qui étiez retiré, noble vicomte: j'arrive de chez Villèle qui lui-même est rentré tard de la conférence que vous lui aviez préparée et annoncée. Il m'a chargé, comme votre plus proche voisin, de vous faire savoir ce que Corbière voulait aussi vous mander de son côté, que l'affaire que vous avez réellement conduite et ménagée dans la journée est décidément finie de la manière la plus simple et la plus abrégée: lui sans portefeuille, son ami avec l'instruction. Il paraissait croire qu'on aurait pu attendre un peu plus, et obtenir d'autres conditions; mais il ne convenait pas de dédire un interprète, un négociateur tel que vous. C'est vous réellement qui leur avez ouvert l'entrée de cette nouvelle carrière: ils comptent sur vous pour la leur aplanir. De votre côté, pendant le peu de temps que nous aurons encore l'avantage de vous conserver parmi nous, parlez à vos amis les plus vifs dans le sens de seconder ou du moins de ne pas combattre les projets d'union. Bonsoir. Je vous fais encore mon compliment de la promptitude avec laquelle vous menez les négociations. Vous arrangerez ainsi l'Allemagne pour revenir plus tôt au milieu de vos amis. Je suis charmé, pour mon compte, de ce qu'il y a de simplifié dans votre position.
«Je vous renouvelle tous mes sentiments.
«M. de Montmorency.»
(p. 176) «Voici, monsieur, une demande adressée par un garde du corps du roi au roi de Prusse: elle m'est remise et recommandée par un officier supérieur des gardes. Je vous prie donc de l'emporter avec vous et d'en faire usage, si vous croyez, quand vous aurez un peu examiné le terrain à Berlin[127], qu'elle est de nature à obtenir quelque succès.
«Je saisis avec grand plaisir cette occasion de me féliciter avec vous du Moniteur de ce matin[128], et de vous remercier de la part que vous avez eue à cette heureuse issue qui, je l'espère, aura sur les affaires de notre France la plus heureuse influence.
(p. 177) «Veuillez recevoir l'assurance de ma haute considération et de mon sincère attachement.
«Pasquier.»
Cette suite de billets montre assez que je ne me vante pas; cela m'ennuierait trop d'être la mouche du coche; le timon ou le nez du cocher ne sont pas des places où j'aie jamais eu l'ambition de m'asseoir: que le coche arrive au haut ou roule en bas, point ne m'en chaut. Accoutumé à vivre caché dans mes propres replis, ou momentanément dans la large vie des siècles, je n'avais aucun goût aux mystères d'antichambre. J'entre mal dans la circulation en pièce de monnaie courante; pour me sauver, je me retire auprès de Dieu; une idée fixe qui vient du ciel vous isole et fait tout mourir autour de vous.[Lien vers la Table des Matières]
Année de ma vie 1821. — Ambassade de Berlin. — Arrivée à Berlin. — M. Ancillon. — Famille royale. — Fêtes pour le mariage du grand-duc Nicolas. — Société de Berlin. — Le comte de Humboldt. — M. de Chamisso. — Ministres et ambassadeurs. — La princesse Guillaume. — L'Opéra. — Réunion musicale. — Mes premières dépêches. — M. de Bonnay. — Le Parc. — La duchesse de Cumberland. — Mémoire commencé sur l'Allemagne. — Charlottenbourg. — Intervalle entre l'ambassade de Berlin et l'ambassade de Londres. — Baptême de M. le duc de Bordeaux. — Lettre à M. Pasquier. — Lettre de M. de Bernstorff. — Lettre de M. Ancillon. — Dernière lettre de Madame la duchesse de Cumberland. — M. de Villèle, ministre des finances. — Je suis nommé à l'ambassade de Londres.
Je quittai la France, laissant mes amis en possession d'une autorité que je leur avais achetée au prix de mon absence: j'étais un petit Lycurgue[130]. Ce qu'il y avait de bon, c'est que le premier essai que j'avais fait de ma force politique me rendait ma liberté; j'allais jouir au dehors de cette liberté dans le pouvoir. Au fond de cette position nouvelle à ma personne, j'aperçois je ne sais quels romans confus parmi des réalités: n'y avait-il rien dans les cours? N'étaient-elles point des solitudes d'une autre sorte? C'étaient peut-être des Champs-Élysées avec leurs ombres.
(p. 180) Je partis de Paris le 1er janvier 1821: la Seine était gelée, et pour la première fois je courais sur les chemins avec les conforts de l'argent. Je revenais peu à peu de mon mépris des richesses; je commençais à sentir qu'il était assez doux de rouler dans une bonne voiture, d'être bien servi, de n'avoir à se mêler de rien, d'être devancé par un énorme chasseur de Varsovie, toujours affamé, et qui, au défaut des czars, aurait à lui seul dévoré la Pologne[131]. Mais je m'habituai vite à mon bonheur; j'avais le pressentiment qu'il durerait peu, et que je serais bientôt remis à pied comme il était convenable. Avant d'être arrivé à ma destination, il ne me resta du voyage que mon goût primitif pour le voyage même; goût d'indépendance,—satisfaction d'avoir rompu les attaches de la société.
Vous verrez, lorsque je reviendrai de Prague en 1833, ce que je dis de mes vieux souvenirs du Rhin: je fus obligé, à cause des glaces, de remonter ses rives et de le traverser au-dessus de Mayence[132]. Je ne (p. 181) m'occupai guère de Moguntia, de son archevêque, de ses trois ou quatre sièges, et de l'imprimerie[133] par qui cependant je régnais. Francfort, cité de Juifs, ne m'arrêta que pour une de leurs affaires: un change de monnaie.
La route fut triste: le grand chemin était neigeux et le givre appendu aux branches des pins. Iéna m'apparut de loin avec les larves de sa double bataille[134]. (p. 182) Je traversai Erfurt et Weimar: dans Erfurt, l'empereur manquait; dans Weimar, habitait Gœthe que j'avais tant admiré, et que j'admire beaucoup moins. Le chantre de la matière vivait, et sa vieille poussière se modelait encore autour de son génie. J'aurais pu voir Gœthe, et je ne l'ai point vu; il laisse un vide dans la procession des personnages célèbres qui ont défilé sous mes yeux.
Le tombeau de Luther à Wittemberg ne me tenta point: le protestantisme n'est en religion qu'une hérésie illogique; en politique, qu'une révolution avortée. Après avoir mangé, en passant l'Elbe, un petit pain noir pétri à la vapeur du tabac, j'aurais eu besoin de boire dans le grand verre de Luther, conservé comme une relique. De là, traversant Potsdam et franchissant la Sprée, rivière d'encre sur laquelle se traînent des barques gardées par un chien blanc, j'arrivai à Berlin. Là demeura, comme je l'ai dit, le faux Julien dans sa fausse Athènes. Je cherchai en vain le soleil du mont Hymette. J'ai écrit à Berlin le quatrième livre de ces Mémoires. Vous y avez trouvé la description de cette ville, ma course à Potsdam, mes souvenirs du grand Frédéric, de son cheval, de ses levrettes et de Voltaire.
Descendu le 11 janvier à l'auberge, j'allai demeurer ensuite Sous les Tilleuls, dans l'hôtel qu'avait quitté M. le marquis de Bonnay, et qui appartenait à madame la duchesse de Dino: j'y fus reçu par MM. de Caux, de Flavigny et de Cussy[135], secrétaires de la légation.
(p. 183) Le 17 de janvier, j'eus l'honneur de présenter au roi les lettres de récréance de M. le marquis de Bonnay et mes lettres de créance. Le roi, logé dans une simple maison, avait pour toute distinction deux sentinelles à sa porte: entrait qui voulait; on lui parlait s'il était chez lui. Cette simplicité des princes allemands contribue à rendre moins sensibles aux petits le nom et les prérogatives des grands. Frédéric-Guillaume[136] allait chaque jour, à la même heure, dans une carriole découverte qu'il conduisait lui-même, casquette en tête, manteau grisâtre sur le dos, fumer son cigare dans le parc. Je le rencontrais souvent et nous continuions nos promenades, chacun de notre côté. Quand il rentrait dans Berlin, la sentinelle de la porte de Brandebourg criait à tue-tête; la garde prenait les armes et sortait; le roi passait, tout était fini.
Dans la même journée, je fis ma cour au prince royal et aux princes ses frères, jeunes militaires fort (p. 184) gais. Je vis le grand-duc Nicolas et la grande-duchesse, nouvellement mariés et auxquels on donnait des fêtes. Je vis aussi le duc et la duchesse de Cumberland[137], le prince Guillaume[138], frère du roi, le prince Auguste de Prusse[139], longtemps notre prisonnier: il avait voulu épouser madame Récamier; il possédait l'admirable portrait que Gérard avait fait d'elle et qu'elle avait échangé avec le prince pour le tableau de Corinne.
Je m'étais empressé de chercher M. Ancillon[140]. Nous nous connaissions mutuellement par nos ouvrages. Je l'avais rencontré à Paris avec le prince royal son (p. 185) élève[141]; il était chargé à Berlin, par intérim, du portefeuille des affaires étrangères pendant l'absence de M. le comte de Bernstorff. Sa vie était très touchante: sa femme avait perdu la vue: toutes les portes de sa maison étaient ouvertes; la pauvre aveugle se promenait de chambre en chambre parmi des fleurs, et se reposait au hasard comme un rossignol en cage: elle chantait bien et mourut tôt.
M. Ancillon, de même que beaucoup d'hommes illustres de la Prusse, était d'origine française: ministre protestant, ses opinions avaient d'abord été très libérales; peu à peu il se refroidit. Quand je le retrouvai à Rome en 1828, il était revenu à la monarchie tempérée et il a rétrogradé jusqu'à la monarchie absolue. Avec un amour éclairé des sentiments généreux, il avait la haine et la peur des révolutionnaires: c'est cette haine qui l'a poussé vers le despotisme, afin d'y demander abri. Ceux qui vantent encore 1793 et qui en admirent les crimes ne comprendront-ils jamais combien l'horreur dont on est saisi pour ces crimes est un obstacle à l'établissement de la liberté?
Il y eut une fête à la cour, et là commencèrent pour moi des honneurs dont j'étais bien peu digne. Jean Bart avait mis pour aller à Versailles un habit de drap d'or doublé de drap d'argent, ce qui le gênait beaucoup. La grande-duchesse, aujourd'hui l'impératrice de Russie, et la duchesse de Cumberland choisirent mon bras dans une marche polonaise: mes romans du monde commençaient. L'air de la marche (p. 186) était une espèce de pot-pourri composé de plusieurs morceaux, parmi lesquels, à ma grande satisfaction, je reconnus la chanson du roi Dagobert: cela m'encouragea et vint au secours de ma timidité. Ces fêtes se répétèrent; une d'elles surtout eut lieu dans le grand palais du roi. Ne voulant pas en prendre le récit sur mon compte, je le donne tel qu'il est consigné dans le Morgenblatt de Berlin par madame la baronne de Hohenhausen:
«Berlin, le 22 mars 1821.
«Morgenblatt (Feuille du matin), no 70.
«Un des personnages remarquables qui assistaient à cette fête était le vicomte de Chateaubriand, ministre de France, et, quelle que fût la splendeur du spectacle qui se développait à leurs yeux, les belles Berlinoises avaient encore des regards pour l'auteur d'Atala, ce superbe et mélancolique roman, où l'amour le plus ardent succombe dans le combat contre la religion. La mort d'Atala et l'heure du bonheur de Chactas, pendant un orage dans les antiques forêts de l'Amérique, dépeint avec les couleurs de Milton, resteront à jamais gravées dans la mémoire de tous les lecteurs de ce roman. M. de Chateaubriand écrivit Atala dans sa jeunesse péniblement éprouvée par l'exil de sa patrie: de là cette profonde mélancolie et cette passion brûlante qui respirent dans l'ouvrage entier. À présent, cet homme d'État consommé a voué uniquement sa plume à la politique. Son dernier ouvrage, la Vie et la Mort du duc de Berry, est tout à fait écrit (p. 187) dans le ton qu'employaient les panégyristes de Louis XIV.
«M. de Chateaubriand est d'une taille assez petite, et pourtant élancée. Son visage ovale a une expression de piété et de mélancolie. Il a les cheveux et les yeux noirs: ceux-ci brillent du feu de son esprit qui se prononce dans ses traits.»
Mais j'ai les cheveux blancs: pardonnez donc à madame la baronne de Hohenhausen de m'avoir croqué dans mon bon temps, bien qu'elle m'octroie déjà des années. Le portrait est d'ailleurs fort joli; mais je dois à ma sincérité de dire qu'il n'est pas ressemblant.
L'hôtel Sous les Tilleuls, Unter den Linden, était beaucoup trop grand pour moi, froid et délabré: je n'en occupais qu'une petite partie.
Parmi mes collègues, ministres et ambassadeurs, le seul remarquable était M. d'Alopeus.[142] J'ai depuis rencontré sa femme et sa fille à Rome auprès de la grande-duchesse Hélène: si celle-ci eût été à Berlin (p. 188) au lieu de la grande-duchesse Nicolas, sa belle-sœur, j'aurais été plus heureux.
M. d'Alopeus, mon collègue, avait la douce manie de se croire adoré. Il était persécuté par les passions qu'il inspirait: «Ma foi, disait-il, je ne sais ce que j'ai; partout où je vais, les femmes me suivent. Madame d'Alopeus s'est attachée obstinément à moi.» Il eût été excellent saint-simonien. La société privée, comme la société publique, a son allure: dans la première, ce sont toujours des attachements formés et rompus, des affaires de famille, des morts, des naissances, des chagrins et des plaisirs particuliers; le tout varié d'apparences selon les siècles. Dans l'autre, ce sont toujours des changements de ministres, des batailles perdues ou gagnées, des négociations avec les cours, des rois qui s'en vont, ou des royaumes qui tombent.
Sous Frédéric II, électeur de Brandebourg, surnommé Dent de Fer; sous Joachim II, empoisonné par le Juif Lippold; sous Jean Sigismond, qui réunit à son électorat le duché de Prusse; sous Georges-Guillaume, l'Irrésolu, qui, perdant ses forteresses, laissait Gustave-Adolphe s'entretenir avec les dames de sa cour et disait: «Que faire? ils ont des canons;» sous le Grand-Électeur, qui ne rencontra dans ses États que des monceaux de cendres, lesquels empêchaient l'herbe de croître, qui donna audience à l'ambassadeur tartare dont l'interprète avait un nez de bois et les oreilles coupées; sous son fils, premier roi de Prusse, qui, réveillé en sursaut par sa femme, prit la fièvre de peur et en mourut; sous tous ces règnes, les divers mémoires ne laissent voir que (p. 189) la répétition des mêmes aventures dans la société privée.
Frédéric-Guillaume Ier, père du grand Frédéric, homme dur et bizarre, fut élevé par madame de Rocoules, la réfugiée: il aima une jeune femme qui ne put l'adoucir; son salon fut une tabagie. Il nomma le bouffon Gundling président de l'Académie royale de Berlin; il fit enfermer son fils dans la citadelle de Custrin, et Quatt eut la tête tranchée devant le jeune prince; c'était la vie privée de ce temps. Le grand Frédéric, monté sur le trône, eut une intrigue avec une danseuse italienne, la Barbarini, seule femme dont il s'approcha jamais: il se contenta de jouer de la flûte la première nuit de ses noces sous la fenêtre de la princesse Élisabeth de Brunswick lorsqu'il l'épousa. Frédéric avait le goût de la musique et la manie des vers. Les intrigues et les épigrammes des deux poètes, Frédéric et Voltaire, troublèrent madame de Pompadour, l'abbé de Bernis et Louis XV. La margrave de Bayreuth[143] était mêlée dans tout cela avec de l'amour, comme en pouvait avoir un poète. Des cercles littéraires chez le roi, puis des chiens sur des fauteuils malpropres; puis des concerts devant des statues d'Antinoüs; puis des grands dîners; puis beaucoup de philosophie; puis la liberté de la presse (p. 190) et des coups de bâton; puis enfin un homard ou un pâté d'anguille qui mit fin aux jours d'un vieux grand homme, lequel voulait vivre: voilà de quoi s'occupa la société privée de ce temps de lettres et de batailles.—Et, nonobstant, Frédéric a renouvelé l'Allemagne, établi un contre-poids à l'Autriche, et changé tous les rapports et tous les intérêts politiques de la Germanie.
Dans les nouveaux règnes nous trouvons le Palais de marbre, madame Rietz[144] avec son fils, Alexandre, comte de La Marche, la Baronne de Stoltzenberg, maîtresse du margrave Schwed, autrefois comédienne, le prince Henri[145] et ses amis suspects, mademoiselle Voss, rivale de madame Rietz, une intrigue de bal masqué entre un jeune Français et la femme d'un général prussien, enfin madame de F..., dont on peut lire l'aventure dans l'Histoire secrète de la cour de Berlin[146]: qui sait tous ces noms? qui se rappellera les nôtres? Aujourd'hui, dans la capitale de la Prusse, c'est à peine si des octogénaires ont conservé la mémoire de cette génération passée.
(p. 191) La société à Berlin me convenait par ses habitudes: entre cinq et six heures on allait en soirée; tout était fini à neuf, et je me couchais tout juste comme si je n'eusse pas été ambassadeur. Le sommeil dévore l'existence, c'est ce qu'il y a de bon: «Les heures sont longues, et la vie est courte,» dit Fénelon. M. Guillaume de Humboldt[147], frère de mon illustre ami le baron Alexandre[148], était à Berlin: je l'avais connu ministre à Rome; suspect au gouvernement à cause de ses opinions, il menait une vie retirée; pour tuer le temps, il apprenait toutes les langues et même tous les patois de la terre. Il retrouvait les peuples, habitants anciens d'un sol, par les dénominations géographiques du pays. Une de ses filles parlait indifféremment le grec ancien ou le grec moderne; si l'on fût tombé dans un bon jour, on aurait pu deviser à table en sanscrit.
Adelbert de Chamisso[149] demeurait au Jardin-des-Plantes, (p. 192) à quelque distance de Berlin. Je le visitai dans cette solitude, où les plantes gelaient en serre. Il était grand, d'une figure assez agréable. Je me sentais un attrait pour cet exilé, voyageur comme moi: il avait vu ces mers du pôle où je m'étais flatté de pénétrer. Émigré comme moi, il avait été élevé à Berlin en qualité de page. Adelbert, parcourant la Suisse, s'arrêta un moment à Coppet. Il se trouva dans une partie sur le lac, où il pensa périr. Il écrivait ce jour-là même: «Je vois bien qu'il faut chercher mon salut sur les grandes mers.»
M. de Chamisso avait été nommé par M. de Fontanes, professeur à Napoléonville[150]; puis professeur de grec à Strasbourg; il repoussa l'offre par ces nobles paroles: «La première condition pour travailler à l'instruction de la jeunesse est l'indépendance: bien que j'admire le génie de Bonaparte, il ne peut me convenir.» Il refusa de même les avantages que lui offrait la Restauration: «Je n'ai rien fait (p. 193) pour les Bourbons, disait-il, et je ne puis recevoir le prix des services et du sang de mes pères. Dans ce siècle, chaque homme doit pourvoir à son existence.» On conserve dans la famille de M. de Chamisso ce billet écrit au Temple, de la main de Louis XVI: «Je recommande M. de Chamisso, un de mes fidèles serviteurs, à mes frères.» Le roi martyr avait caché ce petit billet dans son sein pour le faire remettre à son premier page, Chamisso, oncle d'Adelbert[151].
L'ouvrage le plus touchant peut-être de cet enfant des muses, caché sous les armes étrangères et adopté des bardes de la Germanie, ce sont ces vers qu'il fit d'abord en allemand et qu'il traduisit en vers français, sur le château de Boncourt, sa demeure paternelle:
Je rêve encore à mon jeune âge
Sous le poids de mes cheveux blancs;
Tu me poursuis, fidèle image,
Et renais sous la faux du Temps.
Du sein d'une mer de verdure
S'élève ce noble château.
Je reconnais et sa toiture,
Et ses tours avec ses créneaux;
(p. 194) Ces lions de nos armoiries
Ont encor leurs regards d'amour.
Je vous souris, gardes chéries,
Et je m'élance dans la cour.
Voilà le sphinx à la fontaine,
Voilà le figuier verdoyant;
Là s'épanouit l'ombre vaine
Des premiers songes de l'enfant.
De mon aïeul, dans la chapelle,
Je cherche et revois le tombeau;
Voilà la colonne à laquelle
Pendent ses armes en faisceau.
Ce marbre que le soleil dore,
Et ces caractères pieux,
Non, je ne puis les lire encore,
Un voile humide est sur mes yeux.
Fidèle château de mes pères,
Je te retrouve tout en moi!
Tu n'es plus; superbe naguères,
La charrue a passé sur toi!.....
Sol que je chéris, sois fertile,
Je te bénis d'un cœur serein;
Bénis, quel qu'il soit, l'homme utile
Dont le soc sillonne ton sein.
Chamisso bénit le laboureur qui laboure le sillon dont il a été dépouillé; son âme devait habiter les régions où planait mon ami Joubert. Je regrette Combourg, mais avec moins de résignation, bien qu'il ne soit pas sorti de ma famille. Embarqué sur le vaisseau armé par le comte de Romanzof, M. de Chamisso découvrit, avec le capitaine Kotzebue, le détroit à l'est du détroit de Behring, et donna son nom à l'une des îles d'où Cook avait entrevu la côte de l'Amérique. Il (p. 195) retrouva au Kamtchatka le portrait de madame Récamier sur porcelaine,[152] et le petit conte Peter Schlemihl, traduit en hollandais. Le héros d'Adelbert, Peter Schlemihl, avait vendu son ombre au diable: j'aurais mieux aimé lui vendre mon corps.
Je me souviens de Chamisso comme du souffle insensible qui faisait légèrement fléchir la tige des brandes que je traversai en retournant à Berlin.
D'après un règlement de Frédéric II, les princes et princesses du sang à Berlin ne voient pas le corps diplomatique; mais, grâce au carnaval, au mariage du duc de Cumberland avec la princesse Frédérique de Prusse, sœur de la feue reine, grâce encore à une certaine inflexion d'étiquette que l'on se permettait, disait-on, à cause de ma personne, j'avais l'occasion de me trouver plus souvent que mes collègues avec la famille royale. Comme je visitais de fois à autre le grand palais, j'y rencontrais la princesse Guillaume[153]: elle se plaisait à me conduire dans les appartements. Je n'ai jamais vu un regard plus triste que le sien; dans les salons inhabités derrière le château, sur la (p. 196) Sprée, elle me montrait une chambre hantée à certains jours par une dame blanche, et, en se serrant contre moi avec une certaine frayeur, elle avait l'air de cette dame blanche. De son côté, la duchesse de Cumberland me racontait qu'elle et sa sœur la reine de Prusse, toutes deux encore très jeunes, avaient entendu leur mère qui venait de mourir leur parler sous ses rideaux fermés.
Le roi, en présence duquel je tombais en sortant de mes visites de curieux, me menait à ses oratoires: il m'en faisait remarquer les crucifix et les tableaux, et rapportait à moi l'honneur de ces innovations, parce qu'ayant lu, me disait-il, dans le Génie du Christianisme, que les protestants avaient trop dépouillé leur culte, il avait trouvé juste ma remarque: il n'était pas encore arrivé à l'excès de son fanatisme luthérien.
Le soir à l'Opéra j'avais une loge auprès de la loge royale, placée en face du théâtre. Je causais avec les princesses; le roi sortait dans les entr'actes; je le rencontrais dans le corridor, il regardait si personne n'était autour de nous et si l'on ne pouvait nous entendre; il m'avouait alors tout bas sa détestation de Rossini et son amour pour Gluck. Il s'étendait en lamentations sur la décadence de l'art et surtout sur ces gargarismes de notes destructeurs du chant dramatique: il me confiait qu'il n'osait dire cela qu'à moi, à cause des personnes qui l'environnaient. Voyait-il venir quelqu'un, il se hâtait de rentrer dans sa loge.
Je vis jouer la Jeanne d'Arc de Schiller: la cathédrale de Reims était parfaitement imitée[154]. Le roi, (p. 197) sérieusement religieux, ne supportait qu'avec peine sur le théâtre la représentation du culte catholique. M. Spontini, l'auteur de la Vestale, avait la direction de l'Opéra[155]. Madame Spontini, fille de M. Érard[156], était agréable, mais elle semblait expier la volubilité du langage des femmes par la lenteur qu'elle mettait à parler: chaque mot divisé en syllabes expirait sur ses lèvres; si elle avait voulu vous dire: Je vous aime, l'amour d'un Français aurait pu s'envoler entre le commencement et la fin de ces trois mots. Elle ne pouvait pas finir mon nom, et elle n'arrivait pas au bout sans une certaine grâce.
Une réunion publique musicale avait lieu deux ou trois fois la semaine. Le soir, en revenant de leur ouvrage, de petites ouvrières, leur panier au bras, des garçons ouvriers portant les instruments de leurs (p. 198) métiers, se pressaient pêle-mêle dans une salle; on leur donnait en entrant un feuillet noté, et ils se joignaient au chœur général avec une précision étonnante. C'était quelque chose de surprenant que ces deux ou trois cents voix confondues. Le morceau fini, chacun reprenait le chemin de sa demeure. Nous sommes bien loin de ce sentiment de l'harmonie, moyen puissant de civilisation; il a introduit dans la chaumière des paysans de l'Allemagne une éducation qui manque à nos hommes rustiques: partout où il y a un piano, il n'y a plus de grossièreté.
Vers le 13 de janvier, j'ouvris le cours de mes dépêches avec le ministre des affaires étrangères. Mon esprit se plie facilement à ce genre de travail: pourquoi pas? Dante, Arioste et Milton n'ont-ils pas aussi bien réussi en politique qu'en poésie? Je ne suis sans doute ni Dante, ni Arioste, ni Milton; l'Europe et la France ont vu néanmoins par le Congrès de Vérone ce que je pourrais faire.
Mon prédécesseur à Berlin me traitait en 1816 comme il traitait M. de Lameth dans ses petits vers au commencement de la révolution[157]. Quand on est si aimable, il ne faut pas laisser derrière soi de registres, ni avoir la rectitude d'un commis quand on n'a (p. 199) pas la capacité d'un diplomate. Il arrive, dans les temps où nous vivons, qu'un coup de vent envoie dans votre place celui contre lequel vous vous étiez élevé; et comme le devoir d'un ambassadeur est d'abord de connaître les archives de l'ambassade, voilà qu'il tombe sur les notes où il est arrangé de main de maître. Que voulez-vous? ces esprits profonds, qui travaillaient au succès de la bonne cause, ne pouvaient pas penser à tout.
EXTRAITS DES REGISTRES DE M. DE BONNAY.
No 64. 22 novembre 1816.
«Les paroles que le roi a adressées au bureau nouvellement formé de la Chambre des pairs ont été connues et approuvées de toute l'Europe. On m'a demandé s'il était possible que des hommes dévoués au roi, que des personnes attachées à sa personne et occupant des places dans sa maison, ou dans celles de nos princes, eussent pu en effet donner leurs suffrages pour porter M. de Chateaubriand à la secrétairerie. Ma réponse a été que le scrutin étant secret, personne ne pouvait connaître les votes particuliers. «Ah!» s'est écrié un homme principal, «si le roi pouvait en être assuré, j'espère que l'accès des Tuileries serait aussitôt fermé à ces serviteurs infidèles.» J'ai cru que je ne devais rien répondre, et je n'ai rien répondu.»
.................
«Il en sera de même, monsieur le duc, de la mesure du 5 et de celle du 20 septembre: l'une et l'autre ne trouvent en Europe que des approbateurs. Mais ce qui étonne, c'est de voir que de très purs et très dignes royalistes continuent de se passionner pour M. de Chateaubriand, malgré la publication d'un livre qui établit en principe que le roi de France, en vertu de la Charte, n'est plus qu'un être moral, essentiellement nul et sans volonté propre. Si tout autre que lui avait avancé une pareille maxime, les mêmes hommes, non sans apparence de raison, l'auraient qualifié de jacobin.»
Me voilà bien remis à ma place. C'est du reste une bonne leçon; cela rabat notre orgueil, en nous apprenant ce que nous deviendrons après nous.
Par les dépêches de M. de Bonnay et par celles de quelques autres ambassadeurs appartenant à l'ancien régime, il m'a paru que ces dépêches traitaient moins des affaires diplomatiques que des anecdotes relatives à des personnages de la société et de la cour: elles se réduisaient à un journal louangeur de Dangeau ou satirique de Tallemant. Aussi Louis XVIII et Charles X aimaient-ils beaucoup mieux les lettres amusantes de mes collègues que ma correspondance sérieuse. J'aurais pu rire et me moquer comme mes devanciers; mais le temps où les aventures scandaleuses et les petites intrigues se liaient aux affaires était passé. Quel bien aurait-il résulté pour mon pays du portrait (p. 201) de M. de Hardenberg[158], beau vieillard blanc comme un cygne, sourd comme un pot, allant à Rome sans permission, s'amusant de trop de choses, croyant à toutes sortes de rêveries, livré en dernier lieu au magnétisme entre les mains du docteur Koreff[159] que je rencontrais à cheval trottant dans les lieux écartés entre le diable, la médecine et les muses?
Ce mépris pour une correspondance frivole me fait dire à M. Pasquier dans ma lettre du 13 février 1821, no 13:
«Je ne vous ai point parlé, monsieur le baron, selon l'usage, des réceptions, des bals, des spectacles, etc; je ne vous ai point fait de petits portraits et d'inutiles satires; j'ai tâché de faire sortir la diplomatie du commérage. Le règne du commun reviendra, lorsque le temps extraordinaire sera passé: aujourd'hui il ne faut peindre que ce qui doit vivre et n'attaquer que ce qui menace.»
Berlin m'a laissé un souvenir durable, parce que la nature des récréations que j'y trouvai me reporta au temps de mon enfance et de ma jeunesse; seulement, (p. 202) des princesses très réelles remplissaient le rôle de ma Sylphide. De vieux corbeaux, mes éternels amis, venaient se percher sur les tilleuls devant ma fenêtre; je leur jetais à manger: quand ils avaient saisi un morceau de pain trop gros, ils le rejetaient avec une adresse inimaginable pour en saisir un plus petit; de manière qu'ils pouvaient en prendre un autre un peu plus gros, et ainsi de suite jusqu'au morceau capital qui, à la pointe de leur bec, le tenait ouvert, sans qu'aucune des couches croissantes de la nourriture pût tomber. Le repas fait, l'oiseau chantait à sa manière: cantus cornicum ut secla vetusta. J'errais dans les espaces déserts de Berlin glacé; mais je n'entendais pas sortir de ses murs, comme des vieilles murailles de Rome, de belles voix de jeunes filles. Au lieu de capucins à barbe blanche traînant leurs sandales parmi des fleurs, je rencontrais des soldats qui roulaient des boules de neige.
Un jour, au détour de la muraille d'enceinte, Hyacinthe[160] et moi nous nous trouvâmes nez à nez avec un vent d'est si perçant, que nous fûmes obligés de courir dans la campagne pour regagner la ville à moitié morts. Nous franchîmes des terrains enclos, et tous les chiens de garde nous sautaient aux jambes en nous poursuivant. Le thermomètre descendit ce jour-là à 22 degrés au-dessous de glace. Un ou deux factionnaires, à Potsdam, furent gelés.
De l'autre côté du parc était une ancienne faisanderie abandonnée;—les princes de Prusse ne chassent point. Je passais un petit pont de bois sur un canal de la Sprée, et je me trouvais parmi les colonnes de (p. 203) sapin qui faisaient le portique de la faisanderie. Un renard, en me rappelant ceux du mail de Combourg, sortait par un trou pratiqué dans le mur de la réserve, venait me demander de mes nouvelles et se retirait dans son taillis.
Ce qu'on nomme le parc, à Berlin, est un bois de chênes, de bouleaux, de hêtres, de tilleuls et de blancs de Hollande. Il est situé à la porte de Charlottenbourg et traversé par la grande route qui mène à cette résidence royale. À droite du parc est un Champ de Mars; à gauche des guinguettes.
Dans l'intérieur du parc, qui n'était pas alors percé d'allées régulières, on rencontrait des prairies, des endroits sauvages et des bancs de hêtre sur lesquels la Jeune Allemagne avait naguère gravé, avec un couteau, des cœurs percés de poignards: sous ces cœurs poignardés on lisait le nom de Sand[161]. Des bandes de corbeaux, habitant les arbres aux approches du printemps, commencèrent à ramager. La nature vivante se ranimait avant la nature végétale, et des grenouilles toutes noires étaient dévorées par des canards, dans les eaux çà et là dégelées: ces rossignols-là ouvraient le printemps dans les bois de Berlin. Cependant, le parc n'était pas sans quelques jolis animaux: des écureuils circulaient sur les branches ou se jouaient à terre, en se faisant un pavillon de leur queue. Quand j'approchais de la fête, les acteurs remontaient (p. 204) le tronc des chênes, s'arrêtaient dans une fourche et grognaient en me voyant passer au-dessous d'eux. Peu de promeneurs fréquentaient la futaie dont le sol inégal était bordé et coupé de canaux. Quelquefois je rencontrais un vieil officier goutteux qui me disait, tout réchauffé et tout réjoui, en me parlant du pâle rayon de soleil sous lequel je grelottais: «Ça pique!» De temps en temps je trouvais le duc de Cumberland, à cheval et presque aveugle, arrêté devant un blanc de Hollande contre lequel il était venu se cogner le nez. Quelques voitures attelées de six chevaux passaient: elles portaient ou l'ambassadrice d'Autriche, ou la princesse de Radzivill et sa fille, âgée de quinze ans, charmante comme une de ces nues à figure de vierge qui entourent la lune d'Ossian. La duchesse de Cumberland faisait presque toujours la même promenade que moi: tantôt elle revenait de secourir dans une chaumière une pauvre femme de Spandau, tantôt elle s'arrêtait et me disait gracieusement qu'elle avait voulu me rencontrer; aimable fille des trônes descendue de son char comme la déesse de la nuit pour errer dans les forêts! Je la voyais aussi chez elle: elle me répétait qu'elle me voulait confier son fils, ce petit Georges[162] devenu le prince que sa cousine Victoria aurait, dit-on, désiré placer à ses côtés sur le trône de l'Angleterre.
(p. 205) La princesse Frédérique a traîné depuis ses jours aux bords de la Tamise, dans ces jardins de Kew qui me virent jadis errer entre mes deux acolytes, l'illusion et la misère. Après mon départ de Berlin, elle m'a honoré d'une correspondance; elle y peint d'heure en heure la vie d'un habitant de ces bruyères où passa Voltaire, où mourut Frédéric, où se cacha ce Mirabeau qui devait commencer la révolution dont je fus la victime. L'attention est captivée en apercevant les anneaux par qui se touchent tant d'hommes inconnus les uns aux autres.
Voici quelques extraits de la correspondance qu'ouvre avec moi madame la duchesse de Cumberland:
«19 avril[163], jeudi.
«Ce matin, à mon réveil, on m'a remis le dernier témoignage de votre souvenir; plus tard j'ai passé devant votre maison, j'y ai vu des fenêtres ouvertes comme de coutume, tout était à la même place, excepté vous! Je ne puis vous dire ce que cela m'a fait éprouver! Je ne sais plus maintenant où vous trouver; chaque instant vous éloigne davantage; le seul point fixe est le 26, jour où vous comptez arriver, et le souvenir que je vous conserve.
«Dieu veuille que vous trouviez tout changé pour le mieux et pour vous et pour le bien général! Accoutumée aux sacrifices, je saurai encore porter celui de ne plus vous revoir, si c'est pour votre bonheur et celui de la France.»
«Depuis jeudi j'ai passé devant votre maison tous les jours pour aller à l'église; j'y ai bien prié pour vous. Vos fenêtres sont constamment ouvertes, cela me touche: qui est-ce qui a pour vous cette attention à suivre vos goûts et vos ordres, malgré votre absence? Il me prend l'idée, quelquefois, que vous n'êtes pas parti; que des affaires vous arrêtent, ou que vous avez voulu écarter les importuns pour en finir à votre aise. Ne croyez pas que cela soit un reproche: il n'y a que ce moyen; mais si cela est, veuillez me le confier.»
«23.
«Il fait aujourd'hui une chaleur si prodigieuse, même à l'église, que je ne puis faire ma promenade à l'heure ordinaire: cela m'est bien égal à présent. Le cher petit bois n'a plus de charme pour moi, tout le monde m'y ennuie! Ce changement subit du froid au chaud est commun dans le nord; les habitants ne tiennent pas, par leur modération de caractère et de sentiments, du climat.»
«24.
«La nature est bien embellie; toutes les feuilles ont poussé depuis votre départ: j'aurais voulu qu'elles fussent venues deux jours plus tôt, pour que vous ayez pu emporter dans votre souvenir une image plus riante de votre séjour ici.»
«Berlin, 12 mai 1821.
«Dieu merci, voilà enfin une lettre de vous! Je savais bien que vous ne pouviez m'écrire plus tôt; (p. 207) mais, malgré tous les calculs que faisait ma raison, trois semaines ou pour mieux dire vingt-trois jours sont bien longs pour l'amitié dans la privation, et rester sans nouvelles ressemble au plus triste exil: il me restait pourtant le souvenir et l'espérance.»
«Le 15 mai.
«Ce n'est pas de mon étrier, comme le Grand Turc, mais toujours de mon lit, que je vous écris; mais cette retraite m'a donné tout le temps de réfléchir au nouveau régime que vous voulez faire tenir à Henri V. J'en suis très contente; le lion rôti ne pourra que lui faire grand bien; je vous conseille seulement de le faire commencer par le cœur. Il faudra faire manger de l'agneau à l'autre de vos élèves (Georges) pour qu'il ne fasse pas trop le diable à quatre. Il faut absolument que ce plan d'éducation se réalise et que Georges et Henri V deviennent bons amis et bons alliés.»
Madame la duchesse de Cumberland continua de m'écrire des eaux d'Ems, ensuite des eaux de Schwalbach, et après de Berlin, où elle revint le 22 septembre de l'année 1821. Elle me mandait d'Ems: «Le couronnement en Angleterre se fera sans moi; je suis peinée que le roi ait fixé, pour se faire couronner, le jour le plus triste de ma vie: celui auquel j'ai vu mourir cette sœur adorée (la reine de Prusse)[164]. La mort de Bonaparte m'a aussi fait penser aux souffrances qu'il lui a causées.»
(p. 208) «De Berlin, le 22 septembre.
«J'ai déjà revu ces grandes allées solitaires. Que je vous serai redevable, si vous m'envoyez, comme vous me le promettez, les vers que vous avez faits pour Charlottenbourg! J'ai aussi repris le chemin de la maison dans le bois où vous eûtes la bonté de m'aider à secourir la pauvre femme de Spandau; que vous êtes bon de vous souvenir de ce nom! Tout me rappelle des temps heureux. Il n'est pas nouveau de regretter le bonheur.
«Au moment où j'allais expédier cette lettre, j'apprends que le roi a été détenu en mer par des tempêtes, et probablement repoussé sur les côtes de l'Irlande; il n'était pas arrivé à Londres le 14; mais vous serez instruit de son retour plus tôt que nous.
«La pauvre princesse Guillaume a reçu aujourd'hui la triste nouvelle de la mort de sa mère, la landgrave douairière de Hesse-Hombourg. Vous voyez comme je vous parle de tout ce qui concerne notre famille; veuille le ciel que vous ayez de meilleures nouvelles à me donner!»
Ne semblerait-il pas que la sœur de la belle reine de Prusse me parle de notre famille comme si elle avait la bonté de m'entretenir de mon aïeule, de ma tante et de mes obscurs parents de Plancouët? La famille royale de France m'a-t-elle jamais honoré d'un sourire pareil à celui de cette famille royale étrangère, qui pourtant me connaissait à peine et ne me devait rien? Je supprime plusieurs autres lettres affectueuses: elles ont quelque chose de souffrant et de (p. 209) contenu, de résigné et de noble, de familier et d'élevé; elles servent de contre-poids à ce que j'ai dit de trop sévère peut-être sur les races souveraines. Mille ans en arrière, et la princesse Frédérique étant fille de Charlemagne eût emporté la nuit Éginhard sur ses épaules, afin qu'il ne laissât sur la neige aucune trace.
Je viens de relire ce livre en 1840: je ne puis m'empêcher d'être frappé de ce continuel roman de ma vie. Que de destinées manquées! Si j'étais retourné en Angleterre avec le petit Georges, l'héritier possible de cette couronne, j'aurais vu s'évanouir le nouveau songe qui aurait pu me faire changer de patrie, de même que si je n'eusse pas été marié je serais resté une première fois dans la patrie de Shakespeare et de Milton. Le jeune duc de Cumberland, qui a perdu la vue, n'a point épousé sa cousine la reine d'Angleterre. La duchesse de Cumberland est devenue reine de Hanovre: où est-elle? est-elle heureuse? où suis-je? Grâce à Dieu, dans quelques jours, je n'aurai plus à promener mes regards sur ma vie passée, ni à me faire ces questions. Mais il m'est impossible de ne pas prier le ciel de répandre ses faveurs sur les dernières années de la princesse Frédérique[165].
Je n'avais été envoyé à Berlin qu'avec le rameau de la paix, et parce que ma présence jetait le trouble dans l'administration; mais, connaissant les inconstances de la fortune et sentant que mon rôle politique n'était pas fini, je surveillais les événements: je ne voulais pas abandonner mes amis. Je m'aperçus bientôt que la réconciliation entre le parti royaliste et (p. 210) le parti ministériel n'avait pas été sincère; des défiances et des préjugés restaient; on ne faisait pas ce qu'on m'avait promis: on commençait à m'attaquer. L'entrée au conseil de MM. de Villèle et Corbière avait excité la jalousie de l'extrême droite; elle ne marchait plus sous la bannière du premier, et celui-ci, dont l'ambition était impatiente, commençait à se fatiguer. Nous échangeâmes quelques lettres. M. de Villèle regrettait d'être entré au conseil: il se trompait; la preuve que j'avais vu juste, c'est qu'un an ne s'était pas écoulé qu'il devint ministre des finances, et que M. de Corbière eut l'intérieur[166].
Je m'expliquai aussi avec M. le baron Pasquier; je lui mandais, le 10 février 1821:
«J'apprends de Paris, monsieur le baron, par le courrier arrivé ce matin 9 février, qu'on a trouvé mauvais que j'eusse écrit de Mayence au prince de Hardenberg, ou même que je lui eusse envoyé un courrier. Je n'ai point écrit à M. de Hardenberg et encore moins lui ai-je envoyé un courrier. Je désire, monsieur le baron, que l'on m'évite des tracasseries. Quand mes services ne seront plus agréables, on ne peut me faire un plus grand plaisir que de me le dire tout rondement. Je n'ai ni sollicité ni désiré la mission dont on m'a chargé; ce n'est ni par goût ni par choix que j'ai accepté un honorable exil, mais pour le bien de la paix. Si les royalistes se sont ralliés au ministère, le ministère n'ignore pas que j'ai eu le bonheur de contribuer à (p. 211) cette réunion. J'aurais quelque droit de me plaindre. Qu'a-t-on fait pour les royalistes depuis mon départ? Je ne cesse d'écrire pour eux: m'écoute-t-on? Monsieur le baron, j'ai, grâce à Dieu, autre chose à faire dans la vie qu'à assister à des bals. Mon pays me réclame, ma femme malade a besoin de mes soins, mes amis redemandent leur guide. Je suis au-dessus ou au-dessous d'une ambassade et même d'un ministère d'État. Vous ne manquerez pas d'hommes plus habiles que moi pour conduire les affaires diplomatiques; ainsi il serait inutile de chercher des prétextes pour me faire des chicanes. J'entendrai à demi mot; et vous me trouverez disposé à rentrer dans mon obscurité.»
Tout cela était sincère: cette facilité à tout planter là, et à ne regretter rien, m'eût été une grande force, eussé-je eu quelque ambition.
Ma correspondance diplomatique avec M. Pasquier allait son train: continuant de m'occuper de l'affaire de Naples[167], je disais:
No 15. «20 février 1821.
«L'Autriche rend un service aux monarchies en détruisant l'édifice jacobin des Deux-Siciles; mais (p. 212) elle perdrait ces mêmes monarchies, si le résultat d'une expédition salutaire et obligée était la conquête d'une province ou l'oppression d'un peuple. Il faut affranchir Naples de l'indépendance démagogique, et y établir la liberté monarchique; y briser des fers, et non pas y porter des chaînes. Mais l'Autriche ne veut pas de constitution à Naples: qu'y mettra-t-elle? des hommes? où sont-ils? Il suffira d'un curé libéral et de deux cents soldats pour recommencer.
«C'est après l'occupation volontaire ou forcée que vous devez vous interposer pour faire établir à Naples un gouvernement constitutionnel où toutes les libertés sociales soient respectées.»
J'avais toujours conservé en France une prépondérance d'opinion qui m'obligeait à porter mes regards sur l'intérieur. J'osai soumettre ce plan à mon ministre:
«Adopter franchement le gouvernement constitutionnel.
«Présenter le renouvellement septennal, sans prétendre conserver une partie de la Chambre actuelle, ce qui serait suspect, ni garder le tout, ce qui est dangereux.
«Renoncer aux lois d'exception, source d'arbitraire, sujet éternel de querelles et de calomnies.
«Affranchir les communes du despotisme ministériel.»
(p. 213) Dans ma dépêche du 3 mars, no 18, je revenais sur l'Espagne; je disais:
«Il serait possible que l'Espagne changeât promptement sa monarchie en république: sa Constitution doit porter son fruit. Le roi ou fuira ou sera massacré ou déposé; il n'est pas homme assez fort pour s'emparer de la révolution. Il est possible encore que cette même Espagne subsistât pendant quelque temps dans l'état populaire, si elle se formait en républiques fédératives, agrégation à laquelle elle est plus propre que tout autre pays par la diversité de ses royaumes, de ses mœurs, de ses lois et même de son langage.»
L'affaire de Naples revient encore trois ou quatre fois. Je fais observer (6 mars, no 19):
«Que la légitimité n'a pu jeter de profondes racines dans un État qui a changé si souvent de maîtres, et dont les habitudes ont été bouleversées par tant de révolutions. Les affections n'ont pas eu le temps de naître, les mœurs de recevoir l'empreinte uniforme des siècles et des institutions. Il y a dans la nation napolitaine beaucoup d'hommes corrompus ou sauvages qui n'ont aucun rapport entre eux, et qui ne sont attachés à la couronne que par de faibles liens: la royauté, pour être respectée, est trop près du lazzarone et trop loin du Calabrais. Pour établir la liberté démocratique, les Français eurent trop de vertus militaires; les Napolitains n'en auront pas assez.»
Enfin, je dis quelques mots du Portugal et de l'Espagne encore.
Le bruit se répandait que Jean VI s'était embarqué (p. 214) à Rio-de-Janeiro pour Lisbonne[168]. C'était un jeu de la fortune digne de notre temps qu'un roi de Portugal allant chercher auprès d'une révolution en Europe un abri contre une révolution en Amérique, et passant au pied du rocher où était retenu le conquérant qui le contraignit autrefois de se réfugier dans le Nouveau-Monde.
«Tout est à craindre de l'Espagne, disais-je (17 mars, no 21); la révolution de la Péninsule parcourra ses périodes, à moins qu'il ne se lève un bras capable de l'arrêter; mais ce bras, où est-il? c'est toujours là la question.»
Le bras, j'ai eu le bonheur de le trouver en 1823: c'est celui de la France.
Je retrouve avec plaisir, dans ce passage de ma dépêche du 10 avril, no 26, ma jalouse antipathie contre les alliés et ma préoccupation pour la dignité de la France; je disais à propos du Piémont:
«Je ne crains nullement la prolongation des troubles du Piémont[169] dans ses résultats immédiats; (p. 215) mais elle peut produire un mal éloigné en motivant l'intervention militaire de l'Autriche et de la Russie. L'armée russe est toujours en mouvement et n'a point reçu de contre-ordre.
«Voyez si, dans ce cas, il ne serait pas de la dignité et de la sûreté de la France de faire occuper la Savoie par vingt-cinq mille hommes, tout le temps que la Russie et l'Autriche occuperaient le Piémont. Je suis persuadé que cet acte de vigueur et de haute politique, en flattant l'amour-propre français, serait par cela seul très populaire et ferait un honneur infini aux ministres. Dix mille hommes de la garde royale et un choix fait sur le reste de nos troupes vous composeraient facilement une armée de vingt-cinq mille soldats excellents et fidèles: la cocarde blanche sera assurée lorsqu'elle aura revu l'ennemi.
«Je sais, monsieur le baron, que nous devons éviter de blesser l'amour-propre français et que la (p. 216) domination des Russes et des Autrichiens en Italie peut soulever notre orgueil militaire; mais nous avons un moyen facile de le contenter, c'est d'occuper nous-mêmes la Savoie. Les royalistes seront charmés et les libéraux ne pourraient qu'applaudir en nous voyant prendre une attitude digne de notre force. Nous aurions à la fois le bonheur d'écraser une révolution démagogique et l'honneur de rétablir la prépondérance de nos armes. Ce serait mal connaître l'esprit français que de craindre de rassembler vingt-cinq mille hommes pour marcher en pays étranger, et pour tenir rang avec les Russes et les Autrichiens, comme puissance militaire. Je répondrais de l'événement sur ma tête. Nous avons pu rester neutres dans l'affaire de Naples: pouvons-nous l'être pour notre sûreté et pour notre gloire dans les troubles du Piémont?»
Ici se découvre tout mon système: j'étais Français; j'avais une politique assurée bien avant la guerre d'Espagne, et j'entrevoyais la responsabilité que mes succès mêmes, si j'en obtenais, feraient peser sur ma tête.
Tout ce que je rappelle ici ne peut sans doute intéresser personne; mais tel est l'inconvénient des Mémoires: lorsqu'ils n'ont point de faits historiques à raconter, ils ne vous entretiennent que de la personne de l'auteur et vous en assomment. Laissons là ces ombres oubliées! J'aime mieux rappeler que Mirabeau inconnu remplissait à Berlin en 1786 une mission ignorée[170], et qu'il fut obligé de dresser un pigeon (p. 217) pour annoncer au roi de France le dernier soupir du terrible Frédéric.
«Je fus dans quelque perplexité, dit Mirabeau. Il était sûr que les portes de la ville seraient fermées; il était même possible que les ponts de l'île de Potsdam fussent levés aussitôt l'événement, et dans ce dernier cas on pouvait être aussi longtemps incertain que le nouveau roi le voudrait. Dans la première supposition, comment faire partir un courrier? nul moyen d'escalader les remparts ou les palissades, sans s'exposer à une affaire; les sentinelles faisant une chaîne de quarante en quarante pas derrière la palissade, que faire? Si j'eusse été ministre, la certitude des symptômes mortels m'aurait décidé à expédier avant la mort, car que fait de plus le mot mort? Dans ma position, le devais-je? Quoi qu'il en fût, le plus important était de servir. J'avais de grandes raisons de me méfier de l'activité de notre légation. Que fais-je? J'envoie sur un cheval vif et vigoureux un homme sûr à quatre milles de Berlin, dans une ferme, du pigeonnier de laquelle je possédais depuis quelques jours deux paires de pigeons, dont le retour avait été essayé, en sorte qu'à moins que les ponts de l'île de Potsdam ne fussent levés, j'étais sûr de mon fait.
«J'ai donc trouvé que nous n'étions pas assez riches pour jeter cent louis par la fenêtre; j'ai renoncé à toutes mes belles avances qui m'avaient coûté quelque méditation, quelque activité, quelques louis, et j'ai lâché mes pigeons avec des revenez. Ai-je bien fait? ai-je mal fait? je l'ignore; mais je (p. 218) n'avais pas mission expresse, et l'on sait quelquefois mauvais gré de la surérogation.»
On enjoignait aux ambassadeurs d'écrire, pendant leur séjour à l'étranger, un mémoire sur l'état des peuples et des gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités. Cette suite de mémoires pouvait être utile à l'histoire. Aujourd'hui on fait les mêmes injonctions, mais presque aucun agent diplomatique ne s'y soumet. J'ai été trop peu de temps dans mes ambassades pour mettre à fin de longues études; néanmoins, je les ai ébauchées; ma patience au travail n'a pas entièrement été stérile. Je trouve cette esquisse commencée de mes recherches sur l'Allemagne:
«Après la chute de Napoléon, l'introduction des gouvernements représentatifs dans la confédération germanique a réveillé en Allemagne ces premières idées d'innovation que la révolution y avait d'abord fait naître. Elles y ont fomenté quelque temps avec une grande violence: on avait appelé la jeunesse à la défense de la patrie par une promesse de liberté; cette promesse avait été avidement reçue par des écoliers qui trouvaient dans leurs maîtres le penchant que les sciences ont eu dans ce siècle à seconder les théories libérales. Sous le ciel de la Germanie, cet amour de la liberté devint une espèce de fanatisme sombre et mystérieux qui se propagea par des associations secrètes. Sand vint effrayer l'Europe. Cet homme, au reste, qui révélait une secte puissante, n'était qu'un enthousiaste vulgaire; il se trompa et prit pour un esprit transcendant un esprit commun: son crime s'alla perdre sur un (p. 219) écrivain dont le génie ne pouvait aspirer à l'empire, et n'avait pas assez du conquérant et du roi pour mériter un coup de poignard.»
«Une espèce de tribunal d'inquisition politique et la suppression de la liberté de la presse ont arrêté ce mouvement des esprits; mais il ne faut pas croire qu'ils en aient brisé le ressort. L'Allemagne, comme l'Italie, désire aujourd'hui l'unité politique, et avec cette idée qui restera dormante plus ou moins de temps, selon les événements et les hommes, on pourra toujours, en la réveillant, être sûr de remuer les peuples germaniques. Les princes ou les ministres qui pourront paraître dans les rangs de la Confédération des États allemands hâteront ou retarderont la révolution dans ce pays, mais ils n'empêcheront point la race humaine de se développer: chaque siècle a sa race. Aujourd'hui il n'y a plus personne en Allemagne, ni même en Europe: on est passé des géants aux nains, et tombé de l'immense dans l'étroit et le borné. La Bavière, par les bureaux qu'a formés M. de Montgelas, pousse encore aux idées nouvelles, quoiqu'elle ait reculé dans la carrière, tandis que le landgraviat de Hesse n'admettait pas même qu'il y eût une révolution en Europe. Le prince qui vient de mourir voulait que ses soldats, naguère soldats de Jérôme Bonaparte, portassent de la poudre et des queues; il prenait les vieilles modes pour les vieilles mœurs, oubliant qu'on peut copier les premières, mais qu'on ne rétablit jamais les secondes.»
(p. 220) À Berlin et dans le Nord, les monuments sont des forteresses; leur seul aspect serre le cœur. Qu'on retrouve ces places dans des pays habités et fertiles, elles font naître l'idée d'une légitime défense; les femmes et les enfants, assis ou jouant à quelque distance des sentinelles, contrastent assez agréablement; mais une forteresse sur des bruyères, dans un désert, rappelle seulement des colères humaines: contre qui sont-ils élevés, ces remparts, si ce n'est contre la pauvreté et l'indépendance? Il faut être moi pour trouver un plaisir à rôder au pied de ces bastions, à entendre le vent siffler dans ces tranchées, à voir ces parapets élevés en prévision d'ennemis qui peut-être n'apparaîtront jamais. Ces labyrinthes militaires, ces canons muets en face les uns des autres sur des angles saillants et gazonnés, ces vedettes de pierre où l'on n'aperçoit personne et d'où aucun œil ne vous regarde, sont d'une incroyable morosité. Si, dans la double solitude de la nature et de la guerre, vous rencontrez une pâquerette abritée sous le redan d'un glacis, cette aménité de Flore vous soulage. Lorsque, dans les châteaux de l'Italie, j'apercevais des chèvres appendues aux ruines, et la chevrière assise sous un pin à parasol; quand, sur les murs du moyen âge dont Jérusalem est entourée, mes regards plongeaient dans la vallée de Cédron sur quelques femmes arabes qui gravissaient des escarpements parmi des cailloux; le spectacle était triste sans doute, mais l'histoire était là et le silence du présent ne laissait que mieux entendre le bruit du passé.
J'avais demandé un congé à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux. Ce congé m'étant accordé, je me (p. 221) préparais à partir: Voltaire, dans une lettre à sa nièce, dit qu'il voit couler la Sprée, que la Sprée se jette dans l'Elbe, l'Elbe dans la mer, et que la mer reçoit la Seine; il descendait ainsi vers Paris. Avant de quitter Berlin, j'allai faire une dernière visite à Charlottenbourg: ce n'était ni Windsor, ni Aranjuez, ni Caserte, ni Fontainebleau: la villa appuyée sur un hameau, est environnée d'un parc anglais de peu d'étendue et d'où l'on découvre au dehors des friches. La reine de Prusse jouit ici d'une paix que la mémoire de Bonaparte ne pourra plus troubler. Quel bruit le conquérant fit jadis dans cet asile du silence, quand il y surgit avec ses fanfares et ses légions ensanglantées à Iéna! C'est de Berlin, après avoir effacé de la carte le royaume de Frédéric le Grand, qu'il dénonça le blocus continental et prépara dans son esprit la campagne de Moscou; ses paroles avaient déjà porté la mort au cœur d'une princesse accomplie: elle dort maintenant à Charlottenbourg, dans un caveau monumental; une statue, beau portrait de marbre, la représente. Je fis sur le tombeau des vers que me demandait la duchesse de Cumberland:
LE VOYAGEUR.
Sous les hauts pins qui protègent ces sources,
Gardien, dis-moi quel est ce monument nouveau?
LE GARDIEN.
Un jour il deviendra le terme de tes courses:
Ô voyageur! c'est un tombeau.
LE VOYAGEUR.
Qui repose en ces lieux?
Un objet plein de charmes.
LE VOYAGEUR.
Qu'on aima?
LE GARDIEN.
Qui fut adoré.
LE VOYAGEUR.
Ouvre-moi.
LE GARDIEN.
Si tu crains les larmes,
N'entre pas.
LE VOYAGEUR.
J'ai souvent pleuré.
De la Grèce ou de l'Italie
On a ravi ce marbre à la pompe des morts:
Quel tombeau l'a cédé pour enchanter ces bords?
Est-ce Antigone ou Cornélie?
LE GARDIEN.
La beauté dont l'image excite les transports
Parmi nos bois passa sa vie.
LE VOYAGEUR.
Qui pour elle, à ces murs de marbre revêtus,
Suspendit tour à tour ces couronnes fanées?
LE GARDIEN.
Les beaux enfants dont ses vertus
Ici-bas furent couronnées.
LE VOYAGEUR.
On vient.
C'est un époux: il porte ici ses pas
Pour nourrir en secret un souvenir funeste.
LE VOYAGEUR.
Il a donc tout perdu?
LE GARDIEN.
Non: un trône lui reste.
LE VOYAGEUR.
Un trône ne console pas.
J'arrivai à Paris à l'époque des fêtes du baptême de M. le duc de Bordeaux[171]. Le berceau du petit-fils de Louis XIV dont j'avais eu l'honneur de payer le port a disparu comme celui du roi de Rome. Dans un temps différent de celui-ci, le forfait de Louvel eût assuré le sceptre à Henri V; mais le crime n'est plus un droit que pour l'homme qui le commet.
Après le baptême de M. le duc de Bordeaux[172], on me réintégra enfin dans mon ministère d'État: M. de Richelieu me l'avait ôté, M. de Richelieu me le rendit; (p. 224) la réparation ne me fut pas plus agréable que le tort ne m'avait blessé.
Tandis que je me flattais d'aller revoir mes corbeaux, les cartes se brouillèrent: M. de Villèle se retira[173]. Fidèle à mon amitié et à mes principes politiques, (p. 225) je crus devoir rentrer dans la retraite avec lui. J'écrivis à M. Pasquier:
«Paris, ce 30 juillet 1821.
«Monsieur le baron,
«Lorsque vous voulûtes bien m'inviter à passer chez vous, le 14 de ce mois, ce fut pour me déclarer que ma présence était nécessaire à Berlin. J'eus l'honneur de vous répondre que MM. de Corbière et de Villèle paraissant se retirer du ministère, mon devoir était de les suivre. Dans la pratique du gouvernement représentatif, l'usage est que les hommes de la même opinion partagent la même fortune. Ce que l'usage veut, monsieur le baron, l'honneur me le commande, puisqu'il s'agit, non d'une faveur, mais d'une disgrâce. En conséquence, je viens vous réitérer par écrit l'offre que je vous ai faite verbalement de ma démission de ministre plénipotentiaire à la cour de Berlin: j'espère, monsieur le baron, que vous voudrez bien la mettre aux pieds du roi. Je supplie Sa Majesté d'en agréer les motifs, et de croire à ma profonde et respectueuse reconnaissance pour les bontés dont elle avait daigné m'honorer.
«J'ai l'honneur d'être, etc.,
«Chateaubriand.»
J'annonçai à M. le comte de Bernstorff l'événement qui interrompait nos relations diplomatiques; il me répondit:
(p. 226) «Monsieur le vicomte,
«Bien que depuis longtemps je dusse m'attendre à l'avis que vous avez bien voulu me donner, je n'en suis pas moins péniblement affecté. Je connais et je respecte les motifs qui, dans cette circonstance délicate, ont déterminé vos résolutions; mais, en ajoutant de nouveaux titres à ceux qui vous ont valu dans ce pays une estime universelle, ils augmentent aussi les regrets qu'on y éprouve par la certitude d'une perte longtemps redoutée et à jamais irréparable. Ces sentiments sont vivement partagés par le roi et la famille royale, et je n'attends que le moment de votre rappel pour vous le dire d'une manière officielle.
«Conservez-moi, je vous prie, souvenir et bienveillance, et agréez la nouvelle expression de mon inviolable dévouement et de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, etc., etc.
«Bernstorff.
«Berlin, le 25 août 1821.»
Je m'étais empressé d'exprimer mon amitié et mes regrets à M. Ancillon: sa très belle réponse (mon éloge à part) mérite d'être consignée ici:
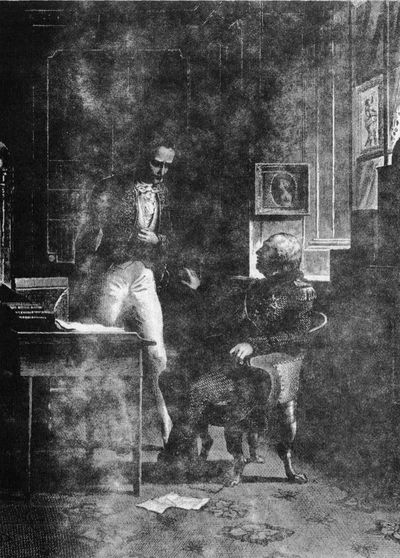
Mr. de Chateaubriand remerciant Louis XVIII.
«Berlin, le 22 septembre 1821.
«Vous êtes donc, monsieur et illustre ami, irrévocablement perdu pour nous? Je prévoyais ce malheur, et cependant il m'a affecté, comme s'il avait été inattendu. Nous méritions de vous conserver (p. 227) et de vous posséder, parce que nous avions du moins le faible mérite de sentir, de reconnaître, d'admirer toute votre supériorité. Vous dire que le roi, les princes, la cour et la ville vous regrettent, c'est faire leur éloge plus que le vôtre; vous dire que je me réjouis de ces regrets, que j'en suis fier pour ma patrie, et que je les partage vivement, ce serait rester fort au-dessous de la vérité, et vous donner une bien faible idée de ce que j'éprouve. Permettez-moi de croire que vous me connaissez assez pour lire dans mon cœur. Si ce cœur vous accuse, mon esprit non-seulement vous absout, mais rend encore hommage à votre noble démarche et aux principes qui vous l'ont dictée. Vous deviez à la France une grande leçon et un bel exemple; vous lui avez donné l'une et l'autre en refusant de servir un ministère qui ne sait pas juger sa situation, ou qui n'a pas le courage d'esprit nécessaire pour en sortir. Dans une monarchie représentative, les ministres et ceux qu'ils emploient dans les premières places doivent former un tout homogène, et dont toutes les parties soient solidaires les unes des autres. Là, moins que partout ailleurs, on doit se séparer de ses amis; on se soutient et l'on monte avec eux, on descend et tombe de même. Vous avez prouvé à la France la vérité de cette maxime, en vous retirant avec messieurs de Villèle et Corbière. Vous lui avez appris en même temps que la fortune n'entre pas en considération quand il s'agit des principes; et, certes, quand les vôtres n'auraient pas pour eux la raison, la conscience et l'expérience de tous les siècles, il suffirait des sacrifices qu'ils (p. 228) dictent à un homme tel que vous pour établir en leur faveur une présomption puissante aux yeux de tous ceux qui se connaissent en dignité.
«J'attends avec impatience le résultat des prochaines élections pour tirer l'horoscope de la France. Elles décideront de son avenir.
«Adieu, mon illustre ami; faites quelquefois tomber des hauteurs que vous habitez quelques gouttes de rosée sur un cœur qui ne cessera de vous admirer et de vous aimer que lorsqu'il cessera de battre.
«Ancillon.»
Attentif au bien de la France, sans plus m'occuper de moi ni de mes amis, je remis à cette époque la note suivante à Monsieur:
NOTE.
«Si le roi me faisait l'honneur de me consulter, voici ce que je proposerais pour le bien de son service et le repos de la France.
«Le centre gauche de la Chambre élective a satisfaction dans la nomination de M. Royer-Collard; pourtant je croirais la paix plus assurée si l'on introduisait dans le conseil un homme de mérite pris dans cette opinion et choisi parmi les membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés.
«Placer encore dans le conseil un député du côté droit indépendant;
«Achever de distribuer les directions dans cet esprit.
«Présenter dans un temps opportun une loi complète sur la liberté de la presse, dans laquelle loi la poursuite en tendance et la censure facultative seraient abolies; préparer une loi communale; compléter la loi sur la septennalité, en portant l'âge éligible à trente ans; en un mot marcher la charte à la main, défendre courageusement la religion contre l'impiété, mais la mettre en même temps à l'abri du fanatisme et des imprudences d'un zèle qui lui font beaucoup de mal.
«Quant aux affaires du dehors, trois choses doivent guider les ministres du roi: l'honneur, l'indépendance et l'intérêt de la France.
«La France nouvelle est toute royaliste; elle peut devenir toute révolutionnaire: que l'on suive les institutions, et je répondrais sur ma tête d'un avenir de plusieurs siècles; que l'on viole ou que l'on tourmente ces institutions, et je ne répondrais pas d'un avenir de quelques mois.
«Moi et mes amis nous sommes prêts à appuyer de tout notre pouvoir une administration formée d'après les bases ci-dessus indiquées.
«Chateaubriand.»
Une voix où la femme dominait la princesse vint donner une consolation à ce qui n'était que le déplaisir d'une vie variant sans cesse. L'écriture de madame la duchesse de Cumberland était si altérée que j'eus quelque peine à la reconnaître. La lettre portait la date du 28 septembre 1821: c'est la dernière que (p. 230) j'aie reçue de cette main royale[174]. Hélas! les autres nobles amies qui dans ces temps me soutenaient à Paris ont quitté cette terre! Resterai-je donc avec une telle obstination ici-bas, qu'aucune des personnes auxquelles je suis attaché ne puisse me survivre[175]? Heureux ceux sur qui l'âge fait l'effet du vin, et qui perdent la mémoire quand ils sont rassasiés de jours!
Les démissions de MM. de Villèle et de Corbière ne tardèrent pas à produire la dissolution du cabinet et à faire rentrer mes amis au conseil, comme je l'avais prévu: M. le vicomte de Montmorency fut nommé ministre des affaires étrangères, M. de Villèle ministre des finances, M. de Corbière ministre de l'intérieur[176]. J'avais eu trop de part aux derniers mouvements politiques et j'exerçais une trop grande influence sur l'opinion pour qu'on me pût laisser de côté. Il fut résolu que je remplacerais M. le duc Decazes à l'ambassade de Londres[177]. Louis XVIII consentait toujours (p. 231) à m'éloigner. Je l'allai remercier; il me parla de son favori avec une constance d'attachement rare chez les rois; il me pria d'effacer dans la tête de George IV les préventions que ce prince avait conçues contre M. Decazes, d'oublier moi-même les divisions qui avaient existé entre moi et l'ancien ministre de la police. Ce monarque, à qui tant de malheurs n'avaient pu arracher une larme, était ému de quelques souffrances dont pouvait avoir été affligé l'homme qu'il avait honoré de son amitié.
Ma nomination réveilla mes souvenirs: Charlotte revint à ma pensée; ma jeunesse, mon émigration, m'apparurent avec leurs peines et leurs joies. La faiblesse humaine me faisait aussi un plaisir de reparaître connu et puissant là où j'avais été ignoré et faible. Madame de Chateaubriand, craignant la mer, n'osa passer le détroit, et je partis seul. Les secrétaires de l'ambassade m'avaient devancé.[Lien vers la Table des Matières]
Année 1822. — Premières dépêches de Londres. — Conversation avec George IV sur M. Decazes. — Noblesse de notre diplomatie sous la légitimité. — Séance du Parlement. — Société anglaise. — Suite des dépêches. — Reprise des travaux parlementaires. — Bal pour les Irlandais. — Duel du duc de Bedford et du duc de Buckingham. — Dîner à Royal-Lodge. — La marquise de Conyngham et son secret. — Portraits des ministres. — Suite de mes dépêches. — Pourparlers sur le Congrès de Vérone. — Lettre à M. de Montmorency; sa réponse qui me laisse entrevoir un refus. — Lettre de M. de Villèle plus favorable. — J'écris à Madame de Duras. — Mort de Lord Londonderry. — Nouvelle lettre de M. de Montmorency. — Voyage à Hartwell. — Billet de M. de Villèle m'annonçant ma nomination au Congrès. — Fin de la vieille Angleterre. — Charlotte. — Réflexions. — Je quitte Londres. — Années 1824, 1825, 1826 et 1827. — Délivrance du roi d'Espagne. — Ma destitution. — L'opposition me suit. — Derniers billets diplomatiques. — Neuchâtel en Suisse. — Mort de Louis XVIII. — Sacre de Charles X. — Réception des chevaliers des ordres.
C'est à Londres, en 1822, que j'ai écrit de suite la plus longue partie de ces Mémoires, renfermant mon voyage en Amérique, mon retour en France, mon mariage, mon passage à Paris, mon émigration en Allemagne avec mon frère, ma résidence et mes malheurs en Angleterre depuis 1793 jusqu'à 1800. Là se (p. 234) trouve la peinture de la vieille Angleterre, et comme je retraçais tout cela lors de mon ambassade (1822), les changements survenus dans les mœurs et dans les personnages de 1793 à la fin du siècle me frappaient; j'étais naturellement amené à comparer ce que je voyais en 1822 à ce que j'avais vu pendant les sept années de mon exil d'outre-Manche.
Ainsi ont été relatées par anticipation des choses que j'aurais à placer maintenant sous la propre date de ma mission diplomatique. Je vous ai parlé de mon émotion, des sentiments que me rappela la vue de ces lieux chers à ma mémoire; mais peut-être n'avez-vous pas lu cette partie de mon livre? Vous avez bien fait. Il me suffit maintenant de vous avertir de l'endroit où sont comblées les lacunes qui vont exister dans le récit actuel de mon ambassade de Londres. Me voici donc, en écrivant en 1839, parmi les morts de 1822 et les morts qui précédèrent en 1793.
À Londres, au mois d'avril 1822, j'étais à cinquante lieues de madame Sutton. Je me promenais dans le parc de Kensington avec mes impressions récentes et l'ancien passé de mes jeunes années[179]: confusion de (p. 235) temps qui produit en moi une confusion de souvenirs; la vie qui se consume mêle, comme l'incendie de Corinthe, l'airain fondu des statues des Muses et de l'Amour, des trépieds et des tombeaux.
Les vacances parlementaires continuaient quand je descendis à mon hôtel, Portland Place. Le sous-secrétaire d'État, M. Planta, me proposa, de la part du marquis de Londonderry[180], d'aller dîner à North-Cray, campagne du noble lord. Cette villa, avec un gros arbre devant les fenêtres du côté du jardin, avait vue sur quelques prairies; un peu de bois taillis sur des collines distinguaient ce site des sites ordinaires de l'Angleterre. Lady Londonderry était très à la mode en qualité de marquise et de femme du premier ministre.
Ma dépêche du 12 avril, no 4, raconte ma première entrevue avec lord Londonderry; elle touche aux affaires dont je devais m'occuper.
«Londres, le 12 avril 1822.
«Monsieur le vicomte[181],
«Je suis allé avant-hier, mercredi, 10 du courant, à North-Cray. Je vais avoir l'honneur de vous rendre compte de ma conversation avec le marquis de Londonderry. Elle a duré une heure et demie avant dîner, et nous l'avons reprise après, mais (p. 236) moins à notre aise, parce que nous n'étions plus tête à tête.
«Lord Londonderry s'est d'abord informé des nouvelles de la santé du roi, avec une insistance qui décelait visiblement un intérêt politique; rassuré par moi sur ce point, il a passé au ministère: «Il s'affermit,» m'a-t-il dit. J'ai répondu: «Il n'a jamais été ébranlé, et comme il appartient à une opinion, il restera le maître tant que cette opinion dominera dans les Chambres.» Cela nous a amenés à parler des élections: il m'a semblé frappé de ce que je lui disais sur l'avantage d'une session d'été pour rétablir l'ordre dans l'année financière; il n'avait pas bien compris jusqu'alors l'état de la question.
«La guerre entre la Russie et la Turquie est ensuite devenue le sujet de l'entretien. Lord Londonderry, en me parlant de soldats et d'armées, m'a paru être dans l'opinion de notre ancien ministère sur le danger qu'il y aurait pour nous à réunir de grands corps de troupe; j'ai repoussé cette idée, j'ai soutenu qu'en menant le soldat français au combat, il n'y avait rien à craindre; qu'il ne sera jamais infidèle à la vue du drapeau de l'ennemi; que notre armée vient d'être augmentée; qu'elle serait triplée demain, si cela était nécessaire, sans le moindre inconvénient; qu'à la vérité quelques sous-officiers pourraient crier Vive la Charte! dans une garnison, mais que nos grenadiers crieraient toujours Vive le roi! sur le champ de bataille.
«Je ne sais si cette grande politique a fait oublier à lord Londonderry la traite des nègres; il ne m'en (p. 237) pas dit un mot. Changeant de sujet, il m'a parlé du message par lequel le président des États-Unis engage le congrès à reconnaître l'indépendance des colonies espagnoles. «Les intérêts commerciaux, lui ai-je dit, en pourront tirer quelque avantage, mais je doute que les intérêts politiques y trouvent le même profit; il y a déjà assez d'idées républicaines dans le monde. Augmenter la masse de ces idées, c'est compromettre de plus en plus le sort des monarchies en Europe.» Lord Londonderry a abondé dans mon sens, et il m'a dit ces mots remarquables: «Quant à nous (les Anglais), nous ne sommes nullement disposés à reconnaître ces gouvernements révolutionnaires.» Était-il sincère?
«J'ai dû, monsieur le vicomte, vous rappeler textuellement une conversation importante. Toutefois, nous ne devons pas nous dissimuler que l'Angleterre reconnaîtra tôt ou tard l'indépendance des colonies espagnoles; l'opinion publique et le mouvement de son commerce l'y forceront. Elle a déjà fait, depuis trois ans, des frais considérables pour établir secrètement des relations avec les provinces insurgées au midi et au nord de l'isthme de Panama.
«En résumé, monsieur le vicomte, j'ai trouvé dans M. le marquis de Londonderry un homme d'esprit, d'une franchise peut-être un peu douteuse; un homme encore imbu du vieux système ministériel; un homme accoutumé à une diplomatie soumise, et surpris, sans en être blessé, d'un langage plus digne de la France; un homme enfin qui ne pouvait se défendre d'une sorte d'étonnement en causant (p. 238) avec un de ces royalistes que, depuis sept ans, on lui représentait comme des fous ou des imbéciles.
«J'ai l'honneur, etc.»
À ces affaires générales étaient mêlées, comme dans toutes les ambassades, des transactions particulières. J'eus à m'occuper des requêtes de M. le duc de Fitz-James[182], du procès du navire l'Éliza-Ann, des déprédations des pêcheurs de Jersey sur les bancs d'huîtres de Granville, etc., etc. Je regrettais d'être obligé de consacrer une petite case de ma cervelle aux dossiers des réclamants. Quand on fouille dans sa mémoire, il est dur de rencontrer MM. Usquin, Coppinger, (p. 239) Deliège et Piffre. Mais, dans quelques années, serons-nous plus connus que ces messieurs? Un certain M. Bonnet étant mort en Amérique, tous les Bonnet de France m'écrivirent pour réclamer sa succession; ces bourreaux m'écrivent encore! Il serait temps toutefois de me laisser tranquille. J'ai beau leur répondre que le petit accident de la chute du trône étant survenu, je ne m'occupe plus de ce monde: ils tiennent bon et veulent hériter coûte que coûte.
Quant à l'Orient, il fut question de rappeler les divers ambassadeurs de Constantinople. Je prévis que l'Angleterre ne suivrait pas le mouvement de l'alliance continentale, je l'annonçai à M. de Montmorency. La rupture qu'on avait crainte entre la Russie et la Porte n'arriva pas: la modération d'Alexandre retarda l'événement. Je fis à ce propos une grande dépense d'allées et venues, de sagacité et de raisonnement; j'écrivis maintes dépêches qui sont allées moisir dans nos archives avec le rendu compte d'événements non advenus. J'avais du moins l'avantage sur mes collègues de ne mettre aucune importance à mes travaux; je les voyais sans souci s'engloutir dans l'oubli avec toutes les idées perdues des hommes.
Le Parlement reprit ses séances le 17 avril; le roi revint le 18, et je lui fus présenté le 19. Je rendis compte de cette présentation dans ma dépêche du 19; elle se terminait ainsi:
«S. M. B., par sa conversation serrée et variée, ne m'a pas laissé le maître de lui dire une chose dont le roi m'avait spécialement chargé; mais l'occasion favorable et prochaine d'une nouvelle audience va se présenter.»
(p. 240) Cette chose dont le roi m'avait spécialement chargé auprès de George IV était relative à M. le duc Decazes. Plus tard je remplis mes ordres: je dis à George IV que Louis XVIII était affligé de la froideur avec laquelle l'ambassadeur de S. M. T. C. avait été reçu. George IV me répondit:
«Écoutez, monsieur de Chateaubriand, je vous l'avouerai: la mission de M. Decazes ne me plaisait pas; c'était agir envers moi un peu cavalièrement. Mon amitié pour le roi de France m'a seule fait supporter un favori qui n'a d'autre mérite que celui de l'attachement de son maître. Louis XVIII a beaucoup compté sur ma bonne volonté et il a eu raison; mais je n'ai pu pousser l'indulgence jusqu'à traiter M. Decazes avec une distinction dont l'Angleterre aurait été blessée. Cependant, dites à votre roi que je suis touché de ce qu'il vous a chargé de me représenter, et que je serai toujours heureux de lui témoigner mon attachement véritable.»
Enhardi par ces paroles, j'exposai à George IV tout ce qui me vint à l'esprit en faveur de M. Decazes. Il me répondit, moitié en anglais, moitié en français: «À merveille! you are a true gentleman.» De retour à Paris, je rendis compte à Louis XVIII de cette conversation: il me parut reconnaissant. George IV m'avait parlé comme un prince bien élevé, mais comme un esprit léger; il était sans amertume parce qu'il pensait à autre chose. Il ne fallait cependant pas se jouer à lui qu'avec mesure. Un de ses compagnons de table avait parié qu'il prierait George IV de tirer le cordon de la sonnette et que George IV obéirait. En (p. 241) effet, George IV tira le cordon et dit au gentleman de service: «Mettez monsieur à la porte.»
L'idée de rendre de la force et de l'éclat à nos armes me dominait toujours. J'écrivais à M. de Montmorency, le 13 avril: «Il m'est venu une idée, monsieur le vicomte, que je soumets à votre jugement: trouveriez-vous mauvais qu'en forme de conversation, en causant avec le prince Esterhazy[183], je lui fisse entendre que si l'Autriche avait besoin de retirer une partie de ses troupes, nous pourrions les remplacer dans le Piémont? Quelques bruits répandus sur un prétendu rassemblement de nos troupes dans le Dauphiné m'offriraient un prétexte favorable. J'avais proposé à l'ancien ministère de mettre garnison en Savoie, lors de la révolte du mois de juin 1821 (voyez une de mes dépêches de Berlin). Il rejeta cette mesure, et je pense qu'il fit en cela une faute capitale. Je persiste à croire que la présence de quelques troupes françaises en Italie produirait un grand effet sur l'opinion, et que le gouvernement du roi en retirerait beaucoup de gloire.»
Les preuves surabondent de la noblesse de notre diplomatie pendant la Restauration. Qu'importe aux partis? N'ai-je pas lu encore ce matin, dans un journal de gauche, que l'Alliance nous avait forcés d'être ses gendarmes et de faire la guerre à l'Espagne[184], quand le Congrès de Vérone est là, quand les documents diplomatiques (p. 242) montrent d'une manière irrécusable que toute l'Europe, à l'exception de la Russie, ne voulait pas de cette guerre; que non-seulement elle ne la voulait pas, mais que l'Angleterre la repoussait ouvertement, et que l'Autriche nous contrariait en secret par les mesures les moins nobles? Cela n'empêchera pas de mentir de nouveau demain; on ne se donnera pas même la peine d'examiner la question, de lire ce dont on parle sciemment sans l'avoir lu! Tout mensonge répété devient une vérité: on ne saurait avoir trop de mépris pour les opinions humaines.
Lord J. Russell[185] fit, le 25 d'avril, à la Chambre des communes, une motion sur l'état de la représentation nationale dans le Parlement: M. Canning la combattit. Celui-ci proposa à son tour un bill pour rapporter une partie de l'acte qui prive les pairs catholiques de leur droit de voter et de siéger à la Chambre. J'assistai à ces séances sur le sac de laine où le speaker m'avait fait asseoir. M. Canning assistait en 1822 à la séance de la Chambre des pairs qui rejeta son bill; il fut blessé d'une phrase du vieux chancelier[186]; celui-ci, parlant de l'auteur du bill, s'écria (p. 243) avec dédain: «On assure qu'il part pour les Indes: ah! qu'il aille, ce beau gentleman (this fine gentleman)! qu'il aille! bon voyage!» M. Canning me dit en sortant: «Je le retrouverai.»
Lord Holland[187] discourut très bien, sans rappeler toutefois M. Fox. Il tournait sur lui-même, en sorte qu'il présentait souvent le dos à l'assemblée et qu'il adressait ses phrases à la muraille. On criait: «Hear! hear!» On n'était point choqué de cette originalité.
En Angleterre, chacun s'exprime comme il peut; l'avocasserie est inconnue; rien ne se ressemble ni dans la voix ni dans la déclamation des orateurs. On écoute avec patience; on ne se choque pas quand le parleur n'a aucune facilité: qu'il bredouille, qu'il ânonne, qu'il cherche ses mots, on trouve qu'il a fait a fine speech s'il a dit quelques phrases de bon sens. Cette variété d'hommes restés tels que la nature les a faits finit par être agréable; elle rompt la monotonie. (p. 244) Il est vrai qu'il n'y a qu'un petit nombre de lords et de membres de la Chambre des communes à se lever. Nous, toujours placés sur un théâtre, nous pérorons et gesticulons en sérieuses marionnettes. Ce m'était une étude utile que ce passage de la secrète et silencieuse monarchie de Berlin à la publique et bruyante monarchie de Londres: on pouvait retirer quelque instruction du contraste de deux peuples aux deux extrémités de l'échelle.
L'arrivée du roi, la rentrée du parlement, l'ouverture de la saison des fêtes, mêlaient les devoirs, les affaires et les plaisirs: on ne pouvait rencontrer les ministres qu'à la cour, au bal ou au parlement. Pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Sa Majesté, je dînais chez lord Londonderry, je dînais sur la galère du lord-maire, qui remontait jusqu'à Richmond: j'aime mieux le Bucentaure en miniature à l'arsenal de Venise, ne portant plus que le souvenir des doges et un nom virgilien. Jadis émigré, maigre et demi-nu, je m'étais amusé, sans être Scipion, à jeter des pierres dans l'eau, le long de cette rive que rasait la barque dodue et bien fourrée du Lord Mayor.
Je dînais aussi dans l'est de la ville chez M. Rothschild de Londres, de la branche cadette de Salomon: où ne dînais-je pas? Le roast-beef égalait la prestance de la tour de Londres; les poissons étaient si longs qu'on n'en voyait pas la queue; des dames, que je n'ai aperçues que là, chantaient comme Abigaïl[188]. (p. 245) J'avalais le tokai non loin des lieux qui me virent sabler l'eau à pleine cruche et quasi mourir de faim; couché au fond de ma moelleuse voiture, sur de petits matelas de soie, j'apercevais ce Westminster dans lequel j'avais passé une nuit enfermé, et autour duquel je m'étais promené tout crotté avec Hingant et Fontanes. Mon hôtel, qui me coûtait 30,000 francs de loyer, était en regard du grenier qu'habita mon cousin de la Boüétardais, lorsque, en robe rouge, il jouait de la guitare sur un grabat emprunté, auquel j'avais donné asile auprès du mien.
Il ne s'agissait plus de ces sauteries d'émigrés où nous dansions au son du violon d'un conseiller du parlement de Bretagne; c'était Almack's dirigé par Colinet qui faisait mes délices; bal public sous le patronage des plus grandes dames du West-end. Là se rencontraient les vieux et les jeunes dandys. Parmi les vieux brillait le vainqueur de Waterloo, qui promenait sa gloire comme un piège à femmes tendu à travers les quadrilles; à la tête des jeunes se distinguait lord Clanwilliam[189], fils, disait-on, du duc de Richelieu. Il faisait des choses admirables: il courait à cheval à Richmond et revenait à Almack's après être tombé deux fois. Il avait une certaine façon de prononcer à la manière d'Alcibiade, qui ravissait. Les modes des mots, les affectations de langage et de prononciation, changeant dans la haute société de (p. 246) Londres presque à chaque session parlementaire, un honnête homme est tout ébahi de ne plus savoir l'anglais, qu'il croyait savoir six mois auparavant. En 1822 le fashionable devait offrir au premier coup d'œil un homme malheureux et malade; il devait avoir quelque chose de négligé dans sa personne, les ongles longs, la barbe non pas entière, non pas rasée, mais grandie un moment par surprise, par oubli, pendant les préoccupations du désespoir; mèche de cheveux au vent, regard profond, sublime, égaré et fatal; lèvres contractées en dédain de l'espèce humaine; cœur ennuyé, byronien, noyé dans le dégoût et le mystère de l'être.
Aujourd'hui ce n'est plus cela: le dandy doit avoir un air conquérant, léger, insolent; il doit soigner sa toilette, porter des moustaches ou une barbe taillée en rond comme la fraise de la reine Élisabeth, ou comme le disque radieux du soleil; il décèle la fière indépendance de son caractère en gardant son chapeau sur sa tête, en se roulant sur les sofas, en allongeant ses bottes au nez des ladies assises en admiration sur des chaises devant lui; il monte à cheval avec une canne qu'il porte comme un cierge, indifférent au cheval qui est entre ses jambes par hasard. Il faut que sa santé soit parfaite, et son âme toujours au comble de cinq ou six félicités. Quelques dandys radicaux, les plus avancés vers l'avenir, ont une pipe.
Mais sans doute, toutes ces choses sont changées dans le temps même que je mets à les décrire. On dit que le dandy de cette heure ne doit plus savoir s'il existe, si le monde est là, s'il y a des femmes, et s'il doit saluer son prochain. N'est-il pas curieux de retrouver (p. 247) l'original du dandy sous Henri III: «Ces beaux mignons, dit l'auteur de l'Isle des Hermaphrodites, portoient les cheveux longuets, frisés et refrisés, remontans par-dessus leurs petits bonnets de velours, comme font les femmes, et leurs fraises de chemises de toile d'atour empesées et longues de demi-pied, de façon que voir leurs têtes dessus leurs fraises, il sembloit que ce fust le chef de saint Jean en un plat.»
Ils partent pour se rendre dans la chambre de Henri III, «branlant tellement le corps, la tête et les jambes, que je croyois à tout propos qu'ils dussent tomber de leur long... Ils trouvoient cette façon là de marcher plus belle que pas une autre.»
Tous les Anglais sont fous par nature ou par ton.
Lord Clanwilliam a passé vite: je l'ai retrouvé à Vérone; il est devenu après moi ministre d'Angleterre à Berlin. Nous avons suivi un moment la même route, quoique nous ne marchions pas du même pas.
Rien ne réussissait, à Londres, comme l'insolence, témoin d'Orsay[190], frère de la duchesse de Guiche: il (p. 248) s'était mis à galoper dans Hyde-Park, à sauter des barrières, à jouer, à tutoyer sans façon les dandys: il avait un succès sans égal, et, pour y mettre le comble, il finit par enlever une famille entière, père, mère et enfants.
Les ladies les plus à la mode me plaisaient peu; il y en avait une charmante cependant, lady Gwydir: elle ressemblait par le ton et les manières à une Française. Lady Jersey se maintenait encore en beauté. Je rencontrais chez elle l'opposition. Lady Conyngham appartenait à l'opposition, et le roi lui-même (p. 249) gardait un secret penchant pour ses anciens amis. Parmi les patronesses d'Almack's, on remarquait l'ambassadrice de Russie.
La comtesse de Lieven[191] avait eu des histoires assez ridicules avec madame d'Osmond et George IV. Comme elle était hardie et passait pour être bien en cour, elle était devenue extrêmement fashionable. On lui croyait de l'esprit, parce qu'on supposait que son mari n'en avait pas; ce qui n'était pas vrai: M. de Lieven était fort supérieur à madame. Madame de Lieven, au visage aigu et mésavenant, est une femme commune, fatigante, aride, qui n'a qu'un seul genre de conversation, la politique vulgaire; du reste, elle ne sait rien, et elle cache la disette de ses idées sous l'abondance de ses paroles. Quand elle se trouve avec des gens de mérite, sa stérilité se tait; elle revêt sa (p. 250) nullité d'un air supérieur d'ennui, comme si elle avait le droit d'être ennuyée; tombée par l'effet du temps, et ne pouvant s'empêcher de se mêler de quelque chose, la douairière des congrès est venue de Vérone donner à Paris, avec la permission de MM. les magistrats de Pétersbourg, une représentation des puérilités diplomatiques d'autrefois. Elle entretient des correspondances privées, et elle a paru très forte en mariages manqués. Nos novices se sont précipités dans ses salons pour apprendre le beau monde et l'art des secrets; ils lui confient les leurs, qui, répandus par madame de Lieven, se changent en sourds cancans. Les ministres, et ceux qui aspirent à le devenir, sont tout fiers d'être protégés par une dame qui a eu l'honneur de voir M. de Metternich aux heures où le grand homme, pour se délasser du poids des affaires, s'amuse à effiloquer de la soie. Le ridicule attendait à Paris madame de Lieven. Un doctrinaire grave est tombé aux pieds d'Omphale: «Amour, tu perdis Troie.»
La journée de Londres était ainsi distribuée: à six heures du matin, on courait à une partie fine, consistant dans un premier déjeuner à la campagne; on revenait déjeuner à Londres; on changeait de toilette pour la promenade de Bond-Street ou de Hyde-Park; on se rhabillait pour dîner à sept heures et demie; on se rhabillait pour l'Opéra; à minuit, on se rhabillait pour une soirée ou pour un raout. Quelle vie enchantée! J'aurais préféré cent fois les galères. Le suprême bon ton était de ne pouvoir pénétrer dans les petits salons d'un bal privé, de rester dans l'escalier obstrué par la foule, et de se trouver nez à nez (p. 251) avec le duc de Somerset[192]; béatitude où je suis arrivé une fois. Les Anglais de la nouvelle race sont infiniment plus frivoles que nous; la tête leur tourne pour un shaw: si le bourreau de Paris se rendait à Londres, il ferait courir l'Angleterre. Le maréchal Soult n'a-t-il pas enthousiasmé les ladies[193], comme Blücher, de qui elles baisaient la moustache? Notre maréchal, qui n'est ni Antipater, ni Antigonus, ni Seleucus, ni Antiochus, ni Ptolémée, ni aucun des capitaines-rois d'Alexandre, est un soldat distingué, lequel a pillé l'Espagne en se faisant battre, et auprès de qui des capucins ont redîmé leur vie pour des tableaux. Mais il est vrai qu'il a publié, au mois de mars 1814, une furieuse proclamation contre Bonaparte, lequel il recevait en triomphe quelques jours après: il a fait depuis ses pâques à Saint-Thomas-d'Aquin. On montre pour un schilling, à Londres, sa vieille paire de bottes.
Toute renommée vient vite au bord de la Tamise et s'en va de même. En 1822, je trouvai cette grande ville plongée dans les souvenirs de Bonaparte; on était passé du dénigrement pour Nic à un enthousiasme bête. Les mémoires de Bonaparte pullulaient; son buste ornait toutes les cheminées; ses gravures brillaient sur toutes les fenêtres des marchands (p. 252) d'images; sa statue colossale, par Canova, décorait l'escalier du duc de Wellington. N'aurait-on pu consacrer un autre sanctuaire à Mars enchaîné? Cette déification semble plutôt l'œuvre de la vanité d'un concierge que de l'honneur d'un guerrier.—Général, vous n'avez point vaincu Napoléon à Waterloo, vous avez seulement faussé le dernier anneau d'un destin déjà brisé[194].
Après ma présentation officielle à George IV, je le vis plusieurs fois. La reconnaissance des colonies espagnoles par l'Angleterre était à peu près décidée; du moins les vaisseaux de ces États indépendants paraissaient devoir être reçus sous leur pavillon dans les ports de l'empire britannique. Ma dépêche du 7 mai rend compte d'une conversation que j'avais eue avec lord Londonderry, et des idées de ce ministre, cette dépêche, importante pour les affaires d'alors, serait presque sans intérêt pour le lecteur d'aujourd'hui. Deux choses étaient à distinguer dans la position des colonies espagnoles relativement à l'Angleterre et à la France: les intérêts commerciaux et les intérêts politiques. J'entre dans les détails de ces intérêts. «Plus je vois le marquis de Londonderry, disais-je à M. de Montmorency, plus je lui trouve de finesse. (p. 253) C'est un homme plein de ressources, qui ne dit jamais que ce qu'il veut dire; on serait quelquefois tenté de le croire bonhomme. Il a dans la voix, le rire, le regard, quelque chose de M. Pozzo di Borgo. Ce n'est pas précisément la confiance qu'il inspire.» La dépêche finit ainsi: «Si l'Europe est obligée de reconnaître les gouvernements de fait en Amérique, toute sa politique doit tendre à faire naître des monarchies dans le nouveau monde, au lieu de ces républiques révolutionnaires qui nous enverrons leurs principes avec les produits de leur sol.
«En lisant cette dépêche, monsieur le vicomte, vous éprouverez sans doute comme moi un mouvement de satisfaction. C'est déjà avoir fait un grand pas en politique que d'avoir forcé l'Angleterre à vouloir s'associer avec nous dans des intérêts sur lesquels elle n'eût pas daigné nous consulter il y a six mois. Je me félicite en bon Français de tout ce qui tend à replacer notre patrie à ce haut rang qu'elle doit occuper parmi les nations étrangères.»
Cette lettre était la base de toutes mes idées et de toutes les négociations sur les affaires coloniales dont je m'occupai pendant la guerre d'Espagne, près d'un an avant que cette guerre éclatât.
Le 17 mai j'allai à Covent-Garden, dans la loge du duc d'York. Le roi parut. Ce prince, jadis détesté, fut salué par des acclamations telles qu'il n'en aurait pas autrefois reçu de semblables des moines, habitants de cet ancien couvent. Le 26, le duc d'York vint dîner à l'ambassade: George IV était fort tenté de me faire le (p. 254) même honneur; mais il craignait les jalousies diplomatiques de mes collègues.
Le vicomte de Montmorency refusa d'entrer en négociations sur les colonies espagnoles avec le cabinet de Saint-James. J'appris, le 19 mai, la mort presque subite de M. le duc de Richelieu[195]. Cet honnête homme avait supporté patiemment sa première retraite du ministère; mais les affaires venant à lui manquer trop longtemps, il défaillit parce qu'il n'avait pas une double vie pour remplacer celle qu'il avait perdue. Le grand nom de Richelieu n'a été transmis jusqu'à nous que par des femmes.
Les révolutions continuaient en Amérique. Je mandais à M. de Montmorency:
No 26. «Londres, 28 mai 1822.
«Le Pérou vient d'adopter une constitution monarchique. La politique européenne devrait mettre tous ses soins à obtenir un pareil résultat pour les colonies qui se déclarent indépendantes. Les États-Unis (p. 255) craignent singulièrement l'établissement d'un empire au Mexique. Si le nouveau monde tout entier est jamais républicain, les monarchies de l'ancien monde périront.»
On parlait beaucoup de la détresse des paysans irlandais, et l'on dansait afin de les consoler. Un grand bal paré à l'Opéra occupait les âmes sensibles. Le roi, m'ayant rencontré dans un corridor, me demanda ce que je faisais là, et, me prenant par le bras, il me conduisit dans sa loge.
Le parterre anglais était, dans mes jours d'exil, turbulent et grossier; des matelots buvaient de la bière au parterre, mangeaient des oranges, apostrophaient les loges. Je me trouvais un soir auprès d'un matelot entré ivre dans la salle; il me demanda où il était; je lui dis: «À Covent-Garden.—Pretty garden, indeed!» (Joli jardin, vraiment!) s'écria-t-il, saisi, comme les dieux d'Homère, d'un rire inextinguible.
Invité dernièrement à une soirée chez lord Lansdowne[196], Sa Majesté m'a présenté à une dame sévère, âgée de soixante-treize ans: elle était habillée de crêpe, portait un voile noir comme un diadème sur ses cheveux blancs, et ressemblait à une reine abdiquée. Elle me salua d'un ton solennel et de trois phrases estropiées du Génie du christianisme; puis elle me dit avec non moins de solennité: «Je suis mistress Siddons.» Si elle m'avait dit: «Je suis lady Macbeth,» je l'aurais cru. Je l'avais vue autrefois sur (p. 256) le théâtre dans toute la force de son talent[197]. Il suffit de vivre pour retrouver ces débris d'un siècle jetés par les flots du temps sur le rivage d'un autre siècle.
Mes visiteurs français à Londres furent M. le duc et madame la duchesse de Guiche[198], dont je vous parlerai à Prague; M. le marquis de Custine[199], dont j'avais vu l'enfance à Fervacques; et madame la vicomtesse de Noailles[200], aussi agréable, spirituelle et gracieuse que (p. 257) si elle eût encore erré à quatorze ans dans les beaux jardins de Méréville.
On était fatigué de fêtes; les ambassadeurs aspiraient à s'en aller en congé: le prince Esterhazy se préparait à partir pour Vienne; il espérait être appelé au congrès, car on parlait déjà d'un congrès. M. Rothschild retournait en France après avoir terminé avec son frère l'emprunt russe de 23 millions de roubles. Le duc de Bedford[201] s'était battu avec l'immense duc de Buckingham[202], au fond d'un trou, dans Hyde-Park; une chanson injurieuse contre le roi de France, envoyée de Paris et imprimée dans les gazettes de Londres, amusait la canaille radicale anglaise qui riait sans savoir de quoi.
Je partis le 6 juin pour Royal-Lodge où le roi était allé. Il m'avait invité à dîner et à coucher.
Je revis George IV le 12, le 13 et le 14, au lever, au drawing-room et au bal de sa Majesté. Le 24, je donnai (p. 258) une fête au prince et à la princesse de Danemarck: le duc d'York s'y était invité.
C'eût été une chose importante jadis que la bienveillance avec laquelle me traitait la marquise de Conyngham: elle m'apprit que l'idée du voyage de S. M. B. au continent n'était pas tout à fait abandonnée. Je gardai religieusement ce grand secret dans mon sein. Que de dépêches importantes sur cette parole d'une favorite au temps de mesdames de Verneuil, de Maintenon, des Ursins, de Pompadour! Du reste, je me serais échauffé mal à propos pour obtenir quelques renseignements de la cour de Londres: en vain vous parlez, on ne vous écoute pas.
Lord Londonderry surtout était impassible: il embarrassait à la fois par sa sincérité de ministre et sa retenue d'homme. Il expliquait franchement de l'air le plus glacé sa politique et gardait un silence profond sur les faits. Il avait l'air indifférent à ce qu'il disait comme à ce qu'il ne disait pas; on ne savait ce qu'on devait croire de ce qu'il montrait ou de ce qu'il cachait. Il n'aurait pas bougé quand vous lui auriez lâché un saucisson dans l'oreille, comme dit Saint-Simon.
Lord Londonderry avait un genre d'éloquence irlandaise qui souvent excitait l'hilarité de la Chambre des lords et la gaieté du public; ses blunders étaient célèbres, mais il arrivait aussi quelquefois à des traits d'éloquence qui transportaient la foule, comme ses paroles à propos de la bataille de Waterloo: je les ai rappelées.
Lord Harrowby était président du conseil; il parlait (p. 259) avec propriété, lucidité et connaissance des faits[203]. On trouverait inconvenant à Londres qu'un président des ministres s'exprimât avec prolixité et faconde. C'était d'ailleurs un parfait gentleman pour le ton. Un jour, aux Pâquis, à Genève, on m'annonça un Anglais: lord Harrowby entra; je ne le reconnus (p. 260) qu'avec peine: il avait perdu son ancien roi; le mien était exilé. C'est la dernière fois que l'Angleterre de mes grandeurs m'est apparue.
J'ai mentionné M. Peel[204] et lord Westmoreland[205] dans le Congrès de Vérone.
Je ne sais si lord Bathurst[206] descendait et s'il était petit-fils de ce comte Bathurst dont Sterne écrivait: «Ce seigneur est un prodige; à 80 ans il a l'esprit et la vivacité d'un homme de 30, une disposition à se laisser charmer et le pouvoir de plaire au delà de tout ce que je connais.» Lord Bathurst, le ministre dont je vous entretiens, était instruit et poli; il gardait la tradition des anciennes manières françaises de la bonne compagnie. Il avait trois ou quatre filles qui couraient, ou plutôt qui volaient comme des hirondelles de mer, le long des flots, blanches, allongées et légères. Que sont-elles devenues? Sont-elles tombées dans le Tibre avec la jeune Anglaise de leur nom?
(p. 261) Lord Liverpool[207] n'était pas, comme lord Londonderry, le principal ministre; mais c'était le ministre le plus influent et le plus respecté. Il jouissait de cette réputation d'homme religieux et d'homme de bien, si puissante pour celui qui la possède; on vient à cet homme avec la confiance que l'on a pour un père; nulle action ne paraît bonne si elle n'est approuvée de ce personnage saint, investi d'une autorité très supérieure à celle des talents. Lord Liverpool était fils de Charles Jenkinson, baron de Hawkesbury, comte de Liverpool, favori de lord Bute. Presque tous les hommes d'État anglais ont commencé par la carrière littéraire, par des pièces de vers plus ou moins bons, et par des articles, en général excellents, insérés dans les revues. Il reste un portrait de ce premier comte de Liverpool lorsqu'il était secrétaire particulier de lord Bute; sa famille en est fort affligée: cette vanité, puérile en tous temps, l'est sans doute encore beaucoup plus aujourd'hui; mais n'oublions pas que nos plus ardents révolutionnaires puisèrent leur haine de la société dans des disgrâces de nature ou dans des infériorités sociales.
Il est possible que lord Liverpool, enclin aux réformes, et à qui M. Canning a dû son dernier ministère, fût influencé, malgré la rigidité de ses principes religieux, par quelque déplaisance de souvenirs. À l'époque où j'ai connu lord Liverpool, il était presque arrivé à l'illumination puritaine. Habituellement il demeurait seul avec une vieille sœur, à quelques (p. 262) lieues de Londres. Il parlait peu; son visage était mélancolique; il penchait souvent l'oreille, et il avait l'air d'écouter quelque chose de triste: on eût dit qu'il entendait tomber ses dernières années, comme les gouttes d'une pluie d'hiver sur le pavé. Du reste, il n'avait aucune passion, et il vivait selon Dieu.
M. Croker[208], membre de l'Amirauté, célèbre comme (p. 263) orateur et comme écrivain, appartenait à l'école de M. Pitt, ainsi que M. Canning; mais il était plus détrompé que celui-ci. Il occupait à White-Hall un de ces appartements sombres d'où Charles 1er était sorti par une fenêtre pour aller de plain-pied à l'échafaud. On est étonné quand on entre à Londres dans les habitations où siègent les directeurs de ces établissements dont le poids se fait sentir au bout de la terre. Quelques hommes en redingote noire devant une table nue, voilà tout ce que vous rencontrez: ce sont pourtant là les directeurs de la marine anglaise, ou les membres de cette compagnie de marchands, successeurs des empereurs du Mogol, lesquels comptent aux Indes deux cents millions de sujets.
M. Croker vint, il y a deux ans, me visiter à l'Infirmerie de Marie-Thérèse. Il m'a fait remarquer la similitude de nos opinions et de nos destinées. Des événements nous séparent du monde; la politique fait des solitaires, comme la religion fait des anachorètes. Quand l'homme habite le désert, il trouve en lui quelque lointaine image de l'être infini qui, vivant seul dans l'immensité, voit s'accomplir les révolutions des mondes.
Dans le courant des mois de juin et de juillet, les affaires d'Espagne commencèrent à occuper sérieusement le cabinet de Londres. Lord Londonderry et la plupart des ambassadeurs montraient en parlant de ces affaires une inquiétude et presque une peur risible. (p. 264) Le ministère craignait qu'en cas de rupture nous ne l'emportassions sur les Espagnols; les ministres des autres puissances tremblaient que nous ne fussions battus; ils voyaient toujours notre armée prenant la cocarde tricolore.
Dans ma dépêche du 28 juin, no 35, les dispositions de l'Angleterre sont fidèlement exprimées:
No 35 «Londres, ce 28 juin 1822.
«Monsieur le vicomte,
«Il m'a été plus difficile de vous dire ce que pense lord Londonderry, relativement à l'Espagne, qu'il ne me sera aisé de pénétrer le secret des instructions données à Sir W. A'Court[209]; cependant je ne négligerai rien pour me procurer les renseignements que vous demandez par votre dernière dépêche, no 18. Si j'ai bien jugé de la politique du cabinet anglais et du caractère de lord Londonderry, je suis persuadé que Sir W. A'Court n'a presque rien emporté d'écrit. On lui aura recommandé verbalement d'observer les partis sans se mêler de leurs querelles. Le cabinet de Saint-James n'aime point les Cortès, mais il méprise Ferdinand. Il ne fera certainement rien pour les royalistes. D'ailleurs, il suffirait que notre influence s'exerçât sur une opinion pour que l'influence anglaise appuyât l'opinion contraire. Notre prospérité renaissante inspire une vive jalousie. Il y a bien ici, parmi les hommes d'État, une certaine crainte vague des passions révolutionnaires qui travaillent l'Espagne; (p. 265) mais cette crainte se tait devant les intérêts particuliers: de telle sorte que si d'un coté la Grande-Bretagne pouvait exclure nos marchandises de la Péninsule, et que de l'autre elle pût reconnaître l'indépendance des colonies espagnoles, elle prendrait facilement son parti sur les événements, et se consolerait des malheurs qui pourraient accabler de nouveau les monarchies continentales. Le même principe qui empêche l'Angleterre de retirer son ambassadeur de Constantinople lui fait envoyer un ambassadeur à Madrid: elle se sépare des destinées communes, et n'est attentive qu'au parti qu'elle pourra tirer des révolutions des empires.
«J'ai l'honneur, etc.»
Revenant dans ma dépêche du 16 juillet, no 40, sur les nouvelles d'Espagne, je dis à M. de Montmorency:
No 40. «Londres, ce 16 juillet 1822.
«Monsieur le vicomte,
«Les journaux anglais, d'après les journaux français, donnent ce matin des nouvelles de Madrid jusqu'au 8 inclusivement. Je n'ai jamais espéré mieux du roi d'Espagne, et n'ai point été surpris. Si ce malheureux prince doit périr, le genre de la catastrophe n'est pas indifférent au reste du monde: le poignard n'abattrait que le monarque, l'échafaud pourrait tuer la monarchie. C'est déjà beaucoup trop que le jugement de Charles Ier et (p. 266) que celui de Louis XVI: le ciel nous préserve d'un troisième jugement qui semblerait établir par l'autorité des crimes une espèce de droit des peuples et un corps de jurisprudence contre les rois! On peut maintenant s'attendre à tout: une déclaration de guerre de la part du gouvernement espagnol est au nombre des chances que le gouvernement français a dû prévoir. Dans tous les cas, nous serons bientôt obligés d'en finir avec le cordon sanitaire, car, une fois le mois de septembre passé, et la peste ne reparaissant pas à Barcelone, ce serait une véritable dérision que de parler encore d'un cordon sanitaire; il faudrait donc avouer tout franchement une armée, et dire la raison qui nous oblige à maintenir cette armée. Cela n'équivaudra-t-il pas à une déclaration de guerre aux Cortès? D'un autre côté, dissoudrons-nous le cordon sanitaire? Cet acte de faiblesse compromettrait la sûreté de la France, avilirait le ministère, et ranimerait parmi nous les espérances de la faction révolutionnaire.
«J'ai l'honneur d'être, etc., etc., etc.»
Depuis le Congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, les princes de l'Europe avaient la tête tournée de congrès: c'était là qu'on s'amusait et qu'on se partageait quelques peuples. À peine le Congrès commencé à Laybach et continué à Troppau était-il fini, qu'on songea à en convoquer un autre à Vienne, à Ferrare ou à Vérone, les affaires d'Espagne offraient l'occasion d'en hâter le moment. Chaque cour avait déjà désigné son ambassadeur.
(p. 267) Je voyais à Londres tout le monde se préparer à partir pour Vérone: comme ma tête était remplie des affaires d'Espagne, et comme je rêvais un plan pour l'honneur de la France, je croyais pouvoir être de quelque utilité au nouveau Congrès en me faisant connaître sous un rapport auquel on ne songeait pas. J'avais écrit dès le 24 mai à M. de Montmorency; mais je ne trouvai aucune faveur. La longue réponse du ministre est évasive, embarrassée, entortillée; un éloignement marqué pour moi s'y déguise mal sous la bienveillance; elle finit par ce paragraphe:
«Puisque je suis en train de confidences, noble vicomte, je veux vous dire ce que je ne voudrais pas insérer dans une dépêche officielle, mais ce que m'ont inspiré quelques observations personnelles, et quelques avis aussi de personnes qui connaissent bien le terrain sur lequel vous êtes placé. N'avez-vous pas pensé le premier qu'il faut soigner, vis-à-vis du ministère anglais, certains effets de la jalousie et de l'humeur qu'il est toujours prêt à concevoir sur les marques directes de faveur auprès du roi, et de crédit dans la société? Vous me direz s'il ne vous est pas arrivé d'en remarquer quelques traces.»
Par qui les plaintes de mon crédit auprès du roi et dans la société (c'est-à-dire, je suppose, auprès de la marquise de Conyngham) étaient-elles arrivées au vicomte de Montmorency? Je l'ignore.
Prévoyant, par cette dépêche privée, que ma partie était perdue du côté du ministre des affaires étrangères, je m'adressai à M. de Villèle, alors mon ami, et qui n'inclinait pas beaucoup vers son collègue. (p. 268) Dans sa lettre du 5 mai 1822, il me répondit d'abord un mot favorable.
«Paris, le 5 mai 1822.
«Je vous remercie, me dit-il, de tout ce que vous faites pour nous à Londres; la détermination de cette cour au sujet des colonies espagnoles ne peut influer sur la nôtre; la position est bien différente; nous devons éviter par-dessus tout d'être empêchés, par une guerre avec l'Espagne, d'agir ailleurs comme nous le devons, si les affaires de l'Orient amenaient de nouvelles combinaisons politiques en Europe.
«Nous ne laisserons pas déshonorer le gouvernement français par le défaut de participation aux événements qui peuvent résulter de la situation actuelle du monde; d'autres pourront y intervenir avec plus d'avantages, aucun avec plus de courage et de loyauté.
On se méprend fort, je crois, et sur les moyens réels de notre pays, et sur le pouvoir que peut encore exercer le gouvernement du roi dans les formes qu'il s'est prescrites; elles offrent plus de ressources qu'on ne paraît le croire, et j'espère qu'à l'occasion nous saurons le montrer.
«Vous nous seconderez, mon cher, dans ces grandes circonstances si elles se présentent. Nous le savons et nous y comptons; l'honneur sera pour tous, et ce n'est pas de ce partage dont il s'agit en ce moment, il se fera selon les services rendus; rivalisons tous de zèle à qui en rendra de plus signalés.
(p. 269) «Je ne sais en vérité si ceci tournera à un congrès, mais, en tout cas, je n'oublierai pas ce que vous m'avez dit.
«Jh. de Villèle.»
Sur ce premier mot de bonne entente, je fis presser le ministre des finances par madame la duchesse de Duras; elle m'avait déjà prêté l'appui de son amitié contre l'oubli de la cour en 1814. Elle reçut bientôt ce billet de M. de Villèle:
«Tout ce que nous disions est dit; tout ce qu'il est dans mon cœur et dans mon opinion de faire pour le bien public et pour mon ami est fait et sera fait, soyez-en certaine. Je n'ai besoin ni d'être prêché, ni d'être converti, je vous le répète; j'agis de conviction et de sentiment.
«Recevez, madame, l'hommage de mon affectueux respect.»
Ma dernière dépêche, en date du 9 août, annonçait à M. de Montmorency que lord Londonderry partirait du 15 au 20 pour Vienne. Le brusque et grand démenti aux projets des mortels me fut donné; je croyais n'avoir à entretenir le conseil du roi T. C. que des affaires humaines, et j'eus à lui rendre compte des affaires de Dieu:
«Londres, 12 août 1822, à 4 heures de l'après-midi
«Dépêche transmise à Paris par le télégraphe de Calais.
«Le marquis de Londonderry est mort subitement ce matin 12, à neuf heures du matin, dans sa maison de campagne de North-Cray.»
(p. 270) No 49. «Londres, 13 août 1822.
«Monsieur le vicomte,
«Si le temps n'a pas mis obstacle à ma dépêche télégraphique, et s'il n'est point arrivé d'accident à mon courrier extraordinaire, expédié hier à quatre heures, j'espère que vous avez reçu le premier sur le continent la nouvelle de la mort subite de Lord Londonderry.
«Cette mort a été extrêmement tragique. Le noble marquis était à Londres vendredi; il sentit sa tête un peu embarrassée; il se fit saigner entre les épaules. Après quoi il partit pour North-Cray, où la marquise de Londonderry était établie depuis un mois. La fièvre se déclara le samedi 10 et le dimanche 11; mais elle parut céder dans la nuit du dimanche au lundi, et, lundi matin 12, le malade semblait si bien, que sa femme, qui le gardait, crut pouvoir le quitter un moment. Lord Londonderry, dont la tête était égarée, se trouvant seul, se leva, passa dans un cabinet, saisit un rasoir, et du premier coup se coupa la jugulaire. Il tomba baigné dans son sang aux pieds d'un médecin qui venait à son secours.
«On cache autant qu'on le peut cet accident déplorable, mais il est parvenu défiguré à la connaissance du public et a donné naissance à des bruits de toute espèce.
«Pourquoi Londonderry aurait-il attenté à ses jours? Il n'avait ni passions ni malheurs; il était plus que jamais affermi dans sa place. Il se préparait à partir jeudi prochain. Il se faisait une partie (p. 271) de plaisir d'un voyage d'affaires. Il devait être de retour le 15 octobre pour des chasses arrangées d'avance et auxquelles il m'avait invité. La Providence en a ordonné autrement, et Lord Londonderry a suivi le duc de Richelieu.»
Voici quelques détails qui ne sont point entrés dans mes dépêches.
À son retour à Londres, George IV me raconta que lord Londonderry était allé lui porter le projet d'instruction qu'il avait rédigé pour lui-même, et qu'il devait suivre au Congrès. George IV prit le manuscrit pour mieux en peser les termes, et commença à le lire à haute voix. Il s'aperçut que lord Londonderry ne l'écoutait pas, et qu'il promenait ses yeux sur le plafond du cabinet: «Qu'avez-vous donc, mylord? dit le roi.—Sire, répondit le marquis, c'est cet insupportable John (un jockey) qui est à la porte; il ne veut pas s'en aller, quoique je ne cesse de le lui ordonner.» Le roi, étonné, ferma le manuscrit et dit: «Vous êtes malade, mylord: retournez chez vous; faites-vous saigner.» Lord Londonderry sortit et alla acheter le canif avec lequel il se coupa la gorge.
Le 15 août, je continuai mes dires à M. de Montmorency:
«On a envoyé des courriers de toutes parts, aux eaux, aux bains de mer, dans les châteaux, pour chercher les ministres absents. Au moment où l'accident est arrivé, aucun d'eux n'était à Londres. On les attend aujourd'hui ou demain; ils tiendront un conseil, mais ils ne pourront rien décider, car, en dernier résultat, c'est le roi qui leur nommera un collègue, et le roi est à Édimbourg. Il est probable (p. 272) que Sa Majesté britannique ne se pressera pas de faire un choix au milieu des fêtes. La mort du marquis de Londonderry est funeste à l'Angleterre: il n'était pas aimé, mais il était craint; les radicaux le détestaient, mais ils avaient peur de lui. Singulièrement brave, il imposait à l'opposition qui n'osait pas trop l'insulter à la tribune et dans les journaux. Son imperturbable sang-froid, son indifférence profonde pour les hommes et pour les choses, son instinct de despotisme et son mépris secret pour les libertés constitutionnelles, en faisaient un ministre propre à lutter avec succès contre les penchants du siècle. Ses défauts devenaient des qualités à une époque où l'exagération et la démocratie menacent le monde.
«J'ai l'honneur, etc.»
«Londres, 15 août 1822.
«Monsieur le vicomte,
«Les renseignements ultérieurs ont confirmé ce que j'ai eu l'honneur de vous dire sur la mort du marquis de Londonderry, dans ma dépêche ordinaire d'avant-hier, no 49. Seulement, l'instrument fatal avec lequel l'infortuné ministre s'est coupé la veine jugulaire est un canif, et non pas un rasoir comme je vous l'avais mandé. Le rapport du coroner, que vous lirez dans les journaux, vous instruira de tout. Cette enquête, faite sur le cadavre du premier ministre de la Grande-Bretagne, comme sur le corps d'un meurtrier, ajoute encore quelque chose de plus affreux à cet événement.
(p. 273) «Vous savez sans doute à présent, monsieur le vicomte, que lord Londonderry avait donné des preuves d'aliénation mentale quelques jours avant son suicide, et que le roi même s'en était aperçu. Une petite circonstance à laquelle je n'avais pas fait attention, mais qui m'est revenue en mémoire depuis la catastrophe, mérite d'être racontée. J'étais allé voir le marquis de Londonderry, il y a douze ou quinze jours. Contre son usage et les usages du pays, il me reçut avec familiarité dans son cabinet de toilette. Il allait se raser, et il me fit en riant d'un rire à demi sardonique l'éloge des rasoirs anglais. Je le complimentai sur la clôture prochaine de la session. Oui, dit-il, il faut que cela finisse ou que je finisse.
«J'ai l'honneur, etc.»
Tout ce que les radicaux d'Angleterre et les libéraux de France ont raconté de la mort de lord Londonderry, à savoir: qu'il s'était tué par désespoir politique, sentant que les principes opposés aux siens allaient triompher, est une pure fable inventée par l'imagination des uns, l'esprit de parti et la niaiserie des autres. Lord Londonderry n'était pas homme à se repentir d'avoir péché contre l'humanité, dont il ne se souciait guère, ni envers les lumières du siècle, pour lesquelles il avait un profond mépris: la folie était entrée par les femmes dans la famille Castlereagh.
Il fut décidé que le duc de Wellington, accompagné de lord Clanwilliam, prendrait la place de lord Londonderry au Congrès. Les instructions officielles se (p. 274) réduisaient à ceci: oublier entièrement l'Italie, ne se mêler en rien des affaires d'Espagne, négocier pour celles de l'Orient en maintenant la paix sans accroître l'influence de la Russie. Les chances étaient toujours pour M. Canning, et le portefeuille des affaires étrangères était confié par intérim à lord Bathurst, ministre des colonies.
J'assistai aux funérailles de lord Londonderry, à Westminster, le 20 août[210]. Le duc de Wellington paraissait ému; lord Liverpool était obligé de se couvrir le visage de son chapeau pour cacher ses larmes. On entendit au dehors quelques cris d'insulte et de joie lorsque le corps entra dans l'église[211]: Colbert et Louis XIV furent-ils plus respectés? Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts; les morts, au contraire, instruisent les vivants.
(p. 275) LETTRE DE M. DE MONTMORENCY.
«Paris, ce 17 août.
«Quoiqu'il n'y ait pas de dépêches bien importantes à confier à votre fidèle Hyacinthe, je veux cependant le faire repartir, noble vicomte, d'après votre propre désir et celui qu'il m'a exprimé, de la part de madame de Chateaubriand, de le voir promptement retourner auprès de vous. J'en profiterai pour vous adresser quelques mots plus confidentiels sur la profonde impression que nous avons reçue, comme à Londres, de cette terrible mort du marquis de Londonderry, et aussi, par la même occasion, sur une affaire à laquelle vous semblez mettre un intérêt bien exagéré et bien exclusif. Le conseil du roi en a profité et a fixé à ces jours-ci, immédiatement après la clôture qui a eu lieu ce matin même, la discussion des directions principales à arrêter, des instructions à donner, de même des personnes à choisir: la première question est de savoir si elles seront une ou plusieurs. Vous avez exprimé quelque part, ce me semble, de l'étonnement que l'on pût songer à..., non pas à vous préférer à lui, vous savez très bien qu'il ne peut pas être sur la même ligne pour nous. Si, après le plus mûr examen, nous ne croyions pas possible de mettre à profit la bonne volonté que vous nous avez montrée très franchement à cet égard, il faudrait sans doute pour nous déterminer de graves motifs que je vous communiquerais avec la même franchise: l'ajournement est plutôt favorable à votre désir, en ce (p. 276) sens qu'il serait tout à fait inconvenable, et pour vous et pour nous, que vous quittassiez Londres d'ici à quelques semaines et avant la décision ministérielle qui ne laisse pas d'occuper tous les cabinets. Cela frappe tellement tout le monde que quelques amis me disaient l'autre jour: Si M. de Chateaubriand était venu tout de suite à Paris, il aurait été assez contrariant pour lui d'être obligé de repartir pour Londres. Nous attendons donc cette nomination importante au retour d'Édimbourg. Le chevalier Stuart[212] disait hier que sûrement le duc de Wellington irait au Congrès; c'est ce qu'il nous importe de savoir le plus tôt possible. M. Hyde de Neuville est arrivé hier bien portant. J'ai été charmé de le voir. Je vous renouvelle, noble vicomte, tous mes inviolables sentiments.
«Montmorency.»
Cette nouvelle lettre de M. de Montmorency, mêlée de quelques phrases ironiques, me confirma pleinement qu'il ne voulait pas de moi au Congrès.
Je donnai un dîner le jour de la Saint-Louis en l'honneur de Louis XVIII, et j'allai voir Hartwell en mémoire de l'exil de ce roi; je remplissais un devoir plutôt que je ne jouissais d'un plaisir. Les infortunes royales sont maintenant si communes qu'on ne s'intéresse guère aux lieux que n'ont point habités le génie (p. 277) ou la vertu. Je ne vis dans le triste petit parc d'Hartwell que la fille de Louis XVI.
Enfin, je reçus tout à coup de M. de Villèle ce billet inattendu qui faisait mentir mes prévisions et mettait fin à mes incertitudes:
«27 août 1822.
«Mon cher Chateaubriand, il vient d'être arrêté qu'aussitôt que les convenances relatives au retour du roi à Londres vous le permettront, vous serez autorisé à vous rendre à Paris, pour de là pousser jusqu'à Vienne ou jusqu'à Vérone comme un des trois plénipotentiaires chargés de représenter la France au Congrès. Les deux autres seront MM. de Caraman et de la Ferronnays; ce qui n'empêche pas M. le vicomte de Montmorency de partir après-demain pour Vienne, afin d'y assister aux conférences qui pourront avoir lieu dans cette ville avant le Congrès. Il devra revenir à Paris lors du départ des souverains pour Vérone.
«Ceci pour vous seul. Je suis heureux que cette affaire ait pris la tournure que vous désiriez; de cœur tout à vous.»
D'après ce billet, je me préparai à partir.
Cette foudre qui tombe sans cesse à mes pieds me suivait partout. Avec lord Londonderry expira la vieille Angleterre, jusqu'alors se débattant au milieu des innovations croissantes. Survint M. Canning: l'amour-propre l'emporta jusqu'à parler à la tribune la langue du propagandiste. Après lui parut le duc de Wellington, conservateur qui venait démolir: quand (p. 278) l'arrêt des sociétés est prononcé, la main qui devait élever ne sait qu'abattre. Lord Grey[213], O'Connell[214], tous ces ouvriers en ruines, travaillèrent successivement à la chute des vieilles institutions. Réforme parlementaire, émancipation de l'Irlande, toutes choses excellentes en soi, devinrent, par l'insalubrité des temps, des causes de destruction. La peur accrut les maux: si l'on ne s'était pas si fort effrayé des menaces, on eût pu résister avec un certain succès.
Qu'avait besoin l'Angleterre de consentir à nos derniers troubles? Renfermée dans son île et dans ses inimitiés nationales, elle était à l'abri. Qu'avait besoin le cabinet de Saint-James de redouter la séparation de l'Irlande? L'Irlande n'est que la chaloupe de l'Angleterre: coupez la corde, et la chaloupe, séparée du grand navire, ira se perdre au milieu des flots. Lord Liverpool avait lui-même de tristes pressentiments. (p. 279) Je dînais un jour chez lui: après le repas nous causâmes à une fenêtre qui s'ouvrait sur la Tamise; on apercevait en aval de la rivière une partie de la cité dont le brouillard et la fumée élargissaient la masse. Je faisais à mon hôte l'éloge de la solidité de cette monarchie anglaise pondérée par le balancement égal de la liberté et du pouvoir. Le vénérable lord, levant et allongeant le bras, me montra de la main la cité et me dit: «Qu'y a-t-il de solide avec ces villes énormes? Une insurrection sérieuse à Londres, et tout est perdu.»
Il me semble que j'achève une course en Angleterre, comme celle que je fis autrefois sur les débris d'Athènes, de Jérusalem, de Memphis et de Carthage. En appelant devant moi les siècles d'Albion, en passant de renommée en renommée, en les voyant s'abîmer tour à tour, j'éprouve une espèce de douloureux vertige. Que sont devenus ces jours éclatants et tumultueux où vécurent Shakespeare et Milton, Henri VIII et Élisabeth, Cromwell et Guillaume, Pitt et Burke? Tout cela est fini; supériorités et médiocrités, haines et amours, félicités et misères, oppresseurs et opprimés, bourreaux et victimes, rois et peuples, tout dort dans le même silence et la même poussière. Quel néant sommes-nous donc, s'il en est ainsi de la partie la plus vivante de l'espèce humaine, du génie qui reste comme une ombre des vieux temps dans les générations présentes, mais qui ne vit plus par lui-même, et qui ignore s'il a jamais été!
Combien de fois l'Angleterre, dans l'espace de quelques cents ans, a-t-elle été détruite? À travers combien de révolutions n'a-t-elle point passé pour arriver (p. 280) au bord d'une révolution plus grande, plus profonde et qui enveloppera la postérité! J'ai vu ces fameux parlements britanniques dans toute leur puissance: que deviendront-ils? J'ai vu l'Angleterre dans ses anciennes mœurs et dans son ancienne prospérité: partout la petite église solitaire avec sa tour, le cimetière de campagne de Gray, partout des chemins étroits et sablés, des vallons remplis de vaches, des bruyères marbrées de moutons, des parcs, des châteaux, des villes: peu de grands bois, peu d'oiseaux, le vent de la mer. Ce n'étaient pas ces champs de l'Andalousie où je trouvais les vieux chrétiens et les jeunes amours parmi les débris voluptueux du palais des Mores au milieu des aloès et des palmiers.
Quid dignum memorare tuis, Hispania, terris
Vox humana valet?
«Quelle voix humaine, ô Espagne! est digne de remémorer tes rivages?[215]»
Ce n'était pas là cette Campagne romaine dont le charme irrésistible me rappelle sans cesse; ces flots (p. 281) et ce soleil n'étaient pas ceux qui baignent et éclaire le promontoire sur lequel Platon enseignait ses disciples, ce Sunium où j'entendis chanter le grillon demandant en vain à Minerve le foyer des prêtres de son temple; mais enfin, telle qu'elle était, cette Angleterre, entourée de ses navires, couverte de ses troupeaux et professant le culte de ses grands hommes, était charmante et redoutable.
Aujourd'hui ses vallées sont obscurcies par les fumées des forges et des usines, ses chemins changés en ornières de fer; et sur ces chemins, au lieu de Milton et de Shakespeare, se meuvent des chaudières errantes. Déjà les pépinières de la science, Oxford et Cambridge, prennent un air désert: leurs collèges et leurs chapelles gothiques, demi-abandonnés, affligent les regards; dans leurs cloîtres, auprès des pierres sépulcrales du moyen âge, reposent oubliées les annales de marbre des anciens peuples de la Grèce; ruines qui gardent les ruines.
À ces monuments, autour desquels commençait à se former le vide, je laissais la partie des jours printaniers que j'avais retrouvée; je me séparais une seconde fois de ma jeunesse, au même bord où je l'avais abandonnée autrefois: Charlotte avait tout à coup réapparu comme cet astre, la joie des ombres, qui, retardé par le cours des mois, se lèverait au milieu de la nuit. Si vous n'êtes pas trop las, cherchez dans ces Mémoires l'effet que produisit sur moi en 1822 la vision subite de cette femme. Lorsqu'elle m'avait remarqué autrefois, je ne connaissais point ces autres Anglaises dont la troupe venait de m'environner à l'heure de mon renom et de ma puissance: leurs hommages (p. 282) ont eu la légèreté de ma fortune. Aujourd'hui, après seize nouvelles années évanouies depuis mon ambassade de Londres, après tant de nouvelles destructions, mes regards se reportent sur la fille du pays de Desdémone et de Juliette: elle ne compte plus dans ma mémoire que du jour où sa présence inattendue ralluma le flambeau de mes souvenirs. Nouvel Épiménide, réveillé après un long sommeil, j'attache mes regards sur un phare d'autant plus radieux que les autres sont éteints sur le rivage; un seul excepté brillera longtemps après moi.
Je n'ai point achevé tout ce qui concerne Charlotte dans les pages précédentes de ces Mémoires: elle vint avec une partie de sa famille me voir en France, lorsque j'étais ministre en 1823. Par une de ces misères inexplicables de l'homme, préoccupé que j'étais d'une guerre d'où dépendait le sort de la monarchie française, quelque chose sans doute aura manqué à ma voix, puisque Charlotte, retournant en Angleterre, me laissa une lettre dans laquelle elle se montre blessée de la froideur de ma réception. Je n'ai osé ni lui écrire ni lui renvoyer des fragments littéraires qu'elle m'avait rendus et que j'avais promis de lui remettre augmentés. S'il était vrai qu'elle eût eu une raison véritable de se plaindre, je jetterais au feu ce que j'ai raconté de mon premier séjour outre-mer.
Souvent il m'est venu en pensée d'aller éclaircir mes doutes; mais pourrais-je retourner en Angleterre, moi qui suis assez faible pour n'oser visiter le rocher paternel sur lequel j'ai marqué ma tombe? J'ai peur maintenant des sensations: le temps, en m'enlevant mes jeunes années, m'a rendu semblable à ces soldats (p. 283) dont les membres sont restés sur le champ de bataille; mon sang, ayant un chemin moins long à parcourir se précipite dans mon cœur avec une affluence si rapide que ce vieil organe de mes plaisirs et de mes douleurs palpite comme prêt à se briser. Le désir de brûler ce qui regarde Charlotte, bien qu'elle soit traitée avec un respect religieux, se mêle chez moi à l'envie de détruire ces Mémoires: s'ils m'appartenaient encore, ou si je pouvais les racheter, je succomberais à la tentation. J'ai un tel dégoût de tout, un tel mépris pour le présent et pour l'avenir immédiat[216], une si ferme persuasion que les hommes désormais, pris ensemble comme public (et cela pour plusieurs siècles), seront pitoyables, que je rougis d'user mes derniers moments au récit des choses passées, à la peinture d'un monde fini dont on ne comprendra plus le langage et le nom.
L'homme est aussi trompé par la réussite de ses vœux que par leur désappointement: j'avais désiré, contre mon instinct naturel, aller au Congrès; profitant d'une prévention à M. de Villèle, je l'avais amené à forcer la main de M. de Montmorency. Eh bien! mon vrai penchant n'était pas pour ce que j'avais obtenu; (p. 284) j'aurais eu sans doute quelque dépit si l'on m'eût contraint de rester en Angleterre; mais bientôt l'idée d'aller voir madame Sutton, de faire le voyage des trois royaumes, l'eût emporté sur le mouvement d'une ambition postiche qui n'adhère point à ma nature. Dieu en ordonna autrement et je partis pour Vérone: de là le changement de ma vie, de là mon ministère, la guerre d'Espagne, mon triomphe, ma chute, bientôt suivie de celle de la monarchie.
Un des deux beaux enfants pour lesquels Charlotte m'avait prié de m'intéresser en 1822 vient de venir me voir à Paris: c'est aujourd'hui le capitaine Sutton; il est marié à une jeune femme charmante, et il m'a appris que sa mère, très malade, a passé dernièrement un hiver à Londres.
Je m'embarquai à Douvres le 8 de septembre 1822, dans le même port d'où, vingt-deux ans auparavant, M. La Sagne, le Neuchâtelois, avait fait voile. De ce premier départ, au moment où je tiens la plume, trente-neuf années sont accomplies. Lorsqu'on regarde ou qu'on écoute sa vie passée, on croit voir sur une mer déserte la trace d'un vaisseau qui a disparu; on croit entendre les glas d'une cloche dont on n'aperçoit point la vieille tour.
Ici vient se placer dans l'ordre des dates le Congrès de Vérone, que j'ai publié en deux volumes à part[217]. Si on avait par hasard envie de le relire, on peut le trouver partout. Ma guerre d'Espagne, le grand événement (p. 285) politique de ma vie[218], était une gigantesque entreprise. La légitimité allait pour la première fois brûler de la poudre sous le drapeau blanc, tirer son premier coup de canon après ces coups de canon de l'empire qu'entendra la dernière postérité. Enjamber d'un pas les Espagnes, réussir sur le même sol où naguère les armées d'un conquérant avaient eu des revers, faire en six mois ce qu'il n'avait pu faire en sept ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige? C'est pourtant ce que j'ai fait; mais par combien de malédictions ma tête a été frappée à la table de jeu où la Restauration m'avait assis! J'avais devant moi une France ennemie des Bourbons et deux grands ministres étrangers, le prince de Metternich et M. Canning. Il ne se passait pas de jour que je ne reçusse des lettres qui m'annonçaient une catastrophe, car la guerre avec l'Espagne n'était pas du tout populaire, ni en France, ni en Europe. En effet, quelque temps après mes succès dans la Péninsule, ma chute ne tarda pas à arriver.
Dans notre ardeur après la dépêche télégraphique qui annonçait la délivrance du roi d'Espagne, nous autres ministres nous courûmes au château. Là j'eus un pressentiment de ma chute: je reçus sur la tête un seau d'eau froide qui me fit rentrer dans l'humilité de mes habitudes. Le roi et Monsieur ne nous aperçurent point. Madame la duchesse d'Angoulême, éperdue du triomphe de son mari, ne distinguait personne. Cette victime immortelle écrivit sur la délivrance de Ferdinand une lettre terminée par cette (p. 286) exclamation sublime dans la bouche de la fille de Louis XVI: «Il est donc prouvé qu'on peut sauver un roi malheureux!»
Le dimanche, je retournai avant le conseil faire ma cour à la famille royale; l'auguste princesse dit à chacun de mes collègues un mot obligeant: elle ne m'adressa pas une parole. Je ne méritais pas sans doute un tel honneur. Le silence de l'orpheline du Temple ne peut jamais être ingrat: le Ciel a droit aux adorations de la terre et ne doit rien à personne.
Je traînai ensuite jusqu'à la Pentecôte; pourtant mes amis n'étaient pas sans inquiétude; ils me disaient souvent: Vous serez renvoyé demain. Tout à l'heure si l'on veut, répondais-je. Le jour de la Pentecôte, 6 juin 1824, j'étais arrivé dans les premiers salons de Monsieur: un huissier vint me dire qu'on me demandait. C'était Hyacinthe, mon secrétaire. Il m'annonça en me voyant que je n'étais plus ministre. J'ouvris le paquet qu'il me présentait; j'y trouvai ce billet de M. de Villèle:
«Monsieur le vicomte,
«J'obéis aux ordres du roi en transmettant de suite à Votre Excellence une ordonnance que Sa Majesté vient de rendre.
«Le sieur comte de Villèle, président de notre conseil des ministres, est chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères, en remplacement du sieur vicomte de Chateaubriand.»
(p. 287) Cette ordonnance était écrite de la main de M. de Rainneville[219], assez bon pour en être encore embarrassé devant moi. Eh! mon Dieu! est-ce que je connais M. de Rainneville? Est-ce que j'ai jamais songé à lui? Je le rencontre assez souvent. S'est-il jamais aperçu que je savais que l'ordonnance qui m'avait rayé de la liste des ministres était écrite de sa main[220]?
Et pourtant qu'avais-je fait? Où étaient mes intrigues et mon ambition? Avais-je désiré la place de M. de Villèle en allant seul et caché me promener au fond du bois de Boulogne? Ce fut cette vie étrange qui me perdit. J'avais la simplicité de rester tel que le ciel m'avait fait, et, parce que je n'avais envie de rien, on crut que je voulais tout. Aujourd'hui, je conçois très bien que ma vie à part était une grande faute. Comment! vous ne voulez rien être? Allez-vous-en! Nous ne voulons pas qu'un homme méprise ce que nous adorons, et qu'il se croie en droit d'insulter à la médiocrité de notre vie.
Les embarras de la richesse et les inconvénients de la misère me suivirent dans mon logement de la rue de l'Université: le jour de mon congé, j'avais au ministère un immense dîner privé; il me fallut envoyer des excuses aux convives, et faire replier dans ma (p. 288) petite cuisine à deux maîtres trois grands services préparés pour quarante personnes. Montmirel et ses aides se mirent à l'ouvrage, et, nichant casseroles, lèchefrites et bassines dans tous les coins, il mit son chef-d'œuvre réchauffé à l'abri. Un vieil ami vint partager mon premier repas de matelot mis à terre. La ville et la cour accoururent, car il n'y eut qu'un cri sur l'outrecuidance de mon renvoi après le service que je venais de rendre; on était persuadé que ma disgrâce serait de courte durée; on se donnait l'air de l'indépendance en consolant un malheur de quelques jours, au bout desquels on rappellerait fructueusement à l'infortuné revenu en puissance qu'on ne l'avait point abandonné.
On se trompait; on en fut pour les frais de courage: on avait compté sur ma platitude, sur mes pleurnicheries, sur mon ambition de chien couchant, sur mon empressement à me déclarer moi-même coupable, à faire le pied de grue auprès de ceux qui m'avaient chassé: c'était mal me connaître. Je me retirai sans réclamer même le traitement qui m'était dû, sans recevoir ni une faveur ni une obole de la cour; je fermai ma porte à quiconque m'avait trahi; je refusai la foule condoléante et je pris les armes. Alors tout se dispersa; le blâme universel éclata, et ma partie, qui d'abord avait semblé belle aux salons et aux antichambres, parut effroyable.
Après mon renvoi, n'eussé-je pas mieux fait de me taire? La brutalité du procédé ne m'avait-elle pas fait revenir le public? M. de Villèle a répété que la lettre de destitution avait été retardée; par ce hasard, elle avait eu le malheur de ne m'être rendue qu'au (p. 289) château; peut-être en fut-il ainsi; mais, quand on joue, on doit calculer les chances de la partie; on doit surtout ne pas écrire à un ami de quelque valeur une lettre telle qu'on rougirait d'en adresser une semblable au valet coupable qu'on jetterait sur le pavé, sans convenances et sans remords. L'irritation du parti Villèle était d'autant plus grande contre moi, qu'il voulait s'approprier mon ouvrage, et que j'avais montré de l'entente dans des matières qu'on m'avait supposé ignorer.
Sans doute, avec du silence et de la modération (comme on disait), j'aurais été loué de la race en adoration perpétuelle du portefeuille; en faisant pénitence de mon innocence, j'aurais préparé ma rentrée au conseil. C'eût été mieux dans l'ordre commun; mais c'était me prendre pour l'homme que point ne suis; c'était me supposer le désir de ressaisir le timon de l'État, l'envie de faire mon chemin; désir et envie qui dans cent mille ans ne m'arriveraient pas.
L'idée que j'avais du gouvernement représentatif me conduisit à entrer dans l'opposition; l'opposition systématique me semble la seule propre à ce gouvernement; l'opposition surnommée de conscience est impuissante. La conscience peut arbitrer un fait moral, elle ne juge point d'un fait intellectuel. Force est de se ranger sous un chef, appréciateur des bonnes et des mauvaises lois. N'en est-il ainsi, alors tel député prend sa bêtise pour sa conscience et la met dans l'urne. L'opposition dite de conscience consiste à flotter entre les partis, à ronger son frein, à voter même, selon l'occurrence, pour le ministère, (p. 290) à se faire magnanime en enrageant; opposition d'imbécillités mutines chez les soldats, de capitulations ambitieuses parmi les chefs. Tant que l'Angleterre a été saine, elle n'a jamais eu qu'une opposition systématique: on entrait et l'on sortait avec ses amis; en quittant le portefeuille on se plaçait sur le banc des attaquants. Comme on était censé s'être retiré pour n'avoir pas voulu accepter un système, ce système étant resté près de la couronne devait être nécessairement combattu. Or, les hommes ne représentant que des principes, l'opposition systématique ne voulait emporter que les principes, lorsqu'elle livrait l'assaut aux hommes[221].
Ma chute fit grand bruit: ceux qui se montraient les plus satisfaits en blâmaient la forme. J'ai appris depuis que M. de Villèle hésita; M. de Corbière décida la question: «S'il rentre par une porte au conseil, (p. 291) dut-il dire, je sors par l'autre[222].» On me laissa sortir: il était tout simple qu'on me préférât M. de Corbière. Je ne lui en veux pas: je l'importunais, il m'a fait chasser: il a bien fait.
Le lendemain de mon renvoi et les jours suivants, on lut dans le Journal des Débats ces paroles si honorables pour MM. Bertin:
«C'est pour la seconde fois que M. de Chateaubriand subit l'épreuve dune destitution solennelle.
«Il fut destitué en 1816, comme ministre d'État, pour avoir attaqué, dans son immortel ouvrage de la Monarchie selon la Charte, la fameuse ordonnance du 5 septembre, qui prononçait la dissolution de la Chambre introuvable de 1815. MM. de Villèle et Corbière étaient alors de simples députés, chefs de l'opposition royaliste, et c'est pour avoir embrassé leur défense que M. de Chateaubriand devint la victime de la colère ministérielle.
«En 1824, M. de Chateaubriand est encore destitué, et c'est par MM. de Villèle et Corbière, devenus ministres, qu'il est sacrifié. Chose singulière! en 1816, il fut puni d'avoir parlé; en 1824, on le punit de s'être tu; son crime est d'avoir gardé le silence dans la discussion sur la loi des rentes. Toutes les (p. 292) disgrâces ne sont pas des malheurs; l'opinion publique, juge suprême, nous apprendra dans quelle classe il faut placer M. de Chateaubriand; elle nous apprendra aussi à qui l'ordonnance de ce jour aura été le plus fatale, ou du vainqueur ou du vaincu.
«Qui nous eût dit, à l'ouverture de la session, que nous gâterions ainsi tous les résultats de l'entreprise d'Espagne? Que nous fallait-il cette année? Rien que la loi sur la septennalité (mais la loi complète) et le budget. Les affaires de l'Espagne, de l'Orient et des Amériques, conduites comme elles l'étaient, prudemment et en silence, seraient éclaircies; le plus bel avenir était devant nous; on a voulu cueillir un fruit vert; il n'est pas tombé, et on a cru remédier à de la précipitation par de la violence.
«La colère et l'envie sont de mauvais conseillers; ce n'est pas avec les passions et en marchant par saccades que l'on conduit les États.
«P.-S. La loi sur la septennalité a passé, ce soir, à la Chambre des députés. On peut dire que les doctrines de M. de Chateaubriand triomphent après sa sortie du ministère. Cette loi, qu'il avait conçue depuis longtemps, comme complément de nos institutions, marquera à jamais, avec la guerre d'Espagne, son passage dans les affaires. On regrette bien vivement que M. de Corbière ait enlevé la parole, samedi, à celui qui était alors son illustre collègue. La Chambre des pairs aurait au moins entendu le chant du cygne.
«Quant à nous, c'est avec le plus vif regret que (p. 293) nous rentrons dans une carrière de combats, dont nous espérions être à jamais sortis par l'union des royalistes; mais l'honneur, la fidélité politique, le bien de la France, ne nous ont pas permis d'hésiter sur le parti que nous devions prendre.»
Le signal de la réaction fut ainsi donné. M. de Villèle n'en fut pas d'abord trop alarmé; il ignorait la force des opinions. Plusieurs années furent nécessaires pour l'abattre, mais enfin il tomba.
Je reçus du président du conseil une lettre qui réglait tout, et qui prouvait, à ma grande simplicité, que je n'avais rien pris de ce qui rend un homme respecté et respectable:
«Paris, 16 juin 1824.
«Monsieur le vicomte,
«Je me suis empressé de soumettre à Sa Majesté l'ordonnance par laquelle il vous est accordé décharge pleine et entière des sommes que vous avez reçues du trésor royal, pour dépenses secrètes, pendant tout le temps de votre ministère.
«Le roi a approuvé toutes les dispositions de cette ordonnance que j'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointe en original.
«Agréez, monsieur le vicomte, etc.»
Mes amis et moi, nous expédiâmes une prompte correspondance:
(p. 294) M. DE CHATEAUBRIAND À M. DE TALARU[223].
«Paris, 9 juin 1824.
«Je ne suis plus ministre, mon cher ami; on prétend que vous l'êtes. Quand je vous obtins l'ambassade de Madrid, je dis à plusieurs personnes qui s'en souviennent encore: «Je viens de nommer mon successeur.» Je désire avoir été prophète. C'est M. de Villèle qui a le portefeuille par intérim.
«Chateaubriand.»
M. DE CHATEAUBRIAND À M. DE RAYNEVAL[224].
«Paris, 16 juin 1824.
«J'ai fini, monsieur; j'espère que vous en avez encore pour longtemps. J'ai tâché que vous n'eussiez pas à vous plaindre de moi.
«Il est possible que je me retire à Neuchâtel, en Suisse; si cela arrive, demandez pour moi d'avance à Sa Majesté prussienne sa protection et ses bontés: offrez mon hommage au comte de Bernstorff, mes amitiés à M. Ancillon, et mes compliments à tous (p. 295) vos secrétaires. Vous, monsieur, je vous prie de croire à mon dévouement et à mon attachement très sincère.
«Chateaubriand.»
M. DE CHATEAUBRIAND À M. DE CARAMAN[225].
«Paris, 22 juin 1824.
«J'ai reçu, monsieur le marquis, vos lettres du 11 de ce mois. D'autres que moi vous apprendront la route que vous aurez à suivre désormais; si elle est conforme à ce que vous avez entendu, elle vous mènera loin. Il est probable que ma destitution fera grand plaisir à M. de Metternich pendant une quinzaine de jours.
«Recevez, monsieur le marquis, mes adieux et la nouvelle assurance de mon dévouement et de ma haute considération.
«Chateaubriand.»
M. DE CHATEAUBRIAND À M. HYDE DE NEUVILLE[226].
«Paris, le 22 juin 1824.
«Vous aurez sans doute appris ma destitution. Il ne me reste qu'à vous dire combien j'étais heureux (p. 296) d'avoir avec vous des relations que l'on vient de briser. Continuez, monsieur et ancien ami, à rendre des services à votre pays, mais ne comptez pas trop sur la reconnaissance, et ne croyez pas que vos succès soient une raison pour vous maintenir au poste où vous vous faites tant d'honneur.
«Je vous souhaite, monsieur, tout le bonheur que vous méritez, et je vous embrasse.
«P.-S.—Je reçois à l'instant votre lettre du 5 de ce mois, où vous m'apprenez l'arrivée de M. de Mérona. Je vous remercie de votre bonne amitié; soyez sûr que je n'ai cherché que cela dans vos lettres.
«Chateaubriand[227].»
(p. 297) M. DE CHATEAUBRIAND À M. LE COMTE DE SERRE[228].
«Paris, le 23 juin 1824.
«Ma destitution vous aura prouvé, monsieur le comte, mon impuissance à vous servir; il ne me reste qu'à faire des souhaits pour vous voir où vos talents vous appellent. Je me retire, heureux d'avoir contribué à rendre à la France son indépendance militaire et politique, et d'avoir introduit la septennalité dans son système électoral; elle n'est pas telle que je l'aurais voulue; le changement d'âge en était une conséquence nécessaire; mais enfin le principe est posé; le temps fera le reste, si toutefois il ne défait pas. J'ose me flatter, monsieur le comte, que vous n'avez pas eu à vous plaindre de nos relations; et moi je me féliciterai toujours d'avoir rencontré dans les affaires un homme de votre mérite.
«Recevez, avec mes adieux, etc.
«Chateaubriand.»
M. DE CHATEAUBRIAND À M. DE LA FERRONNAYS[229].
«Paris, le 24 juin 1824.
«Si par hasard vous étiez encore à Saint-Pétersbourg, monsieur le comte, je ne veux pas terminer notre correspondance sans vous dire toute l'estime et toute l'amitié que vous m'avez inspirées: portez-vous (p. 298) bien; soyez plus heureux que moi, et croyez que vous me retrouverez dans toutes les circonstances de la vie. J'écris un mot à l'empereur.
«Chateaubriand[230].»
La réponse à cet adieu m'arriva dans les premiers jours d'août. M. de La Ferronnays avait consenti aux fonctions d'ambassadeur sous mon ministère; plus tard je devins à mon tour ambassadeur sous le ministère de M. de La Ferronnays: ni l'un ni l'autre n'avons cru monter ou descendre. Compatriotes et amis, nous nous sommes rendu mutuellement justice. M. de La Ferronnays a supporté les plus rudes épreuves sans se plaindre; il est resté fidèle à ses souffrances et à sa noble pauvreté. Après ma chute, il a agi pour moi à Pétersbourg comme j'aurais agi pour lui: un honnête homme est toujours sûr d'être compris d'un (p. 299) honnête homme. Je suis heureux de produire ce touchant témoignage du courage, de la loyauté et de l'élévation d'âme de M. de La Ferronnays. Au moment où je reçus ce billet, il me fut une compensation très supérieure aux faveurs capricieuses et banales de la fortune. Ici seulement, pour la première fois, je crois devoir violer le secret honorable que me recommandait l'amitié.
M. DE LA FERRONNAYS À M. DE CHATEAUBRIAND.
«Saint-Pétersbourg, le 4 juillet 1824.
«Le courrier russe arrivé avant-hier m'a remis votre petite lettre du 16; elle devient pour moi une des plus précieuses de toutes celles que j'ai eu le bonheur de recevoir de vous; je la conserve comme un titre dont je m'honore, et j'ai la ferme espérance et l'intime conviction que bientôt je pourrai vous le présenter dans des circonstances moins tristes. J'imiterai, monsieur le vicomte, l'exemple que vous me donnez, et ne me permettrai aucune réflexion sur l'événement qui vient de rompre d'une manière si brusque et si peu attendue les rapports que le service établissait entre vous et moi; la nature même de ces rapports, la confiance dont vous m'honoriez, enfin des considérations bien plus graves, puisqu'elles ne sont pas exclusivement personnelles, vous expliqueront assez les motifs et toute l'étendue de mes regrets. Ce qui vient de se passer reste encore pour moi entièrement inexplicable; j'en ignore absolument les causes, mais j'en (p. 300) vois les effets; ils étaient si faciles, si naturels à prévoir, que je suis étonné que l'on ait si peu craint de les braver. Je connais trop cependant la noblesse des sentiments qui vous animent, et la pureté de votre patriotisme, pour n'être pas bien sûr que vous approuverez la conduite que j'ai cru devoir suivre dans cette circonstance; elle m'était commandée par mon devoir, par mon amour pour mon pays, et même par l'intérêt de votre gloire; et vous êtes trop Français pour accepter, dans la situation où vous vous trouvez, la protection et l'appui des étrangers. Vous avez pour jamais acquis la confiance et l'estime de l'Europe; mais c'est la France que vous servez, c'est à elle seule que vous appartenez; elle peut être injuste; mais ni vous ni vos véritables amis ne souffriront jamais que l'on rende votre cause moins pure et moins belle en confiant sa défense à des voix étrangères. J'ai donc fait taire toute espèce de sentiments et de considérations particulières devant l'intérêt général; j'ai prévenu des démarches dont le premier effet devait être de susciter parmi nous des divisions dangereuses, et de porter atteinte à la dignité du trône. C'est le dernier service que j'aie rendu ici avant mon départ; vous seul, monsieur le vicomte, en aurez la connaissance; la confidence vous en était due, et je connais trop la noblesse de votre caractère pour n'être pas bien sûr que vous me garderez le secret, et que vous trouverez ma conduite, dans cette circonstance, conforme aux sentiments que vous avez le droit d'exiger de ceux que vous honorez de votre estime et de votre amitié.
(p. 301) «Adieu, monsieur le vicomte: si les rapports que j'ai eu le bonheur d'avoir avec vous ont pu vous donner une idée juste de mon caractère, vous devez savoir que ce ne sont point les changements de situation qui peuvent influencer mes sentiments, et vous ne douterez jamais de l'attachement et du dévouement de celui qui, dans les circonstances actuelles, s'estime le plus heureux des hommes d'être placé par l'opinion au nombre de vos amis.
«La Ferronnays.»
«MM. de Fontenay et de Pontcarré sentent vivement le prix du souvenir que vous voulez bien leur conserver: témoins, ainsi que moi, de l'accroissement de considération que la France avait acquis depuis votre entrée au ministère, il est tout simple qu'ils partagent mes sentiments et mes regrets.»
Je commençai le combat de ma nouvelle opposition immédiatement après ma chute; mais il fut interrompu par la mort de Louis XVIII, et il ne reprit vivement qu'après le sacre de Charles X. Au mois de juillet, je rejoignis à Neuchâtel madame de Chateaubriand qui était allée m'y attendre. Elle avait loué une cabane au bord du lac. La chaîne des Alpes se déroulait nord et sud à une grande distance devant nous; nous étions adossés contre le Jura dont les flancs noircis de pins montaient à pic sur nos têtes. Le lac était désert; une galerie de bois me servait de promenoir. Je me souvenais de milord Maréchal[231]. Quand je (p. 302) montais au sommet du Jura, j'apercevais le lac de Bienne aux brises et aux flots de qui J.-J. Rousseau doit une de ses plus heureuses inspirations. Madame de Chateaubriand alla visiter Fribourg et une maison de campagne que l'on nous avait dit charmante, et qu'elle trouva glacée, quoiqu'elle fût surnommée la Petite Provence. Un maigre chat noir, demi-sauvage, qui pêchait de petits poissons en plongeant sa patte dans un grand seau rempli de l'eau du lac, était toute ma distraction. Une vieille femme tranquille, qui tricotait toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, notre festin dans une huguenote[232]. Je n'avais pas perdu l'habitude du repas du rat des champs.
Neuchâtel avait eu ses beaux jours; il avait appartenu à la duchesse de Longueville; J.-J. Rousseau s'était promené en habit d'Arménien sur ses monts, et madame de Charrière[233], si délicatement observée (p. 303) par M. de Sainte-Beuve, en avait décrit la société dans les Lettres Neuchâteloises: mais Juliane, mademoiselle de La Prise, Henri Meyer[234], n'étaient plus là; je n'y voyais que le pauvre Fauche-Borel[235], de l'ancienne émigration: il se jeta bientôt après par sa fenêtre. Les jardins peignés de M. Pourtalès[236] ne me charmaient pas plus qu'un rocher anglais élevé de main d'homme dans une vigne voisine en regard du Jura. (p. 304) Berthier, dernier prince de Neuchâtel[237], de par Bonaparte, était oublié malgré son petit Simplon du Val-de-Travers, et quoiqu'il se fût brisé le crâne de la même façon que Fauche-Borel.
La maladie du roi me rappela à Paris. Le roi mourut le 16 septembre[238], quatre mois à peine après ma (p. 305) destitution. Ma brochure ayant pour titre: Le roi est mort: vive le roi! dans laquelle je saluais le nouveau souverain[239], opéra pour Charles X ce que ma brochure De Bonaparte et des Bourbons avait opéré pour Louis XVIII. J'allai chercher madame de Chateaubriand à Neuchâtel, et nous vînmes à Paris loger rue du Regard. Charles X popularisa l'ouverture de son règne par l'abolition de la censure; le sacre eut lieu au printemps de 1825. «Jà commençoient les abeilles à bourdonner, les oiseaux à rossignoler et les agneaux à sauteler.»
Je trouve parmi mes papiers les pages suivantes écrites à Reims:
«Reims, 26 mai 1825.
«Le roi arrive après-demain: il sera sacré dimanche 29; je lui verrai mettre sur la tête une couronne à laquelle personne ne pensait en 1814 quand j'élevai la voix. J'ai contribué à lui ouvrir les portes de la France; je lui ai donné des défenseurs, en conduisant (p. 306) à bien l'affaire d'Espagne; j'ai fait adopter la Charte, et j'ai su retrouver une armée, les deux seules choses avec lesquelles le roi puisse régner au dedans et au dehors: quel rôle m'est réservé au sacre? celui d'un proscrit. Je viens recevoir dans la foule un cordon prodigué, que je ne tiens pas même de Charles X. Les gens que j'ai servis et placés me tournent le dos. Le roi tiendra mes mains dans les siennes; il me verra à ses pieds sans être ému, quand je prêterai mon serment, comme il me voit sans intérêt recommencer mes misères. Cela me fait-il quelque chose? Non. Délivré de l'obligation d'aller aux Tuileries, l'indépendance compense tout pour moi.
«J'écris cette page de mes Mémoires dans la chambre où je suis oublié au milieu du bruit. J'ai visité ce matin Saint-Rémi et la cathédrale décorée de papier peint. Je n'aurai eu une idée claire de ce dernier édifice que par les décorations de la Jeanne d'Arc de Schiller, jouée devant moi à Berlin: des machines d'opéra m'ont fait voir au bord de la Sprée ce que des machines d'opéra me cachent au bord de la Vesle: du reste, j'ai pris mon divertissement parmi les vieilles races, depuis Clovis avec ses Francs et son pigeon descendu du ciel, jusqu'à Charles VII, avec Jeanne d'Arc.
Je suis venu de mon pays
Pas plus haut qu'une botte,
Avecque mi, avecque mi,
Avecque ma marmotte.
«Un petit sou, monsieur, s'il vous plaît!
(p. 307) «Voilà ce que m'a chanté, au retour de ma course, un petit Savoyard arrivé tout juste à Reims. «Et qu'es-tu venu faire ici? lui ai-je dit.—Je suis venu au sacre, monsieur.—Avec ta marmotte?—Oui monsieur, avecque mi, avecque mi, avecque ma marmotte, m'a-t-il répondu en dansant et en tournant—Eh bien, c'est comme moi, mon garçon.»
«Cela n'était pas exact: j'étais venu au sacre sans marmotte, et une marmotte est une grande ressource; je n'avais dans mon coffret que quelque vieille songerie qui ne m'aurait pas fait donner un petit sou par le passant pour la voir grimper autour d'un bâton.
«Louis XVII et Louis XVIII n'ont point été sacrés; le sacre de Charles X vient immédiatement après celui de Louis XVI. Charles X assista au couronnement de son frère; il représentait le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Sous quels heureux auspices Louis XVI ne montait-il pas au trône? Comme il était populaire en succédant à Louis XV! Et pourtant, qu'est-il devenu? Le sacre actuel sera la représentation d'un sacre, non un sacre: nous verrons le maréchal Moncey, acteur au sacre de Napoléon; ce maréchal qui jadis célébra dans son armée la mort du tyran Louis XVI, nous le verrons brandir l'épée royale à Reims, en qualité de comte de Flandre ou de duc d'Aquitaine. À qui cette parade pourrait-elle faire illusion? Je n'aurais voulu aujourd'hui aucune pompe: le roi à cheval, l'église nue, ornée seulement de ses vieilles voûtes et de ses vieux tombeaux; les deux Chambres présentes, le serment de fidélité à la Charte prononcé à haute (p. 308) voix sur l'Évangile. C'était ici le renouvellement de la monarchie; on la pouvait recommencer avec la liberté et la religion: malheureusement on aimait peu la liberté; encore si l'on avait eu du moins le goût de la gloire!
Ah! que diront là-bas, sous les tombes poudreuses,
De tant de vaillants rois les ombres généreuses?
Que diront Pharamond, Clodion et Clovis,
Nos Pépins, nos Martels, nos Charles, nos Louis.
Qui, de leur propre sang, à tous périls de guerre
Ont acquis à leurs fils une si belle terre?
«Enfin le sacre nouveau, où le pape est venu oindre un homme aussi grand que le chef de la seconde race, n'a-t-il pas, en changeant les têtes, détruit l'effet de l'antique cérémonie de notre histoire? Le peuple a été amené à penser qu'un rite pieux ne dédiait personne au trône, ou rendait indifférent le choix du front auquel s'appliquait l'huile sainte. Les figurants à Notre-Dame de Paris, jouant pareillement dans la cathédrale de Reims, ne seront plus que les personnages obligés d'une scène devenue vulgaire: l'avantage demeurera à Napoléon qui envoie ses comparses à Charles X. La figure de l'Empereur domine tout désormais. Elle apparaît au fond des événements et des idées: les feuillets des bas temps où nous sommes arrivés se recroquevillent aux regards de ses aigles.»
(p. 309) «Reims, samedi[240], veille du sacre.
«J'ai vu entrer le roi; j'ai vu passer les carrosses dorés du monarque qui naguère n'avait pas une monture; j'ai vu rouler ces voitures pleines de courtisans qui n'ont pas su défendre leur maître. Cette tourbe est allée à l'église chanter le Te Deum, et moi je suis allé voir une ruine romaine et me promener seul dans un bois d'ormeaux appelé le bois d'Amour. J'entendais de loin la jubilation des cloches, je regardais les tours de la cathédrale, témoins séculaires de cette cérémonie toujours la même et pourtant si diverse par l'histoire, les temps, les idées, les mœurs, les usages et les coutumes. La monarchie a péri, et la cathédrale a, pendant quelques années, été changée en écurie. Charles X, qui la revoit aujourd'hui, se souvient-il qu'il a vu Louis XVI recevoir l'onction aux mêmes lieux où il va la recevoir à son tour? Croira-t-il qu'un sacre mette à l'abri du malheur? Il n'y a plus de main assez vertueuse pour guérir les écrouelles, plus de sainte ampoule assez salutaire pour rendre les rois inviolables[241].»
J'écrivis à la hâte ce qu'on vient de lire sur les pages demi-blanches d'une brochure ayant pour titre: Le Sacre; par Barnage de Reims, avocat, et sur une (p. 310) lettre imprimée du grand référendaire, M. de Sémonville, disant: «Le grand référendaire a l'honneur d'informer sa seigneurie, monsieur le vicomte de Chateaubriand, que des places dans le sanctuaire de la cathédrale de Reims sont destinées et réservées pour ceux de MM. les pairs qui voudront assister le lendemain du sacre et couronnement de Sa Majesté à la cérémonie de la réception du chef et souverain grand maître des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel et de la réception de MM. les chevaliers et commandeurs.»
Charles X avait eu pourtant l'intention de me réconcilier. L'archevêque de Paris lui parlant à Reims des hommes dans l'opposition, le roi avait dit: «Ceux qui ne veulent pas de moi, je les laisse.» L'archevêque reprit: «Mais, sire, M. de Chateaubriand?—Oh! celui-là, je le regrette.» L'archevêque demanda au roi s'il me le pouvait dire: le roi hésita, fit deux ou trois tours dans la chambre et répondit: «Eh bien, oui, dites-le-lui,» et l'archevêque oublia de m'en parler.
À la cérémonie des chevaliers des ordres, je me trouvai à genoux aux pieds du roi, dans le moment que M. de Villèle prêtait son serment. J'échangeai deux ou trois mots de politesse avec mon compagnon de chevalerie, à propos de quelque plume détachée de mon chapeau. Nous quittâmes les genoux du prince et tout fut fini. Le roi, ayant eu de la peine à ôter ses gants pour prendre mes mains dans les siennes, m'avait dit en riant: «Chat ganté ne prend point de souris.» On avait cru qu'il m'avait parlé longtemps, et le bruit de ma faveur renaissante s'était répandu. (p. 311) Il est probable que Charles X, s'imaginant que l'archevêque m'avait entretenu de sa bonne volonté, attendait de moi un mot de remercîment et qu'il fut choqué de mon silence.
Ainsi j'ai assisté au dernier sacre des successeurs de Clovis; je l'avais déterminé par les pages où j'avais sollicité le sacre[242], et dépeint dans ma brochure Le roi est mort: vive le roi! Ce n'est pas que j'eusse la moindre foi à la cérémonie; mais, comme tout manquait à la légitimité, il fallait pour la soutenir user de tout, vaille que vaille. Je rappelais cette définition d'Adalbéron[243]: «Le couronnement d'un roi de France est un intérêt public, non une affaire particulière: publica sunt hæc negotia, non privata;» je citais l'admirable prière réservée pour le sacre: «Dieu, qui par tes vertus conseilles tes peuples, donne à celui-ci, (p. 312) ton serviteur, l'esprit de ta sapience! Qu'en ces jours naisse à tous équité et justice: aux amis secours, aux ennemis obstacle, aux affligés consolation, aux élevés correction, aux riches enseignement, aux indigents pitié, aux pèlerins hospitalité, aux pauvres sujets paix et sûreté en la patrie! Qu'il apprenne (le roi) à se commander soi-même, à modérément gouverner un chacun selon son état, afin, ô Seigneur! qu'il puisse donner à tout le peuple exemple de vie à toi agréable.»
Avant d'avoir rapporté dans ma brochure, Le roi est mort: vive le roi! cette prière conservée par Du Tillet, je m'étais écrié: «Supplions humblement Charles X d'imiter ses aïeux: trente-deux souverains de la troisième race ont reçu l'onction royale.»
Tous mes devoirs étant remplis, je quittai Reims et je pus dire comme Jeanne d'Arc: «Ma mission est finie.»[Lien vers la Table des Matières]
Je réunis autour de moi mes anciens adversaires. — Mon public est changé. — Extrait de ma polémique après ma chute. — Séjour à Lausanne. — Retour à Paris. — Les Jésuites. — Lettre de M. de Montlosier et ma réponse. — Suite de ma polémique. — Lettre du général Sébastiani. — Mort du général Foy. — La loi de Justice et d'Amour. — Lettre de M. Étienne. — Lettre de M. Benjamin Constant. — J'atteins au plus haut point de mon importance politique. — Article sur la fête du roi. — Retrait de la loi sur la police de la presse. — Paris illuminé. — Billet de M. Michaud. — Irritation de M. de Villèle. — Charles X veut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. — Je lui écris: ma lettre. — La revue. — Licenciement de la garde nationale. — La Chambre élective est dissoute. — La nouvelle Chambre. — Refus de concours. — Chute du ministère Villèle. — Je contribue à former le nouveau ministère et j'accepte l'ambassade de Rome. — Examen d'un reproche.
Paris avait vu ses dernières fêtes: l'époque d'indulgence, de réconciliation, de faveur, était passée: la triste vérité restait seule devant nous.
Lorsque, en 1820, la censure mit fin au Conservateur, je ne m'attendais guère à recommencer quatre ans après la même polémique sous une autre forme et par le moyen d'une autre presse. Les hommes qui combattaient avec moi dans le Conservateur réclamaient comme moi la liberté de penser et d'écrire; ils étaient (p. 314) dans l'opposition comme moi, dans la disgrâce comme moi, et ils se disaient mes amis. Arrivés au pouvoir en 1820, encore plus par mes travaux que par les leurs, ils se tournèrent contre la liberté de la presse: de persécutés ils devinrent persécuteurs; ils cessèrent d'être et de se dire mes amis; ils soutinrent que la licence de la presse n'avait commencé que le 6 de juin 1824, jour de mon renvoi du ministère; leur mémoire était courte: s'ils avaient relu les opinions qu'ils prononcèrent, les articles qu'ils écrivirent contre un autre ministère et pour la liberté de la presse, ils auraient été obligés de convenir qu'ils étaient au moins en 1818 ou 1819 les sous-chefs de la licence.
D'un autre côté, mes anciens adversaires se rapprochèrent de moi. J'essayai de rattacher les partisans de l'indépendance à la royauté légitime, avec plus de fruit que je ne ralliai à la Charte les serviteurs du trône et de l'autel. Mon public avait changé. J'étais obligé d'avertir le gouvernement des dangers de l'absolutisme, après l'avoir prémuni contre l'entraînement populaire. Accoutumé à respecter mes lecteurs, je ne leur livrais pas une ligne que je ne l'eusse écrite avec tout le soin dont j'étais capable: tel de ces opuscules d'un jour m'a coûté plus de peine, proportion gardée, que les plus longs ouvrages sortis de ma plume. Ma vie était incroyablement remplie. L'honneur et mon pays me rappelèrent sur le champ de bataille. J'étais arrivé à l'âge où les hommes ont besoin de repos; mais si j'avais jugé de mes années par la haine toujours croissante que m'inspiraient l'oppression et la bassesse, j'aurais pu me croire rajeuni.
(p. 315) Je réunis autour de moi une société d'écrivains pour donner de l'ensemble à mes combats. Il y avait parmi eux des pairs, des députés, des magistrats, de jeunes auteurs commençant leur carrière. Arrivèrent chez moi MM. de Montalivet[245], Salvandy[246], Duvergier de Hauranne[247], bien d'autres qui furent mes écoliers (p. 316) et qui débitent aujourd'hui, comme choses nouvelles sur la monarchie représentative, des choses que je leur ai apprises et qui sont à toutes les pages de mes écrits. M. de Montalivet est devenu ministre de l'intérieur et favori de Philippe; les hommes qui aiment à suivre les variations d'une destinée trouveront ce billet assez curieux:
«Monsieur le vicomte,
«J'ai l'honneur de vous envoyer le relevé des erreurs que j'avais trouvées dans le tableau de jugements en Cour royale qui vous a été communiqué. Je les ai vérifiées encore, et je crois pouvoir répondre de l'exactitude de la liste ci-jointe.
«Daignez, monsieur le vicomte, agréer l'hommage du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,
«Votre bien dévoué collègue et sincère admirateur,
«Montalivet.»
Cela n'a pas empêché mon respectueux collègue et sincère admirateur, M. le comte de Montalivet, en son temps si grand partisan de la liberté de la presse, de m'avoir fait entrer comme fauteur de cette liberté dans la geôle de M. Gisquet[248].
(p. 317) De ma nouvelle polémique qui dura cinq ans[249], mais qui finit par triompher, un abrégé fera connaître la force des idées contre les faits appuyés même du pouvoir. Je fus renversé le 6 juin 1824; le 21 j'étais descendu dans l'arène; j'y restai jusqu'au 18 décembre (p. 318) 1826[250]: j'y entrai seul, dépouillé et nu, et j'en sortis victorieux. C'est de l'histoire que je fais ici en faisant l'extrait des arguments que j'employai.
EXTRAIT DE MA POLÉMIQUE APRÈS MA CHUTE.
«Nous avons eu le courage et l'honneur de faire une guerre dangereuse en présence de la liberté de la presse, et c'était la première fois que ce noble spectacle était donné à la monarchie. Nous nous sommes vite repentis de notre loyauté. Nous avions bravé les journaux lorsqu'ils ne pouvaient nuire qu'au succès de nos soldats et de nos capitaines; il a fallu les asservir lorsqu'ils ont osé parler des commis et des ministres.....
«Si ceux qui administrent l'État semblent complètement ignorer le génie de la France dans les choses sérieuses, ils n'y sont pas moins étrangers dans ces choses de grâces et d'ornements qui se mêlent, pour l'embellir, à la vie des nations civilisées.
«Les largesses que le gouvernement légitime répand (p. 319) sur les arts surpassent les secours que leur accordait le gouvernement usurpateur; mais comment sont-elles départies? Voués à l'oubli par nature et par goût, les dispensateurs de ces largesses paraissent avoir de l'antipathie pour la renommée; leur obscurité est si invincible, qu'en approchant des lumières ils les font pâlir; on dirait qu'ils versent l'argent sur les arts pour les éteindre, comme sur nos libertés pour les étouffer[251]...
«Encore si la machine étroite dans laquelle on met la France à la gêne ressemblait à ces modèles achevés que l'on examine à la loupe dans le cabinet des amateurs, la délicatesse de cette curiosité pourrait intéresser un moment; mais point: c'est une petite chose mal faite.
«Nous avons dit que le système suivi aujourd'hui par l'administration blesse le génie de la France: nous allons essayer de prouver qu'il méconnaît également l'esprit de nos institutions.
«La monarchie s'est rétablie sans efforts en France, parce qu'elle est forte de toute notre histoire, parce que la couronne est portée par une famille qui a presque vu naître la nation, qui l'a formée, civilisée, qui lui a donné toutes ses libertés, qui l'a rendue immortelle; mais le temps a réduit cette monarchie à ce qu'elle a de réel. L'âge des fictions est passé en politique: on ne peut plus avoir un gouvernement d'adoration, de culte et de mystère: chacun connaît ses droits; rien n'est possible hors des limites de la raison; et jusqu'à la faveur, dernière (p. 320) illusion des monarchies absolues, tout est pesé, tout est apprécié aujourd'hui.
«Ne nous y trompons pas; une nouvelle ère commence pour les nations; sera-t-elle plus heureuse? La Providence le sait. Quant à nous, il ne nous est donné que de nous préparer aux événements de l'avenir. Ne nous figurons pas que nous puissions rétrograder: il n'y a de salut pour nous que dans la Charte.
«La monarchie constitutionnelle n'est point née parmi nous d'un système écrit, bien qu'elle ait un Code imprimé; elle est fille du temps et des événements, comme l'ancienne monarchie de nos pères.
«Pourquoi la liberté ne se maintiendrait-elle pas dans l'édifice élevé par le despotisme et où il a laissé des traces? La victoire, pour ainsi dire encore parée des trois couleurs, s'est réfugiée dans la tente du duc d'Angoulême; la légitimité habite le Louvre, bien qu'on y voie encore des aigles.
«Dans une monarchie constitutionnelle, on respecte les libertés publiques; on les considère comme le sauvegarde du monarque, du peuple et des lois.
«Nous entendons autrement le gouvernement représentatif. On forme une compagnie (on dit même deux compagnies rivales, car il faut de la concurrence) pour corrompre des journaux à prix d'argent. On ne craint pas de soutenir des procès scandaleux contre des propriétaires qui n'ont pas voulu se vendre; on voudrait les forcer à subir le mépris par arrêt des tribunaux. Les hommes d'honneur répugnant au métier, on enrôle, pour soutenir un ministère royaliste, des libellistes qui ont poursuivi (p. 321) la famille royale de leurs calomnies. On recrute tout ce qui a servi dans l'ancienne police et dans l'antichambre impériale; comme chez nos voisins, lorsqu'on veut se procurer des matelots, on fait la presse dans les tavernes et les lieux suspects. Ces chiourmes d'écrivains libres sont embarquées dans cinq ou six journaux achetés, et ce qu'ils disent s'appelle l'opinion publique chez les ministres[252].»
Voilà, très en abrégé, et peut-être encore trop longuement, un spécimen de ma polémique dans mes brochures et dans le Journal des Débats: on y retrouve tous les principes que l'on proclame aujourd'hui.
Lorsqu'on me chassa du ministère, on ne me rendit point ma pension de ministre d'État; je ne la réclamai point; mais M. de Villèle, sur une observation du roi, s'avise de me faire expédier un nouveau brevet de cette pension par M. de Peyronnet. Je la refusai. Ou j'avais droit à mon ancienne pension, ou je n'y avais pas droit: dans le premier cas, je n'avais pas besoin d'un nouveau brevet; dans le second, je ne voulais pas devenir le pensionnaire du président du conseil.
Les Hellènes secouèrent le joug: il se forma à Paris un comité grec dont je fis partie. Le comité s'assemblait chez M. Ternaux[253], place des Victoires. Les sociétaires (p. 322) arrivaient successivement au lieu des délibérations. M. le général Sébastiani déclarait, lorsqu'il était assis, que c'était une grosse affaire; il la rendait longue: cela déplaisait à notre positif président, M. Ternaux, qui voulait bien faire un châle pour Aspasie, mais qui n'aurait pas perdu son temps avec elle. Les dépêches de M. Fabvier[254] faisaient souffrir le comité; il nous grognait fort; il nous rendait responsables de ce qui n'allait pas selon ses vues, nous qui n'avions pas gagné la bataille de Marathon. Je me dévouai à la liberté de la Grèce: il me semblait remplir un devoir filial envers une mère. J'écrivis une Note; je m'adressai aux successeurs de l'empereur de Russie, comme je m'étais adressé à lui-même à Vérone. La Note a été imprimée et puis réimprimée à la tête de l'Itinéraire[255].
Je travaillais dans le même sens à la Chambre des pairs[256], pour mettre en mouvement un corps politique. (p. 323) Ce billet de M. Molé fait voir les obstacles que je rencontrais et les moyens détournés que j'étais obligé de prendre:
«Vous nous trouverez tous demain à l'ouverture, prêts à voler sur vos traces. Je vais écrire à Lainé si je ne le trouve pas. Il ne faut lui laisser prévoir que des phrases sur les Grecs; mais prenez garde qu'on ne vous oppose les limites de tout amendement, et que, le règlement à la main, on ne vous repousse. Peut-être on vous dira de déposer votre proposition sur le bureau: vous pourriez le faire alors subsidiairement, et après avoir dit tout ce que vous avez à dire. Pasquier vient d'être assez malade, et je crains qu'il ne soit pas encore sur pied demain. Quant au scrutin, nous l'aurons. Ce qui vaut mieux que tout cela, c'est l'arrangement que vous avez fait avec vos libraires. Il est beau de retrouver par son talent tout ce que l'injustice et l'ingratitude des hommes nous avaient ôté.
«À vous pour la vie,
«Molé.»
La Grèce est devenue libre du joug de l'islamisme; mais, au lieu d'une république fédérative, comme je le désirais, une monarchie bavaroise s'est établie à Athènes. Or, comme les rois n'ont pas de mémoire, moi qui avais quelque peu servi la cause des Argiens, je n'ai plus entendu parler d'eux que dans Homère. La Grèce délivrée ne m'a pas dit: «Je vous remercie.» (p. 324) Elle ignore mon nom autant et plus qu'au jour où je pleurais sur ses débris en traversant ses déserts.
L'Hellénie non encore royale avait été plus reconnaissante. Parmi quelques enfants que le comité faisait élever se trouvait le jeune Canaris: son père, digne des marins de Mycale, lui écrivit un billet que l'enfant traduisit en français sur le papier blanc qui restait au bas du billet. Voici cette traduction:
«Mon cher enfant,
«Aucun des Grecs n'a eu le même bonheur que toi: celui d'être choisi par la société bienfaisante qui s'intéresse à nous pour apprendre les devoirs de l'homme. Moi, je t'ai fait naître; mais ces personnes recommandables te donneront une éducation qui rend véritablement homme. Sois bien docile aux conseils de ces nouveaux pères, si tu veux faire la consolation de celui qui t'a donné le jour. Porte-toi bien.
«Ton père,
«C. Canaris.
«De Napoli de Romanie, le 5 septembre 1825.»
J'ai conservé le double texte comme la récompense du comité grec.
La Grèce républicaine avait témoigné ses regrets particuliers lorsque je sortis du ministère. Mme Récamier m'avait écrit de Naples le 29 octobre 1824:
(p. 325) «Je reçois une lettre de la Grèce qui a fait un long détour avant de m'arriver. J'y trouve quelques lignes sur vous que je veux vous faire connaître; les voici:
«L'ordonnance du 6 juin nous est parvenue, elle a produit sur nos chefs la plus vive sensation. Leurs espérances les plus fondées étant dans la générosité de la France, ils se demandent avec inquiétude ce que présage l'éloignement d'un homme dont le caractère leur promettait un appui.»
«Ou je me trompe ou cet hommage doit vous plaire. Je joins ici la lettre: la première page ne concernait que moi.»
On lira bientôt la vie de Mme Récamier: on saura s'il m'était doux de recevoir un souvenir de la patrie des Muses par une femme qui l'eût embellie.
Quant au billet de M. Molé donné plus haut, il fait allusion au marché que j'avais conclu relativement à la publication de mes Œuvres complètes. Cet arrangement aurait dû, en effet, assurer la paix de ma vie; il a néanmoins tourné mal pour moi, bien qu'il ait été heureux pour les éditeurs auxquels M. Ladvocat, après sa faillite, a laissé mes Œuvres. En fait de Plutus ou de Pluton (les mythologistes les confondent), je suis comme Alceste, je vois toujours la barque fatale; ainsi que William Pitt, et c'est mon excuse, je suis un panier percé; mais je ne fais pas moi-même le trou au panier[257].
(p. 326) À la fin de la Préface générale de mes Œuvres, 1826, 1er volume, j'apostrophe ainsi la France:
«Ô France! mon cher pays et mon premier amour, un de vos fils, au bout de sa carrière, rassemble sous vos yeux les titres qu'il peut avoir à votre bienveillance. S'il ne peut plus rien pour vous, vous pouvez tout pour lui, en déclarant que son attachement à votre religion, à votre roi, à vos libertés, vous fut agréable. Illustre et belle patrie, je n'aurais désiré un peu de gloire que pour augmenter la tienne.»
Mme de Chateaubriand, étant malade, fit un voyage dans le midi de la France, ne s'en trouva pas bien, revint à Lyon, où le docteur Prunelle la condamna. Je l'allai rejoindre; je la conduisis à Lausanne, où elle fit mentir M. Prunelle. Je demeurai à Lausanne tour à tour chez M. de Sivry et chez Mme de Cottens, femme affectueuse, spirituelle et infortunée. Je vis Mme de Montolieu[258]: elle demeurait retirée sur une (p. 327) haute colline; elle mourait dans les illusions du roman, comme Mme de Genlis, sa contemporaine. Gibbon avait composé à ma porte son Histoire de l'empire romain: «C'est au milieu des débris du Capitole, écrit-il à Lausanne, le 27 juin 1787, que j'ai formé le projet d'un ouvrage qui a occupé et amusé près de vingt années de ma vie.» Mme de Staël avait paru avec Mme Récamier à Lausanne. Toute l'émigration, tout un monde fini s'était arrêté quelques moments dans cette cité riante et triste, espèce de fausse ville de Grenade. Mme de Duras en a retracé le souvenir dans ses Mémoires et ce billet m'y vint apprendre la nouvelle perte à laquelle j'étais condamné:
«Bex, 13 juillet 1826.
«C'en est fait, monsieur, votre amie[259] n'existe plus; elle a rendu son âme à Dieu, sans agonie, ce matin à onze heures moins un quart. Elle s'était encore promenée en voiture hier au soir. Rien n'annonçait une fin aussi prochaine; que dis-je, nous ne pensions pas que sa maladie dût se terminer ainsi. M. de Custine[260], à qui la douleur ne permet pas de vous écrire lui-même, avait encore été hier matin sur une des montagnes qui environnent Bex, pour faire venir tous les matins du lait des montagnes pour la chère malade.
(p. 328) «Je suis trop accablé de douleur pour pouvoir entrer dans de plus longs détails. Nous nous disposons pour retourner en France avec les restes précieux de la meilleure des mères et des amies. Enguerrand[261] reposera entre ses deux mères.
«Nous passerons par Lausanne, où M. de Custine ira vous chercher aussitôt notre arrivée.
«Recevez, monsieur, l'assurance de l'attachement respectueux avec lequel je suis, etc.
«Berstœcher.[262]»
Cherchez plus haut et plus bas ce que j'ai eu le bonheur et le malheur de rappeler relativement à la mémoire de Mme de Custine.
Les Lettres écrites de Lausanne[263], ouvrage de Mme de Charrière, rendent bien la scène que j'avais chaque jour sous les yeux, et les sentiments de grandeur qu'elle inspire: «Je me repose seule, dit la mère de Cécile, vis-à-vis d'une fenêtre ouverte qui donne sur le lac. Je vous remercie, montagnes, neige, soleil, de tout le plaisir que vous me faites. Je vous remercie, auteur de tout ce que je vois, d'avoir voulu que ces choses fussent si agréables à voir. Beautés frappantes et aimables de la nature! (p. 329) tous les jours mes yeux vous admirent, tous les jours vous vous faites sentir à mon cœur.»
Je commençai à Lausanne, les Remarques sur le premier ouvrage de ma vie, l'Essai sur les révolutions anciennes et modernes. Je voyais de mes fenêtres les rochers de Meillerie: «Rousseau, écrivais-je dans une de ces Remarques, n'est décidément au-dessus des auteurs de son temps que dans une soixantaine de lettres de la Nouvelle Héloïse, dans quelques pages de ses Rêveries et de ses Confessions. Là, placé dans la véritable nature de son talent, il arrive à une éloquence de passion inconnue avant lui. Voltaire et Montesquieu ont trouvé des modèles de style dans les écrivains du siècle de Louis XIV; Rousseau, et même un peu Buffon, dans un autre genre, ont créé une langue qui fut ignorée du grand siècle[264].»
(p. 330) De retour à Paris, ma vie se trouva occupée entre mon établissement, rue d'Enfer, mes combats renouvelés à la Chambre des pairs et dans mes brochures contre les différents projets de lois contraires aux libertés publiques; entre mes discours et mes écrits en faveur des Grecs, et mon travail pour mes Œuvres complètes. L'empereur de Russie mourut[265], et avec lui la seule amitié royale qui me restât. Le duc de Montmorency était devenu gouverneur du duc de Bordeaux. Il ne jouit pas longtemps de ce pesant honneur: il expira le vendredi saint 1826, dans l'église de Saint-Thomas d'Aquin, à l'heure où Jésus expira sur la croix, il alla à Dieu avec le dernier soupir du Christ[266].
L'attaque était commencée contre les jésuites; on entendit les déclamations banales et usées contre cet ordre célèbre, dans lequel, il faut en convenir, règne (p. 331) quelque chose d'inquiétant, car un mystérieux nuage couvre toujours les affaires des jésuites.
À propos des jésuites, je reçus cette lettre de M. de Montlosier, et je lui fis la réponse qu'on lira après cette lettre.
Ne derelinquas amicum antiquum,
Novus enim non erit similis illi. (Eccles.)
«Mon cher ami, ces paroles ne sont pas seulement d'une haute antiquité, elles ne sont pas seulement d'une haute sagesse; pour le chrétien, elles sont sacrées. J'invoque auprès de vous tout ce qu'elles ont d'autorité. Jamais entre les anciens amis, jamais entre les bons citoyens, le rapprochement n'a été plus nécessaire. Serrer ses rangs, serrer entre nous tous les liens, exciter avec émulation tous nos vœux, tous nos efforts, tous nos sentiments, est un devoir commandé par l'état éminemment déplorable du roi et de la patrie. En vous adressant ces paroles, je n'ignore pas qu'elles seront reçues par un cœur que l'ingratitude et l'injustice ont navré; et cependant je vous les adresse encore avec confiance, certain que je suis qu'elles se feront jour à travers toutes les nuées. En ce point délicat, je ne sais, mon cher ami, si vous serez content de moi; mais, au milieu de vos tribulations, si par hasard j'ai entendu vous accuser, je ne me suis point occupé à vous défendre: je n'ai pas même écouté. Je me suis dit en moi-même: Et quand cela serait? Je ne sais si Alcibiade n'eut pas un peu trop d'humeur quand il mit hors de sa propre maison le rhéteur qui ne (p. 332) put lui montrer les ouvrages d'Homère. Je ne sais si Annibal n'eut pas un peu trop de violence quand il jeta hors de son siège le sénateur qui parlait contre son avis. Si j'étais admis à dire ma façon de penser sur Achille, peut-être ne l'approuverais-je pas de s'être séparé de l'armée des Grecs pour je ne sais quelle petite fille qui lui fut enlevée. Après cela, il suffit de prononcer les noms d'Alcibiade, d'Annibal et d'Achille, pour que toute contention soit finie. Il en est de même aujourd'hui de l'iracundus, inexorabilis Chateaubriand. Quand on a prononcé son nom, tout est fini. Avec ce nom, quand je me dis moi-même: il se plaint, je sens s'émouvoir ma tendresse; quand je me dis: la France lui doit, je me sens pénétré de respect. Oui, mon ami, la France vous doit. Il faut qu'elle vous doive encore davantage; elle a recouvré de vous l'amour de la religion de ses pères: il faut lui conserver ce bienfait; et pour cela, il faut la préserver de l'erreur de ses prêtres, préserver ces prêtres eux-mêmes de la pente funeste où ils se sont placés.
«Mon cher ami, vous et moi n'avons cessé depuis longues années de combattre. C'est de la prépondérance ecclésiastique se disant religieuse qu'il nous reste à préserver le roi et l'État. Dans les anciennes situations, le mal avec ses racines était au dedans de nous: on pouvait les circonvenir et s'en rendre maître. Aujourd'hui les rameaux qui nous couvrent au dedans ont leurs racines au dehors. Des doctrines couvertes du sang de Louis XVI et de Charles Ier ont consenti à laisser leur place à des doctrines teintes du sang d'Henri IV et d'Henri III. Ni vous (p. 333) ni moi ne supporterons sûrement cet état de choses; c'est pour m'unir à vous, c'est pour recevoir de vous une approbation qui m'encourage, c'est pour vous offrir comme soldat mon cœur et mes armes, que je vous écris.
«C'est dans ces sentiments d'admiration pour vous et d'un véritable dévouement que je vous implore avec tendresse et aussi avec respect.
«Comte de Montlosier.»
Randanne, 28 novembre 1825.
Paris, ce 3 décembre 1825.
«Votre lettre, mon cher et vieil ami, est très sérieuse, et pourtant elle m'a fait rire pour ce qui me regarde. Alcibiade, Annibal, Achille! Ce n'est pas sérieusement que vous me dites tout cela. Quant à la petite fille du fils de Pélée, si c'est mon portefeuille dont il s'agit, je vous proteste que je n'ai pas aimé l'infidèle trois jours, et que je ne l'ai pas regrettée un quart d'heure. Mon ressentiment, c'est une autre affaire. M. de Villèle, que j'aimais sincèrement, cordialement, a non seulement manqué aux devoirs de l'amitié, aux marques publiques d'attachement que je lui ai données, aux sacrifices que j'avais faits pour lui, mais encore aux plus simples procédés.
«Le roi n'avait plus besoin de mes services, rien de plus naturel que de m'éloigner de ses conseils; mais la manière est tout pour un galant homme, et comme je n'avais pas volé la montre du roi sur sa (p. 334) cheminée, je ne devais pas être chassé comme je l'ai été. J'avais fait seul la guerre d'Espagne et maintenu l'Europe en paix pendant cette période dangereuse; j'avais par ce seul fait donné une armée à la légitimité, et, de tous les ministres de la Restauration, j'ai été le seul jeté hors de ma place sans aucune marque de souvenir de la couronne, comme si j'avais trahi le prince et la patrie. M. de Villèle a cru que j'accepterais ce traitement, il s'est trompé. J'ai été ami sincère, je resterai ennemi irréconciliable. Je suis malheureusement né: les blessures qu'on me fait ne se ferment jamais.
«Mais en voilà trop sur moi: parlons de quelque chose plus important. J'ai peur de ne pas m'entendre avec vous sur des objets graves, et j'en serais désolé! Je veux la charte, toute la charte, les libertés publiques dans toute leur étendue. Les voulez-vous?
«Je veux la religion comme vous; je hais comme vous la congrégation et ces associations d'hypocrites qui transforment mes domestiques en espions, et qui ne cherchent à l'autel que le pouvoir. Mais je pense que le clergé, débarrassé de ces plantes parasites, peut très bien entrer dans un régime constitutionnel, et devenir même le soutien de nos institutions nouvelles. Ne voulez-vous pas trop le séparer de l'ordre politique? Ici je vous donne une preuve de mon extrême impartialité. Le clergé, qui, j'ose le dire, me doit tant, ne m'aime point, ne m'a jamais défendu ni rendu aucun service. Mais qu'importe? Il s'agit d'être juste et de voir ce qui convient à la religion et à la monarchie.
(p. 335) «Je n'ai pas, mon vieil ami, douté de votre courage; vous ferez, j'en suis convaincu, tout ce qui vous paraîtra utile, et votre talent vous garantit le triomphe. J'attends vos nouvelles communications, et j'embrasse de tout mon cœur mon fidèle compagnon d'exil.
«Chateaubriand.»
Je repris ma polémique. J'avais chaque jour des escarmouches et des affaires d'avant-garde avec les soldats de la domesticité ministérielle; ils ne se servaient pas toujours d'une belle épée. Dans les deux premiers siècles de Rome, on punissait les cavaliers qui allaient mal à la charge, soit qu'ils fussent trop gros ou pas assez braves, en les condamnant à subir une saignée: je me chargeais du châtiment.
«L'univers change autour de nous, disais-je: de nouveaux peuples paraissent sur la scène du monde; d'anciens peuples ressuscitent au milieu des ruines; des découvertes étonnantes annoncent une révolution prochaine dans les arts de la paix et de la guerre: religion, politique, mœurs, tout prend un autre caractère. Nous apercevons-nous de ce mouvement? Marchons-nous avec la société? Suivons-nous le cours du temps? Nous préparons-nous à garder notre rang dans la civilisation transformée ou croissante? Non: les hommes qui nous conduisent sont aussi étrangers à l'état des choses de l'Europe que s'ils appartenaient à ces peuples dernièrement découverts dans l'intérieur de l'Afrique. Que savent-ils donc? La bourse! et encore ils la savent mal. Sommes-nous condamnés à porter le poids de (p. 336) l'obscurité pour nous punir d'avoir subi le joug de la gloire[267]?»
La transaction relative à Saint-Domingue me fournit l'occasion de développer quelques point de notre droit public, auquel personne ne songeait.
Arrivé à de hautes considérations et annonçant la transformation du monde, je répondais à des opposants qui m'avaient dit: «Quoi! nous pourrions être républicains un jour? radotage! Qui est-ce qui rêve aujourd'hui la République? etc., etc.
«Attaché à l'ordre monarchique par raison, répliquais-je, je regarde la monarchie constitutionnelle comme le meilleur gouvernement possible à cette époque de la société.
«Mais si l'on veut tout réduire aux intérêts personnels, si l'on suppose que pour moi-même je croirais avoir tout à craindre dans un état républicain, on est dans l'erreur.
«Me traiterait-il plus mal que ne m'a traité la monarchie? Deux ou trois fois dépouillé pour elle ou par elle, l'Empire, qui aurait tout fait pour moi si je l'avais voulu, m'a-t-il plus rudement renié? J'ai en horreur la servitude; la liberté plaît à mon indépendance naturelle; je préfère cette liberté dans l'ordre monarchique, mais je la conçois dans l'ordre populaire. Qui a moins à craindre de l'avenir que moi? J'ai ce qu'aucune révolution ne peut me ravir: sans place, sans honneurs, sans fortune, tout gouvernement qui ne serait pas assez stupide pour dédaigner l'opinion serait obligé de me compter pour (p. 337) quelque chose. Les gouvernements populaires surtout se composent des existences individuelles, et se font une valeur générale des valeurs particulières de chaque citoyen. Je serai toujours sûr de l'estime publique, parce que je ne ferai jamais rien pour la perdre, et je trouverais peut-être plus de justice parmi mes ennemis que chez mes prétendus amis.
«Ainsi, de compte fait, je serais sans frayeur des républiques, comme sans antipathie contre leur liberté: je ne suis pas roi; je n'attends point de couronne; ce n'est pas ma cause que je plaide.
«J'ai dit sous un autre ministère et à propos de ce ministère: qu'un matin on se mettrait à la fenêtre pour voir passer la monarchie.
«Je dis aux ministres actuels: «En continuant de marcher comme vous marchez, toute la révolution pourrait se réduire, dans un temps donné, à une nouvelle édition de la Charte dans laquelle on se contenterait de changer seulement deux ou trois mots[268].»
J'ai souligné ces dernières phrases pour arrêter les yeux du lecteur sur cette frappante prédiction. Aujourd'hui même que les opinions s'en vont à vau de route, que chaque homme dit à tort et à travers ce qui lui passe dans la cervelle, ces idées républicaines exprimées par un royaliste pendant la restauration sont encore hardies. En fait d'avenir, les prétendus esprits progressifs n'ont l'initiative sur rien.
(p. 338) Mes derniers articles ranimèrent jusqu'à M. de Lafayette qui, pour tout compliment, me fit passer une feuille de laurier. L'effet de mes opinions, à la grande surprise de ceux qui n'y avaient pas cru, se fit sentir depuis les libraires qui vinrent en députation chez moi, jusqu'aux hommes parlementaires les moins rapprochés d'abord de ma politique. La lettre donnée ci-dessous, en preuve de ce que j'avance, cause une sorte d'étonnement par la signature. Il ne faut faire attention qu'à la signification de cette lettre, au changement survenu dans les idées et dans la position de celui qui l'écrit et de celui qui la reçoit: quant au libellé, je suis Bossuet et Montesquieu, cela va sans dire; nous autres auteurs, c'est notre pain quotidien, de même que les ministres sont toujours Sully et Colbert.
«Monsieur le vicomte,
«Permettez que je m'associe à l'admiration universelle: j'éprouve depuis trop longtemps ce sentiment pour résister au besoin de vous l'exprimer.
«Vous réunissez la hauteur de Bossuet à la profondeur de Montesquieu: vous avez retrouvé leur plume et leur génie. Vos articles sont de grands enseignements pour tous les hommes d'État.
«Dans le nouveau genre de guerre que vous avez créé, vous rappelez la main puissante de celui qui, dans d'autres combats, a aussi rempli le monde de sa gloire. Puissent vos succès être plus durables: ils intéressent la patrie et l'humanité.
«Tous ceux qui, comme moi, professent les principes (p. 339) de la monarchie constitutionnelle, sont fiers de trouver en vous leur plus noble interprète.
«Agréez, monsieur le vicomte, une nouvelle assurance de ma haute considération,
«Horace Sébastiani.
«Dimanche, 30 octobre.[269]»
Ainsi tombaient à mes pieds amis, ennemis, adversaires, au moment de la victoire. Tous les pusillanimes et les ambitieux qui m'avaient cru perdu commençaient à me voir sortir radieux des tourbillons de poussière de la lice: c'était ma seconde guerre d'Espagne; je triomphais de tous les partis intérieurs comme j'avais triomphé au dehors des ennemis de la France. Il m'avait fallu payer de ma personne, de même qu'avec mes dépêches j'avais paralysé et rendu vaines les dépêches de M. de Metternich et de M. Canning.
Le général Foy et le député Manuel[270] moururent et enlevèrent à l'opposition de gauche ses premiers orateurs. M. de Serre[271] et Camille Jordan descendirent également dans la tombe. Jusque dans le fauteuil de l'Académie, je fus obligé de défendre la liberté de la presse contre les larmoyantes supplications de M. de Lally-Tolendal[272]. La loi sur la police de la presse, que (p. 340) l'on appela la loi de justice et d'amour,[273] dut principalement sa chute à mes attaques. Mon Opinion sur le (p. 341) projet de cette loi est un travail historiquement curieux;[274] j'en reçus des compliments parmi lesquels deux noms sont singuliers à rappeler.
«Monsieur le vicomte,
«Je suis sensible aux remercîments que vous voulez bien m'adresser. Vous appelez obligeance ce que je regardais comme une dette, et j'ai été heureux de la payer à l'éloquent écrivain. Tous les vrais amis des lettres s'associent à votre triomphe et doivent se regarder comme solidaires de votre succès. De loin comme de près, j'y contribuerai de tout mon pouvoir, s'il est possible que vous ayez besoin d'efforts aussi faibles que les miens.
«Dans un siècle éclairé comme le nôtre, le génie est la seule puissance qui soit au-dessus des coups de la disgrâce; c'est à vous, monsieur, qu'il appartenait d'en fournir la preuve vivante à ceux qui s'en réjouissent comme à ceux qui ont le malheur de s'en affliger.
«J'ai l'honneur d'être, avec la considération la plus distinguée, votre, etc., etc.
«Étienne.»
«Paris, ce 5 avril 1826.(p. 342) «J'ai bien tardé, monsieur, à vous rendre grâce de votre admirable discours. Une fluxion sur les yeux, des travaux pour la Chambre, et plus encore les épouvantables séances de cette Chambre, me serviront d'excuse. Vous savez d'ailleurs combien mon esprit et mon âme s'associent à tout ce que vous dites et sympathisent avec tout le bien que vous essayez de faire à notre malheureux pays. Je suis heureux de réunir mes faibles efforts à votre puissante influence, et le délire d'un ministère qui tourmente la France et voudrait la dégrader, tout en m'inquiétant sur ses résultats prochains, me donne l'assurance consolante qu'un tel état de choses ne peut se prolonger. Vous aurez puissamment contribué à y mettre un terme, et si je mérite un jour qu'on place mon nom bien après le vôtre dans la lutte qu'il faut soutenir contre tant de folie et de crime, je m'estimerai bien récompensé.
«Agréez, monsieur, l'hommage d'une admiration sincère, d'une estime profonde et de la plus haute considération.
«Benjamin Constant.
«Paris, ce 21 mai 1827.»

Le Général Foy.
C'est au moment dont je parle que j'arrivai au plus haut point de mon importance politique. Par la guerre d'Espagne j'avais dominé l'Europe; mais une opposition violente me combattait en France: après ma chute, je devins à l'intérieur le dominateur avoué de l'opinion. Ceux qui m'avaient accusé d'avoir commis une faute irréparable en reprenant la plume étaient (p. 343) obligés de reconnaître que je m'étais formé un empire plus puissant que le premier. La jeune France était passée tout entière de mon côté et ne m'a pas quitté depuis. Dans plusieurs classes industrielles, les ouvriers étaient à mes ordres, et je ne pouvais plus faire un pas dans les rues sans être entouré. D'où me venait cette popularité? de ce que j'avais connu le véritable esprit de la France. J'étais parti pour le combat avec un seul journal, et j'étais devenu le maître de tous les autres. Mon audace me venait de mon indifférence: comme il m'aurait été parfaitement égal d'échouer, j'allais au succès sans m'embarrasser de la chute. Il ne m'est resté que cette satisfaction de moi-même, car que fait aujourd'hui à personne une popularité passée et qui s'est justement effacée du souvenir de tous?
La fête du roi[275] étant survenue, j'en profitai pour faire éclater une loyauté que mes opinions libérales n'ont jamais altérée. Je fis paraître cet article:
«Encore une trêve du roi!
«Paix aujourd'hui aux ministres!
«Gloire, honneur, longue félicité et longue vie à Charles X! c'est la Saint-Charles!
«C'est à nous surtout, vieux compagnons d'exil de notre monarque, qu'il faut demander l'histoire de Charles X.
«Vous autres, Français, qui n'avez point été forcés de quitter votre patrie, vous qui n'avez reçu un Français de plus que pour vous soustraire au despotisme impérial et au joug de l'étranger, habitants (p. 344) de la grande et bonne ville, vous n'avez vu que le prince heureux: quand vous vous pressiez autour de lui, le 12 avril 1814; quand vous touchiez en pleurant d'attendrissement des mains sacrées, quand vous retrouviez sur un front ennobli par l'âge et le malheur toutes les grâces de la jeunesse, comme on voit la beauté à travers un voile, vous n'aperceviez que la vertu triomphante, et vous conduisiez le fils des rois à la couche royale de ses pères.
«Mais nous, nous l'avons vu dormir sur la terre, comme nous sans asile, comme nous proscrit et dépouillé. Eh bien, cette bonté qui vous charme était la même; il portait le malheur comme il porte aujourd'hui la couronne, sans trouver le fardeau trop pesant, avec cette bénignité chrétienne qui tempérait l'éclat de son infortune, comme elle adoucit l'éclat de sa prospérité.
«Les bienfaits de Charles X s'accroissent de tous les bienfaits dont nous ont comblés ses aïeux: la fête d'un roi très chrétien est pour les Français la fête de la reconnaissance: livrons-nous donc aux transports de gratitude qu'elle doit nous inspirer. Ne laissons pénétrer dans notre âme rien qui puisse un moment rendre notre joie moins pure! Malheur aux hommes.....! Nous allions violer la trêve! Vive le roi![276]»
Mes yeux se sont remplis de larmes en copiant cette page de ma polémique, et je n'ai plus le courage d'en continuer les extraits. Oh! mon roi! vous que j'avais vu sur la terre étrangère, je vous ai revu sur cette même terre où vous alliez mourir! Quand je combattais (p. 345) avec tant d'ardeur pour vous arracher à des mains qui commençaient à vous perdre, jugez, par les paroles que je viens de transcrire, si j'étais votre ennemi, ou bien le plus tendre et le plus sincère de vos serviteurs! Hélas! je vous parle et vous ne m'entendez plus[277].
Le projet de loi sur la police de la presse ayant été retiré, Paris illumina[278]. Je fus frappé de cette manifestation publique, pronostic mauvais pour la monarchie: l'opposition avait passé dans le peuple, et le peuple, par son caractère, transforme l'opposition en révolution.
La haine contre M. de Villèle allait croissant; les royalistes, comme au temps du Conservateur, étaient (p. 346) redevenus, derrière moi, constitutionnels: M. Michaud[279] m'écrivait:
«Mon honorable maître,
«J'ai fait imprimer hier l'annonce de votre ouvrage sur la censure; mais l'article, composé de deux lignes, a été rayé par MM. les censeurs. M. Capefigue[280] vous expliquera pourquoi nous n'avons pas mis de blancs ou de noirs.
«Si Dieu ne vient à notre secours, tout est perdu; la royauté est comme la malheureuse Jérusalem entre les mains des Turcs, à peine ses enfants peuvent-ils en approcher; à quelle cause nous sommes-nous donc sacrifiés!
«Michaud.»
L'opposition avait enfin donné de l'irascibilité au tempérament froid de M. de Villèle, et rendu despotique l'esprit malfaisant de M. de Corbière. Celui-ci avait destitué le duc de Liancourt[281] de dix-sept places (p. 347) gratuites. Le duc de Liancourt n'était pas un saint, mais on trouvait en lui un homme bienfaisant, à qui la philanthropie avait décerné le titre de vénérable; par le bénéfice du temps, de vieux révolutionnaires ne marchent plus qu'avec une épithète comme les dieux d'Homère: c'est toujours le respectable M. tel, c'est toujours l'inflexible citoyen tel, qui, comme Achille, n'a jamais mangé de bouillie (a-chylos). À l'occasion du scandale arrivé au convoi de M. de Liancourt, M. de Sémonville[282] nous dit, à la Chambre des pairs: «Soyez tranquilles, messieurs, cela n'arrivera plus; je vous conduirai moi-même au cimetière.»
Le roi, au mois d'avril 1827, voulut passer la revue de la garde nationale[283] au Champ de Mars. Deux jours avant cette fatale revue, poussé par mon zèle et ne demandant qu'à mettre bas les armes, j'adressai à Charles X une lettre qui lui fut remise par M. de Blacas et dont il m'accusa réception par ce billet:
«Je n'ai pas perdu un seul instant, monsieur le vicomte, pour remettre au roi la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser pour Sa Majesté; (p. 348) et si elle daigne me charger d'une réponse, je ne mettrai pas moins d'empressement à vous la faire parvenir.
«Recevez, monsieur le vicomte, mes compliments les plus sincères.
«Blacas d'Aulps.»
«Ce 27 avril 1827, à 1 heure après midi.
AU ROI.
«Sire,
«Permettez à un sujet fidèle, que les moments d'agitation retrouveront toujours au pied du trône, de confier à Votre Majesté quelques réflexions qu'il croit utiles à la gloire de la couronne comme au bonheur et à la sûreté du roi.
«Sire, il n'est que trop vrai, il y a péril dans l'État, mais il est également certain que ce péril n'est rien si on ne contrarie pas les principes mêmes du gouvernement.
«Un grand secret, Sire, a été révélé: vos ministres ont eu le malheur d'apprendre à la France que ce peuple que l'on disait ne plus exister était tout vivant encore. Paris, pendant deux fois vingt-quatre heures, a échappé à l'autorité. Les mêmes scènes se répètent dans toute la France: les factions n'oublieront pas cet essai.
«Mais les rassemblements populaires, si dangereux dans les monarchies absolues, parce qu'elles sont en présence du souverain même, sont peu de chose dans la monarchie représentative, parce qu'elles ne sont en contact qu'avec des ministres ou des lois. Entre le monarque et les sujets se trouve (p. 349) une barrière qui arrête tout: les deux Chambres et les institutions publiques. En dehors de ces mouvements, le roi voit toujours son autorité et sa personne sacrée à l'abri.
«Mais, Sire, il y a une condition indispensable à la sûreté générale, c'est d'agir dans l'esprit des institutions: une résistance de votre conseil à cet esprit rendrait les mouvements populaires aussi dangereux dans la monarchie représentative qu'ils le sont dans la monarchie absolue.
«De la théorie je passe à l'application:
«Votre Majesté va paraître à la revue: elle y sera accueillie comme elle le doit; mais il est possible qu'elle entende au milieu des cris de vive le roi! d'autres cris qui lui feront connaître l'opinion publique sur ses ministres.
«De plus, Sire, il est faux qu'il y ait à présent, comme on le dit, une faction républicaine; mais il est vrai qu'il y a des partisans d'une monarchie illégitime: or, ceux-ci sont trop habiles pour ne pas profiter de l'occasion et ne pas mêler leurs voix le 29 à celle de la France pour donner le change.
«Que fera le roi? cédera-t-il ses ministres aux acclamations populaires? ce serait tuer le pouvoir. Le roi gardera-t-il ses ministres? ces ministres feront retomber sur la tête de leur auguste maître toute l'impopularité qui les poursuit. Je sais bien que le roi aurait le courage de se charger d'une douleur personnelle pour éviter un mal à la monarchie; mais on peut, par le moyen le plus simple, éviter ces calamités; permettez-moi, Sire, de vous le dire: on le peut en se renfermant dans l'esprit de nos institutions: (p. 350) les ministres ont perdu la majorité dans la Chambre des pairs et dans la nation: la conséquence naturelle de cette position critique est leur retraite. Comment, avec le sentiment de leur devoir, pourraient-ils s'obstiner, en restant au pouvoir, à compromettre la couronne? En mettant leur démission aux pieds de Votre Majesté, ils calmeront tout, ils finiront tout: ce n'est plus le roi qui cède, ce sont les ministres qui se retirent d'après tous les usages et tous les principes du gouvernement représentatif. Le roi pourra reprendre ensuite parmi eux ceux qu'il jugera à propos de conserver: il y en a deux que l'opinion honore, M. le duc de Doudeauville et M. le comte de Chabrol.
«La revue perdrait ainsi ses inconvénients et ne serait plus qu'un triomphe sans mélange. La session s'achèvera en paix au milieu des bénédictions répandues sur la tête de mon roi.
«Sire, pour avoir osé vous écrire cette lettre, il faut que je sois bien persuadé de la nécessité de prendre une résolution; il faut qu'un devoir bien impérieux m'ait poussé. Les ministres sont mes ennemis; je suis le leur; je leur pardonne comme chrétien; mais je ne leur pardonnerai jamais comme homme: dans cette position, je n'aurais jamais parlé au roi de leur retraite s'il n'y allait du salut de la monarchie.
«Je suis, etc.
«Chateaubriand.»
Madame la Dauphine et madame la duchesse de Berry furent insultées en se rendant à la revue; le roi (p. 351) fut généralement bien accueilli; mais une ou deux compagnies de la 6e légion crièrent: «À bas les ministres! à bas les jésuites!» Charles X offensé répliqua: «Je suis venu ici pour recevoir des hommages, non des leçons.» Il avait souvent à la bouche de nobles paroles que ne soutenait pas toujours la vigueur de l'action: son esprit était hardi, son caractère timide. Charles X, en rentrant au château, dit au maréchal Oudinot: «L'effet total a été satisfaisant. S'il y a quelques brouillons, la masse de la garde nationale est bonne: témoignez-lui ma satisfaction[284].» M. de Villèle arriva. Des légions à leur retour avaient passé devant l'hôtel des finances et crié: À bas Villèle! Le ministre, irrité par toutes les attaques précédentes, n'était plus à l'abri des mouvements d'une froide colère; il proposa au conseil de licencier la garde nationale. Il fut appuyé de MM. de Corbière, de Peyronnet, de Damas et de Clermont-Tonnerre, combattu par M. de Chabrol, l'évêque d'Hermopolis et le duc de Doudeauville. Une ordonnance du roi prononça le licenciement[285], coup le plus funeste porté à la monarchie avant le dernier coup des journées de Juillet: si à ce moment la garde nationale ne se fût pas trouvée dissoute, les barricades n'auraient pas eu lieu. M. le duc de Doudeauville donna sa démission[286]; il écrivit au roi une lettre (p. 352) motivée dans laquelle il annonçait l'avenir, que tout le monde, au reste, prévoyait.
Le gouvernement commençait à craindre; les journaux redoublaient d'audace, et on leur opposait, par habitude, un projet de censure; on pariait en même temps d'un ministère La Bourdonnaye[287], où aurait figuré M. de Polignac. J'avais eu le malheur de faire nommer M. de Polignac ambassadeur à Londres[288], (p. 353) malgré ce qu'avait pu me dire M. de Villèle, en cette occasion il vit mieux et plus loin que moi. En entrant au ministère, je m'étais empressé de faire quelque chose d'agréable à Monsieur. Le président du conseil était parvenu à réconcilier les deux frères, dans la prévision d'un changement prochain de règne: cela lui réussit; moi, en m'avisant une fois dans ma vie de vouloir être fin, je fus bête. Si M. de Polignac n'eût pas été ambassadeur, il ne serait pas devenu ministre des affaires étrangères.
M. de Villèle, obsédé d'un côté par l'opposition royaliste libérale, importuné de l'autre par les exigences des évêques, trompé par les préfets consultés, qui étaient eux-mêmes trompés[289], résolut de dissoudre la Chambre élective, malgré les trois cents qui lui restaient fidèles. Le rétablissement de la censure précéda la dissolution[290]. J'attaquai plus vivement que jamais[291]; (p. 354) les oppositions s'unirent; les élections des petits collèges furent toutes contre le ministère; à Paris la gauche triompha[292]; sept collèges nommèrent M. Royer-Collard, et les deux collèges où se présenta M. de Peyronnet, ministre, le rejetèrent[293]. Paris illumina de nouveau: il y eut des scènes sanglantes; des barricades se formèrent, et les troupes envoyées pour rétablir l'ordre furent obligées de faire feu: ainsi se préparaient les dernières et fatales journées[294]. Sur ces entrefaites, (p. 355) on reçut la nouvelle du combat de Navarin[295], succès dont je pouvais revendiquer ma part. Les grands malheurs de la Restauration ont été annoncés par des victoires; elles avaient de la peine à se détacher des héritiers de Louis le Grand.
La Chambre des pairs jouissait de la faveur publique par sa résistance aux lois oppressives; mais elle ne savait pas se défendre elle-même: elle se laissa gorger de fournées[296] contre lesquelles je fus presque le seul à réclamer. Je lui prédis que ces nominations vicieraient son principe et lui feraient perdre à la longue toute force dans l'opinion: me suis-je trompé? Ces fournées, dans le but de rompre une majorité, ont non seulement détruit l'aristocratie en France, mais elles sont devenues le moyen dont on se servira contre l'aristocratie anglaise; celle-ci sera étouffée sous une nombreuse fabrication de toges, et finira par perdre son hérédité, comme la pairie dénaturée l'a perdue en France.
La nouvelle Chambre arrivée prononça son fameux refus de concours: M. de Villèle, réduit à l'extrémité, songea à renvoyer une partie de ses collègues et négocia avec MM. Laffitte et Casimir Périer. Les deux chefs de l'opposition de gauche prêtèrent l'oreille: la mèche fut éventée; M. Laffitte n'osa franchir le pas; l'heure du président sonna, et le portefeuille tomba de ses mains[297]. J'avais rugi en me retirant des affaires; (p. 356) M. de Villèle se coucha: il eut la velléité de rester à la Chambre des députés; parti qu'il aurait dû prendre, mais il n'avait ni une connaissance assez profonde du gouvernement représentatif, ni une autorité assez grande sur l'opinion extérieure, pour jouer un pareil rôle: les nouveaux ministres exigèrent son bannissement à la Chambre des pairs, et il l'accepta. Consulté sur quelques remplaçants pour le cabinet, j'invitai à prendre M. Casimir Périer et le général Sébastiani: mes paroles furent perdues.
M. de Chabrol, chargé de composer le nouveau ministère, me mit en tête de la liste: j'en fus rayé avec indignation par Charles X. M. Portalis[298], le plus misérable caractère qui fut oncques, fédéré pendant les Cent-Jours, rampant aux pieds de la légitimité dont il parla comme aurait rougi de parler le plus ardent royaliste, aujourd'hui prodiguant sa banale adulation à Philippe, reçut les sceaux. À la guerre, M. de Caux[299] (p. 357) remplaça M. de Clermont-Tonnerre. M. le comte Roy[300], l'habile artisan de son immense fortune, fut chargé des finances. Le comte de La Ferronnays, mon ami, eut le portefeuille des affaires étrangères. M. de Martignac entra au ministère de l'intérieur; le roi ne tarda pas à le détester. Charles X suivait plutôt ses goûts que ses principes: s'il repoussait M. de Martignac à cause de son penchant aux plaisirs, il aimait MM. de Corbière et de Villèle qui n'allaient pas à la messe.
M. de Chabrol et l'évêque d'Hermopolis restèrent provisoirement au ministère. L'évêque, avant de se retirer, vint me voir; il me demanda si je le voulais remplacer à l'instruction publique: «Prenez M. Royer-Collard, lui dis-je, je n'ai nulle envie d'être ministre; mais si le roi me voulait absolument rappeler au conseil, je n'y rentrerais que par le ministère des affaires étrangères, en réparation de l'affront que j'y ai reçu. Or, je ne puis avoir aucune prétention sur ce portefeuille, si bien placé entre les mains de mon noble ami.»
(p. 358) Après la mort de M. Mathieu de Montmorency, M. de Rivière[301] était devenu gouverneur du duc de Bordeaux; il travaillait dès lors au renversement de M. de Villèle, car la partie dévote de la cour s'était ameutée contre le ministre des finances. M. de Rivière me donna rendez-vous rue de Taranne, chez M. de Marcellus, pour me faire inutilement la même proposition que me fit plus tard l'abbé Frayssinous. M. de Rivière mourut, et M. le baron de Damas lui succéda auprès de M. le duc de Bordeaux. Il s'agissait donc toujours de la succession de M. de Chabrol et de M. l'évêque d'Hermopolis. L'abbé Feutrier[302], évêque de Beauvais, fut installé au ministère des cultes, que l'on détacha de l'instruction publique, laquelle tomba à M. de Vatimesnil[303]. Restait le ministère de la marine: (p. 359) on me l'offrit; je ne l'acceptai point. M. le comte Roy me pria de lui indiquer quelqu'un qui me fût agréable et que je choisirais dans la couleur de mon opinion. Je désignai M. Hyde de Neuville[304]. Il fallait en outre trouver le précepteur de M. le duc de Bordeaux; le comte Roy m'en parla: M. de Chéverus[305] se présenta tout d'abord à ma pensée. Le ministre des finances courut chez Charles X; le roi lui dit: «Soit: Hyde à la marine; mais pourquoi Chateaubriand ne prend-il lui-même ce ministère? Quant à M. de Chéverus, le choix serait excellent; je suis fâché de n'y avoir pas pensé; deux heures plus tôt, la chose était faite: dites-le bien à Chateaubriand, mais M. Tharin[306] est nommé.»
(p. 360) M. Roy me vint apprendre le succès de sa négociation; il ajouta: «Le roi désire que vous acceptiez une ambassade; si vous le voulez, vous irez à Rome.» Ce mot de Rome eut sur moi un effet magique; j'éprouvai la tentation à laquelle les anachorètes étaient exposés dans le désert. Charles X, en prenant à la marine l'ami que je lui avais désigné, faisait les premières avances; je ne pouvais plus me refuser à ce qu'il attendait de moi: je consentis donc encore à m'éloigner. Du moins, cette fois, l'exil me plaisait: Pontificum veneranda sedes, sacrum solium. Je me sentis saisi du désir de fixer mes jours, de l'envie de disparaître (même par calcul de renommée) dans la ville des funérailles, au moment de mon triomphe politique. Je n'aurais plus élevé la voix, sinon comme l'oiseau fatidique de Pline, pour dire chaque matin Ave au Capitole et à l'aurore. Il se peut qu'il fût utile à mon pays d'être débarrassé de moi: par le poids dont je me sens, je devine le fardeau que je dois être pour les autres. Les esprits de quelque puissance qui se rongent et se retournent sur eux-mêmes sont fatigants. Dante met aux enfers des âmes torturées sur une couche de feu. M. le duc de Laval[307], que j'allais (p. 361) remplacer à Rome[308], fut nommé à l'ambassade de Vienne.
Avant de changer de sujet, je demande la permission (p. 362) de revenir sur mes pas et de me soulager d'un fardeau. Je ne suis pas entré sans souffrir dans le détail de mon long différend avec M. de Villèle. On m'a accusé d'avoir contribué à la chute de la monarchie légitime; il me convient d'examiner ce reproche.
Les événements arrivés sous le ministère dont j'ai fait partie ont une importance qui le lie à la fortune commune de la France: il n'y a pas un Français dont le sort n'ait été atteint du bien que je puis avoir fait, du mal que j'ai subi. Par des affinités bizarres et inexplicables, par des rapports secrets qui entrelacent quelquefois de hautes destinées à des destinées vulgaires, les Bourbons ont prospéré tant qu'ils ont daigné m'écouter, quoique je sois loin de croire, avec le poète[309], que mon éloquence a fait l'aumône à la royauté. Sitôt qu'on a cru devoir briser le roseau qui croissait au pied du trône, la couronne a penché, et bientôt elle est tombée: souvent, en arrachant un brin d'herbe, on fait crouler une grande ruine.
Ces faits incontestables, on les expliquera comme on voudra; s'ils donnent à ma carrière politique une valeur relative qu'elle n'a pas d'elle-même, je n'en tirerai point vanité, je ne ressens point une mauvaise joie du hasard qui mêle mon nom d'un jour aux événements des siècles. Quelle qu'ait été la variété des accidents de ma course aventureuse, où que les noms et les faits m'aient promené, le dernier horizon du tableau est toujours menaçant et triste.
(p. 363) . . . . . . . Juga cœpta moveri
Silvarum, visæque canes ululare per umbram[310].
Mais si la scène a changé d'une manière déplorable, je ne dois, dit-on, accuser que moi-même: pour venger ce qui m'a semblé une injure, j'ai tout divisé, et cette division a produit en dernier résultat le renversement du trône. Voyons.
M. de Villèle a déclaré qu'on ne pouvait gouverner ni avec moi ni sans moi. Avec moi, c'était une erreur; sans moi, à l'heure où M. de Villèle disait cela, il disait vrai, car les opinions les plus diverses me composaient une majorité.
M. le président du conseil ne m'a jamais connu. Je lui étais sincèrement attaché; je l'avais fait entrer dans son premier ministère, ainsi que le prouvent le billet de remercîments de M. le duc de Richelieu et les autres billets que j'ai cités. J'avais donné ma démission de plénipotentiaire à Berlin, lorsque M. de Villèle s'était retiré. On lui persuada qu'à sa seconde rentrée dans les affaires, je désirais sa place. Je n'avais point ce désir. Je ne suis point de la race intrépide, sourde à la voix du dévouement et de la raison. La vérité est que je n'ai aucune ambition; c'est précisément la passion qui me manque, parce que j'en ai une autre qui me domine. Lorsque je priais M. de Villèle de porter au roi quelque dépêche importante, pour m'éviter la peine d'aller au château, afin de me laisser le loisir de visiter une chapelle gothique dans la rue Saint-Julien-le-Pauvre, il aurait été bien rassuré contre mon ambition, s'il eût mieux jugé de ma candeur puérile ou de la hauteur de mes dédains.
(p. 364) Rien ne m'agréait dans la vie positive, hormis peut-être le ministère des affaires étrangères. Je n'étais pas insensible à l'idée que la patrie me devrait, dans l'intérieur la liberté, à l'extérieur l'indépendance. Loin de chercher à renverser M. de Villèle, j'avais dit au roi: «Sire, M. de Villèle est un président plein de lumières; Votre Majesté doit éternellement le garder à la tête de ses conseils.»
M. de Villèle ne le remarqua pas: mon esprit pouvait tendre à la domination, mais il était soumis à mon caractère; je trouvais plaisir dans mon obéissance, parce qu'elle me débarrassait de ma volonté. Mon défaut capital est l'ennui, le dégoût de tout, le doute perpétuel. S'il se fût rencontré un prince qui, me comprenant, m'eût retenu de force au travail, il avait peut-être quelque parti à tirer de moi: mais le ciel fait rarement naître ensemble l'homme qui veut et l'homme qui peut. En fin de compte, est-il aujourd'hui une chose pour laquelle on voulût se donner la peine de sortir de son lit? On s'endort au bruit des royaumes tombés pendant la nuit, et que l'on balaye chaque matin devant notre porte.
D'ailleurs, depuis que M. de Villèle s'était séparé de moi, la politique s'était dérangée: l'ultracisme contre lequel la sagesse du président du conseil luttait encore l'avait débordé. La contrariété qu'il éprouvait de la part des opinions intérieures et du mouvement des opinions extérieures le rendait irritable: de là la presse entravée, la garde nationale de Paris cassée, etc. Devais-je laisser périr la monarchie, afin d'acquérir le renom d'une modération hypocrite aux aguets? Je crus très sincèrement remplir un devoir (p. 365) en combattant à la tête de l'opposition, trop attentif au péril que je voyais d'un côté, pas assez frappé du danger contraire. Lorsque M. de Villèle fut renversé, on me consulta sur la nomination d'un autre ministère. Si l'on eût pris, comme je le proposais, M. Casimir Périer, le général Sébastiani et M. Royer-Collard, les choses auraient pu se soutenir. Je ne voulus point accepter le département de la marine, et je le fis donner à mon ami M. Hyde de Neuville; je refusai également deux fois l'instruction publique; jamais je ne serais rentré au conseil sans être le maître. J'allai à Rome chercher parmi les ruines mon autre moi-même, car il y a dans ma personne deux êtres distincts, et qui n'ont aucune communication l'un avec l'autre.
J'en ferai pourtant loyalement l'aveu, l'excès du ressentiment ne me justifie pas selon la règle et le mot vénérable de vertu, mais ma vie entière me sert d'excuse.
Officier au régiment de Navarre, j'étais revenu des forêts de l'Amérique pour me rendre auprès de la légitimité fugitive, pour combattre dans ses rangs contre mes propres lumières, le tout sans conviction, par le seul devoir du soldat. Je restai huit ans sur le sol étranger, accablé de toutes les misères.
Ce large tribut payé, je rentrai en France en 1800. Bonaparte me rechercha et me plaça; à la mort du duc d'Enghien, je me dévouai de nouveau à la mémoire des Bourbons. Mes paroles sur le tombeau de Mesdames à Trieste ranimèrent la colère du dispensateur des empires; il menaça de me faire sabrer sur les marches des Tuileries. La brochure De Bonaparte et (p. 366) des Bourbons valut à Louis XVIII, de son aveu même, autant que cent mille hommes.
À l'aide de la popularité dont je jouissais alors, la France anticonstitutionnelle comprit les institutions de la royauté légitime. Durant les Cent Jours, la monarchie me vit auprès d'elle dans son second exil. Enfin, par la guerre d'Espagne, j'avais contribué à étouffer les conspirations, à réunir les opinions sous la même cocarde, et à rendre à notre canon sa portée. On sait le reste de mes projets: reculer nos frontières, donner dans le nouveau monde des couronnes nouvelles à la famille de saint Louis.
Cette longue persévérance dans les mêmes sentiments méritait peut-être quelques égards. Sensible à l'affront, il m'était impossible de mettre aussi de côté ce que je pouvais valoir, d'oublier tout à fait que j'étais le restaurateur de la religion, l'auteur du Génie du christianisme.
Mon agitation croissait nécessairement encore à la pensée qu'une mesquine querelle faisait manquer à notre patrie une occasion de grandeur qu'elle ne retrouverait plus. Si l'on m'avait dit: «Vos plans seront suivis; on exécutera sans vous ce que vous aviez entrepris,» j'aurais tout oublié pour la France. Malheureusement j'avais la croyance qu'on n'adopterait pas mes idées; l'événement l'a prouvé.
J'étais dans l'erreur peut-être, mais j'étais persuadé que M. le comte de Villèle ne comprenait pas la société qu'il conduisait; je suis convaincu que les solides qualités de cet habile ministre étaient inadéquates à l'heure de son ministère: il était venu trop tôt sous la restauration. Les opérations de finances, les associations (p. 367) commerciales, le mouvement industriel, les canaux, les bateaux à vapeur, les chemins de fer, les grandes routes, une société matérielle qui n'a de passion que pour la paix, qui ne rêve que le confort de la vie, qui ne veut faire de l'avenir qu'un perpétuel aujourd'hui, dans cet ordre de choses, M. de Villèle eût été roi. M. de Villèle a voulu un temps qui ne pouvait être à lui, et, par honneur, il ne veut pas d'un temps qui lui appartient. Sous la Restauration, toutes les facultés de l'âme étaient vivantes; tous les partis rêvaient de réalités ou de chimères; tous, avançant ou reculant, se heurtaient en tumulte; personne ne prétendait rester où il était; la légitimité constitutionnelle ne paraissait à aucun esprit ému le dernier mot de la république ou de la monarchie. On sentait sous ses pieds remuer dans la terre des armées ou des révolutions qui venaient s'offrir pour des destinées extraordinaires. M. de Villèle était éclairé sur ce mouvement; il voyait croître les ailes qui, poussant à la nation, l'allaient rendre à son élément, à l'air, à l'espace, immense et légère qu'elle est. M. de Villèle voulait retenir cette nation sur le sol, l'attacher en bas, mais il n'en eut jamais la force. Je voulais, moi, occuper les Français à la gloire, les attacher en haut, essayer de les mener à la réalité par des songes: C'est ce qu'ils aiment.
Il serait mieux d'être plus humble, plus prosterné, plus chrétien. Malheureusement je suis sujet à faillir; je n'ai point la perfection évangélique si un homme me donnait un soufflet, je ne tendrais pas l'autre joue.
Eussé-je deviné le résultat, certes je me serais abstenu; la majorité qui vota la phrase sur le refus de (p. 368) concours ne l'eut pas votée, si elle eût prévu la conséquence de son vote. Personne ne désirait sérieusement une catastrophe, excepté quelques hommes à part. Il n'y a eu d'abord qu'une émeute, et la légitimité seule l'a transformée en révolution: le moment venu, elle a manqué de l'intelligence, de la prudence, de la résolution qui la pouvaient encore sauver. Après tout, c'est une monarchie tombée; il en tombera bien d'autres: je ne lui devais que ma fidélité; elle l'aura à jamais.
Dévoué aux premières adversités de la monarchie, je me suis consacré à ses dernières infortunes: le malheur me trouvera toujours pour second. J'ai tout renvoyé, places, pensions, honneurs; et, afin de n'avoir rien à demander à personne, j'ai mis en gage mon cercueil. Juges austères et rigides, vertueux et infaillibles royalistes, qui avez mêlé un serment à vos richesses, comme vous mêlez le sel aux viandes de vos festins pour les conserver, ayez un peu d'indulgence à l'égard de mes amertumes passées, je les expie aujourd'hui à ma manière, qui n'est pas la vôtre. Croyez-vous qu'à l'heure du soir, à cette heure où l'homme de peine se repose, il ne sente pas le poids de la vie, quand ce poids lui est rejeté sur les bras? Et cependant, j'ai pu ne pas porter le fardeau, j'ai vu Philippe dans son palais, du 1er au 6 août 1830, et je le raconterai en son lieu; il n'a tenu qu'à moi d'écouter des paroles généreuses.
Plus tard, si j'avais pu me repentir d'avoir bien fait, il m'était encore possible de revenir sur le premier mouvement de ma conscience. M. Benjamin Constant, homme si puissant alors, m'écrivait le 20 septembre[311]: (p. 369) «J'aimerais bien mieux vous écrire sur vous que sur moi, la chose aurait plus d'importance. Je voudrais pouvoir vous parler de la perte que vous faites essuyer à la France entière en vous retirant de ses destinées, vous qui avez exercé sur elle une influence si noble et si salutaire! Mais il y aurait indiscrétion à traiter ainsi des questions personnelles, et je dois en gémissant comme tous les Français, respecter vos scrupules.»
Mes devoirs ne me semblant point encore consommés, j'ai défendu la veuve et l'orphelin, j'ai subi les procès et la prison que Bonaparte, même dans ses plus grandes colères, m'avait épargnés. Je me présente entre ma démission à la mort du duc d'Enghien et mon cri pour l'enfant dépouillé; je m'appuie sur un prince fusillé et sur un prince banni; ils soutiennent mes vieux bras entrelacés à leurs bras débiles: royalistes, êtes-vous si bien accompagnés?
Mais plus j'ai garrotté ma vie par les liens du dévouement et de l'honneur, plus j'ai échangé la liberté de mes actions contre l'indépendance de ma pensée; cette pensée est rentrée dans sa nature. Maintenant, en dehors de tout, j'apprécie les gouvernements ce qu'ils valent. Peut-on croire aux rois de l'avenir? faut-il croire aux peuples du présent? L'homme sage et inconsolé de ce siècle sans conviction ne rencontre un misérable repos que dans l'athéisme politique. Que les jeunes générations se bercent d'espérances: avant de toucher au but, elles attendront de longues années; les âges vont au nivellement général, mais ils ne hâtent point leur marche à l'appel de nos désirs: le temps est une sorte d'éternité appropriée aux choses (p. 370) mortelles; il compte pour rien les races et leurs douleurs dans les œuvres qu'il accomplit.
Il résulte de ce qu'on vient de lire, que si l'on avait fait ce que j'avais conseillé; que si d'étroites envies n'avaient préféré leur satisfaction à l'intérêt de la France; que si le pouvoir avait mieux apprécié les capacités relatives, que si les cabinets étrangers avaient jugé, comme Alexandre, que le salut de la monarchie française était dans des institutions libérales; que si ces cabinets n'avaient point entretenu l'autorité rétablie dans la défiance du principe de la charte, la légitimité occuperait encore le trône. Ah! ce qui est passé est passé! on a beau retourner en arrière, se remettre à la place que l'on a quittée, on ne retrouve rien de ce qu'on y avait laissé: hommes, idées, circonstances, tout s'est évanoui.[Lien vers la Table des Matières]
Madame Récamier. — Enfance de Madame Récamier. — Suite du récit de Benjamin Constant: Madame de Staël. — Voyage de Madame Récamier en Angleterre. — Premier voyage de madame de Staël en Allemagne. — Madame Récamier à Paris. — Projets des généraux. — Portrait de Bernadotte. — Procès de Moreau. — Lettres de Moreau et de Masséna à Madame Récamier. — Mort de M. Necker. — Retour de Madame de Staël. — Madame Récamier à Coppet. — Le prince Auguste de Prusse. — Second voyage de Madame de Staël en Allemagne. — Château de Chaumont. — Lettre de Madame de Staël à Bonaparte. — Madame Récamier et M. Mathieu de Montmorency sont exilés. — Madame Récamier à Châlons. — Madame Récamier à Lyon. — Madame de Chevreuse. — Prisonniers espagnols. — Madame Récamier à Rome. — Albano. — Canova: ses lettres. — Le pêcheur d'Albano. — Madame Récamier à Naples. — Le duc de Rohan-Chabot. — Le roi Murat: ses lettres. — Madame Récamier revient en France. — Lettre de Madame de Genlis. — Lettres de Benjamin Constant. — Articles de Benjamin Constant au retour de Bonaparte de l'île d'Elbe. — Madame de Krüdener. — Le duc de Wellington. — Je retrouve Madame Récamier. — Mort de Madame de Staël. — L'Abbaye-aux-Bois.
Nous passons à l'ambassade de Rome, à cette Italie le rêve de mes jours. Avant de continuer mon récit, je dois parler d'une femme qu'on ne perdra plus de vue jusqu'à la fin de ces Mémoires. Une correspondance va s'ouvrir de Rome à Paris entre elle et moi: il faut donc savoir à qui j'écris, comment et à quelle époque j'ai connu madame Récamier.
(p. 372) Elle rencontra aux divers rangs de la société des personnages plus ou moins célèbres engagés sur la scène du monde; tous lui ont rendu un culte. Sa beauté mêle son existence idéale aux faits matériels de notre histoire: lumière sereine éclairant un tableau d'orage.
Revenons encore sur des temps écoulés; essayons à la clarté de mon couchant de dessiner un portrait sur le ciel où ma nuit qui s'approche va bientôt répandre ses ombres.
Une lettre, publiée dans le Mercure après ma rentrée en France en 1800, avait frappé madame de Staël. Je n'étais pas encore rayé de la liste des émigrés; Atala me tira de mon obscurité. Madame Bacciochi (Élisa Bonaparte), à la prière de M. de Fontanes, sollicita et obtint ma radiation dont madame de Staël s'était occupée; j'allai la remercier. Je ne me souviens plus si ce fut Christian de Lamoignon ou l'auteur de Corinne qui me présenta à madame Récamier son amie; celle-ci demeurait alors dans sa maison de la rue du Mont-Blanc. Au sortir de mes bois et de l'obscurité de ma vie, j'étais encore tout sauvage; j'osais à peine lever les yeux sur une femme entourée d'adorateurs.

Madame Récamier.
Environ un mois après, j'étais un matin chez madame de Staël; elle m'avait reçu à sa toilette; elle se laissait habiller par mademoiselle Olive, tandis qu'elle causait en roulant dans ses doigts une petite branche verte. Entre tout à coup madame Récamier, vêtue d'une robe blanche; elle s'assit au milieu d'un sofa de soie bleue. Madame de Staël, restée debout, continua sa conversation fort animée, et parlait avec éloquence; je répondais à peine, les yeux attachés sur madame (p. 373) Récamier. Je n'avais jamais inventé rien de pareil, et plus que jamais je fus découragé: mon admiration se changea en humeur contre ma personne. Madame Récamier sortit, et je ne la revis plus que douze ans après.
Douze ans! quelle puissance ennemie coupe et gaspille ainsi nos jours, les prodigue ironiquement à toutes les indifférences appelées attachements, à toutes les misères surnommées félicités! Puis, par une autre dérision, quand elle en a flétri et dépensé la partie la plus précieuse, elle vous ramène au point de départ de vos courses. Et comment vous y ramène-t-elle? l'esprit obsédé des idées étrangères, des fantômes importuns, des sentiments trompés ou incomplets d'un monde qui ne vous a laissé rien d'heureux. Ces idées, ces fantômes, ces sentiments s'interposent entre vous et le bonheur que vous pourriez encore goûter. Vous revenez le cœur souffrant de regrets, désolé de ces erreurs de jeunesse si pénibles au souvenir dans la pudeur des années. Voilà comme je revins après avoir été à Rome, en Syrie, après avoir vu passer l'empire, après être devenu l'homme du bruit, après avoir cessé d'être l'homme du silence. Madame Récamier qu'avait-elle fait? quelle avait été sa vie?
Je n'ai point connu la plus grande partie de l'existence à la fois éclatante et retirée dont je vais vous entretenir: force m'est donc de recourir à des autorités différentes de la mienne, mais elles seront irrécusables. D'abord madame Récamier m'a raconté des faits dont elle a été témoin et m'a communiqué des lettres précieuses. Elle a écrit, sur ce qu'elle a vu, des notes dont elle m'a permis de consulter le texte, et (p. 374) trop rarement de le citer. Ensuite madame de Staël dans sa correspondance, Benjamin Constant dans ses souvenirs, les uns imprimés, les autres manuscrits, M. Ballanche dans une notice sur notre commune amie, madame la duchesse d'Abrantès dans ses esquisses, madame de Genlis dans les siennes, ont abondamment fourni les matériaux de ma narration: je n'ai fait que nouer les uns aux autres tant de beaux noms, en remplissant les vides par mon récit, quand quelques anneaux de la chaîne des événements étaient sautés ou rompus.
Montaigne dit que les hommes vont béant aux choses futures: j'ai la manie de béer aux choses passées. Tout est plaisir, surtout lorsque l'on tourne les yeux sur les premières années de ceux que l'on chérit; on allonge une vie aimée; on étend l'affection que l'on ressent sur des jours que l'on a ignorés et que l'on ressuscite; on embellit ce qui fut de ce qui est; on recompose de la jeunesse.
J'ai vu à Lyon le Jardin des Plantes établi sur les ruines de l'amphithéâtre antique et dans les jardins de l'ancienne abbaye de la Déserte, maintenant abattue: le Rhône et la Saône sont à vos pieds; au loin s'élève la plus haute montagne de l'Europe, première colonne milliaire de l'Italie, avec son écriteau blanc au-dessus des nuages. Madame Récamier[313] fut mise dans cette abbaye, elle y passa son enfance derrière (p. 375) une grille qui ne s'ouvrait sur l'église extérieure qu'à l'élévation de la messe. Alors on apercevait dans la chapelle intérieure du couvent des jeunes filles prosternées. La fête de l'abbesse était la fête principale de la communauté; la plus belle des pensionnaires faisait le compliment d'usage: sa parure était ajustée, sa chevelure nattée, sa tête voilée et couronnée des mains de ses compagnes; et tout cela en silence, car l'heure du lever était une de celles qu'on appelait du grand silence dans les monastères. Il va de suite que Juliette avait les honneurs de la journée. Son père et sa mère s'étant établis à Paris rappelèrent leur enfant auprès d'eux. Sur des brouillons écrits par madame Récamier je recueille cette note:
«La veille du jour où ma tante devait venir me chercher, je fus conduite dans la chambre de madame l'abbesse pour recevoir sa bénédiction. Le lendemain, baignée de larmes, je venais de franchir la porte que je ne me souvenais pas d'avoir vue s'ouvrir pour me laisser entrer, je me trouvai dans une voiture avec ma tante, et nous partîmes pour Paris.
«Je quitte à regret une époque si calme et si pure pour entrer dans celle des agitations. Elle me revient quelquefois comme dans un vague et doux rêve, avec ses nuages d'encens, ses cérémonies infinies, ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs.»
Ces heures sorties d'un pieux désert se reposent maintenant dans une autre solitude religieuse, sans avoir rien perdu de leur fraîcheur et de leur harmonie.
(p. 376) Benjamin Constant, l'homme qui a eu le plus d'esprit après Voltaire, cherche à donner une idée de la première jeunesse de madame Récamier: il a puisé dans le modèle dont il prétendait retracer les traits une grâce qui ne lui était pas naturelle.
«Parmi les femmes de notre époque, dit-il, que des avantages de figure, d'esprit ou de caractère ont rendues célèbres, il en est une que je veux peindre. Sa beauté l'a d'abord fait admirer; son âme s'est ensuite fait connaître, et son âme a encore paru supérieure à sa beauté. L'habitude de la société a fourni à son esprit le moyen de se déployer, et son esprit n'est resté au-dessous ni de sa beauté ni de son âme.
«À peine âgée de quinze ans[314], mariée à un homme qui, occupé d'affaires immenses, ne pouvait guider son extrême jeunesse, madame Récamier se trouva presque entièrement livrée à elle-même dans un pays qui était encore un chaos.
«Plusieurs femmes de la même époque ont rempli l'Europe de leurs diverses célébrités. La plupart ont payé le tribut à leur siècle, les unes par des amours sans délicatesse, les autres par de coupables condescendances envers les tyrannies successives.
«Celle que je peins sortit brillante et pure de cette atmosphère qui flétrissait ce qu'elle ne corrompait pas. L'enfance fut d'abord pour elle une sauvegarde, tant l'auteur de ce bel ouvrage, faisait tourner tout à son profit. Éloignée du monde dans une solitude embellie par les arts, elle se faisait une (p. 377) douce occupation de toutes ces études charmantes et poétiques qui restent le charme d'un autre âge.
«Souvent aussi, entourée de jeunes compagnes, elle se livrait avec elles à des jeux bruyants. Svelte et légère, elle les devançait à la course; elle couvrait d'un bandeau ses yeux qui devaient un jour pénétrer toutes les âmes. Son regard, aujourd'hui si expressif et si profond, et qui semble nous révéler des mystères qu'elle-même ne connaît pas, n'étincelait alors que d'une gaieté vive et folâtre. Ses beaux cheveux, qui ne peuvent se détacher sans nous remplir de trouble, tombaient alors, sans danger pour personne, sur ses blanches épaules. Un rire éclatant et prolongé interrompait souvent ses conversations enfantines; mais déjà l'on eût pu remarquer en elle cette observation fine et rapide qui saisit le ridicule, cette malignité douce qui s'en amuse sans jamais blesser, et surtout ce sentiment exquis d'élégance, de pureté, de bon goût, véritable noblesse native, dont les titres sont empreints sur les êtres privilégiés.
«Le grand monde d'alors était trop contraire à sa nature pour qu'elle ne préférât pas la retraite. On ne la vit jamais dans les maisons ouvertes à tout venant, seules réunions possibles quand toute société fermée eût été suspecte; où toutes les classes se précipitaient, parce qu'on pouvait y parler sans rien dire, s'y rencontrer sans se compromettre; où le mauvais ton tenait lieu d'esprit et le désordre de gaieté. On ne la vit jamais à cette cour du Directoire, où le pouvoir était tout à la fois terrible et familier, inspirant la crainte sans échapper au mépris.
(p. 378) «Cependant madame Récamier sortait quelquefois de sa retraite pour aller au spectacle ou dans les promenades publiques, et, dans ces lieux fréquentés par tous, ces rares apparitions étaient de véritables événements. Tout autre but de ces réunions immenses était oublié, et chacun s'élançait sur son passage. L'homme assez heureux pour la conduire avait à surmonter l'admiration comme un obstacle; ses pas étaient à chaque instant ralentis par les spectateurs pressés autour d'elle; elle jouissait de ce succès avec la gaieté d'un enfant et la timidité d'une jeune fille; mais la dignité gracieuse, qui dans sa retraite la distinguait de ses jeunes amies, contenait au dehors la foule effervescente. On eût dit qu'elle régnait également par sa seule présence sur ses compagnes et sur le public. Ainsi se passèrent les premières années du mariage de madame Récamier[315], entre des occupations poétiques, des (p. 379) jeux enfantins dans la retraite, et de courtes et brillantes apparitions dans le monde.»
Interrompant le récit de l'auteur d'Adolphe, je dirai que, dans cette société succédant à la terreur, tout le monde craignait d'avoir l'air de posséder un foyer. On se rencontrait dans les lieux publics, surtout au Pavillon d'Hanovre: quand je vis ce pavillon, il était abandonné comme la salle d'une fête d'hier, ou comme un théâtre dont les acteurs étaient à jamais descendus. Là s'étaient retrouvées des jeunes échappées de prison à qui André Chénier avait fait dire:
Je ne veux point mourir encore.
Madame Récamier avait rencontré Danton allant au supplice, et elle vit bientôt après quelques-unes des belles victimes dérobées à des hommes devenus eux-mêmes victimes de leur propre fureur.
Je reviens à mon guide Benjamin Constant:
«L'esprit de madame Récamier avait besoin d'un autre aliment. L'instinct du beau lui faisait aimer d'avance, sans les connaître, les hommes distingués par une réputation de talent et de génie.
«M. de Laharpe, l'un des premiers, sut apprécier cette femme qui devait un jour grouper autour d'elle toutes les célébrités de son siècle. Il l'avait rencontrée dans son enfance, il la revit mariée, et la conversation de cette jeune personne de quinze ans eut mille attraits pour un homme que son excessif amour-propre et l'habitude des entretiens avec les hommes les plus spirituels de France rendaient fort exigeant et fort difficile.
«M. de Laharpe se dégageait auprès de madame (p. 380) Récamier de la plupart des défauts qui rendaient son commerce épineux et presque insupportable. Il se plaisait à être son guide: il admirait avec quelle rapidité son esprit suppléait à l'expérience et comprenait tout ce qu'il lui révélait sur le monde et sur les hommes. C'était au moment de cette conversion fameuse que tant de gens ont qualifiée d'hypocrisie. J'ai toujours regardé cette conversion comme sincère. Le sentiment religieux est une faculté inhérente à l'homme; il est absurde de prétendre que la fraude et le mensonge aient créé cette faculté. On ne met rien dans l'âme humaine que ce que la nature y a mis. Les persécutions, les abus d'autorité en faveur de certains dogmes peuvent nous faire illusion à nous-mêmes et nous révolter contre ce que nous éprouverions si on ne nous l'imposait pas; mais, dès que les causes extérieures ont cessé, nous revenons à notre tendance primitive: quand il n'y a plus de courage à résister, nous ne nous applaudissons plus de notre résistance. Or, la révolution ayant ôté ce mérite à l'incrédulité, les hommes que la vanité seule avait rendus incrédules purent devenir religieux de bonne foi.
«M. de Laharpe était de ce nombre; mais il garda son caractère intolérant, et cette disposition amère qui lui faisait concevoir de nouvelles haines sans abjurer les anciennes. Toutes ces épines de sa dévotion disparaissaient cependant auprès de madame Récamier.»
Voici quelques fragments des lettres de M. de Laharpe à madame Récamier, dont Benjamin Constant vient de parler:
(p. 381) «Samedi, 28 septembre.
«Quoi, madame, vous portez la bonté jusqu'à vouloir honorer d'une visite un pauvre proscrit comme moi! C'est pour cette fois que je pourrais dire comme les anciens patriarches, à qui d'ailleurs je ressemble si peu, «qu'un ange est venu dans ma demeure». Je sais bien que vous aimez à faire œuvres de miséricorde; mais, par le temps qui court, tout bien est difficile, et celui-là comme les autres. Je dois vous prévenir, à mon grand regret, que venir seule est d'abord impossible pour bien des raisons; entre autres, qu'avec votre jeunesse et votre figure dont l'éclat vous suivra partout, vous ne sauriez voyager sans une femme de chambre à qui la prudence me défend de confier le secret de ma retraite, qui n'est pas à moi seul. Vous n'auriez donc qu'un moyen d'exécuter votre généreuse résolution, ce serait de vous consulter avec madame de Clermont[316] qui vous amènerait un jour dans son petit castel champêtre, et de là il vous serait très aisé de venir avec elle. Vous êtes faites toutes deux pour vous apprécier et pour vous aimer l'une et l'autre. . . . . Je fais dans ce moment-ci beaucoup de vers. En les faisant, je songe souvent que je pourrai les lire un jour à cette belle et charmante Juliette dont l'esprit est aussi fin que le regard, et le goût aussi pur que son âme. Je vous enverrais bien aussi le fragment d'Adonis que vous aimez, quoique devenu un peu profane pour moi; mais je voudrais la promesse qu'il ne sortira pas de vos mains. . . . . . . . .
(p. 382) «Adieu, madame; je me laisse aller avec vous à des idées que toute autre que vous trouverait bien extraordinaire d'adresser à une personne de seize ans, mais je sais que vos seize ans ne sont que sur votre figure[317].»
«Samedi.
«Il y a bien longtemps, madame, que je n'ai eu le plaisir de causer avec vous, et si vous êtes sûre, comme vous devez l'être que c'est une de mes privations, vous ne m'en ferez pas de reproches...
«Vous avez lu dans mon âme; vous y avez vu que j'y portais le deuil des malheurs publics et celui de mes propres fautes, et j'ai dû sentir que cette triste disposition formait un contraste trop fort avec tout l'éclat qui environne votre âge et vos charmes. Je crains même qu'il ne se soit fait apercevoir quelquefois dans le peu de moments qu'il m'a été permis de passer avec vous, et je réclame là-dessus votre indulgence. Mais à présent, madame, que la Providence semble nous montrer de bien près un meilleur avenir[318], à qui pourrais-je confier mieux qu'à vous la joie que me donnent des espérances si douces et que je crois si prochaines? Qui tiendra une plus grande place que vous dans les jouissances particulières qui se mêleront à la joie publique? (p. 383) Je serai alors plus susceptible et moins indigne des douceurs de votre charmante société, et combien je m'estimerai heureux de pouvoir y être encore pour quelque chose! Si vous daignez mettre le même prix au fruit de mon travail, vous serez toujours la première à qui je m'empresserai d'en faire hommage. Alors plus de contradictions et d'obstacles; vous me trouverez toujours à vos ordres, et personne, je l'espère, ne pourra me blâmer de cette préférence. Je dirai: Voilà celle qui, dans l'âge des illusions et avec tous les avantages brillants qui peuvent les excuser, a connu toute la noblesse et la délicatesse des procédés de la plus pure amitié, et au milieu de tous les hommages s'est souvenue d'un proscrit. Je dirai: Voilà celle dont j'ai vu croître la jeunesse et les grâces au milieu d'une corruption générale qui n'a jamais pu les atteindre; celle dont la raison de seize ans a souvent fait honte à la mienne: et je suis sûr que personne ne sera tenté de me contredire.»
La tristesse des événements, de l'âge et de la religion, cachée sous une expression attendrie, offre dans ces lettres un singulier mélange de pensée et de style. Revenons encore au récit de Benjamin Constant:
«Nous arrivons à l'époque où madame Récamier se vit pour la première fois l'objet d'une passion forte et suivie. Jusqu'alors elle avait reçu des hommages unanimes de la part de tous ceux qui la rencontraient, mais son genre de vie ne présentait nulle part des centres de réunion où l'on fût sûr de la retrouver. Elle ne recevait jamais chez elle et ne s'était point encore formé de société où l'on pût (p. 384) pénétrer tous les jours pour la voir et essayer de lui plaire.
«Dans l'été de 1799, madame Récamier vint habiter le château de Clichy, à un quart de lieue de Paris. Un homme célèbre depuis par divers genres de prétentions, et plus célèbre encore par les avantages qu'il a refusés que par les succès qu'il a obtenus, Lucien Bonaparte, se fit présenter à elle.
«Il n'avait aspiré jusqu'alors qu'à des conquêtes faciles, et n'avait étudié pour les obtenir que les moyens de romans que son peu de connaissance du monde lui représentait comme infaillibles. Il est possible que l'idée de captiver la plus belle femme de son temps l'ait séduit d'abord. Jeune, chef d'un parti dans le conseil des Cinq-Cents, frère du premier général du siècle, il fut flatté de réunir dans sa personne les triomphes d'un homme d'État et les succès d'un amant.
«Il imagina de recourir à une fiction pour déclarer son amour à madame Récamier; il supposa une lettre de Roméo à Juliette; et l'envoya comme un ouvrage de lui à celle qui portait le même nom.»
Voici cette lettre de Lucien, connue de Benjamin Constant; au milieu des révolutions qui ont agité le monde réel, il est piquant de voir un Bonaparte s'enfoncer dans le monde des fictions.
(p. 385) LETTRE DE ROMÉO À JULIETTE
par l'auteur de la Tribu indienne[319].
«Venise, 29 juillet.
«Roméo vous écrit, Juliette: si vous refusiez de me lire vous seriez plus cruelle que nos parents, dont les longues querelles viennent enfin de s'apaiser: sans doute ces affreuses querelles ne renaîtront plus. . . . . . Il y a peu de jours, je ne vous connaissais encore que par la renommée. Je vous avais aperçue quelquefois dans les temples et dans les fêtes; je savais que vous étiez la plus belle; mille bouches répétaient vos éloges, et vos attraits m'avaient frappé sans m'éblouir. . . . . . . Pourquoi la paix m'a-t-elle livré à votre empire? la paix! elle est dans nos familles, mais le trouble est dans mon cœur. . . . . . . . .
«Rappelez-vous ce jour où pour la première fois je vous fus présenté. Nous célébrions dans un banquet nombreux la réconciliation de nos pères. Je revenais du sénat où les troubles suscités à la République avaient produit une vive impression. . . Vous arrivâtes; tous alors s'empressaient. Qu'elle est belle! s'écriait-on. . . . . . . . . . .
«La foule remplit dans la soirée les jardins de Bedmar. Les importuns, qui sont partout, s'emparèrent de moi. Cette fois je n'eus avec eux ni patience ni affabilité: ils me tenaient éloigné de vous!... Je (p. 386) voulus me rendre compte du trouble qui s'emparait de moi. Je connus l'amour et je voulus le maîtriser... Je fus entraîné et je quittai avec vous ce lieu de fêtes.
«Je vous ai revue depuis; l'amour a semblé me sourire. Un jour, assise au bord de l'eau, immobile et rêveuse, vous effeuilliez une rose; seul avec vous, j'ai parlé... j'ai entendu un soupir... vaine illusion! Revenu de mon erreur, j'ai vu l'indifférence au front tranquille assise entre nous deux... La passion qui me maîtrise s'exprimait dans mes discours, et les vôtres portaient l'aimable et cruelle empreinte de l'enfance et de la plaisanterie.
«Chaque jour je voudrais vous voir, comme si le trait n'était pas assez fixé dans mon cœur. Les moments où je vous vois seule sont bien rares, et ces jeunes Vénitiens qui vous entourent et vous parlent fadeur et galanterie me sont insupportables. Peut-on parler à Juliette comme aux autres femmes!
«J'ai voulu vous écrire; vous me connaîtrez, vous ne serez plus incrédule; mon âme est inquiète; elle a soif de sentiment. Si l'amour n'a pas ému le vôtre; si Roméo n'est à vos yeux qu'un homme ordinaire, oh! je vous en conjure par les liens que vous m'avez imposés, soyez avec moi sévère par bonté; ne me souriez plus, ne me parlez plus, repoussez-moi loin de vous. Dites-moi de m'éloigner, et si je puis exécuter cet ordre rigoureux, souvenez-vous au moins que Roméo vous aimera toujours; que personne n'a jamais régné sur lui comme Juliette, et qu'il ne peut plus renoncer à vivre pour elle au moins par le souvenir.»
(p. 387) Pour un homme de sang-froid, tout cela est un peu moquable: les Bonaparte vivaient de théâtres, de romans et de vers; la vie de Napoléon lui-même est-elle autre chose qu'un poème?
Benjamin Constant continue en commentant cette lettre: «Le style de cette lettre est visiblement imité de tous les romans qui ont peint les passions, depuis Werther jusqu'à la Nouvelle Héloïse. Madame Récamier reconnut facilement, à plusieurs circonstances de détail, qu'elle-même était l'objet de la déclaration qu'on lui présentait comme une simple lecture. Elle n'était pas assez accoutumée au langage direct de l'amour pour être avertie par l'expérience que tout dans les expressions n'était peut-être pas sincère; mais un instinct juste et sûr l'en avertissait; elle répondit avec simplicité, avec gaieté même, et montra bien plus d'indifférence que d'inquiétude et de crainte. Il n'en fallut pas davantage pour que Lucien éprouvât réellement la passion qu'il avait d'abord un peu exagérée.
«Les lettres de Lucien deviennent plus vraies, plus éloquentes, à mesure qu'il devient plus passionné; on y voyait bien toujours l'ambition des ornements, le besoin de se mettre en attitude; il ne peut s'endormir sans se jeter dans les bras de Morphée. Au milieu de son désespoir, il se décrit livré aux grandes occupations qui l'entourent; il s'étonne de ce qu'un homme comme lui verse des larmes; mais dans tout cet alliage de déclamation et de phrases il y a pourtant de l'éloquence, de la sensibilité et de la douleur. Enfin, dans une lettre pleine de passion où il écrit à madame Récamier: «Je ne puis vous haïr, (p. 388) mais je puis me tuer,» il dit tout à coup en réflexion générale: «J'oublie que l'amour ne s'arrache pas, il s'obtient.» Puis il ajoute: «Après la réception de votre billet, j'en ai reçu plusieurs diplomatiques; j'ai appris une nouvelle que le bruit public vous aura sans doute apprise. Les félicitations m'entourent, m'étourdissent... on me parle de ce qui n'est pas vous!» Puis, encore une exclamation: «Que la nature est faible, comparée à l'amour!»
«Cette nouvelle qui trouvait Lucien insensible était pourtant une nouvelle immense: le débarquement de Bonaparte à son retour d'Égypte.
«Un destin nouveau venait de débarquer avec ses promesses et ses menaces; le dix-huit brumaire ne devait pas se faire attendre plus de trois semaines.
«À peine échappé au danger de cette journée, qui tiendra toujours une si grande place dans l'histoire, Lucien écrivait à madame Récamier: «Votre image m'est apparue!... Vous auriez eu ma dernière pensée.»
SUITE DU RÉCIT DE BENJAMIN CONSTANT.
«Madame Récamier contracta, avec une femme bien autrement illustre que M. de Laharpe n'était célèbre, une amitié qui devint chaque jour plus intime et qui dure encore.
«M. Necker, ayant été rayé de la liste des émigrés, chargea madame de Staël, sa fille, de vendre une maison qu'il avait à Paris. Madame Récamier (p. 389) l'acheta, et ce fut une occasion pour elle de voir madame de Staël[320].
«La vue de cette femme célèbre la remplit d'abord d'une excessive timidité. La figure de madame de Staël a été fort discutée. Mais un superbe regard, un sourire doux, une expression habituelle de bienveillance, l'absence de toute affectation minutieuse et de toute réserve gênante; des mots flatteurs, des louanges un peu directes, mais qui semblent échapper à l'enthousiasme, une variété inépuisable de conversation, étonnent, attirent et lui concilient presque tous ceux qui l'approchent. Je ne connais aucune femme et même aucun homme qui soit plus convaincu de son immense supériorité sur tout le monde, et qui fasse moins peser cette conviction sur les autres.
«Rien n'était plus attachant que les entretiens de madame de Staël et de madame Récamier. La rapidité de l'une à exprimer mille pensées neuves, la rapidité de la seconde à les saisir et à les juger; cet esprit mâle et fort qui dévoilait tout, et cet esprit délicat et fin qui comprenait tout; ces révélations (p. 390) d'un génie exercé communiquées à une jeune intelligence digne de les recevoir: tout cela formait une réunion qu'il est impossible de peindre sans avoir eu le bonheur d'en être témoin soi-même.
«L'amitié de madame Récamier pour madame de Staël se fortifia d'un sentiment qu'elles éprouvaient toutes deux, l'amour filial. Madame Récamier était tendrement attachée à sa mère, femme d'un rare mérite, dont la santé donnait déjà des craintes, et que sa fille ne cesse de regretter depuis qu'elle l'a perdue. Madame de Staël avait voué à son père un culte que la mort n'a fait que rendre plus exalté. Toujours entraînante dans sa manière de s'exprimer, elle le devient encore surtout quand elle parle de lui. Sa voix émue, ses yeux prêts à se mouiller de larmes, la sincérité de son enthousiasme, touchaient l'âme de ceux mêmes qui ne partageaient pas son opinion sur cet homme célèbre. On a fréquemment jeté du ridicule sur les éloges qu'elle lui a donnés dans ses écrits; mais quand on l'a entendue sur ce sujet, il est impossible d'en faire un objet de moquerie, parce que rien de ce qui est vrai n'est ridicule.»
Les lettres de Corinne à son amie madame Récamier commencèrent à l'époque rappelée ici par Benjamin Constant: elles ont un charme qui tient presque de l'amour; j'en ferai connaître quelques-unes.
«Coppet, 9 septembre.
«Vous souvenez-vous, belle Juliette, d'une personne que vous avez comblée de marques d'intérêt cet hiver, et qui se flatte de vous engager à redoubler (p. 391) l'hiver prochain? Comment gouvernez-vous l'empire de la beauté? On vous l'accorde avec plaisir, cet empire, parce que vous êtes éminemment bonne, et qu'il semble naturel qu'une âme si douce ait un charmant visage pour l'exprimer. De tous vos admirateurs, vous savez que je préfère Adrien de Montmorency[321]. J'ai reçu de ses lettres, remarquables par l'esprit et la grâce, et je crois à la solidité de ses affections, malgré le charme de ses manières[322]. Au reste, ce mot de solidité convient à moi, qui ne prétends qu'à un rôle bien secondaire dans son cœur. Mais vous, qui êtes l'héroïne de tous les sentiments, vous êtes exposée aux grands événements dont on fait les tragédies et les romans. Le mien[323] s'avance au pied des Alpes. J'espère que vous le lirez avec intérêt. Je me plais à cette occupation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Au milieu de tous ces succès, ce que vous êtes et ce que vous resterez, c'est un ange de pureté et de beauté, et vous aurez le culte des dévots comme celui des mondains. . . . . . Avez-vous revu l'auteur d'Atala? Êtes-vous toujours à Clichy? Enfin je vous demande des détails sur vous. J'aime à savoir ce que vous faites, à me représenter les lieux que vous habitez. Tout n'est-il pas tableau (p. 392) dans les souvenirs que l'on garde de vous? Je joins, à cet enthousiasme si naturel pour vos rares avantages, beaucoup d'attrait pour votre société. Acceptez, je vous prie, avec bienveillance, tout ce que je vous offre, et promettez-moi que nous nous verrons souvent l'hiver prochain.»
«Coppet, 30 avril.
«Savez-vous que mes amis, belle Juliette, m'ont un peu flattée de l'idée que vous viendriez ici? Ne pourriez-vous pas me donner ce grand plaisir? Le bonheur ne m'a pas gâtée depuis quelque temps, et ce serait un retour de fortune que votre arrivée, qui me donnerait de l'espoir pour tout ce que je désire. Adrien et Mathieu disent qu'ils viendront. Si vous veniez avec eux, un mois de séjour ici suffirait pour vous montrer notre éclatante nature. Mon père dit que vous devriez choisir Coppet pour domicile, et que de là nous ferions nos courses. Mon père est très vif dans le désir de vous voir. Vous savez ce qu'on a dit d'Homère:
Par la voix des vieillards tu louas la beauté.
«Et indépendamment de cette beauté vous êtes charmante.»
Pendant la courte paix d'Amiens, madame Récamier fit avec sa mère un voyage à Londres. Elle eut des lettres de recommandation du vieux duc de Guignes, ambassadeur en Angleterre trente ans auparavant. Il avait conservé des correspondances avec les femmes les plus brillantes de son temps: la duchesse (p. 393) de Devonshire[324], lady Melbourne, la marquise de Salisbury, la margrave d'Anspach[325], dont il avait été amoureux. Son ambassade était encore célèbre, son souvenir tout vivant chez ces respectables dames.
Telle est la puissance de la nouveauté en Angleterre, que le lendemain les gazettes furent remplies de l'arrivée de la beauté étrangère. Madame Récamier reçut les visites de toutes les personnes à qui elle avait envoyé des lettres. Parmi ces personnes, la plus remarquable était la duchesse de Devonshire, âgée de quarante-cinq à cinquante ans. Elle était encore à la mode et belle, quoique privée d'un œil qu'elle couvrait d'une boucle de ses cheveux. La première fois que madame Récamier parut en public, ce fut avec elle. La duchesse la conduisit à l'opéra dans sa loge, où se trouvaient le prince de Galles, le duc d'Orléans et ses frères, le duc de Montpensier et le comte de Beaujolais: les deux premiers devaient devenir rois; l'un touchait au trône, l'autre en était encore séparé par un abîme.
(p. 394) Les lorgnettes et les regards se tournèrent vers la loge de la duchesse. Le prince de Galles dit à madame Récamier que, si elle ne voulait être étouffée, il fallait sortir avant la fin du spectacle. À peine fut-elle debout, que les portes des loges s'ouvrirent précipitamment; elle n'évita rien et fut portée par le flot de la foule jusqu'à sa voiture.
Le lendemain, madame Récamier alla au parc de Kensington, accompagnée du marquis de Douglas, plus tard duc d'Hamilton[326], et qui depuis a reçu Charles X à Holy-Rood, et de sa sœur la duchesse de Somerset. La foule se précipitait sur les pas de l'étrangère. Cette effet se renouvela toutes les fois qu'elle se montra en public; les journaux retentissaient de son nom; son portrait, gravé par Bartolozzi, fut répandu dans toute l'Angleterre. L'auteur d'Antigone, M. Ballanche, ajoute que des vaisseaux le portèrent jusque dans les îles de la Grèce: la beauté retournait aux (p. 395) lieux où l'on avait inventé son image. On a de madame Récamier une esquisse par David, un portrait en pied par Gérard, un buste par Canova. Le portrait est le chef-d'œuvre de Gérard; mais il ne me plaît pas, parce que j'y reconnais les traits sans y reconnaître l'expression du modèle.
La veille du départ de madame Récamier, le prince de Galles et la duchesse de Devonshire lui demandèrent de les recevoir et d'amener chez elle quelques personnes de leur société. On fit de la musique. Elle joua avec le chevalier Marin, premier harpiste de cette époque, des variations sur un thème de Mozart. Cette soirée fut citée dans les feuilles publiques comme un concert que la belle étrangère avait donné en partant au prince de Galles.
Le lendemain elle s'embarqua pour La Haye, et mit trois jours à faire une traversée de seize heures. Elle m'a raconté que, pendant ces jours mêlés de tempêtes, elle lut de suite le Génie du christianisme; je lui fus révélé, selon sa bienveillante expression: je reconnais là cette bonté que les vents et la mer ont toujours eue pour moi.
Près de La Haye, elle visita le château du prince d'Orange[327]. Ce prince, lui ayant fait promettre d'aller voir cette demeure, lui écrivit plusieurs lettres dans lesquelles il parle de ses revers et de l'espoir de les vaincre: Guillaume Ier est en effet devenu monarque; en ce temps-là on intriguait pour être roi comme aujourd'hui pour être député; et ces candidats à la (p. 396) souveraineté se pressaient aux pieds de madame Récamier comme si elle disposait des couronnes.
Ce billet de Bernadotte, qui règne aujourd'hui sur la Suède, termina le voyage de madame Récamier en Angleterre.
«. . . . . . . . . . . . . . . . . Les journaux anglais, en calmant mes inquiétudes sur votre santé, m'ont appris les dangers auxquels vous avez été exposée. J'ai blâmé d'abord le peuple de Londres dans son grand empressement; mais, je vous l'avoue, il a été bientôt excusé, car je suis partie intéressée lorsqu'il faut justifier les personnes qui se rendent indiscrètes pour admirer les charmes de votre céleste figure.
«Au milieu de l'éclat qui vous environne et que vous méritez à tant de titres, daignez vous souvenir quelquefois que l'être qui vous est le plus dévoué dans la nature est
«Bernadotte.»
Madame de Staël, menacée de l'exil, tenta de s'établir à Maffliers, campagne à huit lieues de Paris[328]. Elle accepta la proposition que lui fit madame Récamier, revenue d'Angleterre, de passer quelques jours à Saint-Brice avec elle; ensuite elle retourna dans son premier asile. Elle rend compte de ce qui lui arriva alors, dans les Dix années d'exil.
«J'étais à table, dit-elle, avec trois de mes amis, (p. 397) dans une salle où l'on voyait le grand chemin et la porte d'entrée. C'était à la fin de septembre[329], à quatre heures: un homme en habit gris, à cheval, s'arrête et sonne; je fus certaine de mon sort; il me fit demander; je le reçus dans le jardin. En avançant vers lui, le parfum des fleurs et la beauté du soleil me frappèrent. Les sensations qui nous viennent par les combinaisons de la société sont si différentes de celle de la nature! Cet homme me dit qu'il était le commandant de la gendarmerie de Versailles... Il me montra une lettre, signée de Bonaparte, qui portait l'ordre de m'éloigner à quarante lieues de Paris, et enjoignait de me faire partir dans les vingt-quatre heures, en me traitant cependant avec tous les égards dus à une femme d'un nom connu... Je répondis à l'officier de gendarmerie que partir dans les vingt-quatre heures convenait à des conscrits, mais non pas à une femme et à des enfants. En conséquence je lui proposai de m'accompagner à Paris où j'avais besoin de trois jours pour faire les arrangements nécessaires à mon voyage. Je montai donc dans ma voiture avec mes enfants et cet officier qu'on avait choisi comme le plus littéraire des gendarmes. En effet, il me fit des compliments sur mes écrits. «Vous voyez, lui dis-je, monsieur, où cela mène d'être femme d'esprit. Déconseillez-le, je vous prie, aux personnes de votre famille, si vous en avez l'occasion.» J'essayais de me monter par la fierté, mais je sentais la griffe dans mon cœur.
«Je m'arrêtai quelques instants chez madame Récamier. (p. 398) Je trouvai le général Junot, qui, par dévouement pour elle, promit d'aller le lendemain parler au premier Consul. Il le fît en effet avec la plus grande chaleur. . . . . . . . . . . .
«La veille du jour qui m'était accordé, Joseph Bonaparte fit encore une tentative. . . . . .
«Je fus obligée d'attendre la réponse dans une auberge à deux lieues de Paris, n'osant pas rentrer chez moi dans la ville. Un jour se passa sans que cette réponse me parvînt. Ne voulant pas attirer l'attention sur moi en restant plus longtemps dans l'auberge où j'étais, je fis le tour des murs de Paris pour en aller chercher une autre, de même à deux lieues de Paris, mais sur une route différente. Cette vie errante, à quatre pas de mes amis et de ma demeure, me causait une douleur que je ne puis me rappeler sans frissonner.[330]»
Madame de Staël, au lieu de retourner à Coppet, partit pour son premier voyage d'Allemagne. À cette époque elle m'écrivit, sur la mort de madame de Beaumont, la lettre que j'ai citée dans mon premier voyage de Rome.
Madame Récamier réunissait chez elle, à Paris, ce qu'il y avait de plus distingué dans les partis opprimés et dans les opinions qui n'avaient pas tout cédé à la victoire. On y voyait les illustrations de l'ancienne monarchie et du nouvel empire: les Montmorency, les Sabran, les Lamoignon, les généraux Masséna, Moreau et Bernadotte; celui-là destiné à l'exil, celui-ci au trône. Les étrangers illustres s'y rendaient aussi; le prince d'Orange, le prince de Bavière, le frère de (p. 399) la reine de Prusse l'environnaient, comme à Londres le prince de Galles était fier de porter son châle. L'attrait était si irrésistible qu'Eugène de Beauharnais et les ministres mêmes de l'empereur allaient à ces réunions. Bonaparte ne pouvait souffrir le succès, même celui d'une femme. Il disait: «Depuis quand le conseil se tient-il chez madame Récamier?»
Je reviens maintenant au récit de Benjamin Constant: «Depuis longtemps Bonaparte, qui s'était emparé du gouvernement, marchait ouvertement à la tyrannie. Les partis les plus opposés s'aigrissaient contre lui, et tandis que la masse des citoyens se laissait énerver encore par le repos qu'on lui promettait, les républicains et les royalistes désiraient un renversement. M. de Montmorency appartenait à ces derniers par sa naissance, ses rapports et ses opinions. Madame Récamier ne tenait à la politique que par son intérêt généreux pour les vaincus de tous les partis. L'indépendance de son caractère l'éloignait de la cour de Napoléon dont elle avait refusé de faire partie. M. de Montmorency imagina de lui confier ses espérances, lui peignit le rétablissement des Bourbons sous des couleurs propres à exciter son enthousiasme, et la chargea de rapprocher deux hommes importants alors en France, Bernadotte et Moreau, pour voir s'ils pouvaient se réunir contre Bonaparte. Elle connaissait beaucoup Bernadotte, qui depuis est devenu prince royal de Suède. Quelque chose de chevaleresque dans la figure, de noble dans les manières, de très fin dans l'esprit, de déclamatoire dans la conversation, en (p. 400) font un homme remarquable. Courageux dans les combats, hardi dans le propos, mais timide dans les actions qui ne sont pas militaires, irrésolu dans tous ses projets: une chose qui le rend très séduisant à la première vue, mais qui en même temps met un obstacle à toute combinaison de plan avec lui, c'est une habitude de haranguer, reste de son éducation révolutionnaire qui ne le quitte pas. Il a parfois des mouvements d'une véritable éloquence; il le sait, il aime ce genre de succès, et quand il est entré dans le développement de quelque idée générale, tenant à ce qu'il a entendu dans les clubs ou à la tribune, il perd de vue tout ce qui l'occupe et n'est plus qu'un orateur passionné. Tel il a paru en France dans les premières années du règne de Bonaparte, qu'il a toujours haï et auquel il a toujours été suspect, et tel il s'est encore montré dans ces derniers temps, au milieu du bouleversement de l'Europe dont on lui doit toutefois l'affranchissement, parce qu'il a rassuré les étrangers en leur montrant un Français prêt à marcher contre le tyran de la France et sachant ne dire que ce qui pouvait influer sur sa nation.
«Tout ce qui offre à une femme le moyen d'exercer sa puissance lui est toujours agréable. Il y avait d'ailleurs, dans l'idée de soulever contre le despotisme de Bonaparte des hommes importants par leurs dignités et leur gloire, quelque chose de généreux et de noble qui devait tenter madame Récamier. Elle se prêta donc au désir de M. de Montmorency. Elle réunit souvent Bernadotte et Moreau chez elle. Moreau hésitait, Bernadotte déclamait. (p. 401) Madame Récamier prenait les discours indécis de Moreau pour un commencement de résolution, et les harangues de Bernadotte comme un signal de renversement de la tyrannie. Les deux généraux, de leur côté, étaient enchantés de voir leur mécontentement caressé par tant de beauté, d'esprit et de grâce. Il y avait en effet quelque chose de romanesque et de poétique dans cette femme si jeune, si séduisante, leur parlant de la liberté de leur patrie. Bernadotte répétait sans cesse à madame Récamier qu'elle était faite pour électriser le monde et pour créer des séides.»
En remarquant la finesse de cette peinture de Benjamin Constant, il faut dire que madame Récamier ne serait jamais entrée dans ces intérêts politiques sans l'irritation qu'elle ressentait de l'exil de madame de Staël. Le futur roi de Suède avait la liste des généraux qui tenaient encore au parti de l'indépendance, mais le nom de Moreau n'y était pas; c'était le seul qu'on pût opposer à celui de Napoléon: seulement Bernadotte ignorait quel était ce Bonaparte dont il attaquait la puissance.
Madame Moreau donna un bal; toute l'Europe s'y trouva, excepté la France; elle n'y était représentée que par l'opposition républicaine. Pendant cette fête, le général Bernadotte conduisit madame Récamier dans un petit salon où le bruit de la musique seul les suivit et leur rappelait où ils étaient. Moreau passa dans ce salon; Bernadotte lui dit après de longues explications: «Avec un nom populaire, vous êtes le seul parmi nous qui puisse se présenter appuyé de tout un peuple; voyez ce que vous pouvez, ce que (p. 402) nous pouvons guidés par vous.» Moreau répéta ce qu'il avait dit souvent: «Qu'il sentait le danger dont la liberté était menacée, qu'il fallait surveiller Bonaparte, mais qu'il craignait la guerre civile.»
Cette conversation se prolongeait et s'animait; Bernadotte s'emporta et dit au général Moreau: «Vous n'osez pas prendre la cause de la liberté; eh bien, Bonaparte se jouera de la liberté et de vous. Elle périra malgré nos efforts, et vous, vous serez enveloppé dans sa ruine sans avoir combattu.» Paroles prophétiques!
La mère de madame Récamier était liée avec madame Hulot, mère de madame Moreau, et madame Récamier avait contracté avec cette dernière une de ces liaisons d'enfance qu'on est heureux de continuer dans le monde.
Pendant le procès du général Moreau, madame Récamier passait sa vie chez madame Moreau. Celle-ci dit à son amie que son mari se plaignait de ne l'avoir pas encore vue parmi le public qui remplissait la salle et le tribunal. Madame Récamier s'arrangea pour assister le lendemain de cette conversation à la séance. Un des juges, M. Brillat-Savarin[331], se chargea de la (p. 403) faire entrer par une porte particulière qui s'ouvrait sur l'amphithéâtre. En entrant elle releva son voile, parcourut d'un coup d'œil les rangs des accusés, afin d'y trouver Moreau. Il la reconnut, se leva et la salua. Tous les regards se tournèrent vers elle; elle se hâta de descendre les degrés de l'amphithéâtre pour arriver à la place qui lui était destinée. Les accusés étaient au nombre de quarante-sept; ils remplissaient les gradins placés en face des juges du tribunal. Chaque accusé était placé entre deux gendarmes: ces soldats montraient au général Moreau de la déférence et du respect.
On remarquait MM. de Polignac et de Rivière, mais surtout Georges Cadoudal. Pichegru, dont le nom restera lié à celui de Moreau, manquait pourtant à côté de lui, ou plutôt on y croyait voir son ombre, car on savait qu'il manquait aussi dans la prison.
Il n'était plus question de républicains, c'était la fidélité royaliste qui luttait contre le pouvoir nouveau; toutefois, cette cause de la légitimité et de ses partisans nobles avait pour chef un homme du peuple, Georges Cadoudal. On le voyait là, avec la pensée que cette tête si pieuse, si intrépide, allait tomber sur l'échafaud; que lui seul peut-être, Cadoudal, ne serait pas sauvé, car il ne ferait rien pour l'être. Il ne défendait (p. 404) que ses amis; quant à ce qui le regardait particulièrement, il disait tout. Bonaparte ne fut pas aussi généreux qu'on le supposait: onze personnes dévouées à Georges périrent avec lui[332].
Moreau ne parla point. La séance terminée, le juge qui avait amené madame Récamier vint la reprendre. Elle traversa le parquet du côté opposé à celui par lequel elle était entrée, et longea le banc des accusés. Moreau descendit suivi de ses deux gendarmes; il n'était séparé d'elle que par une balustrade. Il lui dit quelques paroles que dans son saisissement elle n'entendit point: elle voulut lui répondre, sa voix se brisa[333].
(p. 405) Aujourd'hui que les temps sont changés, et que le nom de Bonaparte semble seul les remplir, on n'imagine pas à combien peu encore paraissait tenir sa puissance. La nuit qui précéda la sentence, et pendant laquelle le tribunal siégea, tout Paris fut sur pied. Des flots de peuple se portaient au Palais de Justice. Georges ne voulut point de grâce; il répondit à ceux qui voulaient la demander: «Me promettez-vous une plus belle occasion de mourir?»
Moreau, condamné à la déportation, se mit en route pour Cadix, d'où il devait passer en Amérique. Madame Moreau alla le rejoindre. Madame Récamier était auprès d'elle au moment de son départ. Elle la vit embrasser son fils dans son berceau, et la vit revenir sur ses pas pour l'embrasser encore: elle la conduisit à sa voiture et reçut son dernier adieu.
Le général Moreau écrivit de Cadix cette lettre à sa généreuse amie:
«Chiclana (près Cadix), le 12 octobre 1804.
Madame,
«Vous apprendrez sans doute avec quelque plaisir des nouvelles de deux fugitifs auxquels vous avez témoigné tant d'intérêt. Après avoir essuyé des fatigues de tout genre, sur terre et sur mer, nous espérions nous reposer à Cadix, quand la fièvre jaune, qu'on peut en quelque sorte comparer aux maux (p. 406) que nous venions d'éprouver, est venue nous assiéger dans cette ville.
«Quoique les couches de mon épouse nous aient forcés d'y rester plus d'un mois pendant la maladie, nous avons été assez heureux pour nous préserver de la contagion; un seul de nos gens en a été atteint.
«Enfin, nous sommes à Chiclana, très joli village à quelques lieues de Cadix, jouissant d'une bonne santé, et mon épouse en pleine convalescence après m'avoir donné une fille très bien portante.
«Persuadée que vous prendrez autant d'intérêt à cet événement qu'à tout ce qui nous est arrivé, elle me charge de vous en faire part et de la rappeler à votre amitié.
«Je ne vous parle pas du genre de vie que nous menons, il est excessivement ennuyeux et monotone; mais au moins nous respirons en liberté, quoique dans le pays de l'inquisition.
«Je vous prie, madame, de recevoir l'assurance de mon respectueux attachement, et de me croire pour toujours
«Votre très humble et très obéissant serviteur,
«V. Moreau.»
Cette lettre est datée de Chiclana, lieu qui sembla promettre avec de la gloire un règne assuré à M. le duc d'Angoulême: et pourtant il n'a fait que paraître sur ce bord aussi fatalement que Moreau, qu'on a cru dévoué aux Bourbons. Moreau au fond de l'âme était dévoué à la liberté; lorsqu'il eut le malheur de se joindre à la coalition, il s'agissait uniquement à ses yeux de combattre le despotisme de Bonaparte. (p. 407) Louis XVIII disait à M. de Montmorency, qui déplorait la mort de Moreau comme une grande perte pour la couronne: «Pas si grande: Moreau était républicain.» Ce général ne repassa en Europe que pour trouver le boulet sur lequel son nom avait été gravé par le doigt de Dieu.
Moreau me rappelle un autre illustre capitaine, Masséna. Celui-ci allait à l'armée d'Italie; il demanda à madame Récamier un ruban blanc de sa parure. Un jour elle reçut ce billet de la main de Masséna:
«Le charmant ruban donné par madame Récamier a été porté par le général Masséna aux batailles et au blocus de Gênes: il n'a jamais quitté le général et lui a constamment favorisé la victoire.»
Les antiques mœurs percent à travers les mœurs nouvelles dont elles font la base. La galanterie du chevalier noble se retrouvait dans le soldat plébéien; le souvenir des tournois et des croisades était caché dans ces faits d'armes par qui la France moderne a couronné ses vieilles victoires. Cisher, compagnon de Charlemagne, ne se parait point aux combats des couleurs de sa dame: «Il portait, dit le moine de Saint-Gall, sept, huit et même neuf ennemis enfilés à sa lance comme des grenouillettes.» Cisher précédait, et Masséna suivait la chevalerie.
Madame de Staël apprit à Berlin la maladie de son père; elle se hâta de revenir, mais M. Necker était mort[334] avant son arrivée en Suisse.
En ce temps-là arriva la ruine de M. Récamier[335]; (p. 408) madame de Staël fut bientôt instruite de ce malheureux événement. Elle écrivit sur-le-champ à madame Récamier, son amie:
«Genève, 17 novembre[336].
«Ah! ma chère Juliette, quelle douleur j'ai éprouvée par l'affreuse nouvelle que je reçois! que je maudis l'exil qui ne me permet pas d'être auprès de vous, de vous serrer contre mon cœur! Vous avez perdu tout ce qui tient à la facilité, à l'agrément de la vie; mais s'il était possible d'être plus aimée, plus intéressante que vous ne l'étiez, c'est ce qui vous serait arrivé. Je vais écrire à M. Récamier, que je plains et que je respecte. Mais, dites-moi, serait-ce un rêve que de vous voir ici cet hiver? Si vous vouliez, trois mois passés ici, dans un cercle étroit où vous seriez passionnément soignée: mais à Paris aussi vous inspirez ce sentiment. Enfin, au moins à Lyon, ou jusqu'à mes quarante lieues, j'irai pour vous voir, pour vous embrasser, pour vous dire que je me suis senti pour vous plus de tendresse (p. 409) que pour aucune femme que j'aie jamais connue. Je ne sais rien vous dire comme consolation, si ce n'est que vous serez aimée et considérée plus que jamais et que les admirables traits de votre générosité et de votre bienfaisance seront connus malgré vous par ce malheur, comme ils ne l'auraient jamais été sans lui. Certainement, en comparant votre situation à ce qu'elle était, vous avez perdu; mais s'il m'était possible d'envier ce que j'aime, je donnerais bien tout ce que je suis pour être vous. Beauté sans égale en Europe, réputation sans tache, caractère fier et généreux, quelle fortune de bonheur encore dans cette triste vie où l'on marche si dépouillé! Chère Juliette, que notre amitié se resserre; que ce ne soit plus simplement des services généreux qui sont tous venus de vous, mais une correspondance suivie, un besoin réciproque de se confier ses pensées, une vie ensemble. Chère Juliette, c'est vous qui me ferez revenir à Paris, car vous serez toujours une personne toute-puissante, et nous nous verrons tous les jours; et comme vous êtes plus jeune que moi, vous me fermerez les yeux, et mes enfants seront vos amis. Ma fille a pleuré ce matin de mes larmes et des vôtres. Chère Juliette, ce luxe qui vous entourait, c'est nous qui en avons joui; votre fortune a été la nôtre, et je me sens ruinée parce que vous n'êtes plus riche. Croyez-moi, il reste du bonheur quand on s'est fait aimer ainsi.
«Benjamin veut vous écrire; il est bien ému. Mathieu de Montmorency m'écrit sur vous une lettre bien touchante. Chère amie, que votre cœur soit (p. 410) calme au milieu de tant de douleurs. Hélas! ni la mort ni l'indifférence de vos amis ne vous menacent, et voilà les blessures éternelles. Adieu, cher ange, adieu! J'embrasse avec respect votre visage charmant...»
Un intérêt nouveau se répandit sur madame Récamier: elle quitta la société sans se plaindre, et sembla faite pour la solitude comme pour le monde. Ses amis lui restèrent, «et cette fois, a dit M. Ballanche, la fortune se retira seule».
Madame de Staël attira son amie à Coppet[337]. Le prince Auguste de Prusse, fait prisonnier à la bataille d'Eylau[338], se rendant en Italie, passa par Genève: il devint amoureux de madame Récamier. La vie intime et particulière appartenant à chaque homme continuait son cours sous la vie générale, l'ensanglantement des batailles et la transformation des empires. Le riche, à son réveil, aperçoit ses lambris dorés, le pauvre ses solives enfumées; pour les éclairer il n'y a qu'un même rayon de soleil.
Le prince Auguste, croyant que madame Récamier pourrait consentir au divorce, lui proposa de l'épouser[339]. Il reste un monument de cette passion dans le (p. 411) tableau de Corinne que le prince obtint de Gérard; il en fit présent à madame Récamier comme un immortel souvenir du sentiment qu'elle lui avait inspiré, (p. 412) et de l'intime amitié qui unissait Corinne et Juliette[340].
L'été se passa en fêtes: le monde était bouleversé; mais il arrive que le retentissement des catastrophes publiques, en se mêlant aux joies de la jeunesse, en redouble le charme; on se livre d'autant plus vivement aux plaisirs qu'on se sent près de les perdre.
Madame de Genlis a fait un roman sur cet attachement du prince Auguste. Je la trouvai un jour dans l'ardeur de la composition. Elle demeurait à l'Arsenal, au milieu de livres poudreux, dans un appartement obscur. Elle n'attendait personne; elle était vêtue d'une robe noire; ses cheveux blancs offusquaient son visage; elle tenait une harpe entre ses genoux, et sa tête était abattue sur sa poitrine. Appendue aux cordes de l'instrument, elle promenait ses deux mains pâles et amaigries sur l'autre côté du réseau sonore, dont elle tirait des sons affaiblis, semblables aux voix lointaines et indéfinissables de la mort. Que chantait l'antique sybille[341]? elle chantait madame Récamier. (p. 413) Elle l'avait d'abord haïe, mais dans la suite elle avait été vaincue par la beauté et le malheur. Madame de Genlis venait d'écrire cette page sur madame Récamier, en lui donnant le nom d'Athénaïs:
«Le prince entra dans le salon, conduit par madame de Staël. Tout à coup la porte s'entr'ouvre, Athénaïs s'avance. À l'élégance de sa taille, à l'éclat éblouissant de sa figure, le prince ne peut la méconnaître, mais il s'était fait d'elle une idée toute différente: il s'était représenté cette femme si célèbre par sa beauté, fière de ses succès, avec un maintien assuré, et cette espèce de confiance que ne donne que trop souvent ce genre de célébrité; et il voyait une jeune personne timide s'avancer avec embarras et rougir en paraissant. Le plus doux sentiment se mêla à sa surprise.
«Après dîner on ne sortit point, à cause de la chaleur excessive; on descendit dans la galerie pour faire de la musique jusqu'à l'heure de la promenade. Après quelques accords brillants et des sons harmoniques d'une douceur enchanteresse, Athénaïs chanta en s'accompagnant sur la harpe. Le prince (p. 414) l'écouta avec ravissement, et, lorsqu'elle eut fini, il la regarda avec un trouble inexprimable en s'écriant: Et des talents!»
Madame de Staël, dans la force de la vie, aimait madame Récamier; madame de Genlis, dans sa décrépitude, retrouvait pour elle les accents de sa jeunesse; l'auteur de Mademoiselle de Clermont[342] plaçait la scène de son roman à Coppet[343], chez l'auteur de Corinne, rivale qu'elle détestait; c'était une merveille. Une autre merveille est de me voir écrire ces détails. Je parcours des lettres qui me rappellent des temps où je vivais solitaire et inconnu. Il fut du bonheur sans moi, aux rivages de Coppet, que je n'ai pas vus depuis sans quelque mouvement d'envie. Les choses qui me sont échappées sur la terre, qui m'ont fui, que je regrette, me tueraient si je ne touchais à ma tombe; mais, si près de l'oubli éternel, vérités et songes sont également vains; au bout de la vie tout est jour perdu.
Madame de Staël partit une seconde fois pour l'Allemagne[344]. Ici recommence une série de lettres à (p. 415) madame Récamier, peut-être encore plus charmantes que les premières.
Il n'y a rien dans les ouvrages imprimés de madame de Staël qui approche de ce naturel, de cette éloquence, où l'imagination prête son expression aux sentiments. La vertu de l'amitié de madame Récamier devait être grande, puisqu'elle sut faire produire à une femme de génie ce qu'il y avait de caché et de non révélé encore dans son talent. On devine au surplus dans l'accent triste de madame de Staël un déplaisir secret, dont la beauté devait être naturellement la confidente, elle qui ne pouvait jamais recevoir de pareilles blessures.
Madame de Staël étant rentrée en France vint, au printemps de 1810[345], habiter le château de Chaumont (p. 416) sur les bords de la Loire, à quarante lieues de Paris, distance déterminée pour le rayon de son bannissement. Madame Récamier la rejoignit dans cette campagne.
Madame de Staël surveillait alors l'impression de son ouvrage sur l'Allemagne: lorsqu'il fut près de paraître, elle l'envoya à Bonaparte avec cette lettre:
«Sire,
«Je prends la liberté de présenter à Votre Majesté mon ouvrage sur l'Allemagne. Si elle daigne le lire, il me semble qu'elle y trouvera la preuve d'un esprit capable de quelques réflexions et que le temps a mûri. Sire, il y a douze ans que je n'ai vu Votre Majesté et que je suis exilée. Douze ans de malheurs modifient tous les caractères, et le destin enseigne la résignation à ceux qui souffrent. Prête à m'embarquer, je supplie Votre Majesté de m'accorder une demi-heure d'entretien. Je crois avoir des choses à lui dire qui pourront l'intéresser, et c'est à ce titre que je la supplie de m'accorder la faveur de (p. 417) lui parler avant mon départ. Je me permettrai seulement une chose dans cette lettre: c'est l'explication des motifs qui me forcent à quitter le continent, si je n'obtiens pas de Votre Majesté la permission de vivre dans une campagne assez près de Paris pour que mes enfants y puissent demeurer. La disgrâce de Votre Majesté jette sur les personnes qui en sont l'objet une telle défaveur en Europe, que je ne puis faire un pas sans en rencontrer les effets. Les uns craignent de se compromettre en me voyant, les autres se croient des Romains en triomphant de cette crainte. Les plus simples rapports de la société deviennent des services qu'une âme fière ne peut supporter. Parmi mes amis, il en est qui se sont associés à mon sort avec une admirable générosité; mais j'ai vu les sentiments les plus intimes se briser contre la nécessité de vivre avec moi dans la solitude, et j'ai passé ma vie depuis huit ans entre la crainte de ne pas obtenir des sacrifices, et la douleur d'en être l'objet. Il est peut-être ridicule d'entrer ainsi dans le détail de ses impressions avec le souverain du monde; mais ce qui vous a donné le monde, Sire, c'est un souverain génie. Et en fait d'observation sur le cœur humain, Votre Majesté comprend depuis les plus vastes ressorts jusqu'aux plus délicats. Mes fils n'ont point de carrière, ma fille a treize ans: dans peu d'années il faudra l'établir: il y aurait de l'égoïsme à la forcer de vivre dans les insipides séjours où je suis condamnée. Il faudrait donc aussi me séparer d'elle! Cette vie n'est pas tolérable et je n'y sais aucun remède sur le continent. Quelle ville puis-je choisir où la disgrâce de Votre Majesté (p. 418) ne mette pas un obstacle invincible à l'établissement de mes enfants comme à mon repos personnel? Votre Majesté ne sait peut-être pas elle-même la peur que les exilés font à la plupart des autorités de tous les pays, et j'aurais dans ce genre des choses à lui raconter qui dépassent sûrement ce qu'elle aurait ordonné. On a dit à Votre Majesté que je regrettais Paris à cause du Musée et de Talma: c'est une agréable plaisanterie sur l'exil, c'est-à-dire sur le malheur que Cicéron et Bolingbroke ont déclaré le plus insupportable de tous; mais quand j'aimerais les chefs-d'œuvre des arts que la France doit aux conquêtes de Votre Majesté, quand j'aimerais ces belles tragédies, images de l'héroïsme, serait-ce à vous, Sire, à m'en blâmer? Le bonheur de chaque individu ne se compose-t-il pas de la nature de ses facultés? et si le ciel m'a donné du talent, n'ai-je pas l'imagination qui rend les jouissances des arts et de l'esprit nécessaires? Tant de gens demandent à Votre Majesté des avantages réels de toute espèce! pourquoi rougirais-je de lui demander l'amitié, la poésie, la musique, les tableaux, toute cette existence idéale dont je puis jouir sans m'écarter de la soumission que je dois au monarque de la France?»
Cette lettre inconnue méritait d'être conservée[346]. Madame de Staël n'était pas, ainsi qu'on l'a prétendu, (p. 419) une ennemie aveugle et implacable. Elle ne fut pas plus écoutée que moi, lorsque je me vis obligé de m'adresser aussi à Bonaparte pour lui demander la vie de mon cousin Armand. Alexandre et César auraient été touchés de cette lettre d'un ton si haut, écrite par une femme si renommée; mais la confiance du mérite qui se juge et s'égalise à la domination suprême, cette sorte de familiarité de l'intelligence qui se place au niveau du maître de l'Europe pour traiter avec lui de couronne à couronne, ne parurent à Bonaparte que l'arrogance d'un amour-propre déréglé. Il se croyait bravé par tout ce qui avait quelque grandeur indépendante; la bassesse lui semblait fidélité, la fierté révolte; il ignorait que le vrai talent ne reconnaît de Napoléons que dans le génie; qu'il a ses entrées dans les palais comme dans les temples, parce qu'il est immortel.
Madame de Staël quitta Chaumont et retourna à Coppet[347]; madame Récamier s'empressa de nouveau (p. 420) de se rendre auprès d'elle; M. Mathieu de Montmorency lui resta également dévoué. L'un et l'autre en furent punis; ils furent frappés de la peine même qu'ils étaient allés consoler: les quarante lieues de distance de Paris leur furent infligées[348].
Madame Récamier se retira à Châlons-sur-Marne[349], décidée dans son choix par le voisinage de Montmirail[350], qu'habitaient MM. de La Rochefoucauld-Doudeauville.
(p. 421) Mille détails de l'oppression de Bonaparte se sont perdus dans la tyrannie générale: les persécutés redoutaient de voir leurs amis, crainte de les compromettre; leurs amis n'osaient les visiter, crainte de leur attirer quelque accroissement de rigueur. Le malheureux proscrit, devenu un pestiféré, séquestré du genre humain, demeurait en quarantaine dans la haine du despote. Bien reçu tant qu'on ignorait votre indépendance d'opinion, sitôt qu'elle était connue tout se retirait; il ne restait autour de vous que des autorités épiant vos liaisons, vos sentiments, vos correspondances, vos démarches: tels étaient ces temps de bonheur et de liberté.
Les lettres de madame de Staël révèlent les souffrances de cette époque, où les talents étaient menacés à chaque instant d'être jetés dans un cachot, où l'on ne s'occupait que des moyens de s'échapper, où l'on aspirait à la fuite comme à la délivrance: quand la liberté a disparu, il reste un pays, mais il n'y a plus de patrie.
En écrivant à son amie qu'elle ne désirait pas la voir, dans l'appréhension du mal qu'elle lui pourrait apporter, madame de Staël ne disait pas tout: elle était mariée secrètement à M. de Rocca[351], d'où résultait une complication d'embarras dont la police impériale profitait. Madame Récamier, à qui madame de Staël croyait devoir taire ses nouveaux soucis, s'étonnait (p. 422) à bon droit de l'obstination qu'elle mettait à lui interdire l'entrée de son château de Coppet: blessée de la résistance de madame de Staël, pour laquelle elle s'était déjà sacrifiée, elle n'en persistait pas moins dans sa résolution de la rejoindre.
Toutes les lettres qui auraient dû retenir madame Récamier ne firent que la confirmer dans son dessein: elle partit et reçut à Dijon ce billet fatal:
«Je vous dis adieu, cher ange de ma vie, avec toute la tendresse de mon âme. Je vous recommande Auguste[352]: qu'il vous voie et qu'il me revoie. Vous êtes une créature céleste. Si j'avais vécu près de vous, j'aurais été trop heureuse: le sort m'entraîne. Adieu[353].»
Madame de Staël ne devait plus retrouver Juliette que pour mourir. Le billet de madame de Staël frappa d'un coup de foudre la voyageuse: fuir subitement, s'en aller avant d'avoir pressé dans ses bras celle qui accourait pour se jeter dans ses adversités, n'était-ce point de la part de madame de Staël une résolution cruelle? Il paraissait à madame Récamier que l'amitié aurait pu être moins entraînée par le sort.
Madame de Staël alla chercher l'Angleterre en traversant l'Allemagne et la Suède[354]: la puissance de (p. 423) Napoléon était une autre mer qui séparait Albion de l'Europe, comme l'Océan la sépare du monde.
Auguste, fils de madame de Staël, avait perdu son frère, tué en duel d'un coup de sabre[355]; il se maria et eut un fils: ce fils, âgé de quelques mois, l'a suivi dans la tombe. Avec Auguste de Staël s'est éteinte la postérité masculine d'une femme illustre, car elle ne revit pas dans le nom honorable, mais inconnu, de Rocca.
Madame Récamier demeurée seule, pleine de regrets, chercha d'abord à Lyon, sa ville natale, un premier abri[356]: elle y rencontra madame de Chevreuse[357], (p. 424) autre bannie. Madame de Chevreuse avait été forcée par l'Empereur et ensuite par sa propre famille d'entrer dans la nouvelle société. Vous trouveriez à peine un nom historique qui ne consentît à perdre son honneur plutôt qu'une forêt. Une fois engagée aux Tuileries, madame de Chevreuse avait cru pouvoir dominer dans une cour sortie des camps: cette cour cherchait, il est vrai, à s'instruire des airs de jadis, dans l'espoir de couvrir sa récente origine; mais l'allure plébéienne était encore trop rude pour recevoir des leçons de l'impertinence aristocratique. Dans une révolution qui dure et qui a fait son dernier pas, comme par exemple à Rome, le Patriciat, un siècle après la chute de la république, put se résigner à n'être plus que le sénat des empereurs; le passé n'avait rien à reprocher aux empereurs du présent, puisque ce passé était fini; une égale flétrissure marquait toutes les existences. Mais en France les nobles qui se transformèrent en chambellans se hâtèrent trop; l'empire nouvellement né disparut avant eux, et ils se retrouvèrent en face de la vieille monarchie ressuscitée.
Madame de Chevreuse, attaquée d'une maladie de poitrine, sollicita et n'obtint pas la faveur d'achever ses derniers jours à Paris; on n'expire pas quand et où l'on veut[358]: Napoléon; qui faisait tant de décédés n'en aurait pas fini avec eux s'il leur eût laissé le choix de leur tombeau.
(p. 425) Madame Récamier ne parvenait à oublier ses propres chagrins qu'en s'occupant de ceux des autres; par la connivence charitable d'une sœur de la Miséricorde, elle visitait secrètement à Lyon les prisonniers espagnols. Un d'entre eux, brave et beau, chrétien comme le Cid, s'en allait à Dieu: assis sur la paille, il jouait de la guitare; son épée avait trompé sa main. Sitôt qu'il apercevait sa bienfaitrice, il lui chantait des romances de son pays, n'ayant pas d'autre moyen de la remercier. Sa voix affaiblie et les sons confus de l'instrument se perdaient dans le silence de la prison. Les compagnons du soldat, à demi enveloppés de leurs manteaux déchirés, leurs cheveux noirs pendants sur leurs visages hâves et bronzés, levaient des yeux fiers du sang castillan, humides de reconnaissance, sur l'exilée qui leur rappelait une épouse, une sœur, une amante, et qui portait le joug de la même tyrannie.
L'Espagnol mourut. Il put dire comme Zarviska, le jeune et valeureux poète polonais: «Une main inconnue fermera ma paupière; le tintement d'une cloche étrangère annoncera mon trépas, et des voix qui ne seront pas celles de ma patrie prieront pour moi.»
Mathieu de Montmorency vint à Lyon visiter madame Récamier. Elle connut alors M. Camille Jordan et M. Ballanche, dignes de grossir le cortège des amitiés attachées à sa noble vie.
Madame Récamier était trop fière pour demander son rappel. Fouché l'avait longtemps et inutilement pressée d'orner la cour de l'empereur: on peut voir les détails de ces négociations de palais dans les écrits (p. 426) du temps. Madame Récamier se retira en Italie[359]: M. de Montmorency l'accompagna jusqu'à Chambéry. Elle traversa le reste des Alpes, n'ayant pour compagne de voyage qu'une petite nièce âgée de sept ans, aujourd'hui madame Lenormant.
Rome était alors une ville de France, capitale du département du Tibre. Le pape gémissait prisonnier à Fontainebleau, dans le palais de François Ier.
Fouché, en mission en Italie, commandait dans la cité des Césars, de même que le chef des eunuques noirs dans Athènes: il n'y fit que passer[360]; on installa M. de Norvins[361] en qualité de préfet de police: le mouvement était sur un autre point de l'Europe.
Conquise sans avoir vu son second Alaric, la ville éternelle se taisait, plongée dans ses ruines. Des artistes demeuraient seuls sur cet amas de siècles. Canova reçut madame Récamier comme une statue grecque que la France rendait au musée du Vatican: pontife des arts, il l'inaugura aux honneurs du Capitole, dans Rome abandonnée.
Canova avait une maison à Albano; il l'offrit à madame Récamier; elle y passa l'été. La fenêtre à balcon (p. 427) de sa chambre était une de ces grandes croisées de peintre qui encadrent le paysage. Elle s'ouvrait sur les ruines de la villa de Pompée; au loin, par dessus des oliviers, on voyait le soleil se coucher dans la mer. Canova revenait à cette heure; ému de ce beau spectacle, il se plaisait à chanter, avec un accent vénitien et une voix agréable, la barcarolle: O pescator dell' onda; madame Récamier l'accompagnait sur le piano. L'auteur de Psyché et de la Madeleine se délectait à cette harmonie, et cherchait dans les traits de Juliette le type de la Béatrix qu'il rêvait de faire un jour. Rome avait vu jadis Raphaël et Michel-Ange couronner leurs modèles dans de poétiques orgies, trop librement racontées par Cellini: combien leur était supérieure cette petite scène décente et pure entre une femme exilée et ce Canova, si simple et si doux!
Plus solitaire que jamais, Rome en ce moment portait le deuil de veuve: elle ne voyait plus passer en la bénissant ces paisibles souverains qui rajeunissaient ses vieux jours de toutes les merveilles des arts. Le bruit du monde s'était encore une fois éloigné d'elle; Saint-Pierre était désert comme le Colisée.
J'ai lu les lettres éloquentes qu'écrivait à son amie la femme la plus illustre de nos jours passés; lisez les mêmes sentiments de tendresse exprimés avec la plus charmante naïveté, dans la langue de Pétrarque, par le premier sculpteur des temps modernes. Je ne commettrai pas le sacrilège d'essayer de les traduire.
«Domenica mattina.
«Dio eterno? siamo vivi, o siamo morti? lo voglio esser vivo, almeno per scriveri; si, lo vuole il mio (p. 428) cuore, anzi mi comanda assolutamente di tarlo. Oh! se'l conoscete bene a fondo questo povero cuor mio, quanto, quanto mai ve ne persuadereste! Ma per disgrazia mia pare ch'egli sia alquanto all' oscuro per voi. Pazienza! Ditemi almeno come state di salute, se di più non volete dire; benchè mi abbiate promesso di scrivere a di scrivermi dolce. Io davvero che avrei voluto vedervi personalmente in questi giorni, ma non vi poteva essere alcuna via di poterlo fare; anzi su di questo vi dirò a voce delle cose curiose. Conviene dunque che mi contenti, a forza, di vidervi in spirito. In questo modo sempre mi siete presente, sempre vi veggo, sempre vi parlo, vi dico tante, tante cose, ma tutte, tutte al vento, tutte! Pazienza anche di questo! gran fatto che la cosa abbia d'andare sempre in questo modo! voglio intanto però che siate certa, certissima che l'anima mia vi ama molto più assai di quello che mai possiate credere ed imaginare.»

Mme Récamier visitant les Prisonniers Espagnols à Lyon.
Madame Récamier avait secouru les prisonniers espagnols à Lyon; une autre victime de ce pouvoir qui la frappait la mit à même d'exercer à Albano son humeur compatissante: un pêcheur, accusé d'intelligence avec les sujets du pape, avait été jugé et condamné à mort. Les habitants d'Albano supplièrent l'étrangère réfugiée chez eux d'intercéder pour ce malheureux. On la conduisit à la geôle; elle y vit le prisonnier; frappée du désespoir de cet homme, elle fondit en larmes. Le malheureux la supplia de venir à son secours, d'intercéder pour lui, de le sauver; prière d'autant plus déchirante, qu'il y avait impossibilité (p. 429) de l'arracher au supplice. Il faisait déjà nuit, et il devait être fusillé au lever du jour.
Cependant, madame Récamier, bien que persuadée de l'inutilité de ses démarches, n'hésita pas. On lui amène une voiture, elle y monte sans l'espérance qu'elle laissait au condamné. Elle traverse la campagne infestée de brigands, parvient à Rome, et ne trouve point le directeur de la police. Elle l'attendît deux heures au palais Fiano; elle comptait les minutes d'une vie dont la dernière approchait. Quand M. de Norvins arriva, elle lui expliqua l'objet de son voyage. Il lui répondit que l'arrêt était prononcé, et qu'il n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour le faire suspendre.
Madame Récamier repartit le cœur navré; le prisonnier avait cessé de vivre lorsqu'elle approcha d'Albano. Les habitants attendaient la Française sur le chemin; aussitôt qu'ils la reconnurent, ils coururent à elle. Le prêtre qui avait assisté le patient lui en apportait les derniers vœux: il remerciait la dama, qu'il n'avait cessé de chercher des yeux en allant au lieu de l'exécution; il lui recommandait de prier pour lui; car un chrétien n'a pas tout fini et n'est pas hors de crainte quand il n'est plus. Madame Récamier fut conduite par l'ecclésiastique à l'église, où la suivit la foule des belles paysannes d'Albano. Le pêcheur avait été fusillé à l'heure où l'aurore se levait sur la barque, maintenant sans guide, qu'il avait coutume de conduire sur les mers, et aux rivages qu'il avait accoutumé de parcourir.
Pour se dégoûter des conquérants, il faudrait savoir tous les maux qu'ils causent; il faudrait être (p. 430) témoin de l'indifférence avec laquelle on leur sacrifie les plus inoffensives créatures dans un coin du globe où ils n'ont jamais mis le pied. Qu'importaient aux succès de Bonaparte les jours d'un pauvre faiseur de filets des États romains? Sans doute, il n'a jamais su que ce chétif pêcheur avait existé; il a ignoré, dans le fracas de sa lutte avec les rois, jusqu'au nom de sa victime plébéienne.
Le monde n'aperçoit en Napoléon que des victoires; les larmes dont les colonnes triomphales sont cimentées ne tombent point de ses yeux. Et moi, je pense que de ces souffrances méprisées, de ces calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseils de la Providence les causes secrètes qui précipitent du faîte le dominateur. Quand les injustices particulières se sont accumulées de manière à l'emporter sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a du sang muet et du sang qui crie: le sang des champs de bataille est bu en silence par la terre; le sang pacifique répandu rejaillit en gémissant vers le ciel; Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pêcheur d'Albano; quelques mois après il était banni chez les pêcheurs de l'île d'Elbe, et il est mort parmi ceux de Sainte-Hélène[362].
Mon souvenir vague, à peine ébauché dans les pensées de madame Récamier, lui apparaissait-il au milieu des steppes du Tibre et de l'Anio? J'avais déjà passé à travers ces solitudes mélancoliques; (p. 431) j'y avais laissé une tombe honorée des larmes des amis de Juliette. Lorsque la fille de M. de Montmorin (madame de Beaumont) mourut en 1803, madame de Staël et M. Necker m'écrivaient des lettres de regrets; on a vu ces lettres. Ainsi je recevais à Rome, avant presque d'avoir connu madame Récamier, des lettres datées de Coppet; c'est le premier indice d'une affinité de destinée. Madame Récamier m'a dit aussi que ma lettre de 1804 à M. de Fontanes lui servait de guide en 1814, et qu'elle relisait assez souvent ce passage:
«Quiconque n'a plus de lien dans la vie doit venir demeurer à Rome. Là, il trouvera pour société une terre qui nourrira ses réflexions et occupera son cœur, et des promenades qui lui diront toujours quelque chose. La pierre qu'il foulera aux pieds lui parlera; la poussière que le vent élèvera sous ses pas renfermera quelque grandeur humaine. S'il est malheureux, s'il a mêlé les cendres de ceux qu'il aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne passera-t-il pas du sépulcre des Scipions au dernier asile d'un ami vertueux!... S'il est chrétien, ah! comment pourrait-il alors s'arracher de cette terre qui est devenue sa patrie, de cette terre qui a vu naître un second empire, plus saint dans son berceau, plus grand dans sa puissance que celui qui l'a précédé; de cette terre où les amis que nous avons perdus, dormant avec les martyrs aux catacombes, sous l'œil du père des fidèles, paraissent devoir se réveiller les premiers dans leur poussière et semblent plus voisins des cieux[363]?»
(p. 432) Mais en 1814, je n'étais pour madame Récamier qu'un cicerone vulgaire, appartenant à tous les voyageurs; plus heureux en 1823, j'avais cessé de lui être étranger, et nous pouvions causer ensemble des ruines romaines.
À Naples, où madame Récamier se rendit en automne[364], cessèrent les occupations de la solitude. À peine fut-elle descendue à l'auberge, que les ministres du roi Joachim accoururent. Murat, oubliant la main qui changea sa cravache en sceptre, était prêt à se joindre à la coalition. Bonaparte avait planté son épée au milieu de l'Europe, comme les Gaulois plantaient leur glaive au milieu du mallus[365]: autour de l'épée de Napoléon s'étaient rangés en cercle des royaumes qu'il distribuait à sa famille. Caroline avait reçu celui de Naples. Madame Murat n'était pas un camée antique aussi élégant que la princesse Borghèse; mais elle avait plus de physionomie et plus d'esprit que sa sœur. À la fermeté de son caractère on reconnaissait le sang de Napoléon. Si le diadème n'eût pas été pour elle l'ornement de la tête d'une femme, (p. 433) il eût encore été la marque du pouvoir d'une reine.
Caroline reçut madame Récamier avec un empressement d'autant plus affectueux que l'oppression de la tyrannie se faisait sentir jusqu'à Portici. Cependant, la ville qui possède le tombeau de Virgile et le berceau du Tasse, cette ville où vécurent Horace et Tite-Live, Boccace et Sannazar, où naquirent Durante et Cimarozsa, avait été embellie par son nouveau maître. L'ordre s'était rétabli: les lazzaroni ne jouaient plus à la boule avec des têtes pour amuser l'amiral Nelson et lady Hamilton. Les fouilles de Pompéi s'étaient étendues; un chemin serpentait sur le Pausilippe, dans les flancs duquel j'avais passé en 1803[366] pour aller m'enquérir à Literne de la retraite de Scipion. Ces royautés nouvelles d'une dynastie militaire avaient fait renaître la vie dans des pays où se manifestait auparavant la moribonde langueur d'une vieille race. Robert Guiscard, Guillaume Bras de Fer, Roger et Tancrède semblaient être revenus, moins la chevalerie.
Madame Récamier était à Naples au mois de février 1814; où étais-je donc alors? dans ma Vallée-aux-Loups, commençant l'histoire de ma vie. Je m'occupais des jeux de mon enfance au bruit des pas des soldats étrangers. La femme dont le nom devait clore ces Mémoires errait sur les marines de Baïes. N'avais-je pas un pressentiment du bien qui m'arriverait un jour de cette terre, alors que je peignais la séduction parthénopéenne dans les Martyrs:
«Chaque matin, aussitôt que l'aurore commençait à paraître, je me rendais sous un portique. Le soleil (p. 434) se levait devant moi; il illuminait de ses feux les plus doux la chaîne des montagnes de Salerne, le bleu de la mer parsemé des voiles blanches du pêcheur, les îles de Caprée, d'Œnaria et de Prochyta, le cap de Misène et Baïes avec tous ses enchantements.
«Des fleurs et des fruits humides de rosée sont moins suaves et moins frais que le paysage de Naples sortant des ombres de la nuit. J'étais toujours surpris, en arrivant au portique, de me trouver au bord de la mer, car les vagues dans cet endroit faisaient à peine entendre le léger murmure d'une fontaine; en extase devant ce tableau, je m'appuyais contre une colonne, et sans pensée, sans désir, sans projet, je restais des heures entières à respirer un air délicieux. Le charme était si profond, qu'il me semblait que cet air divin transformait ma propre substance, et qu'avec un plaisir indicible je m'élevais vers le firmament comme un pur esprit... Attendre ou chercher la beauté, la voir s'avancer dans une nacelle et nous sourire du milieu des flots; voguer avec elle sur la mer, dont nous semions la surface de fleurs; suivre l'enchanteresse au fond de ces bois de myrthe et dans les champs heureux où Virgile plaça l'Élysée: telle était l'occupation de nos jours...
«Peut-être est-il des climats dangereux à la vertu par leur extrême volupté; et n'est-ce point ce que voulut enseigner une fable ingénieuse en racontant que Parthénope fut bâtie sur le tombeau d'une sirène? L'éclat velouté de la campagne, la tiède température de l'air, les contours arrondis des montagnes, les molles inflexions des fleuves et des (p. 435) vallées, sont à Naples autant de séductions pour les sens, que tout repose et que rien ne blesse...
«Pour éviter les ardeurs du Midi, nous nous retirions dans la partie du palais bâtie sous la mer. Couchés sur des lits d'ivoire, nous entendions murmurer les vagues au-dessus de nos têtes; si quelque orage nous surprenait au fond de ces retraites, les esclaves allumaient des lampes pleines du nard le plus précieux de l'Arabie. Alors entraient de jeunes Napolitaines qui portaient des roses de Pæstum dans des vases de Nola; tandis que les flots mugissaient au dehors, elles chantaient en formant devant nous des danses tranquilles qui me rappelaient les mœurs de la Grèce: ainsi se réalisaient pour nous les fictions des poètes; on eût cru voir les jeux des Néréides dans la grotte de Neptune[367].»
Madame Récamier rencontra à Naples le comte de Neipperg[368] et le duc de Rohan-Chabot[369]: l'un devait (p. 436) monter au nid de l'aigle, l'autre revêtir la pourpre. On a dit de celui-ci qu'il avait été voué au rouge, ayant porté l'habit de chambellan, l'uniforme de chevau-léger de la garde et la robe de cardinal.
Le duc de Rohan était fort joli; il roucoulait la romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé, sa pieuse chevelure, éprouvée au fer, avait une élégance de martyr. Il prêchait à la brune, dans des oratoires sombres, devant des dévotes, ayant soin, à l'aide de deux ou trois bougies artistement placées, d'éclairer en demi-teinte, comme un tableau, son visage pâle.
(p. 437) On ne s'explique pas de prime abord comment des hommes que leurs noms rendaient bêtes à force d'orgueil s'étaient mis aux gages d'un parvenu. En y regardant de près, on trouve que cette aptitude à entrer en condition découlait naturellement de leurs mœurs: façonnés à la domesticité, point n'avaient souci du changement de livrée, pourvu que le maître fut logé au château à la même enseigne. Le mépris de Bonaparte leur rendait justice: ce grand soldat, abandonné des siens, disait à une grande dame: «Au fond, il n'y a que vous autres qui sachiez servir.»
La religion et la mort ont passé l'éponge sur quelques faiblesses, après tout bien pardonnables, du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé à Besançon son sacrifice, secourant le malheureux, nourrissant le pauvre, vêtant l'orphelin et usant en bonnes œuvres sa vie, dont une santé déplorable abrégeait naturellement le cours.
Lecteur, si tu t'impatientes de ces citations, de ces récits, songe d'abord que tu n'as peut-être pas lu mes ouvrages, et qu'ensuite je ne t'entends plus; je dors dans la terre que tu foules; si tu m'en veux, frappe sur cette terre, tu n'insulteras que mes os. Songe de plus que mes écrits font partie essentielle de cette existence dont je déploie les feuilles. Ah! que mes tableaux napolitains n'avaient-ils un fonds de vérité! Que la fille du Rhône n'était-elle la femme réelle de mes délices imaginaires! Mais non: si j'étais Augustin, Jérôme, Eudore, je l'étais seul, mes jours devancèrent les jours de l'amie de Corinne en Italie. Heureux si j'avais pu étendre ma vie entière sous ses pas comme un tapis de fleurs! Ma vie est rude, et (p. 438) ses aspérités blessent. Puissent du moins mes heures expirantes refléter l'attendrissement et le charme dont elle les a remplies sur celle qui fut aimée de tous et dont personne n'eut jamais à se plaindre!
Murat, roi de Naples, né le 25 mars 1767 à la Bastide, près Cahors, fut envoyé à Toulouse pour y faire ses études. Il se dégoûta des lettres, s'enrôla dans les chasseurs des Ardennes, déserta et se réfugia à Paris. Admis dans la garde constitutionnelle de Louis XVI[370], il obtint, après le licenciement de cette garde, une sous-lieutenance dans le 12e régiment de chasseurs à cheval. À la mort de Robespierre, il fut destitué comme terroriste[371]; même chose arriva à Bonaparte, et les deux soldats demeurèrent sans ressources. Murat rentra en grâce au 13 vendémiaire, et devint aide de camp de Napoléon. Il fit sous lui les premières campagnes d'Italie, prit la Valteline et la réunit à la République Cisalpine; il eut part à l'expédition d'Égypte et se signala à la bataille d'Aboukir. Revenu en France avec son maître, il fut chargé de jeter à la porte le conseil des Cinq-Cents. Bonaparte lui donna en mariage sa sœur Caroline. Murat commandait la cavalerie à la bataille de Marengo. Gouverneur (p. 439) de Paris lors de la mort du duc d'Enghien, il gémit tout bas d'un assassinat qu'il n'eut pas le courage de blâmer tout haut.
Beau-frère de Napoléon[372] et maréchal de l'empire, Murat entra à Vienne en 1805[373]; il contribua aux victoires d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland, devint grand-duc de Berg[374] et envahit l'Espagne en 1808.
Napoléon le rappela et lui donna la couronne de Naples. Proclamé roi des Deux-Siciles le 1er août 1808, il plut aux Napolitains par son faste, son costume théâtral, ses cavalcades et ses fêtes.
Appelé en qualité de grand vassal de l'empire à l'invasion de la Russie, il reparut dans tous les combats et se trouva chargé du commandement de la retraite de Smolensk à Wilna. Après avoir manifesté son mécontentement, il quitta l'armée à l'exemple de Bonaparte, et vint se réchauffer au soleil de Naples, comme son capitaine au foyer des Tuileries. Ces hommes de triomphe ne pouvaient s'accoutumer aux revers. Alors commencèrent ses liaisons avec l'Autriche. Il reparut encore aux camps de l'Allemagne en 1813, retourna à Naples après la perte de la bataille de Leipzig et renoua ses négociations austro-britanniques. Avant d'entrer dans une alliance complète, Murat écrivit à Napoléon une lettre que j'ai entendu lire à M. de Mosbourg[375]: il disait à son beau-frère, (p. 440) dans cette lettre, qu'il avait retrouvé la Péninsule fort agitée, que les Italiens réclamaient leur indépendance nationale; que si elle ne leur était pas rendue, il était à craindre qu'ils ne se joignissent à la coalition de l'Europe et n'augmentassent ainsi les dangers de la France. Il suppliait Napoléon de faire la paix, seul moyen de conserver un empire si puissant et si beau. Que si Bonaparte refusait de l'écouter, lui Murat, abandonné à l'extrémité de l'Italie, se verrait forcé de quitter son royaume ou d'embrasser les intérêts de la liberté italienne. Cette lettre très raisonnable resta plusieurs mois sans réponse; Napoléon n'a donc pu reprocher justement à Murat de l'avoir trahi.
Murat, obligé de choisir promptement, signa, le 11 janvier 1814, avec la cour de Vienne, un traité: il s'obligeait à fournir un corps de trente mille hommes aux alliés. Pour prix de cette défection, on lui garantissait son royaume napolitain et son droit de conquête sur les Marches pontificales. Madame Murat avait révélé cette importante transaction à madame Récamier. Au moment de se déclarer ouvertement, Murat, fort ému, rencontra madame Récamier chez Caroline et lui demanda ce qu'elle pensait du parti qu'il avait à prendre; il la priait de bien peser les (p. 441) intérêts du peuple dont il était devenu le souverain. Madame Récamier lui dit: «Vous êtes Français, c'est aux Français que vous devez rester fidèle.» La figure de Murat se décomposa; il repartit: «Je suis donc un traître? qu'y faire? il est trop tard!» Il ouvrit avec violence une fenêtre et montra de la main une flotte anglaise entrant à pleines voiles dans le port.
Le Vésuve venait d'éclater et jetait des flammes. Deux heures après, Murat était à cheval à la tête de ses gardes; la foule l'environnait en criant: «Vive le roi Joachim!» Il avait tout oublié; il paraissait ivre de joie. Le lendemain, grand spectacle au théâtre Saint-Charles; le roi et la reine furent reçus avec des acclamations frénétiques, inconnues des peuples en deçà des Alpes. On applaudit aussi l'envoyé de François II: dans la loge du ministre de Napoléon, il n'y avait personne; Murat en parut troublé, comme s'il eût vu au fond de cette loge le spectre de la France.
L'armée de Murat, mise en mouvement le 16 février 1814, force le prince Eugène à se replier sur l'Adige. Napoléon, ayant d'abord obtenu des succès inespérés en Champagne, écrivait à sa sœur Caroline des lettres qui furent surprises par les alliés et communiquées au Parlement d'Angleterre par lord Castlereagh; il lui disait: «Votre mari est très brave sur le champ de bataille; mais il est plus faible qu'une femme ou qu'un moine quand il ne voit pas l'ennemi. Il n'a aucun courage moral. Il a eu peur et il n'a pas hasardé (p. 442) de perdre en un instant ce qu'il ne peut tenir que par moi et avec moi.»
Dans une autre lettre adressée à Murat lui-même, Napoléon disait à son beau-frère: «Je suppose que vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le lion est mort; si vous faisiez ce calcul, il serait faux. . . Vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez depuis votre départ de Wilna. Le titre de roi vous a tourné la tête; si vous désirez le conserver, conduisez-vous bien.»
Murat ne poursuivit pas le vice-roi sur l'Adige; il hésitait entre les alliés et les Français, selon les chances que Bonaparte semblait gagner ou perdre.
Dans les champs de Brienne[376], où Napoléon fut élevé par l'ancienne monarchie, il donnait en l'honneur de celle-ci le dernier et le plus admirable de ses sanglants tournois. Favorisé des carbonari, Joachim tantôt veut se déclarer libérateur de l'Italie, tantôt espère la partager entre lui et Bonaparte devenu vainqueur.
Un matin, le courrier apporta à Naples la nouvelle de l'entrée des Russes à Paris. Madame Murat était encore couchée, et madame Récamier, assise à son chevet, causait avec elle; on déposa sur le lit un énorme tas de lettres et de journaux. Parmi ceux-ci se trouvait mon écrit De Bonaparte et des Bourbons. La reine s'écria: «Ah! voilà un ouvrage de M. de Chateaubriand; nous le lirons ensemble.» Et elle continua à décacheter ses lettres.
Madame Récamier prit la brochure, et après y avoir jeté les yeux au hasard, elle la remit sur le lit et dit (p. 443) à la reine: «Madame, vous la lirez seule, je suis obligée de rentrer chez moi.»
Napoléon fut relégué à l'île d'Elbe; l'Alliance, avec une rare habileté, l'avait placé sur les côtes de l'Italie. Murat apprit qu'on cherchait au Congrès de Vienne à le dépouiller des États qu'il avait néanmoins achetés si cher; il s'entendit secrètement avec son beau-frère, devenu son voisin. On est toujours étonné que les Napoléon aient des parents: qui sait le nom d'Aridée, frère d'Alexandre? Pendant le cours de l'année 1814, le roi et la reine de Naples donnèrent une fête à Pompéi; on exécuta une fouille au son de la musique: les ruines que faisaient déterrer Caroline et Joachim ne les instruisaient pas de leur propre ruine; sur les derniers bords de la prospérité, on n'entend que les derniers concerts du songe qui passe.
Lors de la paix de Paris, Murat faisait partie de l'Alliance, le Milanais ayant été rendu à l'Autriche: les Napolitains se retirèrent dans les Légations romaines. Quand Bonaparte, débarqué à Cannes, fut entré à Lyon, Murat, perplexe, ayant changé d'intérêts, sortit des Légations et marcha avec quarante mille hommes vers la haute Italie, pour faire diversion en faveur de Napoléon[377]. Il refusa à Parme les conditions que les Autrichiens effrayés lui offraient encore: pour chacun de nous il est un moment critique; bien ou mal choisi, il décide de notre avenir. Le baron de Firmont repousse les troupes de Murat, prend l'offensive et les mène battant jusqu'à Macerata[378]. Les Napolitains se débandèrent; leur général-roi (p. 444) rentre dans Naples, accompagné de quatre lanciers[379]. Il se présente à sa femme et lui dit: «Madame, je n'ai pu mourir.» Le lendemain, un bateau le conduit vers l'île d'Ischia; il rejoint en mer une pinque chargée de quelques officiers de son état-major, et fait voile avec eux pour la France.
Madame Murat, demeurée seule, montra une présence d'esprit admirable. Les Autrichiens étaient au moment de paraître: dans le passage d'une autorité à l'autre, un intervalle d'anarchie pouvait être rempli de désordres. La régente ne précipite point sa retraite; elle laisse le soldat allemand occuper la ville et fait pendant la nuit éclairer ses galeries. Le peuple, apercevant du dehors la lumière, pensant que la reine est encore là, reste tranquille. Cependant, Caroline sort par un escalier secret et s'embarque. Assise à la poupe du vaisseau, elle voyait sur la rive resplendir illuminé le palais désert dont elle s'éloignait, image du rêve brillant qu'elle avait eu pendant son sommeil dans la région des fées.
Caroline rencontra la frégate qui ramenait Ferdinand[380]. Le vaisseau de la reine fugitive fit le salut, le vaisseau du roi rappelé ne le rendit pas: la prospérité ne reconnaît pas l'adversité sa sœur. Ainsi les illusions, évanouies pour les uns, recommencent pour les autres; ainsi se croisent dans les vents et sur les flots les inconstantes destinées humaines: riantes ou funestes, le même abîme les porte ou les engloutit.
Murat accomplissait ailleurs sa course. Le 25 mai (p. 445) 1815, à dix heures du soir, il aborda au golfe Juan, où son beau-frère avait abordé. La fortune faisait jouer à Joachim la parodie de Napoléon. Celui-ci ne croyait pas à la force du malheur et au secours qu'il apporte aux grandes âmes: il défendit au roi détrôné l'accès de Paris; il mit au lazaret cet homme attaqué de la peste des vaincus; il le relégua dans une maison de campagne, appelée Plaisance, près de Toulon. Il eût mieux fait de moins redouter une contagion dont il avait été lui-même atteint: qui sait ce qu'un soldat comme Murat aurait pu changer à la bataille de Waterloo?
Le roi de Naples, dans son chagrin, écrivait à Fouché le 19 juin 1815:
«Je répondrai à ceux qui m'accusent d'avoir commencé les hostilités trop tôt, qu'elles le furent sur la demande formelle de l'empereur, et que, depuis trois mois il n'a cessé de me rassurer sur ses sentiments, en accréditant des ministres près de moi, en m'écrivant qu'il comptait sur moi et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Ce n'est que lorsqu'on a vu que je venais de perdre avec le trône les moyens de continuer la puissante diversion qui durait depuis trois mois, qu'on veut égarer l'opinion publique en insinuant que j'ai agi pour mon propre compte et à l'insu de l'empereur.»
Il y eut dans le monde une femme généreuse et belle; lorsqu'elle arriva à Paris, madame Récamier la reçut et ne l'abandonna point dans des temps de malheur. Parmi les papiers qu'elle a laissés, on a trouvé deux lettres de Murat du mois de juin 1815; elles sont utiles à l'histoire.
«J'ai perdu pour la France la plus belle existence, j'ai combattu pour l'empereur; c'est pour sa cause que ma femme et mes enfants sont en captivité. La patrie est en danger, j'offre mes services; on en ajourne l'acceptation. Je ne sais si je suis libre ou prisonnier. Je dois être enveloppé dans la ruine de l'empereur s'il succombe, et on m'ôte les moyens de le servir et de servir ma propre cause. J'en demande les raisons; on répond obscurément et je ne puis me faire juge de ma position. Tantôt je ne puis me rendre à Paris, où ma présence ferait tort à l'empereur; je ne saurais aller à l'armée, où ma présence réveillerait trop l'attention du soldat. Que faire? attendre: voilà ce qu'on me répond. On me dit, d'un autre côté, qu'on ne me pardonne pas d'avoir abandonné l'empereur l'année dernière, tandis que des lettres de Paris disaient, quand je combattais récemment pour la France: «Tout le monde ici est enchanté du roi.» L'empereur m'écrivait: «Je compte sur vous, comptez sur moi; je ne vous abandonnerai jamais.» Le roi Joseph m'écrivait: «L'Empereur m'ordonne de vous écrire de vous porter rapidement sur les Alpes.» Et quand, en arrivant, je lui témoigne des sentiments généreux, et que je lui offre de combattre pour la France, je suis envoyé dans les Alpes. Pas un mot de consolation n'est adressé à celui qui n'eut jamais d'autre tort envers lui que d'avoir trop compté sur des sentiments généreux, sentiments qu'il n'eut jamais pour moi.
«Mon amie, je viens vous prier de me faire connaître (p. 447) l'opinion de la France et de l'armée à mon égard. Il faut savoir tout supporter et mon courage me rendra supérieur à tous les malheurs. Tout est perdu hors l'honneur; j'ai perdu le trône, mais j'ai conservé toute ma gloire; je fus abandonné par mes soldats, qui furent victorieux dans tous les combats, mais je ne fus jamais vaincu. La désertion de vingt mille hommes me mit à la merci de mes ennemis; une barque de pêcheur me sauva de la captivité, et un navire marchand me jeta en trois jours sur les côtes de France.»

Madame Récamier.
«Sous Toulon, 18 juin 1815.
«Je viens de recevoir votre lettre. Il m'est impossible de vous dépeindre les différentes sensations qu'elle m'a fait éprouver. J'ai pu un instant oublier mes malheurs. Je ne suis occupé que de mon amie, dont l'âme noble et généreuse vient me consoler et me montrer sa douleur. Rassurez-vous, tout est perdu, mais l'honneur reste; ma gloire survivra à tous mes malheurs, et mon courage saura me rendre supérieur à toutes les rigueurs de ma destinée: n'ayez rien à craindre de ce côté. J'ai perdu trône et famille sans m'émouvoir; mais l'ingratitude m'a révolté. J'ai tout perdu pour la France, pour son empereur, par son ordre, et aujourd'hui il me fait un crime de l'avoir fait. Il me refuse la permission de combattre et de me venger, et je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite: concevez-vous tout mon malheur? que faire? quel parti prendre? Je suis Français et père: comme Français, je dois servir ma patrie; comme père, je dois aller partager (p. 448) le sort de mes enfants: l'honneur m'impose le devoir de combattre, et la nature me dit que je dois être à mes enfants. À qui obéir? Ne puis-je satisfaire à tous deux? Me sera-t-il permis d'écouter l'un ou l'autre? Déjà l'empereur me refuse des armées; et l'Autriche m'accordera-t-elle les moyens d'aller rejoindre mes enfants? les lui demanderai-je, moi qui n'ai jamais voulu traiter avec ses ministres? Voilà ma situation: donnez-moi des conseils. J'attendrai votre réponse, celle du duc d'Otrante et de Lucien, avant de prendre une détermination. Consultez bien l'opinion sur ce que l'on croit qu'il me convient de faire, car je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite; on revient sur le passé et on me fait un crime d'avoir, par ordre, perdu mon trône, quand ma famille gémit dans la captivité. Conseillez-moi; écoutez la voix de l'honneur, celle de la nature, et, en juge impartial, ayez le courage de m'écrire ce qu'il faut que je fasse. J'attendrai votre réponse sur la route de Marseille à Lyon.»
Laissant de côté les vanités personnelles et ces illusions qui sortent du trône, même d'un trône où l'on ne s'est assis qu'un moment, ces lettres nous apprennent quelle idée Murat se faisait de son beau-frère.
Bonaparte perd une seconde fois l'empire; Murat vagabonde sans asile sur ces mêmes plages qui ont vu errer la duchesse de Berry. Des contrebandiers consentent, le 22 août 1815, à le passer, lui et trois autres, à l'île de Corse. Une tempête l'accueille: la balancelle qui faisait le service entre Bastia et Toulon le reçoit à son bord. À peine a-t-il quitté son embarcation, (p. 449) qu'elle s'entr'ouvre. Surgi à Bastia le 25 août, il court se cacher au village de Vescovato, chez le vieux Colonna-Ceccaldi. Deux cents officiers le rejoignirent avec le général Franceschetti. Il marche sur Ajaccio: la ville maternelle de Bonaparte seule tenait encore pour son fils; de tout son empire Napoléon ne possédait plus que son berceau. La garnison de la citadelle salue Murat et le veut proclamer roi de Corse: il s'y refuse; il ne trouve d'égal à sa grandeur que le sceptre des Deux-Siciles. Son aide de camp Macirone lui apporte de Paris la décision de l'Autriche en vertu de laquelle il doit quitter le titre de roi et se retirer à volonté dans la Bohême ou la Moldavie. «Il est trop tard, répondit Joachim; mon cher Macirone, le dé en est jeté.» Le 28 septembre. Murat cingle vers l'Italie; sept bâtiments étaient chargés de ses deux cent cinquante serviteurs: il avait dédaigné de tenir à royaume l'étroite patrie de l'homme immense; plein d'espoir, séduit par l'exemple d'une fortune au-dessus de la sienne, il partait de cette île d'où Napoléon était sorti pour prendre possession du monde: ce ne sont pas les mêmes lieux, ce sont les génies semblables qui produisent les mêmes destinées.
Une tempête dispersa la flottille; Murat fut jeté le 8 octobre dans le golfe de Sainte-Euphémie, presque au moment où Bonaparte abordait le rocher de Sainte-Hélène[381].
De ses sept prames, il ne lui en restait plus que deux, y compris la sienne. Débarqué avec une trentaine d'hommes, il essaye de soulever les populations de la côte; les habitants font feu sur sa troupe. Les deux (p. 450) prames gagnent le large; Murat était trahi. Il court à un bateau échoué: il essaye de le mettre à flot; le bateau reste immobile. Entouré et pris, Murat, outragé du même peuple qui se tuait naguère à crier: «Vive le roi Joachim!» est conduit au château de Pizzo. On saisit sur lui et ses compagnons des proclamations insensées: elles montraient de quels rêves les hommes se bercent jusqu'à leur dernier moment.
Tranquille dans sa prison, Murat disait: «Je ne garderai que mon royaume de Naples: mon cousin Ferdinand conservera la seconde Sicile.» Et dans ce moment une commission militaire condamnait Murat à mort. Lorsqu'il apprit son arrêt, sa fermeté l'abandonna quelques instants; il versa des larmes et s'écria: «Je suis Joachim, roi des Deux-Siciles!» il oubliait que Louis XVI avait été roi de France, le duc d'Enghien petit-fils du grand Condé, et Napoléon arbitre de l'Europe: la mort compte pour rien ce que nous fûmes.
Un prêtre est toujours un prêtre, quoi qu'on dise et qu'on fasse; il vient rendre à un cœur intrépide la force défaillie. Le 13 octobre 1815, Murat, après avoir écrit à sa femme, est conduit dans une salle du château de Pizzo, renouvelant dans sa personne romanesque les aventures brillantes ou tragiques du moyen âge. Douze soldats, qui peut-être avaient servi sous lui, l'attendaient disposés sur deux rangs. Murat voit charger les armes, refuse de se laisser bander les yeux, choisit lui-même, en capitaine expérimenté, le poste où les balles le peuvent mieux atteindre.
Couché en joue, au moment du feu, il dit: «Soldats, sauvez le visage; visez au cœur!» Il tombe, tenant (p. 451) dans ses mains les portraits de sa femme et de ses enfants: ces portraits ornaient auparavant la garde de son épée. Ce n'était qu'une affaire de plus que le brave venait de vider avec la vie.
Les genres de mort différents de Napoléon et de Murat conservent les caractères de leur existence.
Murat, si fastueux, fut enterré sans pompe à Pizzo, dans une de ces églises chrétiennes, dont le sein charitable reçoit miséricordieusement toutes les cendres.
Madame Récamier, revenant en France, traversa Rome au moment où le pape y rentrait[382]. Dans une autre partie de ces Mémoires, vous avez conduit Pie VII, mis en liberté à Fontainebleau, jusqu'aux portes de Saint-Pierre. Joachim, encore vivant, allait disparaître, et Pie VII reparaissait. Derrière eux, Napoléon était frappé: la main du conquérant laissait tomber le roi et relevait le pontife.
Pie VII fut reçu avec des cris qui ébranlaient les ruines de la ville des ruines. On détela sa voiture, et la foule le traîna jusqu'aux degrés de l'église des apôtres. Le Saint-Père ne voyait rien, n'entendait rien; ravi en esprit, sa pensée était loin de la terre; sa main se levait seulement sur le peuple par la tendre habitude des bénédictions. Il pénétra dans la basilique au bruit des fanfares, au chant du Te Deum, aux acclamations des Suisses de la religion de Guillaume Tell. Les encensoirs lui envoyaient des parfums qu'il ne respirait pas; il ne voulut point être porté sur le pavois à l'ombre du dais et des palmes; il marcha comme un naufragé accomplissant un vœu à Notre-Dame-de-Bon-Secours, (p. 452) et chargé par le Christ d'une mission qui devait renouveler la face de la terre. Il était vêtu d'une robe blanche; ses cheveux, restés noirs malgré le malheur et les ans, contrastaient avec la pâleur de l'anachorète. Arrivé au tombeau des apôtres, il se prosterna: il demeura plongé, immobile et comme mort, dans les abîmes des conseils de la Providence. L'émotion était profonde, des protestants témoins de cette scène pleuraient à chaudes larmes.
Quel sujet de méditations! Un prêtre infirme, caduc, sans force, sans défense, enlevé du Quirinal, transporté captif au fond des Gaules; un martyr, qui n'attendait plus que sa tombe, délivré des mains de Napoléon qui pressait le globe, reprenant l'empire d'un monde indestructible, quand les planches d'une prison d'outre-mer se préparaient pour ce formidable geôlier des peuples et des rois!
Pie VII survécut à l'empereur; il vit revenir au Vatican les chefs-d'œuvre, amis fidèles qui l'avaient accompagné dans son exil. Au retour de la persécution, le pontife septuagénaire, prosterné sous la coupole de Saint-Pierre, montrait à la fois toute la faiblesse de l'homme et la grandeur de Dieu.
En descendant les Alpes de la Savoie, madame Récamier trouva au Pont-de-Beauvoisin le drapeau blanc et la cocarde blanche. Les processions de la Fête-Dieu, parcourant les villages, semblaient être revenues avec le roi très chrétien. À Lyon, la voyageuse tomba au milieu d'une fête pour la Restauration. L'enthousiasme était sincère. À la tête des réjouissances paraissaient Alexis de Noailles[383] et le colonel Clary, beau-frère de (p. 453) Joseph Bonaparte. Ce qu'on raconte aujourd'hui de la froideur et de la tristesse dont la légitimité fut accueillie à la première Restauration est une impudente menterie. La joie fut générale dans les diverses opinions, même parmi les conventionnels, même parmi les impérialistes, les soldats exceptés; leur noble fierté souffrait de ces revers. Aujourd'hui que le poids du gouvernement militaire ne se sent plus, que les vanités se sont réveillées, il faut nier les faits, parce qu'ils ne s'arrangent pas avec les théories du moment. Il convient à un système que la nation ait reçu les Bourbons avec horreur, et que la Restauration ait été un temps d'oppression et de misère. Cela conduit à de tristes réflexions sur la nature humaine. Si les Bourbons avaient eu le goût et la force d'opprimer, ils se pouvaient flatter de conserver longtemps le trône. Les violences et les injustices de Bonaparte, dangereuses à son pouvoir en apparence, le servirent en effet: on s'épouvante des iniquités, mais on s'en forge une grande idée; on est disposé à regarder comme un être supérieur celui qui se place au-dessus des lois.
Madame de Staël, arrivée à Paris avant madame Récamier, lui avait écrit plusieurs fois; ce billet seul était parvenu à son adresse:
«Je suis honteuse d'être à Paris sans vous, cher ange de ma vie: je vous demande vos projets. Voulez-vous que j'aille au-devant de vous à Coppet, où je vais rester quatre mois? Après tant de souffrances, ma plus douce perspective c'est vous, et mon cœur vous est à jamais dévoué. Un mot sur votre départ et votre arrivée. J'attends ce mot pour savoir ce que je ferai. Je vous écris à Rome, à Naples, etc.»
Madame de Genlis, qui n'avait jamais eu de rapports avec madame Récamier, s'empressa de s'approcher d'elle. Je trouve dans un passage l'expression d'un vœu qui, réalisé, eût épargné au lecteur mon récit.
«11 octobre.
«Voilà, madame, le livre que j'ai eu l'honneur de vous promettre. J'ai marqué les choses que je désire que vous lisiez. . . . . . . . . . . . Venez, madame, pour me conter votre histoire en ces termes, comme on fait dans les romans. Puis ensuite je vous demanderai de l'écrire en forme de souvenirs qui seront remplis d'intérêt, parce que dans la plus grande jeunesse vous avez été jetée, avec une figure ravissante, un esprit plein de finesse et de pénétration, au milieu de ces tourbillons d'erreurs et de folies; que vous avez tout vu, et qu'ayant conservé, durant ces orages, des sentiments religieux, une âme pure, une vie sans tache, un cœur sensible et fidèle à l'amitié, n'ayant ni envie, ni (p. 455) passions haineuses, vous peindrez tout avec les couleurs les plus vraies. Vous êtes un des phénomènes de ce temps-ci, et certainement le plus aimable.
«Vous me montrerez vos souvenirs; ma vieille expérience vous offrira quelques conseils, et vous ferez un ouvrage utile et délicieux. N'allez pas me répondre: Je ne suis pas capable, etc., etc.; je ne vous passerai jamais des lieux communs; ils sont indignes de votre esprit. Vous pouvez jeter sans remords les yeux sur le passé; c'est en tout temps le plus beau des droits; dans celui où nous sommes, c'est inappréciable. Profitez-en pour l'instruction de la jeune personne que vous élevez; ce sera pour elle votre plus grand bienfait.
«Adieu, madame, permettez-moi de vous dire que je vous aime et que je vous embrasse de toute mon âme.»
Maintenant que madame Récamier est rentrée dans Paris[384], je vais retrouver pendant quelque temps mes premiers guides.
La reine de Naples, inquiète des résolutions du congrès de Vienne, écrivit à madame Récamier pour qu'elle lui découvrît un homme capable de traiter ses intérêts à Vienne. Madame Récamier s'adressa à Benjamin Constant, et le pria de rédiger un mémoire. Cette circonstance eut sur l'auteur de ce mémoire l'influence la plus malheureuse; un sentiment orageux fut la suite d'une entrevue. Sous l'empire de ce sentiment, Benjamin Constant, déjà violent antibonapartiste, (p. 456) comme on le voit dans l'Esprit de conquête[385], laissa déborder des opinions dont les événements changèrent bientôt le cours. De là une réputation de mobilité politique funeste aux hommes d'État.
Madame Récamier, tout en admirant Bonaparte, était restée fidèle à sa haine contre l'oppresseur de nos libertés et contre l'ennemi de madame de Staël. Quant à ce qui la regardait elle-même, elle n'y pensait pas et elle eût fait bon marché de son exil. Les lettres que Benjamin Constant lui écrivit à cette époque serviront d'étude sinon du cœur humain, du moins de la tête humaine: on y voit tout ce que pouvait faire d'une passion un esprit ironique et romanesque, sérieux et poétique. Rousseau n'est pas plus véritable, mais il mêle à ses amours d'imagination une mélancolie sincère et une rêverie réelle.
Cependant Bonaparte était descendu à Cannes; la perturbation de son approche commençait à se faire sentir. Benjamin Constant envoya ce billet à madame Récamier:
«Pardon si je profite des circonstances pour vous importuner; mais l'occasion est trop belle. Mon sort sera décidé dans quatre ou cinq jours sûrement; car quoique vous aimiez à ne pas le croire pour diminuer votre intérêt, je suis certainement, avec Marmont, Chateaubriand et Lainé, l'un des quatre hommes les plus compromis de France. Il (p. 457) est donc certain que, si nous ne triomphons pas, je serai dans huit jours ou proscrit et fugitif, ou dans un cachot, ou fusillé. Accordez-moi donc, pendant les deux ou trois jours qui précéderont la bataille, le plus que vous pourrez de votre temps et de vos heures. Si je meurs, vous serez bien aise de m'avoir fait ce bien, et vous seriez fâchée de m'avoir affligé. Mon sentiment pour vous est ma vie: un signe d'indifférence me fait plus de mal que ne pourra le faire dans quatre jours mon arrêt de mort. Et quand je sens que le danger est un moyen d'obtenir de vous un signe d'intérêt, je n'en éprouve que de la joie.
«Avez-vous été contente de mon article, et savez-ce qu'on en dit?»
Benjamin Constant avait raison, il était aussi compromis que moi: attaché à Bernadotte, il avait servi contre Napoléon; il avait publié son écrit De l'esprit de conquête, dans lequel il traitait le tyran plus mal que je ne le traitais dans ma brochure De Bonaparte et des Bourbons. Il mit le comble à ses périls en parlant dans les gazettes.
Le 19 mars, au moment où Bonaparte était aux portes de la capitale, il fut assez ferme pour signer dans le Journal des Débats un article terminé par cette phrase: «Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme, et balbutier des mots profanes pour racheter une vie honteuse[386].»
Benjamin Constant écrivait à celle qui lui avait (p. 458) inspiré ces nobles sentiments: «Je suis bien aise que mon article ait paru; on ne peut au moins en soupçonner aujourd'hui la sincérité. Voici un billet que l'on m'écrit après l'avoir lu: si j'en recevais un pareil d'une autre, je serais gai sur l'échafaud.»
Madame Récamier s'est toujours reprochée d'avoir eu, sans le vouloir, une pareille influence sur une destinée honorable. Rien, en effet, n'est plus malheureux que d'inspirer à des caractères mobiles ces résolutions énergiques qu'ils sont incapables de tenir.
Benjamin Constant démentit le 20 mars son article du 19. Après avoir fait quelques tours de roues pour s'éloigner, il revint à Paris et se laissa prendre aux séductions de Bonaparte[387]. Nommé conseiller d'État, il effaça ses pages généreuses en travaillant à la rédaction de l'Acte additionnel[388].

Madame de Genlis.
Depuis ce moment il porta au cœur une plaie secrète; il n'aborda plus avec assurance la pensée de la postérité; sa vie attristée et défleurie n'a pas peu contribué à sa mort. Dieu nous garde de triompher des misères dont les natures les plus élevées ne sont point exemptes! Le ciel ne nous donne des talents qu'en y attachant des infirmités: expiations offertes à la sottise et à l'envie. Les faiblesses d'un homme (p. 459) supérieur sont ces victimes noires que l'antiquité sacrifiait aux dieux infernaux, et pourtant ils ne se laissent jamais désarmer.
Madame Récamier était restée en France pendant les Cent-Jours, où la reine Hortense l'invitait à demeurer; la reine de Naples lui offrait, au contraire, un asile en Italie. Les Cent-Jours passèrent. Madame de Krüdener[389] suivit les alliés, arrivés de nouveau à Paris. Elle était tombée du roman dans le mysticisme; elle exerçait un grand empire sur l'esprit de l'empereur de Russie.
Madame de Krüdener logeait dans un hôtel du faubourg Saint-Honoré. Le jardin de cet hôtel s'étendait jusqu'aux Champs-Élysées. Alexandre arrivait incognito par une porte du jardin, et des conversations politico-religieuses finissaient par de ferventes prières. Madame de Krüdener m'avait invité à l'une de ces sorcelleries célestes: moi, l'homme de toutes les chimères, j'ai la haine de la déraison, l'abomination du nébuleux et le dédain des jongleries; on n'est pas parfait. La scène m'ennuya; plus je voulais prier, plus je sentais la sécheresse de mon âme. Je ne trouvais rien à dire à Dieu, et le diable me poussait à rire. J'avais mieux aimé madame de Krüdener lorsque, environnée de fleurs et habitante encore de cette chétive terre, elle composait Valérie. Seulement, je trouvais que mon vieil ami M. Michaud, mêlé bizarrement à cette idylle, n'avait pas assez du berger, malgré son nom. Madame de Krüdener, devenue (p. 460) séraphin, cherchait à s'entourer d'anges; la preuve en est dans ce billet charmant de Benjamin Constant à madame Récamier:
«Jeudi.
«Je m'acquitte avec un peu d'embarras d'une commission que madame de Krüdener vient de me donner. Elle vous supplie de venir la moins belle que vous pourrez. Elle dit que vous éblouissez tout le monde, et que par là toutes les âmes sont troublées et toutes les attentions impossibles. Vous ne pouvez pas déposer votre charme; mais ne le rehaussez pas. Je pourrais ajouter bien des choses sur votre figure à cette occasion, mais je n'en ai pas le courage. On peut être ingénieux sur le charme qui plaît, mais non sur celui qui tue. Je vous verrai tout à l'heure; vous m'avez indiqué cinq heures, mais vous ne rentrerez qu'à six, et je ne pourrai vous dire un mot. Je tâcherai pourtant d'être aimable encore cette fois.»
Le duc de Wellington ne prétendait-il pas aussi à l'honneur d'attirer un regard de Juliette? Un de ses billets que je transcris n'a de curieux que la signature:
«À Paris, ce 13 janvier.
«J'avoue, madame, que je ne regrette pas beaucoup que les affaires m'empêchent de passer chez vous après dîner, puisque, à chaque fois que je vous vois, je vous quitte plus pénétré de vos agréments et moins disposé à donner mon attention à la politique!!!»
(p. 461) «Je passerai chez vous demain à mon retour de chez l'abbé Sicard, en cas que vous vous y trouvassiez et malgré l'effet que ces visites dangereuses produisent sur moi.
«Votre très fidèle serviteur,
«Wellington.»
À son retour de Waterloo, entrant chez madame Récamier, le duc de Wellington s'écria: «Je l'ai bien battu!» Dans un cœur français, son succès lui aurait fait perdre la victoire, eût-il pu jamais y prétendre.
Ce fut à une douloureuse époque pour l'illustration de la France que je retrouvai madame Récamier; ce fut à l'époque de la mort de madame de Staël. Rentrée à Paris après les Cent-Jours, l'auteur de Delphine était redevenue souffrante; je l'avais revue chez elle et chez madame la duchesse de Duras. Peu à peu, son état empirant, elle fut obligée de garder le lit. Un matin, j'étais allé chez elle rue Royale; les volets des fenêtres étaient aux deux tiers fermés; le lit, rapproché du mur du fond de la chambre, ne laissait qu'une ruelle à gauche; les rideaux, retirés sur les tringles, formaient deux colonnes au chevet. Madame de Staël, à demi assise, était soutenue par des oreillers. Je m'approchai, et quand mon œil se fut un peu accoutumé à l'obscurité, je distinguai la malade. Une fièvre ardente animait ses joues. Son beau regard me rencontra dans les ténèbres, et elle me dit: «Bonjour, my dear Francis. Je souffre, mais cela ne (p. 462) m'empêche pas de vous aimer.» Elle étendit sa main que je pressai et baisai. En relevant la tête, j'aperçus au bord opposé de la couche, dans la ruelle, quelque chose qui se levait blanc et maigre: c'était M. de Rocca, le visage défait, les joues creuses, les yeux brouillés, le teint indéfinissable; il se mourait; je ne l'avais jamais vu, et ne l'ai jamais revu. Il n'ouvrit pas la bouche; il s'inclina, en passant devant moi; on n'entendait point le bruit de ses pas: il s'éloigna à la manière d'une ombre. Arrêtée un moment à la porte, la nueuse idole frôlant les doigts se retourna vers le lit pour ajourner madame de Staël. Ces deux spectres qui se regardaient en silence, l'un debout et pâle, l'autre assis et coloré d'un sang prêt à redescendre et à se glacer au cœur, faisaient frissonner.
Peu de jours après, madame de Staël changea de logement. Elle m'invita à dîner chez elle, rue Neuve-des-Mathurins: j'y allai; elle n'était point dans le salon et ne put même assister au dîner; mais elle ignorait que l'heure fatale était si proche. On se mit à table. Je me trouvai assis auprès de madame Récamier. Il y avait douze ans que je ne l'avais rencontrée, et encore ne l'avais-je aperçue qu'un moment. Je ne la regardais point, elle ne me regardait pas; nous n'échangions pas une parole. Lorsque, vers la fin du dîner, elle m'adressa timidement quelques paroles sur la maladie de madame de Staël, je tournai un peu la tête et je levai les yeux. Je craindrais de profaner aujourd'hui par la bouche de mes années, un sentiment qui conserve dans ma mémoire toute sa jeunesse, et dont le charme s'accroît à mesure que (p. 463) ma vie se retire. J'écarte mes vieux jours pour découvrir derrière ces jours des apparitions célestes, pour entendre du bas de l'abîme les harmonies d'une région plus heureuse.
Madame de Staël mourut[390]. Le dernier billet qu'elle écrivit à madame de Duras était tracé en grandes lettres dérangées comme celles d'un enfant. Un mot affectueux s'y trouvait pour Francis. Le talent qui expire saisit davantage que l'individu qui meurt: c'est une désolation générale dont la société est frappée; chacun au même moment fait la même perte.
Avec madame de Staël s'abattit une partie considérable du temps où j'avais vécu: telles de ces brèches, qu'une intelligence supérieure en tombant forme dans un siècle, ne se referment jamais. Sa mort fit sur moi une impression particulière, à laquelle se mêlait une sorte d'étonnement mystérieux: c'était chez cette femme illustre que j'avais connu madame Récamier, et, après de longs jours de séparation, madame de Staël réunissait deux personnes voyageuses devenues presque étrangères l'une à l'autre: elle leur laissait à un repas funèbre son souvenir et l'exemple de son attachement immortel.
J'allai voir madame Récamier rue Basse-du-Rempart, et ensuite rue d'Anjou. Quand on s'est rejoint à sa destinée, on croit ne l'avoir jamais quittée: la vie, selon l'opinion de Pythagore, n'est qu'une réminiscence. Qui, dans le cours de ses jours, ne se remémore quelques petites circonstances indifférentes à tous, hors à celui qui se les rappelle? À la (p. 464) maison de la rue d'Anjou il y avait un jardin, dans ce jardin un berceau de tilleuls, entre les feuilles desquels j'apercevais un rayon de lune, lorsque j'attendais madame Récamier: ne me semble-t-il pas que ce rayon est à moi, et que si j'allais sous les mêmes abris, je le retrouverais? Je ne me souviens guère du soleil que j'ai vu briller sur bien des fronts.
J'étais au moment d'être obligé de vendre la Vallée-aux-Loups, que madame Récamier avait louée, de moitié avec M. de Montmorency.
De plus en plus éprouvée par la fortune, madame Récamier se retira bientôt à l'Abbaye-aux-Bois[391].
La duchesse d'Abrantès parle ainsi de cette demeure:
«L'Abbaye-aux-Bois avec toutes ses dépendances, ses beaux jardins, ses vastes cloîtres dans lesquels jouaient de jeunes filles de tous les âges, au regard insoucieux, à la parole folâtre, l'Abbaye-aux-Bois n'était connue que comme une sainte demeure à laquelle une famille pouvait confier son espoir; encore ne l'était-elle que par les mères ayant un intérêt au delà de sa haute muraille. Mais, une fois que la sœur Marie avait fermé la petite porte surmontée d'un attique, limite du saint domaine, on traversait la grande cour qui sépare le couvent de (p. 465) la rue, non-seulement comme un terrain neutre, mais étranger.
«Aujourd'hui il n'en va pas ainsi: le nom de l'Abbaye-aux-Bois est devenu populaire; sa renommée est générale et familière à toutes les classes. La femme qui y vient pour la première fois en disant à ses gens: «À l'Abbaye-aux-Bois,» est sûre de n'être pas questionnée par eux pour savoir de quel côté ils doivent tourner. . . . . . .
«D'où lui est venue, en aussi peu de temps, une renommée si positive, une illustration si connue? Voyez-vous deux petites fenêtres tout en haut, dans les combles, là, au-dessus des larges fenêtres du grand escalier? c'est une des petites chambres de la maison. Eh bien! c'est pourtant dans son enceinte que la renommée de l'Abbaye-aux-Bois a pris naissance, c'est de là qu'elle est descendue, qu'elle est devenue populaire. Et comment ne l'aurait-elle pas été lorsque toutes les classes de la société savaient que dans cette chambre habitait un être dont la vie était déshéritée de toutes les joies, et qui néanmoins avait des paroles consolantes pour tous les chagrins, des mots magiques pour adoucir toutes les douleurs, des secours pour toutes les infortunes?
«Lorsque du fond de sa prison Coudert[392] entrevit l'échafaud, quelle fut la pitié qu'il invoqua? «Va (p. 466) chez madame Récamier, dit-il à son frère, dis-lui que je suis innocent devant Dieu... elle comprendra ce témoignage...» et Coudert fut sauvé. Madame Récamier, associa à son action libérale cet homme qui possède en même temps le talent et la bonté: M. Ballanche seconda ses démarches, et l'échafaud dévora une victime de moins.
«C'était presque une merveille présentée à l'étude de l'esprit humain que cette petite cellule dans laquelle une femme, dont la réputation est plus qu'européenne, était venue chercher du repos et un asile convenable. Le monde est ordinairement oublieux de ceux qui ne le convient plus à leurs festins; il ne le fut pas pour celle qui, jadis, au milieu de ses joies, écoutait encore plus une plainte que l'accent du plaisir. Non-seulement la petite (p. 467) chambre du troisième de l'Abbaye-aux-Bois fut toujours le but des courses des amis de madame Récamier, mais, comme si le prestigieux pouvoir d'une fée eût adouci la raideur de la montée, ces mêmes étrangers, qui réclamaient comme une faveur d'être admis dans l'élégant hôtel de la Chaussée-d'Antin, sollicitaient encore la même grâce. C'était pour eux un spectacle vraiment aussi remarquable qu'aucune rareté de Paris, de voir, dans un espace de dix pieds sur vingt, toutes les opinions, réunies sous une même bannière, marcher en paix et se donner presque la main. Le vicomte de Chateaubriand racontait à Benjamin Constant les merveilles inconnues de l'Amérique. Mathieu de Montmorency, avec cette urbanité personnelle à lui-même, cette politesse chevaleresque de tout ce qui porte son nom, était aussi respectueusement attentif pour madame Bernadotte allant régner en Suède, qu'il l'aurait été pour la sœur d'Adélaïde de Savoie, fille d'Humbert aux Blanches-Mains, cette veuve de Louis le Gros qui avait épousé un de ses ancêtres. Et l'homme des temps féodaux n'avait aucune parole amère pour l'homme des jours libres.
«Assises à côté l'une de l'autre sur le même divan, la duchesse du faubourg Saint-Germain devenait polie pour la duchesse impériale; rien n'était heurté dans cette cellule unique. Lorsque je revis madame Récamier dans cette chambre, je revenais à Paris, d'où j'avais été longtemps absente. C'était un service que j'avais à lui demander, et j'allais à elle avec confiance. Je savais bien par des amis communs à quel degré de force s'était porté son (p. 468) courage; mais j'en manquais en la voyant là, sous les combles, aussi paisible, aussi calme que dans les salons dorés de la rue du Mont-Blanc.
«Eh quoi! me dis-je, toujours des souffrances! Et mon œil humide s'arrêtait sur elle avec une expression qu'elle dut comprendre. Hélas! mes souvenirs franchissaient les années, ressaisissaient le passé! Toujours battue de l'orage, cette femme, que la renommée avait placée tout en haut de la couronne de fleurs du siècle, depuis dix ans voyait sa vie entourée de douleurs, dont le choc frappait à coups redoublés sur son cœur et la tuait!...
«Lorsque, guidée par d'anciens souvenirs et un attrait constant, je choisis l'Abbaye-aux-Bois pour mon asile, la petite chambre du troisième n'était plus habitée par celle que j'aurais été y chercher: madame Récamier occupait alors un appartement plus spacieux. C'est là que je l'ai vue de nouveau. La mort avait éclairci les rangs des combattants autour d'elle, et, de tous ces champions politiques, M. de Chateaubriand était, parmi ses amis, presque le seul qui eût survécu. Mais vint à sonner aussi pour lui l'heure des mécomptes et de l'ingratitude royale. Il fut sage; il dit adieu à ces faux semblants de bonheur et abandonna l'incertaine puissance tribunitienne pour en ressaisir une plus positive.
«On a déjà vu que dans ce salon de l'Abbaye-aux-Bois il s'agite d'autres intérêts que des intérêts littéraires, et que ceux qui souffrent peuvent tourner vers lui un regard d'espérance. Dans l'occupation constante où je suis, depuis quelques mois, de (p. 469) ce qui a rapport à la famille de l'empereur, j'ai trouvé quelques documents qui ne me paraissent pas hors d'œuvre en ce moment.
«La reine d'Espagne se trouvait dans l'obligation absolue de rentrer en France. Elle écrivit à madame Récamier pour la prier de s'intéresser à la demande qu'elle faisait de venir à Paris. M. de Chateaubriand était alors au ministère, et la reine d'Espagne, connaissant la loyauté de son caractère, avait toute confiance dans la réussite de sa sollicitation. Cependant la chose était difficile, parce qu'il y avait une loi qui frappait toute cette famille malheureuse, même dans ses membres les plus vertueux. Mais M. de Chateaubriand avait en lui ce sentiment d'une noble pitié pour le malheur, qui lui fit écrire plus tard ces mots touchants:
Sur le compte des grands je ne suis pas suspect:
Leurs malheurs seulement attirent mon respect.
Je hais ce Pharaon, que l'éclat environne;
Mais s'il tombe, à l'instant j'honore sa couronne;
Il devient, à mes yeux, roi par l'adversité;
Des pleurs je reconnais l'auguste autorité:
Courtisan du malheur, etc., etc.[393].
«M. de Chateaubriand écouta les intérêts d'une personne malheureuse; il interrogea son devoir, qui ne lui imposa pas la crainte de redouter une faible femme, et, deux jours après la demande qui lui fut adressée, il écrivit à madame Récamier que madame Joseph Bonaparte pouvait rentrer en France, (p. 470) demandant où elle était, afin de lui adresser par M. Durand de Mareuil, notre ministre alors à Bruxelles, la permission de venir à Paris sous le nom de la comtesse de Villeneuve. Il écrivit en même temps à M. de Fagel.
«J'ai rapporté ce fait avec d'autant plus de plaisir qu'il honore à la fois celle qui demande et le ministre qui oblige: l'une par sa noble confiance, l'autre par sa noble humanité[394].»
Madame d'Abrantès loue beaucoup trop ma conduite, qui ne valait même pas la peine d'être remarquée; mais, comme elle ne raconte pas tout sur l'Abbaye-aux-Bois, je vais suppléer à ce qu'elle a oublié ou omis.
Le capitaine Roger[395], autre Coudert, avait été condamné à mort. Madame Récamier m'avait associé à son œuvre pie pour le sauver. Benjamin Constant était également intervenu en faveur de ce compagnon de Caron, et il avait remis au frère du condamné la lettre suivante pour madame Récamier:
«Je ne me pardonnerais pas, madame, de vous importuner toujours, mais ce n'est pas ma faute s'il y a sans cesse des condamnations à mort. Cette (p. 471) lettre vous sera remise par le frère du malheureux Roger, condamné avec Caron. C'est l'histoire la plus odieuse et la plus connue. Le nom seul mettra M. de Chateaubriand au fait. Il est assez heureux pour être à la fois le premier talent du ministère et le seul ministre sous lequel le sang n'ait pas coulé. Je n'ajoute rien; je m'en remets à votre cœur. Il est bien triste de n'avoir presque à vous écrire que pour des affaires douloureuses; mais vous me pardonnez, je le sais, et je suis sûr que vous ajouterez un malheureux de plus à la nombreuse liste de ceux que vous avez sauvés.
«Mille tendres respects.
«B. Constant.
«Paris, 1er mars 1823.»
Quand le capitaine Roger fut mis en liberté, il s'empressa de témoigner sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. Un après-dîner j'étais chez madame Récamier, comme de coutume: tout à coup apparaît cet officier. Il nous dit, avec un accent du Midi: «Sans votre intercession, ma tête roulait sur l'échafaud.» Nous étions stupéfaits, car nous avions oublié nos mérites; il s'écriait, rouge comme un coq: «Vous ne vous souvenez pas?... Vous ne vous souvenez pas?...» Nous faisions vainement mille excuses de notre peu de mémoire: il partit, entre-choquant les éperons de ses bottes, furieux de ce que nous ne nous souvenions pas de notre bonne action, comme s'il eût eu à nous reprocher sa mort.
Vers cette époque, Talma demanda à madame Récamier à me rencontrer chez elle pour s'entendre avec (p. 472) moi sur quelques vers de l'Othello de Ducis, qu'on ne lui permettait pas de dire tels qu'ils étaient. Je laissai les dépêches et je courus au rendez-vous; je passai la soirée à refaire avec le moderne Roscius les vers malencontreux: il me proposait un changement, je lui en proposais un autre; nous rimions à l'envi; nous nous retirions à la croisée ou dans un coin pour tourner et retourner un hémistiche. Nous eûmes beaucoup de peine à tomber d'accord pour le sens ou pour l'harmonie. Il eût été assez curieux de me voir, moi, ministre de Louis XVIII, lui, Talma, roi de la scène, oubliant ce que nous pouvions être, jouter de verve en donnant au diable la censure et toutes les grandeurs du monde. Mais si Richelieu faisait représenter ses drames en lâchant Gustave-Adolphe sur l'Allemagne, ne pouvais-je pas, humble secrétaire d'État, m'occuper des tragédies des autres en allant chercher l'indépendance de la France à Madrid?
Madame la duchesse d'Abrantès, dont j'ai salué le cercueil dans l'église de Chaillot, n'a peint que la demeure habitée de madame Récamier; je parlerai de l'asile solitaire. Un corridor noir séparait deux petites pièces. Je prétendais que ce vestibule était éclairé d'un jour doux. La chambre à coucher était ornée d'une bibliothèque, d'une harpe, d'un piano, du portrait de madame de Staël et d'une vue de Coppet au clair de lune; sur les fenêtres étaient des pots de fleurs. Quand, tout essoufflé après avoir grimpé trois étages, j'entrais dans la cellule aux approches du soir, j'étais ravi: la plongée des fenêtres était sur le jardin de l'Abbaye, dans la corbeille verdoyante duquel tournoyaient des religieuses et couraient des pensionnaires. (p. 473) La cime d'un acacia arrivait à la hauteur de l'œil. Des clochers pointus coupaient le ciel, et l'on apercevait à l'horizon les collines de Sèvres. Le soleil mourant dorait le tableau et entrait par les fenêtres ouvertes. Madame Récamier était à son piano; l'angelus tintait: les sons de la cloche, «qui semblait pleurer le jour qui se mourait, il giorno pianger che si muore,» se mêlaient aux derniers accents de l'invocation à la nuit de Roméo et Juliette, de Steibelt[396]. Quelques oiseaux se venaient coucher dans les jalousies relevées de la fenêtre; je rejoignais au loin le silence et la solitude, par-dessus le tumulte et le bruit d'une grande cité.
Dieu, en me donnant ces heures de paix, me dédommageait de mes heures de trouble; j'entrevoyais le prochain repos que croit ma foi, que mon espérance appelle. Agité au dehors par les occupations politiques ou dégoûté par l'ingratitude des cours, la placidité du cœur m'attendait au fond de cette retraite, comme le frais des bois au sortir d'une plaine brûlante. Je retrouvais le calme auprès d'une femme, de qui la sérénité s'étendait autour d'elle, sans que cette sérénité eût rien de trop égal, car elle passait au travers (p. 474) d'affections profondes. Hélas! les hommes que je rencontrais chez madame Récamier, Mathieu de Montmorency, Camille Jordan, Benjamin Constant, le duc de Laval, ont été rejoindre Hingant, Joubert, Fontanes, autres absents d'une autre société absente. Parmi ces amitiés successives se sont élevés de jeunes amis, rejetons printaniers d'une vieille forêt où la coupe est éternelle. Je les prie, je prie M. Ampère, qui lira ceci quand j'aurai disparu, je leur demande à tous de me conserver quelque souvenir: je leur remets le fil de la vie dont Lachésis laisse échapper le bout sur mon fuseau. Mon inséparable camarade de route, M. Ballanche, s'est trouvé seul au commencement et à la fin de ma carrière; il a été témoin de mes liaisons rompues par le temps, comme j'ai été témoin des siennes entraînées par le Rhône: les fleuves minent toujours leurs bords.
Le malheur de mes amis a souvent penché sur moi, et je ne me suis jamais dérobé au fardeau sacré: le moment de la rémunération est arrivé; un attachement sérieux daigne m'aider à supporter ce que leur multitude ajoute de pesanteur à des jours mauvais. En approchant de ma fin, il me semble que tout ce qui m'a été cher m'a été cher dans madame Récamier, et qu'elle était la source cachée de mes affections. Mes souvenirs de divers âges, ceux de mes songes comme ceux de mes réalités, se sont pétris, mêlés, confondus, pour faire un composé de charmes et de douces souffrances dont elle est devenue la forme visible. Elle règle mes sentiments, de même que l'autorité du ciel a mis le bonheur, l'ordre et la paix dans mes devoirs.
(p. 475) Je l'ai suivie, la voyageuse, par le sentier qu'elle a foulé à peine; je la devancerai bientôt dans une autre patrie. En se promenant au milieu de ces Mémoires, dans les détours de la basilique que je me hâte d'achever, elle pourra rencontrer la chapelle qu'ici je lui dédie; il lui plaira peut-être de s'y reposer: j'y ai placé son image.[Lien vers la Table des Matières]
L'écrit de Chateaubriand était au moment de paraître quand l'ordonnance du 5 septembre fut publiée au Moniteur. L'auteur y ajouta un post-scriptum. Il rapprochait les considérants de l'ordonnance du 5 septembre 1816 de ceux de l'ordonnance du 13 juillet 1815, et faisait ressortir les contrastes et les contradictions que renfermaient ces deux ordonnances, dont l'une proclamait la nécessité de réviser la Charte, l'autre celle de la maintenir telle qu'elle était. Puis, pour prévenir le parti que les ministres pourraient tirer du nom du Roi dans les élections, il donnait à entendre que le ministère avait surpris la bonne foi du monarque; que celui-ci ne partageait pas les passions de son entourage contre une Chambre à laquelle il avait lui-même décerné le titre de Chambre introuvable, et que, s'il avait consenti à la dissolution, c'était «parce qu'il avait jugé (p. 478) que la France satisfaite lui renverrait les députés dont il était si satisfait».
Ce post-scriptum blessa profondément le roi; il irrita surtout très vivement les ministres et en particulier le comte Decazes, ministre de la police générale. M. Decazes, malgré l'avis contraire du duc de Richelieu, président du Conseil, résolut de procéder à des poursuites, que légitimait d'ailleurs une imprudence grave commise par l'imprimeur M. Le Normant. Ce dernier avait envoyé un assez grand nombre d'exemplaires dans les départements et même en avait laissé circuler quelques-uns à Paris avant de faire le dépôt légal, la contravention était formelle et, aux termes mêmes de la loi, il y avait lieu à saisie et séquestre. En conséquence, le 18 septembre, à dix heures du matin, une descente de police avait lieu chez M. Le Normant; déjà les scellés étaient apposés sur les volumes, les feuilles et les formes, lorsque Chateaubriand, prévenu en toute hâte, arriva. Les ouvriers l'entourent et lui font une ovation. Aux cris de: Vive M. de Chateaubriand! Vive le Roi! Vive la liberté de la presse! ils brisent les scellés et arrachent aux officiers de paix et aux inspecteurs de police les objets saisis et séquestrés. En vain le commissaire met M. Le Normant en demeure de faire rentrer ses ouvriers dans les ateliers. Chateaubriand, élevant fortement la voix, fait entendre cette protestation: «Je suis pair de France. Je ne connais point l'ordre du ministre. Je m'oppose, au nom de la Charte dont je suis le défenseur, et dont tout citoyen peut réclamer la protection, je m'oppose à l'enlèvement de mon ouvrage. Je défends le transport de ces feuilles. Je ne me rendrai qu'à la force, que lorsque je verrai la gendarmerie.» Elle parut bientôt. Chateaubriand se retira dans les appartements de M. Le Normant et y rédigea aussitôt la lettre suivante, adressée à M. le comte Decazes:
(p. 479) Paris, le 18 septembre 1816.
Monsieur le comte,
J'ai été chez vous pour vous témoigner ma surprise. J'ai trouvé à midi chez M. Le Normant, mon libraire, des hommes qui m'ont dit être envoyés par vous pour saisir mon ouvrage intitulé: De la Monarchie selon la Charte.
Ne voyant pas d'ordre écrit, j'ai déclaré que je ne souffrirais pas l'enlèvement de ma propriété, à moins que des gens d'armes ne la saisissent de force. Des gens d'armes sont arrivés, et j'ai ordonné à mon libraire de laisser enlever l'ouvrage.
Cet acte de déférence à l'autorité, Monsieur le comte, n'a pas pu me laisser oublier ce que je devais à ma dignité de pair. Si j'avais pu n'apercevoir que mon intérêt personnel, je n'aurais fait aucune démarche; mais les droits de la pensée étant compromis, j'ai dû protester, et j'ai l'honneur de vous adresser copie de ma protestation. Je réclame, à titre de justice, mon ouvrage; et ma franchise doit ajouter que, si je ne l'obtiens pas, j'emploierai tous les moyens que les lois politiques et civiles mettent en mon pouvoir.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Vte de Chateaubriand.
Dans sa réponse, M. Decazes fit observer que la saisie avait été faite en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 21 octobre 1814; qu'elle avait été faite régulièrement, le commissaire de police et les officiers de paix étant porteurs d'un ordre signé d'un ministre du Roi; que la qualité de pair dont était revêtu l'auteur ne pouvait l'affranchir de l'exécution des lois et du respect dû par tous les citoyens aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leur charge; qu'elle ne pouvait surtout légitimer de sa part et de celle de ses ouvriers un acte de révolte ouverte contre un commissaire de police et des officiers constitués par le Roi, revêtus des marques distinctives de leurs fonctions et agissant en vertu d'ordres légaux. Il terminait en disant que si la dignité de pair avait été compromise dans cette circonstance, ce n'était pas par lui, M. Decazes.
À cette lettre du ministre de la police, Chateaubriand fit sur le champ cette réponse:
(p. 480) Paris, ce 19 Septembre 1816.
Monsieur le comte,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 de ce mois. Elle ne répond point à la mienne du même jour.
Vous me parlez d'écrits clandestinement publiés (à la face du soleil, avec mon nom et mes titres). Vous parlez de révolte et de rébellion, et il n'y a eu ni révolte ni rébellion. Vous dites qu'on a crié: Vive le Roi! Ce cri n'est pas encore compris dans la loi des cris séditieux, à moins que la police n'en ait ordonné autrement que les Chambres. Au reste, tout cela s'éclaircira en temps et lieu. On n'affectera plus de confondre la cause du libraire et la mienne; nous saurons si, dans un gouvernement libre, un ordre de la police, que je n'ai pas même vu, est une loi pour un pair de France; nous saurons si l'on n'a pas violé envers moi tous les droits qui me sont garantis par la Charte, et comme citoyen et comme pair. Nous saurons, par les lois mêmes que vous avec l'extrême bonté de me citer (il est vrai avec un peu d'inexactitude), si je n'ai pas le droit de publier mes opinions; nous saurons enfin si la France doit désormais être gouvernée par la police ou par la Constitution.
Quant à mon respect et à mon dévouement pour le Roi, Monsieur le comte, je ne puis recevoir de leçon et je pourrais servir d'exemple. Quant à ma dignité de pair, je la ferai respecter aussi bien que ma dignité d'homme; et je savais parfaitement, avant que vous prissiez la peine de m'en instruire, qu'elle ne sera jamais compromise par vous ni par qui que ce soit. Je vous ai demandé la restitution de mon ouvrage: puis-je espérer qu'il me sera rendu? Voilà dans ce moment, toute la question.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur le comte, votre très humble et très obéissant serviteur.
Vte de Chateaubriand.
Dès le 18 septembre, en même temps qu'il avait adressé sa première lettre à M. Decazes, il en avait écrit une autre à M. le chancelier Dambray, président de la chambre des pairs:
Paris, ce 18 septembre 1816.
Monsieur le Chancelier,
J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la protestation que j'ai faite et de la lettre que je viens d'écrire à M. le ministre de la police.
(p. 481) N'est-il pas étrange, monsieur le chancelier, qu'on enlève en plein jour, à main armée, malgré mes protestations, l'ouvrage d'un pair de France, signé de son nom, imprimé publiquement à Paris, comme on aurait enlevé un écrit séditieux et clandestin, le Nain-Jaune ou le Nain-Tricolore? Outre ce que l'on devait à ma prérogative comme pair de France, j'ose dire, Monsieur le chancelier, que je méritais personnellement un peu plus d'égards. Si mon ouvrage était coupable, il fallait me traduire devant les tribunaux compétents: j'aurais répondu.
J'ai protesté pour l'honneur de la pairie, et je suis déterminé à suivre cette affaire avec la dernière rigueur. Je réclame, Monsieur le chancelier, votre appui comme président de la Chambre des pairs, et votre autorité comme chef de la justice.
Je suis, avec un profond respect, etc.
Vicomte De Chateaubriand.
Dans la forme M. Decazes avait raison. Il n'avait fait, après tout, qu'user du droit que lui conférait la loi du 21 octobre 1814, laquelle disait en termes exprès: «Nul imprimeur ne peut mettre en vente un ouvrage, ou le publier de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires.—Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage si l'imprimeur ne représente pas les récépissés du dépôt.» La mesure de police prise par le ministre était donc légale, mais elle était à coup sûr intempestive; prise contre un homme tel que Chateaubriand, elle était maladroite. Ainsi en avait jugé le duc de Richelieu, qui avait déconseillé les poursuites demandées par son collègue. Il avait fait remarquer qu'il était contraire à la dignité du gouvernement de supprimer la contradiction; que, d'ailleurs, l'apparence de la persécution aurait uniquement pour effet de donner plus de vogue à l'ouvrage incriminé. «J'aime mieux, disait-il spirituellement, que l'ouvrage se vende deux francs qu'un louis.» Il fit abandonner l'instruction que le parquet avait commencée sur l'ordre de M. Decazes. On imprima une nouvelle édition du livre saisi, on satisfit cette fois à toutes les formalités légales, et l'écrit de Chateaubriand, qui était (p. 482) d'ailleurs un chef-d'œuvre, se répandit dans la France entière. La monarchie selon la Charte le plaçait au premier rang de nos publicistes, mais il ne laissa pas de payer cher cette gloire ajoutée à tant d'autres dont son front était déjà couronné. Le 20 septembre 1816, parut dans le Moniteur l'ordonnance qui le rayait de la liste des ministres d'État. Cette décision lui enlevait un traitement de 24,000 francs.[Lien vers la Table des Matières]
Au tome II de son roman des Misérables, Victor Hugo a réuni sous ce titre: l'Année 1817, un grand nombre de petits faits habillement choisis pour rendre Louis XVIII et son gouvernement ridicules et odieux. Chateaubriand obligé de vendre ses livres à la criée, à la salle Sylvestre, voilà un petit fait, qui méritait peut-être d'être rappelé. Le poète l'a passé sous silence. Il a cependant parlé de Chateaubriand, mais c'est uniquement pour nous le montrer en déshabillé du matin. «Chateaubriand, dit-il, debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue Saint-Dominique, en pantalon à pied et en pantoufles, ses cheveux gris coiffés d'un madras, les yeux fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgien-dentiste ouverte devant lui, se curait les dents, qu'il avait charmantes, tout en dictant la Monarchie selon la Charte à M. Pilorge, son secrétaire.» Singulière fantaisie, il faut en convenir que celle de Chateaubriand s'amusant à dicter, tout en se curant les dents, des pages depuis longtemps imprimées; ou plutôt ignorance singulière de Victor Hugo, qui aurait dû savoir, ce qui est partout—dans toutes les (p. 483) histoires de la Restauration, dans les Mémoires d'Outre-tombe, dans la préface et le post-scriptum de la Monarchie selon la Charte,—que la publication de cet écrit avait eu lieu, non en 1817, mais au lendemain même de l'ordonnance du 5 septembre 1816.
Ce n'est pas du reste la seule inexactitude que renferment les quatre lignes de Victor Hugo. En 1817, Chateaubriand ne demeurait pas rue Saint-Dominique, mais bien rue de l'Université, no 25. En 1818, il échangea le ruisseau de la rue de l'Université contre celui de la rue du Bac, si cher à son amie Mme de Staël[399], et il habita pendant deux ans le no 42 de cette dernière rue; en 1820 seulement il se transporta au no 27 de la rue Saint-Dominique-Saint-Germain. On peut suivre, dans les volumes successifs de l'Almanach royal, ce petit itinéraire de Chateaubriand à Paris.
Et puisque nous voilà sur le chapitre de l'année 1817, je signalerai un autre petit fait, qui présente celui-là, si je ne m'abuse, un véritable intérêt.
Joseph de Maistre n'est pas nommé une seule fois dans les Mémoires d'Outre-tombe. Est-ce donc que l'auteur du Génie du christianisme et l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg n'ont jamais eu aucuns rapports ensemble? Est-ce qu'ils ne se sont jamais vus? Est-ce qu'ils ne se sont jamais écrit? Dans la Correspondance du comte Joseph de Maistre, on trouve des lettres au vicomte de Bonald, à l'abbé de La Mennais, au comte de Marcellus[400],—ou des réponses de Bonald, de La Mennais, de Lamartine: de lettres adressées à Chateaubriand, ou écrites par lui, nulle (p. 484) trace. Et cependant il y a dans la Correspondance de Joseph de Maistre une très longue et très belle lettre de lui écrite à Chateaubriand au mois d'octobre 1817; le malheur est qu'elle a été donnée par les éditeurs avec cette suscription: À M. le vicomte de Bonald[401]. Les éditeurs ici se sont trompés: c'est au vicomte de Chateaubriand que la lettre a été écrite. Voici, en effet, que parmi les autographes figurant, avec fac-similé, au Catalogue de la collection Bovet[402], je trouve une lettre de trois pages et quart, in-4o, écrite par Chateaubriand à Joseph de Maistre et datée de Montgraham, par Nogent-le-Rotrou, 6 septembre 1817. Il le prie d'excuser le retard de ses réponses, après trois mois d'angoisses et de craintes pour la vie de Mme de Chateaubriand:
Je vais Monsieur le comte, lire votre manuscrit, mais vous croyez bien que je n'aurai pas l'impertinence d'y rien trouver à changer. Ce n'est point à l'écolier à toucher au tableau du maître...
Voyons maintenant la lettre de Joseph de Maistre:
Monsieur le vicomte, chaque jour en me réveillant, je me répète le fameux vers de Voltaire:
L'univers, mon ami, ne pense point à toi.
Si donc Mme la duchesse de Duras a pris la liberté d'oublier parfaitement et moi et mon manuscrit, je l'en absous de tout mon cœur. Je trouve très juste qu'elle mette mille et une pensées avant celle d'un Allobroge qui a passé devant elle comme une hirondelle, et qui n'a eu, par conséquent, ni le temps ni l'occasion de s'enfoncer un peu plus dans son souvenir...
Ainsi c'est à la duchesse de Duras que Joseph de Maistre a confié un manuscrit. Or, la duchesse est l'intime amie (p. 485) de Chateaubriand, et c'est à lui bien évidemment qu'elle a charge de le remettre. Tout ceci, du reste, est mis hors de doute par une autre lettre du comte de Maistre, écrite de Turin, le 26 octobre 1817, et adressée à Mme Swetchine: «Quand une fois, dit-il, vous serez placée, envoyez-moi le plan de votre cabinet, que je voie votre table, votre fauteuil et la place de vos livres. Je fais ce que je puis pour en ajouter deux à votre pacotille, mais je suis prodigieusement contrarié par ceci ou par cela. Si je réussis, ce sera un beau tapage. La duchesse de Duras avait tranquillement oublié l'œuvre sur son bureau sans y penser une seule fois, pas plus qu'à son auteur; lorsque M. de Chateaubriand m'en a fait part dernièrement avec toutes les excuses de la courtoisie, je me suis mis à rire de la meilleure foi du monde. La duchesse de Duras a fort bien fait de m'oublier; moi-même je n'ai jamais pensé à elle que pour me rappeler à quel point j'avais mal réussi dans cet hôtel. Je m'y trouvais gauche, embarrassé, ridicule, ne sachant à qui parler, et ne comprenant personne. C'est une des plus singulières expériences que j'aie faites de ma vie; il me semble que je vous l'ai dit à Paris...[403]».
La preuve est déjà faite, si je ne me trompe, que c'est bien au vicomte de Chateaubriand—et non au vicomte de Bonald—qu'a été écrite la lettre de Joseph de Maistre publiée dans sa Correspondance. Mais continuons de parcourir cette lettre:
Je me sens glacé lorsque je lis dans votre lettre: Je vais lire votre manuscrit. Bon Dieu! auriez-vous cette complaisance? La lecture d'un manuscrit m'a toujours paru le tour de force de l'amitié; c'est trop demander à la courtoisie; si cependant vous avez cette bonté, rien n'égalera ma reconnaissance...
«Je vais lire votre manuscrit,» dit Chateaubriand.—«Je lis dans votre lettre: Je vais lire votre manuscrit,» écrit, de son côté, Joseph de Maistre. Comment expliquer (p. 486) cette rencontre, si la lettre de Joseph de Maistre n'est pas une réponse à celle de Chateaubriand?
«Vous ne voulez pas me corriger? écrit encore de Maistre; trêve de compliments, Monsieur le vicomte, tant pis pour moi. Combien j'aurais gagné à cette revue!» Ces lignes ne sont-elles pas encore une réponse directe à ce que Chateaubriand avait dit: «Croyez-bien que je n'aurai pas l'impertinence d'y rien trouver à changer; ce n'est point à l'écolier à toucher au tableau du maître.»
Enfin Chateaubriand avait parlé des trois mois d'angoisses et de craintes que lui avait causées la maladie de sa femme, craintes qui ont heureusement cessé. La lettre de Joseph de Maistre répondra à ce passage comme aux autres. Elle porte ce qui suit: «Très peu de temps après vous avoir écrit ma dernière lettre, Monsieur le vicomte, j'appris les cruelles angoisses qui vous oppressaient. Je vous félicite de tout mon cœur de ce qu'elles ont cessé[404].»
S'il était besoin d'une nouvelle et dernière preuve, celle-là plus décisive encore que les autres, le vicomte de Bonald lui-même se chargerait de nous la fournir. Le 2 décembre 1817, il écrivait à Joseph de Maistre:
Monsieur le comte, suis-je assez malheureux! Quand je suis en Allemagne, tous êtes je ne sais où; je viens en France, vous êtes en Russie; je retourne dans mes montagnes, vous arrivez à Paris; je reviens à Paris, vous voilà à Turin, et nous semblons nous chercher et nous fuir tour à tour. J'avais eu l'honneur de vous écrire de ma campagne quand je vous sus à Paris, et, ne sachant pas bien votre adresse, je mis ma lettre sous le couvert de Mme Swetchine. Je ne sais si elle vous est parvenue, mais je n'ai plus trouvé ici cette excellente et spirituelle femme... Ne la reverrons-nous plus ici et ne vous y verrai-je jamais vous-même?
(p. 487) Mais, Monsieur le comte, s'il ne nous est pas donné de nous voir, au moins dans la partie matérielle de notre être, il nous est permis de nous connaître, et surtout de nous entendre d'une manière intime et complète, dont j'avais fait depuis longtemps la remarque avec orgueil pour moi et avec une bien grande satisfaction comme écrivain, parce que cette coïncidence a été pour moi comme une démonstration rigoureuse de la vérité de mes pensées. J'ai éprouvé l'impression de plaisir et de consolation qu'un homme égaré dans un désert éprouverait en entendant la voix d'un homme qui vient à son secours[405]...
Joseph de Maistre écrivait, de son côté, à M. de Bonald, à la fin de 1817, après sa rentrée à Turin: «Ce qu'on appelle un homme parfaitement désappointé, ce fut moi, lorsque je ne vous trouvai point à Paris, au mois d'août dernier. Comme on croit toujours ce qu'on désire, je m'étais persuadé que je vous rencontrerais encore; mais il était écrit que je n'aurais pas le plaisir de connaître personnellement l'homme du monde dont j'estime le plus la personne et les écrits[406].»
Ainsi Joseph de Maistre et Bonald ne se sont jamais vus, ni même entrevus. Ce n'est donc pas au vicomte de Bonald que Joseph de Maistre pouvait dire ce qu'il écrit dans sa lettre d'octobre 1817: «Je dirai toujours de vous: Virgilium vidi tantum! Moi qui avais tant d'envie de vous voir, je n'ai pu que vous entrevoir[407].» Donc, le vicomte auquel est adressée cette lettre ne peut être M. de Bonald; c'est, à n'en pas douter, un autre vicomte, le vicomte de Chateaubriand, que Joseph de Maistre a vu dans le salon de la duchesse de Duras.
Le manuscrit que le comte de Maistre avait confié à madame de Duras, avec prière de le placer sous les yeux de Chateaubriand, était le manuscrit de son livre du Pape. Sa lettre à Chateaubriand est donc, à ce point de vue (p. 488) encore, des plus curieuses, et je ne saurais trop engager les lecteurs à la lire en entier dans la Correspondance de Joseph de Maistre. Je dois me borner à en donner ce nouvel et court extrait:
Des personnes qui s'intéressent fort à la publication de mon ouvrage m'assurent qu'elle ne sera point permise en France à cause du 4me livre, où je prouve jusqu'à la démonstration (du moins je m'en flatte), que le système Gallican, exagéré dans le siècle dernier, nous avait conduits à un véritable schisme de fait, infiniment nuisible à la religion. Quoique j'élève d'ailleurs l'Église Gallicane aux nues, cependant on se tient sûr que la censure me chicanera sur les vérités que je dis à ce sujet à cette vénérable Église.
Si j'ai prouvé, moi aussi, jusqu'à la démonstration, qu'il a existé des relations entre l'auteur du Pape et l'auteur du Génie du christianisme,—fait demeuré jusqu'ici entièrement ignoré—je ne cache pas que je tiens cette démonstration pour une bonne fortune.
Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai reçu de M. l'abbé Pailhès—dont l'obligeance est inépuisable—communication de la lettre même de Chateaubriand à Joseph de Maistre. En voici le texte complet:
Montgraham, par Nogent-le-Rotrou,
le 6 septembre 1817.
Monsieur le Comte,
Après trois mois d'angoisses et de craintes pour la vie de Mme de Chateaubriand, je viens passer deux jours à Paris; je trouve avec grand plaisir, mais à mon grand étonnement, vos lettres et votre manuscrit restés chez Mme la duchesse de Duras. Vous avez dû, monsieur le Comte, être bien étonné de mon silence, après la marque de confiance et d'estime que vous avez eu l'extrême bonté de me donner; je vois que je n'ai point encore épuisé ma mauvaise fortune.
Je vais, Monsieur le Comte, lire le manuscrit: mais vous croyez bien que je n'aurai pas l'impertinence d'y trouver rien à changer; ce n'est point à l'écolier de toucher au tableau du (p. 489) maître. Je trouve seulement d'avance que vous êtes bien bon de vous donner la peine de combattre M. Ferrand.
Je serai à Paris vers la fin d'octobre, pour l'ouverture de la session, et je traiterai de vos intérêts avec M. Le Normant[408], si, d'après votre réponse, vous êtes toujours dans l'intention de publier votre ouvrage.
La triste politique et les persécutions de tout genre que j'éprouve occupent une grande partie de mon temps; mais il m'en restera toujours pour vous lire et vous admirer.
Recevez, Monsieur le Comte, je vous prie, l'assurance de ma reconnaissance, de ma profonde estime, de ma sincère admiration, sans parler de la haute considération avec laquelle je suis, Monsieur le Comte,
Votre très humble et très dévoué serviteur,
Le vicomte de Chateaubriand.
En tête de cette lettre, ces mots, de la main de Joseph de Maistre: «Reçue à Turin, le 27.»[Lien vers la Table des Matières]
Le Conservateur a commencé au mois d'octobre 1818. Ce n'était pas un journal quotidien; il paraissait par livraison de trois feuilles d'impression, à des jours indéterminés, ainsi que le faisait la prudente Minerve. Libéraux et royalistes échappaient ainsi à la censure, qui n'atteignait que les publications périodiques. Ses bureaux étaient rue de Seine, no 8, chez Le Normant fils, éditeur. En tête de chaque livraison, se lisait la devise: le Roi, la Charte et les (p. 490) Honnêtes Gens. Chateaubriand, qui en fut jusqu'à la fin le principal rédacteur, avait groupé autour de lui des hommes politiques et des écrivains qui le secondèrent à merveille. Il en nomme quelques-uns dans ses Mémoires; il convient, je crois, d'en donner ici la liste complète: on verra que jamais plus vaillant chef ne fut entouré d'un plus brillant état-major. Voici cette liste:
F.-M. Agier; Benoit, député de Maine-et-Loire; Berryer fils; T. de Boisbertrand; vicomte de Bonald; Henri de Bonald; de Bouville; comte de Bruges; vicomte de Castelbajac; marquis de Coriolis d'Espinousse; Couture, avocat; Crignon d'Ouzouer, député du Loiret; Astolphe de Custine; Dureau de la Malle; l'abbé Fayet; Joseph Fiévée; duc de Fitz-James; A. de Frénilly; Eugène Genoude; vicomte Emmanuel d'Harcourt; marquis d'Herbouville; comte Édouard de la Grange; A. de Jouffroy; Florian de Kergorlay; duc de Lévis; le cardinal de la Luzerne; Martainville; l'abbé de la Mennais; comte O'Mahony; Charles Nodier; comte Jules de Polignac; de Saint-Marcellin; comte de Saint-Roman; comte de Salaberry; comte Humbert de Sesmaisons; vicomte de Suleau; baron Trouvé; Joseph de Villèle.
Le Conservateur cessa de paraître au mois de mars 1820. Il n'avait vécu que deux ans et demi; mais ces deux années lui avaient suffi pour conquérir une place que depuis lors nulle feuille politique n'a pu lui disputer. Quel journal compta jamais en même temps, parmi ses rédacteurs, trois écrivains tels que Chateaubriand, La Mennais et Bonald?
Dans la liste qu'on vient de lire, j'ai souligné un nom, aujourd'hui bien oublié, celui de Saint-Marcellin. M. de Saint-Marcellin était le fils de Fontanes, et c'est à lui que fait allusion Chateaubriand, à la fin du huitième livre de sa première partie, lorsqu'il écrit: «Fontanes n'est plus; un chagrin profond, la mort tragique d'un fils, l'a jeté (p. 491) dans la tombe avant l'heure.» Il fut tué en duel[410], le 1er février 1819, alors qu'il venait de débuter avec éclat dans le Conservateur, presque au lendemain du jour où il venait d'y publier sous ce titre: M. Dimanche, un dialogue étincelant d'esprit et de verve[411]. Chateaubriand consacra au fils de son ami des pages qu'il n'a pas recueillies dans ses Œuvres, mais qui doivent ici trouver place. Elles sont le complément naturel de ces autres pages si belles, que l'auteur des Mémoires, a écrites sur Fontanes.
Voici l'article de Chateaubriand; je l'emprunte au tome II du Conservateur, pages 272-276:
NÉCROLOGIE
M. de Saint-Marcellin, à peine âgé de vingt-huit ans, blessé à mort le 1er de ce mois, a expiré le 3, entre neuf et dix heures du soir. Il avait fait l'apprentissage des armes dans la campagne de 1812, en Russie. Il donna les premières preuves de sa valeur dans le combat qui eut pour résultat la prise du village de Borodino et de la grande redoute qui couvrait le centre de l'armée russe. Le rapport du prince Eugène au major-général sur cette journée se termine par cette phrase: «Mon aide de camp de Sève et le jeune Fontanes de Saint-Marcellin méritent d'être cités dans ce rapport.»
M. de Saint-Marcellin s'était précipité dans les retranchements de l'ennemi, et avait eu le crâne fendu de trois coups de sabre.
Après le combat, il se présenta dans cet état à un hôpital encombré de 4,000 blessés, où il n'y avait que trois chirurgiens dénués de linge, de médicaments et de charpie: il ne put même obtenir d'y être reçu. Il s'en retournait baigné dans son sang, (p. 492) lorsqu'il rencontra Bonaparte. «Je vais mourir, lui dit-il; accordez-moi la croix d'honneur, non pour me récompenser, mais pour consoler ma famille.» Bonaparte lui donna sa propre croix.
M. de Saint-Marcellin, jeté sur des fourgons, arriva à moitié mort à Moscou: il y séjourna quelque temps et fut assez heureux pour trouver le moyen de revenir en France, où nous l'avons vu, pendant plus de dix-huit mois, porter encore une large blessure à la tête.
La France ayant rappelé son Roi légitime, M. de Saint-Marcellin fut fidèle aux nouveaux serments qu'il avait faits. Il était aide-de-camp du général Dupont à l'époque du 20 mars. Il se trouvait à Orléans avec son général, lorsque les soldats séduits quittèrent la cocarde blanche; M. de Saint-Marcellin osa la garder: circonstance que peut avoir connue M. le maréchal Gouvion de Saint-Cyr, qui fit reprendre la cocarde blanche aux troupes égarées. Rentré à Paris, M. de Saint-Marcellin eut une altercation politique avec un officier, se battit, blessa son adversaire, et partit du champ clos pour aller rejoindre ceux à qui il avait engagé sa foi.
Nommé capitaine à Gand, il sollicita l'honneur d'accompagner le général Donadieu, chargé par le Roi, d'une mission importante. Débarqué à Bordeaux, il fut arrêté et remis aux mains de deux gendarmes qui devaient le conduire à Paris pour y être fusillé. En passant par Angoulême, il échappa à ses gardes, excita un mouvement royaliste dans la ville, et rentra dans Paris avec le Roi.
M. de Saint-Marcellin fut alors envoyé comme chef de bataillon dans un régiment de ligne à Orléans: blessé de nouveau, il fut obligé de revenir à Paris. Depuis ce moment, il consacra ses loisirs aux lettres: il avait de qui tenir. Il donna quelques ouvrages à nos différents théâtres lyriques. Compris comme chef d'escadron dans la nouvelle organisation de l'état-major de l'armée, il avait refusé dernièrement un service actif qui l'eût éloigné de Paris. La Providence voulait le rappeler à elle. Pour des raisons faciles à deviner, l'administration avait subitement, dit-on, changé en rigueur sa bienveillance politique. On assure que M. de Saint-Marcellin allait perdre sa place de chef d'escadron, quand la mort est venue épargner aux ennemis des royalistes une destitution de plus, et rayer elle-même ce brave militaire du tableau où elle efface également et les chefs et les soldats.
M. de Saint-Marcellin n'a point démenti, à ses derniers moments, ce courage français qui porte à traiter la vie comme la (p. 493) chose la plus indifférente en soi, et l'affaire la moins importante de la journée. Il ne dit ni à ses parents ni à ses amis qu'il devait se battre, et il s'occupa tout le matin d'un bal qui devait avoir lieu le soir chez M. le marquis de Fontanes. À trois heures il se déroba aux apprêts du plaisir pour aller à la mort. Arrivé sur le champ de bataille, le sort ayant donné le premier feu à son adversaire, il se met tranquillement au blanc, reçoit le coup mortel, et tombe en disant: «Je devais pourtant danser ce soir.» Rapporté sans connaissance chez M. de Fontanes, on sait qu'il y rentra à la lueur des flambeaux déjà allumés pour la fête. Lorsqu'il revint à lui, on lui demanda le nom de son adversaire: «Cela ne se dit pas, répondit-il en souriant; seulement c'est un homme qui tire bien.» M. de Saint-Marcellin ne se fit jamais d'illusion sur son état: il sentit qu'il était perdu; mais il n'en convenait pas, et il ne cessait de dire à ses parents et à ses amis en pleurs: «Soyez tranquilles, ce n'est rien.» Il n'a fait entendre aucunes plaintes, il n'a témoigné, ni regrets de la vie, ni haine, ni même humeur contre celui qui la lui arrachait: il est mort avec le sang-froid d'un vieux soldat et la facilité d'un jeune homme. Ajoutons qu'il est mort en chrétien.
Les lettres et l'armée perdent dans M. de Saint-Marcellin, une de leurs plus brillantes espérances. On remarque, dans les premiers essais échappés à sa plume, une gaîté de bon goût, appuyée sur un fond de raison, et sur des sentiments nobles. Lorsqu'il parle d'honneur, on voit qu'il le sent, et quand il rit, on s'aperçoit qu'il méprise. Sa destinée paraissait devoir être heureuse dans un ordre de choses différent de celui qui existe aujourd'hui; mais aussitôt qu'il est entré dans la ligne des devoirs légitimes, il a été atteint par cette fatalité qui semble s'attacher aux pas de tout ce qui est devenu ou resté fidèle. Est-ce une raison pour renoncer à une cause sainte et juste? Bien loin de là, c'est une raison pour s'y attacher: les hommes généreux sont tentés par les périls, et l'honneur est une divinité à laquelle on s'attache par les sacrifices mêmes qu'on lui fait.
Devons-nous plaindre ou féliciter M. de Saint-Marcellin? Il n'était pas fait pour vivre dans ces temps d'ingratitude et d'injustice. Le sang lui bouillait dans les veines; son cœur se révoltait quand il voyait récompenser la trahison et punir la fidélité. Son indignation avait l'éclat de son courage, et il ne faisait pas plus de difficulté de montrer ses sentiments que de tirer son épée: avec une pareille disposition d'âme, nous ne l'eussions pas gardé longtemps. D'ailleurs, nous marchons si vite, le système adopté nous prépare de tels événements, que Saint-Marcellin n'a peut-être perdu que des orages: il s'est hâté d'arriver (p. 494) au lieu de son repos, et du moins il n'entend plus le bruit de nos divisions.
Mille raisons nous commandaient de payer ce tribut d'éloges à la mémoire de Saint-Marcellin; mais il y en a surtout une qu'une vieille amitié sentira. Cette amitié a été éprouvée par la bonne et la mauvaise fortune; elle nous retrouvera toujours, et particulièrement quand il s'agira de la consoler: Ille dies utramque duxit ruinam.[Lien vers la Table des Matières]
C'est pendant qu'il était ambassadeur à Berlin, que Chateaubriand perdit le plus ancien et le plus fidèle de ses amis, M. de Fontanes. Avant de quitter Paris, il avait essayé de faire rétablir en faveur de son ami la Grande Maîtrise de l'Université: la chose ne s'était point arrangée, à cause des combinaisons politiques qu'il avait fallu satisfaire et M. de Fontanes lui avait écrit ce billet:
Je vous le répète, je n'ai rien espéré, ni rien désiré. Ainsi, je n'éprouve aucun désappointement, mais je n'en suis pas moins sensible aux témoignages de votre amitié; ils me rendent plus heureux que toutes les places du monde.
Le 10 mars 1821, Fontanes fut atteint d'une attaque de goutte à l'estomac qui causa tout de suite à ses amis les plus vives inquiétudes.
Je serai bien affligée, écrivait la duchesse de Duras, en annonçant à Chateaubriand la triste nouvelle, je serai bien affligée si nous perdons M. de Fontanes, je l'aime. Il vous a été si fidèle! C'est encore un modèle qui disparaîtrait, un type de goût littéraire qui ne serait pas remplacé. Vous appartenez bien plus que lui à la race nouvelle. Ce qui me frappe tous les jours, c'est que tout finit. Les dieux s'en vont.
(p. 495) Le 17 mars, Chateaubriand écrivait à Mme Récamier: «Je suis au désespoir de la maladie de Fontanes. Je tremble de l'arrivée du prochain courrier.»—Fontanes était mort le matin même du jour où son ami écrivait cette lettre.
Chateaubriand fut accablé par cette mort; il envoya à M. Bertin les lignes suivantes, qui parurent dans le Journal des Débats du 10 avril 1821:
Monsieur,
Il est de mon devoir de répondre à l'appel que vous avez fait à l'amitié, dans votre journal du 19 de ce mois. J'y répondrai mal, car ce n'est pas quand on a le cœur brisé qu'on peut écrire. L'époque à jamais célèbre fondée par Boileau, Racine et Fénelon, finit en M. de Fontanes; notre gloire littéraire expire avec la monarchie de Louis XIV.
Mon illustre ami laisse entre les mains de sa veuve inconsolable et de sa jeune et malheureuse fille les manuscrits les plus précieux; et telle était son indifférence pour la renommée, qu'il se refusait à les publier. Ces manuscrits consistent en un Recueil d'odes et de poèmes admirables, en des mélanges littéraires écrits dans cette prose où le bon goût ne nuit point à l'imagination, l'élégance au naturel, la correction à l'éloquence et la chasteté du style à la hardiesse de la pensée.
Devais-je être appelé si tôt à parler des derniers ouvrages de l'écrivain supérieur qui annonça mes premiers essais? Personne (si ce n'est un de ses vieux amis qui est aussi le mien, M. Joubert) n'a mieux connu que moi cette bonhomie, cette simplicité, cette absence de toute envie, qui distinguent les vrais talents et qui faisaient le fond du caractère de M. de Fontanes. Singulière fatalité! notre amitié commença dans la terre étrangère, et c'est dans la terre étrangère que j'apprends la mort du compagnon de mon exil!
Comme homme public, M. de Fontanes a rendu à son pays des services inappréciables; il maintint la dignité de la parole, sous l'empire du maître qui commandait un silence servile; il éleva dans les doctrines de nos pères des enfants qu'on voulait séparer du passé pour bouleverser l'avenir. Vous aussi, monsieur, vous avez admiré et aimé ce beau génie, cet excellent homme, qui peut-être est déjà oublié dans la ville où tout s'oublie.
(p. 496) Mais le temps de la mémoire viendra; la postérité reconnaissante voudra savoir quel fut cet héritier du grand siècle, dont elle lira les pages immortelles. Je suis incapable aujourd'hui d'entrer dans de longs détails sur la personne et les travaux de mon ami; la perte que je fais est irréparable, et je la sentirai le reste de ma vie. Au moment même où votre journal est arrivé, j'écrivais à M. de Fontanes: je ne lui écrirai plus! Pardonnez, monsieur, si je borne ma lettre à ce peu de mots que je vois à peine en les traçant.
J'ai l'honneur, etc.
Chateaubriand.
Berlin, 31 mars.
C'est par les soins de Chateaubriand que furent publiées, en 1839, les Œuvres de Fontanes, en deux volumes in-8o, avec une Notice par Sainte-Beuve. L'année précédente, il s'était fait l'éditeur du Recueil des Pensées de Joubert: Chateaubriand n'oubliait pas ses amis.[Lien vers la Table des Matières]
Le Constitutionnel, dans son numéro du 5 avril 1831, rendant compte de la brochure de Chateaubriand sur la Restauration et la Monarchie élective, fit allusion à un soi-disant traité secret, conclu à Vérone le 22 novembre 1822 et portant la signature de Chateaubriand. Aux termes de ce traité, la France, l'Autriche, la Prusse et la Russie s'engageaient mutuellement à faire tous leurs efforts pour anéantir le système représentatif dans toutes les contrées de l'Europe où il pourrait exister.
Chateaubriand adressa immédiatement au Constitutionnel la lettre suivante:
Monsieur,
Je viens de lire dans votre journal l'article obligeant que vous avez bien voulu publier sur ma brochure de la Restauration et de la Monarchie élective. J'y ai remarqué une phrase qui me force à vous importuner; cette phrase est celle-ci: «Ce sont vos anciens amis qui ont souvent dit et toujours pensé ce que vous avez eu le malheur de signer au congrès de Vérone contre le gouvernement constitutionnel.»
Permettez-moi, Monsieur, de m'étonner qu'un journal aussi accrédité et aussi bien informé des affaires du monde que le vôtre, ait jamais pu croire à l'authenticité de la misérable pièce, que l'on a donnée comme un traité signé par moi au congrès de Vérone. On oublie que je n'assistais à ce congrès que comme ambassadeur de France à Londres, que j'avais pour collègues M. le comte de la Ferronnays, ambassadeur de France en Russie; M. le marquis de Caraman, ambassadeur de France à Vienne; M. le comte de Serre, ambassadeur de France à Naples; et qu'enfin M. le duc (alors vicomte) Mathieu de Montmorency, Ministre des affaires étrangères de France, était le véritable représentant de la cour de France au congrès.
Et ce serait moi, dont les opinions libérales me rendaient si suspect au cabinet de Vienne; moi que ce cabinet voyait d'un si mauvais œil à Vérone; ce serait moi, simple ambassadeur, qu'on aurait choisi pour signer avec les ministres des affaires étrangères de Russie, d'Autriche et de Prusse, un traité contre les gouvernements constitutionnels lorsque le ministre des affaires étrangères de France, mon propre ministre, était là auprès de moi!
La supposition est trop absurde: il a fallu toute l'autorité dont jouit votre journal pour que j'aie daigné la relever. Je l'avais vu traîner ailleurs avec tout le mépris qu'elle méritait de ma part. Je dois ajouter, pour l'honneur de la mémoire de M. de Montmorency et la justification des ambassadeurs français, mes collègues à Vérone, que jamais le prétendu traité, publié comme pièce officielle, n'a existé, que c'est une grossière invention, aussi dénuée de vraisemblance que de vérité.
J'ose croire. Monsieur, que cette lettre suffira pour tirer d'erreur les journaux de bonne foi qui ont fait mention de cette pièce: je renonce d'avance à convaincre ceux qu'animeraient l'esprit de parti et des inimitiés personnelles.
J'ai l'honneur, etc.
Chateaubriand.
(p. 498) Le texte du pseudo-traité du 22 novembre 1822, publié pour la première fois par le Morning-Chronicle en 1823, a été reproduit par M. de Marcellus dans son excellent ouvrage, Politique de la Restauration en 1822 et 1823. L'article 2 est ainsi conçu:
Comme on ne peut douter que la liberté de la presse ne soit le moyen le plus puissant employé par les prétendus défenseurs des droits des nations, au détriment de ceux des princes, les hautes parties contractantes promettent réciproquement d'adopter toutes les mesures propres à la supprimer, non seulement dans leurs propres états, mais aussi dans le reste de l'Europe.
Certes, il fallait une singulière audace pour oser mettre au bas de cet article la signature de Chateaubriand,—de l'homme qui avait été toute sa vie le plus énergique et le plus éloquent champion de la liberté de la presse; de celui qui avait crié sur les toits cet axiome, que sans la liberté de la presse, toute constitution représentative est en péril; de celui qui, le premier en France, avait fait et mené à bien une guerre, en présence de cette liberté!
M. de Marcellus a du reste donné, dans son livre, sur les circonstances dans lesquelles fut fabriqué ce prétendu traité secret, des détails qui viendraient encore corroborer, s'il en était besoin, le démenti opposé par Chateaubriand à cette misérable supercherie:
Ce document, dit M. de Marcellus, avait beau se dire natif de Vérone, marqué à sa naissance du sceau de la langue diplomatique de l'Europe, et issu en droite ligne des plénipotentiaires des cours unies par la Sainte-Alliance, il n'en était pas moins originaire de Londres, où il était sorti, tout armé de style anglais, du front d'un seul créateur...
Pendant ma gestion des affaires de France à Londres, en 1823, cet article, fabriqué tout chaud pour les presses du Morning-Chronicle avait attiré mes regards; le jour même de son apparition, le prince Esterhazy pour l'Autriche, le baron de Werther pour la Prusse, le comte de Lieven pour la Russie, et moi pour la France, nous avions reconnu en lui une de ces tentatives (p. 499) journalières combinées pour agir sur les fonds publics d'un côté du détroit comme de l'autre; après avoir unanimement pensé que, par son caractère apocryphe, il portait en lui-même sa condamnation et son antidote, comme il ne méritait pas une réfutation sérieuse, nous nous étions bornés à le faire démentir à Londres, sans commentaire et sans signature, dans le New-Times, journal du matin, et dans le Sun, journal du soir.
J'ajoute qu'au moment de l'éclosion artificielle de ce traité secret, M. Canning (ministre des Affaires étrangères dans le cabinet britannique) m'en avait parlé légèrement à Glocester-Lodge mais sans le soumettre à aucun examen politique ou grammatical, et le rangeant lui-même parmi ces documents que la presse disait-il,
Supposita de matre nothos furata creavit.
«—Sans doute, lui avais-je répondu, il est bien bâtard, et il en porte tous les signes. C'est un produit de fabrique anglaise, et je pourrais montrer dans le Strand la boutique d'où il sort.—Ah! vous connaissez donc nos ateliers de Forgery?—Oh! non pas plus que votre ambassadeur à Paris ne connaît les laboratoires de nos gazettes[414].»[Lien vers la Table des Matières]
Il y a ici, dans les Mémoires, une lacune volontaire et forcée. Il n'est rien dit des vingt mois (octobre 1822 à juin 1824) pendant lesquels Chateaubriand fut d'abord ambassadeur de France au Congrès de Vérone, puis ministre des affaires étrangères à Paris; rien dit de la guerre d'Espagne, qui fut cependant son œuvre. Certes, il n'entendait pas laisser dans l'ombre les événements mêmes auxquels est attaché l'honneur de son nom comme homme d'État. Il a voulu, au contraire, en parler tout à son aise. De toutes les périodes de sa vie, c'est celle dont le récit a (p. 500) pris sous sa plume le plus de développement,—des développements tels que ce récit formait d'abord quatre volumes, réduits plus tard à deux, dans des circonstances que nous dirons tout à l'heure. Ces deux volumes font en réalité partie intégrante des Mémoires d'Outre-tombe. S'ils n'y figurent pas, c'est que l'auteur a craint, en leur donnant place dans ses Mémoires, de déranger la belle ordonnance de son livre, où toutes les proportions sont si bien gardées, où toutes les parties de l'œuvre s'harmonisent entre elles avec un art si parfait. Pour cette raison, et aussi afin de venger publiquement la Restauration des calomnies dont elle était alors journellement l'objet, il se décida, en 1838, à publier à part tout ce qu'il avait écrit sur le Congrès de Vérone et la guerre d'Espagne.
Sa copie, je viens de le dire, formait quatre volumes. C'était quatre-vingt mille francs (vingt mille francs par volume) qui lui revenaient aux termes de ses traités avec la société nantie du droit de publier ses œuvres futures. Déjà les quatre volumes étaient imprimés presque en entier, lorsque M. de Marcellus et M. de la Ferronnays, alarmés de voir mettre au jour certaines pièces diplomatiques, destinées, selon eux, à rester secrètes, supplièrent Chateaubriand de sacrifier ici et là, un peu partout, des documents, qui étaient pourtant de l'intérêt le plus vif. Il consentit à la plupart des retranchements demandés, et fit à ses deux amis si bonne mesure que les quatre volumes primitifs se trouvèrent réduits aux deux volumes actuels.—«Eh! bien,» dit Chateaubriand à M. de Marcellus, quand le sacrifice fut consommé, «vous me coûtez, tous les deux, quarante mille francs.—Soit, quarante mille francs, reprit M. de Marcellus, plutôt que des regrets trop tardifs.» Et Chateaubriand de répliquer:—«C'est maintenant chose faite; j'ai respecté vos scrupules et ceux de la Ferronnays; j'ai beaucoup retranché pour vous plaire. Mais vous ne vous êtes pas suffisamment l'un et (p. 501) l'autre mis par la pensée en dehors de votre siècle et des affaires. Pour juger d'un effet de ton, il faut se placer à distance. C'est en disant tout qu'on se distingue de la foule des hommes d'État boutonnés et méticuleux. J'ai conçu la diplomatie sur un nouveau plan; je parle tout haut. Vous avez tort de redouter mes révélations; elles ne pouvaient que vous faire honneur. Je vous le prédis: vous ferez plus tard, quand vous croirez le danger amoindri, la Ferronnays ou vous, et par le même motif, ce que vous m'empêchez de faire maintenant. D'avance, pour mon compte, je vous y autorise[416]».
Puisque Chateaubriand a été conduit, comme nous venons de le voir, à laisser en dehors de ses Mémoires cette guerre d'Espagne, qui fut «le grand événement politique de sa vie», il sied de rappeler ici, au moins en quelques mots, que cette guerre fut un acte de haute et grande politique, et non, comme l'ont répété à satiété les ennemis de la Restauration, un acte de servitude et de sujétion vis-à-vis des cabinets du Nord.
Lorsque M. de Montmorency, ministre des Affaires étrangères, se rendit au congrès de Vérone, il était porteur d'instructions positives, qui renfermaient ces propres mots: «La France étant la seule puissance qui doive agir par ses troupes, elle sera seule juge de cette nécessité. Les plénipotentiaires ne doivent pas consentir à ce que le congrès prescrive la conduite de la France à l'égard de l'Espagne.» Entraîné par la générosité et l'élévation de ses sentiments, qui revêtaient parfois une teinte de mysticisme, (p. 502) à embrasser une politique où l'initiative particulière de chaque nation s'effacerait devant les décisions prises en commun par une sorte de directoire des grandes puissances chargé de faire prévaloir partout les intérêts du droit et de l'humanité, le loyal et chevaleresque Mathieu de Montmorency avait été conduit à demander que la Russie, l'Autriche, la Prusse et la France adressassent à l'Espagne une dernière signification, après laquelle les ambassadeurs seraient rappelés. M. de Villèle se prononça contre cette action collective, dans le conseil des ministres qui fut tenu aux Tuileries le 25 janvier 1822. Il revendiqua pour la France le droit d'intervenir seule. Louis XVIII se rangea à son avis, et déclara que «la France était vis-à-vis de l'Espagne dans une position spéciale; que, pour elle, rappeler l'ambassadeur, c'était trop ou trop peu;» puis il ajouta: «Louis XIV a détruit les Pyrénées, je ne les laisserai pas relever; il a placé ma maison sur le trône d'Espagne, je ne l'en laisserai pas tomber; mon ambassadeur ne doit quitter Madrid que le jour où cent mille Français s'avanceront pour le remplacer.» Parler ainsi, c'était séparer l'action de la France de celle des autres puissances; M. Duvergier de Hauranne n'hésite pas à le reconnaître.[417] C'était désavouer M. de Montmorency; il remit aussitôt son portefeuille. Il avait voulu faire de la question d'Espagne une question européenne; avec Chateaubriand, son successeur, elle devint une question française. Le chef du cabinet britannique, M. Canning, s'en montra profondément irrité. L'hostilité de l'Angleterre n'arrêta point le gouvernement de Louis XVIII. «Tenez le ton haut avec les ministres anglais», écrivait Chateaubriand, le 16 janvier 1823, à M. de Marcellus, représentant de la France (p. 503) à Londres. «Dites et répétez à M. Canning, lui écrivait-il encore dans une dépêche en date du 28 janvier, que nous voulons la paix comme lui, et que l'Angleterre peut l'obtenir avant l'ouverture de la campagne, si elle veut tenir le même langage que nous et demander la liberté du roi. Mais ajoutez bien que notre parti est pris, et que rien ne nous fera reculer.» Et, le 13 mars 1823: «M. Canning m'en veut de n'avoir pas cédé à ses menaces et de n'avoir pas précipité la France aux genoux de l'Angleterre. Il ne peut pas guerroyer, il n'en a aucune demi-raison plausible, il le sent et il est piqué de s'être si fort avancé. Mais, guerre ou non, la France fera ce qu'elle doit faire, ou je ne serai plus ministre...» Et en post-scriptum: «Donnez des fêtes, et ripostez ferme à M. Canning.» Le 17 avril: «L'Angleterre sent que cette guerre nous rend notre influence et nous replace à notre rang en Europe; elle doit être irritée et malveillante. L'amour-propre de M. Canning est compromit: de là sa violence et son humeur... Je vous recommande de vous montrer désormais froid et réservé avec M. Canning... Soyez poli, mais causez peu; et qu'il s'aperçoive, à votre manière, que le gouvernement français connaît sa force et défend sa dignité.»[418]
Les actes furent à la hauteur des paroles. La politique de Chateaubriand avait été habile et ferme: une guerre heureuse et bien conduite la couronna. Voici en quels termes Benjamin Constant et le général Foy, qui parlaient pourtant au nom de l'opposition, ont jugé la guerre d'Espagne:
«Loin de contester ce que notre honorable collègue (M. de Martignac) a dit sur le passé, j'aime à reconnaître avec lui que l'ensemble de cette expédition mémorable a été glorieux pour notre armée, et je dirai que cette gloire est d'autant plus belle qu'elle ne se compose pas seulement de succès militaires. La générosité française animant jusqu'à nos simples soldats a travaillé (p. 504) toujours et heureusement réussi quelquefois à faire prévaloir l'humanité contre la vengeance, la pitié contre la fureur et à protéger l'ennemi désarmé contre l'auxiliaire aigri par de longs revers.» Ainsi s'exprima Benjamin Constant à la tribune de la Chambre des députés, dans la séance du 28 juin 1824. Le général Foy, dans la même séance, ajouta ces paroles: «La rapidité des opérations en Espagne et la plénitude du succès militaire ont trompé les prévisions de ceux qui ne voulaient pas la guerre et ont surpassé les espérances de ceux qui l'avaient appelée de leurs vœux.»
Tous les esprits vraiment libéraux se sont accordés à reconnaître que la guerre d'Espagne était à la fois politique et légitime, et, par dessus tout nationale. En affermissant le gouvernement à l'intérieur, elle rendait à la France sa liberté d'action au dehors. Le congrès d'Aix-la-Chapelle avait délivré notre territoire. Le congrès de Vérone et la campagne qui le suivit émancipaient notre politique. Nous redevenions une grande nation.
M. Saint-Marc Girardin écrivait, en 1838, dans un article publié par le Journal des Débats:
Non, le congrès de Vérone n'a pas imposé à la France l'obligation de faire la guerre à la révolution espagnole. L'Europe s'accommodait de notre impuissance de 1815. Sans doute, la révolution d'Espagne l'inquiétait; mais la résurrection politique et militaire de la France, qui était une des conséquences de la guerre d'Espagne, si cette guerre réussissait, inquiétait l'Europe bien plus encore que la révolution espagnole... Voilà ce que démêla M. de Chateaubriand, et voilà pourquoi il déclara hautement que la guerre d'Espagne a été un acte de hardiesse plutôt qu'un acte de soumission et d'obéissance; mais il vit en même temps que l'Europe continentale ne pouvait nous défendre de faire cette guerre, et qu'elle devait même nous y soutenir en apparence de ses vœux, forcée qu'elle était à cela par ses principes et ses opinions monarchiques[419].

Cascade de Terni.
M. Guizot avait été, en 1823, un des adversaires de l'expédition; (p. 505) cela ne l'empêchera pas, quand il aura lui-même passé par les affaires, de dire dans ses Mémoires:
Comme coup de main de dynastie et de parti, la guerre d'Espagne réussit pleinement. Les prédictions sinistres de ses adversaires furent démenties et les espérances de ses fauteurs dépassées. Mises en même temps à l'épreuve, la fidélité de l'armée et l'impuissance des conspirateurs réfugiés au dehors éclatèrent à la fois. L'expédition fut facile, quoique non sans gloire. Le duc d'Angoulême s'y fit honneur. La prospérité et la tranquillité de la France n'en reçurent aucune atteinte[420].
Sir Robert Peel, membre du Cabinet anglais, appréciait ainsi, dans une conversation avec M. de Marcellus, les résultats de la campagne:
La Providence est pour vous, vous aviez raison... Vous avez conquis une influence réelle sur le continent; une armée fidèle; des finances florissantes; un héritier de la couronne qui s'est acquis autant de gloire par son courage que par sa modération[421].[Lien vers la Table des Matières]
Le duc Victor de Broglie, au tome II de ses Souvenirs, a cru pouvoir accueillir une anecdote, qui, si on ne l'arrêtait pas au passage, pourrait finir quelque jour par entrer dans l'histoire. Après avoir rappelé comment Chateaubriand fut brusquement renvoyé du ministère, M. de Broglie ajoute ce qui suit:
Le 8 juin[423], à dix heures du matin, le lendemain du jour où son sort avait été décidé à son insu, comme il entrait aux Tuileries (p. 506) pour faire sa cour à M. le comte d'Artois, son secrétaire, consterné et la larme à l'œil, lui remit un message qui le congédiait à peu près aussi cavalièrement qu'un laquais de bonne maison...
Je dois ajouter, pour ne rien omettre, que les amis de M. de Villèle ne se firent pas faute de l'excuser, comme on excuse en ce bas monde, en aggravant le tort par la calomnie, en insinuant malignement que l'auteur du Génie du christianisme devait s'en prendre à lui-même si son congé ne l'avait rejoint qu'en plein midi et en pleine cour; qu'il l'aurait reçu en temps et lieu convenables, s'il fût rentré chez lui la veille au soir, et s'il y eût passé la nuit. J'ai toujours regardé, pour ma part, cette sottise comme inventée à plaisir et après coup. M. de Chateaubriand, dans ses Mémoires d'Outre-tombe, en m'imputant (gratuitement, de son propre aveu) un acte de persécution aussi faux en lui-même qu'étranger, j'ose le dire, à mon caractère, a trouvé bon d'y joindre cette réflexion, qu'en tout cas j'en étais bien capable. Il ne tiendrait qu'à moi de lui rendre ici la pareille; mais les mauvais procédés et les mauvais exemples ne sont bons qu'à éviter[424].
Mettons tout d'abord en regard de cette page des Souvenirs du duc Victor de Broglie la page du Congrès de Vérone, où Chateaubriand a raconté lui-même son renvoi: audiatur et altera pars. Aussi bien, la page est charmante:
Le 6, au matin, nous ne dormions pas; l'aube murmurait dans le petit jardin; les oiseaux gazouillaient: nous entendîmes l'aurore se lever; une hirondelle tomba par notre cheminée dans notre chambre; nous lui ouvrîmes la fenêtre: si nous avions pu nous envoler avec elle! Les cloches annoncèrent la solennité de la Pentecôte; jour mémorable dans notre vie: ce même jour, nous avions été relevé à sept ans des vœux d'une pauvre femme chrétienne; après tant d'anniversaires, ce jour nous rendait à notre obscurité première; de là s'en allait nous attendre au palais des rois de Bohême, où nous devions saluer ce Charles X exilé, à qui l'on ne nous permit pas, en 1824, de chanter aux Tuileries l'hymne des félicitations.
À dix heures et demie, nous nous rendîmes au Château. Nous voulions d'abord faire notre cour à Monsieur. Le premier salon du pavillon Marsan était à peu près vide; quelques personnes (p. 507) entrèrent successivement et semblaient embarrassées. Un aide de camp de Monsieur nous dit: «Monsieur le vicomte, je n'espérais pas vous rencontrer ici; n'avez-vous rien reçu?» Nous lui répondîmes: «Non, que pouvions-nous recevoir?» Il répliqua: «J'ai peur que vous ne le sachiez bientôt.» Là-dessus, comme on ne nous introduisit point chez Monsieur, nous allâmes ouïr la musique à la chapelle.
Nous étions tout occupé des beaux motets de la fête, lorsqu'un huissier vint nous dire qu'on nous demandait. Nous suivîmes l'huissier, il nous conduit à la salle des Maréchaux. Nous y trouvons notre secrétaire, Hyacinthe Pilorge. Il nous remit la lettre de M. de Villèle et l'ordonnance royale, en nous disant: «Monsieur n'est plus ministre» M. le duc de Rauzan, directeur des affaires politiques, avait ouvert le paquet pendant notre absence et n'avait osé nous l'apporter[425]...
L'ordonnance royale, qui chargeait M. de Villèle par intérim du portefeuille des Affaires étrangères, en remplacement de M. de Chateaubriand, se terminait ainsi: «Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 6 juin de l'an de grâce 1824».
C'est le dimanche 6 juin que Chateaubriand se présente aux Tuileries; l'ordonnance qui le renvoie du ministère est de ce même jour; elle n'a donc pas pu être portée chez lui la veille au soir. Que devient, en présence de ce fait indéniable, de cette date incontestée, le récit du duc Victor de Broglie? Que deviennent les bruits, les insinuations recueillis dans son livre? J'ai déjà rappelé, dans une des notes de ce volume, le mot d'un ami de Mme de Staël, la belle-mère de l'auteur des Souvenirs, cette parole du duc de Laval-Montmorency, disant un jour: «Les dates! c'est peu élégant!» C'est peu élégant, sans doute, mais c'est quelquefois bien utile.
Non content d'aimer les dates exactes, j'ai un autre faible, je l'avoue, au risque de paraître décidément peu élégant: j'aime les démonstrations complètes. On me permettra donc, pour achever celle que j'ai entreprise, de (p. 508) faire encore une citation. Je l'emprunte aux carnets de M. de Villèle:
Le 6 juin, jour de la Pentecôte, je fus mandé à dix heures du matin chez le roi. Je m'y rendis, et à peine la porte du cabinet était-elle fermée, qu'il me dit: «Villèle, Chateaubriand nous a trahis[426]... Je ne veux pas le voir ici à ma réception d'après la messe. Faites l'ordonnance de son renvoi, qu'on le cherche partout et qu'on la lui remette à temps. Je ne veux pas le voir à ma réception.» Je représentai au roi la brièveté du temps. Il me fit dresser l'ordonnance sur son propre bureau, ce qu'il n'aurait jamais fait dans une autre occasion. Il la signa, j'allai l'expédier. On ne trouva plus M. de Chateaubriand chez lui. Il était déjà dans les appartements de S. A. R. Monsieur, attendant la sortie du prince pour lui présenter ses hommages. Ce fut là seulement qu'on put lui remettre l'ordre du roi qui le révoquait de ses fonctions[427].[Lien vers la Table des Matières]
Le 24 mars 1826, jour du Vendredi-Saint, malgré les fatigues d'un grave étourdissement qui l'avait frappé dans la rue du Bac, la semaine précédente, le duc Mathieu de Montmorency voulut aller prier au tombeau dressé dans sa paroisse. Il vint à Saint-Thomas d'Aquin, dans l'après-midi; mais à peine s'était-il agenouillé pour adorer la croix, qu'il perdit connaissance: il chancela, on accourut près de lui, il n'était plus.
Voulant s'associer à la douleur de Mme Récamier, qui perdait en M. Mathieu de Montmorency le plus ancien (p. 509) et le plus fidèle de ses amis, Chateaubriand composa pour elle une pièce que Madame Lenormant nous a conservée. «Le titre, dit Mme Lenormant (tome II, page 210), est au pluriel dans l'original, ce qui laisse supposer le projet d'autres compositions analogues; mais nous croyons être sûre que cette pièce est la seule de ce genre que M. de Chateaubriand ait écrite.»
PRIÈRES CHRÉTIENNES
POUR QUELQUES AFFLICTIONS DE LA VIE.
Pour la perte d'une personne qui nous était chère.
J'ai senti que mon âme s'ennuyait de la vie, parce qu'il s'y est formé un grand vide, et que la créature qui remplissait mes jours a passé.
Mon Dieu! pourquoi m'avez-vous enlevé celui ou celle qui m'était chère?
Heureux celui qui n'est jamais né, car il n'a pas connu les brisements du cœur et les défaillances de l'âme. Que vous ai-je fait, ô Seigneur, pour me traiter ainsi? Notre amitié, nos entretiens, l'échange mutuel de nos cœurs, n'étaient-ils pas pleins d'innocence? Et pourquoi appesantir ainsi votre main puissante sur un vermisseau? Ô mon Dieu! pardonnez à ma douleur insensée! Je sens que je me plains injustement de votre rigueur. Ne vous avais-je pas oublié pendant le cours de cette amitié trompeuse; ne portais-je pas à la créature un amour qui n'est dû qu'au créateur? Votre colère s'est animée en me voyant épris d'une poussière périssable; vous avez vu que j'avais embarqué mon cœur sur les flots, que les flots, en s'écoulant, le déposeraient au fond de l'abîme.
Être éternel, objet qui ne finit point et devant qui tout s'écroule, seule réalité permanente et stable, vous seul méritez qu'on s'attache à vous; vous seul comblez les insatiables désirs de l'homme que vous portez dans vos mains. En vous aimant, plus d'inquiétudes, plus de crainte de perdre ce qu'on a choisi. Cet amour réunit l'ardeur, la force, la douceur et une espérance infinie. En vous contemplant, ô beauté divine! on sent avec transport que la mort n'étendra jamais ses horribles ombres sur vos traits divins.
(p. 510) Mais, ô miracle de bonté! je retrouverai dans votre sein l'ami vertueux que j'ai perdu! Je l'aimerai de nouveau par vous et en vous, et mon âme entière, en se donnant, se retrouvera unie à celle de mon ami. Notre attachement divin partagera alors votre éternité.[Lien vers la Table des Matières]
La lutte très vive à laquelle avait donné lieu, au début de la session de 1828, la vérification des pouvoirs, l'élection de M. Royer-Collard à la présidence de la Chambre, la nomination de la commission chargée de la rédaction de l'adresse au roi, commission dont la majorité était hostile au précédent ministère, avaient créé pour Mgr de Frayssinous et M. de Chabrol, qui avaient fait partie du ministère Villèle, une situation difficile au sein du nouveau cabinet comme devant les Chambres. Hommes de tact et d'honneur, ils ne voulurent pas devenir un embarras et, le 3 mars 1828, ils offrirent leur démission, qui fut acceptée.
On était à la veille de la discussion de l'adresse. Comprenant qu'au premier jour la majorité ne serait plus avec eux, les ministres supputèrent les voix dont ils pouvaient disposer et présentèrent au roi le résultat de leur calcul. Charles X en fut effrayé, et il fut décidé qu'une démarche serait faite près de Chateaubriand pour lui demander de donner son appui au cabinet, en acceptant le ministère de la marine, laissé vacant par la retraite de M. de Chabrol. Mgr Feutrier, évêque de Beauvais, devait remplacer Mgr de Frayssinous. Mais je dois ici laisser la parole à un témoin particulièrement bien informé. M. Hyde de Neuville:
(p. 511) Quoique la marine, dit-il, ne fût certes point un poste secondaire, néanmoins j'envisageai qu'il ne pouvait convenir à M. de Chateaubriand qu'en y ajoutant la présidence du Conseil. Par suite, je ne voulus pas me mêler aux différentes démarches tentées près de lui, persuadé qu'une secrète irritation que j'avais cru remarquer ne disparaîtrait qu'en face d'une proposition catégorique qui lui prouverait que son admission avait été pleinement consentie par le roi. Mais un mot ambigu, comme tout ce qu'écrivait Laborie avec son écriture illisible, me donna l'espoir que mon idée avait cours parmi les projets mis en avant. Je crus à un succès presque certain, et je me rendis chez Chateaubriand pour vaincre, s'il le fallait, une dernière résistance.
La soirée était avancée, et je le trouvai retiré dans son appartement. On m'annonça; il vint à moi avec cet œil brillant et ce front dégagé des nuages qui le couvraient depuis quelque temps.
—Eh bien, me dit-il, la marine, est-ce fait?
—Je vous le demande, répondis-je, ce serait le plus cher de mes vœux.
Cette réponse, qui mit entre nous un moment de silence, fut rompue par de bonnes et chaleureuses paroles de mon interlocuteur.
Quel ne fut pas mon étonnement lorsqu'il me dit qu'il avait refusé positivement le poste qui lui avait été offert et m'avait désigné pour le remplir! «Chose acceptée et qui vous sera communiquée demain», ajouta-t-il.
«Réfléchissez, je vous en conjure, lui dis-je, que mon entrée au ministère ne le consolidera en aucune façon. Nous perdons en ce moment la seule chance possible de sauver le ministère et peut-être la couronne. Vous savez bien d'ailleurs que ce ne sont pas ceux qui montent à l'assaut qui plantent le drapeau au jour de la victoire. Laissons un nom comme le vôtre lui donner le baptême de la popularité.»
Rien ne put persuader mon illustre ami, et je rentrai chez moi fort troublé, n'ayant jamais songé à être appelé à ce périlleux devoir, dont les dangers dépassent les honneurs, quand on les envisage au point de vue de la responsabilité.[430]
Hyde de Neuville dut céder, et, le 5 mars, il prêtait serment entre les mains du roi,[431] avec Monseigneur Feutrier, nommé ministre des cultes.
(p. 512) En désignant M. Hyde de Neuville pour faire partie du ministère, Chateaubriand n'entendait pas très certainement renoncer lui-même à y entrer. Il croyait, comme son ami, que la popularité de son nom pourrait seule sauver la couronne et son ambition se confondait ici avec les véritables intérêts du pays. Le 15 mars, il adressait à M. Hyde de Neuville la lettre suivante:
Samedi, 15 mars 1828.
Il paraît, mon cher ami, que vous allez parler de mon entrée au Conseil sans portefeuille (ministre secrétaire d'État, membre du conseil de vos ministres). Si l'on fait quelque chose pour moi, l'entrée au Conseil est une réparation qui m'est due, sans quoi on aurait l'air de sanctionner la manière brutale dont j'en ai été écarté; vous surtout, mon ami, étant là et n'ayant pas même pu prendre mon parti et plaider ma cause.
Une fois ministre secrétaire d'État, on fera de moi ce que l'on voudra pour le meilleur service du Roi; mais il n'est pas question de cela dans ce moment. Le premier pas, si on veut le faire, est mon entrée immédiate auprès de vous au Conseil. On me trouvera bon coucheur, je ne prends pas de place et ne me mêle que de mon affaire.
Je dis entrée immédiate, voici pourquoi: ma position n'est plus tenable; je suis, d'une part, regardé comme étant déjà ministre et obligé de répondre que je ne le suis pas, ce qui devient ridicule au dernier point; d'une autre part, tout le parti immense qui s'appuie sur moi, gronde, me reproche mes politesses, prétend qu'on se moque de moi et me pousse violemment à l'opposition.
J'épuise mes forces dans ce double combat; il faut que je prenne bientôt une résolution; vous connaissez les exigences des partis, on ne tergiverse pas longtemps avec eux.
Voilà, mon cher ami, les raisons à exposer; que vos collègues (p. 513) disent oui ou non. Me veulent-ils ou ne me veulent ils pas? S'ils me veulent, obtenez que l'ordonnance paraisse sans se faire attendre, pour décider ma douteuse position et me faire sortir de la race amphibie pour laquelle la nature ne m'a pas fait du tout. Je remets le tout entre vos mains.
Faites-moi dire des nouvelles de Madame de Neuville: elle est aussi bien que possible, m'assure-t-on; si ma pauvre femme n'était presque toujours dans son lit, elle irait savoir des nouvelles de la vôtre.
Chateaubriand.
Cette lettre, dans laquelle perçait un mécontentement visible, émut fort M. Hyde de Neuville qui, dès le lendemain, recevait de son illustre ami une nouvelle missive.
Dimanche, midi, 16 mars 1828.
Je viens de demander l'audience, mon cher ami. Dieu sait ce qu'elle produira, mais j'ai fait quelques réflexions que je dois vous communiquer. Si j'entre, il faut que j'entre seul; c'est alors une distinction particulière; avec deux collègues sans portefeuille, je m'amoindris: c'est un plan, un système; ce que je peux valoir disparaît; ce n'est pas moi qu'on a appelé, c'est trois personnes. Ces personnes très honorables qu'on pourrait m'adjoindre viendront ensuite; je dois commencer. Tenons-nous-en là.
Mais pour dire la vérité, mon cher ami, je crains que ce ne soit là que des demi-partis toujours funestes en dernier résultat. Faites recréer la maison du Roi en conservant même La Bouillerie, comme M. de Pradel était auprès de M. de Blacas. Prenez vite Casimir Perier, donnez les postes à Delalot avec entrée au Conseil; les forêts à Bertin de Vaux; et, si vous pouviez, Sébastiani à la guerre, tout serait dit et le triomphe assuré. Songez-y sérieusement; un effort, j'en suis persuadé, réussirait. Si vous attendez, la majorité vous échappera, et vous serez tous enveloppés dans une même catastrophe.
Mon cher ami, je vous aime trop pour vous flatter. J'ai contribué à vous mettre où vous êtes; je serais au désespoir de vous y voir périr. Prenez garde au sommeil des ministres, à la faiblesse de vos appuis, à la fascination du pouvoir; j'y ai été pris. Retirez-vous mille fois plutôt que de vous exposer à une chute. Si vous parlez ferme et clair, on vous donnera qui vous voudrez: (p. 514) l'avenir est entre vos mains. Mais les Chambres, les journaux, l'opinion générale pressent les événements; ne croyez pas que vous ayez du temps devant vous. Je vous en avertis de bonne heure, pour ne pas vous parler trop tard.
À vous pour la vie,
Chateaubriand.
Chateaubriand, ministre secrétaire d'État, membre du conseil des ministres, Casimir Perier à l'intérieur, Sébastiani à la guerre—c'était le salut. Il était permis de l'espérer, puisqu'aussi bien Charles X ne se refusait pas à l'idée d'introduire dans le gouvernement quelques hommes comme M. Casimir Perier. La combinaison cependant n'aboutit pas, et, le 22 mars, Chateaubriand adressait à Hyde de Neuville cette dernière lettre:
Samedi matin, 22 mars 1828.
Réflexions faites, mon cher ami, il vaut mieux que je n'aille pas chez vous ce soir: on parle toujours mal de soi, et moi plus qu'un autre. D'ailleurs, qu'ai-je à dire que vous ne connaissiez? J'avais déjà peu d'ardeur pour entrer dans le Conseil, et, depuis l'audience d'hier, elle est encore singulièrement refroidie. Néanmoins, à cause de vous et pour vous seul, j'entrerai sans portefeuille, si vos collègues le veulent et montent à l'assaut.
Voilà tout, vous savez cela et vous le direz à merveille. Souvenez-vous bien seulement qu'après lundi, je ne suis plus maître de retenir personne, et la guerre continuera malgré moi.
Je serais, je vous assure, mon cher ami, très effrayé pour vous si je ne savais que vous avez toujours pour vous sauver, quand il en sera temps, le moyen d'une retraite qui ne fera qu'augmenter votre réputation d'homme de bien et de courage. Comme le ministère est constitué, il n'ira pas à la fin de la session; vous ne devez pas tomber avec lui. Votre démission isolée, ou vous rendra maître de tout, ou vous sauvera du naufrage commun. Qu'arrivera-t-il après la chute du ministère actuel? Un ministère de mes ci-devant amis mêlés des amis de M. de Villèle.
Je le crois, ce ministère amènera un mouvement politique; mais rien que la peur, si elle s'en mêle, ne me parait pouvoir empêcher cet événement, d'après ce que j'ai vu hier.
(p. 515) Ainsi donc, quand vous aurez fait tout ce que vous aurez pu pour éclairer le Roi, pour amener le bien, vous déclarerez n'avoir accepté le portefeuille avec une grande répugnance que dans l'espoir d'arranger les choses et pour ne pas laisser le Roi dans l'embarras, sans appui et sans conseil; que votre espoir ayant été trompé, vous vous retirez satisfait d'avoir rempli un devoir pénible.
Votre position politique reste ainsi admirable, et vous grandissez encore dans l'opinion publique.
Vous voyez, mon cher ami, que je suis beaucoup plus occupé de vous que de moi.
Tout à vous,
Chateaubriand.[432]
TROISIÈME PARTIE
Les Cent-Jours à Paris. Effet du passage de la légitimité en France. — Étonnement de Bonaparte. — Il est obligé de capituler avec les idées qu'il avait crues étouffées. — Son nouveau système. — Trois énormes joueurs restés. — Chimères des libéraux. — Clubs et fédérés. — Escamotage de la République: l'Acte additionnel. — Chambre des représentants convoquée. — Inutile Champ de Mai. — Soucis et amertumes de Bonaparte. — Résolution à Vienne. — Mouvement à Paris. — Ce que nous faisions à Gand. — M. de Blacas. — Bataille de Waterloo. — Confusion à Gand. — Quelle fut la bataille de Waterloo. — Retour de l'Empereur. — Réapparition de La Fayette. — Nouvelle abdication de Bonaparte. — Scènes orageuses à la Chambre des Pairs. — Présages menaçants pour la seconde Restauration. — Départ de Gand. — Arrivée à Mons. — Je manque ma première occasion de fortune dans ma carrière politique. — M. de Talleyrand à Mons. Scène avec le roi. — Je m'intéresse bêtement à M. de Talleyrand. — De Mons à Gonesse. — Je m'oppose avec M. le comte Beugnot à la nomination de Fouché comme ministre: mes raisons. — Le duc de Wellington l'emporte. — Arnouville. — Saint-Denis. — Dernière conversation avec le roi. 1
Bonaparte à la Malmaison. — Abandon général. — Départ de la Malmaison. — Rambouillet. — Rochefort. — Bonaparte se réfugie sur la flotte anglaise. — Il écrit au prince régent. — Bonaparte sur le Belléphoron. — Torbay. — Acte qui confine Bonaparte à Sainte-Hélène. — Il passe sur le Northumberland et fait voile. — Jugement sur Bonaparte. — Caractère de Bonaparte. — Si Bonaparte nous a laissé en renommée ce qu'il nous a ôté en force. — Inutilité des vérités ci-dessus exposées. — Île de Sainte-Hélène. — Bonaparte traverse l'Atlantique. — Napoléon prend terre à Sainte-Hélène. — Son établissement à Longwood. — Précautions. — Vie à Longwood. — Visites. — Manzoni. — Maladie de Bonaparte. — Ossian. — Rêveries de Napoléon à la vue de la mer. — Projets d'enlèvement. — Dernière occupation de Bonaparte. — Il se couche et ne se relève plus. — Il dicte son testament. — Sentiments religieux de Napoléon. — L'aumônier Vignale. — Napoléon apostrophe Antomarchi, son médecin. — Il reçoit les derniers sacrements. — Il expire. — Funérailles. — Destruction du monde napoléonien. — Mes derniers rapports avec Bonaparte. — Sainte-Hélène depuis la mort de Napoléon. — Exhumation de Bonaparte. — Ma visite à Cannes. 61
Changement du monde. — Années de ma vie 1815, 1816. — Je suis nommé pair de France. — Mon début à la tribune. — Divers discours. — Monarchie selon la Charte. — Louis XVIII. — M. Decazes. — Je suis rayé de la liste des ministres d'État. — Je vends mes livres et ma Vallée. — Suite de mes discours en 1817 et 1818. — Réunion Piet. — Le Conservateur. — De la morale des intérêts matériels et de celle des devoirs. — Année de ma vie 1820. — Mort du duc de Berry. — Naissance du duc de Bordeaux. — Les dames de la halle de Bordeaux. — Je fais entrer M. de Villèle et M. de Corbière dans leur premier ministère. — Ma lettre au duc de Richelieu. — Billet du duc de Richelieu et ma réponse. — Billets de M. de Polignac. — Lettres de M. de Montmorency et de M. Pasquier. — Je suis nommé ambassadeur à Berlin. — Je pars pour cette ambassade. 127
Année de ma vie 1821. — Ambassade de Berlin. — Arrivée à Berlin. — M. Ancillon. — Famille royale. — Fêtes pour le mariage du grand-duc Nicolas. — Société de Berlin. — Le comte de Humboldt. — M. de Chamisso. — Ministres et ambassadeurs. — La princesse Guillaume. — L'Opéra. — Réunion musicale. — Mes premières dépêches. — M. de Bonnay. — Le Parc. — La duchesse de Cumberland. — Mémoire commencé sur l'Allemagne. — Charlottenbourg. — Intervalle entre l'ambassade de Berlin et l'ambassade de Londres. — Baptême de M. le duc de Bordeaux. — Lettre à M. Pasquier. — Lettre de M. de Bernstorff. — Lettre de M. Ancillon. — Dernière lettre de Madame La duchesse de Cumberland. — M. de Villèle, ministre des finances. — Je suis nommé à l'ambassade de Londres. 179
Année 1822. — Premières dépêches de Londres. — Conversation avec George IV sur M. Decazes. — Noblesse de notre diplomatie sous la légitimité. — Séance du Parlement. — Société anglaise. — Suite des dépêches. — Reprise des travaux parlementaires. — Bal pour les Irlandais. — Duel du duc de Bedford et du duc de Buckingham. — Dîner à Royal-Lodge. — La marquise de Conyngham et son secret. — Portraits des ministres. — Suite de mes dépêches. — Pourparlers sur le Congrès de Vérone. — Lettre à M. de Montmorency; sa réponse qui me laisse entrevoir un refus. — Lettre de M. de Villèle plus favorable. — J'écris à Madame de Duras. — Mort de Lord Londonderry. — Nouvelle lettre de M. de Montmorency. — Voyage à Hartwell. — Billet de M. de Villèle m'annonçant ma nomination au Congrès. — Fin de la vieille Angleterre. — Charlotte. — Réflexions. — Je quitte Londres. — Années 1824, 1825, 1826 et 1827. — Délivrance du roi d'Espagne. — Ma destitution. — L'opposition me suit. — Derniers billets diplomatiques. — Neuchâtel en Suisse. — Mort de Louis XVIII. — Sacre de Charles X. — Réception des chevaliers des ordres. 233
Je réunis autour de moi mes anciens adversaires. — Mon public est changé. — Extrait de ma polémique après ma chute. — Séjour à Lausanne. — Retour à Paris. — Les Jésuites. — Lettre de M. de Montlosier et ma réponse. — Suite de ma polémique. — Lettre du général Sébastiani. — Mort du général Foy. — La loi de Justice et d'Amour. — Lettre de M. Étienne. — Lettre de M. Benjamin Constant. — J'atteins au plus haut point de mon importance politique. — Article sur la fête du roi. — Retrait de la loi sur la police de la presse. — Paris illuminé. — Billet de M. Michaud. — Irritation de M. de Villèle. — Charles X veut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. — Je lui écris: ma lettre. — La revue. — Licenciement de la garde nationale. — La Chambre élective est dissoute. — La nouvelle Chambre. — Refus de concours. — Chute du ministère Villèle. — Je contribue à former le nouveau ministère et j'accepte l'ambassade de Rome. — Examen d'un reproche. 313
Madame Récamier. — Enfance de Madame Récamier. — Suite du récit de Benjamin Constant: Madame de Staël. — Voyage de Madame Récamier en Angleterre. — Premier voyage de Madame de Staël en Allemagne. — Madame Récamier à Paris. — Projets des généraux. — Portrait de Bernadotte. — Procès de Moreau. — Lettres de Moreau et de Masséna à Madame Récamier. — Mort de M. Necker. — Retour de Madame de Staël. — Madame Récamier à Coppet. — Le prince Auguste de Prusse. — Second voyage de Madame de Staël en Allemagne. — Château de Chaumont. — Lettre de Madame de Staël à Bonaparte. — Madame Récamier et M. Mathieu de Montmorency sont exilés. — Madame Récamier à Châlons. — Madame Récamier à Lyon. — Madame de Chevreuse. — Prisonniers espagnols. — Madame Récamier à Rome. — Albano. — Canova: ses lettres. — Le pêcheur d'Albano. — Madame Récamier à Naples. — Le duc de Rohan-Chabot. — Le roi Murat: ses lettres. — Madame Récamier revient en France. — Lettre de Madame de Genlis. — Lettres de Benjamin Constant. — Articles de Benjamin Constant au retour de Bonaparte à l'île d'Elbe. — Madame de Krüdener. — Le duc de Wellington. — Je retrouve Madame Récamier. — Mort de Madame de Staël. — L'Abbaye-aux-Bois. 369
Paris. (France).—Imp. Paul Dupont (Cl.).—8. 8. 1925
Note 1: Le Journal des Patriotes de 1789, fondé par Réal et Méhée de Latouche, avait paru du 18 août 1795 au 16 août 1796. Il ressuscita pendant les Cent-Jours, du 1er mai au 3 juillet 1815, sous ce titre: Le Patriote de 1789, journal du soir, politique et littéraire. Réal, alors préfet de police, en était l'inspirateur, et Méhée de La Touche le rédacteur principal. Ce Méhée, une des plus rares figures de coquins de la période révolutionnaire et impériale, avait été, en 1792, secrétaire greffier adjoint de la Commune dite du 10 août, et il avait, en cette qualité, joué un rôle dans la préparation des massacres de septembre. Le 17 septembre, la section du Panthéon délibérait sur le genre de gouvernement que l'on devait demander à la Convention; il envoya son vœu dans un billet ainsi conçu: «Si jamais ce que l'on appelait un roi, ou quelque chose qui ressemble à un roi, ose se présenter en France, et qu'il vous faille quelqu'un pour le poignarder, inscrivez-moi au nombre des candidats. Voilà mon nom: Méhée.» Après le 18 brumaire, il rédigea le Journal des Hommes libres, qui lui valut bientôt d'être arrêté en vertu d'un ordre des Consuls qui le qualifiait de septembriseur. Exilé d'abord à Dijon, puis à l'île d'Oléron, il s'évada sans trop de peine, ne fut pas recherché par la police, qui avait ses raisons pour fermer les yeux, et passa en Angleterre. Il se présenta au gouvernement anglais et au comte d'Artois comme l'agent d'un parti puissant qui voulait renverser Bonaparte. De retour en France, il publia un Mémoire qui dévoilait ses nouvelles infamies. Cette affaire lui valut beaucoup d'argent anglais et français, et il se fixa à Paris, où il étala une sorte de faste, jusqu'au jour où il retomba dans sa détresse ordinaire. Au mois de juillet 1815, il lui fallut quitter la France et se réfugier en Suisse. Après avoir habité successivement l'Allemagne et la Belgique, il put rentrer en 1819, publia quelques brochures discréditées d'avance par son nom et mourut dans la misère en 1826, à l'âge de soixante-six ans.[Retour au Texte Principal]
Note 2: Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, né à Genève le 9 mai 1773, mort dans la même ville le 25 juin 1842. Ses principaux ouvrages sont: l'Histoire des républiques italiennes, seize volumes in-8o (1807-1818), et l'Histoire des Français, vingt neuf volumes in-8o (1821-1842). C'est en 1813 qu'il vint pour la première fois à Paris. Pendant les Cent-Jours, il donna au Moniteur une série d'articles en faveur de l'Acte additionnel, et les réunit en un volume sous le titre d'Examen de la Constitution française. Ils attirèrent l'attention de l'Empereur, qui manda Sismondi et s'entretint longuement avec lui.[Retour au Texte Principal]
Note 3: Lucien Bonaparte.[Retour au Texte Principal]
Note 4: Philippe-Antoine, comte Merlin, dit Merlin de Douai (1754-1838), député à la Constituante, à la Convention, au Conseil des Anciens, et à la Chambre des représentants en 1815; ministre de la Justice en 1795, puis ministre de la police générale; membre du Directoire après le 18 fructidor; sous l'Empire, procureur général à la Cour de cassation, conseiller d'État, comte, grand-officier de la Légion d'honneur. Destitué de ses fonctions en 1814, bien qu'il eût des premiers adhéré à Louis XVIII, il fut, après le 20 mars, rappelé par l'Empereur à la Cour de cassation, avec le titre de ministre d'État. Le 24 juillet 1815, il fut exilé comme régicide ayant rempli des fonctions pendant les Cent-Jours. Il se retira en Hollande et y vécut jusqu'à la révolution de 1830, qui lui permit de rentrer en France. Il mourut à Paris, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Jurisconsulte de premier ordre, il eut l'infamie de rédiger la loi des suspects. Si très peu d'hommes, pendant la Révolution, ont eu plus de talent que Merlin de Douai, sa lâcheté fut plus grande encore que son talent.[Retour au Texte Principal]
Note 5: L'Acte additionnel fut publié dans le Moniteur du 23 avril 1815. Le même jour paraissait un décret portant que les Français étaient appelés à consigner leur vote sur des registres ouverts dans toutes les communes, et que le dépouillement aurait lieu à l'assemblée du Champ de Mai convoquée à Paris pour le 26 mai.[Retour au Texte Principal]
Note 6: La surprise et le mécontentement furent universels. Un témoin peu suspect, Thibaudeau, a dit: «L'effet fut prompt comme la foudre; à l'enthousiasme des patriotes succéda incontinent un froid glacial; ils tombèrent dans le découragement, ne prévirent que malheurs et s'y résignèrent.» (Le Consulat et l'Empire, t. X, p. 325-326).—Un Anglais, présent alors à Paris, et qui, en sa qualité d'étranger, était un spectateur impartial du mouvement des idées et des faits, M. Hobbouse, d'ailleurs favorable à Napoléon, rend le même témoignage: «Je ne me rappelle pas, dit-il, avoir vu dans l'opinion un changement pareil à celui qui eut lieu à Paris, lorsque parut l'Acte additionnel.» (Lettres sur les Cent-Jours.) Les bonapartistes eux-mêmes étaient loin d'être satisfaits. «Les napoléonistes autoritaires, dit M. Henry Houssaye (1815, tome I, p. 546), déplorèrent ces concessions libérales. Ils dirent que l'empereur en transigeant avec l'anarchie faiblissait et s'affaiblissait, ils le regardèrent comme perdu.»—Voir Alfred Nettement, Histoire de la Restauration, tome II, p. 282; Benjamin Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, tome II, 70-71; Mémoires de La Fayette, tome V, 420; Villemain, Souvenirs contemporains, tome II, 182-183.[Retour au Texte Principal]
Note 7: Aux termes du décret du 22 avril, la cérémonie du Champ de Mai avait été fixée au 26 mai, mais il fallut la remettre au 1er juin, des retards s'étant produits dans l'envoi des registres électoraux et les délégués tardant à arriver.[Retour au Texte Principal]
Note 8: La fête fut magnifique, mais ce fut une fête de théâtre. On avait dressé à la hâte, au Champ de Mars, une estrade, un trône, un autel. Les acteurs ne manquaient pas, et le plus grand de tous était là, revêtu d'un costume, qui était aussi un costume de théâtre: une tunique et un manteau nacarat, des culottes de satin blanc, des souliers à bouffettes, une toque de velours noir orné de plumes blanches. Ses frères étaient entièrement vêtus de velours blanc, avec petits manteaux à l'espagnole, brodés d'abeilles d'or, et toque tailladée. Ses hérauts d'armes, ses chambellans, ses pages, étaient habillés comme des personnages d'opéra-comique. Ce Champ de Mai qui, dans la pensée de Napoléon, devait évoquer les souvenirs de Charlemagne, réveillait dans l'esprit des spectateurs les souvenirs de Jean de Paris, le héros d'un opéra de Boiëldieu alors très en vogue.[Retour au Texte Principal]
Note 9: En débarquant à Cannes, Murat s'était mis à la disposition de l'Empereur. Celui-ci, craignant la contagion du malheur, ne répondit pas au roi détrôné et lui fit interdire par Fouché l'accès de Paris.[Retour au Texte Principal]
Note 10: Adresse de la Chambre des Pairs du dimanche 11 juin.—Moniteur du 12 juin.[Retour au Texte Principal]
Note 11: Voyez plus haut celle du maréchal Soult. Ch.[Retour au Texte Principal]
Note 12: Allusion au maréchal Soult.[Retour au Texte Principal]
Note 13: La mission de porter l'épée du connétable, au sacre de Charles X, fut confiée au maréchal Moncey. Les maréchaux Soult, Mortier et Jourdan furent appelés à porter le sceptre, la main de justice et la couronne.[Retour au Texte Principal]
Note 14: Dans la nuit du 6 au 7 mars. La nouvelle avait été envoyée par le consul général d'Autriche à Gênes.[Retour au Texte Principal]
Note 15: Charles-Alexandre, comte Pozzo di Borgo, né à Alata, (Corse) le 8 mars 1764. Député de la Corse à l'Assemblée législative de 1791, il se rangea parmi les monarchistes constitutionnels et se tint jusqu'au 10 août en relations fréquentes avec le roi. En 1796, obligé de quitter la Corse, il se rendit en Angleterre, puis à Vienne, et se mit enfin au service de la Russie. À la fois militaire et diplomate, il paie de sa personne sur les champs de bataille, et il déploie, comme négociateur, dans les missions les plus difficiles, les plus rares qualités de pénétration et de souplesse. Pozzo fut le plus redoutable ennemi de Bonaparte et nul n'a plus contribué à sa chute. C'est lui qui détermina l'empereur Alexandre à marcher sur Paris sans s'inquiéter des mouvements que faisait Napoléon sur ses derrières. La fameuse proclamation du prince de Schwarzenberg, qui la première parla des Bourbons, fut de même l'œuvre du comte Pozzo; le prince de Schwarzenberg ne l'avait pas signée, et ce fut Alexandre qui, dans une entrevue au quartier général de Bondy, lui dit: «Mon cher prince, vous avez fait là une belle proclamation, elle est parfaite; signez-la, elle vous fera honneur.» Et Schwarzenberg, un peu par amour-propre, un peu par déférence, la scella de son nom. Napoléon renversé, Pozzo fut nommé ambassadeur de Russie auprès de la cour de France. Il suivit Louis XVIII à Gand et resta ambassadeur à Paris jusqu'en 1835. À cette époque, il échangea ce poste contre celui d'ambassadeur à Londres, où il représenta l'empereur Nicolas jusqu'en 1839. Il demanda alors sa retraite, et vint passer les dernières années de sa vie à Paris, où il mourut le 15 février 1842. La mère de MM. Louis et Charles Blanc appartenait à la famille de Pozzo di Borgo.[Retour au Texte Principal]
Note 16: Le baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche près la cour de France. Ce n'était pas précisément un ambassadeur à la façon de Chateaubriand. Je trouve sur lui ce petit détail dans l'Histoire de la Restauration, par M. Louis de Viel-Castel, t. XVI, p. 256: «Le baron de Vincent était célibataire et ne tenait pas une grande maison... On raconte que les jours où il donnait à dîner, il se tenait sans affectation près de la porte de son salon, ce qui dispensait d'annoncer et de nommer les convives.»[Retour au Texte Principal]
Note 17: Ferdinand, baron d'Eckstein, né à Altona (Danemark) en septembre 1790, de parents israélites. Il embrassa le catholicisme à Rome en 1806, se battit dans les rangs des volontaires de Lutzow pendant la campagne de 1813, et, à la chute de l'Empire, entra au service de la Hollande. Gouverneur de Gand à l'époque des Cent-Jours, les égards qu'il eut pour le roi Louis XVIII lui valurent la faveur de ce prince. Il le suivit en France, devint successivement commissaire général à Marseille et inspecteur général du ministère de la police, reçut le titre de baron et fut enfin attaché, en qualité d'historiographe, au ministère des affaires étrangères. Non content d'écrire dans les journaux ultra-royalistes, le Drapeau blanc et la Quotidienne, il fonda en 1826 une revue politique et religieuse, Le Catholique. Orientaliste distingué, polémiste ardent et convaincu, il fut l'un des premiers rédacteurs du Correspondant, collabora après 1830 à l'Avenir et à la Revue archéologique et ne cessa, pendant plus de trente ans, de multiplier ses écrits en faveur de la religion. Le baron d'Eckstein est mort à Paris le 25 novembre 1861.[Retour au Texte Principal]
Note 18: Guillaume-Frédéric, duc de Brunswick, fils de celui qui avait commandé en 1792 les armées coalisées contre la France, et qui avait été, en 1806, mortellement blessé près d'Auerstædt.[Retour au Texte Principal]
Note 19: Bulow (Frédéric-Guillaume de), comte de Dennewitz, né en 1765, l'un des meilleurs généraux prussiens. En 1813, il avait battu le maréchal Oudinot à Gross-Beeren et le maréchal Ney à Dennewitz, et avait contribué à la victoire de Leipsick. Il joua un rôle très important à Waterloo, où sa marche sur le flanc droit de l'armée française décida du sort de la journée. Il avait depuis 1814, le titre de commandant général de l'infanterie prussienne et le gouvernement de la Prusse orientale. Après la campagne de 1815, il retourna au chef-lieu de son gouvernement à Kœnigsberg, où il mourut en 1816.[Retour au Texte Principal]
Note 20: Guillaume-Frédéric (1772-1843), fils de Guillaume V, le dernier stathouder de Hollande, et qui allait lui-même devenir roi des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume Ier. Il commandait à Waterloo un des corps de l'armée de Wellington. Son fils, Guillaume-Georges-Frédéric (1792-1848), qui sera plus tard roi de Hollande sous le nom de Guillaume II, assistait également à la bataille comme aide de camp du généralissime anglais, et il fut blessé comme son père.[Retour au Texte Principal]
Note 21: Voir, au tome III, la note 2 de la page 205.[Retour au Texte Principal]
Note 22: M. Thiers, dans son vingtième volume, publié en 1862, aura été le dernier défenseur de la phrase légendaire. «À ce moment, dit-il, on entend ce mot qui traversera les siècles, proféré selon les uns par le général Cambronne, selon les autres par le colonel Michel: La garde meurt et ne se rend pas.» En dépit de M. Thiers, nul ne croit plus à la réalité de la fameuse phrase, que le général Cambronne a d'ailleurs toujours désavouée, notamment en 1835, dans un banquet patriotique, qu'il présidait à Nantes. (Voir Levot, Biographie bretonne, au mot Cambronne.) Le seul point sur lequel on discute encore est celui de savoir si Cambronne a dit—ou n'a pas dit—le monosyllabe que Victor Hugo a mis dans sa bouche. (Les Misérables, tome III, liv. I, ch. 15, p. 103.)—Le mieux, je crois, est de s'en tenir à ces lignes d'un judicieux historien, M. Alfred Nettement: «Le mot prêté à Cambronne, leur chef: «La garde meurt et ne se rend pas,» n'a point été dit; mais l'action est supérieure aux paroles; ces héroïques soldats, entourés de monceaux de cadavres tombés sous leurs balles et leurs baïonnettes, sont tous mort pour ne pas se rendre.» (Histoire de la Restauration, tome II, p. 567).[Retour au Texte Principal]
Note 23: Henri-Amédée-Mercure, comte de Turenne (1776-1852). Officier au régiment du Roi quand éclata la Révolution, il refusa d'émigrer, et voulut reprendre du service militaire; mais, incarcéré à Lyon comme suspect pendant la Terreur, il ne fut remis en liberté qu'après le 9 thermidor, et servit à l'armée des Pyrénées occidentales. Le décret de 1794 contre les nobles le força de quitter l'armée; il resta dans la vie privée jusqu'à la proclamation de l'Empire, et fut alors un des premiers à se rallier au nouveau pouvoir. Tandis que sa femme devenait dame du palais de l'impératrice Joséphine, lui-même était attaché à la personne de l'Empereur comme officier d'ordonnance. Chambellan de Napoléon après Wagram, premier chambellan et maître de la garde-robe en 1812, colonel pendant la campagne de Russie, il fut créé comte de l'Empire le 11 novembre 1813. Il suivit Napoléon pendant la campagne de France, assista aux adieux de Fontainebleau, mais ne put obtenir l'autorisation d'accompagner l'Empereur à l'île d'Elbe. Louis XVIII le nomma sous-lieutenant aux mousquetaires gris et chevalier de Saint-Louis. Aux Cent-Jours, il reprit son service auprès de Napoléon, fut nommé pair le 2 juin 1815 et assista à la bataille de Ligny et à celle de Waterloo, où il tenta des efforts désespérés contre les gardes anglaises. La seconde Restauration lui supprima ses titres et ses fonctions; mais elle ne lui tint pas rigueur jusqu'au bout. Le 31 octobre 1829, elle le nomma maréchal de camp honoraire. M. de Turenne se rallia à la monarchie de Juillet et devint pair de France le 19 novembre 1831. Frappé de cécité, quelques années plus tard, il termina ses jours dans la retraite.[Retour au Texte Principal]
Note 24: C'est plus rapide encore que Quinte-Curce: Darius tanti modo exercitus rex... fugiebat.[Retour au Texte Principal]
Note 25: Jacques-Antoine Manuel (1775-1827). Il était avocat à Aix, lorsque les électeurs des Cent-Jours l'envoyèrent à la Chambre des représentants. Manuel ne parut à la tribune qu'après Waterloo. Le 23 juin, il fit voter un ordre du jour portant que Napoléon II était devenu empereur des Français. Le 27, il fit prévaloir l'urgence de la discussion de la Constitution et du budget. Le 3 juillet, il présenta un projet d'adresse qui fut trouvé trop vague et qu'il défendit en protestant bien haut qu'il croyait le bonheur de la France incompatible avec le retour des Bourbons; le 5, il demanda, en présence des propositions théoriques de Garat, qu'on mît dans la Constitution plus de «positif» et moins d'«idéologie». Le 7, à la nouvelle que les Alliés s'étaient engagés à replacer Louis XVIII sur le trône, il s'éleva contre un acte qui blessait «notre liberté et nos droits».—Membre de la Chambre des députés de 1818 à 1824, il fit au gouvernement royal une opposition que rendait redoutable son remarquable talent d'improvisateur. Lors de la discussion sur la guerre d'Espagne, le 27 février 1823, il répondit au magnifique discours par lequel Chateaubriand, alors ministre des Affaires étrangères, avait défendu l'expédition. Par deux fois, il prononça des paroles, où ses collègues virent une apologie du régicide. Le 2 mars, la Chambre décida qu'il serait exclu des séances pendant toute la durée de la session. Le lendemain, Manuel vint prendre place à son banc. Sur son refus de se retirer, et après que le sergent Mercier, commandant le détachement de garde nationale qui faisait le service d'honneur à la Chambre des députés, eut refusé de porter la main sur lui, il fut expulsé par le colonel de Foucault requis, à cet effet, avec un détachement de gendarmerie, par le président, M. Ravez.—Manuel ne fut pas réélu; il passa dans la retraite les dernières années de sa vie et mourut chez son ami M. Laffitte au château de Maisons (Seine-et-Oise) le 22 août 1827. Le 24 août, son corps fut transporté au Père-Lachaise, suivi d'une foule immense; malgré les précautions prises par la police, qui n'avait accordé le passage que par les boulevards extérieurs, ce ne fut qu'à grand'peine qu'on put éviter des troubles sérieux.[Retour au Texte Principal]
Note 26: Le 22 juin 1815.[Retour au Texte Principal]
Note 27: Nicolas-Marie Quinette (1762-1821). Député de l'Aisne à la Législative, puis à la Convention, il vota la mort du roi. Au mois d'avril 1793, il fut, avec les conventionnels Camus, Lamarque et Bancal des Issarts et le ministre de la guerre Beurnonville, envoyé à l'armée de Dumouriez pour faire arrêter ce général. Ce fut ce dernier qui les fit arrêter et les livra au prince de Cobourg. Quinette et ses collègues furent soumis à une assez dure captivité jusqu'au 25 décembre 1795, jour où ils furent échangés, à Bâle, contre la fille de Louis XVI. Sous le Directoire, il fit partie du Conseil des Cinq-Cents et devint ministre de l'Intérieur. Préfet de la Somme après le 18 brumaire, il fut, en 1810, nommé conseiller d'État et fait baron, ce qui ne l'empêcha pas, en 1814, d'adhérer à la chute de Napoléon. Aux Cent-Jours, il se présenta, dès le 26 mars, à l'Empereur, qui lui confia une mission extraordinaire dans l'Eure, la Seine-Inférieure et la Somme, avec le titre de conseiller d'État, et l'appela, le 2 juin 1815, à siéger dans la Chambre des pairs impériale. Atteint par la loi du 12 janvier 1816 contre les régicides qui avaient rempli des fonctions pendant les Cent-Jours, il passa aux États-Unis, où il resta deux ans, revint en 1818 en Europe et se fixa à Bruxelles, où il mourut le 14 juin 1821.[Retour au Texte Principal]
Note 28: Paul, comte Grenier (1768-1827). Général de division dès 1794, il servit avec distinction dans les guerres de la Révolution et de l'Empire. À la première Restauration, il reçut de Louis XVIII le commandement de la 8e division militaire. Élu, en 1815, à la Chambre des représentants, il en fut nommé vice-président. Sous la seconde Restauration, il fut membre de la Chambre des députés de 1818 à 1822. À la fin de la législature, il se retira dans sa terre de Morembert (Aube), où il mourut le 18 avril 1827.[Retour au Texte Principal]
Note 29: Horace-François-Bastien Sébastiani (1772-1851). Il coopéra au 18 brumaire, se distingua à Marengo, fut envoyé comme ambassadeur à Constantinople (1802-1807) et il décida la Turquie à déclarer la guerre à la Russie et à résister aux Anglais. En 1808, Napoléon lui donna un commandement en Espagne, où il remporta d'abord des succès, qui lui valurent d'être créé comte de l'Empire; puis il se laissa souvent surprendre: «En vérité, disait Napoléon, Sébastiani me fait marcher de surprise en surprise.» Il se rallia aux Bourbons en 1814, revint à l'Empereur en 1815 et fut élu représentant à la Chambre des Cent-Jours par l'arrondissement de Vervins. Sous la seconde Restauration, député de 1816 à 1824 et de 1826 à 1830, il siégea sur les bancs de l'opposition. Après la révolution de Juillet, il fut successivement ministre des Affaires étrangères (août 1830-octobre 1832), ambassadeur à Naples (1834) et à Londres (1835-1840). Louis-Philippe lui donna, le 21 octobre 1840, le bâton de maréchal de France. Il passa ses dernières années dans la retraite, accablé par l'assassinat de sa fille, la duchesse de Praslin (17 août 1847). Marié en premières noces (1805) à Mlle de Coigny, qui mourut en couches en 1807, il était, par son second mariage avec Mlle de Gramont, proche parent du prince de Polignac.[Retour au Texte Principal]
Note 30: Louis-Germain Doulcet, comte de Pontécoulant (1764-1853). Député du Calvados à la Convention, il vota, dans le procès du roi, pour le bannissement. Après le 31 mai 1793, il dénonça la Commune de Paris et déclara que la Convention n'était pas libre. Au mois de juillet suivant, choisi comme défenseur par Charlotte Corday, il refusa de l'assister devant le Tribunal révolutionnaire, soit qu'il ait craint pour lui-même, soit qu'il ait eu peur d'aggraver par son intervention la situation de sa compatriote. Charlotte Corday, au moment de monter sur l'échafaud, lui écrivit une lettre qui commençait ainsi: «Doulcet Pontécoulant est un lâche d'avoir refusé de me défendre...» Le 3 octobre 1793, il fut mis hors la loi, mais il échappa aux poursuites en se réfugiant chez une amie, Mme Lejay, libraire, qui avait été publiquement la maîtresse de Mirabeau, et qu'il épousa l'année suivante. Préfet de la Dyle sous le Consulat, il fut nommé sénateur le 1er février 1802 et créé comte le 26 avril 1808. En 1809, il accepta de remplir dans le Calvados une mission de police et il fut le principal agent de l'assassinat du comte d'Aché. (Voir Louis de Frotté et les insurrections normandes, par L. de la Sicotière, t. II, p. 685.) Cela ne l'empêcha pas d'être nommé pair de France par Louis XVIII le 4 juin 1814 et de siéger sans interruption à la Chambre haute de 1814 à 1848. On a de lui des Mémoires publiés en 1862.[Retour au Texte Principal]
Note 31: Voyez les Œuvres de Napoléon, tome 1er, dernières pages. Ch.[Retour au Texte Principal]
Note 32: Auguste-Charles-Joseph, comte de Flahaut de la Billarderie (1785-1870), pair des Cent-Jours, pair de France de 1831 à 1848, sénateur du second Empire, ambassadeur à Londres de 1860 à 1862, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur de 1861 à 1870. Général de division en 1813, à vingt-huit ans, il déploya en faveur de Napoléon, après Waterloo, les plus généreux efforts. Il mourut le 1er septembre 1870, le jour du désastre de Sedan, et ne vit pas la chute de la dynastie à laquelle le rattachaient de secrètes et intimes affections. Il était le père du duc de Morny, frère naturel de Napoléon III.—Le père du comte de Flahaut avait péri sur l'échafaud en 1794; sa mère, la comtesse de Flahaut, remariée en 1802 au marquis de Souza-Bothello, a pris rang parmi nos meilleurs romanciers. Quelques-uns de ses romans, Adèle de Sénanges, Charles et Marie, Eugène de Rothelin, sont des œuvres parfaites, du sentiment le plus délicat et du goût le plus pur.[Retour au Texte Principal]
Note 33: Antoine, comte Drouot (1774-1847), général de division d'artillerie, et, au jugement de Napoléon, le premier officier de son arme. Il avait suivi l'Empereur à l'île d'Elbe, s'était opposé autant qu'il avait pu au projet de retour en France; mais, lorsque ce projet avait été décidé, il avait pris le commandement de l'avant-garde. Le 2 juin 1815, il fut nommé pair des Cent-Jours. Il était à Waterloo. Après la défaite, il accourut à la Chambre des pairs, exposa éloquemment la situation, et proposa de continuer la lutte. Investi par le gouvernement provisoire du commandement de la garde impériale, il eut assez d'influence sur elle pour la déterminer à se retirer derrière la Loire et à se laisser désarmer. L'ordonnance du 24 juillet 1815 l'ayant excepté de l'amnistie, il se constitua lui-même prisonnier, comparut devant un conseil de guerre le 6 avril 1816, et fut acquitté. Il vécut, dès lors, dans sa ville natale, à Nancy, exclusivement occupé de questions agricoles, refusant les offres d'emploi, de pensions et d'honneurs qui lui furent faites par Louis XVIII et par le gouvernement de Juillet. Il consentit seulement, le 19 novembre 1831, à être fait pair.—Napoléon l'appelait le Sage. «Drouot, disait-il, est un homme qui vivrait aussi satisfait avec quarante sous par jour qu'avec la dotation d'un souverain.» Par son testament de Sainte-Hélène, il lui légua 100 000 francs, qui furent employés en œuvres de bienfaisance. D'une piété sincère, Drouot n'avait cessé de pratiquer, même au milieu des camps, les devoirs de la religion. C'est peut-être la figure la plus héroïque et la plus pure de l'époque impériale. L'Éloge funèbre du général Drouot a été prononcé par le Père Lacordaire.[Retour au Texte Principal]
Note 34: Charles-Angélique-François Huchet, comte de La Bédoyère (1786-1815). Il avait été fait colonel en 1812, à vingt-six ans. Après l'abdication de Fontainebleau, sa famille avait obtenu pour lui la croix de Saint-Louis et le commandement du 7e de ligne, en garnison à Grenoble. Le 7 mars 1815, Napoléon n'avait encore vu son escorte se grossir que de faibles détachements, lorsqu'un régiment entier se joignit à lui à Vizille: c'était le régiment de La Bédoyère. À partir de ce moment, la partie était gagnée: la trahison du jeune colonel venait d'en assurer le succès. L'Empereur le nomma général de brigade, son aide de camp, et, bientôt, général de division; le 2 juin, il l'appelait à la Chambre des pairs. Après la chute de l'Empire, impliqué dans un complot récemment découvert, La Bédoyère fut pris et arrêté (2 août 1815), traduit devant un conseil de guerre comme prévenu de «trahison, de rébellion et d'embauchage», condamné à la peine de mort à l'unanimité, et fusillé dans la plaine de Grenelle (19 août 1815).[Retour au Texte Principal]
Note 35: Sur M. de Perray et sur cette négociation de Talleyrand, voir, au tome III, la note de la page 528.[Retour au Texte Principal]
Note 36: En 1508, l'empereur Maximilien Ier, le roi de France Louis XII, le roi d'Aragon Ferdinand le Catholique et le pape Jules II formèrent entre eux, contre la République de Venise, une ligue qui est restée célèbre sous le nom de Ligue de Cambrai.[Retour au Texte Principal]
Note 37: «La maîtresse de cette auberge était si royaliste qu'elle voyait des princesses partout; elle me prit pour Mme la duchesse d'Angoulême et me porta presque dans une grande salle, où il y avait une table de vingt couverts au moins. La chambre était tellement éclairée de bougies et de chandelles qu'on perdait la respiration au milieu d'un nuage de fumée, sans compter la chaleur d'un feu qui aurait été à peine supportable au mois de janvier. Lorsque la bonne dame s'aperçut que je n'étais pas Mme la duchesse d'Angoulême, elle fut un peu désappointée; mais enfin nous arrivions de Gand; nous étions donc au moins de bons royalistes: elle nous fit fête en conséquence; et, en partant, nous eûmes une peine infinie à lui faire accepter de l'argent. Dans cette classe, le dévouement est bien plus sans réserve que dans la classe plus élevée. Je me rappelle que cette pauvre femme me disait: «Voyez-vous, madame, je suis royaliste au point que, quelquefois, je me regarde de travers pour n'avoir pas su me faire guillotiner pour nos Bourbons.» (Souvenirs de Mme de Chateaubriand.)[Retour au Texte Principal]
Note 38: «Nous arrivâmes à Senlis le... juillet. Comme de coutume, nous ne pûmes trouver à nous loger; enfin, il fallut, manque d'auberge, nous présenter avec notre billet de logement chez un vieux chanoine qui nous reçut comme des chiens, ou plutôt nous fit recevoir par sa servante; car pour lui, il ne voulut pas nous voir. On nous donna une mauvaise chambre avec deux lits plus mauvais encore, et la vieille bonne eut ordre de ne nous rendre d'autre service que d'aller nous acheter de quoi manger, avec notre argent, bien entendu. Du reste, la pauvre fille était aussi serviable que son maître était inhospitalier; malgré sa défense, elle nous servit de son mieux et nous réconcilia même avec son chanoine, qui vint nous voir le lendemain avant notre départ; il nous demanda gracieusement si nous ne voulions pas prendre quelque chose, et cela avec d'autant plus d'instances qu'il savait que nous avions déjeuné.» (Souvenirs de Mme de Chateaubriand.)[Retour au Texte Principal]
Note 39: Gonesse, à 15 kilomètres. N.E. de Paris. Philippe-Auguste y est né en 1165.[Retour au Texte Principal]
Note 40: Les Mémoires du baron Hyde de Neuville sont ici de tous points d'accord avec ceux de Chateaubriand. Au tome II. p. 115, M. Hyde de Neuville s'exprime ainsi: «Nous partîmes, le maréchal Macdonald et moi pour nous rendre à Gonesse. Macdonald insista pour que nous vissions le prince de Talleyrand avant de nous présenter chez le roi... Ce ne fut pas M. de Talleyrand, mais M. de Chateaubriand que nous rencontrâmes le premier, ainsi qu'il le raconte dans les Mémoires d'Outre-tombe. Par respect pour le maréchal, je le laissai rendre compte du motif de notre voyage. Il assura que les choses étaient arrivées au point que la rentrée du roi à Paris était forcément liée à la nécessité de prendre Fouché pour ministre...»[Retour au Texte Principal]
Note 41: Séance de la Convention du 22 thermidor an III (9 août 1795).—Moniteur du 14 août.[Retour au Texte Principal]
Note 42: Wellington était né à Duncan-Castle, en Irlande.[Retour au Texte Principal]
Note 43: J.-B. Machault d'Arnouville (1701-1794), contrôleur général des finances sous Louis XV. Disgracié en 1754, il avait depuis vécu dans la retraite, dans sa terre d'Arnouville. Enfermé en 1794 aux Madelonnettes comme suspect, il mourut dans cette prison.[Retour au Texte Principal]
Note 44: «À Arnouville, nous fûmes obligés de loger chez le maire, qui, à l'approche de l'armée royale, s'était caché... On manquait de vivres: on ne trouvait plus un pain dans le village; nous et une douzaine d'arrivants de Gand, nous mourions de faim; la servante du maire avait mis à l'ombre toutes ses provisions et ne nous avait réservé que ses injures, dont elle n'était pas avare, quand, par bonheur, arriva un certain M. Dubourg, général de sa façon, qui, nous dit-il, avait pris nombre de villes sur son chemin: c'était le plus grand hâbleur qu'on pût voir, et il nous racontait le plus sérieusement du monde (les croyant lui-même) ses hauts faits d'armes de Gand à Paris: on les aurait trouvés incroyables dans la vie d'Alexandre; mais cette espèce de fou nous rendit un grand service en allant à la quête et nous rapportant d'énormes morceaux de viande, de pain, etc. Je crois qu'il avait fait très militairement emplette de ces provisions; mais, sans scrupules, nous en fîmes un déjeuner excellent.» (Souvenirs de Mme de Chateaubriand.)[Retour au Texte Principal]
Note 45: Nous retrouverons mon ami, le général Dubourg, dans les journées de Juillet. Ch.—Sans attendre les journées de Juillet, nous dirons ici quelques mots du «général» Dubourg, qui devait, en effet, avoir beaucoup d'histoires à raconter, car sa vie fut un vrai roman. Frédéric Dubourg-Butler, né en 1778, était, à l'époque de la Révolution, élève de marine. En 1793, il alla en Vendée faire le coup de feu dans les rangs des royalistes. Blessé et fait prisonnier, il allait être fusillé, lorsqu'il fut sauvé par une femme. Le lendemain, on le trouve dans les rangs des républicains, servant dans l'armée de l'Ouest, alors commandée par Bernadotte. En 1812, il est en Russie, attaché à l'état-major d'une division polonaise. Blessé et fait prisonnier, il ne rentre en France qu'après la chute de l'Empire. En 1815, officier d'état-major du duc de Feltre, ministre de la guerre, il suit le roi à Gand, reçoit, à la rentrée de Louis XVIII, le commandement de l'Artois, mais pour tomber presque aussitôt en disgrâce. Il disparaît pendant quinze ans, et surgit le 29 juillet 1830, à l'Hôtel de Ville, s'improvise «général», du droit de l'émeute et du fait de son uniforme, pris chez un fripier, et de ses épaulettes, tirées du magasin de l'Opéra-Comique. Il joue un instant le rôle de chef de la partie militaire du gouvernement provisoire, puis disparaît de nouveau. On ne le reverra plus que le 24 février 1848. Le nouveau gouvernement provisoire lui accorda une pension de retraite de général de brigade. Cette pension lui fut sans doute fort mal payée, car en 1850 le pauvre diable mit fin au roman de sa vie en avalant une forte dose d'opium.[Retour au Texte Principal]
Note 46: Alexandre-Charles-Emmanuel, bailli de Crussol (1743-1815). Député de la noblesse aux États-Généraux pour la prévôté et vicomté de Paris, il fut un des membres les plus ardents du côté droit. Louis XVIII le nomma pair de France le 4 juin 1814; il mourut le 17 décembre 1815.[Retour au Texte Principal]
Note 47: L'impératrice Joséphine était morte au château de la Malmaison (Seine-et-Oise) le 29 mai 1814.[Retour au Texte Principal]
Note 48: Le 29 juin.[Retour au Texte Principal]
Note 49: Henri-Gratien, comte Bertrand (1773-1844). Napoléon l'avait nommé, à la mort du maréchal Duroc, grand maréchal du palais (18 novembre 1813). Compagnon de l'Empereur à l'île d'Elbe, il prépara activement les Cent-Jours et fut élevé à la pairie le 2 juin 1815. Il suivit Napoléon à Sainte-Hélène et ne le quitta plus. Condamné à mort par contumace, le 7 mai 1816, il fut à son retour, après la mort de Napoléon (1821), réintégré dans tous ses grades par Louis XVIII, dont une ordonnance annula l'arrêt de condamnation de 1816. Il siégea à la Chambre des députés, de 1831 à 1834. En 1840, il accompagna le prince de Joinville à Sainte-Hélène et rapporta en France avec lui les restes de l'Empereur.[Retour au Texte Principal]
Note 50: Nicolas-Léonard Beker (1770-1840). Il avait épousé la sœur du général Desaix. Général de division, comte de l'Empire, grand officier de la Légion d'honneur après Essling, il devint cependant suspect à Napoléon, à cause de l'opinion qu'il n'avait pas craint d'exprimer sur les conséquences de son système de guerre à outrance, et il dut se rendre en disgrâce à Belle-Isle-en-Mer, pour en prendre le commandement. Il y resta jusqu'en 1814. Pendant les Cent-Jours, le département du Puy-de-Dôme l'envoya à la Chambre des représentants. Louis XVIII l'appela à la Chambre des pairs le 5 mars 1819.[Retour au Texte Principal]
Note 51: Le 3 juillet.[Retour au Texte Principal]
Note 52: Charles-Tristan, comte de Montholon (1783-1853). Il était général de brigade à la chute de l'Empire, en 1814. Resté fidèle à la cause bonapartiste, malgré les sollicitations de M. de Sémonville, son beau-père, marié avec sa mère, Mme de Montholon, et celles du maréchal Macdonald, son beau-frère, qui le pressaient de se rallier à la Restauration, il rejoignit Napoléon, revenant de l'île d'Elbe, dans sa marche sur Paris, fut nommé adjudant-général, se battit bravement à Waterloo, et, avec sa femme et ses enfants, accompagna l'empereur à Sainte-Hélène. De retour en France, il dut se réfugier en Belgique, à la suite de spéculations commerciales qui furent malheureuses (1828). En 1840, il prit part à l'échauffourée de Boulogne, fut condamné par la Cour des pairs à vingt ans de détention et enfermé au château de Ham; il en sortit après l'évasion du prince Louis-Napoléon. Les électeurs de la Charente-Inférieure l'envoyèrent en 1849 à l'Assemblée législative. Il a publié avec le général Gourgaud les célèbres Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène sous sa dictée par les généraux qui ont partagé sa captivité (années 1823 et suivantes). Il a, en outre, fait paraître, en 1847, deux volumes intitulés: Récits de la captivité de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène.[Retour au Texte Principal]
Note 53: Marin-Joseph-Emmanuel-Auguste-Dieudonné, comte de Las Cases (1766-1842). Lieutenant de vaisseau quand éclata la Révolution, il émigra, servit à l'armée des princes et fit partie de l'expédition de Quiberon. Rentré en France après le 18 brumaire, il composa un Atlas historique et géographique, qu'il publia sous le pseudonyme de Le Sage (1803-1804) et qui eut un grand succès. Napoléon le fit baron, puis comte, maître des requêtes au Conseil d'État et chambellan. Pendant les Cent-Jours, l'empereur l'attacha de plus en plus étroitement à sa personne, et Las Cases le suivit de l'Élysée à la Malmaison, à Rochefort, enfin à Sainte-Hélène. Le 27 novembre 1816, le gouverneur Hudson-Lowe l'expulsa de l'île. Ce ne fut qu'après la mort de Napoléon qu'il put rentrer en France, où il publia, avec un immense succès (1822-1823) son Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon pendant dix-huit mois.[Retour au Texte Principal]
Note 54: Napoléon ne fut point désarmé. Selon M. Thiers (T. XX, p. 573), «au moment de passer du Bellérophon au Northumberland, l'amiral Keith, avec un chagrin visible et du ton le plus respectueux, adressa ces paroles à l'Empereur: Général, l'Angleterre m'ordonne de vous demander votre épée.—À ces mots Napoléon répondit par un regard qui indiquait à quelles extrémités il faudrait descendre pour le désarmer. Lord Keith n'insista point, et Napoléon conserva sa glorieuse épée.» Cette scène est une pure fiction; elle se trouve même contredite par le comte de Las Cases, dans son Mémorial, où il dit: «Je demandai s'il serait bien possible qu'on pût en venir au point d'arracher à l'Empereur son épée. L'amiral répondit qu'on la respecterait, mais que Napoléon serait le seul, et que tout le reste serait désarmé.» Napoléon garda donc son épée, et à leur arrivée à Sainte-Hélène ses compagnons recouvrèrent la leur.[Retour au Texte Principal]
Note 55: Voyez plus haut dans leur ordre chronologique les actions de Bonaparte. Ch.[Retour au Texte Principal]
Note 56: Voyage aux régions équinoxiales. Ch.[Retour au Texte Principal]
Io mi voisi a man dextra e posi mente
All' atro polo, e vidi quattro stelle
Non viste mai fuor ch' alla prima gente.
(Le Purgatoire, chant I, vers 22-24.)[Retour au Texte Principal]
Note 58: Briars (les Églantiers) était le nom du cottage habité par M. Balcombe, négociant de l'île. Napoléon y résida pendant deux mois environ, du 17 octobre au 10 décembre 1815, depuis son arrivée à Sainte-Hélène jusqu'à son installation à Longwood. Voir les Souvenirs de Betzy Balcombe, traduits par M. Aimé Le Gras, 1898.[Retour au Texte Principal]
Note 59: L'aide de camp Muiron.[Retour au Texte Principal]
Note 60: Le commissaire français était M. de Montchenu; le commissaire autrichien, M. de Sturmer; le commissaire russe, M. de Balmain.[Retour au Texte Principal]
Note 61: Basil Hall (1738-1844), marin et voyageur anglais, auteur de plusieurs volumes de Voyages, qui se recommandent par l'exactitude et l'intérêt du récit. Le plus célèbre de ses voyages est celui dont il revenait, lorsqu'il passa à Sainte-Hélène, et dont il a publié le récit, en 1817, sous ce titre: Voyage de découverte sur la côte ouest de Corée et à Lieou-Khieou.[Retour au Texte Principal]
Note 62: Le chiffre exact est cent trente-deux.[Retour au Texte Principal]
Note 63: Jean Rossignol (1759-1802), général en chef des armées de la République dans la guerre de Vendée. Il mourut le 8 floréal an X (28 avril 1802) sur l'îlot insalubre d'Anjouan.[Retour au Texte Principal]
Note 64: Voir la Vie véritable du citoyen Jean Rossignol, publiée sur les écritures originales, avec des notes et des documents inédits, par Victor Barrucand, 1896.[Retour au Texte Principal]
Note 65: Ode d'Alexandre Manzoni sur la mort de Napoléon. Cette Ode, qui a pour titre le Cinq mai (il Cinque maggio) est un des plus beaux morceaux lyriques du XIXe siècle.[Retour au Texte Principal]
Note 66: Le renvoi de Las Cases eut lieu le 27 novembre 1816. L'Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, d'après les documents officiels inédits et les manuscrits de sir Hudson Lowe, publiée par William Forsyth, renferme sur cet épisode d'intéressants détails. Dans une lettre particulière au comte Bathurst, datée du 3 décembre 1816, sir Hudson Lowe annonce qu'il a saisi les papiers de M. de Las Cases, et qu'avec l'assentiment de ce dernier, il a pu les parcourir. «Ils remplissaient, dit-il, un coffre et un portefeuille. J'y ai trouvé les brouillons des campagnes de Bonaparte en Italie, dictées par lui-même, avec les notes et documents les concernant; puis, sa correspondance officielle avec sir George Cockburn et avec moi. Je me suis fait une loi de ne rien regarder de la première de ces deux collections plus que ce qui était nécessaire pour m'assurer que c'étaient bien les papiers spécifiés. Elle a été ensuite rapportée au général Bonaparte avec le cachet du comte Las Cases, ainsi que la correspondance officielle. Il reste une collection d'une plus haute importance, qui est réclamée également par Bonaparte et par Las Cases; c'est un journal très volumineux tenu par le comte Las Cases, qui y a inséré tout ce qui est arrivé au général Bonaparte depuis l'époque où il a quitté Paris jusqu'au jour où l'arrestation du comte a eu lieu. Ses actes, ses conversations, ses remarques, des copies de toutes ses remontrances, y compris les lettres de Montholon, ses gestes même y sont notés; le tout est écrit avec la minutie de la Vie de Johnson par Boswell, la force de langage du général Bonaparte et l'embellissement de style du comte Las Cases; j'ai obtenu le consentement même du comte Las Cases pour parcourir cette collection. Tout y est sacrifié au grand objet de présenter à la postérité le général Bonaparte comme un modèle d'excellence et de vertu. Les faits y sont altérés, les conversations rapportées seulement par moitié, ses propres expressions répétées, les réponses omises; j'ai remarqué que tel était particulièrement le cas dans les conversations que j'ai eues moi-même avec lui-même, celles qui avaient lieu en présence de témoins. Le général Bonaparte a demandé que ce document lui fût renvoyé, disant que c'est un journal qui était tenu par ses ordres exprès et le seul memorandum qu'il ait de tout ce qui lui est arrivé. Le comte Las Cases, au contraire, réclame ces papiers comme lui appartenant en propre; il les appelle ses pensées et ne veut pas convenir que le général Bonaparte en ait connaissance... En ce moment, chacun d'eux ignore encore les réclamations de l'autre. La conduite la plus prudente que je croie devoir tenir sera de garder le journal scellé avec le cachet au comte Las Cases et le mien, jusqu'à ce Votre Seigneurie ait envoyé ses instructions à ce sujet.» (Tome II, p. 76.)[Retour au Texte Principal]
Note 67: L'abbé Buonavita et l'abbé Vignale. «À cette époque, dit M. Thiers, c'est-à-dire vers la fin de 1819, arrivèrent à Sainte-Hélène les personnages envoyés par le cardinal Fesch. C'étaient un bon vieux prêtre, l'abbé Buonavita, ancien missionnaire au Mexique, et un jeune ecclésiastique, l'abbé Vignale, l'un et l'autre fort honnêtes gens, mais sans instruction et sans esprit.» (Histoire du Consulat et de l'Empire, tome XX, p. 688.)—Les deux prêtres arrivèrent à Sainte-Hélène le 20 septembre 1819, (William Forsyth, tome III, p. 149.)[Retour au Texte Principal]
Note 68: François Antomarchi (1780-1330). Né en Corse il était professeur d'anatomie à Florence, quand il fut choisi par le cardinal Fesch pour aller à Sainte-Hélène donner ses soins à Napoléon, auquel on venait d'enlever le docteur O'Meara. Arrivé par le même navire que l'abbé Buonavita et l'abbé Vignale, il resta auprès de l'empereur jusqu'à sa mort. Les Mémoires du docteur Antomarchi, ou les derniers moments de Napoléon (Paris, 1825, 2 vol. in-8o), contiennent l'histoire de la captivité de l'empereur depuis le 21 septembre 1819 jusqu'au 5 mai 1821. M. Thiers (p. 688) parle du docteur Antomarchi en ces termes: «C'était un jeune médecin italien, ayant quelque esprit, peu d'expérience et une extrême présomption.»[Retour au Texte Principal]
Note 69: Extrait de l'article de Chateaubriand du 17 novembre 1818. Le Conservateur, tome I. p, 333.—Œuvres complètes, tome XXVI, p. 32.[Retour au Texte Principal]
Note 70: Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, par M. de Montholon, tome IV, p. 243.—Ch.[Retour au Texte Principal]
Note 71: Chateaubriand ici se souvient de Corneille:
Dans quelque urne chétive en ramasser la cendre.
Et d'un peu de poussière élever un tombeau
À celui qui du monde est le sort le plus beau.[Retour au Texte Principal]
Note 72: La frégate La Belle-Poule, commandée par le prince de Joinville.[Retour au Texte Principal]
Note 73: Souvenirs de Sainte-Hélène, par l'abbé Coquereau.—L'abbé Coquereau était aumônier de la frégate la Belle-Poule. En 1850, il fut nommé par Louis-Napoléon aumônier en chef de la flotte, fonctions qu'il a conservées jusqu'à sa mort (1866).[Retour au Texte Principal]
Note 74: Chateaubriand visita Cannes et le golfe Juan au mois de juillet 1838. Il écrivait de Cannes à Madame Récamier le 28 juillet: «J'ai quitté à Marseille mon bruit pour venir voir le lieu où Bonaparte en débarquant, a changé la face du monde et nos destinées. Je vous écris dans une petite chambre, sous la fenêtre de laquelle se brise la mer. Le soleil se couche; c'est l'Italie tout entière que je retrouve ici. Dans une heure, je vais partir pour aller à deux lieues d'ici, au Golfe Juan; j'y arriverai de nuit, je verrai cette grève déserte où cet homme aborda avec sa petite flotte. Je m'arrangerai de la solitude, des vagues et de ciel: l'homme a passé pour toujours.»[Retour au Texte Principal]
Note 75: Ce livre a été écrit à Paris en 1839 et revu le 22 février 1845.[Retour au Texte Principal]
Note 76: Dans son livre sur la Politique de la Restauration en 1822 et 1823, page 55, M. de Marcellus rapporte ces autres paroles de Chateaubriand, qui ont ici leur place naturelle: «Sous la Restauration, la liberté avait remplacé dans nos mœurs le despotisme; la nature humaine s'était relevée. Il y avait plus d'air dans la poitrine, comme disait Madame de Staël; la publicité de la parole avait succédé au mutisme; les intelligences et l'esprit littéraire renaissaient; et, bien que le Français soit né courtisan, n'importe de qui, toujours est-il qu'on rampait moins bas.»[Retour au Texte Principal]
Note 77: Voir, au tome XXIII des Œuvres complètes, le discours prononcé, par Chateaubriand, le 22 août 1815, à l'ouverture du collège électoral, à Orléans. Il n'a pas recueilli la lettre-circulaire que, le 7 août, il avait adressée à chacun des électeurs du Loiret, et dont voici le texte:
«Paris, le 7 août 1815.
«Monsieur,
«Vous savez sans doute que la Chambre des Députés a été dissoute par une Ordonnance du Roi, en date du 13 juillet de cette année, et que, par la même Ordonnance, les Collèges électoraux sont convoqués.
«Le Roi, Monsieur, m'ayant fait l'honneur de me nommer président du Collège électoral du département du Loiret, je m'empresse de vous adresser cette lettre, pour vous inviter à vous rendre à Orléans, le vingt-deuxième jour du présent mois d'août, jour de l'ouverture des Collèges électoraux de Département.
«Dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons, il est important, Monsieur, pour l'honneur et le salut de la France, que le choix des Électeurs tombe sur des hommes graves et prudents, fidèles à leur Roi, dévoués à leur pays, instruits des lois du Royaume, attachés à ces principes de morale qui sont la base de tout ordre politique, et sans lesquels il n'y a point d'institutions durables. Vous vous empresserez donc, Monsieur, de concourir à un but si utile; une partie des embarras qui sembleraient devoir vous retenir dans vos foyers, ne peut disparaître que par la réunion des deux Chambres; ainsi, vos intérêts particuliers, autant que l'intérêt général de la patrie, exigent impérieusement votre présence à l'Assemblée du Collège électoral.
«J'ai l'honneur d'être, avec une haute considération,
«Monsieur,
«Votre très humble et très obéissant serviteur,
«Le Ministre d'État, ambassadeur de S. M. T. C. à la Cour de Suède, Pt du Coll. élect. du Dépt du Loiret,
«Vicomte de Chateaubriand.»[Retour au Texte Principal]
Note 78: L'Ordonnance portant nomination du vicomte de Chateaubriand à la Chambre des pairs est en date du 17 août 1815.[Retour au Texte Principal]
Note 79: Opinion sur la résolution relative à l'inamovibilité des juges, prononcée à la Chambre des pairs, le 19 décembre 1815.—Œuvres complètes, tome XXIII, p. 32.[Retour au Texte Principal]
Note 80: Le conventionnel Courtois, député de l'Aube, l'auteur du Rapport fait, au nom de la Commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices, dans la séance du 16 nivôse an III (5 janvier 1795). Il avait trouvé l'original du testament de la Reine dans les papiers de Robespierre et se l'était approprié.[Retour au Texte Principal]
Note 81: Discours prononcé à l'occasion des communications faites à la Chambre des pairs par M. le duc de Richelieu, dans la séance du 22 février 1816.—Œuvres complètes, tome XXIII, p. 109.[Retour au Texte Principal]
Note 82: Opinion prononcée à la Chambre des pairs, le 12 mars 1816, sur la résolution de la Chambre des députés, relative aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés.—Œuvres complètes, tome XXIII, p. 114.[Retour au Texte Principal]
Note 83: Opinion sur le projet de loi relatif aux élections, prononcée à la Chambre des pairs, séance du 3 avril 1816.—Œuvres complètes, tome XXIII, p. 136.[Retour au Texte Principal]
Note 84: Proposition faite à la Chambre des pairs, dans la séance du 9 avril 1816, relative aux Puissances barbaresques.—Œuvres complètes, tome XXIII, p. 155.[Retour au Texte Principal]
Note 85: L'Ordonnance du 5 septembre 1816, publiée dans le Moniteur du 7, prononçait la dissolution de la Chambre de 1815, que Louis XVIII lui-même avait appelée la Chambre introuvable.[Retour au Texte Principal]
Note 86: Jean-Jacques, baron Baude (1792-1862). Il signa, comme rédacteur du journal le Temps, la protestation des journalistes contre les ordonnances de juillet 1830 et fit enregistrer sa protestation devant notaires. Préfet de police du 26 décembre 1830 au 25 février 1831, il laissa l'émeute saccager l'archevêché et l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Membre de la Chambre des députés, il présenta, le 15 mars 1831, d'accord avec le Gouvernement, une proposition tendant à déclarer «l'ex-roi, Charles X, ses descendants et les alliés de ses descendants, bannis à perpétuité du territoire français». Chateaubriand combattit la proposition de M. Baude dans une éloquente brochure, sur laquelle nous aurons à revenir plus tard.[Retour au Texte Principal]
Note 87: Nicolas-François Bellart (1761-1826), avocat au barreau de Paris de 1785 à 1815, député de la Seine, de 1815 à 1820, procureur général près la Cour royale de Paris, de 1815 à 1826. Ce fut lui qui porta la parole dans le procès du maréchal Ney. Bellart fut un homme de bien, un grand magistrat et un orateur éloquent. Il possédait au plus haut degré la faculté de l'improvisation. Énergique, abondant, impétueux, quelquefois irrégulier, son talent était plein de force et d'éclat. À l'audience, d'après le témoignage d'un de ses émules, M. Billecocq, il ne laissait point respirer; il terrassait; tout, jusqu'à son désordre, allait au but et l'atteignait.» (Notice historique sur N.-F. Bellart, par M. Billecocq, avocat. Paris, 1827).—Voir aussi l'année 1817, par Edmond Biré, p. 132-137.[Retour au Texte Principal]
Note 88: Voir l'Appendice no I: La Saisie de la Monarchie selon la Charte.[Retour au Texte Principal]
Note 89: Le roi est mort: Vive le Roi!—Paris, Le Normant, père, 1824, in-8o, 37 pages.[Retour au Texte Principal]
Note 90: Élie, duc Decazes, né à Saint-Martin-de-Laye, près Libourne, le 28 septembre 1780. Bien que Napoléon et la famille impériale ne lui aient pas ménagé leurs faveurs, sa fortune politique date en réalité de la décision avec laquelle, à la nouvelle du retour de l'île d'Elbe, il mobilisa sa compagnie de garde nationale pour défendre la cause des Bourbons. Il était, depuis 1810, conseiller à la Cour d'appel. Lorsque, le 25 mars 1815, la Cour se réunit pour voter une adresse à l'Empereur, il s'y opposa, et comme un de ses collègues s'écriait: «Est-il besoin d'une autre preuve de sa légitimité que la rapidité de sa marche?»—«Je n'ai jamais ouï-dire, répliqua M. Decazes, que la légitimité fût le prix de la course.» Napoléon se hâta de l'exiler à quarante lieues de Paris. Le 7 juillet 1815, il fut nommé préfet de police. Député de la Seine le 22 août, ministre de la police générale le 24 septembre, il reçut la pairie et le titre de comte après l'ordonnance du 5 septembre 1816. Il devint ministre de l'intérieur le 29 décembre 1818, et président du Conseil le 19 novembre 1819. Le 17 février 1820, il quitta le ministère pour l'ambassade de Londres (avec le titre de duc), et la conserva jusqu'au 9 janvier 1822. Le 20 septembre 1834, il remplaça le duc de Sémonville comme grand référendaire de la Chambre des pairs. Il mourut le 24 octobre 1860.[Retour au Texte Principal]
Note 91: M. Decazes avait été, sous l'Empire, secrétaire des commandements de Madame Lætitia, mère de Napoléon.[Retour au Texte Principal]
Note 92: M. Decazes avait épousé, en 1805, une fille du comte Muraire, premier président de la cour de Cassation, ce qui lui avait valu une place de juge au tribunal de la Seine; sa femme mourut l'année suivante. Au mois d'août 1818, il épousa, en secondes noces, Mlle de Sainte-Aulaire, petite-fille par sa mère du dernier prince régnant de Nassau-Saarbruck; en considération de ce mariage, le roi de Danemarck lui donna le titre de duc et la terre de Glücksberg.[Retour au Texte Principal]
Note 93: Dans un article du Conservateur, sous la date du 3 mars 1820. Voici le passage où se trouve le mot de Chateaubriand: «... Pas une proclamation pour annoncer à la patrie un si grand malheur! Rien pour consoler le peuple, pour l'éclairer sur sa position et sur ses devoirs! On eût dit qu'on craignait d'exciter l'indignation contre un crime; on avait l'air de ménager la délicatesse de ceux qui pouvaient en commettre de semblables. Des autorités ont elles-mêmes semé le bruit que ce crime était une vengeance particulière; et l'on peut remarquer des traces de cette version officielle jusque dans les journaux anglais. On s'est hâté de dérober aux regards de la foule attendrie le visage et la poitrine du malheureux prince: si la censure eût existé, on eût forcé les journaux à garder le silence; on eût défendu de parler du jeune Bourbon moissonné, comme on défendit jadis aux gardes nationales de porter une branche de lis, de peur de choquer la Révolution, de peur d'inspirer trop d'amour pour le Roi: il y avait quelque chose de plus important que tout cela: un misérable ministère s'en allait, pouvait-on songer à la grande victime de son système? Mais ceux qui luttaient encore contre la haine publique n'ont pu résister à la publique douleur. Nos larmes, nos gémissements, nos sanglots ont étonné un imprudent ministre: Les pieds lui ont glissé dans le sang; il est tombé.» Le Conservateur, tome VI, p. 476.[Retour au Texte Principal]
Note 94: Ordonnance du 20 septembre 1816.[Retour au Texte Principal]
Note 95: «Les frontières du Rhin, écrit M. de Marcellus (Chateaubriand et son temps, p. 246), étaient pour M. de Chateaubriand un rêve de toutes ses nuits:»—«La guerre d'Espagne», me disait-il à Londres, en interrompant une de ses dépêches où il poussait le plus vivement à franchir les Pyrénées, «doit être le signal et le premier acte de notre résurrection. Après, il nous faudra la rive gauche du Rhin aussi loin qu'elle peut s'étendre. Les conquêtes du génie des batailles s'écoulent comme un torrent, pour parler comme Racine; la monarchie légitime et traditionnelle seule sait, par l'influence d'une paix solide, faire désirer sa domination, agrandir le pays, fondre en un seul corps les populations, et les conserver à la patrie.»[Retour au Texte Principal]
Note 96: La bibliothèque de Chateaubriand fut vendue le 29 avril 1817 et les jours suivants.—Journal des Débats, 29 avril 1817.—Voir, l'Appendice no II: Chateaubriand, Victor Hugo et Joseph de Maistre.[Retour au Texte Principal]
Note 97: Le Journal des Débats, dans son numéro du 12 avril 1817, inséra la note suivante, rédigée par M. Bertin:
«On vient de mettre en vente une maison de campagne en partie meublée, située à Aulnay, commune de Châtenay, près Sceaux-Penthièvre, appelée la Vallée ou Val-de-Loup. Cette maison, qui n'était qu'une chaumière avec une vigne et un verger quand le propriétaire actuel en fit l'acquisition en 1807, est aujourd'hui une maison agréable, placée dans un parc de vingt arpents enclos de murs et planté avec soin. On y trouve la collection presque entière des arbres exotiques ou naturels au sol de la France. Le tout présente l'aspect d'une vallée solitaire, environnée de bois qui semblent en faire partie. Nous pouvons parler en connaissance de cause de cette demeure charmante, de ces beaux arbres trop tôt ravis aux mains qui les ont plantés; et nous félicitons d'avance celui qui devra à la faveur du sort la propriété d'une campagne qui, comme celle de Tibur et d'Auteuil, sera à jamais illustrée par le nom et le souvenir de son premier créateur.»[Retour au Texte Principal]
Note 98: Le vicomte, plus tard duc, Mathieu de Montmorency-Laval, ministre des affaires étrangères, du 24 décembre 1821 au 22 décembre 1822. Il mourut le 24 mars 1826.—La Vallée-aux-Loups appartient aujourd'hui à M. le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville, dont la mère était une Montmorency-Laval.[Retour au Texte Principal]
Note 99: Proposition faite à la Chambre des pairs, dans la séance du 23 novembre 1816, et tendante à ce que le Roi soit humblement supplié de faire examiner ce qui s'est passé aux dernières élections, afin d'en ordonner ensuite selon sa justice; suivie des pièces justificatives annoncées dans la proposition.—Œuvres complètes, T. XXIII, p. 159.[Retour au Texte Principal]
Note 100: Opinion sur le projet de loi relatif aux finances, prononcée à la Chambre des pairs, dans la séance du 21 mars 1817.—Œuvres complètes, T. II, p. 226.[Retour au Texte Principal]
Note 101: Jean-Baptiste-Guillaume-Marie-Anne-Séraphin-Joseph, comte de Villèle (1773-1854). Membre de la Chambre des députés de 1815 à 1828. Ministre sans portefeuille du 21 décembre 1820 au 27 juillet 1821. Le 14 décembre de cette même année, il devint ministre des finances, et, le 7 septembre 1822, président du Conseil. Il garda le pouvoir jusqu'au 4 janvier 1828, et, en le quittant, obtint la dignité de pair. Louis XVIII l'avait fait comte le 17 août 1822. Après la révolution de Juillet, il se retira à Toulouse, sa ville natale, où il mourut le 13 mars 1854.—Son petit-fils, M. de Neuville, a publié les Mémoires et Correspondance du comte de Villèle, 5 vol. in-8o, 1889.[Retour au Texte Principal]
Note 102: Jacques-Joseph-Guillaume-François-Pierre, comte de Corbière (1766-1853). Il a fait partie, en 1797, du Conseil des Cinq-Cents; mais, à partir de 1815, sa fortune politique se confond entièrement avec celle de M. de Villèle. Tous deux sont députés de 1815 à 1828; tous deux sont ministres en titre, du 14 décembre 1821 au 4 janvier 1828, l'un aux finances et l'autre à l'intérieur. Louis XVIII les a fait comtes le même jour; le même jour, Charles X les fait pairs de France. Après les journées de Juillet, tous deux se retirent dans leur province, pour mourir à peu de mois de distance, Corbière en 1853, Villèle en 1854.[Retour au Texte Principal]
Note 103: Jean-Pierre Piet-Tardiveau (1763-1848), député de 1815 à 1819 et de 1820 à 1828. Les députés de l'opposition de droite, en 1816 et 1817, se réunissaient chez lui, rue Thérèse, no 8. Lorsque MM. de Villèle et Corbière arrivèrent au pouvoir, leurs amis continuèrent à fréquenter son salon et... sa salle à manger. Les auteurs de la Villéliade et de la Corbiéréide, MM. Barthélemy et Méry, nous le montrent, au début du premier de ces poèmes, donnant à dîner aux députés du centre:
Piet, traiteur du Sénat......
et plus loin, au chant cinquième, tirant à la cible dans la Charte constitutionnelle:
Muni de ses besicles,
Piet de l'auguste cible emporte deux articles.[Retour au Texte Principal]
Note 104: Charles-Guillaume Étienne (1778-1845), auteur dramatique, publiciste et homme politique. Le succès de sa comédie les Deux Gendres (1811) lui avait ouvert les portes de l'Académie française. La protection du duc de Bassano, dont il avait été le secrétaire, lui avait valu d'être nommé censeur du Journal de l'Empire, et d'être chargé, en qualité de chef de la division littéraire, de la police des journaux. Sous la Restauration, l'ex-censeur impérial devint un libéral ardent et fit aux Bourbons, dans la Minerve française et dans le Constitutionnel, une opposition des plus vives. Le succès de ses «Lettres sur Paris», publiées dans le premier de ces deux journaux, détermina les électeurs de la Meuse à le choisir pour député en 1820. Il siégea à la Chambre de 1820 à 1824. Réélu en 1827, il fut, au mois de mars 1830, le principal rédacteur de l'adresse des 221. Le gouvernement de Juillet le nomma pair de France, le 7 novembre 1839. À l'égal du gouvernement et des hommes de la Restauration, M. Étienne haïssait les romantiques; l'Académie lui joua le mauvais tour de lui donner pour successeur le comte Alfred de Vigny.—La Minerve française, dont Étienne était le principal rédacteur, avait été fondée en février 1818, neuf mois avant le Conservateur; elle paraissait une fois par semaine, mais à des jours indéterminés, ce qui lui permettait, n'ayant pas d'une manière absolue la forme périodique, d'échapper à la censure. Les collaborateurs d'Étienne à la Minerve étaient Benjamin Constant, Évariste Dumoulin, Aignan, Jay, Jouy, Lacretelle aîné et Tissot.[Retour au Texte Principal]
Note 105: Le Conservateur commença de paraître au mois d'octobre 1818.—Voir l'Appendice no III: Le Conservateur.[Retour au Texte Principal]
Note 106: Eugène-François-Auguste d'Armand, baron de Vitrolles (1774-1854). Il s'enrôla à 17 ans dans l'armée des princes, fut rayé de la liste des émigrés sous le Consulat, et fut nommé sous l'Empire maire de Vitrolles, conseiller général des Hautes-Alpes et inspecteur des bergeries impériales. Napoléon le créa baron le 15 juin 1812. Lié avec le duc de Dalberg et avec Talleyrand, il s'associa aux vues de ce dernier en 1814, se rendit auprès des alliés et plaida avec autant de chaleur que d'habileté la cause des Bourbons. Pendant les Cent-Jours, il essaya de soulever le Midi, fut arrêté et enfermé à Vincennes, puis à l'Abbaye. Membre de la Chambre de 1815, il siégea parmi les ultras, et, après l'ordonnance du 5 septembre 1816, devint l'un des agents les plus actifs de la politique personnelle de Monsieur. Charles X le nomma ministre plénipotentiaire à Florence (décembre 1827) et pair de France (janvier 1828). La chute de la branche aînée le rendit à la vie privée. Compromis un instant dans la tentative de la duchesse de Berry en Vendée (1832), il fut arrêté lors du pillage de l'archevêché, et relâché presque aussitôt. Ses Mémoires, publiés en 1885, sont du plus vif intérêt.[Retour au Texte Principal]
Note 107: Marie-Barthélemy, vicomte de Castalbajac (1776-1868). Il émigra en 1790 et servit dans l'armée de Condé. Rentré en France avec les Bourbons, il fut élu par le collège de département du Gers à la Chambre de 1815, où il se signala par l'exaltation de son royalisme. De 1819 à 1827, il fut député de la Haute-Garonne. L'ordonnance du 5 novembre 1827 le nomma pair de France, nomination qui ne fut pas ratifiée par le gouvernement de Juillet. À partir de 1830, M. de Castalbajac se retira complètement de la vie politique.[Retour au Texte Principal]
Note 108: César-Guillaume, duc de La Luzerne (1738-1821). Agent général du clergé en 1765, évêque de Langres en 1770, membre de l'Assemblée des notables en 1787, il fut élu député du clergé aux États-Généraux par le bailliage de Langres. Il donna sa démission le 2 décembre 1789, émigra en Italie et se fixa à Venise. Là, en visitant et en soignant les prisonniers de guerre français dans les hôpitaux, il contracta le typhus et faillit en mourir. Rentré en France en 1800, il donna, au concordat, sa démission d'évêque de Langres et se consacra à l'étude et à la retraite. À la première Restauration, Louis XVIII le nomma pair de France (4 juin 1814), et lui restitua son titre de duc et son évêché. Il obtint le chapeau de cardinal le 28 juillet 1817. Il a composé un grand nombre d'ouvrages dont voici les principaux: Considérations sur divers points de la morale chrétienne (1795); Dissertations sur la vérité de la religion (1802); Explication des Évangiles (1807).[Retour au Texte Principal]
Note 109: Réflexions sur l'état intérieur de la France (22 octobre 1818).—Le Conservateur, tome I, p. 113.[Retour au Texte Principal]
Note 110: Ci-devant marquis, ex-député des Bouches-du-Rhône à l'Assemblée législative. Il siégea comme juré au Tribunal révolutionnaire dans le procès de la Reine et dans la procès des Girondins.[Retour au Texte Principal]
Note 111: Le Conservateur, tome I, p. 466.[Retour au Texte Principal]
Note 112: Anne-Victor-Denis Hubault, marquis de Vibraye (1766-1843) était officier de cavalerie au moment de la Révolution. Il émigra en 1791, rentra en 1814 et devint alors colonel et aide de camp de Monsieur, plus tard Charles X. Nommé pair de France le 17 août 1815, le même jour que Chateaubriand, il fut promu maréchal de camp le 1er octobre 1823, et quitta la Chambre haute à la Révolution de 1830, pour ne pas prêter serment au nouveau régime.[Retour au Texte Principal]
Note 113: Alexandre, comte de Girardin (1776-1855), fils de René-Louis de Girardin, l'hôte et l'ami de J.-J. Rousseau. Il fit avec distinction les campagnes de l'Empire; colonel en 1806, général de brigade en 1811, il fut fait général de division pendant la campagne de France (1814). Louis XVIII le nomma premier veneur, fonctions qu'il conserva jusqu'en 1830. Il est le père de M. Émile de Girardin, le célèbre rédacteur de la Presse, par qui furent publiés, pour la première fois, les Mémoires d'Outre-Tombe.[Retour au Texte Principal]
Note 114: Le Conservateur, tome VI, p. 382. L'article est de Chateaubriand.[Retour au Texte Principal]
Note 115: Athalie acte I scène I.[Retour au Texte Principal]
Note 116: Article de Chateaubriand, daté du 3 mars 1820. Le Conservateur, tome VI, p. 471.[Retour au Texte Principal]
Note 117: Lorsque le nonce vint féliciter le roi au nom du corps diplomatique, il prononça la phrase suivante en montrant le duc de Bordeaux: «Voici le plus grand bienfait que la Providence la plus favorable a daigné accorder à la tendresse de Votre Majesté. Cet enfant de souvenirs et de regrets est aussi l'enfant de l'Europe. Il est le présage et le garant de la paix et du repos qui doivent suivre tant d'agitations».[Retour au Texte Principal]
Il est né, l'enfant du miracle!
Héritier du sang d'un martyr,
Il est né d'un tardif oracle,
Il est né d'un dernier soupir!
Aux accents du bronze qui tonne
La France s'éveille et s'étonne
Du fruit que la mort a porté!
Jeux du sort! merveilles divines!
Ainsi fleurit sur des ruines
Un lis que l'orage a planté.
(La Naissance du duc de Bordeaux, par Alphonse de Lamartine.)[Retour au Texte Principal]
Note 119: «Aniche, synonyme gascon d'Annette et diminutif d'Anne. Aniche était fort belle, et s'était fait connaître sous l'Empire par l'ardeur de son royalisme. Je l'ai admirée à Bordeaux, en 1815, louant des chaises à tous les promeneurs des allées de Tourny: elle n'avait pas d'autre fortune». Marcellus, Chateaubriand et son temps, p. 248.[Retour au Texte Principal]
Note 120: M. Decazes avait donné sa démission le 17 février. Le Moniteur du 21 février publia trois ordonnances, signées la veille. La première acceptait la démission de M. Decazes; la seconde nommait M. le duc de Richelieu président du conseil, en laissant l'ancien ministère debout; la troisième conférait à M. Decazes le titre de duc et de ministre d'État.[Retour au Texte Principal]
Note 121: Il y a la une erreur de plume. Le ministre des affaires étrangères, en février 1820, était M. Pasquier. M. Molé n'a eu, sous la Restauration, que le portefeuille de la marine, et cela à une autre époque, du 12 septembre 1817 au 28 décembre 1818.[Retour au Texte Principal]
Note 122: L'ordonnance nommant le duc Decazes à l'ambassade de Londres est du 20 février 1820. Il la conserva jusqu'au 9 janvier 1822.[Retour au Texte Principal]
Note 123: Sœur du duc de Richelieu. Elle était très liée avec Chateaubriand.[Retour au Texte Principal]
Note 124: Le 20 décembre 1820.[Retour au Texte Principal]
Note 125: M. de Barante avait donné sa démission de directeur général des contributions indirectes, poste auquel était attribué, à cette époque, un traitement de cent mille francs. (Voir les Souvenirs du baron de Barante, t. II. p. 455.)[Retour au Texte Principal]
Note 126: Le mercredi 20 décembre 1820.[Retour au Texte Principal]
Note 127: Chateaubriand venait d'être nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Berlin. Moniteur du 30 novembre 1820.[Retour au Texte Principal]
Note 128: M. de Corbière eut la présidence de l'instruction publique avec l'entrée au Conseil. M. de Villèle entrait également comme ministre secrétaire d'État sans portefeuille. Ce dernier mit une condition à son acceptation: c'est qu'il resterait dans son logement et ne recevrait ni indemnité ni traitement. Et jusqu'à la fin, il fera preuve du même désintéressement. Nommé ministre des Finances, en décembre 1821, il avait droit à une somme de 25,000 francs pour frais d'installation: il la refusa. Louis XVIII l'éleva, le 7 septembre 1822, à la dignité de président du Conseil. Un supplément de 50,000 francs de traitement annuel était attaché à ces fonctions: il le refusa. Lorsqu'il sortit du ministère, en 1828, Charles X exigea de lui qu'il acceptât la pension de ministre d'État; cette pension fut inscrite au grand-livre. Il s'empressa d'y renoncer aussitôt après la Révolution de 1830. Il lui suffisait d'avoir relevé la fortune publique, d'avoir fondé sur des bases indestructibles le crédit de la France, d'avoir donné à notre pays les meilleures finances qu'il ait jamais eues. Pendant ce temps, les auteurs de la Villéliade le représentaient sous les traits d'un Sardanapale mangeant la France dans de riches banquets, sous la figure d'un Minotaure
Dont la dent terrible dévore
Et notre fortune et nos lois.[Retour au Texte Principal]
Note 129: Ce livre a été écrit en 1839 et revu en décembre 1846.[Retour au Texte Principal]
Note 130: Après avoir fait jurer aux Lacédémoniens de ne rien changer pendant son absence aux lois qu'il leur avait données, Lycurgue partit pour un long voyage... et ne revint jamais.[Retour au Texte Principal]
Note 131: M. de Marcellus (Chateaubriand et son temps, p. 251) nous a conservé le nom du courrier qui précédait ainsi sur les grandes routes le nouvel ambassadeur. «C'était, dit-il, le pauvre Valentin, à qui je n'ai jamais connu d'autre nom, le plus dévoué des nombreux serviteurs que l'antichambre réunissait plus tard à Londres, sous mon autorité de ménagère, titre que parfois en riant me donnait l'ambassadeur. Il est la seule chose, à lui appartenant, que M. de Chateaubriand ait laissée à son départ au ministère des Affaires étrangères, après en avoir fait un garçon de bureau. Le Varsovien était en effet grand mangeur, comme le dit son maître; mais il était grand buveur aussi».[Retour au Texte Principal]
Note 132: Chateaubriand écrivait de Mayence à la duchesse de Duras, le 6 janvier 1821:
«Je suis arrêté ici par le Rhin qui n'est ni gelé ni dégelé; je suis allé le voir ce matin; c'était la vieille Germanie dans toute sa beauté. Quand je serai sur l'autre bord, j'aurai vraisemblablement passé le fleuve d'oubli. Savez-vous ce que j'ai fait en route? J'ai relu les lettres de Mirabeau sur Berlin. J'ai été frappé d'une chose, c'est de la légèreté, de l'incapacité de ce gouvernement, qui voyait la correspondance d'un pareil homme, et qui ne devinait pas ce qu'il était. Tout Mirabeau, et Mirabeau très supérieur, est dans cette correspondance diplomatique; l'avenir de l'Europe y est à chaque ligne. Eh bien! cet homme qui, deux ans après, devait renverser la France, s'humilie, demande qu'on lui donne un petit titre diplomatique, et qu'on ne l'emploie pas dans une mission honteuse et non avouée. Il pense qu'on ne peut pas garder un imbécile d'ambassadeur qu'on avait à Berlin; mais il ne porte pas ses vues si haut; le moindre poste lui suffirait. Il s'abaisse jusqu'à proposer d'aller, déguisé en marchand, étudier les frontières orientales de l'Autriche! Cela fait mal à lire; mais aussi cela m'a fait faire de tristes réflexions. Quand ma correspondance vaudrait celle de Mirabeau, me connaîtra-t-on mieux? J'ai prédit cinq ans l'avenir de la France, ne m'a-t-on pas tout nié jusqu'au dernier moment? Mais Mirabeau, si outrageusement méconnu, s'est vengé, et je ne me vengerai pas. Au reste, je vois ici des traces de cette vengeance: une ville à moitié écrasée par les bombes, des figures sur des tombeaux, des effigies de saints mutilés par les sabres de l'égalité, la mort et la vie profanées par cette révolution dont les soldats n'étaient un moment vaincus à Mayence que pour aller exterminer les Vendéens. Allons! demeurons incorrigibles! Recommençons! on recommencera!—Je voudrais savoir assez d'allemand pour offrir à lady Clara l'hommage de mon respect».[Retour au Texte Principal]
Note 133: Mayence est la patrie de Guttemberg, qui fit dans cette ville les premiers essais de l'art de l'imprimerie en 1438 ou 1440.[Retour au Texte Principal]
Note 134: Celle du 6 septembre 1631 gagnée par Gustave-Adolphe, et celle du 19 octobre 1813 perdue par Napoléon.[Retour au Texte Principal]
Note 135: Sur M. de Caux et M. de Cussy, voir, au tome I, la note 1 de la page 173.—Maurice-Adolphe-Charles, vicomte de Flavigny (1799-1813). Après avoir rempli auprès du prince de Polignac les fonctions de secrétaire, il servit la monarchie de Juillet et entra à la Chambre des pairs le 25 décembre 1841. Représentant d'Indre-et-Loire à l'Assemblée législative de 1849 et membre de la droite monarchiste, il se rallia, après le coup d'État du 2 décembre, au gouvernement de Louis-Napoléon. Député au Corps législatif de 1852 à 1863, il se prononça avec énergie en faveur du pouvoir temporel du pape, ce qui lui valut de perdre la qualité de candidat officiel et de n'être pas réélu lors du renouvellement du 1er juin 1863.[Retour au Texte Principal]
Note 136: Frédéric-Guillaume III, né le 3 août 1770, veuf de la reine Louise, morte le 19 juillet 1810. Il était monté sur le trône le 16 novembre 1797. Il eut pour successeur, en 1840, Frédéric-Guillaume IV, son fils. Un autre de ses fils a été l'empereur Guillaume Ier.[Retour au Texte Principal]
Note 137: Ernest-Auguste, duc de Cumberland, cinquième fils du roi d'Angleterre George III, né en 1771, mort en 1851, était le troisième des princes de la maison de Hanovre qui ait porté ce titre. Il avait épousé en 1815 la princesse Frédérique-Caroline-Sophie de Mecklembourg-Strélitz, née le 2 mars 1778, veuve en premières noces du prince Louis de Prusse et divorcée d'avec son second mari, prince de Salms-Braunfels. Elle s'était d'abord fiancée au duc de Cambridge, septième fils de George III, puis avait rompu avec lui pour épouser le duc de Cumberland. En 1837, le duc Ernest-Auguste a été appelé au trône de Hanovre, la loi salique en vigueur dans ce pays empêchant la reine Victoria de réunir les deux couronnes sur sa tête, comme ses prédécesseurs.[Retour au Texte Principal]
Note 138: Frédéric-Guillaume-Charles, frère du roi, né le 3 juillet 1783, marié le 12 janvier 1804 à Amélie-Marianne de Hesse-Hombourg.[Retour au Texte Principal]
Note 139: Fils du prince Ferdinand de Prusse et neveu du grand Frédéric. Il avait été fait prisonnier, le 10 octobre 1806, au combat de Saalfeld, où son frère aîné le prince Louis avait été tué.[Retour au Texte Principal]
Note 140: Jean-Pierre-Frédéric Ancillon (1766-1837), historien et homme d'État prussien, descendant de parents français émigrés à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Il avait publié en 1803 un Tableau des révolutions du système politique de l'Europe, qui lui fit prendre rang parmi les meilleurs historiens de l'époque. En 1806, il fut chargé par Guillaume III de l'éducation du prince royal, et en 1814 il vint à Paris avec son élève. Il devint en 1831 ministre des Affaires étrangères.[Retour au Texte Principal]
Note 141: Frédéric-Guillaume, né le 15 octobre 1795. Il succéda à son père en 1840, sous le nom de Frédéric-Guillaume IV et mourut le 1er janvier 1861.[Retour au Texte Principal]
Note 142: Le comte David d'Alopeus (1769-1831). Après avoir été ministre de Russie à la cour de Suède, puis à la cour de Wurtemberg, il devint, en 1813, commissaire général des armées alliées, et fut alors fixé par ses fonctions au quartier général des souverains confédérés. Sa femme, qui l'y accompagnait, se fit autant remarquer par sa beauté que par les grâces de son esprit. En 1815, le comte d'Alopeus fut gouverneur de la Lorraine, pour la Russie, et fit preuve dans ce nouveau poste de la plus louable modération. Nommé peu de temps après ministre plénipotentiaire de Russie à la cour de Berlin, il resta dans cette ville jusqu'à sa mort, arrivée le 13 juin 1831.—Sa fille, Mlle Alexandrine d'Alopeus, épousa Albert de la Ferronnays, l'un des fils du comte de la Ferronnays, l'ami de Chateaubriand. Elle est l'héroïne du Récit d'une sœur, de Mme Augustus Craven.[Retour au Texte Principal]
Note 143: Sophie-Wilhelmine, margravine de Bayreuth (1709-1758), fille du roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier et sœur du grand Frédéric. Elle épousa en 1731 l'héritier du margraviat de Bayreuth. Voltaire a écrit une Ode sur sa mort. Elle a laissé des Mémoires qui vont de 1706 à 1742 et qui renferment les plus intéressants détails sur l'intérieur de la cour de Prusse. La Correspondance de cette princesse avec Frédéric II a été imprimé dans les Œuvres de ce dernier (tome XXVII).[Retour au Texte Principal]
Note 144: Wilhelmine Enke, femme Rietz, comtesse de Lichtenau (1754-1820). Fille d'un musicien de la chapelle royale de Prusse, elle devint à seize ans la maîtresse du prince royal, fils du grand Frédéric, qui lui fit épouser un de ses valets de chambre nommé Rietz, et qui, devenu roi en 1786 sous le nom de Frédéric-Guillaume II, la revêtit du titre de comtesse de Lichtenau. Elle a écrit des Mémoires, qui ont été traduits en français (1809).[Retour au Texte Principal]
Note 145: Le prince Henri de Prusse, frère du grand Frédéric, né en 1726. Il contribua puissamment aux succès de son frère pendant la guerre de Sept ans. Ami de la France, et surtout de ses philosophes, dont il partageait, comme son frère, les idées anti-chrétiennes, il était venu à Paris en 1788 pour y passer la fin de sa vie; mais la Révolution le força de s'éloigner. Il mourut à son château de Rheinsberg en 1802.[Retour au Texte Principal]
Note 146: Histoire secrète de la cour de Berlin, par Mirabeau.[Retour au Texte Principal]
Note 147: Charles-Guillaume, baron de Humboldt (1767-1835). Il fut successivement ministre ou ambassadeur en Espagne, à Rome, à Vienne, en Angleterre. Il prit part, comme plénipotentiaire de la Prusse, aux congrès de Châtillon, de Vienne, d'Aix-la-Chapelle, et fut l'un des signataires de la paix de Paris en 1814. Son principal ouvrage, comme philologue, est un traité sur la Langue kawi dans l'île de Java. Ses Essais esthétiques sont considérés comme un des chefs-d'œuvre de la critique allemande.[Retour au Texte Principal]
Note 148: Frédéric-Henri-Alexandre, baron de Humboldt (1769-1859), auteur du Cosmos, essai d'une description physique du monde, l'une des plus grandes œuvres de ce siècle.[Retour au Texte Principal]
Note 149: Louis-Charles-Adélaïde, dit Adelbert de Chamisso de Boncourt (1781-1831), poète, romancier et savant allemand, né en Champagne, au château de Boncourt, d'une famille noble et originaire de Lorraine. Ses parents émigrèrent dès 1790 et l'emmenèrent en Allemagne. À quinze ans, il devint page de la reine de Prusse. À dix-sept ans, il entra au service, et il était lieutenant en 1801. Il revint en France après la paix de Tilsitt (1807), mais retourna en Allemagne en 1811. On lui doit deux volumes de poésies et une traduction en vers des chansons de Béranger. Comme romancier, il a acquis une célébrité européenne par l'Histoire merveilleuse de Pierre Schlemihl (1814). C'est l'histoire humoristique d'un homme qui a perdu son ombre. On a traduit dans presque toutes les langues cet «inimitable caprice», comme l'appelle M. N. Martin, qui l'a traduit en français (1838). «C'est à un Français, à Chamisso, dit le traducteur, que cette fantastique Allemagne, qui prétend avoir seule bien compris et cultivé le romantisme, doit le chef-d'œuvre de sa poésie romantique.» Chamisso est également l'auteur de nombreux travaux scientifiques, parmi lesquels il faut citer son Tableau des plantes les plus utiles et les plus nuisibles du Nord de l'Allemagne;—ses Observations recueillies pendant le voyage de découvertes de Kotzebue, et son Voyage autour du monde.[Retour au Texte Principal]
Note 150: Napoléon-Vendée.[Retour au Texte Principal]
Note 151: Le 10 août 1792, les deux frères aînés de Chamisso, Hippolyte et Charles, se trouvaient auprès de Louis XVI. Charles, blessé en défendant le roi, fut sauvé par un homme du peuple; peu de temps après, il reçut une épée qu'avait portée l'infortuné monarque, et un billet ainsi conçu: «Je recommande à mon frère M. de Chamisso, un de mes fidèles serviteurs; il a plusieurs fois exposé sa vie pour moi. LOUIS.»—Notice sur Chamisso, par Jean-Jacques Ampère (Littératures et Voyages, p. 227).[Retour au Texte Principal]
Note 152: Chamisso avait fait partie, de 1815 à 1818, de l'expédition d'exploration dans les mers du Nord, entreprise par Otto Kotzebue, sous les auspices du chancelier russe Romanzof. Un gracieux souvenir de la France l'attendait au Kamtchatka. «Je vis, dit-il, pour la première fois un portrait que j'ai souvent retrouvé depuis sur des vaisseaux américains, et que leur commerce a répandu sur les côtes et dans les îles de l'Océan Pacifique, le portrait de Mme Récamier, cette aimable amie de Mme de Staël, auprès de laquelle j'avais eu le bonheur de vivre longtemps. Il était peint sur verre par une main chinoise assez délicate.»[Retour au Texte Principal]
Note 153: Amélie-Marianne de Hesse-Hombourg, femme du prince Guillaume et belle-sœur du roi.[Retour au Texte Principal]
Note 154: Au lendemain de cette représentation, Chateaubriand écrivait à Mme de Duras: «J'ai été voir jouer la Jeanne d'Arc de Schiller. C'est un mélodrame, mais un mélodrame superbe. La cérémonie du sacre est admirable. Quand j'ai vu la cathédrale de Reims et que j'ai entendu le chant religieux, au moment de la consécration de Charles VII, j'ai pleuré sans comprendre un mot de ce qu'on disait. Quel peuple que ce peuple français! Comme il occupe les autres peuples! Et quelle honte de ne plus retrouver de La Hire que sur les théâtres étrangers! Schiller chante Jeanne et Voltaire la déshonore.»[Retour au Texte Principal]
Note 155: Gaspard Spontini (1778-1854), auteur des opéras de la Vestale (1807) et de Fernand Cortez (1809). Il était depuis 1820 directeur de l'Opéra de Berlin. Après la mort de son protecteur Frédéric-Guillaume III, il revint à Paris, où il avait été élu à l'unanimité membre de l'Académie des beaux-arts dès 1839.[Retour au Texte Principal]
Note 156: Sébastien Érard, facteur de pianos (1752-1831). Il perfectionna le piano, l'orgue et la harpe, construisit les premiers pianos à queue (1796) et à double échappement (1823); inventa les harpes à fourchette (1789) et le mécanisme à double mouvement pour harpe (1810). Il réussit à rendre expressif le jeu de l'orgue au moyen de la seule pression du doigt (1827).[Retour au Texte Principal]
Note 157: Charles de Lameth, l'un des principaux membres du côté gauche à la Constituante, s'était couvert de ridicule, au mois de mars 1790, en dirigeant, comme membre du comité de surveillance, une expédition nocturne contre le couvent des Annonciades de Pontoise, pour y rechercher M. de Barentin, frère de l'abbesse. Le marquis de Bonnay, prédécesseur de Chateaubriand à Berlin, avait composé à cette occasion un poème héroï-comique, des plus spirituels, la Prise des Annonciades.[Retour au Texte Principal]
Note 158: Charles-Auguste, prince de Hardenberg (1750-1822). Ministre des Affaires étrangères depuis 1806, il fut nommé en 1810 chancelier d'État, et signa en 1814 la paix de Paris. Il assista comme plénipotentiaire aux Congrès d'Aix-la-Chapelle, de Carlsbad, de Vienne et de Vérone. Le roi de Prusse l'avait créé prince en 1814.[Retour au Texte Principal]
Note 159: David-Frédéric Koreff (1783-1851), célèbre médecin allemand. Il était né à Breslau. Il fut pendant quelque temps le secrétaire du prince de Hardenberg, qui l'avait en particulière amitié. Il mourut à Paris, où il avait fini par se fixer, et où il n'était pas moins connu par son esprit original que par son inépuisable charité.[Retour au Texte Principal]
Note 160: Hyacinthe Pilorge, secrétaire de Chateaubriand.[Retour au Texte Principal]
Note 161: Charles-Louis Sand (1795-1819) étudiant de l'Université d'Iéna, qui, le 23 mars 1819, à Manheim, avait assassiné le célèbre écrivain Auguste de Kotzebue, qu'il regardait comme le suppôt de l'absolutisme. Le capitaine Otto de Kotzebue, que nous avons vu tout à l'heure diriger l'expédition dans les mers du Nord, dont fit partie Chamisso, était le fils d'Auguste de Kotzebue.[Retour au Texte Principal]
Note 162: Le fils de la duchesse de Cumberland, né en 1819, devint roi de Hanovre, en 1851, sous le nom de George V. Ayant pris parti contre la Prusse, dans la guerre de cet état contre l'Autriche, et ayant été battu, il fut déposé, et son royaume annexé à la Prusse (1866). Son fils porte aujourd'hui en Angleterre le titre de duc de Cumberland. Il a épousé la princesse Thyra de Danemark, sœur de la princesse de Galles.[Retour au Texte Principal]
Note 163: 19 avril 1821. Chateaubriand était parti pour Paris, afin d'assister au baptême du duc de Bordeaux.[Retour au Texte Principal]
Note 164: Le couronnement de George IV, roi d'Angleterre, eut lieu le 19 juillet 1821. La reine Louise de Prusse était morte le 19 juillet 1810.[Retour au Texte Principal]
Note 165: La reine de Hanovre mourut au mois de juillet 1841.[Retour au Texte Principal]
Note 166: Le 14 décembre 1822, MM. de Villèle et Corbière étaient devenus, le premier, ministre des finances, et le second, ministre de l'intérieur.[Retour au Texte Principal]
Note 167: Le 2 juillet 1820, une révolution militaire avait éclaté à Naples. Les carbonari, vaste association secrète qui couvrait de son réseau une grande partie de l'Italie, avaient gagné l'armée. Le général Pepe avait obligé le roi des Deux-Siciles, Ferdinand Ier, à proclamer une constitution calquée sur celle que les révolutionnaires venaient d'établir en Espagne. Les Autrichiens entrèrent à Naples le 23 mars 1821. Les principaux auteurs du mouvement cherchèrent un refuge sur des vaisseaux étrangers. Le parlement se sépara, et la vente suprême des carbonari prononça elle-même sa dissolution. Ferdinand, qui avait dû quitter sa capitale le 10 décembre 1820, y rentra le 15 mai 1821.[Retour au Texte Principal]
Note 168: Jean VI, empereur du Brésil et roi de Portugal (1767-1826). Fils de Pierre III et de la reine Marie, il fut nommé régent du royaume de Portugal, en 1792, lorsque sa mère tomba en démence. Attaqué en 1807 par les armées françaises, il se retira avec la famille royale au Brésil, colonie portugaise, et y prit le titre d'empereur. Proclamé roi du Portugal en 1816, à la mort de sa mère, il ne quitta pas cependant Rio-de-Janeiro, et ce fut seulement en 1821 qu'il revint à Lisbonne. Il se vit contraint à son arrivée de sanctionner une constitution proposée par les Cortès; mais il l'abolit deux ans après. Pendant qu'il était en Portugal, le Brésil se déclara indépendant, et ne lui laissa que le vain titre d'empereur. Il laissa en mourant deux fils, don Pedro (Pierre IV) et don Miguel, célèbres par leur inimitié.[Retour au Texte Principal]
Note 169: Au moment où la révolution de Naples expirait, des troubles avaient éclaté dans le Piémont. Le 10 mars 1821, la garnison d'Alexandrie s'était soulevée, aux cris de: Vive le Roi! Vive la constitution d'Espagne! À bas l'Autriche! Turin, Pignerol, Ivrée avaient suivi le mouvement. Les conjurés avaient gagné le colonel Saint-Marsan, fils du ministre des Affaires étrangères, et comptaient sur le cousin du roi, le jeune prince de Carignan,—le futur Charles-Albert. Le 13 mars, le roi Victor-Emmanuel I abdiqua en faveur de son frère Charles-Félix, et, en l'absence de ce dernier, qui se trouvait alors auprès du duc de Modène, son beau-père, il donna la régence au prince de Carignan. Celui-ci proclama aussitôt la constitution des Cortès d'Espagne, et institua une junte provisoire; mais, au bout de peu de jours, le 21 mars, il fut forcé de se retirer devant l'intervention autrichienne. Les conjurés d'Alexandrie et les fédérés italiens furent dispersés à Novare par le général Latour. L'armée victorieuse entra le 10 avril à Turin. Victor-Emmanuel maintint son abdication, et Charles-Félix rétablit l'ancien gouvernement.[Retour au Texte Principal]
Note 170: Il donnait des conseils hardis qu'on n'écoutait pas à Versailles. Ch.[Retour au Texte Principal]
Note 171: On lit dans le Moniteur du 29 avril 1821: «Paris, 28 avril. M. le vicomte de Chateaubriand, ministre plénipotentiaire de France à Berlin, est arrivé avant-hier à Paris.»[Retour au Texte Principal]
Note 172: Le baptême du duc de Bordeaux eut lieu à Notre-Dame, avec une grande solennité, le 1er mai 1821. Chateaubriand fut rétabli sur la liste des ministres d'État, MM. de Blacas et de Montesquiou furent créés ducs; de nombreuses promotions furent faites dans l'ordre militaire et dans l'ordre civil. Il y eut une magnifique revue au Champ-de-Mars et une fête splendide à l'Hôtel de Ville. Les députés des trente-neuf bonnes villes de France y furent invités. La ville de Paris dota seize jeunes filles; d'immenses secours furent prodigués aux pauvres.[Retour au Texte Principal]
Note 173: Le 7 juillet 1821, à l'occasion de la demande de la prolongation de la censure jusqu'à la fin de la session suivante, proposition déposée par le ministère, la Chambre des députés avait voté un amendement qui limitait la durée de la censure aux trois premiers mois de la session prochaine. La plus grande partie de la droite avait voté pour cet amendement. Louis XVIII ne cacha pas le vif mécontentement qu'il en éprouvait. «Ce déplaisir manifesté par le roi, dit Alfred Nettement (Histoire de la Restauration, tome V, p. 621), achevait de rendre très difficile la position de MM. de Villèle et de Corbière dans le Conseil et dans la Chambre. C'étaient les voix de leurs amis, ils ne pouvaient se le dissimuler, qui avaient déterminé le vote, et dans l'état d'incertitude où étaient les affaires, ils ne pouvaient les blâmer d'avoir pris des sûretés qu'on ne leur donnait pas. Après s'être tous deux concertés, ils reconnurent qu'ils ne pouvaient demeurer plus longtemps dans les conditions où il étaient placés sans amoindrir leur position comme membres du cabinet et comme hommes du parlement. Ils résolurent donc de poser catégoriquement la question au duc de Richelieu, préférant se retirer du Conseil avec honneur que d'y rester dans une position équivoque. M. de Corbière eut avec M. de Serre (Garde des Sceaux dans le cabinet Richelieu) une conférence qui n'aboutit à rien. M. de Chateaubriand venait d'arriver de Berlin; il y eut une délibération dans la réunion de la droite; et l'on convint de deux choses l'une, ou sortir du ministère, ou y entrer avec trois portefeuilles: deux pour MM. de Villèle et de Corbière; un troisième, celui de la guerre, pour le duc de Bellune (le maréchal Victor). M. de Chateaubriand déclara que, si cet arrangement n'était pas accepté, il donnerait sa démission de l'ambassade de Berlin, et se retirerait avec MM. de Villèle et de Corbière. La droite, avec le nombre de voix dont elle disposait dans la Chambre, ne pouvait, selon lui, se trouver satisfaite à moins.»—Les négociations durèrent jusqu'au 27 juillet, et se terminèrent par la retraite de MM. de Villèle et de Corbière. En même temps, Chateaubriand donnait sa démission d'ambassadeur.[Retour au Texte Principal]
Note 174: La princesse Frédérique, reine de Hanovre, vient de succomber après une longue maladie: la mort se trouve toujours dans la Note au bout de mon texte! (Note de Paris, juillet 1841.) Ch.[Retour au Texte Principal]
Note 175: Voir l'Appendice no III: La mort de Fontanes.[Retour au Texte Principal]
Note 176: La nomination du cabinet de droite parut au Moniteur du 15 décembre 1821. Il était ainsi composé: MM. de Villèle aux Finances, Corbière à l'Intérieur, le duc de Bellune à la Guerre, de Clermont-Tonnerre à la Marine, Mathieu de Montmorency aux Affaires étrangères, de Peyronnet à la Justice, M. de Lauriston, seul ministre restant, à la maison du Roi.[Retour au Texte Principal]
Note 177: On lit, dans le Moniteur du 10 janvier 1822: «Paris, 9 janvier. Sur la démission donnée par M. le duc Decazes, ambassadeur de France en Angleterre, le Roi, par ordonnance du 9 janvier, a nommé M. le vicomte de Chateaubriand, pair de France, ministre d'État, à l'ambassade de Londres, et M. le comte de Serre à l'ambassade du royaume des Deux-Siciles.»[Retour au Texte Principal]
Note 178: Ce livre a été écrit en 1839.—Il a été revu en décembre 1846.[Retour au Texte Principal]
Note 179: À peine arrivé à Londres, il écrivait à la duchesse de Duras: «J'ai été saisi de tristesse depuis que je suis ici. J'ai revu les rues que j'ai habitées, Kensington dont les arbres sont devenus énormes. L'épreuve est rude. Que de temps écoulé! Ma maudite mémoire est telle que j'ai reconnu jusqu'à des marques que j'avais vues sur des bornes. Tout cela était pour moi comme d'hier. J'ai parcouru en voiture, au milieu de la foule, les allées de Hyde-Park, où j'errais à pied en composant Atala et René. Étais-je plus heureux? mais au moins j'avais le temps d'attendre. Je reçois votre longue lettre. J'en avais grand besoin. Je ne puis soulever le poids que Londres a mis sur moi. Il me semble que je suis au fond d'un désert et que je ne dois plus revoir mes amis. Berlin était une merveille.»[Retour au Texte Principal]
Note 180: Lord Londonderry, vicomte Castlereagh, secrétaire d'État pour les Affaires étrangères. Voir, au tome I, la note 1 de la page 322.[Retour au Texte Principal]
Note 181: Le vicomte Mathieu de Montmorency, ministre des affaires étrangères.[Retour au Texte Principal]
Note 182: Édouard, duc de Fitz-James (1776-1838) appartenait à une famille de vieille noblesse qui descendait des Stuarts. Petit-fils du maréchal de France duc de Berwick, il émigra en Italie avec les siens dès le début de la Révolution, servit dans l'armée de Condé en qualité d'aide-de-camp du duc de Castries, rentra en France en 1801 et vécut dans la retraite jusqu'à la fin du régime impérial. Nommé pair de France le 4 juin 1814, il donna sa démission, lorsque fut votée la loi qui supprimait l'hérédité de la pairie (28 décembre 1831). De 1835 à sa mort, il fit partie de la Chambre des députés, siégea sur les bancs de la droite et se fit remarquer par son éloquence, à côté même de Berryer. «M. le duc de Fitz-James, dit Cormenin (Livre des orateurs, t. I, p. 130), a été le dernier des chevaliers-orateurs. Sa stature était haute et sa physionomie mobile et spirituelle. Il avait, à la tribune, les airs, le sans-gêne, le déboutonné d'un grand seigneur qui parle devant des bourgeois... Son discours était tissu de mots fins, et quelquefois il était hardi et coloré... C'était une nature forte et heureusement organisée, à laquelle il n'a manqué, autrefois que l'occasion, et depuis que la jeunesse. Du reste, grand dans ses sentiments comme dans son langage; plein de cet honneur qui est la vie même du gentilhomme, et de ce désintéressement qui préférait la pauvreté à une bassesse; religieux, mais sans hypocrisie; fier de son origine, mais préoccupé des droits et des besoins de la génération nouvelle; jaloux de la dignité de son pays et portant haut son cœur français.[Retour au Texte Principal]
Note 183: Le prince Paul Esterhazy, longtemps ambassadeur d'Autriche à Londres et, ainsi que le prince de Lieven, un des familiers de George IV, qui aimait à s'entourer d'étrangers.[Retour au Texte Principal]
Note 184: Voir l'Appendice, no IV: Le prétendu Traité de Vérone.[Retour au Texte Principal]
Note 185: John Ier comte Russell (1792-1878). Dès qu'il eut atteint sa majorité, il entra dans la vie politique en qualité de député de Tavistock (juillet 1813). Il a fait partie du Parlement jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant soixante-cinq ans: membre de la Chambre des Communes de 1813 à 1860, et de la Chambre des lords de 1861 à 1878. L'un des principaux orateurs du parti libéral, il a occupé une place importante dans tous les cabinets whigs qui se sont succédé de 1835 à 1865.[Retour au Texte Principal]
Note 186: John Scott, comte d'Eldon (1751-1838). Fils d'un simple marchand de charbon de Newcastle-sur-Tyne, il parvint par son talent aux plus hauts emplois. Successivement conseiller du roi, attorney général, chef des plaids-communs, il fut élevé en 1790 à la dignité de pair d'Angleterre et remplit de 1801 à 1827, les fonctions de lord chancelier. Le lord chancelier est en même temps le président de la Chambre des lords, le chef de la justice et le président d'une cour particulière appelée court of chancery.—Tory exalté, lord Eldon combattit opiniâtrement l'émancipation des catholiques.[Retour au Texte Principal]
Note 187: Chateaubriand a déjà eu occasion de citer lord Holland, au tome II, page 199.—Henri-Richard Vassall-Fox, troisième baron Holland (1773-1840) avait à peine un an quand il hérita de la pairie paternelle. Grand admirateur de la Révolution française et de Napoléon, il est toujours demeuré fermement attaché au parti whig. En 1797, il avait épousé lady Webster, née Vassall, qu'il avait connue à Florence, et avec laquelle il avait eu une liaison antérieure. Sir Godfrey Webster avait obtenu le divorce à son profit, et lord Holland avait dû lui payer 6,000 livres sterling de dommages et intérêts. Lady Holland jouissait d'une réputation d'esprit parfaitement méritée, et Holland House a été pendant de longues armées le rendez-vous de toutes les notabilités littéraires de l'époque.[Retour au Texte Principal]
Note 188: «C'étaient, en effet, dit M. de Marcellus (Chateaubriand et son temps, p. 267), des chanteuses, actrices, danseuses même, réunies par M. de Rothschild de Londres dans un but tout hospitalier. Il connaissait le penchant inné du corps diplomatique pour les plaisirs auxquels ces dames président; et il jugea leur société de nature à faire oublier à ses nobles convives la sévérité et la tristesse d'un séjour israélite.»[Retour au Texte Principal]
Note 189: Lord Clanwilliam, sous-secrétaire d'État du Foreign-Office, était à cette époque le type du dandysme.[Retour au Texte Principal]
Note 190: Dans toutes les éditions précédentes, on a imprimé Dorset, défigurant ainsi le nom du comte d'Orsay, qui fut pendant plusieurs années, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, le roi de la fashion, à Londres comme à Paris.—Gillion-Gaspard-Alfred de Grimaud, comte d'Orsay, né le 4 février 1801, fils de Jean-François-Albert-Marie-Gaspard de Grimaud, comte d'Orsay et du Saint-Empire, lieutenant général, commandeur de Saint-Louis, et de Éléonore de Franquemont. Garde du corps sous la Restauration, il épousa en 1827 une fille issue du premier mariage de lord Blessington. Cette union ne fut pas heureuse. Les deux époux divorcèrent. Tandis que sa femme convolait en secondes noces avec lord Spencer, Alfred d'Orsay continua de vivre auprès de sa belle-mère, même après la mort de lord Blessington (mai 1829). Lady Blessington menait grand train, tenait un salon célèbre, publiait des romans du genre fashionable et finalement se ruinait. Le mauvais état de ses affaires l'obligea de rendre son mobilier en 1849 et de se réfugier à Paris. Le comte d'Orsay l'y accompagna. Comme il avait été très lié à Londres avec le prince Louis Bonaparte, et qu'il avait d'ailleurs un joli talent de sculpteur, le prince-président le nomma en 1851 surintendant des beaux-arts. Il mourut le 4 août 1852 à Chambourg, près de Saint-Germain.—Barbey d'Aurevilly, dans son petit volume Du Dandysme et de George Brummel, esquisse en ces termes le portrait du comte d'Orsay: «C'était un nerveux sanguin aux larges épaules, à la poitrine François 1er et à la beauté sympathique. Il avait une main superbe et une manière de la tendre qui prenait les cœurs et les enlevait. Ce n'était pas le shake-hands du Dandysme... D'Orsay était un roi de bienveillance aimable, et la bienveillance est un sentiment entièrement inconnu aux dandys... Quoique fat, d'Orsay fut aimé par les femmes les plus fates de son temps. Il a même inspiré une passion qui dura et resta historique... Quant à ce duel charmant de d'Orsay, jetant son assiette à la tête de l'officier qui parlait mal de la Sainte-Vierge, et se battant pour elle parce qu'elle était femme et qu'il ne voulait pas qu'on manquât de respect à une femme devant lui, quoi de moins dandy et de plus français?»—Sur la liaison du comte d'Orsay et de lady Blessington, commencée en 1822 pour finir seulement en 1849, à la mort de la célèbre authoress, voir The English Cyclopædia, conducted by Charles Knight, Biography, vol. I, p. 720. London, 1856.[Retour au Texte Principal]
Note 191: Dorothée Christophorowna de Benkendorf (1785-1855). Elle avait épousé Christophe Andréiëvitch, prince de Lieven, général dans l'armée russe, gouverneur du tsar Alexandre II et pendant vingt-deux ans ambassadeur à Londres. Le portrait qu'en trace ici Chateaubriand est trop poussé au noir. «Bien qu'étrangère, dit M. de Marcellus, elle dominait les filles d'Albion par une incontestable supériorité d'attitude et de manières. Elle savait causer de tout; elle avait été fort jolie, et sa taille gardait encore beaucoup plus tard une grande élégance; elle possédait une merveilleuse aptitude pour la musique; sa mémoire lui rappelait des opéras entiers qu'elle exécutait à ravir sur le piano.» Justement réputée par son esprit et sa rare intelligence des affaires publiques, elle a été liée avec tout ce que son temps comptait de personnages éminents, dans tous les partis et dans toutes les nationalités. Castlereagh et Canning ont été particulièrement de ses amis, ainsi que le prince de Metternich; lord Grey lui écrivait chaque matin de son lit un billet demi-politique, demi-galant. On lui a attribué une liaison avec George IV. À Paris, où elle s'était fixée après la mort de son mari, elle a été l'Égérie de M. Guizot qui passait toutes ses soirées chez elle.[Retour au Texte Principal]
Note 192: Édouard-Adolphe Saint-Maur, onzième duc de Somerset (1775-1855).[Retour au Texte Principal]
Note 193: Le 23 avril 1838. Louis-Philippe nomma le maréchal Soult ambassadeur extraordinaire de France en Angleterre pour assister au couronnement de la reine Victoria. La population de Londres fit au maréchal une réception enthousiaste; il fut le lion de toutes les fêtes. Le couronnement de la reine eut lieu le 20 juin 1838.[Retour au Texte Principal]
Note 194: «Cette apostrophe au duc de Wellington, dit M. de Marcellus (Chateaubriand et son temps, p. 272), me rappelle que, dans sa colère contre la statue que les ladies fashionnables dressèrent par souscription, ære feminino, au héros représenté sous les traits d'un Achille jeune et à demi-nu, M. de Chateaubriand me dit comme nous passions un jour dans ce coin de Hyde-Park: «Non, il n'a battu que le maréchal Soult; il n'a point vaincu l'invincible, et il n'a été à Waterloo que l'exécuteur de la justice divine.»[Retour au Texte Principal]
Note 195: À sa sortie du ministère, le duc de Richelieu avait projeté de faire, au printemps de 1822, un voyage à Vienne et à Odessa. Avant de partir, il était allé passer quelque temps au château de Courteille, auprès de sa femme et de sa belle-mère; là, il se sentit assez sérieusement souffrant, et se hâta de rentrer à Paris. À peine y était-il arrivé qu'une congestion cérébrale le frappait. Son vieil ami, l'abbé Nicolle, accourut à son chevet, pendant que l'abbé Feutrier, curé de l'Assomption, lui administrait les derniers sacrements. Le duc parut s'associer aux prières qu'on faisait pour lui, et serra les mains de l'abbé Nicolle; des larmes coulèrent de ses yeux; puis il expira doucement, le 17 mai 1832, à onze heures du soir; il était âgé de cinquante-cinq ans et huit mois (Souvenirs du duc de Rochechouart, p. 498).[Retour au Texte Principal]
Note 196: Henry Petty-Fitz-Maurice, 3e marquis de Lansdowne (1780-1863). De 1830 à 1858, il a fait partie de tous les ministères whigs.[Retour au Texte Principal]
Note 197: Sarah Kemble, mistress Siddons (1755-1831), fille de Roger Kemble, directeur d'une troupe ambulante, et sœur du fameux acteur J. Kemble, épousa Siddons, acteur de la troupe de son père. Elle fut surnommée la Reine de la tragédie. Le rôle de lady Macbeth était son triomphe. Selon lord Byron, elle était la perfection même et réalisait l'idéal de la tragédienne. Elle quitta le théâtre dès 1799 pour se livrer aux lettres et à l'éducation de ses enfants.[Retour au Texte Principal]
Note 198: Antoine-Louis-Marie de Gramont, duc de Guiche (1755-1836) était, à la Révolution, capitaine aux gardes du corps. Il émigra avec sa famille en Angleterre, où il servit au 10e hussards; il y était connu sous le nom de capitaine Gramont. Rentré en France avec le duc d'Angoulême, dont il fut le premier aide de camp, il devint successivement pair de France (4 juin 1814), général de division (8 août 1814), gouverneur de la 11e division militaire (30 septembre 1814). Après la révolution de juillet, il ne refusa pas le serment au nouveau gouvernement et resta à la Chambre haute jusqu'à sa mort.—Sa femme, la duchesse de Guiche, était la fille de la duchesse de Polignac. Son fils, le duc de Gramont, a été ministre des Affaires étrangères en 1870.[Retour au Texte Principal]
Note 199: Astolphe, marquis de Custine. Voir, au tome II, la note 1 de la page 298.[Retour au Texte Principal]
Note 200: Charlotte-Marie-Antoinette-Léontine de Noailles-Mouchy, née le 22 juillet 1791, fille d'Arthur-Jean-Tristan-Charles-Languedoc de Noailles, duc de Mouchy, prince de Poix, et de Nathalie-Luce-Léontine de la Borde de Méréville, la Blanca de Chateaubriand. (Voir sur Mme de Noailles-Mouchy, l'Appendice du tome II, no XII.) Léontine de Noailles épousa, le 15 avril 1809, son cousin Alfred-Louis-Dominique-Vincent de Paule, vicomte de Noailles, qui fut tué, le 28 novembre 1812, au passage de la Bérésina. Elle est morte à Mouchy-le-Châtel, le 13 septembre 1851. Chateaubriand ne dit rien de trop des agréments de la vicomtesse Alfred de Noailles, qui fut une des femmes les plus distinguées de son temps. Elle a écrit la Vie de la princesse de Poix, et ce petit livre est en son genre un chef-d'œuvre.—Mme Alfred de Noailles n'a laissé qu'une fille, Charlotte-Anne-Marie-Cécile (1810-1858), mariée à son cousin-germain Charles-Philippe-Henry de Noailles, duc de Mouchy, prince de Poix, grand d'Espagne, sénateur du second Empire (1808-1854).[Retour au Texte Principal]
Note 201: L'un des chefs du parti whig, père de lord John Russell. Le duc de Bedford et son adversaire le duc de Buckingham moururent tous les deux en 1839.[Retour au Texte Principal]
Note 202: Grenville-Nugent-Temple-Brydges-Chandos, duc de Buckingham (1776-1839). Ami personnel de George IV, il avait été créé chevalier de la Jarretière en 1820 et duc de Buckingham en 1822.[Retour au Texte Principal]
Note 203: Dudley Ryder, premier comte de Harrowby, né en 1762, mort en 1847. Fils de Nathaniel Ryder, premier baron Harrowby, il entra au Parlement en 1784 comme député de Tiverton, bourg de sa famille, devint sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères en 1789 et, l'année suivante, contrôleur de la maison du Roi. Orateur lucide et agréable, il avait une belle prestance. Il se lia avec Pitt, à qui il servit de témoin dans le duel de celui-ci avec Tierney. La mort de son père, en 1803, le fit entrer à la Chambre des lords. Lorsque Pitt succéda à Addington comme premier ministre en 1804, Harrowby fut nommé ministre des affaires étrangères, mais il ne garda ce poste que quelques mois, ayant fait une chute grave dans l'escalier du Foreign Office. En 1809, il fut créé vicomte Sandon et comte de Harrowby. En 1812, il entra dans le cabinet en qualité de président du Conseil Privé, fonctions qu'il devait conserver jusqu'en 1827. C'était dans sa maison de Grosvenor Square que Thistlewood et ses complices, au mois de février 1820, avaient résolu d'assassiner les ministres, et ce fut à lui que le complot fut révélé. À l'époque de la retraite de lord Goderich, en 1827, il donna sa démission et se refusa à former un cabinet dont il eût été le chef, Charles Greville, secrétaire du Conseil Privé, dans son très intéressant Journal, dit de lord Harrowby, qu'il était cassant, raide, et avait quelque chose de provocateur; qu'il avait des manies, qu'il manquait de décision et que c'était un alarmiste, mais qu'il était très instruit, et, en dehors des questions de parti, très favorable aux idées libérales. Quelque temps avant sa mort, Pitt avait, paraît-il, désigné Harrowby comme l'homme le plus capable d'être son successeur; mais son humeur inégale diminuait son influence sur les gens de son parti, et il ne possédait pas un talent d'orateur suffisant pour contrebalancer ce défaut.—Le comte de Harrowby avait épousé en 1795 lady Suzan Leveson Gower, sixième fille du marquis de Stafford, une des femmes les plus remarquables de son temps, et de qui il eut quatre fils et cinq filles.[Retour au Texte Principal]
Note 204: Sir Robert Peel (1788-1850), fils d'un très riche filateur de coton, que Pitt avait créé baronnet en 1800. Il fut élu député à vingt et un ans et prit place parmi les tories. En 1822, il était ministre de l'intérieur. Entré pour la première fois au ministère à l'âge de vingt-quatre ans, il fit successivement partie des cabinets Liverpool (de 1822 à 1827) et Wellington (de 1828 à 1830). De 1841 à 1848, il tint les rênes du gouvernement en qualité de premier ministre. Il était sur le point de revenir au pouvoir lorsqu'il mourut d'une chute de cheval dans sa soixante-deuxième année.[Retour au Texte Principal]
Note 205: John Pane, comte de Westmoreland, mort en 1841. Il avait été, sous le ministère de William Pitt, lord-lieutenant d'Irlande. En 1822, il était gardien du sceau privé.[Retour au Texte Principal]
Note 206: Henri, comte de Bathurst (1762-1834). Appelé, en 1809, à faire partie du ministère, en qualité de secrétaire d'État pour la guerre et les colonies, il eut à prendre comme tel les mesures relatives au Captif de Sainte-Hélène. Sorti du ministère en 1825, il revint au pouvoir en 1828 avec les tories et eut la présidence du conseil, qu'il conserva jusqu'en 1830.[Retour au Texte Principal]
Note 207: Lord Liverpool remplissait dans le cabinet les fonctions de premier Lord de la Trésorerie.—Voir sur lui, au tome I, la note 1 de la page 321.[Retour au Texte Principal]
Note 208: John William Croker. Voir sur lui, au tome II, la note 7 de la page 199.—Né à Galway (Irlande) le 20 décembre 1780, il débuta dans la carrière des lettres par deux mordantes satires sur le théâtre et la société de Dublin (1804-1805), et par une brillante brochure intitulée: Esquisse de l'Irlande passée et présente, dans laquelle il préconisait l'émancipation des catholiques (1807). En cette même année 1807, il fut envoyé au Parlement par les électeurs de Downpatrick. Deux ans plus tard, il fut nommé secrétaire de l'Amirauté en récompense du zèle avec lequel il avait défendu le duc d'York accusé d'avoir, de concert avec sa maîtresse Mistress Clarke, trafiqué des grades dont la nomination lui appartenait en sa qualité de commandant en chef de l'armée. Croker conserva ces fonctions lucratives jusqu'en 1830. À cette époque, il se retira avec une pension de 1500 livres sterling. Lorsque la Réforme électorale fut un fait accompli (1832), il refusa de rentrer au Parlement, ne pouvant pas, disait-il, «prendre une part active à un système de gouvernement qui devait aboutir au renversement de l'Église, de la pairie et du trône, en un mot de la constitution anglaise». Il ne voulut même pas accepter une place dans le ministère de son vieil ami Robert Peel en 1834, et il rompit avec Peel lui-même, lorsque les lois sur les céréales furent abolies (1846). Il mourut le 10 août 1857.—Outre les 260 articles qu'il a donnés à la Quarterly Review, de 1809 à 1854, William Croker a publié un très grand nombre d'ouvrages, dont les principaux sont les Contes pour les enfants tirés de l'histoire d'Angleterre (1817); la Johnson de Boswell (1831), et les Essais sur les commencements de la Révolution française. Il est l'inventeur du nom de «Conservateur» appliqué aux tories; Disraeli l'a représenté sous les traits de Rigby dans son roman de Coningsby (1844). Sir Théodore Martin a consacré un long article des plus élogieux à Croker dans le Dictionary of National Biography; et il ne parle pas trop mal de lui-même dans ses propres Mémoires, journaux et lettres, publiées en 1884 par les soins de Louis Jennings (trois vol. in-8o).[Retour au Texte Principal]
Note 209: Ambassadeur d'Angleterre à Madrid.[Retour au Texte Principal]
Note 210: On lit dans le Journal de Charles C.-F. Greville, secrétaire du Conseil Privé, sous la date du 19 août 1822: «Les funérailles de Lord Londonderry auront lieu demain à l'abbaye de Westminster. Eu égard aux circonstances de sa mort, il eût peut-être été de meilleur goût d'éviter la pompe et la solennité de cette cérémonie, mais on défère en cela au désir exprimé par sa veuve, qui aurait considéré comme une offense à sa mémoire le refus de rendre à ses restes tous les honneurs d'usage.»[Retour au Texte Principal]
Note 211: Dans une lettre à Madame de Duras, Chateaubriand lui disait: «J'arrive des funérailles de ce pauvre homme. Nous étions tous rangés autour de la fosse dans cette vieille église de Westminster. Le duc de Wellington qui a vu tant de morts paraissait abattu; lord Liverpool se cachait le visage dans son chapeau. Un groupe de radicaux, hors de l'église, a agité ses drapeaux et poussé des cris de joie, en voyant passer le cadavre. Le peuple n'a pas répondu et a paru indigné. Je verrai longtemps ce grand cercueil, qui renfermait cet homme égorgé de ses propres mains, au plus haut point de la prospérité. Il faut se faire trappiste.»[Retour au Texte Principal]
Note 212: Charles Stuart, né le 2 janvier 1779, remplit les fonctions d'ambassadeur d'Angleterre près la cour de France de 1815 à 1824 et de 1828 à 1830. Il fut élevé à la pairie en 1828 sous le titre de lord Stuart de Rothesay. Il mourut à sa terre de Highcliff (Hampshire) le 7 novembre 1845.[Retour au Texte Principal]
Note 213: Charles, 2e comte Grey, d'abord lord Horwick (1764-1845). Entré aux Communes dès sa majorité, et enrôlé dans les rangs des whigs par la belle duchesse de Devonshire, qui mettait ses séductions au service de son parti, il y prit position comme adversaire acharné de Pitt. Premier lord de l'amirauté en 1806, puis ministre des Affaires étrangères à la mort de Fox, il ne rentra aux affaires que comme premier ministre à la chute de Wellington en 1830. Dans l'intervalle, il avait été appelé par la mort de son père à la Chambre des lords. Après avoir attaché son nom à la grande réforme parlementaire de 1832, il quitta le pouvoir en 1834 et se retira à peu près complètement de la vie publique.[Retour au Texte Principal]
Note 214: Daniel O'Connell (1775-1847). Élu en 1828 membre de la Chambre des Communes, après une lutte acharnée contre le candidat protestant, il ne put siéger parce qu'il refusa de prêter le serment de Test; mais, aussitôt après l'émancipation des catholiques, qu'il n'avait cessé de réclamer et qui était en réalité son œuvre, il entra à la Chambre (1830). Orateur admirable, ardent patriote, fervent catholique, le libérateur de l'Irlande restera l'une des plus grandes figures de ce siècle.[Retour au Texte Principal]
Note 215: Chateaubriand—ses Mémoires le prouvent de reste—aimait les citations. Sa conversation en abondait quand elle dépassait les monosyllabes ou les lieux communs de la politesse. «Il ne faut pas croire,» disait-il un jour, à Londres, à M. de Marcellus, «que l'art des citations soit à la portée de tous les petits esprits qui, ne trouvant rien chez eux, vont puiser chez les autres. C'est l'inspiration qui donne les citations heureuses. La Mémoire est une Muse, ou plutôt c'est la mère des Muses, que Ronsard fait parler ainsi:
«Grèce est notre pays, Mémoire est notre Muse.
«Les plus grands écrivains du siècle de Louis XIV se sont nourris de citations.» Chateaubriand et son temps, p. 286.[Retour au Texte Principal]
Note 216: Ce pessimisme, dont les Mémoires renferment de si nombreux témoignages, l'auteur ne se faisait pas faute de le manifester également, presque en toute rencontre, dans ses conversations. En 1844, un jour que M. de Marcellus et lui faisaient quelques pas ensemble dans son petit jardin de la rue du Bac, il dit à son ami: «Le fleuve de la monarchie s'est perdu dans le sang à la fin du siècle dernier. Entraînés par les courants de la démocratie, à peine depuis avons-nous fait quelques haltes sur la boue des écueils. Mais le torrent nous submerge: et c'en est fait en France de la vraie liberté politique et de la dignité de l'homme.»[Retour au Texte Principal]
Note 217: Congrès de Vérone, Guerre d'Espagne, Négociations, Colonies espagnoles, par M. de Chateaubriand. Deux volumes in-8o, Paris, chez Delloye. 1838.[Retour au Texte Principal]
Note 218: Voir l'Appendice no V: Le Congrès de Vérone et la Guerre d'Espagne.[Retour au Texte Principal]
Note 219: Alphonse-Valentin Vaysse, vicomte de Rainneville (1798-1864). Il était en 1824 maître des requêtes, directeur des bureaux près le ministre des finances, et l'un des plus habiles collaborateurs de M. de Villèle, qui ne tarda pas à en faire un conseiller d'État. Député de la Loire, de 1846 à 1848, il fit une opposition modérée au ministère Guizot, et quitta la vie politique à la révolution de février.[Retour au Texte Principal]
Note 220: Voir l'Appendice no VI: Le renvoi de Chateaubriand.[Retour au Texte Principal]
Note 221: Ce petit couplet en l'honneur de l'opposition systématique n'est pas seulement très spirituel, il exprime encore une idée très juste et très vraie. Un des hommes qui ont le plus étudié et le mieux connu la théorie et la pratique du gouvernement représentatif, M. de Cormenia, dans son Livre des Orateurs, ne parle pas autrement que Chateaubriand: «Vous dites que vous êtes indépendants et que vous ne relevez que de votre conscience. C'est fier! c'est beau! Mais votre prétendue conscience n'est que de l'orgueil, votre prétendue indépendance n'est que de l'anarchie. Autant de têtes, autant d'opinions; autant de soldats, autant de capitaines. Je vois des combattants, mais point d'armée; je vois des opposants, mais point d'opposition. Sachez donc que toute opposition qui n'est pas systématique n'a pas de caractère, de principe, d'influence, de but, ni même de nom. Elle ne fait pas les affaires de la France, elle ne fait pas même les siennes. C'est un bariolage de couleurs rouges, bleues, jaunes, blanches, vertes, avec leurs teintes plus ou moins foncées. Le merveilleux tableau que cela fait!» (Tome I, p. 64.)[Retour au Texte Principal]
Note 222: Le mot que rapporte ici Chateaubriand fut dit, non par M, de Corbière, mais par le baron de Damas, ministre de la guerre. On lit dans les Mémoires du comte de Villèle: «Après la signature du renvoi de M. de Chateaubriand, je dus assigner à mes collègues une réunion du conseil après la messe et la réception du Roi. Grande fut notre surprise d'entendre le baron de Damas se féliciter hautement de ce qui venait d'avoir lieu, en déclarant que si le Roi n'avait pas pris ce parti, il était bien résolu à signifier, à la première occasion, à M. de Chateaubriand, qu'il fallait que l'un des deux quittât le conseil.»[Retour au Texte Principal]
Note 223: Louis-Justin-Marie, marquis de Talaru (1769-1850), pair de France et maréchal de camp. Il était ambassadeur à Madrid.[Retour au Texte Principal]
Note 224: François-Joseph-Maximilien Gérard, comte de Rayneval (1778-1836). Il était alors ambassadeur à Berlin. Quand éclata la révolution de juillet, il était ambassadeur à Vienne. Rappelé à Paris, il se tint d'abord à l'écart, mais ne tarda pas à se rallier au nouveau gouvernement. Casimir Périer le fit nommer ambassadeur à Madrid (février 1832). Sa santé s'étant gravement altérée en Espagne, il succomba, à Sainte-Ildefonse, le 16 août 1836, au cours d'un voyage qu'il fit pour rejoindre la reine Isabelle.[Retour au Texte Principal]
Note 225: Victor-Louis-Charles Riquet, marquis, puis duc de Caraman (1762-1839). Il était depuis 1816 ambassadeur à Vienne. Pair de France depuis 1815, maréchal de camp depuis 1830, il se rallia au gouvernement issu de la révolution de juillet. Malgré son grand âge, il accompagna le maréchal Clausel dans l'expédition de Constantine (octobre 1837), et vit périr, devant cette place, Victor de Caraman, son fils, qui commandait l'artillerie de siège.[Retour au Texte Principal]
Note 226: Ambassadeur de France à Lisbonne.[Retour au Texte Principal]
Note 227: Un an plus tard, le 3 juillet 1825, le baron Hyde de Neuville annonçait à son tour à son ami Chateaubriand que son ambassade venait de lui être enlevée:
«Mon noble ami,
«Vous m'avez annoncé votre sortie du ministère. Je vous fais savoir à mon tour que je ne suis plus ambassadeur.
«On me frappe parce que je vous ai suivi. Tant mieux, cela doit resserrer nos liens d'amitié; que Dieu soit loué, le Roi béni!
«The king can do wrong.
«Tout à vous,
«Hyde de Neuville.»
Il reçut la réponse suivante:
«Bravo! mon cher ami, qu'ils s'en prennent à des hommes comme vous, et ils n'iront pas loin. Je ne puis vous offrir par quartiers les cinq mille francs que vous aviez mis à ma disposition; mais j'ai encore quelques assiettes de porcelaine à votre service, et si vous en avez besoin, nous les vendrons.
«Pauvre France! À vous plus que jamais.
«Chateaubriand.»[Retour au Texte Principal]
Note 228: Ambassadeur à Naples.[Retour au Texte Principal]
Note 229: Ambassadeur à Saint-Pétersbourg.[Retour au Texte Principal]
Note 230: Chateaubriand eut sans doute à écrire bien d'autres lettres à l'occasion de son renvoi du ministère. Au comte de Montlosier, son ancien camarade d'émigration à Londres, qui lui avait fait parvenir, du fond de son Auvergne, une lettre de condoléances, il répondait, le 20 juin 1824, par ce joli billet:
«Je vous remercie, mon ancien ami. Si vous aviez été à Paris, j'aurais reçu avec reconnaissance les conseils de votre expérience et de vos lumières. Vos troupeaux sont moins difficiles à gouverner que ceux que je conduisais. Il vous reste au moins une montagne et des moutons. Moi, je n'ai qu'un grenier et deux chattes qui regretteront, je vous assure, plus que moi, le ministère. Il est dur de passer d'un perdreau à une souris. Aussi j'entre dans leurs peines. Au reste, vous voyez que l'on m'a mis à la porte, comme si j'avais volé la montre du roi sur la cheminée. Si vous entendez dire cela dans votre Auvergne, défendez-moi, je vous prie. Je vous assure que je suis sorti du ministère les mains nettes. Conservez-moi bien votre amitié et comptez à jamais sur la mienne.
«Chateaubriand.»[Retour au Texte Principal]
Note 231: Lord Keith (1685-1778), maréchal héréditaire d'Écosse, plus connu sous le nom de Milord Maréchal. S'étant déclaré pour les Stuarts, il avait dû quitter la Grande-Bretagne et s'était retiré en Prusse, où il avait gagné l'amitié de Frédéric II. Il était gouverneur de Neuchâtel, lorsque Rousseau, chassé de France, de Genève et du canton de Berne, vint se réfugier à Motiers-Travers au mois de juillet 1762. Milord Maréchal ne se borna pas à le couvrir de sa protection, allant jusqu'à l'appeler son fils; il lui assura une rente viagère de six cents livres, dont quatre cents réversibles sur la tête de Mlle Le Vasseur, la compagne de Rousseau. D'Alembert a écrit un Éloge de Milord Maréchal (1779).[Retour au Texte Principal]
Note 232: Marmite de terre sans pieds où l'on fait cuire les viandes sans bruit, sur un fourneau, parce qu'on prétend que les huguenots de France avaient cette précaution pour éviter le scandale aux jours défendus (Dictionnaire de Littré).[Retour au Texte Principal]
Note 233: Isabelle-Agnès Van Tuyll, Mme de Saint-Hyacinthe de Charrière, née en 1745 à Utrecht. En 1767, elle épousa l'instituteur de son frère, de Charrière, gentilhomme vaudois, et alla résider avec lui en Suisse, près de Neuchâtel. Elle écrivit là, pour elle et pour ses amis, plutôt que pour le public, des romans dont la réputation ne se fit qu'après sa mort. Son premier ouvrage, les Lettres Neuchâteloises (1784), est un chef-d'œuvre, au jugement de Sainte-Beuve: «Un pathétique discret et doucement profond, dit-il, s'y mêle à la vérité railleuse, au ton naïf des personnages, à la vie familière et de petite ville prise sur le fait. Quelque chose du détail hollandais... avec une rapidité bien française... Rien qui sente l'auteur; rien même qui sente le peintre.» Vinrent ensuite plusieurs autres romans, dont les meilleurs sont: Caliste ou Lettres écrites de Lausanne (1786), et les Trois femmes (1797). Sainte-Beuve a consacré à Mme de Charrière, dans ses Portraits de femmes, une de ses plus pénétrantes études.[Retour au Texte Principal]
Note 234: Personnages des Lettres Neuchâteloises.[Retour au Texte Principal]
Note 235: Louis Fauche-Borel (1762-1829) était imprimeur à Neuchâtel au moment de la Révolution française. Il se voua à la cause des Bourbons et fut jusqu'en 1814 un de leurs agents les plus actifs; il leur servit notamment d'intermédiaire auprès de Pichegru, de Barras et de Moreau. Emprisonné sous le Directoire, jeté au Temple sous le Consulat, il ne sortit de cette dernière prison, après 18 mois de captivité, que sur la demande du roi de Prusse, qui le réclama comme un de ses sujets. Après la Restauration, il ne fut payé que d'ingratitude et retourna à Neuchâtel, où il vécut dans la misère et où il mit fin à ses jours en se précipitant par une fenêtre, comme le dit Chateaubriand. Il a laissé des Mémoires (1830, 4 vol. in-8o), qui renferment de curieuses révélations.[Retour au Texte Principal]
Note 236: Louis, comte de Pourtalès (1773-1848), gouverneur de Neuchâtel. Il était aussi riche que son compatriote Fauche-Borel était pauvre. Son père avait fait dans le commerce une fortune qui dépassait cent millions.[Retour au Texte Principal]
Note 237: Le maréchal Berthier avait été créé, le 31 mars 1806, prince souverain de Neuchâtel. En même temps, Napoléon lui faisait épouser la nièce du roi de Bavière; en 1809, il le nommait vice-connétable et prince de Wagram. Berthier n'en fut pas moins des plus empressés à abandonner l'Empereur en 1814. À l'époque des Cent-Jours, il se retira à Bamberg, en Bavière, et, le 1er juin 1815, dans un accès de folie, il se précipita des fenêtres du château sur le pavé et se tua.[Retour au Texte Principal]
Note 238: Le 13 septembre, le Roi avait reçu les derniers sacrements de la main du grand aumônier, en présence de la famille royale. «Il reçut, dit Lamartine, avec une piété recueillie et avec une liberté d'attention complète les saintes cérémonies, répondant quelquefois lui même par des versets de psaumes latins aux versets psalmodiés par les pontifes. Il remercia le clergé et prit un congé éternel des officiers de sa maison... Le mourant, après ces cérémonies et ces adieux, resta entouré seulement de son frère, de son neveu, de la duchesse d'Angoulême et de quelques serviteurs, dans des assoupissements interrompus de courts réveils, sans agonie, sans délire, sans douleur. À l'aube du jour, le 16 septembre, jour qu'il avait fixé lui-même à ses médecins pour le terme de ses forces, le premier médecin (le baron Portal) entr'ouvrit ses rideaux et prit son bras pour s'assurer si le pouls battait encore: le bras était chaud, mais le pouls ne battait plus dans l'artère. Le roi dormait du dernier sommeil. M. Portal leva la couverture, et se retournant du côté des assistants: «Le roi est mort, messieurs», dit-il en s'inclinant devant le comte d'Artois, «Vive le Roi!»—Histoire de la Restauration, tome VII, p. 396.—Le maréchal Marmont, duc de Raguse, assistait aux derniers moments du roi; il en parle ainsi dans ses Mémoires: «La mort de Louis XVIII est un des spectacles les plus admirables dont j'aie jamais été témoin. Il s'est montré avec la physionomie d'un sage de l'antiquité au moment de cette grande épreuve. Il n'est pas de grand homme dont la vie ne serait honorée par une telle mort.» (Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse, t. VII, p. 311.)[Retour au Texte Principal]
Note 239: Dans cette brochure, Chateaubriand parlait en ces termes de la mort de Louis XVIII: «Depuis longtemps, il est donné au peuple le plus brave d'avoir à sa tête les princes qui meurent le mieux: par les exemples de l'Histoire, on serait autorisé à dire: mourir comme un Bourbon, pour exprimer tout ce qu'un homme peut mettre de magnanimité dans sa dernière heure. Louis XVIII n'a point démenti cette intrépidité de famille. Après avoir reçu le saint Viatique au milieu de sa cour, le fils aîné de l'église a béni d'une main défaillante, mais d'un front serein, ce frère encore appelé à un lit funèbre, ce neveu qu'il nommait le fils de son choix, cette nièce deux fois orpheline, et cette veuve deux fois mère.»[Retour au Texte Principal]
Note 240: Samedi 28 mai 1825. Le sacre eut lieu le dimanche 29 mai.[Retour au Texte Principal]
Note 241: Il y a bien du dépit dans ces pages sur le sacre. Charles X avait conservé M. de Villèle à la présidence du conseil; il n'avait pas rappelé Chateaubriand: dès lors tout était mal.[Retour au Texte Principal]
Note 242: Chateaubriand avait dit, en effet, dans la brochure à laquelle il avait donné pour titre le vieux cri de la monarchie: Le roi est mort! vive le Roi! «Supplions humblement Charles X d'imiter ses aïeux: trente-deux souverains de la troisième race ont reçu l'onction royale, c'est-à-dire tous les souverains de cette race, hormis Jean Ier, qui mourut quatre jours après sa naissance, Louis XVII et Louis XVIII qui furent investis de la royauté, l'un dans la tour du Temple, l'autre sur la terre étrangère. Tous ces monarques furent sacrés à Reims: Henri IV le fut à Chartres, où l'on trouve encore dans les registres de la ville une dépense de 9 francs pour une pièce mise au pourpoint du roi: c'était peut-être à l'endroit du coup d'épée que le Béarnais reçut à la journée d'Aumale.»—Chateaubriand, en reproduisant cet écrit dans ses Œuvres complètes, ajoute la note suivante: «Je laisse ce paragraphe tel qu'il est, mais je dois dire que Louis le Gros fut sacré à Orléans. Henri et Louis le Gros ne furent pas sacrés à Reims; le premier, parce que Reims était encore entre les mains de la Ligue, et le second parce que deux archevêques de Reims étaient en contestation pour le siège de cette métropole.»[Retour au Texte Principal]
Note 243: Archevêque de Reims. Ce fut lui qui sacra Hugues Capet.[Retour au Texte Principal]
Note 244: Ce livre a été écrit en 1839.[Retour au Texte Principal]
Note 245: Marthe-Camille Bachasson, comte de Montalivet (1801-1880). Il hérita du titre de pair à la suite de la mort de son père (22 janvier 1823) et de celle de son frère aîné (12 octobre 1823), mais il ne fut admis à siéger à la Chambre haute que le 12 mai 1826, en raison de son âge. Dès la première année de son admission, il se montra le défenseur des idées constitutionnelles, et fit paraître (1827) une brochure intitulée: Un jeune pair de France aux Français de son âge. Plusieurs fois ministre de 1830 à 1839, il se consacra tout entier, à dater de 1839, à ses fonctions d'intendant général de la liste civile, qu'il occupa jusqu'au 24 février 1848. Élu sénateur inamovible le 14 février 1879, il mourut le 4 janvier 1880.[Retour au Texte Principal]
Note 246: Narcisse-Achille, comte de Salvandy (1795-1856). Il publia de 1824 à 1827 un grand nombre de brochures politiques et fut, à la même époque, l'un des principaux rédacteurs du Journal des Débats. On l'appelait le clair de lune de Chateaubriand, dont il imitait le style, non sans succès; il arriva même parfois qu'on attribua au grand écrivain quelques-uns de ses articles. En 1835, il fut élu membre de l'Académie française. Deux fois ministre de l'instruction publique, d'avril 1837 à mars 1839, dans le cabinet Molé, et, de février 1845 à février 1848, dans le ministère Guizot, il signala son passage au pouvoir par de sages et libérales réformes et par son amour éclairé des lettres.[Retour au Texte Principal]
Note 247: Prosper-Léon Duvergier de Hauranne (1798-1881). Il prit, dans les dernières années de la Restauration, une part très active à la rédaction du journal le Globe. Député de 1831 à 1848, il joua, dans les chambres de la monarchie de Juillet, un rôle considérable, sans jamais être ministre, si ce n'est pendant quelques heures, le 23 février 1848. Représentant du peuple à l'Assemblée constituante de 1848 et à l'Assemblée législative de 1849, il s'y fit le champion des idées les plus conservatrices. Sous l'Empire, il se consacra tout entier à écrire une Histoire du gouvernement parlementaire en France, qui ne forme pas moins de dix volumes et qui lui valut d'être nommé, le 19 mai 1870, membre de l'Académie française.[Retour au Texte Principal]
Note 248: Henri-Joseph Gisquet (1792-1866). Il remplit les fonctions de préfet de police du 14 octobre 1831 au 6 septembre 1836, et c'est sous son administration que Chateaubriand, comme nous le verrons plus tard, fut emprisonné, au mois de juin 1832. Malheureusement pour M. Gisquet, son nom s'est trouvé mêlé à d'autres affaires bien autrement fâcheuses. Il avait été, sous la Restauration, l'un des chefs de la maison Périer. Après 1830, au milieu des menaces et des préparatifs de guerre européenne, il fut chargé par le gouvernement de l'achat de 300 000 fusils, et parvint à négocier l'acquisition de 566 000 armes de provenance anglaise. La presse de l'opposition dirigea à ce propos contre le commissionnaires et les ministres, particulièrement M. Casimir Périer et le maréchal Soult, de graves accusations. La Tribune et la Révolution furent saisies et comparurent en cour d'assises, le 29 octobre 1831. Il fut établi aux débats que M. Gisquet, associé de la maison Périer, avait traité l'affaire pour son propre compte, avait payé très cher des fusils défectueux, et qu'une partie de ces armes, refusée sous le ministère Gérard, avait été acceptée sous le ministère Soult. Jusqu'en 1848, les «fusils Gisquet» furent une arme entre les mains de l'opposition.—À la fin de 1838, de vagues rumeurs accusèrent l'ex-préfet de police, devenu conseiller d'État et député de Saint-Denis, de concussions auxquelles il aurait mêlé sa maîtresse et sa famille. Le Messager, qui s'en fit l'écho, fut poursuivi en diffamation par M. Gisquet et condamné au minimum de la peine (500 francs d'amende), après des paroles de l'avocat du roi, M. Plougoulm, qui faisaient pressentir les rigueurs du pouvoir contre le plaignant (28 décembre). En effet, M. Gisquet fut destitué le lendemain de ses fonctions de conseiller d'État. À la fin de la session il ne se représenta pas à la députation. Il ne devait plus reparaître sur la scène politique.[Retour au Texte Principal]
Note 249: Au jugement de Sainte-Beuve, ses articles de cette époque sont les meilleurs qu'il ait écrits, et on y doit voir le chef-d'œuvre de la polémique au XIXe siècle. «Autant M. de Chateaubriand, dit Cormenin (Livre des Orateurs, I, 127), est gracieux, coloré, sublime, inventif dans ses poèmes d'Atala, de René et des Martyrs, autant il est correct, grammatical et sévère dans la forme de sa polémique. Ici, point de phrases à effet, point de contours saillants, point de mouvements accidentés, point de véhémence. C'est une discussion sage et tempérée. Chose remarquable! don singulier de l'appropriation! Ce poète vous expliquera mieux que beaucoup de financiers le jeu des rentes et de l'amortissement. Cet homme d'imagination entrera plus avant qu'un jurisconsulte dans l'esprit et les détails d'une loi civile. Quelquefois, en grand écrivain, il relève la vulgarité de l'idée par la hardiesse du mot. Quelquefois, il vous ramène des hauteurs du débat, par la familiarité de l'expression. Ou bien, il entrecoupe le cours uni de la narration par une image éblouissante, par une allusion historique, par un tour inattendu, par un trait, par une date, par un mot tel que Chateaubriand sait les dire.»[Retour au Texte Principal]
Note 250: Les articles de Chateaubriand, du 21 juin 1824 au 18 décembre 1826, parurent dans le Journal des Débats.[Retour au Texte Principal]
Note 251: Article du 28 juin 1824.—Œuvres complètes, tome XXVI, p. 344.[Retour au Texte Principal]
Note 252: Article du 5 juillet 1824.—Tome XXVI, p. 353.[Retour au Texte Principal]
Note 253: Louis-Guillaume Ternaux (1763-1833), célèbre industriel, député de 1818 à 1821 et de 1827 à 1831. Une ordonnance royale du 17 novembre 1819 lui conféra le titre de baron. On lui doit l'introduction en France des chèvres du Thibet, la fabrication des beaux cachemires, dits Ternaux, qui rivalisent avec ceux de l'Inde, et l'établissement de silos pour la conservation des grains.—M. Mortimer-Ternaux, à qui l'on doit l'excellente Histoire de la Terreur, était son neveu.[Retour au Texte Principal]
Note 254: Sur le général Fabvier, voir, au tome III, la note 2 de la page 385.[Retour au Texte Principal]
Note 255: Note sur la Grèce, 1825, in-8o. Elle reparut en 1826 avec de nouveaux développements. C'est un des plus éloquents écrits de Chateaubriand. La première édition était précédée de cet Avertissement: «Ce n'est point un livre, pas même une brochure qu'on publie; c'est, sous une forme particulière, le prospectus d'une souscription, et voilà pourquoi il est signé: c'est un remerciement et une prière qu'un membre de la Société en faveur des Grecs adresse à la piété nationale; il remercie des dons accordés; il prie d'en apporter de nouveaux; il élève la voix au moment de la crise de la Grèce; et comme, pour sauver ce pays, les secours de la générosité des particuliers ne suffiraient peut-être pas, il cherche à procurer à une cause sacrée de plus puissants auxiliaires.»[Retour au Texte Principal]
Note 256: Opinion de M. le vicomte de Chateaubriand sur le projet de loi relatif à la répression des délits commis dans les Échelles du Levant.—Chambre des pairs, séance du 13 mars 1826.[Retour au Texte Principal]
Note 257: Chateaubriand avait cédé au libraire Ladvocat la propriété de ses œuvres complètes, moyennant une somme de sept cent mille francs. «Pendant le reste du jour, dit un de ses biographes, l'abbé Clergeau, qui fut aussi son aumônier, l'éditeur refit ses calculs, qui se continuèrent toute la nuit, restée pour lui sans sommeil. Il s'était trompé! Ce marché était pour lui un désastre. Dès le matin, il va trouver M. de Chateaubriand: «Monsieur le vicomte, je suis perdu.—Comment cela?—Dans le contrat que j'ai passé hier avec vous, je suis en perte de 200 000 francs.—Vous arrivez à temps, car j'allais déléguer mes droits pour l'hospice Marie-Thérèse qu'érige Mme de Chateaubriand.» Le grand écrivain donna, en effet, à l'hospice Marie-Thérèse, une grande partie des fonds qu'il toucha. La faillite du libraire Ladvocat lui fit perdre presque entièrement ceux qu'il s'était réservés pour «assurer la paix de sa vie».[Retour au Texte Principal]
Note 258: Jeanne-Isabelle-Pauline Polier de Bottens, baronne de Montolieu, née le 7 mai 1751, à Lausanne, morte le 29 décembre 1832. Son premier ouvrage, Caroline de Lichtfield (1786) est aussi le meilleur. C'est un roman bien composé, qui a de l'intérêt et du charme. Elle a publié plus de cent volumes, qui sont, pour la plupart, imités ou traduits assez librement de l'allemand ou de l'anglais. Celui qui eut le plus de vogue est Le Robinson suisse, traduit de Wyss (1813, 2 vol. in-12), et sa Continuation (1824, 3 volumes in-12).[Retour au Texte Principal]
Note 259: La marquise de Custine.[Retour au Texte Principal]
Note 260: Astolphe de Custine, fils de la marquise.[Retour au Texte Principal]
Note 261: Louis-Philippe-Enguerrand de Custine, fils unique de Léontine de Saint-Simon de Courtomer et d'Astolphe de Custine, mort à l'âge de trois ans, le 2 janvier 1826. Il est enterré dans la chapelle du château de Fervacques entre sa mère et sa grand'mère.[Retour au Texte Principal]
Note 262: M. Berstœcher était l'ancien précepteur d'Astolphe de Custine.[Retour au Texte Principal]
Note 263: Caliste ou Lettres écrites de Lausanne, roman de Mme de Charrière.[Retour au Texte Principal]
Note 264: Cette longue note (pages 120-123 de la nouvelle édition de l'Essai, publiée en 1826) est une excellente page de critique littéraire. Elle mériterait d'être reproduite en entier. En voici la fin: «Je ne me reproche point mon enthousiasme pour les ouvrages de Rousseau; je conserve en partie ma première admiration, et je sais à présent sur quoi elle est fondée. Mais si j'ai dû admirer l'écrivain, comment ai-je pu excuser l'homme? Comment n'étais-je pas révolté des Confessions sous le rapport des faits? Eh quoi! Rousseau a cru pouvoir disposer de la réputation de sa bienfaitrice! Rousseau n'a pas craint de rendre immortel le déshonneur de Mme de Warens! Que dans l'exaltation de sa vanité, le citoyen de Genève se soit considéré comme élevé au-dessus du vulgaire pour publier ses propres fautes (je modère mes expressions), libre à lui de préférer le bruit à l'estime. Mais révéler les faiblesses de la femme qui l'avait nourri dans sa misère, de la femme qui s'était donnée à lui! mais croire qu'il couvrira cette odieuse ingratitude par quelques pages d'un talent inimitable, croire qu'en se prosternant aux pieds de l'idole qu'il venait de mutiler, il lui rendra ses droits aux hommages des hommes! c'est joindre le délire de l'orgueil à une dureté, à une stérilité de cœur dont il y a peu d'exemples. J'aime mieux supposer, afin de l'excuser, que Rousseau n'était pas toujours maître de sa tête: mais alors ce maniaque ne me touche point; je ne saurais m'attendrir sur les maux imaginaires d'un homme qui se regarde comme persécuté, lorsque toute la terre est à ses pieds, d'un homme à qui l'on rend peut-être plus qu'il ne mérite. Pour que la perte de la raison puisse inspirer une vive pitié, il faut qu'elle ait été produite par un grand malheur, ou qu'elle soit le résultat d'une idée fixe, généreuse dans son principe. Qu'un auteur devienne insensé par les vertiges de l'amour-propre; que toujours en présence de lui-même, ne se perdant jamais de vue, sa vanité finisse par faire une plaie incurable à son cerveau, c'est de toutes les causes de folie celle que je comprends le moins, et à laquelle je puis le moins compatir.»[Retour au Texte Principal]
Note 265: L'empereur Alexandre mourut à Taganrog, le 1er décembre 1825.[Retour au Texte Principal]
Note 266: Voir, à l'Appendice, le no VIII: La mort de Mathieu de Montmorency.[Retour au Texte Principal]
Note 267: Article du 8 août 1825, sur la Conversion des rentes. Œuvres complètes, tome XXVI, p. 411.[Retour au Texte Principal]
Note 268: Article du 24 octobre 1825, sur le discours d'adieu du président des États-Unis au général La Fayette.—Tome XXVI, p. 490.[Retour au Texte Principal]
Note 269: 30 octobre 1825.[Retour au Texte Principal]
Note 270: Le général Foy mourut le 28 novembre 1825, et Manuel le 20 août 1827.[Retour au Texte Principal]
Note 271: M. de Serre mourut à Castellamare (Italie) le 21 juillet 1824. Camille Jordan était mort le 19 mai 1821.[Retour au Texte Principal]
Note 272: Le 29 décembre 1826, M. de Peyronnet avait, au nom du gouvernement, déposé sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi sur la presse, qui souleva, immédiatement une très vive opposition. Dès le 11 janvier 1827, Charles Lacretelle proposa à ses confrères de l'Académie française de délibérer sur les moyens de faire parvenir au roi l'expression de leurs inquiétudes et de leur douleur. Le 16 janvier, il soumit à l'Académie la proposition d'une supplique au roi. La discussion s'ouvrit alors sur l'opportunité et la légalité de cette démarche. Fortement soutenu par MM. Lemercier, de Tracy, Villemain, Michaud, Andrieux, de Ségur, Brifaut et Raynouard, le projet d'adresse fut combattu par MM. Auger, Cuvier et Roger. M. de Lally-Tolendal demanda s'il était raisonnable d'espérer qu'on serait écouté: «Pourquoi faire une demande qui devait demeurer sans succès?» Chateaubriand répondit que la conscience ne se déterminait point par les chances plus on moins probables d'un résultat utile. «On risque tous les jours, dit-il, sa fortune et sa vie sans espoir de succès, et l'on fait bien: on remplit un devoir dont le résultat est au moins l'estime publique.» On alla aux voix. Sur vingt-neuf académiciens présents, dix-huit se prononcèrent pour le projet de supplique. La rédaction en fut confiée à MM. Lacretelle, Chateaubriand, Villemain. Le directeur, M. de Laplace, chargé de présenter la supplique, demanda à être reçu par le roi, mais l'audience ne fut pas accordée. «L'Académie, dit le Moniteur du 27 janvier, a décidé que la supplique qu'elle avait votée, et dont elle avait ordonné la transcription sur les registres, ne serait point publiée.» Histoire de l'Académie française, par Paul Mesnard, p. 305.[Retour au Texte Principal]
Note 273: Un article, sorti du ministère de la justice et publié dans le Moniteur du 5 janvier 1827, contenait ce passage: «Le discours de M. le garde des sceaux, pour exposer les motifs de la loi sur la liberté de la presse, avait rassuré tous les vrais amis de cette liberté. Si quelque chose vient encore effrayer les esprits, ce sont ces articles violents et calomniateurs qui, prévenant le débat, remplacent le calme des discussions par l'impétuosité des injures et demandent, dans leur dérisoire impartialité, que l'on forge des armes pour l'attaque et des chaînes pour la défense. La loi présentée veut être une loi de justice et d'amour.» Cette expression, singulièrement maladroite et fâcheuse, revint ricocher contre la loi, et lui fut désormais appliquée, comme un sobriquet à la fois odieux et ridicule.[Retour au Texte Principal]
Note 274: Opinion sur le projet de loi relatif à la police de la presse.—1827, in-8o de 104 pages. Ce discours ne fut pas prononcé, le projet de loi ayant été retiré par le gouvernement.—Les articles, brochures et discours de Chateaubriand en faveur de la liberté de la presse, au cours des deux années 1827 et 1828, remplissent un volume entier, le tome XXVII des Œuvres complètes.[Retour au Texte Principal]
Note 275: La fête du roi se célébrait le 4 novembre, le jour de la Saint-Charles.[Retour au Texte Principal]
Note 276: Article du 3 novembre 1825.—Tome XXVI, p. 501.[Retour au Texte Principal]
Note 277: «Cette apostrophe pleine de tristesse et de sanglots, dit ici M. de Marcellus (Chateaubriand et son temps, p. 307), appelle dans nos yeux les larmes qui mouillaient les joues de l'auteur en l'écrivant; et plus d'une fois j'ai surpris pleurant tout seul M. de Chateaubriand qui ne pleurait devant personne.»[Retour au Texte Principal]
Note 278: Adoptée par la Chambre des députés, le 12 mars 1827, par 233 voix contre 134, la loi sur la presse avait été portée à la Chambre des pairs, qui nomma une commission nettement hostile. Le 17 avril le gouvernement retira le projet. Dans la soirée, on donna un charivari à M. de Villèle aux cris de Vive le Roi! Vivent les pairs! À bas les ministres! À bas les jésuites! Une démonstration analogue eut lieu sous les fenêtres de la duchesse de Berry. Le 18, Paris illumina, une foule immense envahit les rues et les places, mêlant à ses cris de joie des cris de haine contre les jésuites et contre les ministres. Le 19, ces manifestations prirent un caractère plus sérieux. Il y eut des promenades d'étudiants portant des drapeaux; les ouvriers imprimeurs parcoururent la ville en célébrant la victoire remportée sur le gouvernement; les chiffonniers, à qui l'on avait persuadé que la nouvelle loi tuerait leur industrie, firent aussi leur démonstration, ce qui leur valut de recevoir une belle Épître de M. Viennet.[Retour au Texte Principal]
Note 279: Joseph Michaud, directeur de la Quotidienne. Voir, au tome II, la note 1 de la page 367.[Retour au Texte Principal]
Note 280: Jean-Baptiste-Honoré-Raymond Capefigue (1802-1872), publiciste et historien. Il a publié, sur l'histoire de France, plus de cent volumes, qui, pour avoir été hâtivement composés, n'en ont pas moins une très réelle valeur. Ses meilleurs ouvrages sont: l'Europe pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon (10 vol. in-8o) et l'Histoire de la Restauration (10 vol. in-8o). Il était, en 1827, un des rédacteurs de la Quotidienne.[Retour au Texte Principal]
Note 281: François-Alexandre-Frédéric de La Rochefoucauld, duc de Liancourt (1747-1827), député à l'Assemblée constituante de 1789, représentant à la Chambre des Cent-Jours, pair de France. À la tête d'un très grand nombre d'œuvres charitables, fondateur de la première caisse d'épargne de France, l'un des principaux propagateurs de l'enseignement mutuel, il jouissait d'une extrême popularité. Il mourut le 27 mars 1827, et ses funérailles coïncidèrent avec l'agitation qui s'était produite à l'occasion de la loi sur la presse. Elles furent marquées par de pénibles incidents. Les élèves de l'École des arts et métiers de Châlons ayant voulu, malgré la défense du commissaire de police, porter eux-mêmes le cercueil et s'opposer à ce qu'il fût déposé sur le char, au sortir de l'église de l'Assomption, une lutte s'engagea entre eux et les soldats de l'escorte d'honneur envoyée aux obsèques du duc qui, comme officier général, avait droit à un bataillon. Au milieu de la bagarre, le cercueil tomba dans la boue, et les insignes de la pairie qui le décoraient furent foulés aux pieds.[Retour au Texte Principal]
Note 282: Le marquis de Semonville, grand référendaire de la Chambre des pairs. Il conserva ces fonctions jusqu'au 31 septembre 1834 et fut alors remplacé par le duc Decazes.[Retour au Texte Principal]
Note 283: Elle eut lieu le 29 avril 1827.[Retour au Texte Principal]
Note 284: Le récit de Chateaubriand est pleinement confirmé par les Souvenirs inédits de la Duchesse de Reggio. Voir le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, p. 466.—1894.[Retour au Texte Principal]
Note 285: L'ordonnance de licenciement, signée par le roi le soir même de la revue, figure en première ligne dans le Moniteur du 30 avril.[Retour au Texte Principal]
Note 286: Le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville était, depuis 1824 ministre de la maison du roi. M. de Chabrol, ministre de la marine, quoiqu'il eût été contraire au licenciement, continua à faire partie du ministère, ainsi que l'évêque d'Hermopolis (Mgr Frayssinous), ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, qui aurait voulu qu'on se contentât de dissoudre une ou deux légions.[Retour au Texte Principal]
Note 287: François-Régis, comte de La Bourdonnaye (1767-1839). Député de Maine-et-Loire de 1815 à 1830, il siégea constamment à l'extrême-droite. Au mois d'août 1829, il eut, dans le ministère Polignac, le portefeuille de l'intérieur, mais donna sa démission dès le 8 novembre de la même année, au moment où le prince de Polignac fut nommé président du conseil. Le 27 janvier 1830, il fut élevé à la pairie, six mois avant la révolution qui devait mettre fin à sa carrière politique. Cormenin a dit de lui, dans son Livre des orateurs (tome II, p. 7): «À la tête des ultra-royalistes, brillait M. de La Bourdonnaye... Contre-révolutionnaire trempé à la manière des anciens conventionnels, subjugué par la raison d'État; plus impérieux qu'habile, et qui ne manquait dans son langage, ni d'élévation ni de vigueur.»[Retour au Texte Principal]
Note 288: Le prince de Polignac avait été nommé ambassadeur à Londres au mois de février 1823. Quoiqu'en dise ici Chateaubriand, il y fit très bonne figure et se montra le digne interprète de la politique française. Plus d'une fois, Chateaubriand eut occasion, comme ministre des affaires étrangères, de féliciter le prince de la manière dont il défendait en Angleterre les intérêts de la France. Lui ayant exprimé un jour le désir de lui voir signer un traité, afin que le roi pût le mettre sur le même pied que M. de Talaru qui venait de signer le traité avec l'Espagne, il reçut de M. de Polignac ce billet, modèle de bon sens et de bon goût:
«Je vous remercie, mon cher vicomte, du désir que vous m'exprimez de me voir signer un traité pour me mettre sur le même pied que le marquis de Talaru. Mais je n'ai rien à signer de ce côté de l'eau, qu'un traité de commerce, et je vous engage à n'en pas faire; qu'un traité de paix, et j'espère vous éviter la guerre; et mon tardif arrangement relatif aux huîtres de Granville, et, dans ce cas, je ne réclame qu'une mention honorable au Rocher de Cancale (célèbre restaurant du temps). Au poste où je suis, il y a à acquérir plus de gloire que de profit, et plus d'honneur que d'honneurs.»
Cette lettre est datée du 20 février 1824.[Retour au Texte Principal]
Note 289: Chateaubriand se trompe ici lui-même et calomnie, sans le savoir, ces pauvres préfets. Mieux informé, M. de Villèle écrivait, à la date du 8 août 1827: «Les préfets sont effrayés de l'idée seule d'élections générales. Ils disent que, si on les faisait cette année, elles seraient détestables.» Le 4 septembre suivant, le président du conseil constatait encore, sur son carnet, que «les préfets étaient unanimes à repousser les élections générales comme un grand danger.» Alfred Nettement, Histoire de la Restauration, tome VII, p. 551, 554.[Retour au Texte Principal]
Note 290: Le 22 juin 1827, la session avait été déclarée close; le 24 juin, une ordonnance contre-signée par MM. de Villèle, Corbière et Peyronnet, rétablit la censure.[Retour au Texte Principal]
Note 291: Du rétablissement de la Censure par l'ordonnance du 24 juin 1827.—Paris, Ladvocat, 1827, in-8o.—Œuvres complètes, t. XXVII.[Retour au Texte Principal]
Note 292: La Chambre des députés fut dissoute le 5 novembre 1827. Les élections des collèges d'arrondissement eurent lieu le 17 novembre, et celles des collèges de département le 24.—À Paris, les huit candidats de la gauche furent nommés au premier tour de scrutin, c'étaient: MM. Benjamin Constant, Casimir Périer, Laffitte, Royer-Collard, Ternaux, baron Louis et de Schonen.[Retour au Texte Principal]
Note 293: Royer-Collard fut élu à Vitry, à Châlons, à Paris, à Lyon, à Neufchâteau (Vosges), à Melun et à Béziers. M. de Peyronnet, qui s'était présenté à Bourges et à Bordeaux, y éprouva un double échec.[Retour au Texte Principal]
Note 294: Le 19 novembre, la foule, particulièrement dans les quartiers Saint-Denis et Saint-Martin, parcourut les rues en criant: «Des lampions!» et: «Vive la Charte! Vivent les députés!» Puis d'autres cris s'y joignirent, parmi lesquels on entendit ceux de: «Vive Napoléon» et: «Vive l'Empire!» On cassait les vitres des maisons qui n'illuminaient pas, et des pétards étaient lancés contre les voitures. Quelques barricades s'élevèrent rue Saint-Denis. L'autorité envoya des gendarmes qui en renversèrent deux; il fallut faire marcher la garde royale et tirer des feux de peloton pour en enlever trois autres. L'émeute recommença le 20; les barricades de la veille furent relevées, et beaucoup d'autres obstruaient les rues du quartier Saint-Denis. Elles furent détruites par la troupe de ligne. Quelques hommes furent tués et un assez grand nombre blessés et il fallut, pour rétablir l'ordre, recourir à un grand déploiement de forces.[Retour au Texte Principal]
Note 295: Le 20 octobre 1827.[Retour au Texte Principal]
Note 296: Le Moniteur du 6 novembre 1827, en même temps qu'il insérait l'ordonnance prononçant la dissolution de la Chambre des députés, en publiait une autre nommant soixante-seize pairs.[Retour au Texte Principal]
Note 297: M. de Villèle donna sa démission le 2 décembre 1827; elle fut acceptée par le roi le 6. Le nouveau cabinet ne put être constitué que le 4 janvier 1828. Les ordonnances nommant les nouveaux ministres parurent au Moniteur du 5 janvier.[Retour au Texte Principal]
Note 298: Joseph-Marie, comte Portalis (1778-1858). Conseiller d'État en 1808, comte de l'Empire et directeur général de la librairie en 1810, premier président de la Cour d'Angers en 1813, conseiller à la Cour de Cassation en 1815, pair de France en 1819, sous-secrétaire d'État au ministère de la Justice du 21 février 1820 au 14 décembre 1821, garde des sceaux le 4 janvier 1828, ministre des Affaires étrangères le 14 mai 1829, premier président de la Cour de cassation le 8 août suivant. Il garda cette charge jusqu'au 18 décembre 1852; il était sénateur depuis le 26 janvier. Il mourut à Passy le 4 août 1858.[Retour au Texte Principal]
Note 299: Le vicomte de Caux, lieutenant-général, député du Nord. Il avait servi avec distinction dans l'arme du génie, et s'était également fait remarquer par ses qualités d'administrateur. Le 11 octobre 1832, le roi Louis-Philippe l'éleva à la dignité de pair de France. Le vicomte de Caux était le fils de M. de Caux de Blaquetot (1723-1793), lieutenant-général et directeur des fortifications sous Louis XVI, l'un des meilleurs officiers de notre corps du génie, qui était alors le premier de l'Europe.[Retour au Texte Principal]
Note 300: Antoine, comte Roy (1764-1847). Le portefeuille des finances lui fut confié trois fois: du 7 au 29 décembre 1818, du 19 novembre 1819 au 14 décembre 1821, du 4 janvier 1828 au 8 août 1829. Il avait été reçu avocat au Parlement de Paris en 1786. Pendant la Révolution, il prêta le secours de sa parole à plusieurs personnes accusées de royalisme. En 1798, il obtint du duc de Bouillon la jouissance de la terre de Navarre et l'administration de ses biens. La situation du duc étant fort gênée, il ne tarda pas à céder la plus grande partie de ses biens à M. Roy, moyennant une rente annuelle de 300,000 francs; sa mort étant survenue peu de mois après, M. Roy se trouva l'un des plus riches propriétaires fonciers de France.[Retour au Texte Principal]
Note 301: Charles-François Riffardeau, duc de Rivière (1763-1828). Ami personnel du comte d'Artois, et son aide de camp pendant l'émigration, il fut compromis, en 1804, dans le procès de Georges Cadoudal, et condamné à mort. L'intervention de Joséphine fit commuer cette peine en celle d'un emprisonnement au fort de Joux; il y resta quatre ans et fut ensuite déporté. Louis XVIII le nomma pair de France et ambassadeur à Constantinople. Charles X le créa duc héréditaire (30 mai 1825) et le promut gouverneur du duc de Bordeaux en 1826. M. de Rivière mourut le 21 avril 1828. Il avait fait don au roi, en 1822, de la Vénus de Milo, qu'il avait découverte pendant son ambassade auprès du Sultan.[Retour au Texte Principal]
Note 302: François-Jean-Hyacinthe, comte Feutrier (1785-1830), évêque de Beauvais depuis 1826. Il fut nommé ministre des Affaires ecclésiastiques le 4 mars 1828.[Retour au Texte Principal]
Note 303: Antoine-François-Henri Lefebvre de Vatimesnil (1789-1860). Attaché au parquet de la Seine dès 1815, il s'était fait remarquer par la maturité précoce de ses rares qualités, par une science profonde du droit, une argumentation méthodique, claire, pressante, une parole facile, pénétrante, fortement accentuée. «Vous avez fait oublier votre jeunesse par vos talents,» lui disait M. de Sèze, lorsqu'il fut installé comme avocat général à la Cour de cassation, le 18 août 1824. Orateur, jurisconsulte, membre de nos assemblées délibérantes, son nom demeurera inséparable des luttes judiciaires de la Restauration, des mémorables combats pour la revendication de la liberté religieuse et de la liberté d'enseignement (1844-1850), et de la loi sur l'assistance judiciaire dont il fut, à l'Assemblée législative, le véritable auteur (7 décembre 1850—22 janvier 1851).[Retour au Texte Principal]
Note 304: Voir l'Appendice no IX: Chateaubriand et le ministère Martignac.[Retour au Texte Principal]
Note 305: Jean-Louis-Anne-Madeleine Lefébure, comte de Chéverus (1768-1836). Reçu prêtre le 18 décembre 1790, il émigra en Angleterre et de là en Amérique, prêcha l'Évangile chez les Indiens, et montra un tel dévouement pendant une épidémie de fièvre jaune qui ravageait Boston, qu'il fut nommé évêque de cette ville. Rappelé en France par Louis XVIII, qui le força d'accepter l'évêché de Montauban (1823), il dut se résigner, en 1826, à devenir archevêque de Bordeaux. Le 5 novembre de la même année, il fut nommé pair de France, puis conseiller d'État. La révolution de 1830 ayant supprimé les pairs créés par Charles X, M. de Chéverus en profita pour se retirer de la vie politique, et refusa la pairie du gouvernement de Juillet, qui, du moins, demanda et obtint pour lui le chapeau de cardinal (9 mars 1836). Sa Vie a été écrite par M. Hamon.[Retour au Texte Principal]
Note 306: Il était évêque de Strasbourg.[Retour au Texte Principal]
Note 307: Le duc de Laval-Montmorency. Voy. sur lui, au tome II, la note 1 de la page 278.—Le duc de Laval eût voulu garder son ambassade; Chateaubriand en fut informé, et bien que lui-même désirât vivement être envoyé à Rome, il adressa au comte de La Ferronnays, ministre des Affaires étrangères, la lettre suivante:
«Lundi 26 mai 1828.
«Noble comte, en relisant votre lettre, j'ai vu que le duc de Laval éprouvait de vifs regrets de quitter Rome. J'ai su d'autre part qu'il avait manifesté les mêmes regrets à ses parents et à ses amis.
«Pour rien au monde, je ne voudrais troubler la destinée d'un homme, et à plus forte raison d'un homme qui, comme le duc de Laval, n'a jamais eu que de bons procédés envers moi. Le roi n'a pas de meilleur, de plus fidèle et de plus noble serviteur que son ambassadeur actuel auprès du Saint-Siège.
«Dans cette position, qu'il me soit permis de m'adresser plus à l'ami qu'au ministre. Je ne pourrais accepter la haute mission dont il plairait à S. M. de m'honorer, que dans le cas où le duc de Laval croirait devoir lever lui-même mes scrupules. Jamais je n'occuperai sa place que de son aveu. C'est lui qui doit trancher la question.
«Pardonnez, noble comte, ces importunités et ces petits intérêts personnels, bien ennuyeux dans l'ensemble des grandes affaires générales. Vous savez que je ne demande rien que d'être passif dans ces arrangements. Je n'ai d'autre désir que d'entretenir entre nous tous la bonne harmonie, et d'apporter au gouvernement du roi le peu de force que l'opinion publique veut bien attacher à mon nom. Mais ce n'est pas vous, mon noble ami, qui trouverez mauvais que je sois arrêté par un sentiment de délicatesse. J'aime beaucoup les libertés nouvelles de la France, mais je ne veux point les séparer du vieil honneur français.
«Voyez, je vous prie, le duc de Laval avant le conseil, afin que vous n'ayez à porter au roi que l'accord, la soumission et la respectueuse reconnaissance de toutes les parties intéressées.
«Mille compliments et dévouements, etc.»
Les susceptibilités enfin aplanies entre les deux concurrents par des procédés honorables, le duc de Laval partit pour Vienne et Chateaubriand pour Rome.[Retour au Texte Principal]
Note 308: Chateaubriand partit pour Rome, comme nous le verrons au livre XII, le 14 septembre 1828. Un peu avant son départ, il lut, à la Chambre des pairs, dans la séance du 18 juin, l'éloge du comte de Sèze, mort le 2 mai précédent. Dans ses Mémoires, il ne dit rien de cet Éloge, qui n'a pas été reproduit dans ses Mélanges historiques, publiés en 1830. Il conviendra de réimprimer dans la prochaine édition de ses œuvres ces pages consacrées au défenseur de Louis XVI: elles sont parmi les plus belles que Chateaubriand ait écrites.[Retour au Texte Principal]
Note 309: Béranger, À M. de Chateaubriand (septembre 1831).
Son éloquence à ces rois fit l'aumône:
Prodigue fée, en ses enchantements,
Plus elle voit de rouille à leur vieux trône,
Plus elle y sème et fleurs et diamants.[Retour au Texte Principal]
Note 310: Énéide, VI, v. 256-257.[Retour au Texte Principal]
Note 311: Le 20 septembre 1830.[Retour au Texte Principal]
Note 312: Ce livre a été écrit à Paris en 1839.[Retour au Texte Principal]
Note 313: Jeanne-Françoise-Julie-Adélaïde Bernard était née à Lyon le 4 décembre 1777. De tous ces noms de baptême, le seul qui lui fût resté dans l'habitude était celui de Julie transformé en Juliette.—Son père, Jean Bernard, était notaire à Lyon; il fut nommé, en 1784, receveur des finances à Paris.[Retour au Texte Principal]
Note 314: Et non treize ans, comme le portent les éditions précédentes.[Retour au Texte Principal]
Note 315: Juliette Bernard n'avait que quinze ans, lorsqu'elle épousa, en pleine Terreur, le 24 avril 1793, M. Jacques Récamier, banquier à Paris, mais qui était, comme elle, originaire de Lyon. Il demeurait au no 13 de la rue des Saints-Pères. (Voir, au tome II du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur, par Edmond Biré, le chapitre sur le Mariage de Mme Récamier.)—M. Récamier avait 31 ans de plus que sa jeune femme. «Ce lien, dit Mme Lenormant, ne fut jamais qu'apparent; Mme Récamier ne reçut de son mari que son nom. Ceci peut étonner, mais je ne suis pas chargée d'expliquer le fait; je me borne à l'attester, comme auraient pu l'attester tous ceux qui, ayant connu M. et Mme Récamier, pénétrèrent dans leur intimité. M. Récamier n'eut jamais que des rapports paternels avec sa femme; il ne traita jamais la jeune et innocente enfant qui portait son nom que comme une fille dont la beauté charmait ses yeux et dont la célébrité flattait sa vanité.» Souvenirs et Correspondance tirés des papiers de Mme Récamier, tome I.[Retour au Texte Principal]
Note 316: Madame de Clermont-Tonnerre.[Retour au Texte Principal]
Note 317: Cette lettre est ainsi datée: De ma retraite de Corbeil, le samedi 28 septembre 1797.—La Harpe, proscrit après le coup d'État du 18 fructidor (4 septembre 1797), avait trouvé un asile à Corbeil, où Mme Récamier l'alla voir une fois.[Retour au Texte Principal]
Note 318: Cette lettre, qui ne porte d'autre indication de date que le mot samedi a dû être écrite quelques jours après le 18 brumaire.[Retour au Texte Principal]
Note 319: Lucien Bonaparte venait de publier un roman intitulé la Tribu indienne, ou Édouard et Stellina. (Paris, 1799, 2 vol. in-18.)[Retour au Texte Principal]
Note 320: Comme le duc de Laval, un autre admirateur de Mme Récamier, Benjamin Constant n'aimait pas les dates. Son écrit sur Mme Récamier n'en renferme pas une seule. Besoin nous est donc de préciser. À la fin de 1798, Mme de Staël fut chargée par son père, qui venait d'être rayé de la liste des émigrés, de vendre l'hôtel qu'il possédait rue du Mont-Blanc, aujourd'hui rue de la Chaussée-d'Antin, 7. M. Récamier était depuis longtemps en relations d'affaires avec M. Necker, il était son banquier, ainsi que celui de sa fille; il acheta l'hôtel. L'acte de vente porte la date du 25 vendémiaire an VII (16 octobre 1798). La négociation de cette affaire devint l'origine de la liaison qui s'établit entre Mme de Staël et Mme Récamier. (Souvenirs et Correspondance..., par Mme Lenormant, I, 23.)[Retour au Texte Principal]
Note 321: Plus tard duc de Laval-Montmorency, celui précisément que Chateaubriand remplacera comme ambassadeur à Rome.[Retour au Texte Principal]
Note 322: «Arbitre du goût et des bonnes manières», a dit Mme de Staël. Sous une apparence légère et mobile, le duc de Laval était un noble cœur et un esprit élevé. Il géra les plus grandes ambassades et fut partout à la hauteur de sa tâche.[Retour au Texte Principal]
Note 323: Le roman de Delphine, qui parut à la fin de 1802.[Retour au Texte Principal]
Note 324: Georgina Spenser, duchesse de Devonshire (1746-1806), célèbre par son esprit et sa beauté. Elle se mêla aux luttes politiques de son temps, soutint Fox et écrivit plusieurs poésies, dont la principale, le Passage du mont Saint-Gothard, a été traduite par Delille.[Retour au Texte Principal]
Note 325: Élisabeth Craven, margravine d'Anspach (1750-1828). Fille du comte de Berkeley, elle épousa d'abord lord Craven, dont elle eut sept enfants. Abandonnée par son mari, elle demanda le divorce, et quitta l'Angleterre pour voyager. Devenue veuve en 1790, elle épousa en secondes noces le margrave d'Anspach et vint demeurer avec lui en Angleterre, dans la terre de Brandebourg-House. Après la mort de ce prince (1806), elle recommença ses voyages et mourut à Naples à l'âge de 78 ans. Elle a composé des pièces de théâtre, un Voyage à Constantinople en passant par la Crimée, traduit trois fois en français, et des Mémoires fort curieux, qui parurent à Londres en 1825 et furent traduits, l'année suivante, par J.-T. Parisot (2 vol. in-8o).[Retour au Texte Principal]
Note 326: M. de Marcellus, à qui la France doit de posséder la Vénus de Milo, rencontrant ici le nom du duc d'Hamilton, en a profité, comme c'était son droit, pour nous conter cette jolie anecdote: «Ce premier des ducs écossais, mêlé au récit du voyage de Mme Récamier en Angleterre, s'était épris aussi des charmes de la Vénus de Milo, dès son entrée à Paris. Sachant que je l'avais enlevée, il m'en fit offrir, toute mutilée qu'elle était, dix mille livres sterling. Elle n'était pas à moi; elle n'appartenait même plus à M. le marquis de Rivière, qui venait d'en faire don à Louis XVIII: quelques années après, la duchesse de Hamilton, que je recevais avec son fils et sa fille dans la jolie villa de Saltocchio, au pied des Apennins, me rappela, à la vue de quelques statues informes, cette passion qu'elle avait partagée pour la Vénus victorieuse. Mais quand j'avais dérobé mon idole à l'obscurité de Milo et aux empressements d'une frégate anglaise, arrivée quelques heures trop tard, ce n'était pas pour qu'un autre pays que le mien vînt à s'illuminer jamais de sa beauté.» (Chateaubriand et son temps, p. 316.)[Retour au Texte Principal]
Note 327: Sur le prince d'Orange, voir, au tome III, la note 1 de la page 206.[Retour au Texte Principal]
Note 328: Cette maison de campagne appartenait à Mme de la Tour, «personne vraiment bonne et spirituelle», à qui Mme de Staël avait été recommandée par M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, alors président de la section de l'intérieur au Conseil d'État.[Retour au Texte Principal]
Note 329: Septembre 1803.[Retour au Texte Principal]
Note 330: Mme de Staël, Dix années d'exil, 1re partie, chap. XI.[Retour au Texte Principal]
Note 331: Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826). Député du Tiers aux États généraux pour le bailliage de Bugey et Valromey, il siégea parmi les modérés, émigra en 1793 et se retira en Suisse, puis à New-York, où il se créa des ressources en donnant des leçons de français et en tenant le premier violon dans un petit théâtre. Sous le Consulat, il fut nommé juge au Tribunal de Cassation (1er avril 1800). Il mourut conseiller à la Cour de Cassation le 2 février 1826, des suites d'un rhume contracté dans l'église de Saint-Denis, à la cérémonie expiatoire du 21 janvier. L'année précédente, il avait publié l'ouvrage qui a fait sa gloire, la Physiologie du goût.—Balzac, sans doute comme auteur de la Physiologie du mariage, lui a consacré une intéressante notice dans la Biographie universelle, de Michaud. «Brillat-Savarin, dit-il, offrait une des rares exceptions à la règle qui destitue de toute haute faculté intellectuelle les gens de haute taille; quoique sa stature presque colossale lui donnât en quelque sorte l'air du tambour-major de la Cour de cassation, il était grand homme d'esprit, et son ouvrage se recommande par des qualités littéraires peu communes.»[Retour au Texte Principal]
Note 332: L'exécution de Georges Cadoudal et de ses onze compagnons eut lieu le lundi 25 juillet 1804, à onze heures du matin, en place de Grève. La veille, le geôlier de Bicêtre était entré dans son cachot, apportant à Georges une demande en grâce toute prête. Il jette un regard sur le papier qu'on lui présente et qui était adressé à Sa Majesté l'Empereur. Il n'en veut pas voir davantage. Se tournant vers ses compagnons: «Mes camarades, dit-il, faisons la prière.» Le matin de l'exécution, à quelqu'un qui lui demandait des nouvelles du condamné, le capitaine Laborde répondit: «Il a dormi plus tranquillement que moi.» Georges était assisté de l'abbé de Keravenant, qui fut sous la Restauration curé de Saint-Germain des Prés. Arrivé sur la place de Grève, l'abbé lui faisait réciter la Salutation angélique: «Je vous salue, Marie, pleine de grâces... Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs, maintenant...» Et Georges s'arrêtait: «Continuez, dit le prêtre, et à l'heure de notre mort.—À quoi bon? dit Georges; l'heure de la mort, n'est-ce pas maintenant?» Au pied de l'échafaud, raconte le duc de Rivière dans ses Mémoires, page 52, il déclara qu'il avait une faveur à solliciter. «Pour ôter à mes compagnons d'infortune, dit-il, l'idée que je pourrais leur survivre, je demande à mourir avant eux. C'est moi, d'ailleurs, qui dois leur donner l'exemple.» On y consentit, et Georges eut sur l'échafaud la place qu'il occupait devant l'ennemi, il fut le premier à la mort comme il l'avait été tant de fois au combat.[Retour au Texte Principal]
Note 333: Dans les pages qui précèdent, Chateaubriand n'a fait que résumer le récit même de Mme Récamier, reproduit plus tard en son entier par Mme Lenormant au tome Ier des Souvenirs, pages 103 et suivantes.[Retour au Texte Principal]
Note 334: M. Necker mourut à Coppet le 9 avril 1804.[Retour au Texte Principal]
Note 335: La ruine de M. Récamier fut postérieure de deux ans à la mort de M. Necker. Elle se produisit dans l'automne de 1806. Par suite d'une série de circonstances, et plus particulièrement de l'état politique et financier de l'Espagne, la maison de banque de M. Récamier se trouva en présence de graves embarras. Pour les conjurer, il aurait suffi que la Banque de France fût autorisée à lui avancer un million, avance en garantie de laquelle il offrait de donner de très bonnes valeurs. Le prêt d'un million fut durement refusé, et la catastrophe eut lieu. M. Récamier abandonna à ses créanciers tout ce qu'il possédait, et en reçut ce témoignage de confiance et d'estime, d'être mis par eux à la tête de la liquidation de ses affaires. Sa femme vendit jusqu'à son dernier bijou. On se défit de l'argenterie, l'hôtel de la rue du Mont-Blanc fut mis en vente. Il fut acheté par M. Mosselmann.[Retour au Texte Principal]
Note 336: 17 novembre 1806.[Retour au Texte Principal]
Note 337: Mme Récamier avait perdu sa mère le 20 janvier 1807. Elle passa les six premiers mois de son deuil dans une profonde retraite; au milieu de l'été de 1807, elle consentit, sur les instances de Mme de Staël, à se rendre à Coppet.[Retour au Texte Principal]
Note 338: Ce n'est pas à la bataille d'Eylau (8 février 1807) que le prince Auguste fut fait prisonnier, mais bien, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, au combat de Saalfeldt, le 10 octobre 1806.—Le prince n'avait que vingt-quatre ans; il était de cinq ans plus jeune que Mme Récamier.[Retour au Texte Principal]
Note 339: On lit à ce sujet dans le livre de Mme Lenormant: «Le prince Auguste était remarquablement beau, brave, chevaleresque; à l'ardeur passionnée de ses sentiments, se joignaient une loyauté et une sorte de candeur toutes germaniques... La passion qu'il conçut pour l'amie de Mme de Staël était extrême; protestant et né dans un pays où le divorce est autorisé par la loi civile et par la loi religieuse, il se flatta que la belle Juliette consentirait à faire rompre le mariage qui faisait obstacle à ses vœux, et il lui proposa de l'épouser... Mme Récamier était émue, ébranlée: elle accueillit un moment la proposition d'un mariage, preuve insigne, non seulement de la passion, mais de l'estime d'un prince de maison royale fortement pénétré des prérogatives et de l'élévation de son rang. Une promesse fut échangée. La sorte de lien qui avait uni la belle Juliette à M. Récamier était de ceux que la religion catholique elle-même proclame nuls. Cédant à l'émotion du sentiment qu'elle inspirait au prince Auguste, Juliette écrivit à M. Récamier pour lui demander la rupture de leur union. Il lui répondit qu'il consentirait à l'annulation de leur mariage, si telle était sa volonté; mais, faisant appel à tous les sentiments du noble cœur auquel il s'adressait, il rappelait l'affection qu'il lui avait portée dès son enfance, il exprimait même le regret d'avoir respecté des susceptibilités et des répugnances sans lesquelles un lien plus étroit n'eût pas permis cette pensée de séparation; enfin il demandait que cette rupture de leur lien, si Mme Récamier persistait dans un tel projet, n'eût pas lieu à Paris, mais hors de France, où il se rendrait pour se concerter avec elle.
«Cette lettre digne, paternelle et tendre, laissa quelques instants Mme Récamier immobile: elle revit en pensée ce compagnon des premières années de sa vie, dont l'indulgence, si elle ne lui avait pas donné le bonheur, avait toujours respecté ses sentiments et sa liberté; elle le revit vieux, dépouillé de la grande fortune dont il avait pris plaisir à la faire jouir, et l'idée de l'abandon d'un homme malheureux lui parut impossible. Elle revint à Paris à la fin de l'automne ayant pris sa résolution, mais n'exprimant pas encore ouvertement au prince Auguste l'inutilité de ses instances. Elle compta sur le temps et l'absence pour lui rendre moins cruelle la perte de ses espérances...» Souvenirs et Correspondance..., tome I, p. 140-142. Voir aussi pages 143 à 152.[Retour au Texte Principal]
Note 340: C'est seulement en 1818, après la mort de Mme de Staël, que le prince Auguste commanda à Gérard le célèbre tableau représentant Corinne au cap Misène. En échange de ce tableau, Mme Récamier lui envoya son portrait, peint également par Gérard. Le prince l'avait placé dans la galerie de son palais, à Berlin; il ne s'en sépara qu'à sa mort. D'après ses dernières volontés, ce portrait fut renvoyé à Mme Récamier en 1845, et, dans la lettre que le prince lui écrivait trois mois avant sa mort, en pleine santé, mais comme frappé d'un pressentiment, se trouvent ces paroles: «L'anneau que vous m'avez donné me suivra dans la tombe.»—Souvenirs et Correspondance, I, 151.[Retour au Texte Principal]
Note 341: M. F. Barrière, l'éditeur de la Collection des Mémoires sur le 18e et le 19e siècle, eut occasion vers ce même temps de visiter Mme de Genlis; il décrit en ces termes l'appartement de «l'antique sibylle»:—«Nous la trouvâmes dans un appartement de bien médiocre apparence et surtout bien mal tenu. Mme de Genlis était assise devant une table de bois de sapin, noircie par le temps et l'usage. Cette table offrait le bizarre assemblage d'une foule d'objets en désordre; on y voyait pêle-mêle des brosses à dents, un tour en cheveux, deux pots de confitures entamés, des coquilles d'œufs, des peignes, un petit pain, de la pommade, un demi-rouleau de sirop de capillaire, un reste de café au lait dans une tasse ébréchée, des fers propres à gaufrer des fleurs en papier, un bout de chandelle, une guirlande commencée à l'aquarelle, un peu de fromage de Brie, un encrier en plomb, deux volumes bien gras et deux carrés de papier sur lesquels étaient griffonnés des vers.» Avant-Propos des Mémoires de Mme de Genlis.[Retour au Texte Principal]
Note 342: Mademoiselle de Clermont est le meilleur ouvrage de Mme de Genlis; il avait paru en 1802.[Retour au Texte Principal]
Note 343: La nouvelle de Mme de Genlis, dont parle ici Chateaubriand, a paru seulement en 1832 sous le titre d'Athénaïs ou le Château de Coppet en 1807.[Retour au Texte Principal]
Note 344: Dans l'automne de 1807. On lit, au sujet de ce voyage, dans les notes de M. Auguste de Staël: «Depuis son voyage à Berlin, si cruellement interrompu par la mort de son père, ma mère n'avait pas cessé d'étudier la littérature et la philosophie allemandes; mais un nouveau séjour lui était nécessaire pour achever le tableau de ce pays qu'elle se proposait de présenter à la France. Dans l'automne de 1807, elle partit pour Vienne, et elle y retrouva, dans la société du prince de Ligne, dans celle de la maréchale Lubomirska, etc., cette urbanité de manières, cette facilité de conversation qui avaient tant de charme à ses yeux. Le gouvernement autrichien, épuisé par la guerre, n'avait pas alors la force d'être oppresseur pour son propre compte, et cependant il conservait envers la France une attitude qui n'était pas sans indépendance et sans dignité. Ceux que poursuivait la haine de Napoléon pouvaient encore trouver à Vienne un asile; aussi l'année que ma mère y passa fut-elle la plus calme dont elle eût joui depuis son exil.» Avertissement de M. de Staël fils, en tête de la seconde partie de Dix années d'exil.[Retour au Texte Principal]
Note 345: Les précédentes éditions portent à tort 1812. C'est en 1810, et non en 1812, que Mme de Staël habita le château de Chaumont. On lit dans l'Avertissement de M. Auguste de Staël: «Au commencement de l'été de 1810, ayant achevé les trois volumes de l'Allemagne, elle voulut aller en surveiller l'impression à quarante lieues de Paris, distance qui lui était encore permise et où elle pouvait espérer de revoir ceux de ses amis dont l'affection n'avait pas fléchi devant la disgrâce de l'empereur. Elle alla donc s'établir, près de Blois, dans le vieux château de Chaumont-sur-Loire, que le cardinal d'Amboise, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis et Nostradamus ont jadis habité. Le propriétaire actuel de ce séjour romantique, M. Le Ray, avec qui mes parents étaient liés par des relations d'affaires et d'amitié, était alors en Amérique. Mais, tandis que nous occupions son château, il revint des États-Unis avec sa famille; et, quoiqu'il voulût bien nous engager à rester chez lui, plus il nous en pressait avec politesse, plus nous étions tourmentés de la crainte de le gêner. M. de Salaberry nous tira de cet embarras avec la plus aimable obligeance, en mettant à notre disposition sa terre de Fossé.»—Le château de Chaumont est situé dans la commune de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher). Il appartient actuellement à M. le prince Amédée de Broglie.—Le château de Fossé, situé dans la commune de Fossé (Loir-et-Cher), appartient aujourd'hui à M. le comte de Salaberry.[Retour au Texte Principal]
Note 346: Chateaubriand ne donne pas la date de cette lettre. Elle doit être du mois de septembre 1810. Mme de Staël dit en effet, dans ses Dix années d'exil (seconde partie, chapitre premier): «Le 23 septembre (1810), je corrigeai la dernière épreuve de l'Allemagne: après six ans de travail, ce m'était une vraie joie de mettre le mot fin à mes trois volumes. Je fis la liste des cent personnes à qui je voulais les envoyer dans les différentes parties de la France et de l'Europe; j'attachais un grand prix à ce livre, que je croyais propre à faire connaître des idées nouvelles à la France: il me semble qu'un sentiment élevé sans être hostile l'avait inspiré, et qu'on y trouvait un langage qu'on ne parlait plus.»[Retour au Texte Principal]
Note 347: Au mois d'octobre 1810.—Les trois volumes de l'Allemagne étaient à peine achevés d'imprimer que le duc de Rovigo, ministre de la police, envoyait ses agents pour mettre en pièces les dix mille exemplaires qu'on avait tirés, et il signifiait à l'auteur l'ordre de quitter la France sous trois jours. Ayant vu dans les journaux que des vaisseaux américains étaient arrivés dans les ports de la Manche, Mme de Staël se décida à faire usage d'un passeport qu'elle avait pour l'Amérique, espérant qu'il lui serait possible de relâcher en Angleterre. Il lui fallait quelques jours, dans tous les cas, pour se préparer à ce voyage, et elle fut obligée de s'adresser au ministre de la police pour demander ce peu de jours. À la date du 3 octobre 1810, Rovigo lui accorda huit jours. Il lui disait dans sa lettre: «Il m'a paru que l'air de ce pays-ci ne vous convenait point, et nous n'en sommes pas encore réduits à chercher des modèles dans les peuples que vous admirez. Votre dernier ouvrage n'est point français; c'est moi qui en ai arrêté l'impression... Je mande à M. Corbigny (le préfet de Loir-et-Cher) de tenir la main à l'exécution de l'ordre que je lui ai donné, lorsque le délai que je vous accorde sera expiré...» La lettre du ministre de la police se terminait par ce post-scriptum: «J'ai des raisons, madame, pour vous indiquer les ports de Lorient, La Rochelle, Bordeaux et Rochefort, comme étant les seuls ports dans lesquels vous pouvez vous embarquer. Je vous invite à me faire connaître celui que vous aurez choisi.» On interdisait à Mme de Staël les ports de la Manche, afin de l'empêcher d'aller en Angleterre. Du moment qu'on lui donnait pour toute alternative l'Amérique ou Coppet, elle prit le parti de retourner à Coppet, où elle arriva dans la seconde quinzaine d'octobre 1810.[Retour au Texte Principal]
Note 348: C'est au mois de septembre 1811 que cet ordre d'exil fut signifié à Mme Récamier; un ordre semblable était notifié en même temps à M. Mathieu de Montmorency.[Retour au Texte Principal]
Note 349: En arrivant à Châlons, elle s'établit d'abord à l'auberge de la Pomme-d'Or, qu'elle abandonna bientôt pour prendre, rue du Cloître, un petit appartement, qui avait au moins l'avantage d'être commode et silencieux.[Retour au Texte Principal]
Note 350: Le château de Montmirail, magnifique habitation des La Rochefoucauld-Doudeauville, située dans la commune de Montmirail (département de la Marne).[Retour au Texte Principal]
Note 351: Mme de Staël, alors âgée de 45 ans, avait contracté, en 1811, un mariage secret avec M. de Rocca, jeune officier de 27 ans, remarquablement beau, du caractère le plus noble, et qui (lorsqu'elle le connut à Genève) semblait mourant des suites de cinq blessures qu'il avait reçues. M. de Rocca ne survécut qu'un an à Mme de Staël et mourut en 1818.[Retour au Texte Principal]
Note 352: Auguste-Louis de Staël-Holstein, fils aîné de Mme de Staël, né à Paris le 31 août 1790, mort à Coppet le 11 novembre 1827. Il s'occupa spécialement d'agronomie et d'améliorations sociales. Ses œuvres, recueillies par sa sœur, la duchesse de Broglie, ont été publiées en 1829 (3 vol. in-8o).[Retour au Texte Principal]
Note 353: Ce billet, dont Chateaubriand n'indique pas la date, fut écrit au moment où Mme de Staël allait quitter la Suisse pour se rendre en Allemagne. Elle partit de Coppet le 23 mai 1812. (Dix années d'exil, 2e partie, chapitre V).[Retour au Texte Principal]
Note 354: Partie de Coppet, comme nous venons de le voir, le 23 mai 1812, Mme de Staël se rendit à Vienne, qu'elle dut bientôt quitter pour échapper aux tracasseries de la police autrichienne, mise en mouvement par la police de Napoléon. À la fin de juin, elle partait pour la Pologne, et, le 14 juillet 1812, elle entrait en Russie. Après avoir visité successivement Kiew, Moscou, Saint-Pétersbourg, elle s'embarqua à Abo pour Stockholm. Elle passa huit mois en Suède, pendant lesquels elle écrivit ses Dix années d'exil. Peu de temps après, elle partit pour Londres, et c'est là qu'elle publia, en 1813, son ouvrage sur l'Allemagne. Pendant son séjour en Angleterre, elle eut une entrevue avec Louis XVIII: «Nous aurons, annonçait-elle alors à un ami, un roi très favorable à la littérature.»[Retour au Texte Principal]
Note 355: Le second fils de Mme de Staël fut tué en duel en 1813.[Retour au Texte Principal]
Note 356: Mme Récamier quitta Châlons au mois de juin 1812, pour aller à Lyon auprès d'une sœur de son mari, Mme Delphin-Récamier.[Retour au Texte Principal]
Note 357: La duchesse de Chevreuse, née Narbonne-Pelet, était la belle-fille du duc Albert de Luynes. Tandis que son beau-père avait dû se laisser faire sénateur (1er septembre 1803), elle avait dû consentir à être dame du palais de l'impératrice Joséphine (1806). Deux ans plus tard, au moment de l'arrestation de la famille royale d'Espagne, l'Empereur voulut placer la duchesse de Chevreuse auprès de la reine captive; elle répondit qu'elle pouvait bien être prisonnière, mais qu'elle ne serait jamais geôlière. Cette fière réponse lui valut son exil et de cet exil elle devait mourir.[Retour au Texte Principal]
Note 358: «La duchesse de Chevreuse est morte du serrement de cœur que son exil lui a causé. Elle ne put obtenir de Napoléon, lorsqu'elle était mourante, la permission de retourner une dernière fois à Paris, pour consulter son médecin et revoir ses amis.» Mme de Staël, Considérations sur la Révolution française, IVe partie, chap. VIII.[Retour au Texte Principal]
Note 359: Au printemps de 1813.[Retour au Texte Principal]
Note 360: Sur le séjour de Fouché à Rome en 1813, voir, à l'Appendice du tome III du Mémorial de Norvins, les très curieuses pages intitulées: Fouché à Rome.[Retour au Texte Principal]
Note 361: Jacques Marquet de Montbreton, baron de Norvins (1769-1854). Son Histoire de Napoléon (1827, 4 vol. in-8o), après avoir joui d'une grande vogue, est aujourd'hui oubliée. Ses Mémoires, publiés en 1896 par M. Lanzac de Laborie sous le titre: Mémorial de J. de Norvins (3 vol. in-8o) resteront. Parmi les nombreux Mémoires publiés en ces dernières années, ils méritent de tenir un des premiers rangs, à côté de ceux du chancelier Pasquier et du général Marbot.[Retour au Texte Principal]
Note 362: Sur cet épisode du pêcheur d'Albano, voyez Souvenirs et Correspondance tirés des papiers de Madame Récamier, tome I, pages 236-239. C'est au mois de septembre 1813 que fut fusillé le pêcheur d'Albano. Un mois après, au mois d'octobre, Napoléon perdait son Empire dans les plaines de Leipsick.[Retour au Texte Principal]
Note 363: Lettre à M. de Fontanes.—«Un jour, à Rome, comme je rappelais à M. de Chateaubriand cette page que je savais par cœur, et qu'il avait tracée vingt-cinq ans auparavant: «Je ne pourrais pas écrire ainsi aujourd'hui, me dit-il; il faut pour cela être jeune et malheureux.» M. de Marcellus, Chateaubriand et son temps, p. 321.[Retour au Texte Principal]
Note 364: Mme Récamier se rendit à Naples dans les premiers jours de décembre 1813.[Retour au Texte Principal]
Note 365: C'est un souvenir de l'épisode de Velléda, où se trouve cette phrase: «On planta une épée nue pour indiquer le centre du Mallus ou du conseil.»—Et l'auteur ajoutait, dans une note: «J'ai suivi quelques auteurs qui pensent que les Gaulois avaient, ainsi que les Goths, l'usage de planter une épée nue au milieu de leur conseil. (Ammien Marcellin, lib. XXXII, cap. II, p. 622.) Du mot mallus est venu notre mot mail; et le mail est encore aujourd'hui un lieu bordé d'arbres.»[Retour au Texte Principal]
Note 366: La date exacte de l'excursion de Chateaubriand à Literne est: Janvier 1804.[Retour au Texte Principal]
Note 367: Les Martyrs, livre V.[Retour au Texte Principal]
Note 368: Adam-Albert, comte de Neipperg (1775-1829), général autrichien. Il avait déjà été employé par M. de Metternich dans plusieurs missions délicates, lorsqu'au mois de juillet 1814 il fut désigné par l'empereur François II pour être attaché à l'ex-impératrice Marie-Louise. Il ne tarda pas à conquérir les bonnes grâces de cette princesse, qui s'éprit de lui, bien qu'une blessure reçue à la guerre l'eût privé d'un œil et l'obligeât à porter un bandeau noir qui coupait son front en deux. Au mois d'avril 1816, elle prit possession du duché de Parme, et M. de Neipperg devint le grand-maître de son palais, en attendant de devenir son mari. Elle l'épousa morganatiquement et en eut plusieurs enfants. L'Almanach de Gotha relate officiellement le mariage du général comte de Neipperg avec «Marie-Louise, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, veuve de Napoléon Ier, empereur des Français, née archiduchesse d'Autriche».[Retour au Texte Principal]
Note 369: Louis-François-Auguste, prince de Léon, duc de Rohan-Chabot (1788-1833). Après avoir été sous l'Empire chambellan de Napoléon, il fut sous Louis XVIII officier de mousquetaires. Il avait épousé en 1809 Mlle de Sérent, qui mourut tragiquement. Le 9 janvier 1815, comme elle se préparait à aller dîner chez la duchesse d'Orléans, douairière, elle s'approcha de la cheminée; le feu prit aux dentelles de sa robe; lorsqu'on arriva dans sa chambre, les flammes s'élevaient de trois pieds au-dessus de sa tête. Elle mourut le lendemain après d'atroces souffrances et dans les sentiments de la foi la plus vive. Son mari renonça au monde, embrassa l'état ecclésiastique et devint en peu de temps grand vicaire de Paris, archevêque d'Auch, puis de Besançon, et enfin cardinal. Il quitta la France après la révolution de 1830, mais il rentra dans son diocèse en 1832, lors de l'invasion du choléra, et succomba peu après aux atteintes du fléau. Mme Lenormant a tracé de M. de Rohan-Chabot en 1813 le portrait qu'on va lire: «Il était dans toute la fleur de la jeunesse, et avait, en dépit d'une nuance de fatuité assez prononcée, la plus charmante, la plus délicate, je dirais presque la plus virginale figure qui se pût voir. La tournure de M. de Chabot était parfaitement élégante: sa belle chevelure était frisée avec beaucoup d'art et de goût; il mettait une extrême recherche dans sa toilette; il était pâle, sa voix avait une grande douceur. Ses manières étaient très distinguées, mais hautaines. Il avait peu d'esprit, mais, quoique dépourvu d'instruction, il avait le don des langues: il en saisissait vite, et presque musicalement, non point le génie, mais l'accent.»[Retour au Texte Principal]
Note 370: Sur les conditions dans lesquelles il sortit de la garde constitutionnelle de Louis XVI, voir, au tome II, la note 1 de la page 39.[Retour au Texte Principal]
Note 371: Après la mort de l'Ami du Peuple, Murat, par le simple changement d'une lettre, transforma son nom en celui de Marat. Il est si fier de son invention que, dans une lettre qu'il écrit le 18 novembre 1793 et où il presse l'exécution d'un «modérantiste», il appose quatre fois sa nouvelle signature: Marat. (Frédéric Masson, Napoléon et sa famille, tome I, p. 311.)[Retour au Texte Principal]
Note 372: Il avait épousé Caroline Bonaparte le 20 janvier 1800.[Retour au Texte Principal]
Note 373: Le 13 novembre 1805.[Retour au Texte Principal]
Note 374: Le 15 mars 1806.[Retour au Texte Principal]
Note 375: Jean-Michel-Laurent Agar, comte de Mosbourg (1771-1844) était un compatriote et un camarade d'études de Murat, qui s'attacha à sa fortune, l'appela en 1806 au ministère des finances de sa principauté de Berg, lui fit épouser une de ses nièces et lui donna le titre et la dotation du comté de Mosbourg. En 1808, il suivit à Naples le nouveau roi et y prit, comme à Dusseldorf, le portefeuille des finances, qu'il conserva pendant presque toute la durée du règne. Député du Lot après 1830, il fut élevé à la pairie le 3 octobre 1837.—Le comte de Mosbourg avait réuni, pour écrire la vie de Joachim Murat, des documents qui viennent d'être utilisés en partie par le comte Murat dans son livre sur Murat, lieutenant de l'Empereur en Espagne. 1897.[Retour au Texte Principal]
Note 376: Le 29 janvier 1814.[Retour au Texte Principal]
Note 377: Le 28 mars 1815.[Retour au Texte Principal]
Note 378: Le 3 mai.[Retour au Texte Principal]
Note 379: Le 19 mai.[Retour au Texte Principal]
Note 380: Ferdinand IV (comme roi de Naples; Ier comme roi des Deux-Siciles).[Retour au Texte Principal]
Note 381: Napoléon arriva à Sainte-Hélène le 15 octobre.[Retour au Texte Principal]
Note 382: Pie VII fit son entrée solennelle à Rome le 25 mai 1814.[Retour au Texte Principal]
Note 383: Alexis-Louis-Joseph, comte de Noailles (1783-1835). Il avait été emprisonné en 1809 pour avoir répandu la bulle d'excommunication de Pie VII contre les auteurs et complices de l'usurpation des États romains. Au mois de mai 1814, lorsque Mme Récamier traversa Lyon, Alexis de Noailles y était avec le titre de commissaire royal. Il vint la voir, et l'ayant accompagnée dans une fête donnée au palais Saint-Pierre en l'honneur du retour des Bourbons, il fut, ainsi que la belle exilée, l'objet d'une sorte d'ovation.[Retour au Texte Principal]
Note 384: Elle arriva à Paris le 1er juin 1814.[Retour au Texte Principal]
Note 385: L'Esprit de conquête et d'usurpation dans ses rapports avec la civilisation européenne fut publié, dans les premiers mois de 1814, en Allemagne, où se trouvait alors Benjamin Constant; il ne rentra en France qu'avec les Bourbons.[Retour au Texte Principal]
Note 386: Voir le texte de cet article au tome III, note 1 de la page 489.[Retour au Texte Principal]
Note 387: Dès le 6 avril 1815, le Journal de l'Empire annonça que M. Benjamin Constant était un des membres de la Commission constitutionnelle.[Retour au Texte Principal]
Note 388: Dans ses Mémoires sur les Cent-Jours, Benjamin prétend qu'il n'est pas l'auteur de l'Acte additionnel. «C'est jouer sur les mots, dit M. Henry Houssaye (1815, t. 1, p. 542); sans doute il y eut plus d'un article modifié ou ajouté par l'empereur et par la Commission, mais l'Acte additionnel, dans son ensemble, n'en est pas moins l'œuvre de Benjamin Constant.»[Retour au Texte Principal]
Note 389: Sur Mme de Krüdener, voir, au tome II, la note 1 de la page 366.[Retour au Texte Principal]
Note 390: Le 14 juillet 1817.[Retour au Texte Principal]
Note 391: C'est en 1819 que Mme Récamier se retira à l'Abbaye-aux-Bois, dans un petit appartement au troisième étage, carrelé, incommode, dont l'escalier était des plus rudes à monter, ce qui ne l'empêchait pas d'être gravi chaque jour par les plus grandes dames du faubourg Saint-Germain et par tout ce que Paris comptait d'illustrations.[Retour au Texte Principal]
Note 392: Il était compromis dans l'affaire de Bories. Ch.—Coudert avait pris part à un complot militaire contre le gouvernement, le premier complot de Saumur, qui éclata au mois de décembre 1821. L'affaire fut jugée en février 1822 par le second Conseil de guerre de la 4e division militaire siégeant à Tours. Les accusés étaient au nombre de onze: huit furent acquittés; trois furent condamnés à la peine de mort, le lieutenant Delon, chef du complot, contumace, et les deux maréchaux des logis Charles Coudert et Sirejean. Ils se pourvurent en révision, et dans l'intervalle qui sépara les deux jugements, les familles des condamnés essayèrent quelques démarches. Coudert fut le premier pour lequel on eut la pensée d'invoquer l'assistance de Mme Récamier. Dès le commencement de mars, M. Eugène Coudert, frère aîné du sous-officier compromis, se présenta à l'Abbaye-aux-Bois sans autre recommandation que le malheur de son frère Charles. Mme Récamier, émue de la plus sincère pitié, la fît partager à tous ses amis et usa de leur crédit pour obtenir en faveur du condamné l'indulgence du conseil de révision. Ces efforts furent couronnés de succès: le 18 avril, le conseil, cassant l'arrêt des premiers juges, condamna simplement Coudert à cinq ans de prison comme non révélateur. Souvenirs et Correspondance tirés des papiers de Mme Récamier, t. I, p. 373.—La note de Chateaubriand disant que Coudert «était compromis dans l'affaire de Bories» est inexacte. L'affaire de Bories est celle des Quatre sergents de la Rochelle, qui fut jugée par la Cour d'assises de la Seine au mois d'août 1822.[Retour au Texte Principal]
Note 393: Ces vers sont, en effet, de Chateaubriand, dans sa tragédie de Moïse, acte III, scène IV.[Retour au Texte Principal]
Note 394: Histoire des Salons de Paris. Tableaux et portraits du grand monde, sous Louis XVI, le Directoire, le Consulat et l'Empire, la Restauration et le règne de Louis-Philippe Ier, par la duchesse d'Abrantès, tome VII, 1838.[Retour au Texte Principal]
Note 395: Roger, ancien lieutenant (et non capitaine), avait pris part, avec le lieutenant-colonel Caron, au complot de Colmar. Le 23 février 1823, la Cour d'assises de la Moselle le condamna à mort. Sa peine fut commuée en celle de vingt ans de travaux forcés. Envoyé au bagne de Toulon, il obtint grâce entière, au bout de deux ans.[Retour au Texte Principal]
Note 396: Daniel Steibelt, pianiste et compositeur, né à Berlin en 1765, mort à Saint-Pétersbourg en 1823. Il vint en 1790 à Paris, où il balança le succès de Pleyel. Le 10 septembre 1793, en pleine Terreur, il fit représenter sur le Théâtre de l'Opéra-Comique national, avec un vif succès, Roméo et Juliette, «M. de Chateaubriand, dit M. de Marcellus, p. 328, partageait l'affection que nos grand'mères ont portée à l'habile pianiste, au point qu'il me fallut pour lui plaire chercher à Londres une romance de Steibelt, intitulée: «La plus belle des belles», et la lui faire entendre sur mon piano dans nos soirées de solitude. N'était-ce pas encore dans sa pensée un hommage à Mme Récamier?»[Retour au Texte Principal]
Note 397: Ci-dessus, p. 138.[Retour au Texte Principal]
Note 398: Ci-dessus, p. 145.[Retour au Texte Principal]
Note 399: Mme de Staël, qui s'écriait, en face du Léman: Oh! le ruisseau de la rue du Bac! n'a cependant jamais habité cette rue. Elle occupait, avant son exil, un hôtel de la rue de Grenelle-Saint-Germain, auprès de la rue du Bac. (Sainte-Beuve, Portraits de femmes.)[Retour au Texte Principal]
Note 400: Marie-Louis-Auguste de Martin du Tyrac, comte de Marcellus, député de 1815 à 1823, pair de France de 1823 à 1830. C'était le père de M. de Marcellus, l'auteur de Chateaubriand et son temps.[Retour au Texte Principal]
Note 401: Correspondance de Joseph de Maistre, édition de 1886, V. VI p. 108.[Retour au Texte Principal]
Note 402: Catalogue de la collection Bovet, séries V à VIII, 1884, p. 288 no 798, avec fac-similé; et Catalogue Et. Charavay, 20 décembre 1890, no 31.[Retour au Texte Principal]
Note 403: Vie de Madame Swetchine par le comte de Falloux, p. 212.[Retour au Texte Principal]
Note 404: Chateaubriand écrivait à son ami M. Frisell au mois de juillet 1817: «J'ai été bien inquiet, mon cher ami; je suis un peu calmé. Ma malade est bien faible pour le moment; aujourd'hui, il y a encore eu une crise... Mme de Chateaubriand vous dit de tendres choses, du fond de son lit, et moi je vous embrasse tendrement.» (Correspondant du 25 septembre 1897.)[Retour au Texte Principal]
Note 405: Voy. cette lettre de Bonald dans la Correspondance de J. de Maistre, t. VI, p. 319.[Retour au Texte Principal]
Note 406: Correspondance de J. de Maistre, t. VI, p. 112.[Retour au Texte Principal]
Note 407: Ibidem. t. VI, p. 109.[Retour au Texte Principal]
Note 408: M. Le Normant fils, imprimeur, rue de Seine, no 8, était l'éditeur et l'ami de Chateaubriand. Dans sa réponse, Joseph de Maistre écrivait: «Ce sera à M. Le Normant de diviser l'ouvrage comme il l'entendra. Le titre du 2me volume est mobile, il peut le placer où il voudra pour égaliser les volumes.»[Retour au Texte Principal]
Note 409: Ci-dessus, p. 152.[Retour au Texte Principal]
Note 410: On lit dans le Journal des Débats du 3 février 1819, sous la date de Paris, 2 février: «M. de Saint-Marcellin s'est battu en duel hier au soir, à cinq heures, hors la barrière de Clichy. Il a été atteint dangereusement d'un coup de pistolet dans le bas-ventre. Des paysans l'ont apporté à l'hôtel de M. de Fontanes.»—Dans son numéro du 7 février, le Journal des Débats signalait cette bizarre coïncidence: «Le jour et à l'instant même où M. de Saint Marcellin recevait le coup de la mort dans un combat singulier, commençait sur le théâtre de Nantes, la représentation d'un de ses plus jolis ouvrages dramatiques, les Oiseaux et les Chaperons, précédé du Coup d'épée de Saint-Foix et suivi du Duel.»[Retour au Texte Principal]
Note 411: Le Conservateur, t. II, p. 113.[Retour au Texte Principal]
Note 412: Ci-dessus, p. 225.[Retour au Texte Principal]
Note 413: Ci-dessus, p. 241.[Retour au Texte Principal]
Note 414: Politique de la Restauration, p. 58.[Retour au Texte Principal]
Note 415: Ci-dessus, p. 283.[Retour au Texte Principal]
Note 416: Comte de Marcellus, Politique de la Restauration en 1822 et 1823, p. 49. M. de Marcellus ajoute: «M. Delloye, l'éditeur, détruisit, m'a-t-il dit, tout ce qu'il avait déjà imprimé des deux volumes retranchés, il n'en garda qu'un seul exemplaire en feuilles, sur lequel il nota lui-même pour sa justification, de sa main et à la marge, les retranchements demandés, refusés ou consentis. Or, cet exemplaire, s'il existe encore, et si la frénésie des éditions princeps et des raretés bibliographiques se maintient, ne peut manquer d'exciter un jour une véritable curiosité.»[Retour au Texte Principal]
Note 417: Histoire du gouvernement parlementaire en France, tome VII, p. 218.—Voir aussi, sur le Congrès de Vérone et la guerre d'Espagne, le beau récit de M. Alfred Nettement, Histoire de la Restauration tome VI, livres XII, XIII et XIV.[Retour au Texte Principal]
Note 418: Marcellus, Politique de la Restauration, pages 123, 128, 169, 201.[Retour au Texte Principal]
Note 419: Études de morale et de littérature, par M. Saint-Marc Girardin, tome II.[Retour au Texte Principal]
Note 420: Mémoires de M. Guizot, t. I, p. 258.[Retour au Texte Principal]
Note 421: Politique de la Restauration, par M. de Marcellus, p. 274.[Retour au Texte Principal]
Note 422: Ci-dessus, p. 285.[Retour au Texte Principal]
Note 423: C'est le 6 juin—et non le 8—que Chateaubriand fut renvoyé du ministère.[Retour au Texte Principal]
Note 424: Souvenirs, t. II, p. 405.[Retour au Texte Principal]
Note 425: Congrès de Vérone, t. II, p. 389.[Retour au Texte Principal]
Note 426: Chateaubriand avait refusé de défendre à la Chambre des pairs le projet de loi sur la conversion de la rente, projet qui fut rejeté à la majorité de 120 voix contre 105.[Retour au Texte Principal]
Note 427: Cet extrait des carnets de M. de Villèle a été publié par Alfred Nettement, dans son Histoire de la Restauration, t. VI, p. 70.[Retour au Texte Principal]
Note 428: Ci-dessus, p. 330.[Retour au Texte Principal]
Note 429: Ci-dessus, p. 359[Retour au Texte Principal]
Note 430: Mémoires et Souvenirs du baron Hyde de Neuville, t. 111, p. 377.[Retour au Texte Principal]
Note 431: «Quoique irrité contre M. Hyde de Neuville, que son amitié pour Chateaubriand et la fougue de son caractère avaient jeté à la tête de la défection royaliste dans la Chambre, la vieille affection pour ce serviteur dévoué des mauvais jours prévalut dans l'esprit du Roi sur des mécontentements passagers; il l'appela à la place de M. de Chabrol au ministère de la marine. On ne pouvait conférer à des mains plus chevaleresques la dignité du pavillon de la France ni la sécurité de la couronne à un cœur plus fidèle.»—Lamartine, Histoire de la Restauration, tome VIII, page 128.[Retour au Texte Principal]
Note 432: Mémoires et Souvenirs du baron Hyde de Neuville, t. III, pages 377 à 395.[Retour au Texte Principal]