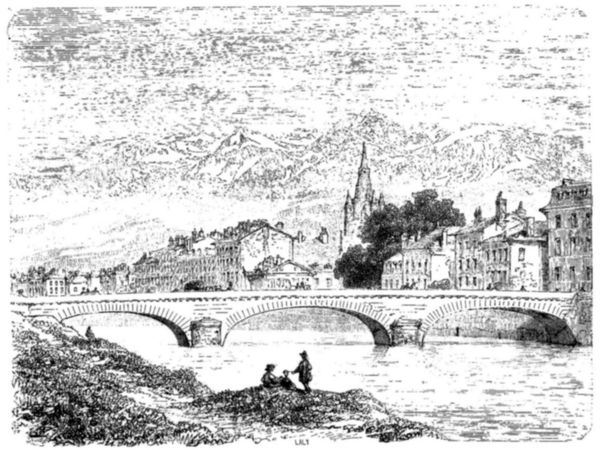
Grenoble et les Alpes dauphinoises.—Dessin de Karl Girardet d'après une photographie de MM. Muzet et Bajat.
The Project Gutenberg EBook of Le Tour du Monde; Dauphiné, by Various
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Le Tour du Monde; Dauphiné
Journal des voyages et des voyageurs; 2. sem. 1860
Author: Various
Editor: Édouard Charton
Release Date: May 11, 2008 [EBook #25435]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE TOUR DU MONDE; DAUPHINÉ ***
Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the
Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Note au lecteur de ce fichier digital:
Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1860).
Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur le Dauphiné.
Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.
IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9, à Paris
PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION
DE M. ÉDOUARD CHARTON
ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES
1860
DEUXIÈME SEMESTRE
LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie
PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No 77
LONDRES, KING WILLIAM STREET, STRAND
LEIPZIG, 15, POST-STRASSE
1860
Un mois en Sicile (1843.—Inédit.), par M. Félix Bourquelot.
Arrivée en Sicile. — Palerme et ses habitants. — Les monuments de Palerme. — La cathédrale de Monreale. — De Palerme à Trapani. — Partenico. — Alcamo. — Calatafimi. — Ruines de Ségeste. — Trapani. — La sépulture du couvent des capucins. — Le mont Éryx. — De Trapani à Girgenti. — La Lettica. — Castelvetrano. — Ruines de Sélinonte. — Sciacca. — Girgenti (Agrigente). — De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l'enlèvement de Proserpine. — De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini. — Syracuse. — De Syracuse à Catane. — Lentini. — Catane. — Ascension de l'Etna. — Taormine. — Messine. — Retour à Naples.
Voyage en Perse, fragments par M. le comte A. de Gobineau (1855-1858), dessins inédits de M. Jules Laurens.
Arrivée à Ispahan. — Le gouverneur. — Aspect de la ville. — Le Tchéhar-Bâgh. — Le collége de la Mère du roi. — La mosquée du roi. — Les quarante colonnes. — Présentations. — Le pont du Zend-è-Roub. — Un dîner à Ispahan. — La danse et la comédie. — Les habitants d'Ispahan. — D'Ispahan à Kaschan. — Kaschan. — Ses fabriques. — Son imprimerie lithographique. — Ses scorpions. — Une légende. — Les bazars. — Le collége. — De Kaschan à la plaine de Téhéran. — Koum. — Feux d'artifice. — Le pont du Barbier. — Le désert de Khavèr. — Houzé-Sultan. — La plaine de Téhéran. — Téhéran. — Notre entrée dans la ville. — Notre habitation.
Une audience du roi de Perse. — Nouvelles constructions à Téhéran. — Température. — Longévité. — Les nomades. — Deux pèlerins. — Le culte du feu. — La police. — Les ponts. — Le laisser aller administratif. — Les amusements d'un bazar persan. — Les fiançailles. — Le divorce. — La journée d'une Persane. — La journée d'un Persan. — Les visites. — Formules de politesses. — La peinture et la calligraphie persanes. — Les chansons royales. — Les conteurs d'histoires. — Les spectacles: drames historiques. — Épilogue. — Le Démavend. — L'enfant qui cherche un trésor.
Voyages aux Indes Occidentales, par M. Anthony Trollope (1858-1859); dessins inédits de M. A. de Bérard.
L'île Saint-Thomas. — La Jamaïque: Kingston; Spanish-Town; les réserves; la végétation. — Les planteurs et les nègres. — Plaintes d'une Ariane noire. — La toilette des négresses. — Avenir des mulâtres. — Les petites Antilles. — La Martinique. — La Guadeloupe. — Grenada. — La Guyane anglaise. — Une sucrerie. — Barbados. — La Trinidad. — La Nouvelle-Grenade. — Sainte-Marthe. — Carthagène. — Le chemin de fer de Panama. — Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. — Le Serapiqui. — Greytown.
Voyage dans les États scandinaves, par M. Paul Riant. (Le Télémark et l'évêché de Bergen.) (1858.—Inédit.)
Le Télémark. — Christiania. — Départ pour le Télémark. — Mode de voyager. — Paysage. — La vallée et la ville de Drammen. — De Drammen à Kongsberg. — Le cheval norvégien. — Kongsberg et ses gisements métallifères. — Les montagnes du Télémark. — Leurs habitants. — Hospitalité des gaards et des sæters. — Une sorcière. — Les lacs Tinn et Mjös. — Le Westfjord. — La chute du Rjukan. — Légende de la belle Marie. — Dal. — Le livre des étrangers. — L'église d'Hitterdal. — L'ivresse en Norvège. — Le châtelain aubergiste. — Les lacs Sillegjord et Bandak. — Le ravin des Corbeaux.
—Le Saint-Olaf et ses pareils. — Navigation intérieure. — Retour à Christiania par Skien.
L'évêché de Bergen. — La presqu'île de Bergen. — Lærdal. — Le Sognefjord. — Vosse-Vangen. — Le Vöringfoss. — Le Hardangerfjord. — De Vikoër à Sammanger et à Bergen.
Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860.—Texte et dessins inédits.)—Lettre au Directeur du Tour du monde (Khartoum, 10 mai 1860).
D'Alexandrie à Souakin. — L'Égypte. — Le désert. — Le simoun. — Suez. — Un danger. — Le mirage. — Tor. — Qosséir. — Djambo. — Djeddah.
Voyage au mont Athos, par M. A. Proust (1858.—Inédit.)
Salonique. — Juifs, Grecs et Bulgares. — Les mosquées. — L'Albanais Rabottas. — Préparatifs de départ. — Vasilika. — Galatz. — Nedgesalar. — L'Athos. — Saint-Nicolas. — Le P. Gédéon. — Le couvent russe. — La messe chez les Grecs. — Kariès et la république de l'Athos. — Le voïvode turc. — Le peintre Anthimès et le pappas Manuel. — M. de Sévastiannoff.
Ermites indépendants. — Le monastère de Koutloumousis. — Les bibliothèques. — La peinture. — Manuel Panselinos et les peintres modernes. — Le monastère d'Iveron. — Les carêmes. — Peintres et peintures. — Stavronikitas. — Miracles. — Un Vroukolakas. — Les bibliothèques. — Les mulets. — Philotheos. — Les moines et la guerre de l'Indépendance. — Karacallos. — L'union des deux Églises. — Les pénitences et les fautes.
La légende d'Arcadius. — Le pappas de Smyrne. — Esphigmenou. — Théodose le Jeune. — L'ex-patriarche Anthymos et l'Église grecque. — L'isthme de l'Athos et Xerxès. — Les monastères bulgares: Kiliandari et Zographos. — La légende du peintre. — Beauté du paysage. — Castamoniti. — Une femme au mont Athos. — Dokiarios. — La secte des Palamites. — Saint-Xénophon. — La pêche aux éponges. — Retour à Kariès. — Xiropotamos, le couvent du Fleuve Sec. — Départ de Daphné. — Marino le chanteur.
Voyage d'un naturaliste (Charles Darwin).—L'archipel Galapagos et les attoles ou îles de coraux.—(1838).
L'Archipel Galapagos. — Groupe volcanique. — Innombrables cratères. — Aspect bizarre de la végétation. — L'île Chatam. — Colonie de l'île Charles. — L'île James. — Lac salé dans un cratère. — Histoire naturelle de ce groupe d'îles. — Mammifères; souris indigène. — Ornithologie; familiarité des oiseaux; terreur de l'homme; instinct acquis. — Reptiles; tortues de terre; leurs habitudes.
Encore les tortues de terre; lézard aquatique se nourrissant de plantes marines; lézard terrestre herbivore, se creusant un terrier. — Importance des reptiles dans cet archipel où ils remplacent les mammifères. — Différences entre les espèces qui habitent les diverses îles. — Aspect général américain.
Les attoles ou îles de coraux. — Île Keeling. — Aspect merveilleux. — Flore exiguë. — Voyage des graines. — Oiseaux. — Insectes. — Sources à flux et reflux. — Chasse aux tortues. — Champs de coraux morts. — Pierres transportées par les racines des arbres. — Grand crabe. — Corail piquant. — Poissons se nourrissant de coraux. — Formation des attoles. — Profondeur à laquelle le corail peut vivre. — Vastes espaces parsemés d'îles de corail. — Abaissement de leurs fondations. — Barrières. — Franges de récifs. — Changement des franges en barrières et des barrières en attoles.
Biographie.—Brun-Rollet.
Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique), par Ouvarovski (1830-1839).
Djigansk. — Mes premiers souvenirs. — Brigandages. — Le paysage de Djigansk. — Les habitants. — La pêche. — Si les poissons morts sont bons à manger. — La sorcière Agrippine. — Mon premier voyage. — Killæm et ses environs. — Malheurs. — Les Yakoutes. — La chasse et la pêche. — Yakoutsk. — Mon premier emploi. — J'avance. — Dernières recommandations de ma mère. — Irkoutsk. — Voyage. — Oudskoï. — Mes bagages. — Campement. — Le froid. — La rivière Outchour. — L'Aldan. — Voyage dans la neige et dans la glace. — L'Ægnæ. — Un Tongouse qui pleure son chien. — Obstacles et fatigues. — Les guides. — Ascension du Diougdjour. — Stratagème pour prendre un oiseau. — La ville d'Oudskoï. — La pêche à l'embouchure du fleuve Ut. — Navigation pénible. — Boroukan. — Une halte dans la neige. — Les rennes. — Le mont Byraya. — Retour à Oudskoï et à Yakoutsk.
Viliouisk. — Sel tricolore. — Bois pétrifié. — Le Sountar. — Nouveau voyage. — Description du pays des Yakoutes. — Climat. — Population. — Caractères. — Aptitudes. — Les femmes yakoutes.
De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud), notes extraites d'une correspondance particulière (1860).
Les Alpes australiennes. — Le bassin du Murray. — Ce qui reste des anciens maîtres du sol. — Navigation sur le Murray. — Frontières de l'Australie du Sud. — Le lac Alexandrina. — Le Kanguroo rouge. — La colonie de l'Australie du Sud. — Adélaïde. — Culture et mines.
Voyages et découvertes au centre de l'Afrique, journal du docteur Barth (1849-1855).
Henry Barth. — But de l'expédition de Richardson. — Départ. — Le Fezzan. — Mourzouk. — Le désert. — Le palais des démons. — Barth s'égare; torture et agonie. — Oasis. — Les Touaregs. — Dunes. — Afalesselez. — Bubales et moufflons. — Ouragan. — Frontières de l'Asben. — Extorsions. — Déluge à une latitude où il ne doit pas pleuvoir. — La Suisse du désert. — Sombre vallée de Taghist. — Riante vallée d'Auderas. — Agadez. — Sa décadence. — Entrevue de Barth et du sultan. — Pouvoir despotique. — Coup d'œil sur les mœurs. — Habitat de la girafe. — Le Soudan; le Damergou. — Architecture. — Katchéna; Barth est prisonnier. — Pénurie d'argent. — Kano. — Son aspect, son industrie, sa population. — De Kano à Kouka. — Mort de Richardson. — Arrivée à Kouka. — Difficultés croissantes. — L'énergie du voyageur en triomphe. — Ses visiteurs. — Un vieux courtisan. — Le vizir et ses quatre cents femmes. — Description de la ville, son marché, ses habitants. — Le Dendal. — Excursion. — Angornou. — Le lac Tchad.
Départ. — Aspect désolé du pays. — Les Ghouas. — Mabani. — Le mont Délabéda. — Forgeron en plein vent. — Dévastation. — Orage. — Baobab. — Le Mendif. — Les Marghis. — L'Adamaoua. — Mboutoudi. — Proposition de mariage. — Installation de vive force chez le fils du gouverneur de Soulleri. — Le Bénoué. — Yola. — Mauvais accueil. — Renvoi subit. — Les Ouélad-Sliman. — Situation politique du Bornou. — La ville de Yo. — Ngégimi ou Ingégimi. — Chute dans un bourbier. — Territoire ennemi. — Razzia. — Nouvelle expédition. — Troisième départ de Kouka. — Le chef de la police. — Aspect de l'armée. — Dikoua. — Marche de l'armée. — Le Mosgou. — Adishen et son escorte. — Beauté du pays. — Chasse à l'homme. — Erreur des Européens sur le centre de l'Afrique. — Incendies. — Baga. — Partage du butin. — Entrée dans le Baghirmi. — Refus de passage. — Traversée du Chari. — À travers champs. — Défense d'aller plus loin. — Hospitalité de Bou-Bakr-Sadik. — Barth est arrêté. — On lui met les fers aux pieds. — Délivré par Sadik. — Maséna. — Un savant. — Les femmes de Baghirmi. — Combat avec des fourmis. — Cortége du sultan. — Dépêches de Londres.
De Katchéna au Niger. — Le district de Mouniyo. — Lacs remarquables. — Aspect curieux de Zinder. — Route périlleuse. — Activité des fourmis. — Le Ghaladina de Sokoto. — Marche forcée de trente heures. — L'émir Aliyou. — Vourno. — Situation du pays. — Cortége nuptial. — Sokoto. — Caprice d'une boîte à musique. — Gando. — Khalilou. — Un chevalier d'industrie. — Exactions. — Pluie. — Désolation et fécondité. — Zogirma. — La vallée de Foga. — Le Niger. — La ville de Say. — Région mystérieuse. — Orage. — Passage de la Sirba. — Fin du rhamadan à Sebba. — Bijoux en cuivre. — De l'eau partout. — Barth déguisé en schérif. — Horreur des chiens. — Montagnes du Hombori. — Protection des Touaregs. — Bambara. — Prières pour la pluie. — Sur l'eau. — Kabara. — Visites importunes. — Dangereux passage. — Tinboctoue, Tomboctou ou Tembouctou. — El Bakay. — Menaces. — Le camp du cheik. — Irritation croissante. — Sus au chrétien! — Les Foullanes veulent assiéger la ville. — Départ. — Un preux chez les Touaregs. — Zone rocheuse. — Lenteurs désespérantes. — Gogo. — Gando. — Kano. — Retour.
Voyages et aventures du baron de Wogan en Californie (1850-1852.—Inédit).
Arrivée à San-Francisco. — Description de cette ville. — Départ pour les placers. — Le claim. — Première déception. — La solitude. — Mineur et chasseur. — Départ pour l'intérieur. — L'ours gris. — Reconnaissance des sauvages. — Captivité. — Jugement. — Le poteau de la guerre. — L'Anglais chef de tribu. — Délivrance.
Voyage dans le royaume d'Ava (empire des Birmans), par le capitaine Henri Yule, du corps du génie bengalais (1855).
Départ de Rangoun. — Frontières anglaises et birmanes. — Aspect du fleuve et de ses bords. — La ville de Magwé. — Musique, concert et drames birmans. — Sources de naphte; leur exploitation. — Un monastère et ses habitants. — La ville de Pagán. — Myeen-Kyan. — Amarapoura. — Paysage. — Arrivée à Amarapoura.
Amarapoura; ses palais, ses temples. — L'éléphant blanc. — Population de la ville. — Recensement suspect. — Audience du roi. — Présents offerts et reçus. — Le prince héritier présomptif et la princesse royale. — Incident diplomatique. — Religion bouddhique. — Visites aux grands fonctionnaires. — Les dames birmanes.
Comment on dompte les éléphants en Birmanie. — Excursions autour d'Amarapoura. — Géologie de la vallée de l'Irawady. — Les poissons familiers. — Le serpent hamadryade. — Les Shans et autres peuples indigènes du royaume d'Ava. — Les femmes chez les Birmans et chez les Karens. — Fêtes birmanes. — Audience de congé. — Refus de signer un traité. — Lettre royale. — Départ d'Amarapoura et retour à Rangoun. — Coup d'œil rétrospectif sur la Birmanie.
Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale, par le capitaine Burton (1857-1859).
But de l'expédition. — Le capitaine Burton. — Zanzibar. — Aspect de la côte. — Un village. — Les Béloutchis. — Ouamrima. — Fertilité du sol. — Dégoût inspiré par le pantalon. — Vallée de la mort. — Supplice de M. Maizan. — Hallucination de l'assassin. — Horreur du paysage. — Humidité. — Zoungoméro. — Effets de la traite. — Personnel de la caravane. — Métis arabes, Hindous, jeunes gens mis en gage par leurs familles. — Ânes de selle et de bât. — Chaîne de l'Ousagara. — Transformation du climat. — Nouvelles plaines insalubres. — Contraste. — Ruine d'un village. — Fourmis noires. — Troisième rampe de l'Ousagara. — La Passe terrible. — L'Ougogo. — L'Ougogi. — Épines. — Le Zihoua. — Caravanes. — Curiosité des indigènes. — Faune. — Un despote. — La plaine embrasée. — Coup d'œil sur la vallée d'Ougogo. — Aridité. — Kraals. — Absence de combustible. — Géologie. — Climat. — Printemps. — Indigènes. — District de Toula. — Le chef Maoula. — Forêt dangereuse.
Arrivée à Kazeh. — Accueil hospitalier. — Snay ben Amir. — Établissements des Arabes. — Leur manière de vivre. — Le Tembé. — Chemins de l'Afrique orientale. — Caravanes. — Porteurs. — Une journée de marche. — Costume du guide. — Le Mganga. — Coiffures. — Halte. — Danse. — Séjour à Kazeh. — Avidité des Béloutchis. — Saison pluvieuse. — Yombo. — Coucher du soleil. — Jolies fumeuses. — Le Mséné. — Orgies. — Kajjanjéri. — Maladie. — Passage du Malagarazi. — Tradition. — Beauté de la Terre de la Lune. — Soirée de printemps. — Orage. — Faune. — Cynocéphales, chiens sauvages, oiseaux d'eau. — Ouakimbou. — Ouanyamouézi. — Toilette. — Naissances. — Éducation. — Funérailles. — Mobilier. — Lieu public. — Gouvernement. — Ordalie. — Région insalubre et féconde. — Aspect du Tanganyika. — Ravissements. — Kaouélé.
Tatouage. — Cosmétiques. — Manière originale de priser. — Caractère des Ouajiji; leur cérémonial. — Autres riverains du lac. — Ouatata, vie nomade, conquêtes, manière de se battre, hospitalité. — Installation à Kaouélé. — Visite de Kannéna. — Tribulations. — Maladies. — Sur le lac. — Bourgades de pêcheurs. — Ouafanya. — Le chef Kanoni. — Côte inhospitalière. — L'île d'Oubouari. — Anthropophages. — Accueil flatteur des Ouavira. — Pas d'issue au Tanganyika. — Tempête. — Retour.
Fragment d'un voyage au Saubat (affluent du Nil Blanc), par M. Andrea Debono (1855).
Voyage à l'île de Cuba, par M. Richard Dana (1859).
Départ de New-York. — Une nuit en mer. — Première vue de Cuba. — Le Morro. — Aspect de la Havane. — Les rues. — La volante. — La place d'Armes. — La promenade d'Isabelle II. — L'hôtel Le Grand. — Bains dans les rochers. — Coolies chinois. — Quartier pauvre à la Havane. — La promenade de Tacon. — Les surnoms à la Havane. — Matanzas. — La Plaza. — Limossar. — L'intérieur de l'île. — La végétation. — Les champs de canne à sucre. — Une plantation. — Le café. — La vie dans une plantation de sucre. — Le Cumbre. — Le passage. — Retour à la Havane. — La population de Cuba. — Les noirs libres. — Les mystères de l'esclavage. — Les productions naturelles. — Le climat.
Excursions dans le Dauphiné, par M. Adolphe Joanne (1850-1860).
Le pic de Belledon. — Le Dauphiné. — Les Goulets.
Les gorges d'Omblèze. — Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou. — Le col de la Cochette.
Excursions dans le Dauphiné, par M. Élisée Reclus (1850-1860).
(p. 369)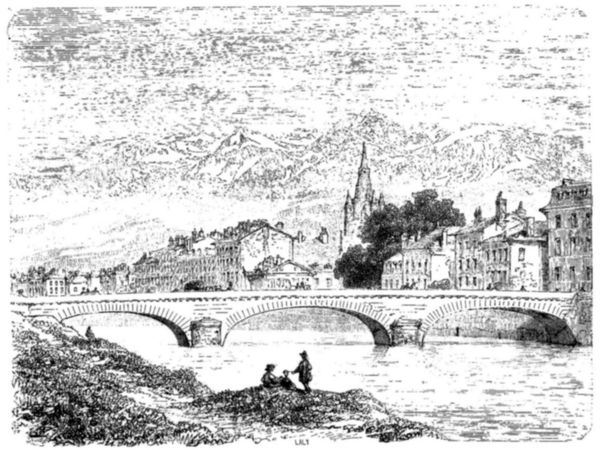
Grenoble et les Alpes dauphinoises.—Dessin de Karl Girardet d'après une photographie de MM. Muzet et Bajat.
I
Le pic de Belledonne.
Avant d'entrer à Grenoble, la route de Paris gravit un petit escarpement au pied duquel coule l'Isère et que domine le village de Saint-Martin-le-Vinoux. Du sommet de cette côte on découvre un des plus beaux paysages de la France. Jamais je n'ai pu me lasser de l'admirer. Les vastes plaines du Drac et de l'Isère, bien que trop souvent ravagées par ces rivières qui les fécondent, sont couvertes d'une végétation si luxuriante et si variée; les hautes montagnes, entre lesquelles elles s'étendent ou se resserrent tour à tour, présentent des aspects si divers, des formes si différentes, des teintes si opposées et si harmonieusement fondues ensemble, que la critique la plus difficile ne trouverait aucun trait, aucune couleur à modifier dans ce merveilleux tableau. Rien n'y manque de ce qui peut charmer les yeux: eaux abondantes et rapides, vertes prairies, vergers touffus, immenses forêts où toutes les essences prospèrent également, rochers bizarres souvent visités par les nuages, neiges et glaces que ne parviennent point à fondre les plus fortes chaleurs de l'été, et dont la blancheur fait paraître plus bleu l'azur d'un ciel déjà méridional.... Heureux ceux qui savent apprécier ces chefs-d'œuvre de la création! Quant à moi, je retournerais chaque année à Grenoble, si je le pouvais, ne fût-ce que pour contempler, n'importe à quelle heure du jour, le panorama qu'offre aux touristes qui ont le bonheur de la gravir, la petite côte de Saint-Martin-le-Vinoux.
Quelques minutes après avoir dépassé ce village si (p. 370) bien situé, en contourne le dernier escarpement du mont Radiais, pour entrer à Grenoble par la porte de France. Le paysage change tout à coup; il est moins varié, mais plus grandiose. La gravure placée en tête de cet article me dispense de le décrire. Au-dessus du groupe pittoresque des maisons et des monuments publics de Grenoble se dresse la grande chaîne des Alpes dauphinoises, étincelante de neiges et de glaces éternelles, et dont les crêtes dentelées atteignent la hauteur de deux mille cinq cents à trois mille mètres.
Tout enfant, je m'étais senti attiré par ces montagnes. Mon instinct ne me trompait pas: je pressentais, en les admirant pour la première fois, que je passerais sur leurs sommets quelques-unes des plus belles heures de ma vie. Bien des années cependant devaient s'écouler avant que je pusse satisfaire ces désirs de ma jeunesse. Devenu homme, je les avais vus s'accroître au lieu de diminuer. Ce n'était pas un caprice, c'était une passion; plus je m'y abandonnais, plus elle me possédait. J'en avais fait l'expérience dans les Alpes de la Suisse et du Tyrol; toutefois, par suite de circonstances inutiles à rappeler ici, je n'avais pas encore escaladé les Alpes du Dauphiné. Stupide vanité! diront les promeneurs des plaines. On n'entreprend de pareilles courses que pour s'en vanter au retour. Erreur profonde! Loin de moi la prétention d'excuser ni d'encourager des expéditions dangereuses où l'on compromet par orgueil, non-seulement sa vie, mais l'existence des guides que l'appât du gain détermine à vous accompagner. On n'est absous de pareilles tentatives que si elles ont pour but une observation ou une découverte scientifique. Elles méritent un blâme sévère toutes les fois que l'amour-propre est leur seul mobile. Mais, quand on aime vraiment la nature, quand on sait en comprendre les charmes, les splendeurs, les harmonies, les enseignements, on éprouve des jouissances infinies à s'élever sur les hautes montagnes. La santé de l'âme y gagne autant que celle du corps. On y prend, en fatiguant ses membres pour les fortifier, ces bains d'air vivifiant que recommandait avec tant d'éloquence Jean-Jacques Rousseau; les sentiments s'y épurent comme l'atmosphère; les idées y grandissent; on y découvre, à mesure qu'on monte, des beautés inconnues de ceux qui se contentent de les contempler des vallées ou des plaines; tout change, en effet, formes, couleurs, aspects, horizons; on éprouve enfin un plaisir indéfinissable à dominer, à perdre de vue, en paraissant se rapprocher du ciel, ces bas-fonds de la terre, où la triste humanité se livre à son travail forcé, plus occupée malheureusement à satisfaire de mauvaises et honteuses passions qu'à développer les facultés intellectuelles et morales qui devraient être la source unique de ses plaisirs et de son bonheur!
Le 11 septembre 1852, le temps paraissant assuré pour le lendemain, je résolus de tenter l'escalade de la plus haute sommité de la chaîne des Alpes dauphinoises qui dominent la rive gauche de l'Isère. Cette sommité,—on ne la voit pas de Grenoble,—se nomme le pic de Belledonne. La carte du dépôt de la guerre, dont j'avais eu la précaution de me munir, lui donne une élévation totale de deux mille neuf cent quatre-vingt-un mètres. C'était tout ce que je savais. Vainement j'avais feuilleté et refeuilleté le petit nombre d'ouvrages publiés soit à Paris, soit à Grenoble, sur le Dauphiné. Aucun d'eux ne consacrait une seule ligne à cette montagne. Seulement, un botaniste qui ne l'avait pas gravie, mais qui s'était aventuré jusqu'à sa base, m'avait appris que l'ascension de Belledonne était possible. Je devais aller coucher au village de Revel, où je trouverais un guide nommé Marquet.
Vers quatre heures de l'après-midi je partis donc pour Revel avec un jeune compagnon qui désirait tenter aussi l'aventure. Nous remontâmes jusqu'à Domène la rive gauche de l'Isère, dans la célèbre vallée du Graisivaudan, si belle à cette époque de l'année, mais trop infectée par les mares pestilentielles où rouit le chanvre. Aussi hâtions-nous le pas pour fuir l'odeur désagréable et malsaine qui nous poursuivait depuis notre départ de Grenoble, et, malgré les admirables paysages que nous offraient incessamment les deux versants de la grande vallée, nous vîmes s'ouvrir avec plaisir, à Domène, le vallon latéral que nous devions remonter.
De ce vallon sort un torrent qui descend du lac Robert et d'autres petits lacs supérieurs. L'entrée en est étroite et boisée. Au lieu de s'engager dans cette gorge pittoresque, le chemin s'élève en zigzags au-dessus de la rive droite. À chaque contour on découvre de plus beaux points de vue sur la vallée du Graisivaudan. Quand on a gravi ce premier escarpement, on se trouve dans une grande vallée aux pentes fortement inclinées, parsemée de bois et de cultures variées, dominée par un cirque immense de montagnes dentelées qui relie Chanrousse à Belledonne. Le premier plan est charmant. Sur un promontoire de rochers, à la base duquel le torrent creuse incessamment son lit encaissé, apparaissent au milieu d'un bouquet d'arbres les ruines d'un vieux château. Mais nous étions trop pressés d'arriver au village que nous voyions à une petite distance pour aller explorer le manoir de Revel.
Le guide qui nous avait été indiqué, M. Marquet, était heureusement chez lui, lorsque nous nous présentâmes à son débit de tabac. Je le trouvai, au premier abord, intelligent, complaisant et grand amateur de courses alpestres. Il paraissait aimer avec passion ses montagnes; plusieurs fois déjà il était monté au sommet du Belledonne. Le temps, complétement au beau, ne devait nous inspirer aucune inquiétude pour le lendemain. En conséquence, nos petites conventions furent bientôt réglées, à notre satisfaction commune. Nous partirions à trois heures du matin, afin d'arriver à la cime avant dix heures. Restait cependant une question importante à résoudre: où pourrions-nous trouver à dîner, un gîte pour la nuit et des provisions pour notre expédition.
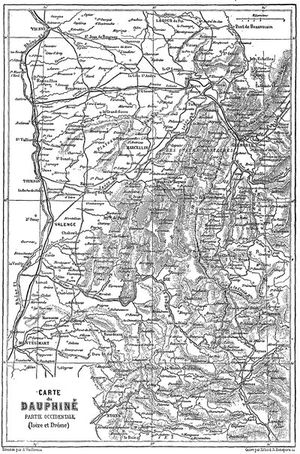
CARTE du DAUPHINÉ PARTIE OCCIDENTALE (Isère et Drôme).
Dressée par A. Vuillemin Gravé par Erhard R. Bonaparte 42.
Le village de Revel, situé à quinze kilomètres seulement de Grenoble et peuplé de plus de neuf cents habitants, ne possède aucune auberge. Quand on veut y coucher, il faut demander l'hospitalité au boulanger, M. Belot, (p. 372) qui l'accorde avec un empressement et une amabilité dont on doit lui garder une reconnaissance éternelle, mais qui malheureusement manque de tout ce qui lui serait nécessaire pour équilibrer le résultat avec sa bonne volonté. La maison de M. Belot mérite une courte description. Le rez-de-chaussée consistait en une pièce, tout à la fois ou tour à tour boutique, cuisine, salle à manger, cabaret et four. Au fond, un escalier de bois, noirci par la fumée comme les murs et le plafond, donnait accès à une grande salle d'un aspect non moins sombre, mal éclairée d'ailleurs par une fenêtre dont les vitres étaient en partie brisées. De longs bancs de bois et des tables de bois, qui portaient les traces trop évidentes de très-nombreuses libations, en formaient tout le mobilier. Une chambre, ouvrant sur cette salle, servait de logement à toute la famille composée alors du père, de la mère et de deux enfants.
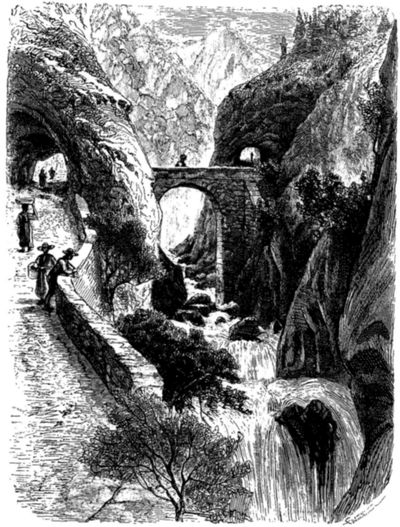
Les Grands Goulets.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Mme Belot était une petite femme active, intelligente et complaisante jusqu'au dévouement. Soit qu'elle se fût privée des deux paillasses sur lesquelles elle couchait, soit qu'elle en eût emprunté d'autres à quelque voisine, en moins d'une demi-heure elle nous eut installé à chacun un lit aux extrémités supérieures des deux tables, et mis un double couvert au milieu de l'une d'elles. En attendant le dîner, qu'elle nous promettait toutefois le plus tôt possible, nous descendîmes dans la rue pour respirer à notre aise l'air extérieur, car l'atmosphère de cette pièce avait été tellement viciée, pendant je ne sais combien d'années, par une si grande variété d'odeurs et d'émanations fétides, et se renouvelait en outre si difficilement, qu'on s'y sentait prêt à suffoquer. Mais le rez-de-chaussée nous présenta un spectacle qui devait nous y retenir assez longtemps.
C'était le samedi, jour important pour le boulanger et (p. 374) la population de Revel. Ce jour-là, en effet, M. Belot cuit son pain et celui de ses pratiques. Or, les paysannes les plus riches du village profitent de cette circonstance pour faire cuire, les unes, un morceau de viande, les autres, des légumes, toutes des pognes. La pogne (le paysan prononce généralement pougne, cependant la prononciation varie selon les villages) est en automne le régal favori des Dauphinois ou plutôt des Dauphinoises, car le sexe masculin préfère à tout le jeu de boules. Je comprends cette passion, mais je ne la partage pas. Malgré les divers efforts que j'ai faits pour l'adorer, la pogne m'est restée à peu près indifférente. C'est une sorte de galette dont les bords sont assez relevés pour pouvoir contenir une bouillie jaunâtre, fabriquée avec un peu de lait, un peu de sucre, et beaucoup de potiron. L'ensemble manque de goût; cependant, à part sa fadeur, il n'a rien de particulièrement désagréable.
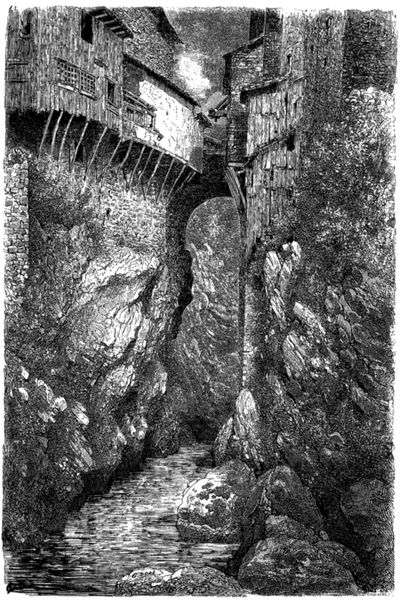
Pont-en-Royans.—Dessin de Doré d'après une photographie de Baldus.
Sept ou huit villageoises, l'aristocratie financière du village, étaient groupées devant la gueule du four de M. Belot. Le boulanger, pour le moment l'arbitre de leur destinée, semblait comprendre la hauteur de la mission qu'il était appelé à remplir. Le monde entier avait cessé d'exister pour elles; elles n'avaient plus qu'une seule pensée: leur pogne serait-elle cuite à point, de manière à satisfaire tout à la fois les yeux, l'odorat et le goût. En vérité, leur physionomie révélait une si poignante inquiétude et un mélange si expressif d'espérance et de crainte, qu'elles se transfiguraient à mes propres yeux. Ce n'étaient plus de grosses, laides et malpropres paysannes avides d'un gâteau préféré, je voyais en elles de véritables artistes tremblant pour la réalisation de leur rêve favori, pour la réussite d'une œuvre dont dépendait leur fortune ou leur réputation. M. Belot s'élevait presque au sublime quand il ôtait à demi la plaque qui fermait la gueule du four afin de s'assurer si son expérience ne le trompait point. Sa pose, ses gestes, ses regards semblaient leur dire: C'est pour calmer votre impatience que je consens à jeter un coup d'œil furtif sur vos pognes, car je suis certain du succès de l'opération. Malgré son sang-froid et son assurance, elles se dressaient toutes sur la pointe des pieds pour tâcher d'apercevoir au fond du four entr'ouvert l'état inquiétant ou consolant de la pâte qu'elles avaient pétrie avec tant d'amour.
L'heure si vivement attendue arriva enfin. Tous les yeux se fixèrent sur le même point; les poitrines étaient haletantes; l'anxiété atteignait son paroxysme. M. Belot, complétement maître de lui, enleva la cendre brûlante qui fermait hermétiquement la porte mobile du four, retira cette porte qu'il déposa à terre, et, saisissant avec vivacité sa meilleure pelle, il la plongea d'un air triomphant jusqu'au fond de l'antre brûlant. L'habile boulanger de Revel avait eu raison de dédaigner les appréhensions de ses pratiques. Jamais pogne mieux réussie n'avait réjoui leurs yeux charmés. Évidemment il tenait à se distinguer devant les étrangers auxquels il avait accordé l'hospitalité. Un cri d'enthousiasme et de joie s'échappa de toutes les bouches, et nous mêlâmes d'instinct nos applaudissements à ceux de la foule, sûrs que, cette fois du moins, on pouvait se fier à son approbation.
Cette fournée, à jamais mémorable dans l'histoire de Revel, ne pouvait évidemment pas se passer d'une célébration solennelle. À la demande de son mari, Mme Belot apporta sur la table une bouteille de liqueur et douze petits verres. Il nous fallut trinquer avec les paysannes à la santé du boulanger, qui buvait à la nôtre, en nous remerciant de nos éloges, dont il paraissait vraiment heureux et fier. Ce tableau villageois avait, dans sa vulgarité, un caractère primitif que le souvenir a revêtu d'une certaine poésie.
Cependant les paysannes emportèrent leurs pognes, et nous remontâmes dans notre galetas. Le dîner fut excellent, grâce à un énorme gigot cuit à point, dont nous devions emporter le lendemain les restes dans notre expédition, et à une grosse pogne qui nous parut un peu fade. La nuit, au contraire, devait être terrible. La salle où nous étions couchés sur deux tables ressemblait à une arche de Noé: non-seulement elle servait d'asile à la volaille de la maison, mais un grand nombre d'animaux nuisibles, quoique domestiques, y venaient prendre leurs ébats. Il y avait des souris, il y avait des rats, il y avait des araignées, des papillons de nuit, peut-être des chauves-souris, à coup sûr des myriades de ces jolis, mais exécrables, petits insectes que Töpffer a surnommés kangurous. À peine notre chandelle fut-elle éteinte que le sabbat commença. Les rats se distinguèrent par leurs évolutions fantastiques, auxquelles je m'efforçais vainement de donner un sens. Ils couraient à droite, ils couraient à gauche comme des insensés, ils dansaient sur les bancs et sur les tables, ils grimpaient le long des murs, ils se promenaient, je crois, au plafond. Pour comble de malheur, deux ivrognes s'étaient attablés dans la boutique, et, comme tous les ivrognes, se répétaient incessamment les mêmes banalités sans se comprendre; plus ils buvaient, plus ils criaient, moins ils s'entendaient. Mme Belot n'osa pas les mettre à la porte avant que l'horloge du village eût sonné minuit, puis la pauvre femme, qui devait se lever avec le jour, lava et rangea un peu trop bruyamment sa vaisselle, et elle monta enfin, vers une heure du matin, dans la petite chambre séparée de notre salle par une mince cloison, que faisaient vibrer les ronflements de son mari. Ses deux enfants, affligés pour le moment de la coqueluche, pleuraient ou criaient en fausset; elle dut les apaiser et les endormir. Enfin je l'entendis tomber épuisée sur je ne sais quel grabat. Bien que les rats et les souris, un moment troublés par son passage, se fussent empressés de réparer le temps perdu, vaincu par la fatigue, à demi-asphyxié d'ailleurs, je fermai les yeux et m'assoupis dans cet état de veille qui n'est ni la vie ni la mort, où l'on conserve le sentiment de l'existence, mais où l'on perd la force de manifester sa volonté. Tous les bruits se confondirent en une vague rumeur qui devint une note monotone. Je regardais, sans la voir, la fenêtre par laquelle glissait un faible rayon lumineux, je devins même insensible aux caresses sans cesse répétées des kangurous, et, quand un rat, plus (p. 375) hardi que ses compagnons, se permit de venir chanter je ne sais quelle romance tout près de mon oreille, je voulus en vain le prier poliment de s'éloigner....
Je ne dormais pas cependant, car, dès que le pas de Marquet retentit dans la rue, je l'entendis. Dix minutes après, nous étions, mon compagnon et moi, aux deux côtés de notre guide. La lune s'était couchée, si mes souvenirs ne me trompent pas, et, bien que le ciel fût sans nuages, l'obscurité était profonde, surtout au sortir du village, le chemin que nous suivions serpentant sous de grands arbres. Nous marchions déjà depuis assez longtemps lorsque quatre heures sonnèrent à l'horloge de Revel. Bientôt l'aurore aux doigts de rose—jamais elle n'avait mieux mérité cette qualification—nous apparut à l'horizon, et peu à peu tous les objets dont nous étions entourés sortirent des ténèbres pour s'éclairer de cette lumière vague et terne qui précède le véritable jour.
Nous gravissions des pentes douces couvertes de cultures variées. Chaque champ est entouré d'une haie et souvent séparé du champ voisin par une ligne de grands arbres. De distance en distance, en nous retournant, nous apercevions, à travers les brumes du matin, qui en cette saison s'élèvent de tous les bas-fonds, la grande vallée où l'Isère, libre encore de toutes digues, déroulait ses longs et gracieux rubans d'argent.... Cependant, à mesure que nous nous élevions, les cultures devenaient plus rares et plus maigres. Nous entrâmes dans une forêt composée en grande partie de sapins, puis les arbres eux-mêmes disparurent peu à peu, et deux heures environ après notre départ de Revel, nous atteignîmes la région des pâturages.
L'arête gazonnée sur laquelle monte le sentier s'appelle les prés Raymond (un chemin partant de Lancey vient y aboutir par la Combe qui porte le nom de ce dernier village). On y découvre déjà, quand on se retourne, une vue admirable, mais il faut savoir se ménager le plaisir de la surprise. En face de nous, en continuant à monter, nous remarquions alors deux montagnes dépourvues de végétation, souvent labourées par la foudre, et paraissant tour à tour grises, jaunes, rouges, noires, selon qu'elles étaient éclairées ou dans l'ombre. On les désigne sous les noms de la Petite et de la Grande Lance. À gauche s'enfonce une gorge étroite, pittoresque, noire de sapins, la Grande Combe. Bientôt nous dépassâmes les derniers arbres rabougris qui végètent à cette hauteur, et à la région des pâturages succéda la région des roches où la vie végétale et animale continue toutefois à se manifester. Les plantes y sont nombreuses, fortes et belles; de charmants oiseaux, moins farouches que ceux qui habitent les vallées ou les plaines, y chantent en sautillant de bloc en bloc; des papillons y voltigent de fleur en fleur avec une sécurité vraiment superbe. L'homme seul y est rare, mais on s'en console aisément; on en rencontre cependant de distance en distance: ici, un berger provençal qui veille de loin et de haut sur les moutons confiés à sa garde; là, un chasseur de chamois tout occupé à contempler les pointes les plus ardues pour y découvrir le gibier qu'il n'atteindra que dans quatre ou cinq heures; ailleurs, un robuste et brave montagnard, à l'œil vif, au teint basané, au jarret de fer, qui cherche des pierres précieuses ou des herbes médicinales, car la montagne, si pauvre qu'elle paraisse, a ses richesses. Ces déserts de pierres sont possédés par des propriétaires qui en retirent des loyers assez considérables. Au mois d'août 1860, je gravissais, avec un berger provençal, les sentiers ardus et rocheux qui conduisent aux Sept-Laux. Quand nous arrivâmes au premier des lacs, j'aperçus des moutons parqués dans une petite presqu'île. Au signal qu'il donna, les bergers, chargés sous ses ordres de la garde des troupeaux, laissèrent libre l'isthme étroit qu'ils occupaient avec leurs chiens. Les moutons, impatients de liberté, avides surtout de nourriture, se précipitèrent aussitôt sur les rochers où croissaient quelques touffes d'herbes, et se dispersèrent dans toutes les directions. On les comptait au passage pour constater leur nombre, car plus d'un par semaine tombe dans un précipice, où il se tue. De quelque côté que se portassent mes regards, je ne voyais que des pierres, de l'eau, de la neige et des glaces éternelles. Pourtant ce désert nourrissait pendant trois mois de l'été deux mille moutons de la Crau, et il était affermé par bail authentique deux mille cinq cents francs par an, pour une période de six années.
Cependant Marquet s'était baissé, et, ramassant une pierre, il la lança sur un tas déjà considérable d'autres pierres qui s'élevait au fond d'un petit ravin entièrement aride et nu. À la gravité de son maintien, à la solennité de son geste, je compris qu'il venait d'accomplir une sorte d'acte religieux.
«Que faites-vous? lui demandai-je.
—Prenez cette pierre, me répondit-il, en m'en offrant une autre qu'il venait de ramasser, et jetez-la sur ce tas où je viens d'en jeter une; c'est la pierre du Mercier.»
Plus d'une fois dans les Alpes de la Suisse, de la Savoie ou du Tyrol, j'avais été sollicité par mes guides de rendre ainsi les derniers devoirs à quelque victime de la fureur des éléments ou de la perversité des hommes. Cette pratique, aussi touchante dans l'intention qu'absurde dans la forme, ne m'étonna donc pas; je m'empressai de m'y soumettre, et, quand ma pierre se fut arrêtée sur le tas ainsi formé par tous les voyageurs qui avaient avant moi traversé ce passage, je demandai à Marquet quel était le mercier mort au fond de ce ravin solitaire, et comment il avait péri.
«Nul ne le sait, me répondit-il; chacun raconte à ce sujet une histoire différente. Selon les uns, il a été assassiné par des voleurs qui s'emparèrent du petit pécule qu'il rapportait de ses voyages. À en croire les autres, il est mort dans une tourmente de neige.»
Au delà de la pierre du Mercier, le désert devient de plus en plus sauvage. Continuant à monter, on traverse le torrent qui descend du pic de Belledonne, et bientôt, trois heures après avoir quitté Revel, on atteint le lac du Crozet, situé à une hauteur de dix-neuf cent trente-six mètres. Pour ceux qui ne connaissent pas les Alpes de la Suisse, l'aspect de ce lac est saisissant. Ses eaux, qui changent de couleur plusieurs fois par jour ou même par (p. 376) heure, selon l'état du ciel, sont généralement d'un vert noir. Il est encaissé entre des rochers aux teintes sombres que dominent: à gauche en montant, la Grande Lance; à droite, le Colon, dont le sommet a deux mille trois cent quatre-vingt-treize mètres; en face, les rochers de la Praz, qui ressemblent à d'énormes tours. Aucun arbre ne croît dans ce bassin désolé, où l'on trouve souvent de la neige au milieu de l'été. Toutefois les botanistes récoltent des plantes rares entre les blocs de pierre que les avalanches, les pluies et la foudre ont fait rouler des sommités ou des pentes voisines. Au moment où nous longeâmes la rive droite du lac, longue d'environ quatre cents mètres, aucune brise n'agitait la surface de l'eau, calme et sombre comme celle de la mer Morte; mais, quand la tourmente descend de la montagne, elle y soulève des vagues énormes qui si brisent avec une fureur inutile contre leurs digues infranchissables. Heureusement, il ne nous fut pas permis d'assister à ce grand et imposant spectacle, car le beau temps nous était nécessaire pour jouir du splendide panorama que nous promettait le sommet de Belledonne.
À l'extrémité supérieure du lac du Crozet, le sentier que nous avions suivi cesse d'être praticable aux chevaux; il disparaît même entièrement. On passe où l'on veut, c'est-à-dire où l'on peut, en remontant la gorge sauvage au fond de laquelle les eaux des lacs Domeynon se frayent un passage à travers les rochers jusqu'au lac du Crozet. Après trente minutes de marche environ, on découvre sur la droite un vallon élevé (les pâturages de la Praz), souvent visité par les botanistes, qui sont certains d'y trouver un grand nombre de plantes rares. Mais, quand on veut faire l'ascension de Belledonne, il ne faut pas se laisser séduire par les gazons et les fleurs de ces prairies alpestres. On doit, inclinant sur la gauche, s'élever, de rochers en rochers, au haut de la pente escarpée d'où le torrent se précipite en formant une cascade. Cette chute mérite, à un double titre, d'attirer l'attention. Quand il a plu abondamment sur la montagne ou quand le soleil a fait fondre les neiges, elle offre vraiment un bel aspect; en outre ses eaux se divisent: une partie va se jeter dans l'Isère par la Combe de Lancey; l'autre arrose au contraire la vallée de Domène, après avoir formé cette magnifique cascade de l'Oursières que ne manquent pas d'aller admirer tous les baigneurs d'Uriage.
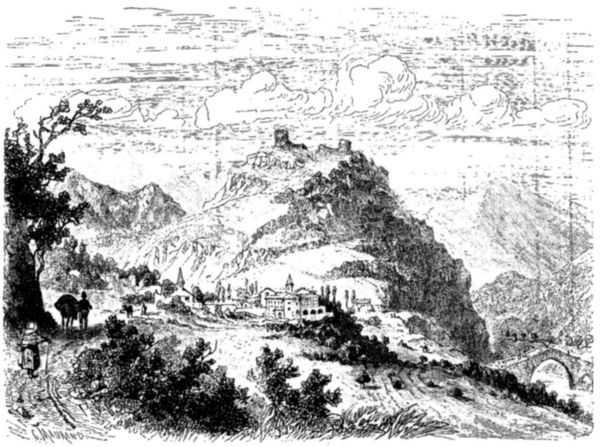
Sainte-Croix et les ruines du Château de Quint.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
L'escarpement gravi, on se trouve dans un vallon supérieur haut de deux mille deux cent cinquante-trois mètres, et dont le fond est occupé par deux petits lacs, le Petit et le Grand Domeynon. Ces lacs sont souvent gelés, même au milieu de l'été. Des plaques de neige plus ou moins épaisses s'étendent ça et là sur leurs bords, et entre les blocs de roches noirâtres que portent les pentes supérieures. Au nord la Grande Lance dérobe aux Grenoblois (p. 378) la vue de Belledonne; au sud se dresse la Grande Voudène, qui atteint deux mille sept cent quatre-vingt-neuf mètres; au nord-est se montrent, au-dessus d'une muraille presque à pic, couverte de neige et de glace, les trois pics de Belledonne, dont le plus élevé, haut de deux mille neuf cent quatre-vingt-un mètres, est à sept cent vingt-huit mètres au-dessus du grand lac Domeynon. Dès lors on se plaît à contempler cette pointe, longtemps cachée, qu'il faut atteindre; à peine si le sifflement d'une marmotte ou l'apparition soudaine d'un chamois (on en rencontre souvent dans ces parages) parviennent à détourner l'attention: c'est là qu'est le terme de tous les efforts, la récompense de toutes les fatigues, la réalisation de toutes les espérances. Quelques pas encore et nous admirerons le panorama que nous sommes venus chercher si haut, car aucune vapeur ne trouble la sérénité du ciel.

Pic de Saint-Géniz. Pic de Chamaloc. Vallée de Roumeyer. La Dent de Die. Rochers de Glandaz. Plateau de Glandaz.
Die et la vallée de la Roumeyer, vue prise des hauteurs de Saint-Justin.—Dessin de Français d'après M. A. Muston.
Mais ces derniers pas sont plus nombreux qu'on ne le croirait d'abord; ils sont plus pénibles, surtout si l'on suit le chemin que je me suis tracé. Dès que nous eûmes atteint l'extrémité supérieure du vallon de Domeynon, je demandai à Marquet quelle direction il se proposait de prendre. Il me montra de la main les montagnes qui s'élevaient à notre droite et qui paraissaient en effet d'un abord relativement facile.
«Combien de temps nous faudra-t-il, lui dis-je alors, pour arriver au sommet de Belledonne en faisant ce long détour que vous m'indiquez?
—Une heure et demie, me répondit-il.
—C'est bien long. Pourquoi ne monterions-nous pas en suivant la ligne droite?
—La pente est trop roide.»
Il s'agissait en effet de gravir une pente de quarante-cinq degrés environ, recouverte d'une couche épaisse de cette neige grenue et durcie qui n'est plus de la neige à proprement parler, mais qui n'est pas encore de la glace et qu'on appelle dans les Alpes le nevé.
«Essayons.
—Je n'oserais pas y conduire des voyageurs. Ce serait une trop grande responsabilité.
—Si les voyageurs vous y conduisent, les suivrez-vous?
—Peut-être.»
J'avais exploré assez de glaciers dans les Alpes de la Suisse, de la Savoie et du Tyrol pour savoir que je ne courais aucun danger en tentant de gravir cette pente de neige un peu trop roide. Puisque ce n'était pas un glacier, il n'y avait aucune crevasse à redouter. D'ailleurs, avec une pareille inclinaison, les crevasses, étant toujours visibles, sont faciles à éviter. Le seul risque auquel on s'exposait était une chute. Or on peut tomber partout si l'on manque de prudence ou de solidité. Mon parti fut bientôt pris. J'en avertis mon compagnon qui n'hésita pas à me suivre. En me voyant si résolu, Marquet hocha la tête et s'assit sur un bloc de rocher.
Le nevé se trouvait dans d'excellentes conditions; il n'était ni trop dur ni trop ramolli. En y enfonçant quatre ou cinq fois de suite avec vigueur l'extrémité de mon gros soulier ferré, je formais facilement un degré qui offrait toute la solidité désirable. Mon compagnon n'avait qu'à monter cet escalier improvisé que je traçais parfois en zigzag pour diminuer la roideur de la pente. Nous nous élevions rapidement, et déjà nous avions atteint la moitié environ de la rampe, lorsque Marquet se décida à profiter de mon chemin. Il fut bientôt auprès de nous, c'est-à-dire derrière nous. Nous arrivâmes ainsi à la file, non sans fatigue mais sans accident, sur un vaste plateau de nevé en pente douce, d'où une demi-heure nous suffit pour nous élever jusqu'à celui des pics de Belledonne que couronne une croix de bois. Le grand pic, haut de quelques mètres seulement au-dessus du point où nous étions parvenus, est si escarpé qu'aucun être humain n'a pu le gravir.
Quelques nuages avaient malheureusement, pendant la dernière partie de notre ascension, monté du fond des vallées sur un certain nombre de sommités qu'ils nous cachaient. Toutefois le panorama que nous découvrions encore répondait entièrement à nos espérances. J'en connais peu de plus grand, de plus varié, de plus beau. Un pareil tableau ne saurait ni se peindre ni se décrire. Je ne ferai donc pas ici une tentative inutile. J'indiquerai seulement en quelques lignes les points les plus importants ou les plus éloignés qu'embrassaient nos regards.
Au-dessous de nous, dans la direction du nord-ouest, s'enfonçait un véritable glacier, aux pentes escarpées, sillonné de crevasses, et descendant jusqu'à un petit lac—le lac blanc—dont les eaux arrosent le sauvage et pittoresque vallon de Mury; puis, au-dessus de la grande vallée du Graisivaudan se redressait avec un élan superbe le curieux massif auquel la Grande Chartreuse a donné son nom. Nous en reconnaissions aisément tous les pics principaux; le Casque de Néron, la Pinéa, Chamechaude, le Grand Som, la Dent de Crolles, le Granier. Entre ces deux dernières montagnes, apparaissait le lac du Bourget, dominé à gauche par la chaîne du Mont-du-Chat, à droite par la Dent de Nivolet et le massif des Beauges. Des brumes nous dérobaient la vue du Jura, de la vallée du Rhône et de Lyon. Mais, à la droite des Beauges le Mont-Blanc, qui nous montrait sa plus haute cime et les Aiguilles Verte et du Dru, cachait dans les nuages ses autres Aiguilles. Les montagnes de la Suisse, du Piémont et de la Savoie comprises entre le Mont-Blanc et les Grandes Rousses étaient trop enveloppées de nuages pour que nous pussions bien distinguer leurs profils, et parvenir à les reconnaître. M. Antonin Macé, qui a été plus heureux que nous[1], croit avoir vu le Mont-Rose et le Saint-Gothard, le Grand Saint-Bernard, le Mont-Iseran, le Petit Saint-Bernard, le Mont-Thabor et le Mont-Cenis. Je serais désolé de le contredire, car il fait autorité. Cependant il m'est difficile d'admettre que, du sommet de Belledonne, on aperçoive le massif du Saint-Gothard. À l'est, au contraire, le ciel était encore libre de nuages. Nous dominions la vallée de l'Eau-d'Olle au fond de laquelle se tapissaient (p. 379) quelques hameaux, et la vallée de l'Oisans; mais, ce que j'admirais surtout, parce que ce grand et magnifique spectacle était complètement inattendu, c'étaient les glaciers des Grandes Rousses qui nous faisaient face quand nous nous retournions du côté de l'est ou du sud-est. Leur étendue m'étonnait; rarement, même en Suisse, j'avais eu sous les yeux une masse aussi imposante de glaciers. Plus au sud, le massif du Pelvoux, non moins richement couvert de neiges et de glaces éternelles, attirait et retenait également notre attention. Enfin, en continuant à nous tourner du sud à l'ouest, nous cherchions et nous parvenions à distinguer, au milieu d'un monde de montagnes inconnues, Taillefer, le Mont-Aurousse, l'Obiou, le Mont-Aiguille à la forme si caractéristique (voir la gravure de la page 380), le Grand Veymont, la Moucherolle, le massif de Saint-Nizier, les chaînes de l'Ardèche, du Vivarais, du Forez....
Oui, l'homme est trop petit, ce spectacle l'écrase;
Il sent, dans les transports de sa première extase,
Sa raison s'égarer.
En vain il veut parler, sa voix tremblante expire;
Ébloui, haletant, il regarde, il admire,
Et se prend à pleurer.
II
Le Dauphiné.
L'ascension de Belledonne est donc, comme le récit qui précède essaye de le prouver, l'une des courses les plus intéressantes que les touristes puissent entreprendre dans toute la chaîne des Alpes. Sans aucun danger, facile même, elle montre les hautes montagnes sous tous leurs aspects, depuis la région des vignes jusqu'à celle des neiges éternelles, avec leurs climats de la Provence et de la Sibérie, leurs cultures aussi variées que leurs climats, leurs forêts d'essences diverses, leurs pâturages d'été, leurs rochers sillonnés par la foudre, leurs torrents impétueux, leurs lacs suspendus au-dessus des abîmes, leurs solitudes glacées. C'est là un tableau complet, d'autant plus admirable qu'un très-petit nombre de pics offrent un panorama aussi étendu et aussi beau. Cependant l'ascension de Belledonne était bien rarement faite à l'époque où je résolus de la tenter; aucun ouvrage publié, soit à Paris, soit dans le Dauphiné, ne la recommandait ou ne l'indiquait, et les voyageurs qui allaient de Grenoble à Chambéry, ignoraient même, en traversant la vallée du Graisivaudan, le nom de cette remarquable montagne; ils couraient où court toujours la foule, qui n'aime pas les aventures nouvelles, aux pics de la Savoie ou de la Suisse, dont la réputation était déjà plus qu'européenne. Depuis 1853, il est vrai, grâce surtout à MM. Maisonville, l'intelligent éditeur de la Revue des Alpes, et Antonin Macé, professeur d'histoire à la faculté des lettres de Grenoble[2], Belledonne, enfin mieux connue, est plus souvent visitée; mais sa renommée n'a guère dépassé les limites de la province dont elle sera toujours l'une des principales merveilles. Le Righi, ou telle autre montagne de la Suisse, est au contraire aussi célèbre sur les bords du Mississippi, de l'Amazone, du Gange ou du Volga, que sur les rives de la Tamise ou de la Seine.
Je visitais un jour l'établissement thermal de la Motte sous la conduite d'un vieux médecin qui se montrait fort peu satisfait des impressions que trahissaient ma physionomie et mon langage. Son mécontentement était tel qu'il était prêt à dépasser les bornes de la politesse.
«Mais enfin, monsieur, me criait-il aux oreilles d'un ton aigre et ironique dont le sens caché ne m'échappait pas, comment voulez-vous juger notre vallée en vous bornant à la traverser? Il faudrait pour la connaître y passer au moins huit jours.... Ce pays-ci, monsieur, ajouta-t-il (en donnant à sa voix un accent qui signifiait, je le compris fort bien: Vous êtes un sot, en trois lettres, mon fils), ce pays-ci est bien plus beau que la Suisse.
—Connaissez-vous la Suisse? lui répondis-je avec le plus grand calme.
—Non, monsieur, mais....»
Il allait continuer, je l'interrompis.
«Il n'y a pas de mais, toute discussion serait inutile entre nous. J'ai fait, moi, de nombreux voyages en Suisse et j'ai sur vous l'immense avantage de juger par comparaison. La Suisse, croyez-moi, est plus belle que votre beau pays.»
Il n'en crut rien; mais, le saluant le plus poliment que je pus, je l'abandonnai à ses folles illusions.
Non, le Dauphiné n'est pas aussi beau que la Suisse, car aucune région du globe ne peut rivaliser avec ce petit coin de terre où la nature semble avoir pris plaisir à réunir toutes ses plus surprenantes beautés, mais le Dauphiné est la plus belle partie de la France; il l'emporte de beaucoup sur le Jura et sur les Pyrénées, il l'emporte même sur l'Auvergne et le Velay qui ont cependant un caractère plus accentué, plus original, plus saisissant. Il possède une grande vallée et des gorges que la Suisse elle-même pourrait lui envier; quelques-uns de ses glaciers étonnent par leur magnificence et par leur étendue les touristes qui reviennent de l'Oberland bernois ou de Chamonix. Si les versants de ses montagnes sont parfois trop arides, trop dépouillés, les forêts qu'ils ont heureusement conservées peuvent encore montrer des arbres merveilleux de force, d'élévation, de couleur; il donne naissance à de grandes rivières dont les affluents forment dans leurs vallées d'admirables cascades; ses eaux minérales guérissent ou soulagent un nombre considérable de maladies; le poisson et le gibier y abondent; son sol recèle des mines qui enrichiront un jour une population plus industrieuse et plus éclairée; ses principales sommités présentent à ceux qui les gravissent d'immenses et splendides panoramas; son ciel a parfois déjà les teintes chaudes de latitudes plus méridionales; enfin sa plus haute cime, voisine du Pelvoux, le point culminant de la France entière, atteint quatre mille cent mètres au-dessus du niveau de la mer.
(p. 380)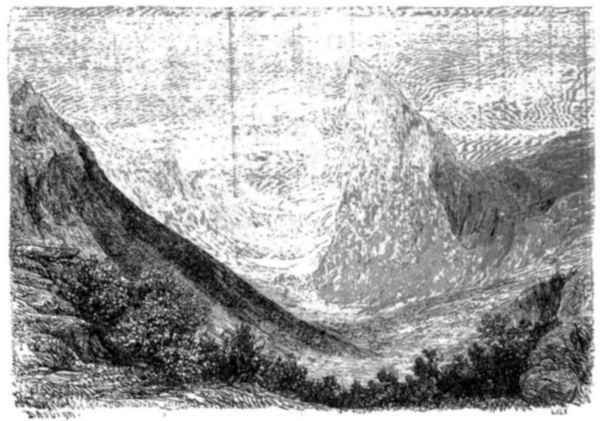
Le Mont-Aiguille vu de Clelles.—Dessin de Daubigny d'après M. A. Muston.
Si cette grande et belle province de l'ancienne France, presque rivale de la Suisse et de la Savoie, supérieure à tous égards aux Pyrénées, est beaucoup moins connue et surtout plus rarement visitée, c'est, il faut le dire, la faute de ses habitants. Non-seulement les Dauphinois n'avaient jamais rien su faire, ni livres, ni chemins, pas même des auberges, pour attirer et retenir les étrangers dans leur pays (c'est à peine s'ils ont le sentiment de sa beauté), mais ils ne font même rien pour s'y plaire eux-mêmes. La plupart des familles nobles et riches y habitent des masures à demi ruinées, dont les prétendus parcs ressemblent à des vergers de fermes mal entretenus. Cet abandon, dans lequel on laisse les maisons décorées du nom de châteaux, frappent au premier aspect les observateurs les plus superficiels. Où la propreté la plus vulgaire manque complétement, il serait insensé de chercher le confortable. Les cours, les corridors, les escaliers de la moitié au moins des maisons de Grenoble étaient encore en 1860 des dépôts publics d'immondices. Cet état de choses qui indigne les étrangers, la population ne le voit pas, ne le sent pas; elle s'y est accoutumée. Les habitants des villes, à plus forte raison les paysans, n'ont guère plus de soin de leur personne que de leurs demeures. Il y a sans doute des exceptions, et de nombreuses, mais ces trop justes reproches s'adressent à l'immense majorité. Entrez-vous dans une auberge? vous avez peine, si affamé que vous soyez, à vaincre la répugnance que vous inspirent l'aspect et l'odeur de la salle où l'on vous introduit. Avant la découverte de la poudre insecticide, dont l'inventeur est un Dauphinois, et dont l'usage n'est pas encore assez répandu, tous les lits étaient de véritables ménageries. Montez-vous dans une voiture? les coussins sont déchirés, les vitres cassées, les portières brisées; heureux surtout si vous n'avez pas pris une place de coupé, car trois rustres, puants et grossiers, viennent s'asseoir devant les ouvertures par lesquelles vous espériez admirer le paysage, et, non contents de vous priver d'air et de lumière, vous envoient au visage.... la fumée de leur mauvais tabac. L'incurie des administrations est encore plus inconcevable que l'apathie des habitants; je n'en citerai qu'un exemple; il suffira. À six kilomètres de Grenoble, se trouve, sur la rive gauche de l'Isère, un village qui doit sa réputation aux fromages qu'il ne fabrique pas, et aux curiosités naturelles qu'il a le bonheur de posséder sur son territoire. C'est Sassenage. Ces curiosités vraiment belles,—des Cuves, c'est-à-dire des grottes d'où sort un torrent, des cascades et de beaux points de vue,—y attirent chaque année un grand nombre de Dauphinois et d'étrangers, qui enrichissent, ou du moins qui aident à vivre par leurs dépenses, une partie de la population. Eh bien! le croirait-on? la commune de Sassenage n'a jamais eu l'idée de faire quoi que ce soit dans son intérêt pour faciliter aux visiteurs l'accès des Cuves. Le sentier de la rive droite du Furon est d'une roideur désespérante; celui de la rive gauche devient tellement impraticable (p. 382) que les chèvres hésiteraient à y passer. D'ailleurs, aucun pont ne réunit les deux rives du Furon et du torrent qui sort des Cuves. Des enfants vous apportent, il est vrai, des planches qu'ils jettent devant vous sur les cours d'eau, mais ces planches sont étroites, mal consolidées, humides, glissantes; il est presque dangereux de s'y aventurer. La belle cascade du Furon reste invisible pour ceux qui ne risquent pas leur vie sur le sentier de la rive gauche. Personne à Sassenage n'a eu l'esprit et la prévoyance de couper les branches des arbustes qui la dérobent aux regards. Nulle part, en Europe, on ne trouverait, en vérité, des populations et des administrations plus insouciantes. J'ai raconté, peut-être un peu trop longuement, mon ascension de Belledonne, mais les détails dans lesquels je suis entré avaient pour but de montrer combien il est pénible, impossible même de voyager actuellement encore dans le Dauphiné. En effet, on y manque de livres, de moyens de transport, de guides, d'auberges, de mulets, de provisions, de propreté, en un mot, de tout ce que l'on trouve surabondamment en Suisse, et même dans certaines parties de la Savoie et des Pyrénées.
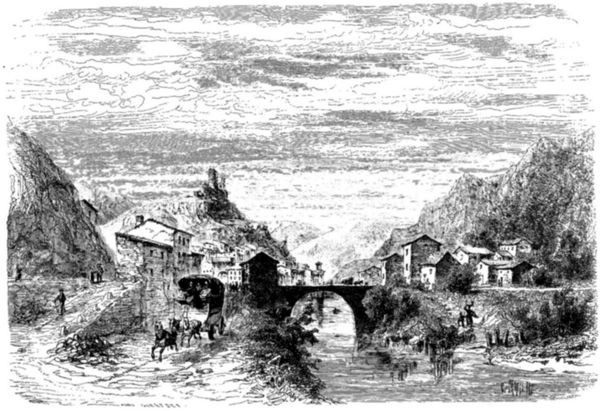
Pontaix.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Les livres ne tarderont pas à venir. Ils sont déjà venus, grâce aux chemins de fer. Les publications à l'usage des voyageurs, si rares autrefois, abondent déjà aujourd'hui. La Revue des Alpes, fondée par M. Maisonville, imprimeur libraire, l'Écho du Dauphiné et du Vivarais, publié par M. Merle, et qui se décidera bientôt à s'occuper des deux belles provinces dont il a pris les noms pour se faire un titre, les excellents itinéraires de M. Antonin Macé[3], les guides aux Sept-Laux et à la Grande Chartreuse de M. Jules Taulier, les travaux géologiques de M. Lory, les remarquables monographies de MM. Aristide Albert et Roussillon sur l'Oisans, ont déjà appelé l'attention publique sur les principales curiosités du Dauphiné. Les belles photographies de M. Baldus, de Paris, et de MM. Muzet et Bajat, de Grenoble, ont produit des résultats aussi heureux pour les contrées qu'elles reproduisent que pour leurs habiles et consciencieux éditeurs. Enfin, en attendant la publication de l'Itinéraire du Dauphiné et des Alpes maritimes, pour lequel je me suis assuré la collaboration de MM. Élisée Reclus et A. Muston, j'ai obtenu de MM. le directeur et les éditeurs du Tour du Monde trois livraisons de cette belle et intéressante publication afin de faire connaître à leurs nombreux abonnés ou souscripteurs les régions les plus rarement explorées ou les moins souvent décrites des départements de l'Isère et de la Drôme.
Toutefois la publicité ne suffira pas pour attirer dans ce beau pays les armées de touristes qui partent chaque année de toutes les capitales du monde civilisé et vont envahir la Savoie, la Suisse, les Pyrénées. Il faut absolument que la population se décide à tenter quelques efforts d'amabilité, de politesse et surtout de propreté en faveur des étrangers. Les dépenses matérielles resteront peut-être improductives pendant une assez longue période, mais peu à peu, les pertes seront couvertes et les bénéfices augmenteront chaque année. Toute la question est là. Les voyageurs s'empresseront d'accourir dans le Dauphiné dès qu'ils seront certains d'y trouver ce qu'ils vont chercher ailleurs: bon souper et bon gîte. Si j'avais eu l'honneur d'être directeur de la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, j'aurais immédiatement convoqué tous mes actionnaires et je leur aurais tenu à peu près ce langage: «Messieurs, autorisez-moi à construire à vos frais vingt hôtels modestes, confortables, propres, aux prix modérés, dans vingt localités désignées par une commission spéciale, puis, les constructions achevées, les cuisiniers à leurs fourneaux, les sommeliers à leur poste,—sans habit noir et sans cravate blanche,—j'annoncerai au monde entier cette grande nouvelle par toutes les voies de la publicité, et je vous promets que vos recettes ne tarderont pas à s'augmenter dans une proportion qui vous étonnera.» Et si, au lieu d'être directeur, j'avais eu la chance d'être simplement actionnaire, j'aurais battu des mains à une semblable proposition et voté avec enthousiasme des remercîments au directeur qui aurait eu l'heureuse idée de me la soumettre.
Aujourd'hui rien n'est encore fait, sauf, je le répète, quelques bons livres de MM. Antonin Macé, Lory, Taulier, A. Albert, Roussillon, etc. Les auberges manquent presque partout; les guides sont rares, les voitures publiques impossibles, les chemins souvent impraticables, les habitants peu empressés. Qu'importent cependant toutes ces petites misères de la vie humaine aux touristes qui aiment la grande et belle nature des Alpes, si leur âge et leur santé leur permettent de braver tous les ennuis, de surmonter toutes les difficultés: qu'ils aillent donc visiter le Dauphiné; ils y seront amplement récompensés de leurs privations et de leurs fatigues; ils auront en outre la satisfaction d'y faire de véritables découvertes. Certaines régions de notre belle France n'ont encore été explorées par aucun voyageur, décrites dans aucun livre. Le massif de la Grande Chartreuse lui-même, si rapproché de Grenoble, n'est fréquenté que sur deux ou trois points. Les massifs du Villard-de-Lans, de Belledonne, des Grandes Rousses, du Pelvoux, du Dévoluy, et tant d'autres dont l'énumération serait trop longue, attendent encore leur de Saussure. Je n'ai pas la prétention d'indiquer ici aux voyageurs futurs toutes les vallées, toutes les montagnes, tous les passages du Dauphiné qui me semblent vraiment dignes d'une exploration; je veux seulement, pour piquer leur curiosité, dans leur intérêt, leur montrer, avec l'aide du crayon de M. A. Muston et de nos plus habiles artistes, Français, Karl Girardet, Daubigny, etc., quelques-unes de ses curiosités naturelles les plus pittoresques et les moins connues.
III
Les Goulets.
Du sommet de Belledonne transportons-nous à Pont-en-Royans, à l'entrée des Goulets. La course est un peu (p. 383) longue, mais rien de plus charmant, rien de plus beau même que le pays que l'on parcourt de Grenoble à Pont-en-Royans. Ce pays en effet est la vallée du Graisivaudan. Le chemin de fer vous conduit d'abord à Moirans, où vous prenez une diligence qui, en, quelques heures, vous mène à Saint-Marcelin en suivant, sans la côtoyer toutefois, la rive droite de l'Isère. On peut du reste prendre aussi la route de la rive gauche, non moins pittoresque, non moins intéressante. C'est un enchantement continuel, une succession ininterrompue de paysages toujours divers, le paradis des artistes dauphinois. Plus on descend la vallée de l'Isère, plus la nature change d'aspect et de couleur; il semble que l'on ait franchi les Alpes et que l'on soit déjà parvenu sur le versant italien; on se rapproche sensiblement du Midi. Les montagnes se sont abaissées, il est vrai, mais toutes les teintes de la terre et du ciel sont plus vives, les contrastes entre les rochers et la verdure plus saisissants; si la végétation n'a pas plus de force, elle a évidemment plus d'éclat. Paysagiste, je préférerais le Royannais à la vallée du Graisivaudan. En quelque lieu que l'on se place, on a sous les yeux un tableau trop complet et trop parfait pour qu'on ait besoin d'y modifier un ton ou une ligne.
Pont-en-Royans est un chef-lieu de canton de mille quatre-vingt-douze habitants, situé à trois cents mètres au-dessus de la mer, sur un torrent appelé la Bourne qui descend du Villard-de-Lans par la vallée de la Choranche. Quand je dis sur, c'est pour parler la langue des géographes; cette expression, qui doit se traduire par «au bord de,» manque ici complétement de vérité. Jetez, en effet, les yeux sur le dessin de M. Doré qui reproduit une belle photographie de Baldus (page 373), et vous conviendrez sans peine que au-dessus donnerait une idée plus juste de la position extraordinaire qu'occupe l'ancienne capitale du Royannais. La plupart de ses maisons, soutenues par des échafaudages aussi pittoresques que les constructions, dominent, à une grande élévation, les belles eaux de la Bourne dont les excellentes truites servent trop souvent de régal aux aigles pêcheurs domiciliés dans les rochers voisins. Autrefois l'unique rue de Pont-en-Royans était bordée d'un côté par les habitations ainsi suspendues au-dessus de l'abîme, et de l'autre par le rocher. Peu à peu on a enlevé une partie du rocher, et des maisons se sont bâties sur l'emplacement ainsi conquis à l'aide du pic et de la poudre; d'autres, plus pressées ou plus hardies, ont grimpé sur les terrasses supérieures, s'étageant en amphithéâtre partout où il y avait une place assez large pour les supporter. Bref, il serait difficile de trouver, non-seulement dans le Dauphiné, mais dans toute la France, un lieu plus incommode à habiter. Pourquoi l'a-t-on donc choisi? me demanderez-vous. La solution de ce problème n'est, hélas! que trop facile à trouver: c'est que l'espèce humaine a autant de vices que de vertus. Elle s'est installée, fortifiée dans ce défilé pour se défendre plus facilement contre des attaques injustes ou méritées. Les anciens souverains du Royannais étaient probablement, comme tant d'autres, des brigands de grand chemin qui de temps en temps s'élançaient de leur repaire, aujourd'hui ruiné et presque aussi inaccessible que les aires des aigles, leurs voisins, leurs maîtres ou leurs émules, pour aller piller dans les plaines du Rhône les voyageurs obligés de traverser leur territoire. Au dix-huitième siècle, quand la royauté eut interdit toute déprédation à la noblesse féodale, l'industrie drapière, libre de se développer sans crainte, prit un grand développement à Pont-en-Royans. Toutes les fabriques qui ont fait jadis la prospérité et la gloire de ce bourg ont cessé d'exister; les habitants que n'occupe pas la culture des terres tissent de la soie ou tournent des boules et d'autres objets de bois. La civilisation moderne a pénétré toutefois dans cette gorge sauvage et pittoresque; une partie de la rue est garnie de trottoirs; bientôt même on plantera sur les promenades publiques, à l'instar de Paris, des arbres tout venus, emmaillottés, avec des cuvettes, et qui, après avoir végété deux années, rendront leur dernière sève dans les derniers mois de la troisième année, toujours comme à Paris.
La Bourne, qui passe sous le pont auquel l'ancienne capitale du Royannais a dû la première partie de son nom, descend d'une vallée étroite, rocheuse, pittoresque, bien digne d'une exploration complète; toutefois nous n'y jetterons qu'un coup d'œil en passant; notre but c'est la vallée de la Vernaison, surtout la partie de cette vallée qui se trouve comprise entre les Grands et les Petits Goulets.
La Vernaison prend sa source au sud-est du village du Rousset près du col, haut de huit cent quatre-vingt-onze mètres, auquel ce village a donné son nom, coule du sud au nord, arrose une vallée supérieure longue de seize kilomètres environ, large à peine d'un kilomètre, reçoit au-dessous du village de Tourtres les eaux d'un petit affluent descendu par Saint-Martin de Saint-Julien, et, inclinant au sud-ouest, pénètre dans une montagne calcaire par une fissure étroite et profonde qu'elle a eu la patience de creuser, et où, jusqu'à ces dernières années, elle s'était promis de passer toujours seule. Ce défilé franchi, elle bondit capricieusement dans une petite vallée appelée la vallée des Échevis, et fermée à son extrémité inférieure comme à son extrémité supérieure. Elle a triomphé de ce nouvel obstacle en employant le procédé qui lui avait déjà si bien réussi; elle l'a scié, qu'on me permette cette expression. À peu de distance de ce second défilé, elle se jette dans la Bourne, au-dessus de Pont-en-Royans. Ces deux passages curieux, dont l'entrée était jadis interdite à l'homme, s'appellent les Grands et les Petits Goulets (de goulots). Les deux vallées supérieures de la Vernaison, ainsi que les montagnes qui les dominent, forment la région désignée par les géographes sous le nom de Vercors.
Adolphe Joanne.
(La suite à la prochaine livraison.)
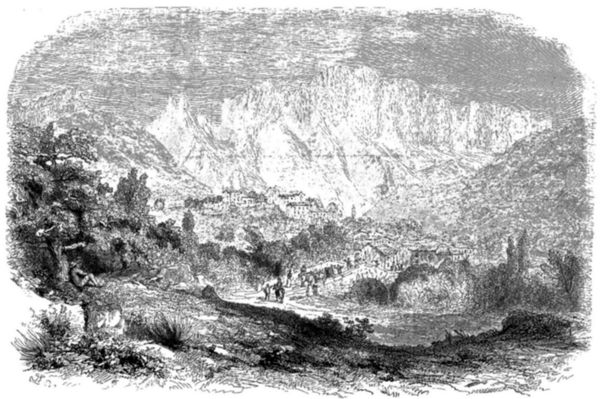
Roumeyer et le mont Glandaz.—Dessin de Français d'après M. A. Muston.
(p. 385)
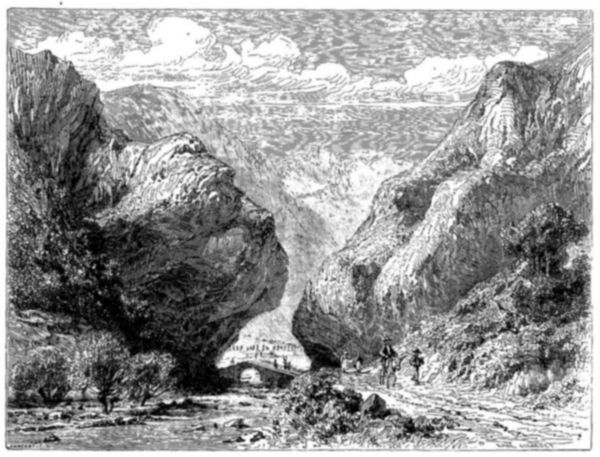
Entrée de la vallée de Roumeyer.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Le Vercors et le Royannais, distants de dix ou douze kilomètres à peine, ne pouvaient communiquer ensemble que par les montagnes qui les séparaient. Il fallait, parvenu à l'entrée des Grands ou des Petits-Goulets, escalader la montagne de l'Allier, s'élever jusqu'à plus de mille deux cents mètres et redescendre. Le sentier était escarpé, difficile, dangereux même, surtout du côté de Pont-en-Royans, au-dessous du col de Chatelus. On avait dû tailler çà et là des degrés dans les rochers, tant la pente était roide. Chaque année, malgré cette précaution, des mulets tombaient avec leur chargement dans les précipices. L'hiver, les communications devenaient souvent impossibles. Elles étaient en toute saison si lentes, si pénibles, si coûteuses, que le Vercors se dépeuplait; les habitants ne pouvant tirer parti, faute de voies de communication, des richesses naturelles de leur territoire qui se trouvait enfermé de tous côtés entre des montagnes trop difficiles à franchir.
Dès l'année 1829, des ingénieurs avaient conçu le hardi projet d'ouvrir une route de voitures dans ces deux massifs de rochers à travers lesquels la Vernaison avait su se creuser patiemment un passage, dont elle s'était, avec un égoïsme bien digne d'un châtiment exemplaire, réservé la jouissance exclusive. Ces projets, plusieurs fois abandonnés et repris, furent enfin approuvés par l'administration départementale. L'adjudication des travaux eut lieu le 9 septembre 1843, et, en 1851, la Vernaison, justement humiliée, vaincue, punie, vit enfin passer avec elle et au-dessus d'elle, non-seulement des piétons et des mulets, mais des voitures, dans ces deux défilés où elle se riait si orgueilleusement depuis tant de siècles des fatigues et des dépenses qu'occasionnait à la population du (p. 386) Vercors et des Échevis le voyage de Pont-en-Royans. Cette route serait à elle seule une des merveilles du Dauphiné, quand bien même les gorges qu'elle traverse ne mériteraient pas une égale admiration.
Le pont de Pont-en-Royans franchi, on gravit une rue étroite, pittoresque, à l'extrémité supérieure de laquelle on découvre, en se retournant, l'ancienne capitale du Royannais dominée par les ruines de son vieux château. La route redescend alors dans une petite vallée que la Vernaison ravage trop souvent, comme pour donner une dernière preuve de sa force avant de mêler ses eaux à celles de la Bourne. Cette vallée traversée, on en remonte la rive gauche à travers d'agréables vergers, et bientôt on aperçoit en face de soi, au-dessous d'un vaste cirque de montagnes chenues, l'ouverture ou plutôt la sortie des Petits-Goulets qu'on ne tarde pas à atteindre. Le torrent s'élance, en formant une petite cascade, d'une fente étroite entre deux parois de roches calcaires presque perpendiculaires, dont quelques maigres bouquets d'arbustes, venus on ne sait comment sur la pierre, font ressortir les teintes grisâtres. Pour faire passer des voitures dans ce défilé où l'homme n'avait jamais mis le pied, les ingénieurs ont dû employer le pic et la mine, et percer la montagne. Cinq tunnels, longs de soixante-dix mètres, soixante-quinze mètres, vingt-cinq mètres, soixante-quinze mètres et quarante-cinq mètres environ, s'y succèdent à des distances inégales. Dans les intervalles la route est en certains endroits protégée contre les éboulements des parois supérieures par le rocher qui surplombe, taillé en forme de berceau. De ces galeries, on voit, à cent cinquante mètres au-dessous de soi, la Vernaison dont les eaux rapides et écumeuses continuent à creuser leur lit profondément encaissé. Sur la rive opposée se dresse une montagne calcaire, non moins curieuse par ses formes que par sa couleur, et dans laquelle s'ouvre une sorte de grotte naturelle d'une configuration singulière. Au delà du quatrième tunnel on est sorti de la gorge des Petits-Goulets pour entrer dans cette vallée d'Échevis qui, avant le percement de la route actuelle, ne pouvait communiquer que par les montagnes avec les vallées voisines. Ce n'est pas un paradis terrestre assurément; elle est même un peu trop nue; mais, au débouché de ce défilé rocheux, et toujours un peu sombre bien qu'il soit assez large, on revoit déjà avec plaisir le ciel et la verdure. Les premières pentes de la vallée sont couvertes de champs et de vignes, parsemées de mûriers, de châtaigniers et de noyers. On y désirerait plus de gazon et plus d'arbres. Au-dessus des terrains cultivés s'étendent de vastes forêts dominées par des rochers à pic, que couronnent ça et là des bouquets de sapins. L'ensemble est gracieux mais un peu froid.
Après être descendue par une pente douce au bord de la Vernaison, la route traverse ce torrent sur un pont de pierre d'une seule arche, puis monte aux Grands-Goulets le long et au-dessus de la rive droite. La longueur de cette rampe est de cinq mille cinq cents mètres; sa pente moyenne de cinq centimètres par mètre. À quinze minutes du pont se trouvent le presbytère et l'église, entourés de quelques maisons. Les autres habitations de le commune, assez éloignées l'une de l'autre, se cachent sous les arbres à fruits qui les protègent pendant l'été des rayons trop ardents du soleil. Les figues y mûrissent en plein vent et la vigne exposée au midi y produit un vin estimé. En gravissant cette longue rampe, presque toujours tracée en zigzag, on découvre sous tous ses aspects la vallée d'Échevis, dont le calme profond, et l'isolement complet, maintenant plus apparent que réel, font rêver une longue retraite dans ses solitudes les plus boisées avec un petit nombre d'amis préférés.
Quand on a atteint le dernier lacet, à une hauteur de six cents mètres environ au-dessus de la mer, de trois cents mètres au-dessus de la sortie des Petits-Goulets, on commence seulement à apercevoir l'entrée des Grands-Goulets, car la vallée, dans sa partie supérieure, incline légèrement à l'est. Le paysage prend alors un caractère plus grand et plus alpestre. Toute culture a disparu. D'immenses parois de rochers, ici grises, là jaunâtres, dominent la route d'où l'on découvre comme d'une terrasse la Vernaison qui se brise en écume à une grande profondeur contre les blocs de pierre qui interceptent son cours. Sur la rive gauche, de beaux massifs de pierre, aux formes et aux accidents bizarres, se dressent presque à pic au-dessus de bois escarpés. Avant de pénétrer dans la gorge mystérieuse dont on ne voit encore que l'ouverture, il faut traverser un premier tunnel de soixante mètres environ de longueur. Ce souterrain est précédé et suivi de remarquables travaux d'art. Sur ce point, en effet, le rocher surplombait tellement que toute base manquait aux ingénieurs; ils durent donc creuser dans cette paroi,—plus éloignée à son extrémité inférieure qu'à son extrémité supérieure de la paroi qui lui fait face,—des trous profonds destinés à recevoir les barres de fer qui supportent le tablier de la route; espèce de pont latéral ainsi suspendu sur l'abîme. Tout en admirant l'œuvre de la nature, on ne peut s'empêcher de songer avec émotion à l'audace et à l'adresse qu'ont déployées dans ce curieux passage les ouvriers mineurs pour accomplir la tâche difficile et périlleuse dont ils s'étaient chargés. On les descendait du haut de la montagne au fond, ou plutôt au milieu, du précipice, avec des cordes auxquelles étaient attachés deux bâtons en croix qui leur servaient de siége. Sur ce frêle support, ils flottaient en l'air comme des moucherons suspendus à un fil, et se balançaient au-dessus du torrent, essayant d'atteindre, dans un de leurs élans, sous l'espèce de grotte que formait le rocher, une aspérité assez saillante pour qu'ils pussent s'y cramponner. Après avoir ainsi conquis, au risque de leur vie, une base solide d'opérations, ils y plantaient un crochet de fer auquel ils s'amarraient, et commençaient aussitôt à creuser des trous de mines. «Les mineurs qui préparaient ainsi les chantiers avaient acquis une telle habitude de ce genre de travail, a dit un des ingénieurs, que, vers la fin de l'entreprise, ils ne prenaient même plus la peine, quand ils avaient mis le feu à une mèche, de faire remonter la corde à laquelle (p. 387) ils étaient attachés; ils se contentaient de frapper le rocher du pied avec assez de force pour aller presque toucher la paroi opposée, et, pendant cette émouvante excursion dans le vide, la mine avait le temps de produire son effet; à leur retour, tout danger avait disparu. Une fois, cependant, une pierre coupa, comme l'eût fait un couteau, la corde de l'un de ces imprudents travailleurs qui tomba dans l'abîme, d'où ses camarades ne retirèrent quelques heures après qu'un cadavre défiguré.»
À partir de ce point, les travaux d'art se multiplient tellement, que leur simple énumération deviendrait fastidieuse. Ce ne sont plus que tunnels, galeries, encorbellements, pour me servir de l'expression technique. La gorge se rétrécit. De distance en distance on aperçoit au fond de l'abîme, à cent cinquante mètres au-dessous de soi, dans une sinistre obscurité, l'écume blanche de la Vernaison qui continue sans repos son œuvre de percement; d'autres fois on entend mugir le laborieux torrent sans le voir, tant les ténèbres où il se cache sont profondes. Des deux côtés de la route, entre les tunnels, se dressent, à une grande hauteur, de magnifiques rochers aux superbes teintes d'un gris bleuâtre, complètement dépourvus de végétation, et dont les échos répètent incessamment les plaintes lamentables des eaux. Ici, une petite cascade tombe en se jouant capricieusement dans le gouffre qui dérobe ses derniers ébats aux regards du voyageur attristé de sa fin précoce; là, des tapis de mousse et des bouquets d'arbustes voilent avec un art charmant la nudité trop crue de la pierre; ailleurs, dans un détour, on embrasse d'un coup d'œil la gorge que l'on a déjà parcourue et celle où l'on va s'engager. Le passage le plus saisissant est celui que représente notre dessin (voir la page 372). On s'est rapproché du torrent qui se calme ou plutôt qui n'est pas encore devenu furieux; mais les deux parois se resserrant encore plus, on pourrait craindre qu'elles ne finissent par se toucher. Il a fallu faire passer la route de la rive droite sur la rive gauche. Au delà du pont, les tunnels, devenus plus nombreux, se succèdent à de plus courts intervalles. Même dans le milieu du jour, quand le ciel est sans nuages, une faible lumière se glisse à peine à travers les branches des arbustes qui sont parvenus à croître sur les escarpements des rochers que l'homme a su percer aussi pour s'ouvrir un passage. Si le soleil a disparu derrière un épais rideau de vapeurs, une nuit presque complète règne au fond de cette solitude où la voix gémissante du torrent couvre tous les autres bruits de la terre. On ne peut se défendre d'une émotion indéfinissable.... Malgré les beautés merveilleuses de ce paysage, peut-être unique, on se sent presque fatigué d'admirer; on éprouve le besoin de respirer un air plus libre, de revoir le soleil, des arbres, de la verdure, des êtres animés; on se trouve heureux enfin quand, au sortir d'un dernier souterrain, on débouche dans une vallée supérieure brillamment éclairée, dont les versants boisés sont éloignés l'un de l'autre de plus d'un kilomètre, et dont les terres cultivées témoignent de la présence de l'homme.... À deux cents mètres plus loin, en se retournant, on aperçoit à peine dans la montagne l'ouverture des Grands-Goulets, à demi cachée par des guirlandes de broussailles....
IV
Les gorges d'Omblèze.
Des Grands-Goulets, on peut aller à Die par la Chapelle-en-Vercors, le col de Rousset et Chamaloc; mais la route de voitures n'est pas encore terminée, car on doit percer un tunnel de quatre cents mètres dans la montagne de Rousset. Si intéressante d'ailleurs que soit cette route, il me faut suivre mon habile dessinateur, M. A. Muston, par un autre chemin plus curieux pour les artistes. Cette fois nous partirons, non de Pont-en-Royans, mais de Saint-Jean-en-Royans, chef-lieu de canton de deux mille sept cent trente et un habitants, qui n'est éloigné de Pont que de deux heures à pied, et qui appartient déjà au département de la Drôme.
Saint-Jean-en-Royans n'a de remarquable que sa situation sur la Lyonne, les trois arbres de liberté—des peupliers—qui ombragent l'abondante fontaine de sa place principale, et ses magnifiques noyers dont les produits s'exportent à l'étranger, surtout dans le nord de l'Europe.
À une heure environ de Saint-Jean, quand on a dépassé Oriol et Saint-Martin-le-Colonel, la vallée de la Lyonne, moins riante et plus resserrée entre des montagnes plus hautes, devient plus pittoresque et plus sauvage. Bientôt elle se bifurque. Du sud descend la Lyonne de Bouvante: notre route remonte, en se dirigeant au sud-ouest, la Lyonne de Léoncel, qui roule ses belles eaux dans une longue gorge droite, presque partout stérile et nue. Jadis d'admirables forêts couvraient entièrement ces pentes aujourd'hui dépouillées de végétation; mais ils sont depuis longtemps tombés sous la hache du bûcheron, tous les arbres qui, abattus et transportés dans la plaine, pouvaient produire le plus faible bénéfice. L'exploitation de ceux qui restent debout sur des hauteurs d'un accès difficile serait trop coûteuse, aussi les respecte-t-on encore.
Cette gorge un peu triste aboutit à un vallon également nu, mais tapissé en partie de belles prairies, au milieu desquelles s'épanouit à l'aise le petit village de Léoncel, peuplé seulement de quatre cent quarante-cinq habitants (voy. la gravure, p. 388). Une abbaye de l'ordre de Citeaux avait été fondée au douzième siècle dans ce vallon alors entièrement boisé. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines, assez belles toutefois pour avoir mérité d'être classées parmi les monuments historiques de la France. Les derniers débris de l'église, entretenus avec soin, servent de succursale. Un autre village, situé sur notre route, à deux kilomètres de Léoncel, témoigne encore par son nom de l'importance qu'eut cette antique abbaye: il s'appelle la Vacherie. Les moines avaient en effet établi sur ce point une grande ferme dont le nom seul a subsisté.
À cent mètres environ de la Vacherie, on voit se développer (p. 388) sur la droite une route de voitures qui décrit de longs lacets. C'est la route de Chabeuil par Peyrus. Bien que nous allions à Die, c'est-à-dire dans une direction opposée, nous descendrons pendant quelques instants cette route pour contempler l'admirable vue que l'on découvre du haut des pentes abruptes qui dominent la grotte ou balme du Pialoux (voy. p. 389).
Des rochers aux formes étranges, tapissés de plantes rares, ombragés ça et là de pins sylvestres ou de pins maritimes, composent le premier plan du tableau; sur le second, des collines de sable et de gravier, entièrement nues, ondulent comme les vagues d'une mer furieuse. Au delà de cette ligne jaunâtre, la Véoure déroule ses rubans argentés à travers une plaine accidentée et couverte d'une luxuriante végétation, où tous les tons du vert, habilement fondus, forment un harmonieux ensemble. À l'extrémité de cette mer de verdure, le Rhône, à demi perdu dans les vapeurs de l'horizon, apparaît ça et là au pied de la chaîne des montagnes du Forez et de l'Ardèche, que l'on découvre depuis les vignobles de Saint-Péray jusqu'aux cimes du Mezenc et du Gerbier-de-Joncs. Parmi les innombrables maisons blanches qui surgissent comme des îlots du sein des flots d'arbres, on distingue surtout les groupes plus importants qui portent les noms de Romans, Chabeuil et Valence.

La vallée de Léoncel.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Remontons maintenant à la Vacherie pour gagner, par un chemin qui n'est pas encore praticable aux voitures, le vallon des Pêcheurs, d'où nous irons explorer les gorges d'Omblèze. D'abord le vallon est trop cultivé ou trop aride; mais bientôt le sentier, pittoresquement taillé en escalier dans les corniches ébréchées des rochers, descend le long du ruisseau qui, transformé en torrent impétueux, bondit en écume de gradin en gradin, jusqu'à ce qu'il forme une jolie cascade, la «Grande pissoire,» plus importante mais moins gracieuse que la «Petite pissoire.» Ces cascades ne sont pas visibles tous les jours, je dois en avertir les touristes; même quand les eaux sont abondantes, elles disparaissent complètement, car elles servent à l'irrigation des prairies supérieures. Il serait donc inutile de les chercher sur ma recommandation; on ne les trouverait pas aux heures où elles sont condamnées, pour remplir leur fonction fécondante, à se montrer plus utiles qu'agréables. Lorsqu'elles ont la liberté de se faire admirer, elles se jettent dans la Gervanne, qui arrose les célèbres gorges d'Omblèze.
Ces gorges, où nous sommes parvenus, ont environ quatre kilomètres de longueur; mais on passerait, sans en regretter une seule minute, une journée entière à les parcourir. Elles sont, en effet, tellement variées de formes et d'aspects qu'à chaque pas que l'on y fait elles offrent un paysage nouveau. Leur largeur moyenne est de cent (p. 389) vingt et cent cinquante mètres; et parfois le torrent y dispute à la route l'espace dont il a besoin. Ces jeux, ces caprices de la nature, sont aussi charmants qu'extraordinaires. Ce qui donne aux parois de cette gorge un aspect tout particulier, ce sont les gracieux bouquets de verdure qui les décorent; de toutes les fentes, de toutes les corniches, pendent de vigoureux arbustes ou des fleurs odorantes. Le cri du pluvier domine par moments les murmures des eaux et les bruissements du feuillage. Tous les sens sont ravis à la fois. Comme le moine de la légende dont le sommeil dura mille ans, on oublierait aisément les heures dans cette gorge solitaire, à contempler les tableaux qui s'y déroulent incessamment aux regards, à respirer les senteurs embaumées des plantes, à écouter les chants des oiseaux.
Le charme cesse toutefois si l'on continue trop longtemps sa promenade; la gorge s'élargissant prend une direction droite, les rochers qui s'abaissent perdent leurs formes pittoresques, la culture reparaît. Dans le fond de ce bassin vulgaire se dresse la montagne d'Ambel aux pentes rapides, aux flancs déchirés, à la base de laquelle se tapit le village d'Omblèze qui a donné son nom à la vallée. Mais, si au lieu de continuer à remonter le ruisseau, nous le descendons, d'autres curiosités nous attendent.

La vallée de la Véoure et la plaine du Rhône vues des hauteurs de la Vacherie.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Peu de temps, en effet, après être sortie des gorges d'Omblèze, la Gervanne, parvenue sur le bord d'un escarpement de quarante mètres de hauteur environ, s'élance d'un bond dans l'abîme où ses eaux, tout à l'heure si calmes sous un épais berceau de saules, se brisent en écume avec le bruit de la foudre. Cette belle cascade se nomme la Druïse. Quelle description pourrait valoir la gravure qu'en ont faite, d'après un dessin de M. A. Muston, MM. Français et Lavieille (voir page 393)?
Au-dessous de la Druïse, la vallée de la Gervanne, plus large, devient par conséquent moins intéressante; mais, en revanche, deux curieuses montagnes en forment les deux versants: l'une, celle de la rive gauche, domine le village d'Ansage qui lui a pris son nom; l'autre, celle de la rive droite, s'appelle le Velan et porte sur ses flancs herbeux et boisés le village de Plan-de-Baix. Ces deux montagnes se distinguent de toutes celles que nous avons vues jusqu'ici par les crêtes abruptes, les arêtes vives des grands et beaux rochers arides de leur sommet; quand le soleil les dore de ses plus chauds rayons, leur couleur éclatante fait un contraste saisissant avec les teintes, plus foncées et plus pâles tout à la fois, des tapis de gazon ou des bois qui s'étendent en pente douce de leur base jusqu'au fond de la vallée.
Le Velan ne doit pas seulement nous attirer par lui-même de son côté, bien qu'il ne soit pas sur notre route. Au-dessus et au-dessous de Plan-de-Baix, nous avons, comme en témoigne la gravure de la page 394, deux (p. 390) excursions à faire: l'une au château de Montrond, l'autre aux sources du Ruïdoux. Le château de Montrond, dont l'histoire m'est restée inconnue, malgré mes recherches, n'est plus qu'une ruine entourée de vieux arbres. On y arrive par un plateau d'un accès facile, d'un aspect riant, mais, des fenêtres de la façade opposée à celle de la porte d'entrée, on domine les rochers abrupts et sauvages au pied desquels coule la Gervanne. Le Ruïdoux est un ruisseau qui sort d'une grotte à la base d'un escarpement aride, et qui coule dans une gorge profonde que côtoie la route de Beaufort. Ce chef-lieu de canton (voir la gravure de la page 392) est trop éloigné de Plan-de-Baix pour que nous allions le visiter. D'ailleurs, la route n'est pas seulement longue, elle manque d'intérêt; et Beaufort, qui n'a conservé que des débris insignifiants de son ancien château fort et de ses vieilles fortifications, n'aurait rien à nous montrer que sa belle situation au-dessus de l'étroite vallée de la Gervanne. Retournons donc à la Druïse et franchissons la Gervanne, près des moulins, pour monter, par une pente assez roide et rocailleuse, au hameau d'Ansage, puis, au delà d'un petit plateau, sur la montagne de Birchos, que la carte du Dépôt de la guerre appelle les Berches.
Après avoir dépassé plusieurs petits vallons gazonnés, on contourne l'extrémité supérieure d'un bassin plus considérable et plus profond, la vallée d'Eyglui ou du Cheylard, et, laissant cette vallée à sa droite, on monte par des terrains rocailleux jusqu'à un petit col d'où l'on aperçoit tout à coup sous ses pieds une autre vallée, celle dans laquelle nous allons descendre par le hameau des Petites-Vachères. Cette vallée, c'est la vallée de Quint. La Suze, qui l'arrose et qui se jette dans la Drôme à Sainte-Croix, prend sa source au Pas de l'Infernay dont le signal atteint dix-sept cent trois mètres. L'attention est surtout attirée par les montagnes, très-extraordinaires de formes et de couleurs, au-dessus desquelles se dressent dans le lointain le mont Glandaz et le grand pic de Saint-Géniz. «C'est, en effet, selon l'expression pittoresque de M. A. Muston, qui les a aussi bien décrites que dessinées, une véritable bataille de montagnes, saisie dans son tumulte et immobilisée dans son mouvement le plus impétueux.» (Voir la gravure de la page 377.)
À l'entrée de la vallée de Quint où nous nous dirigeons, s'élève une colline isolée qui semble la barrer, et dont la Suze est obligée de contourner la base avant de pouvoir se jeter dans la Drôme. Cette colline, qui porte le village de Sainte-Croix, a joué un rôle important dans l'histoire militaire du Diois. Le château fort en ruines que l'on aperçoit à son sommet (voir la gravure de la page 376) avait été bâti par les Romains pour protéger leurs communications sur la route de Vienne à Milan, qui traversait le mont Genèvre, et mettre en même temps Die, la capitale des Voconces (dea Vocontia), à l'abri d'une attaque des peuplades voisines. Il appartint longtemps aux empereurs d'Occident. En 1215, l'empereur Frédéric II le donna aux évêques de Saint-Paul-Trois-Châteaux; mais, vers la fin du treizième siècle, la maison de Poitiers le possédait. Pendant les guerres de religion, les catholiques et les protestants l'occupèrent tour à tour. Ces derniers le gardèrent jusqu'à la prise de la Rochelle. Richelieu, les en ayant expulsés, le fit démolir. Sa forte position témoigne seule maintenant de son importance passée, car les ruines ne se composent que de quelques fragments de murailles. Le vaste bâtiment qui attire les regards au milieu du village de Sainte-Croix n'est point un château moderne, construit dans une situation plus facilement abordable après la destruction de la vieille forteresse romaine et féodale; c'est un couvent d'Antonins, supprimé avant la Révolution, et dont les biens avaient été donnés à l'ordre de Malte. Des belles terrasses de ce monastère, transformé en ferme, on découvre une jolie vue sur la vallée de la Drôme, qui décrit une courbe elliptique de Sainte-Croix jusqu'à Pontaix.
Pour aller visiter Pontaix (voir la gravure page 380), situé à deux kilomètres en aval de Sainte-Croix, il nous faudrait descendre la vallée de la Drôme en suivant la rive gauche de la rivière. Nous allons au contraire la remonter jusqu'à Die. D'ailleurs Pontaix est aussi mal bâti et aussi malpropre que pittoresquement situé.
Le petit bassin qui commandait la forteresse de Sainte-Croix aboutit, en amont de l'embouchure de la Suze, à un défilé au sortir duquel on découvre devant soi le vaste et beau bassin de Die (voir la gravure de la page 377). Nous revoyons de plus près et mieux dégagées quelques-unes des montagnes que nous avons déjà remarquées au col des Vachères. Le mont Glandaz se distingue entre toutes ces montagnes par son étendue, sa forme et sa couleur. On chercherait en vain dans toute la chaîne des Alpes une masse de rochers aussi étrangement singulière. Elle ressemble en effet à une immense forteresse flanquée de tours et de bastions. À la gauche de ces hautes parois verticales qui dominent le Val Croissant, caché derrière un chaînon de collines, se dressent les deux pointes de la Dent de Die, au pied de laquelle passe la route du Monêtier de Clermont; le Grand-Weymont se montre quand le temps est clair au-dessus du pic de Chamaloc. Enfin, au delà du plateau supérieur du Vercors, le pic de Saint-Génix, dont le signal atteint quatorze cent soixante-six mètres, domine la vallée de Quint.
V
Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou.
Die est, à certains égards, une ville heureuse entre toutes les villes: elle occupe une agréable situation, sous un climat tempéré, dans une vallée aussi riante que fertile; elle contemple à son aise de belles montagnes assez éloignées de son territoire pour qu'elle n'ait jamais à souffrir de leur ombre; une rivière suffisamment abondante l'arrose; ses vignes produisent un petit vin blanc, une clairette justement célèbre, qui, au charme piquant du Champagne mousseux, unit un caractère plus inoffensif. Elle possède un assez grand nombre d'antiquités pour se distraire à perpétuité par l'étude de ces respectables débris du passé, quand elle sera rassasiée de tous les bienfaits (p. 391) dont la nature s'est plu à la combler; et cependant cette cité, trop favorisée du ciel, n'a jamais joui d'un bonheur complet. Au lieu de se laisser vivre au jour le jour, en admirant les délicieux et beaux paysages qui les entouraient de toutes parts, en dégustant, dans un doux far niente, sous leurs fraîches tonnelles, l'excellent vin qu'ils avaient l'inappréciable chance de pouvoir récolter sans trop de fatigue, en se livrant même, si l'envie les en eût pris, à des discussions historiques et archéologiques, ses habitants n'ont jamais laissé échapper une occasion de se quereller, de se battre, de s'égorger; que dis-je? dès qu'elle leur manquait, ils s'empressaient de la faire naître. L'homme est trop souvent inquiet, maladroit, pour ne pas dire sot, envieux, entêté, vindicatif, dominateur. L'histoire de Die servira-t-elle de leçon à d'autres villes? J'en doute; mais, pour justifier mes reproches, je vais essayer de la raconter le plus brièvement que je pourrai.
Ce n'est pas l'étymologie du nom de la ville qui a divisé la population en deux ou plusieurs camps rivaux. Cette étymologie, malgré les savants, paraît à peu près certaine. Die vient de dia, c'est-à-dire de dea, en français déesse. Sous les Romains, pour ne pas remonter plus haut, cette ville était consacrée à Cybèle, la déesse ou la bonne déesse, à laquelle elle rendait un culte particulier. Les Voconces ou Vocontiens,—on appelait ainsi les habitants de la vallée de la Drôme et d'autres vallées voisines,—avaient alors la passion des tauroboles, sacrifices des taureaux. C'était une distraction assez sauvage, comme vous allez en juger. Il fallait être singulièrement Voconce pour se complaire à de pareils divertissements. Ne désirant nullement me faire un mauvais parti dans la Dea Vocontiorum, j'emprunte les renseignements suivants à Millin, et je déclare solennellement que je lui en laisse toute la responsabilité:
«On creusait une grande fosse où descendait le prêtre qui devait faire l'expiation; il avait une robe de soie, une couronne sur la tête et des bandelettes. Le plancher de la fosse était percé de plusieurs trous. Le sang de la victime arrosait le prêtre qui devait se retourner pour le recevoir partout; alors chacun se prosternait devant lui, comme s'il représentait la divinité. Ses habits ensanglantés étaient conservés avec un respect religieux. Le taurobole était donc une expiation, un baptême de sang: on le renouvelait tous les vingt ans. Les femmes recevaient cette régénération comme les hommes.»
Aujourd'hui encore, on trouve à Die cinq autels tauroboliques bien conservés; d'autres, dont les inscriptions sont parvenues jusqu'à nous, ont été détruits; mais ces inscriptions et les autels qui restent suffisent pour témoigner de la sottise et de la brutalité de ses anciens habitants. Du reste, les tauroboles ne sont pas les seules antiquités de Die. «Il est peu de villes, dit le savant auteur de la Statistique de la Drôme, M. Delacroix, où l'on remarque un aussi grand nombre de monuments anciens, d'inscriptions, de colonnes et de bas-reliefs. Beaucoup de ces fragments sont employés dans des bancs et des chambranles de portes et fenêtres. La porte de Saint-Pierre, par laquelle on arrive à Die, en venant de Saillans, est un reste de construction romaine. On y voyait autrefois une inscription portant que Sextus Vencius Juventianus, prêtre augustat, agrégé au corps des citoyens et élevé à la dignité de sénateur de Lyon, etc., avait obtenu des Vocontiens les honneurs d'une statue, à cause de sa grande libéralité pour les spectacles et les jeux publics. À gauche, hors de la même porte, est un lieu vulgairement appelé palat: on croit que c'est l'emplacement de l'ancien palais. Un peu plus loin, et tout près des remparts, on remarque des restes de murailles en forme d'hémicycle, qui font conjecturer que ce sont les ruines d'un théâtre. À quelque distance de là, on reconnaît les vestiges des aqueducs qui amenaient à Die les eaux de la vallée de Roumeyer et du Val Croissant. La porte Saint-Marcel, avec ses deux tours, est un arc de triomphe auquel furent ajoutées, dans le moyen âge, des constructions qui contrastent avec ce qui reste de cet ancien édifice.... Les belles colonnes de granit qui forment le péristyle de l'église cathédrale et celles qui supportent les voûtes supérieures des divers étages du clocher ont évidemment appartenu à des monuments antiques.... De tous côtés, on a découvert des bas-reliefs, des mosaïques, des inscriptions....»
Die, s'étant convertie au christianisme dès le troisième siècle, renonça sans doute à ses pratiques païennes, mais elle s'était trop habituée aux sacrifices des taureaux pour se priver du plaisir de verser ou de voir couler le sang. À défaut de taureaux, elle immola des hommes. Ses évêques et ses comtes s'en disputant incessamment la possession, elle prit parti tantôt pour les évêques, tantôt pour les comtes, afin de satisfaire à discrétion ses appétits de bête fauve. Aussi grand fut son mécontentement lorsque, en 1201, l'intervention du dauphin du Viennois, Guignes André, vint mettre un terme à une lutte civile qui durait depuis des siècles. Sous le prétexte assez spécieux, je l'avoue, de revendiquer les droits naturels ou les priviléges dont l'avaient dépouillée ses seigneurs ecclésiastiques, la population se souleva, et, ce qui est beaucoup moins excusable, se permit, sans doute pour s'entretenir la main, de massacrer son évêque, Humbert, devant l'une des portes de la cathédrale, appelée depuis cette époque la porte rouge. Ce sacrifice d'un prélat, substitué, malgré le progrès général de l'humanité, à celui d'un taureau, eut lieu le 3 novembre 1222. Il devait être et il fut inutile. Humbert mort, Amédée lui succéda, et le comte de Valentinois, investi du fief des anciens comtes, lui déclara la guerre. Toutes ces querelles impatientèrent à la fin le pape Grégoire X, qui, pour en finir, employa un moyen moins violent, mais plus sûr que celui dont s'était servi jadis la populace: au lieu de supprimer l'évêque (Amédée venait de mourir), il supprima l'évêché qu'il réunit à celui de Valence (1275). Le remède fut, hélas! pire que le mal. Les chanoines et les habitants, ligués ensemble, s'insurgèrent aussitôt contre le titulaire des deux évêchés, et le contraignirent à confirmer leurs privilèges. Les chanoines avaient leur petite armée de mercenaires qui (p. 392) se battaient contre leurs adversaires, quels qu'ils fussent; quand ils se sentaient assez riches pour augmenter le nombre de leurs soldats, ils essayaient à leur tour de se rendre indépendants et d'asservir les bourgeois. C'était un tohu-bohu souvent impossible à comprendre. Cependant, après s'être tour à tour administré de sévères leçons, le chapitre et le peuple firent définitivement cause commune, et, n'étant pas assez forts pour triompher seuls de leur évêque, se donnèrent d'abord au pape, puis, cet appui leur ayant manqué lorsque le pape dut quitter Avignon, au dauphin, roi de France, Charles VI. Ainsi, dès les premières années du quinzième siècle (1404), le Diois fut réuni au Dauphiné.

Beaufort.—Dessin de Français d'après M. A. Muston.
Les querelles politiques apaisées, Die resta quelque temps tranquille; mais les passions religieuses ne tardèrent pas à lui procurer les émotions fortes dont elle s'était montrée si avide pendant tant de siècles. Les catholiques et les protestants s'en emparèrent à tour de rôle, et y commirent d'odieux excès. Toutefois, la population plus éclairée commençait à se lasser de tous ces plaisirs sanglants. Quand l'édit de Nantes lui rendit la paix et lui garantit la liberté de conscience, elle employa toutes ses facultés à son développement physique, intellectuel et moral. Elle s'accrut en s'enrichissant par l'industrie et le commerce, et en s'efforçant d'augmenter le petit trésor de ses connaissances. Ses fabriques étaient renommées au loin; on enseignait même les langues orientales dans son académie protestante. Malheureusement la révocation de l'édit de Nantes vint l'arrêter dans son essor. La moitié de ses habitants émigrèrent, et c'étaient, comme partout, les plus intelligents, les plus instruits, les plus industrieux. Elle ne s'est jamais relevée de ce coup fatal. Bien que Louis XIV lui eût rendu un évêché séparé que la Révolution a supprimé, aujourd'hui elle ne compte que trois mille neuf cent douze habitants. Elle est plus commerçante qu'industrielle, et on lui reproche de falsifier trop souvent, par amour du lucre, cette clairette qui lui a valu jadis une certaine réputation. Malgré ces petites tricheries sur la nature et la qualité des produits qu'elle livre à la consommation, elle s'est évidemment améliorée; elle donne complétement raison aux défenseurs de la doctrine incontestable du progrès.

Cascade de la Druïse.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Die a conservé une partie de ses anciennes murailles, flanquées de tours, mais son église cathédrale, saccagée par les protestants, a été reconstruite au dix-septième siècle, telle qu'elle est aujourd'hui; aussi offre-t-elle peu d'intérêt. Les antiquaires y sont généralement plus heureux que les archéologues, car ils y trouvent un grand nombre de fragments de colonnes, de pierres sculptées, de mosaïques, et ils peuvent en outre s'y procurer la satisfaction de déchiffrer, de copier, de traduire, de commenter cinquante-six inscriptions, sans compter celles qui sont encore enfouies dans les murailles ou sous le sol actuel, et qu'ils pourraient parvenir à déterrer s'ils les cherchaient (p. 394) bien. Parmi les touristes affligés de douleurs rhumatismales, plus d'un se félicitera d'être venu à Die et d'y avoir passé quelques jours, soit dans l'établissement du docteur Chevandier, soit dans celui du docteur Benoît, au Martouret. Les bains de vapeur résineuse, inventés par les paysans des environs et perfectionnés par ces habiles praticiens, ont, en effet, pour résultat presque infaillible de soulager et même de guérir les diverses variétés de ces maladies, aussi cruelles qu'inconnues, que la médecine désigne sous le nom général de rhumatisme.

Le Velan et le Plan-de-Baix vus des sources du Ruïdoux.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Les environs de Die sont agréables à visiter. L'une des vallées les plus intéressantes est celle de Roumeyer, qui s'ouvre au nord et à peu de distance de la ville. L'entrée en est étrangement pittoresque (voir la gravure de la page 385). Si les rochers qui la forment s'avançaient encore un peu l'un vers l'autre, ils se toucheraient dans leur partie supérieure, en laissant au-dessous de ce pont naturel un passage suffisant pour la rivière et la route. Ce curieux défilé franchi, on voit s'étendre devant soi une jolie vallée, riche en prairies, bordée de collines boisées, que dominent les crêtes bizarres, majestueuses et nues du mont Glandaz (voir la gravure de la page 383). Si, après avoir traversé le village, on continue à suivre le ruisseau en le remontant, on ne tarde pas à atteindre la source ou plutôt les sources de ce cours d'eau. Au pied d'un grand rocher de poudingues, dont une verdure variée décore toutes les fentes, jaillissent, entre les pierres, la mousse et le gazon, quatre sources limpides qui ne tarissent jamais....
Descend-on au contraire la vallée de la Drôme de Die à Valence, on traverse, avant d'atteindre la petite ville de Crest, le bourg d'Aouste (on prononce Oste), ancienne colonie romaine, connue jadis sous le nom d'Augusta. Les habitants de ce bourg, dont le nombre dépassera bientôt deux mille, ont assez d'esprit pour vivre en bonne intelligence, bien que la moitié de la population professe la religion catholique et l'autre moitié la religion protestante. Une route nouvelle, encore inachevée, et qui partira d'Aouste, doit relier dans une dizaine d'années la vallée de la Drôme à celle de l'Aygues par la forêt de Saou et Bourdeaux. Cette route s'appelle la route du Pas de Lauzun. Elle doit ce nom à un défilé assez semblable à ceux que nous avons déjà admirés dans les Goulets, dans les gorges d'Omblèze et à l'entrée de la vallée de Roumeyer. Le passage est étroit: les rochers semblent vouloir se rejoindre au-dessus de la route, taillée au ciseau en encorbellement ou en corniche. Le ruisseau fait une jolie chute au fond de la gorge. Ce chemin, attribué à tort ou à raison aux Romains, n'a jamais été honoré, que je sache, de la visite de ce favori de Louis XIV qui épousa en secret la petite-fille de Henri IV. S'il porte ce nom fameux, c'est qu'on exploite dans le (p. 395) voisinage une carrière de grandes pierres plates que les paysans appellent des lauzes.
À peine a-t-on dépassé le seuil de cette singulière porte naturelle, que l'on entre dans une petite vallée étroite mais verdoyante, où le ruisseau qui l'arrose, et qui descend des hauteurs de Roche-Colombe, paraît se plaire à folâtrer. On serait volontiers tenté de l'imiter. De jeunes bois taillis couvrent les deux versants qu'ombrageaient jadis des forêts séculaires. Le calme est profond, l'air embaumé: le thym, la lavande, le serpolet abondent sur les rochers où un charmant oiseau, le grimpereau des murailles, aime à faire son nid. Que de lieux obscurs et solitaires ravissent ainsi le voyageur qui voudrait s'y fixer pour longtemps, quelquefois même pour toujours, s'il lui était permis d'y vivre entouré de ceux qu'il aime, mais qui passe, comme le torrent ou le nuage, sans pouvoir s'arrêter au gré de son caprice, emportant avec ses souvenirs la triste certitude de ne jamais les revoir! Heureusement pour lui les tableaux nouveaux que la nature lui offre incessamment adoucissent l'amertume de ses regrets en lui inspirant d'autres désirs non moins vifs et aussi vite oubliés!
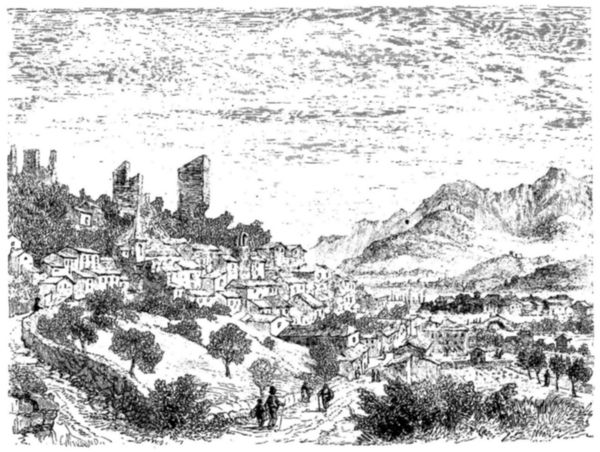
Bourdeaux.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Lorsqu'on est parvenu au sommet de la colline que gravit la route, on traverse un petit plateau cultivé, au delà duquel on voit s'ouvrir devant soi le bassin extraordinaire qui porte le nom de forêt de Saou (on prononce Sou). Ce bassin présente en effet, sur une longueur de douze à treize kilomètres, et une largeur moyenne de cinq à six (j'emprunte ces chiffres à M. Delacroix), la forme d'un immense vaisseau; à l'extérieur, des rochers à pic en forment la carène; à l'intérieur, il offre des pentes inclinées, autrefois couvertes d'arbres magnifiques qui lui ont fait donner le nom de forêt. Cette colossale corbeille contient aujourd'hui des habitations, des terres labourables, des prés, d'abondants pâturages et quelques bouquets de bois en décorent l'extrémité exposée au nord ou les hauteurs. Une mine de charbon y a été exploitée sans succès. On n'y pénètre que par deux grands portails naturels qui s'ouvrent, l'un, au nord, du côté d'Aouste, l'autre, au sud, vers le village de Saou; ces deux portails pourraient se fermer comme les portes d'une ville. Les eaux qui y tombent ou qui y jaillissent y forment le ruisseau de Vèbre, qui en sort par le portail du défilé méridional. De tous les rochers dont elle est entourée, le plus haut, le plus abrupt, le plus déchiré est celui qu'on appelle Roche-Courbe ou des Trois-Becs. De ce rocher on découvre un vaste et curieux panorama.
La forêt de Saou, la plus belle forêt de la Drôme, appartenait autrefois à une abbaye, dont il ne reste actuellement que des ruines insignifiantes. Elle est aujourd'hui possédée presque entièrement par M. Crémieux, avocat au barreau de Paris (voir la gravure de la page 397). (p. 396) À l'époque où les moines l'habitaient, ils y jouissaient de la société des lynx et des aigles qui y prospéraient également. Le dernier lynx a été tué en 1820, mais les aigles y sont encore nombreux. Ces oiseaux de proie y déploient une habileté qui dénote une certaine intelligence. Comme ils ne se sentent pas assez forts pour enlever des moutons vivants, ils se précipitent sur ceux qui paissent au bord d'un rocher, les frappent à coups d'ailes, les effrayent de leurs cris et les font tomber dans les précipices où ils peuvent dépecer en paix leurs cadavres sanglants. Quant aux renards, qui sont moins faciles à surprendre et à épouvanter, ils les saisissent avec leurs serres, les emportent à une grande hauteur, elles laissent tomber sur le rocher le plus escarpé et le plus aigu de la forêt. Si leur victime ne meurt pas de la première chute, ils recommencent l'opération et la continuent ainsi jusqu'à ce qu'elle réussisse, car ils ont grand'peur de la morsure des renards blessés.

Poët-Cellard.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
Dès qu'on a atteint à peu près le milieu de cet étrange bassin, on voit s'entr'ouvrir à droite les rochers qui le forment, sur l'un des points où ils sont le plus élevés. La route s'engage avec le ruisseau dans cette profonde fissure appelée le Pas de Saou. En en sortant on se trouve dans une petite vallée, couverte de prairies où ne croît aucun arbre, où nulle habitation ne s'est construite, tant les vents qui s'y engouffrent dans les jours de tempête y soufflent avec violence. Ce désert a environ deux kilomètres de longueur. À son extrémité inférieure se montre le petit village de Saou, qui avec les hameaux voisins compte environ mille habitants. Un piton isolé le domine. Un château du seizième siècle, flanqué de tourelles, a été, comme l'abbaye, transformé en ferme....
Au delà de Saou, je pourrais aller visiter le Pas de Lestang, le vieux château de Poët-Cellar, Bourdeaux, dont notre dessinateur, M. A. Muston, l'auteur de l'Histoire des Vaudois, est l'un des ministres protestants (voir la gravure de la page 395); enfin la Gorge de Trente-Pas (voir la gravure de la page 400), etc. Mais il me faut retourner à Grenoble pour monter à la Grande Chartreuse.
Durant ce petit voyage à travers le département de la Drôme, je ne me suis occupé que de la nature; jamais je n'ai parlé des habitants. La raison de mon silence est bien simple: il n'y a rien à en dire. Les paysans drômois ressemblent aux paysans de tous nos départements, beaucoup trop nombreux, dont la population a perdu son originalité primitive. Ils n'ont aucun caractère physique qui leur soit propre; leurs qualités ou leurs défauts, leurs vertus ou leurs vices ne se distinguent plus par aucun trait saillant; leur costume est aussi vulgaire de forme et de couleurs que leur habitation. Enfin s'ils emploient encore entre eux un patois imagé et sonore:
Véci lou djoli mé di mai
Qui lous galans plantan lou mai,
N-en plantaré iun à ma mïo,
Saro plus iaut qui sa tiolino,
(p. 397) ils parlent le français avec les étrangers, et ils le comprennent tous. On ne court même plus la chance d'éprouver, en visitant leur curieux pays, des impressions de voyage semblables à celle que racontait Racine à son ami la Fontaine en 1661, dans son voyage de Paris à Uzès.
«J'avais, dit-il, commencé dès Lyon à ne plus guère entendre le langage du pays, et à n'être plus intelligible moi-même. Ce malheur s'accrut à Valence, et Dieu voulut qu'ayant demandé à une servante un pot de chambre, elle mit un réchaud sous mon lit. Vous pouvez vous imaginer les suites de cette maudite aventure, et ce qui peut arriver à un homme endormi, qui se sert d'un réchaud dans ses nécessités de nuit....»
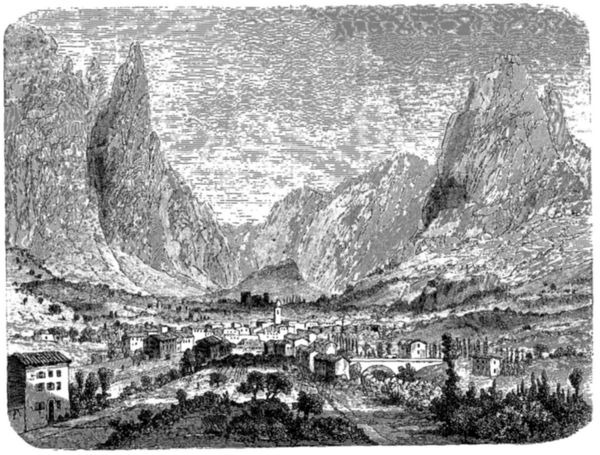
La forêt de Saou.—Dessin de Sabatier d'après M. A. Muston.
VI
Le col de la Cochette.
Une nuit du mois dernier, à mon retour de Grenoble, je fis un rêve singulier. Un Génie venait de me donner un talisman qui me permettait de ressusciter un mort pendant vingt-quatre heures. Mon choix avait été bientôt fait. J'étais allé, sans perdre une minute, réveiller le grand saint Bruno au fond de sa tombe, et je l'avais prié de m'accompagner incognito à la Grande-Chartreuse. Je me promettais une joie enfantine de jouir de ses surprises; tout ce qu'il verrait, tout ce qu'il entendrait, seulement le long du chemin, lui causerait, me disais-je, un tel étonnement qu'il refuserait d'en croire ses yeux et ses oreilles. Nous eûmes ensemble la conversation suivante, dès que nous approchâmes de Fourvoirie:
SAINT BRUNO. Dites-moi, je vous prie, mon cher guide, quel est ce grand bâtiment qui s'élève sur la droite de notre route?
MOI. C'est un entrepôt de liqueur.
SAINT BRUNO. Où donc est la fabrique?
MOI. À la Grande-Chartreuse.
SAINT BRUNO. Vous voulez plaisanter.
MOI. Nullement, mon révérend père. Les Chartreux, vos descendants, fabriquent actuellement des liqueurs, et de fort bonnes, je vous assure. La recette est leur propriété. J'ignore à quelle époque et par qui ces liqueurs, dont la réputation, très-justement méritée, est répandue dans le monde entier, ont été inventées; mais je sais qu'il entre dans leur composition de petits œillets rouges, de la mélisse, de l'absinthe, et aussi de jeunes bourgeons de sapin. Il y en a de trois espèces: la verte, la jaune et la blanche. La verte est la plus forte, la blanche la plus faible; généralement on préfère la jaune. La consommation s'accroît chaque année, et les Chartreux retirent maintenant de cette fabrication des bénéfices considérables.
SAINT BRUNO. Cela n'est pas possible....
MOI. Permettez-moi de vous interrompre. Tout est (p. 398) possible à notre époque. Ne jugez pas les Chartreux de 1860 avec vos idées, vos sentiments et vos habitudes du onzième siècle. Les temps sont bien changés. D'ailleurs cette industrie était devenue, depuis la Révolution, une nécessité pour le couvent, car les moines furent alors dépouillés de toutes leurs propriétés. Ils ne possèdent plus aujourd'hui que de vastes bâtiments d'un entretien fort coûteux et d'un rapport complètement nul. Pour subvenir à toutes leurs dépenses, et plus encore pour secourir les malheureux qui ne sollicitent jamais en vain leur pitié, ils ont dû se créer des ressources: ils se sont faits liquoristes. Qui pourrait les en blâmer? Ne croyez pas d'ailleurs qu'ils s'occupent eux-mêmes de la fabrication, de la vente et de l'expédition de leurs liqueurs. Ce sont des domestiques salariés qui sous la direction d'un frère, s'acquittent de tous ces soins matériels.
SAINT BRUNO. Tout ce que vous m'apprenez me semble trop extraordinaire. Mais, où va cette voiture remplie de jeunes gens et de jeunes femmes et qui paraît suivre le même chemin que nous?
MOI. À la Chartreuse.
SAINT BRUNO. À la Chartreuse!
MOI. Cela vous étonne. Écoutez-moi. Le désert n'est plus le désert. De votre temps, le Guiers passait seul dans cette gorge étroite qu'il avait creusée entre ces deux murailles de rochers. Un jour les Chartreux se lassèrent de suivre les mauvais chemins que vous aviez découverts en cherchant la solitude où vous vous étiez établi pour la vie. Nombreux d'ailleurs, il leur fallait absolument, à moins de se laisser mourir de faim, s'ouvrir des voies de communication plus faciles avec le reste du monde. Au commencement du seizième siècle, le trente-troisième général de l'ordre, dom Le Roux, se décida à profiter de l'exemple que lui avait donné le torrent; il fit tailler, à l'aide de la pioche et de la mine, dans l'un des rochers qui se dressaient à pic au-dessus du Guiers, un chemin praticable aux bêtes de somme; mais il eut le soin de se réserver l'usage exclusif de ce chemin. Le désert était tout à la fois ouvert et fermé à la volonté des Chartreux. Une double porte fortifiée, gardée par un portier fidèle, en interdisait l'entrée aux indiscrets et aux malfaiteurs. Si ce premier passage avait été forcé, il y en avait un autre d'un accès encore plus difficile et mieux défendu—la porte de l'Œillette—qui mettait, de ce côté du moins, le couvent à l'abri de toute attaque ennemie ou de toute invasion curieuse. D'ailleurs, ce chemin était rude, escarpé, souvent impraticable par le mauvais temps et depuis longtemps ouvert à tout venant. Il y a quelques années, l'État, devenu en 1789 propriétaire de la majeure partie des forêts qui couvrent encore les montagnes voisines de la Grande-Chartreuse, l'État, dis-je, résolut de rendre ce mauvais chemin praticable aux voitures. Un de mes bons amis, un homme de talent et de cœur, alors inspecteur des forêts, aujourd'hui bénédictin à Solesmes, M. Eugène Viaud, fut chargé de cette tâche difficile dont il s'acquitta avec autant d'habileté que de goût, avant d'embrasser la vie monastique. Cette voie nouvelle, encore plus pittoresque que l'ancienne, ne devait dans le principe servir qu'au transport des bois exploités. Mais à peine fut-elle ouverte que des voitures publiques et privées s'y aventurèrent; aujourd'hui des espèces d'omnibus font un service régulier entre Saint-Laurent-du-Pont et la Grande-Chartreuse. C'est une promenade dangereuse, parce que la route, trop roide encore à certains tournants, n'est pas bordée de garde-fous. De temps en temps une voiture roule dans l'abîme avec le cheval, le cocher et les voyageurs. N'importe, le lendemain la procession recommence de plus belle; on est curieux de voir, outre le désert et le couvent, l'endroit où l'événement a eu lieu. Chaque jour, pendant la belle saison, des centaines de personnes des deux sexes montent à la Grande-Chartreuse à pied, à mulet ou en voiture. Les uns en redescendent le même jour, les autres y passent la nuit.
SAINT BRUNO. Où donc, monsieur?
MOI. Dans le couvent, mon révérend père. Vos descendants se sont toujours distingués par leur hospitalité. En tout temps ils ont bien accueilli les fidèles ou les simples curieux qui venaient leur rendre visite. Depuis que le tourisme (excusez-moi, c'est un mot moderne que vous ne devez pas comprendre) est devenu à la mode, le nombre de leurs hôtes s'est accru dans une telle proportion que souvent ils sont fort embarrassés pour les loger. Une nuit de cette année, ils ont pu donner des lits à deux cent cinquante individus. L'entrée du couvent reste interdite aux femmes; elles dînent et couchent dans un bâtiment séparé habité par des religieuses. L'inconvénient grave de cette situation, c'est la nécessité où se voient aujourd'hui les Chartreux de recevoir indistinctement toutes les personnes qui se présentent à la porte du monastère. Or, parmi leurs innombrables visiteurs, se trouvent des individus indignes d'un tel honneur et qui en abusent! En outre, quand les Chartreux, privés désormais de toutes leurs propriétés productives, ont, pour ne pas déroger à leurs nobles habitudes, résolu d'accorder l'hospitalité à tous les étrangers, quelles que fussent leur nationalité, leur condition, leur religion, leur profession, leur moralité, ils ont dû forcément leur demander au départ une certaine rétribution. Cette rétribution est assurément toujours trop faible, mais les voyageurs mal élevés qui la payent sans réflexion, ceux surtout qui n'auraient jamais dû entrer dans ce saint lieu, s'imaginent trop souvent être par cela seul autorisés à faire entendre, comme dans une auberge, des réclamations exagérées ou des plaintes ridicules....
SAINT BRUNO. Aucun étranger ne devrait pénétrer dans le couvent, ni le jour ni la nuit.
MOI. Y pensez-vous, mon révérend père? Vous seriez actuellement à la tête de l'ordre que vous ne pourriez mettre ce principe en pratique. Vous refuseriez de recevoir, je le veux bien, les simples touristes qui viendraient seulement admirer les sévères beautés de la solitude où jadis vous avez dit au monde un adieu éternel; mais repousseriez-vous les fidèles dont les âmes souffrantes ou troublées auraient besoin de vos consolations (p. 399) et de vos conseils pour reprendre confiance en la bonté du Tout-Puissant et se raffermir dans la voie du devoir? Évidemment non. Comment choisir, d'après leur apparence extérieure, à moins d'être doué d'une intuition divine, entre tous ceux qui se présenteraient sous un prétexte ou sous un autre? Laisseriez-vous mourir de fatigue, de froid, de soif et de faim, sous les murs du monastère, le voyageur que la tempête, si fréquente dans vos montagnes, aurait surpris au milieu des forêts voisines, et qui, après avoir longtemps erré à travers les sapins, arriverait mouillé jusqu'aux os, épuisé d'émotions et d'efforts, mourant d'inanition, à l'asile où l'aurait guidé une lumière libératrice?... Je comprends et je respecte votre silence. Si vous n'osez pas me répondre, c'est que dans ces diverses circonstances, vous ouvririez votre demeure et votre cœur à tous ceux qui solliciteraient de votre bonté, de votre dévouement, un secours physique et moral. Écoutez le court récit que je vais vous faire et vous reconnaîtrez avec moi que vos successeurs sont vraiment dignes de vous.
Il y a quelques années, la cohue de badauds que l'on rencontrait déjà sur cette route, alors ouverte seulement aux piétons et aux bêtes de somme, avait fini par m'impatienter. Cette foule vulgaire, qui ne sait ni regarder ni comprendre la nature, ou qui n'a aucun sentiment religieux, et qui monte à la Grande-Chartreuse comme elle irait au parc d'Asnières, uniquement parce que c'est la mode d'y monter, me donnait des crispations de nerfs dont je souffrais trop pour pouvoir admirer les magnifiques tableaux que formaient, sous mes yeux ravis, les arbres, les rochers, la route et le torrent. Je résolus de chercher, pour mon pèlerinage annuel, un chemin moins fréquenté, fût-il moins beau. Un de mes bons amis du Dauphiné, le docteur E..., m'offrit de me conduire par les cols de la Charmette et de la Cochette. «Nous étions sûrs, me dit-il, de jouir, dans une solitude complète, des innombrables beautés de ce passage; car ce chemin, presque inconnu, est peu fréquenté, et le col escarpé de la Cochette ne peut être escaladé que par des piétons exercés aux courses de montagnes; les mulets ne sauraient y passer.» Je m'empressai d'accepter. Nous partîmes donc, accompagnés de sa femme et de ses deux filles. Malheureusement le docteur, qui est la personnification du dévouement, avait cru devoir sacrifier une partie de sa matinée à une pauvre femme malade. Il était neuf heures quand nous quittâmes le village de Saint-Robert, situé sur la route de Lyon, à six kilomètres de Grenoble, pour monter à Proveysieux. Plus malheureusement encore, nous rencontrâmes le curé de ce dernier village, et, malgré les protestations du docteur, qui avait déjà fait plusieurs fois cette belle course, il persuada à Mme E.... que trois heures devaient nous suffire pour aller à la Grande-Chartreuse; or, il nous en fallait au moins encore sept. On se reposa trop souvent pour jouir des paysages charmants et variés que nous offrit le chemin: là, un ruisseau qui bondissait de roche en roche, sous des arbres touffus, ou qui serpentait mélancoliquement à travers une jolie prairie; ici, des grottes nombreuses, percées dans les flancs arides d'une montagne chenue; derrière nous, au delà de la longue et gracieuse vallée de Proveysieux, entre le casque de Néron et Rochepleine, tout un monde de cimes lointaines; plus loin, au-dessous du col de la Charmette, un hardi promontoire de rochers tout couvert de sapins séculaires, comme l'abîme imposant qu'il domine; plus loin encore, un petit vallon solitaire, dont les herbes et les fleurs s'élevaient jusqu'à la ceinture. La montée du col de la Cochette fut un peu pénible. On se reposa; puis il fallut gravir une aiguille voisine pour découvrir un splendide point de vue. Au sortir des forêts, où le sentier est fort roide, on rencontre une si ravissante prairie qu'on est toujours tenté de faire une courte halte sur ses épais tapis de gazon. D'ailleurs n'est-il pas nécessaire d'achever ses provisions? À quoi bon se fatiguer plus longtemps à les porter? N'aperçoit-on pas les clochers du monastère? Le jour commence à baisser! Qu'importe? le couvent est en vue! pourquoi se presser? Nous ne hâtâmes donc point le pas, et, quand nous atteignîmes les prairies de Vallombrée, la nuit y était aussi arrivée. Nous avions à traverser, pour descendre au Guiers, une épaisse forêt de sapins. À peine nous fûmes-nous engagés sous cette voûte sombre que le sentier nous manqua. Nous nous jetâmes sur la gauche, afin de ne pas prendre à droite un chemin qui devait nous conduire à la porte du désert. Le lit alors desséché d'un torrent nous parut être le sentier que nous cherchions. Nous le descendîmes, mais nous ne tardâmes pas à reconnaître notre erreur; car nous étions obligés de nous laisser glisser de bloc en bloc, et nous entendions déjà, à l'extrémité inférieure de ce couloir escarpé formé par les eaux, le Guiers se briser avec un fracas étourdissant contre les rochers qu'il roule depuis des siècles. L'obscurité était profonde; le froid devenait très-vif. Notre inquiétude croissait de minute en minute. Que faire? Continuer à descendre, c'était se vouer à une mort presque certaine; remonter jusqu'à la prairie, il n'y fallait pas songer. Nous eûmes un moment l'idée de bivaquer, mais nous n'avions ni vivres pour ranimer nos forces épuisées, ni vêtements pour nous garantir de l'humidité glaciale de la nuit, et nous étions déjà affamés et tout mouillés de sueur. Une simple halte eût été surtout pour les deux jeunes filles un véritable danger.
En vain j'appelai du secours de toutes mes forces; en vain je fis retentir tous les échos de la forêt d'un cri prolongé bien connu des montagnards. Le torrent qui menaçait de nous engloutir répondit seul à mon appel. Je tentai un dernier effort; abandonnant un moment mes compagnons, je me lançai résolument à travers les ténèbres dans la direction où j'espérais retrouver le sentier perdu. Cette fois j'eus le bonheur de réussir, et bientôt nous fûmes tous cinq réunis dans la bonne voie. Mais le plus difficile restait encore à faire. Il fallait dans cette forêt même franchir le Guiers sur un vieux pont de pierre, construit en dos d'âne à une assez grande élévation au-dessus du torrent, et fort insuffisamment garni de parapets. Or, ce pont nous ne pouvions pas le trouver. Toutes (p. 400) les allumettes dont nous étions porteurs avaient été inutilement brûlées. Nous sondions le terrain à droite et à gauche pour ne pas nous précipiter dans les Guiers, et nos bâtons ferrés s'enfonçaient d'un côté dans le vide. Nous ignorions alors que le pont fût en biais. Jamais, je crois, voyageurs attardés n'ont été égarés, dans une obscurité plus profonde. Enfin à une nouvelle tentative mon bâton alla chercher si bas un point d'appui qu'il n'en rencontra plus. Je tombai avec lui dans l'abîme. Mes amis me crurent perdu. Par bonheur un bloc de rocher m'arrêta; mais, comme je ne voyais pas le danger que je courais (j'en frémis plus tard quand je vins au grand jour explorer ce terrible passage), je n'eus aucune frayeur, et, en me relevant, j'aperçus l'arche du pont qui se dressait à sept ou huit mètres au-dessus de ma tête. Le torrent franchi, nous étions sauvés. Toutefois il y avait encore un long trajet à parcourir avant d'atteindre le couvent. Les émotions que nous avions éprouvées, plus pour les autres que pour nous-mêmes, avaient doublé notre fatigue. Onze heures sonnaient quand nous frappâmes à la porte du monastère. Nous avions, tous cinq, grand besoin d'un bon souper, d'un grand feu, de quelques verres de liqueur et d'un lit.... et pourtant le temps était beau. Si vous nous aviez entendus, mon révérend père, ne seriez-vous pas venu nous ouvrir, et, si vous étiez venu nous ouvrir, auriez-vous refusé de nous recevoir malgré le règlement qui fixe à huit heures, je crois, la fermeture définitive des portes? Non certainement. On nous entendit, on nous ouvrit, on s'empressa de nous offrir tout ce dont nous avions besoin, et nous en conserverons une reconnaissance éternelle. Cependant, je l'avoue entre nous, chaque fois que j'entre dans la salle des voyageurs, que je vois l'excellent frère Gérasime vendre des caisses de liqueurs, faire faire l'addition des voyageurs qui fument leur cigare en soldant leur compte, à côté d'une affiche jaune indiquant le service des omnibus de Saint-Laurent-du-Pont à la Grande-Chartreuse et la marche des trains du chemin de fer de Paris-Lyon à la Méditerranée, j'éprouve quelques-unes des émotions qui ne manqueront pas de vous troubler lorsque nous arriverons tout à l'heure au couvent....
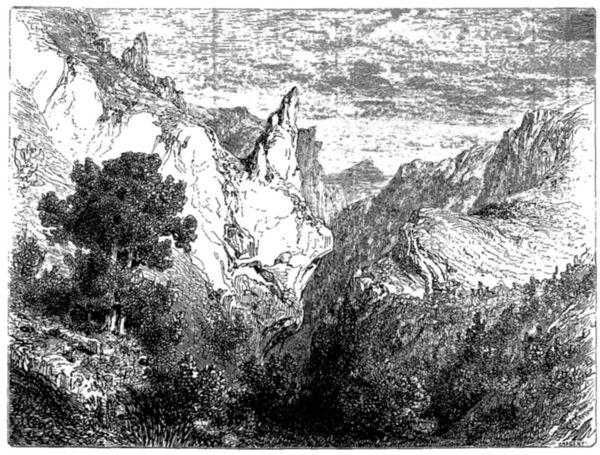
La gorge de Trente-Pas.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
.................
Notre conversation dura encore longtemps, mais il faut que je cède la place à mon collaborateur et ami, M. Élisée Reclus, qui va conduire mes lecteurs dans d'autres régions du Dauphiné, qu'il connaît et qu'il décrira mieux que moi.
Adolphe Joanne.
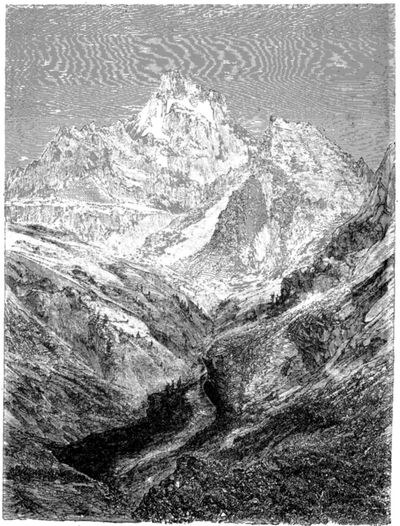
Le Mont Viso.—Dessin de Sabatier d'après nature.
I
La Grave. — L'Aiguille du Midi. — Le Clapier de Saint-Christophe. — Le pont du Diable. — La Bérarde. — Le col de la Tempe.
Dans les deux numéros précédents du Tour du monde, M. Adolphe Joanne a décrit quelques-uns des sites les plus pittoresques du Dauphiné: le pic de Belledonne, le Graisivaudan, le Royannais, le Vercors. Il faudrait écrire des volumes pour les faire connaître comme ils le méritent, ainsi que tant d'autres parties de cette belle province: le Champsaur, le Val-Godemar, le Val-Queyras et cette étonnante chaîne de montagnes à laquelle les formes étranges et hérissées de ses pics, ses obélisques, ses pyramides et ses aiguilles, les blocs amoncelés dans ses vallons, les ravages de ses torrents ont fait donner le nom de Dévoluy (devolutum), synonyme d'écroulement. Ce groupe de montagnes, ancienne et formidable citadelle des Sarrasins, se termine de tous les côtés par des roches abruptes dont les deux Buech, le Drac et l'un de ses affluents rongent les bases; le Mont-Aurouze, grand pic qui se dresse à son extrémité méridionale, est entouré de talus de pierres et de débris étincelants au soleil comme des contre-forts de marbre blanc; tous les sommets qui partent de ce colosse à l'apparence volcanique semblent des entassements de montagnes en désordre; on ne voit de toutes parts que des ruines et des avalanches de rochers avec lesquelles la charmante vallée de Saint-Étienne, située au centre du groupe, comme au fond d'un cratère, et les vastes forêts de la Chartreuse de Durbon, produisent un délicieux contraste. Mais quel que soit l'intérêt offert par cette chaîne étrange du Dévoluy, elle le cède sous tous les rapports au massif du Pelvoux ou de l'Oisans, le plus remarquable de la France avant l'annexion de la Savoie.
Ce massif de terrains granitiques situé dans les deux départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, est de forme presque circulaire. Du côté du nord, il présente un front de montagnes à pic séparées des Grandes-Rousses et de la chaîne méridionale de la Savoie par la dépression du Lautaret et l'étroite combe de Malaval; au sud, il dresse comme un promontoire la montagne escarpée de Chaillol-le-Vieil dominant la haute vallée du Drac; à l'est et à l'ouest, il est limité par une série de cols gazonnés et de sommets calcaires; de profondes vallées, que parcourent de furieux torrents, la Guisane, la Gironde, le Fournel, le Vénéon, la Séveraisse, entaillent ce massif et présentent les seules voies qui donnent accès aux hautes sommités pendant les plus beaux jours de la belle saison; encore ces vallées aboutissent-elles sans exception à quelque muraille croulante et souvent inabordable du glacier qui remplit uniformément les cirques et recouvre les sommets, vaste étendue blanche que percent ça et là de noires aiguilles mouchetées de neige. Le soulèvement du Pelvoux, d'une hauteur moyenne de deux mille cinq cents à quatre mille mètres, n'a guère que quarante kilomètres de long sur trente kilomètres de large; cependant, il offre dans ce petit espace un vrai dédale de neiges, de glaces, de moraines, de fissures étroites, de rochers et de pics: on pourrait cheminer pendant des années dans ce labyrinthe de montagnes sans le parcourir en entier.
Ce massif si remarquable par ses beautés naturelles et ses phénomènes grandioses est encore à peu près inconnu, si ce n'est aux botanistes et aux géologues. Un grand nombre de rocs et de glaciers n'ont encore été visités que par les chamois et les chasseurs; plusieurs pics élevés attendent encore leur nom; tel col, qui fait communiquer les vallées les plus importantes des deux versants, n'a encore été franchi que par une trentaine de personnes, et la Vallouise, charmante vallée ouverte au pied même de la montagne qui a donné son nom au massif entier, ne reçoit peut-être pas dix voyageurs par an. Sans aucun doute, les habitants des villes voisines, Grenoble, Gap, Briançon, connaissent bien mieux de visu ou par ouï-dire les beautés de la Suisse et de la Savoie que celles des montagnes qui bornent leur horizon. Heureusement qu'un Écossais, M. Forbes, a visité les hautes vallées du Pelvoux et raconté son voyage à ses compatriotes[6]. Espérons qu'une pacifique invasion d'Anglais nous apprendra que cette région de notre patrie n'est pas moins belle que bien des pays étrangers fourmillant chaque année de touristes innombrables. Il est temps que les Français apprennent à connaître la France.
Le panorama le plus grandiose offert par le massif du Pelvoux est sans contredit celui que l'on contemple du haut de l'arête méridionale de la Maurienne; de ce côté la citadelle de montagnes se présente dans toute sa largeur comme une muraille à pic, depuis les glaciers de Monêtier et l'hospice de la Madeleine jusqu'aux pâturages du Mont-de-Lans: on n'en est séparé que par une (p. 403) combe noire semblable à une fissure et que l'on croirait à peine éloignée d'un jet de pierre. Un jour, accompagné de quelques amis, j'eus le bonheur de voir ce beau panorama du haut du col de l'Infernet, situé en face même des plus hauts sommets de l'Oisans. Derrière nous ce n'était qu'une mer de brouillards et de pluie roulant ses flots gris sur les plateaux, les vallées et les montagnes; à nos pieds, une lumière éblouissante éclairait de rares champs de neige écroulés dans un cirque, dorait une colline herbeuse qui jaillit du fond de l'abîme comme un cône volcanique, et lançait même quelques rayons incertains dans le gouffre noir de la combe de Malaval; au delà, les brouillards cachaient le ciel jusque près du zénith et reposaient encore sur toutes les cimes du Pelvoux: on ne voyait que des champs de glace aux reflets de plomb, semblables à des pans de nuages, et les bases noirâtres des montagnes où croissent à grand'peine quelques sapins rabougris. Mais, par degrés, le vaste rideau de vapeurs remonta; ça et là de larges trouées s'ouvrirent dans sa surface amincie; le vent le déchira lambeau par lambeau et en éparpilla les débris dans l'air bleu où ils disparurent lentement; puis les nuages s'amoindrissant toujours et rampant en longues traînées sur les arêtes vives des contre-forts, battirent en retraite devant l'implacable soleil, s'enroulèrent autour des hautes cimes, ou bien s'étendirent comme de l'argent mat sur le métal éblouissant des névés. Toutes les glaces se montraient dans leur splendeur: au centre brillaient les trois glaciers de la Grave, blanches cataractes aux vagues soulevées par de longues arêtes et des rochers aigus; ça et là, sur les escarpements, on voyait les tranches bleuâtres de la glace d'où se détachent parfois des pans énormes, cristaux de cinquante mètres qui tombent d'un jet du sommet des rocs, roulent avec un bruit tonnant plus fort que celui de l'artillerie, et s'écrasent au milieu des pâturages en longues coulées d'une blancheur éclatante. Au delà des dômes arrondis qui limitent les champs de glace apparaissaient au loin quelques cimes du Pelvoux, tandis qu'au-dessus des neiges, des roches et des cimes, trônait éternelle et splendide la pyramide de l'Aiguille du Midi, ceinte d'un léger brouillard qui lui faisait une auréole lumineuse et fondait ainsi ses lignes superbes avec l'azur trop cru du ciel.
Les voyageurs qui désirent se rendre directement de la Grave dans la vallée du Vénéon, ouverte au centre même du massif du Pelvoux, peuvent, s'ils ont le pied montagnard, gravir les escarpements que couronne l'Aiguille du Midi, et traverser le vaste glacier du Lac, semblable à un amphithéâtre romain aux gradins concentriques. Du haut d'un dôme de glace, qui s'arrondit à trois mille six cent soixante-treize mètres au-dessus du niveau de la mer, ils verront d'un regard tout le massif des monts d'Oisans, vaste champ de neige troué de pics et dominé par la Barre des Escrins, point culminant des Alpes dauphinoises; en se retournant vers le nord, ils verront aussi, par delà les deux chaînes de Maurienne, le Mont-Blanc qui se dresse avec ses aiguilles et ses glaciers comme une île escarpée au milieu d'une mer de vapeurs. Le spectacle de ces deux géants des Alpes est vraiment grandiose; mais les dangers de l'excursion ne doivent pas être bravés de gaieté de cœur, et le touriste prudent se gardera de tenter les crevasses du glacier du Lac, les ardoisières de Saint-Christophe, les moraines de la Selle et les défilés du Diable, qui mènent dans la vallée du Vénéon. Il vaut mieux, comme les montagnards eux-mêmes, suivre la grande route qui passe au fond de la combe de Malaval, le long du cours de la Romanche, gravir la colline escarpée du Mont-de-Lans, et redescendre au charmant village de Vénosc par l'alpe du Mont-de-Lans, pâturage dont le célèbre Linné connaissait déjà les plantes rares; c'est à la beauté de ce pâturage que les habitants de Vénosc doivent indirectement leur prospérité. Souvent visités par des botanistes, ils sont devenus botanistes eux-mêmes, et chaque année, dans leurs émigrations périodiques, ils vont exercer le commerce des plantes alpines dans toutes les parties de la France, en Italie, en Angleterre, et même jusqu'en Russie et en Amérique; de retour dans leurs montagnes, ils apportent avec eux l'aisance ou même la fortune.
Vénosc éparpille ses maisons blanches et roses sur des croupes mollement arrondies, qui s'abaissent d'étage en étage jusqu'aux bords du Vénéon. L'ensemble de la vallée offre un charmant tableau: les habitations sont à demi cachées sous le branchage des grands noyers; le Vénéon, aux eaux d'un bleu pâle comme les glaciers qui les ont produites, bondit de pierre en pierre entre deux berges fleuries; le ruisseau de la Muzelle descend en cascade d'un charmant vallon de prairies et plonge dans une forêt de sapins: au loin on aperçoit des neiges et le cirque de pâturages au fond duquel se cache le lac de Lauvitel. Mais à peine a-t-on marché pendant quelques minutes en remontant le cours du Vénéon que le paysage change tout à coup de caractère: on vient d'entrer dans le clapier de Saint-Christophe. Toute trace de végétation a disparu; on ne voit plus que blocs entassés en désordre, semblables à des tours, à des pans de murailles, aux ruines d'une Babel gigantesque; les sommets des montagnes disparaissent eux-mêmes derrière l'accumulation de ces débris énormes; on entend mugir le Vénéon à une grande profondeur sous l'amas des rochers écroulés; ça et là brille à travers une ouverture étroite l'écume blanchissante du torrent. Les blocs semblent se tenir debout en vertu d'un équilibre impossible; on se croirait au milieu du chaos d'une nature insurgée contre ses propres lois et l'on tremble presque en suivant l'humble sentier qui serpente à la base des rochers, se glisse dans leurs interstices, s'attache à leurs anfractuosités, et passe sous leurs voûtes hardies.

CARTE du DAUPHINÉ PARTIE ORIENTALE (Isère et Htes
Alpes).
Dressée par A. Vuillemin Gravé chez Erhard R. Bonaparte 42.
Pour saisir d'un coup d'œil l'ensemble du chaos et se faire une idée du gigantesque écroulement, le voyageur qui peut disposer de quelques heures de loisir fera bien de gravir à la suite des chèvres les escarpements du Diable qui dresse en face ses assises d'ardoise rayées de noir et de gris. En s'aidant des pieds et des mains pour monter les degrés inégaux du roc, puis en suivant les passerelles vertigineuses suspendues au flanc de la (p. 404) montagne, et en pénétrant dans les couloirs étroits d'où s'écroulent au printemps des avalanches de neiges et de pierres, on finit par atteindre une terrasse de pâturages d'où la vue s'étend librement sur la vallée du Vénéon. À plus de mille mètres de profondeur, immédiatement au-dessous du rebord de la terrasse, apparaît le torrent bleuâtre serpentant au milieu d'un champ de pierres, alluvions de l'ancien lac que retenait l'effroyable digue du clapier. En face l'immense écroulement se montre dans toute sa hauteur. Ce n'est rien moins qu'une moitié de montagne formant, avec ses fragments de toutes les dimensions, un demi-cône de débris aussi élevé que le Vésuve, et barrant complétement la vallée de son énorme talus. Sur la face du mont resté debout, on voit en partie l'escarre blanche de laquelle s'est détaché ce chaos formidable de pierres. Un léger brouillard de vapeurs et les couches d'air vaguement azurées jettent un voile transparent sur les rochers épars de la base; à droite et à gauche du clapier, des ruisseaux descendus des neiges supérieures bondissent dans la vallée du Vénéon et secouent au vent leurs ondoyantes cascades: on n'aurait soi-même qu'à faire un pas pour tomber de chute en chute dans l'abîme effrayant, si profond qu'il semble appartenir à un autre monde.
(p. 405)
Le pont du Diable, près du village de Saint-Christophe.—Dessin de Sabatier d'après nature.
Cette étroite vallée, plus nue et plus sombre en certains endroits que la combe de Malaval, ne mérite pas d'être célèbre uniquement à cause de son clapier. Quelques minutes avant d'arriver au village de Saint-Christophe, on franchit un ressaut de rochers et l'on atteint un petit pont d'une arche bordé de garde-fous peints en rouge: c'est le pont du Diable. Il n'est guère de vallée des Pyrénées et des Alpes qui ne se vante d'avoir un pont construit par l'architecte des enfers, mais ces travaux méritent rarement le nom que les montagnards leur ont orgueilleusement donné. Le pont de Saint-Christophe, lui-même, n'offre rien de bien diabolique; en revanche, la gorge d'où sort le torrent du Diable, et plus bas, l'abîme où il se perd, offrent un spectacle vraiment infernal. En amont, du côté des glaciers de la Selle, l'eau jaillit d'une étroite fissure entre deux rochers perpendiculaires striés de couches noires comme des bancs de houille. Blanc d'écume, le ruisseau descend en cascades qui se séparent, se rejoignent, s'entre-croisent, se séparent de nouveau, puis se réunissent en une seule masse pour tomber sur des blocs éboulés, qui les font rejaillir en fusées de perles sur des buissons ondoyants penchés au-dessus de la chute. Un moment calmée, l'eau du torrent s'étale en tournoyant, puis, glissant au-dessous du pont par un étroit canal, s'abîme une seconde fois dans un gouffre: on voit encore une masse d'écume blanchissant à peine au fond de l'obscurité; plus bas, on entrevoit les spirales d'un tourbillon, puis la fissure se referme, le torrent reste caché par les lèvres de l'abîme et les branchages des frênes qui croissent dans les fentes des rocs; la terre semble avoir englouti son fils mugissant. Les églantiers en fleurs, des touffes de fougères (p. 406) et de scolopendres se font jour à travers les pierres descellées du pont et recourbent leur feuillage sur l'eau tournoyante; de vertes capillaires, toujours humides de rosée, tapissent ça et là les parois du gouffre. Un bruit étourdissant résonne sans cesse dans la gorge et se répercute de roche en roche.
Le petit hameau de la Bérarde est situé à l'extrémité de la vallée du Vénéon dans un site qu'on pouvait à bon droit, il y a encore une vingtaine d'années, appeler le Bout du Monde. À cette époque, aucun montagnard, pas même un chasseur de chamois, n'avait depuis longtemps franchi les glaciers qui remplissent les gorges environnantes, et les quelques habitants de la Bérarde, agglomérés dans leurs petites cabanes à demi enterrées dans le sol, ne communiquaient avec le reste du monde que par la vallée de Saint-Christophe. Maintenant il n'en est plus ainsi, grâce au courage et à l'adresse des deux chasseurs Roudier père et fils. Ils ont découvert au milieu des glaces trois cols de plus de dix mille pieds de hauteur qui permettent de passer de la vallée de la Bérarde soit dans celle de la Romanche, soit dans la Vallouise, soit dans le Val-Godemar. Ils ont déjà guidé par ces passages difficiles plus de cinquante touristes: il va sans dire que c'est à des Anglais que revient l'honneur d'avoir inauguré la traversée des Alpes du Pelvoux: en 1841, MM. Forbes et Heath, ont pénétré de la vallée de la Bérarde dans le Val-Godemar par le col de Saïs, quelques jours après que ce passage eût été frayé par Roudier père. Depuis cette époque, il ne s'écoule guère d'année sans qu'un ou plusieurs touristes français, anglais ou même américains viennent réclamer les services des intrépides chasseurs de la Bérarde; mais la plupart se contentent d'aller visiter la base des hauts glaciers et redoutent avec raison la traversée des cols.
En compagnie d'un ami qui désirait passer avec moi dans la Vallouise, je quittai la Bérarde par une froide matinée de juillet, une heure environ avant le lever du soleil. Le brouillard recouvrait uniformément toutes les montagnes de son voile gris et nous permettait à peine de voir à quelques pas devant nous les pierres éparses dans les pâturages; la voix même du torrent était assourdie par les couches de vapeurs; mais le guide, que rassuraient divers signes météorologiques à nous inconnus, nous promettait une belle journée et nous le suivîmes avec confiance. En effet, dès que nous eûmes commencé à gravir les roches arides ou parsemées de genévriers rabougris qui hérissent les flancs de la montagne de la Tempe, le dôme de brouillard qui recouvrait la vallée s'amincit peu à peu et prit la teinte jaunâtre de l'air éclairé par les premiers rayons du soleil. Enfin, arrivés sur une pente de neige, nous émergeons de la couche la plus élevée des vapeurs et nous voyons se dérouler autour de nous tout l'amphithéâtre des glaciers, le Chardon, le Baverjat, la Pilatte, la Combe-Faviel, la Tempe, le Vallon, les uns encore ensevelis dans l'ombre, les autres réfléchissant timidement la lumière discrète du matin. L'arche d'où jaillit le Vénéon apparaît comme une petite cavité noire à la base des glaces de la Pilatte; quelques nuages remontent lentement vers le col de Saïs; en bas, sur la mer de vapeurs qui tourbillonne comme la fumée d'un grand incendie, nos ombres se dessinent vaguement environnées d'un double arc-en-ciel qui se déplace à chacun de nos pas; l'ombre de la montagne elle-même, avec toutes les aiguilles de sa crête, repose sur les ondes mouvantes des brouillards. La magnificence du spectacle augmente à mesure que nous montons: le soleil fait resplendir d'un éclat plus intense la blancheur immaculée des cirques; les vapeurs se cachent dans les ravins et disparaissent comme une armée en déroute; par delà les crevasses et le champ de neige qui nous séparent encore de l'arête du col, nous voyons grandir incessamment les pics les plus élevés du Pelvoux, l'Ailefroide, les deux Olan, la Barre des Escrins ou pointe des Arcines. Enfin, nous atteignons le col, haut de trois mille sept cent cinquante-six mètres au-dessus du niveau de la mer, et nous contemplons à nos pieds un cirque de glaces large de deux à trois kilomètres, sillonné dans toute sa longueur de fentes étroites et de moraines parallèles semblables aux stries des fucus au milieu de l'Océan. Une paix merveilleuse règne sur l'immense horizon de montagnes et de neiges: aucun bruit des vallées ne s'élève jusqu'à ces hauteurs, la voix du torrent lui-même a cessé de retentir. Parfois une masse de neige s'écroule d'une terrasse de rochers et s'abat dans le cirque, accompagnée d'un nuage de poussière et suivie d'un long roulement d'échos, comme celui de la foudre. Rien ne rappelle la vie animale dans ce désert, si ce n'est la trace d'un chamois ou quelque papillon gris voltigeant au hasard. Sur la surface du champ de neige ridée par le vent comme les rivages de la mer sont ridés par les flots, les pierres éparses sont bordées de cristaux de glace que le brouillard vient de déposer; ça et là des touffes d'herbes dont chaque feuille est recouverte d'une gaîne de givre, des pensées, de petites gentianes, des myosotis, des œillets roses aux racines enfoncées dans un coussin de mousse verte, jaillissent à travers la couche de neige: souvent ces plantes sont couvertes de quelques flocons fraîchement tombés; on dirait que la neige est veinée de sang. Quelle charmante élégie un poëte de l'école mélancolique pourrait faire sur ces pensées et ces myosotis, les dernières fleurs qui accompagnent l'homme dans les régions de l'éternel hiver!
Le glacier qui s'étendait à nos pieds, offre le seul chemin par lequel on pénètre de la vallée de la Bérarde dans la Vallouise: il est connu sous le nom du glacier Noir. Il reçoit presque toutes les neiges du Mont-Pelvoux et de la Barre des Escrins, aussi bien que les rochers écroulés des flancs presque perpendiculaires de ces montagnes; au sortir de son vaste cirque, il comprime ses glaces et ses moraines dans un défilé large d'un demi-kilomètre au plus, et vient, à la base septentrionale du Pelvoux, s'unir en partie à l'extrémité inférieure du glacier Blanc, également étranglée entre deux parois de rochers verticaux. À l'endroit où ils s'effleurent par leurs moraines latérales, ces deux glaciers offrent (p. 407) un contraste absolu, et peut-être que nulle part dans les Alpes, on ne pourrait mieux étudier tous les phénomènes que présentent ces étranges fleuves de glace sur lesquels les savants discutent depuis si longtemps sans pouvoir s'entendre. Vu de la plaine de débris qui s'ouvre entre les deux moraines et que parcourt le ruisseau du Banc, le glacier Noir est tellement chargé de détritus de toute espèce qu'il semble une immense coulée de boue, pareille à celle que vomissent les volcans de Java: on ne reconnaît la nature de sa masse que par les crevasses béantes dans lesquelles s'engouffrent incessamment avec un bruit sourd des blocs de pierre et des traînées de cailloux. À la base du glacier s'appuie une effroyable moraine de plusieurs centaines de mètres de haut, composée de fragments de roches arrachés à toutes les montagnes avoisinantes; des ruisseaux boueux s'échappent de cet amas de blocs et se traînent lentement à travers les débris de la plaine. De l'autre côté, le glacier Blanc, presque entièrement libre de rochers, se termine par de gigantesques degrés et appuie sur le sol des contre-forts verticaux qui le font ressembler à une patte de lion. Ses assises sont d'un blanc pur, ça et là rayé de rouge et de jaune d'or; de son arche médiane admirablement cintrée s'échappe l'affluent principal du Banc, aux eaux d'un blanc laiteux comme celles du Vénéon. En face du confluent des deux glaciers, le Mont-Pelvoux se dresse comme une flèche gothique, hérissée de clochetons et portant dans ses anfractuosités des champs de glace très-courts, mais très-épais, ressemblant à des marches massives de marbre blanc. À sa base, croissent quelques mélèzes rabougris.
Les crevasses de ces divers glaciers sont assez dangereuses et il s'écoule peu d'années qui ne comptent leur moisson de victimes. Quelques jours avant notre passage une petite fille de dix ans qui gardait ses brebis dans un maigre pâturage situé sur le bord d'un glacier, avait glissé sur une pente de mousse et disparu dans une crevasse: on n'avait pu découvrir son corps mutilé qu'après deux jours de recherche. Un mois auparavant, un autre accident, qui heureusement ne se termina pas d'une manière fatale, avait eu lieu près du même endroit. Un pâtre, arrêté sur la surface du glacier, sondait avec son bâton une couche de neige qui recouvrait l'ouverture d'une crevasse. Soudain la neige s'affaisse et l'entraîne; avant qu'il ait songé à se jeter en travers de la fente, il se trouve à vingt-cinq mètres de profondeur entre deux murailles de glace bleue et sur un sol jonché de pierres. Sa position était tout à fait désespérée: à sa place, aucun autre n'eût songé à sortir de cette fissure étroite qui laissait à peine un rayon de lumière descendre jusqu'à lui. Les cris étaient inutiles; car personne ne l'avait accompagné sur le glacier; autour de lui, il ne touchait que la glace dure, de ses pieds il ne frappait que le roc de granit; il se sentait gelé par le souffle aigre et froid qui glissait dans la crevasse; ses vêtements mouillés se glaçaient sur son corps. N'importe: au lieu d'attendre avec frayeur cette mort qui devait lui sembler inévitable, il se met hardiment à l'ouvrage; avec la petite hache qui termine son bâton, il taille à intervalles égaux, dans les deux parois de la crevasse, des trous profonds qui lui servent d'échelons pour remonter peu à peu; il arrive ainsi jusqu'à une dizaine de mètres au-dessous de la surface du glacier; mais à cet endroit, une des parois surplombe tellement qu'il ne peut y tailler de marches, et qu'il est obligé de s'arrêter dans son ascension. Son courage ne l'abandonne pas: il creuse dans une des parois une espèce de niche, et vis-à-vis, deux entailles rapprochées; ensuite il redescend et va chercher au fond de la crevasse trois pierres, une assez large qu'il pose dans la niche, deux autres plus petites qu'il place dans les marches de la paroi opposée; puis il s'assied sur la grosse pierre, afin d'éviter à son corps le contact de la glace humide, pose ses pieds sur les petites pierres de la paroi opposée, et ne cesse de battre la semelle pour maintenir la chaleur vitale. Il resta ainsi plus de vingt-quatre heures suspendu à mi-hauteur de la crevasse; le lendemain matin, les bergers envoyés à sa recherche entendirent ses cris et le retirèrent encore vivant hors de la fente du glacier. Ce héros, qui déploya tant de courage et de présence d'esprit, est un crétin à l'œil terne, à la parole embarrassée, au long goître pendant; à sa place, tout homme de sens se serait abandonné au désespoir, ou bien aurait croisé ses bras en invoquant la mort; mais le pauvre d'esprit ne sut pas comprendre son horrible situation et c'est pour cela qu'il réussit à sauver sa vie.
II
La Vallouise. — Le plateau de Puy-Prés. — Le Pertuis-Rostan. — Le village des Claux. — Le Mont-Pelvoux. — La Balme-Chapelu. — Mœurs des habitants.
La Vallouise, jadis appelée Valpute, est une vallée tortueuse, longue d'environ vingt kilomètres, depuis les moraines du glacier Noir et l'arche du glacier Blanc jusqu'à son confluent avec la vallée de la Durance. Elle offre incontestablement les paysages les plus charmants des Alpes dauphinoises: il faudrait même aller jusqu'en Piémont pour trouver des sites aussi gracieux, des forêts aussi vastes, des plateaux plus riants et mieux cultivés. C'est à la rencontre des terrains géologiques qui composent cette partie des Alpes que la Vallouise doit la richesse de sa végétation et la diversité de ses aspects. Les gorges supérieures appartiennent encore au Pelvoux et traversent les formations primitives: là, ce ne sont que glaces, rochers écroulés, murailles de rochers à pic, cascades mugissantes; au point de contact des terrains primitifs et des grès à anthracite, des bouquets de sapins sont épars sur les pentes et sur le bord des torrents; puis vient la formation du lias avec ses massifs de trembles, de hêtres, de mélèzes, ses larges croupes herbeuses, ses buissons fleuris, ses eaux ruisselantes et ses plateaux boisés, dominés par d'âpres crêtes calcaires semblables aux ruines de gigantesques murailles.
Le chef-lieu de la vallée, décoré par les habitants du nom de Ville-Vallouise, ou plus brièvement de Ville, ne mérite guère son nom ambitieux: c'est un misérable (p. 408) village, aux ruelles tortueuses, aux chalets enfumés qui semblent porter la trace de récents incendies. En outre, les maisons situées sur le bord du torrent ont été en partie détruites par l'inondation de 1856: depuis cette époque, on n'a rien fait pour réparer le désastre; les chambres et les greniers délabrés sont encore ouverts à tous les vents, et ces pauvres débris de constructions ruinées sont à la merci de la première crue. Les habitants de Ville-Vallouise n'oseraient guère s'enorgueillir de leur patrie s'ils n'avaient les fresques de l'église représentant saint Christophe et l'enfant Jésus. Cette ignoble peinture, qui occupe presque toute la hauteur du clocher, leur semble une merveilleuse œuvre d'art; ils l'admirent consciencieusement et montrent avec satisfaction aux étrangers les longues jambes rouges du géant, son pourpoint bleu, sa face paterne et débonnaire. «Que dites-vous de notre saint Christophe? me demandait un Vallouisais. A-t-on d'aussi belles peintures à Paris?»

Le lac de l'Échauda.—Dessin de Sabatier d'après nature.
Si le village lui-même n'est remarquable que par le délabrement et la saleté de ses constructions, en revanche sa position est vraiment belle. Il est situé au confluent de deux vallées, au pied d'un promontoire crénelé de rochers et portant sur son plateau presque uni de vastes pâturages semés de chalets et de bois. D'un côté le Gir, qui reçoit toutes les eaux du Pelvoux et de l'Échauda; de l'autre côté, l'Onde alimentée par les neiges de l'Alp-Martin, de Bonvoisin, du Célard, environnent le village et se réunissent pour former la Gironde, torrent presque aussi fort que la Durance dans laquelle il va se jeter à un kilomètre au nord de l'Argentière. Des talus de sable et de pierres rouges, tombés des cimes du Sablier et du Montbrison, cachent en partie les (p. 410) pentes qui dominent la rive septentrionale du Gir; par un heureux contraste, les vastes forêts de la Ville recouvrent les montagnes de la vallée de l'Onde; mais quel que soit le charme dont ces forêts revêtent le paysage, elles le cèdent en beauté au plateau riant de Puy-Prés qui s'étend au sud-est de Ville-Vallouise sur une longueur de cinq kilomètres et une largeur de près de trois kilomètres. Ce plateau est la gloire de la Vallouise: des prés, arrosés par de petits ruisseaux gazouilleurs qui ne débordent jamais, occupent les vallons en forme de conques qui frangent le plateau; des bouquets d'aunes et de frênes croissant au bord des ruisseaux égayent les premières pentes et laissent entrevoir ça et là les villages et les hameaux éparpillés à mi-côte; plus haut, viennent les champs d'orge et d'avoine à l'abri dans une large dépression qui occupe presque tout le sommet du plateau; plus haut encore, ce sont des bois de mélèzes d'abord clairsemés, puis réunis en une vaste forêt qui tapisse tout le versant; enfin deux escarpements calcaires jaillissent de la verdure, séparés par le col boisé de la Pousterle. De ce col, on jouit d'une vue vraiment ravissante sur la forêt de mélèzes et les cultures du plateau: au delà du promontoire de Ville-Vallouise se dresse le Mont-Pelvoux sur un entassement de montagnes neigeuses; à leurs bases se contournent la vallée du Gir, et, plus loin, celle d'Ailefroide jusqu'aux glaciers Blanc et de l'Encula, dont la surface semble hérissée de vagues comme une mer agitée par l'orage.
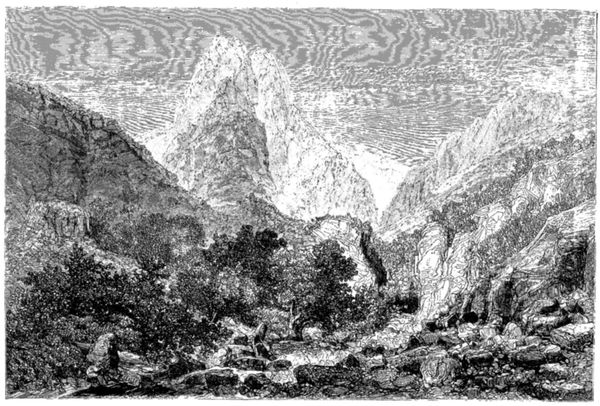
Le Pelvoux.—Dessin de Sabatier d'après nature.
La Vallouise forme un monde à part, et rien ne serait plus facile que d'en faire une véritable forteresse de montagnes. Inaccessible pour ainsi dire du côté de la barrière de glaciers qui la sépare à l'ouest de la Bérarde et du Val-Godemar, elle ne pourrait être envahie au nord que par le col de l'Échauda et le sentier scabreux de Presles, au sud par le col de la Pousterle et les passages souvent encombrés de neige de l'Alp-Martin et de la Cavale. À l'est, le promontoire qui se prolonge entre la Vallouise et la Durance était jadis fortifié au moyen de retranchements et de tours, aujourd'hui en ruines.
Quel fut le constructeur de cette muraille bâtie entre la Durance et la Gironde, à plus d'un kilomètre en amont du confluent? C'est là une question souvent débattue, mais non résolue par les archéologues du Dauphiné. Peu nous importe d'ailleurs, car en cet endroit même un fait géologique des plus intéressants jette singulièrement dans l'ombre tous les travaux attribués aux archevêques d'Embrun, aux seigneurs de Briançon ou même aux émirs sarrasins. Immédiatement en amont de la muraille ruinée qui défendait l'entrée de la Vallouise, la Durance coule entre deux parois de rochers complètement à pic, taillés sans aucun doute par l'action incessante des eaux lors du soulèvement de cette partie des Alpes. À une cinquantaine de mètres au-dessus du lit actuel de la rivière, ces parois se terminent soudain, et des deux côtés s'étend une surface relativement unie, mais assez étroite, semblable à la marche d'un degré gigantesque; chacun de ces plateaux qui surplombe le lit de la Durance, est à son tour dominé par une paroi très-abrupte qui escarpe le flanc de la montagne. L'ancien chemin de Briançon passait sur le plateau oriental, et peut-être que ça et là ses lacets avaient été taillés dans le roc: il n'en fallait pas davantage aux savants du Dauphiné pour leur faire supposer que la gorge elle-même avait été ouverte de main d'homme; d'après les uns, les rochers qui obstruaient le passage auraient été dissous par le vinaigre d'Annibal, d'après les autres, ce percement grandiose serait l'œuvre de Cottius, d'après d'autres encore, le chef sarrasin Rostan aurait fendu la montagne pour faire passer dans la vallée de Briançon ses bandes envahissantes: de là viendrait à la gorge son nom de Pertuis-Rostan. Cependant il suffit de regarder pour comprendre que les deux plateaux des versants opposés sont le reste d'un ancien lit de la Durance, lit que le torrent a scié lui-même par le milieu dans toute sa longueur, afin d'y creuser l'espèce de cañon[7] dans lequel ses eaux coulent aujourd'hui.
Si l'on monte sur l'un des mamelons pierreux qui séparent le confluent de la Durance et de la Gironde, on verra parfaitement que ce dernier torrent a lui-même changé d'allure depuis les âges géologiques. De nos jours, il coule directement de la Vallouise vers la Durance jusqu'à cinq cents mètres environ de Pertuis-Rostan; là, il se recourbe tout à coup vers le sud, et, passant dans une gorge étroite, court parallèlement à la Durance pendant plus d'un kilomètre. Autrefois ses eaux se déversaient directement dans le torrent principal par la dépression du col de la Bathie, situé à côté de Pertuis-Rostan et à peu près à la même hauteur, en amont de l'ancien mur qui fermait la Vallouise. Ainsi le soulèvement des Alpes a forcé les deux torrents à se frayer un nouveau lit: la Durance l'a excavé dans la gorge où elle passait déjà, tandis que la Gironde, changeant de cours et abandonnant la dépression de la Bathie, obliquait à droite et se frayait une issue à travers le flanc de la montagne de Pousterle.
Mais parmi les voyageurs qui suivent la grande route de Briançon à Gap serpentant sur le flanc de la montagne de la Bessée, il en est peu qui remarquent la gorge de Pertuis-Rostan et le col de la Bathie; la vue est invinciblement attirée vers le Pelvoux, qui dresse à l'horizon ses deux cornes de rochers séparés par un long couloir de glaces: c'est le roi de la Vallouise, et les rares touristes qui pénètrent dans cette vallée ne peuvent se dispenser d'aller visiter au moins la base du géant.
Si l'on veut tenter l'ascension de cette montagne, ou seulement parcourir les vallées qui s'ouvrent alentour, il faut choisir pour quartier général le village des Claux, situé à cinq kilomètres en amont de Ville-Vallouise, au confluent des deux torrents d'Ailefroide et de l'Échauda, dont les eaux réunies forment le Gir. Les Claux, en patois Claou, c'est-à-dire Clef, sont en effet la clef des vallées supérieures, car les chalets de ce village sont bâtis au point de contact des terrains granitiques et des formations calcaires; là, le sol presque uni de la vallée est (p. 411) dominé de tous côtés par des ressauts élevés, d'où les torrents descendent en rapides et en cascades; les voyageurs qui redoutent la fatigue des ascensions sont dans une véritable impasse. Les constructions de ce village sont encore plus misérables que celles de Ville-Vallouise; mais, en revanche, le paysage est peut-être plus beau dans son cadre resserré: les diverses essences d'arbres s'y mêlent en groupes plus pittoresques et les eaux y ruissellent en plus grande abondance; au milieu des prairies ombragées gazouillent de toutes parts les canaux d'irrigation, empruntant leur eau transparente à l'Échauda ou leur onde laiteuse au torrent d'Ailefroide. C'est le versant méridional surtout qui fait la beauté de ce coin de la Vallouise: il est recouvert, jusqu'à la hauteur de deux cents mètres, de frênes et de trembles, à travers lesquels on voit briller les innombrables cascatelles de la Pisse jaillissant en nappes, bondissant en chutes successives ou glissant discrètement sous le feuillage. À quelques mètres au-dessus de la plus haute cascade, là où commence à se faire sentir l'âpre souffle des glaciers, l'herbe courte remplace tout à coup les grands arbres; la limite entre la végétation et l'aridité est marquée par une ligne inflexible, droite comme si elle eût été tirée au cordeau. L'eau qui alimente toutes ces cascades provient en grande partie du petit lac de l'Échauda, bassin ovale qui engouffre dans son sein les blocs tombés des roches surplombantes, et laisse flotter à sa surface les glaçons translucides, petits icebergs détachés de la base du glacier de Séguret-Foran.
Vu du bassin des Claux, le Mont-Pelvoux apparaît dans toute sa majesté. Sa double pyramide appuyée sur des contre-forts également pyramidaux, ses glaciers étroits qui semblent taillés à pic, ses terrasses herbeuses environnées de précipices, les neiges saupoudrant ses rochers abrupts, son isolement surtout, lui donnent un caractère grandiose; par son énorme masse, il cache complètement la Barre des Escrins et les autres cimes qui lui sont égales ou supérieures en élévation; il semble le monarque incontesté de la chaîne; aussi a-t-il donné son nom au massif entier. Sa forme offre une certaine analogie avec celle du Viso, autre monarque, régnant sur toute la chaîne des Alpes méridionales, depuis la dépression du Mont-Genèvre jusqu'au col de Tende. Le Bric du Mont-Viso, encore plus auguste que le Pelvoux, se termine aussi par deux cimes distinctes; autour de lui tous les sommets s'abaissent et lui font une ceinture de neiges et de glaces; mais il a de plus que le Pelvoux le privilège de n'avoir jamais été visité. Il est vierge de pas humains et restera probablement inviolé jusqu'à ce que l'aéronaute puisse diriger son ballon et débarquer du haut du ciel sur toutes les cimes inaccessibles aujourd'hui.
D'après le témoignage des guides et des rares touristes qui ont foulé la cime du Pelvoux, cette montagne est très-facile à gravir pendant deux ou trois semaines de l'été, alors que les pentes supérieures sont presque dégagées de neiges; à cette époque de l'année, les bergers provençaux, suivis de leurs brebis, montent souvent dans les cirques ouverts à quelques centaines de mètres du sommet. Lorsque les neiges d'hiver ont été peu abondantes, les glaciers sont d'un accès difficile parce que les crevasses non remplies par les névés restent béantes dans toute leur largeur; les montagnes, en revanche, sont facilement accessibles, parce que le rocher reste à nu et qu'il ne se forme pas de couloirs d'avalanches. Le contraire a lieu lorsque l'hiver a répandu sur toutes les montagnes des couches épaisses de neige: alors les glaciers offrent moins de dangers, et les pics deviennent inabordables. Les mêmes circonstances qui m'avaient permis de traverser le col de la Tempe m'empêchèrent d'escalader le Pelvoux, et je dus me contenter d'errer dans les vallées qui entourent la base de cette montagne.
Au sortir des Claux, on gravit une assise de rochers que le torrent traverse par une profonde coupure, et l'on se trouve sur une terrasse herbeuse, vrai paysage de Calame transporté de la Suisse en Dauphiné. Des rocs éboulés reposent ça et là au milieu des prairies; des sapins se groupent en massifs pittoresques et laissent entrevoir les neiges et les monts à travers leur large branchage; des troncs tombés de vieillesse, mais retenus dans leur chute par une saillie du roc, se tiennent en équilibre au-dessus du gouffre au fond duquel mugit le torrent d'Ailefroide. Au delà d'une ancienne levée de moraines, aujourd'hui revêtue de mousse et ombragée par un rideau de mélèzes, on entre dans le bassin triangulaire de Planche-Vallière, étalant ses maigres champs d'orge et ses prairies marécageuses au pied même des escarpements en étages du Pelvoux. Là sont épars les chalets misérables d'Ailefroide, situés au confluent du Banc ou ruisseau de Saint-Pierre, issu du glacier Blanc, et du torrent de Celce-Nière, Capescure ou Soleillan, provenant du vaste glacier du Célé. C'est la gorge de ce dernier torrent qu'il faut suivre quand on veut tenter l'ascension du Pelvoux. On peut également pénétrer par les glaciers de cette gorge dans le Val-Godemar, et l'examen de la carte nous fait supposer qu'on pourrait aussi choisir cette voie pour se rendre dans la vallée de la Bérarde; la distance serait un peu plus longue que par le col de la Tempe, mais le col qu'on aurait à franchir est moins élevé de près de huit cents mètres.
Après avoir marché pendant deux heures dans la gorge de Capescure jusqu'à la base du glacier du Célé, le voyageur qui se dirige vers le Pelvoux gravit à droite une pente escarpée aboutissant à une terrasse où se trouve le gîte des bergers de Provence, formé par la cavité d'un grand rocher tombé du haut de la montagne: c'est là que le touriste et son guide passent la nuit, étendus à côté d'un grand feu de racines et de branches sèches. Le lendemain matin, on atteint, comme on peut, le sommet d'un éboulis de pierres, puis on escalade, en s'aidant des mains, les saillies d'une espèce d'escalier de roches où coulent d'innombrables ruisseaux descendus des neiges du sommet, où bondissent aussi des blocs de granit détachés du flanc de la montagne. L'astronome M. Puiseux, qui a fait en 1848 l'ascension du Pelvoux, venait de s'installer pour le déjeuner sur l'un de ces gradins, lorsque (p. 412) tout à coup un bloc d'un mètre cube environ vint tomber comme une bombe à côté de lui, lançant dans toutes les directions une mitraille d'éclats; heureusement que ni lui ni son guide ne furent atteints, et le repas, commencé sous de si fâcheux auspices, ne fut pas autrement troublé. Arrivé au sommet de l'escarpement, on se trouve sur un vaste plateau de neige d'un parcours facile, au milieu duquel s'élèvent les deux plus hautes sommités du Pelvoux. De ces deux cimes, également accessibles, on jouit d'une vue magnifique. On voit s'ouvrir à ses pieds la verdoyante Vallouise, et, plus loin, l'aride vallée de la Durance; à l'ouest, la Barre des Escrins lève sa tête noire au-dessus des glaciers de l'Encula, de la Tempe et du Vallon; au delà de ce premier cercle de glaces et de neiges, toutes les Alpes du Dauphiné forment à l'horizon des cercles concentriques de pics et de dômes; au nord, le mont Blanc écrase toutes les autres cimes de sa masse énorme; à l'est, le mont Viso se fait remarquer par sa double pyramide élancée. M. Durand, le premier touriste qui ait escaladé le mont Pelvoux, croit avoir aussi aperçu la Méditerranée; mais M. Puiseux n'a pu la distinguer, et les guides des Claux disent n'avoir jamais vu du côté du sud d'autre mer que celle des brouillards ou des brumes reposant sur les plaines de Provence.

Le mont Aurouze, vu du col de Barbey-Loubet.—Dessin de Français d'après M. A. Muston.
Depuis 1828, année de la première ascension, jusqu'à nos jours, le mont Pelvoux n'a encore été gravi que par ces touristes français; presque tous les Anglais qui ont pénétré dans la Vallouise, avaient pour unique but de faire un pèlerinage à la Balme-Chapelu, grotte située au pied du mont, dans la combe de Capensure. Cette excavation, dont la voûte de granit, en partie effondrée, peut encore abriter deux cents personnes, a longtemps servi de forteresse aux Vaudois persécutés. Inaccessible de toutes parts, si ce n'est du côté du torrent dont la sépare une pente escarpée, elle offrait une retraite sûre, et des tas de pierres que l'on voit près de l'entrée prouvent que les Vaudois étaient disposés à se défendre. Les pauvres gens réfugiés dans cette grotte consentaient à vivre comme des ours dans la région des orages; éloignés de leur patrie, privés de tout commerce avec leurs semblables, ils n'avaient d'autres ressources que les maigres récoltes épargnées par le terrible hiver de la Combe; mais au moins pouvaient-ils lire en paix leur Bible et prier leur Dieu dans leur propre langue, sans crainte d'être décapités ou écorchés vifs. Mais en une fatale nuit d'orage, ils furent tout à coup surpris par une force considérable de soldats. Un petit nombre d'entre eux seulement put échapper au massacre et s'enfuir à travers les glaciers, dans le Val-Godemar, et de là dans la vallée de Freyssinières. Les montagnards de la Vallouise se racontent encore l'un à l'autre l'histoire de ces malheureux étrangers, peu à peu transformée en légende; mais ils (p. 414) ne comprennent point le mobile qui les poussait; d'après eux, les Vaudois n'auraient jamais osé braver les terreurs d'un hiver passé au milieu des glaces, des brouillards et des tempêtes, s'ils n'avaient pratiqué de noirs maléfices et connu l'art de transformer les pierres en lingots d'or. En l'an de grâce 1859, il s'est encore trouvé des gens assez superstitieux pour creuser à l'heure de minuit le sol de la Balme, dans l'espoir d'y découvrir des trésors cachés. Quelques années auparavant, un prêtre accompagné de deux sacristains avait réussi à détacher de la voûte enchantée une pierre, qui, grâce à des incantations magiques, devait se transformer en un bloc d'argent; mais, le lendemain matin, la pierre remonta, dit-on, par une impulsion soudaine et se replaça d'elle-même dans la voûte de la grotte. Heureux celui qui saura découvrir les trésors cachés sous la pierre par les Vaudois fugitifs, de leur vivant noirs magiciens et suppôts du démon!

Mont Ferrand. Mont Charnier. Mont Chamouset. Mont Aurouze.
Les Montagnes du Déveluy.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
On le voit: les habitants de la Vallouise ne peuvent se vanter d'avoir l'esprit dégagé des antiques superstitions, et la plupart d'entre eux mériteraient de vivre en plein moyen âge. Il n'est pas un récit de miracle qui ne trouve crédit chez eux, tout prodige est accepté comme vrai sans examen. Un jour qu'un de mes amis, un peu ironique de sa nature, racontait à une société de Vallouisais les merveilles les plus étranges, les aventures les plus miraculeuses de la mythologie indoue, il s'aperçut avec stupeur qu'on acceptait tous ses récits sans arrière-pensée; les exploits divins de Krichna et de Kali trouvaient dans ces âmes simples une croyance absolue. Séparés du reste du monde par un cercle de glaces et de rochers, initiés depuis quelques années seulement à la jouissance d'un chemin carrossable, les habitants de la Vallouise sont restés à peu près en dehors de tout progrès. Ils sont incontestablement bons, doux et naïfs, mais on ne leur ferait aucun tort si on les comparait à tel peuple barbare du nouveau monde ou de la mer du Sud.
Pour apprendre à connaître les mœurs des indigènes de la Vallouise, qu'on entre dans une de leurs cabanes, et l'on verra que les huttes des Esquimaux[8] ne sont guère inférieures aux habitations de nos compatriotes des Alpes. Je ne parle pas ici seulement de ces gîtes improvisés entre deux rochers surplombants, et dont les murailles sont construites au hasard en pierres de toute provenance, ardoise, granit, marbre ou porphyre; les plus superbes constructions, celles qui de loin offrent le plus de ressemblance avec les chalets suisses, et dont le toit bruni recouvre un vaste grenier à gerbes, sont en réalité des bouges inhabitables pour tout homme doué du moindre instinct de propreté. En entrant par la porte basse qui est la seule ouverture du taudis, on ne peut d'abord rien distinguer dans l'obscurité générale, mais, en revanche, l'odorat est désagréablement affecté. Lorsque enfin les yeux se sont habitués à ces demi-ténèbres, on ne peut reconnaître les objets, tant ils sont confondus en désordre et recouverts uniformément d'une épaisse couche de suie. Aux noires poutres du plafond sont suspendus des barattes, des marmites, des paniers, des branches jadis vertes de sapin bénit, de fétides articles de vêtement, sale défroque transmise de génération en génération; des débris de toute espèce sont épars sur le sol presque visqueux; une table, un lit, un pétrin, et deux ou trois siéges en bois qu'à leur couleur on ne saurait distinguer du sol ou du foyer, occupent plus de la moitié de la chambre; une acre fumée se mêle à l'air déjà si corrompu. Près du feu gît une boîte de sapin noirci, hermétiquement fermée par des pièces de toile ou de laine jadis vertes; cette boîte, d'où s'échappent des gémissements lamentables, ressemble à un cercueil, c'est le berceau d'un nouveau-né. Si le pauvre être a eu le malheur de venir au monde vers le commencement de l'hiver, il est condamné à vivre pendant huit mois de la fétide atmosphère qu'il a respirée au jour de sa naissance; pendant cette première période de sa vie, de beaucoup la plus importante en résultats pour sa santé future, ses poumons ne s'empliront pas une seule fois de l'air pur qui descend des montagnes; dans leur sollicitude, ses parents lui ont créé une atmosphère artificielle de la plus funeste insalubrité. Qu'on s'étonne ensuite de la mortalité des enfants dans les Alpes dauphinoises, qu'on s'étonne de compter parmi les survivants un si grand nombre de crétins!
Dans quelques villages, ces êtres dégradés forment le tiers ou la moitié de la population. Abondamment pourvus d'un goître majestueux qui ne fait que s'allonger et grossir avec l'âge, ils atteignent dès leur enfance le plus complet développement possible de leur intelligence, semblables sous ce rapport aux orangs-outangs qui n'ont plus rien à acquérir dès qu'ils sont arrivés à l'âge de trois ans. À cinq ans les petits crétins ont déjà l'air placide et mûr qu'ils doivent garder toute leur vie; leurs membres sont ramassés et trapus comme ceux des hommes faits; ils remplissent leurs fonctions de bergers ou de manœuvres aussi bien qu'ils le feront dans la force de l'âge, et comme des adultes, ils portent culottes, habit à queue et large chapeau noir. Ils ont même avant l'âge un certain gros bon sens, et s'ils appartiennent à une famille de notables, rien n'empêche qu'on ne les choisisse pour en faire les sacristains et les marguilliers de la paroisse: une seule chose leur manque, la force d'impulsion nécessaire pour devenir des hommes. Leurs yeux, aussi brillants qu'ils soient, se ternissent peu à peu, leur bouche commence à baver, leurs jambes hésitent et se traînent. Épais, lourds, hideux, ils ne demandent qu'à satisfaire leur faim, et la vue d'une écuelle de lait, d'un morceau de pain les satisfait complètement. Pour comprendre leur misérable état, est-il besoin d'analyser savamment l'eau qu'ils boivent et de doser l'air qu'ils absorbent? Il suffit de pénétrer dans les tanières impures où ils ont passé leur enfance.
La nourriture des montagnards du Pelvoux ne vaut guère mieux que leur logement; elle est simple, puisqu'elle se compose presque uniquement de pain, de laitage et de racines; mais le pain qui forme la base de l'alimentation est toujours de mauvaise qualité. Un usage (p. 415) antique et solennel veut que chaque famille ait sa provision de pain pour une année entière; ainsi l'on montre aux envieux que la farine ne manque pas. Le pauvre seul mange parfois du pain frais, parce qu'il n'a pas une récolte suffisante pour cuire en une fois la provision de toute l'année; mais il a honte de sa pauvreté, et quand il s'agit de mettre de nouveau la main à la pâte, il se cache afin d'échapper aux regards des voisins. Le pain de la Vallouise, fait de seigle et de froment, ou bien de seigle et d'avoine, a toujours goût de poussière ou de moisi. Il va sans dire que pour couper ce pain il faut recourir à des moyens héroïques. Sur la table est placé un gros billot de chêne auquel est attaché un coutelas tranchant; on introduit le pain sous l'instrument, et en appuyant de tout le poids de son corps sur le manche qui termine le coutelas, on parvient à détacher un morceau du bloc de pain soumis à la pression. Pour ramollir ce morceau, dur comme un éclat de marbre, il faut le faire tremper pendant quelques minutes; les pauvres se contentent d'eau pure, les riches se servent de vin blanc pour cette opération.
Semblables sous ce rapport à toutes les peuplades isolées, les gens de la Vallouise n'ont point d'habitudes commerciales; ils tâchent de vivre comme si le reste du genre humain n'existait pas, et chacun d'eux tâche de produire dans ses champs et dans son chalet tout ce qu'il croit être nécessaire à ses besoins ou à son agrément. Il se contente de vendre sur les marchés de Briançon et de la Bessée les denrées qu'il lui est absolument impossible de consommer lui-même, et jamais il n'achète qu'à la dernière extrémité les objets les plus indispensables. Il est son propre journalier, son charpentier, son maçon, son boulanger, son tailleur, son cordonnier; même lorsqu'il est obligé d'accepter l'intermédiaire du fabricant, il se croit tenu de fournir la matière première. Quand il a besoin d'un vêtement de drap, il tond ses brebis, en fait carder et filer la laine dans sa maison, la porte au fabricant qui la transforme en drap, puis au teinturier qui la teint en gros bleu, et enfin rapporte le drap à sa femme qui taille la culotte ou l'habit sur un patron laissé par la grand'mère. De même, les chemises du Vallouisais doivent être faites du chanvre qui croît autour de son chalet; en outre, le nombre des sétérées de chanvre qu'il cultive doit augmenter avec sa fortune. Un œil exercé peut toujours reconnaître à l'étendue des chènevières situées dans une propriété, combien le maître a de chemises dans son armoire. Il est bon d'ajouter que la plupart de ces chemises ne sont autre chose qu'un symbole de richesse et restent inviolées sur les planches de sapin jusqu'au jour où l'heureux possesseur les transmet solennellement à son fils ou à son gendre.
Ayant ainsi l'ambition de tout produire par eux-mêmes, leur foin, leurs céréales, leurs chanvres, leurs laines, leurs fromages, leur vin, les habitants de la Vallouise sont obligés d'avoir des parcelles de terrain à plusieurs lieues de distance, les unes à l'origine, les autres à l'issue de la vallée, car les produits divers qu'ils demandent ne peuvent être obtenus qu'à différentes altitudes. Les habitants des Claux, non contents d'avoir autour de leurs chalets des champs de céréales, des prairies, des chènevières, quelques arbres fruitiers, ont aussi des chalets d'été à l'Ailefroide, à la Sapenière, à l'Échauda, dans tous les pâturages communaux où ils peuvent envoyer leurs moutons ou leur gros bétail; d'un hameau, ils tirent leur seigle, leurs choux et leurs navets; près d'un autre hameau, situé à deux ou trois lieues plus loin, ils traient leurs vaches, font leur beurre et leurs fromages. Quant aux vignobles, ils sont situés à seize kilomètres des Claux, près de l'issue de la vallée, à la base d'un rocher exposé au soleil du midi; mais leur altitude dépassant mille mètres, ils ne peuvent produire qu'un abominable verjus dont les propriétaires sont pourtant singulièrement fiers. Au milieu du vignoble se trouve la cave où l'on emmagasine les deux ou trois barriques de liquide récolté, et lorsque le vin manque chez les habitants des Claux, ils sont obligés de seller leur monture et d'employer toute une journée de travail pour aller remplir deux outres goudronnées. En revenant, ils ne manquent pas d'inviter tous les amis qu'ils rencontrent sur la route, la procession grossit à mesure qu'ils se rapprochent du village; à peine arrivés, tous s'attablent pour fêter le bon vin; une grande partie de l'outre entamée se vide en l'honneur de l'amphitryon, et celui-ci passe le reste de la journée à cuver sa liqueur. Tel est l'un des moindres inconvénients du système que pratique l'indigène de la Vallouise en produisant sur sa propriété tous les objets nécessaires à sa consommation. Protectionniste fidèle aux saines traditions de l'économie politique, il mange son blé, boit son vin, s'habille de sa laine et de son chanvre, bâtit son chalet avec son propre bois, sculpte lui-même le berceau de son enfant et rabote le cercueil de son père; il ne paye aucun tribut aux habitants des autres vallées; mais il mange du pain moisi, boit du vinaigre, s'habille de vêtements mal faits, se construit des cabanes insalubres, fait de ses enfants autant de petits crétins, et de plus il perd son temps qu'il pourrait employer d'une manière utile.
Lorsque vient l'hiver, l'interminable hiver, lorsqu'une épaisse neige remplit la vallée et que les branches d'arbres portent chacune leur poids de glace, ceux qui n'abandonnent pas le pays se réfugient, pour échapper au froid, dans les écuries creusées au-dessous des maisons: les exhalaisons du fumier entassé depuis plusieurs mois, la respiration des chevaux et des mulets, l'absence de courant d'air, l'épaisseur des murailles, même la couche de neige qui obstrue toutes les issues, maintiennent une température confortable dans ces souterrains nauséabonds. On y transporte les instruments culinaires, les rouets, les fuseaux, les branches bénites, l'antique pendule qui mesure les heures de son tictac monotone. Une rigole pavée emporte les eaux ménagères et le purin des animaux dans le tas de fumier qui occupe l'extrémité opposée à celle où siègent les dieux lares de la famille. Toutes les dispositions sont prises dans le but de rendre supportable le séjour des écuries. Le temps se passe assez agréablement pour les femmes qui ont toujours à (p. 416) vaquer aux soins du ménage, soigner les enfants, les vieillards et les malades, à filer la laine et le chanvre; quant aux hommes, ils n'ont qu'à se jeter sur la paille à côté des animaux, et sauf les heures pendant lesquelles ils soignent leurs bêtes, ils emploient leur temps à dormir d'un long sommeil semblable à celui des marmottes; parfois, dans leurs moments d'insomnie, ils tricotent des bas et vont tenir compagnie aux dames.

Ruines de la Chartreuse de Durbon.—Dessin de Karl Girardet d'après M. A. Muston.
C'est là un genre de vie inacceptable pour des hommes habitués au grand air, à la liberté du chasseur ou du pâtre; aussi la plupart d'entre eux quittent la prison dans laquelle l'hiver renferme leur famille, et suivant l'exemple que leur donnent les troupeaux de Provence, quittent leurs âpres montagnes pour aller séjourner jusqu'au printemps dans les régions plus fortunées du Midi. Vrais nomades, ils habitent pendant la saison des chaleurs les fraîches vallées des Alpes, puis au commencement de l'automne descendent dans les vallées inférieures et enfin, lors de la chute des neiges, vont jouir du doux climat des plages maritimes. Il serait à désirer qu'en hiver les hommes n'eussent pas seuls le privilège d'émigrer dans les plaines tempérées de la Provence. Pendant la saison des neiges, le climat des Alpes devient celui du Spitzberg; alors les femmes et les enfants, confinés sous terre dans les écuries infectes, n'osent plus sortir de peur de respirer l'air glacé du dehors. Le jour ne viendra-t-il pas où ils pourront émigrer en masse vers les chaudes plaines du Midi, laissant les villages en garde à quelques chasseurs? Le bien-être des montagnards, leur santé l'exigent impérieusement, et si l'on désire l'extinction graduelle du crétinisme, on ne peut recourir à un moyen plus naturel et plus efficace. Autant les montagnes sont belles quand les vallées qui en ceignent la base leur font une ceinture de feuillage, autant elles sont effrayantes à voir lorsqu'elles reposent sur un monde de frimas. Alors un silence terrible repose sur la vaste étendue des vallées et des montagnes uniformément blanches; le ciel gris se confond avec l'horizon dentelé des cimes; souvent les neiges tourbillonnent fouettées par la tourmente, et les avalanches s'écroulent en grondant du haut des rochers. Au milieu de cette nature inhospitalière, l'homme, blotti dans un souterrain, se sent à peine le droit d'exister.
Élisée Reclus
I. Sous le titre Voyage d'un naturaliste, pages 139 et 146, on a imprimé: (1858.—INÉDIT).—Cette date et cette qualification ne peuvent s'appliquer qu'à la traduction.
La note qui commence la page 139 donne la date du voyage (1838) et avertit les lecteurs que le texte a été publié en anglais.
II. Dans un certain nombre d'exemplaires, le voyage du capitaine Burton aux grands lacs de l'Afrique orientale, 1re partie, 46e livraison, le mot ORIENTALE se trouve remplacé par celui d'OCCIDENTALE.
III. On a omis, sous les titres de Juif et Juive de Salonique, dessins de Bida, pages 108 et 109, la mention suivante: d'après M. A. Proust.
IV. On a également omis de donner, à la page 146, la description des oiseaux et du reptile de l'archipel des Galapagos représentés sur la page 145. Nous réparons cette omission:
1º Tanagra Darwinii, variété du genre des Tanagras très-nombreux en Amérique. Ces oiseaux ne diffèrent de nos moineaux, dont ils ont à peu près les habitudes, que par la brillante diversité des couleurs et par les échancrures de la mandibule supérieure de leur bec.
2º Cactornis assimilis: Darwin le nomme Tisseim des Galapagos, où l'on peut le voir souvent grimper autour des fleurs du grand cactus. Il appartient particulièrement à l'île Saint-Charles. Des treize espèces du genre pinson, que le naturaliste trouva dans cet archipel, chacune semble affectée à une île en particulier.
3º Pyrocephalus nanus, très-joli petit oiseau du sous-genre muscicapa, gobe-mouches, tyrans ou moucherolles. Le mâle de cette variété a une tête de feu. Il hante à la fois les bois humides des plus hautes parties des îles Galapagos et les districts arides et rocailleux.
4º Sylvicola aureola. Ce charmant oiseau, d'un jaune d'or, appartient aux îles Galapagos.
5º Le Leiocephalus grayii est l'une des nombreuses nouveautés rapportées par les navigateurs du Beagle. Dans le pays on le nomme holotropis, et moins curieux peut-être que l'amblyrhinchus, il est cependant remarquable en ce que c'est un des plus beaux sauriens, sinon le plus beau saurien qui existe.
Le saurien amblyrhinchus cristatus, que nous reproduisons ici, est décrit dans le texte, page 147.
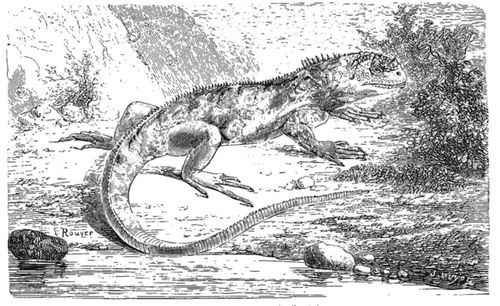
Amblyrhinchus cristatus, iguane des îles Galapagos.
IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9, à Paris
Note 1: Le pic de Belledonne. Grenoble, Maisonville. 1858.[Retour au Texte Principal]
Note 2: Excursion dans les environs de Grenoble: le pic de Belledonne. Grenoble, 1858. 1 vol. in-18 de 100 pages. 1 fr. 25 c.[Retour au Texte Principal]
Note 3: Le Pic de Belledonne, les Montagnes de Saint-Nizier, le Dauphiné et la Maurienne, les Chemins de fer du Dauphiné. In-18. Chez M. Maisonville.[Retour au Texte Principal]
Note 4: Suite.—Voy. page 369.[Retour au Texte Principal]
Note 5: Suite et fin.—Voy. pages 369 et 385.[Retour au Texte Principal]
Note 6: Norway and its glaciers visited in 1851; followed by a Journal of excursions in the High Alps of Dauphiné, Berne and Savoy, by James D. Forbes, Edinburgh, Adam and Charles Black. 1853.[Retour au Texte Principal]
Note 7: Voir la 23e livraison du Tour du monde.[Retour au Texte Principal]
Note 8: Voir la 2e livraison du Tour du monde.[Retour au Texte Principal]
End of the Project Gutenberg EBook of Le Tour du Monde; Dauphiné, by Various
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE TOUR DU MONDE; DAUPHINÉ ***
***** This file should be named 25435-h.htm or 25435-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
https://www.gutenberg.org/2/5/4/3/25435/
Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the
Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
(This file was produced from images generously made
available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: https://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
https://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.