
SOUVENIRS VÉCUS

151e mille
IMPRIMERIES G. MONT-LOUIS
57, Rue Blatin,
57 CLERMONT-FERRAND
 |
 |
 |
madame marguerite |
| Préface | |||
| CHAPITRE | I. | (1-17) | Avant leur premier séjour à l'Hôtel des Marronniers. |
| — | II. | (18-24) | Premier séjour. |
| — | III. | (25-26) | Du premier au second séjour. |
| — | IV. | (27-37) | Second séjour. |
| — | V. | (38-67) | Du second au troisième séjour. |
| — | VI. | (68-73) | Troisième séjour. |
| — | VII. | (74-119) | Du troisième au quatrième séjour. |
| — | VIII. | (120-124) | Quatrième séjour. |
| — | IX. | (125-161) | Du quatrième séjour au voyage de Londres. |
| — | X. | (162) | Portland-Place. |
| — | XI. | (163-176) | Du retour au premier voyage de Jersey. |
| — | XII. | (177) | L'Hôtel de la Pomme-d'Or |
| — | XIII. | (178-201) | Du retour au second voyage de Jersey. |
| — | XIV. | (202) | Saint-Brelade. |
| — | XV. | (203-229) | Leur fin. |
| — | XVI. | (230) | Ixelles. |
Le JOURNAL DE LA BELLE MEUNIèRE, édité en 1895 par E. Dentu, avait été cliché pour faciliter les réimpressions ultérieures, qui se sont succédé au nombre de plus de quarante. Mais la Maison Dentu a cessé d'être et un incendie a détruit son dépôt de formes.
L'auteur, par suite, a pu reprendre toute liberté de procéder à une réédition personnelle.
Il en a profité pour apporter au texte de 1895 d'attentives retouches consistant surtout en coupures. Il a pensé que les souvenirs vécus se rapportant au général Boulanger et à son Amie gagneraient à être dégagés de divers commentaires, de plusieurs menus faits n'intéressant pas directement les personnages principaux du récit, enfin, de nombreux passages consacrés aux polémiques des années 1888 à 1891.
L'auteur n'a pas hésité à alléger ainsi de plus de 150 pages son Journal, afin d'en présenter une édition refondue, réduite et condensée au possible.
Marie QUINTON.
Nice, Novembre 1910.
Qu'on me pardonne de me présenter moi-même sous ce nom de «Belle Meunière». Depuis mon enfance, je n'en connais pas d'autre. Depuis les années ensoleillées où je jouais, fillette, parmi les rochers et les sources de mon adorable vallée de Royat, tout le monde m'appelait ainsi, les compères aux lourds chapeaux de feutre et les commères aux coiffes plissées.
«La Zenta Mounira». Méritai-je mon surnom? J'en serais trop convaincue s'il m'avait plu de prêter l'oreille à tous ceux qui auraient voulu m'en faire compliment. Aujourd'hui, les belles années s'en sont allées, mais mon nom, lui, ne veut pas les rejoindre. Plus je vais, et plus je le sens peser sur moi comme un regret. Rien n'y fera, je dois m'y résigner: il me le faudra porter jusqu'à la fin.
De bonne heure, j'ai pris une habitude que personne ne m'a enseignée: écrire le journal de ma vie. Je lui ai confié, à ce cher journal, et à lui seul, toutes les angoisses ignorées de l'existence d'une pauvre femme qui a beaucoup souffert. Parfois, les choses vécues dégageaient une telle tristesse que le cœur me défaillait de les écrire. Bien des pages sont restées blanches, tant étaient noires les impressions que j'eusse dû tracer dessus.
Cependant, une clarté est venue traverser quelques années de mon existence. Le hasard m'a fait approcher le général Boulanger à l'époque la plus passionnante de sa carrière. J'ai vu de près, comme je crois que personne n'a pu la voir, sa vie intime, toute pleine de l'amour surhumain qui l'a étreinte jusqu'à l'étouffer.
On ne cesse de me dire que ces choses sont devenues de l'histoire et que je n'ai plus le droit de les garder pour moi. C'est bien. Je détache ces pages de mon livre. Les voici:

Royat, Mai 1895.
1.—Aujourd'hui Samedi 9 juillet 1887
On ne fait que parler de l'arrivée du général Boulanger, forcé hier soir, à Paris, de s'échapper sur une locomotive pour quitter la gare de Lyon, qu'avait envahie une foule immense, et pour n'être pas emporté, étouffé par le peuple qui l'idolâtre.
Tout le monde est bien fier ici de l'avoir maintenant à Clermont, commandant du 13e corps d'armée. Il va nous rester trois ans et, qui sait, c'est peut-être de Clermont que lui, le brave général Revanche, partira pour la guerre, pour la victoire, pour la reprise des provinces perdues.
C'est demain qu'il doit faire son entrée en ville, à la tête des troupes, et qu'il doit aller au quartier général prendre possession de son commandement.
Demain, il va y avoir un monde fou. Toutes les personnes à qui j'ai causé n'ont qu'un désir, un souhait, un seul but de promenade pour demain: aller voir et acclamer le général Boulanger!
2.—Dimanche 10 juillet.
Est-ce que moi aussi je suis atteinte de ce que notre vieil ami et docteur appelait plaisamment, ces jours-ci, la «Boulangite»? Dès mon lever, j'étais sur des charbons ardents; enfin, l'heure approche, je prends mes gants, mon manteau et, au premier moment favorable, je m'échappe, je descends sur Clermont en courant comme je ne l'ai plus fait depuis que j'étais toute fillette!
Pourvu que je n'arrive pas trop tard! Je cours, je cours, je n'ai plus de souffle. Tout le long de la route, une foule de plus en plus compacte se porte vers Clermont.
Bientôt, on ne peut plus avancer qu'au pas, et il me faut faire des prodiges de souplesse pour me glisser à travers tous ces hommes pressés les uns contre les autres.
J'arrive, luttant pied à pied, jusqu'à l'octroi. Mais là, impossible de faire un pas de plus. à partir de ce point jusqu'à la place de Jaude, ce n'est plus qu'une mer humaine. Tout Royat, tout Clermont, tout le département du Puy-de-Dôme,—toute l'Auvergne est là à l'attendre.
J'entends des patois, j'aperçois des coiffes qui viennent d'au moins quinze à vingt lieues à la ronde.
Un vieux paysan, placé près de moi, déclare qu'il n'a jamais vu telle affluence, même au temps où l'Empereur est venu dans le pays. Il paraìt que, passé la place de Jaude, la foule est encore plus immense sur tout le trajet, jusque bien au delà du quartier général.
Le temps est magnifique, le ciel tout bleu, tout ensoleillé. La gaìté de la nature se reflète dans la foule. Personne n'est dans son état normal, on est enfiévré, on palpite. à tout moment éclatent, répétés par des milliers de poitrines, les refrains d'En revenant d'la Revue. Et quand on arrive aux mots:
«Moi, je n'faisais qu'admirer
Le brav' général Boulanger!»
un seul cri s'échappe de toutes les bouches: «Vive Boulanger!»
Tout à coup, des sonneries de clairon parviennent jusqu'à nous, suivies du bruit, lointain d'abord, puis de plus en plus proche, des tambours qui battent aux champs. Et, au même instant, au milieu du silence absolu qui vient de se faire, les musiques des régiments entonnent la Marseillaise.
Ainsi que tous en ce moment, je penche la tête et je fixe les yeux dans la direction de Chamalières, d'où va déboucher le cortège. Une poussée se produit vers le cordon de troupes qui fait la haie et m'empêche, pendant un moment, de voir. Mais je m'accroche, je me hisse sur les épaules de ceux qui sont devant moi et, maintenant, je vois très bien. Toute la largeur de la route est prise par une armée d'officiers de toutes armes, chevauchant en grande tenue. Leurs uniformes scintillent comme s'ils étaient pailletés d'or. Plus près, plusieurs généraux à culottes blanches et coiffés d'un bicorne à plumes noires; enfin, à quelques mètres seulement de moi, très droit sur un superbe cheval noir, le grand cordon rouge entourant le torse, la poitrine constellée de décorations, le bicorne étincelant sous la plume blanche, c'est Lui!
C'est bien Lui, tel que le représentent les images qui ornent jusqu'aux plus humbles de nos chaumières, Lui, le jeune général à la barbe blonde, aux yeux gris d'acier, au profil si puissamment beau! Je le fixe de toute la force de mon regard et, alors, une chose m'a frappée. Sur ce visage de l'homme adoré des foules, en cette minute de triomphe où tout un pays de France l'acclamait, il y avait une expression de tristesse infinie! Je n'ai pas pu me tromper: ses yeux, un instant, se sont abaissés de mon côté; et ces yeux étaient infiniment mornes, et la face tout entière était pâle, assombrie. Je voulus m'en assurer encore, mais, déjà, il m'avait dépassée, tandis que le cri populaire, jusque-là retenu dans toutes les poitrines, ébranlait de nouveau l'espace de son nom.
Je suis remontée à Royat, parmi la foule qui se dispersait. Toutes les impressions de ces minutes inoubliables se pressaient en tumulte dans mon cerveau. Mais la dernière, celle de sa tristesse à Lui au moment de notre enthousiasme à tous, celle-là dominait toutes les autres.
4.—Mercredi 13 juillet.
Demain, jour de la Fête Nationale, les troupes seront passées en revue par le général Boulanger, sur la place de Jaude. Je le reverrai donc,—car je veux le revoir, pour bien lire sur son visage...
5.—Jeudi 14 juillet.
La revue s'est faite, mais Il n'y était pas. C'est un général à plume noire qui commandait. La foule était plus grande encore que ce dimanche, et cela a été pour tous une immense déception.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
13.—Lundi 10 octobre.
Nous prenons nos quartiers d'hiver, car, décidément, la saison et l'arrière-saison sont bien finies. Je congédie pour le 15 les extras que j'avais encore retenus à mon service passé le 1er octobre.
J'ai fait fermer la plupart des locaux, j'ai réduit au strict minimum les fournitures qu'on m'apporte tous les jours. Nous allons passer maintenant au travaux d'hiver, à commencer par les soins à donner au vin nouveau.
14.—Jeudi 13 octobre.
Que vient-on de m'apprendre? Le général Boulanger mis aux arrêts de rigueur pendant trente jours pour avoir flétri les scandales dont le flot boueux monte sans cesse.
16.—Samedi 22 octobre.
Ce soir sont venus dìner deux messieurs, visiblement des officiers en civil, le plus âgé grand, très brun, fortement charpenté, grosse moustache noire, l'autre de taille plutôt petite, cheveux blonds, mince moustache blonde, une tête de vrai gentleman, toute fine et distinguée.
Les voilà installés. Mon rôle est terminé pour l'instant, et je leur tire ma révérence, me promettant simplement d'aller les reconduire lorsqu'ils s'en iront, afin de leur poser la question traditionnelle: «Avez-vous été satisfaits, Messieurs?»
Mais ce sont eux qui me font appeler. Ils en étaient au dessert. Le plus âgé prend la parole, me complimente sur le dìner, puis me demande s'il m'est possible de recevoir des pensionnaires dans le courant du mois et quels appartements je pourrais leur donner?
Je prends aussitôt une lampe et les invite à me suivre. Nous montons au premier étage. Je leur fais voir les deux chambres à coucher et la salle à manger qui s'y trouvent. Ils les examinent avec le plus grand soin, les parcourent en tous sens, se rendent minutieusement compte de la distribution, se font ouvrir les fenêtres, m'interrogent sur mille détails, enfin, se déclarent satisfaits de cet appartement, pourvu que je transforme l'une des deux chambres à coucher en un cabinet de toilette des plus confortables. Ils me laissent deux jours pour tout mettre en état.
Nous redescendons, et ils sont sur le point de franchir le seuil de la maison, quand, tout à coup, ils reviennent vers moi avec l'air d'avoir oublié quelque chose. Ils se regardent un moment, comme s'ils se demandaient qui parlerait le premier. Je les regarde de mon côté et nous restons ainsi une bonne minute. Enfin, le plus âgé se décide et me dit à voix basse: «Nous aurions encore quelque chose à vous demander, tout à fait en particulier.»
Sans un mot, je les ramène dans leur salle à manger, et, la porte refermée, je leur fais signe de s'expliquer.
«Ce que nous avons à vous demander, continue le même, est une faveur exceptionnelle... Voici: nos amis, qui doivent arriver chez vous après-demain soir, tiennent à prendre les plus grandes précautions pour n'être pas reconnus... Sans doute s'en exagèrent-ils la nécessité: mais, puisqu'ils y attachent une telle importance, il faut, Madame, que vous fassiez en sorte que personne, entendez-vous, personne, ne puisse se douter de leur présence ici... Il faudrait donc que personne, même de vos gens de service, ne puisse pénétrer dans l'escalier et dans les couloirs pendant tout le temps qu'ils passeront ici... Il faudrait, en un mot, et c'est la faveur que nous vous demandons, que nos amis soient servis exclusivement par vous...»
La demande m'a tellement surprise, c'était pour moi chose si nouvelle, que je suis restée un bon moment sans répondre. Ils ont insisté tous deux:
«Nous vous le demandons instamment, Madame...»
Alors, je leur ait dit: «Oui», et ils sont partis. De la part de qui venaient-ils? Quel est ce couple mystérieux que ma maison devra cacher aux yeux du monde?
17.—Dimanche 23 octobre.
J'ai longuement réfléchi aux dispositions à prendre pour bien recevoir le couple annoncé avec tant de mystère par ces deux officiers en civil et surtout pour qu'il se sente en pleine sécurité. Il m'est venu subitement une réflexion singulière: ce visiteur, qui a tant intérêt à ce que personne au monde ne puisse soupçonner sa présence sous mon toit, ne serait-ce pas le fameux commandant en chef du 13e corps, le général Boulanger lui-même?
Je me suis dit aussitôt que c'était impossible, puisque les arrêts de rigueur ont transformé sa résidence de Clermont en une prison dont il lui est interdit de sortir avant le mois prochain. Mais, j'ai beau me répéter encore que cela n'est pas, il y a une idée fixe qui me hante en m'affirmant le contraire.
Décidément, la boulangite me tourne la tête! Elle me fait voir du Boulanger un peu partout.
Du moins, mon idée fixe ne sera-t-elle pas pour faire du tort au couple attendu demain. Dans l'incertitude, je soigne l'installation de leur logement comme je ne l'ai jamais fait de ma vie. à défaut des dorures de nos grands hôtels de Royat, je veux qu'ils trouvent chez moi un nid tout plein de gaìté, de lumière et de fleurs.
J'ai levé, dès ce matin, une grosse difficulté qui m'inquiétait un peu. J'ai fait comprendre à ma vieille mère et à ma bonne sœur qu'il fallait s'effacer, s'en remettre entièrement à moi, me laisser maìtresse absolue d'agir comme les circonstances le commandaient. Les excellentes femmes m'aiment tant et me portent une confiance tellement illimitée qu'elles n'ont pas fait une objection. Elles vont s'installer dans une autre aile de la maison et me laisseront toute seule ici, dans une chambre située au-dessus de l'appartement du couple. Ma vieille servante Françoise, mise au courant à son tour, me secondera avec la plus entière discrétion.
Ce soir, sont venus dìner des journalistes et des messieurs du Conseil municipal de Clermont. Naturellement, on n'a parlé que de deux choses: des scandales des décorations et des arrêts du général Boulanger.
«Rester un mois chez soi, a dit un de ces messieurs, la belle affaire, vraiment, et la grande privation, quand on est bien portant, confortablement installé, doté d'une bonne cuisine et qu'on a, par-dessus le marché, sa femme près de soi...»
«Oh! quant à ce dernier point, a dit un autre, autant ne pas en parler. On sait parfaitement que Mme Boulanger est une très digne et respectable dame, mais qu'elle n'est plus une épouse pour le général.»
Cette opinion a surpris la plupart des assistants. Une discussion s'est engagée. Les uns soutenaient que le général était excellent père de famille, époux modèle, à quoi les autres ont répondu que le général était un «cascadeur», qu'il ne s'en cachait guère, du reste, et qu'on l'avait assez vu avec la «dame blonde»...
à ce moment précis, Françoise est venue me réclamer. Je l'ai envoyée au diable.
«Oui, Messieurs, disait l'un des journalistes, la petite dame blonde qu'on a tant de fois aperçue traversant avec lui le Bois de Boulogne en coupé fermé... Elle a beau mettre d'épaisses voilettes, on a tout de même fini par démasquer son incognito...»
«Son nom! son nom!» se sont-ils tous écriés.
«Eh bien! Messieurs, c'est tout simplement Mlle R..., de la Comédie-Française, la toujours jeune et mignonne ingénue!»
Françoise me rappelait, je me suis enfuie.
Une actrice!
18.—Lundi 24 octobre.
3 heures de l'après-midi
Ce matin, je suis descendue à Clermont pour me procurer des plantes et des fleurs. Je suis entrée chez le plus grand photographe, et j'ai demandé le portrait de Mlle R..., de la Comédie-Française. Je l'ai là sous les yeux. Ce n'est pas une véritable beauté, mais on n'est pas plus mignonne, plus délicate. Et quelle expression de finesse dans ce regard, dans ce sourire!... Sera-ce elle?
J'aime mieux penser à autre chose. Je suis heureuse de jeter ces notes, en attendant qu'approche l'heure où se résoudra l'énigme: dans trois heures d'ici, à six heures! Si je ne me donnais pas cette distraction, je mourrais d'impatience!
Voyons, je vais faire le «voyage autour de ma chambre», décrire l'appartement, maintenant tout prêt.
Il occupe le premier étage, au haut de l'escalier qui commence à la petite porte donnant sur le chemin de la Grotte de Royat. Un couloir sur lequel débouchent trois pièces: à gauche, la chambre à coucher; à droite, le cabinet de toilette; à droite, tout au fond, la salle à manger. On ne peut arriver à celle-ci que par le couloir, mais on peut passer de la chambre à coucher dans le cabinet de toilette directement, en traversant seulement une petite pièce intermédiaire, pratiquée aux dépens du cabinet de toilette par une cloison posée après coup.
La salle à manger a trois fenêtres, dont deux donnant sur la terrasse de l'hôtel et la troisième sur la route de la Vallée. à part le buffet, le dressoir, la table, les fauteuils en chêne, j'y ai fait placer, à tout hasard, un piano.
La fenêtre du cabinet de toilette et celle de la petite pièce intermédiaire donnent toutes deux sur la vallée de Royat elle-même, sur la gentille Tiretaine qui ruisselle et serpente au fond du ravin. La chambre à coucher a deux fenêtres, l'une s'ouvrant sur la vallée, l'autre lui faisant vis-à-vis et donnant sur le chemin de la Grotte.
Leur plaira-t-elle? Si non, ce ne sera pas de ma faute, car, toute l'ingéniosité dont je puis disposer, je l'ai employée à la rendre coquette et avenante. De toutes parts, j'ai placé des fleurs: ici des roses tout épanouies, là des œillets sur le point de s'ouvrir.
Les rideaux du lit et des croisées sont en guipure crème doublée de satin rose. Les tentures sont en une étoffe qui n'a pas grande valeur, mais qui en prend sous la lumière, car elle est entre-semée de paillettes d'or. J'ai répandu la lumière à profusion, tout en ne lui laissant aucune crudité. J'ai suspendu au plafond une lampe à trois becs, surmontée d'un abat-jour rose que j'ai été longue à trouver. Sachant que les Parisiennes aiment à se coiffer, tout en causant, dans leur chambre, j'ai installé une table de toilette, aux deux côtés de laquelle j'ai appliqué deux lampes ayant pour verres deux tulipes roses. Sur la cheminée, j'ai mis deux candélabres à six branches. Il y avait une pendule au milieu, mais je l'ai remplacée par des fleurs. Son tic-tac aurait pu incommoder. Les Parisiennes sont si nerveuses!
Dans l'âtre flambe, depuis ce matin; un bon feu de bois.
5 heures
Je me suis interrompue pour descendre à la cuisine, puis placer une lumière dans l'escalier. J'ai mis simplement une petite veilleuse, qui jette une clarté tout juste suffisante pour distinguer les marches. J'ai poussé la porte donnant sur le chemin de la Grotte, la laissant à peine entrebâillée. Il fait, dehors, un temps épouvantable, une vraie tempête. Le vent hurle avec fureur.
Je suis remontée glacée, à travers l'escalier sombre, et je me suis sentie aveuglée, étourdie, en me trouvant dans cette chambre tiède, parfumée et toute éblouissante de lumière.
Au dernier moment, je viens de me rappeler un détail. Avec tant de lumières à l'intérieur, les volets à claire-voie des fenêtres ne peuvent pas suffire. Il ne faut même pas qu'on devine, au dehors, que la chambre est éclairée. Vite, j'ai saisi des tapis de table doublés de satinette, et je les ai interposés entre la vitre et le volet. Maintenant, que l'on observe les fenêtres tant qu'on voudra, impossible d'apercevoir le moindre filet de lumière.
L'heure approche. Le cœur me bat à tout rompre, d'un tic-tac que je n'ai jamais encore senti si violent ni si précipité. Je ne tiens plus en place. Dieu, que c'est long!
minuit
Vais-je me retrouver dans tout ce qui vient de se passer? Il y a eu des moments où j'ai cru que ma pauvre tête allait éclater, tant j'ai éprouvé d'émotions diverses. En cet instant même, elle me fait mal comme si elle avait reçu des coups de marteau.
Quand six heures ont sonné, je me suis mise à écouter les bruits du dehors, afin de guetter la voiture, et, dès qu'elle approcherait, de la faire avancer tout contre le pas de la porte, de manière à ce qu'il n'y eût même pas à mettre pied à terre sur la chaussée. Je n'entendais rien que le bourdonnement de mes oreilles...
Six heures un quart. Mille suppositions contradictoires se pressaient en tumulte dans mon esprit. Viendront-ils? Est-ce Lui? Arrive-t-elle de Paris? Le mauvais temps ne les arrêterait-il pas? Quel est l'empêchement?...
Tout à coup, j'entends la porte du dehors s'ouvrir très doucement, et des pas étouffés qui montent l'escalier. Je m'avance sur le palier. Une femme voilée passe devant moi, suivie d'un homme qui tient à la main deux grosses valises. Il me les tend sans mot dire et je les porte dans le cabinet de toilette l'une après l'autre, car elles sont bien lourdes.
Ils sont entrés droit dans la chambre à coucher. J'y vais à mon tour. Tout éblouie, je ne vois d'abord rien que deux vagues silhouettes.
Je débarrasse de son manteau,—un lourd manteau de loutre,—la dame, qui se laisse faire sans se retourner. Puis, prenant mon courage à deux mains, je lève les yeux...
Déception! Ce n'est pas Lui! C'est un homme de haute taille, aux yeux noirs, avec une longue barbe brune.
J'étais désespérée et furieuse contre moi-même de m'être monté l'imagination par un tout autre mirage. Je regrettais amèrement d'avoir promis de servir en personne ces gens-là, ces étrangers. J'en avais du dépit jusqu'à vouloir rompre ma promesse immédiatement.
J'en étais là de mes réflexions, et je me tenais sur le palier, quand j'ai vu le monsieur sortir de la chambre et prendre la rampe de l'escalier. M'apercevant, il s'est avancé vers moi, et m'a dit en chuchotant: «Vous allez laisser, jusqu'à neuf heures, la porte d'en bas entr'ouverte comme je l'ai trouvée, et vous tâcherez qu'il y ait dans l'escalier moins de lumière encore, si possible.» Il est parti sans ajouter un mot.
Du même coup, un poids écrasant me tombait de la poitrine. Cet homme parti, un autre allait donc venir?
Mais qui? qui?? Et l'idée fixe me reprenait, me murmurait à l'oreille son nom à Lui...
Un détail m'apparaissait maintenant très clair: sans aucun doute, l'homme qui venait de partir ne faisait qu'un avec le plus grand des deux officiers qui avaient dìné ici avant-hier. Je ne sais quoi, une inflexion de voix ou un geste me l'avait fait reconnaìtre sous sa barbe noire dont, avant-hier, il n'y avait pas trace. Pourquoi cette fausse barbe? Lequel des deux amants qui allaient ici se rejoindre avait-il besoin de tout ce mystère, digne d'un secret d'État?
Toute préoccupée, j'avais pris la veilleuse et je l'avais montée trois marches plus haut; l'escalier se trouvait ainsi plongé dans une obscurité presque complète.
Un coup de sonnette me fit tressaillir. Il venait de la chambre d'en haut. Il me rappelait brusquement à la réalité. J'avais tout à fait oublié qu'il y avait là-haut une femme.
Je monte en toute hâte, je frappe. Une voix argentine me répond: «Entrez!» J'entre et je me trouve en présence de cette femme et, du premier coup d'œil, je vois que, ce n'est pas l'actrice dont j'ai regardé le portrait.
Certes, ce n'est ni cette actrice, ni une autre. L'expression du visage, infiniment douce, très simple, presque virginale et un peu grave en même temps, révèle, sans hésitation possible, la femme d'intérieur qui n'a jamais eu à affronter le public. Quant à l'apparition tout entière, elle est empreinte d'une telle distinction que je me sens aussitôt en présence d'une grande, d'une très grande dame.
Me faisant signe d'approcher, elle me sourit et me donne en mains deux petites clefs: «Je vous prie de défaire les deux valises», dit-elle.
Je cours au cabinet de toilette, je les ouvre: un parfum délicieux s'en échappe. Je me mets à les vider, j'en retire une quantité incroyable de linge fin, d'objets de toilette, de vêtements, de falbalas comprimés au possible là-dedans.
Pendant qu'agenouillée à terre je me livre à ce travail, avec une maladresse que mon énervement ne fait qu'accroìtre, la belle dame passe et repasse, cherche parmi les objets, prend avec elle diverses choses.
Le déballage terminé, je m'occupe de ranger tout cela dans les armoires. Puis, je ne sais plus trop que devenir de ma personne. Faut-il rester? faut-il me retirer? Je n'ai jamais été aux ordres de personne, et mon nouveau métier de femme de chambre me rend toute perplexe.
La même voix argentine se fait entendre à nouveau: «Voulez-vous venir un instant?...»
Je pénètre dans la chambre. Elle est assise à sa toilette, en élégant peignoir blanc, ses cheveux blonds à moitié dénoués. Elle me montre d'un geste les vêtements de ville qu'elle vient d'ôter, manteau de loutre, chapeau garni de loutre aussi, robe de voyage en drap capucin soutachée de noir. Je les emporte dans la pièce à côté.
Je revins vers elle dans l'intention de me retirer, mais elle m'arrête d'un signe de main, me regarde en souriant très doucement, puis me dit: «Nous allons donc vivre avec vous, chez vous, près de vous pendant quelques jours... Plus tard, vous apprendrez à nous connaìtre. Vous saurez qui nous sommes. Aujourd'hui, vous ne devez voir en nous que des inconnus... Eh bien! malgré le mystère qui doit nous entourer, je veux vous dire une chose qui pourra vous paraìtre étrange,—mais croyez surtout que je ne la prodigue pas... Nous sommes venus vers vous parce que nous savons qui vous êtes. Ce que je viens de voir de vous me confirme que nous ne nous sommes pas trompés...»
L'expression de ses traits était devenue plus grave pendant qu'elle parlait ainsi. Alors, elle se remit subitement à sourire, me fixa bien en face de ses yeux bruns clairs, et, me tendant la main, me dit très doucement: «Voulez-vous être mon amie?»
J'étais toute surprise et émue par la manière infiniment délicate dont elle venait de me parler.
Sans trouver d'autre réponse, je baisai sa main et je me retirai.
J'allais et venais dans ma maison, me répétant sans cesse: «Quelle femme exquise!» quand un nouveau coup de sonnette m'a rappelée près d'elle.
En ouvrant la porte, je fus éblouie par le spectacle qui s'offrait à mes yeux. Elle se tenait debout, au milieu de la chambre, en grande toilette de soirée satin lilas, recouverte de dentelles noires. Le corsage, très décolleté, laissait à nu son cou, ses épaules, ses bras. Des diamants resplendissaient de toutes parts. Une aigrette scintillait dans sa chevelure blonde d'or. Elle était féerique à voir.
Jamais je n'avais vu d'apparition aussi harmonieusement belle. Les nuances des étoffes et l'éclat des bijoux s'accordaient merveilleusement avec la blancheur mate des chairs. Une rose thé était fixée au corsage et un œillet rouge dans les cheveux.
Elle souriait à mon admiration muette. J'ai fini par laisser échapper ce cri: «Dieu, Madame, que vous êtes belle!»
«IL faut être belle pour celui qu'on aime», a-t-elle répondu. Puis elle m'a demandé de lui apporter l'indication exacte de tous les départs de courriers pour Paris, et elle s'est mise à écrire une lettre.
Pendant ce temps, je suis allée à la salle à manger préparer le couvert. Neuf heures ont sonné. La tempête du dehors redoublait de violence. Un chien du voisinage hurlait désespérément.
J'étais énervée au plus haut degré, quand j'entends de nouveau la porte d'en bas s'entr'ouvrir. Je cours vers l'escalier où vient de s'engouffrer une rafale qui menace d'éteindre la veilleuse. J'aperçois deux silhouettes d'hommes barbus arrêtés au bas des marches et prêtant l'oreille du côté de la route. Au bout de quelques moments, le plus grand de ces hommes prend des mains de l'autre une valise que celui-ci portait, et lui dit à voix très basse: «à demain, neuf heures.» L'autre s'échappe aussitôt par la porte, qu'il referme après lui, tandis que le premier se met à monter.
Je descends vers lui, il m'entrevoit, je prends la valise qu'il me tend. Je remonte, il me suit. Je frappe doucement. La voix argentine répond. J'ouvre...
Au même instant, l'homme qui me suivait se précipite dans la chambre, et deux cris, deux cris inoubliables, se croisent:
«Marguerite!»
«Georges!»
Il s'est jeté dans ses bras, il la serre à la broyer, il la couvre de baisers avec une impétuosité sans nom. Elle veut parler, il lui ferme la bouche de ses lèvres, et il l'embrasse avec furie, sur les cheveux, le front, les yeux, le cou, les épaules, les bras, les mains, partout où sa bouche rencontre la chair de sa bien-aimée.
C'est une scène indescriptible de félicité, de délire, de bonheur surhumain.
Je me retire, complètement étourdie de ce que je viens de voir. La violence de cet amour surpasse tout ce que je pouvais imaginer. Et l'homme qui aime ainsi, c'est Lui, l'idole des foules, c'est le général Boulanger!
Maintenant que j'en ai la certitude, mon cœur se gonfle d'orgueil et de joie. Lui, sous mon toit! Lui, confié à ma garde!
Dois-je lui montrer que je l'ai reconnu, ou faut-il, au contraire, que je fasse celle qui ne sait pas? Dois-je, lorsqu'il sonnera, l'aborder en disant: «Mon général?»
Je discute avec moi-même, et je décide que non. Ils ne me connaissent pas encore, il faut leur laisser le temps de m'accorder leur confiance jusqu'à me révéler ce qu'ils croient être un secret pour moi. Il faut qu'ils se croient ignorés pour être complètement tranquilles et heureux.
Justement, on sonne. Il y a une heure environ que je les ai laissés. Je monte et les trouve debout, étroitement enlacés l'un à l'autre.
«Pouvons-nous dìner?» me demande-t-il par-dessus la blanche épaule de son adorée. Et moi de répondre: «Oui, Monsieur.»
à ces mots, ils s'embrassent comme si ce «Oui, Monsieur», les comblait de joie.
Quand ils sont passés dans la salle à manger, je puis les observer à mon aise. Le général ne porte pas plus que la quarantaine. Les cheveux, châtains clairs et nullement blonds d'or comme sur les images d'Epinal, sont taillés ras en arrière et laissés plus longs en avant. Ils sont très fournis et très fins. Une raie les sépare un peu de côté et les relève légèrement à gauche. La barbe, coupée en pointe, possède une nuance à peine plus claire. L'ensemble de la figure est volontaire et martial. Le torse paraìt plus haut et plus large que ne le comporterait la taille, plutôt moyenne. Le vêtement est très simple: une jaquette bleue sombre et un pantalon à raies. La cravate, adaptée au col rabattu, porte comme épingle un œillet en rubis orné d'un diamant.
Mais, ce qui achève de rendre cette physionomie inoubliable, ce sont les yeux, des yeux d'un bleu intense, profondément enfoncés dans le creux que laisse la proéminence des sourcils,—des yeux toujours grands ouverts et fixes, tantôt pénétrants ainsi que des lames d'acier, tantôt inexpressifs et vides comme s'ils étaient de cristal, tantôt, sous les sourcils froncés, lançant des éclairs, tantôt devenant infiniment caressants dès qu'ils se posent sur Elle.
Et ils ne cessent de se poser sur Elle, pendant qu'il lui parle d'une voix grave, sonore, point du tout cassante comme chez les militaires, et qu'il tamise encore en lui parlant. Le geste est sobre, le jeu de physionomie presque nul, mais le rire est celui d'un jeune homme tout plein du bonheur de vivre.
Tout en m'occupant de les servir, alors qu'ils s'occupent fort peu de manger, j'entends une partie des propos qu'il lui tient: «Ma Marguerite, si tu savais... J'ai tant souffert... loin de toi... Toi aussi? Non, je t'en supplie, ne me le dis pas! Laisse-moi croire que j'ai été seul à souffrir, que toi tu as été épargnée, que tu t'es endormie pour ne te réveiller qu'en ce moment, et que, pendant toute notre séparation, tu n'as fait qu'un seul et beau rêve... Laisse-moi tout ce qui est torture, douleur, chagrin: tu sais que je suis fort... Oui, mais une attente d'une heure encore, et je serais devenu fou! Il aurait peut-être été prudent que je ne sorte qu'une heure plus tard, mais je sentais bouillonner dans mon cerveau une telle chaleur que j'en étais effrayé... J'ai été sur le point de sauter du second étage plutôt que de descendre l'échelle posée contre le mur...»
Pendant qu'il parlait avec une passion inouïe, pendant que ses yeux jetaient des étincelles, Elle, plus calme, un peu maternelle, le grondait doucement: «Georges, Georges, soyez sage... Ne parlez plus de cela... Plus un mot, je vous en prie, de tout ce qui n'est pas notre amour...»
Au dessert, je me suis retirée, sans même leur dire bonsoir.
Les voilà donc au comble du bonheur pendant que j'écris ces lignes, dans ma chambrette située juste au-dessus de leur nid.
19.—Mardi 25 octobre.
Ma mère et ma sœur m'ont demandé ce matin si les voyageurs attendus étaient arrivés et si je les connaissais. J'ai répondu qu'il était venu un monsieur et une dame que je ne connaissais pas.
Les mots qu'il avait dits hier soir à l'homme avec lequel il était venu: «à demain, neuf heures!» me trottaient par la tête. à neuf heures du matin, j'étais sur le qui-vive, près de la porte.
Un pas de cheval approche, un cavalier s'arrête et frappe à la porte avec le manche de sa cravache. Je sors, et j'aperçois un capitaine d'infanterie dans lequel je reconnais le plus jeune des deux messieurs qui avaient dìné ici samedi. Je devine maintenant qu'il était venu, lui aussi, hier au soir, muni d'une fausse barbe, escortant son général pendant que son camarade avait la mission d'accompagner l'adorée...
Après m'avoir saluée comme s'il me voyait pour la première fois, le capitaine me demande si, dans un instant, je ne pourrais pas lui servir une tasse de café au lait sans qu'il ait besoin de mettre pied à terre...
En effet, quelques minutes plus tard, le voilà qui repasse devant la porte. Dès que j'entends le sabot du cheval, je sors, je lui présente le plateau et je verse ce qu'il a demandé. Il prend la tasse, la vide d'un seul trait, la repose sur le plateau. Au même instant, je vois ses yeux me fixer avec insistance et me faire signe de regarder le plateau.
Je regarde: j'aperçois sous la tasse une enveloppe toute blanche que je ne lui avais même pas vu glisser... J'ai compris. Il me salue et part au grand trot dans la direction de Clermont.
Je monte frapper à leur porte. Deux voix me répondent: «Entrez!» Leur chambre est plongée dans une demi-obscurité, toute fraìche et parfumée.
Je dépose la lettre près d'eux en expliquant comment elle m'a été remise. Je me hâte d'enlever les tapis qui calfeutrent les fenêtres et d'ouvrir les volets. Voici la chambre inondée de lumière. Je m'accroupis à la cheminée pour faire du feu, tout en les observant du coin de l'œil.
Il est couché dans le fond du lit, en train de lire la lettre à travers un lorgnon qu'elle vient de prendre sur la petite table et de lui passer. Appuyée contre son épaule, elle suit des yeux ce qu'il lit. Elle est enveloppée entièrement d'une chemise comme je n'en avais jamais vu: une sorte de peignoir en surah opaque et fin, garnie jusqu'aux poignets d'entre-deux de valenciennes et se refermant par devant à l'aide de larges rubans de soie rose noués de place en place.
Le feu allumé, je me retire. C'est seulement à midi qu'ils m'ont sonnée pour déjeuner.
Il portait un vêtement de chasse en grosse laine couleur marron. Elle avait pris une nouvelle transformation, aussi ravissante que sa toilette d'hier soir: une robe simplette en mousseline de soie blanche avec une grande ceinture de surah rose et des manches exquises, ne tombant qu'à mi-bras, entr'ouvertes de haut en bas, réunies seulement par des agrafes de diamants et de rubis entre lesquelles s'apercevait le bras nu.
Lui, un ambitieux, un César? On ne peut pas être plus dégagé de toute pensée sérieuse, plus enjoué, plus câlin, plus enfant, qu'il ne l'a été durant tout ce déjeuner, oubliant de manger à force de la couver du regard, ne la quittant pas des yeux, saisissant tout prétexte pour lui couvrir les mains et les bras de baisers fous.
Des phrases entrecoupées de baisers qu'ils se murmuraient, j'ai compris que, jamais encore, ils n'avaient été aussi réunis, aussi tranquilles qu'ici... Ils ont fait allusion aux entrevues qu'ils avaient eues jusque-là, à Paris, furtivement, la nuit... Il a répété plusieurs fois: rue de Bercy... J'ai cru comprendre que c'était son domicile à Elle. à un moment, il s'est écrié, les yeux en feu: «Voilà dix mois que je rêvais ce tête-à-tête!»
Il l'aime depuis dix mois! Et les journalistes bien informés qui colportent la fable de l'actrice blonde!
En se levant de table, il m'a avertie que si je voyais arriver l'un des deux amis qui avaient retenu l'appartement, je le fasse attendre en bas et je prévienne.
Ils n'ont pas eu besoin de moi l'après-midi. à huit heures du soir, l'officier de ce matin est revenu, à pied, cette fois, et en civil. Sans un mot, je l'ai fait entrer dans une petite pièce du rez-de-chaussée et je suis montée prévenir. Je les ai trouvés près de la cheminée, causant à voix basse, Lui, assis dans un grand fauteuil, près de la lampe, et Elle, assise sur ses genoux, toute pelotonnée contre Lui. Il m'a tendu deux lettres. Je les ai portées à l'officier, qui est reparti aussitôt.
Une heure après, ils m'ont appelée pour le dìner. Elle avait l'éblouissante toilette d'hier.
à peine à table, comme s'ils s'étaient donné un mot d'ordre, ils ont commencé à me parler, alors que, jusque-là, ils ne s'étaient pas du tout occupés de moi. J'étais sur mes gardes. Il s'est mis à causer politique. Je le voyais venir... Et, de fil en aiguille, le voilà qui me questionne sur le général Boulanger.
Je lui réponds comme une humble femme qui n'a jamais vu le général, mais qui est tout acquise à la cause patriotique qu'il incarne.
«Mais enfin, a-t-il répondu, en me fixant de ses yeux d'acier, comme s'il voulait me percer à jour, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu la curiosité d'aller voir le général Boulanger de vos propres yeux?»
«Monsieur, lui ai-je dit très tranquillement, j'ai tant à faire à la maison que je ne puis jamais sortir. Pour voir le général Boulanger, il aurait fallu qu'il lui prenne fantaisie de venir jusqu'ici déjeuner ou dìner...»
Ma réponse a paru l'enchanter, ainsi qu'elle. Alors, il m'a demandé:
«Croyez-vous que le général réussira dans le but qu'il poursuit?»
«Monsieur, j'en suis sûre, et je ne suis pas seule de cet avis!»
«Vous en êtes sûre? Et pourquoi?»
«Parce que je suis sûre qu'il aime et qu'il aimera toujours son but par-dessus tout!»
à ces mots, elle s'est mise à lui sourire singulièrement. Il a tourné les yeux vers elle, et ces yeux jetaient des éclairs. J'ai senti que je devais m'effacer un instant. à peine avais-je refermé la porte, que je l'ai entendu se jeter violemment à ses pieds, et s'écrier avec un accent éperdu: «C'est toi, Marguerite, c'est toi que j'aime par-dessus tout!»
Au bout d'un instant, je suis rentrée. Il avait repris sa place. Ils se tenaient les deux mains par-dessus la table, ils se regardaient les yeux dans les yeux et ils se souriaient.
Après dìner, je suis entrée dans leur chambre pour arranger le feu, puis je leur ai fait ma révérence: «Bonsoir, monsieur et dame!»
Tous deux se sont avancés vers moi, m'ont tendu leurs mains, et m'ont dit, avec le plus affectueux sourire: «Merci, nous nous trouvons très heureux chez vous.»
Maintenant, mon opinion est faite. Cet homme aime cette femme autant qu'il est possible d'aimer. Il est tout à elle, il ne vit plus que par elle. Elle fera de lui ce qu'elle voudra.
Puisse-t-elle être bonne autant qu'elle est belle! Puisse-t-elle avoir le cœur assez grand pour se sacrifier, s'il le faut, un jour, afin qu'il remplisse sa destinée pour le bonheur de mon pays!
20.—Mercredi 26 octobre.
Ce matin, le capitaine est revenu à cheval et m'a glissé une lettre par le même procédé.
Ils se sont levés à midi. Ils étaient, à déjeuner, habillés de même qu'hier. Elle était vraiment divine dans cette robe blanche, avec ses cheveux d'or coiffés à la vierge, son visage un peu pâle, ses yeux un peu cerclés de bleu. Il était plus amoureux, plus caressant encore si possible. Il ne pouvait se tenir en place, se précipitait à tout moment vers elle, la renversait sous ses baisers, lui murmurait à l'oreille des choses qui devaient être délicieuses, car elle défaillait de joie...
Le soir, l'officier est venu, en civil, prendre des lettres que je lui ai remises. Au dìner, elle avait la même robe de soirée que la veille et l'avant-veille, mais modifiée du tout au tout par quelques-uns de ces détails dont les femmes de goût ont seules le secret: une guirlande de roses et d'œillets retenue au corsage par des agrafes de diamants, une libellule en brillants dans les cheveux. Une reine sur son trône n'est pas plus majestueusement belle. Une reine?... Qui sait ce qu'elle sera?...
Ils m'ont dit bonsoir de la même manière affectueuse, et ils ont répété qu'ils se sentaient extrêmement bien chez moi.
Je n'avais plus parcouru les journaux depuis trois jours. Je viens de le faire. Voici ce que je lis au sujet des arrêts de rigueur infligés au général Boulanger:
«Cette peine n'emporte que la privation absolue de sortir.
»On n'exerce aucune surveillance sur l'officier aux arrêts et l'on se fie à son honneur.
»Si la violation des arrêts de rigueur était dûment constatée, ils seraient transformés en arrêts de forteresse, qui entraìnent, de ce fait, l'emprisonnement, sans préjudice de conséquences plus graves.
»Avec un homme comme le général Boulanger, cela n'est pas à craindre.
»On peut n'être pas d'accord sur certains points, mais il est une appréciation sur laquelle personne ne varie: c'est que le général Boulanger est homme d'honneur.»
Ce que je viens de lire me glace d'effroi. Ainsi, pour l'amour de cette femme, le général est sorti de chez lui, au risque d'être reconnu, d'être arrêté, conduit dans une forteresse, cassé, peut-être!...
Lui, l'exemple de la discipline, il a violé la discipline!... Plus encore! Lui, l'honneur militaire personnifié, il a commis un acte qui équivaut à la rupture d'une parole d'honneur!
Et elle l'a laissé faire!
Non, je ne veux rien blâmer, rien supposer.
Je veux croire qu'il le fallait... Mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'on ne le découvre pas!
21.—Jeudi 27 octobre.
La journée s'est passée comme hier. à déjeuner, il a plusieurs fois essayé de me surprendre par des questions relatives au général Boulanger, mais j'ai eu la chance de parer tous les coups.
Le soir, le capitaine n'est pas revenu, mais il est venu à sa place, en civil, l'autre officier, le grand brun qui avait dìné avec lui samedi dernier et que j'avais reconnu lundi sous sa fausse barbe noire.
Celui-là doit être plus intime avec le général, car j'ai été chargée de le faire monter chez eux.
Il est resté à dìner. Le général a beaucoup causé avec lui et, comme il parlait à voix bien plus haute que quand il est en tête à tête avec son adorée, j'ai pu saisir une partie de la conversation. Elle portait sur la façon dont il avait quitté, lundi soir, le quartier général. Il semble que cela n'a pas marché tout seul. Une grande échelle avait été posée contre une fenêtre donnant sur le jardin; on s'en était servi pour assujettir les gonds de la persienne et on l'avait laissée là comme par mégarde. Le général était descendu par cette échelle dans le jardin, aussitôt la nuit tombée, et s'était tenu près d'une heure caché dans une charmille. Puis il avait sauté dehors par une brèche du mur de clôture. Il avait marché seul, dans la nuit, pendant deux kilomètres, jusqu'au chemin de la Poudrière, le plus désert des faubourgs de Clermont. Là, il avait trouvé une voiture dans laquelle l'attendait son officier d'ordonnance avec sa valise, sortie du quartier général déjà plusieurs jours auparavant et cachée jusqu'à ce moment chez l'officier en question qui était, je le suppose, le capitaine que je vois arriver tous les jours.
La voiture les avait conduits par l'ancienne route de Royat, jusqu'au parc de l'établissement thermal, en cette saison noir et désert. Le reste du chemin, ils l'avaient fait à pied, à travers les petits sentiers qui longent le fond de la vallée et aboutissent à ma maison en passant par mon moulin, maintenant hors d'activité.
C'est surtout Elle qui s'informait avec intérêt de toutes les menues circonstances de cette aventure, dont elle paraissait entendre pour la première fois le récit détaillé.
Puis, ils en sont venus à parler de ce qui se passait maintenant au quartier général. Personne ne se doutait que la cage était vide. Personne n'était admis auprès du général, à l'exception de ses deux officiers d'ordonnance, en sorte que le secret était bien gardé...
J'aurais bien voulu entendre la suite de la conversation, d'autant plus qu'en rentrant, après être allée chercher le café et les liqueurs, j'ai compris à leurs regards qu'ils venaient de parler de moi... Mais, dès lors, ils se sont mis à causer à voix basse et je n'ai plus rien saisi.
Le monsieur n'a pris congé d'eux qu'à onze heures passées.
22.—Vendredi 28 octobre.
Le capitaine m'a glissé plusieurs lettres ce matin. à la lecture de l'une d'elles, Elle est devenue toute soucieuse. Ils se sont mis à causer à voix basse. J'ai compris qu'Elle devait être rendue à Paris pour dimanche et qu'il leur fallait, par conséquent, se quitter demain.
Ils me l'ont annoncé, d'ailleurs, à déjeuner. Ils l'ont fait en paroles si douces, si affectueuses, que j'ai eu bien de la peine à retenir mes larmes.
L'angoisse de ce départ a pesé sur eux toute la journée. Ils se faisaient toujours signe de n'en pas parler, mais leur pensée y revenait obstinément. Par moments, Elle faisait l'insouciante, la rieuse, et il essayait de lui donner la réplique.
Ils n'en étaient dupes ni l'un ni l'autre. à l'instant même où ils cherchaient à faire les fous, leurs visages redevenaient subitement graves, tandis qu'une tristesse passait dans leurs yeux.
Le soir, j'ai remis cinq lettres au capitaine, dont quatre de sa fine écriture à Elle. Le capitaine a fait une drôle de grimace, en disant entre ses dents: «Encore une nuit de chemin de fer, aller et retour!» Il s'est fait servir un verre de liqueur, car il était tout transi du mauvais temps qu'il fait dehors, et il est parti, pas plus enchanté que cela.
Comme ils ne me sonnaient pas pour dìner, j'ai eu l'idée d'aller leur demander s'ils ne préféraient pas que je leur apporte de quoi manger. Je les ai trouvés silencieux et rêvant dans l'ombre, à leur place favorite, près de la cheminée, sans autre lumière que la flamme mourante qui éclairait faiblement leurs deux visages.
Ils ont accepté mon offre avec empressement.
Je leur ai apporté le plateau, j'ai allumé deux bougies: ils m'ont fait signe que c'était assez... J'ai jeté des bûches dans l'âtre et je me suis retirée doucement sans leur dire bonsoir, pour ne pas les troubler dans leur rêverie.
23.—Samedi 23 octobre.
Ils sont partis ce soir!
Voyons, que je rassemble mes souvenirs dans cette âme endolorie.
Toute la nuit d'hier à aujourd'hui, je n'ai pas cessé de songer à eux, sans pouvoir prendre le moindre sommeil.
Dans le secret de mon âme, je formais des vœux pour qu'ils ne partent pas. Et, cependant, il y avait une chose dont j'avais peur plus encore que de leur départ: c'est qu'Elle ne lui manifeste tout à coup le désir de rester encore... Car je savais qu'alors il ne partirait pour rien au monde, et qu'aucune force humaine ne pourrait l'arracher des pieds de son adorée... Et j'avais peur de cela.
Le capitaine n'est pas venu ce matin. Ils ne m'ont pas sonnée. à une heure, j'ai fini par devenir inquiète.
Je suis allée frapper chez eux. Elle m'a répondu qu'ils venaient déjeuner dans un instant.
J'avais justement fait préparer un déjeuner bien réconfortant. Dieu, qu'ils ont été longs à venir!
Enfin, les voilà. Lui comme d'ordinaire, Elle dans le costume qu'elle avait en arrivant. Bien pâles, tous deux. Ils se sont placés l'un en face de l'autre. Mais il a trouvé que ce n'était pas assez près, et il est allé s'asseoir sur de bord de son fauteuil à Elle, en la serrant contre lui d'un bras, et la caressant doucement de la main restée libre.
Autant dire que le repas devenait un mythe. J'en étais tellement désolée que j'ai fini par me planter en face d'eux, les bras croisés, sans plus les servir. Ils ont compris le geste et ils sont partis d'un franc éclat de rire, qui a été leur dernier mouvement de gaìté. Mais ils ne se sont pas corrigés pour cela et, quand ils se furent levés de table, j'ai pu constater qu'ils n'avaient pris en tout que deux œufs et trois biscuits.
Je leur ai proposé de tout emballer moi-même, sans qu'ils eussent à se soucier de rien. Ils m'ont fait signe qu'ils acceptaient. Pendant que j'allais et venais d'une pièce à l'autre, tout occupée à ma besogne, ils restaient immobiles, sur le divan du fond de la chambre, et se redisaient leur amour. C'est Lui, surtout, qui parlait avec un accent de conviction profonde où je sentais palpiter tout son cœur.
«Te laisser partir! lui disait-il, faut-il que je t'aime pour me résoudre à souffrir ainsi! Faut-il que j'aie un courage surhumain pour me séparer de toi, c'est-à-dire pour m'arracher le cœur tout vif de la poitrine... Faut-il que tu le veuilles pour que je m'y résigne! Car ta volonté seule peut me faire consentir à ce sacrifice sans nom... Si, au moins, tu me laissais te suivre, quel est l'obstacle au monde qui pourrait m'empêcher d'être partout où tu seras? Les convenances, le monde, ma situation, dis-tu? Est-ce que cela compte pour moi? Est-ce que tout cela m'a donné une seule heure valant l'une de celles que je viens de vivre près de toi? Est-ce que tous les honneurs et tout la popularité dont on m'a entouré valent un seul de tes baisers?... Oui, je croyais avoir touché au comble des jouissances humaines en goûtant les honneurs, les flatteries, les acclamations du peuple, la renommée... Tu es venue, et tu m'as révélé que tout cela n'est rien auprès du bonheur d'aimer... Ange de ma vie, toi qui m'as donné des joies que je ne croyais pas réalisables sur cette terre, je n'ai commencé à vivre que du jour où je t'ai connue... Le sort en est jeté: Il ne me sera plus possible de vivre sans toi!...»
Pendant qu'il parlait, elle l'écoutait toute pensive et, parfois, elle le regardait fixement de ses yeux clairs.
Mon travail d'emballage terminé. Je les ai laissés. J'ai descendu les trois valises au rez-de-chaussée. La nuit est tombée.
L'Angelus avait fini de sonner, quand le grand brun est entré chez moi, sans faire de bruit. Il venait, m'a-t-il dit, accompagner à la gare ses deux amis qui repartaient ensemble pour Paris par l'express de neuf heures. Il s'est mis à m'expliquer d'une façon plutôt embrouillée que l'une de leurs valises, la plus petite, pourrait rester quelques jours chez moi en attendant qu'on vìnt la prendre, car elle était remplie d'objets dont ses amis n'avaient pas besoin d'alourdir aujourd'hui leurs bagages...
Huit heures. J'allais monter les prévenir, quand ce sont eux-mêmes qui m'ont appelée: «Belle Meunière!»
Je les trouve dans leur chambre, déjà tout prêts à partir.
«Nous voulons vous dire au revoir», me disent-ils.
Je suis si bouleversée que je ne puis plus retenir mes larmes. Alors, tout émus, eux aussi, ils s'approchent de moi, me mettent leurs mains sur les épaules, me grondent doucement.
«Allons, me dit-il, ne vous chagrinez pas à ce point... Nous reviendrons, soyez-en sûre... Nous avons été si heureux chez vous que notre plus cher désir sera de revivre les moments que nous avons passés ici... Vous avez été pour nous une sincère amie, et nous ne l'oublierons pas... Nous ne vous disons pas adieu, mais au revoir et à bientôt...»
En prononçant ces derniers mots, il m'a pris la tête dans ses deux mains, et m'a donné sur le front un long baiser fraternel, et, aussitôt, Elle, soulevant sa voilette, m'a embrassée, comme une vraie sœur, sur les deux joues.
Ils sont descendus très vite et, accompagnés par le grand brun qui portait une valise dans chaque main, ils se sont éloignés à grands pas dans la nuit, allant sans doute vers une voiture qui devait les attendre plus bas.
Je n'en puis plus, je suis brisée d'émotion.
Ils sont partis!
25.—Mercredi 16 novembre.
Ce matin, à onze heures, une voiture s'est arrêtée devant ma maison, et j'ai été toute surprise d'en voir descendre celui que j'ai l'habitude d'appeler le grand brun. La première chose qu'il a faite, en entrant, a été de me tendre sa carte, sur laquelle j'ai lu:
CAPITAINE GUIRAUD
Officier d'ordonnance du Général Commandant le 13e Corps d'Armée
Clermont-Ferrand
J'ai levé les yeux sur lui. Il souriait.
«Je me doutais, lui ai-je dit, que vous deviez être un officier attaché à Sa personne...»
«Comment, s'est-il écrié, vous vous doutiez de quelque chose!»
Alors, je lui ai tout raconté, comment j'ai eu, dès le premier jour, le pressentiment que l'hôte annoncé serait le général, quelle avait été ma déception quand j'avais vu un autre arriver avec la dame, comment je l'avais dévisagé, lui, le grand brun, sous sa fausse barbe noire, comment j'avais reconnu le général dès son entrée dans la chambre, et quelle contrainte j'avais dû m'imposer durant tout son séjour pour n'avoir pas l'air de le connaìtre, bien plus, pour déjouer toutes les questions qui m'étaient posées dans l'intention de me surprendre...
Il ouvrait de grands yeux étonnés, il n'en revenait pas... «Le diable m'emporte! a-t-il fini par s'écrier, si je vous aurais supposée de cette force-là!»
«Et moi, Monsieur le cachottier, pendant tout le dìner où vous avez raconté à Mme Marguerite la manière dont le général s'était échappé de Clermont, je n'ai cessé de guetter le moment où vous vous laisseriez allé à dire: «Mon général...» Tous mes compliments, mon capitaine: cela ne vous est pas arrivé une seule fois.»
Il s'est mis à rire de bon cœur, puis il m'a dit:
«Chère madame, je suis justement chargé par le général d'une commission pour vous... Comme vous le savez sans doute, ses arrêts de rigueur ont pris fin dimanche, et il est maintenant à Paris avec son autre officier d'ordonnance, mon camarade Driant. Le général m'a chargé de reprendre chez vous sa valise et il a tenu à ce que je vous déclare que vous vous êtes fait de lui un véritable ami... Il m'a chargé aussi de vous dire qu'il comptait revenir bientôt chez vous, et, enfin, de vous remettre ceci.»
En prononçant ces mots, il m'a présenté la broche que Mme Marguerite avait portée tous les jours à son peignoir: un fer à cheval en or, garni de sept perles et de deux diamants.
Je l'ai prié de remercier chaleureusement, en mon nom, le général et Mme Marguerite en leur faisant savoir qu'ils pouvaient compter sur moi d'une façon absolue, en toute circonstance.
«Et, surtout, ai-je ajouté, que le général me pardonne d'avoir fait si longtemps celle qui ne sait rien, alors que je savais tout... Qu'il soit bien convaincu que, si j'ai agi de la sorte, c'est pour que sa tranquillité soit plus grande et son bonheur parfait...»
Il a pris la valise, il m'a saluée de la façon la plus aimable, et il est reparti.
26.—Mardi 29 novembre.
J'ai eu du monde aujourd'hui jusqu'après onze heures du soir. J'allais me coucher, à l'approche de minuit, quand j'entends frapper de grands coups contre la porte. Toute surprise, je prête l'oreille; les coups redoublent, une voix crie: «Ouvrez, c'est une dépêche!...»
Je descends, je prends en mains le télégramme...
Serons chez vous demain six heures soir. Préparez nos chambres.
Mon Dieu, comment vais-je faire pour tout préparer d'ici qu'ils arrivent! Je prends une lampe, je monte au premier, j'ouvre leur chambre... Tout est resté tel qu'ils l'ont laissé. Je n'avais pas eu le courage d'y toucher.
Vite, vite, je mets un peu d'ordre, j'allume un bon feu qui durera une partie de la nuit et que je continuerai à faire flamber toute la journée de demain.
27.—Mercredi 30 novembre.
Ils sont arrivés ce soir à six heures, en voiture fermée, tout seuls. Sans me dire un mot, Elle est montée droit dans sa chambre. Quant à Lui, me regardant avec un air sévère et même très méchant, il m'a dit:
«Nous avons des comptes à régler ensemble... En attendant, faites-nous dìner au galop!»
Absolument décontenancée par cette attitude, qui m'avait coupé net les paroles de bienvenue que je m'apprêtais à leur dire, je me suis occupée de faire monter la malle et les valises, puis de servir le dìner.
Le potage une fois sur la table, je les ai prévenus. Ils ont passé aussitôt dans la salle à manger, Elle, toujours silencieuse et évitant de me regarder, Lui, l'air de plus en plus sévère. Ils se sont mis à manger très vite, comme des gens très affamés, et sans m'adresser la parole.
Sa figure m'apparaissait aujourd'hui moins avenante, plus dure et moins jeune. Je n'ai pas tardé à découvrir à quoi ce changement était dû. Il avait modifié son port de cheveux, et les portait maintenant taillés en brosse. Sans doute pour désarmer les imbéciles qui lui trouvaient la raie trop bien faite...
De temps à autre, il jetait un coup d'œil de mon côté, en fronçant les sourcils.
Je devais être assez pâle, car je sentais une angoisse qui m'étreignait le cœur. Je me demandais ce qui avait pu m'attirer la disgrâce qu'ils semblaient me témoigner.
Je redoutais qu'au cours de leur voyage, et peut-être à leur arrivée à Clermont, quelque calomnie ne m'eût noircie à leurs yeux.
J'avais envie de tomber à leurs pieds, de les supplier d'abréger le tourment que m'infligeait leur silence... J'avais besoin de toute mon énergie pour attendre qu'il lui plût d'ouvrir la bouche, et les minutes me paraissaient des éternités.
Enfin, il s'est mis à parler:
«Ah! perfide! Nous avions eu confiance en vous, et vous nous avez indignement trompés!... Nous vous avions crue sincère et vous nous avez menti tant que vous avez pu!... Nous vous avions prise pour une naïve, et vous ne fûtes qu'un monstre d'hypocrisie!... Et vous avez encore l'air de vous étonner du visage que nous vous montrons?... Perfide Auvergnate que vous êtes, sachez bien que nous nous repentons cruellement d'être venus chez vous, et que si nous sommes encore revenus ce soir, c'est uniquement pour vous dire votre fait comme vous le méritez... Allons, essayez un peu de vous défendre, de biaiser une fois de plus... Je serais bien curieux de voir ce que vous allez trouver à répondre...»
Je ne savais que penser.
«Veuillez au moins me dire, ai-je répondu d'une voix tremblante, ce que vous me reprochez?»
«La coquine! s'est-il écrié en donnant un grand coup de poing sur la table, elle a l'audace de continuer à faire celle qui ne devine pas... Eh bien, nous allons la confondre d'un seul coup! Abìme de dissimulation que vous êtes, avez-vous, oui ou non, confessé au capitaine Guiraud que vous avez reconnu en moi le général Boulanger?»
Il me foudroyait du regard, mais, au lieu de la confusion, c'était la tranquillité la plus absolue qui venait d'entrer d'un seul coup dans mon âme.
«Mais oui, mon général», ai-je répondu le plus naturellement du monde.
Un éclat de rire argentin s'est aussitôt fait entendre: c'était Elle qui n'y tenait plus. Et lui, à moitié figue, à moitié raisin, ne savait plus s'il devait continuer à fulminer ou s'il allait rire aussi...
Il a fini par me faire asseoir entre eux deux, en me disant, déjà plus doucement:
«Racontez-nous comment tout cela vous est venu à l'esprit.»
Alors, je leur ai tout dit, mon pressentiment, la confirmation qui lui avait été donnée par les allures étrangement mystérieuses de ses officiers d'ordonnance venus pour retenir l'appartement, la déception que j'avais eue à l'arrivée du capitaine Guiraud..., accompagnant Mme Marguerite, la certitude qui était venue ensuite... Ils m'écoutaient en échangeant des regards et des sourires.
«Voilà donc le crime avoué, a-t-il conclu. Maintenant, voyons le mobile!»
«Le mobile, mon général?... Permettez-moi de vous répondre par une question... En agissant comme j'ai agi, n'ai-je pas fait ce qu'il fallait faire pour que vous soyez tous deux tranquilles et heureux?...»
Ils ne m'ont rien répondu. Mais ils m'ont pris chacun une main et, tous deux en même temps, m'ont embrassée sur les joues.
«Accusée, a ajouté le général, à l'unanimité, le jury vous acquitte... L'audience est levée.»
Ils se sont levés de table et le général, m'offrant son bras, m'a conduite dans leur chambre, disant que nous avions encore beaucoup de choses à nous dire.
Dès cet instant, ils se sont mis à me parler comme à une amie d'enfance, comme à une parente de province qui leur serait bien chère. Ils m'ont encore fait répéter les menus détails de la comédie qu'il m'avait fallu jouer avec eux, et ils s'en sont amusés comme des fous.
Comme je leur exprimais ma joie et ma surprise de les avoir vus revenir si tôt, le général s'est écrié:
«Oui, nous devons une fière chandelle à Wilson!»
«Devoir quelque chose à M. Wilson? Oh, mon général!...»
«Mais si, mais si», a-t-il insisté en riant. Et il m'a expliqué que, s'il avait pu venir dès aujourd'hui, c'était à cause des affaires de décorations qui s'étaient aggravées jusqu'à rendre la démission de M. Grévy inévitable d'une heure à l'autre. En prévision de la crise présidentielle qui allait se produire, les commandants de corps d'armée, à ce moment réunis à Paris par un travail de classement, avaient été tous renvoyés à leur poste, et c'est ainsi qu'il avait pu prendre le train avec sa chère Marguerite... Toutes les après-midi, il comptait descendre à Clermont passer deux ou trois heures au quartier général, et le reste du temps, il le vivrait sous mon toit, dans le bonheur...
Nous causions ainsi près du bon feu pétillant. Lui, allongé dans un siège, fumant un cigare et ayant l'air d'un homme aussi heureux qu'il est possible de l'être, et Elle, plus jolie que jamais, debout derrière son fauteuil, doucement penchée sur Lui...
C'est moi qui ai fini par m'apercevoir qu'il était une heure du matin. Je leur ai souhaité le bonsoir.
Le cher couple! comme je les aime!
28.—Jeudi 1er décembre.
Dès neuf heures du matin, j'entends un cavalier galoper et je vois arriver l'officier d'ordonnance blond, le capitaine Driant. Le manège de la tasse de café prise à cheval et de la lettre glissée sur le plateau recommence comme au mois d'octobre.
Cette fois, la lettre est un gros pli cacheté qui doit renfermer énormément de choses.
Je le porte au général qui l'ouvre aussitôt. Il s'en échappe plusieurs lettres sous enveloppes et divers papiers pliés. Elle et Lui procèdent au dépouillement.
Tout en allumant du feu, je l'entends faire ces réflexions:
«Quel gâchis, ma chère amie... Grévy qui se cramponne de plus en plus, les Chambres en permanence, le Gouvernement en dislocation, l'anarchie partout... Je comprends qu'ils aient la frousse de ma présence à Paris...»
Elle s'est mise à rire ironiquement:
«Les braves gens, n'en dites pas trop de mal! Combien je leur sais gré d'avoir tellement peur de vous, puisque cela me vaut d'être maintenant à vos côtés.»
Quel charme inouï cette femme exerce sur Lui! Chaque fois que, se départissant de son calme habituel, Elle lui dit une parole un peu flatteuse, il en devient fou de bonheur. Il l'a serrée contre lui en la couvrant de baisers. Je me suis éclipsée.
Ils ont sonné pour déjeuner à une heure. Elle avait une exquise toilette de crépon blanc, avec ceinture et nœuds de soie bleu clair. Lui était tout habillé pour sortir, mais très simplement, comme toujours. Envoyant au diable les affaires sérieuses, ils n'ont cessé de rire, de plaisanter, de se câliner du geste et du regard.
Je les voyais faire, tout abasourdie de la provision de tendresse inépuisable que le général montrait, et qui lui faisait à tout instant trouver des attentions, des câlineries nouvelles, sans qu'il y eût jamais de défaillance dans ce souffle d'amour qu'il faisait passer en Elle.
à trois heures, ils étaient encore à table; le capitaine Driant est revenu, en civil, et m'a remis un autre pli.
Quand le général eut ouvert, au premier coup d'œil, il s'est écrié:
«La démission de Grévy!»
Elle s'est levée pour mieux voir ce qu'il lisait.
Ils se sont mis à parcourir fiévreusement les nouvelles reçues.
«Dites au capitaine d'attendre!» m'a-t-il commandé. Je me suis empressée de transmettre l'ordre. Quand je suis revenue auprès d'eux, ils finissaient de se parler à voix basse.
Le général s'est tourné vers moi:
«Il faut que je parle au capitaine, faites-le monter immédiatement ici.»
Au même instant, Mme Marguerite s'était levée, et, de son pas léger, avait passé dans sa chambre. Cela me confirmait dans l'idée que le capitaine n'était pas encore admis à la connaìtre.
Je l'ai fait monter dans la salle à manger, j'ai refermé la porte sur eux, et je suis restée à attendre dans le couloir. C'est surtout le général qui parlait. Par moments, sa voix s'élevait. Il était question tout le temps de Paris, de la guerre...
Tout à coup, le général a ouvert la porte en criant à son officier d'ordonnance: «Attendez-moi là! Un instant de réflexion et je reviens.»
Il s'est rendu de ce pas dans la chambre à coucher pour réfléchir... par son cerveau à Elle, comme j'ai déjà cru remarquer qu'il le faisait dès qu'il avait une décision importante à prendre. Un quart d'heure au moins s'est écoulé. Un coup de sonnette nerveux m'a appelée. Mme Marguerite était assise, le dos tourné de mon côté. Le général, les mains dans les poches, les yeux à terre, marchait à grands pas dans la chambre.
«Avez-vous des enveloppes de sûreté?» m'a-t-il demandé.
Justement j'avais ce qu'il désirait. M. le Préfet D..., qui était descendu chez moi pendant l'avant-dernière saison, avait laissé quelques-unes de ces enveloppes.
Je suis allée les chercher dans ma chambre et je les ai apportées. Elle était toujours assise de même, et il continuait à marcher en disant: «Comme vous voyez juste!... Vous avez mille fois raison, ma chère Marguerite... Laissons la guerre de côté... Je ne ferai pas cette folie... Je n'irai pas aujourd'hui!»
Il s'est mis à écrire. Le temps devait sembler long au capitaine. Je suis allée lui tenir compagnie. Je l'ai trouvé, les mains derrière le dos, en train de regarder les quelques méchants chromos dont j'ai orné (?) la salle à manger et qui ne méritent vraiment pas un instant d'attention. Notre conversation n'a pas été très nourrie, car il se retenait comme un homme préoccupé ou encore comme un homme qui ne veut pas qu'on le fasse parler...
Enfin, le général est revenu, plusieurs lettres à la main. J'ai repris mon poste dans le couloir. Au bout d'un instant, le général a reconduit son officier d'ordonnance, en répétant: «C'est cela, inutile de repasser par le quartier général... Il n'y a pas une minute à perdre!»
Le capitaine est descendu avec rapidité, le général est rentré auprès de Mme Marguerite. J'ai compris que des décisions très graves venaient d'être arrêtées. Mon Dieu! Que se passe-t-il en cette heure de crise? Ce mot de «la guerre! la guerre!» qui revenait sans cesse me glace de terreur.
J'étais en proie à ces sombres pensées. La nuit était tombée. Un coup de sonnette a retenti.
J'ouvre leur porte et je suis clouée au sol par le violent contraste provoqué entre mon état d'âme et le spectacle qui s'offre à mes yeux.
Dans la chambre tout inondée de lumière, toute tiède et parfumée, Elle se tient debout, dans une éblouissante robe de soirée, ruisselante de bijoux. Et Lui, à genoux près d'elle, il arrange les plis de sa robe avec le zèle d'un couturier.
Il se tourne vers moi, la figure riante: «Des fleurs, Belle Meunière, il nous faut des fleurs!»
J'en ai bien reçu tantôt de Clermont, mais je ne les avais pas jugées dignes de leur être présentées. Je compte en recevoir demain de Nice, où j'ai télégraphié. Tant pis! j'apporte, pour l'instant, ce que j'ai: des camélias et des violettes.
Il les prend de mes mains et se met à les fixer dans ses cheveux, sur son corsage, tout en la couvrant de baisers. Il ne cesse de lui murmurer: «Comme vous êtes adorable, ce soir! Jamais je ne vous ai vue aussi belle!...»
«Georges! répond-elle, ne plaisantez pas une vieille femme de trente ans...»
Il lui ferme la bouche d'un long baiser.
«Vous, prononcer ce vilain mot! vous qui avez dix-huit ans de moins que moi! Vous, mon adorée, qui n'étiez pas encore de ce monde quand je portais déjà l'uniforme!»
à huit heures, ils ont sonné pour dìner. Sa toilette et ses bijoux jetaient un tel éclat autour d'Elle que ma modeste salle à manger en était tout illuminée. à propos d'une lettre du capitaine Guiraud, resté à Paris, ils ont un instant parlé politique.
«Les fous! s'est écrié le général; avoir songé à moi pour sauver Grévy! Moi, atteler mon cheval noir à la remorque d'un tombereau d'immondices!... Faut-il qu'ils me connaissent peu pour m'avoir fait perdre deux soirées en allées et venues à écouter leurs propositions et d'autres plus saugrenues encore: l'enlèvement de Ferry, la rentrée en France des Orléans... Aussi fous les uns que les autres, communards, parlementaires et royalistes... Mais, c'est de l'histoire ancienne. Voyons ce qui va suivre... Que donnera le Congrès? J'entrevois quatre solutions possibles: ou bien Ferry, ou bien Floquet, ou bien Freycinet, ou, enfin, l'Imprévu, le candidat de la dernière heure... Si c'est Floquet, je suis sûrement ministre de la Guerre demain... Si c'est Freycinet, ce sera sans doute pour après-demain... Si c'est l'Imprévu, inutile de faire des pronostics... Mais, si c'est Ferry, nous allons rire...» Il s'est mis à rire nerveusement.
«Ferry, président de la République!... Ce ne seront plus les chassepots, ce seront mes chers petits Lebel qui partiront tout seuls!... Ce ne sera plus un duel entre Ferry et moi, mais entre Ferry et la France, dont je prendrai en main la bonne épée!...»
Il est resté silencieux un moment, les sourcils froncés. Puis il a ajouté:
«Je crois que ce sera Ferry!»
Elle ne l'a pas laissé continuer. Avec l'éventail en plumes blanches qu'elle avait près d'Elle, Elle l'a doucement frappé sur l'épaule:
«Allons, Georges, ne prenez pas cet air qui me fait de la peine!... N'escomptons pas l'avenir, vivons pour le présent... N'est-ce pas?...»
Sous l'action magique du regard qu'Elle lui a jeté, son visage s'est éclairci subitement.
Il s'est mis à embrasser la main qui venait de le frapper. Et les voilà de nouveau à se câliner, à se cribler de baisers, à se redire combien ils s'aiment!
C'est étrange! Aujourd'hui, je me suis sentie moins heureuse de les voir ainsi.
Je les aurais voulus autrement, à l'instant où la France est peut-être à la veille d'une guerre civile...
29.—Vendredi 2 décembre.
Encore du neuf! Ce matin, à la place du capitaine, c'est un simple soldat qui est venu, à pied, en petite tenue de caserne. Il m'a remis un pli portant ces mots:
MADAME LA BELLE MEUNIèRE
Hôtel des Marronniers, Royat.
«C'est pour mon colonel», a-t-il ajouté en clignant de l'œil.
Dans ce pli, il devait y avoir quelque chose de grave pour Elle, car elle est devenue toute soucieuse. J'ai deviné qu'il lui fallait absolument repartir pour Paris ce soir même, quitte à revenir aussitôt. Elle insistait. Lui s'y opposait de toutes ses forces. La discussion a duré pendant toute la matinée, car, à diverses reprises, j'ai dû rentrer dans leur chambre, et cela continuait toujours. Elle a beaucoup de volonté, mais ne se départit jamais de son calme. Lui s'échauffait par moments, élevait la voix, puis, un instant après, l'adoucissait jusqu'à la rendre suppliante.
à déjeuner, ils étaient préoccupés tous deux, et ils ont aussi peu causé que mangé. Elle tenait les yeux baissés obstinément. Lui ne la quittait pas du regard, et ce regard était plein d'inquiétude.
«Il faut cependant que je descende aujourd'hui, du moins, au quartier général», a-t-il dit en se levant. Il s'est approché d'Elle, lui a pris la tête dans ses deux mains et lui a murmuré d'une voix suppliante:
«Tu ne partiras pas, dis!»
Elle a fait sa réponse en fermant les yeux, d'une voix à peine distincte: «Puisque tu le veux!...»
Alors, il s'est mis à l'embrasser follement, comme un homme au comble de ses vœux. Et il est parti, lui envoyant encore de sa main des baisers.
Elle s'est retirée aussitôt dans sa chambre; quelques minutes après, elle m'a sonnée. Sa figure m'a un peu effrayée. Elle était toute pâle de contrariété. Elle avait les lèvres blanches et serrées.
«Belle Meunière, m'a-t-elle dit d'un ton bref, il faut me rendre un service... Regardez dehors et, si vous voyez le général revenir sur ses pas, il faut m'avertir immédiatement.»
J'ai fait comme elle l'a demandé. Enveloppée d'une fourrure, je me suis tenue à une fenêtre de la salle à manger, derrière les volets à moitié refermés.
J'étais là depuis un bon moment quand elle m'a sonnée de nouveau. Elle tenait à la main une lettre fraìchement cachetée. La bougie, à peine éteinte, fumait encore.
«Belle Meunière, m'a-t-elle dit, il faut encore que vous me rendiez un service... Cette lettre doit partir de suite, et il faut que vous la portiez vous-même à la poste la plus voisine... Elle doit peser plus que le poids: vous mettrez, à tout hasard, trois timbres... Mais, surtout, quand le général reviendra, gardez-vous de laisser échapper que j'ai expédié une lettre pendant son absence!...»
En me parlant ainsi, elle me regardait fixement et sa voix tremblait un peu. Je considérais machinalement l'enveloppe que j'avais prise de ses mains: il y avait dessus:
P. M. L. P. S.
Poste Restante
paris.
Tout cela me causait une grande surprise. Elle me donna une tape amicale sur la joue et ajouta, d'une voix redevenue subitement très douce:
«Allez vite et ne vous étonnez de rien... C'est pour Lui que je fais cela... Ceux qu'on aime, il faut parfois les servir même malgré eux!»
Sans perdre un instant, j'ai fait la commission.
à cinq heures, le général est revenu, en excellente humeur. Il a plaisanté sur son passage au quartier général, sur les dernières nouvelles reçues de Paris. Il riait à propos de tout et ne cessait de lui dire:
«Voyons, Marguerite, riez un peu!» Et, comme elle ne se déridait pas assez vite à son gré, il s'est mis à la chatouiller, tout en lui murmurant:
«Allons, méchante, feras-tu risette!»
à dìner, leur insouciance les avait complètement repris. Il avait substitué à sa serviette, par un vrai tour de passe-passe, une chemise en grosse toile de ménage qu'il avait chipée je ne sais où, et il se l'était gravement nouée autour du cou, à mon immense stupéfaction.
Elle riait à en tomber par terre.
Les enfants! Sont-ils fous!
30.—Samedi 3 décembre.
Ce matin, le capitaine est revenu, en civil, avec des lettres. Le général m'a chargée de le faire patienter. Nous nous sommes mis à causer, cette fois, avec plus de succès qu'avant-hier.
Il m'a donné à entendre qu'il venait de finir son temps, ses quatre ans, je crois, comme officier d'ordonnance attaché au général Boulanger, et qu'il éprouvait un gros chagrin de devoir le quitter.
Il a fait allusion aussi à l'Amie du général, mais sans une sympathie exagérée. «Elle lui faisait faire, disait-il, un métier de conducteur de chemin de fer... Quitter Clermont à neuf heures du soir, descendre à Nevers pour jeter ses lettres, afin qu'on la croit dans une propriété de ces régions, et revenir à Clermont par le train de cinq heures du matin...»
Un coup de sonnette m'a rappelée auprès du général, qui était levé et m'a priée de faire monter le capitaine dans la salle à manger. Ils se sont entretenus très longtemps.
De toute la journée, le général n'est pas sorti.
Il a fait, d'ailleurs, un temps épouvantable dehors. Après déjeuner, Elle s'est mise au piano. Pendant qu'il l'écoutait, le petit verre de fine champagne près de lui, le cigare à la main, les yeux perdus dans le rêve, Elle jouait, de mémoire, des berceuses adorablement mélancoliques.
Puis, s'interrompant tout à coup, Elle s'est mise à chanter l'En revenant d'la revue...
Les fleurs de Nice sont arrivées: rien que des violettes d'un parfum exquis. Elle en a paru enchantée. Je crois qu'elle adore la violette. Elle n'emploie pas d'autre parfum qu'une eau de cologne de première qualité, en flacons cerclés de paille.
Il était en train de piquer des fleurs dans sa toilette de soirée, comme avant-hier soir, quand le capitaine est revenu, porteur d'une dépêche. En l'ouvrant, le général s'est écrié:
«Ferry n'est pas élu... Il s'est retiré au second tour... Le Congrès a nommé M. Sadi Carnot.»
Ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre en répétant: «Ferry n'est pas élu!»
Il a vite griffonné quelques lignes sur une feuille de papier, qu'Elle a mise sous enveloppe et que j'ai portée au capitaine, lequel est reparti aussitôt.
Ils ont encore longtemps causé de cette élection, même à table. Elle plaisantait sur le compte du nouvel élu, elle trouvait tout à fait drôle son prénom de Sadi.
Lui prenait la chose plus au sérieux. Sans doute, ce choix n'était dû qu'à la peur qu'on a fini par avoir d'une élection Ferry: mais il aurait pu être plus mauvais... Il a rappelé que Sadi Carnot avait rendu des services en 1870 et qu'il s'était montré d'une honnêteté irréprochable au milieu des turpitudes de Wilson.
«Enfin, a-t-elle répondu en riant, vous pensez que M. Sadi Carnot fera un bon président... provisoire?» Elle avait appuyé sur ce dernier mot et il avait souri. Puis elle a ajouté:
«Au fait, j'aime mieux que ce soit lui aujourd'hui plutôt que vous, car je sais à quoi m'attendre quand viendra votre heure... Je sais que mon bonheur sera fini... Oh! ne niez pas! Je veux croire que vous continuerez à m'aimer quand même... Mais vous serez si peu à moi!... Et je prévois autre chose encore: je ne cesserai plus de trembler pour vos jours. Quel est le chef de l'État, en France, que l'on n'ait pas cherché à assassiner... Pour M. Grévy lui-même, si peu intéressant cependant, n'est-il pas venu des fous à l'Élysée... Oh! mon ami! comme je serai malheureuse, le jour où vous serez le maìtre de la France!»
Il s'est mis à la rassurer, lui a rappelé que, depuis Louis XVI, aucun chef d'État français n'avait même reçu une égratignure, et que, depuis Henri IV, aucun n'avait été assassiné.
«Va, va, a-t-il ajouté, Mme Sadi Carnot et toi, vous pouvez dormir toutes deux tranquilles... Ni lui, ni moi, nous ne mourrons sous l'arme blanche ou par le pistolet...»
Cette fois, c'est lui qui a fait défense de parler davantage de ces choses peu amusantes. Ils se sont remis à rire et à ne plus songer qu'à leur bonheur.
31.—Dimanche 4 décembre.
Mme Marguerite est partie ce matin pour Paris, par l'express de neuf heures. Autant que j'ai pu comprendre, elle va là-bas offrir, chez elle, un grand dìner mondain, ce soir même, et elle doit se remettre en route dès demain matin. Une femme de confiance, dont elle dispose à Paris, a dû tout préparer.
Malgré mes instances et celles de Mme Marguerite, le général n'a pas voulu la laisser partir sans l'accompagner. Il a commis l'imprudence bien inutile de monter en voiture auprès d'elle, pour ne la quitter qu'à la gare.
Il est revenu au bout d'une heure et, lorsqu'il est descendu de voiture, j'ai failli pousser un cri.
Son visage était presque méconnaissable, tellement la douleur l'avait creusé. Ses yeux étaient rouges.
Il avait dû pleurer. J'avoue que je ne comprenais pas: qu'avait-il pu se passer entre eux pour qu'il revienne désolé à ce point?
Il semble qu'il n'y a eu rien de particulier, et qu'il souffrait simplement de s'être séparé d'elle. Le malheureux! Mais, alors, que deviendrait-il si jamais une catastrophe le séparait d'elle pour de bon, si elle lui devenait infidèle ou si la mort la foudroyait?...
Il était là, affaissé dans un fauteuil, l'œil creusé, le regard sans vie. Je lui ai annoncé que le déjeuner était prêt. Il ne m'entend pas! Il est comme en état de léthargie. Je répète, il n'entend pas davantage. Je prends alors le parti de crier avec toute la force de mes poumons:
«Mon général, le déjeuner vous attend!... Mon Dieu, est-il possible que vous vous laissiez tellement abattre? Elle est partie? Mais elle ne va pas tarder à revenir! Demain, à pareille heure, elle sera déjà à mi-chemin... Voyons, mon général...»
Ces paroles ont fini par avoir action sur lui. Il s'est levé, en me remerciant du regard, et en répondant simplement:
«Vous êtes dans le vrai!»
Mais, quand il s'est rendu dans la salle à manger, son premier coup d'œil a été pour la pendule, et il s'est écrié:
«Si, au moins, elle prenait le train de ce soir, neuf heures!»
J'étais navrée. C'était folie pure. Comment concevoir le désir qu'elle prenne le train de neuf heures, alors qu'elle donnait son dìner à sept!
Il a mangé à peine, puis il est descendu à Clermont.
Quand il est revenu, il m'a demandé de rester un peu auprès de lui, à coudre, et il s'est mis à me parler d'Elle.
Il m'en a parlé avant le dìner, pendant son repas, et après le dìner, longtemps encore, sans se lever de table. Il a fini par me raconter toute son histoire, jusqu'au moment où Elle était entrée dans sa vie:
«Depuis que je la connais, disait-il, je ne me reconnais plus moi-même!... L'homme que j'étais avant sa venue et l'homme que je suis depuis qu'elle m'a pris tout entier n'ont rien de commun ensemble... Avant cela, je n'avais donné de droits sur moi qu'à une seule femme: celle qui est actuellement encore Mme Boulanger. Elle a été une épouse irréprochable. Elle est la mère de mes enfants... Ce n'est pas sa faute si elle n'a pas fait le bonheur de ma vie. Nous n'étions pas créés l'un pour l'autre, et quand nous nous sommes épousés, avec la précipitation qu'on met aux mariages des jeunes officiers, nous ne nous connaissions pas, nous ne pouvions pas nous deviner... Les premières années, j'ai été dupe de mes illusions. J'ai cru que je la façonnerais comme il me la fallait pour qu'elle me rende heureux... J'ai dû finir par m'avouer que je m'étais trompé, et que nos deux natures, loin de pouvoir se rapprocher, voyaient se creuser entre elles un abìme qui allait sans cesse en s'élargissant...
»Et, de la sorte, nous avons fini par vivre côte à côte comme deux étrangers qui ne restent l'un avec l'autre que par une convention tacite, pour les convenances, pour le monde... Il y a dix ans que Mme Boulanger ne m'est plus rien! Nous ne prenons même plus nos repas ensemble, sauf quand il s'agit de grands dìners invités...
»Dans ces conditions, il fallait bien que je cherche ailleurs... Je me suis mis à courir le cotillon, à papillonner de la brune à la blonde, à voltiger de fleur en fleur, en m'attardant à peine à celle-ci, davantage à celle-là, et en trouvant cette autre tout à fait exquise, mais sans qu'aucune m'enivre vraiment de son parfum... J'ai gaspillé ainsi ma jeunesse, et je croyais avoir beaucoup aimé... Je croyais avoir semé miette à miette tout mon cœur, de telle sorte qu'il ne m'en restait plus... Et je m'en félicitais, car je voyais approcher le moment où je rentrerais dans la réserve de la territoriale... J'atteignais cinquante ans.
»Alors, un jour, est tombé le coup de foudre... Elle est apparue! Et aussitôt j'ai reconnu que ce cœur que je croyais tombé en poussière était intact, et qu'il était aussi jeune, aussi ardent, aussi assoiffé d'aimer que si j'avais vingt ans!... Et ce cœur, dont elle a opéré la résurrection comme par un miracle, je le lui ai donné tout entier... Vous avez bien dû vous en apercevoir, je l'aime éperdument, je l'aime autant qu'il est possible à un homme d'aimer... Je ne vis plus que par Elle, je ne veux plus que ce qu'Elle veut!... Où me conduira notre amour? Je ne veux même pas chercher à le prévoir... Je me laisse aller avec une volupté infinie, les yeux fermés...»
Il s'était levé, le visage enfiévré, les yeux étincelants, et, alors, mettant une main sur le cœur, et étendant l'autre comme s'il prêtait un serment, il m'a dit ces paroles, que je n'oublierai jamais:
«Voulez-vous savoir à quel point je l'aime et à quel point je suis devenu sa chose?... Eh bien! supposez qu'elle entre en cet instant, qu'elle me tende un pistolet chargé, qu'elle me dise de l'appliquer contre la tempe et de faire feu... J'obéirai sur l'heure, comme un soldat, sans demander pourquoi!»
J'ai manqué de défaillir. Un grand frisson m'a parcourue tout entière. Je n'ai pas trouvé un mot à répondre. Enfin, je lui ai dit:
«Mon général, vous me faites peur: ne parlons plus de cela... Il est minuit, j'ai le devoir de vous engager à aller prendre du sommeil...»
«J'obéis, a-t-il répondu très doucement... Puisque que la consigne est de dormir, je vais aller m'étendre sur mon lit—et penser à Elle!»
Avant que j'eusse pu l'en empêcher, il m'a baisé la main, et il s'est retiré.
32.—Lundi 5 décembre.
Je n'ai presque pas dormi cette nuit, tant j'étais préoccupée. à la première heure, c'est-à-dire à la pointe du jour, on frappe très fort à la porte de la maison. C'est une dépêche. Elle m'est adressée, mais je me doute qu'elle n'est pas pour moi, et je la porte chez le général.
En me voyant entrer, il saute à bas du lit, sur lequel il était étendu tout habillé. Il m'arrache la dépêche des mains, il la déchire plutôt qu'il ne l'ouvre. Grâce à Dieu, son visage s'éclaircit aussitôt: c'est une dépêche expédiée par Elle, hier soir, et qui lui dit qu'Elle pense à lui et qu'Elle lui envoie mille baisers...
à onze heures, le capitaine Driant est venu prendre le général pour un déjeuner qu'il a offert aujourd'hui, au buffet de la gare de Clermont, à ses principaux officiers. Le général est parti tranquille en me glissant dans l'oreille qu'il serait là bien avant l'heure...
En effet, il était là dès cinq heures, et Elle ne doit arriver qu'à six. J'avais rangé la chambre et disposé partout des fleurs nouvellement arrivées de Nice. Il s'en est aperçu de suite, et cela lui a fait plaisir. S'approchant d'un bouquet de violettes placé sur la table, il a dit, comme s'il parlait aux fleurs: «Vous attendez comme moi la blanche main qui doit vous caresser!»
Assis dans son fauteuil, près du feu, il s'est mis à lire des journaux.
à six heures, on frappe. Il bondit, mais, d'un geste, je lui défends de se montrer. Je descends: c'est une nouvelle dépêche, adressée, comme ce matin, à mon nom.
Je la monte. J'aurais bien dû, en même temps, monter des cordes pour le ligoter.
Je ne suis jamais allée dans un asile d'aliénés. Je ne me rends pas un compte très exact de ce que peut être un fou furieux. Mais, ce dont je suis sûre, c'est que j'ai eu ce soir, devant moi, pendant plus d'une heure, le spectacle d'un amoureux en proie à une crise nerveuse qui devait valoir un accès de folie, à tel point que j'ai pu me croire un instant dans la nécessité d'appeler à l'aide, non pas pour ma sécurité personnelle, mais pour empêcher cet homme de se broyer le crâne contre le mur.
Et, tout cela, pourquoi? Parce que la dépêche annonçait qu'elle n'avait pas pu partir ce matin, mais qu'elle partait ce soir, et qu'elle expliquerait demain matin, en arrivant, les causes de ce retard.
à un moment donné, cette rage a paru se calmer. J'ai cru que c'était fini, et je me suis éloignée pour aller mettre le couvert. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu des cris rauques, des espèces de râles qui m'ont bouleversée... Je cours vers la chambre: elle est vide. Je pénètre dans le cabinet de toilette: le malheureux est là, par terre, à se rouler dans ses vêtements à Elle, qu'il a arrachés du mur où ils pendaient, à les embrasser et à les mordre...
Cette seconde crise passée, un grand abattement s'est emparé de lui. Il a refusé toute nourriture. Maintenant, c'était une idée fixe qui le tenait: il voulait partir demain matin, à quatre heures, d'ici, pour aller la recevoir à la gare de Clermont quand arriverait le train, à cinq heures.
J'ai eu beau lui parler raison, il est demeuré inflexible. Il n'a même pas accepté que je descende maintenant à Clermont pour arrêter une voiture qui viendrait le chercher demain matin. Avec un entêtement de maniaque, il m'a fait défense absolue de le contrarier sur ce point.
à force d'insistance, j'ai fini tout de même par obtenir un résultat: c'est qu'au moins il aille se coucher ce soir. Mais je n'y ai réussi qu'en lui jurant que, moi-même, je ne me coucherais pas, afin qu'il soit bien assuré que je l'appellerai demain à quatre heures—puisqu'il n'y a pas de réveil-matin dans la maison.
Me voici donc condamnée à ne pas dormir cette nuit. D'ailleurs, comment l'aurais-je pu faire, bouleversée jusqu'au fond de l'âme comme je le suis?
33.—Mardi 6 décembre.
à quatre heures du matin, je suis descendue auprès du général. Il était en train de s'habiller. Je m'en doutais: il n'avait pas plus sommeillé que la nuit d'avant!
L'idée qu'avant une heure il allait la presser dans ses bras lui avait rendu sa gaìté. Le plus gentiment du monde, il m'a priée de l'excuser de la scène d'hier.
«J'étais fou! a-t-il dit, mais il faut me pardonner, car, voyez-vous, ces douze heures pendant lesquelles je me suis vu encore séparé d'elle, il faut les avoir vécues avec elle pour comprendre quelle somme elles représentent de bonheur perdu!»
Il s'en voulait aussi de m'avoir fait veiller, bien inutilement, puisque lui-même n'avait pas fermé l'œil. Je l'ai rassuré de mon mieux, je lui ai fait prendre un bol de lait chaud coupé de rhum, et je l'ai reconduit jusqu'à la porte.
Dieu! quel temps il fait dehors! Lorsque j'ai ouvert la porte, une horrible bourrasque de neige s'est engouffrée du même coup, a éteint ma lanterne et nous a glacés tous deux. Le vent souffle avec une violence effrayante. Il y a de la neige sur le sol jusqu'à mi-genou, et la nuit est absolument noire, sans une lumière au ciel.
Je veux encore l'arrêter: il y a plus d'une lieue d'ici la gare de Clermont et, vraiment, par un temps pareil...
Mais il n'écoute rien.
«Il y a un Dieu pour les amoureux!» me crie-t-il, et le voilà parti à grandes enjambées.
Je mets aussitôt de l'ordre dans leur appartement, j'allume un bon feu, je bassine leur lit, je prépare du bon café bien chaud pour leur arrivée. Le jour commence à poindre quand on frappe à la porte. J'ouvre: ce sont eux, à pied, blancs de neige et trempés jusqu'aux os. Elle a des glaçons sur la voilette, et lui, sur les moustaches.
à peine prennent-ils le temps de vider chacun un bol de café bouillant, en me racontant qu'ils n'ont trouvé, à la gare de Clermont, qu'une méchante guimbarde attelée d'une rosse qui marchait si mal qu'ils ont fini par la lâcher à mi-côte.
«Et sur ce, ajoutent-ils, il faut aller vous coucher de suite, Belle Meunière... Nous faisons de même.»
Je n'en pouvais plus. J'ai dormi d'un sommeil de plomb jusqu'à midi. Quand je suis redescendue près d'eux, ils m'ont demandé d'apporter dans leur chambre de quoi manger.
à six heures du soir, le capitaine Driant est venu avec des lettres. En me voyant, il m'a demandé:
«Madame de Bonnemain, est-elle de retour?»
Je lui ai fait signe que oui. Mais ce nom, que j'entendais pour la première fois, n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle est donc de la noblesse, comme je le supposais: car j'avais remarqué que divers objets lui appartenant étaient marqués du chiffre M. B., surmonté d'une couronne à cinq fleurons, c'est-à-dire, si je ne me trompe, d'une couronne vicomtale.
La vicomtesse Marguerite de Bonnemain! Le nom sonne bien et possède, ma foi, une belle allure!
à huit heures, pour dìner, ils se sont fait également servir chez eux. Ils m'ont remis un pli avec la recommandation suivante:
«Quand le capitaine viendra, demain matin, vous lui donnerez ceci et vous lui direz de ne rien attendre, de ne pas perdre une minute, et d'exécuter au galop la commission qui lui est confiée là-dedans... Vous n'aurez pas besoin de venir avant que nous ne vous sonnions.»
34.—Mercredi 7 décembre.
Toute reposée par l'excellent sommeil que j'ai pris cette nuit, j'ai vu arriver le capitaine à neuf heures du matin. Je lui ai fait signe d'entrer dans la maison et je lui ai aussitôt remis l'enveloppe, en lui répétant la recommandation qui m'avait été faite. Après avoir pris connaissance du pli, il a réfléchi un instant, puis il s'est frotté les mains d'un air enchanté. Il m'a alors donné deux lettres à l'adresse du général, qu'il a tirées de son manteau. Je croyais que c'était tout, mais, après avoir cherché un instant, il s'est mis à fouiller dans la poche intérieure de son dolman, et il en a sorti une troisième enveloppe, toute blanche et un peu froissée. En me la remettant, sa main tremblait un peu. Puis il est remonté en selle et il est parti au grand galop.
Je me suis dit que cette enveloppe blanche devait contenir quelque chose d'important.
à dix heures, le général a sonné. J'ai trouvé leur chambre remplie d'une épaisse fumée. Les tourtereaux avaient essayé de faire du feu eux-mêmes, mais la tentative avait absolument avorté. Je les ai grondés. J'ai établi un courant d'air en ouvrant les deux fenêtres; j'ai allumé un feu, bien flambant, celui-là. Je les ai laissés au moment où Mme Marguerite ouvrait, pour la lire au général, la première des trois lettres reçues.
Quelques instants plus tard, un coup de sonnette a retenti. J'accours, le général est en proie à une vive émotion. Il me prend le bras nerveusement:
«Le capitaine est-il encore là? voyons, parlez!»
«Mais, mon général, il y a une heure qu'il est parti... Ne m'aviez-vous pas dit, hier, vous-même, qu'il n'attende pas?...»
«Sacrebleu! Si j'avais pu prévoir... Enfin, tant pis! à vous de me tirer d'affaire, ma bonne Meunière. Arrangez-vous pour me trouver quelqu'un de sûr qui puisse, sans se faire remarquer, porter une lettre au quartier général. La lettre, vous l'aurez dans cinq minutes... C'est assez de temps pour la forte tête que vous êtes...»
Quelqu'un de sûr et qui ne se fasse pas remarquer! Comment vais-je faire, grand Dieu! Si j'envoie une personne de chez moi, elle sera certainement suivie. Mais, alors, qui? Vrai, je préférerais que le général ne me croie pas si forte tête! C'est encore plus embarrassant que flatteur.
...On n'a pas idée d'une chance pareille: les cinq minutes n'étaient pas écoulées que le plus grand des hasards me sauvait d'embarras. Le prétendu d'une de mes servantes, un brave gars de la montagne, honnête et taciturne comme tous nos montagnards, a arrêté sa carriole devant ma porte, ainsi qu'il ne manque jamais de le faire quand il descend vers la Limagne. Plus d'une fois, je lui avais confié des commissions pour Clermont. Je n'ai eu qu'à lui expliquer, en patois, qu'il y avait une lettre à porter chez un officier de l'état-major de Clermont et sa réponse à me rapporter au plus vite, pour que le brave garçon, sans m'en demander davantage, se déclarât prêt à me faire la course en toute hâte et à revenir de même.
«Eh bien! Belle Meunière, avez-vous trouvé?»
«Oui, mon général.»
Justement, le général a sonné et m'a remis la lettre,—une toute petite enveloppe avec cette adresse:
Monsieur le Capitaine Driant,
au Quartier Général.
Très urgente.
«J'en étais sûr d'avance. Avec vous, il ne faut jamais douter de rien... Qu'on aille vite, surtout, et qu'on m'apporte la réponse sans retard, car c'est très, très sérieux!»
En disant cela, il avait l'air à la fois heureux, impatient et perplexe.
à midi, mon excellent montagnard était de retour avec la réponse que le capitaine avait écrite devant lui, dans son bureau du quartier général où il doit, soit dit en passant, terriblement peiner, lui qui est seul là-bas pour recevoir, répondre, et parer à l'imprévu!
Quand j'ai porté la lettre au général, il me l'a arrachée des mains, tandis que Mme Marguerite m'a dit:
«Occupez-vous vite du déjeuner. Nous n'en avons que pour un petit moment.»
Le petit moment a duré une grande heure, j'en ai profité pour orner de fleurs la table.
«Bravo! s'est écrié le général quand ils sont enfin venus s'y asseoir. Voilà qui est une délicieuse surprise pour un jour pareil!»
Et, s'adressant à Elle:
«Oui, c'est une journée qui comptera, celle-là!... Quelle portée elle peut avoir! Et quelle joie, plus tard, de nous dire: c'est notre cher petit coin de Royat qui a été le point de départ...»
Brusquement, elle lui a coupé la parole en lui fermant la bouche de ses mains. Ils se sont embrassés... La belle conclusion, pour moi!...
Le déjeuner fini, le général est allé à Clermont.
Je débarrassais la table, quand elle m'a appelée:
«Chère amie, voulez-vous que nous passions l'après-midi à travailler ensemble?»
«Oh! madame, lui ai-je répondu, c'est à genoux que je devrais vous remercier de l'honneur inespéré qui est fait par la grande dame que vous êtes à la campagnarde que je suis.»
Elle m'a remerciée d'un gracieux sourire. J'ai apporté la couture que je suis en train de faire pour ma mère—une surprise que je lui prépare. Elle a étalé son ouvrage sur un fauteuil: il y avait là un travail de tapisserie d'une très grande difficulté, mais elle n'y a pas touché. Elle a pris un petit tricot de laine blanche, dans lequel j'ai bientôt reconnu de petites brassières pour nouveau-nés.
Je lui ai déjà entendu dire qu'elle n'avait pas d'enfants: en grande dame qu'elle est, elle occupe donc ses loisirs à travailler de ses fines mains pour des œuvres charitables?
Tout en tricotant, elle s'est mise à me parler de sa voix argentine. Avec ce savoir-faire exquis que possèdent seules les femmes du monde, elle a voulu m'amener à lui causer de moi, à lui raconter ma vie dans laquelle elle croyait deviner une tristesse... Elle ne s'est pas trompée, mais, mise sur ce chapitre, j'ai été bien sobre d'explications, car, les tristesses, je pense qu'il faut les garder pour soi, qu'il faut y songer le moins possible et n'en parler jamais.
Le général est rentré à la nuit tombée. Son visage rayonnait de joie. De nouveau, il s'est entretenu très longuement avec Mme Marguerite.
à huit heures, il m'a sonnée:
«Vite, faites-nous dìner, car une voiture doit venir me prendre dans une heure d'ici. Dès que vous l'entendrez, vous m'avertirez. Je m'en remets à vous pour que personne ne remarque ma sortie.»
Décidément, il doit y avoir sous tout ce mystère une conspiration! De plus en plus intriguée, je les sers à dìner et, entre temps, je réduis l'éclairage de l'escalier à une simple veilleuse et j'entr'ouvre la porte donnant sur le chemin de la Grotte.
Neuf heures.—Un bruit de roues sur la neige durcie. Je cours prévenir le général. Mais, déjà, enveloppé dans une pelisse, il est au pied de l'escalier.
Je distingue la silhouette du capitaine Driant qui vient de sauter à terre et tient la portière ouverte. Tandis que le général monte dans la voiture, j'y aperçois un autre personnage, une sorte de colosse aux hautes épaules, emmitouflé de fourrures...
La voiture repart aussitôt, au grand trot, dans la direction de la campagne.
C'est seulement vers onze heures qu'elle est revenue. Près de la porte entrebâillée, j'ai vu descendre le général et je lui ai entendu dire avec émotion:
«C'est le vrai langage d'un prince... Merci!»
à quoi l'autre, lui tendant la main, a répondu d'une voix étrange et profonde:
«à bientôt, Général... et à Paris!»
Pendant que la voiture s'ébranlait, le personnage en question a avancé la tête, et j'ai pu distinguer qu'il portait une épaisse barbe blonde.
...Un prince?—Un prince étranger, évidemment. Mais où donc ai-je vu cette figure barbue? car, il n'y a pas de doute, je l'ai aperçue quelque part!
35.—Jeudi 8 décembre.
Le capitaine ne s'est pas montré aujourd'hui.
C'est un soldat, le même que la semaine dernière, qui est venu apporter le pli contenant le courrier.
à force de m'être creusé l'esprit, j'ai fini par retrouver à quelle ressemblance correspondait l'inconnu d'hier; je dois l'avoir entrevu—je ne sais quand, par exemple—parmi les grands personnages russes qui viennent faire leur cure à Royat.
Après déjeuner, le général est redescendu à Clermont et Mme Marguerite m'a de nouveau invitée à lui tenir compagnie.
De fil en aiguille (c'est le cas de le dire, puisque nous cousions, ou du moins je cousais tandis qu'elle tricotait ses petites brassières), Elle est arrivée à me raconter comment s'était faite, entre le général et Elle, la connaissance qui avait abouti à les jeter dans les bras l'un de l'autre:
«Figurez-vous, ma chère, que j'étais une grande ennemie du général Boulanger, et cela l'année dernière... Le monstre! j'avais trois griefs contre lui... Le premier, c'est que sa popularité me portait sur les nerfs et m'agaçait au plus haut point. Impossible de faire une visite, d'entrer dans un salon, de prendre une tasse de thé, de faire un tour de valse, de dìner dans le monde, sans entendre prononcer son nom... Et si encore ce nom avait eu une certaine allure! Mais il me paraissait vulgaire, ridicule au possible. Le général Boulanger? Pourquoi pas le général Charcutier ou le général Liquoriste?... Quant à son portrait, colporté de toutes parts, il ne me réconciliait pas avec lui: je trouvais ce port de barbe prétentieux, et je jugeais l'homme un bellâtre... Second grief: ses opinions politiques. Je n'aime pas les républicains. Je me félicitais du moins que l'armée—je dis: le cadre des officiers—maintenait intactes les traditions d'ordre et d'autorité qui vont en déclinant dans notre pauvre France... Et, tout à coup, voilà un officier, bien plus, un général, un ministre de la Guerre, qui se met à faire du radicalisme, de l'anti-cléricalisme, et Dieu sait quelles horreurs encore!... Troisième grief, celui-là absolument personnel et décisif.. Un matin d'hiver, je galopais au Bois et je croise le général... Je le reconnais, il me regarde, et l'impertinent a l'audace de me fixer comme si j'étais femme à lui rendre œillade pour œillade...
»Je suis rentrée chez moi rouge de dépit et, dès cet instant, mon aversion pour lui n'a plus eu de limites... Partout où j'allais, je disais sur son compte le plus de mal possible... On me fit bientôt une réputation de la haine que je montrais à l'égard du général Boulanger.
»Or, j'avais une amie d'enfance—autant dire une sœur. Elle est à peine plus âgée que moi, nous avons été élevées dans le même couvent, nous nous sommes mariées à la même époque, et chacune de nous a épousé un officier... Nous ne cessions de nous voir, l'hiver à Paris, l'été à la campagne, aux bains de mer ou au littoral. Je le répète, deux sœurs ne sont pas plus inséparables que nous l'étions... Elle était assez différente de moi par le caractère: mais c'était peut-être une raison de plus pour que nous nous entendions si bien... Son mari est colonel d'un régiment caserne dans une ville proche de Paris. Comprenant qu'il fallait au bonheur de sa femme la vie mondaine pour laquelle elle était faite, il l'a laissée à Paris, revenant près d'elle dès qu'il le peut... Elle reçoit à merveille chez elle, et l'on y accourt d'autant plus volontiers qu'elle est extrêmement jolie... Du côté de l'harmonie du visage, la nature ne lui a rien refusé. Elle a été moins prodigue en ce qui concerne le corps, qui est massif et dénué d'élégance... Aussi, jalouse-t-elle un peu toutes les femmes plus heureusement douées à cet égard...»
«Dans ce cas, Madame, elle doit beaucoup vous jalouser, ai-je interrompu, car cette élégance, vous la possédez au plus haut degré!»
Mme Marguerite sourit et reprit:
«J'ai fait mon possible pour me faire pardonner d'elle... Quoi qu'il en soit, un soir, elle vint me trouver, toute surexcitée, comme je ne l'avais jamais vue, et ses premiers mots, en se jetant dans mes bras, ont été: «Ma chère Marguerite, le Ministre de la Guerre accepte de dìner jeudi soir chez moi!» Ma réponse manquait d'enthousiasme: «Tu me permettras, chérie, de ne pas t'en faire mon compliment!» Cela ne l'a pas empêchée de me demander, à l'instant suivant, de lui rendre un immense service... Vous ne devineriez jamais lequel: celui d'aller dìner ce soir-là chez elle, moi, troisième et dernière convive!
»Sans aucun doute, la chère enfant n'avait plus la tête à elle... Me faire une semblable proposition, à moi, l'ennemie intime et publique tout à la fois de cet affreux ministre de la Guerre!... Vous vous doutez de ce qu'a pu être ma réponse: un refus glacial et absolu... Je ne m'en suis pas contentée, je l'ai vertement grondée de toute l'inconvenance de sa proposition: dìner, deux femmes seules, avec un homme, un étranger... Pour qui voulait-elle donc qu'il nous prenne?... Trois couverts? Quelle folie! Il fallait, ou bien en mettre davantage, ou bien n'en laisser que deux!
»Elle a paru sentir la justesse de cette observation.
»Elle a changé ses batteries...
«Tu as raison, il faut que j'invite d'autres personnes... Mais alors, si j'en ai beaucoup, dix, quinze, vingt, me rendras-tu au moins le service que je te demande? Songe donc, Marguerite, tu ne seras plus exposée à devoir lui parler, bien au contraire, tu pourras ne t'occuper que des autres invités...»
«Pendant que toi, ma chère, tu ne t'occuperas que de lui?... Désolée de ne pouvoir t'abriter en cette circonstance...»
«Alors, tu refuses même cette combinaison?»
«Formellement.»
«C'est ton dernier mot?»
«Mon dernier.»
«Eh bien! mon dernier à moi sera celui-là: tu as peur du général Boulanger... Il y a longtemps déjà qu'on trouve peu naturelle et singulièrement excessive l'aversion dont tu fais montre à son égard... On lui a cherché des motifs: il n'a pas été difficile de les trouver... Les plus méchants disent que c'est un dépit dont la cause serait ton secret—et le sien... Je dis, moi, que c'est la peur: la peur de te trouver sous son regard, parce que tu ne te sens pas assez sûre de toi...»
«Très bien, ma chère: je serai chez toi jeudi soir... à sept heures précises, n'est-ce pas?»
»Ce jeudi, il s'est trouvé que, par hasard (car, quelque prix qu'on y mette, on n'obtient jamais cela à coup sûr), ma couturière avait admirablement réussi la toilette que je lui avais commandée,—une toilette à longue traìne, en velours noir constellé de paillettes de jais: depuis que j'avais eu la douleur de perdre mon défunt beau-père, le général de Bonnemain, je ne portais pas encore de robes de couleur... Une toilette simple, en somme, mais qui m'allait à merveille... J'étais en retard, j'ordonne à mon cocher de me conduire au plus vite... J'arrive: tout le monde était déjà là,—et ce tout le monde se composait de la maìtresse de la maison, d'un vieil oncle et du général.
»J'étais jouée. Soit qu'elle ait cru impossible d'inviter à temps beaucoup de personnes, soit plutôt qu'elle soit revenue à son idée première d'une dìnette intime, elle m'avait manqué de parole. Mais que faire? Il était trop tard pour reculer!
»Alors, j'ai pris le parti opposé, celui de l'attaque, de l'offensive à outrance! J'ai voulu écraser mon ennemi,—le général,—l'accabler de coups d'épingle, le cingler de railleries. Ce fut entre nous deux, paraìt-il, un véritable feu d'artifice de reparties, un scintillement de coups portés et parés aussitôt... J'avais pris goût à la lutte: le général m'a redit depuis que je fus étonnante de verve et que j'étais superbe à voir... Lui, de son côté, piqué au vif, n'avait plus de paroles et de regards que pour moi, sans s'apercevoir, l'imprudent, que le visage de la maìtresse de maison changeait!...
»Elle voulut mettre fin à notre dialogue en portant la conversation sur un autre sujet, qui lui rappelait sa présence:
«Général, fit-elle, s'il en est qui vous accablent de critiques, il en est d'autres qui vous portent un culte sincère et profond... Combien ai-je dû vous supplier pour que vous consentiez à combler mes désirs en venant ce soir à ma table!...»
»La flagornerie me parut un peu vive.
«Général, ajoutai-je d'un ton ironique, il paraìt qu'il faut beaucoup vous supplier pour avoir l'insigne honneur de vous compter parmi ses convives?»
«C'est un défaut de plus que vous me prêtez, Madame...»
«Je vous le donne, général, car il est bien à vous.»
»Mais je refuse. Je ne m'en reconnais pas le propriétaire et, si vous vouliez en avoir la preuve, il suffirait que vous me fassiez le très grand honneur de me convier un jour chez vous...»
«Chez moi, général! Avec plaisir et quand il vous plaira! Fixez vous-même le jour.»
«Le plus tôt possible, alors... Demain, si vous le permettez, Madame.»
«Eh bien! général, à demain!»
»Et c'est ainsi qu'il m'a fallu, le lendemain, recevoir le général Boulanger chez moi... Dès cette seconde entrevue, naissait, de lui à moi, une vive amitié,—en attendant mieux...
»Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai bien ri, depuis, de tous les griefs qui me faisaient le détester... Je ne lui en ai plus voulu, bien au contraire, de m'avoir tant remarquée un jour au Bois... Je n'ai plus éprouvé de la haine pour sa popularité, mais je me suis sentie délicieusement bercée par le bruit flatteur qui s'élevait autour de lui... Je me suis mis à adorer sa barbe blonde... Je lui ai pardonné jusqu'à ses convictions politiques, qui, d'ailleurs, gagnaient à être mieux connues... Quant à son nom, j'ai compris qu'un nom valait par l'usage qu'un homme sait en faire. Le nom professionnel de Boulanger n'est pas plus ridicule que le nom animal de Corneille ou le nom végétal de Racine. Et ce nom qu'il a reçu de son père, mon Georges l'a si noblement porté, que je serai la plus heureuse des femmes, croyez-le bien, le jour où je pourrai le prendre, moi aussi...»
Mme Marguerite s'est tue à ces mots, comme quelqu'un qui caresse un rêve. Puis, elle a repris:
«De ce premier dìner avec Georges date donc l'origine de notre bonheur... Mais cette soirée-là ne devait pas m'apporter seulement du bonheur... Je vous ai dit qu'il n'y avait avec moi que trois convives: deux d'entre eux ont gardé le souvenir impérissable de ce jour, l'un pour me chérir, l'autre pour me...»
Elle n'a pas achevé sa pensée, mais une profonde tristesse s'est montrée sur son visage. Elle s'est levée, a plié son ouvrage et m'a dit:
«Maintenant, assez causé, ma bonne Meunière. Apportez-moi la toilette héliotrope, afin que je me fasse belle pour mon Georges adoré.»
Elle est vraiment magnifique, cette toilette en velours héliotrope, avec, de chaque côté de la jupe, un panneau brodé d'or. Mme Marguerite m'a fait former en guirlande les fleurs venues aujourd'hui de Nice, et elle a fixé cette guirlande au corsage à l'aide d'une flèche garnie de diamants. Dans les cheveux, elle a disposé, un peu en arrière, quelques œillets qui semblaient croìtre parmi cette chevelure blonde; au milieu des fleurs, une couronne à cinq fleurons en diamants. Enfin, elle a enroulé autour du bras gauche un serpent d'or qui en faisait cinq ou six fois le tour et qui brillait d'un éclat tout à fait extraordinaire.
Elle était féerique à voir ainsi.
Le général, quand il l'a aperçue en ouvrant la porte, s'est jeté à genoux, les mains jointes, sans une parole. Rien ne pouvait mieux que ce geste exprimer l'immense adoration qu'il a pour Elle.
J'ai couru m'occuper du dìner... Ils ont dìné tard. Le général la dévorait du regard et ne cessait de s'exclamer sur l'éblouissante beauté de sa toilette...
«Vous me complimentez toujours sur ma toilette, a-t-elle fini par dire en riant, je voudrais bien que vous m'offriez ici l'occasion de vous rendre la pareille en vous complimentant sur votre grand uniforme...»
«Ma chère amie, s'est-il écrié, pourquoi n'étiez-vous pas là, le jour de mon entrée à Clermont!»
Ces mots m'ont évoqué un souvenir.
«Mon général, lui ai-je demandé, à quoi pensiez-vous, ce jour-là, au moment où je vous ai vu passer?... Je précise: vous descendiez, suivi de votre état-major, l'avenue de Royat, vers la place de Jaude. J'ai lu une tristesse sur vos traits.»
«Belle Meunière, vous êtes physionomiste!... à quoi je pensais? Parbleu, ai-je besoin de le dire? à mon adorée!... Je pensais à elle et je me disais: «Comme elle est loin!...» Et j'avais beau voir l'avenue remplie d'une foule immense qui m'acclamait, elle m'apparaissait vide, puisque je ne l'y apercevais pas!»
Le dìner fini, ils se sont retirés vers leur chambre, à petits pas, étroitement enlacés.
36.—Vendredi 9 décembre.
Le capitaine a reparu ce matin, mais simplement pour savoir s'il n'y avait pas d'ordres. Il n'apportait rien.
«Pas de courrier?» lui dis-je.
«Non, hier et aujourd'hui, journées tranquilles... pour lui, du moins.»
«Oui, car pour ce qui est de vous, capitaine, vous ne devez pas manquer d'ouvrage, là-bas!»
«Oh! moi, c'est mon rôle, et puis, pour lui, voyez-vous, je travaillerais dix fois plus, s'il le fallait, tant il est bon, affable et indulgent...»
On a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, toutes sortes de petits indices me font deviner que le capitaine Driant a des raisons meilleures encore pour aimer le travail au quartier général: c'est que, dans le chef qu'il sert avec tant de zèle, il voit aussi le père d'une charmante jeune fille qu'il a promesse d'épouser un jour.
à déjeuner, ils n'ont fait que se câliner et se lancer œillade sur œillade. Il la fixait parfois avec des pupilles agrandies, comme un homme hypnotisé, ou comme un fumeur d'opium, s'il est permis de comparer à un individu qui s'enivre d'un rêve cet amant qui se grise d'une si adorable réalité!
Tout à coup, il m'a demandé une feuille de papier et, avec son crayon bleu, il s'est mis à tracer des lettres. Quand il eut fini, il m'a questionnée:
«Comment appelez-vous votre maison?»
Un peu surprise qu'il pût l'ignorer, puisque le nom se trouve inscrit en grosses lettres sur le mur extérieur, je lui ai répondu:
«L'Hôtel des Marronniers, mon général.»
«Parfait. Une autre question: avez-vous, près d'ici, un peintre en bâtiments qui sache son métier?»
«Certainement, mon général.»
«Eh bien! vous devriez aller le chercher, et lui dire: «Effacez-moi de suite ce nom, si quelconque, si terne, d'Hôtel des Marronniers, et mettez à sa place un nom qui donnera du moins un avant-goût du bonheur qu'on peut goûter sous ce toit!»
Et, ce disant, le général a déplié la feuille sur laquelle il venait d'écrire. Elle portait ces mots, en caractères majuscules:
HOTEL DU PARADIS
«Mon général, ai-je répliqué, je ne me déciderai pas à donner ce nom à ma maison, car il promettrait trop de bonnes choses, et je ne saurais comment les tenir.»
L'Hôtel du Paradis! Sans doute, je vois bien que ma maison est devenue pour eux un paradis dont ils sont les bienheureux élus et dont je suis, moi, l'ange gardien. Mais tout paradis implique un enfer, et je ne puis me dissimuler que ma mère et ma sœur, tyranniquement reléguées par moi loin de leurs chambres, loin de leurs aises, dans l'autre aile de la maison et dans les sous-sols, avec défense absolue de se montrer, de faire le moindre bruit, doivent trouver que cela ressemble à un enfer, ou tout au moins à un purgatoire dont elles ne seraient pas fâchées de voir la fin.
Le général a voulu descendre à Clermont après déjeuner. Comme il y avait du monde attroupé sur la grande route, à cause d'une vente aux enchères qui se faisait dans une maison voisine, je l'ai prié de passer par le petit chemin de la Grotte qui descend vers la Tiretaine, la franchit et remonte de l'autre côté, le long des rochers, juste en face de chez nous. Il a fait comme je lui avais dit; et nous nous sommes mises, Mme Marguerite et moi, à le suivre des yeux. Mais, arrivé aux rochers d'en face, l'imprudent n'a pu résister à la tentation de se retourner vers la maison.
Elle, de son côté, sans écouter mes cris, a entr'ouvert la fenêtre, et voilà mes deux amoureux qui s'envoient, d'un bord à l'autre de la vallée, des baisers avec la main...
Ils étaient si gentils à voir tous deux, que je serais bien restée à les regarder: mais la prudence me dictait d'autres devoirs, et j'ai dû arracher Mme Marguerite de sa fenêtre. Alors, seulement, il a repris son chemin.
Nous avons de nouveau travaillé ensemble, Mme Marguerite et moi. Elle s'est fait raconter par moi toutes sortes de détails sur Royat, sur Clermont, sur Montferrand, sur Riom, sur toute mon Auvergne que j'aime tant!
Le général est rentré de meilleure heure que d'habitude: il faisait encore tout à fait jour. Ses premiers mots ont été:
«J'ai été reconnu dans le Parc... On m'a suivi jusqu'ici.»
Je suis descendue aussitôt à la salle commune donnant sur la terrasse et seule accessible au public. Je m'y suis trouvée en présence de plusieurs messieurs de Clermont qui m'ont complimentée d'avoir le général Boulanger chez moi, et qui m'ont posé des tas de questions les unes plus indiscrètes que les autres. Je n'ai pas essayé de nier.
«C'est vrai, Messieurs, le général Boulanger vient d'entrer ici: il offre à dìner, ce soir, chez moi, à six de ses amis... Entre nous, je crois que ce sont des officiers supérieurs.»
Ils sont partis, enchantés de m'avoir arraché mon secret.
Deux heures ne s'étaient pas écoulées que d'autres consommateurs sont arrivés, des journalistes ceux-là, montés exprès de Clermont pour savoir à quoi s'en tenir: ils avaient entendu raconter, au café, que le général Boulanger faisait dìner chez moi, ce soir, quantité de généraux accourus de plusieurs points de la France...
Décidément, il fallait couper les ailes au canard que j'avais laissé s'échapper de ma basse-cour.
«Messieurs, leur ai-je dit, on doit exagérer... Je ne suppose pas que ces messieurs, qui sont là-haut, soient des généraux, car ils disent tous, en s'adressant à leur amphitryon: «Mon général...»
«Oh! cela ne prouve rien!» ont-ils interrompu en chœur.
J'ai continué imperturbablement:
«Et le général leur répond: «Colonel, commandant, major...»
Ils se sont regardés, fortement déçus.
«Bah! si c'est du menu fretin, a opiné l'un d'entre eux, pas la peine d'en parler!»
Et ils se sont retirés.
Le général s'est beaucoup amusé de cette aventure. à ce propos, il a raconté que d'autres fables, non moins fantastiques, couraient en ce moment sur sa prétendue présence à Paris, la veille et le jour de l'élection du Président de la République. N'allait-on pas jusqu'à supposer qu'il attendait, caché, l'instant de se montrer à la foule pour prendre la tête du mouvement populaire, au cas où Ferry serait élu, alors qu'au contraire, écœuré des conciliabules nocturnes auxquels on avait voulu le faire assister, il avait tranquillement pris le train depuis trois jours!
Parmi les choses qu'il a dites au sujet de ces événements de Paris, il y en a une qui m'a bien fait rire de moi-même, après qu'ils se fussent retirés en me disant affectueusement bonsoir. Décidément, en politique, je ne suis qu'une nigaude qui aura joliment de la peine à se déniaiser! Voici ce dont il s'agit. La semaine dernière, j'avais entendu avec terreur qu'il était tout le temps question, dans la bouche du général, de «la guerre». Puis, subitement, il n'en avait plus été parlé, et je ne savais comment me l'expliquer...
Ce soir, j'ai eu la clef du problème. Pareille à ce singe des fables de La Fontaine qui a pris un port pour un homme, j'ai pris, moi, pour la plus affreuse des calamités publiques le nom d'un député radical, ami politique du général Boulanger.
Grande niaise d'Auvergnate, va!
37.—Samedi 10 décembre.
Le capitaine Driant est revenu, cette fois, avec un courrier volumineux.
Quand j'ai monté tout cela au général, il m'a demandé d'attendre pour rapporter de suite au capitaine toutes les pièces signées.
Une heure plus tard, le général m'a dit, sans préambules:
«Nous vous quittons, nous sommes obligés de partir ce soir pour Paris... Mais, cette fois, Belle Meunière, il faut que nous ne soyons chagrinés ni les uns, ni les autres... Je pars heureux, avec ma Marguerite... Et quant à vous, il ne faut pas vous plaindre: au lieu de quatre ou cinq jours que nous pensions rester, nous en sommes restés dix, et vous n'avez plus le droit de douter que nous partions avec l'immense désir de revenir au plus tôt!»
En effet, quelle journée de départ différente de celle de leur premier voyage! à déjeuner, ils ont été très gais l'un et l'autre. Le général est sorti, en sifflotant, pour descendre à Clermont. Je suis restée avec Elle, à emballer ses effets.
Quand j'ai décroché ses robes de la muraille du cabinet de toilette, j'ai vu repasser devant moi la terrifiante image du général qui se roulait par terre en poussant des cris fous...
«Madame, lui ai-je dit sous le coup de cette ressouvenance, permettez-moi de vous dire mon sentiment: je ne crois pas qu'une femme ait jamais été plus aimée que vous l'êtes... Il vous aime à la folie, oui, à la folie... jusqu'à en inspirer de l'inquiétude...»
Elle a deviné mon arrière-pensée. Elle m'a regardée de ses yeux clairs, et elle m'a répondu:
«Vous ne vous trompez pas, il en devient parfois un peu fou... Mon devoir est alors tout tracé, ma chère: il faut que je sois raisonnable pour deux!»
Le général est rentré à cinq heures. Je les ai laissés, mais bientôt ils m'ont rappelée. Ils sont allés vers moi, m'ont pris chacun une main et, doucement, m'ont fait asseoir sur le divan, entre eux deux. C'est le général qui a pris la parole:
«Notre belle et surtout bonne Meunière, nous avons quelque chose de très grave à vous dire... Nous avons à vous confier un secret que vous serez seule à partager avec nous... Marguerite est enceinte...»
J'étais muette de surprise. Le général a continué: «Elle est enceinte, elle en est certaine, des indices évidents ne permettent plus d'en douter... Or, en ce moment notre situation est très délicate. Marguerite n'est pas libre, ni moi non plus. D'ici que nous le devenions—ce qui ne saurait tarder—et que nous consacrions publiquement notre union—il faut que l'existence de cet enfant demeure cachée... Nous avons songé à vous! Vous seule, que nous chérissons maintenant comme si vous étiez une proche parente, une sœur dévouée, vous seule pourrez nous rendre l'immense service que nous attendrons de vous quand l'heure sera venue: prendre chez vous cet enfant, lui donner une bonne nourrice, lui servir de mère, veiller sur lui jusqu'au jour où nous vous le reprendrons...»
Il s'était tu, m'interrogeant du regard. Elle tenait les yeux baissés. Je ne disais rien, mais le combat le plus violent se livrait en moi. Devais-je, pouvais-je accepter? Le temps n'est plus, hélas! où j'étais une jeune épouse en puissance de mari, et où les plus médisants du village n'auraient rien pu trouver à redire à l'apparition d'un nouveau-né chez moi! Mais aujourd'hui que je suis une femme seule, à quoi vais-je m'exposer, mon Dieu! Je la vois déjà qui m'accable, la calomnie, l'infâme calomnie!... Non, pour rien au monde, je ne puis consentir à cela! Et cependant, si je ne fais pas ce qu'ils me demandent, quelle opinion vont-ils emporter des sentiments que j'ai pour eux? Comment prouver qu'on affectionne, si l'on recule devant les épreuves douloureuses et si l'on hésite à se sacrifier?
Allons, je n'hésite plus: à la grâce de Dieu!
«Mon général, ai-je répondu non sans peine, car ma voix tremblait beaucoup... Mon général, c'est vraiment un très grand service que vous me demandez... Je n'en aurai pas rendu de plus grand dans la vie... Je vous le rendrai.»
Très ému lui-même, il a serré très fort ma main, qu'il n'avait pas quittée, et il l'a portée à ses lèvres. En même temps, Elle, tout heureuse de mon consentement, m'a embrassée. Puis, me faisant lever, ils m'ont reconduite jusqu'au seuil de la chambre en me répétant: «Merci!»
Je suis allée m'occuper du dìner. Ils l'ont mangé de fort grand appétit, en parfaite gaìté d'esprit. à huit heures du soir, le capitaine Driant est venu les chercher avec une voiture. Ils m'ont fait leurs adieux.
Le général m'a passé autour du poignet une lourde gourmette d'or avec médaille de saint Georges et il m'a embrassée en disant: «Ceci, comme gage de notre amitié.»
Elle m'a embrassée à son tour et m'a dit: «Merci encore d'accepter la garde du petit dauphin, dont je prépare déjà les layettes... Nous savons que, chez vous, il sera en bonnes mains...»
«Ça ne le changera pas!» s'est écrié le général en riant.
«Georges! a-t-elle répondu avec un regard courroucé, je vous défends, une fois pour toutes, de plaisanter un sujet aussi délicat...»
Il lui a baisé les mains, comme pour se faire pardonner. Ils m'ont embrassée encore une fois, et ils sont partis.
38.—Dimanche 11 décembre.
J'ai fermé leur appartement. Je le considère comme ne faisant plus partie de mon hôtel. Je le garderai intact jusqu'à leur retour.
Il est venu aujourd'hui beaucoup de monde, beaucoup de consommateurs qui avaient vaguement entendu parler d'un grand dìner politico-militaire que le général Boulanger aurait offert, chez moi, avant-hier soir.
L'un d'eux, un vieux client, m'as pris à part: «Savez-vous, m'a-t-il dit, ce qu'on raconte à Clermont? Le général aurait réuni chez vous, vendredi soir, un tas de généraux avec lesquels il aurait conspiré. Et la preuve qu'il y avait un mystère sous roche, c'est que des personnes, des journalistes, je crois, qui avaient parié de tirer la chose au clair en attendant la sortie de ces messieurs, sont restés longtemps sur la route de la Vallée sans apercevoir de lumières chez vous ni voir venir personne... En sorte qu'ils ont fini par deviner que vos hôtes sont descendus, par vos moulins, dans les sentiers du fond de la vallée... Est-ce vrai?»
Je lui ai répondu:
«C'est parfaitement exact, et ces messieurs l'ont fait exprès, uniquement pour jouer un tour aux gens qu'ils ont remarqués, faisant le pied de grue!»
Que pouvais-je répondre? J'aurais beau jurer par tous les saints du Paradis que le général n'a pas conspiré un seul instant sous mon toit, ce qui est la vérité la plus vraie du monde, ils sont tous à voir des menées et des complots dans la moindre de ses démarches. Il est bien heureux encore qu'on ne le soupçonne pas d'avoir soudoyé l'individu qui, hier à la Chambre, a tenté d'assassiner M. Ferry!
39.—Dimanche 1er janvier 1888.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Si le général fait comme moi, au premier janvier, l'inventaire de l'année écoulée, il doit se dire aujourd'hui que ses jours de l'an, à lui, diffèrent singulièrement.
Il y a deux ans, à pareille date, il n'était qu'un général de division à peu près inconnu.
Il y a un an, il était le Ministre de la Guerre à la mode, couru de tout Paris, fêté par la Presse, applaudi par la Chambre, vraie coqueluche de toutes les belles dames du monde, et idole de la foule qui l'acclamait éperdument dès qu'il se montrait à elle...
Aujourd'hui, le voilà simple commandant de corps d'armée, dans une ville de province qui n'est même pas une grande ville, à Clermont.
Bah! que lui importe! Son avenir militaire ne demeure-t-il pas intact et riche d'espoirs? Il a des préférences politiques, sans doute. Il en a peut-être trop... Mais il n'en reste pas moins le général populaire qui se tient au-dessus de tous les partis, le patriote qui porte une épée au côté pour le service de la France...
Quel magnifique rôle!
à condition que...
40.—Vendredi 13 janvier.
Un camelot a passé dans Royat, criant l'Almanach Boulanger, que je me suis empressée de lui acheter. Une coquette brochure, avec plusieurs portraits de général et celui de Henri Rochefort, car c'est l'Intransigeant qui édite cet almanach. J'ai été bien intéressée de lire la biographie du général.
Quelle superbe carrière, toute d'honneur et de gloire, que la sienne! Né à Rennes, le 29 avril 1837, entré à Saint-Cyr en 1855, envoyé en Kabylie dès sa sortie de l'École, sous les ordres du brave maréchal Randon; blessé une première fois à Robecchetto, dans la guerre d'Italie, d'un coup de feu en pleine poitrine, guéri comme par miracle, décoré, blessé une seconde fois d'un coup de lance en Cochinchine; nommé capitaine-instructeur à Saint-Cyr, blessé une troisième fois à la bataille de Champigny, une quatrième fois dans l'armée de Versailles contre la Commune, nommé enfin général de brigade en 1880, après vingt-cinq ans de service, vingt campagnes, quatre blessures et deux citations à l'ordre de l'armée! Là-dessus, délégué comme représentant de l'armée française aux fêtes du Centenaire des États-Unis, chargé d'une direction au Ministère de la Guerre, nommé général de division et commandant en chef des troupes d'occupation de la Tunisie, devenu Ministre de la Guerre le 7 janvier 1886, grand-officier de la Légion d'honneur après l'inoubliable revue du 14 juillet, tombé du Ministère avec le cabinet de Freycinet, le 2 décembre 1886, mais revenu aussitôt au pouvoir dans le cabinet Goblet; tombé une seconde fois avec celui-ci, le 17 mai 1887, remplacé, après treize jours de crise et d'incertitude, par un autre général, et envoyé, en fin de compte, à Clermont-Ferrand.
Avec une telle biographie, si éloquente en sa simplicité, j'aurais voulu que la brochure ne renferme rien d'autre! Pourquoi, surtout, sous cette même couverture, une méchante vignette qui représente le général donnant un coup de botte à Jules Ferry?...
41.—Lundi 27 février.
Aux élections de députés qui ont eu lieu hier, dans sept départements, plus de cinquante mille suffrages se sont portés sur le nom du général Boulanger.
On assure que le général—inéligible, puisqu'il est en activité—n'y est pour rien.
42.—Mardi 6 mars.
Sur les deux heures, j'entends frapper à la porte de la maison. Je sors, et me trouve en présence du capitaine G..., en uniforme et à cheval, précédé de deux artilleurs à cheval, auxquels il commande de faire halte. Quelques mètres plus loin, j'aperçois, suivi de deux autres artilleurs, le général, en petite tenue, chevauchant sur son beau cheval noir.
Arrivé jusqu'à moi, il arrête sa monture, me fait signe d'approcher, et me tend affectueusement la main. J'ai à peine la force de la prendre, tant je suis émue de surprise, et je ne trouve pas une parole à lui dire. Il me regarde un instant; je m'aperçois alors que sa figure est toute pâle et triste, sous le képi brodé d'or. Enfin, il me dit:
«J'ai fait ma promenade de ce côté exprès pour vous parler... Je ne puis pas mettre pied à terre maintenant, d'autant plus qu'il y a là-bas quelqu'un qui nous regarde... Je viendrai demain soir,—à cinq heures, voulez-vous?... Oui, j'ai à vous parler d'Elle... Allons, au revoir!»
Il m'a fait un salut militaire, et il est reparti au trot, sans se retourner, en descendant vers Clermont.
43.—Mercredi 7 mars.
Dans l'attente du général, j'ai rouvert leur appartement et j'ai fait du feu dans leur chambre.
à cinq heures, son coupé, attelé de deux superbes chevaux alezans clairs, s'est arrêté devant la maison. Le général était en civil.
Je l'ai conduit dans la chambre. Il s'est laissé tomber dans son fauteuil, à leur place favorite, près de la cheminée.
Il a promené un regard abattu autour de lui, et il a dit tristement:
«Ma pauvre Meunière, c'est hier, n'est-ce pas, qu'Elle et moi nous sommes partis d'ici?... Hélas! Est-ce que nos plus beaux jours seraient maintenant passés!»
Il est resté silencieux quelque temps, sans que j'osasse troubler son silence. Puis il a continué:
«Si vous saviez ce que j'ai souffert depuis deux semaines et combien j'ai passé de nuits d'insomnie!... Marguerite a fait une chute en descendant un escalier: vous savez dans quelle position elle se trouvait... La chute a provoqué un avortement, et Marguerite a failli en mourir!... Aujourd'hui encore, son état est grave...»
Il s'est tu de nouveau et il a repris:
«Par conséquent, adieu nos belles espérances! Adieu le cher rêve de paternité dont je faisais mon bonheur! Adieu le projet que nous avions fait avec vous, notre fidèle confidente... Dire que lui, qui ne devait pas naìtre, avait déjà quatre mois!...
»Ah! c'est affreux, voyez-vous, ce que j'ai souffert! Voir s'écrouler tout cela, la voir, elle, à deux doigts de la mort, et subir en même temps les coups d'épingle, les vexations sans pitié des gens de gouvernement! Car, vous n'avez pas idée de ce qu'ils font pour me rendre la situation intolérable! ils décachètent ma correspondance, ils m'entourent d'espions, ils cherchent à crocheter la serrure de mon bureau, ils sont allés jusqu'à corrompre mon valet de chambre!... Tout cela, je le leur passerais encore! Mais ce qu'ils m'ont fait dans ces derniers quinze jours est vraiment trop... Comme bien vous le pensez, à la première nouvelle que j'ai reçue de l'accident qui lui était arrivé, et qui, à ce moment-là, ne paraissait pas encore devoir entraìner des conséquences aussi terribles, je me suis rendu aussitôt auprès d'Elle. Je ne me cachais pas. Le Ministre de la Guerre, informé de ma présence, m'a immédiatement intimé l'ordre de retourner à Clermont et de ne plus m'absenter sans permission... C'est la règle stricte, il est vrai, mais depuis longtemps tombée en désuétude; aucun des autres commandants de corps d'armée ne l'observe. On l'a ressuscitée pour moi!... Là-dessus, un vendredi soir, je reçois une dépêche m'annonçant l'aggravation subite de son état. Je n'ai plus le temps de former une demande, je n'ai que tout juste celui de courir à la gare prendre le train qui allait partir. Je la trouve très mal, mais je retourne cependant à Clermont le jour même, pour me mettre en règle, et je demande au Ministre la permission de venir à Paris pendant quatre jours. Il refuse. En même temps que son refus, je reçois des nouvelles de plus en plus alarmantes. Je le presse par télégramme de m'accorder du moins une permission de vingt-quatre heures... Il refuse de nouveau! Alors, j'ai failli me révolter, donner ma démission, tout envoyer au diable! Guiraud m'a calmé, non sans peine. J'ai pris le parti de me rendre auprès d'Elle en cachette, vendredi dernier: je suis descendu à Charenton, où m'attendait son coupé. Je suis sûr de n'avoir pas été vu... Je l'ai de nouveau quittée le soir même. C'est alors qu'il a été convenu entre nous que j'irais vous porter la triste nouvelle, à vous qui étiez seule au monde à avoir connaissance du bonheur que nous avons perdu!»
J'écoutais son récit, émue au plus haut point. Je crois qu'il aurait fallu avoir un cœur de pierre pour n'en pas ressentir de l'émotion.
Il y avait, par moments, des larmes dans sa voix.
Il a repris de nouveau:
«Ma pauvre Meunière, maintenant que je vous ai dit nos chagrins, je vais vous quitter, car j'ai encore des dispositions à prendre pour pouvoir retourner ce soir à son chevet!»
«Repartir ce soir! me suis-je écriée. Pour l'amour de Dieu, mon général, ne faites pas cela! Votre souffrance, je la partage de tout mon cœur, mais je vous supplie de ne pas y sacrifier votre carrière, votre avenir militaire si magnifique! Vous voyez bien que les gens du Gouvernement sont jaloux de vous, qu'ils ont peur de la force que vous représentez, et qu'ils ne cherchent que l'occasion de vous perdre. Vous avez déjà commis, pardonnez-moi de vous le dire, une grave imprudence en venant passer une semaine ici à l'époque de vos arrêts de rigueur. Grâce à Dieu, personne ne s'en est douté. Vous êtes allé maintenant à Paris, deux fois, malgré la défense qui vous en a été faite. Vous croyez n'avoir pas été aperçu; mais, espionné comme vous savez que vous l'êtes, vous ne pouvez pas échapper davantage à la dénonciation... On signalera vos secrets déplacements et l'on vous accusera d'être allé à Paris pour comploter...»
Le général m'a interrompue:
«M'accuser de comploter, moi?... L'ironie serait un peu forte! Je viens encore de répondre «Non!» au député Laisant venu exprès me prier d'aller à Paris m'entendre avec ses amis politiques. Et je mettrai au défi qui que ce soit de prouver que je sois jamais allé comploter...»
«Mais on vous mettra au défi vous-même de donner un motif plausible à ces voyages...»
«Allons donc! Je n'aurais qu'à dire que je me suis rendu au chevet de ma femme gravement malade...»
«Malheureusement, comme Mme Boulanger n'est ni malade, ni disposée à servir vos desseins, on n'aurait pas de peine à prouver le contraire... Je vous en supplie, mon général, écoutez-moi. La manifestation électorale qui s'est faite dernièrement sur votre nom exaspère vos ennemis. Aux imprudences commises, n'en ajoutez plus de nouvelles!... Ne partez pas, mon général, laissez-moi partir—si vous le voulez, ce soir même! Sans doute, je ne vous remplacerai pas auprès d'Elle, mais, du moins, je la soignerai avec un dévouement qui atténuera votre inquiétude et qui vous permettra de rester à votre poste jusqu'à ce que vous puissiez vous en absenter régulièrement.»
Il m'a regardée de son œil gris, où passaient des lueurs sombres. Puis il m'a dit:
«Jamais!... Votre offre est celle d'une amie: je regrette de n'y avoir pas songé plus tôt, mais maintenant votre présence ne serait plus nécessaire... Quant à moi, rien, entendez-vous, rien ne peut m'empêcher de me rendre auprès d'Elle, ni les vexations du Gouvernement, ni les dangers qui me menacent, ni l'intérêt de mon avenir, ni même les supplications d'une amie telle que vous... Cependant, pour vous, et uniquement à cause de vos bonnes paroles, je veux faire une concession: je veux attendre quarante-huit heures encore—au prix de quelles souffrances, moi seul je le sais!—et je veux encore une fois demander une permission au Ministre... Mais c'est là, voyez-vous, ma dernière concession, car je n'en puis plus! je n'en puis plus!! je suis à bout!!!»
Ces dernières paroles, il les a prononcées avec un accent d'exaspération inouïe. Il m'a serré les deux mains avec violence, et il est descendu précipitamment.
Le malheureux! Il me semble qu'il est condamné à payer d'un prix terrible l'amour surhumain qu'il a pour cette femme.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
45.—Jeudi 15 mars.
Je suis partie ce matin de bonne heure pour Riom, et j'y suis restée toute la journée, extrêmement occupée par mes affaires jusqu'après cinq heures. Je m'achemine alors vers la gare pour rentrer à Clermont par l'express de Paris. Comme j'approche, j'entends des crieurs de journaux qui annoncent: «La Révocation du général Boulanger» et je vois tous les passants s'arrêter avec effarement, puis se jeter sur les journaux qu'on leur tend.
La nouvelle occupe en grosses lettres toute la manchette. Le général est révoqué en tant que commandant de corps d'armée et mis en non-activité par retrait d'emploi pour être secrètement venu à Paris, malgré la défense qui lui en avait été faite, le 24 février, le 2 mars et samedi 10 mars dernier.
46.—Vendredi 16 mars.
Le malheureux événement ne quitte pas un seul instant ma pensée. Je me suis inquiétée de savoir quelles pouvaient être exactement ses conséquences et voici ce que les journaux m'ont appris:
«Le général Boulanger se voit enlever les fonctions de commandant de corps d'armée qui lui avaient été confiées, mais il conserve son grade de général de division et reste à la disposition du Ministre de la Guerre.
»Le traitement afférent au grade se trouve réduit de deux cinquièmes.
»On le voit, sauf la privation de l'emploi et une retenue pécuniaire, la situation de l'officier général en non-activité n'entraìne pas de sérieux inconvénients.
»Mais, étant à la disposition du Ministre de la Guerre, il ne peut pas accepter de mandat politique.»
Parmi les commentaires relatifs à l'événement, je relève celui-ci:
«Il n'est à souhaiter, ni pour la France, ni pour le général Boulanger, qu'il entre dans la politique active. Il doit rester soldat et supporter sa mise en disponibilité avec calme. Ses ennemis et ses amis trop ardents le poussent dans une voie que son patriotisme doit l'empêcher de suivre.»
Je ne sais pas qui a écrit ces lignes. Comme je les signerais des deux mains!
47.—Dimanche 18 mars.
Les amis du général continuent de plus belle.
Pendant que la foule l'acclamait à Paris, partout où elle pouvait l'apercevoir, un journal boulangiste s'est fondé, La Cocarde et un «Comité de protestation nationale» s'est formé, pour poser sa candidature en signe de défi, quoiqu'il soit toujours inéligible, à toutes les élections qui vont se présenter! Il y a dans ce Comité des députés radicaux (dont pas un seul de chez nous), des journalistes, et même le rouge des rouges, Henri Rochefort.
Et il les laisse faire!
48.—Lundi 19 mars.
Il est revenu ce matin à Clermont. Il a fait ses adieux aux troupes par un ordre du jour de quatre lignes, et il s'occupe de tout déménager du quartier général. Son successeur est le général Warnet.
Il est question d'organiser une ovation patriotique pour mercredi ou jeudi, quand le général quittera définitivement Clermont.
49.—Vendredi 23 mars.
Le général est parti ce matin par le train de 9h. 18, au milieu d'une ovation comme on n'en avait jamais vu à Clermont. Je n'ai pas pu y aller, ne voulant pas quitter ma mère malade. Dès six heures du matin, j'ai vu des groupes descendre la route de la Vallée, des gars qui venaient de loin, de la montagne, et des charrettes comme s'il y avait grande foire à Clermont. à partir de dix heures, tout ce monde-là a commencé à revenir. Beaucoup se sont arrêtés chez moi.
Les gars avaient des rubans tricolores sur la blouse, sur le chapeau, comme au jour du tirage au sort. Tout le monde portait des médailles, des brochettes, des mirlitons, avec le portrait du brave général.
Les groupes reprenaient en chœur le refrain à la mode:
«Quand les pioupious d'Auvergne iront en guerre,
C'est là qu'on chant'ra!
C'est là qu'on dans'ra!
On fera la soupe dans la grande soupière,
Et pour la manger
On s'passera pas de Boulanger!»
ou encore ils chantaient à tue-tête:
«C'est Boulange, Boulange, Boulange,
C'est Boulanger qu'il nous faut!»
Les dernières nouvelles publiées le soir annoncent que l'ovation s'est continuée à toutes les stations du parcours.
50.—Lundi 26 mars.
Le général a été élu hier, dans le département de l'Aisne, par 45.000 voix.
C'est nul, puisqu'il est inéligible: mais le Gouvernement n'attendait plus que cela. Il l'a cité devant un Conseil d'enquête militaire, pour lui retirer sa qualité de soldat.
Il doit comparaìtre aujourd'hui même.
51.—Mercredi 28 mars.
C'est fait. Il n'appartient plus à l'armée!
Conformément à l'avis du Conseil d'enquête, le Gouvernement l'a mis à la retraite d'office pour fautes graves contre la discipline.
Dès ce jour, pour qu'il reprenne son épée, il faudrait une loi votée par les Chambres, même si la guerre éclatait demain!
Que va-t-il devenir, maintenant?
52.—Dimanche 1er avril.
Ceci n'est malheureusement pas un poisson d'avril, car la nouvelle, annoncée dès hier, s'est confirmée aujourd'hui.
Pendant que ses amis aidaient à renverser le Ministère, le général a manifesté sa volonté de faire de la politique—et quelle politique! Dans la proclamation qu'il adresse aux électeurs du département du Nord, il se déclare républicain, mais il répudie tous les partis existants, il attaque avec violence la Chambre des Députés, le parlementarisme, la séquelle gouvernementale, la Constitution... Il réclame la dissolution, la revision!
C'est la guerre qu'il vient de déclarer à tout l'état de choses qui existe actuellement.
53.—Lundi 9 avril.
Le général a été élu, hier, par 59.000 voix, dans le département de la Dordogne, et de plus il a encore recueilli 20.000 voix dans les départements de l'Aisne et de l'Aude, où il n'était pas candidat.
On l'accuse de se faire plébisciter comme autrefois l'empereur.
54.—Lundi 6 avril.
Le général a remporté un succès éclatant dans le département du Nord. Il a été élu par 172.000 voix—100.000 voix de plus que son concurrent gouvernemental!
55.—Vendredi 20 avril.
Hier jeudi, le général a fait son entrée à la Chambre des Députés. Il s'y est rendu dans un landau découvert, au milieu des acclamations de la foule.
Ses partisans exultent.
56.—Mercredi 25 avril.
J'ai eu le chagrin de voir aujourd'hui, pour la première fois, une manifestation antiboulangiste. C'était peu de chose, il est vrai. Quelques étudiants de Clermont, manifestant à l'instar des étudiants de Paris qui viennent de prendre la tête de ce mouvement.
Je ne sais pourquoi, ils sont remontés jusqu'à Royat, vers cinq heures du soir. En passant devant ma maison, ils hurlaient à qui mieux mieux:
«Conspuez Boulanger!
Conspuez Boulanger!
Conspuez!»
Ils s'interrompaient pour crier: «à bas Boulanger! Vive la République! à bas le dictateur! à bas le césarisme! à bas les plébiscitaires! à bas la Boulange!»
L'un d'eux brandissait, au bout d'un bâton, une image du général qui pendait, la tête en bas, à moitié lacérée.
En les voyant passer, une tristesse m'a étreint le cœur. S'il était resté le soldat patriote, s'il était resté lui-même, comme ces jeunes gens-là seraient unanimes à confondre les cris de: «Vive Boulanger!» et de: «Vive la France!»
57.—Dimanche 29 avril.
Les journaux mènent grand bruit autour du banquet que les amis politiques du général lui ont offert avant-hier soir, au Café Riche, pour fêter l'élection du Nord. Le héros de la fête a été le sénateur Naquet, le père du divorce, fraìchement converti au boulangisme. On a fait de lui le Vice-Président du Comité électoral, devenu maintenant le Comité républicain national. Dehors, sur les boulevards, la foule, pour n'en pas perdre l'habitude, manifestait ferme: car, depuis trois semaines, ce ne sont, à Paris, que manifestations et contre-manifestations à l'état chronique.
58.—Dimanche 6 mai.
Je viens de lui écrire, à l'Hôtel du Louvre, où il réside...
59.—Lundi 7 mai.
Nos lettres se sont croisées. Je reçois ce matin la suivante de Lui:
«Dimanche 6 mai.
»Nous désirons beaucoup revoir notre chère petite chambrette d'autrefois.
»Pouvez-vous nous la garantir pour quatre ou cinq jours compris entre le 20 et le 30 de ce mois? Il faudrait que nous fussions complètement sûrs qu'elle sera vacante à cette époque.
»Je vous prie de me répondre de suite, et, dans quelques jours, je vous ferai connaìtre la date exacte de notre arrivée.
»Avec nos meilleurs souvenirs de tous les deux.
»Général Boulanger.
»Hôtel du Louvre.»
Je me suis hâtée de répondre que ma maison était prête à les recevoir, et non seulement maintenant, mais toujours, à quelque moment qu'il lui plaise d'en profiter!
J'ai cru bon d'ajouter en post-scriptum que la prudence lui commandait de s'arranger de manière à ne pas passer par Clermont, s'il ne voulait pas être reconnu.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
61.—Dimanche 13 mai.
Je n'ai pas encore sa réponse, mais je n'en suis pas autrement étonnée. Depuis trois jours, il est en train de faire, à travers le département du Nord, un voyage qui n'est qu'un perpétuel triomphe.
Les journaux annoncent qu'aussitôt revenu à Paris, il va s'installer dans un coquet hôtel qu'il a loué, 11 bis, rue Dumont-d'Urville.
62.—Samedi 19 mai.
Sa réponse est arrivée:
«Vendredi 18.
»Merci de votre lettre. Nous avions déjà reçu la première. Nous n'avions jamais douté tous les deux de vos sentiments et nous étions assurés de toute votre bonne volonté.
»Donc, nous comptons sur vous, afin d'être bien tranquilles dans notre mignonne petite chambrette pendant quatre ou cinq jours.
»Nous arriverons à Royat le lundi 4 juin, à midi 49. Trouvez-vous à la gare avec une voiture.
»Vous voyez que, pour ne pas passer à Clermont, nous prendrons la ligne d'Orléans et nous arriverons par Limoges.
»à bientôt donc. Nous nous unissons pour vous envoyer un affectueux souvenir.
»G. B.»
Mon général, quoique stratégiste consommé, vous êtes d'une imprudence! Mieux vaudrait mille fois passer et repasser par Clermont que de descendre, en pleine saison, et sur le coup de midi, à la gare de Royat-les-Bains, c'est-à-dire à deux pas des grands hôtels et sous l'œil vigilant de M. le Commissaire de police, établi là en permanence pour dévisager, dès leur arrivée, messieurs les grecs et autres écumeurs de villes d'eaux! Et, par-dessus le marché, me convier à aller vous chercher, moi? moi qui, avec ma coiffe, suis plus connue que le loup blanc? Ce serait bien le comble!
Décidément, il faudra que j'avise à trouver autre chose.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
63.—Mercredi 30 mai.
Je viens encore de répondre: «Non» à une famille de Lyon, qui veut descendre chez moi pendant la première quinzaine de juin.
Mais, avec tout cela, je ne vois pas du tout comment fera le général pour arriver le 4 juin, puisque, s'il faut en croire les journaux, il doit prononcer la semaine prochaine son grand discours-programme, si impatiemment attendu par tout le monde?
64.—Jeudi 31 mai.
Le facteur m'apporte ce matin une lettre que l'envoyeur—le cher envoyeur—a omis d'affranchir. Comme je le prévoyais, c'est un contre-ordre:
«Ma pauvre Belle Meunière,
»Nous sommes désolés absolument, mais il nous faut retarder notre voyage de quelques jours.
»Nous ne pouvons pas partir dimanche prochain et arriver le lundi 4. Nous ne partirons que le mardi 12, et nous arriverons à la gare de Royat, par le train venant de Limoges, le mercredi 13, à midi 49.
»Répondez-moi, je vous prie, deux mots pour me dire que c'est bien entendu.
»Nous comptons passer chez vous quatre ou cinq jours pleins.
»Tous les deux, nous nous unissons pour vous envoyer notre meilleur souvenir et vous dire: à bientôt.
»Général B.
»Mercredi 30 mai.»
Toujours cette gare de Royat! Heureusement que j'ai trouvé mieux. Ils n'auront qu'à descendre à une petite station des environs, par exemple à Durtol, où j'enverrai une voiture les prendre et les ramener chez moi par le haut de la vallée, sans traverser Royat-les-Bains.
C'est ce que je lui ai écrit.
Il me reste maintenant à donner, à mon tour, contre-ordre à la famille de Paris à laquelle j'avais cru pouvoir promettre ma maison à partir du 15 juin.
65.—Mardi 5 juin.
C'est hier que le général a prononcé—ou plutôt qu'il a lu, à la Chambre, son grand discours-programme.
D'un bout à l'autre de sa lecture, le général n'a cessé d'être accablé d'interruptions: je comprends que cela l'ait mis assez mal à l'aise, car, lorsqu'on a été habitué, comme lui, pendant toute une vie, à être obéi sans réplique, on ne doit pas du tout être préparé à ce genre de discussions contradictoires!
Plus je vais et plus je pense qu'il a commis une erreur en se faisant député!
66.—Mercredi 6 juin.
Le général accepte ma combinaison:
«Vous avez parfaitement raison, ma chère Meunière, et c'est à la gare de Durtol que nous arriverons, à midi 40, le mercredi 13.
»C'est donc là qu'il faudra envoyer votre voiture nous attendre.
»Nous nous faisons une grande fête d'aller passer quelques bons jours chez vous, où nous avons été si heureux, et nous vous embrassons tous les deux.
»G...
»Mardi 5.»
Avec tout ce que j'ai refusé de monde depuis trois semaines, je n'ai plus chez moi que les deux pensionnaires venus hier et auxquels j'ai signifié que je ne pouvais pas les garder au delà de lundi prochain.
Mais la maison serait-elle comble de la cave au grenier, que je saurais bien faire le vide pour Eux!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
67.—Mardi 12 juin.
C'est donc pour demain! Les deux pensionnaires de Paris sont déménagés ce matin pour un autre hôtel, non sans m'avoir exprimé leurs regrets.
Je suis tout inquiète, car la grande affaire va être maintenant de les garder, Elle et Lui, à l'abri des yeux indiscrets. Sans doute, il n'y a plus à trembler pour Lui comme la première fois, lors de ses arrêts de rigueur. Encore ne faudrait-il pas qu'on l'aperçût, ce dont les antiboulangistes profiteraient aussitôt pour clamer: «Il est à faire la fête dans les villes d'eaux, au lieu de faire son métier de député!»
C'est surtout pour Elle que je suis inquiète. Jusqu'ici, quelques-uns soupçonnent bien l'existence d'une dame blonde, mais tout le monde, grâce à Dieu, ignore qui elle est, et l'on n'est guère plus renseigné à cet égard que l'année dernière.
La principale difficulté sera qu'ils voudront sortir, se promener. Ce passage du printemps à l'été est, dans nos montagnes, la saison où la nature apparaìt la plus belle. Jamais elle ne le fut plus merveilleusement que cette année.
Toutes les collines sont couvertes d'une fraìche verdure, tous les gazons sont constellés de fleurs d'où s'échappe un parfum pénétrant, qui embaume délicieusement l'air à la tombée du soir. C'est un vrai paradis terrestre! Aussi les baigneurs et les touristes sont-ils accourus en foule, cette année, et parcourent-ils les environs en tous sens depuis un mois déjà. C'est là justement ce que je redoute. Comment permettre aux deux amoureux de goûter, eux aussi, le charme de la nature, tout en empêchant qu'ils soient reconnus?
Le choix du cocher était un problème important. Je crois l'avoir résolu. Le cocher dont je me suis assuré est de toute confiance; il a été longtemps au service d'un prélat, et il a appris la discrétion à cette école. Je pense qu'il sera un auxiliaire excellent, docilement soumis à mes ordres, tout en ayant l'air de l'être à ceux du général... car, ainsi que l'a dit un jour Mme Marguerite: «Il faut parfois servir ses amis malgré eux!»
68.—Mercredi 13 juin.
midi
Ils viennent! Voici le petit mot de Lui que j'ai reçu ce matin:
«Nous partons ce soir. Ainsi, c'est bien entendu, nous trouverons votre voiture à Durtol demain mercredi, à midi 40.
Ȉ demain donc. Et mille bons souvenirs de nous deux.
»G...
»Mardi.»
La voiture est partie pour Durtol, il y a une bonne heure. J'ai donné au cocher le signalement des deux personnes qu'il devait prendre à la gare, et je lui ai fait les recommandations les plus minutieuses. Il doit, d'abord, les conduire droit à la voiture, puis, seulement, s'occuper d'y charger les bagages.
Ici, tout est prêt. La chambre est emplie des fleurs qu'ils aiment, de marguerites et de roses, et d'œillets rouges comme le sang. Bien que l'air soit très tiède dehors, un tout petit feu pétille dans l'âtre. Le soleil entre à pleins flots par les fenêtres donnant sur la Tiretaine...
onze heures du soir
à deux heures et demie, j'étais dans leur salle à manger, quand j'ai entendu la voiture revenir.
Le cœur me battait qu'elle ne fût vide... Mais non, j'aperçois une malle près du cocher! Je cours vers l'escalier, dans lequel j'entends monter un pas léger, et je La reçois dans mes bras au moment où Elle atteint le palier. Il suit à deux pas d'intervalle.
Tous deux m'embrassent comme une vieille amie que l'on n'a plus revue depuis des années.
Je m'échappe pour m'occuper de leurs bagages. Mais, quand je reviens auprès d'Eux, Ils m'embrassent de nouveau, en disant: «Chère bonne Meunière, quel bonheur, n'est-ce pas, de se retrouver?»
Vite, vite, je les fais passer dans la salle à manger. Un bon déjeuner est servi, qu'ils dévorent du meilleur appétit du monde. Tout en mangeant les bouchées doubles, Il s'adresse à moi:
«Ma pauvre Meunière, hein! que d'événements depuis que nous vous avons quittée?... Mais nous nous sommes juré de ne pas parler de tout cela pendant les quelques jours que nous passerons ici... Nous comptons rester jusqu'à lundi... D'ici là, pas un mot d'affaires sérieuses, ni surtout de politique. N'est-ce pas, Marguerite?... D'ailleurs, nous n'enverrons presque pas de lettres et nous n'en recevrons pas davantage, sauf peut-être des nouvelles de l'élection de mon ami Déroulède, qui va avoir lieu dans la Charente, dimanche... Les lettres ou dépêches qui nous arriveront seront adressées à votre nom... Il faudra que vous nous rendiez le service de porter vous-même nos lettres et nos dépêches, soit à la poste de Royat, soit à celle de Clermont... Nous allons vous remettre une dépêche tantôt... J'espère bien qu'on nous laissera tranquilles, car, plus que jamais, j'ai besoin de me détendre... Si vous saviez la vie que je mène à Paris...»
«Georges, a-t-Elle interrompu, je vous défends de vous en souvenir!»
«C'est vrai, a-t-il repris en souriant, sans quoi nous retomberions de suite dans la politique... Si jamais cela nous arrivait, je vous charge, Belle Meunière, de nous couper la parole net... Combien ce trajet par Limoges est interminable!... Nous allons nous reposer tout de suite, et nous serions bien heureux que vous nous apportiez notre dìner ce soir, après neuf heures... Savez-vous ce qui nous ferait plaisir? Un bon ragoût aux pommes de terre! C'est encore ce que nous aimons le mieux!»
Pendant qu'il parlait, je les regardais. Lui avait le visage plus blanc, moins hâlé, plus citadin, en un mot, qu'à l'époque où il était général. Elle était plus jolie que jamais dans sa toilette de voyage couleur gris-perle, très simple, mais, comme toujours, d'une élégance exquise. Elle en dépense de l'argent en toilettes! à chaque voyage, je ne reconnais plus rien de ce que j'avais vu au voyage précédent.
Ils se sont bientôt levés de table. Cinq minutes après être rentrés dans leur chambre, ils m'ont remis une dépêche à expédier, que j'ai portée aussitôt à la poste de Royat. Elle était ainsi conçue:
«Auguste, 14, rue Lapérouse,
»Enfant se porte bien.
»Parage.»
Aussitôt revenue de ma course, j'ai songé qu'il fallait que je porte mes deux pensionnaires sur mon livre des voyageurs. Car nous voici en pleine saison, et il s'agit d'être en règle avec les autorités. J'ai donc inscrit séance tenante: «M. et Mme Parage, rentiers, venant de Paris.»
Le soir, je leur ai porté leur dìner, avec le ragoût demandé, qu'ils ont trouvé excellent.
Après quoi, je leur ai souhaité le bonsoir.
C'est égal! Je me sens bien heureuse de les savoir là, tout près de moi, dans une paix profonde, où rien ne trouble ces deux cœurs qui battent à l'unisson...
69.—Jeudi 14 juin.
Ce matin, à huit heures, j'étais à peine levée quand on est venue me prévenir qu'un agent de police en uniforme me demandait.
Je descends. Cet homme me réclame, de la part de M. le Commissaire spécial de police, mon livre des voyageurs. Je le lui remets aussitôt et il s'en va.
Bien que cette formalité se répète assez souvent au cours de la saison, j'étais sur le qui-vive. Je redoutais autre chose.
En effet, à onze heures du matin, on m'annonce que l'agent est revenu et qu'il m'attend dans la salle commune. Je me hâte de m'y rendre. Il me dit que M. le Commissaire de police me demande de passer à son bureau pour une communication importante qu'il a à me faire. Je réponds que je m'empresserai d'y aller de suite après déjeuner. Mais cet homme insiste, m'invitant à l'accompagner de ce pas, attendu que M. le Commissaire a à me parler d'urgence. Que faire? Le temps de jeter une mantille sur les épaules et je sors avec l'agent, qui a presque l'air de me conduire au poste. Nous descendons vers le parc de l'Établissement thermal, suivis par quelques regards curieux. Je me sentais tout à la fois contrariée de devoir m'absenter de la maison, à une heure où Ils pouvaient me sonner d'un moment à l'autre, et vaguement inquiète de ce qui allait se passer.
Nous voici au Commissariat de police. En me voyant entrer, M. le Commissaire se lève avec empressement et m'avance un siège le plus aimablement du monde.
«Merci, Monsieur le Commissaire, lui dis-je, je n'en ferai rien... C'est l'heure du déjeuner, et je vous serais très reconnaissante de me retenir aussi peu que possible,—à moins, toutefois, que vous ne croyiez devoir me garder tout à fait, ce que l'on aurait presque pu supposer en voyant la manière dont votre agent m'a escortée jusque chez vous...»
«Oh! le monstre! a-t-il répondu, je vais le réprimander d'importance... Il lui suffisait de vous transmettre l'invitation que je vous ai faite de bien vouloir venir... Je vous prie instamment de ne pas me garder rancune de cet excès de zèle.»
«Je vous prie, à mon tour, Monsieur le Commissaire, de ne pas gronder cet homme... Je crois que vous devez avoir besoin d'agents zélés, et même parfois zélés à l'excès...»
«à condition, Madame, que ces excès de zèle ne puissent donner aucun sujet de plainte à des personnes méritant, comme vous, toute ma confiance et toute ma sympathie... Car, enfin, votre profession fait de vous une aide précieuse à laquelle il m'est indispensable de recourir dans l'accomplissement de la tâche qui m'est confiée... Aussi ai-je l'espoir que vous voudrez bien me faciliter cette tâche en toute circonstance par la bonne volonté que vous mettez à me renseigner, aussi complètement que possible, sur les points dont j'aurai à m'informer près de vous...»
«Monsieur le Commissaire, soyez assuré de mon concours le plus dévoué.»
«Et vous, Madame, de toute ma reconnaissance... En feuilletant votre livre, j'ai été péniblement surpris de constater que vous aviez reçu, ce mois, moins de monde qu'à l'ordinaire, alors que les autres hôtels se félicitent plutôt d'un accroissement dans l'affluence des voyageurs...»
«C'est vrai, Monsieur le Commissaire. Je n'arrive pas à m'expliquer à quoi cela peut être dû.»
«Il ne faut pas vous en inquiéter. Je suis sûr que c'est un accident passager qui ne persistera pas... En somme, vous n'avez eu, depuis le 1er juin, que quatre pensionnaires: deux venus le 5, si je ne me trompe, et repartis le 12, et deux autres venus hier?»
«C'est cela même, Monsieur le Commissaire.»
«Voulez-vous être assez aimable pour me donner tous les renseignements dont vous disposez sur les pensionnaires qui sont partis le 12?»
Je respirais! C'était donc à cause de ceux-là, et non de mes chers arrivants d'hier, que j'étais convoquée! Je me suis empressée de dire tout ce que je savais. Il m'écoutait avec la plus grande attention, me posait diverses questions pour préciser le signalement de ces deux personnes, et prenait quelques notes.
Quand j'eus tout dit, il s'est levé en me remerciant de la façon la plus gracieuse. Toute heureuse d'en être quitte à si bon marché, j'allais me retirer, quand il m'a dit subitement:
«Bon! et vos deux voyageurs d'hier que j'allais oublier... Je ne veux pas vous retenir davantage, Madame: deux mots seulement sur ce qu'ils vous paraissent être...»
J'ai senti un frisson me courir de la nuque au talon: c'était le moment décisif.
«Monsieur le Commissaire, ai-je répondu, que vous dire? Je les ai encore si peu vus... Ce sont un monsieur et une dame de Paris... Vous avez vu leurs noms sur mon livre...»
«Oui, M. et Mme Parage... Leur signalement, s'il vous plaìt?»
«La dame est une très jolie personne de trente-cinq ans environ, blonde dorée, l'air délicat et fin... Elle portait, en arrivant, une grande pelisse de soie couleur gorge de pigeon, avec un chapeau de paille à plumes noires et une épaisse voilette noire à petits pois... Elle est très élégante. Je serais presque tentée de dire qu'elle l'est trop...»
Pendant que je lui parlais ainsi, il écoutait avec de petits hochements de tête, comme un homme satisfait d'entendre confirmer des détails qui lui ont déjà été signalés. Il m'a demandé, en clignant de l'œil:
«Trop élégante? Alors, vous supposez que c'est une... personne à allures tapageuses?»
«Mon Dieu, Monsieur le Commissaire, elle me fait plutôt l'effet d'être une actrice, une de ces actrices des grands théâtres de Paris...»
«Bien! Très bien!... Et le Monsieur?»
«Le Monsieur?... Oh! celui-là, je n'ai pas besoin de vous le décrire en détail! Il me suffira de vous dire que sa figure ressemble trait pour trait à celle du général Boulanger...»
Un éclair de joie triomphante a illuminé le visage du commissaire.
«...Sauf, toutefois, ai-je ajouté, qu'elle accuse dix ans de moins.»
Patatras! Impossible d'imaginer mine plus déçue que celle que M. le Commissaire a faite à ces mots! J'ai continué, avec le même calme souriant:
«Cette ressemblance est tellement curieuse que, lorsque ce Monsieur est descendu pour dìner avec sa dame, les personnes présentes s'y sont trompées sur le premier moment. Lui-même s'en est aperçu, et il en a bien ri... D'ailleurs, Monsieur le Commissaire, si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, j'aurais plaisir à vous le montrer dès qu'ils seront de retour, car ils sont partis pour le Mont-Dore ce matin, mais ils ne tarderont pas à revenir d'ici deux ou trois jours... Ils ont laissé leurs bagages chez moi.»
J'avais beau parler, il n'y était plus. Ses yeux se fixaient machinalement sur une grande feuille de papier qui était là, devant lui, et sur laquelle se trouvait épinglée une dépêche. Ses pensées vagabondaient ailleurs...
«Oui, nous verrons...» a-t-il murmuré d'un air distrait. Puis, s'arrachant brusquement à ses préoccupations: «Merci encore, chère Madame, m'a-t-il dit, pour la parfaite bonne grâce avec laquelle vous avez bien voulu me renseigner... Je suis désolé de vous avoir retenue aussi longtemps, et je vous en fais toutes mes excuses.»
J'ai répondu par ma plus belle révérence, et me voilà courant vers ma maison, avec l'immense contentement intérieur d'avoir gagné la partie. Des bouffées de joie me montaient au visage quand je songeais qu'à ce moment même, M. le Commissaire spécial de police devait être en train de rédiger son rapport: «Cherchez ailleurs, c'est une fausse piste, le général Boulanger n'est pas à Royat!»
Je réfléchissais en même temps quel prétexte inventer pour expliquer au général mon absence, dans le cas où il m'aurait vainement sonnée. Mais la précaution n'a pas été nécessaire: le petit grelot n'avait pas encore retenti.
La journée s'est passée sans autre incident, le plus gaìment du monde. Vers les cinq heures, le général m'a exprimé le désir d'aller faire un tour de promenade en voiture. Cela ne m'arrangeait pas du tout, puisque j'avais dit au commissaire de police que mes deux pensionnaires se trouvaient, en ce moment, au Mont-Dore. J'ai donc expliqué au général que mon cocher—le seul qu'il fût possible d'employer en toute confiance—avait malheureusement été empêché de venir aujourd'hui... En réalité, le brave homme se morfondait à la porte depuis le matin, avec sa voiture. Ils ont fort bien pris la chose. Comment n'auraient-ils pas bon caractère? Ils sont si heureux!
70.—Vendredi 15 juin.
Aujourd'hui à midi, en allant se mettre à table, ils m'ont demandé des journaux. J'avais là le Figaro, le Gaulois, la Cocarde, le Temps, sans parler des gazettes locales.
Mme Marguerite les a dépliés et s'est mise à en lire les principaux passages à haute voix. Tout à coup, ses yeux sont tombés sur un entrefilet où le Général était cité: elle a commencé à le lire, mais, aussitôt, elle s'est arrêtée, et, devenue toute pâle, elle s'est trouvée mal. Le Général s'est précipité vers elle en renversant presque la table. Je me suis empressée de mon côté, et, grâce à Dieu, nous n'avons pas eu de peine à la faire revenir à elle.
«Ce n'est rien, a-t-elle dit d'une voix toute faible encore, c'est cet entrefilet qui m'a fait peur... On annonce que le Général est parti pour le centre de la France et qu'il passera sans doute quelques jours en Auvergne... Mais j'ai eu peur qu'il n'y ait quelque chose de plus... La révélation livrant mon nom au public...»
Lui et moi, nous la rassurions à qui mieux mieux. Mais ils avaient été si bouleversés tous deux, qu'ils n'ont plus rien pu manger.
Ce que cet incident, heureusement peu grave, va me servir de leçon! Dès cette heure, plus un journal ne passera sous leurs yeux avant que je ne l'eusse parcouru ligne par ligne; et au feu, sans pitié, tous ceux qui contiendraient ne fût-ce qu'un seul mot de nature à troubler la paix de leur bonheur!
J'ai pensé qu'une bonne promenade en voiture achèverait de dissiper ce petit nuage qui s'était montré dans leur ciel bleu. J'ai donné au cocher les instructions les plus complètes: se ranger, tant au départ qu'à l'arrivée, tellement près du seuil de la porte qu'il n'y ait pas à mettre le pied dans la rue pour passer de la maison à la voiture ou réciproquement; ne découvrir la voiture qu'en atteignant la pleine campagne et la refermer à l'approche de Royat; marcher doucement quand il n'y aurait personne en vue, mais filer à toute vitesse dès que l'on croiserait une voiture ou un passant, afin que les regards indiscrets n'aient pas le temps de dévisager; si le Général donnait des ordres peu prudents, faire le sourd le plus longtemps possible, jusqu'à ce que le danger à éviter ait disparu... Le cocher a parfaitement compris. Me voilà tranquille.
à six heures, jugeant le moment opportun, je suis montée leur annoncer que la voiture les attendait. Ils en ont eu joliment de la joie.
Ils sont revenus à neuf heures seulement, enchantés de cette belle promenade, la première qu'ils eussent faite ensemble dans notre Auvergne. Elle avait des fleurs plein les mains. Le cocher les avait conduits par delà Gravenoire, à travers des sites adorables et tout fleuris. Ils se déclaraient émerveillés de la richesse de la flore et des senteurs captivantes, grisantes, qui s'en dégageaient dans la fraìcheur du soir.
Ils échangeaient encore leurs impressions enthousiastes quand je les ai laissés.
71.—Samedi 16 juin.
J'ai commencé ma journée en faisant consciencieusement mon métier d'Anastasie, mais je n'ai eu à condamner aucun journal, pas un seul ne parlant du voyage du général.
Dans le pays même, on ne se doute de rien. Les mieux informés savent seulement que le général a quitté Paris et se trouve en excursion soit dans le Midi, soit dans le Centre de la France. Cependant, je ne crois pas me tromper en devinant des agents de police secrète dans deux ou trois individus que je vois depuis hier rôdant autour de la maison. J'ai appris avec étonnement qu'il existe plusieurs polices indépendantes l'une de l'autre: peut-être que ceux-là travaillent pour le compte d'autres chefs que le commissaire spécial de Royat. En tout cas, c'est notre poche de contribuables qui paye les uns et les autres... Et tout cela, pourquoi faire???
Il est venu une lettre ce matin, sous double enveloppe, la première à mon nom, la seconde au nom de Mme Marguerite. Ils ont causé à déjeuner des nouvelles qu'elle apportait: c'était relatif à une instance extrêmement très coûteuse que Mme Marguerite, qui est très pratiquante, a introduite en cour de Rome pour solliciter de l'Église l'annulation de son mariage religieux, le divorce civil qu'elle a obtenu ne pouvant pas lui suffire. à cette occasion, le général a fait allusion à sa propre instance en divorce contre Mme Boulanger.
Après déjeuner, ils m'ont mise en colère par leur imprudence incorrigible. Les voilà qui se mettent à la fenêtre grande ouverte, lui la tenant par la taille. Or, au même instant, M. Charles Dilke, l'homme politique anglais, sa femme et leur dame de compagnie, qui sont venus tous trois déjeuner ce matin, passent sur la terrasse! Le général a très bien reconnu M. Charles Dilke: je tremble que la réciproque ne soit vraie, car ces hommes politiques sont tous journalistes, dès qu'il s'agit d'être indiscrets...
à sept heures du soir, ils ont fait leur seconde sortie en voiture et ne sont revenus dìner que vers dix heures. Ils sont allés, cette fois, dans la vallée de Fontanas, jusqu'au pied du Puy de Dôme. Leur promenade les a ravis autant que celle d'hier.
à dìner, je ne sais comment, la conversation est tombée sur les événements du mois de mars.
Le général est devenu grave, sous le coup d'une pensée qui a traversé son esprit. Il l'a exprimée aussitôt:
«Ah! ils m'ont arraché mon épée!... Ils savaient bien que jamais je ne la déposerais de mon propre gré!... Sous prétexte qu'on faisait de la politique sur mon nom, ils m'ont forcé à en faire moi-même... Eh bien! ils s'en repentiront: la politique me rendra ce qu'ils ont cru qu'elle me ferait perdre!»
Il a prononcé ces paroles avec une puissante énergie. Au bout d'un instant, il m'a demandé:
«Et vous, Belle Meunière, que pensez-vous de mon entrée dans la politique?»
J'ai eu envie de lui répondre que je la trouvais déplorable. Mais je me suis dit: à quoi bon?
«Mon général, ai-je répondu, je pense... que vous m'avez donné l'ordre de vous couper la parole net, dès que vous vous mettriez à causer politique... Je ne connais que ma consigne, moi!»
Il a ri de bon cœur du biais que je venais de prendre. Dès ce moment, ils ont causé de choses quelconques. Il était minuit passé quand ils se sont retirés dans leur chambre. Presque aussitôt, ils m'ont sonnée. Le général m'a priée de lui acheter, demain matin, ce qui se trouvait indiqué sur une fiche qu'il m'a remise. Cette fiche porte:
Indicateur des Chemins de fer.—Guides Joanne ou autres:
Espagne et Baléares, Maroc, Tunisie,
Italie et Sicile, Suisse.
Quel projet y a-t-il là-dessous?
72.—Dimanche, 17 juin.
Mon premier soin a été d'aller chercher les livres demandés à la papeterie du Casino, puis, n'ayant pas trouvé tout ce qu'il fallait, aux librairies de Clermont. Comme la plupart étaient fermées, j'ai dû revenir sans les Guides pour l'Espagne et pour le Maroc.
Quand ils m'ont sonnée pour le déjeuner, je leur ai remis mon emplette, en promettant de la compléter demain. Ils l'ont apportée à table, et, tout en feuilletant les volumes, ils se sont mis à causer de leurs projets: partir de Paris pour un grand voyage dès la fin du mois prochain, quand les débats où il devait intervenir seraient terminés à la Chambre; visiter l'Espagne, le Maroc, toucher peut-être à Tunis, y séjourner quelques jours pour se reposer, de là, aller en Sicile, revenir enfin par l'Italie et la Suisse.
L'après-midi, ils se sont mis à lire le manuscrit d'un grand ouvrage militaire que le capitaine Driant est en train d'écrire. J'étais entrée leur apporter des fleurs fraìchement arrivées: je me suis arrêtée à les regarder, tant ils étaient beaux à voir. C'est Elle qui lisait, assise, drapée dans un délicieux peignoir en surah bleu clair, dont les larges manches garnies de point d'Alençon, laissaient s'échapper ses bras, à demi nus. Lui se tenait à ses pieds, sur un coussin enlevé du divan, les bras passés autour de sa taille et ne la quittant pas des yeux. Je crois qu'il la regardait lire plutôt qu'il ne l'écoutait, n'en retenant que la beauté de ses lèvres qu'il voyait s'entr'ouvrir et le son argentin de sa voix qui le berçait délicieusement. Parfois, il l'interrompait de force, lui abaissait les bras pour les couvrir de caresses et l'attirait vers lui pour mettre sur ses lèvres un long baiser où toute son âme se donnait...
Comme ils s'aiment! J'avais cru, lors du premier voyage, puis tout au moins lors du second, que leur amour avait atteint ce maximum qu'il doit être humainement impossible de dépasser. Eh bien! je me suis trompée, chaque jour je constate que la violence de cette passion a augmenté d'un degré. Et je me demande avec anxiété: où s'arrêtera-t-elle?
à six heures, ils m'ont sonnée pour leur promenade. La voiture attendait, mais, à cause du grand nombre de Clermontois que ce beau dimanche d'été a attirés à la campagne, j'ai jugé qu'il n'était pas encore prudent de sortir. Je leur ai donc répondu d'un air désolé que le cocher, dont je ne m'expliquais pas la conduite en cette circonstance, n'était pas encore là.
Un peu contrariée, Elle s'est mise à faire de la musique, qu'il est venu écouter comme il avait écouté tantôt la lecture.
à huit heures, ils ont accepté ma proposition de dìner de suite pour sortir après, au cas où ce monstre de cocher reviendrait! Au dìner, ils ont eu un moment de tristesse, en songeant à l'enfant qui aurait dû naìtre dans deux mois d'ici.
Je leur ai raconté avec quelle joie intime je mûrissais dans mon esprit, souvent en des heures d'insomnie, le projet de cette quasi-maternité qu'ils avaient bien voulu me proposer; comment je m'occupais déjà du choix d'une nourrice, que je voulais belle entre les belles, pleine de santé, de force et de fraìcheur... Puis je leur ai dit toute la désolation que j'avais éprouvée en voyant s'écrouler mon rêve...
«Au moins, ai-je conclu, me promettez-vous que je puis encore garder de l'espoir que tout n'est pas perdu?...»
à cette question, ils ont souri tous deux, et ils m'ont dit en se regardant:
«Nous vous le promettons!»
Vers les dix heures, je leur ai annoncé que le cocher venait enfin d'arriver, que je l'avais secoué d'importance, mais qu'il s'était excusé en raison d'un accident survenu à l'un de ses chevaux.
Ils ne sont revenus qu'après minuit de leur promenade, faite en voiture découverte par une nuit de toute beauté.
73.—Lundi 18 juin.
Dès la première heure du matin, une dépêche a été apportée à mon nom. Elle venait d'Angoulême, n'était pas signée, et contenait seulement ces mots:
Arrivage 145 barriques Mercuriale rouges 119 blancs 114 piquette 91
N'y comprenant rien, j'ai porté la dépêche au général, à son premier coup de sonnette. Il a bien ri de ma perplexité. Les barriques indiquaient le nombre de sections dont le vote était dès maintenant connu, dans l'élection de la Charente. Les autres chiffres disaient combien de centaines de voix chaque candidat avait obtenues. Les vins rouges, c'était Déroulède; les vins blancs, c'était le candidat conservateur Gélibert des Séguins; la piquette, c'était le candidat opportuniste, un nommé M. Weiller. Le général se déclarait enchanté de ces premiers résultats partiels, puisque Déroulède tenait la tête, tandis que l'opportuniste ne venait qu'au troisième rang!
Là-dessus le général m'a pressée d'aller à Clermont lui rapporter les deux volumes qui manquaient, car Lui et Elle voulaient prendre à Durtol le train qui les amènerait à Limoges pour huit heures du soir, et ils désiraient s'occuper, tout le long de la route, de leur grand projet de voyage à l'étranger.
à onze heures, j'étais de retour avec mon emplette. Eux, pendant ce temps, avaient fait leurs malles. Ils ont alors déjeuné, assez légèrement.
Ils m'ont fait une drôle de confession: c'est qu'à diverses reprises, au cours de leurs séjours chez moi, il leur est arrivé de cacher et de brûler ensuite dans la cheminée une partie de ce que je leur servais, pour que je ne fusse pas trop peinée de les voir si peu manger.
Quand ils m'ont fait leurs adieux, bien affectueusement, la plus oppressée et la plus chagrine de nous trois, c'était certainement moi. Eux étaient tout heureux des beaux jours sans nuages passés ici et de ce grand projet dont ils rêvent en s'en promettant une volupté infinie...
Au moment de descendre l'escalier, elle l'a laissé passer en avant, et m'a glissé dans la main, sans prononcer une parole, un papier plié. Elle y avait tracé, de sa fine écriture d'élève d'un grand couvent, ces mots:
S'il arrive une dépêche, l'ouvrir, la copier textuellement et l'adresser à M. Parage, au buffet de la gare de Limoges, Bénédictins.
Mais aucune dépêche n'est venue. Bien entendu, j'ai fermé leur chambre, qui ne s'ouvrira plus qu'à leur retour.
Quand?...
74.—Mardi 19 juin.
Le général a dû éprouver une bien vive contrariété, puisqu'en fin de compte les vins rouges ont fléchi tandis que les blancs faisaient prime et que la piquette elle-même améliorait son cours! Les résultats complets, connus aujourd'hui, ont cruellement démenti les prévisions d'hier. Loin de tenir la tête, Déroulède n'arrive que troisième et dernier au ballottage, distancé non seulement par Gélibert des Séguins, mais par Weiller lui-même! Et déjà les journaux antiboulangistes ricanent: «Preuve absolue que le général, en dépit de ses succès personnels, n'est pas en état de faire élire ses partisans... Bien plus, défaite directe pour lui, puisqu'il a eu l'imprudence de dire aux électeurs: «Voter pour Déroulède, c'est voter pour moi!»
Les journaux commencent à s'inquiéter sérieusement—il en est bien temps!—de ce qu'a bien pu devenir le général depuis une semaine.
Les bruits les plus contradictoires ont couru. On a parlé d'un voyage secret du général à Berlin, en vue de rassurer le nouvel empereur allemand sur ses intentions pacifiques. On a prétendu, d'autre part, que le général était compromis dans le drame de la Boissière, où son ami, le commandant Hériot, a été blessé d'un coup de feu et qu'il se cachait pour cela.
Le XIXe Siècle assure que le général a été aperçu à Agen, blessé à la jambe et voyageant en compagnie d'une dame très corpulente.
La Cocarde et la Presse déclarent qu'il a fait simplement un voyage à Auch.
Par contre, le Figaro d'hier annonce que, parti de Paris, gare d'Orléans, mardi dernier, au soir, il s'est rendu d'abord à Toulouse, puis en Auvergne chez un ami, dans un château aux environs de Thiers.
Un journaliste de Clermont est venu m'interviewer pour tâcher de me faire avouer qu'il était chez moi.
Je lui ai tenu le même langage qu'au commissaire de police, et j'ai ajouté en riant que le monsieur qui était descendu chez moi ressemblait si outrageusement au général que j'avais cru devoir lui conseiller de se faire couper la barbe s'il voulait éviter d'autres mésaventures.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
75.—Mardi 3 juillet.
Reçu aujourd'hui la première lettre qui me vienne de Mme Marguerite:
«Ne croyez pas, ma bonne Meunière, que nous vous oublions. Ne le pensez pas. Nous nous souvenons au contraire de vous et nous pensons bien souvent aux heures heureuses que nous avons passées dans votre jolie chambrette. Comptez donc toujours sur nous.»
Ce n'est qu'un petit mot, écrit à la hâte. Mais qu'il m'a été agréable et avec quel plaisir j'y ai répondu!
76.—Mardi 10 juillet.
Le général fait en ce moment un voyage à travers la Bretagne, son pays natal. Partout, les populations l'accueillent, avec enthousiasme, comme un compatriote dont elles sont glorieuses et fières. Hier, à Saint-Servan, il a prononcé des paroles qui m'ont causé bien de la joie. Il a déclaré qu'il ne poursuivait qu'un but: «reprendre son épée» et qu'il y atteindrait avant un an.
77.—Vendredi 13 juillet.
Reçu ce matin un autre billet de Mme Marguerite:
«Jeudi 12.
»Ma bonne Meunière, merci de votre lettre affectueuse. Vous avez en nous de bons amis en qui vous pouvez avoir toute confiance. Soyez assurée de notre sincère affection.»
Dans ces quelques mots aucune préoccupation ne se trahit. Sûrement, ils ont dû être écrits avant...
Car, hier après-midi, il y a eu une séance épouvantable à la Chambre. Le général est venu sommer l'Assemblée de reconnaìtre son impuissance et de réclamer elle-même sa dissolution.
«La Chambre, a-t-il dit, est incapable de rien produire... Elle a renversé, pour les motifs les plus futiles, cinq ministères, et le sixième est une déception de plus... La Chambre est en fragments, en débris, en poussière!»
Un tumulte sans nom a accompagné ces paroles. La majorité, debout tout entière, a couvert d'invectives le général et ses quelques partisans.
Le Président du Conseil a répondu au général par une attaque violente: «Le plus modeste de ces représentants du peuple que vous insultez, s'est-il écrié, a rendu à la République plus de services que vous ne pourrez jamais lui faire de mal!»
Le général a bondi de son siège, s'est élancé vers M. Floquet, lui criant qu'il avait impudemment menti. La Chambre a voté la censure, au milieu d'un vacarme sans précédent: mais le général n'a pas attendu le vote et il a jeté sa démission de député.
Voilà donc où nous en sommes avec cette infernale politique qui ne fait qu'exalter de part et d'autre l'exaspération!
78.—Samedi 14 juillet.
Son sang a coulé.
Il s'est battu avec M. Floquet, à mort, hier matin. Il a reçu un profond coup d'épée dans le cou. Il est tombé blessé grièvement,—peut-être mortellement.
79.—Dimanche 15 juillet.
Oh! la triste veillée que j'ai faite hier, seule dans leur chambre, pendant qu'au dehors éclataient les pétards de la Fête Nationale et résonnaient les mirlitons...
J'ai attendu avec impatience l'arrivée du matin pour courir aux nouvelles. Le premier journal que j'ai pu me procurer, j'ai presque hésité à le déplier, tant j'avais peur d'y lire: «Le Général a succombé à sa blessure.»
Grâce à Dieu, la blessure n'est pas mortelle! Il s'en est fallu de quelques millimètres!
Je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Mon cœur disait qu'il fallait partir de suite, aller à Paris, auprès de Lui, à son chevet. Mais ma raison répondait qu'il ne se trouvait pas chez lui, qu'il était resté dans la maison dont le jardin avait servi de champ clos, chez le comte Dillon, un ami pour lui, un inconnu pour moi...
J'ai donc simplement envoyé une dépêche chez le comte Dillon, à Neuilly, près Paris, 6, boulevard d'Argenson.
Par moments, mon cœur me reproche tout de même d'avoir obéi à ma raison...
80.—Lundi 16 juillet.
L'état du cher blessé s'améliore. La blessure entre en voie de guérison. Il a pu prendre un peu de nourriture.
J'ai lu que Mme Boulanger s'était rendue auprès de lui avec ses deux filles.
J'ai lu aussi qu'une élégante dame blonde, qui suivait des yeux la rencontre dans une voiture arrêtée près de la grille du jardin, s'est évanouie au moment où le général est tombé...
81.—Mardi 17 juillet.
L'angoisse me reprend. Son état s'est aggravé. Des bulles d'air ont pénétré dans la plaie. Une congestion pulmonaire s'est déclarée.
82.—Mercredi 18 juillet.
Enfin, une lettre d'Elle!
«Mardi 17 juillet.
»Ma bonne Meunière,
»Vous avez dû,—d'après l'affection que vous nous portez,—passer quelques jours bien pénibles... Mais, grâce à Dieu, je vous griffonne ces mots pour vous dire que notre cher Général est en pleine voie de guérison. Ne vous tourmentez donc plus et donnez-nous bien vite de vos bonnes nouvelles. Vous savez à quel point nous nous intéressons à vous.
»Encore et bien toujours à vous!»
C'est donc Elle qui est à son chevet! Tant mieux, je puis leur écrire maintenant sans hésitation.
C'est justement la Sainte-Marguerite après-demain. Je vais envoyer, chez le comte Dillon, une jardinière pleine de marguerites.
83.—Vendredi 20 juillet.
Il y a amélioration sensible. Avant-hier, il a bien dormi, bien mangé et il a pu quitter le lit pour un fauteuil pendant une heure. Hier, le mieux a continué. La blessure s'est cicatrisée. Il ne reste plus que la congestion pulmonaire, qui ne semble pas offrir de danger.
84.—Samedi 21 juillet.
L'état devient tout à fait rassurant. Le Général a pu se tenir levé pendant quelques instants.
Demain aura lieu, dans le département de l'Ardèche, une élection qui prend une importance exceptionnelle, puisque le Général en attend le siège de député que sa démission lui a fait perdre. Le duel l'a malheureusement empêché de se rendre auprès de ses électeurs, mais on pense, cependant, qu'il passera à une grosse majorité.
85.—Dimanche 22 juillet.
Le Général est guéri. Il a pu se lever pendant des heures entières. Il rentrera peut-être aujourd'hui même chez lui, rue Dumont-d'Urville.
Comme j'ai remercié Dieu, ce matin!
86.—Lundi 23 juillet.
Le Général est rentré dans son hôtel de la rue Dumont-d'Urville.
L'élection de l'Ardèche est une défaite: il est mis en minorité par 43.000 voix contre 27.000.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
87.—Mercredi 8 août.
Le Général a repris la lutte électorale. Il s'est représenté dans le département du Nord, et, en outre, dans ceux de la Somme et de la Charente-Inférieure. Les trois élections doivent avoir lieu ensemble, de dimanche en huit.
Il accomplit en ce moment sa tournée de candidat dans la Charente-Inférieure. L'accueil que lui font les populations paraìt aussi chaleureux qu'auparavant. La semaine prochaine, il se rendra dans la Somme.
88.—Lundi 13 août.
Il a eu lieu, l'attentat que tant de gens souhaitent peut-être avec ferveur dans le tréfonds de leur âme,—l'attentat contre la vie du général Boulanger! Seulement, il a raté.
Hier après-midi, à Taillebourg, entre Saintes et Saint-Jean-d'Angély, dans la Charente-Inférieure, le landau du général débouchait sur la place de l'Église, au milieu des acclamations de la foule, quand un homme s'est élancé vers le général, déchargeant sur lui cinq coups de revolver. Deux paysans, qui se tenaient contre les roues, ont été blessés. Un cheval s'est abattu sous les coups de feu. Le général, admirable de sang-froid, s'est levé droit dans la voiture, faisant signe qu'il n'était pas atteint. Mais déjà la foule en fureur se ruait sur le meurtrier. Cinq brigades de gendarmerie ont eu la plus grande peine à arracher l'homme aux mains de ceux qui l'auraient lynché sur place. Les citoyens indignés ont alors dételé le landau et se sont mis à le traìner eux-mêmes.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
89.—Lundi 20 août.
C'est un succès complet, écrasant, sur toute la ligne. Comme il n'avait cessé de le prédire, il est élu au premier tour dans les trois départements: dans la Charente-Inférieure par 57.000 voix; dans la Somme par 76.000; dans le Nord par 142.000!
Les échecs du mois dernier sont effacés du même coup, sans qu'il en survive le moindre vestige. Son étoile apparaìt plus resplendissante que jamais.
90.—Vendredi 31 août.
Les journaux annoncent que le Général est parti pour un voyage de quelques semaines qui le conduira en Suède et Norvège et peut-être en Russie.
Je n'en crois pas un traìtre mot. Le voyage que le Général est en train d'entreprendre doit être celui-là même dont ils ont causé tous deux ici, et que le duel, ainsi que la triple élection, auront forcé de retarder jusqu'à ce moment.
Le Général a d'ailleurs joliment raison de fournir aux curieux une fausse piste. Tous les yeux vont maintenant se tourner vers la Norvège. Ils y perdront le Nord, les pauvres, tandis que lui, tranquillement, gagnera le Midi.
91.—Jeudi 20 septembre.
Rien de plus drôle que le bruit qui se mène autour du voyage du Général. Tous les journaux en parlent et chacun donne une version différente. Les journaux du parti persistent à affirmer que le général s'est rendu en Norvège et détaillent ses faits et gestes à Christiania. Mais les correspondants d'autres journaux leur télégraphient que jamais le Général n'est venu dans ces parages. D'autre part, on croit l'avoir aperçu en Allemagne, à Hambourg, à Dresde, à Gastein, dans un couvent de Bavière; on parle même d'une entrevue avec Bismarck. On le signale aussi en Suisse, à Lucerne, à Prangins où l'on suppose qu'il est allé voir le prince Napoléon. On l'a vu en Belgique, à Anvers et à Bruxelles. On l'a vu en Italie, à Venise. On l'a reconnu en Espagne. Enfin, il en est qui prétendent que le Général voyage en Bretagne, à Nantes, à Pornic et dans l'ìle Beber, chez le comte Dillon, tandis que d'autres assurent qu'il s'est tout bonnement et bourgeoisement retiré aux environs de Paris, à Ville-d'Avray, ou dans la vallée de Chevreuse.
Pour moi, une seule version est la bonne: celle d'Espagne. On a cru reconnaìtre le Général à Barcelone, à Madrid, à Grenade. Il doit être là, avec Elle, dans ce beau pays du soleil, loin des curieux, des interviewers et des politiciens.
92.—Lundi 8 octobre.
Le Général est rentré à Paris, venant de Baie, par un train si matinal qu'il a devancé la foule accourue un peu plus tard à la gare de l'Est dans l'espoir de l'acclamer. Je suppose que le capitaine G... a dû être chargé de ramener Mme Marguerite par un autre chemin.
Malheureux journaux, les voilà fixés! Plus moyen de faire de la copie avec le «Mystérieux voyage du général Boulanger».
93.—Dimanche 14 octobre.
Quelle joie! Une lettre de Mme Marguerite qui me donne l'espoir de les revoir bientôt!
«Samedi 13 octobre.
»Ma bonne Meunière,
»Je suis sûre que vous croyez que nous vous oublions. Cela serait très mal à vous—car, au contraire, constamment nous pensons et parlons de vous. Mais, depuis deux mois, nous n'avons pu vous le dire... Écrivez-nous, nous serions si heureux de vous savoir heureuse. Nous, nous le sommes toujours beaucoup, peut-être toujours de plus en plus. Vous vous en apercevrez bien quand nous irons vous voir, du 10 au 15 novembre, dès que le mariage de sa fille sera fait. Car vous devez savoir que M. Driant est au comble de ses vœux et épouse prochainement la fille cadette de qui vous savez.
»à bientôt donc, ma bonne Meunière. Nous vous reverrons et nous vous retrouverons, je l'espère, tout à fait gaie et contente. En attendant, nous vous redisons que nous vous affectionnons bien.»
94.—Samedi 20 octobre.
Reçu un aimable petit mot de Mme Marguerite, me remerciant affectueusement de ce que je lui avais écrit en réponse à sa dernière lettre, mais ne faisant aucune allusion à leur prochaine venue, dont je me réjouissais tant. Le projet serait-il abandonné? C'est ce que je me suis hâtée de lui demander, tout anxieuse.
95.—Mardi 23 octobre.
Me voilà rassurée.
«Ma bonne Meunière,
»Il ne faut pas vous désoler. D'ici une quinzaine ou trois semaines, nous irons chez vous et pourrons être tout à la joie. En attendant, comptez toujours sur notre bonne affection.»
96.—Dimanche 28 octobre.
Hier, à Paris, grand banquet boulangiste dans une brasserie de l'avenue Lowendal. Le Général a prononcé un discours. à la sortie, la Ligue des Patriotes lui a fait une ovation endiablée.
Demain, mariage du capitaine Driant.
Il court en ce moment, dans les journaux du pays, des racontars étranges relativement à une alliance conclue entre le Général et les royalistes. Le Général se serait engagé à restaurer la monarchie moyennant un titre princier, la dignité de connétable et une honnête rente de deux millions. Ce pourquoi le Comte de Paris lui avancerait de l'argent, sorti surtout de la poche des banquiers israélites.
Je ne vois pas le Général jouant les Raton...
97.—Mardi 30 octobre.
Le mariage civil du capitaine Driant s'est fait hier, à quatre heures, à la Mairie de Passy, avec la plus grande simplicité.
Le mariage religieux a dû être célébré aujourd'hui.
98.—Mercredi 31 octobre.
Le mariage religieux du capitaine Driant et de Mlle Marcelle Boulanger, célébré hier, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, a été un grand événement parisien.
Le général a revêtu, pour la circonstance, son grand uniforme avec toutes ses décorations. J'avoue que la lecture de ce détail m'a causé une véritable joie, car, ignorante comme je le suis, je m'imaginais qu'il n'avait plus le droit de se mettre en tenue...
L'église, remplie de plantes vives, regorgeait de monde, et du monde le plus élégant, le plus aristocratique, auquel les anciens «rouges», devenus partisans du général, ne semblent pas fâchés d'avoir été mêlés. M. Laguerre donnait le bras à Mme la duchesse d'Uzès. Le général du Barrail représentait officiellement le prince Victor. Dans la foule des noms nobles que citent les journaux mondains, je lis aussi celui de «Mme la vicomtesse de Bonnemain, dont la toilette en velours bleu de ciel, garnie de renard bleu, a fait sensation».
Mme Boulanger, la mère très âgée du général, assistait également au mariage.
à la sortie, et pendant tout le trajet de l'église à la rue Dumont-d'Urville, la foule a fait une ovation indescriptible à son cher général, qu'elle était enthousiasmée de revoir en uniforme.
Un lunch et une réception ont eu lieu chez le général. Des centaines de féliciteurs ont défilé devant lui. La maison débordait de fleurs envoyées de tous les coins de France.
Les nouveaux époux sont partis pour un voyage dont le but final est Tunis, lieu de garnison actuel du capitaine Driant.
99.—Mercredi 7 novembre.
Un billet de Mme Marguerite:
«Ma bonne Meunière,
»Nous pensons bien vous arriver vers le 15 ou le 20 de ce mois, à moins d'un cas extraordinaire que nous ne prévoyons pourtant pas. Mais, dans ce cas, nous serions chez vous alors vers le 10 décembre. Vous voyez, comptez sur nous pour dans dix jours ou dans un mois, et croyez à nos bonnes amitiés.»
Sera-ce pour ce mois-ci?
100.—Mercredi 14 novembre.
Une nouvelle lettre vient de m'arriver: ils seront là après-demain matin.
«Mardi.
»Ma bonne Meunière,
»Dans trois jours, nous serons auprès de vous. C'est vendredi 16 que nous allons vous arriver. Nous prendrons, jeudi 15, au soir, l'express de Clermont, partant et arrivant à la nuit. C'est préférable que de faire le grand tour par Limoges. Donc, nous serons à Clermont vendredi matin, entre 5 heures et demie et 6 heures. Je crois que c'est à cette heure-là que le train arrive. Peut-être est-ce plus tôt? Mais vous devez bien le savoir! Que votre cocher vienne au-devant de nous avec sa voiture et qu'il nous attende à la sortie des voyageurs, sur le quai, afin qu'il nous conduise à la voiture, autrement nous aurions de la peine à la trouver. Est-ce bien compris, ma bonne Meunière? Répondez, courrier par courrier, un mot à qui vous savez, afin qu'il l'ait jeudi matin, lui disant bien que vous nous attendez vendredi matin, vers 6 heures, à Royat, et que nous trouverons votre cocher et sa voiture pour nous y conduire.
»à bientôt donc, et comptez toujours sur nous.»
101.—Jeudi 15 novembre.
Dès l'aube, j'étais levée. J'avais ouvert leur appartement et allumé un bon feu, car les froids commencent à venir. Puis je suis descendue à Clermont pour faire mes diverses emplettes. Je suis revenue avec des fleurs en masse, les unes en pots, les autres en bouquets, que je me suis mise à disposer dans leur chambre. J'étais tout heureuse. Je me disais de temps à autre: «Tant d'heures encore, et ils vont être là!»
à la nuit tombée, j'ai entendu frapper à la porte. C'était une dépêche:
«Impossible partir. Lettre suit.»
Pauvre Meunière, une déception de plus!
102.—Vendredi 16 novembre.
La lettre annoncée confirme la dépêche, mais n'explique rien:
«Jeudi 15.
»Comme je vous l'ai télégraphié, ma pauvre Meunière, nous ne pouvons partir ce soir, et nous en sommes bien malheureux, soyez-en sûre. Nous espérons que cela ne sera qu'un petit retard et nous vous arriverons dans une quinzaine. Ne vous désolez pas trop de notre non-venue. Je vous promets que ce n'est qu'une chose remise.
»Croyez à notre bonne affection.»
Allons! puisque c'est pour dans quinze jours, reprenons-nous à espérer!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
103.—Lundi 3 décembre.
La quinzaine dont parlait Mme Marguerite dans sa dernière lettre est révolue, et point d'annonce de leur arrivée! Je ne sais rien de plus pénible que ces continuelles attentes, ces alternatives de joie, d'espérance, d'incertitude et de déception. J'ai écrit, les suppliant de me fixer au plus vite.
Les boulangistes ont offert au général un grand banquet à Nevers.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
104.—Mercredi 12 décembre.
Enfin, une lettre d'Elle:
«Ma bonne Meunière,
»Voici trois lettres que je vous écris sans réponse de vous... Pourquoi? Êtes-vous malade?... Nous nous en tourmentons. Répondez, je vous en prie, par retour du courrier.
»Bons souvenirs.»
Donc, pendant que j'attendais de jour en jour, sans plus y rien comprendre, trois lettres m'ont été écrites par Elle, et Elle n'a pas reçu celle que j'ai fini par lui envoyer!
Je crois bien que, maintenant, je comprends trop...
105.—Samedi 22 décembre.
Décidément, leur arrivée ne sera plus pour cette année. C'est ce que m'apprend la lettre recommandée que j'ai reçue d'Elle ce matin.
«Vendredi 21 décembre.
«Ma bonne Meunière.
»Il y a une fatalité, un sort jeté sur nous. Nous voilà encore forcés de retarder notre arrivée. Soyez persuadée que nous en souffrons. Mais il s'agit d'intérêts si graves dans ce moment pour nous, pour moi, que nous sommes forcés de remettre un plaisir pour gagner un bonheur... Si vous devinez, ne parlez pas de cela dans votre réponse et dites-nous si le vendredi 19 vous conviendrait. Cette fois, cela sera la dernière remise, et nous vous arriverons, je l'espère, bien heureux et bien gais.
»Priez pour moi... et comptez sur notre profonde affection.»
Bien sûr que je devine... C'est aux instances qu'ils ont intentées tous deux pour devenir libres et pouvoir s'épouser que fait allusion sa lettre. Comment ne prierai-je pas pour Elle, et cela de toutes les forces de mon âme, puisque, pour Lui, ce serait atteindre au but suprême de ses vœux?
106.—Lundi 31 décembre.
Que se passe-t-il? Le facteur m'a apporté un pli recommandé, qui contenait cette lettre d'Elle:
«Ma bonne Meunière,
»Voulez-vous m'aider à faire quelque chose pour qui vous savez? Oui, n'est-ce pas? Eh bien! sans un mot de plus, sans un mot de moins, écrivez de suite, par le retour du courrier, à peu près ceci:
«J'ai bien compris votre lettre, Madame, et je vais vous demander de ne pas arriver comme vous me l'indiquez, le 5 ou le 6. Ma maison ne sera prête à vous recevoir qu'à partir du 19, etc...»
»Ma bonne Meunière, comprenez-moi bien, il ne faut pas qu'on se doute que je vous dicte cela, mais cela serait, pour que vous savez, une grande imprudence, si nous n'agissons pas comme je vous le demande pour lui. Faites ce que je vous écris aussi un peu pour moi. Ce retard nous permettra de rester auprès de vous plus longtemps.
»Vous m'avez bien comprise. En grâce, faites ce que je vous demande. En plus, renvoyez votre réponse par retour du courrier et faites-la partir de Riom.
»Bons souvenirs.
»J'ajoute ce mot: Je compte sur vous pour qu'il ne se doute pas de ce que je vous écris. Pour lui, et encore une fois, c'est très important, faites ce que je vous demande, et croyez qu'il m'en coûte. C'est un vrai sacrifice, mais c'est pour lui.»
Je devine qu'il veut absolument venir ici dès la fin de cette semaine, et que, devant son désir impérieux, elle a dû s'incliner, en apparence, du moins, et feindre comme si elle m'avait écrit dans ce sens...
Puisque c'est pour Lui, mon devoir est tout tracé. Je n'ai pas à apprécier: je n'ai qu'à faire ce qu'elle me demande, car elle doit savoir mieux que moi...
Mais, tout de même, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise: cette obligation de l'aider à Lui mentir,—à Lui, qui ne lui a jamais rien caché...
107.—Mardi 1er janvier 1889.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quelle différence encore, dans sa situation à Lui, entre cette nouvelle année et la précédente!
Il n'est plus le général à plume blanche qui, d'un moment à l'autre, pouvait redevenir Ministre de la Guerre. Il n'est plus soldat, hélas!...
Il est homme politique.
Mais là, comme toujours, il est vite devenu le premier, le plus en vue, celui sur lequel se fixent les yeux pleins d'espérance du peuple et aussi les regards terrifiés de ses adversaires...
Né pour être chef, il l'est devenu d'une nouvelle armée, autrement nombreuse que celle qu'il commandait ici, car elle comprend des millions de citoyens qui mettent leur confiance en lui.
Pourvu qu'il veuille, la victoire lui est acquise!
108.—Vendredi 4 janvier.
La lettre qu'Elle m'avait demandée n'a pas suffi:
«Mercredi soir.
»Ma bonne Meunière,
»Merci de votre lettre. Elle était parfaitement ce qu'il fallait et vous m'aviez très bien comprise... Mais elle n'a pas suffi! Car vous connaissez le maìtre: quand il a mis quelque chose dans sa tête, il le veut,—et, malgré votre lettre, il veut encore que nous partions samedi soir. Hélas! tout mon cœur le désirerait, mais toute ma raison s'y refuse, car, à l'heure actuelle, la chose serait très imprudente pour lui, et nous le regretterions plus tard. Il faut savoir l'aimer pour lui avant de l'aimer pour moi. Il faut donc que, dès que vous aurez reçu cette lettre, c'est-à-dire dès demain vendredi, vous envoyiez cette dépêche:
«Monsieur Auguste, 14, rue Lapérouse,
»Quoiqu'il m'en coûte, vous supplie de retarder au moins de huit jours.»
et vous signerez de votre prénom. Je m'arrangerai ensuite, mais, je vous en prie, qu'il ne se doute pas que c'est moi qui vous dicte cela. Je vous assure qu'en le faisant, je me sacrifie, mais il le faut.
»Je vous écrirai demain, dès votre dépêche reçue, ce que vous aurez ensuite à écrire, mais envoyez cette dépêche de suite et comme je vous l'indique. Merci de m'aider à travailler pour lui, cela m'est pénible, mais je ne veux pas que son amour pour moi l'emporte sur la raison... D'ici peu, nous pourrons nous rattraper, et je vous jure que je voudrais être au jour où nous pourrons, sans danger, vous arriver.
»Vous savez que je vous souhaite beaucoup de bonheur, et, pour commencer cette année, je vous embrasse de tout cœur.»
Cette lettre ne m'a été remise qu'à midi. Je suis aussitôt descendue à Clermont pour expédier la dépêche.
Je comprends maintenant pourquoi il serait si imprudent qu'Il s'absente actuellement de Paris. Il est candidat à Paris même, pour le siège que vient de laisser vacant la mort de M. Hude, et l'élection est fixée au 27 de ce mois.
109.—Samedi 5 janvier.
Elle est toujours encore dans l'angoisse!
«Vendredi 4.
»Ma bonne Meunière,
»Il est 4 heures et la dépêche que je vous ai demandé d'envoyer n'est pas encore arrivée. J'en suis tout ennuyée. J'espère qu'elle va arriver. Mais, dans le cas où vous n'auriez rien envoyé quand vous aurez reçu cette lettre, envoyez-en une de suite, comme je vous l'ai indiqué, à M. Auguste, 14, rue Lapérouse, et disant que vous nous demandez de retarder au moins de huit jours.
»Je vous écris à la vapeur, toute contrariée que votre dépêche ne soit pas encore arrivée. Ma lettre d'hier n'était pas recommandée, l'ayant mise trop tard à la poste. Celle-ci ne le sera pas non plus, pour la même raison. Faites bien ce que je vous demande, pour que nous ne vous arrivions pas, je vous en prie. C'est la nécessité, pour qui vous savez. Mais, dans le cas où il voudrait quand même partir, je vous enverrais, demain, une dépêche vous disant:
«Effet raté et prenez précautions.»
»Si vous recevez cette dépêche, c'est que nous partirions malgré tout demain soir—(quelle imprudence et quelle folie!)—et que nous serions dimanche matin, par l'express, à Clermont; que votre cocher nous attende, etc., etc... Dieu! que j'aimerais mieux faire ce voyage quelques jours plus tard! ce qui nous permettrait, d'abord, de rester plus longtemps.
»Ma bonne Meunière, pour lui que j'aime tant, arrangeons cela ainsi. Si une dépêche a été envoyée, ne le faites plus. Mais, dans le cas contraire, vite, vite, envoyez-en une de Royat, dès demain matin à la première heure.
»Mes bonnes amitiés.»
Je suis retournée au télégraphe de Clermont. On m'a affirmé que ma dépêche d'hier avait été dûment transmise. Elle doit donc l'avoir reçue peu après l'envoi de cette lettre.
Moi, qui me faisais une telle joie de leur prochaine arrivée, j'en arrive à former des vœux pour qu'elle soit retardée. Comment pourrait-Elle le rendre franchement heureux, puisqu'Elle ne viendrait qu'à contre-cœur.
110.—Dimanche 6 janvier.
Dieu merci! la chose est enfin arrangée:
«Samedi.
»Ma bonne Meunière,
»Votre dépêche est enfin arrivée hier soir, à 7 heures. Merci. Je vous écrirai demain. Aujourd'hui, je n'en ai pas le temps.
»Merci et amitiés.
»N'écrivez pas avant que vous n'ayez ma lettre, pour que vous sachiez ce qu'il faudra que vous écriviez.»
111.—Vendredi 11 janvier.
Aujourd'hui, seulement, m'est arrivée la lettre annoncée:
«Jeudi 10 janvier 1889.
»Vous devez vous demander pourquoi je ne vous ai pas envoyé plus tôt, ma bonne Meunière, la lettre annoncée, afin que vous puissiez écrire. C'est que je viens d'être un peu souffrante. Je vous assure que j'ai regretté vivement de n'être pas auprès de vous. Il me semble que, bien soignée par vous, j'aurais été si bien. Enfin, bientôt, quand nous aurons traversé cette élection, et une autre chose, nous vous arriverons gais et heureux. Pour le moment, il faut que vous écriviez à peu près ceci à qui vous savez:
»Que vous ne pensiez pas que nous pouvions venir si près du jour de l'an et que vous avez mis les ouvriers chez vous... Que vous en avez été désolée, car cela pouvait faire croire que vous ne nous étiez plus dévoués, quand c'était le contraire, mais que, justement, la seule chambre bonne n'avait plus ni plancher, ni plafond, etc..., mais que, maintenant, vous nous attendiez avec espoir et bonheur, etc., etc...»
»Dieu! Ce qu'il m'en a coûté de faire cela et de ne pas partir! Je vous le dirai mieux de vive voix, ma bonne Meunière. Mais, encore une fois, quitter Paris à l'heure présente était une grosse et terrible imprudence pour lui, et lui-même commence peut-être à le reconnaìtre, car, hier, il me disait:
«Enfin, cela vaut peut-être mieux que notre Meunière n'ait pas pu nous recevoir.»
»Vous m'avez aidée à participer au grand succès sur lequel nous comptons et sommes sûrs pour le 27... Mais ne parlez pas de tout cela dans votre réponse... Ne parlez absolument que des empêchements que vous aviez et de vos regrets.
»Encore merci et mes bonnes amitiés.
»Si vous voulez, dès que je saurai le résultat du 27, je vous le télégraphierai. Mais n'en dites rien dans votre lettre.»
Je devine, par les expressions qu'Elle me dicte, qu'il a éprouvé un moment de grosse contrariété en recevant les missives qu'Elle m'a fait écrire, et peut-être même qu'il a douté de moi... Et cette pensée m'est bien pénible.
Enfin, ce qui me console, c'est qu'ils ont pris le sage parti de ne venir qu'après le 27: seulement quelques semaines après, j'imagine. Car si vraiment Il était élu à Paris,—ce dont on ne paraìt pas aussi sûr qu'Elle l'est,—les conséquences de sa victoire seraient incalculables, et il lui faudrait tout d'abord s'occuper d'en tirer parti, sans perdre un instant...
Il faudra que je me mette maintenant à combiner ce qu'il convient de faire pour donner un air de vraisemblance à la fable des réparations qui auraient mis leur appartement sens dessus dessous...
112.—Lundi 21 janvier.
Une lettre recommandée d'Elle:
«Dimanche,
»Bravo! ma bonne Meunière, vous avez parfaitement compris, et votre lettre était très bien écrite. De tout cœur je vous en remercie et je me fais une fête de vous dire que bientôt, sans danger pour lui, nous allons vous arriver... Dieu! comme j'en suis heureuse, et vous allez l'être aussi, n'est-ce pas? Et vous le serez quand nous vous arriverons, j'en suis sûre. Je rêve de ce cher bonheur. Dans huit jours, la vie infernale qu'il mène dans ce moment sera terminée, et cette fois sans crainte. J'ai pu fixer avec lui irrévocablement notre départ au jeudi 31. Nous vous arriverons vendredi matin: cela sera le 1er février. Cela lui fera du bien de passer quatre à cinq jours dans notre chère chambrette. Nous le gâterons, nous le reposerons, nous le soignerons bien, et il reprendra sa bonne mine. Pour le moment, il a une toute petite figure un peu tirée. Mais son séjour auprès de vous le remettra complètement.
»Lundi 28, matin, je vous enverrai une dépêche vous parlant de santé. Vous comprendrez que selon que j'ajouterai: très bonne, bonne ou pas bonne, cela voudra dire que le succès du 27 est très bien, bien... ou qu'il aura échoué. Mais cette dernière hypothèse est impossible, car le succès est sûr.
»Écrivez-lui vite que vous nous attendez sûrement vendredi 1er au matin. Que votre cocher soit à la gare, etc... Comme je voudrais y être!! Encore merci, ma bonne Meunière. Je vous embrasse en attendant le 1er.»
Je ne sais ce que j'ai, mais la nouvelle de leur arrivée pour le 1er février, au lieu de me combler de joie, m'a rendue toute soucieuse. Il me semble que c'est trop tôt... Et puis, avec ces lettres interceptées en novembre et décembre, j'ai peur qu'il ne leur soit plus permis de rester ignorés chez moi. J'ai peur de l'espionnage, des démonstrations possibles sous leurs fenêtres, et surtout du bruit mené dans la presse, dans les feuilles antiboulangistes telles que ce nouveau journal, La Bataille. J'ai peur de la mauvaise impression que cette fugue en galante compagnie, au lendemain de la victoire, pourrait produire à Paris et dans toute la France...
Mais j'espère bien que les événements se chargeront tout seuls de modifier leur projet...
En attendant, je n'ai que le temps de faire remanier de fond en comble leur appartement.
113.—Vendredi 25 janvier.
Le peintre a achevé sa besogne. Il a couvert le plafond de leur chambre, auparavant tout nu, de dessins sur fond blanc, avec encadrement rose. Il a badigeonné en blanc la cimaise des murs, qui était couleur de bois. Il a changé aussi la couleur des boiseries de la salle à manger.
Le brave homme paraissait assez étonné de la lubie qui m'avait prise de faire transformer des peintures encore bien neuves, puisqu'elles ne remontaient même pas à un an et demi!
Maintenant, au tapissier!
114.—Samedi 26 janvier.
C'est demain le grand jour.
Peuple de Paris, quel sera ton vote? Qui choisiras-tu, de Jacques ou de Boulanger, de l'obscur conseiller municipal dont les antiboulangistes, vraiment pas heureux dans leur choix, ont fait le «candidat de la République», ou du glorieux général que tu fus jadis unanime à acclamer?
Qui des deux surnagera dans ce déluge d'affiches sous lequel les deux partis aux prises cherchent à s'étouffer?
Peuple de Paris, sur qui toute la France aura les yeux fixés demain, quelle sera ta décision souveraine?...
115.—Dimanche 27 janvier.
Durant toute la journée, je n'ai cessé un seul instant de songer à ce qui se passait à Paris. Il s'est mis à neiger. Le front collé contre la vitre, j'ai regardé tomber les flocons, et j'ai eu conscience qu'en ce même instant il neigeait des bulletins de vote là-bas.
116.—Lundi 28 janvier.
à la pointe du jour, on frappe. C'est une dépêche. C'est la dépêche qu'elle m'a promise.
«Clermont, Paris, 79511 20 28 12h. 30m.
»Santé absolument parfaite. Suis heureuse. à bientôt. Lettre suit.
»Marguerite.»
Il est élu, élu à une majorité qui doit être formidable.
Vite, je m'apprête et je cours à Clermont, pour me procurer des journaux. Il est élu par 244.000 voix contre 162.000 à M. Jacques!
C'est un triomphe qui dépasse tout ce que ses partisans les plus enthousiastes pouvaient rêver. J'en suis littéralement grise de joie.
117.—Mardi 29 janvier.
Les journaux de Paris sont venus, donnant les détails complets de la journée. J'ai appris avec étonnement et avec peine qu'il a tenu en mains le moyen de terminer la lutte d'un seul coup,—et qu'il ne l'a pas fait!
Tout le peuple de Paris était massé sur les boulevards, se bousculant vers le restaurant de la place de la Madeleine où l'on savait qu'Il était venu apprendre les résultats, et tout ce peuple n'attendait que le moment où Il sortirait pour le porter en triomphe.
Il Lui suffisait, à Lui, de mettre son uniforme afin d'être mieux reconnu, de se montrer et de se laisser aller dans les bras qui se tendaient vers Lui. Au même instant, un immense cortège se serait formé. La Ligue des Patriotes, dévouée corps et âme à sa cause, aurait pris la tête, et tout le peuple de Paris aurait suivi. Et cette foule enthousiasmée, à l'élan de laquelle aucune armée au monde aurait pu résister, serait entrée à l'Élysée sans coup férir, sans une goutte de sang versée! Lui, il aurait pu y coucher le soir même et y signer sa première proclamation annonçant au peuple français l'avènement du régime nouveau!
Et Il ne l'a pas voulu!
Des amis, paraìt-il, le pressaient, le suppliaient d'agir. Il n'a rien voulu entendre. Aussitôt le résultat du vote définitivement connu, il s'est échappé en voiture, se dérobant aux ovations.
Puisque, cette fois, on ne peut s'en prendre à ses amis, qui donc a eu assez d'action sur Lui pour l'empêcher de faire ce que son intérêt personnel lui criait de hâter et ce que la France entière aurait ratifié à une majorité écrasante?
Oui, qui donc?
118.—Mercredi 30 janvier.
J'ai reçu, sous pli recommandé, la lettre suivante:
«Mardi.
»Vous avez bien reçu ma dépêche, n'est-ce pas, ma bonne Meunière, et vous avez dû en être bien heureuse. C'est un beau succès, mais bien mérité!
»Enfin, c'est bien convenu et bien arrêté: nous partons après-demain soir, c'est-à-dire jeudi 31, par l'express de huit heures qui arrive, je crois, vers les cinq heures du matin à Clermont. Nous descendrons à Clermont. Que votre cocher soit à la sortie des voyageurs à nous attendre et pour nous conduire à sa voiture, que nous ne pourrions pas retrouver autrement. J'aurais voulu vous écrire plus longuement, mais j'ai peur du courrier et je veux que cette lettre parte sûrement aujourd'hui. Ne répondez pas, c'est plus prudent. Nous sommes sûrs que vous nous attendez et que tout sera bien fait. Je vous écrirai du reste encore demain.
»à vendredi et nos bonnes amitiés.»
Ne pas répondre!—J'ai eu des envies folles de lui écrire directement, à Lui, de lui dire: «Je vous en supplie, ne venez pas! Puisque vous n'avez pas voulu achever votre victoire d'un seul coup, tout au moins ne permettez pas à vos adversaires de la rendre stérile en se concertant, en se rassemblant pendant que vous serez au loin, dans les bras d'une femme!»
Mais, venant de moi, c'était inutile. Il ne m'aurait pas comprise...
119.—Jeudi 31 janvier.
La lettre qu'Elle m'a annoncée pour aujourd'hui n'est pas arrivée. Mais comme, d'autre part, il n'est venu aucune dépêche, aucun contre-ordre jusqu'à ce moment, je veux croire qu'ils sont en route. Je serai donc à la gare de Clermont demain matin. Le cocher—celui-là même qui nous a si bien servis pendant leur dernier séjour du mois de juin,—doit venir me prendre à quatre heures et demie.
Aujourd'hui, le tapissier a terminé son œuvre. L'appartement est maintenant méconnaissable. Les tentures pailletées d'or qui garnissaient leur chambre ont émigré à la salle à manger, et un papier à fleurs les a remplacées. Des rideaux du même dessin encadrent les fenêtres, les portes, le ciel de lit. Un lit et une armoire en pitchpin ont pris la place des anciens meubles en noyer. La chambre entière est devenue plus coquette et plus gaie.
J'étais déjà remontée pour me coucher. Mais le cœur ne m'en dit pas. J'aime mieux veiller dans leur chambre, en activant la flamme qui pétille dans la cheminée, et en songeant aux chers amoureux que la locomotive m'amène à travers la nuit...
120.—Vendredi 1er février.
à quatre heures et demie précises, la voiture est venue me chercher. Le ciel était noir, sans une étoile, le temps sec et froid. Les roues faisaient craquer la neige durcie. Devant la gare, stationnaient seulement deux ou trois omnibus d'hôtel de Clermont, à l'affût des rares voyageurs de commerce qui circulent en cette saison.
J'ai fait ranger la voiture dans le coin le plus sombre de la cour. Je me suis postée dans le passage de sortie des voyageurs. Tout en comptant les minutes, je me demandais si le général observerait les conseils de prudence que j'avais cru bon d'adresser à Mme Marguerite: s'il aurait soin de marcher sur le quai à quelque distance d'Elle, pour moins attirer l'attention, et s'il prendrait la précaution de se dissimuler la figure en enfonçant le chapeau sur les yeux et en relevant le col de son grand pardessus de voyage.
Voilà le train signalé, le long coup de sifflet de l'arrivée, l'entrée en gare de la locomotive piaffante, le roulement sourd des vagons qui vont s'arrêter... Le cœur me bat à tout rompre... Je Les cherche des yeux. Je n'aperçois d'abord personne. Puis tout à coup, à dix pas devant moi, je les vois s'avancer côte à côte, en se souriant d'un air heureux. Elle, radieuse d'élégance, de distinction et de beauté à faire tourner toutes les têtes, et Lui, les mains dans les poches, le chapeau sur l'oreille, le col de fourrure parfaitement étalé sur les épaules, comme s'il flânait le long des boulevards!... Je me tenais dans l'ombre. Ils ne m'ont reconnue que lorsqu'ils ont été tout contre moi. Nous avons échangé un coup d'œil. Il ne m'a dit qu'un mot: «Enfin!»
Vite, je les ai conduits à la voiture, je les y ai installés, je leur ai fait baisser les stores, et, aidée du cocher, je suis allée chercher les bagages. Il n'y avait que deux grandes valises, deux petites et un sac de voyage, empilés dans le fauteuil-lit qu'ils occupaient. Aussitôt le tout chargé sur la voiture, je suis montée moi-même à côté du cocher, pour ne pas troubler leur tête-à-tête, et, au triple galop, nous sommes retournés à Rayat en moins de vingt minutes.
Le long de la route, je n'ai cessé de maudire l'incorrigible imprudence du général. D'abord, quel besoin avaient-ils, les deux amoureux, de venir ensemble? Pourquoi ne pas voyager séparément jusqu'au moment de se rejoindre sous mon toit? Et, puisqu'ils n'y voulaient pas consentir, pourquoi, du moins, ne pas se tenir à distance tant qu'ils étaient dans la gare, afin de ne pas laisser se fixer sur Lui les regards qui forcément, se portaient vers Elle quand elle passait, avec son allure de princesse voyageant incognito.
Pourquoi s'attirer à plaisir le reproche, si mal venu en un moment aussi grave, de s'amuser à de petit voyages en galante compagnie... Grand imprudent! Ne pas même daigner relever son col, tant il avait horreur de tout ce qui pouvait ressembler à un déguisement...
Et c'est ce même homme dont les rapports de police ont raconté qu'il voyageait en affectant de boiter et en s'affublant de lunettes bleues!
Nous voici arrivés. Je descends du siège, à moitié gelée par la brise glaciale qui cinglait cruellement.
«Entêtée! me disent-ils, pourquoi n'être pas entrée avec nous dans la voiture!» Mais sans leur répondre, je les conduis droit vers leur chambre, toute tiède, toute parfumée, tout inondée de lumière. Comme je m'y attendais, l'impression du contraste a été très forte sur eux. Lui, tout en clignant des yeux, un peu aveuglé par l'éclat des lampes, s'est mis à pousser des exclamations:
«Quel adorable nid! C'est plus joli encore qu'autrefois! Mes compliments, Belle Meunière. Vos ouvriers, s'ils m'ont empêché de venir, il y a un mois, ont fait tout de même de la bonne besogne!... Va-t-on se sentir heureux, ici!»
Elle ne disait rien. Mais ses regards m'exprimaient assez combien elle me savait gré de lui avoir fait la surprise d'un détail qu'elle avait omis de me recommander, et dont l'oubli aurait pu causer tant de complications. Car enfin, quels soupçons le général n'aurait-il pas été en droit de concevoir s'il n'avait rien trouvé de changé dans l'appartement?
Pendant ce temps, j'aide Mme Marguerite à se débarrasser de sa voilette, de son grand chapeau de feutre noir, de sa jaquette de loutre. Lui-même ôte son manteau de voyage. Je les dévisage tous deux. Elle est admirablement portante, mais Lui paraìt réellement fatigué. Elle disait vrai: la figure est toute petite, un peu tirée. Le nez paraìt agrandi à cause de l'amoindrissement des joues. Les yeux sont très creusés, la face est pâle.
En quelques mots, ils me décrivent la vie infernale qu'il a dû mener à Paris pendant un mois: les centaines de délégués, de visiteurs, de journalistes qui l'assaillaient journellement, qui s'empilaient dans son hôtel, du rez-de-chaussée au troisième étage, qui encombraient hier encore la rue Dumont-d'Urville de voitures, et qu'il lui fallait recevoir depuis la première heure du matin jusque fort avant dans la soirée, avec un moment d'attention et un mot aimable pour chacun! Et les nuits, par deux et par trois, passées dans l'insomnie! Et la privation presque absolue de la seule chose qui pût lui donner du bonheur, de sa présence à Elle: l'impossibilité de s'entrevoir autrement que la nuit, à une ou deux heures du matin, en une courte apparition chez elle, rue de Berry!
Je venais de leur servir du café bien chaud. Je les ai invités à aller se reposer et à rester couchés toute la journée. Ils ne se sont pas fait prier. Avant de se retirer dans leur chambre, ils m'ont avertie qu'ils ne comptaient guère recevoir de lettres, mais que si, par hasard, il en venait, ce serait sous double enveloppe, la première à mon nom, la seconde au nom de Pacage.
Il faisait nuit encore. Je suis montée dormir moi aussi. à midi, j'étais sur pied, à peu près reposée. Ils n'ont pas tardé à sonner. Je leur ai apporté un déjeuner servi froid. Au bout de quelque temps, ils ont resonné à nouveau. Ils étaient assis devant la table où j'avais déposé le plateau, Lui, habillé de son vêtement d'intérieur en laine marron, Elle, en un exquis peignoir de soie bleu de ciel à grand ramages richement tissés dans l'étoffe. Ils n'occupaient qu'un seul fauteuil, car elle se tenait sur ses genoux, le bras passé autour de son cou. Je crois bien qu'ils mangeaient dans la même assiette et buvaient dans le même verre.
«Eh bien! Belle Meunière, m'a-t-elle dit d'un ton de reproche, et les fortifiants que je vous avais demandés, qu'en avez-vous fait? Et le jus de viande? Et le vin de coca? Et tout ce dont vous parlait ma lettre d'avant-hier?»
J'étais frappée de surprise, mais j'ai compris aussitôt qu'il y avait de nouveau une lettre interceptée... Le laisser deviner, c'était compromettre, dès le début, leur quiétude. Aussi, feignant l'embarras, ai-je répondu:
«Veuillez pardonner à une pauvre Auvergnate, toute honteuse d'être si peu savante et d'avoir si mal exécuté vos ordres... J'avais pris note de ce que vous me demandiez, mais le pharmacien n'a pas bien compris... Alors, j'ai mieux aimé vous prier de me récrire la liste vous-même, en la précisant...»
«Parbleu! s'est-il écrié, la Belle Meunière a raison, et nous aurions dû lui envoyer simplement l'ordonnance du docteur... D'ailleurs, je crois que je l'ai sur moi...»
Il l'a trouvée, en effet, dans son calepin. Cinq minutes après, profitant de ce qu'ils n'avaient plus besoin de moi, je suis descendue moi-même à Clermont pour faire ces emplettes. Il neigeait. J'étais tourmentée par l'idée de cette lettre interceptée: il me semblait certain maintenant que le général était découvert.
Comme je passais sur la place de Jaude, un journaliste, que je connais de vue seulement, s'est approché de moi en saluant:
«Comment, Madame, en courses par un temps pareil? C'est ce qui s'appelle du courage. On voit bien qu'il y a du neuf chez vous depuis ce matin...»
J'esquissai un geste de dénégation. Il s'est mis à sourire d'un air entendu:
«Oh! je ne vous demande pas votre secret. On sait assez que vous êtes la discrétion même... Au revoir, Madame, et mes meilleurs compliments au général...»
Avant que j'eusse pu répondre, l'autre avait décampé. J'étais navrée. Mais d'où savait-on la nouvelle?
Rentrée à la maison, j'ai eu bien de la peine à affecter une mine insouciante quand ils ont passé à table.
Elle s'était mise en grande toilette: une robe de soie noire brochée, à petites guirlandes de roses, sans aucune garniture, mais d'une richesse d'étoffe merveilleuse. Au cou, un collier de perles magnifiques, à triple rangée. Dans les cheveux, une rose thé prise parmi les fleurs venues aujourd'hui de Nice.
Par une singulière ironie des choses, au moment même où je les contemplais en silence, toute préoccupée du souci de les savoir découverts, ils étaient en train de se féliciter de leur incognito. Ils ont fait allusion à l'amitié sûre de l'un des principaux chefs de la gare de Lyon, qui leur avait permis de s'embarquer dans le plus grand mystère. Ils se sont rappelé le bon tour joué aux journalistes, lors de leur grand voyage en Espagne et au Maroc, l'été dernier, et ils n'ont plus tari de plaisanteries quand leur pensée est tombée sur ces pauvres policiers qui, une fois de plus, allaient se mettre en branle, par le froid et la neige, pour chercher aux quatre coins de France le général disparu... Subitement, le général, levant les yeux sur moi, m'a demandé:
«à propos, Belle Meunière, que dit le pays de mon élection à Paris?»
J'ai répondu sans hésiter, comme je me l'étais promis:
«Mon général, le pays dit que c'est un succès sans précédent, qui vous permettait de coucher le soir même à l'Élysée—et tout le monde se demande pourquoi vous ne l'avez pas fait.»
Il ne s'attendait certainement pas à cette réponse. Ses yeux me fixaient avec une expression indéfinissable. Puis ils se sont abaissés sur Mme Marguerite.
Enfin, éclatant de rire:
«Parbleu, s'est-il écrié, c'est Marguerite qui n'a pas voulu!»
Elle avait pâli. Les yeux baissés, ce qui, chez elle, est signe de vive contrariété, elle a dit doucement:
«Georges, vous me faites mal en disant cela... Vous savez bien que je ne veux que ce que vous voulez...»
Alors, lui, comme pris de repentir:
«Allons, je plaisantais... Je voulais seulement dire que nous avons vu et voulu de la même manière... Comme moi, vous avez pensé que mon triomphe devait être pacifique et qu'un homme aussi sûr que moi de posséder la confiance du peuple n'a besoin de violenter personne pour arriver au pouvoir... Laissons agir le peuple: dans six mois, aux élections générales, il donnera la victoire à mon parti par huit millions de suffrages. Et, quand nous l'appellerons ensuite à nommer le chef de l'État comme en Amérique, il me désignera à une majorité plus formidable encore, dût-on m'opposer tous les candidats imaginables, le comte de Paris, le prince Napoléon, le prince Victor et M. Carnot... Faire un coup d'État? Ce n'est pas la première occasion qui s'en offrait à moi. En mai 1887, à ma chute du Ministère, alors que je tenais encore en mains toutes les forces militaires du pays, et que Paris, dans une manifestation imprévue de tous, déposait spontanément, lors d'une élection législative, 38.000 suffrages à mon nom, il m'eût été facile de faire un coup d'État... Au mois de juillet suivant, lors de mon départ de la gare de Lyon, je n'aurais eu qu'à me laisser porter par la foule qui voulait marcher sur l'Élysée... Quelques jours après, à la Fête Nationale, j'aurais pu quitter Clermont en secret, me présenter en uniforme à la revue de Longchamp: l'armée tout entière aurait passé de mon côté. Je n'ai pas voulu y songer un seul instant. Je sais que mes ennemis ont prétendu que je suis allé à Paris ce jour-là: c'est faux. J'étais tranquillement au quartier général à soigner une foulure que je venais de me faire au pied... Puis, lors du renversement de Grévy, j'aurais pu rester à Paris, prêter l'oreille aux complots, empêcher le vote de l'Assemblée de Versailles. Vous savez ce que j'en ai fait: j'étais ici... Toute ma carrière, tous mes actes ont affirmé l'horreur profonde que m'inspirent les coups d'État, et il n'y a pas deux mois je le proclamais encore assez hautement, ce me semble, dans mon discours de Nevers... Ce qui n'empêchera pas, d'ailleurs, mes ennemis de m'accuser de menées césariennes et de me condamner pour cela s'ils l'osaient...
»Pour en revenir à l'élection de dimanche, avez-vous réfléchi que, si 240.000 électeurs ont voté en ma faveur, il y en a aussi 160.000 qui se sont prononcés contre moi et que, sur ce nombre, il en est tout de même qui n'auraient pas hésité à agir pour m'empêcher d'arriver? C'était donc, presque à coup sûr, la guerre civile le soir même... Je sais bien que les troupes, la garde républicaine, la police me sont acquises. Admettons que j'en eusse profité et que je me sois installé à l'Élysée sans trop de mal. Une chose était certaine: nous aurions eu la guerre avec l'Allemagne le lendemain. Un coup d'État accompli par moi l'aurait fait éclater, sur-le-champ: je le sais à n'en pas pouvoir douter... Eh bien! moi qui ai été le ministre chargé de préparer cette guerre, je ne sais que trop quelle concentration de forces, quel ordre, quel calme absolu dans le pays tout entier il nous faudra pour pouvoir compter sur la victoire dans une guerre avec l'Allemagne. Et jamais, cela dût-il me coûter tout mon avenir, je n'aurais voulu encourir cette responsabilité terrible, le soir du 27 janvier...»
Pendant qu'il parlait ainsi, d'une voix vibrante, ses yeux lançaient des éclairs. Il s'est tu un instant, puis, changeant brusquement de ton:
«Et voilà pourquoi, Belle Meunière, au lieu de coucher ce soir-là à l'Élysée, je suis allé, en sortant de chez Durand, droit chez Marguerite... Je vous prie de croire que je n'ai pas perdu au change!»
Il s'est tu de nouveau, pour achever d'une gorgée sa tasse de café noir. Ils se sont levés de table. Alors lui entourant la taille de son bras, Il lui a dit d'un ton câlin:
«Mais tout de même, si vous n'aviez pas été là-bas, à m'attendre, je me serais peut-être laissé aller à commettre cette folie... Ils m'y excitaient tous, chez Durand. Et la foule, sur la place de la Madeleine, qui m'appelait... Il y a eu un moment où j'ai failli me sentir entraìné... Ah! oui, j'ai eu rudement chaud...»
à petits pas, il l'a conduite vers leur chambre, tout en lui soulevant le menton de ses baisers. Elle se laissait faire, silencieuse, les yeux toujours baissés.
Au bout d'un instant, ils ont sonné et m'ont demandé des journaux. J'en avais précisément passés quelques-uns à la visite, avant dìner: ils ne contenaient aucune mention de la fugue du général. Je les leur ai portés.
J'avais pris à peine congé d'eux qu'on me remettait la Gazette d'Auvergne de ce soir, qui annonce la nouvelle à sensation:
«Le général Boulanger est arrivé à Clermont ce matin par l'express de 5 heures 23. Il a passé la journée à Clermont et Royat, La Préfecture, aussitôt prévenue, a fait surveiller l'hôtel où il est descendu.»
Ça y est! Maintenant, j'en aurai pour huit jours au moins de polémiques dans la presse locale! Et des reporters, et des interviewers, et des visiteurs de toute espèce, et sans doute aussi de nouvelles amabilités à échanger avec M. le Commissaire de police... Si quelque chose m'étonne, c'est qu'il ne soit pas accouru, dès ce soir, une bonne demi-douzaine de journalistes.
Il est vrai qu'il neige si dru dehors!
Mais je ne perdrai pas à attendre. Demain commencera la lutte âpre pour m'arracher mon secret. La lutte? Très bien, nous lutterons!
121.—Samedi 2 février.
La journée a été plus calme que je n'avais osé l'espérer. Dès la première heure du matin, j'ai envoyé ma sœur à Clermont avec une double mission: commander chez les fournisseurs de quoi parer au surplus de clients que la curiosité attirerait forcément chez moi, et en même temps, sans en avoir l'air, s'informer de ce qu'on dit...
à neuf heures, je suis entrée chez eux pour faire du feu. Ils avaient encore un tel besoin de dormir qu'ils m'ont priée de ne pas ouvrir les volets. Je me suis retirée sur la pointe des pieds, et, en attendant que ma sœur revienne, je me suis mise à observer les alentours de la maison. Combien il est différent, ce triste tableau hivernal, du paysage si vert, si fleuri, si ensoleillé dont ils avaient tant joui pendant leur dernier séjour! Les arbres, alors si feuillus, n'offrent plus maintenant que la carcasse de leurs branchages dénudés dont la fine dentelure se frange de la neige qui s'y est glacée. Toutes les saillies des roches sont saupoudrées de cette neige, sur la blancheur de laquelle le creux de la pierre se détache d'autant plus noir. Le sol est tout blanc, des brumes laiteuses flottent lourdement sur la vallée et le ciel chargé de neige est blanc à perte de vue. Tout est blanc, ou gris, ou noir, si ce n'est la verdure éternelle des sapins, des lierres et des mousses, sombre verdure infiniment triste aussi.
Sur la route, parcourue en été par tant de touristes aux vêtements clairs, il ne passe presque personne. Parfois, j'entends un bruit de roues: ce sont de longues et frêles charrettes à claire-voie qui descendent de la montagne, surchargée de troncs d'arbres fraìchement abattus ou d'immenses blocs de glace. De petits bœufs montagnards au pelage fauve les traìnent péniblement. Les paysans qui marchent auprès portent des bonnets de fourrure enfoncés sur les yeux, des manteaux en peau de bique, le poil tourné en dehors, et souvent de la paille enroulée autour des jambes, afin de mieux les protéger contre la neige dans laquelle ils s'enfoncent jusqu'aux genoux.
J'ai voulu me rendre compte, de mes propres yeux, des mesures de surveillance policière qu'a bien voulu organiser la Préfecture. Avec un peu d'attention, je n'ai pas eu de peine à reconnaìtre messieurs les agents secrets. Il y en a toute une nuée autour de l'hôtel. Les uns circulent sur les différentes voies avoisinant la maison, avec des mines suspectes qui suffiraient à les dénoncer. D'autres se tiennent à poste fixe. Il y en a un dans le chemin qui descend vers la Grotte. Un second fait le guet au bord opposé de la vallée, sur le sentier qui remonte le long des rochers. Mais le plus curieux à observer est celui qui s'est perché entre les deux principales branches d'un gros marronnier dont le tronc noir se dresse au haut de la côte rocheuse, juste vis-à-vis de la maison, de l'autre côté de la grande route. Je le regardais depuis quelques instants à peine quand la neige s'est remise à tomber à gros flocons. Le pauvre homme a rabattu sur la figure le capuchon de sa pèlerine et ouvert un parapluie avec résignation. Il me faisait vraiment pitié. J'aurais eu presque envie de lui faire porter une chaufferette...
Ma sœur est revenue de Clermont, porteuse de nouvelles autrement inquiétantes que ce déploiement de forces policières. Dans toute la ville, ce n'est qu'un cri: le général Boulanger, arrivé hier matin de Paris, se trouve à l'Hôtel des Marronniers! Il paraìtrait qu'il a été reconnu à la gare par un cocher d'omnibus, et aussi par un abonné de la Gazette d'Auvergne qui attendait son fils par le même train, et qui s'est empressé d'informer le journal de sa découverte. Chose plus grave, la rédaction aurait, le soir même, expédié 127 dépêches communiquant la nouvelle à tous les journaux de France. Déjà, on annonçait l'arrivage d'un stock de journalistes de Paris, pour ce soir ou demain matin.
Bizarre revirement des circonstances! Autrefois, il me fallait lutter d'adresse pour empêcher que personne ne découvre la retraite du général. Aujourd'hui, c'est juste l'inverse: il va me falloir user de toute mon habileté pour que le général ne puisse pas deviner un seul instant que sa retraite est découverte... Pourvu que des cris indiscrets, poussés devant ses fenêtres, ne me rendent pas la tâche impossible!
L'esprit tout plein de ces réflexions, j'étais occupée à mettre le couvert dans la salle à manger, quand Mme Marguerite est venue tout à coup me trouver.
Elle m'a regardée d'un air sévère, puis elle m'a dit, avec une voix qui tremblait un peu d'émotion contenue:
«Belle Meunière, j'ai deux mots à vous dire... Vous m'avez fait de la peine, hier soir... Vous avez été cause que le général a dit à table que s'il n'était pas allé coucher à l'Élysée le soir de l'élection, c'est que, moi, je ne l'avais pas voulu... Ce n'était sans doute qu'une plaisanterie, mais elle m'a été douloureuse et je souhaite qu'elle ne se renouvelle pas... D'abord, veuillez vous mettre dans l'esprit une fois pour toutes que je n'ai aucune influence—vous entendez bien: aucune—sur les actes politiques du général. Il a beau m'informer de tout ce qu'il fait, je ne veux ni ne voudrai m'en occuper, car ce n'est pas de mon domaine... Ensuite, je serais heureuse que vous adoptiez ma propre façon d'agir qui est de ne jamais causer politique avec le général, et même de ne jamais lui répondre quand il porte la conversation sur ce terrain... Voyez-vous, ce n'est pas là notre affaire, à nous autres femmes: et vous, moins encore que moi, vous ne pouvez apprécier des circonstances que vous ne connaissez pas et qui ont pu déterminer les actes dont vous vous étonnez... Comme condition et comme gage de l'amitié que je désire maintenir entre nous, je vous demande de me donner votre parole d'honnête femme que jamais plus, quels que soient les événements, vous ne parlerez politique au général.»
Je lui ai répondu, émue moi aussi:
«Je ne croyais pas mal faire. Je suis désolée de vous avoir causé de la peine. Je tiens à votre bonne amitié plus qu'à tout au monde. Vous me demandez ma parole: je vous la donne sans aucune restriction.»
Elle m'a embrassée, très contente, puis elle s'est échappée pour retourner à pas de loup auprès du général qui dormait encore.
Ils ont déjeuné très tard, vers deux heures seulement. Ils se sont informés du temps qu'il faisait dehors. J'avais une peur affreuse qu'il ne leur prìt fantaisie de vouloir sortir. Mais ils m'ont déclaré qu'ils entendaient passer ces quelques jours sans tenter aucune promenade, à se reposer en faisant de la lecture et en causant.
à peine étaient-ils rentrés dans leur chambre qu'on m'a appelée en m'annonçant qu'un homme demandait à me parler. Je m'attendais à trouver un policier: ce n'était qu'une innocente victime de la police, un brave cocher de fiacre qui s'était vu mandé chez le commissaire et agonisé de questions, parce qu'on le soupçonnait d'avoir conduit hier le général chez moi...
«Mêmement, qu'il n'a pas été poli du tout avec moi, M. le Commissaire... Mêmement, qu'il m'a menacé de me mettre à pied si je continuais à faire la bête... Le général Boulanger! bon Dieu de bon Dieu! Je ne le connaissons seulement pas en peinture... Alors, ma bonne Madame, je venons vous demander, comme ça, de témoigner que ça n'est pas moi qui vous avons amené le général!»
Je l'ai assuré que, dès qu'on m'interrogerait, je répondrais la vérité, savoir que ni lui ni aucun autre ne m'avait amené le général Boulanger, puisque celui-ci n'était pas venu chez moi. Cette révélation a achevé d'exaspérer mon homme, qui s'est mis à pousser d'horribles jurons contre les procédés de la police et qui a fini par me déclarer que, dès cet instant, il voterait en toute circonstance pour Boulanger, avec l'espoir de voir balayer tous ces mouchards... Je lui ai fait servir un petit verre pour le stimuler dans son indignation.
Le cocher parti, je suis vite montée changer de robe, me disant que la robe de soie que j'avais mise pour les servir à table risquerait d'attirer l'attention des visiteurs qui pourraient venir. Pendant ce temps, la salle commune commençait à se remplir de consommateurs. J'y ai fait une apparition. Ceux qui me connaissaient ont essayé de me faire parler en prenant pour cela leurs airs les plus aimables. Je leur demandais, de mon côté, s'ils étaient mystificateurs ou mystifiés.
à la nuit tombante, je suis remontée auprès des deux amoureux, que j'ai trouvés causant doucement au coin du feu. J'ai allumé les lampes et fermé les volets hermétiquement, à l'aide de tapis interposés empêchant l'échappée du moindre filet de lumière.
Il est venu d'autres visiteurs encore.
Vers neuf heures, le général a sonné pour dìner. Je venais justement de me remettre en robe de soie. Mme Marguerite avait la même toilette qu'hier. C'est bien pour ne pas sembler trop Cendrillon à côté d'elle qu'il me faut soigner un peu ma propre mise.
Sont-ils à envier, les amoureux! S'embrassaient-ils assez en se rappelant avec émotion les heures de joie et de douleur vécues ensemble: l'angoisse mortelle qu'elle avait éprouvée, lorsqu'il eut reçu ce terrible coup d'épée, la veille du jour de la dernière Fête Nationale, où ses amis auraient voulu qu'il se rendìt en grand uniforme; les soins dévoués qu'elle lui avait prodigués, alors que Mme Boulanger, loin d'être venue en personne à son chevet, ainsi que les journaux l'avaient prétendu, s'était seulement contentée d'envoyer son médecin; enfin, ce délicieux voyage qu'ils avaient fait ensemble pendant l'été, avec Mlle Marcelle, dont Mme Marguerite parlait comme d'une chère sœur cadette et qu'elle a même appelée «sa fille adoptive, son héritière unique», ce qui lui a valu un regard de reproche du général.
Comme pour traduire en d'autres accents la douce rêverie qui leur remplissait le cœur, elle s'est mise au piano et elle a fait jaillir du clavier une de ces mélodies exquises dont on se bercerait sans fin... Forcée, hélas! de ne jamais perdre de vue le côté terre à terre, je suis descendue avec la crainte que la musique ne fût remarquée dans la salle commune.
Lorsque je suis remontée auprès d'eux, le général m'a demandé des journaux. Je n'ai pu leur en donner que deux ou trois, car la plupart reproduisent l'information de la Gazette d'Auvergne. Le Figaro était de ceux-là: j'ai prétexté que je n'avais pu me le procurer aujourd'hui. Ils m'en ont un peu grondée, puis ils m'ont dit affectueusement bonsoir.
122.—Dimanche 3 février.
J'ai vécu aujourd'hui la journée peut-être la plus mouvementée de ma vie. Depuis la première heure du matin, il m'a fallu lutter pied à pied, sans un instant de relâche, contre les efforts réunis de tous ceux qui voulaient me surprendre et m'arracher mon secret. Il s'est succédé à l'hôtel plus de deux cents personnes.
Mais, procédons par ordre.
Aussitôt levée, j'ai parcouru les journaux du matin, apportés de Clermont.
à neuf heures est venu le facteur, avec une liasse de lettres dont plusieurs recommandées. Tout cela était adressé au nom du général. Sans hésiter une seconde, j'ai repoussé le tout de la main et j'ai dit au facteur:
«Mon brave, il y a erreur... C'est sans doute une mauvaise plaisanterie... Il faut renvoyer tout cela chez M. le Général Boulanger, à Paris: tout le monde sait son adresse, c'est rue Dumont-d'Urville.»
D'un moment à l'autre, je m'attendais à l'apparition d'un agent de police qui m'appellerait une fois de plus chez M. le Commissaire. Il n'en a rien été. En revanche, il y a encore plus de détectives qu'hier. L'homme perché dans l'arbre est toujours à son poste. Des gamins le regardent curieusement et font autour de son perchoir une ronde en chantant.
Françoise, sortie aux emplettes, me signale une voiture tout attelée qui, depuis avant-hier soir, n'a cessé de stationner nuit et jour dans le haut de la grande route. Les voisins affirment qu'elle sert d'abri aux policiers en faction, qui viennent s'y reposer à tour de rôle. Autre révélation: dans une villa située en face, à l'autre bord de la vallée, des journalistes auraient loué fort cher une chambrette d'où ils peuvent observer mon hôtel tout à l'aise, grâce à l'absence de feuillage des arbres. Je n'aperçois dans cette direction qu'une fenêtre béante: mais il paraìtrait qu'ils y ont placé une longue-vue, ainsi qu'un appareil photographique... Bien du plaisir, Messieurs!
Dix heures sonnaient, quand un superbe équipage de maìtre s'est arrêté devant la porte de la terrasse. Il en est descendu un monsieur de haute mine, enveloppé d'une grande fourrure noire. Il m'a demandée; j'étais occupée, en ce moment, à mettre le couvert dans leur salle à manger. On l'a fait asseoir dans la salle commune et on l'a prié d'attendre quelques instants, car je ne saurais tarder à rentrer. Je descends, le monsieur se lève, s'incline avec courtoisie et me tend une lettre qui portait cette adresse:
Madame Marie Quinton,
Hôtel des Marronniers.
Il ajoute en chuchotant:
«Je vous prie de déchirer la première enveloppe.»
J'obéis et je trouve au-dessous une seconde enveloppe avec cette autre adresse:
Urgente très pressée,
Monsieur le Général Boulanger,
Royat.
Je regarde le monsieur bien en face, et, lui tendant la lettre, je lui réponds:
«Voici une lettre qui me semble très pressée, Monsieur... Qu'attendez-vous pour la faire partir à son adresse? Vous ne devez pas ignorer que M. le Général Boulanger a quitté Clermont depuis près d'une année déjà et qu'il n'a jamais habité Royat? Son adresse à Paris est: 11 bis, rue Dumont-d'Urville... 11 bis, c'est bien cela... Si vous l'expédiez maintenant, elle sera distribuée demain, par le premier courrier du matin...»
Et là-dessus, avec un salut très respectueux, j'ai fait comprendre au monsieur que je n'avais plus rien à lui dire. Il s'est retiré en saluant, la mine longue, longue... à midi, quinze messieurs étaient à table, plus occupés à écarquiller les yeux qu'à manger. Parmi eux, plusieurs journalistes de Paris qui m'ont fait subir un interrogatoire en règle et n'ont cessé de me tendre piège sur piège, jusqu'à ce que je me sois enfin échappée pour avoir entendu la sonnette du général, dont le tintement, à moi seule connu, eût frappé mes oreilles entre mille bruits semblables.
Quel changement de tableau, quel contraste entre tout ce qui se passe en bas et le calme souriant de mes deux tourtereaux! Aucun pli sur leur visage, aucune ombre dans leur bonheur, aucune idée de l'agitation qui les environne et dont j'ai tant de peine à empêcher les rumeurs de remonter jusqu'à eux.
Aussitôt libre, je suis redescendue. Comme c'est dimanche, ma toilette ne risquait d'étonner personne. Que de compliments flatteurs j'ai reçus des clients, qui se disaient sans doute qu'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre...
à trois heures de l'après-midi, il y avait plus de trente voitures de place alignées le long de la route, formant une file longue de deux cents mètres. Jamais cela ne s'était vu. Tout Royat était dehors, rien que pour regarder les fiacres.
La maison était tellement pleine de monde que je n'avais plus de sièges à offrir. Beaucoup de gens se tenaient debout sur la terrasse, malgré le mauvais temps.
Constamment, sans un instant de répit, j'étais sur le qui-vive. à peine avais-je paré les questions indiscrètes de l'un qu'il me fallait faire front à celles de l'autre.
Il est venu des gens de toute espèce: des civils, des militaires, des messieurs excentriques qui parlaient ou affectaient de parler très difficilement, avec un fort accent étranger.
Il est venu un ancien militaire qui voulait à tout prix faire contresigner son livret par le général Boulanger, «son général, sacrebleu!» L'homme était à moitié ivre et insistait avec force jurons, à la grande joie de toute l'assistance. J'ai eu toutes les peines du monde à me débarrasser de lui, en lui expliquant qu'il s'était trompé et qu'il n'aurait qu'à prendre un billet aller et retour Clermont-Paris, pour toucher la main au général de ses rêves...
Il est venu des messieurs me demandant à louer des chambres. J'ai dû leur répondre que tout était déjà loué, depuis la veille, à des journalistes auxquels j'avais même fait visiter ma maison de la cave au grenier.
Il est venu, enfin,—comble des combles,—un monsieur pour faire une saison!
Quand, à la nuit tombante, je suis remontée auprès d'eux, le général s'est informé de ce que signifiait le bruit de voix qui se percevait confusément dans la maison. Je lui ai répondu qu'il y avait une noce dans le village et que tout le cortège se trouvait en ce moment chez moi.
Je m'en suis aussitôt mordu les lèvres: où ça se voit-il que des noces se célèbrent le dimanche? Mais eux, tout à leur bonheur sans nuages, ne m'ont rien demandé de plus. Et puis, s'ils l'avaient fait, j'aurais bien trouvé à répondre qu'il y a dans le pays des noces qui durent trois jours!
à six heures, il est venu une dizaine d'officiers de toutes armes en uniforme. Ils se sont emparés d'une table laissée vide à la minute par le départ d'autres consommateurs. Ils n'en ont pas bougé pendant trois heures. Je les observais du coin de l'œil: ceux-là étaient montés jusqu'aux Marronniers pour remarquer le moment où je serais obligée de disparaìtre afin de servir le général à table.
Par bonheur, la sonnette qui réclame ma présence là-haut n'a pas retenti une seule fois pendant qu'ils étaient là. Je n'ai donc pas eu à quitter la salle un seul instant. De guerre lasse, ils ont fini par se retirer à neuf heures. Ils auraient bien pu au moins rester à dìner!
Aussitôt qu'ils furent partis, je suis montée rappeler au général qu'il était grand temps de dìner. Elle et lui n'y songeaient même pas!
Les heures avaient filé pour eux sans qu'ils s'en aperçussent. Pour n'avoir pas à faire de toilette, ils m'ont priée de leur apporter le repas. Cela m'a permis de retourner prestement à la salle commune, toujours encore pleine de monde.
Un coup de sonnette m'a rappelée. Le général demandait les journaux. Je lui ai répondu que je venais de les envoyer chercher pour la troisième fois à Clermont. En réalité, ils étaient là: seulement, je n'avais pas eu le temps de les parcourir et je ne voulais, pour rien au monde, les leur livrer avant cette mesure de précaution. Grand bien m'en a pris! Tous sans exception, comme j'ai pu m'en assurer aussitôt, parlaient du séjour du général à Royat. La constatation faite, je suis remontée chez eux les mains vides et l'air navré:
«Pas de journaux, mon général!... Les neiges sont cause que le train de Paris n'est pas encore arrivé...»
Le général eut un moment de franche colère. Me foudroyant du regard, il s'est mis à pester comme un beau diable:
«Le train en retard à cause des neiges! Je reconnais bien là l'Administration des Chemins de fer! Les bougres d'ingénieurs! Être tous plus ou moins polytechniciens et ne pas arriver à prendre les mesures élémentaires qui permettent en Amérique, avec six mois de neige comme on n'en a pas idée ici, de faire arriver tous les trains à heure fixe... Je me demande ce que ce serait en cas de mobilisation...»
J'étais sauvée: une fois sur ce chapitre de La Guerre de Demain, le général ne manque jamais de s'y enferrer jusqu'à la garde, oubliant tout autre préoccupation.
Les derniers consommateurs ne sont partis qu'après minuit. J'ai terminé ma journée en faisant ma caisse: le résultat dépassait celui des plus fortes journées de la saison. Que de liqueurs de toutes marques, que d'apéritifs et de petits verres l'insatiable curiosité humaine avait fait absorber aujourd'hui!
123.—Lundi 4 février.
Toute la nuit, j'ai été tourmentée par la crainte que des cris ne soient poussés sous leurs fenêtres. Grâce à Dieu, il n'en a rien été. Il a neigé, du reste, sans discontinuer.
J'ai commencé ma journée, comme hier, par la lecture des gazettes locales.
corté de lettres à l'adresse du général, attendu qu'il avait transmis mon indication de les renvoyer à Paris: il m'a dit seulement qu'il en était arrivé autant, si pas plus, qu'hier. Il m'a laissé deux lettres à moi adressées. L'une contenait un long poème incohérent, où il était parlé de la barbe blonde du général et de mes cheveux noirs de jais. En ouvrant la seconde, j'ai découvert une autre enveloppe qui portait:
Monsieur Parage—Personnelle.
Il n'y avait pas de doute possible, elle était pour lui! Je suis aussitôt montée la lui remettre et allumer le feu en même temps. Après avoir pris connaissance de la lettre, le général m'a dit:
«Belle Meunière, comme je le prévoyais en arrivant, il faut que vous nous reteniez, dès aujourd'hui, deux fauteuils-lits à Clermont.»
«Mon général, lui ai-je répondu, vous me permettrez d'être plus prudente que vous. C'est par Riom que je veux vous voir partir. Les deux places seront retenues cette après-midi et la voiture commandée pour demain six heures.»
Le général n'a pas protesté. Il l'aurait fait, d'ailleurs, que je n'en aurais pas moins agi à ma tête, car, partir par Clermont, en ce moment, c'était s'exposer à des mésaventures certaines.
J'ai aussitôt envoyé ma sœur à Riom, ne pouvant y aller moi-même pour ne pas étonner, par mon absence, les personnes qui se présenteraient.
à déjeuner le général et Mme Marguerite ont été de fort belle humeur. L'après-midi, malgré la neige, il est encore venu une cinquantaine de visiteurs, journalistes ou curieux: entre autres, un grand monsieur blond, genre anglais, qui était, paraìt-il, un explorateur suédois très connu. Il aurait bien voulu explorer le logement du général, mais il avait compté sans la sœur tourière...
Les fleurs qui sont venues de Nice aujourd'hui étaient exquises de fraìcheur. Le général en a été émerveillé quand je les leur ai apportées. Mme Marguerite était en train de mettre sa grande toilette: le général y a adapté des œillets et des roses de ses propres mains. Ils ont dìné à huit heures d'un excellent appétit. J'ai pu leur remettre aujourd'hui quelques journaux qui, par extraordinaire, ne parlaient pas d'eux; dans le cas contraire, j'aurais été joliment embarrassée.
Vers onze heures, les quelques consommateurs qui s'étaient encore attardés à la maison ont repris le chemin de chez eux. Et ma sœur qui n'était pas encore revenue de Riom! Je commençais à être sérieusement inquiète. Tout à coup, j'entends une voiture qui monte la côte, je sors sur la terrasse et j'en aperçois encore une autre à dix mètres en arrière. La première s'arrête devant la maison et ma sœur en descend. La seconde stoppe un instant, puis tourne et repart dans la direction de Clermont.
«Tu vois, m'a dit ma sœur, tout émotionnée, ils m'ont suivie jusqu'ici... Depuis que je suis partie, deux hommes ne m'ont pas quittée d'une semelle... à Riom, pour les dépister, j'ai sauté dans une voiture; mais, au bout de cinq minutes, une autre voiture nous rejoignait, qui ne nous a plus lâchés...»
Minuit approchait. Prise de fatigue, je laisse à ma sœur le soin de faire la caisse et je remonte dans ma chambre. Je n'y étais pas depuis dix minutes et j'avais à peine eu le temps de défaire ma coiffure quand j'entends des pas précipités dans l'escalier, des coups frappés à ma porte et la voix de ma sœur qui me crie d'ouvrir, pour l'amour de Dieu!
J'ouvre. Je vois entrer ma sœur toute pâle, un flambeau à la main et tellement bouleversée qu'elle peut à peine parler... Elle m'en dit assez pour que je comprenne que des individus viennent de pénétrer dans le moulin par effraction et qu'ils essayent de grimper le long de la corde des monte-sacs. Ces individus s'étaient postés en bas, du côté de la rivière, devant la partie de la maison où fonctionnait, il y a quelques années encore, notre moulin. De ce côté, il n'y a que de vieilles portes vermoulues qui joignent mal: ils ont brisé l'une d'elles et ils sont entrés au rez-de-chaussée du moulin, dans les bluteries où sont les cylindres à bluter la farine. à l'étage au-dessus se trouvent les meules, à l'étage suivant les engrenages, plus haut encore la farinière, qui, elle, est de plain-pied avec le rez-de-chaussée de l'hôtel et d'où part un couloir y conduisant. Mais la porte d'accès de l'étroit escalier menant des bluteries à la farinière est fortement verrouillée. Il ne reste donc aucun moyen de monter, à moins d'avoir l'audace de grimper à la force des poignets le long de la corde des monte-sacs, qui va de haut en bas, traversant les plafonds par de larges trappes. C'est ce que des individus sont en train de faire.
Je ne sais ce que j'eusse fait moi-même en toute autre circonstance: j'eusse sans doute appelé au secours, ameuté les voisins... La présence du général m'a inspiré une tout autre résolution. En un clin d'œil, glissant mon revolver dans la poche de côté, je suis descendue vers la farinière. En traversant la cuisine, j'ai entendu le bruit des trappes qui retombaient. Un grand coutelas très effilé traìnait sur l'évier: je l'ai saisi et nous voici dans la farinière. Tout cela s'était fait avec la plus grande rapidité. En avançant la lumière sur la trappe béante, j'ai aperçu, à un ou deux mètres au-dessous, un homme qui montait le long de la corde. Sans perdre un instant, j'ai passé le flambeau à ma sœur et, saisissant d'une main la corde, levant de l'autre le coutelas, je me suis écriée:
«Halte-là! ou je coupe!...»
La corde coupée, c'était l'homme précipité d'une hauteur de trois étages, sans salut possible pour lui.
Il l'a bien compris, car il a aussitôt cessé de monter.
J'étais dès lors maìtresse de la situation, et le sentiment que j'en avais me donnait un calme presque souriant.
J'ai ordonné à ma sœur d'avancer de nouveau la lumière: j'ai alors aperçu plus bas d'autres hommes accrochés à cette même corde. Un ou deux d'entre eux venaient de se laisser glisser à terre, mais il en restait encore deux, montés trop haut pour oser descendre et dont la position était aussi critique que celle du chef de file. Ce dernier avait tourné vers moi sa figure, une figure de brigand à longues moustaches noires: de grosses gouttes de sueur y perlaient. Il a fini par me dire:
«Laissez-nous redescendre, s'il vous plaìt?»
Je n'aurais pas hésité à faire appeler les voisins à mon aide pour qu'on remette ces coquins entre les mains des gendarmes. Mais comment le faire sans mettre en péril, du même coup, l'incognito du général? Il n'y fallait pas songer. Il n'y avait qu'à laisser filer ces individus sans bruit, en gardant l'aventure secrète.
Je leur ai donc enjoint de filer immédiatement par la grande route sans causer le moindre tapage et sans plus faire parler d'eux.
Ils ne se le sont pas fait dire deux fois.
Aussitôt que le dernier fut sauté à terre, j'ai remonté la corde, pendant que toute la bande battait en retraite silencieusement. Je ne suis pas rentrée dans ma chambre avant d'avoir passé l'inspection de toutes les serrures et verrouillé toutes les portes. Je ferai consolider, dès demain, celles qui ferment mal.
Que pouvaient vouloir ces gens-là? Assassiner le général? L'enlever? Essayer de le surprendre seulement?...
124.—Mardi 5 février.
Encore une nuit passée presque sans sommeil, tant l'étrange aventure d'hier soir m'émotionnait, me faisait battre le cœur et me hantait le cerveau.
Il a fallu la lecture des journaux de ce matin pour me distraire un peu.
La matinée s'est écoulée tranquille. Pas de visiteurs. à onze heures, le général et Mme Marguerite se sont mis à table. Leur conversation est bientôt tombée sur l'événement de la semaine dernière dont les journaux sont quotidiennement remplis: la mort mystérieuse du prince héritier d'Autriche. Ils ont envisagé les différentes versions qu'on donne: le général s'est prononcé pour celle du suicide. L'archiduc Rodolphe se serait tiré un coup de pistolet en apercevant sa maìtresse morte. Ils ont discuté sur cette action. Mme Marguerite a déclaré qu'elle ne pouvait approuver le suicide, que nul n'avait le droit de disposer d'une vie que Dieu a donnée et que lui seul peut reprendre quand il juge l'heure venue....
Le général a défendu avec chaleur une tout autre façon de voir:
«Mon amie, je pense qu'aucune restriction humaine ne peut être imposée au droit absolu que chacun a sur sa vie.... C'est Dieu qui donne la vie, dites-vous, et l'homme n'en est que dépositaire: eh bien! on a toujours le droit de restituer un dépôt quand on ne se sent plus la force de le garder. Un homme comme l'archiduc Rodolphe, sans enfants et sans souci de ses proches, avait donc, à mon sens, la liberté absolue d'en finir avec l'existence, et je l'approuve, car je conçois qu'on ne puisse pas vivre quand est morte la femme aimée.... Je sais bien, quant à moi, que je n'hésiterais pas plus que lui, dans certains cas, à me brûler la cervelle.... Je le ferais si les malheurs d'une guerre m'acculaient à une humiliante capitulation.... Et je le ferais bien plus encore si j'avais l'infortune sans nom de perdre tout ce que j'aime, tout ce qui m'attache à la vie: de te perdre, toi!...»
Il l'aurait fait à l'instant même si semblable malheur lui était arrivé: la flamme de ses yeux et la contraction de sa figure l'attestaient autant que ses paroles.
Mme Marguerite avait pâli en le regardant. Elle s'est levée et, se laissant glisser à ses genoux, elle lui a dit:
«Georges, vous me faites peur... Ne dites pas cela... Je vous en supplie, ne le dites pas... Vous le savez bien, cela n'arrivera jamais...»
Il l'a relevée. Ils se sont embrassés éperdument. Des larmes avaient apparu dans ses yeux, à Lui. Elle les a séchées avec ses baisers...
...Après déjeuner, je les ai aidés à ranger leurs affaires dans les valises. Tout en y travaillant, ils ont fait allusion à l'instance en divorce que le général a intentée et pour laquelle ils espèrent une solution le 14 de ce mois. Ils ont causé aussi de la demande d'annulation du mariage religieux de Mme Marguerite, qui rencontrait bien des difficultés à Rome. Je me suis hasardée à faire une observation:
«Mon général, j'ai idée que tout cela avancera rondement dès que vous serez devenu maìtre du pouvoir...»
Le général s'est mis à rire:
«Belle Meunière, vous connaissez les hommes. Voulez-vous qu'un procès se termine vite à votre profit? Devenez puissant: la recette est infaillible!»
Les valises bouclées, je les ai laissés. Il est encore venu, dans le courant de l'après-midi, une vingtaine de visiteurs, mais leur curiosité était si peu satisfaite et le temps si mauvais que, vers les six heures, il ne restait plus qu'un seul monsieur de Clermont, qui s'est mis à dìner dans la petite salle à manger du rez-de-chaussée, pendant que sa voiture attendait devant la porte.
Celle qui devait emmener le général, arrivée à l'instant, s'est tranquillement rangée derrière. Le cocher de la première me gênait: j'ai donné ordre au mien de lui payer à boire chez le petit traitant situé en face, mais à condition de réintégrer son siège dès qu'il entendrait six heures et demie sonner à l'église, et de partir aussitôt pour Riom, sans attendre qu'on le lui répétât.
Remontée auprès d'eux, je leur ai servi un léger dìner et, tandis qu'ils mangeaient, j'ai porté moi-même les valises dans leur berline. L'autre voiture me masquait si bien pendant que je me glissais derrière, et, de plus, la nuit était si noire que je ne pouvais pas être aperçue.
En moins de vingt minutes, ils avaient fini leur repas. Ils se sont levés, m'ont pris les deux mains et m'ont remerciée bien affectueusement des bonnes journées vécues une fois de plus sous mon toit.
«Ma bonne Meunière, a dit le général, avant trois mois nous vous reviendrons... Nous sommes déjà venus chez vous l'été, l'automne et l'hiver: cette fois, ce sera pour le printemps, pour le mois d'avril sûrement... Quant à vous, nous vous demandons une chose qui nous prouvera une fois de plus la profonde affection que vous nous avez constamment montrée: si jamais nous sentions le besoin de votre présence et que nous vous appelions, même sans vous expliquer pourquoi, promettez-nous de venir de suite...»
«De tout mon cœur, je vous le promets!» ai-je répondu aussi distinctement que me le permettaient les sanglots qui m'étouffaient. Ils m'ont embrassée alors avec une véritable tendresse.
La pendule a sonné la demie: l'horloge de l'église n'allait pas tarder. Vite, je les ai pressés de descendre, et les ai conduits à leur voiture, dont ils ont aussitôt baissé les stores. La demie sonnait: le cocher est arrivé en courant, a sauté sur son siège et fouetté prestement les chevaux. Avant que j'eusse eu le temps de refermer ma porte, la voiture était déjà loin.
...Ils sont partis! Si quelque chose peut me consoler, c'est qu'ils ont été pleinement heureux chez moi. Le général avait choisi ma maison pour se reposer de sa grande victoire: il n'a pas été déçu. Il partait défatigué, l'âme tranquille, le cœur retrempé par les heures délicieuses passées auprès de Celle qui est tout pour lui. Rien n'avait troublé leur bonheur. Jusqu'au bout, ils étaient restés dans l'ignorance complète des curiosités qui s'agitaient autour d'eux et contre lesquelles j'avais eu tant de mal à les défendre.
125.—Mercredi 6 février.
Voici la première nuit, depuis jeudi, où j'ai pu dormir tranquille. Mais aussi de quel sommeil de plomb: quinze heures de suite! Une seule fois, j'ai été réveillée par un grand cri de: «à bas Boulanger!» poussé d'une voix avinée... Bon ivrogne, tu arrives trop tard! C'est la réflexion que je me suis faite en me rendormant aussitôt. Ah! j'avais besoin de repos! Je ne me soutenais plus, depuis dimanche, que par la seule force de volonté. Un ou deux jours encore de cette existence, et, sûrement, je m'alitais.
Il faut croire que la police n'a pas encore connaissance du départ du général, car je ne vois rien de changé aux mesures de surveillance. Le mouchard qui me fait tant pitié est toujours là-haut dans son arbre.
Les fournisseurs de Royat et de Clermont, que j'ai soldés aujourd'hui, m'en ont appris de nouvelles: chaque fois qu'ils envoient chez moi, on les fait filer. Des garçons livreurs qui avaient des courses de 20 kilomètres à faire ont vu leur carriole suivie sans interruption par une voiture fermée. Les agents en faction aux alentours de la maison se relayent, paraìt-il, de six en six heures. Les chevaux du landau tout attelé qui attend dans le haut de la grande route sont changés deux fois par jour. Des clients même—car il en est encore revenu plusieurs aujourd'hui,—se sont plaints d'avoir été filés jusqu'à leur porte, en sortant de chez moi.
Voilà donc des voitures, de pauvres chevaux et des quantités d'agents, envoyés exprès de Paris, qu'on laisse exposés à la neige et au froid, par un temps à ne pas mettre un chien dehors! Et tout cela, pour surveiller quoi? La fumée qui sort de mes cheminées?...
Si, au moins, cela pouvait les réchauffer!
...J'ai rangé, aujourd'hui, leur chambre. J'ai découvert dans un tiroir du linge que Mme Marguerite y a oublié: de ces chemises de nuit à grands flots de rubans, se fermant par devant, qui m'avaient tant étonnée jadis; des chemises de jour très simples, mais faites en une toile merveilleusement fine; quelques serviettes en magnifique toile festonnée, avec les initiales B. B. surmontées de la couronne à cinq fleurons,—du linge de trousseau sans doute; enfin, quelques mouchoirs en batiste, ornés d'une marguerite brodée à la main...
126.—Jeudi 7 février.
Comme je le souhaitais, personne de ceux qui s'obstinaient à croire le général chez moi, ne se doute encore de son départ.
127.—Vendredi 8 février.
Reçu une lettre de Mme Marguerite, dont l'enveloppe, malgré le cachet de cire, a été visiblement ouverte, puis recollée:
«Ma bonne Meunière,
»Nous sommes bien partis, nous sommes bien arrivés, nous nous portons bien et nous pensons et parlons beaucoup de notre chère et bonne hôtesse. Je vous assure que si je pouvais me rajeunir de huit jours, je le ferais avec joie. Mais, ne le pouvant pas, je voudrais vieillir et être à la fin de ce mois, car il faut maintenant que j'attende la fin du mois, au lieu du 14, pour être heureuse sans restriction...
»Vous avez lu les journaux: vous savez donc qu'on a parlé de vous... Maintenant, cela n'a plus aucune importance—mais, c'est égal, prenez des précautions pour les lettres que vous m'écrivez et faites-les bien mettre à la gare.
»Encore merci, ma bonne Meunière, des bonnes heures passées chez vous. Nous vous affectionnons bien et nous serons toujours heureux de vous le prouver.»
Allons, tout est à merveille, puisqu'ils n'ont connu la vérité qu'au moment où elle ne pouvait plus leur causer d'inquiétude. Mais ce qui me réjouit moins, c'est ce nouvel ajournement de la solution tant attendue dans l'instance en divorce du général. Vraiment, cela ne me dit rien qui vaille!
Quant au reste, plus de doute possible aujourd'hui: on sait le général parti de Royat.
Le gros marronnier d'en face est vide; les agents de police ont disparu. à ce propos, j'en suis encore à m'étonner que M. le Commissaire ne m'ait pas fait l'honneur de m'interviewer! Il est vrai que cela lui avait si peu réussi au mois de juin!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
128.—Dimanche 10 février.
Les journaux de Paris annoncent tous la rentrée du général chez lui, rue Dumont-d'Urville, pendant que la foule l'attendait patiemment à Nice. Des rédacteurs ont eu la naïveté de lui demander s'il était vrai qu'il se fût retiré à Royat? Il leur a naturellement répondu que c'était faux, et qu'il s'était contenté de passer quelques jours aux environs de Paris. Je lis, entre autres, une information bien intéressante:
«Le général Boulanger est réellement venu à Clermont. Il y a séjourné du 1er au 5 février. Il est descendu chez la «Belle Meunière». Le général a reçu secrètement diverses visites de personnalités boulangistes. Il était accompagné d'une dame d'une quarantaine d'années dont le signalement répond assez à celui d'une sociétaire de la Comédie-Française...
»Le fait est absolument certain.»
Comment donc!
130.—Mardi 12 février.
Les craintes que j'avais avant leur arrivée ne me trompaient pas. Pendant qu'Il se reposait de sa victoire, ses adversaires se sont remis de leur désarroi. Le Gouvernement, tout surpris d'être encore là, a décidé de demander aux Chambres la suppression du scrutin de liste, afin que des départements entiers ne puissent plus donner des centaines de milliers de suffrages au général.
Nos députés ont donc rétabli l'ancien vote par arrondissement et ils ont prescrit, en outre, qu'il n'y aurait plus d'élection partielle jusqu'au renouvellement de la Chambre entière.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
131.—Vendredi 15 février.
Décidément, les événements ont l'air de vouloir se précipiter. Le Ministère Floquet a été renversé hier, comme si on n'avait attendu que le vote du scrutin d'arrondissement pour le mettre à la porte.
132.—Samedi 23 février.
Une nouvelle lettre de Mme Marguerite m'est parvenue, portant, autant que la précédente, la trace d'une violation du secret postal:
«Vendredi, 2 h.
«Ma bonne Meunière,
»Malgré mon silence, je ne vous oublie pas. Au contraire, je pense souvent, c'est-à-dire nous pensons souvent à vous. Mais j'ai eu tant de choses à faire depuis quelques jours que je n'ai pu vous écrire plus tôt. Tout va bien de toutes façons et, si le résultat que j'espérais pour le 14 n'est pas encore arrivé, ce n'est que partie remise et ce sera pour le 7.
»Et vous, ma bonne Meunière? Écrivez-moi. Je vous promets de le faire plus longuement d'ici peu de jours. En attendant, de notre part à tous les deux, je vous dis notre bonne et grande affection.»
à part cela, rien de neuf ou presque rien: un ministère de plus! Celui-là est formé de MM. Tirard, de Freycinet, Constans, etc...
133.—Vendredi 1er mars.
à peine installés, les nouveaux ministres viennent de faire un coup de théâtre: la Ligue des Patriotes est dissoute! Hier, à deux heures de l'après-midi, sans que personne ne se doutât de ce qui allait arriver, les gens de police se sont présentés au siège de la Ligue, place de la Bourse, ont pénétré dans les bureaux, forcé les tiroirs, éventré le coffre-fort. Une liasse immense de papiers a été saisie.
En voyant cet éclat de foudre tomber si près du général, chacun se demande: «Que va-t-il faire?» Mais lui, souriant et tranquille, se trouvait le soir même à une fête que M. Millevoye lui offrait au Grand-Hôtel. Comme au mariage du capitaine Driant, les rouges y côtoyaient les blancs. La présence de M. Rochefort n'excluait pas celle du prince de Polignac et du duc de Montmorency.
134.—Samedi 9 mars.
Les orages ont beau s'amonceler sur sa tête, le général fait comme si de rien n'était et se laisse tranquillement fêter tantôt par l'un, tantôt par l'autre. On mène grand grand bruit autour du dìner que Mme la duchesse d'Uzès a donné jeudi en son honneur. Les plus grands noms de France se pressaient dans les salons.
La duchesse portait des œillets rouges au corsage; ses fanfares de chasse ont sonné les Pioupious d'Auvergne.
135.—Vendredi 15 mars.
Pendant que le général, comme disent les journaux, «fait le tour du monde parisien en 90 jours ou davantage», la Chambre, sur la demande du Gouvernement, vient d'accorder les poursuites contre les députés boulangistes Laguerre, Laisant et Turquet, en leur qualité de chefs de la Ligue des Patriotes.
Le Sénat a fait de même pour M. Naquet.
On commence à parler de poursuites possibles contre le général en personne.
Je suis inquiète et je l'ai écrit à Mme Marguerite.
136.—Lundi 18 mars.
Avant-hier, à la Chambre, chaude séance. Répondant aux attaques de M. Laguerre, le Ministre de l'Intérieur, M. Constans, en est venu jusqu'à prononcer les paroles suivantes:
«Il se peut qu'on ait supposé qu'on pourrait m'arrêter dans la marche que je suis. Monsieur Laguerre, il n'en sera rien. Je marcherai où je dois aller, je marcherai contre vous et vos amis... Dites et faites ce que vous voudrez, je méprise absolument vos paroles, vos accusations, et je ne veux pas dire jusqu'où j'irai!»
Le Ministre, en descendant de la tribune, a achevé sa pensée par un geste de menace et de défi.
137.—Lundi 25 mars.
Mme Marguerite m'a envoyé une bonne lettre rassurante:
«Ma bonne Meunière,
»Vous devez être tout étonnée de mon silence et même croire que nous vous oublions, quand c'est, au contraire, tout le contraire; mais j'ai dû d'abord faire une petite absence de quelques jours. Ensuite, j'ai été fort souffrante. Maintenant que je vais mieux, bien vite je me dépêche de vous écrire, afin de vous rassurer sur tout; tout va très bien. Il y a certaine chose qu'on a dû remettre un peu, mais qui n'en ira que mieux d'ici quelque temps. Ne vous préoccupez pas de tout ce que les vilains journaux racontent. Ils crient fort, mais, grâce à Dieu, ne peuvent pas mordre et, plus ils font, plus ils servent la cause qui nous est si chère.
»Nous n'oublions pas que nous devons aller nous reposer chez vous dans le mois prochain. Nous en parlons souvent et nous nous réjouissons à l'avance de ce grand plaisir.
»Écrivez-moi vite, ma bonne Meunière, et soyez sûre que nous vous affectionnons bien.»
Une seule ombre au tableau. Cette lettre confirme ce que je savais déjà par les journaux. Quand le général s'est présenté pour soutenir sa demande de divorce, invoquant comme grief le refus de sa femme de réintégrer le domicile conjugal, Mme Boulanger a trouvé cette déconcertante réponse: «Offrez-moi votre bras, Monsieur, et rentrons!»
Bref, la «certaine chose qu'on a dû remettre un peu...», c'est l'instance en divorce qui se trouve définitivement rejetée.
138.—Dimanche 31 mars.
Il court des bruits étranges. Le général aurait été indisposé, il se serait trouvé mal à un dìner en ville; il aurait souffert de douleurs telles qu'on a été obligé de le piquer à la morphine Les uns disent que le malaise est dû aux dìners trop répétés dans le grand monde. Les autres parlent d'empoisonnement... Grâce à Dieu, tous les journaux sont d'accord pour déclarer que le général est d'ores et déjà entièrement rétabli.
D'autres bruits courent, plus alarmants encore. L'arrestation du général serait imminente. M. Constans y serait absolument décidé et la chose s'effectuerait avant même le procès de la Ligue des Patriotes, qui doit commencer après-demain au tribunal correctionnel.
139.—Lundi 1er avril.
Les dépêches du soir annoncent une nouvelle à sensation: le Procureur général de la Cour d'Appel de Paris, M. Bouchez, est subitement révoqué et remplacé par M. Quesnay de Beaurepaire. Il n'aurait pas voulu prendre sur lui, paraìt-il, d'intenter des poursuites au général.
140.—Mardi 2 avril.
J'ai parcouru la Gazette d'Auvergne pour voir ce qu'on dit du procès de la Ligue des Patriotes, qui a commencé aujourd'hui.
J'ai trouvé en dernière heure une information grotesque: le bruit courait à Paris que le général a pris la fuite...
Voyons, Messieurs, le 1er avril, c'était hier. Vous retardez!
141.—Mercredi 3 avril.
La fumisterie continue. Les gazettes locales du matin et les journaux venus ce soir de Paris regorgent de détails sur les courses éperdues de leurs reporters à la recherche du général introuvable. Ses amis, son secrétaire, ses domestiques, ont affirmé qu'il était à Paris. Mais un agent secret l'aurait filé, paraìt-il, lundi soir, jusqu'au nº 39 de la rue de Berry, d'où il l'aurait vu ressortir accompagné d'une dame toute de noir vêtue et voilée; après avoir changé deux fois de fiacre, le couple serait arrivé à la gare du Nord et y aurait pris, à 9h. 45, l'express de Bruxelles.
La bonne plaisanterie! Bien entendu, le collet relevé et le chapeau enfoncé sur les yeux ont fait, une fois de plus, leur apparition! Pourquoi pas la jambe boiteuse et les lunettes bleues?
Et puis, si même le fait était exact, quoi de plus naturel? Le général aura simplement éprouvé le besoin de prendre de nouveau quelques jours de repos, en dépistant tous les indiscrets.
Oh! une idée vient de me jaillir... Si c'était cela!... S'ils avaient passé de la ligne du Nord à celle d'Auvergne: s'ils étaient en route, à l'heure qu'il est, et déjà tout près d'arriver!... La dernière lettre de Mme Marguerite ne parlait-elle pas avec intention de leur prochaine venue?...
Je cours, de ce pas, préparer leur chambre...
142.—Mardi 9 avril.
J'ai été bien souffrante tous ces jours-ci et je me sens bien faible encore.
Aujourd'hui seulement, le docteur m'a autorisée à lire et à écrire un peu.
Donc, ils ont quitté tous deux Paris, lundi soir, par le train de 9h. 45 qui les a amenés à Bruxelles à 5 heures du matin. Le général est descendu à l'hôtel Mengelle sous le nom de M. Bruneau: mais c'est seulement le lendemain mercredi, en revenant de Mons où il avait été chercher Henri Rochefort (parti, lui aussi, avec une dame, ainsi que le comte Dillon) que le général a été reconnu à Bruxelles, acclamé par les uns, sifflé par les autres et interviewé bien entendu par quantité de journalistes, auxquels il a déclaré qu'il s'était mis en sûreté parce qu'il se savait à la veille d'être arrêté.
Voilà les faits. Quelles en vont être les conséquences? La première s'est produite aussitôt, et elle devrait suffire à ouvrir les yeux au général: c'est la joie féroce de ses ennemis en présence de sa fuite, c'est la précipitation qu'ils ont mise à décréter d'accusation, pour crime de complot et d'attentat contre la sûreté de l'État, celui qui semblait ainsi s'avouer coupable et impuissant à se défendre.
C'est le Sénat, formé en Haute-Cour de justice, qui va avoir à juger le général.
...Mme Marguerite!... Que de questions se pressent dans mon esprit en songeant à elle!
Quelle a été sa conduite dans cette navrante aventure?
Se peut-il qu'elle, si clairvoyante en toute circonstance, n'ait pas compris qu'il allait commettre une de ces fautes qui ne s'excusent ni ne se réparent jamais? Et, chose plus déconcertante encore, se peut-il qu'elle n'ait même pas hésité devant les conséquences navrantes que la fuite devait fatalement entraìner pour sa propre vie: le scandale public dès maintenant consommé par l'apparition de son nom dans les journaux, la perte irrémédiable de sa situation mondaine, la rupture de toutes ses relations, la rigueur dédaigneuse des uns, le mépris grossier des autres, et les outrages, les infamies qui viendraient l'accabler dans l'exil?
Oh! Marguerite! Comme je voudrais être près de vous, pour lire dans vos yeux clairs, pour y découvrir la vérité...
143.—Lundi 15 avril.
Le procès du général s'instruit activement à Paris. La police perquisitionne avec ardeur, à la recherche de papiers compromettants. On assure qu'un grand nombre de fonctionnaires, de magistrats et d'officiers vont payer cher l'imprudence d'avoir envoyé un mot au général.
Le va-et-vient de personnalités boulangistes et les coups de téléphone entre Paris et Bruxelles continuent sans interruption. Le général va décidément s'installer à Bruxelles, dans un hôtel qu'il vient de louer, avenue Louise.
Les journaux disent que Mme de B... (quelques-uns prennent un malin plaisir à écrire le nom en toutes lettres) se trouve auprès du général sous le nom de miss Erable. Je viens de lui écrire pour l'assurer que, malgré toute la douleur que leur départ m'a causée, je reste leur fidèle amie.
144.—Dimanche 21 avril.
On assure que le général va, de son propre gré, quitter la Belgique pour n'en être pas expulsé: il se fixerait à Londres.
Quelque effort que je fasse pour me cuirasser, je ne puis m'empêcher de ressentir un coup d'aiguillon au cœur chaque fois que j'entends les gens—ce qui, par les temps qui courent, arrive si souvent, hélas!—couvrir le nom du général d'insultes! Leur cruauté est intarissable, ce sont chaque fois des épithètes nouvelles qu'on invente. Ses ennemis ne l'appellent plus que le général La Frousse, ou le brave Fiche-son-camp, ou Bruneau-le-fileur, sans parler de mille autres outrages tellement immondes que la rougeur m'en vient au front.
145.—Vendredi 26 avril.
Le général est passé en Angleterre. Il a quitté Bruxelles avant-hier matin, par train spécial pour Ostende. La traversée d'Ostende à Douvres s'est accomplie par un temps magnifique, à bord du Victoria, frété exprès. En approchant de la côte anglaise, le drapeau tricolore a été hissé. Arrivé à Londres, le général est descendu à l'Hôtel Bristol. Rochefort et le comte Dillon vont aussi s'établir à Londres.
146.—Mercredi 1er mai.
Les journaux annoncent que le général s'est installé dans une maison toute meublée qu'il a louée dans une des rues les plus aristocratiques de Londres, 51, Portland Place.
à Paris, ses amis ont fêté avant-hier le 52e anniversaire de sa naissance. On a lu une lettre de lui où il disait:
«Assurez bien nos amis que l'année prochaine, à pareille date, je serai depuis longtemps près d'eux, car le pays aura voté.»
Hélas! Les boulangistes n'annonçaient-ils pas, il y a quelques mois, qu'il inaugurerait en personne la merveilleuse Exposition universelle qui va s'ouvrir?
147.—Samedi 19 mai.
Voici plus d'un mois que j'ai écrit à Mme Marguerite, et pas de réponse! Je lui écris de nouveau, à l'adresse du général, à Londres.
Les journaux, tout aux merveilles de l'Exposition universelle, ne parlent presque plus de Lui.
148.—Samedi 22 juin.
Encore un long mois écoulé sans aucune lettre ni de Mme Marguerite, ni du général. Je viens d'écrire pour la troisième fois.
Les journaux racontent que le général vit à Londres, très fêté par la haute société anglaise qui le choie comme un véritable prétendant.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
149.—Dimanche 14 juillet.
L'instruction est close, la Chambre d'accusation a prononcé le renvoi, devant la Haute-Cour, des accusés Boulanger, Dillon et Rochefort.
150.—Mercredi 17 juillet.
Toujours pas de nouvelles d'Eux! Mes fleurs seront-elles plus heureuses que mes lettres? Je viens d'en envoyer une jardinière pleine, à Londres, pour la sainte Marguerite.
Il n'est bruit, dans le pays, que des élections au Conseil général qui vont avoir lieu de dimanche en huit, et de la bizarre idée qu'ont eue les boulangistes de poser la candidature du général dans 80 des 1.500 cantons de France appelés au vote.
151.—Dimanche 28 juillet.
Le vote pour le Conseil général a eu lieu aujourd'hui, pendant qu'on affichait à Paris, à la porte des domiciles vides du général, du comte Dillon et de Rochefort, l'ordonnance du président de la Haute-Cour sommant les trois accusés de se livrer dans un délai de dix jours, faute de quoi ils seront jugés par contumace.
J'apprends à l'instant les résultats du vote dans le pays. La candidature du général a misérablement échoué. M. Pommerol est élu dans Clermont-Est et notre député, M. Blatin, dans Clermont-Sud.
152.—Lundi 29 juillet.
On ne connaìt encore que les résultats d'environ trois cents cantons. Le général n'a passé que dans six.
153.—Mardi 30 juillet.
Les résultats complets sont connus. C'est un effondrement comme personne n'osait le prévoir.
Le général n'est élu, en tout, que dans douze cantons! Ses partisans sont consternés.
154.—Vendredi 9 août.
Toc! Toc! Toc!!! Les trois coups sont frappés, la comédie judiciaire commence. Devant la Haute-Cour de Justice assemblée sous la coupole du Luxembourg, M. le Procureur général Quesnay de Beaurepaire a commencé hier à lire son réquisitoire.
La lecture a duré pendant toute l'après-midi, et elle doit occuper sans doute encore deux grandes audiences.
155.—Samedi 10 août.
Hier, seconde audience de la Haute-Cour et suite de la lecture du réquisitoire.
De plus en plus instructif, ce réquisitoire! Ne m'a-t-il pas appris, à moi, que le M. Auguste, auquel Mme Marguerite m'avait écrit de télégraphier en janvier dernier, appartenait à la garde du corps du général,—une poignée de solides gaillards dont deux, à tour de rôle, surveillaient les abords de son hôtel, tandis que les autres se tenaient, en permanence, 14, rue Lapérouse?
Un bon point à M. le Procureur général pour la statistique si détaillée des lettres chargées que la poste a transmises à l'accusé Boulanger: 1.275 en seize mois!
M. Quesnay de Beaurepaire aurait bien dû, pendant qu'il y était, joindre celle de toutes les missives que la poste a oublié de transmettre... Il est vrai que cela aurait peut-être demandé une audience supplémentaire!
156.—Dimanche 11 août.
C'est seulement hier, à l'approche de la nuit, que la lecture du réquisitoire s'est achevée.
Ouf! quel morceau d'éloquence! Imprimé en volume, cela ferait bien un gros roman,—si toutes ces petites histoires, cousues bout à bout, n'étaient trop invraisemblables pour prendre place même dans les œuvres complètes de Lucie Herpin!
Voilà donc à quoi se réduit le colossal amas d'accusations sous lequel on a menacé d'ensevelir, à jamais, l'honneur du général! Il n'y a qu'une conclusion à en tirer: c'est celle du proverbe de nos paysans:
Che vôl batre mo bourriquo,
Troubaré be tourzou no triquo[1].
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
157.—Jeudi 15 août.
Consummatum est. L'arrêt de la Haute-Cour est rendu. Il a été prononcé hier soir à six heures.
Les trois accusés sont déclarés coupables sans circonstances atténuantes et condamnés par contumace à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée.
L'arrêt aura pour conséquences de priver les condamnés de leurs droits de citoyens, de les rendre inéligibles, de placer leurs biens sous séquestres, d'arracher au général cette plaque de grand-officier de la Légion d'honneur qui brille si fièrement sur sa poitrine. à moins qu'il ne rentre pour faire tomber l'arrêt et recommencer le procès...
Mais, alors, pourquoi être parti?
158.—Jeudi 5 septembre.
Enfin, enfin, une lettre de Mme Marguerite!
«Jeudi 29 août.
»Savez-vous, ma bonne Meunière, que nous avons depuis plusieurs mois de très grands doutes sur l'affection que vous disiez nous porter... car, depuis cinq mois, c'est-à-dire depuis que nous avons dû quitter Paris... nous n'avons rien reçu de vous... et, vrai, cela nous étonne... Quelle est la cause de votre silence?... Je ne puis croire que cela soit l'oubli... Je vais vous faire remettre cette lettre d'une manière sûre. J'espère donc qu'elle vous parviendra et j'espère surtout qu'elle sera suivie d'une prompte réponse... qui nous rassurera sur l'état de votre cœur à notre égard.
»Depuis cinq mois, j'ai été très malade d'une très grave pleurésie. Maintenant, je suis tout à fait guérie et je compte les jours qui nous séparent du retour dans notre chère France... Celui que j'aime tant a supporté vaillamment et courageusement ce temps si pénible de l'exil. Il est sûr du succès prochain. Cela lui redonne de nouvelles forces. Il sait que je vous écris, mais, comme il est extrêmement pris, il me charge de vous dire qu'il ne peut ajouter un mot à cette lettre, mais que tout ce que je vous dis d'affectueux, il le partage,—si vous n'êtes pas devenue oublieuse!!
»Voilà comment et à quel nom il faut me faire parvenir votre lettre: sous double enveloppe, la première, c'est-à-dire celle qui se verra, vous mettrez dessus:
Mademoiselle Francine Molès,
39, rue de Berry,
Paris.
»Puis, dans l'intérieur de cette enveloppe, votre lettre dans une autre enveloppe cachetée, avec, sur l'enveloppe, ces mots:
Faire parvenir à Madame de B...
De suite.
»J'espère, de cette façon, que, si vous m'écrivez, votre lettre me parviendra sûrement. Allons... dites-moi vite que nous sommes toujours aimés, dans ce petit coin de France... où j'ai certes passé mes jours les plus heureux.
»Je vous embrasse, vilaine oublieuse.
»B. B.»
La lettre a été jetée hier seulement à Paris, dans une boìte de gare. Elle aura mis huit jours à aller de Londres à Royat!
Et toutes celles que, depuis cinq mois, je leur ai envoyées? Et mes pauvres fleurs de la Sainte-Marguerite?
J'enrage à la pensée qu'elles sont peut-être en train de fleurir à la croisée d'un des séides de M. Constans!
159.—Lundi 16 septembre.
On murmure tout bas, avec des airs mystérieux, qu'un nouveau coup de théâtre va peut-être se produire: la rentrée du général en France, cette semaine, juste à temps pour impressionner le pays avant les grandes élections de dimanche prochain.
Je me suis amusée aujourd'hui à ranger la collection de brochures et chansons boulangistes que j'ai patiemment formée depuis de longs mois.
Du côté des brochures, voilà le Boulangiste du mois d'août 1886, avec les portraits humoristiques du Ministre de la Guerre en grande tenue, en petite, en négligé, debout, assis, à genoux, etc... Voilà les Almanachs Boulanger et plusieurs biographies du général, depuis la première, parue aussi en 1886, au lendemain de la revue de Longchamp...
Voilà aussi les diverses proclamations et déclarations du général, puis un long panégyrique intitulé: Celui que nous voulons! puis la brochure de M. Laisant: Pourquoi et comment je suis boulangiste et la contrepartie de M. Yves Guyot, où il explique pourquoi il ne l'est pas. Voilà, d'autre part, le placard: Au peuple, mon seul juge! où le général se justifie des accusations de M. Quesnay de Beaurepaire, et la brochure de propagande: Qui a dit vrai? tout récemment parue, laquelle met en regard le texte du réquisitoire et les réfutations.
Voici, maintenant, le côté des chansons parues depuis 1886: l'En revenant d'la revue, les Pioupious d'Auvergne, le Général Revanche, le Prépare-toi, soldat de France! l'hymne Honneur au vaillant Général! et celui qui a nom Faut qu'il revienne! (sur l'air d'En revenant d'la revue):
Nous le voulons, la France entière,
Qui n'a pourtant pas froid aux yeux,
Mais qui regarde à la frontière,
Veut ce ministre valeureux.
La nation est assez forte,
Nous cherchons la paix, mais qu'importe
Qu'on fronce le sourcil là-bas:
Boulanger nous guide au combat!
à coup sûr, ce jour-là,
Le peuple et le soldat
Suivront leur brave général,
Avec un entrain général,
Sous les plis du drapeau,
Émules de Marceau,
Tous se mettront à crier:
«Vive la France et Boulanger!»
(Au refrain.)
Oui, Boulanger
à bien su relever
Le moral du troupier,
Qu'on s'en souvienne!
Le peuple entier,
Dont il s'est fait aimer,
Réclame Boulanger:
Faut qu'il revienne!
Certains de ces hymnes patriotiques, c'est une justice à leur rendre, sont tout simplement idiots. Exemple:
LA REVANCHE DE BOULANGER
(Air: Les Pioupious d'Auvergne.)
Comme une relique,
Notre général,
Néral!
Aim' la République,
C'est un homme loyal,
Loyal!
Gloire au patriote
Qui tient not' drapeau,
Drapeau!
Gloire au sans-culotte,
Sans-culotte... de peau,
De peau!
Je ne continue pas.—Voici l'image du général crucifié par la Haute-Cour, avec une inscription flamboyante dans le ciel: «Il ressuscitera!» Voici une autre gravure, où l'on voit le général, armé du glaive de la volonté populaire, chasser les parlementaires des marches du Palais-Bourbon. Au-dessous, vient la chanson:
TOUS VONT DÉCAMPER
(Air: Les Pioupious d'Auvergne.)
Depuis longtemps la Chambre
Ne fait que dormir,
De janvier à décembre:
Il faut en finir!...
Paris, la province
Demandent promptement
Que l'on vous évince
Tous du Parlement!
(Au refrain.)
Les cinq cents rois fainéants de la Chambre
Vont tous décamper,
Grâce à Boulanger!
Mais ce n'est pas le coup du Deux-Décembre,
La dissolution
Fera passer la revision!
On verra la France,
Au premier signal,
Donner sa confiance
Au brav' général.
Tous, comme un seul homme,
Tous iront voter
Et l'on verra comme
On aim' Boulanger!
(Au refrain.)
Boulanger, le maìtre
D'une majorité,
Bientôt fera naìtre
La prospérité!
Alors notre France,
Vivant dans la paix,
Reprendra confiance,
Heureuse désormais!
(Au refrain.)
Il y a aussi la Marseillaise boulangiste qui appelle au vote:
Aux urnes, citoyens!
Échappons au danger!
Votons,
Votons,
Sur un seul nom!
Votons pour Boulanger!
Mais, à côté de ces chansons politiques et électorales, il en est également qui parlent au sentiment, comme si elles s'adressaient à nous autres, femmes! Tel: l'Œillet patriotique, précédé d'une vignette qui encadre le portrait du général d'une branche d'œillets rouges:
(Air: Les Pioupious d'Auvergne.)
Quand le ciel se dore,
D'avril à juillet,
Aux feux de l'aurore,
Resplendit l'œillet!...
Ô fleur d'espérance,
Chante avec fierté
Le peuple de France
Et la liberté!(Au refrain.)
Acclamons tous l'œillet patriotique,
L'œillet parfumé
Qui fleurit en mai;
Qu'il soit l'emblème de la République
Et tout palpitants
Chantons cette fleur du printemps.
Aux champs de l'histoire
Pour un front guerrier,
L'emblème de gloire
Sera le laurier!
Laisse-lui son rôle,
Œillet si vanté!
Sois le grand symbole
De fraternité!
Pauvre fleur du printemps! C'est un jour printanier qui t'aura été fatal, ce premier lundi d'avril...
160.—Dimanche 22 septembre.
Ce matin, quelle surprise! Le facteur m'apporte cette lettre recommandée de Mme Marguerite:
«Vendredi.
»Ma bonne Meunière, je vous envoie cette lettre recommandée et par Paris... Elle vous arrivera donc sûrement. Arrivez-nous, venez-nous faire une petite visite de deux ou trois jours. Vous aurez cette lettre dimanche matin. Partez lundi soir par le train de 9 heures à Clermont, pour arriver à Paris à 5 h. 5 du matin, gare de Lyon. Là, vous prenez un fiacre, c'est-à-dire une voiture, et vous vous faites conduire à la gare du Nord. Le train pour Londres part à 11 heures du matin (onze heures); vous aurez donc quelques heures à attendre. Vous en profiterez pour vous reposer et déjeuner. Vous prendrez un billet pour Londres, aller et retour, par Calais et Douvres. C'est à Calais que vous prenez le bateau; vous débarquez à Douvres et là vous prenez le train pour Londres, gare de Charing-Cross. Bien entendu, votre billet pris à Paris, vous n'avez plus rien à renouveler jusqu'à Londres. à la gare de Londres, où vous arriverez mardi vers 7 heures ½ du soir, vous trouverez un domestique à votre rencontre qui aura à la boutonnière un œillet rouge. Je vous recommande le plus profond silence; ne dire à personne où vous allez; ne prononcer jamais ni le nom du général ni le mien; de tenir le but de votre voyage absolument caché. Au domestique qui ira vous chercher à la gare, vous direz tout simplement que vous êtes Mme Quinton, pas un mot de plus, quoi qu'il vous dise et vous demande. Il vous conduira ici. Votre chambre sera prête. Dès cette lettre reçue, c'est-à-dire dimanche, écrivez-moi ici directement de cette manière-là: la première enveloppe à l'adresse de:
Madame Abadie,
51, Portland-Place, Londres, Angleterre.
»Je l'écris de nouveau:
Madame Abadie, 51, Porland-Place, Londres.
»Dans une autre enveloppe, vous mettrez:
Pour Madame de B...
»Est-ce bien compris?
»Puis, à Paris, en attendant le train de Londres, vous aurez à envoyer, toujours au nom de Mme Abadie, une dépêche avec ces mots: «Suis en route.» Inutile de la signer... Surtout, ayez bien le soin de cacheter l'enveloppe qui contiendra votre lettre: il est inutile que la personne à qui vous l'adressez la lise.
»C'est donc convenu: vous nous arriverez mardi, très bien portante, et, je n'en doute pas, heureuse de nous revoir. à mardi, donc. Je vous embrasse.
»Il faut que vous descendiez à Londres, à la gare de Charing-Cross. à Londres, il y a plusieurs gares: Charing-Cross est la seconde gare où le train s'arrête dans Londres.»
Rien ne pouvait me surprendre ni me troubler davantage que cet ordre de départ subit. Aller dès demain à Londres, moi qui ne suis encore sortie de mon Royat que deux fois en tout, sans voyager plus loin que Paris! Quitter ainsi à l'improviste ma maison, mes affaires, et tous les miens que ce départ va plonger dans un véritable désespoir!
N'importe! Y aurait-il obstacle sur obstacle, rien ne m'empêchera d'accomplir ce qu'ils m'ont demandé, en février, dans leurs dernières paroles d'adieu: «d'accourir auprès d'eux dès qu'ils auraient besoin de moi!»
Minuit
C'est aujourd'hui que le pays a voté pour la nouvelle Chambre des Députés.
Ils viennent seulement de partir, les membres du Comité électoral qui ont choisi ma maison, ce soir, pour y recevoir les premières nouvelles. Je leur dois d'avoir été renseignée de suite. à Royat même, le candidat du général, M. Mège, a mis en ballottage M. Blatin et pourrait bien passer au deuxième tour, Mais, dans tout le reste du département, c'est la victoire absolue des candidats du Gouvernement: M. Guyot-Dessaigne, à Clermont, M. Farjon, à Ambert, M. Bony-Cisternes, à Issoire, M. Duchasseint, à Thiers, sont élus. Il ne manque plus que les résultats de Riom.
161.—Lundi 23 septembre.
108 candidats du Gouvernement élus, 77 conservateurs et seulement 16 boulangistes, voilà les premiers résultats apportés par les journaux du matin.
Ma malle est bouclée. J'ai passé toute ma journée en préparatifs. Ma mère et ma sœur, après avoir rempli la maison de leurs lamentations comme si je m'en allais à ma perte, se sont enfin un peu calmées, sur ma promesse que je serais de retour dans deux semaines.
L'heure approche. Adieu les miens, adieu Royat, adieu mon cher Journal, confident de ma vie, que je ne reprendrai que pour raconter mon voyage, à mon retour du pays d'Angleterre. Et maintenant, en route vers les deux chers êtres qui m'appellent là-bas.
162
Mardi 24 septembre.—Samedi 5 octobre 1889.
Le voyage d'aller s'est accompli ponctuellement suivant les instructions de Mme Marguerite. Pendant mon passage à Paris, le 24 au matin, j'ai lu dans les journaux les résultats presque complets des élections: 219 candidats du Gouvernement, 138 réactionnaires et 21 boulangistes élus au premier tour. Le trajet de Paris à Calais m'a permis de faire des comparaisons entre ces maigres et plats paysages du Nord de la France et la nature si riche, si pittoresque de mon Auvergne tant aimée! Puis ça a été un grand cri qui s'est échappé de ma poitrine: la mer, la mer immense qui s'étendait là, devant moi, et que mes yeux embrassaient pour la première fois!
L'impression a été si forte que j'en étais toute grisée et que, appuyée contre la balustrade du bateau, je n'arrivais pas à détacher les yeux de l'infinie nappe verdâtre frangée d'argent. Mais, bientôt, le temps s'est gâté, les grosses lames se sont mises à soulever l'embarcation en tous sens, tandis qu'une pluie froide battait le pont. Il m'a fallu descendre dans le salon d'en bas: je m'y suis trouvée à côté de trois messieurs qui avaient fait le trajet dans le même train que moi depuis Paris et qui causaient des élections. «Des journalistes, sans doute», me suis-je dit. Eux se sont arrêtés net en apercevant ma coiffe, qui, décidément, a le don d'intriguer tout le monde. La curiosité aidant, ils n'ont pas tardé à m'adresser fort aimablement la parole. Pour n'avoir pas à leur donner la réplique, j'ai fait celle qui commence à ressentir les premières affres du hideux mal de mer... La ruse était bonne: elle aurait été meilleure encore, si je n'avais fini moi-même par la prendre trop au sérieux...
Grâce à Dieu, enfin, la terre ferme! Quelques minutes à peine d'arrêt à Douvres, et le train nous emporte avec une rapidité vertigineuse vers Londres. La nuit est tombée. Tout à coup, des lumières commencent à y scintiller, de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées. Des deux côtés de la voie, à perte de vue, ce sont maintenant des milliers de points lumineux qui trouent l'obscurité. Bientôt d'aveuglantes clartés électriques se mêlent aux becs de gaz: une halte rapide dans une première gare, quelques instants encore de trajet, puis un pont est franchi à une grande hauteur au-dessus du fleuve très large où se reflètent les feux multicolores des bateaux, et le train s'arrête dans la gare de Charing-Cross.
La première personne que j'aperçoive sur le quai d'arrivée est un domestique portant l'œillet rouge à la boutonnière. Je vais vers lui, mais les trois messieurs de tout à l'heure l'ont également aperçu et l'appellent par son nom, s'imaginant sans doute que c'est eux qu'il attend. Ils échangent quelques paroles avec lui, puis s'en vont. J'en ai entendu assez pour comprendre que ce sont des amis politiques du général, arrivés à Londres pour conférer avec leur chef.
Il était près de huit heures. Le domestique, auquel je viens de me nommer, me mène immédiatement à la voiture du général. Dix minutes d'une course rapide à travers des rues sillonnées de véhicules sans nombre, et me voici devant la maison de Portland-Place. Sur mon désir d'aller d'abord un instant dans ma chambre, j'y suis conduite à travers un vestibule orné de bustes et un vaste escalier que je monte jusqu'au second étage.
Vite, ayant remis un peu d'ordre dans ma toilette, je redescends au rez-de-chaussée. Le domestique ouvre toute grande devant moi une porte à deux battants. J'entre, et je me trouve en face d'Eux...
Jamais je ne pourrai oublier le groupe qu'ils formaient: Elle, assise toute droite sur un siège très élevé, éblouissante de beauté, vêtue d'une robe de mousseline de soie rouge sang, à tout petits plis droits, la taille serrée par une ceinture très large en surah noir, le cou découvert, mais sans un seul bijou; Lui, accroupi à ses pieds, sur une causeuse basse, le visage très pâle et les yeux profondément creusés.
J'ai été tellement saisie de les voir, l'émotion a été si forte que je n'ai pu faire un pas ni prononcer une parole. Et quand mon regard s'est fixé sur Lui, sur sa figure amaigrie qui disait d'une façon si saisissante combien cet homme était malheureux, je n'ai plus pu retenir mes larmes, qui se sont mises à couler silencieusement...
En me voyant dans cet état, ils se sont levés, sont venus vers moi, m'ont embrassée bien affectueusement sur les deux joues. Mais rien n'y faisait: mes larmes redoublaient. Ils m'ont alors prise dans leurs bras, me câlinant, me caressant de la main, me rassurant de leurs paroles comme on fait pour un enfant qui s'obstine à pleurer. J'en avait honte: c'étaient Eux, maintenant, qui s'efforçaient de me consoler!
Enfin, la crise a passé et le général, feignant un brusque accès de bonne humeur, m'a pris le bras de force et m'a entraìnée dans la salle à manger. Nous nous sommes assis à table. J'étais encore si émue que je ne trouvais rien à dire. Il s'est alors mis à parler:
«Ma bonne Meunière, vos larmes nous ont assez révélé quelle affection vous nous portez et quelle part vous prenez à nos déceptions. Merci d'être venue, comme vous nous l'aviez promis, à notre premier appel... Pourquoi nous vous avons appelée? C'est ce que je vais maintenant vous dire... Vous connaissez le résultat des élections. C'est la défaite complète pour moi. Inutile même que je prolonge la lutte. Le peuple s'est détourné de moi; il a cru mes ennemis. Je l'avais pris pour juge: il m'a répondu en me condamnant, lui aussi, par contumace, comme les gens de la Haute-Cour... La partie est perdue, n'en parlons plus... Le plus pénible serait, en ce moment, de ne pas savoir nettement ce qui me reste à faire. C'est ce que je redoutais, dans la prévision d'un échec: car je dois vous dire que, depuis près de deux mois, depuis la malheureuse affaire des Conseils généraux, j'avais de mauvais pressentiments... Aussi ai-je employé ce temps à prendre mes mesures pour le cas où viendrait la défaite. Vous savez que j'ai été en Amérique? C'est le pays au monde, après ma chère France, que j'aime et que j'admire le plus... Des amis, auxquels j'ai écrit, m'y invitent chaudement. Des sommes—et de très grosses sommes—me sont même offertes si je veux y profiter de mon séjour pour faire quelques conférences... Bref, tout ce qui peut contribuer à rendre un voyage désirable se trouve réuni là-bas... Sans doute, ce sera s'éloigner davantage encore de la patrie: mais pas sans esprit de retour, je vous l'assure, car, bien au contraire, ce temps de recueillement doit m'aider à d'autant mieux préparer ma rentrée en France... Restait un obstacle: ma chère Marguerite, pour qui l'Amérique paraissait bien lointaine! Mais Marguerite vient de me donner une preuve nouvelle de son affection. Elle a compris que rien ne pourra atténuer ma peine, si ce n'est cette diversion violente à toutes les tristesses qui m'entourent. Elle consent donc aujourd'hui à ce que nous allions ensemble à New-York... Reste un dernier point à résoudre, et celui-là dépend de vous. Nous ne pouvons partir que si nous avons avec nous une compagne qui puisse nous aider en toute circonstance, une confidente à qui nous puissions tout dire, une amie qui ne nous quitte pas. Eh bien! cette compagne, cette confidente, cette amie, il n'y a qu'une seule personne qui puisse l'être: vous l'avez deviné? C'est vous!... Oui, ma bonne Meunière, c'est à vous que nous nous adressons; nous savons quel sacrifice nous vous demandons et combien il pourra vous paraìtre douloureux de quitter pour un an, pour deux, peut-être, votre cher Royat et vos proches... Mais nous connaissons aussi la place que nous occupons dans votre cœur, et, puisque c'est à vous que nous devons les jours les plus heureux, certes, que nous ayons vécus ici-bas, nous sommes sûrs que vous ne refuserez pas de nous assister encore pendant les épreuves qui sont venues sur nous...»
Pendant que le général parlait et qu'elle écoutait, sans un mouvement, les yeux baissés, je revoyais dans mon esprit l'image de ma vieille mère et de ma pauvre sœur, pleurant toutes les larmes de leur corps à l'idée qu'il me faudrait «passer la mer» pour aller de Royat à Londres... Et je me disais: «Que deviendront-elles, les pauvres femmes, si elles me voient partir pour l'Amérique? Et que deviendra ma maison, dont j'ai eu tant de peine à faire ce qu'elle est?»
Mais cela n'a été qu'une réflexion d'un instant, n'affaiblissant en rien mon idée dominante: la volonté de les servir, chaque fois qu'ils auraient besoin de moi, dans la pleine mesure de mes forces. Aussi, quand le général, s'étant tu, m'a interrogée du regard, je lui ai répondu sans hésiter: «Vous avez raison d'être sûr de moi.»
Il m'a remercié en me pressant les mains avec chaleur, tandis que s'éclaircissait sa figure jusque-là attristée. Il a envisagé aussitôt les détails d'exécution: je devais retourner chez moi dès le lendemain afin d'avoir le plus de temps possible pour faire mes préparatifs et pour dire adieu aux miens; lui-même emploierait une semaine à liquider certains comptes et à prendre congé de certaines personnes; nous nous retrouverions enfin à Liverpool, dans les premiers jours d'octobre, et alors en avant pour la libre et grande Amérique!
Tout en parlant de ce projet, il oubliait son chagrin, son visage s'animait et prenait presque l'expression des jours heureux d'autrefois. Elle, au contraire, demeurait immobile, sans lever les yeux, comme si elle éprouvait une contrariété secrète. Mais il ne s'en apercevait pas et parlait toujours.
Notre repas était terminé, si l'on peut appeler ainsi un défilé de plats auxquels nous n'avions eu le cœur, ni eux, ni moi, de toucher. Nous étions revenus dans le bureau du général, où il s'était fait apporter sa tasse de café, son petit verre et ses deux cigares réglementaires.
Dix heures sonnaient. Un domestique est venu annoncer que trois messieurs demandaient si le général pouvait les recevoir de suite: M. Laguerre, M. Elie May, et un troisième dont je n'ai pas entendu le nom. Le général a donné ordre de les introduire. Mme Marguerite et moi nous n'avons eu que le temps de nous échapper par la porte ouverte de la salle à manger, en laissant retomber derrière nous le rideau qui la masquait.
Mme Marguerite m'ayant fait signe de rester auprès d'elle à écouter, j'ai jeté un regard à travers la fente du rideau, et j'ai reconnu mes trois messieurs de tout à l'heure. Ils parlaient, avec de grands gestes et beaucoup de véhémence, de la situation faite par le premier tour de scrutin, de la honteuse pression électorale qu'avait exercée M. Constans, des dispositions à prendre en vue du scrutin de ballottage... Le général les écoutait froidement, répondant à peine par oui et par non.
Tout à coup, comme s'il en avait assez, il s'est levé et il leur a dit, d'une voix ferme, «qu'il entendait en rester là, qu'il ne voulait pas continuer une agitation désormais inutile et que sa résolution, ainsi qu'il l'avait déclaré d'ailleurs la veille à Naquet, était bien arrêtée: renoncer aux luttes électorales et se retirer en Amérique».
à ces mots, cela a été, de la part de ces messieurs, une véritable explosion de cris indignés. Tous trois protestaient en même temps, adjuraient le général de revenir sur sa décision, s'adressaient tour à tour à l'intérêt, au sentiment, au point d'honneur, bref, employaient tous les moyens de conviction qui peuvent fléchir la volonté d'un homme... Mais leur éloquence se dépensait en pure perte. Le général, qui s'était de nouveau assis, se contentait de leur répéter, de temps à autre, très doucement: «Inutile d'insister, mes amis. Ma volonté est inébranlable.»
Alors, le plus éloquent des trois a tenté un dernier effort.
Debout devant le général, il s'est mis à lui adresser un discours. Il l'a prié de réfléchir une dernière fois à la gravité de l'acte qu'il voulait commettre, à la responsabilité qu'il allait encourir devant le pays, devant l'opinion publique et devant le jugement de l'histoire. Il lui a tracé un tableau navrant de la stupéfaction avec laquelle le monde accueillerait son départ, ou plutôt sa désertion à la veille du scrutin de ballottage,—de cette lutte décisive où se trouvait en suspens le sort de tant des siens, qui s'étaient jetés dans la mêlée, à corps perdu, pour lui... Il lui a représenté la joie sans nom de ses adversaires, le désespoir de ses amis, l'effet déplorable produit sur les 1.500.000 Français qui lui avaient, malgré tout, maintenu leur confiance, et les malédictions populaires qui le suivraient dans sa fuite, et cette honte qui ne s'effacerait jamais de son front...
Sa voix, tantôt modérée et froide, tantôt incisive et mordante, prenait par moments des inflexions déclamatoires d'orateur professionnel, de prédicateur ou d'avocat. Mme Marguerite me poussait à chaque fois du coude en me chuchotant: «Regardez comme il plaide!»
Maintenant, sa plaidoirie traitait de l'état des esprits à Paris, des 200.000 électeurs qui y étaient restés fidèles, de la majorité qui y était assurée aux amis du général lorsque, au printemps prochain, le Conseil municipal devrait être renouvelé, et de la revanche éclatante que l'on prendrait alors, car qui tient Paris, tient la France.
Enfin est venue la péroraison, dans laquelle, faisant appel à toute son éloquence, il a supplié le général d'accomplir son devoir jusqu'au bout, de rester le chef de son parti et de donner sa promesse qu'il ne s'en ira pas au loin... En prononçant ces dernières paroles, il avait des sanglots dans la voix. Saisies par l'émotion, nous avons avancé toutes deux nos têtes et nous l'avons vu tomber aux genoux du général. Celui-ci s'était levé très pâle. Des larmes mouillaient ses yeux. Lui seul nous faisait face, tandis que les trois autres ne pouvaient nous voir. Son regard a croisé le nôtre, et j'y lu une interrogation muette. Oh! comme j'aurais voulu que Mme Marguerite lui criât, en cet instant décisif:
«Ne cédez pas! C'est leur intérêt immédiat qui les inspire, mais l'intérêt supérieur de l'avenir vous commande d'exécuter votre projet!»
Mme Marguerite, au contraire, a fait un signe de tête avec un sourire qui disait: Cédez, j'y consens!»
Le général a tendu ses deux mains à celui qui s'était jeté à ses genoux et l'a relevé en lui disant:
«Mon ami, je reste. Je vous promets de ne pas partir!»
Et c'est ainsi qu'il a renoncé à ce voyage d'Amérique, qui aurait été pour lui le bonheur dans les circonstances présentes et qui lui aurait permis de gagner honorablement une fortune dont la possession serait devenue, plus tard, autrement utile à sa cause que ne peut l'être maintenant son séjour plus ou moins proche de France!
Les trois messieurs s'étaient retirés, après avoir remercié avec effusion le général.
Nous sommes rentrées aussitôt dans son bureau. Il avait l'air accablé, ainsi qu'un homme auquel on vient d'arracher son consentement et qui en éprouve du regret. Mais Mme Marguerite, qui, décidément, n'avait accepté ce grand voyage qu'à contre-cœur, s'est mise à le câliner tendrement, en le félicitant d'avoir changé de résolution.
Il se faisait déjà très tard. Leur ayant dit bonsoir, je me suis retirée.
Le lendemain, j'ai pu examiner tout à loisir cette fameuse maison de Portland-Place dont les journaux faisaient une si somptueuse demeure seigneuriale. Il n'y avait de seigneurial que la situation de l'immeuble dans l'une des plus belles rues de Londres, à main gauche, sur le chemin de Regents-Park, dont les grands arbres s'apercevaient au fond, et parmi d'autres constructions, qui, elles, étaient de véritables palais à colonnades. Quant à la maison elle-même, c'était tout bonnement une confortable habitation bourgeoise, sans cour d'honneur ni péristyle, et précédée seulement d'une grille à la mode anglaise, derrière laquelle descendait un escalier extérieur menant aux cuisines. Les écuries se trouvaient ailleurs.
Au rez-de-chaussée, le bureau du général, éclairé par deux fenêtres donnant sur la rue, se distinguait surtout par un encombrement excessif de sièges, de bronzes et de bibelots de toute espèce. à côté, la salle à manger, garnie de meubles très simples en vieux noyer ciré, pouvait tenir tout au plus douze à quinze personnes.
La seule pièce un peu vaste était le salon, qui occupait presque tout le premier étage. Il y avait là, également, un véritable bris-à-brac de bibelots et de meubles, de sièges de tous styles et de toutes nuances, de vitrines, de glaces, de petites étagères formant rayons, de vases de Sèvres, de porcelaines de Saxe, de coupes, de statuettes en vieux bronze verdâtre, d'objets chinois et indiens. Dans un coin, un grand piano long. Comme on sentait, à l'arrangement des choses, que c'était là un salon anglais, loué tout meublé.
Outre le salon, il n'y avait plus au premier étage qu'une seule pièce: la salle de bains... Bizarrement située, mais confortable.
à l'étage au-dessus se trouvaient la chambre du général, celle de Mme Marguerite et trois chambres d'amis dont une contenait un grand harmonium. Enfin, au troisième, les logis mansardés des domestiques.
La chambre du général était surtout honoraire: il n'y apparaissait que pour faire sa toilette. La chambre de Mme Marguerite correspondait exactement au bureau du général, situé deux étages plus bas. C'était une jolie chambre, tendue de percale à fleurs rouges sur fond crème, remplie elle aussi de bibelots, mais arrangée avec une élégance exquise par la main de celle qui l'habitait. à quel point Mme Marguerite aime tout ce qui est beau, tout ce qui est riche! Que d'heures j'ai passées à admirer ses bijoux qu'elle a sortis d'un grand coffret moyenâgeux en argent ciselé pour les étaler devant mes yeux éblouis! Quelle fortune en colliers de perles, en aigrettes, agrafes, boucles d'oreilles et bagues resplendissantes de diamants, en lourds bracelets d'or et en accessoires de toilette du même métal! Et partout, la couronne vicomtale ou bien un blason formé de deux écus surmontés de la couronne à cinq fleurons.
Sur l'écu de gauche, quatre compartiments, avec une barre inclinée et différents symboles. Sur l'écu de droite, deux compartiments seulement: trois barres inclinées, et, au-dessous, des créneaux surplombant une étoile à cinq pointes.
Les créneaux, symboles de l'aristocratique châtelaine, qui dominent, jusqu'à l'éteindre, une étoile...
N'y a-t-il pas là quelque chose de fatidique?...
La vie qu'Elle et Lui menaient à Portland-Place était aussi peu somptueuse que la maison elle-même.
Tous les matins, à neuf heures, le général était levé et descendait en tenue de cavalier, coiffé d'un petit chapeau melon qui lui allait aussi mal que possible, pour sortir à cheval en compagnie du capitaine Guiraud et de M. Driant—un monsieur pas sympathique, ayant tout l'air d'un brasseur d'affaires. Ces trois messieurs se rendaient de préférence à l'allée de Rotten-Row, dans Hyde-Park.
à onze heures, le général était de retour et travaillait, dans son bureau, avec ses deux secrétaires, au dépouillement de l'énorme courrier qui lui arrivait tous les jours.
à midi, Mme Marguerite descendait, en toilette de ville, et l'on se mettait à table. Une ou deux fois tout au plus, il y eut des invités à déjeuner, et seulement des intimes. La table était bonne, mais extrêmement simple.
Vers deux heures, une victoria s'arrêtait devant la maison. C'était M. Rochefort qui venait faire sa visite journalière. Le général et lui s'entretenaient cordialement pendant une demi-heure, puis M. Rochefort remontait dans sa voiture.
Il se présentait pas mal de visiteurs durant l'après-midi. Le général les recevait dans son bureau. Les journaux ont prétendu qu'il a consigné sa porte à tout le monde, durant les premiers jours qui ont suivi les élections. C'est inexact: il l'a consignée aux seuls journalistes, dont les questions ne pouvaient que l'importuner dans l'état d'esprit où il était.
Pendant que le général recevait ces visites, Mme Marguerite, qui tenait à n'être vue ni connue de personne, restait dans sa chambre à lire ou à écrire.
Elle-même ne recevait guère que Mmes Driant et Guiraud.
De cinq à six heures, le général travaillait à nouveau avec ses secrétaires: c'était la correspondance qu'on expédiait. Il y avait un exprès qui, tous les deux jours, faisait le voyage de Paris et y portait des monceaux de lettres.
C'est seulement à la tombée de la nuit que Mme Marguerite sortait, en voiture fermée, avec le général. Ils parcouraient ainsi, pendant deux heures environ, les parcs de Londres. Je n'ai fait moi-même aucune autre promenade, en sorte que je n'ai presque rien vu de la ville, si ce n'est qu'elle est immense.
Au retour, ils dìnaient. Ils n'ont jamais eu personne à table. Une seule fois, il a pris fantaisie à Mme Marguerite de faire comme s'il y avait des invités, de se mettre en toilette décolletée et de passer, pour prendre le café, dans le salon du premier étage. J'ai même été très chagrine de lui voir les épaules nues dans ce grand salon glacial, que l'on chauffait peut-être pour la première fois depuis que la fin de l'automne avait ramené à Londres un temps humide et froid. Mais elle avait tant de plaisir à montrer ses belles épaules, et cela le rendait si heureux, Lui!
Après dìner, le général allait presque tous les soirs dans le monde. Il y allait sans enthousiasme, par devoir et même en pestant pas mal contre toutes les corvées mondaines dont il lui fallait s'acquitter, ne fût-ce que pour prendre congé de la société de Londres. Mme Marguerite attendait, en lisant ou en écrivant, jusqu'à ce qu'il fût de retour. Ils ne sont sortis ensemble qu'un seul soir pour me conduire au théâtre. Elle ne nous avait pas permis d'assister à sa toilette, afin de nous en laisser la surprise. Elle était descendue, enveloppée dans un grand manteau de soie changeante, tout recouvert de broderie de jais, qui était lui-même une merveille. Mais quand, arrivée dans la loge, elle l'a laissé tomber, ni le général, ni moi, nous n'avons pu retenir un cri d'admiration auquel a répondu un long frémissement de la salle tout entière. Elle était éblouissante à défier toute description, dans une magnifique toilette de moire paille, garnie de dentelles applications d'Angleterre, avec son splendide collier de perles autour du cou et une étincelante aigrette de diamants dans sa blonde chevelure. Aussi fallait-il voir comment, tant qu'elle est demeurée à la représentation, toutes les jumelles sont restées obstinément braquées sur elle!
La journée se terminait, pour le général, le plus souvent après minuit, par une pilule d'opium que Mme Marguerite était forcée de lui faire avaler tous les soirs, afin qu'il pût se soustraire, du moins pendant quelques heures de sommeil, aux préoccupations qui le hantaient.
Quelles étaient ces préoccupations? Le soin que Mme Marguerite mettait à ne pas faire allusion, devant lui, aux derniers événements politiques, le disait assez clairement. C'était là le point douloureux dont cette âme souffrait. Par une sorte d'accord tacite que j'ai aussitôt deviné et partagé, elle évitait de le toucher jamais.
Lui-même n'a abordé que rarement ces sujets si pénibles pour lui. Une fois, il a parlé des démarches pressantes qu'on avait multipliées auprès de lui, huit jours avant les élections, dans le but de le décider à entrer en France et à s'offrir en holocauste pour le triomphe électoral de ceux qui comptaient jouer de son arrestation, de sa mort peut-être, comme d'un atout décisif. Le ton sur lequel il en causait indiquait suffisamment qu'il n'avait jamais arrêté sa pensée à ces petites combinaisons. à ce propos, il a rappelé quelques souvenirs de l'époque de son départ pour la Belgique: les efforts qu'avait tentés M. Constans pour amener d'autres députés boulangistes à franchir également la frontière, et les terreurs qu'un de ses auxiliaires secrets, un M. de C..., avait essayé d'inspirer à quelques-uns d'entre eux, MM. Naquet et Laisant, si je ne me trompe, auxquels il avait même fait passer des nuits d'attente sur des chalands stationnant en Seine.
Un autre jour, il a touché un mot des grandes élections qui, si elles avaient réussi, lui auraient permis de revenir à Paris comme Président de la nouvelle Chambre... en attendant mieux,—et aussi des malheureuses élections aux Conseils généraux dans lesquelles, induit en erreur par M. T..., il avait cru voir la meilleure réponse qu'il dût opposer à la récente loi contre les candidatures multiples, ainsi qu'aux poursuites de la Haute-Cour.
Le général parlait de ces choses à la manière d'un homme qui n'a plus guère d'illusions ni sur les espérances de son parti, ni sur la fidélité de ses lieutenants. Dans son bureau, après déjeuner, je l'ai vu à plusieurs reprises tirer de sa poche des lettres confidentielles qu'il n'avait pas voulu laisser à ses secrétaires et qui étaient des demandes d'argent venant soit de membres du Comité boulangiste, soit de fonctionnaires révoqués. Il y avait là de suppliantes missives signées de gros bonnets du parti qui eussent été joliment embarrassés par leur publication... Chaque fois, le général, après avoir démêlé, dans le fatras de raisons explicatives, le chiffre de la somme demandée, m'a remis la clef de «la caisse», en me priant de lui apporter de suite le nécessaire. «La caisse», c'était un tiroir du joli secrétaire à appliques de bronze qui se trouvait dans la chambre de Mme Marguerite, entre les deux fenêtres donnant sur la rue. Ce tiroir contenait des liasses de banknotes blanches anglaises, de billets bleus français et un sac en grosse toile grise où s'empilaient quelques centaines de guinées anglaises, plus grosses que nos louis d'or.
Quand j'avais rapporté au général l'argent et la clef, il ne manquait jamais de jeter au feu la lettre de demande. Je n'ai pu m'empêcher un jour de lui faire remarquer que c'était imprudent, ce qu'il faisait là, et qu'il valait peut-être mieux garder certains documents...
Le général a haussé les épaules. Puis il m'a dit: «Ce n'est pas ça qui les empêchera de me lâcher le jour où ils auront raclé le fond de la caisse!»
Pour ce qui est de Mme Marguerite, elle ne se ressentait plus aucunement de la pleurésie dont elle avait souffert pendant de si longs mois. Elle m'a raconté comment la maladie lui était venue.
Partie avec le général trop précipitamment pour avoir pu prendre toutes les dispositions nécessaires, elle s'est vue forcée de retourner, pendant quelques jours, à Paris. Elle y portait un manteau de loutre extrêmement lourd, sous lequel elle a eu si chaud, une après-midi où elle était entrée dans le couloir d'une porte cochère pour s'y abriter d'un orage, qu'elle n'a pu se défendre de le dégrafer. Un courant d'air l'a saisie: une fluxion de poitrine s'est déclarée le soir même. Le voyage de Paris à Bruxelles l'a aggravée, et elle était encore mal rétablie quand le général a dû quitter Bruxelles pour Londres. Elle a pris froid de nouveau pendant la traversée et elle a été longtemps malade à Portland-Place. Mais, maintenant, il n'en restait plus rien. Elle était plus resplendissante de santé que jamais... Elle avait même pris tellement d'embonpoint qu'aucune des soixante robes dont elle était si fière ne lui allait plus. Le soir où elle s'est faite si belle pour se rendre au théâtre, elle aurait bien voulu mettre la toilette en velours bleu de ciel, garnie de renard bleu, qu'elle avait portée au mariage du capitaine Driant, mais impossible d'y entrer!
Une seule chose me chiffonnait. J'ai remarqué qu'elle avait la respiration un peu courte et qu'elle était tout essoufflée quand elle montait les deux étages conduisant à sa chambre.
Mme Marguerite passait son temps à faire sa toilette, à écrire, à lire, à apprendre l'anglais. Elle écrivait beaucoup de lettres en se cachant du général, et c'était sa maìtresse d'anglais qui les portait. J'ai compris qu'il s'agissait d'affaires concernant sa fortune personnelle, auxquelles elle préférait ne pas initier le général qui avait déjà assez de soucis sans cela.
Elle n'entretenait de correspondance suivie qu'avec une seule personne de sa famille, une tante très âgée qui lui voulait beaucoup de bien.
«Vous êtes bien heureuse, m'a-t-elle dit un jour, d'avoir encore votre mère... Moi, je n'ai plus ni père, ni mère depuis vingt ans déjà et celle qui m'a tenu lieu de mère est comme morte pour moi!...»
Elle a ajouté:
«Moi-même, puisque Dieu ne m'a pas accordé d'enfants, j'aurais voulu être la mère adoptive d'une jeune femme qui me doit son bonheur et pour laquelle j'ai eu toutes les bontés, toutes les gâteries... La chère enfant ne trouvait rien d'assez beau parmi les objets que nous allions choisir ensemble dans les magasins. Je lui avais offert un nécessaire de voyage, garni de flacons de cristal à bouchons d'argent: elle a voulu des bouchons d'or... Elle a aperçu un livre de messe, une merveille, valant des milliers de francs! Elle n'a eu de repos jusqu'à ce que je le lui eusse acheté... Chaque robe qu'elle me voyait, elle en désirait aussitôt la pareille... J'ai satisfait à tous ses caprices: 60.000 francs y ont passé en quelques jours. Mais j'étais si heureuse de la voir satisfaite!... Bien plus, sans rien lui dire, je l'ai instituée ma légataire universelle... Aujourd'hui, elle m'a oubliée et elle feint de ne plus me connaìtre. Plus une lettre, plus un mot à mon intention!...»
à part cette pensée qui lui venait de temps à autre et la faisait beaucoup souffrir, Mme Marguerite ne se montrait jamais attristée. J'ai même été surprise du grand courage avec lequel elle supporte la grise monotonie de sa vie d'exilée et de paria, qui devrait lui paraìtre plus douloureuse qu'à toute autre femme. Car, à bien la connaìtre, elle n'est ni une femme d'action, ni une femme d'intérieur. Elle n'a de goût marqué pour aucune occupation! Elle est, avant tout, une mondaine, une éprise d'élégance et de luxe, une passionnée de toilettes, de visites et de réceptions. Or, c'est précisément tout cela que sa fuite avec le général lui a fait perdre, en sorte qu'on peut se demander: «La pauvre femme, que lui reste-t-il?»
Il lui reste l'affection sans bornes qu'elle montre pour Lui et qu'elle emploie maintenant à lui adoucir l'amertume de la défaite. Jamais je ne l'avais vue aussi aimante, aussi câline, aussi caressante que maintenant. Tous deux s'aiment plus passionnément que jamais. Plus d'une fois, ils se sont enfermés chez eux, en plein jour, pour se le dire et se le redire encore. Et il y avait quelque chose d'infiniment triste dans cette exaspération que cet homme qui souffrait et cette femme qui le voyait cruellement souffrir, mettaient à se donner éperdument à leur amour, comme s'enlacent, dans un naufrage, deux amants qui vont se noyer...
Deux questions ont occupé le général et Mme Marguerite pendant mon séjour auprès d'eux: la réduction de leur train de maison et la recherche d'un autre lieu de résidence.
Le train de maison qu'ils menaient à Portland-Place devait leur coûter certainement plus de cent mille francs par an. Le loyer était, si j'ai bien compris, de mille livres sterling pour l'année: perte sèche, par conséquent, puisque le général était décidé à partir après y être resté cinq mois seulement. Douze personnes étaient appointées sur la bourse du général. D'abord trois messieurs, savoir: les deux secrétaires et le capitaine G..., auquel le général, pour le dédommager de l'avoir suivi dans son exil, donnait mille francs par mois pour s'occuper de ses chevaux qui étaient au nombre de sept.
Puis, l'interprète qui se tenait constamment dans le vestibule d'entrée et l'exprès qui portait les lettres à Paris. Enfin sept domestiques: le cocher, le valet de pied, le valet de chambre, la femme de chambre, le maìtre d'hôtel chargé de servir à table, le cuisinier-chef et son aide de cuisine.
Mme Marguerite, qui se considérait comme épouse du général devant Dieu et comme unie à lui pour la vie, avait obtenu, non sans peine, qu'il la laissât payer—«sur sa dot», comme elle le disait,—tous les frais intérieurs de la maison: cuisine, chauffage, éclairage, etc... Le général gardait la dépense, de beaucoup la plus lourde, des appointements et gages. Mais, sur ce chapitre aussi, Mme Marguerite cherchait à alléger ses débours: elle s'arrangeait secrètement avec les domestiques pour qu'ils réduisissent les notes qu'ils avaient à présenter au général, et elle payait de sa poche ce qu'ils retranchaient ainsi. Bien entendu, les domestiques en abusaient.
Après avoir examiné la situation, le général et Mme Marguerite se sont décidés à se séparer du capitaine G... ainsi que de l'un des deux secrétaires, à vendre trois chevaux (de façon à ne garder que Tunis, le fameux cheval noir, Jupiter, cheval de selle alezan clair du général, et les deux grands carrossiers bruns que Mme Marguerite lui avait donnés l'an dernier pour sa fête), enfin à congédier l'interprète, l'exprès, le valet de pied, le maìtre d'hôtel, le cuisinier et l'aide de cuisine. L'opération s'est effectuée sans incidents, sauf en ce qui concerne le capitaine G... Le général, qui le considérait comme un ami, ressentait un véritable crève-cœur à l'idée de devoir lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Comme il hésitait de jour en jour, Mme Marguerite s'en est chargée. Qu'a-t-elle dit et que lui a répondu le capitaine? Je ne sais. Toujours est-il qu'il y a eu des mots vifs échangés, dont Mme Marguerite a paru très affectée quand elle est allée les redire au général. Lui, qui tressaille de douleur dès qu'on fait mine de contrarier sa Marguerite, en a eu un accès de colère épouvantable.
En ce qui concerne le changement de résidence, toutes sortes de solutions ont été envisagées. Puisque le général, en promettant de ne pas partir pour l'Amérique, s'était engagé à rester non loin de France, on a passé en revue les pays voisins. L'Espagne, l'Italie, la Suisse ont été écartées pour diverses raisons. La Belgique aurait convenu au général, si elle avait été plus hospitalière. Restait l'Angleterre: soit la côte anglaise du côté de Brighton, soit l'ìle de Wight, renommée pour la douceur de son climat, soit les Îles Normandes. Ce sont ces dernières qui ont eu la préférence. Une amie de Mme Marguerite lui avait vanté le charme de Jersey et le bon marché des hôtels de Saint-Hélier. Et puis, à Jersey, n'était-on pas aussi près que possible des côtes de France? Quoique sous le drapeau britannique, ne s'y trouvait-on pas en vraie terre normande, parmi des Français de race, sinon de nationalité?
Jersey a donc été adopté, et un appartement a été retenu à l'Hôtel de la Pomme-d'Or. Le départ devait s'effectuer aussitôt après le scrutin de ballottage, à moins que ses résultats ne nécessitent une prolongation de séjour à Londres.
Je les ai quittés le samedi soir, 5 octobre, veille du scrutin de ballottage. Quand je leur ai fait mes adieux, ils m'ont priée de monter un instant avec eux dans leur chambre, et Mme Marguerite, ouvrant de nouveau devant moi son magnifique coffret à bijoux, m'a dit de choisir, comme souvenir, ce qui me plairait le mieux. Mais, à ce moment, la pensée m'est venue des temps de gêne vers lesquels ils marchent peut-être tous deux à grands pas, et je leur ai répondu:
«Vous souvenez-vous, Madame, qu'après que vous m'eussiez fait voir toutes ces merveilles, vous vous êtes écriée: «Mais voici mes bijoux les plus précieux!» et vous avez montré les photographies du général, rangées par vous avec tant d'amour sur cette cheminée. Eh bien! puisque vous m'accordez le choix, je vous demande un de vos bijoux les plus précieux...»
Ma réponse les a surpris et touchés. Mme Marguerite a hésité un instant, puis elle a saisi celle de ces photographies qui occupait la place d'honneur et elle me l'a donnée avec deux bons baisers, en me disant: «Ma bonne Meunière, je vous remets là une chose pour laquelle je donnerais sans hésiter tous mes bijoux... C'est ma photographie préférée de Georges, celle qu'il a fait faire à Londres pour le jour de ma fête et qu'il a signée pour moi... Gardez-la bien, ma bonne Meunière, et gardez-nous tous deux dans votre cœur!»
Nous nous sommes embrassés une dernière fois, avec tendresse, et je suis partie.
Tout le long de la route, je n'ai cessé de la contempler, cette chère photographie, qui le représente debout, tourné de trois quarts, en habit noir avec chemise à col rabattu, l'écharpe tricolore de député et la plaque de grand-officier de la Légion d'honneur sur la poitrine. Le bras gauche pend, le poing fermé; la main droite s'appuie sur un meuble et l'annulaire porte la bague favorite du général, en forme de fer à repasser. L'attitude est martiale, le regard fixe, l'expression du visage sévère et concentrée. C'est le général à la veille de la grande bataille politique, scrutant de son œil d'aigle les chances de victoire et de défaite dans l'avenir brumeux.
Dimanche soir, j'étais de retour auprès des miens auxquels mes jours d'absence avaient paru longs comme des jours sans pain, et juste à temps pour apprendre le résultat du vote de ballottage à Royat: l'élection du candidat du général, M. Mège, nommé par 10.383 voix contre 8.351 à M. Blatin.
163.—Mardi 8 octobre.
Les résultats complets du scrutin de ballottage sont enfin connus. La nouvelle Chambre va se composer de 366 républicains antiboulangistes, de 163 conservateurs et de 47 boulangistes, ce qui fait, pour le Gouvernement, une majorité de plus de 150 voix, aussi forte que celle dont il disposait dans la dernière Chambre.
M. Constans peut se frotter les mains. Quant à nos braves paysans, ils se grattent la tête, et ceux d'entre eux qui, sur la foi des placards boulangistes, s'attendaient déjà à voir Dieu sait quel état de choses nouveau surgir des élections générales, s'en vont répétant d'un ton moitié résigné, moitié déconfit: «Allons, plus ça change, plus c'est la même chose!»
164.—Vendredi 11 octobre.
Tandis que Rochefort et Dillon restent définitivement à Londres, le général est parti mardi, et il se trouve installé, depuis ce même jour, à l'Hôtel de la Pomme-d'Or,—très modestement, disent les journaux.
Il y serait descendu sous le nom de M. Ducheyne, et l'amie du général se ferait appeler miss Florence.
J'ai écrit à M. Ducheyne et à miss Florence en leur souhaitant tout le bonheur possible dans leur nouveau séjour.
165.—Dimanche 13 octobre.
La dislocation de la grande armée est chose accomplie. Les anciens partis, si étroitement alliés aux boulangistes pendant la lutte, ont rompu avec eux dès que la défaite a été consommée. M. Arthur Meyer le leur a dit fort galamment dans son Gaulois: «Bonsoir, Messieurs!»
J'ai là sous les yeux une gazette satirique, La Silhouette, qui trouve drôle d'offrir—en image—un revolver au général, comme seul moyen honorable de sortir de l'aventure où il s'est plongé.
166.—Mercredi 13 novembre.
à Paris, hier, rentrée des Chambres et manifestation boulangiste devant le Palais-Bourbon,—ou plutôt essai de manifestation, pâle reflet des étourdissantes «journées» d'autrefois.
C'est l'enterrement final des succès de la rue après ceux du bulletin de vote.
Durant les quelques jours que j'ai passés à l'Exposition de Paris, la semaine dernière, j'ai pu me rendre compte que la plupart des gens ne s'occupaient plus du boulangisme qu'à la manière dont un chasseur fixe l'oiseau mortellement blessé pour le voir tournoyer, descendre et s'abattre.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
167.—Vendredi 27 décembre.
Les journaux annoncent que Mme de Bonnemain vient d'hériter une fortune de trois millions que lui a laissée sa tante, Mme Dézoneaux, veuve d'un notaire, décédée ces jours derniers.
Je devine que c'est cette vieille tante de Mme Marguerite qui, à peu près seule de toute sa famille, lui voulait du bien.
168.—Mercredi 1er janvier 1890.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Oh! le triste jour de l'an pour lui! Oh! la navrante place qu'occupe dans sa vie cette année 1889 qui a commencé si rayonnante, au seuil de son plus vertigineux triomphe, et qui s'est continuée brusquement par sa fuite, par son procès, par sa condamnation, pour s'achever par sa défaite, maintenant irréparable, quoi qu'en puissent dire ses rares amis.
Que reste-t-il aujourd'hui du brillant chef militaire d'il y a deux ans ou du formidable chef politique d'il y a quelques mois encore? Rien qu'un vaincu sur lequel s'acharnent les haines.
Il aurait pu devenir le maìtre de la France. Il a mieux aimé rester l'esclave de sa Marguerite. C'est son bonheur. Elle est tout pour lui. Il l'a près de lui, plus rien ne peut le séparer d'elle. Y a-t-il donc tant que cela à le plaindre?
Peut-être pas. Mais, pour sûr, il y a à regretter amèrement...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
169.—Dimanche 9 février.
Quatre mois écoulés sans qu'ils me donnent signe de vie! Faut-il les accuser d'oubli? Faut-il plutôt soupçonner le cabinet noir de M. Constans? Nous verrons bien: je leur ai expédié cette fois ma lettre dans un gros pli chargé, avec valeur déclarée.
Tout le monde ne s'entretient que de l'escapade imprévue du jeune duc d'Orléans, arrivé avant-hier à Paris pour réclamer sa place parmi les conscrits de cette année et sa part à leur gamelle. Arrêté aussitôt, il est traduit devant le Tribunal correctionnel.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
170.—Lundi 17 février.
Les journaux publient chaque jour les menus des repas que le jeune duc d'Orléans commande à un grand restaurant voisin de la Conciergerie, après en avoir mûrement conféré, chaque matin, avec un maìtre d'hôtel délégué auprès de lui. On ne pouvait pas lui faire de plus mauvaise plaisanterie. Mes compliments, mon prince, c'est ça votre gamelle? Exquise, ma foi, et bien choisie pour faire venir l'eau à la bouche de vos 200.000 camarades de classe! Les Parisiens se gaussent de vous: laissez-les rire. Moi, qui me pique d'être cordon bleu, cela me pénètre de respect de voir en vous un jeune fils de France si expert déjà dans l'art de bien manger.
171.—Vendredi 21 février.
Quels sont ces bruits étranges? Je viens d'entendre que Mme de Bonnemain serait à Paris depuis près d'un mois, qu'elle refuserait de retourner à Jersey et que le général lui télégraphierait «en clair» plusieurs fois par jour inutilement.
Mme Marguerite à Paris? Pourquoi? Pour ses affaires, évidemment, pour cet héritage de trois millions qui lui est tombé du ciel.
172.—Jeudi 27 février.
Le jeune duc d'Orléans—le «petit La Gamelle», comme l'appellent irrévérencieusement certains journaux de Paris,—a été transféré de la Conciergerie à la prison de Clairvaux.
173.—Mercredi 5 mars.
Dieu, quelle émotion j'ai eue ce matin quand le facteur, m'annonçant une lettre recommandée, m'a tendu une enveloppe encadrée de noir sur laquelle j'ai reconnu son écriture et son cachet blasonné, à Elle! Une lettre de Mme Marguerite! Enfin!!
«Lundi 3 mars.
»Vraiment, ma bonne Meunière, vous êtes une odieuse créature et, si nous ne vous aimions pas bien, nous vous détesterions à cause de votre horrible paresse. Je vous ai écrit, il y a plus de quinze jours, en vous demandant de me répondre courrier par courrier—et je n'ai encore rien reçu. Vrai, c'est très mal à vous. Nous devrions bouder, et ne plus jamais vous écrire. Je vous demandais dans ma dernière lettre si vous pouviez venir bientôt. Dans celle-ci, je viens vous fixer le jour. Nous voudrions vous voir arriver ici le vendredi 14. Donc, pour cela, il faut que vous quittiez Royat le jeudi 13 au matin. Vous prendrez à Clermont le train express du matin qui arrive à Paris à six heures. Vous prendrez à la gare une voiture et vous vous ferez conduire de suite à la gare Montparnasse. Ne vous trompez pas: gare Montparnasse. Là, vous pourrez dìner, mais vous n'aurez pas énormément de temps devant vous, car il faut que vous preniez pour Saint-Malo le train de 8 heures 45. Le train de Saint-Malo ne se prend pas au bas de la gare, où il y a le buffet, mais bien en haut. Vous demanderez pour Jersey, y compris le bateau, un billet d'aller et retour (c'est valable un mois) et vous prendrez le train à 8 heures 45. Vous arriverez à Saint-Malo à 6 heures 45 du matin. Le bateau ne part qu'à 9 heures et demie du matin. Vous aurez donc le temps de déjeuner, mais je vous engage à vous faire conduire au bateau avant par un des omnibus que vous trouverez à la gare. Vous ferez mettre vos bagages sur le bateau et, après cela, vous pourrez faire ce que vous voudrez jusqu'à 9 heures. Vous arriverez à Jersey à midi et demi. J'espère que vous aurez une mer calme. Vous trouverez quelqu'un à votre arrivée qui vous conduira ici à l'hôtel.
»Est-ce bien compris?... Dès que vous aurez reçu cette lettre, envoyez une dépêche au nom de Mme Abadie pour nous dire si c'est convenu.
»Allons, à bientôt, ma bonne Meunière. Attendez-vous à être grondée très fort.—En attendant, nous vous embrassons encore pour cette fois.
»Vtesse de B...»
Comment, elle m'aurait écrit il y a plus de quinze jours? Oh! M. Constans, voilà encore un tour de votre façon.
Bien entendu, j'ai envoyé ma dépêche de suite. J'aurais voulu la faire longue, longue, pour leur dire et redire tout ce que j'ai sur le cœur depuis de si longs mois. Ne le pouvant, j'y ai joint une lettre où j'ai expliqué combien de fois je leur ai écrit sans recevoir aucune réponse et où je me suis enquise avec insistance de sa santé, puisqu'à diverses reprises j'ai entendu dire qu'elle était souffrante.
174.—Lundi 10 mars.
Je suis encore retournée à Clermont aujourd'hui, pour activer les préparatifs de mon départ. En rentrant, j'ai trouvé une dépêche qui m'attendait:
Royat-Jersey 128-33-10-2 h. 49 s.
Madame veuve Quinton, Hôtel des Marronniers,
Royat (Puy-de-Dôme).
Télégraphiez-moi de suite qu'à votre grand regret vous êtes absolument forcée de retarder de quelques jours ce qui était convenu. Je vous écris.
Que penser? Que faire? Expédier le télégramme demandé par Mme Marguerite: ce que j'ai fait sur l'heure.
Elle voit sans doute quelque inconvénient à mon arrivée, et, comme toujours, au lieu de le déclarer elle-même au général, elle préfère s'arranger de manière à ce que l'empêchement semble venir de moi.
175.—Mardi 11 mars.
Nouvelle dépêche ce soir:
Royat-Jersey 150-23-11-6 h. 10 s.
Madame Quinton, Hôtel Marronniers, Royat.
Très contrarié. Suis certain que vous ferez dimanche ce que vous deviez faire jeudi. Y compte absolument. Lettre suit.
Celle-là est du général, et je n'ai pas de peine à deviner qu'il était furieux en la rédigeant. Le retard de ma venue le contrarie. Pourvu qu'il ne finisse pas par m'en vouloir de toutes les cachotteries auxquelles Mme Marguerite m'associe bien malgré moi, car rien ne me répugne autant que ces façons détournées de procéder.
Attendons maintenant la lettre explicative que ces deux dépêches m'annoncent.
176.—Vendredi 14 mars.
La lettre explicative est arrivée. Elle n'explique rien du tout.
«Mardi 11.
»Merci, ma bonne Meunière, d'avoir fait ce que je vous ai télégraphié. Je vous en expliquerai de vive voix la raison. Lui vient de vous télégraphier et je compte bien que vous ferez ce qu'il vous dit, que vous partirez dimanche et que vous nous arriverez sûrement lundi. Il faudra que vous trouviez un prétexte pour lui expliquer ce retard. Donc vous partirez, n'est-ce pas, dimanche matin de Clermont, comme vous deviez partir jeudi. Une fois à Paris, vous irez gare Montparnasse. Là seulement, partant dimanche soir, il y aura un petit changement: au lieu de prendre le train pour Saint-Malo, vous prendrez celui pour Granville qui part à 9 heures du soir au lieu de 8 heures 45. Vous aurez donc un quart d'heure de plus pour dìner. Le train part en haut également, comme pour Saint-Malo. Donc, vous partez pour Granville dimanche à 9 heures du soir. Vous arriverez à Granville à 6 heures 18 du matin. Le bateau, ce jour-là, ne part qu'à 2 heures un quart de l'après-midi, à cause de la marée. Vous prendrez donc à la gare l'omnibus pour l'Hôtel du Nord. Là, vous pourrez déjeuner, vous reposer jusqu'à midi, déjeuner de nouveau et toujours l'omnibus de l'hôtel vous conduira au bateau. Vous arriverez ici vers 5 heures et vous trouverez quelqu'un au-devant de vous.
»J'ai, en effet, été assez souffrante—mais pas comme on vous l'a dit, et vous me trouverez mieux.
»Donc, à lundi, et, en attendant, nous vous embrassons.»
Non seulement la lettre n'explique rien, mais c'est encore moi qui dois m'ingénier à expliquer mon retard au général. Mme Marguerite m'en abandonne le soin. Merci de la surprise. Que vais-je bien trouver à lui prétexter? Sans doute la santé de ma pauvre mère,—qui n'est malheureusement que trop souvent mal portante depuis quelques années.
177
Lundi 17 mars.—Lundi 31 mars 1890.
Exécutant au pied de la lettre les prescriptions de Mme Marguerite, je suis partie le dimanche 16 mars, par l'express du matin. Aussitôt débarquée à la gare de Lyon, je me suis fait conduire à la gare Montparnasse. C'est alors que j'ai commencé à m'apercevoir que j'étais suivie par un individu qui ne m'a plus perdue de vue jusqu'à Jersey. J'en ai été très effrayée d'abord, et cela m'a gâté mon trajet nocturne de Paris à Granville. Puis j'en ai pris mon parti et je me suis mise à observer avec curiosité les allées et venues du garde du corps que M. Constans m'avait fait le très grand honneur de m'adjoindre.
Arrivée à Granville à 6 heures du matin, j'ai eu le temps de me reposer quelques bonnes heures à l'Hôtel du Nord, de déjeuner et de me rendre à pied au bateau. La traversée s'est effectuée par une après-midi magnifique,—véritable promenade de plaisance où le bateau glissait sans une secousse, sur une mer calme comme un lac bleu.
Le capitaine circulait parmi les passagers, disant à chacun un mot aimable. Il parut me remarquer d'une façon toute particulière, sans doute à cause de ma coiffe—et fut tout particulièrement aimable et galant avec moi.
Tout à coup, voici la terre qui s'aperçoit, d'abord lointaine et confuse, puis de plus en plus distinctement. La côte est rocheuse, mais plus à l'intérieur se montrent de belles pelouses verdoyantes qui s'étendent à perte de vue. Une ruine, surmontée d'une tour, se dresse en face de nous. Le bateau la laisse à droite et file à toute vitesse sur le port de Saint-Hélier dont les jetées deviennent visibles. Le voilà qui s'engage dans un goulet à peine assez large pour lui laisser passage, puis qui débouche dans un bassin très vaste, où stationnent quantité de petits vapeurs et de voiliers. Sur la droite, s'élève une sorte de fortin surmonté du drapeau anglais. Sur la gauche s'alignent les maisons de Saint-Hélier.
Dès que j'eus franchi la passerelle, j'aperçois l'omnibus de la Pomme-d'Or. Je pense y monter, mais conducteur me désigne l'hôtel, situé sur le quai même presque en face de nous. Je m'y dirige de ce pas. C'est une maison sans apparence, pas très haute, donnant sur une sorte de renfoncement. Je franchis une profonde porte cochère et me trouve dans une petite cour intérieure, plutôt triste, qu'égayent à peine quelques plantes vives alignées le long d'un mur. Une servante m'indique l'appartement du général: «L'escalier dans le coin, à droite, au second étage, au fond du couloir.» Je monte l'escalier sombre, je suis un long couloir qui fait un coude sur la droite. La fille de service m'a rejointe et m'offre de m'annoncer. Je pénètre dans une antichambre, de là dans une autre pièce et me voici auprès d'eux.
Le soir tombait, et, dans la pénombre, ils se tenaient assis aux deux côtés de la cheminée, auprès du feu qui se mourait. En me voyant entrer, ils se sont levés et m'ont embrassée affectueusement. Je ne pouvais pas très bien distinguer leurs traits, mais la première chose qui me frappa fut un embonpoint très prononcé qui déformait la silhouette de Mme Marguerite. J'en eus un mouvement de joie, croyant que le rêve tant caressé allait enfin s'accomplir... Le général me détrompa aussitôt:
«Vous voyez ma chère Marguerite un peu souffrante d'un gonflement et aussi d'une toux nerveuse qui la fatigue beaucoup... Les soins de notre médecin de Saint-Hélier n'y ont rien fait. Alors, comme il y avait déjà deux mois que ce double malaise persistait, nous avons fait venir de Paris le docteur qui a soigné Marguerite depuis son enfance. Il a passé deux jours ici, et il est reparti hier. Nous attendons pour demain son ordonnance avec les médicaments nécessaires. Je suis bien heureux que vous soyez là: à nous deux, nous la soignerons bien, notre chère petite malade, jusqu'à ce qu'elle soit...»
Un accès de toux de Mme Marguerite lui coupa la parole et me fit frissonner: c'était une toux mauvaise, sèche et rauque, qui lui déchirait affreusement la poitrine.
On vint allumer les lampes à gaz, et aussitôt mes regards effrayés se portèrent sur Mme Marguerite. Dieu, qu'elle apparaissait changée! Ce visage, que j'avais laissé à Londres si florissant, était maintenant pâle et amaigri. Les lèvres étaient toutes blanches et des cercles bleuâtres entouraient les yeux, augmentant l'apparence maladive de sa figure. Sous la robe de chambre en crépon noir, garnie de dentelles et de rubans, le ballonnement du ventre était tel qu'on eût pu croire la pauvre femme atteinte d'hydropisie. De temps à autre, sa toux la reprenait, la secouant tout entière, lui congestionnant la figure, après quoi elle restait abattue et sans forces.
Chaque fois le général se levait de son fauteuil, la prenait dans ses bras, la câlinait et la rassurait. Je le regardais faire, tout en l'observant lui-même. Jamais je ne lui avais vu aussi bonne mine. Toutefois, j'aperçus aux tempes des touffes de cheveux blancs, et aussi des filets argentés dans la barbe blonde.
J'étais si oppressée que j'avais peine à répondre aux questions qu'ils me posaient. Heureusement que le général était en veine de causerie. Il montrait une confiance absolue dans le prompt rétablissement de Mme Marguerite et dans le bien que pouvait lui faire le climat de Jersey. Il semblait s'être beaucoup attaché à l'ìle, à en juger par la description enthousiaste qu'il se mit à m'en faire.
Huit heures sonnaient. On s'est levé pour aller dìner. J'aurais supposé qu'on les servait chez eux. Il n'en était rien. Le général a jeté un fichu de laine blanche sur les épaules de Mme Marguerite et, lui offrant le bras, l'a menée vers l'escalier. Dès les premières marches descendues, je me suis sentie toute saisie par l'air frais du dehors, contrastant avec la chaleur de leur chambre. La cour, que nous avons ensuite traversée, m'a paru une vraie glacière. Je frissonnais quand nous sommes arrivés à leur petite salle à manger située au fond d'un couloir, à l'autre extrémité de cette cour. Au même instant, Mme Marguerite a été saisie d'une quinte de toux plus violente que toutes celles qui avaient précédé.
à dìner, tout appétit m'avait passé. Mme Marguerite toussait de temps en temps, ne mangeait presque rien, mais buvait, par grandes rasades, du vin blanc du Rhin très étendu d'eau. Quant au général, il faisait honneur au repas et continuait à me parler de Jersey.
Après dìner, nous avons refait la traversée de la petite cour glaciale. Mme Marguerite a monté l'escalier avec peine, s'appuyant lourdement sur le bras du général et s'arrêtant plusieurs fois en route, très rouge et essoufflée. La voyant ainsi, je me suis souvenue de l'essoufflement que j'avais déjà remarqué chez elle, à Londres, alors qu'elle paraissait cependant en si belle santé... Je n'ai pas eu le temps d'y arrêter davantage ma pensée, car, à peine arrivée dans sa chambre, Mme Marguerite a été reprise d'un affreux accès de toux, si violent qu'il lui a fait rendre le peu qu'elle avait absorbé.
Le général m'a naïvement avoué que cela se passait ainsi tous les jours, après chaque repas. J'étais outrée. Je leur ai représenté que cette maudite cour tuait Mme Marguerite, que la femme la mieux portante ne résisterait pas au coup de froid qu'on éprouvait en la traversant, que la montée de cet escalier aggravait la toux et que les déplorables accidents qui s'ensuivaient ne pouvaient manquer d'affaiblir la malade au plus haut degré. Ils en convinrent, mais ils ne voulurent pas se résoudre, comme je les en suppliais, à se faire servir dorénavant chez eux.
Ils trouvaient que cela présentait trop d'incommodité pour le peu de temps qu'ils passeraient encore à la Pomme-d'Or: car ils étaient déterminés à la quitter dès qu'ils auraient trouvé une villa à leur convenance.
Autant cet hôtel, le meilleur de Saint-Hélier, pouvait être agréable à habiter pour un touriste, autant il leur présentait d'inconvénients de toute espèce. Le général s'y sentait trop regardé, trop observé par les curieux, parmi lesquels il devinait plus d'un mouchard. Enfin, le docteur les avait complètement décidés à partir en leur déclarant que la cuisine d'hôtel n'était pas ce qu'il fallait à l'état de santé de Mme Marguerite.
En attendant, pour me donner du moins une demi-satisfaction, ils m'assurèrent que, le soir, on ne se rendrait plus à la salle à manger en passant par la cour, mais par l'intérieur de la maison.
Mme Marguerite se sentant un peu mieux, ils m'ont fait visiter leurs modestes appartements. D'abord, la chambre de Madame, une jolie pièce éclairée par deux fenêtres anglaises, à châssis glissant l'un sur l'autre. Ces fenêtres donnent sur le quai et la mer. Le lit se trouve au fond, dans une sorte de placard. Des fauteuils bas, très confortables, et de petits meubles anglais à tiroirs se détachent sur la moelleuse moquette rouge. Dans un coin, le buste du général, en terre cuite.
à côté, d'une part, la chambre du général, où il ne reste jamais, et, d'autre part, son bureau, donnant aussi sur la mer par une belle fenêtre double. Aux murs, l'étoffe à fleurons d'or sur un fond grenat qui tapissait, m'ont-ils expliqué, son cabinet de travail de la rue Dumont-d'Urville. Beaucoup de sièges, un autre buste du général, en marbre blanc. Au plafond, un lustre en cristal contre lequel il m'a dit s'être cogné un jour très fort, ce qui avait fait courir le bruit, à l'hôtel, qu'il y avait eu tentative de suicide.
Du bureau du général on passe dans une longue pièce formant antichambre, et là se termine leur logement proprement dit. Quatre autres pièces en dépendent: en sortant dans le couloir, de suite à main droite, la chambre du domestique et de sa femme; un peu plus loin, le bureau du secrétaire; puis, en tournant le coin, à main gauche, une pièce servant de débarras pour les innombrables robes de Mme Marguerite et une chambre d'ami qui m'a été donnée.
«Vous voyez, m'a dit Mme Marguerite, qu'il serait difficile d'accuser encore le général d'habiter des palais fastueux... Quant à notre personnel de service, il est tout aussi réduit: ma femme de chambre, Delphine, partie depuis hier pour Bruxelles d'où elle va nous ramener toutes sortes d'objets qui rendront notre intérieur plus confortable; son mari, valet de chambre du général, et enfin notre cocher. Ajoutez-y un garçon d'écurie engagé ici, un maìtre d'hôtel et une servante de la Pomme-d'Or attachés exprès à nos ordres, et voilà un strict minimum au-dessous duquel il était impossible de descendre... Avec cela, aucune dépense extraordinaire, sauf, dernièrement, l'achat d'un petit cheval à atteler au tilbury... Eh bien! malgré toutes ces économies, nous dépensons cependant deux fois plus que nous ne le présumions!»
Nous étions rentrés dans leur chambre et nous y avons encore causé quelque temps. à onze heures sonnant, je leur ai dit bonsoir. En se levant pour m'embrasser, Mme Marguerite a été saisie d'une nouvelle crise de toux, déchirante à fendre l'âme. Je me suis retirée chez moi profondément angoissée, et la plus grande partie de la nuit s'est écoulée sans que j'eusse pu prendre de sommeil. Il me semblait entendre cette toux affreuse, dont les oreilles me tintaient. En repassant dans l'esprit tout ce que je venais de voir, de lugubres souvenirs, vieux de plusieurs années, ressuscitaient en moi. J'ai soigné, hélas! et j'ai vu s'en aller, malgré tous mes soins, des proches atteints de la phtisie. D'instant en instant, l'effroyable vérité m'apparaissait plus nettement: Mme Marguerite est phtisique... Autant dire qu'elle est perdue!...
Le général ne s'en rend pas compte... Moi non plus, jadis, je ne voyais rien, jusqu'à ce que la réalité m'eût enfin ouvert les yeux...
Tant mieux pour lui: puisse-t-il tout ignorer jusqu'au bout... Combien de temps cela durera-t-il? Dans l'état où je la vois, avec ce changement si prodigieux en quelques mois, avec cette toux affreuse, je ne crois pas qu'il soit possible que cela se prolonge au delà d'une année, de dix-huit mois tout au plus... Elle passera peut-être encore un hiver, mais c'est le printemps qui est à craindre, le printemps où se réveille tout ce qui doit vivre et où, en vertu de je ne sais quelle attraction mystérieuse, les êtres condamnés à mort s'en vont vers le cimetière qui se couvre de gazon nouveau.
Et alors, un jour le général se trouvera seul dans la vie...
Miséricorde!
Vers onze heures du matin, Mme Marguerite est entrée chez moi. Elle apparaissait encore plus pâle et défaite, à la clarté du jour, que hier soir aux lumières. Elle s'est assise et elle m'a dit:
«Ma bonne Meunière, pendant que le général a été forcé de sortir, je viens vous expliquer, en confidence, pourquoi je vous ai demandé de retarder votre voyage... à part le plaisir qu'elle nous cause, votre arrivée devait nous rendre service, car nous pensions vous prier de rester auprès de moi pendant tout le temps où ma femme de chambre serait absente, afin qu'en cas de complications dans mon état de santé vous soyez là pour me soigner... Quand on est aussi mal portante que moi en ce moment, il faut, voyez-vous, songer à tout cela...»
Elle s'est arrêtée, saisie d'un accès de toux qu'elle a cherché en vain à étouffer dans son mouchoir. Quand il se fut apaisé, elle a repris:
«De plus, je voulais vous avoir près de moi lors de la visite de mon docteur de Paris, afin de pouvoir m'en remettre à vous, en qui j'ai toute confiance, au cas où il y aurait eu quelque chose à faire ou à cacher... Mais nous recauserons de cela dans un instant... Il était donc entendu que ma femme de chambre s'en irait jeudi et que vous nous arriveriez le lendemain, quand, il y a une semaine, j'ai été amenée à juger préférable que Delphine ne parte que trois jours plus tard... Mes raisons auraient été trop longues à expliquer au général: j'ai préféré vous demander de retarder vous-même votre voyage, ce qui m'offrait le prétexte d'ajourner celui de Delphine... à propos, avez-vous songé à ce que vous répondriez au général s'il vous questionnait sur les motifs de votre retard?
«Oui, Madame, mais il ne m'a rien demandé jusqu'ici.»
«Tant mieux, espérons qu'il aura oublié... Maintenant, autre chose, je viens de recevoir une lettre que je voudrais vous faire lire avant de la brûler... Seulement, il faut que vous me donniez votre parole la plus sacrée que vous n'en toucherez jamais un mot au général!»
Me regardant fixement, elle m'a tendu la main. J'y ai mis la mienne en lui promettant ce qu'elle demandait. Elle a alors tiré de son sein une enveloppe qui paraissait contenir plusieurs feuillets. Elle a fait mine de me la passer, puis elle s'est retenue avec un air d'hésitation:
«C'est peut-être bien imprudent de ma part, a-t-elle dit, de vous associer à ce secret.»
Le rouge m'est monté à la figure.
«Oh! Madame, me suis-je écriée, je crois vous avoir fourni assez de preuves de la confiance que vous pouviez m'accorder!»
Elle a souri:
«Vous avez cent fois raison, ma bonne Meunière, et je n'ai aucun doute blessant à votre égard... Eh bien! je vais vous la donner à l'instant cette lettre, mais pas ici: dans ma chambre, car, vrai, il ne fait pas chaud chez vous.»
Elle a recommencé à tousser. La soutenant par le bras, je l'ai reconduite à sa chambre. Elle m'a alors mis en mains l'enveloppe. J'en ai tiré une ordonnance de médecin que je lui ai rendue et une longue lettre de la même écriture, que je me suis mise à parcourir fiévreusement.
C'était une lettre suppliante, où le docteur lui parlait le langage le plus affectueux d'un ami. Il l'adjurait de quitter au plus tôt non seulement l'Hôtel de la Pomme-d'Or, mais l'ìle de Jersey, qu'il déclarait meurtrière pour elle. Il lui représentait que les plus graves conséquences l'attendaient si elle hésitait davantage à se transporter dans un climat plus ensoleillé. Il en était temps encore, mais tout juste: dans quelques mois, il serait peut-être trop tard. Il lui indiquait la Sicile ou Naples comme le séjour le plus approprié à la conservation de sa santé, ou tout au moins San-Remo, sur la Côte d'Azur, si le général tenait absolument à résider tout près de France.
En terminant, il invoquait un suprême argument: si elle faisait fi de ses conseils, si, pour ne pas contrarier le général dans ses projets, elle se sacrifiait à lui, qu'adviendrait-il dans la suite? Son ami la pleurerait un mois, trois mois, six mois peut-être, puis, aucune douleur n'étant éternelle, il se consolerait... Tandis que, si elle entreprenait le nécessaire pour se soigner, elle et lui continueraient à jouir de cet amour qui faisait leur bonheur à tous deux.
J'avais achevé cette lecture et j'en étais tout émue, Mon regard interrogea Mme Marguerite. Elle me reprit doucement la lettre des mains, puis elle me dit:
«Vous vous demandez ce que je compte faire... Eh bien! mon amie, regardez!»
Et, d'un geste rapide, elle jeta les feuillets dans le feu.
Je voulus les retirer des flammes; elle m'en empêcha en me serrant le bras nerveusement: «Laissez-la, cette lettre, dit-elle, il faut qu'elle disparaisse, pour que rien ne subsiste plus des conseils qu'elle me donne et que je suis bien déterminée à ne pas suivre... Quitter Jersey maintenant, quelle folie! J'ai eu toutes les peines du monde à empêcher le docteur d'en parler personnellement à Georges! Je n'y ai réussi qu'en lui exposant que la chose avait besoin d'être amenée avec quelques ménagements, en lui jurant mes grands dieux que je me chargeais de faire le nécessaire et en le priant de m'écrire une lettre que je puisse montrer... Vous avez vu ce que j'en ai fait.»
Je ne pouvais croire ce que j'entendais. Cela me bouleversait. Je me suis mise à supplier Mme Marguerite de revenir sur une détermination qui ne s'expliquait pas, d'accepter ce changement de séjour et de ne pas se condamner volontairement à une issue fatale, alors qu'elle n'avait qu'à écouter les recommandations du docteur pour vivre à jamais heureuse.
Elle ne me laissa pas continuer.
«Inutile de recommencer le plaidoyer du docteur, fit-elle. Là où il a échoué, vous ne réussirez pas!»
«Eh bien! Madame, répliquai-je vivement, il me reste encore un moyen de réussir et de vous sauver malgré vous... Je vais tout dire au général!»
Elle pâlit et me fixa, les sourcils froncés, puis elle me dit:
«Vous ne ferez pas cela, car vous protestiez tout à l'heure encore que vous étiez incapable de manquer à votre parole... D'ailleurs, pouvez-vous supposer que j'agisse par simple obstination? Croyez-moi, tout s'oppose à ce que j'aille en Italie, ou plutôt à ce que le général y aille, puisque rien au monde ne saurait le a séparer de moi, du moins tant que je serai vivante—et peut-être même plus tard... Le général a actuellement mille raisons pour rester à Jersey, et il en a mille autres pour ne pas se fixer en Italie. D'ici, il peut diriger la grande bataille électorale qui va se livrer à Paris, à la fin du mois prochain, pour les élections municipales, et dans laquelle il compte jouer sa dernière carte. S'éloigner davantage de Paris, en ce moment, serait une faute grave, qui produirait le plus mauvais effet. De plus, le général n'aime pas l'Italie, ou plutôt l'attitude actuelle des Italiens: lui qui a reçu sa première blessure et gagné sa croix dans la guerre de 1859 ne peut pardonner aux Italiens d'avoir si vite oublié... Vous voyez donc avec quelle répugnance il m'accompagnerait là-bas. Certes, si je l'en priais, il y consentirait. Mais, sûrement aussi, je l'exposerais, en le faisant, à de nouvelles attaques qui rejailliraient sur moi: on l'accuserait de nouveau d'avoir cédé au caprice d'une femme, et l'on m'accuserait, moi... Ah! dussé-je le payer du prix de ma vie, je ne veux plus qu'on m'accuse de quoi que ce soit: Dieu sait le mal qu'on m'a fait en insinuant que j'avais détourné le général de son devoir...»
Elle dit ces dernières paroles avec des larmes dans la voix. Un violent accès de toux la secoua, elle reprit:
«Voyez-vous, ma pauvre Meunière, il faut que je traìne mon boulet jusqu'au bout. J'aurai beau demander grâce, j'aurai beau crier que je suis mortellement malade, on ne voudra croire à ma maladie que quand j'en serai morte... Et puis, je n'ai même pas le droit d'en parler, car ce serait jeter dès maintenant une douleur épouvantable sur son existence à lui, déjà si éprouvé... Mais halte-là, le voilà qui revient!»
Le général rentrait, en effet, le visage souriant. Avec une présence d'esprit étonnante, Mme Marguerite lui sauta au cou et lui dit, d'un air joyeux:
«Georges, ma guérison est arrivée... La Belle Meunière vient de m'apporter l'ordonnance du docteur et les médicaments venus de Paris.»
Cela lui causa une joie véritable. Ils s'embrassèrent comme aux meilleurs jours d'autrefois. Elle lui tendit l'ordonnance. Après l'avoir parcourue, il demanda:
«C'est tout? Le docteur n'a rien écrit avec cela?»
Elle répondit, du ton le plus naturel du monde:
«Mais non; c'est vrai, il aurait bien pu ajouter un mot.»
«Allons, dit le général en riant, ces médecins sont tous les mêmes. Quand ils vous font l'insigne faveur de tracer quelques lignes à votre intention, on dirait que c'est avec un compte-gouttes!»
Le petit colis contenant les médicaments se trouvait sur la cheminée. Ils se mirent à le déballer, tous deux, retournant chaque objet en tous sens, comme de vrais enfants.
«Eh bien! Belle Meunière, finit par me crier le général, qu'avez-vous à rester toute morose dans votre coin, à l'instant où le bonheur rentre chez nous?... Allons, venez en prendre votre part: tout cela vous concerne autant que nous, car c'est vous et moi qui allons, maintenant, soigner notre chère petite Marguerite, et cela dès ce soir, pour qu'elle soit d'autant plus vite rétablie...»
Je m'approchai d'eux en souriant... Mon Dieu, combien je souffrais!
On ne tarda pas à descendre pour déjeuner. Mme Marguerite s'efforça de montrer plus d'appétit que la veille, mais je n'ai pas eu de peine à remarquer qu'elle buvait avec avidité, tandis qu'elle se faisait violence pour manger. En remontant chez elle, elle fut reprise d'un violent accès de toux, suivi d'autres accidents... Cependant, elle fit la courageuse et déclara qu'elle voulait absolument se promener en voiture avant de se résigner à garder la chambre pendant plusieurs jours.
Je l'ai aidée à mettre une robe forme peignoir en drap amazone, soutachée de noir, élargie à la taille exprès pour elle, comme si elle devait être mère à brève échéance... Nous sommes montés dans le landau découvert et nous avons fait un grand tour à travers l'ìle.
J'ai pu me faire une première impression sur Jersey, laquelle n'a pas varié depuis. J'ai trouvé l'ìle extrêmement jolie, mais d'une joliesse un peu mièvre et maladive. Ainsi que me l'a fait remarquer le général, les plantes les plus méridionales, les agaves et les camélias, poussent ici en pleine terre: mais elles y poussent comme dans une serre artificiellement chauffée. La végétation a je ne sais quoi d'anémique et de pâlot: les bois, ces bois d'un vert profond qui donnent tant de pittoresque à ma chère Auvergne, font presque complètement défaut; les arbres même sont rares; point de ruisselets ni de fraìches cascades comme dans ma vallée de Royat. Rien que d'immenses pelouses ondulées, où paissent des vaches maigres à cornes rabattues vers le museau, et que parsèment de petites maisonnettes blanches ou rouges, de coquettes villas à pignons pointus et de minuscules chapelles qui semblent disposées là comme si un enfant-géant les avait sorties de sa boìte à jeu.
Ce qui m'a semblé le plus beau dans cette promenade, c'est la mer, qui tantôt apparaissait dans une trouée, tantôt disparaissait derrière quelque roche, et qui s'étendait, tout argentée, sous le ciel merveilleusement clair.
Pendant que nous roulions, le général me faisait les honneurs de l'ìle, qu'il connaissait maintenant par cœur, m'indiquait du doigt tous les sites intéressants, me racontait leur histoire, me disait leurs noms. Mme Marguerite paraissait tout heureuse de le voir de si bonne humeur.
Ses yeux clairs le fixaient avec une tendresse particulière que je ne leur avais jamais vue, et où il me semblait lire la volupté du sacrifice auquel elle s'était décidée ce matin. Plus d'une fois, elle s'est penchée sur ses épaules et elle l'a baisé sur les lèvres avec une tendresse éperdue. Ma pensée se reportait alors à ces promenades en voiture qu'ils faisaient, autrefois, le soir, dans la vallée de Royat, et dont ils revenaient ivres d'amour et de baisers. Mais aussitôt la toux rauque me rappelait à la réalité...
Tout à coup, Mme Marguerite se sentit si altérée qu'elle exprima le désir impérieux de boire. Le général ne voulut pas céder d'abord, car le médecin avait prescrit qu'elle boive aussi peu que possible, sous peine de ne pas se guérir de sa dilatation de ventre. Mais elle le supplia avec tant d'insistance, elle promit si gentiment de ne plus recommencer jamais et d'être bien sage dans la suite, qu'il finit par arrêter le landau devant une auberge, en demandant de l'eau. On en apporta une carafe pleine, toute couverte de buée, tant l'eau était fraìche: Mme Marguerite en vida deux grands verres, coup sur coup. Il fallut lui retirer la carafe pour l'empêcher d'en boire un troisième.
Elle fut saisie aussitôt d'une quinte de toux terrible. Le général l'a enveloppée de ses bras et lui a porté son mouchoir aux lèvres. Il y est venu quelques petites taches de sang.
«Ce n'est rien! a-t-elle dit dès qu'il lui a été possible de parler. C'est cette vilaine toux nerveuse qui m'irrite la gorge!»
Le général l'a grondée d'avoir bu si avidement cette eau glacée. Il a fait refermer le landau et il a ordonné au cocher de revenir à toute vitesse sur Saint-Hélier.
Aussitôt rentrés à l'hôtel, nous avons obligé la malade à se coucher, et, le soir même, le traitement a commencé. Il s'agissait d'abord de réagir contre la toux en appliquant, au bas des omoplates, deux vésicatoires qui devaient être gardés toute la nuit. Le général l'a fait lui-même avec des précautions infimes, et il a enroulé ensuite des bandes de toile autour de tout le torse. Il y mettait tant de soin et d'adresse que je n'ai pu m'empêcher de lui dire:
«Vrai, mon général, il fait bon être souffrante avec un garde-malade tel que vous... On voit que vous avez l'habitude de faire le bon Samaritain avec ceux que vous aimez.»
IL m'a regardée d'un air étonné:
«Ma foi, je dois vous avouer que, de ma vie, il ne m'est jamais arrivé d'administrer, à qui que ce soit, la moindre pilule!»
«Eh bien! mon général, je vous félicite et vous admire. Du premier coup, vous avez atteint le savoir-faire de l'infirmière la plus accomplie!»
C'est plutôt «de la sœur de charité la plus exquise» que j'aurais dû dire: cette comparaison, seule, pouvait convenir aux soins dont il entourait sa chère malade, aux mille attentions qu'il avait pour elle et aux paroles touchantes qu'il trouvait afin de verser un peu de baume sur le cœur de cette femme qui souffrait,—car ces vésicatoires l'ont fait atrocement souffrir pendant toute la nuit. Jamais je n'ai mieux vu que durant cette nuit de veillée quels trésors de tendresse et de dévouement son cœur, à Lui, renfermait.
Le matin, quand nous eûmes déroulé les bandes de toile et décollé doucement les vésicatoires, j'ai vu le moment où il faudrait les soigner tous deux. Il s'agissait d'ouvrir les cloques qui s'étaient formées. J'ai passé au général de petits ciseaux d'argent: il les a levés, mais il est devenu en même temps si pâle que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Je lui ai alors offert de le remplacer. Ah bien oui! Lui, laisser d'autres mains que les siennes toucher ce corps adoré! Ma seule proposition a suffi à lui rendre le courage qui avait failli lui manquer, et il a bravement accompli l'opération jusqu'au bout.
«Ah! j'ai eu rudement chaud!» a-t-il dit avec un soupir de soulagement, quand le pansement fut terminé.
Ce même jour, Mme Marguerite s'est soumise aux autres prescriptions de son traitement, fort compliqué. Il y avait une potion à prendre par cuillerées d'heure en heure, des pilules pour la toux, d'autres pour le ventre, de la poudre de charbon en cachets pour faire disparaìtre le gonflement, sans compter les fortifiants, jus de viande, pepto-fer et compotes. Tout cela, le général l'administrait à l'heure militaire, sans une demi-minute de retard. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible, il avait affiché l'ordonnance près du lit de la malade et il s'y référait constamment, se mettant dans des colères épouvantables si tout n'était pas prêt à l'heure dire.
Mais, dès qu'il revenait vers sa malade, il redevenait doux comme une Sainte Vierge, la berçant dans ses bras ainsi qu'elle a dû le faire pour l'Enfant Jésus, et inventant chaque fois de nouveaux propos, les uns tendres, les autres gais, pour la rasséréner.
Au bout de trois jours, Mme Marguerite fut autorisée à se lever. Elle garda la chambre encore quelques jours, puis elle reprit petit à petit le train de vie ordinaire, tout en continuant sa médication avec la même régularité. Le traitement lui faisait un bien incontestable, surtout au ventre, dont le gonflement diminuait à vue d'œil. L'appétit revenait, les lèvres avaient repris un peu de couleur. La toux n'avait que peu diminué. Pour se rendre le soir à dìner, on montait maintenant quelques marches menant aux cuisines, que l'on traversait, ainsi que la grande salle à manger de l'hôtel. Mais cela ne valait guère mieux, car la fumée des fourneaux la faisait tousser tout autant qu'auparavant l'air froid de la cour. Plusieurs fois, les accès la saisirent au moment où elle débouchait dans la grande salle commune, et c'était navrant de la voir ainsi, sous les yeux de tous ces étrangers en train de manger. Au retour dans l'appartement, il y eut encore bien souvent d'autres quintes de toux amenant de fâcheux accidents: cependant, ces derniers tendaient à devenir plus rares.
Ce mieux relatif comblait de joie le général. Il faisait plaisir à voir, tant il était heureux et gai. Un soir, Mme Marguerite lui prépara une surprise qui devait mettre le comble à son bonheur. Deux amis étaient venus de Paris et le général les avait promenés pendant toute la journée. En attendant qu'ils revinssent pour dìner, Mme Marguerite avait fait appeler sa couturière et, à nous trois, nous nous sommes consultées sur ce qu'il y avait à faire pour qu'elle pût se mettre en toilette,—elle qui, depuis trois mois, avait été dans l'impossibilité de prendre un corset. Celui-ci gênait bien un peu: il fut coupé et élargi séance tenante.
Elle choisit une magnifique toilette en moire blanche avec surtout de tulle noir brodé de jais, qu'elle avait dû rapporter de Paris tout récemment. Il y avait à modifier la taille: nous y réussìmes par nos efforts combinés. J'aidai alors Mme Marguerite à s'habiller. Hélas! elle n'avait plus ses belles épaules d'autrefois, et je jugeais, à part moi-même, qu'il était préférable de les voiler. Je pris donc du tulle et des dentelles, la suppliant de me laisser arranger cela pour qu'elle ne puisse prendre froid. J'obtins ainsi de la prudence ce que la coquetterie ne m'aurait certainement pas accordé, car la pauvre femme ne s'apercevait pas à quel point elle était changée. Avec un flot de dentelles, ce fut parfait. Les bras avaient moins maigri que le reste et étaient encore assez beaux. Un brin de rouge sur les joues et les lèvres, des fleurs au corsage, une aigrette de diamants dans les cheveux, et nous eûmes un ensemble tout à fait séduisant. Justement, ces Messieurs venaient d'entrer dans le bureau du général. Mme Marguerite souleva la portière, derrière laquelle je me cachais (car je n'avais pas voulu me montrer à ce dìner) et pénétra vivement auprès d'eux... Ce fut un murmure d'admiration, puis un concert de compliments des deux invités. Quant au général, il ne disait rien: mais, l'ayant regardé par une fente du rideau, je vis que sa figure rayonnait de joie contenue.
Dès que Mme Marguerite eut paru suffisamment rétablie pour n'avoir plus à garder la chambre, le général avait proposé de reprendre les promenades en voiture de l'après-midi, en leur donnant pour but la visite de toutes les villas qui étaient à louer dans l'ìle. J'avais été assez imprudente, ce jour-là, pour lui demander pourquoi il tenait tant que cela à rester à Jersey, alors que d'autres pays, plus tièdes, pourraient leur offrir un séjour autrement agréable; cela m'avait valu un regard de reproche d'Elle et, de la part du général, cette réponse catégorique:
«Belle Meunière, plus un mot contre Jersey, ou bien nous allons nous battre... Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas, aussi près de France, un pays plus tiède et plus sain que celui-là... Jersey? Mais c'est un autre Nice, moins le voisinage peu sympathique des Italiens de Bismarck!... Et puis, voyez-vous, il y a bien des choses qui nous attachent ici. J'ai un lieu de promenade préféré: le château de Montorgueil, et du haut de ce château, quand le temps est clair, je vois les côtes de France!»
En prononçant ces mots, sa voix tremblait. Il a ajouté:
«D'ailleurs, s'il fait beau demain, notre première sortie sera pour Montorgueil.»
En effet, nous y sommes allés le lendemain. En fait de château, il n'y avait plus guère que des ruines, des murs écroulés, des vestiges de tours, le tout perché sur une roche assez haute. Mme Marguerite, un peu fatiguée, s'était assise chez le gardien, renonçant à nous accompagner plus haut, jusqu'au point de vue favori du général. Quand nous fûmes arrivés, le général laissa planer ses yeux d'aigle sur la mer qui s'étendait à nos pieds, puis, me montrant du doigt un point de l'horizon, me dit:
«Tenez, notre France!»
Je portai les regards de ce côté. Je ne voyais que la mer et un bateau à vapeur qui disparaissait, au loin. Le général me tendit une lorgnette. Après avoir longuement fixé l'horizon, je finis par distinguer, dans la brume du lointain, une ligne un peu plus sombre, qui pouvait être la côte normande. Le général, lui, sans se servir d'aucun verre, s'abritait les yeux sous la main déployée et disait:
«Tenez, je les aperçois maintenant, je les distingue, les flèches de la cathédrale de Coutances!»
Je le regardai. Il se tenait immobile, comme hypnotisé par ce qu'il voyait. Une larme se mit à descendre le long de sa joue.
Doucement, sans le troubler dans sa contemplation, je revins auprès de Mme Marguerite.
«Si vous saviez, me dit-elle, quelle impression cela lui cause!... Bien des fois, je l'ai vu pleurer à chaudes larmes, et un jour même tomber à genoux, la face inondée de pleurs, en tendant les bras vers cette patrie qu'il aime si éperdument et qui l'a proscrit.»
Le général nous rejoignit bientôt, l'air préoccupé, et il demeura taciturne pendant le reste de la journée. Les jours suivants, il m'a fait voir tous les autres sites renommés de l'ìle, le phare de Corbière, où la mer vient avec violence se briser contre les rochers, les grèves de Lecq, les grottes de Plémont, profondément entaillées dans la falaise et accessibles seulement tant que la mer est basse, car elle les submerge en montant... à chacune de ces promenades, conformément au programme arrêté, nous visitions toutes les villas qui se trouvaient à louer sur notre route.
On s'était à peu près décidé pour une propriété située vers l'intérieur de l'ìle, à une demi-heure de Saint-Hélier,—une maison de campagne plutôt rustique, mais entourée d'un immense et superbe jardin,—quand le hasard d'une excursion à la baie de Saint-Brelade nous fit découvrir, tout auprès, une villa qui surpassait en beauté tout ce que nous avions vu. C'était une sorte de pavillon d'été, en briques rouges, d'une élégance et d'une légèreté de construction vraiment exquises, avec d'immenses vérandas donnant sur la mer et des rosiers sans nombre grimpant partout.
Devant la maison s'étendait un bout de prairie qui, seul, la séparait de la plage. Derrière, le terrain s'élevait assez fort, jusqu'à un petit bois de pins. Le jardin, où il devait y avoir, en été, des milliers de roses à couper par jour, occupait cette montée; un chemin, bordé par une rampe à pilastres, en pierre blanche, l'escaladait, en décrivant plusieurs lacets parsemés de bancs de charmilles à formes étranges: tels, un gigantesque tonneau en bois et une grande lanterne de verre. Tout en haut gisaient des ruines, des colonnades à moitié brisées, d'où l'on avait un coup d'œil superbe sur le jardin, la maison et la mer.
à l'intérieur, la villa était installée et meublée avec une coquetterie extrême. C'était flambant neuf et d'un goût parfait. Mais, n'y aurait-il rien eu entre les quatre murs, qu'il y avait là une merveille qui suffisait, à elle seule, à rendre cette habitation désirable entre toutes: c'est la vue dont on pouvait jouir du haut des fenêtres et des vérandas. Le regard embrassait toute la baie de Saint-Brelade, la plus belle de Jersey, qui se découpait en anse sablonneuse, terminée par deux promontoires rocheux dont l'un portait une sorte de château fort. à gauche, à droite, la côte s'étendait, couverte de prés et de jardins, parmi la verdure desquels émergeaient quelques maisonnettes blanches et le clocher pointu d'une chapelle. Et en face, dans toute la largeur de l'horizon, c'était la mer à perte de vue.
Nous étions éblouis. Nous ne pouvions nous détacher de cet enchantement. Pourtant, le général exprima un regret:
«Ce serait autrement beau, si je pouvais apercevoir d'ici ce que l'on voit de Montorgueil!»
Mme Marguerite aurait voulu arrêter la location immédiatement, mais là était la difficulté: la villa venait d'être achetée par un Parisien, qui ne l'avait même pas encore habitée et qui n'était peut-être pas disposé à la louer. Cette incertitude les désola. Ils entamèrent de pressants pourparlers le jour même, et, dès cet instant, ils n'eurent plus d'autre aspiration que de les voir aboutir.
Un matin, par un temps splendide, ils s'en allèrent, tous deux, déjeuner là-bas. Ils ne revinrent qu'à la tombée de la nuit, heureux et ravis au delà de toute expression. Ils me déclarèrent que c'était un séjour idéal, un nid d'amoureux comme on n'en voit qu'en rêve. Ils se réjouissaient à la pensée que la location se conclurait sans doute pour le premier mai. Et, déjà, ils faisaient les projets les plus délicieux: ils reprendraient leurs promenades à cheval, Elle montant Tunis et Lui Jupiter; ils feraient, tous les matins, des baignades en pleine mer; ils se laisseraient bercer dans une barque, sur les flots argentés par le clair de lune...
Mme Marguerite eut un mauvais accès de toux. Une grande tristesse s'empara de moi. Le général s'en aperçut et m'en demanda la cause. Que lui répondre?...
«Mon général, lui dis-je, vous me voyez chagrine, car il me faudra bientôt partir, et j'aurais eu tant de bonheur à être encore là pour vous installer tous deux dans le nid que vous vous êtes choisi.»
Ces longues promenades en voiture, qu'ils faisaient tous les jours, prenaient le meilleur de la journée. En rentrant, le général passait dans son bureau, s'entretenait un peu avec son secrétaire, M. M..., recevait quelques visiteurs, le plus souvent des touristes désireux de lui être présentés, puis se hâtait de rejoindre Mme Marguerite. Ils causaient ensemble et lisaient, aux deux côtés de la cheminée, jusqu'à l'heure du dìner, et ils reprenaient la causerie, après dìner, jusque vers minuit. Ils se levaient aux environs de dix heures du matin. Le général restait à son bureau une heure ou deux, expédiait quelques lettres, recevait parfois d'autres visiteurs, et allait offrir son bras à Mme Marguerite pour la conduire à déjeuner. Après quoi, on partait en promenade.
En somme, existence d'officier retraité qui contrastait du tout au tout avec celle que le général avait si longtemps menée.
Ce changement n'était pas sans réagir sur son état d'esprit. Il avait généralement bonne humeur, bonne mine, bon sommeil, excellent appétit, mais, n'empêche qu'à l'observer de plus près, il apparaissait un peu—comment dirai-je?—un peu alourdi par ce genre de vie insuffisamment actif.
Il causait beaucoup, mais parlait surtout de l'ìle ou bien disait de bonnes choses câlines à Mme Marguerite, et il abordait rarement des sujets plus sérieux. Je me souviens qu'un jour, au retour de courses de chevaux où il m'avait menée, où Mme Marguerite avait tenu à parier et où elle avait perdu, un colporteur courut à notre voiture et nous tendit des images qu'il vendait. Mme Marguerite les prit pendant que le général jetait une pièce blanche à cet homme. C'étaient des images d'Epinal qui reproduisaient les traits du comte de Paris, du duc d'Orléans et divers épisodes de leur vie, y compris l'audience de la 8e Chambre correctionnelle et la prison de Clairvaux.
Un portrait du jeune duc était accompagné de cette phrase: «La prison est moins dure que l'exil, car, la prison, c'est encore la terre de France!»
Un autre portrait le représentait en pioupiou, l'arme au pied, avec cette inscription en lettres tricolores:
«Le premier conscrit de France.»
«Encore ce petit duc!» fit Mme Marguerite, d'un ton de dépit.
Le général lui prit les gravures des mains, les considéra longuement, les sourcils un peu froncés, puis, les ayant froissées en boule, les jeta sous les roues de la voiture, sans prononcer une parole.
Une autre fois, la conversation tomba sur M. D... Le général y mit fin aussitôt, d'un ton qui montrait que ce sujet lui était pénible. Mais j'en avais assez entendu pour comprendre que l'on s'était brouillé au moment où M. D... avait été invité à fournir ses comptes. Mme Marguerite me confia un peu plus tard qu'il y avait eu, dans la caisse boulangiste, un «coulage» d'un million ou deux.
La seule entreprise dont le général se préoccupât vivement était la prochaine élection pour le renouvellement du Conseil municipal de Paris. Il y songeait sans cesse et escomptait la victoire comme certaine.
En vue du résultat qu'il entrevoyait, il se disposait à mobiliser toutes ses ressources: car il entendait faire lui-même les frais de ces élections. Le Comité boulangiste devait venir dans les premiers jours d'avril en conférer avec lui.
Quant à Mme Marguerite, elle supportait avec l'apparence de la plus grande sérénité cette vie de Jersey, où les journées se passaient invariablement, pour elle, à causer avec le général et avec moi, à faire un peu de broderie, un peu de lecture, et à écrire des lettres. Elle ne laissait voir aucun désir d'y rien changer et elle se montra inébranlable chaque fois qu'il m'arriva, étant seule avec elle, de lui rappeler ce que lui avait demandé le docteur.
Cependant, elle n'était pas sans éprouver quelquefois une inquiétude secrète pour l'avenir... Jamais je ne m'en suis mieux aperçue qu'un dimanche où je fus assourdie par des litanies entrecoupées d'une musique aigre et discordante, dont le bruit arrivait jusque dans ma chambre, située pourtant sur la cour. J'entrai dans leur appartement, pour regarder par une fenêtre ce qui se passait. Le bureau du général était vide: je me mis à la croisée ouverte, et j'aperçus l'Armée du Salut qui se démenait sur le quai, devant l'hôtel. Je me retournai, et à ce moment je vis, à travers la porte dont le rideau était un peu écarté, Mme Marguerite, dans sa chambre, agenouillée devant le crucifix d'ivoire suspendu près de son lit, les mains jointes, immobile comme une statue de cire, le regard fixe et les yeux tout débordants de larmes. Je fis un mouvement pour me retirer; elle tressaillit, m'aperçut et se leva, rougissante. Je lui demandai pardon de l'avoir involontairement troublée dans sa dévotion.
«Vous êtes toute pardonnée, fit-elle. Je suis, comme vous, une croyante... Hélas! ne suis-je pas en état de péché mortel?... Alors, je prie Dieu et je demande à sa miséricorde de m'accorder encore la force de vivre du moins jusqu'au jour où j'aurai cessé d'être une pécheresse...»
Ce souci de mettre son cœur d'amante en règle avec sa conscience de chrétienne la préoccupait beaucoup. Elle redoublait d'efforts pour faire aboutir la procédure qu'elle avait intentée en cour de Rome. Comme l'instruction de l'affaire s'éternisait, elle avait fini par s'adresser à un personnage de là-bas dont on lui avait vanté l'habileté consommée en cette matière et l'influence très grande sur les décisions du Vatican. Après mûr examen de sa demande, ce personnage avait bien voulu se charger de la soutenir auprès de Notre Saint-Père. Le but poursuivi n'était plus seulement l'annulation de son propre mariage, mais aussi celle de l'union du général, sous prétexte qu'il avait épousé, sans dispense pontificale, sa cousine germaine. De la sorte, puisque le rejet de l'instance en divorce du général ne leur avait pas permis de s'unir légalement en France, ils pourraient du moins contracter un mariage religieux à l'étranger. Des dépêches chiffrées s'échangeaient sans cesse, longues parfois de plus de cent mots. Je devinais qu'il y avait aussi de gros, de très gros envois d'argent. Mais aucun sacrifice n'aurait semblé trop lourd à Mme Marguerite pour atteindre le suprême but de ses désirs: cette bénédiction du prêtre, cette sanctification de leur amour qui lui permettrait de retourner, l'âme tranquille, à confesse et à communion.
Rien que d'y songer, ses yeux brillaient, son visage s'illuminait. Quant au général, il préférait ne pas en parler, car il doutait... Ainsi, chacun d'eux caressait son illusion: elle, la réussite de cette entreprise, lui, le triomphe aux élections municipales de Paris...
Mme Marguerite avait encore d'autres préoccupations, dont elle ne se confiait pas même au général.
Elle écrivit, à son insu, plusieurs lettres qu'elle me fit porter à la poste, et elle en reçut quelques-unes adressées au nom de sa femme de chambre. Bien qu'elle ne fût guère loquace sur ces sujets, je compris qu'il y avait toutes sortes de micmacs avec la succession de sa tante; qu'il fallait compter avec deux co-héritiers; que la majeure partie de l'héritage était en rente inaliénable, d'où nécessité d'en revendre la nue propriété à perte pour se procurer immédiatement une centaine de mille francs. Je devinai quelque chose de plus: étant allée à Paris, de janvier à février, elle y a déchiré le testament par lequel elle avait institué légataire universelle la jeune femme dont elle aurait rêvé de faire sa fille adoptive et dont, ni elle, ni le général ne prononçaient plus le nom, tant ils avaient eu à souffrir de son ingratitude...
Que renferme son testament actuel? Cela ne fait aucun doute dans mon esprit... Son devoir, à elle, n'est-il pas de tout lui laisser,—quitte à lui de refuser?...
Sur ce point, elle ne m'a rien révélé, mais un jour elle a eu un mot qui m'a beaucoup frappée. Je venais de lui raconter comment les journaux avaient rapporté que Mme Boulanger faisait des économies pour réserver un morceau de pain à son mari quand il lui reviendrait, brisé par la vie...
Elle m'a regardée singulièrement, puis elle a dit, avec un sourire étrange:
«Rassurez-vous, il faudrait que je sois morte pour cela—et alors le général n'aura besoin de rien, ni de personne.»
Les jours s'étaient vite écoulés. La femme de chambre de Mme Marguerite était revenue de Bruxelles, sa mission accomplie, en sorte que ma présence ne leur offrait plus d'utilité. Ils auraient bien voulu me retenir quand même; malheureusement, ma sœur m'écrivait que notre mère était retombée malade, et cela me mettait sur des charbons ardents. Il fut donc convenu que je partirais le dernier jour du mois, un lundi. Mais, avant de m'en aller, je devais éprouver une émotion terrible.
C'était l'avant-veille de mon départ. Ils avaient des invités. Je leur avais demandé la permission de ne pas dìner avec eux, et, mon repas rapidement terminé, j'étais remontée dans leur appartement pour lire un roman de Loti qui m'enchantait, en attendant qu'ils remontassent eux-mêmes et que je puisse leur dire bonsoir. Je m'étais placée sur le divan de l'antichambre, un coussin sous la tête et le dos tourné à la porte donnant sur le couloir, que je n'avais pas refermée. J'étais tout absorbée dans ma lecture, quand subitement, dans la direction du couloir, j'entendis prononcer le nom du général et celui de Mme Marguerite, ce qui me forçait, presque malgré moi, de prêter l'oreille à ce qui se disait.
C'étaient la femme de chambre et son mari, le valet de chambre, qui, sans se douter de ma présence, causaient tranquillement chez eux, leur propre porte à demi ouverte. Le mari était phtisique au dernier degré; il se plaignait amèrement à sa femme de ce que Madame avait eu la pingrerie de ne pas lui payer sa dernière note de médecin, se montant à 500 francs. Là-dessus, les voilà qui se sont mis à dégorger tout ce que leurs âmes renfermaient à l'égard des maìtres.
J'avais eu, jusqu'alors, la naïveté de croire que ces gens-là, qui n'étaient sympathiques ni l'un ni l'autre, portaient, sinon de l'affection, du moins un dévouement absolu à Mme Marguerite. Elle les avait comblés de bienfaits. Elle les avait tirés de la misère la plus noire. Elle ne cessait d'abandonner à sa Delphine pour des milliers de francs de linge et de toilettes à peine portées. à l'hôtel, elle leur avait assigné, à côté de leur propre appartement, une chambre de façade avec vue sur la mer. Ils étaient servis aussi bien que leurs maìtres, et même mieux. Ils ne faisaient presque rien, mais ils empochaient des gratifications sans nombre. Et, quand ils avaient marié leur fille, Mme Marguerite lui avait fait une dot de 20.000 francs auxquels le général avait ajouté 150 louis d'or.
Ah! dans ce qu'ils étaient en train de se communiquer, ils apparaissaient joliment reconnaissants envers leurs bienfaiteurs! Eux, qui auraient dû baiser les pieds de leurs maìtres, ne trouvaient que des méchancetés à en dire: pis que des méchancetés, des objections tellement immondes que le cœur m'en battait à tout rompre de surprise et de douleur. Et, plus ils parlaient, plus leur perfidie éclatait, plus leur haine s'exaspérait. Leurs voix devenaient sifflantes, ils avaient des accents d'une férocité qui me glaçait jusqu'à la moelle. Ils se réjouissaient de tout ce qui arrivait de malheureux au général et à Mme Marguerite, de ses défaites à lui, de sa maladie à elle.
«Ah! la Margot, proféra le valet avec un rire démoniaque, la voilà malade comme moi maintenant!... Tiens, ça me fait rire aux larmes quand je l'entends qui crache sa poitrine...»
Le monstre!... Je voulais me lever pour aller lui vomir au visage son ignominie... Mais le cœur me battait trop violemment... La force me manqua... j'eus une sensation de vide... je perdis connaissance.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quand je revins à moi, j'étais à cette même place, Mme Marguerite me faisait respirer un flacon de sels et le général me tapait dans les mains. Ils poussèrent des cris de joie en me voyant rouvrir les yeux. Au même instant, la femme de chambre s'approcha de moi avec un verre d'eau... J'eus un soubresaut et je fis un geste que cette femme a dû comprendre, car, devenue très pâle, elle s'est retirée aussitôt et elle ne s'est plus, dès lors, montrée sur mon chemin.
Quand je fus tout à fait remise, le général et Mme Marguerite m'ont emmenée dans leur chambre, me pressant de questions sur la raison d'être de cet évanouissement dans lequel ils m'avaient trouvée, exsangue comme une morte. Je ne pus d'abord rien leur répondre d'autre que:
«Ah! si vous saviez!... Si vous saviez!...»
Et puis, que leur dire? Si j'avais eu le malheur de leur révéler ce que ces misérables avaient proféré sur le compte de Mme Marguerite, le général les aurait tués. Si j'avais seulement répété la centième partie de leurs propos infâmes, ils eussent été chassés sur l'heure. Je n'osais pas... Je finis par déclarer au général que ces gens-là avaient mal parlé de lui.
«Bon! s'écria-t-il, je comprends ce que vous voulez dire... C'est encore une paire de mouchards corrompus, n'est-ce pas?... Ah! vraiment, mon valet de chambre m'espionne, lui en qui j'ai eu confiance jusqu'à admettre son frère sur la liste de mes candidats investis, aux élections dernières!... Dire que j'allais encore l'envoyer à Paris avec un stock de lettres pour les élections municipales!... Je vous sais fameusement gré de m'avoir ouvert les yeux. Demain, le gaillard aura ses huit jours, et c'est vous qui me rendrez le service de porter ces lettres.»
Le lundi 31 mars, au matin, je suis entrée dans leur chambre pour leur faire mes adieux. Ils m'ont demandé affectueusement ce qu'il me serait agréable d'emporter comme souvenir.
«Un bijou, leur ai-je répondu. J'entends, le pendant du bijou que vous m'avez fait la joie de me donner à Londres.»
Ils ont souri et Mme Marguerite m'a dit:
«Voyez comme nos pensées se rencontrent... J'y avais songé et j'ai enveloppé hier soir ma photographie avec les lettres que voici, qui vous sont confiées par le général pour que vous les jetiez à la poste à Paris.
Et maintenant, dépêchez-vous, le bateau siffle pour le départ!»
Ils m'ont embrassée et, serrant dans mon sac à main le précieux paquet, j'ai couru au bateau, sur le point de lever l'ancre.
Nous voici à Granville. Le bateau est amarré, on va descendre. Je franchis la passerelle, suivie par un voyageur dont j'avais déjà remarqué les regards obstinément fixés sur moi. Il me serre de si près que je me retourne—juste à temps pour lui voir adresser un signe à un monsieur occupé à dévisager les arrivants et dans lequel j'ai deviné un commissaire de police. Je me rends à la douane avec tout le monde.
Puis, en toute hâte à l'hôtel, les passagers du bateau étaient déjà attablés.
Vers la fin du repas, un monsieur à barbe grisonnante, placé près de moi, me dit doucement:
«Madame, vous avez dû sans doute vous en apercevoir... Il m'a semblé remarquer que vous étiez suivie par des agents secrets.»
N'en était-il pas lui-même? à tout hasard, je lui répondis d'un air candide:
«Moi, Monsieur? Je vous demande excuse: ce serait plutôt vous. J'allais vous faire la même remarque. Il nous a bien semblé à tous que vous étiez filé.»
Le monsieur prit une expression vaguement inquiète.
Après déjeuner, je me promenai à travers la ville, jusqu'au train de cinq heures.
à Mantes, étant enfin restée seule dans mon coupé, je déballai le paquet. Il contenait exactement 70 lettres déjà toutes timbrées, adressées soit de la main du général, soit de celle de son secrétaire; plus une grande enveloppe blanche cachetée. L'ayant ouverte, j'en retirai d'abord une lettre sur l'enveloppe de laquelle Mme Marguerite avait écrit: à remettre de suite à ma concierge, 39, rue de Berry.
Je sortis enfin la photographie, que j'examinai longuement.
La voilà telle qu'Elle était il y a deux ans et demi, quand je l'aperçus pour la première fois, et même il n'y a que six mois, à mon départ de Londres! Son buste de déesse se trouve merveilleusement moulé dans une toilette de soirée que je me souviens lui avoir vue à Royat, lors de son second voyage: une toilette en velours héliotrope, avec panneaux soutachés d'or et garnis de pampilles dorées. Ses magnifiques bras sont nus, sans un bracelet ni une bague. La main droite s'appuie sur un vase à fleurs, la main gauche tient un éventail en plumes d'autruches noires à manche d'ébène et à ferrure d'or surmontée de la couronne vicomtale. Au corsage, un immense saphir entouré de diamants, cadeau du général. Dans les cheveux, un diadème en brillants. Dieu, à quel point elle est éblouissante,—ou plutôt, hélas! à quel point elle le fut!
«Paris, gare Montparnasse!» Il est quatre heures du matin. Je décide de jeter immédiatement à la poste les lettres du général, mais en me jurant de rendre fameusement dure la tâche de quiconque voudrait me suivre. Je commence par me faire conduire directement à la gare de Lyon et par y déposer mes bagages en consigne, ne gardant avec moi que mon sac à main. Le jour va bientôt poindre. Rassurée par les équipes de balayeurs qui sillonnent la chaussée, je descends à pied jusqu'à la place de la Bastille, j'avale un bol de lait chaud dans la première crémerie que je trouve en train d'ouvrir et, devant le Restaurant des Quatre-Sergents de La Rochelle, je hèle un second fiacre. Il m'arrête à plusieurs bureaux de poste où je jette une partie de mes lettres. Je le lâche aux Halles et j'y achète une splendide gerbe d'œillets à l'intention de Mme Marguerite. Je me rends de ce pas à Notre-Dame; j'assiste au premier office du matin. En sortant, je retiens une troisième voiture, qui me mène à d'autres bureaux de poste et que je quitte place de la Bourse. J'en prends une quatrième sur le boulevard en donnant ordre de me conduire 25, rue de Berry. Je mets à la poste, en route, les dernières lettres qui me fussent restées. Arrivée à destination, je paye le cocher et je me glisse à travers la porte à peine entr'ouverte. J'aperçois, au fond d'une cour, un domestique à favoris, le plumeau à la main. Allant vers lui, je lui demande carrément:
«Monsieur le Marquis de Montorgueil, s'il vous plaìt?»
Ahuri, il me répond qu'il ne connaìt personne de ce nom. Mais je fais la sourde oreille et j'insiste, afin de laisser à la voiture le temps de filer. Alors ce valet, fixant ma coiffe, est devenu familier:
«Ma petite Bretonne, il faut en prendre votre parti... Ça n'a jamais habité par ici: c'est ce que nous appelons, à Paris, le coup du lapin!»
Le laissant ricaner tout à son aise, je suis ressortie. La rue était vide. Au bout d'un instant, j'étais au numéro 39, une grande et belle maison, tout à fait digne de Mme Marguerite. J'ai remis sa lettre après avoir causé avec la concierge assez longtemps pour être sûre que je ne commettais pas d'erreur sur la personne. Il n'y avait plus de temps à perdre: j'ai vite pris une rue conduisant à l'avenue des Champs-Élysées, où j'ai sauté dans une voiture—et, fouette, cocher, pour la gare de Lyon! à neuf heures du matin, je partais pour Clermont, et à sept heures du soir j'étais rentrée chez moi. Un chagrin m'y attendait: ma pauvre mère est bien mal.
178.—Vendredi 11 avril.
Faut-il que j'ai été angoissée par la crise que vient de traverser ma pauvre mère, pour avoir négligé jusqu'à ce jour de leur écrire! Je l'ai fait aujourd'hui, et je leur ai envoyé aussi de nos fruits confits d'Auvergne, surtout de ces cerises au sucre que Mme Marguerite aimait tant à croquer, aux jours, lointains déjà, où ils étaient mes hôtes.
179.—Vendredi 18 avril.
Je viens de recevoir la réponse de Mme Marguerite:
«Mardi 15.
»Ma bonne Meunière,
»Nous commencions à trouver votre silence bien long et nous nous en tourmentions. C'était, en effet, pour une triste raison que vous ne nous écriviez pas. Heureusement, cette cause n'existe plus et voilà votre mère, j'en suis sûre, en pleine convalescence.
»Oui, ma bonne Meunière, nous avons la maison de Saint-Brelade. Pensez si je suis contente!... Nous devons nous y installer le 26, c'est-à-dire dans dix jours. Je les compte, tellement j'ai hâte de quitter cet hôtel et d'être chez nous.
»Ces infâmes A... sont partis depuis huit jours. C'est un vrai bonheur pour moi. Je suis enchantée de la nouvelle femme de chambre que j'ai. C'est une travailleuse, très soigneuse, très attentionnée, très avenante. Cela nous change.
»Savez-vous, ma bonne Meunière, que vous venez de nous gâter horriblement. Nous avons reçu hier une caisse pleine de bonnes choses...
»J'ai déclaré qu'on n'en mangerait qu'une fois qu'on serait à Saint-Brelade... Nous vous remercions beaucoup, beaucoup de cet envoi.
»Je vais toujours mieux, je mange mieux, je tousse moins et mon ventre continue à diminuer. Je suis sûre qu'une fois là-bas, je me guérirai tout à fait.
»Au revoir, ma bonne Meunière, nous avons été bien, bien contents de vous avoir pendant quelques jours, car vous savez que nous vous aimons bien. Vous nous reviendrez dès que votre saison sera finie. Le général et moi, nous vous embrassons de tout cœur.
»Vtesse DE B...»
Voilà de bonnes nouvelles: la disparition des deux misérables, la location de Saint-Brelade!
à Paris, la lutte électorale devient de plus en plus ardente pour le scrutin du 27. Dans chaque quartier, c'est un corps à corps désespéré entre le boulangisme et ses adversaires.
180.—Lundi 28 avril.
Quel désastre! Qui aurait pu prévoir qu'ils ne seraient même pas vingt, pas dix, pas cinq, pas deux, et qu'il n'y aurait, au vote d'hier, qu'un boulangiste, un seul, d'élu!
Et c'est pour aboutir à cela que le Comité boulangiste a retenu dans la lutte, malgré lui, le général qui avait eu la sagesse de vouloir l'abandonner dès l'échec des grandes élections de septembre!
Malheureux général! Ils lui en avait conté tant et tant, dans son ìle d'exil, ses soi-disant amis politiques, qu'il avait fini par reprendre de l'espoir... Quelle confiance on était arrivé à lui inspirer dans la fidélité de ses électeurs parisiens, «de ses meilleures troupes», ainsi qu'il disait avec orgueil!
...C'est donc avant-hier qu'ils se sont installés à Saint-Brelade. Ah! la triste pendaison de crémaillère!
181.—Vendredi 2 mai.
Le Comité boulangiste s'est rendu à Jersey afin de tenir conseil avec le général. On donne à entendre que des décisions extraordinaires pourraient sortir de cette entrevue. On ne parle de rien moins que de la rentrée du général avant le second tour de scrutin, c'est-à-dire demain au plus tard.
182.—Lundi 5 mai.
Le désastre est complet. Le second tour de scrutin a parachevé l'œuvre du premier. Hier encore, il n'y a eu qu'un seul boulangiste élu, ce qui porte le total à deux. Voilà pour le Conseil municipal de Paris: quant aux conseillers généraux de la banlieue, tous les élus sont antiboulangistes.
Je ne sais ce que pensent et disent les boulangistes demeurés fidèles, je ne sais même pas s'il s'en trouve encore, car je n'en vois plus trace autour de moi. C'est maintenant le lâchage universel: tout le monde tourne casaque, tandis que les ennemis du général affectent des airs de toréadors foulant aux pieds la bête abattue.
Quant à moi, qui ai la naïveté de ne pas comprendre que les revers de fortune puissent rien changer à l'amitié, et qui viens d'écrire au général qu'il pouvait et devait, demain comme hier, compter sur mon absolu dévouement, je comparerai son histoire politique à l'évolution d'une belle étoile.
Elle gravitait dans la nuit quand tout à coup elle est apparue, scintillante, sur le firmament parisien, un jour radieux de 14 juillet. Elle a rapidement grandi, inquiétant bientôt ceux que son éclat aveuglait, mais émerveillant les autres, ceux qui la trouvaient belle parce qu'elle promettait de devenir grande comme un soleil, comme le soleil d'Austerlitz...
Et c'est ainsi qu'un soir de janvier la comète est arrivée à remplir tout le ciel de son panache d'or. Puis elle s'est mise à décroìtre, à descendre rapidement vers le néant. La fuite, la Haute-Cour, puis la défaite en province, commencée par les élections des Conseils généraux, consommée par les grandes élections du mois de septembre: voilà les échelons de la descente. Enfin, l'effondrement final de Paris.
Adieu, belle étoile! Ta descente est achevée!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
183.—Jeudi 22 mai.
Le Comité boulangiste n'est plus. Il a terminé hier son inutile existence, remplie surtout de manifestes très creux et de notes à payer très chargées. De Profundis!
La France n'aura pas une larme de regret.
184.—Vendredi 6 juin.
La cage de Clairvaux s'est ouverte, le jeune duc d'Orléans a été rendu à son papa.
J'ai de nouveau écrit, aujourd'hui, à Saint-Brelade, non sans féliciter le général d'être enfin débarrassé de son Comité.
185.—Mercredi 25 juin.
Une longue et très curieuse lettre de Mme Marguerite:
«Dimanche 22 juin.
»Vous n'êtes pourtant pas, j'en suis sûre, ma bonne Meunière, dans ceux qui abandonnent quand le succès tarde à venir... et pourtant, vous agissez un peu comme si vous n'étiez plus boulangiste... Votre silence nous fait de la peine et, vous voyez, nous fait penser sur vous de bien vilaines choses. Écrivez-nous vite et nous vous pardonnerons.
»Nous sommes installés à Saint-Brelade depuis deux petits mois et nous nous y trouvons à merveille. Ma santé, à ce bon air, s'est tout à fait remise. Je ne tousse presque plus. J'ai retrouvé ma taille d'autrefois. Je mange beaucoup. Somme toute, je me porte à merveille. Nous avons avec nous la mère et la cousine du général. Nous sommes donc entourés, avec les bons amis qui viennent nous voir, d'une façon très douce. Nous ne sommes donc ni malheureux, ni découragés par les trahisons dernières. Nous pensons, au contraire, que cela fera du bien au parti.
»Le général n'ayant plus son Comité qui lui a fait plus de mal que de bien, va reprendre toute sa popularité, popularité qu'il a acquise sans son Comité... Il travaille donc beaucoup et espère très fort dans l'avenir. Dites bien cela tout autour de vous, aux amis comme aux ennemis. Dites-leur que le général a gardé toute sa confiance, qu'il est sûr que d'ici peu le peuple se ressaisira et verra qu'il a été trompé, qu'il l'est encore, comme il est affreusement volé. Il se rappellera alors celui qui a voulu le rendre heureux et prospère et la France entière demandera le général à grands cris. Pour que cela arrive le plus vite possible, il ne faut pas que le général travaille seul. Il faut que nous l'aidions tous.
»Je viens donc vous demander votre concours et vous dire qu'il faut faire beaucoup de propagande à un nouveau journal qui va paraìtre d'ici peu, La Voix du Peuple, et qui sera le journal du général. Nous vous en ferons envoyer beaucoup d'exemplaires et des circulaires, ainsi qu'une lettre du général écrite à la direction de ce journal. Il faut, ma bonne Meunière, vous atteler à cette propagande et trouver un grand nombre d'abonnés. Ce journal ne paraìtra qu'une fois par semaine et ne coûtera que 6 francs par an, donc, pas trop cher pour les petites bourses. Il fera, je crois, beaucoup de bien au parti et sera en même temps très intéressant. Vous êtes très intelligente, très dévouée, vous aimez de tout cœur notre général: travaillez donc beaucoup pour ce journal. Vous êtes à même, surtout pendant la saison de Royat, de le faire avec succès. Faites de la propagande également à Clermont. C'est dit, n'est-ce pas, nous comptons sur vous...
»Le général se porte à merveille, il engraisse même beaucoup. Dès que votre saison sera finie, vous viendrez en juger par vous-même. Nous espérons que votre mère va bien et que ce n'est pas sa santé qui est cause de votre silence. Allons, écrivez-nous vite, et à bientôt.
»Nous vous embrassons de tout notre cœur.
»B. B.
» Le général fait envoyer également des exemplaires à M. B... Dans votre propagande, ne vous occupez donc pas de lui. Mais travaillez ferme. Hélas! ces malheureuses élections ont coûté deux fois plus cher que je ne le pensais.»
Je lui ai répondu immédiatement,—par lettre chargée, puisque de nouveau mes deux dernières missives ne leur sont pas arrivées en mains... Je lui ai promis de m'employer de toutes mes forces à la propagande qu'ils voulaient bien me confier.
Je n'attends plus que le journal annoncé. Mais je tremble que, dans la situation actuelle, les résultats possibles ne soient en disproportion absolue avec l'effort déployé...
186.—Dimanche 6 juillet.
La Voix du Peuple m'est parvenue. Je m'attendais à un grand journal, ou alors à une sorte de revue, comme il en paraìt tant à Paris une fois par semaine. Quelle déception en recevant cette mince gazette, identique par le format et l'apparence à la plus modeste des feuilles d'intérêt local qui se publient dans nos chefs-lieux de canton!
Je suis désolée. Autant vouloir placer les actions d'une maison de crédit en pleine déconfiture!
187.—Mercredi 16 juillet.
«On nous informe, de Jersey, que l'amie du général Boulanger a été atteinte d'une fluxion de poitrine. L'état de Mme de Bonnemain, après avoir inspiré d'assez vives inquiétudes aux hôtes de Saint-Brelade, est maintenant tout à fait rassurant.»
Quand cet entrefilet m'est tombé sous les yeux, cette après-midi, vite, j'ai écrit au général, le suppliant de me tranquilliser. Je venais justement d'envoyer, ce matin, mes fleurs pour la Sainte-Marguerite.
188.—Dimanche 24 août.
Après la défaite, la trahison: c'était fatal. Il s'agissait seulement de savoir qui aurait le triste courage de trahir le premier. Judas vient de sortir du rang. Bien qu'il ait encore un masque sur le visage, il est sûrement un de ceux qui formèrent le Comité du général, qui reçurent ses confidences et qui partagèrent ses secrets.
De tout ce qui se disait et se faisait, il a recueilli jusqu'aux dernières miettes: puis, quand les revers furent arrivés, quand il fut bien sûr qu'il n'aurait plus rien à retirer de l'entreprise, ni rien à craindre du maìtre proscrit, il a porté tout cela au journal qui pourrait le plus cher payer sa honte, et il la lui a vendue.
Le scandale produit par l'apparition de ces «Coulisses du Boulangisme», dans le Figaro, est sans nom.
189.—Mardi 26 août.
Enfin, j'ai pu me procurer le numéro du Figaro, introuvable depuis deux jours, autour duquel tous les journaux mènent un tel tapage à cause des révélations qu'il contient sur Mme X...
Pauvre Mme X...! Il lui a été fait la faveur d'un chapitre entier.
Ah! comme Mme Marguerite a dû cruellement souffrir en lisant ces lignes dont chaque mot est un coup de lancette qu'on lui porte en plein cœur! Quels tourments affreux elle doit éprouver à cette heure même, en songeant que partout, dans l'univers entier, chacun va avoir sous les yeux cet article infâme qui la classe sans façon parmi les maìtresses et les bonnes fortunes du général, qui parle de leur amour si sacré comme d'une liaison publique et affichée, qui lui reproche textuellement de n'avoir pas été le conseiller éclairé et énergique qu'il eût fallu au général, de n'avoir pas été ambitieuse pour lui, d'avoir obéi à des sentiments ordinaires, d'avoir été une amoureuse égoïste, de lui avoir fait tout sacrifier et d'avoir été l'obstacle à sa fortune; qui, bien plus, l'accuse d'avoir préparé et excité le général à la fuite, et qui, prétendant pénétrer dans le secret de son âme, ose insinuer qu'en elle-même cette fuite a dû la réjouir!
Monsieur X..., qui que vous soyez, il y avait un chapitre que, pour tout l'or du monde, vous ne pouviez pas, vous ne deviez pas écrire! Une chose au moins aurait dû vous toucher: un peu de pitié envers un pauvre être souffrant, miné déjà par une maladie terrible, et que vos révélations peuvent faire mourir...
190.—Mardi 2 septembre.
Ce que je redoutais tant se réalise. Je viens de lire dans un journal que Mme de B... aurait eu une rechute très grave.
Affolée, j'ai couru à Clermont et j'ai télégraphié au général:
Vous supplie envoyer nouvelle santé. Attends réponse anxieusement.
191.—Samedi 6 septembre.
Grâces soient rendues au ciel! La nouvelle était fausse et mon alarme vaine. Voici ce que m'écrit Mme Marguerite elle-même:
«Mercredi 3 septembre.
»Ma bonne Meunière,
»Vous venez de rester bien longtemps sans nouvelles de nous, mais cela n'est pas tout à fait notre faute. J'ai été bien malade tout le mois de juillet, ayant bêtement attrapé une grosse pleurésie. Mais, grâce à Dieu, cela n'était pourtant pas aussi grave que ce que les journaux ont bien voulu dire, et la preuve, c'est que je suis maintenant absolument guérie et même mieux portante que quand nous avons eu le bonheur de vous voir, ma bonne Meunière. Si, ensuite, je ne vous ai pas écrit au mois d'août, c'est que nous avons eu tellement de monde—nous en avons encore beaucoup, du reste...—que, vraiment, je n'ai pas, tout en le regrettant beaucoup, trouvé le temps de vous dire que nous vous aimons toujours bien. Hier, nous avons reçu votre dépêche, et, vous voyez, quoique très prise, très occupée, nous y répondons, car nous vous aimons bien et nous espérons bien vous revoir bientôt.
»Quand finit votre saison? Quand serez-vous libre? Nous pensons que vous pourrez venir nous faire une petite visite vers le 15 octobre. Dans ce bon espoir, nous vous embrassons tous les deux de tout cœur.
»Bien à vous.»
192.—Vendredi 3 octobre.
Le mois de septembre s'est achevé, mais la «lessive boulangiste» ne semble pas vouloir toucher à sa fin. Quelle lessive, bonté divine! De mémoire d'homme, je crois qu'on n'a jamais assisté à pareil entre-croisement de polémiques, de démentis, d'altercations personnelles, de duels, de procès-verbaux, de lettres de témoins, le tout agrémenté de la collection la plus complète qui se puisse imaginer d'outrages de toute espèce. C'est une mêlée générale où se confondent tous les partis.
193.—Lundi 27 octobre.
Mme Marguerite ne m'ayant pas encore répondu au sujet de mon voyage à Saint-Brelade, qu'elle m'avait fait espérer, dans sa dernière lettre, pour le 15 de ce mois, je viens de leur écrire que j'attends leurs ordres.
194.—Mardi 25 novembre.
L'hiver est précoce cette année. Nous avons eu de la neige en masse. Il gèle. Je ne cesse de penser au temps qu'il peut faire là-bas, sur le bord de l'Océan, à Saint-Brelade, et au contre-coup que ces froids peuvent avoir pour la santé de Mme Marguerite. Je viens de leur récrire.
195.—Samedi 6 décembre.
Reçu, enfin, une lettre de Mme Marguerite:
«Mardi 2 décembre.
»Ma bonne meunière,
»Pour sûr, vous devez avoir de la peine de notre silence et croire que nous ne pensons plus à vous... Voilà qui serait mal à vous... Nous vous aimons toujours si bien que nous pensons que vous allez vous arranger pour nous venir bientôt. Je suis sûre que cela vous fera plaisir de revoir le général bien portant, gras, gai et ayant plus de confiance et d'espoir que jamais. Moi, vous me trouverez également beaucoup mieux. J'ai été dernièrement à Paris—une des causes de mon long silence,—et, là, j'ai consulté les plus grands médecins. Ils ont tous déclaré que je n'avais absolument rien qu'une toux nerveuse et que mes poumons étaient très bons. Je tousse encore, mais par quintes. Quand à mon estomac, il est remis et j'ai repris, avec même un peu de maigreur, mes mesures d'autrefois. Vous voudrez voir tout cela bien vite, n'est-ce pas? Bien entendu, si vous nous dites que vous pouvez venir, nous vous renseignerons comme pour les autres fois.
»Une autre raison de mon silence, c'est que nous venons de passer quinze jours à Londres. Vous voyez que je me porte bien pour faire tout cela... Nous y avons fait un très agréable séjour. Nous venons d'avoir un temps très froid ici et beaucoup de neige. Je pense que vous ne devez pas avoir très chaud chez vous. Comment va votre mère? J'espère que sa santé ne vous empêchera pas de venir. Le général et moi nous vous embrassons de bonne amitié.
»Vtesse DE B...»
196.—Jeudi 1er janvier 1891.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Le premier janvier de l'année passée était déjà bien triste pour lui, et cependant c'était avant le désastre des élections municipales, c'était avant les «Coulisses du Boulangisme», et c'était avant sa maladie, à Elle!
Elle! Voilà tout ce qui lui reste, aujourd'hui, dans l'écroulement de tout ce qu'il rêvait. Voilà le seul lien qui l'attache encore à la vie.
Je me demande avec angoisse ce que sera le jour de l'an prochain!
197.—Lundi 12 janvier.
J'ai reçu la réponse aux deux lettres que je leur avais envoyées, le mois dernier et au jour de l'an:
«Jeudi 8.
»Ma bonne Meunière,
»Nous avons été bien heureux de vos bonnes lettres, surtout de la dernière qui nous dit que vous êtes rassurée sur la santé de votre sœur... Nous pensons bien souvent à vous et nous avons grand désir de vous revoir. Nous vous dirions d'arriver tout de suite, si nous n'attendions pas quelques amis. D'ici une quinzaine, je vous écrirai la date à laquelle nous aimerions vous voir arriver—et nous nous en réjouissons à l'avance. Malgré l'hiver absolument rigoureux que nous avons, je ne me porte pas trop mal. Quant au général, il se porte à merveille, car il sait n'avoir jamais voulu que le bien de la France et le bonheur du peuple. Puis, il a confiance. Écrivez-nous, dites-nous ce que vous entendez dire au sujet de la politique, car il faut tout savoir, tout connaìtre.
»Nous désirons que votre mère aille le mieux possible. Nous vous souhaitons ce que vous désirez, d'autant plus que mon cœur me dit que ce que vous désirez le plus, c'est son retour en France!... C'est notre désir le plus grand, qui ne tardera pas, j'en suis sûre!...
»Nous vous embrassons bien fort, comme nous vous aimons.
»B. B.»
J'ai répondu sur-le-champ,—mais, quant à la politique, je me suis contentée d'écrire que la santé des miens m'avait préoccupée à tel point que je n'ai plus causé avec personne, ni lu aucun journal, depuis des semaines.
D'ailleurs, qu'aurais-je eu à leur dire qui pût les intéresser? Des mensonges? Je n'en ai pas le courage. La vérité? Ce serait encore pire! La Voix du Peuple n'y a rien fait: le boulangisme est bien mort, sans résurrection possible. Le regain d'actualité que lui avaient donné les scandales est lui-même tombé. Les polémiques se sont éteintes et l'on ne reparle plus du général que de loin en loin, comme d'un personnage historique dont l'aventure se voile déjà dans la brume du passé.
198.—Lundi 9 février.
Nouvelle lettre de Mme Marguerite et nouvel ajournement de mon voyage, remis de mois en mois depuis octobre:
«Jeudi 5 février.
»Ma bonne Meunière,
»Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, c'est que nous venons d'avoir, pendant trois semaines, plusieurs amis. Nous en attendons d'autres pour tout ce mois-ci. Cela nous désole beaucoup parce que cela nous force à reculer votre venue. Mais, heureusement, une chose nous console, c'est que, puisque nous sommes malheureusement forcés de vous retarder d'un mois, nous allons vous retarder de six semaines... Nous vous demandons de nous arriver entre le 20 et le 25 mars!... Hein, vous n'y comprenez plus rien?—Voilà: c'est que, venant à cette époque, outre le grand plaisir que nous aurons à vous revoir, vous pourrez nous être utile. Mais, pour cela, il faudra que vous nous restiez au moins quinze jours, trois semaines, peut-être plus... Voilà ce qui nous fait plaisir! Arrangez-vous donc pour nous arriver vers le 20 ou le 25 et nous rester le plus longtemps possible. C'est entendu, n'est-ce pas?
»Le général a été, l'autre semaine, un peu souffrant d'un torticolis. Mais il est, maintenant, tout à fait guéri. Moi, je vais mieux, tout en n'ayant pas encore une santé bien robuste. Écrivez-nous bien vite que nous pouvons compter sur vous pour fin mars et que vous vous arrangerez pour laisser votre maison le long temps que nous vous réclamerons.—Quel hiver affreux vous avez dû avoir... Ici, pour le pays, il a été terrible: mais, chez vous, quelles misères il y a dû avoir...
»Au revoir, ma bonne Meunière, nous vous affectionnons bien, nous vous embrassons et nous vous disons: dans six semaines, pour longtemps.
»B. B.»
Je suis de plus en plus inquiète par les nouvelles qu'elle m'envoie sur son état. Dans sa dernière lettre, elle me disait: «Je ne me porte pas trop mal.» Maintenant, elle m'écrit: «Je vais mieux, tout en n'ayant pas encore une santé bien robuste.» J'ai relu un vieux paquet de lettres d'un parent qui s'en est allé de la poitrine, dans le Midi. Chaque fois, il se sentait un peu mieux. Ce fut ainsi jusqu'à la fin...
199.—Jeudi 26 février.
On m'a montré un journal qui annonce que Mme de Bonnemain, venue à Paris il y a quelques jours, a été atteinte d'une pneumonie.
J'allais courir à la gare, partir pour Paris, si les miens ne m'avaient suppliée d'attendre au moins la confirmation de la nouvelle, en me rappelant les faux bruits qui m'avaient déjà alarmée au début de septembre.
Je me suis donc résignée à écrire seulement. Mais où? En quel endroit est-elle descendue? Sans doute chez elle, rue de Berry. J'y ai envoyé une lettre et une autre à Saint-Brelade.
200.—Vendredi 13 mars.
Bien que nous soyons un vendredi et un 13, c'est une bonne journée, puisqu'elle a mis fin aux angoisses qui me tourmentaient depuis deux semaines. La lettre, venue de Belgique, que j'ai reçue de Mme Marguerite, me rassure un peu, tout en confirmant la nouvelle publiée par les journaux.
hotel de bellevue
bruxelles
«Mercredi 11.
»Ma belle Meunière, il y a une dizaine de jours, nous vous avons écrit afin que vous ne soyez pas trop tourmentée par la lecture des journaux!... Avez-vous reçu cette lettre?... Selon toutes les probabilités, nous croyons qu'elle n'a pas dû vous parvenir. Je vous racontais qu'ayant été obligée d'aller à Paris, il y a maintenant trois semaines, j'ai été prise, à Paris, d'une congestion pulmonaire. Le général, vous comprenez, s'est affolé de me sentir malade loin de lui. Moi également, j'en étais si malheureuse que cela augmentait ma fièvre, et les médecins ne voulaient pas me laisser retourner à Jersey. Heureusement, le général a eu la bonne pensée de Bruxelles. J'ai pu faire ce petit trajet et nous nous sommes retrouvés ici.
»Je vais beaucoup mieux. Je suis admirablement soignée et je pense que, d'ici huit à dix jours, je pourrai—nous pourrons—rentrer à Saint-Brelade. Dès que nous y serons, nous vous en préviendrons et vous pourrez nous arriver. Donc, à bientôt, ma belle et bonne Meunière. Nous vous embrassons bien fort.
»B. B.
»Écrivez à Monsieur Bertin,
Hôtel de Bellevue, Bruxelles,
Belgique.
»Mettez votre lettre au chemin de fer.»
Quel drame révèlent ces quelques lignes: «Le général s'est affolé de me sentir malade loin de lui. Moi, également, j'en étais si malheureuse que cela augmentait ma fièvre, et les médecins ne voulaient pas me laisser retourner à Jersey!...» Il me semble y assister: Elle, couchée, presque mourante, Lui, fou de douleur, là-bas, envoyant dépêche sur dépêche et déjà prêt à partir pour Paris...
Que serait-il arrivé, mon Dieu, si elle n'avait pas eu la force de se faire transporter à Bruxelles! Il serait accouru auprès d'Elle. On aurait eu la férocité de l'emprisonner, et l'univers aurait assisté à ce dénouement effroyable: l'amante tuée par le chagrin et l'amant frappé de démence par le désespoir ou se tuant lui-même, après avoir épuisé en quelques heures tout ce qu'un homme peut souffrir.
201.—Mercredi 25 mars.
Je pars ce soir pour Saint-Brelade. J'ai reçu cette lettre à midi:
hotel de bellevue
bruxelles
«Dimanche 22 mars.
»Ma bonne Meunière,
»Je vais mieux et nous partons après-demain, mardi, pour Jersey. Nous y serons jeudi matin. Vous allez donc pouvoir, vous aussi, partir et nous rejoindre dès le lendemain de notre retour. Vous aurez cette lettre mardi ou peut-être seulement mercredi matin. Ne perdez pas votre temps, car il faut que vous quittiez Clermont dès mercredi soir, c'est-à-dire le soir du même jour où vous aurez cette lettre, si vous ne l'avez que mercredi. Donc, mercredi soir 25, vous partirez de Clermont pour Paris. Vous y serez jeudi matin, vous vous ferez conduire gare Montparnasse. Là, vous pourrez vous reposer dans une salle d'attente, déjeuner, et vous prendrez, pour Saint-Malo, le train qui part à 11 heures 30 du matin.
»Donc, vous prenez, jeudi 26, à 11 heures ½ du matin (onze heures et demie), le train pour Saint-Malo. Vous y arriverez après être restée deux heures à Rennes pour y dìner.—Vous arriverez, dis-je, à Saint-Malo à 10 heures 42 du soir. Là, vous prendrez un omnibus et vous vous ferez conduire directement au bateau partant pour Jersey à 5 heures 45 du matin, vendredi 27. Vous demanderez le salon des dames et là vous vous coucherez. Cela sera beaucoup moins fatigant que d'aller à l'hôtel et de vous lever à 4 heures du matin, et ainsi, également, vous ne risquez pas de manquer le bateau. Vous serez vers neuf heures à Jersey et là vous trouverez la voiture que vous reconnaìtrez bien, n'est-ce pas?...
»Avez-vous bien tout compris, ma bonne Meunière? Oui, n'est-ce pas? Aussi nous comptons sur vous vendredi 27 et cela nous fait plaisir. Jeudi matin, de Paris, avant de prendre le train pour Saint-Malo, vous enverrez cette dépêche:
«Général Boulanger, Jersey.—Entendu.» C'est tout, nous nous comprendrons. à bientôt donc, ma bonne Meunière. Nous vous embrassons de bon cœur,
»B. B.»
Quand la lettre m'a été apportée, j'étais encore couchée, avec un vésicatoire sur l'épaule droite. Ma sœur aussi est alitée, et rien n'était prêt. N'importe: ils me demandent de venir, je serai près d'eux à l'heure dite! Je me suis aussitôt précipitée aux mille préparatifs à faire. Tout a été mené tambour battant. Je pars en vrai coup de foudre.
202
Vendredi 27 mars.—Samedi 25 avril 1891.
à neuf heures du soir, j'ai pris le train de Paris et, le lendemain jeudi, à onze heures et demie du matin, celui de Bretagne. à Rennes, ayant une grande heure à moi, j'ai fait un tour en ville. Je n'ai pas tardé à remarquer que j'étais suivie par une sorte de grand escogriffe, enveloppé dans un ulster et flanqué d'un gros dogue. Je n'en ai pas moins continué ma promenade, en m'informant, de droite et de gauche, de la maison où le général Boulanger était né. On n'a pas su me renseigner exactement. J'ai dû repartir avec le regret de n'avoir pas eu plus de temps à m'en enquérir: je l'aurais bien retrouvée, si toutefois elle est encore debout.
à onze heures du soir, j'étais à Saint-Malo. L'omnibus m'a conduite au port. Je suis descendue, on a déposé mes bagages près de moi et voilà l'omnibus reparti, me laissant toute seule dans la nuit noire. Agréable sensation! J'ai beau chercher des yeux le bateau auquel j'avais demandé à être menée, impossible de ne rien distinguer à travers l'obscurité, si ce n'est, de-ci de-là, quelques lanternes lointaines et, à mes pieds, un clapotis sinistre m'apprenant que je suis au bord d'un bassin. Pour comble d'effroi, un grognement rauque se fait entendre à deux pas de moi: Dieu du ciel, c'est le grand escogriffe de tout à l'heure avec son dogue! La terreur me saisit, je pousse un cri et je me mets à courir, butant à chaque pas contre des cordages et poursuivie par les aboiements furieux du chien.
Je me serais immanquablement noyée dans quelque bassin, si deux douaniers n'avaient surgi juste à temps pour me recevoir dans leurs bras. J'étais si effrayée qu'il m'a fallu un bon moment avant de pouvoir leur expliquer ce que je voulais. Ils m'ont assurée que le bateau était là, à l'ancre: si je ne l'avais pas aperçu, c'est qu'étant à marée basse, il se trouvait au-dessous du niveau du quai. Ils m'ont ramenée vers l'endroit d'où je m'étais enfuie: l'escogriffe avait disparu, mais les bagages, grâce à Dieu, étaient restés en place. Ils ont donné un coup de sifflet strident. Un matelot est apparu, comme s'il sortait du bassin. Il a pris mes bagages et je n'ai eu qu'à le suivre, sur l'échelle qu'il s'est mis à redescendre, pour parvenir au bateau.
Au petit jour, le temps s'est gâté, une bourrasque s'est élevée, accompagnée d'une violente giboulée. Cela promettait une jolie traversée. Elle a été, en effet, aussi mauvaise que possible.
Dix heures du matin. Enfin, le bateau s'engage dans les eaux calmes du port de Saint-Hélier, suivi, à courte distance, d'un autre vapeur, sous pavillon anglais. Aussitôt la passerelle jetée, je me hâte de quitter cette coque de noix où j'ai été si affreusement secouée cinq heures durant. Horreur! La terre ferme elle-même, sous mon pied mal assuré, continue le tangage et le roulis du bateau!
J'aperçois le tilbury du général, amené pour prendre mes bagages, et en même temps je vois venir vers moi les deux grands carrossiers bruns attelés au landau fermé et vide. Je monte dans la voiture qui repart aussitôt vers l'autre extrémité du port. Je me demande ce qu'elle va y chercher: mais déjà je me trouve en face du bateau anglais que nous avions devancé tout à l'heure. Au même instant, sur la passerelle qu'on vient de jeter, apparaìt le général...
Mais il n'est pas seul. à son bras se traìne un pauvre être courbé, un spectre de femme drapé dans un grand manteau de fourrure d'où s'échappent des falbalas fripés. Mon regard hésite... La voilà qui lève un peu la tête, montrant un visage livide et décharné. Est-ce possible, grand Dieu?... Jésus, Marie! Ce cadavre vivant, c'est Elle!
Je les regardais s'approcher, terrifiée comme si je voyais Lazare sortir de son tombeau. Je n'avais cessé de trembler, pendant tout le voyage, en songeant à l'état où je la trouverais. Mais jamais, en mettant les choses au pire, je n'aurais pu concevoir qu'il soit réalisable de changer d'une façon si affreuse, tout en gardant encore un reste de vie.
Je ne sais où j'ai trouvé la force de les embrasser, de leur dire quelques mots de bienvenue, quand ils sont montés dans la voiture. Nous roulions maintenant vers Saint-Brelade. Mes regards ne pouvaient se détacher d'Elle, de cette pauvre figure méconnaissable, amaigrie au delà de toute expression, de ces joues creuses, de ces lèvres réduites à rien qui laissaient apercevoir de longues dents jaunes et déchaussées. Elle me fixait de ses yeux caves, démesurément agrandis par le rapetissement de la face, et brûlants de fièvre.
«Vous paraissez émue, me dit-elle. Sans doute que vous me trouvez bien changée?»
Je fis un effort surhumain pour ne pas éclater en larmes, et je lui répondis:
«Comment n'aurais-je pas de l'émotion: vous revoir, vous retrouver tous deux, après une année entière passée loin de vous!... Vivre enfin cet instant de bonheur que je voyais constamment fuir devant moi et que tout à l'heure encore, pendant cette traversée maudite où j'ai souffert mille morts, je désespérais d'atteindre!... Je vois avec peine que votre traversée n'a pas été meilleure, car nous sommes trois ici à avoir bien mauvaise mine.»
«C'est vrai, fit-elle, nous avons beaucoup souffert de la mer. Le général, qui la craint tant, avait cependant retardé notre départ d'un jour parce que les dépêches la représentaient comme mauvaise... Nous n'avons rien perdu pour attendre et nous avons été horriblement malades tous deux.»
Là-dessus, elle se mit à me raconter tout ce voyage de Paris, qu'elle avait entrepris en février parce qu'elle avait donné congé pour son appartement de la rue de Berry et qu'elle voulait s'occuper elle-même de l'emballage de tout le mobilier. Mais elle n'avait rien pu faire, car, dès son arrivée, elle était tombée malade d'une dangereuse pleurésie, qui l'avait clouée au lit à l'Hôtel Continental. Comme elle me l'avait écrit, il s'était passé là quelques journées atroces, le général affolé étant déjà sur le point d'accourir à Paris et elle-même éprouvant un désespoir sans nom à la pensée de tout ce qui pouvait survenir... Enfin, grâce aux pointes de feu qu'on lui avait faites, elle avait pu partir, le 26 février au soir, et rejoindre le général à Bruxelles...
Elle parlait d'une voix faible, mais toujours encore argentine: le timbre d'autrefois n'était qu'à peine voilé. En revanche, la toux ne discontinuait pas, et il y eut finalement un accès terrible où je crus que sa poitrine allait se briser. Quand elle s'en fut un peu remise, le général lui fit défense d'ouvrir la bouche et il continua lui-même son récit:
«Ce que Marguerite a oublié de vous dire, c'est que je me suis opposé de toutes mes forces à ce qu'elle fìt ce voyage de Paris avant l'arrivée de la belle saison. Je craignais qu'elle ne prìt froid: vous voyez si mon pressentiment m'a trompé... Et, maintenant encore, j'ai voulu l'empêcher d'entreprendre ce nouveau voyage de Bruxelles à Jersey, si long, si fatigant: pensez donc, de Bruxelles à Ostende, d'Ostende à Douvres, de Douvres à Southampton, de Southampton à Jersey, vingt-quatre heures de trajet, moitié en chemin de fer, moitié en bateau, et par quelle mer!... Mais, Madame est une enfant gâtée qui ne veut plus en faire qu'à sa tête: elle a absolument tenu à présider en personne au déménagement de nos bibelots de Saint-Brelade... Car je dois vous dire que nous ne resterons pas davantage à Saint-Brelade et que nous nous établissons définitivement à Bruxelles, où j'ai loué un hôtel, rue Montoyer. Mon mobilier de la rue Dumont-d'Urville attend déjà là-bas en garde-meuble, depuis un temps infini; celui de la rue de Berry vient d'y arriver; il ne reste plus à y expédier que les quelques caisses d'objets que nous avons à Saint-Brelade. Et vous allez même nous donner un fameux coup de main pour cette besogne...»
Pendant que le général parlait, sa figure, très pâle lorsqu'il était sorti du bateau, avait repris de belles couleurs. Le teint rose, le visage plein, les mains grasses, le corps épais accusaient une santé resplendissante.
Nous étions en train de traverser un gros bourg: «Saint-Aubin! dit le général. Dans dix minutes, nous sommes chez nous!»
La route longeait maintenant la mer qui s'étendait à main gauche, grise et houleuse. Un repli de terrain la masqua pendant quelques instants, puis apparut la baie de Saint-Brelade, et, sur la droite, la villa, profilant son élégante silhouette sur le fond plus sombre de la côte couronnée de pins.
Au moment où la voiture s'engagea dans le chemin conduisant à la grille, un drapeau tricolore fut hissé le long du grand mât blanc qui s'élevait derrière la maison.
Le général eut un mouvement de joie: «Notre drapeau!... Combien je lui dois, à celui-là! Combien il me l'a fait paraìtre moins éloignée, notre France!»
Ce jour-là, on ne fit rien d'autre que de se reposer, le général et Mme Marguerite chez eux, et moi dans la chambre qu'ils m'avaient assignée,—une jolie chambre tendue de cretonne à fleurettes roses sur fond crème et bleu de ciel, dont la triple fenêtre donnait sur la mer.
Je ne les revis que le soir pour leur souhaiter bonne nuit, car ils n'étaient même pas descendus dìner, tant le mal de mer de la traversée leur avait enlevé toute envie de manger.
Dès le lendemain matin, je me mis à ma besogne de déménageuse, ce qui m'obligea à parcourir la villa plus d'une fois, des caves au grenier. Mais loin de lui découvrir des défauts cachés, je la trouvai plus pimpante encore, vue de près, que lors de notre première visite, il y a un an.
Elle était construite sur un plan parfaitement conçu. Les communs, avec les cuisines, les buanderies, l'office, les logis des domestiques, occupaient tout l'arrière du bâtiment, regardant le jardin, tandis que les chambres d'habitation donnaient toutes sur la façade, avec vue sur la mer. Elles étaient au nombre de quatre à chaque étage. Celles du rez-de-chaussée communiquaient seules entre elles; celles des deux autres étages n'avaient d'issue que sur le long couloir mitoyen qui séparait les deux parties de la maison.
La plus vaste pièce était, au rez-de-chaussée, le bureau du général. La lumière y entrait à flots par une grande véranda vitrée. Beaucoup de bibelots, plusieurs peintures sur chevalets. Dans un coin, sur une console, un saint Georges en bronze, terrassant le Dragon. Au mur, une jolie toile qui représentait Tunis en liberté, dans la prairie, levant sa fine tête de cheval pur sang.
Deux portes, séparées par la cheminée, conduisaient au salon, dont les murs étaient tapissés d'un treillis de bois doré sous-tendu de soie ponceau, et dont le plafond était tout revêtu de glaces plates, sur lesquelles étaient peints des paons, des faisans et des fleurs. Une précieuse pendule ancienne sur l'imposante cheminée, un admirable écran de soie brodé à la main, deux grandes lampes à pied, des fauteuils, des guéridons, dont un muni de papier à lettres ayant pour en-tête une vue de Saint-Brelade.
à côté du salon, la salle à manger contenant de très beaux meubles, et enfin la bibliothèque, encombrée de livres, où se trouvait un grand meuble extrêmement riche, incrusté de nacre.
Le salon et la salle à manger débouchaient tous deux sur la grande véranda centrale, faisant face à la mer. La porte du salon était masquée par un magnifique rideau en soie olivâtre, brodé en zigzags, à petits points, par Mme Marguerite elle-même, à l'époque où une longue maladie l'avait retenue alitée pendant plus de deux ans. Des tables rustiques et des fauteuils d'osier, drapés de cretonne, garnissaient la véranda qui s'ouvrait sous une toiture vitrée soutenue par des colonnes le long desquelles des rosiers grimpaient.
On montait du rez-de-chaussée aux deux étages supérieurs par un bel escalier très clair, orné de vieilles tapisseries à images et d'une exquise lanterne en fer forgé.
La Chambre de Mme Marguerite se trouvait juste au-dessus du bureau du général. Les tentures et les meubles étaient en peluche verdâtre. Sur une table, un objet de forme étrange: un moulin à goudron, placé là pour purifier l'air.
La chambre du général était représentée par une petite pièce attenante à laquelle menait un couloir étroit.
Ce premier étage renfermait encore trois autres chambres: celle qu'avait habitée, l'année dernière, la mère plus qu'octogénaire du général; celle où sa cousine, Mlle Mathilde Griffith, avait résidé pendant tout le séjour de Mme Boulanger mère, qu'elle ne quittait jamais; celle enfin qu'on m'avait donnée.
Au second étage se trouvaient des pièces mansardées, meublées d'une façon originale: une chambre marine, avec lit de marin, hamac, cordages et ancres; une chambre militaire, pleine de drapeaux, de trophées et d'armes; et le reste à l'avenant.
Dehors, sous les fenêtres, le printemps venait. Le jardin, assez triste à notre arrivée, s'embellissait de jour en jour; de toutes parts, la jeune verdure poussait et quelques arbustes commençaient à se couvrir de floraison blanche ou rose. L'air devenait tiède. C'était la saison des amoureux.
Il semble qu'on n'aurait dû entendre que rires, chansons et baisers dans cette villa délicieuse, où deux amoureux comme il n'y en a guère au monde avaient établi leur nid! Mais rien ne troublait le morne silence de la maison, si ce n'est une toux rauque qui ne discontinuait pas. Pauvres amoureux! Vous avez cru venir seuls pour jouir de votre tête-à-tête divin: mais derrière vous s'est glissé, invisible, un troisième hôte. Il a franchi le seuil en même temps que vous; il s'est assis à votre foyer et il ne lâchera prise que lorsqu'il tiendra la proie qu'il s'est marquée...
Hélas! Rien de plus triste que l'existence vécue par eux dans ce séjour d'enchantement. Ils ne prenaient plus plaisir à rien, ne sortaient jamais dans le jardin, n'allaient même pas sur la véranda. Au bord de la mer se dressaient, abandonnées, deux cabines qui ne leur avaient peut-être jamais servi. Jupiter et Tunis paissaient sur la pelouse sans plus jamais avoir l'honneur de porter leur maìtre, et, comme lui, ils s'épanouissaient. On faisait bien encore, une ou deux fois par semaine, des sorties en voiture, mais en voiture étroitement fermée. Les visiteurs étaient rares. Les après-midi s'écoulaient mortellement longues. Une immense tristesse pesait sur la maison.
Mme Marguerite allait de mal en pis. De jour en jour sa faiblesse augmentait: elle ne se déplaçait plus qu'en se traìnant avec la plus grande peine. Son visage devenait terreux. Son pauvre corps n'était plus qu'un squelette. Tous les quatre ou cinq jours, nous badigeonnions de teinture d'iode ce qui avait été autrefois un torse de Vénus et ce qui n'était plus maintenant qu'une cage osseuse, où pendillaient quelques restes de chairs brûlées par les pointes de feu. Les épaules s'étaient voûtées en arc de cercle. Deux profondes salières se creusaient aux clavicules. Les bras étaient d'une maigreur affreuse.
La toux était continuelle, et, trois ou quatre fois par jour, il y avait des accès si terribles qu'on pouvait croire qu'Elle y succomberait. Mais il ne venait presque pas de sang, probablement parce que ce pauvre corps exsangue n'en avait plus à donner. L'appétit décroissait sans cesse. Elle n'arrivait plus à rien supporter, ni le lait, qui lui était tellement recommandé que le général avait acheté, exprès pour elle, une petite vache du pays, ni même le Champagne.
à l'heure des repas, elle se rendait à table, soutenue par le général, mais elle ne touchait presque à rien et elle faisait peine à voir. Souvent, des nausées la prenaient, et elle avait aussi des pertes sanguinolentes, ce qui m'a fait supposer qu'elle était atteinte de quelque autre dérangement interne en même temps que de la phtisie. Ces causes réunies précipitaient l'aggravation de son état et hâtaient la consomption de son pauvre corps, d'où se dégageait une senteur écœurante—pour ne pas dire plus—qui imprégnait son linge, ses vêtements et se répandait dans les chambres où elle passait. Les nuits étaient encore pires que les journées. Elle avait la fièvre, une forte transpiration la saisissait, et la toux devenait plus mauvaise. Le général ne la quittait pas d'un instant, ne prenant lui-même que quelques bribes de sommeil.
Ils se levaient fort tard. Mme Marguerite ne le faisait qu'à regret; elle aurait préféré céder à l'alanguissement de sa faiblesse et rester constamment couchée. Mais les docteurs avaient recommandé au général de s'y opposer, un trop long séjour au lit déprimant l'énergie et diminuant les forces. Il lui faisait donc doucement violence, pour l'obliger à se lever. Un jour, elle s'entêta à n'y pas consentir. Pour fléchir sa volonté, il déclara qu'il ne mangerait rien tant qu'elle ne serait pas descendue à table. Elle ne voulut pas céder et c'est ainsi qu'il est resté toute une journée à son chevet sans la quitter des yeux et sans prendre aucune nourriture.
Bien entendu, Mme Marguerite ne se mettait plus en frais de toilettes. Elle, si fière jadis de changer de robe trois ou quatre fois par jour et de dìner tous les soirs en grande toilette de bal, ne quittait plus maintenant son peignoir ouaté en pékin lilas à raies de soie et de satin, dont les flots de rubans et de dentelles contrastaient d'une façon navrante avec ce cou et ce visage décharnés. C'est à peine si elle le changeait, lorsqu'ils devaient se faire conduire à Saint-Hélier, contre une robe ample en drap noir, avec un grand boa en fourrure autour du cou.
Cependant, une coquetterie lui restait: ses bijoux. Ses pauvres doigts étaient surchargés de bagues superbes: l'une d'elles portait une grosse perle noire entourée de brillants. Sur l'annulaire de la main gauche, elle avait cinq anneaux montés de la même façon, mais enchâssant cinq pierres de couleurs différentes: topaze, rubis, émeraude, saphir et diamant.
Quelquefois, par un caprice de malade, elle ouvrait son coffret à bijoux et elle les mettait tous sur elle. Elle avait alors l'air macabre de ces reines d'Égypte dont on a trouvé les corps momifiés dans les pyramides, parés comme pour un couronnement. Elle se plaçait devant une glace et se souriait. Et il me semble voir se refléter l'image de la Mort qui grinçait des dents.
Mme Marguerite prévoyait certainement sa fin prochaine. Plus d'une fois, je l'ai surprise tournant un chapelet à chaìne d'or et à grains de nacre perlière, taillés en facette. Quand elle priait ainsi, ses grands yeux désespérément levés au ciel, que demandait-elle à la miséricorde du Tout-Puissant? Elle me l'a dit un jour: «Pourvu que je puisse vivre jusqu'à ce qu'il me soit permis de me marier chrétiennement, je mourrai heureuse!» Pauvre infortunée! C'est un miracle qu'elle implorait: car, maintenant qu'elle a épuisé sans succès toutes les ressources de la science humaine, il ne faudrait rien moins qu'un miracle céleste pour prolonger sa vie, ne fût-ce même que de quelques mois!
Parfois, il lui arriva de faire allusion à sa mort. Un jour, comme Elle finissait de Lui couper les ongles, ce qu'elle tenait à faire elle-même, par câlinerie, elle dit, avec un ton d'infinie tristesse:
«Qui vous fera les ongles quand je n'y serai plus?» D'autres fois, il lui prenait des élans subits de tendresse comme je ne lui en avais jamais vus. Elle l'enlaçait de ses bras, le serrait contre sa poitrine, donnait toute son âme dans un baiser. Elle ne disait rien: mais je sentais qu'une pensée de mort venait de passer sur elle.
Un soir même, après une crise de toux terrible, elle s'écria, en se mettant à sangloter:
«Georges, mon Georges, je crois que bientôt nous allons être séparés!»
Il la saisit à bras le corps, la serra contre lui d'une étreinte éperdue, et, sanglotant lui-même, lui défendit de prononcer encore le mot de séparation: «Me séparer de toi, Marguerite! jamais! jamais!... Si tu pars la première, tu sais bien que je ne resterai pas, mais que je te rejoindrai aussitôt là où tu seras allée... Et puis, je t'en supplie, ne parle jamais de cela: c'est encore si loin de nous! N'avons-nous pas encore de belles années à vivre, une fois que tu seras guérie, jusqu'à ce qu'arrive enfin le jour, plus tard, bien plus tard, où nous partirons tous deux, la main dans la main?...»
En parlant ainsi, le général était sincère. Il ne pouvait pas plus admettre la disparition de cette vie à laquelle la sienne était si étroitement liée, qu'un homme en pleine force ne peut se faire à l'idée de sa mort. Il n'avait même pas la notion de la gravité du mal dont se mourait Mme Marguerite. Il ignorait que ce fût la phtisie. Il ne s'apercevait pas des ravages terribles qu'elle causait. Il avait de son adorée une autre vision que le reste du monde: il la voyait toujours belle comme autrefois.
Un jour, Mme Marguerite s'étant trouvée plus mal et ayant gardé le lit, j'ai voulu profiter de ce que je déjeunais seul avec le général pour tâcher de lui ouvrir les yeux. Je lui ai dit que je croyais de mon devoir d'attirer son attention sur la gravité de la maladie de Mme Marguerite... Il ne m'a pas permis de placer un mot de plus. Jetant sa serviette, il s'est mis dans une colère épouvantable:
«Je vous défends, a-t-il crié, de continuer sur ce sujet! Occupez-vous de ce qui vous regarde et ne venez pas ici jouer l'oiseau de malheur!»
Il avait tellement dépassé la mesure que je n'avais plus qu'à me lever et à me retirer. à peine étais-je dans ma chambre que le général m'y a rejointe, et, me prenant les mains, me les embrassant, m'a priée de lui pardonner son emportement.
«Seulement, a-t-il ajouté, je vous en supplie, quelles que soient vos bonnes et amicales intentions, ne touchez plus jamais un sujet aussi pénible pour moi!»
Et aussitôt, comme pour me prouver—ou se prouver à lui-même—que mes appréhensions étaient sans motif, il s'est mis à me raconter, avec force détails, comment Mme Marguerite avait traversé jadis des maladies bien autrement dangereuses, qui l'avaient clouée au lit pendant des années, ce qui ne l'avait pas empêchée de s'en remettre complètement et de redevenir florissante de santé.
Ses yeux me fixaient, mendiant une parole d'encouragement. Je n'en ai pas trouvé une seule à lui dire.
La maladie de Mme Marguerite n'était pas sans influer sur son humeur. D'égale et de calme qu'elle était autrefois, elle était devenue changeante, impressionnable et prompte à s'agacer.
Ainsi, le tic-tac de la pendule placée sur la cheminée de leur chambre à coucher lui avait causé de telles crises d'énervement que le général avait pris le parti d'arrêter le mouvement tous les soirs, quitte à le remettre en marche chaque matin.
Un jour, elle éprouva une désolation sans nom parce que son couteau à papier était perdu. Il est vrai que ce couteau, à lame de nacre perlière et à manche de vieil argent fleuronné d'or, avait toute une histoire qui le rendait plus précieux pour elle que n'importe quel autre objet.
C'était le premier souvenir que le général, alors ministre de la Guerre, lui eût offert, dans un magasin devant lequel ils s'étaient arrêtés à la première sortie qu'ils avaient faite ensemble, incognito, sur les boulevards. Depuis qu'ils habitaient sous le même toit, c'est-à-dire depuis la fuite, il leur servait à tous deux: combien de livres ils avaient coupés et combien de lettres ils avaient ouvertes avec son aide!
Pendant que Mme Marguerite se roulait sur son lit en pleurant, nous avons bouleversé toute la maison pour retrouver l'objet, mais ce fut en vain.
Une autre fois, elle faillit s'évanouir de douleur parce qu'en rangeant des papiers elle était tombée sur une vieille lettre, tracée d'une écriture féminine, qui portait en post-scriptum ces mots: «Bon souvenir à Taty.»
Cela avait suffi à rouvrir dans son cœur une blessure cruelle et toujours saignante. Celle qui avait tracé ces lignes était la jeune femme qu'Elle avait comblée de dons lorsqu'elle s'était mariée, dont Elle avait rêvé de faire sa fille, son héritière, et qui, depuis, l'avait oubliée. «Mon Dieu, mon Dieu, gémissait-elle, qu'ai-je fait de mal pour souffrir ainsi?... Parce que j'ai aimé, toutes les portes se sont fermées devant moi, on m'a accablée d'outrages, on a voulu me salir de toutes les façons, on a publié sur moi des choses infâmes... C'étaient des ennemis qui faisaient cela, et je supplie Dieu de leur pardonner, car les plus méchants d'entre eux ne peuvent pas se douter du mal qu'ils m'ont fait... Mais avoir été abandonnée et reniée par celle-là même à laquelle j'avais donné toute mon affection et qui a poussé son mépris pour moi jusqu'à ne plus vouloir, malgré les supplications du général, prononcer dans aucune de ses lettres ce nom de Taty qu'elle me prodiguait tant jadis... Juste Dieu, vraiment, c'est trop souffrir!...»
Ce qui augmentait la nervosité de Mme Marguerite, c'étaient les angoisses que lui causait la correspondance qu'elle recevait et expédiait en cachette. D'ordinaire, toutes les lettres à destination de Saint-Brelade étaient remises, par le facteur de Saint-Aubin, au secrétaire du général, qui habitait avec sa femme et ses quatre enfants une petite maisonnette voisine de la villa. M. Mouton venait deux fois par jour, vers midi et vers quatre heures, et remettait le courrier au général, lequel, à son tour, distribuait les lettres qui ne lui étaient pas adressées.
Quant aux lettres à expédier, c'était encore le secrétaire qui s'en chargeait. On s'arrangeait de manière à les faire porter le plus souvent possible jusqu'à Paris, car on se méfiait de la poste de Granville.
Mme Marguerite avait des raisons secrètes pour recevoir et expédier clandestinement toute une partie de sa correspondance. Elle se faisait adresser des lettres, sous double enveloppe, chez leur boulanger de Saint-Aubin, qui les glissait dans l'un des quatre pains de deux livres qu'il envoyait journellement, sur les onze heures ou midi, à Saint-Brelade. La femme de chambre Catherine, en qui sa maìtresse avait toute confiance—et qui, dans ce rôle de confidente dont elle ne pouvait se passer, avait succédé à la perfide Delphine,—avait mission de guetter l'arrivée du garçon boulanger et de retirer les lettres. Elle me les donnait et c'était alors à moi, conformément à ce que m'avait demandé Mme Marguerite dès le lendemain de mon arrivée, de les lui remettre, soit de la main à la main, soit de quelque autre façon. J'avoue que cette besogne me répugnait à l'extrême, car je tremblais sans cesse d'être surprise et de m'aliéner, bien malgré moi, l'estime du général: mais je n'avais pas pu m'y refuser.
Mme Marguerite m'avait priée d'enlever moi-même les enveloppes, pour qu'elle n'eût plus à les déchirer, ce qui prenait du temps et pouvait faire du bruit. Le général la quittait si peu que j'avais les plus grandes peines du monde à lui faire parvenir ces missives. Souvent, je les glissais dans la poche de son peignoir, pendu à la patère, ou bien dans la doublure des semelles de ses pantoufles. Je dus les garder parfois pendant quatre ou cinq jours sans réussir à les passer d'aucune manière.
Une autre difficulté, non moins grande, pour Mme Marguerite, était d'écrire les réponses à ces lettres secrètes. Elle n'y parvenait, le plus souvent, que lorsque le général travaillait dans son bureau et qu'elle se trouvait elle-même au salon. Elle s'asseyait alors à un secrétaire qu'elle avait encombré à dessein de livres et de papiers; elle me faisait asseoir près d'elle, avec un livre en mains, de façon à ce que je la masque un peu. Elle commençait une lettre quelconque, de celles qu'elle n'avait pas à cacher; puis elle se mettait à écrire les autres, tout en prêtant l'oreille au moindre bruissement de la pièce voisine. Le général et elle ne pouvaient se voir pendant qu'ils écrivaient tous deux: mais on entendait à merveille, d'une pièce à l'autre, la plume courir sur le papier. Dès que le général bougeait un peu, Mme Marguerite prenait peur et, toute pâlissante, presque défaillante, elle glissait sous les papiers amoncelés la lettre qu'elle écrivait, et elle feignait de continuer celle qu'elle avait commencée en premier lieu. Ce manège se répétait vingt fois par heure, car le général se remuait beaucoup, marchait à grands pas dans son bureau et venait souvent embrasser Mme Marguerite.
Une fois ses lettres achevées, elle me les remettait et je courais, le matin, les jeter à une boìte aux lettres située tout près sur la route de Saint-Aubin. La femme de chambre portait à Saint-Aubin même celles qui étaient à recommander. De temps à autre, une occasion se présentait pour les faire partir de Paris.
Qu'y avait-il dans toute cette correspondance? J'aurais pu le savoir mieux que personne si je n'avais pensé que, moins que quiconque, je n'avais le droit de m'en rendre compte, puisque c'est à ma loyauté qu'elle était confiée. Je ne sais donc rien: mais Mme Marguerite, pour obtenir mon aide, m'avait donné sa parole la plus sacrée qu'il n'y avait dans tout cela rien d'autre que des missives concernant ses affaires d'argent. Je suis convaincue qu'elle ne m'a pas menti.
Un jour, je lui ai vu retirer d'une lettre trois billets de mille francs. Un autre jour, étant à déjeuner, elle feignit d'avoir oublié son mouchoir sous son coussin. Je montai le prendre et je le trouvai entourant une enveloppe sur laquelle elle avait crayonné: «Dépêche à expédier par Saint-Hélier, au plus vite.» Justement, ils se disposaient, cette même après-midi, à aller voir quelqu'un à Saint-Hélier. Je demandai à les accompagner pour faire quelques achats. Ils me déposèrent devant un magasin de nouveautés et je pus envoyer la dépêche.
Elle était adressée à un M. Martin, à Paris, et elle contenait ces mots:
«Au nom de notre ancienne amitié, vous supplie envoyer vingt mille, de suite.»
Mme Marguerite eut une grande inquiétude pendant trois jours. Le quatrième, elle reçut une lettre qui la rasséréna. Les vingt mille étaient arrivés.
Malheureusement, quelque innocente qu'elle fût, cette correspondance en cachette prêtait à des suppositions et à des dénonciations malveillantes. Des lettres anonymes venaient sans cesse, avertissant le général que Mme Marguerite le trompait, qu'elle le trahissait, qu'elle était une vendue, placée auprès de lui pour le perdre. Quelques-unes renfermaient des détails si précis qu'une personne de la domesticité pouvait seule les avoir révélés. Mais qui soupçonner, du jardinier ou du cuisinier, de l'aide de cuisine ou du garçon de service, du garçon d'écurie ou du cocher? Mme Marguerite finit par soupçonner ce dernier, parce qu'elle l'avait surpris se faisant adresser des lettres à Saint-Hélier. Le général l'ayant appelé pour lui demander des explications, cet homme avait répondu que Madame recevait bien d'autres lettres en cachette. Il avait eu sur-le-champ son congé, tout en restant maintenu à son poste jusqu'au jour où l'on quitterait Saint-Brelade. Mme Marguerite lui portait à présent une telle aversion qu'elle ne pouvait le regarder.
Un jour, vers midi, elle se trouvait avec moi dans le salon, prête à passer à table dès que le général, qui venait de recevoir son courrier, sortirait de son bureau pour lui offrir le bras. Le général apparut, une lettre à la main, et dit d'une voix tremblante d'émotion contenue:
«Ma chère amie, nous allons commettre une folie, ce matin... Le boulanger doit passer d'un moment à l'autre. J'ai donné ordre qu'on m'en avertisse. Je suis décidé à lacérer tous les pains qu'il aura dans sa voiture... C'est une folie. Qu'importe? Les pauvres de Jersey en profiteront...»
Au même instant, un domestique vint dire que le boulanger arrivait, et le général sortit.
Je regardai Mme Marguerite: elle restait assise, immobile, les yeux fixés à terre, livide comme une suppliciée.
Le général rentra, les quatre pains à la main et les jeta, presque brutalement, sur les genoux de Mme Marguerite:
«Tenez, fit-il, voilà les pains qui nous étaient destinés! Ce n'était pas la peine de lacérer les autres, puisque ceux-là seuls peuvent renfermer la fameuse correspondance politique que cette lettre vous accuse de recevoir par ce moyen... Voici un couteau: ouvrez-les vous-même.»
Il lui tendit le couteau, mais elle ne le prit pas. Elle demeura sans un mouvement, pendant que le général, très pâle lui-même, la contemplait.
Finalement, il ne fut plus maìtre de sa colère. Il arracha les pains, et se mit à les entailler avec fureur. Trois d'entre eux gisaient déjà à terre et je commençais à respirer, quand, ayant porté le couteau sur le quatrième, il en fit s'échapper une lettre qui tomba sur le tapis.
Comment ne l'a-t-il pas tuée sur le coup?
Le poing levé, la face injectée de sang, il était terrible à voir. Son poing s'abattit lourdement sur un grand vase de porcelaine, qui se brisa avec fracas. Mais déjà sa fureur était tombée, et, s'effondrant dans un fauteuil, il se mit à pleurer comme un enfant.
Ils restèrent ainsi quelques minutes. C'est Mme Marguerite qui parla la première:
«Georges, sans m'avoir frappée, vous me tuez... Vous en avez le droit, si je suis une misérable... Mais vous avez le devoir de lire d'abord cette lettre, qui est peut-être une infamie, préparée exprès pour me perdre...»
Il leva la tête et la regarda fixement, de ses yeux rougis par les larmes. Puis il ramassa la lettre, déchira l'enveloppe et lut à haute voix. C'était une lettre d'affaires assez insignifiante, se rapportant au collier de perles que Mme Marguerite avait engagé autrefois.
Quand il eut fini, il se mit à marcher à grands pas dans la chambre, repoussant du pied les éclats de porcelaine qui encombraient le tapis. Il fit reproche à Mme Marguerite d'entretenir des correspondances qu'elle ne lui montrait pas, à lui qui cependant n'avait jamais eu un secret pour elle. Il lui rappela que déjà, à l'Hôtel de Bellevue, quelques semaines auparavant, il l'avait surprise écrivant en cachette, qu'ils avaient eu une scène des plus pénibles et qu'elle lui avait juré de ne plus recommencer jamais. Cependant, il convint que le procédé seul était à blâmer et que les lettres surprises n'avaient rien de coupable. Il se radoucissait de plus en plus à mesure qu'il parlait. Ce fut, en fin de compte, Lui qui demanda pardon à Mme Marguerite de lui avoir causé une aussi violente émotion.
Quant au boulanger, il fut vertement tancé, le lendemain, par le général en personne. Il protesta ses grands dieux que c'était la première lettre qu'il eût transmise et il jura, lui aussi, qu'il ne le ferait plus. Mais il avait déjà été mis au courant de tout par la femme de chambre, avec laquelle il avait convenu que les lettres attendraient désormais chez lui jusqu'à ce qu'elle pût venir les chercher. Il n'y eut donc plus de missives secrètes introduites dans les pains du boulanger.
Malgré cet incident, le général conserva une entière confiance dans celle qu'il aimait. Il me le dit assez clairement un jour où je fis avec lui une promenade en voiture, à laquelle je l'avais décidé sur les instances de Mme Marguerite qui, sans doute, avait des lettres importantes à écrire. Il me montra un billet anonyme qu'il avait encore reçu le matin même, et il ajouta:
«C'est une infamie de plus de la femme chez qui j'ai rencontré Marguerite pour la première fois et qui ne sait qu'inventer pour se venger de ce que nous nous sommes aimés... J'ai reconnu la main de cette femme dans tous les malheurs qui nous sont arrivés depuis quatre ans... C'est elle qui corrompait mes domestiques à Clermont-Ferrand et qui obtenait d'eux des dénonciations que j'ai fini par payer de ma plume blanche... C'est elle encore qui lance des entrefilets venimeux dans les gazettes, qui m'entoure d'un réseau d'espions et qui m'accable de lettres anonymes, les unes menaçantes, les autres infâmes... Mais aussi, je crache là-dessus comme il convient et comme je voudrais pouvoir le faire à la face du démon dont la haine ne désarme ni devant mes revers de fortune, ni devant les souffrances de Marguerite... Tenez, à Londres, un de ses émissaires est venu m'offrir de me mettre en mains vingt lettres qui devaient me prouver que Marguerite me trahissait et me conduisait à ma perte... Elle, me trahir! Mais c'était absurde! Mes intérêts n'étaient-ils pas les siens et y avait-il une somme au monde qui pût lui compenser la situation que j'aurais eu l'orgueil de lui faire si j'étais arrivé?... Je ne me serais jamais pardonné d'avoir cédé même à une curiosité: j'ai donc refusé net... Comme l'émissaire insistait, je l'ai mis à la porte avec cette réponse: «Et quand même cela serait, j'aime encore mieux me perdre par elle que de jamais la perdre!»
Sur ces mots, le général ouvrit d'un coup de pouce le bouton de sa manchette gauche, un bouton en or portant un Saint-Georges en relief et renfermant à l'intérieur la photographie de Mme Marguerite.
Il contempla le portrait avec amour, puis se mit à l'embrasser en répétant:
«Toi, me trahir, allons donc!»
Le général ouvrait souvent ce bouton, mais il ne touchait jamais à celui de l'autre manchette. Si parfois ses yeux s'y arrêtaient, il y passait une lueur de tristesse et de dépit. Un jour, le bouton se détacha, par hasard, et roula sur le parquet. Je le ramassai. Il s'était entr'ouvert dans sa chute. Il contenait aussi une photographie, celle d'une toute jeune femme dont la fine tête blonde lui ressemblait beaucoup...
Les jours dignes de pitié que le général vivait auprès de son amie mourante et les nuits d'insomnie qu'il passait avec elle ne l'empêchaient pas d'avoir une mine superbe. Il engraissait à vue d'œil. à ne juger que l'apparence, il semblait aller mieux que jamais. Mais, en réalité, cette façon de vivre finissait à la longue par lui causer le plus grand mal. Elle faisait pis que si elle avait fatigué son corps; elle alourdissait son intelligence et elle déprimait son énergie.
Un incident me donna la mesure du changement opéré dans son caractère. La Cocarde, au cours d'une polémique de presse, avait abusé de son nom et imprimé en première page, en caractères énormes, des extraits d'une lettre confidentielle qu'il avait anciennement écrite.
Le général, tel que je l'avais connu jadis, serait entré dans une colère épouvantable, après quoi il se serait assis à son bureau et vous aurait sabré une de ces réponses comme il savait les envoyer!
à ma grande surprise, il prit la chose le plus mollement du monde, hocha la tête, se demanda ce qu'il y avait lieu de faire, nous questionna sur ce que nous en pensions, remit toute décision après déjeuner, rédigea une lettre à l'adresse de la Cocarde, la lut, la retoucha, la relut, la jeta au panier, en refit une seconde, la déchira également et finit par écrire à son conseiller et ami, Pierre Denis.
Il montrait la même apathie pour tout ce qui touchait à la politique. Il m'avoua un jour que, si Pierre Denis n'avait pas été là pour le retenir, il y a beau temps qu'il aurait envoyé tout au diable. Il avait fait venir des tas de livres qui devaient le renseigner sur les questions économiques, sur les rapports du capital et du travail, sur les besoins du peuple. Il se proposait, de jour en jour, de s'atteler à cette étude, mais il n'y parvenait jamais. Et, en le voyant ainsi, j'avais le sentiment d'une belle et grande force réduite à rien par les conditions malheureuses où elle s'était placée.
Il parlait sans passion de ses adversaires et même des lieutenants qui l'avaient abandonné. Il allait jusqu'à chercher des circonstances atténuantes pour les torts qu'ils avaient eus, et, plus d'une fois, je l'ai entendu citer avec impartialité, bien plus, avec éloge, tel ou tel ancien collaborateur qui avait violemment rompu avec lui: par exemple, Paul Déroulède. Mais il en était quelques-uns dont la conduite envers lui avait été si ignoble qu'il ne pouvait se rappeler leurs noms sans y accoler l'expression de son plus profond mépris. En tête de ceux-là était l'auteur des Coulisses du Boulangisme.
«Je vous en prie, me dit le général, un jour que nous déjeunions seuls, Mme Marguerite étant restée couchée,—ne parlez jamais de ce livre ici! Si Marguerite entendait prononcer son nom, elle pourrait se trouver mal. Elle a failli mourir de douleur à l'époque où a été publié le chapitre qui la met en cause. Elle s'est évanouie en le lisant. J'ai pensé la perdre, et, certes, si elle n'a pas été tuée du coup, ce n'est pas la faute de celui qui a écrit cette vilenie... Le misérable a compulsé son livre comme les sorcières mélangent leurs poisons: il y a pilé des drogues de diverses provenances, mais aussi toxiques les unes que les autres. Des détails confidentiels cueillis à l'ancien Comité; des potins royalistes; des médisances haineuses répandues par la femme que vous savez; des racontars dus à des personnes ayant fait partie de mon entourage, et surtout à un de mes anciens officiers d'ordonnance; enfin, des découpures de journaux, le tout assaisonné du venin le plus pur: voilà la recette des Coulisses du Boulangisme!»
Le général citait avec une gratitude particulière les noms de ceux qui, malgré la défaite et la calomnie, n'étaient pas allés grossir les rangs de ses ennemis. Sans parler de Pierre Denis, pour lequel Mme Marguerite et lui éprouvaient une véritable affection, il ne s'exprimait jamais qu'avec la plus grande déférence sur le compte de Henri Rochefort. De même sur celui de Mme Séverine, qu'il ne connaissait d'ailleurs que par ses articles, mais à laquelle il savait gré de s'être montrée pitoyable envers lui dans son malheur, alors qu'elle n'avait guère été enthousiaste tant que son étoile montait. Il prononçait encore avec sympathie quelques autres noms, tels que ceux de ses anciens collaborateurs: Paulin Méry, Léveillé, Millevoye, Pierre Richard, de Susini, Dumonteil, Castelin, Théodore Cahu. Combien leur liste était courte en comparaison de l'énorme volume que l'on aurait pu former avec les noms de tous les boulangistes dont la casaque s'était retournée sur les épaules!
Il lui arrivait rarement de faire allusion à ses succès passés. Un jour, cependant, il exprima d'amers regrets:
«Thiébaud et Dillon, s'écria-t-il, ont été mes deux mauvais génies! T... m'a entraìné dans les campagnes électorales un an et demi plus tôt qu'il n'eût fallu. J'aurais dû rester tranquille, faire le mort dans mon commandement de Clermont-Ferrand, mettre la sourdine aux journaux, fermer la porte aux intrigants et aux politiciens. Bref, j'aurais dû m'abstenir de tout ce qui pouvait inquiéter les gouvernants. N'ayant rien à me reprocher, ils auraient bien été forcés de me laisser en place. Le scrutin de liste aussi aurait été maintenu, et, au moment des élections générales, je n'aurais eu qu'à me présenter tout seul, sans avoir besoin d'aucun Comité, pour passer en tête de liste dans soixante départements. Du coup, je tenais la France. Tandis que le plan de Thiébaud m'a mené où je suis. Quant à Dillon, c'est à lui que je dois d'avoir été empêtré dans un tas de sales affaires d'argent et de compromissions de toute espèce, au milieu desquelles j'étais tout honteux de me débattre. Mais ne m'avait-il pas persuadé que, pour faire de la politique, il fallait avant tout des millions? Parbleu! avec des faméliques comme ceux qui se sont alors rués sur la caisse, des milliards n'auraient pas été suffisants! Je n'avais besoin de me compromettre avec personne pour me procurer l'argent strictement nécessaire: les dons patriotiques qui ne demandaient qu'à affluer vers moi auraient suffi... Ma popularité m'assurait le succès, à condition que je ne sorte pas de mon passé de général patriote: les aigrefins qui voulaient en faire leur vache à lait m'ont perdu en m'amenant à endosser le faux rôle de spéculateur et de politicien... Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'une dernière ressource: tâcher de reconquérir, sinon ma popularité, du moins l'estime du peuple, en lui prouvant que je suis prêt à travailler pour lui!»
Le général parlait davantage de ce qu'il projetait de faire. Il était prêt à profiter de la première guerre un peu sérieuse qui éclaterait quelque part pour aller «se dérouiller». Déjà, il avait songé, au mois de février, à mettre son épée à la disposition des Portugais, s'ils avaient déclaré la guerre aux Anglais pour leurs empiétements en Afrique.
En attendant, il comptait, étant à Bruxelles, étudier de près les forts de la Meuse et la question de la pénétration en France par la frontière du Nord. Il avait aussi un projet de voyage en Italie, et ce qu'il en dit devant moi me prouva que ses sentiments à l'égard des Italiens étaient devenus bien plus favorables depuis un an.
Il y avait enfin un grand projet de retour en France, auquel il ne fit allusion qu'une seule fois, à propos de leur installation à Bruxelles, qui devait en faciliter l'exécution en rendant la surveillance policière moins aisée. Mme Marguerite connaissait ce projet et l'approuvait. Ils en parlèrent tellement à mots couverts que je ne pus saisir qu'un seul fait: c'est que ses fidèles auraient la surprise de le revoir en personne, à Paris, avant un an.
Ce sera donc la seconde fois qu'il rentrera en France depuis son malheureux départ pour la Belgique, car ils m'ont raconté, sous le sceau du secret le plus absolu, comment ils y étaient venus une fois déjà tous deux.
Cela s'était passé en été 1890, par une nuit sombre de nouvelle lune. Ils s'étaient échappés secrètement de la villa et avaient rejoint, sur la plage, une barque de pêcheurs venue du petit port voisin de Gorey. La mer était absolument calme. Vers les deux heures du matin, ils avaient débarqué sur la côte bretonne, non loin de Saint-Malo. En touchant le sol de la patrie, le général avait été saisi d'une émotion indescriptible. Il l'avait baisé à pleine bouche, et longtemps, longtemps, il avait pleuré.
Ils étaient repartis quand le soleil se fut levé, sans avoir été rencontrés par personne, si ce n'est par un jeune pâtre breton qui avait passé près d'eux au petit jour. Celui-là, certes, en voyant cet homme sangloter sur le rivage, ne se doutait ni du nom qu'il portait, ni des grandeurs qu'il avait failli atteindre, ni de l'infortune où il se trouvait!
J'ai quitté Saint-Brelade le samedi 25 avril, quatre semaines et un jour après mon arrivée. J'avais terminé mon travail de triage et d'emballage. Vingt grandes caisses pleines étaient parties, dont quatre ou cinq, contenant des livres, pour Paris, et le reste pour Bruxelles, à l'adresse de l'hôtel loué par le général: 79, rue Montoyer. Le général et Mme Marguerite se disposaient eux-mêmes à s'en aller dans peu de jours.
La veille de mon départ, la pauvre malade a eu une grande joie. Un éventail m'étant tombé des mains pendant que j'étais à ma fenêtre, je suis descendue pour le reprendre. Je l'ai retrouvé dans le petit parterre de fleurs planté au pied de la véranda; mais, en même temps, j'ai aperçu, fiché en terre, le fameux couteau à papier de Mme Marguerite. Quand je le lui ai apporté, elle m'a sauté au cou. Elle aurait dansé d'allégresse, si elle n'avait été aussi faible. Le général était accouru au bruit que nous faisions. De quel bon cœur ils s'embrassèrent!
Le soir, quand je suis venue leur souhaiter bonne nuit pour la dernière fois, le général m'a dit: «Notre sœur de lait (ils m'avaient fait passer pour la sœur de lait de Mme Marguerite), puisque vous retournez demain en Auvergne, il ne faut pas que vous nous quittiez sans emporter un souvenir des bons amis que vous avez en nous... Il y en a un que nous avons décidé de vous remettre parce qu'il nous a valu aujourd'hui, grâce à vous, les seuls moments heureux que nous ayons vécus à Saint-Brelade depuis longtemps: prenez ce couteau à papier... Vous savez combien il nous est précieux... Cependant, il n'a guère de valeur par lui-même et nous serions heureux de vous voir choisir parmi les bijoux de Marguerite...»
Je l'arrêtai d'un geste, le suppliant de ne rien ajouter à un cadeau qui était le plus touchant qu'ils eussent pu me faire.
Le lendemain, après avoir donné un dernier morceau de sucre à mon cher Tunis, je revins auprès d'eux, vers midi, pour les adieux. Mme Marguerite venait de se lever. Elle avait passé une nuit très pénible, et sa mine était plus mauvaise que jamais. En m'avançant vers elle, j'eus le pressentiment très net que je ne la reverrais plus vivante. Une sorte d'horreur surnaturelle, comme on en éprouve devant les mourants, me passa à travers tout le corps. Mes jambes fléchissaient. Sans une parole, je tombai à genoux et je fondis en larmes.
Elle aussi, comme si elle devinait ce qui se passait en moi, se mit à pleurer, avec de grands hoquets qui étaient presque des râles. Seul, le général s'efforçait de nous calmer. Me relevant de terre, il me dit:
«Allons, ne vous désolez pas ainsi, et ne manquez pas de venir nous voir à Bruxelles!»
Elle répéta:
«Oui, n'oubliez pas... Venez nous voir quand nous serons là-bas!»
Nous nous embrassâmes une dernière fois, nous tenant tous trois enlacés. Le général descendit avec moi. La voiture n'était pas encore là. Pendant qu'on l'attelait devant la remise, nous fìmes quelques pas vers le jardin, jusqu'auprès du mât au drapeau. Le général, se baissant vers une plate-bande, cueillit une pensée et quelques violettes qu'il me remit. Mais déjà on m'appelait. Je courus vers la remise, en criant: «Au revoir!» Lui, debout, à ce moment, au pied du grand mât où flottaient les trois couleurs de France, se découvrit et dit d'une voix forte:
«Adieu!»
J'avais tourné le coin. Je ne le vis plus. Mais, quand la voiture passa devant le perron, je levai les yeux et j'aperçus, pendant quelques instants encore, à la fenêtre de Mme Marguerite, une hâve silhouette de spectre qui me faisait signe de la main...
Le voyage de retour s'est accompli sans incidents.
Triste voyage, pendant lequel les idées de mort ne me quittèrent pas un seul instant. Le train filait à travers des campagnes ensoleillées, où s'épanouissait le printemps. Mais ma pensée était auprès de la pauvre mourante et, quand mes yeux s'arrêtaient par hasard sur toute cette fraìche verdure nouvelle, je me disais: «Feuilles qui venez de pousser, avant que vous ne tombiez, elle sera morte!» Et, alors, mon âme épouvantée tâchait de pénétrer l'avenir...
Quand je suis rentrée dans ma maison, à la tombée du jour, les miens ont poussé un cri d'effroi en me voyant: les insomnies et la douleur m'avaient vieillie de dix ans.
203.—Vendredi 1er mai.
à la tombée de la nuit, on vient m'avertir que quelqu'un désire me parler. Je descends à la salle commune et me trouve en présence d'un monsieur décoré, à favoris grisonnants.
«Madame Marie Quinton?» me demande-t-il en me regardant bien en face.
«C'est moi, Monsieur, pour vous servir.»
«Madame, je suis chargé de vous faire une communication toute personnelle.»
Je le conduis dans un petit salon et le prie de s'asseoir. Le voilà qui fouille dans la poche de son paletot. Je m'attendais à en voir sortir quelque papier à procès, tant ce monsieur avait l'air d'appartenir au monde du Palais. Mais il retire une petite boìte cachetée de rouge et me la remet en disant:
«Voici ce que j'ai été chargé de vous apporter de la part de Mme de B..., qui m'a confié cette mission, entre plusieurs autres, au moment de quitter elle-même Jersey... Je ne saurais rien vous dire de plus, ne connaissant, quant à moi, aucun autre détail. Et, sur ce, je vous demande la permission de rebrousser chemin en toute hâte, car j'ai encore une commission à Clermont, et il faut que je sois à Nevers par l'express de ce soir.»
Avant que j'eusse eu le temps de répondre, le monsieur, avec un grand salut, était parti.
J'ouvre la boìte, en coupant la ficelle qui l'enveloppe, cachetée aux armes des B... Un cri s'échappe de ma poitrine...
C'est la parure aux trois perles, dont Mme Marguerite me fait cadeau!
Parure exquise, que je lui ai vu mettre avec ses plus belles toilettes. L'une des perles forme agrafe, montée sur trois fleurs de lis en brillants que soutiennent quatre branches de laurier comprenant trente-deux diamants. Les deux autres forment boucles d'oreilles, entourées chacune d'un fer à cheval en brillants que surmonte une fleur de lis.
...Oh! Marguerite, comment pourrais-je vous exprimer ce que je ressens, moi que cette magnifique surprise eût autrefois enivrée de joie, et qu'elle pénètre de tristesse aujourd'hui!
204.—Mardi 5 mai.
On annonce que le général, après avoir passé par Londres pour y serrer la main à Henri Rochefort, est arrivé à Bruxelles avant-hier.
Je viens de leur écrire, à leur hôtel de la rue Montoyer.
205.—Samedi 16 mai.
J'en ai appris de bien drôles, aujourd'hui, sur la véritable surveillance de haute police dont j'ai été l'objet pendant plus de deux ans. Dès le début de 1889, on a organisé, à mon intention, un service spécial de filature. Deux femmes, habitant le pays, ont été chargées de ne pas me perdre de vue et de me suivre, comme mon ombre, dans toutes mes allées et venues. Pas une visite, pas une sortie dans Clermont ou dans Royat qui n'eût été soigneusement observée.
Cependant, quelque serrée que fut cette surveillance, j'avais réussi parfois à glisser entre les mailles. Mon voyage de Londres n'avait été signalé qu'après coup, alors que j'étais déjà de retour, ce qui avait même valu à plusieurs d'avoir la tête fortement lavée par le Ministère de l'Intérieur, qui supposait que je pouvais avoir été porteur d'instructions pour le scrutin de ballottage des élections générales.
La personne de qui j'ai obtenu ces renseignements et qui était merveilleusement placée pour les fournir, a ajouté:
«C'est ainsi qu'il existe en haut lieu, un gros dossier bourré de rapports vous concernant... Dossier tout à votre honneur, du reste, puisqu'il montre qu'il n'y a rien à relever dans votre conduite,—et pas seulement au point de vue politique: à tous les points de vue...»
L'aveu m'a fait plaisir. Mais, franchement, Monsieur Constans, le résultat auquel a abouti votre enquête peut-il valoir tout l'argent qu'elle a dû vous coûter?
206.—Mercredi 27 mai.
Les journaux font savoir que le général s'est installé, depuis quelques jours, dans son hôtel de la rue Montoyer. à les en croire, cette demeure serait tout simplement princière: porte cochère magistrale, escalier monumental, rampe en bois sculpté digne de figurer dans une exposition de chefs-d'œuvre, salons de réception nombreux et immenses, vérandas vitrées pouvant former des serres de plantes rares, vaste cour, jardin anglais, rien, en un mot, n'y manquerait! Dix chevaux piafferaient dans les écuries, cinq voitures rempliraient la remise, dont un superbe mail-coach avec lequel le général ferait sensation dans le grand monde high-life de Bruxelles.
C'est le Gaulois qui, le premier, a conté ces belles choses. Mon Dieu! qu'elles riment peu avec tout ce que j'ai vu et entendu à Saint-Brelade.
207.—Jeudi 4 juin.
Je suis tourmentée au dernier degré par l'angoisse où me plonge leur silence. Sans cesse, je m'attends à recevoir une lettre de Bruxelles, encadrée de noir...
N'y tenant plus, je leur ai écrit en les suppliant de me rassurer un peu. Ma lettre prête, je l'ai déchirée: elle trahissait trop mon inquiétude. J'en ai refait une autre, et, pour mieux masquer sa véritable raison d'être, j'ai envoyé là-bas de nos fruits confits d'Auvergne.
208.—Mardi 9 juin.
La lettre de Bruxelles est arrivée. L'enveloppe était blanche, mais j'ai eu un serrement de cœur tout de même, car l'adresse était de la main du général...
Grand Dieu! Ses forces auraient-elles déjà baissé au point qu'elle ne puisse plus écrire?... Mais non! Les pages contenues dans l'enveloppe sont encore de son écriture à Elle:
«Dimanche 7.
»Ma bonne Meunière,
»Je comprends vos tourments, et vraiment je suis désolée d'être restée si longtemps sans vous écrire. Mais ce n'est pas de ma faute. Entre ce voyage très fatigant, l'installation de l'hôtel à faire, je n'ai pas eu une minute à moi. Aujourd'hui, je vous écris de mon lit, où le docteur me retient depuis que nous sommes rue Montoyer, c'est-à-dire depuis quinze jours. Je tousse toujours beaucoup et je suis bien faible, mais le docteur me promet une prompte et complète et prochaine guérison. Nous avons eu un si mauvais temps, du reste, que tout le monde a été plus ou moins malade... Notre installation est très jolie, vous verrez cela plus tard. Je ne regrette pas du tout Saint-Brelade.
»Ma bonne Meunière, le hasard est extraordinaire. Juste pendant que je vous écris, on m'apporte un tas de gâteries. Vous êtes vraiment trop gentille. Je ne mange toujours pas beaucoup, mais je mangerai de votre envoi en pensant à vous. Le général qui, ici, a du monde toute la journée—c'est à peine si je le vois—m'a chargée de bien vous embrasser. Je le fais pour lui et pour moi de tout cœur.
»B. B.
»Écrivez au nom du général, 79, rue Montoyer.»
J'ai écrit sans tarder d'une heure.
Elles comptent...
209.—Mardi 7 juillet.
Se peut-il qu'Elle vive encore, Elle que j'ai quittée, il y a deux mois et demi, dans un état si voisin de l'agonie?
J'ai de nouveau écrit à Bruxelles. Qui me répondra?
210.—Samedi 11 juillet.
J'ai reçu la réponse de Bruxelles. Cette fois, lettre comme enveloppe sont entièrement de la main du général:
«Bruxelles, 79, rue Montoyer.
Jeudi 9 juillet.
»Ma bonne Meunière,
»C'est moi qui réponds aujourd'hui à votre lettre d'il y a un mois et à celle que nous recevons aujourd'hui. Mme de B..., en effet, quoique allant beaucoup mieux, est toujours alitée et ne pourrait pas écrire sans fatigue. Elle a été fortement éprouvée, mais les soins qui lui sont donnés par un médecin que j'ai fait venir de Paris promettent de prédire pour bientôt la convalescence. La toux a presque disparu, les transpirations également. Quand elle aura repris un peu d'appétit, les forces reviendront.
»Elle me charge de vous dire de sa part mille et mille choses affectueuses: nous pensons à vous et nous parlons souvent de vous.
»Écrivez-nous; donnez-nous de vos nouvelles. Vous êtes maintenant en pleine saison et il faut espérer que, le beau temps une fois arrivé, les baigneurs ne vous manqueront pas.
»Vous ne nous dites rien de la santé de votre mère et de votre sœur; nous espérons donc qu'elles vont bien.
»Au revoir, ma bonne Meunière. Tous les deux, nous vous envoyons nos souvenirs les plus affectueux.
»Gral B...»
Elle n'a plus eu la force d'écrire! Plus de doute, c'est la fin.
Je leur ai répondu de suite, mais en gardant le silence sur la santé des miens. Qu'irai-je leur raconter à quel point ma pauvre vieille mère est de nouveau souffrante! Qu'irai-je faire retentir mes propres alarmes là où une douleur si immense se prépare...
Si du moins, avant de s'éteindre, Elle pouvait encore respirer le parfum des rouges œillets et des blanches marguerites que je lui fais envoyer de Nice, pour son jour de fête du 20 de ce mois!
213.—Mercredi 15 juillet.
Maman est plus mal aujourd'hui.
J'ai reçu avis de Nice que tout avait été fait selon mes ordres et que les fleurs commandées arriveraient à destination pour le 19.
214.—Jeudi 16 juillet.
Elle est morte!
à sept heures du soir est venue cette dépêche:
Royat, Bruxelles 2316-6-16-5h. 35 s.
Quinton, Hôtel Marronniers, Royat.
Marguerite morte.
On ne s'aguerrit pas contre le malheur. De jour en jour, je m'attendais à la fatale nouvelle. Quand je l'ai reçue, le coup a été aussi terrible que si elle était morte en pleine santé.
J'aurais voulu partir de suite. Tout m'en empêche. Ma maison est pleine de monde comme jamais. S'il n'y avait que cela! Mais, là-haut, ma mère se débat dans la fièvre; ma sœur aussi s'est alitée de fatigue, et il n'y a que moi pour les soigner.
J'ai envoyé cette dépêche:
Général Boulanger, 79, rue Montoyer,
Bruxelles.
Quelle affreuse et désespérante nouvelle! Suis avec vous dans votre douleur. Souffre mortellement de ne pouvoir être près de vous.
Marie.
Demain, je veux lui écrire.
Aujourd'hui, qu'on me laisse pleurer...
215.—Vendredi 17 juillet.
Je lui ai écrit, je lui ai parlé d'Elle, je l'ai supplié de trouver la force de vivre.
Car, depuis la dépêche d'hier, je redoutais d'un moment à l'autre une nouvelle encore plus terrible...
J'ai ouvert les journaux de ce matin en tremblant. Dieu soit loué. Il ne s'est pas tué dès qu'elle fut morte!
216.—Samedi 18 juillet.
Les journaux donnent des détails sur la mort de Mme Marguerite.
Le général n'aurait eu les yeux ouverts sur la gravité de son état que dans le courant de mai. Il s'est
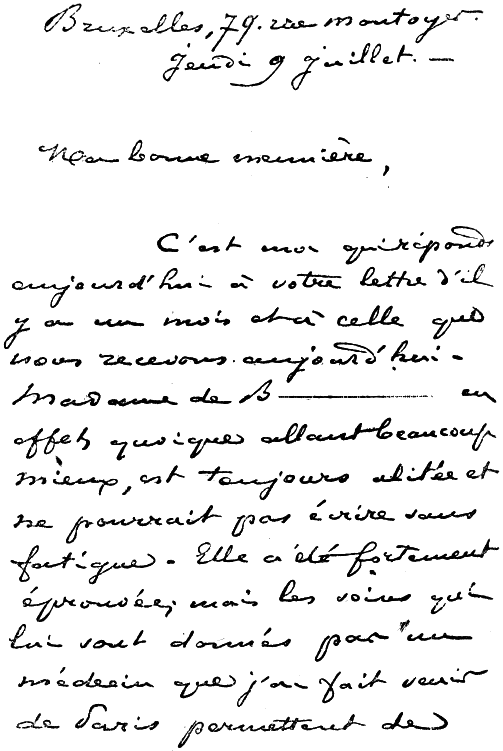
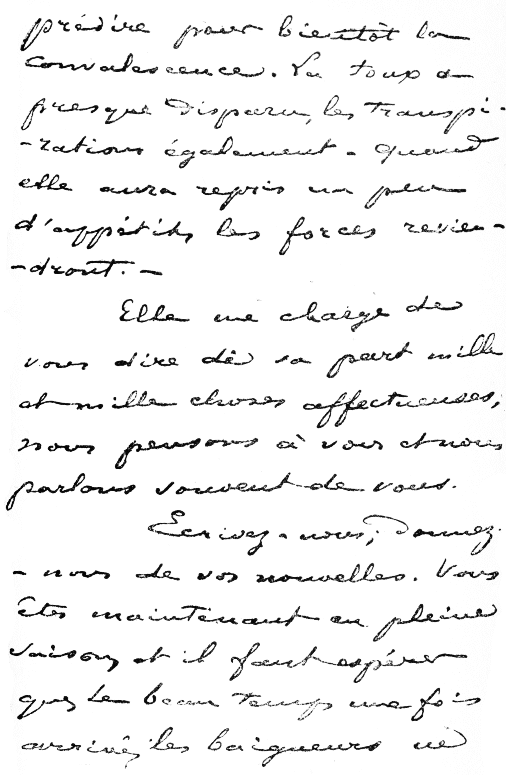
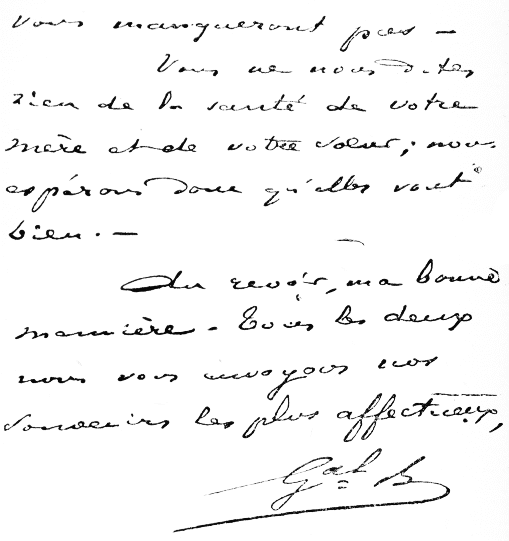
adressé aux spécialistes les plus renommés pour le traitement de la tuberculose. On a essayé de la créosote, puis, depuis le début de ce mois, d'un remède nouveau, le gaïacol, administré en injections sous la peau. En dernier lieu, le général faisait ces injections lui-même.
Il y aurait eu un soulagement, un sentiment de mieux dans les premiers jours de la semaine, et le général se serait repris à espérer. Mais, le mercredi, la malade a été saisie d'une sorte de vertige. On a appelé le médecin. En descendant, il a pris le général à part et lui a dit: «Préparez-vous, c'est fini.»
Le général n'a plus quitté le chevet de la mourante. Il est resté douze heures près d'elle, couvrant de baisers ces mains qui se glaçaient. Elle ne toussait plus. Elle s'assoupissait par instants, puis, soudain, s'éveillait. Ses yeux se tournaient alors vers lui, le fixant longuement, tandis que ses lèvres remuaient et voulaient parler. Mais elle n'eut la force de prononcer que deux paroles,—les dernières:
«à bientôt...»
La nuit tombait. La mourante entra en agonie. Sa poitrine se soulevait en un râle effrayant. L'écume lui montait aux lèvres.
Vers le milieu de la nuit, un peu de calme survint. Puis elle souleva légèrement la tête et entr'ouvrit la bouche, comme pour happer l'air. En même temps, ses yeux tournèrent...
Lui se jeta vers elle, l'appelant par son nom d'une voix désespérée. Mais déjà sa tête était retombée sur l'oreiller. Elle était morte.
...C'est demain, à deux heures, qu'auront lieu, à Bruxelles, le service et l'enterrement de Mme Marguerite, décédée le 16 juillet 1891, dans la trente-sixième année de son âge.
J'ai fait dire, ce matin, une messe basse pour le repos de son âme. Pendant que le prêtre officiait pour Elle, moi, je priais pour Lui...
217.—Dimanche 19 juillet.
...Pauvres fleurs de la Sainte-Marguerite, qui deviez lui parvenir la veille de sa fête, et qui arrivez à Bruxelles aujourd'hui, jour de son enterrement!
218.—Lundi 20 juillet.
Les obsèques, par un navrant contraste, ont eu lieu à travers une ville en pleine liesse populaire, car c'était hier la fête nationale des Belges et la grande kermesse de Bruxelles.
Le général avait fait lui-même la toilette funèbre de la défunte. Il l'avait enveloppée d'une longue robe blanche, puis il l'avait couchée dans son cercueil avec un bouquet d'œillets et de marguerites sur la poitrine. Avant qu'on refermât le couvercle, il avait coupé une mèche des cheveux blonds de la morte et lui avait donné un dernier baiser.
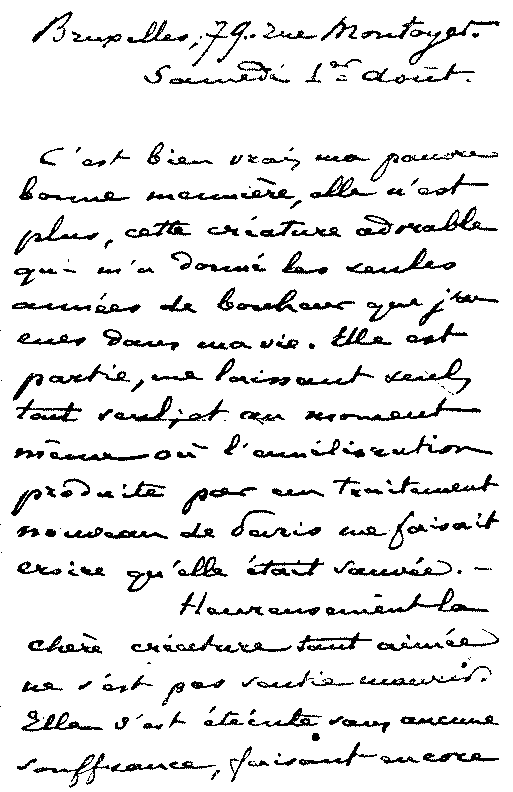
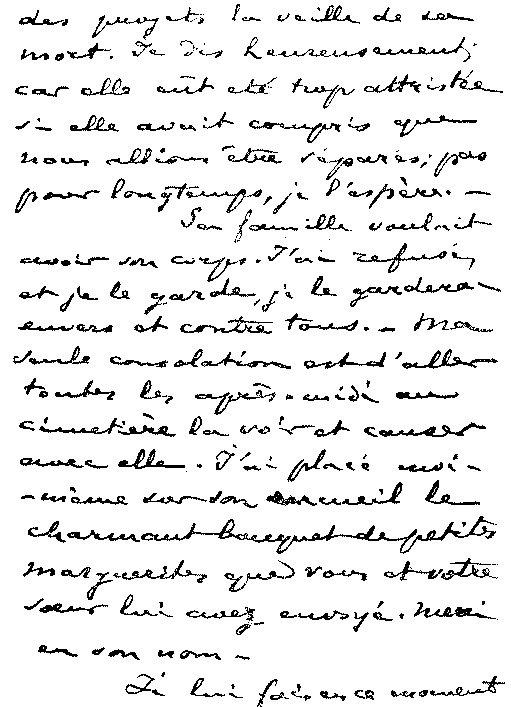
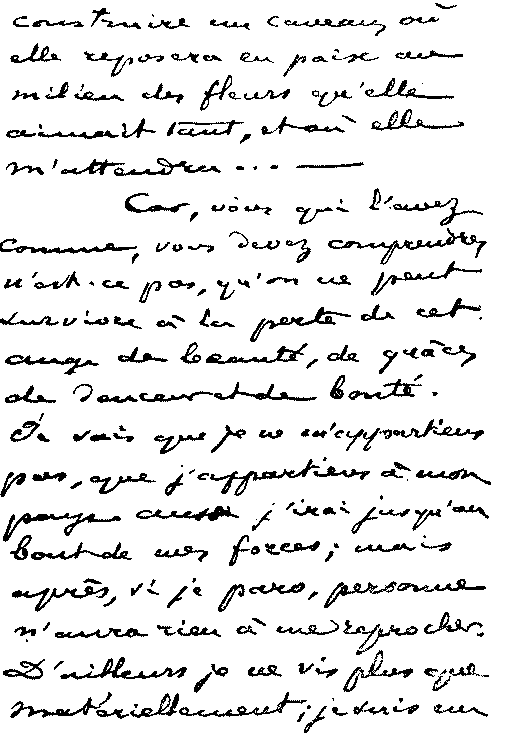
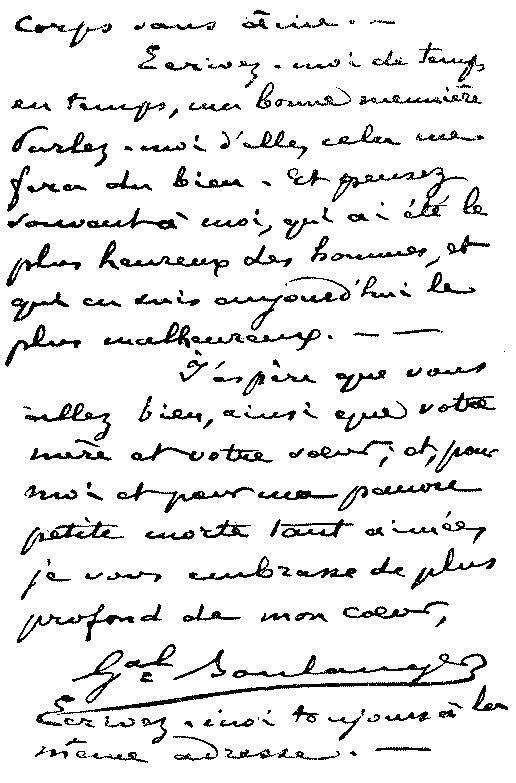
Après la levée du corps à la maison mortuaire, le cortège s'est rendu à l'église Saint-Jacques-sur-Caudenberg, en traversant le boulevard du Régent, la place du Trône, la place des Palais, la place Royale, tout remplis de trophées, de mâts et de drapeaux.
Derrière le corbillard marchait le général, en habit, la plaque de grand-officier de la Légion d'honneur sur la poitrine, très droit, le front levé, mais le visage affreusement pâle et parfois convulsé par des contractions. Cinq députés boulangistes le suivaient: Castelin, Déroulède, Dumonteil, Millevoye, de Susini, et avec eux quelques fidèles du parti comme Théodore Cahu, quelques amis personnels, enfin quelques dames en grand deuil, parmi lesquelles Mme Séverine. Sur tout le parcours du cortège, le peuple, en habits de dimanche, s'écrasait.
Place Royale, devant la façade de l'église, et jusqu'au haut des marches, sous les colonnes du péristyle, il s'est produit une indigne bousculade, à l'entrée comme à la sortie.
L'absoute donnée, on est monté dans les voitures de deuil qui se sont rendues, au pas d'abord, puis au grand trot, à travers les faubourgs du Sud-Est, au cimetière d'Ixelles.
Au moment où le corps a été enfermé dans le caveau, le général n'a plus été maìtre de sa douleur. Il a été pris d'une défaillance. On a dû le soutenir.
Ce n'est encore qu'un caveau provisoire où le cercueil a été déposé, en attendant que le général lui fasse ériger une tombe définitive.
Cette dernière information m'a diminué un peu l'angoisse qui me broie le cœur, car elle me donne la certitude qu'il ne se détruira pas avant que la tombe ne soit achevée.
219.—Samedi 25 juillet.
Par le courrier du soir m'est venu un mot de lui, tracé sur sa carte:
LE GÉNÉRAL BOULANGER
a été très sensible à votre dépêche et à votre lettre; il vous en remercie bien vivement et va vous écrire.
Bruxelles, le 23 juillet 91.
Demain matin, je ferai partir le bouquet de marguerites, imité en fines perles de verre, que j'envoie au Général pour la tombe d'Ixelles.
220.—Mercredi 29 juillet.
Le testament de Mme Marguerite est connu. Il a été rédigé à Paris, le mercredi 29 janvier 1890. Il partage sa fortune entre trois dames, trois amies. Du Général, il ne fait aucune mention!
L'une de ces dames reçoit toute la garde-robe et tous les bijoux. Mais c'est tout ce qui reste encore d'Elle, à celui qu'elle a quitté!
221.—Lundi 3 août.
Le Général m'a écrit:
«Bruxelles, 79, rue Montoyer.
»Samedi 1er août.
»C'est bien vrai, ma pauvre bonne Meunière, elle n'est plus, cette créature adorable qui m'a donné les seules années de bonheur que j'ai eues dans ma vie. Elle est partie, me laissant seul, tout seul, et au moment même où l'amélioration produite par un traitement nouveau de Paris me faisait croire qu'elle était sauvée.
»Heureusement, la chère créature tant aimée ne s'est pas sentie mourir. Elle s'est éteinte sans aucune souffrance, faisant encore des projets la veille de sa mort. Je dis heureusement; car elle eût été trop attristée si elle avait compris que nous allions être séparés; pas pour longtemps, je l'espère.
»Sa famille voulait avoir son corps. J'ai refusé, et je le garde, je le garderai envers et contre tous.—Ma seule consolation est d'aller toutes les après-midi au cimetière la voir et causer avec elle. J'ai placé moi-même, sur son cercueil, le charmant bouquet de petites marguerites que vous et votre sœur lui avez envoyé. Merci en son nom.
»Je lui fais, en ce moment, construire un caveau où elle reposera en paix au milieu des fleurs qu'elle aimait tant, et où elle m'attendra... Car, vous qui l'avez connue, vous devez comprendre, n'est-ce pas, qu'on ne peut survivre à la perte de cet ange de beauté, de grâce, de douceur et de bonté. Je sais que je ne m'appartiens pas, que j'appartiens à mon pays. Aussi, j'irai jusqu'au bout de mes forces; mais après, si je pars, personne n'aura rien à me reprocher. D'ailleurs, je ne vis plus que matériellement; je suis un corps sans âme.
»Écrivez-moi de temps en temps, ma bonne Meunière. Parlez-moi d'Elle, cela me fera du bien. Et pensez souvent à moi, qui ai été le plus heureux des hommes, et qui en suis aujourd'hui le plus malheureux.
»J'espère que vous allez bien, ainsi que votre mère et votre sœur, et, pour moi et pour ma pauvre petite morte tant aimée, je vous embrasse du plus profond de mon cœur.
»Gral Boulanger.
»Écrivez-moi toujours à la même adresse.
222.—Samedi 8 août.
Avant-hier, le cercueil de Mme Marguerite a été transporté du caveau provisoire dans le caveau définitif, que le Général a fait creuser en un endroit du cimetière qu'il a lui-même choisi.
Le caveau seul est achevé. Le reste de la tombe est en construction.
Tant mieux! Encore un délai.
223.—Mardi 18 août.
Les journaux reparlent du Général. Le prince Napoléon aurait songé à lui, comme témoin dans le mariage de sa fille avec le frère du roi d'Italie. Le Général désapprouve les manifestations excessives auxquelles les plus violents de son parti viennent de se livrer à propos de l'ordre donné à notre escadre de se rendre de Cronstadt à Portsmouth, et à propos de la représentation de Lohengrin à l'Opéra.
Tout cela indiquerait-il que le parti de vivre reprend le dessus en lui?
Je lui écris pour la seconde fois depuis sa lettre. Ma résolution est bien prise maintenant. J'irai auprès de Lui, pour lui parler un peu d'Elle, dès les premiers jours d'octobre.
224.—Jeudi 17 septembre.
Je lui écris pour la troisième fois.
225.—Samedi 26 septembre.
Je suis horriblement angoissée. J'ai eu un cauchemar affreux, cette nuit. J'ai vu venir vers moi, parmi les tombes d'un cimetière, le Général et Mme Marguerite qui se tenaient étroitement embrassés.
226.—Mercredi 30 septembre.
Il s'est tué.
227.—Mercredi 7 octobre.
Depuis trois jours, depuis que je commence à me relever lentement de la prostration où cet épouvantable malheur m'a jetée, j'ai essayé en vain de tracer une seule ligne. Chaque fois, le désespoir, me débordant du cœur, m'a paralysée.
C'est le 30 septembre, à 11 heures ½ du matin, près de la tombe de Mme Marguerite, que le général s'est tué d'un coup de * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
C'est en vain! Je ne suis pas encore assez forte aujourd'hui.
228.—Samedi 10 octobre.
Depuis que son Amie l'avait quitté, le général ne vivait plus que dans la pensée de la rejoindre. Il se faisait conduire au cimetière tous les jours, à 4 heures, y portait des fleurs et restait longuement en méditation devant le tombeau. Il habitait sa chambre, il couchait dans le lit où elle était morte, et la nuit, pendant les rares instants de sommeil qu'il parvenait à trouver, il lui parlait et il entendait en rêve sa voix qui l'appelait.
Quand la tombe fut complètement achevée, il s'est mis à trier ses papiers, dont il a jeté au feu, tous les jours, une grande quantité. Il a réglé les comptes de tous les fournisseurs, quelques jours avant la fin du mois. Le 29 septembre, il a écrit son testament politique, contenant ces lignes:
«Je me tuerai demain, non pas que je désespère de l'avenir du parti auquel j'ai donné mon nom, mais parce que je ne puis supporter l'affreux malheur qui m'a frappé il y a deux mois et demi. Depuis deux mois et demi, j'ai lutté. J'ai essayé de prendre le dessus. Je n'ai pu y parvenir.
»Je suis convaincu que mes partisans si dévoués, si nombreux, ne m'en voudront pas de disparaìtre en raison d'une douleur telle que tout travail m'est devenu impossible...
»En quittant la vie, je n'ai qu'un regret: ne pas mourir sur le champ de bataille, en soldat, pour mon pays...»
Il a écrit en même temps son testament privé, léguant tout son avoir à sa cousine, Mlle Mathilde Griffith, donnant son cheval Tunis à un ami, M. Barbier, et exprimant la volonté formelle d'être enterré dans le caveau qu'il avait fait construire pour Marguerite.
Sur l'un et sur l'autre testaments, il a ajouté:
Ceci est écrit en entier de ma main, à Bruxelles, 79, rue Montoyer, le 29 septembre 1891, veille de ma mort.
Après quoi, il a signé.
Il a rédigé ensuite une lettre destinée à sa vieille mère, où il lui expliquait tendrement qu'il partait pour un long voyage. La malheureuse femme ayant l'entendement affaibli par la grande vieillesse, cette lettre devait servir à lui cacher que son fils était mort.
Il a libellé de sa propre main des dépêches annonçant sa mort à diverses personnes, une, entre autres, pour la générale, sa femme, qu'il a adressée ainsi:
«Madame Veuve Boulanger,
Rue de Satory, Versailles.»
Ces dépêches, il les a placées dans une grande enveloppe, sur laquelle il a écrit:
Télégrammes à expédier immédiatement après ma mort.
à 4 heures, il est allé déposer les testaments chez son notaire. Cela fait, il a accompli son pèlerinage quotidien à la tombe d'Ixelles. Après l'avoir longtemps contemplée, il est entré chez le conservateur du cimetière, M. Marchal, lui a serré la main et lui a recommandé d'une voix émue les frêles arbrisseaux qu'il avait fait planter autour de la tombe, afin qu'ils l'abritent de leur ombrage plus tard.
Le soir, à dìner, il s'est montré d'une bonne humeur inaccoutumée. Il a causé gaìment avec un ami qui se trouvait depuis quelques jours son hôte, M. Dutens. En se levant, il a embrassé sa vieille maman avec une tendresse particulière.
Vers 10 heures du matin, le mercredi 30 septembre, il a fait atteler son coupé et il est sorti sans en avertir personne. Mais son absence a été presque aussitôt remarquée par M. Dutens, qui ne le perdait plus de vue depuis qu'il l'avait surpris dans son bureau, quelques jours auparavant, tenant un revolver à la main.
Saisi d'un pressentiment, M. Dutens est sauté en fiacre et s'est fait conduire au cimetière. Le général s'y trouvait, en effet, devant le caveau. En voyant la mine inquiète de son ami, il a eu un sourire. Il lui a pris le bras et s'est mis à se promener avec lui à travers les tombes, tout en le rassurant d'un ton enjoué. Quand il l'eut suffisamment tranquillisé, il l'a invité à aller renvoyer son fiacre, devenu inutile puisque le coupé était là pour les ramener tous deux. Il était 11 heures ½. Le général a fait le tour du tombeau et s'est assis du côté droit, sur le rebord du soubassement, le dos appuyé contre la pierre tombale, les jambes étendues vers le lilas planté tout auprès. Il a posé son chapeau à terre, a sorti un revolver de sa poche, l'a appliqué contre la tempe droite et a fait feu.
La balle a troué le cerveau de part en part, puis elle est allée se perdre par delà le mur du cimetière. On est accouru au bruit de la détonation, mais déjà le général expirait. Son corps n'avait pas bougé, sa tête pendait sur la poitrine, un fort jet de sang s'échappait de chaque tempe.
Le revolver était resté dans sa main crispée, on l'a retiré. Le corps tout ensanglanté, étendu dans le coupé, a été ramené par M. Dutens à l'hôtel de la rue Montoyer. En le déshabillant, on a trouvé sur le cœur, complètement détrempée de sang, la boucle de cheveux que le général avait coupée à son Amie morte. La grande photographie de Mme Marguerite, semblable à celle qu'elle m'a donnée, occupait, sous la chemise, toute la largeur de la poitrine. Le sang desséché la collait si fort contre la peau qu'on ne put l'enlever sans la déchirer par places.
On a revêtu le corps d'un habit de soirée avec la plaque de grand-officier de la Légion d'honneur. On a laissé au doigt la bague en fer à repasser. On a joint les deux mains sur la poitrine et l'on a placé un crucifix entre deux candélabres, près du lit mortuaire.
La nouvelle du suicide s'était rapidement répandue en ville. à trois heures de l'après-midi, on la criait dans les rues de Paris, et elle courait dans toutes les bouches à la brillante garden-party que M. et Mme Carnot offraient à l'Élysée. Sur les six heures, je recevais la désespérante dépêche qui me l'apprenait et qui m'étendait à terre comme un coup de massue.
Le 1er octobre, à 9 heures du soir, on a mis en bière le corps du général, après avoir replacé sur sa poitrine la photographie et la boucle de cheveux, et après avoir mis à ses pieds des œillets rouges. Le cercueil portait une croix en palissandre et une plaque de cuivre sur laquelle on avait gravé: «Général Boulanger.»
Les funérailles ont eu lieu le 3 octobre. Le cardinal-archevêque de Malines ayant refusé l'assistance de l'Église, le cortège s'est rendu, à 4 heures, directement de la maison au cimetière. Le cercueil était recouvert d'un grand drapeau tricolore. Le corbillard disparaissait sous l'amoncellement des couronnes. Derrière lui, étaient portés, sur des coussins, tous les insignes et toutes les décorations du général défunt.
Henri Rochefort, Paul Déroulède, une vingtaine de députés, plus de deux cents délégués venus de France, marchaient ensuite. Une moitié de Bruxelles accompagnait le cortège, et l'autre le regardait passer. à l'entrée du cimetière, il y a eu une bousculade si épouvantable que de nombreuses personnes ont été blessées. Il n'y a pas eu de discours. Déroulède a jeté sur le cercueil du proscrit un peu de terre de France. Puis, le caveau des deux amants a été fermé.
229.—Vendredi 1er janvier 1892.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Depuis des mois, ils ne sont plus.
Leurs dépouilles charnelles se désagrègent dans un même sépulcre, jusqu'au jour où, s'échappant de leurs cercueils tombés en poussière, leurs cendres se confondront.
Mais leurs âmes vivent, et, en dépit des préjugés sociaux, en dépit même de la sévérité qu'a pu montrer un prince de l'Église, elles doivent avoir trouvé, dans l'au-delà, une pitié sans bornes qui leur a tout pardonné, parce qu'elles ont immensément aimé.
Et, tant qu'il y aura des hommes sur la terre, c'est-à-dire de pauvres êtres destinés à aimer, à souffrir et à mourir, leur souvenir et leur nom survivront, enlacés...
230.—Lundi 25 avril 1892.
N'oubliez pas... Venez nous voir quand nous serons là-bas!...»
Elles n'ont pas cessé de résonner dans ma mémoire, ainsi qu'une suprême invite, ces paroles, les dernières qu'Elle m'eût adressées, à Saint-Brelade, quand je les ai quittés.
Il y a de cela un an juste, jour pour jour, et je suis venue les voir aujourd'hui.
Arrivée à Bruxelles pour eux et rien que pour eux, j'y ai visité toutes les stations de leur calvaire. D'abord, très haut dans la rue Royale, au delà de la colonne du Congrès, au nº 103, sur la droite, cet hôtel Mengelle, leur première étape après la fuite. Au début de la même rue, sur la place Royale, l'hôtel de Bellevue, où elle s'est fait amener de Paris, presque mourante déjà, avant les dernières semaines passées à Jersey, et dont les fenêtres de façade donnent sur l'église Saint-Jacques en laquelle son cercueil a été béni. Un peu plus loin, allant du Parc Royal au Parc Léopold, la rue Montoyer, une belle rue aristocratique et tranquille, aux maisons blanches et aux portes cochères fermées. Tout au bout, les dépendances d'une gare: des murs en briques noircies par la fumée, des palissades de bois, un passage à niveau de chemin de fer. Un peu avant d'y atteindre, à droite, le nº 79, où ils ont passé les derniers mois de leur vie, où Elle est morte, et où son cadavre à Lui a été ramené, couvert de sang. Une façade blanche, une porte cochère, quatre fenêtres de rez-de-chaussée, et deux autres étages à cinq fenêtres chacun.
Rue d'Arlon, rue du Parnasse, rue Caroly, rue de Dublin, rue de la Paix, chaussée d'Ixelles: c'est l'itinéraire qu'a suivi le cortège du suicidé.
La route traverse de tristes paysages de banlieue. Des maisons de plus en plus clairsemées, les unes vieilles, basses et noires, les autres à peine construites, tout en briques, en fer et en verre. Des terrains à bâtir, des carrés rougeâtres de terre argileuse fraìchement remuée, des plants de culture maraìchère, des prés où paissent des moutons, et, de-ci de-là, des hangars de marchands de tombes et des serres d'horticulteurs pour couronnes mortuaires.
Une petite place ronde: voici l'entrée du cimetière. Je quitte la voiture, portant dans mes bras le buisson de marguerites que je leur apporte de Royat, poussé en bonne terre de France. Une courte avenue me mène à un rond-point, d'où rayonnent cinq autres avenues, précédées chacune de deux grands cyprès en forme de cônes.
Laquelle prendre? On me montre la troisième, juste en face. Elle est plantée de jeunes acacias, et entièrement garnie de tombes des deux cotés. Elle se termine, au bout d'une centaine de mètres, à un petit carrefour formé par l'entre-croisement de la 10e avenue, qui longe, à gauche, le mur du cimetière, et de l'allée nº 6, qui descend vers la droite. La dernière tombe, à gauche, au coin, est la leur.
Bien simple, la pauvre tombe. Un soubassement précédé, en avant, de deux marches, une pierre tombale inclinée, et, à son sommet, une colonne brisée. Le tout en pierre grise, blanchâtre.
Une grille basse, à glands dorés, entoure le caveau et les deux petits espaces laissés libres de chaque côté. Elle n'a pas plus de cinq mètres en longueur sur trois à quatre en profondeur. Plus de cinquante couronnes y pendent, la plupart en feuilles de zinc ou en perles de verre, envoyées par les Comités révisionnistes. Parmi elles, quelques minces couronnes en plâtre, offertes par des pauvres et aussi quelques fleurs desséchées.
La grille est précédée d'une bande de terre large d'un mètre, où poussent des pensées et des myosotis. Au fond, des cyprès dressent leur silhouette sombre et à droite, tout au coin, s'élève un sapin nain.
Dans l'intérieur de l'enclos, des rosiers vont bientôt fleurir. à droite, à un mètre et demi de la tombe, on a laissé debout le lilas qui a été témoin du suicide. La place où le général s'était assis, sur la bordure du soubassement, se trouve à peu près à la hauteur de l'avant-dernière ligne de l'inscription gravée sur la pierre tombale.
Cette inscription, je n'ai pu d'abord la distinguer, car un grand bouquet de marguerites, lié avec des rubans tricolores, se trouvait jeté là et la couvrait. J'avais déposé mes marguerites au pied du tombeau, je m'étais agenouillée sur le bord du chemin et, le cœur gonflé d'une douleur sans nom qui ne voulait pas éclater en larmes, j'ai prié. Puis, j'ai fixé longuement jusqu'aux moindres détails de ce que j'avais devant moi, afin de ne l'oublier jamais.
Des pas approchaient, des gens venaient vers moi. Je me suis relevée et me suis mise à marcher à travers le cimetière. Du petit carrefour voisin de la tombe, j'ai contemplé la campagne, les vertes prairies pleines de troupeaux et, plus loin, la fraìche verdure printanière du bois de la Cambre. Le site était si champêtre et le petit cimetière si blanc, si propre, que l'aspect en était presque gai. Le soleil semait des étincelles sur la dorure des croix et sur le poli des granits.
Je revins vers leur sépulture pour lui jeter un dernier regard. On venait d'y toucher. Mes marguerites étaient maintenant dans l'intérieur de l'enclos et le bouquet jeté sur la pierre tombale en avait été retiré. J'ai pu alors la lire, scintillante sous le soleil, l'épitaphe qui clôt l'histoire des deux amants:
marguerite
19 décembre 1855
16 juillet 1891
à bientôt!
———
georges
29 avril 1837
30 septembre 1891
ai-je bien pu vivre deux mois et demi sans toi?
MONT-LOUIS.—CLERMONT-FERRAND
[1] Si je veux battre ma bourrique, Je trouverai bien toujours une trique.
Bruxelles, 79 rue Montoyer.
Jeudi 9 juillet.—
Ma bonne meunière,
C'est moi qui réponds aujourd'hui à votre lettre d'il y a un mois et à celle que nous recevons aujourd'hui. Madame de B—- en effet quoique allant beaucoup mieux, est toujours alitée et ne pourrait pas écrire sans fatigue. Elle a été fortement éprouvée; mais les soins qui lui sont donnés par un médecin que j'ai fait venir de Paris permettent de prédire pour bientôt la convalescence. La toux a presque disparu, les transpirations également. Quand elle aura repris un peu d'appétit, les forces reviendront.—
Elle me charge de vous dire de sa part milles et milles choses affectueuses; nous pensons à vous et nous parlons souvent de vous.
écrivez-nous; donnez-nous de vos nouvelles. Vous êtes maintenant en pleine saison et il faut espérer que les beaux temps une fois arrivés, les baigneurs ne vous manqueront pas—
Vous ne nous dites rien de la santé de votre mère et de votre sœur; nous espérons donc qu'elles vont bien.—
Au revoir, ma bonne meunière. Tous les deux nous vous envoyons nos souvenirs les plus affectueux,
Gal B.
Bruxelles, 79 rue Montoyer.
Samedi 1er août.
C'est bien vrai ma pauvre bonne meunière, elle n'est plus, cette créature adorable qui m'a donné les seules années de bonheur que j'ai eues dans ma vie. Elle est partie, me laissant seul, tout seul; et au moment même où l'amélioration produite par un traitement nouveau de Paris me faisait croire qu'elle était sauvée.—
Heureusement la chère créature tant aimée ne s'est pas sentie mourir. Elle s'est éteinte sans aucune souffrance, faisant encore des projets la veille de sa mort. Je dis heureusement; car elle eût été trop attristée si elle avait compris que nous allions être séparés; pas pour longtemps, je l'espère.—
Sa famille voulait avoir son corps. J'ai refusé, et je le garde, je la garderai envers et contre tous.—Ma seule consolation est d'aller toutes les après-midis au cimetière la voir et causer avec elle. J'ai placé moi-même dans son cercueil le charmant bouquet de petites marguerites que vous et votre sœur lui avez envoyé. Merci en son nom.
Je lui fais en ce moment construire un caveau, où elle reposera en paix au milieu des fleurs quelle aimait tant, et où elle m'attendra...—
Car, vous qui l'avez connue, vous devez comprendre, n'est-ce pas, qu'on ne peut survivre à la perte de cet ange de beauté, de grâce, de douceur et de bonté. Je sais que je ne m'appartiens pas, que j'appartiens à mon pays aussi j'irai jusqu'au bout de mes forces; mais après, si je pars, personne n'aura rien à me reprocher. D'ailleurs je ne vis plus que matériellement; je suis sur corps sans âme.—
écrivez-moi de temps en temps, ma bonne meunière Parlez-moi d'elle, cela me fera du bien. Et pensez souvent à moi, qui ai été le plus heureux des hommes, et qui en suis aujourd'hui le plus malheureux.—
J'espère que vous allez bien, ainsi que votre mère et votre sœur; et, pour moi et pour ma pauvre petite morte tant aimée, je vous embrasse de plus profond de mon cœur,
Gal Boulanger
écrivez-moi toujours à la même adresse.—
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.