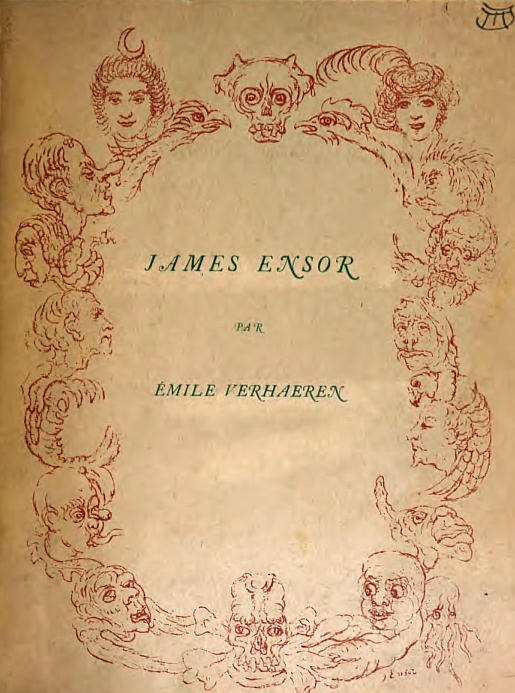
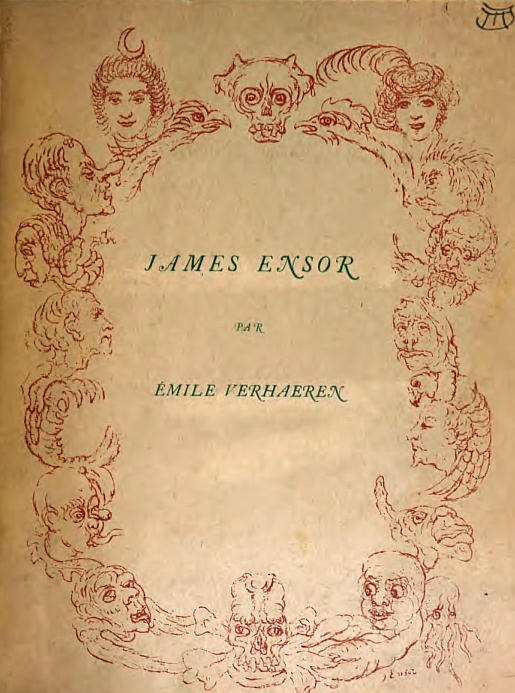
Souvent, des vagues venant du côté de l'Angleterre s'engouffrent nombreuses et larges dans le port d'Ostende. Et les idées et les coutumes suivent ce mouvement marin.
La ville est mi-anglaise: enseignes de magasins et de bars, proues hautaines des chalutiers, casquettes d'agents et d'employés y font briller au soleil, en lettres d'or, des syllabes britaniques; la langue y fourmille de mots anglo-saxons; les gens des quais y comprennent le patois de Douvres et de Folkstone; des familles londoniennes s'y sont établies jadis, y ont fait souche et marié leurs filles et leurs fils non pas entre eux mais aux fils ou aux filles de la West-Flandre. Le service quotidien des malles voyageuses resserre tous ces liens divers, comme autant de cordes tordues en un seul cable, si bien qu'on peut comparer la grande île à quelqu'énorme vaisseau maintenu en pleine mer, grâce à des ancres solides dont l'une serait fixée dans le sol même de notre côte.
Cette influence d'outre-mer qui imprègne le milieu où il naquit suffirait certes à expliquer l'art spécial de James Ensor. Toutefois elle se précise encore si l'on note que l'ascendance paternelle de l'artiste est purement anglaise. Le nom qu'il porte n'est point flamand. C'est à Londres, qu'il se multiplie aux devantures. Je le vis flamboyer, un soir, dans Soho-square et plus loin il se projetait—réclame mouvante—sur un trottoir d'Oxford street.
L'œuvre que nous étudierons et exalterons s'élève donc au confluent de deux races—races saxonne, race flamande ou hollandaise—harmonieusement mêlées dans le sang et dans l'âme d'un très beau peintre.
L'erreur serait grande si l'on se figurait qu'à cause de ses origines britaniques, Ensor se soit complu à réapprendre comme certains peintres modernes l'art des Reynolds ou des Gainsborough ou se soit assimilé n'importe quelle méthode des préraphaelites illustres. L'anglomanie qui s'est glissée jusque dans l'esthétique l'a épargné. Ce n'est point par des qualités extérieures et souvent artificielles qu'il se rattache aux maîtres de là là-bas, mais bien, naturellement, par certains dons fonciers et rares. Il est de leur famille, sans le vouloir. Il est audacieux et harmonieux comme Turner, sans qu'il s'y applique, sans qu'il s'en doute. Il aime les effets tumultueux et larges de Constable sans qu'aucune de ses toiles fasse songer aux paysages célèbres de ce grand peintre. La parenté est souterraine et comme secrète. Elle se manifeste dans la manière de comprendre et d'aimer la nature, dans la sensibilité aiguë de l'œil dans la franchise et l'audace des conceptions, dans la pratique du dessin pictural, dans la délicatesse mêlée à la force, dans la plaisanterie unie à la brutalité. Dès que cette dernière caractéristique est atteinte, James Ensor rejoint non plus Constable ni Turner, mais Gillray et Rowlanson plus encore que Jérôme Bosch ou Pierre Breughel.
Encore que l'influence anglaise agisse avant toute autre sur elle, c'est toute l'Europe et l'Amérique qui transforment pendant l'été, quand la saison balnéaire s'inaugure, Ostende. Les jeux et les fêtes l'exaltent tout à coup. Les femmes du quartier Marbeuf envahissent sa digue. Le monde qui l'hiver se groupe à Monte-Carle, à Menton, à Biarritz s'y concentre. Des nuits de lourde et chaude volupté s'y passent à la lueur de flambeaux. La chair s'y mire et s'y pavane aux miroirs de cabarets fastueux. Et la folie des villes frémissantes et trépidantes brûle soudain ce coin de Flandre calme et foncièrement sain et propage sa fièvre nocturne et flamboyante tout au long de la mer.
Magasins de Paris, boutiques de Vienne, comptoirs chargés de coraux de Naples et de Sicile, brasseries de Dortmund et de Munich, caves remplies de vins de Portugal et d'Espagne vous installez votre barriolage de goûts et de couleurs devant les mille désirs populaires ou mondains, devant les appétits vulgaires ou rares, devant les convoitises baroques ou distinguées. La flânerie des promeneurs s'en va, à droite, vers le port, à gauche, vers le champ de courses, en partant de la rampe de Flandre où James Ensor habite. A cette large voie se relie en outre toute la ville basse avec ses rues étroites, les unes venant de la grand' place, les autres du théâtre, celle-ci de la gare et celle-là du marché. Le carillon n'est pas loin: on l'entend tricoter sa musique menue, le soir, ou bien, aux midis de réjouissances, ruer de toutes ses notes et s'emporter vers quelque hymne national.
La foule et ses remous passe donc à toute heure du jour devant les fenêtres du peintre: foule élégante ou hautaine, foule grotesque ou brutale, cortèges de la mi-carême, processions de la fête-Dieu, fanfares rétentissantes des villages, sociétés chorales des villes voisines, cris, tumultes, vacarmes.
Et ces flux et ces reflux de gestes et de pas aboutissent tous là-bas, à cette féerie de verre et d'émail qu'est le Kursaal d'Ostende.
Avec ses dômes et ses pignons et ses rosaces et ses lanternes, avec ses ors élancés et ses bronzes trapus, avec ses festons de gaz et ses couronnes de feux, il apparaît, toutes portes et fenêtres ouvertes, comme un tabernacle de plaisirs éclatants et sonores. Un orchestre savant y fait naître, chaque jour, des floraisons de musique; des voix illustres s'y font entendre—orateurs ou conférenciers—et des virtuoses dont le nom émeut les mille échos y jettent vers l'applaudissement en tonnerre des foules, les phrases les plus belles des maîtres célèbres. Toutes les langues s'y parlent. Joueurs, financiers, gens de course, gens de bourse, princes et princesses, dames du monde et courtisanes, tout s'y coudoie ou s'y toise; s'y méprise ou s'y confond.
Le soir, quand les verrières du monument flamboient face à face avec la nuit et l'océan, on peut croire que le bal y tournoie en un décor d'incendie. Du fond de la mer s'aperçoivent les hautes coupoles illuminées et le phare dont la lueur troue les lieues et les lieues semble ne lancer si loin son cri de lumière que pour héler vers la joie le cœur battant de ceux qui traversent l'espace.
Ainsi pendant l'été tout entier Ostende s'affirme la plus belle peut-être de ces capitales momentanées du vice qui se pare et du luxe qui s'ennuie. Et ce n'est pas en vain que chaque année James Ensor dont l'art se plaît à moraliser cyniquement, assiste à cette ruée vers le plaisir et vers la ripaille, vers la chair et vers l'or.
La chambre où il travaille ouvre, là haut, au quatrième d'une maison banale, son unique et peu large fenêtre. De tous les peintres modernes Ensor est le seul qui jamais ne se soit mis en quête d'un atelier. Lui le chercheur de lumière il campe ses toiles en un jour médiocre tombant non pas d'une verrière mais à travers les pauvres carreaux d'une baie verticale et parcimonieuse de clarté. Pourtant que de pages merveilleuses s'y élaborent et que de tons admirablement harmonisés y juxtaposent leurs musiques inentendues!
Celui qui surprend Ensor, la haut, dans son travail, le voit surgir d'un emmêlement d'objets disparates: masques, loques, branches flétries, coquilles, tasses, pots, tapis usés, livres gisant à terre, estampes empilées sur des chaises, cadres vides appuyés contre des meubles et l'inévitable tête de mort regardant tout cela, avec les deux trous vides de ses yeux absents. Une poussière amie recouvre et protège ces mille objets baroques contre le geste brusque et intempestif des visiteurs. Ils sont là chez eux pour que seul le peintre leur insuffle la vie, les interroge les fasse parler et les introduise dans l'art grâce à la sympathie qu'il leur voue et l'éloquence secrète qu'il découvre en leur silence.
Il est opportun de se figurer James Ensor en tête à tête quotidien et prolongé avec ces effigies en carton et en plâtre, avec ces débris d'existance et de splendeur, avec ces défroques ternes ou violentes pour comprendre quelques-unes des surprises de son caractère et quelques traits profonds et spéciaux de son art. Il est certain que pour lui, à telles heures d'illusion souveraine, un tel assemblage de visages, d'attitudes, d'ironies ou de détresses a dû représenter la vie. Elle lui est apparue mauvaise, déplorable, hostile. Elle lui a enseigné la misanthropie que seuls corrigent la farce, le rire et le sarcasme.
L'existence d'Ensor entouré d'un tel décor familier ne manque pas de paraître énigmatique et bizarre et je ne crois pas qu'il lui répugne de maintenir autour de lui ces apparences. Ses paroles qui souvent déconcertent, ses saillies drôles, ses rires soudains et furtifs, sa voix sourde, sa marche lente et l'éternel parapluie qui toujours l'accompagne comme s'il se défiait du plus fidèle et du plus loyal soleil confirment l'étrange impression qu'il produit volontairement ou ingénûment, qu'importe.
Personne que je sache ne met moins de mise en scène dans l'accueil. Les œvres qu'il montre ne toisent pas le visiteur du haut d'un chevalet comme pour lui imposer leur présence autoritaire. Ses toiles ne sont pas même tendues. Elles gisent roulées les unes sur les autres, en des coins obscurs. Elles apparaissent à la lumière ployées et gondolées et c'est avec peine qu'on leur trouve une zône de clarté propice afin qu'elles s'y étalent sans trop se nuire entre elles. Aucun commentaire n'accompagne leur présentation. Seul un rire menu, quand le sujet étonne et froisse quelque goût trop puritain. Et les œvres succédent aux œuvres et quand tout est montré, toujours, soit au fond d'un coffre, soit au fond pièce voisine se découvre une merveille oubliée dont la crasse voile la fraîcheur et la beauté. Un coup d'éponge donné à la hâte réveille la splendeur endormie.
On dégringole l'écalier raide et tournant et l'on quitterait, la poignée de main échangée, la maison du peintre, sans plus, si le magasin du rez-de-chaussée, avec ses larges vitrines encombrées de bibelots ne retenait, un instant encore, l'attention. C'est que là, parmi les coquillages et les nacres, les vases de la Chine et les laques du Japon, les plumes versicolores et les écrans barriolés, l'imagination visuelle du peintre se complait à composer ses plus rares et ses plus amples symphonies de couleurs. Oh les notes à la fois tendres et fortes, à la fois subtiles et brutales, à la fois sobres et éclatantes qu'il sût faire vibrer en prenant comme prétexte quelque pauvre bibelot d'orient que la mode banalisa! Et la coquille ourlée dont le bourgeois morose ornera sa cheminée en marbre peint deviendra grâce à la magie, grâce à l'hermétisme de l'artiste, ce miracle de couleur triomphante dont s'éblouiront les salles les plus belles des musées modernes.
Ensor se plaît parmi ces mille riens exotiques parmi ces dépouilles luisantes ou vitreuses de la mer. Lui même s'intéresse parfois au trafic qu'en font et sa mère et sa tante, marchandes tenaces et expérimentées. Souvent le soir, la causerie rassemble autour des comptoirs la famille entière. La sœur du peintre et sa nièce qu'il affectionne vivement sont là. Et l'on parle d'Ostende, non pas de l'Ostende ruée aux fêtes et aux plaisirs de l'été, mais de l'Ostende automnale qui se plaît dans la déréliction et le silence. Ensor adore celle-ci avec ses rues étroites, ses places humbles et désertes, ses petites boutiques vieillottes au fond des quartiers populaires et ses propres et luisants estaminets où l'odeur de la bière se mêle à des relents de poisson sec et de crevettes humides. C'est là qu'il dessina maint pêcheur à vareuse bleue, à boucles d'oreilles étroites, à pantoufles multicolores. C'est là qu'il rencontra et qu'il interpréta en des croquis larges et vivants, les vieilles femmes à mantelets, avec de lourds et noirs capuchons de drap recouvrant leur intact et fragile bonnet blanc.
La vie du port est la seule vie d'Ostende, l'hiver. Elle ne pénètre point la ville; elle n'anime que ses confins. C'est une vie en bordure. Oh les câbles et les amarres au long des quais, les voiles rousses et brunes dans le brouillard gris, les proues sculptées des vieux navires s'apercevant du fond d'une ruelle et les mouettes blanches, entrant dans les bassins et volant, dirait-on, à travers les entrecroisements dédaliens des haubans et des vergues! Et les petites boutiques, en plein vent, à l'angle des ponts et les plies et les limandes qui sèchent dans le courant d'air des fenêtres et la marmaille grouillante parmi les écailles de moules versées en tas, sur le trottoir! O cette vie comme goudronnée au contact des bateaux, des cordes et des voiles; cette vie tranquille, têtue et dangereuse qui fait les races calmes ou violentes comme ces mers du Nord dont elles vivent depuis mille ans. Elle n'a qu'un sursaut, en Février, aux temps du carnaval. Et combien mélancolique et brutal! Et combien morne et quelquefois sanglant!
Ensor a traduit cette liesse en des œuvres quasi sinistres et qui étonnent et qui font peur. Le pittoresque de l'accoutrement, l'usure de la défroque, la drôlerie muette de masque, l'ennui qui semble suinter des murs tout se ligue pour provoquer une impression sombre avec des éléments soi-disant gais.
Je me souviens d'un Mardi gras passé à Nieuport, jadis, avec des amis. Jamais je ne compris mieux la folie et la tristesse des masques d'Ensor.
Des groupes ivres battaient les rues. En des salles de danse, à moitié désertes, avec de pauvres musiciens grelottant de froid dans un coin, la valse fouettait deux ou trois couples tournoyants et muets, avec les lanières usées de sa musique banale et sifflante. Un ivrogne, orné d'un faux nez violet, titubait près du comptoir et sa commerre dépoitraillée et gisante contre une cloison, mordait, machinalement, les crins de sa perruque descendue sur ces yeux. Un bout de bas blanc passait à travers les trous de son soulier. Un hoquet lourd et profond lui sécouait, de temps en temps, le ventre. Et l'ivrogne riait et pleurait tour à tour devant elle.
Lorsque James Ensor se plaisait à traduire par le pinceau de telles scènes grotesques et lamentables, il était le compagnon falot qu'Eugène Demolder, assignait, sous le déguisement de Fridolin, au grand Saint Nicolas. James Ensor donnait la réplique, dans le livre du poète d'Yperdamme, au joyeux et doux patron des petits enfants de la West-Flandre. Il jouait, en ce temps là, de la flûte et se promenait, avec deux carlins boulus, renfrognés et fidèles.
L'effigie qu'Henri de Groux vient de nous donner de James Ensor nous le représente robuste et presque gras. Les cheveux grisonnent, le teint s'enlumine, l'allure est massive. L'appuie-main tenu entre les doigts fait songer vaguement à quelque sceptre. Ensor semble commander à son art dont une page caractéristique se devine au fond de la toile. Le voici donc tel que l'âge mûr le définit. Au surplus l'œuvre compte et s'affirme excellente.
Toutefois j'aime à me souvenir d'un tout autre James Ensor, celui que je connus, il y a vingt ou vingt-cinq ans, avec un corps svelte, un teint pâle, des yeux clairs, des mains longues fiévreuses et fines. Non pas un dandy, car une mise négligée presque toujours rejetait cette comparaison, mais une sorte de jeune parlementaire britanique qui faisait songer à Disraeli.
James Ensor parlait peu, se tenait sur la réserve, avec un air fermé et craintif. On lui prêtait un caractère difficile et ombrageux. Il avait certes, la pleine conscience de sa force naissante; il n'admettait aucune restriction sur l'entière personnalité de son art et se rebiffait, dès que l'ombre d'une injustice l'effleurait dans la mêlée de la vie. La haine de la critique bouillonnait en lui, comme chez tous les artistes vrais et impérieux. Il ne pouvait admettre qu'on ne le comprit pas et que sa peinture qui lui paraissait toute simple et naïve ne s'imposât point, du premier coup, grâce à sa sincérité absolue. Il oubliait la difficulté ardue, que rencontre tout esprit dès qu'il veut pénétrer de sa lumière à lui quelqu'autre esprit fut-il voisin du sien et combien le baptême de l'hostilité et du dénigrement est salutaire à toute originalité naissante. C'est parce qu'il fut bafoué, nié, villipendé jadis que sa victoire aujourd'hui nous apparaît si consolante et si belle. La gloire ne se livre pas; elle se prend d'assaut. Elle se retranche derrière une muraille d'hostilités et de sarcasmes.
Tout artiste vrai est un héros ingénu. Il faut qu'il souffre pour qu'un jour il ait la joie d'imposer a tous sa victorieuse personnalité totale. En ce temps-ci ou chacun est tout le monde, le poète, le peintre, le sculpteur, le musicien ne vaut que s'il est authentiquement lui-même. C'est le plus réel des privilèges que la nature, sans aucune intervention autre que celle de sa puissance, confère et maintient à travers les siècles et seul le poète, le peintre, le sculpteur, le musicien en peut jouir pleinement.
Oh ces débutants choyés dès qu'ils apparaissent et par la critique et par le public! Aucune de leurs toiles ne survit après vingt ou trente ans. Ils n'ont jamais passionné personne. Ils n'ont connu ni la révolte de leurs maîtres, ni la jalousie de leurs amis, ni la haine de la foule. Ils ont été banalement heureux en attendant qu'ils soient banalement quelconques. Les Salons triennaux out accueilli leurs essais à la rampe mais les Musées rejetteront bientôt leurs œuvres dans les coins. Ces peintres-là sont morts depuis longtemps quand sonne leur agonie. Et leur nom de plus en plus pâle, de plus en plus éteint, de plus en plus oublié ne trouve plus refuge qu'aux pages jaunies d'un catalogue ou il finit par se confondre avec un pauvre et morne numéro.
Il importe donc d'aimer et les attaques et les batailles, les coups portés avec enthousiasme et reçus avec courage. L'ivresse suprême réside dans la conscience qu'on a d'être une belle force humaine. Et rien ne l'exalte autant que la violence et l'injustice. L'émeute autour d'une toile nouvelle est un sacre à rebours. L'artiste y doit puiser non l'abattement mais le lyrisme. Sa vraie vie commence, dès cet instant. Et l'œuvre doit succéder à l'œuvre, sans compromission, sans reticence, audacieusement, toujours, jusqu'à l'heure où cessera le rire et se taira la huée. Et qu'importe si la colère montante ne se retire que devant le tombeau. Les triomphes posthumes sont les plus sûrs.
Je doute que James Ensor ait admis ces vérités aux temps de sa jeunesse, mais je sais qu'il a toujours agi comme si leur lumière vivait en son esprit.
L'époque pendant laquelle débuta James Ensor fut pour la patrie, un laps de temps héroique et fécond. Aujourd'hui qu'il est loin, il apparaît quasi légendaire.
Un miracle se fit tout à coup. Le pays, habitué à ne produire que des peintres, suscita des sculpteurs et parmi eux un génie: Meunier. Bien plus; la Belgique hostile aux lettres et vouée depuis longtemps à la littérature des parlementaires et des journalistes, se para d'une floraison de poètes.
Les coutumes furent à tel point bousculées, les réputations assises à tel point secouées sur leurs sièges, qu'il y eut comme un tremblement des cerveaux. On n'osait y croire; on n'y croyait pas. Notre sol qui se couvrait du seigle annuel des lucratives affaires et du froment régulier des prospères négoces ne pouvait tout à coup se modifier assez profondément pour nourrir de sève et exalter vers la lumière des odes belles comme des chênes et des idylles fragiles et jolies comme des arbustes. L'extraordinaire fut taxé d'impossible et des «bouches autorisées» déclarèrent qu'en tous cas le prodige n'aurait pas de suites.
Il en eut d'admirables.
Malgré les oppositions soit franches, soit sournoises, malgré les mille cris des feuilletonistes inquiétés dans leurs goûts et leurs habitudes, malgré la compacte et massive inertie et la bêtise au front non pas de taureau mais de bœuf, les nouveaux écrivains s'affirmèrent, d'année en année, plus clairs, plus hauts, plus purs. Si bien qu'aujourd'hui ils sont tout et leurs détracteurs d'antan, rien. L'opinion a été retournée comme un vêtement dont on secoue les poussières, dont on vide les poches des vieux préjugés qu'elles recélaient, dont on brosse le drap depuis le col jusques aux pans et qu'on désinfecte enfin en tous ses plis. Aujourd'hui les générations littéraires se succèdent les unes aux autres, comme les générations des peintres; l'art d'écrire est acclimaté parmi nous; la presse est passée aux mains des écrivains, la foule se fait attentive et le pouvoir récompense et s'émeut. C'est une victoire qu'on ne conteste plus.
Or, ces prosateurs et ces poètes de la vie dans la phrase se virent attaqués en même temps que les peintres de la vie dans la lumière. Leurs ennemis se liguaient entre eux; ils se liguèrent entre eux contre leurs ennemis. Cela se fit avec entrain et naturel parce que la nécessité souveraine nouait elle-même les liens d'entente. Le consentement fut tacite et rapide.
Jamais les polémiques d'art ne furent aussi vives, aussi ardentes, aussi impitoyables. On frappait avec des poings sauvages; on n'avait égard ni à la vieillesse ni aux situations prises; on était fier d'être partial et féroce. La norme était franchie joyeusement, ventre à terre; toute réticence devenait trahison, toute justice rendue aux adversaires raison de blâme et de défiance. La tolérance est une force de l'âge mûr. Elle est une tare et une faiblesse quand on se trouve à la tête de ses vingt ans.
Oh l'orage des discussions autour des noms de Khnopff, de Schlobach, de Van Rysselberghe, de Dario de Regoyos, de Wytsman, de Finch, de Toorop et d'Ensor! La belle mêlée de colères et sarcasmes! Les lourdes attaques et les folles défenses! Les fiers éclairs dont on foudroyait les esthétiques vieillies et les règles désuètes. On s'exposait avec joie, on dardait son audace partout et l'on se reprochait sans cesse de n'avoir pas été assez violemment téméraire. Vraiment la vie passionnée était belle, en ce temps-là!
Les peintres novateurs s'étaient d'abord cantonnés à l'Essor, société d'art où se mêlaient des talents avancés et rétrogrades. Une scission eut lieu. Elle était fatale. Les plus hardis s'en allèrent, laissant végéter le cercle où s'éteignaient, une à une, toutes les flammes des forces et des ardeurs.
Les XX furent crées. L'idée en est due, m'assure-t-on, à Charles Van der Stappen qui s'en ouvrit à Octave Maus et à Edmond Picard. Cela se passait, au temps des vacances, à Famelette, près de Huy, où chaque année Edmond Picard accueillait les artistes comme des hôtes de choix. «Peintres et sculpteurs se réuniraient au nombre de vingt, organiseraient une exposition annuelle et inviteraient vingt autres artistes déjà consacrés. Ceux-ci seraient choisis parmi les maîtres dont l'art était fier, libre et encore combatif».
Quand l'exposition s'ouvrit en février 1884, tout le monde, partisans et adversaires, étaient sous les armes. Des revues de combat étaient nées: l'Art Moderne, la Jeune Belgique, la Société Nouvelle, la Basoche. Même certains journaux—telle la Réforme et le National belge—se montraient attentifs et bienveillants. Quelques peintres parmi les aînés, les Heymans, les Smits, les Baron, quelques sculpteurs, les Meunier, les Van der Stappen, les Vinçotte avouaient, par leur présence et leur parole nette, combien la tentative et l'audace des vingtistes leur agréaient. On les comptait; dix-sept peintres: Periclès Pantazis, Guillaume Vogels, Willy Finch, Dario de Regoyos, Théo Van Rysselberghe, Frantz Charlet, Rodolphe Wytsman, Frans Simons, Piet Verhaert, Théodore Verstraete, Guillaume Van Aise, Jean Delvin, Charles Goethals, Guillaume Van Strydonck, Fernand Khnopff, James Ensor et trois sculpteurs: Achille Chainaye, Paul Dubois, Jef Lambeaux. Parmi les invités se signalaient Israëls, Rops, Stobbaerts, Maris, Rodin. Aucun nom d'impressionniste français ne figurait au catalogue. Monet et Renoir n'exposèrent qu'à la troisième exposition des XX, en 1886.
C'est à cette date que, l'animosité ayant crû d'année en année, le critique d'art de la Jeune Belgique s'exprima de la sorte,—nous citons l'extrait qui n'est certes pas un modèle de goût, uniquement pour montrer la rudesse des polémiques—:
«Oh la triomphale journée que celle du 6 février! Les XX sont ouverts. Désormais la bêtise belge a sa date! On dirait qu'à cette «première» artistique le cerveau bourgeois se dégorge par toutes ses circonvolutions. Il en jaillit des excréments de sottise. Cela rappelle des opérations d'abattoir. Le porc est tué: il est suspendu, ventre ouvert, à de grossières tringles, les boyaux sont jetés sur l'étal, fumants et flasques.
«Les avez-vous vu vider? La bêtise belge et bourgeoise, c'est cela.
«Ce qui se débite d'âneries en ces quelques heures devant ces quarante exposants ferait un fumier monumental. Dames élégantes à bouche pincée de souris prude, fourrures confortables avec un ventre officiel dedans, gommeux monoclés, académiciens rances, peintres deshonorés de rubans rouges, réputations tuées depuis longtemps dans leur propre Bataille de Lépante et leur propre Peste de Tournay, prud'hommes énormes, collectionneurs d'eux-mêmes, tout cela potine, commère, hausse les épaules, passe et fuit devant ces quelques centaines d'œuvres d'art qui hurlent l'avenir. Et des rages! Voici un Monsieur qui s'arrête devant les Toorop et jure comme un porte-faix et trépigne et remue les poings ... qu'il tient en poche. Tel autre s'affale sur un banc et crie qu'il faut «brûler tout.»
«Les années précédentes il y avait çi et là un tableau «à la portée du premier venu» un tableau sauveur ... aujourd'hui, rien.
«Oh les pauvres oiseaux qui se cognent aux murs d'une cave obscure! Pas un coin où se tenir tranquille sur un perchoir d'admiration bon-enfant. Pas un coin où débiter le monologue d'amateur éclairé devant un auditoire de mamans et de fillettes. Pas d'opinion juste-milieu possible. Ou la haine ou l'emballement.»
C'était le ton. On le prenait, sans le savoir. L'atmosphère de bataille est grisante. On la trouve trop chaude quand on en est sorti. Quand on la respirait, elle était vraiment et bellement violente, exaltante et fiévreuse.
L'histoire des XX devrait, un jour, se faire, année par année. On y insisterait sur les successives et graduées victoires des peintres du plein-air en Belgique. On y pourrait mettre également en relief la manière nouvelle dont les œuvres y furent présentées. Pour la première fois on y juxtaposait toutes les pages d'un même peintre. Et toutes s'étalaient à la rampe. Des tentures de fond harmonieuses étaient choisies. Des chiffres d'or décoraient discrètement les murs.
Peu à peu les conférences s'inauguraient et bientôt les auditions musicales. Le directeur des XX, Octave Maus, s'y employait avec zèle et goût. Les XX qui plus tard abandonnèrent leur titre au profit de celui de Libre Esthétique devinrent ainsi un milieu de lutte précieux. Le mois de février ou de mars qu'ils choisissaient, annuellement, pour se grouper, combattre et triompher fut un mois de joie violente et âpre. Bruxelles interrompait ou plutôt clôturait par une fête intellectuelle l'ennui et la somnolence du morne hiver. L'art mettait avant, le printemps, une ardeur de renouveau dans les têtes. Et bientôt dans toutes les capitales de l'Europe des salons, organisés d'après celui qui s'ouvrait, chaque année, chez nous, multiplièrent les batailles et les triomphes des peintres et des sculpteurs hardis et révolutionnaires. Munich, Vienne, Berlin, La Haye, Paris, toutes ces villes eurent des Libres Esthétiques dont elles changeaient simplement le nom.
Ensor est le premier de tous nos peintres qui fit de la peinture vraiment claire. Il substitua l'étude de la forme épandue de la lumière à celle de la forme emprisonnée des objets. Cette dernière est violentée par lui, hardiment. Tout est sacrifié au ton solaire, surtout le dessin photographique et banal. A ceux qui, devant ses œuvres, vaticinent: «ce n'est pas dessiné», Ensor peut répondre: «c'est mieux que ça».
Son influence fut notable sur ses amis. A part Fernand Khnopff—et encore dans sa toile En écoutant du Schumann a-t-il peint le tapis en se souvenant de l'Après-midi à Ostende—tous subirent plus ou moins la fascination de son art. Ceux qui s'en garaient le plus, Van Rysselberghe, Schlobach, de Regoyos, Charlet parlaient de lui avec une admiration aiguë. Ils sentaient sa force; ils ne tarissaient point sur les dons qu'il manifestait, et hautement le proclamaient le plus beau peintre du groupe entier.
Mais d'autres, tels que Finch et Toorop, se montrèrent attentifs, non pas à son enseignement—James Ensor n'en donna jamais—mais à sa façon nouvelle de traiter et de vivifier les couleurs. Il fut leur maître sans qu'il le voulût et peut-être sans qu'ils le sussent. Ils étaient compagnons, se rencontraient sans cesse, se montraient l'un à l'autre le travail du jour, causaient de l'œuvre en train, discutaient, s'exaltaient. Finch, flegmatique et silencieux, observait, certes, plus qu'il ne parlait, mais ses yeux prenaient part mieux que ne l'eût fait sa langue aux entretiens du soir en face de la toile, humide encore.
La nature complexe et curieuse de Toorop s'assimila facilement les procédés et les techniques. Sa Dame en blanc fut un magnifique hommage rendu à l'art merveilleux de son ami.
Faut-il ajouter que, depuis ces temps lointains, Toorop et Finch se sont dégagés de l'amicale influence et que leur art d'aujourd'hui est à eux seuls. A part cette domination temporaire, James Ensor n'en a guère exercée. On le comprend du reste. Sa personnalité n'est pas assez purement flamande pour influencer longuement et décisivement les artistes d'ici. Et Finch et Toorop étaient eux-mêmes l'un Anglais, l'autre Javanais.
C'est de 1880 à 1885 que James Ensor produisit ses toiles les plus belles. Son œuvre n'est point une moisson d'été ni une vendange d'automne; c'est avant tout une germination de printemps. Sa force libre jusqu'à l'excès, sa personnalité violente jusqu'à l'exaspération, son indépendance superbe et outrancière lui ont fait une jeunesse admirable. Il créait abondamment, surabondamment même, avec acuité. Avant que la critique nombreuse se fût acharnée sur lui, il avait produit, déjà, tout ce qui plus tard devait susciter la bienveillance ou la haine. Il n'a donc pu donner ni à la louange ni au blâme le temps d'avoir prise sur lui ni de modifier en quoi que ce fût son travail. L'éclosion de son talent fut comme une explosion. D'un coup, il apparut presque en toute sa stature.
Il débute en 1879 par peindre son Propre portrait; il y joint deux compositions: Judas lançant l'argent dans le Temple et Oreste tourmenté par les Furies; puis dès 1880 apparaissent le Lampiste (exposé à l'Essor en 1883 et aux XX en 1884) et la Coloriste, deux toiles où tout son art est affirmé, et ce merveilleux Flacon bleu qui demeure peut-être la plus étonnante nature-morte qu'il ait signée. Oh le merveilleux morceau! Une table grossière supporte un poulet plumé, minable, douloureux, dont le cou pend dans le vide et dont la chair aux tons verdâtres inquiète. Largement, par ci, par là, à coups de couteau, la couleur est étendue. La main qui construit et peint avec une telle solidité, avec une telle prestesse semble déjà celle d'un maître. Et l'œil qui voit et qui précise le ton magnifique et choisi de la bouteille connaît déjà toute la force et la rareté d'un ton. Certes, la composition est absente: ce n'est qu'un morceau amoureusement traité; ce n'est qu'un coin de cuisine montré sous un éclairage propice, mais que de vie lumineuse, que de splendeur, que d'éclat! Aucune nature-morte célèbre ne s'interpose ici entre l'œuvre et l'admiration du passant. Tout est neuf, spontané, patent, définitif. Où donc a-t-il été éduqué le regard qui voit ces pauvres et quotidiens objets comme personne ne les a vus jamais? Renferme-t-il en lui même une subtilité, une délicatesse inconnues ou bien le spectacle de la mer que le peintre a sans cesse devant les yeux et qui s'offre à lui avec ses désinences infinies de teintes à chaque heure du jour—aubes, midis et soirs—a-t-il doué l'artiste d'un sens extraordinaire?
Le lampiste qui décore, à cette heure, le Musée moderne de Bruxelles est très simple d'arrangement. Sur fond gris, un gamin, tout entier habillé de noir, tient en main une lanterne de cuivre. Il la regarde et le verre et le métal brillent. On pourrait dire que le sujet du tableau existe dans la couleur elle-même. Ces larges masses grises et noires qu'animent les quelques détails jaunes du lumignon réalisent comme un conflit apaisé. Du reste tout tableau n'est-il pas une sorte de combat? Les tubes se présentent avec leur violence et leur diversité de couleurs comme chargés de mitraille dangereuse. Si le peintre n'en calcule point la force, s'il les laisse détonner, sans discipliner leur vacarme, s'il ne les contient d'un côté pour leur mieux donner carrière de l'autre, la bataille qu'il livre sera irrémédiablement perdue. Il faut qu'il prévoie ce que les orangés voisinant avec les bleus, ou les verts avec les rouges, ou les jaunes avec les violets, donneront d'éclat. Il faut qu'il juge comment les teintes transitoires atténueront tel ou tel choc de couleurs trop hardies. Il faut qu'il sache ce qu'un ton franc posé à tel endroit apporte de désordre ou de vie dans l'ensemble. Il existe une façon lâche de peindre, grâce au blaireautage, qui escamote les difficultés et affadit l'art. Ce procédé veule et funeste, Ensor ne le connaîtra jamais.
L'éclat de la lanterne que le lampiste tient en ses mains rayonne franchement mais sans brutalité; les noirs sur lesquels l'objet lumineux se détache le soutiennent par leur vigueur sombre; il n'y a aucun heurt, il n'y a que de l'audace heureuse.
La Coloriste est d'un jeu de couleurs plus abondant que le Lampiste. Une femme en blanc est assise dans un atelier éclairé par une fenêtre. Des étoffes, des vases et des écrans l'entourent. Cette toile fut montrée à la Chrysalide en 1881. Ce Cercle déjà ancien et dont le lieu d'exposition s'ouvrait salle Janssens (rue du Gentilhomme, alors rue du Petit Écuyer), avait à sa tête des maîtres: Louis Dubois, Artan, Vogels, Rops, Pantazis et d'autres. On y cultivait une peinture aux qualités solides, faite au couteau et qu'on prétendait sortie ou plutôt dérivée de la puissante et rayonnante esthétique des ancêtres. Cette opinion, certes, n'était point mensongère, encore qu'il fallût convenir que ces puissants peintres qui, à juste titre, se réclamaient de leur origine avaient tous regardé avec trop d'insistance les toiles du Franc-Comtois Courbet. Il est vrai que ce dernier aimait à s'arrêter longuement devant celles de Rubens, de Snyders et de Jordaens et que la peinture puissante et truculente, ferme et savoureuse, qu'il prônait n'était autre que la peinture flamande elle-même.
Dans la Coloriste la couleur n'est plus comme dans le Lampiste distribuée par larges plans. Au contraire. Elle se divise, se dissémine, se parsème. Sans le tact d'Ensor la multiplicité des verts, des rouges, des bleus, des jaunes aboutirait à quelque papillotage. Les écrans peints ne seraient qu'un assemblage de fusées et le tableau mentirait à son titre. Mais le peintre a voulu que la Coloriste enseignât ce que doit être une toile bien venue. Sur un fond, où les roux et les gris établissent leurs accords profonds et solides, les tons clairs et multicolores chantent, avec justesse et variété, leurs notes hautes et vives et chacune d'elles s'appuie, avant de s'élancer vers la joie, sur le tremplin des vigoureuses sonorités fondamentales. L'ensemble tient de l'un à l'autre bout de la toile, les liens subtils, qui unissent les teintes entre elles comme les notes d'un page de musique heureusement écrite, se serrent et se nouent partout.
La Musique russe (Salon de Bruxelles, 1881 et les XX, 1886)représente le peintre Finch assistant à quelqu'audition musicale qu'une pianiste lui donne. L'œuvre est plus qu'un portrait. L'auditeur, assis sur une chaise, se croise les jambes, rejette légèrement le corps en arrière, détourne aux trois quarts la tête et, dans cette pose attentive et tendue, écoute. Ce sont des gris délicats rehaussés ci et là d'une couleur plus vive qui constituent l'harmonie en demi-teinte du tableau. Aucun accent violemment sonore, mais une succession de nuances et de touches assourdies comme si la musique frêle, étrange, atténuée qu'on est sensé entendre commandait à la peinture. La difficulté consistait à réaliser, sans nuire à l'intérêt ni à la joie des yeux, cet art comme à demi-voix. Il fallait qu'on sentit le silence de cet appartement que troublent seuls quelques accords ou quelques chants et qu'à l'exemple de l'unique auditeur on y fût attentif.
Et comme contraste à cet art discret et mesuré, voici qu'un peu plus tard, en 1883, Ensor, sous le titre: Chinoiseries peint en pleine clarté sonore quelques potiches remplies de pivoines. On ne sait ce qu'il faut louer le plus, ou bien la couleur laiteuse des tons bleus et blancs du vase, ou bien le dessin large et sûr de son décor. Que ce soit le dessin cette fois, car jamais, me semble-t-il, l'artiste n'a mieux affirmé ce qu'est pour lui dessiner en peignant. La ligne, en cette œuvre franche et belle, est la couleur elle-même. Elle ne vit pas d'une vie indépendante, elle crée en même temps la forme et le ton et, si j'ose dire, l'ossature et la chair. Ceux qui prétendent qu'Ensor ignore la forme oublient sans cesse que le dessin de Rubens et de Delacroix est l'opposé du dessin d'Ingres et de Raphaël. Ceux-ci ne font que remplir par des couleurs le vide laissé entre les lignes tracées d'avance; ceux-là peignent d'abord et leur dessin résulte de la justesse des valeurs entre elles, ou si l'on veut, n'est que le résultat du jeu des ombres et des clartés. C'est le coup de brosse, et non pas le crayon ou le fusain, qui écrit les formes si bien que dans leurs tableaux rien n'est dur, rien n'est découpé, rien n'est sec, rien n'est séparé soit du fond, soit de l'objet voisin. Ils ne cernent pas des images; ils traduisent la vie.
Bien plus. Les artistes linéaires tels qu'Ingres et Raphaël ne s'embarassent ni des ombres ni surtout des reflets. Pour eux, les êtres et les choses semblent n'exister que dans une sorte de vacuité atmosphérique. La lumière qui les baigne est toute artificielle et le vide semble seul les contenir. Chaque objet existe d'une vie solitaire. Il ne subit en rien la loi des interinfluences. Il apparaît, s'il est beau, d'une grandeur presque toujours stérile. Il est jailli du raisonnement et de la pensée; il ne l'est jamais—si je puis dire—d'une émotion sensuelle. Or, c'est précisément cette joie de voir le monde entier s'épanouir dans la réelle et mouvante lumière, qui suscite en quelques êtres de choix le désir et bientôt l'art de peindre. Ensor se range parmi eux. Nous verrons comme il tient compte de ces ombres et de ces reflets que dédaignait M. Ingres et comme il les rend naïvement, scrupuleusement, de peur d'enlever n'importe quel élément de vie et de splendeur à la réalité.
Les sujets les plus humbles le requièrent. Voici qu'il peint poissons, bouteilles, pommes. Et voici qu'un simple chou vert (1880) posé sur une table rouge lui fait faire un chef-d'œuvre. Une lumière nouvelle, qui s'affranchit soudain des oppositions violentes entre les avant-plans et les arrière-plans, baigne cette merveilleuse nature-morte. Elle fut exposée en 1884 au Cercle artistique de Bruxelles et l'an dernier (1907) au Salon d'automne de Paris. Elle n'y perdit rien de ces prestiges d'autrefois. Elle étonna et charma autant que quelques superbes Cézanne rassemblés en une salle voisine. Elle apparut à tous avec ses qualités de belle sagesse et de maîtrise. C'était l'œuvre devant laquelle on s'arrête et l'on revient. Le rouge de la table sonnait en même temps que le vert du légume. Ces deux couleurs complémentaires n'étaient séparées que par une nappe blanche qui atténuait la violence qu'aurait produite leur immédiat voisinage. Chaque objet était peint à sa place, avec une sûreté parfaite. Rien ne violentait l'attention, mais chaque coup de pinceau la retenait. Et l'on songeait que le signataire de cette merveille fut qualifié, jadis, par la critique, d'artiste iconoclaste et sauvage et l'on ne comprenait pas. C'est, du reste, le propre des œuvres vraiment fortes d'étonner à leur apparition par leur soi-disant audace et de s'imposer après quelques années par leur absolue convenance.
Elles déroutent d'abord, elles ameutent et révolutionnent. Mais, le jour qu'elles entrent dans les musées et qu'elles voisinent avec les pages solennelles des maîtres et se trouvent enfin chez elles, en lieu sûr, dans la compagnie qui leur convient, on est surpris, chaque fois, de les voir très simplement continuer et rajeunir l'histoire de la beauté.
C'est dans le Salon bourgeois (1881) autant que dans Musique russe (1880) et plus tard dans la Mangeuse d'huîtres (1882), qu'on peut constater combien l'art de James Ensor tient compte du rôle, dans un tableau, des ombres et des reflets. «La lumière mange les objets» dit-il. Et en effet rien ne déforme le contour et la ligne comme une brusque clarté frappant les surfaces. Dès que vous prétendez rendre ce que l'œil voit et non pas seulement ce que le raisonnement prouve, un meuble (table, piano, armoire, chaise) apparaît en perpétuelle déformation. Que la lumière s'accentue ou s'affaiblisse, qu'elle change ou se déplace, aussitôt la réalité visuelle se modifie, alors que la réalité palpable demeure. Or c'est la réalité visuelle, c'est la tromperie et l'erreur de l'œil qu'il faut peindre puisque vous vous adressez aux yeux des spectateurs et non pas à leur toucher. Ce jeu sans cesse mouvant des ombres et des reflets, ces influences réciproques des choses interrompant soudain soit la ligne perpendiculaire d'un pied de table, soit les droites parallèles d'un panneau d'armoire, soit les courbes d'un dossier de chaise et dérangeant ainsi tout le décor géométrique d'un appartement, séduit le peintre moderne plus qu'il ne séduisait les peintres anciens. Il ne s'en dissimule point la difficulté et l'affronte, dût son dessin paraître vacillant et incertain, dût sa composition chavirer dans un apparent deséquilibre. Qu'on examine l'Après-dîner à Ostende ou la Musique russe, ou la Mangeuse d'huîtres, l'on se rendra aisément compte de combien de dangers picturaux l'art d'Ensor est sorti vainqueur. Ce n'est, en ces trois toiles, qu'un entremêlement de lueurs et d'ombres, d'objets frappés de clarté soudaine à côté d'autres restés voiles et la lumière qui glisse sur l'acajou, se répand sur les marbres, atteint les lustres, descend sur les tapis et se dissémine partout. Si la clarté provoquait l'écho, on n'entendrait, ici, que des répercussions et des voix qui se répondent.
Je me souviendrai toujours de l'étonnement que je ressentis, il y a quelque vingt-cinq ans, à l'exposition de l'Essor (1882), devant un portrait—c'était celui de son père—qu'Ensor y exposait. La toile était accrochée à la rampe près d'une porte dans un des halls du Palais des Beaux-Arts, rue de la Régence. Au milieu des œuvres jeunes qui sollicitaient par leur tapage et leur inexpérience, celle-ci proférait on ne sait quoi de grave, d'appaisé et de sévère. Elle était conçue par grands plans: des bleus, des noirs, des blancs réalisaient sa très simple harmonie. A droite, la clarté, tombant d'une fenêtre à travers des rideaux pâles, baignait le front d'un homme qui lisait. Une cheminée en marbre occupait le fond, à gauche. La figure était attentive à sa lecture. Et le silence régnait. La profondeur du ton, sa solidité, sa force commentait seule l'intensité de cette scène. C'était donc par des moyens uniquement picturaux que l'attention était fixée et l'impression produite. Aucune distraction n'était permise. C'était de la vie nue montrée dans sa réalité quotidienne, sans plus.
L'après-midi à Ostende—refusé en 1884 au Salon de Bruxelles—qui fut peint dans la même année que le Portrait de mon père (1881) nous attire, par contre, grâce à son charme abondant de tons variés. L'étoffe multicolore d'un tapis de table, les éclats métalliques d'un foyer, la décoration des lampes de la cheminée, les jupes et les corsages des deux personnes assises face à face permettent au peintre le jeu d'une admirable harmonie sourde et comme étouffée, malgré la violence locale des objets, hauts en couleur. Tout ici est en sourdine. La distinction des tons est parfaite. Un authentique peintre flamand aurait fait sonner comme une fanfare et les cuivres et les aciers et les étoffes. Il y aurait eu heurt, choc et tintamarre. C'eût été une exaltation dans la force. Ensor a réalisé un apaisement dans la délicatesse. Mais pour que tout fût maintenu, avec pourtant son éclat et son ardeur propres, dans une sorte de paix générale et brillât et scintillât comme sous un voile, de quelle finesse, de quelle justesse, de quelle acuité d'observation ne fallait-il point faire preuve?
Au fur et à mesure que son œuvre se poursuivait et que ses intérieurs bourgeois, ses après-dîners à Ostende, ses portraits lui assignaient comme tâche d'étudier la lumière circulant dans les maisons à travers la baie des hautes fenêtres, l'œil très subtil du peintre ne pouvait s'empêcher de s'émouvoir aussi de la clarté du dehors et surtout ne pouvait s'abstraire de la contemplation de la mer. Le paysage marin le requit dès ses premiers travaux. Et voici l'Estacade et la Mer grise et la Dame au brise-lame (1880); et voici Marine (effet de soleil), la Dune noire (1881); et voici les deux Marines et le Brise-lame (1882); et voici Dune et Mer et Marine (l'après-midi) (1883) et les Barques et la Marine (1884). Cette dernière se distingue par sa belle teinte verdâtre et par son aspect de simplicité et de grandeur. Un seul navire en sillonne l'étendue et l'impression de l'immensité se dégage toute entière. Supposant à la Marine (1884) voici le Coucher de soleil (1885) dont l'horizon déchiqueté de lueurs saumonées et de nuages violets multiplie le ton et fait songer à quelqu'énorme oiseau de flamme qu'on déplumerait, au bord de l'espace. La mer fut pour l'œil d'Ensor une admirable éducatrice. Rien de plus tenu et de plus frêle que la coloration d'une vague avec ses infinies désinences, avec sa mobilité lumineuse et myriadairement changeante. Quand elle s'épand au soleil sur le sable micassé de la grève, les tons les plus purs et les plus clairs des toiles les plus célèbres semblent grossiers et troubles.
En 1882, James Ensor achève le Pouilleux, la Dame en détresse, la Dame au châle bleu et la Mangeuse d'huîtres.
La première de ces quatre œuvres fut exposée en 1883 à l'Essor et fut acquise pour le musée d'Ostende. Elle indique une orientation nouvelle dans le choix des sujets. Le Pouilleux sera suivi bientôt par les Masques scandalisés (1883), et ceux-ci ouvriront à l'artiste une voie étrange où pendant longtemps son imagination se complaira. Le Pouilleux est pris dans la réalité quotidienne. Il a traîné son corps et sa guenille sur les quais. Il se peut que jadis il fût pêcheur: son teint basané et son œil vif furent certes lustrés par la mer. Le voici dans un morne logis, assis près d'un poêle, les sabots rapprochés du feu. Il regarde et ses traits profèrent on ne sait quelle vague goguenardise.
La Dame en détresse qu'on admirait en 1886 à l'exposition des XX représente une femme couchée sur un lit. Un jour ardent pénètre à travers des rideaux fauves. L'affaissement du corps, son abattement, est admirablement rendu. Cette longue ligne horizontale commande au tableau. Quelque chose d'inquiétant émane de la scène. Certes peut-on songer à quelque drame. Mais il est toujours facile et trop facile de faire, à propos des œuvres picturales, des réflexions gratuitement littéraires. Il s'en faut garder, quand l'évidence ne les fournit point.
Oh l'admirable tâche que celle du châle de la Dame au châle bleu. Déjà dans le Flacon bleu (1880) cette couleur fut propice au peintre. Elle lui a confié, peut-on dire, ses secrets les plus cachés. Certes, aucune couleur n'existe par elle même. Elle emprunte sa sonorité soit à l'ambiance, soit directement au ton voisin. Qu'importe! Certaines profondeurs, certains éclats, certaines violences heureuses de ce fragment du spectre n'auront été connus et rendus que par Ensor.
Voici une page capitale: la Mangeuse d'huîtres. C'est la seule œuvre dont il ait fait une réplique. Elle fut en 1882 refusée au Salon d'Anvers; en 1883 elle ne fut point admise à l'Essor. Ce n'est qu'en 1886 qu'elle s'épanouit, à la cimaise, aux XX. Elle y fit scandale. Je me souviens encore des colères qu'elle déchaîna. On ne voulut voir en cette merveille que les défauts, nécessaires, peut-être, en tous cas secondaires; et chacun, comme s'il était heureux de blâmer, d'éclabousser et de nier, piétinait dans le parti-pris, se refusait à toute louange et tournait le dos à la plus élémentaire justice.
Et pourtant ce tableau imposera sa date dans notre école. Comme le peintre s'y affranchit des fonds sombres et quelquefois opaques pour hardiment n'employer que des tons francs et quasi purs! Quelle joie, quelle fête, quelle liesse de couleurs répandues sur la table où la mangeuse a pris place! Bouteilles, verres, assiettes, citrons, vins, liqueurs s'influencent, se pénètrent de lueurs, entrent pour ainsi dire les uns dans les autres et maintiennent quand même, triomphantes, la solidité et la rigueur de leurs formes. Et cette admirable note rouge que jette la reliure d'un livre placé sur une tablette dans le fond de la toile! Et la belle chair vivante des mains et du visage. Et les plis bleuâtres de la nappe et tout enfin.
Certes, depuis qu'il peignait, James Ensor avait banni de sa palette la terre de Sienne brûlée et le noir de vigne; certes, depuis toujours, il s était défié de ce qu'on appelait «les vigueurs» obtenues par l'abus des mauvaises et fuligineuses couleurs; certes enfin, il s'était soucié d'atmosphère, d'air ambiant et de réelle et authentique clarté, mais jamais comme en cette étonnante Mangeuse d'huîtres ses efforts n'avaient abouti, ni sa victoire porté la flamme de ses drapeaux aussi haut, ni aussi loin. L'œuvre revêt je ne sais quel caractère historique. C'est le premier tableau, vraiment clair, qu'on fit chez nous.
La Mangeuse d'huîtres, sur l'escalier tournant de l'art d'Ensor, semble s'étaler sur un large et triomphal palier. Aux yeux du peintre pourtant, elle est moins encore un point d'arrivée qu'un point de départ. Comme le chou datant de 1880, elle lui ouvre l'ère de la peinture à tons purs ou quasi purs. Mais Ensor est celui qui cherche toujours. Il suit, peut-on dire, plusieurs chemins à la fois. Il ne se détourne ni de la mer, ni du paysage, ni de la nature-morte. Le voici qui parachève, en 1883 et 1884, les Toits d'Ostende, Grande vue d'Ostende, le Nuage blanc, le Houx, la Dune, Vue de Bruxelles. Et les Pochards et les Masques scandalisés et le Meuble hanté le retiennent en même temps au royaume de la fantaisie et de l'hallucination.
Et voici dans la toile le Christ marchant sur la mer qu'une voie nouvelle semble s'ouvrir encore. Un souci de composition particulier s'accuse. Prenant comme thèmes quelques sujets bibliques, le peintre se hausse soudain jusqu'au rôle de visionnaire. Les personnages n'occupent, dans mainte de ses toiles étonnantes, qu'un place minime. A première vue on ne les y distingue guère. Il les y faut chercher. Ils paraissent faire partie des éléments: vents, nuages, flots, soleils. Les maîtres anciens donnaient invariablement dans leurs œuvres la place prépondérante aux actions humaines. Dans le déploiement des légendes à travers la peinture universelle, les Dieux et les hommes existent seuls. Mais au fur et à mesure que l'idée de force s'est déplacée et modifiée et que l'humanité comprend que l'être humain n'est qu'un tourbillon de pensée emportée dans le vertige des puissances cosmiques, l'importance de ses gestes a décru.
Le Christ marchant sur la mer est conçu d'après les mêmes pensées. C'est la mer, c'est le ciel qui remplissent de leur immensité la toile entière. A peine une auréole, à peine une lueur se dégageant d'une forme vague, indique-t-elle le prodigue.
Dans Adam et Eve chassés du Paradis (1887) ces précédentes remarques se vérifient mieux encore. La page est merveilleuse. Les cieux remués de miracles tonnants et foudroyants occupent à peu près toute la toile. Des trombes de vents passent, des lueurs formidables apparaissent, tout le vertige de l'atmosphère est rendu. Vraiment, c'est une colère céleste qui se gonfle, qui voyage et qui éclate. L'ange exterminateur semble être à lui seul toute la nuée. A droite, avec des mouvements de fuite et de terreurs et comme brûlés par l'épée vengeresse, apparaissent Adam et Eve. Ils sont là, dans le coin de la toile, presque indistincts, roulés comme des épaves, tandis que seul l'orage que leur misère et leur fragilité ont suscité, occupe les quatre points de l'espace.
L'effet surnaturel est produit sans que la couleur se mélodramatise de violentes oppositions de noirs et de clairs. La tonalité générale reste lumineuse, magnifiquement. On y surprend quasi de la délicatesse. Mais les lignes tumultueuses sont bien appropriées au sujet et la fougue des touches émerveille.
En 1891 le Christ apaisant la tempête continue la série des œuvres légendaires. Le ciel et la mer, qui se rejoignent à l'horizon, se présentent en cette toile comme un énorme coquillage bivalve qui serait entr'ouvert et dont les deux parois internes contiendraient les nuées et les eaux. Le personnage, invariablement à droite du tableau, comme dans le Christ marchant sur les eaux et dans Adam et Eve chassés du Paradis, indique chez le peintre un souci de composition presque uniforme. La science, l'équilibre, le prolongement heureux des arabesques, tout ce qui constitue la combinaison étudiée et heureuse ne l'inquiètent guère. Il voit d'un coup, comme si quelque brusque rideau s'ouvrait, et il rend ce qu'il voit, sans plus. C'est ainsi que procèdent les voyants.
On peut rattacher à ce cortège de paysages animés de légende et d'histoire quelques autres pages: le Feu d'artifice (1887) et le Domaine d'Arnheim (1890).
Une gerbe jaune, immense se projette sur un ciel bleu foncé comme si tout à coup s'ouvrait un cratère. Effet très simple. On dirait que la fureur des tempêtes calmées par le Christ marchant sur les eaux ou la colère des cieux se déchaînant sur Adam et Eve subsistent encore dans l'esprit du peintre.
Quant au Domaine d'Arnheim il suscite devant les yeux un bois profond que baigneraient des flots calmes. Une barque les sillonne. Le titre, fourni par Edgar Poe importe, bien qu'on l'ait trouvé inutile. Il nous transporte hors de la réalité, vers quelque lieu illusoire et magnifique où règnerait un calme d'or parmi des îles d'ombre majestueuse, touffue et silencieuse. Quand il composa le Domaine d'Arnheim, l'esprit du peintre s'était de plus en plus retiré de la contingence quotidienne; il commençait à vivre en plein monde imaginaire; il était déjà hanté. C'est à ces dispositions spirituelles qu'est due la manière de traiter ce paysage. On peut croire en effet que ce morceau de nature est tout entier arraché à l'imagination ou bien que, là bas, quelque part au bout du monde, sous un ciel inconnu, il s'étale et fleurit, sans que jamais quelqu'un, à part son mystérieux visiteur, ne l'ait parcouru. Plus tard, bientôt, ces îles, ces eaux et ces jardins seront, grâce au rêve de James Ensor, peuplés de masques et de pierrots et d'arlequins et de colombines. Ils s'intituleront alors le Théâtre des masques. Et ce seront ses Fêtes galantes à lui, certes moins charmantes que celles de Watteau, mais plus folles, plus fusantes, plus papillotantes et plus fiévreuses.
Continuant, après la Mangeuse d'huîtres, sa marche vers la clarté et s'attardant non plus dans le rêve et la légende mais dans la réalité vécue et quotidienne, Ensor propose à notre admiration les Enfants à la toilette (1886). Et c'est dans une chambre, deux enfants nus, l'un debout, l'autre assis, que la lumière, tamisée à travers les rideaux, baigne. L'atmosphère est ambrée, frêle, douce, chantante. Les chairs roses, délicatement, s'étalent dans un jour doré sans qu'aucune brutalité, aucun heurt, aucune dissonance ne dissipe l'impression de calme et de fraîcheur et d'innocence qui émane de la toile. La Mangeuse d'huîtres proférait des tons pleins, entiers, majeurs; les Enfants à la toilette n'émettent au contraire que des tons atténués, assourdis et mineurs. Mais si l'on tient compte de l'aiguë difficulté que les peintres rencontrent à faire jaillir, non pas de l'opposition ni du contraste, mais d'un assemblage de teintes voisines, la lumière, les Enfants à la toilette étonneront plus encore que la Mangeuse d'huîtres. La clarté apparaît diffuse, elle ne s'accroche à rien, elle ne fait aucune saillie; elle glisse sur les meubles, les tapis et les chairs. La transparence des stores baissés est parfaite. Jadis avec des tons profonds et noirs, Ensor résolvait dans l'Après midi à Ostende un problème analogue. Tout y était fort et discret, dans l'ombre. Ici tout est fort et discret, dans la clarté.
Enfin voici une toile, toute en tons purs cette fois et toute en violence, où la réalité se mêle à la fantaisie, où les deux routes suivies par l'artiste se rejoignent. La page est intitulée Le Christ faisant son entrée à Bruxelles. Elle ne fut jamais exposée. La date?—1888. C'était le temps où les néo-impressionnistes ameutaient les ateliers parisiens. Georges Seurat avec sa théorie de la décomposition lumineuse ou de la division du ton apportait vraiment dans l'art de son temps un procédé inédit. On l'invitait aux XX. Ses toiles y faisaient scandale. L'évolution lente de l'impressionnisme semblait comme suspendue au profit d'une révolution soudaine. De nombreuses conversions esthétiques eurent lieu. Ce fut une sorte de cataclysme magnifique.
La grande part de vérité que Seurat apportait ne put laisser insouciant un esprit aussi attentif et aussi inquiet que celui de James Ensor. Toutefois, après réflexion, il n'adopta point les théories nouvelles et voici les raisons qu'il en donne.
«Les recherches des pointillistes m'ont laissé indifférent: ils n'ont cherché que la vibration de la lumière. En effet ils appliquent froidement et méthodiquement leurs pointillages entre des lignes correctes et froides. Ce procédé uniforme et trop restreint défend d'ailleurs d'étendre les recherches et de là résulte une impersonnalité absolue dans leurs œuvres, si bien que les pointillistes n'atteignent que l'un des côtés de la lumière: la vibration, sans aboutir à donner sa forme. Mes recherches et ma vision à moi s'éloignent de la vision de ces peintres et je crois être un peintre d'exception.»
Ne retenons de ces lignes que la dernière affirmation. Qu'Ensor soit un peintre d'exception, rien n'est plus juste. Sa nature est trop spéciale pour que jamais elle lui permette d'être d'un groupe. Le néo-impressionnisme exigeait une discipline, portait en lui un enseignement, élaborait un programme. Dès ce moment le peintre ne le pouvait admettre. Ce qui caractérise la personnalité d'Ensor c'est le libre-vouloir. Sitôt qu'un désir lui vient, il le satisfait. Sa tête est une chambre ouverte où tantôt les idées, tantôt les rêves, tantôt les folies, s'installent. Et le néo-impressionnisme lui apparaissait comme une prison.
Mais, tout en tournant le dos à l'esthétique de Seurat, il voulut, lui aussi, se signaler par de très nettes audaces. Il ne pouvait nier d'ailleurs que la nouvelle école, plus qu'aucune autre, ne purifiât la vision. Les couleurs dont elle préconisait l'emploi étaient les couleurs mêmes du prisme, les couleurs vierges, primitives, intactes. Toute l'ancienne palette était comme abolie et le spectre solaire prenait sa place. La virginité totale du ton devint un objet de conquête. Déjà Turner, et à sa suite tous les impressionnistes, s'étaient essayé à créer cette virginité et à l'imposer à leur œuvre; ils s'y étaient pris empiriquement, en se fiant à la subtilité et à la délicatesse de leur œil. Les nouveaux-venus, jugeant cette conquête incomplète, purifièrent en quelque sorte cette pureté hésitante et tâtonnante et grâce aux découvertes scientifiques la proclamèrent certaine et sûre. Et leurs toiles étaient en effet lustrales plus que nulle autres. On eût dit qu'elles portaient en elles la grâce d'un éclatant et violent baptême.
Dans son Entrée du Christ à Bruxelles on peut croire qu'à son tour, comme pour défier le néo-impressionnisme, Ensor ait voulu rebaptiser sa peinture. Il en a augmenté encore et vivifié la clarté. Et les principales étapes qu'il suivit pour aboutir à cette victoire furent, comme nous l'avons dit, le Chou (1880), la Mangeuse d'huîtres (1882) et les Enfants à la toilette (1886). Son évolution entière fut donc longuement préparée, logique et personnelle.
Le sujet du Christ faisant son entrée à Bruxelles peut certes déplaire. On y voit l'homme-Dieu mêlé grotesquement à nos pauvres, féroces et actuelles querelles. Il assiste au défilé mouvant et tumultuaire des revendications politiques et sociales, comme un banal élu—bourgmestre, échevin, député—un jour de manifestation déchaînée. Il voit passer les fanfares doctrinaires, les charcutiers de Jérusalem et des banderoles et des drapeaux se déroulent et inscrivent en leurs plis «Vive la Sociale et vive Anseele et Jésus».
A ne juger que la plastique et la forme, l'œuvre fourmille de défauts, mais la couleur en est triomphante. Les bleus, les rouges, les verts, soit juxtaposés, soit divisés entre eux par des blancs larges, sonnent comme une charge de tons purs et leur bariolage audacieux, parfois brutal, impressionne la rétine lyriquement. Au surplus l'ironie du peintre se donne, ici, libre carrière. On ne peut exiger de lui qu'il prenne au sérieux n'importe quelle démonstration populaire. La ruée du peuple à travers les places se boursoufle, pour ainsi dire, de visages tuméfiés, de ventres formidables que les masques et les oripeaux revêtent de leur invraisemblance. Mais, grâce à cette exagération savoureuse, grâce à l'exaltation des tons crus qui parfois se rapprochent des tons d'une affiche, grâce peut-être au désordre même de la composition, l'ensemble donne une âpre, farouche et tintamarrante sensation de vie. Ensor se plaît d'ailleurs à ces caractéristiques évocations de foules. Il les multiplie à travers toute son œuvre. Il les rêve compactes, serrées, formidables. Elles apparaissent comme étouffées dans les rues et étranglées aux carrefours. Les maisons, les monuments, les balcons, les toits semblent subir l'entraînement de la poussée unanime et dans une eau-forte célèbre on pourrait croire que la multitude—si dense qu'un caillou jeté sur elle ne trouverait point un interstice assez large pour choir à terre—porte, comme une chasse, une cathédrale entière sur ses épaules.
Cette manière de peindre à grands tons plats et clairs que James Ensor adopta dans l'Entrée du Christ à Bruxelles, il la gardera longtemps et l'emploira souvent dans ses études baroques et macabres de pierrots et de bouffons. Mais avant de parcourir cette province large et pittoresque de son art, qui lui fit donner le nom de «peintre de masques», il importe d'insister sur son talent de portraitiste et de nature-mortier.
Il serait surprenant qu'Ensor, aimant avant tout au monde son art et par conséquent chérissant surtout celui qui le fait, c'est à dire lui-même, n'eût multiplié à l'infini sa propre effigie. Ajoutons qu'en se regardant, en un miroir, il a toujours à portée de main, de brosse et de palette, un modèle complaisant et gratuit.
Dès ses tout premiers débuts, aux temps lointains et maudits où il s'égarait à l'académie, il traduit ses traits (1879); en 1880 il se repeint; en 1883 encore et en 1884 il se dessine. En 1886 il fixe au crayon quatre fois son image; en 1888 il se déguise et se reproduit au pinceau. Dans l'Ecce-Homo, c'est lui qui apparaît flanqué de ses deux bourreaux MM. Fetis & Sulzberger; en 1891 parmi ses dessins fantasmagoriques il prend place; en 1899 il s'entoure de masques et dans nombre de compositions son visage tantôt hilare, tantôt mélancolique, tantôt angoissé et piteux, s'impose. Il est en quelque sorte la figure centrale de tous ses rêves. Et c'est logique et c'est humain qu'il en soit ainsi. On pourrait serrer de près sa psychologie, rien qu'en analysant ses portraits aux différentes saisons de son art et l'être insaisissable qu'il est se dévoilerait peut-être mieux, grâce à cette méthode, que par l'examen de ses gestes quotidiens dans la vie.
De ses représentations si variées et si nombreuses, je retiens la première. En veston havane, sa palette à la main, à l'atelier, il se campe devant son chevalet. Il est jeune, l'œil clair, l'allure attentive et naïve. La vie hostile ne l'a point encore touché. L'œuvre est comme joyeuse; de belles taches claires s'y rencontrent. On y devine le coloriste qu'il est.
En 1882, Théo Hannon et Willy Finch, deux de ses amis, lui servent de modèles. Le dernier de ces deux portraits est d'une solidité belle. Les tons clairs font place aux tons profonds et fermes; le visage est traduit avec une franchise et une sûreté de facture remarquables; aucune mise en scène, aucune recherche, si ce n'est la recherche fondamentale des beaux peintres en face de l'architecture humaine à traduire avec souplesse et force.
Suit l'effigie de la Mère de l'artiste. Robe noire et col en dentelles. Trois roses groupées, comme ornement. Simplicité absolue dans la pose; les traits sont âprement caractérisés. De loin, le modèle fait songer à quelque dame qu'aimait à peindre d'une manière brusque, scrupuleuse, aiguë, le grand Goya.
En 1891, James Ensor voulut bien consacrer quelques séances à mon propre portrait. Je n'insiste sur cette œuvre que pour noter le faire spécial qui la distingue. Elle est plutôt écrite que peinte. Le trait est insistant, il creuse la chair, il traduit le caractère. Vers cette époque James Ensor introduit ce procédé graphique, tout à coup, dans sa peinture. La ligne qu'il dissimulait et noyait jadis y prend la première place, non pas la ligne ornementale et pure, mais la ligne caractéristique et rompue. Ces brusques sauts, ces rapides volte-face, ce changement incessant de procédé indiquent à la fois les recherches incessantes de son art et les inquiétudes journalières de son caractère et de son esprit.
Trois ans plus tard s'achève le portrait d'Eugène Demolder et en 1895 celui de M. Culus. Enfin voici le dernier portrait en date (1907). Il représente Mme Lambotte, d'Anvers.
Le personnage est assis au centre de la toile, vêtu d'une robe bleue et d'un grand châle vert. Admirable accord que celui de ces deux tons principaux. A gauche une table. La main droite du modèle s'y appuie sur un bibelot japonais. Au fond, mais bien à leur plan malgré la vivacité de leurs teintes, apparaissent les Masques scandalisés et quelque scène du conservatoire de Bruxelles où le maître Gevaert dirige les chœurs. L'œuvre est intéressante à préciser. La figure est traitée, délicatement; le chapeau est d'une fraîcheur comme florale. On dirait que le personnage est rentré d'une excursion aux champs et qu'il retient sur lui quelque chose de la limpidité et de la bonne odeur champêtres. Les yeux vivent d'une vie charmante; les cils sont peints, hardiment, en bleu. Et cette couleur si éloignée du ton local est d'une justesse admirable dans l'ensemble. Tout ainsi revêt une vibration aiguë et subtile à qui sait voir les objets non plus dans leur réalité plate, mais dans leurs rapports avec un rêve de couleur et de lumière. Il faut qu'un artiste vrai ne tienne presqu'aucun compte de la vue banale des choses et qu'il ne les voie que comme prétexte à interprétation belle. Tout se peut transposer d'une vie dans une autre, de la vie commune dans la vie de l'art. La couleur unique dont il faille se soucier est celle qui fait bien sur la toile et affirme et soutient et rehausse son harmonie. Ensor a nettement obéi à cette loi dans le portrait de Mme Lambotte.
Deux très belles natures-mortes datent de 1893, la Raie et le Coq mort. Sur fond blanc le coq au plumage argenté se détache et tout un frisson de lumière semble courir sur son ventre et ses ailes. Je me souviens aussi et des Viandes (Musée d'Ostende) et de l'admirable Coin de cuisine du Musée de Liège. Le pinceau semble avoir glissé sur ces victuailles comme s'il était empreint non de couleurs mais de clarté. Si la forme des objets était plus précisée et plus arrêtée, ce bain de lueurs où le mercure et le soleil semblent fusionner n'aurait certes pu aussi bellement, envelopper la toile. Qu'on voie la couleur, affirme Ensor, aussitôt on ne voit qu'elle; de même, qu'on étudie la forme et l'œil n'est plus sensible qu'à la ligne. Unir dans une même œuvre le ton et le dessin, leur donner la même importance n'est possible qu'aux demi-natures qui ne sentent rien fortement. Il faut choisir. Ensor a choisi la couleur ou plutôt la lumière.
On peut donc lui reprocher parfois que ses morceaux de viande, ses choux, ses fruits, ses pots, ses vaisselles manquent de fermeté ou de poids. Il en conviendra certes. Mais que lui importent ces remarques terre à terre. Il existe une sorte de réalité esthétique plus haute que la réalité authentique. Cette réalité ou plutôt cette vie est atteinte par de purs moyens d'art. Ils réalisent les harmonies impeccables et glorieuses du ton, les sensibilités merveilleuses des ombres et les joies de la calme ou triomphante lumière. Quand ce haut résultat est atteint il efface—surtout qu'il s'agit, en ce cas-ci, de simples natures-mortes—toute critique vétilleuse et tatillonne. On ne sait quel trophée choisir parmi tant d'éclatantes conquêtes du pinceau. Vases de Chine aux tons laiteux, statuettes esquissées en quelques coups de brosse, soies, linges, étoffes, écrans, éventails fins et légers, tout le magasin familial de la Rampe de Flandre a traversé l'imagination de l'évocateur.
Voici les Coquillages peints en 1889. A côté d'écailles roses et lustrées, en voici d'autres blanches comme de la craie et d'autres encore jaspées comme des dos de sèche et d'autres enfin creusées et rayées comme des branchies. La structure de poissons improbables, diables de mer ou rougets, se retrouve comme pétrifiée dans telles formes minérales. Ensor en saisit les analogies, les traduit, les aime et peut-être, au fond de lui, relie-t-il, par des liens psychiques, ces architectures marines avec leurs silhouettes baroques et compliquées, au monde étrange de ses masques et de ses squelettes. Tout cela peuple sa mémoire et fixe et détermine son désir presqu'au même titre.
Sur tel panneau, on croit surprendre la vie des mollusques au fond même de la mer. Il date de 1895. Un grand coquillage bistre domine, la pointe en l'air, comme en pyramide, d'autres coquilles, les unes vertes, les autres roses, et cet arrangement comme maladroit semble le fait même de ces bêtes lentes et visqueuses. Le dessin en est très ferme et comme écrit. Il insiste sur chaque circonvolution et sur chaque spirale. Et voici—contraste brusque—deux bulbeuses et légères grappes de raisin, l'une bleue et l'autre rose-cerise, avec un oignon, une noix et une poire, la queue dressée. Ensemble presque transparent. Il est si frais, si lucide, si délicat qu'on le dirait comme baigné de rosée.
L'entrée dans le royaume des masques dont James Ensor est roi, se fit, lentement, inconsciemment, mais avec une sûre logique. Ce fut la découverte d'un pays, province par province, les lieux pittoresques succédant aux endroits terribles et les parages tristes prolongeant ou séparant les districts fous. Grâce à ses goûts, mais aussi grâce à son caractère, James Ensor n'a vécu pendant longtemps qu'avec des êtres puérils, chimériques, extraordinaires, grotesques, funèbres, macabres, avec des railleries faites clodoches, avec des colères faites chienlits, avec des mélancolies faites croque-morts, avec des désespoirs faits squelettes. Il s'est improvisé le visiteur de lamentables décroche-moi-ça, de malodorantes arrière-boutiques de marchandes à la toilette, de piteux bric-à-brac en plein vent. Il a vagué par des vallées de misère où lui apparaissaient des pierrots malades, des arlequins en goguette, des colombines soûles. Parfois, comme un ménétrier fantasque, il montait sur un tonneau et sur la place de je ne sais quelle ville du pays de Narquoisie, il agitait, au son d'un rebec invisible, en un trémoussement soudain, toute cette joie lugubre et bariolée. Il pleurait peut-être lui-même en peignant tel masque hilare ou souriait en dessinant telle tête de mort. Les contrastes les plus aigus devaient lui plaire et il les réalisait en oppositions violentes, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes se donnant comme des coups de poings sur la toile. L'art d'Ensor devint féroce. Ses terribles marionnettes exprimaient la terreur au lieu de signifier la joie. Même quand leurs oripeaux, arboraient le rose et le blanc, elles semblaient revêtir une telle détresse, elles semblaient incarner un tel effondrement et représenter une telle ruine qu'elles ne prêtaient plus à rire, jamais. J'en sais d'une angoisse de cauchemar. Et la camarde se mêla à la danse. Le squelette lui-même devint tantôt pierrot, tantôt clodoche, tantôt chienlit. Masque de vie ou tête de mort s'identifiaient. On ne songeait plus à quelque carnaval lointain d'Italie ou de Flandre, mais à quelque géhenne ou les démons se coiffaient de plumes baroques et s'affublaient de draps-de-lit usés, de bicornes invraisemblables, de bottes crevées et de tignasses multicolores. C'est pendant les mauvais jours de sa vie que James Ensor donna cette signification pessimiste à ses fantoches.
Dans ce pays imaginaire, d'où la farce classique semble bannie, évoluent le masque Wouse et Saint Antoine, les diables Dzitss et Hihahox, les pouilleux Désir et Rissolé, les soudards Kès et Pruta et l'on y rencontre la ville de Bise et le territoire de Phnosie. Rien que ces appellations et ces noms, venus d'on ne sait quelle région d'un cerveau hanté, renseignent sur la très spéciale imagination d'Ensor. Au reste, pour animer pendant vingt-cinq ans un peuple aussi grouillant d'êtres chimériques et les douer d'une psychologie aussi étonnamment variée, fallait-il que le monde de la démence fût naturellement pour le peintre un monde de prédilection et de choix. Certes, croyait-il à tout l'invraisemblable, à tout le baroque, à toute la folie et ne recouvrait-il la lucidité qu'à l'heure où il s'asseyait devant sa toile et choisissait ses couleurs et harmonisait ses tons. Il a réalisé admirablement cette vie double.
Le Masque Wouse (1889) apparaît un des premiers. Il est vêtu d'un schall discrètement et magnifiquement bariolé de rouge, de vert, de jaune, de bleu, il tient en main un parasol, est coiffé d'un bonnet et le nez de son visage en carton s'agrémente d'une pendeloque légère. Il regarde, gisants devant lui comme autant de marionnettes flasques, d'autres êtres semblables à lui et l'on dirait quelqu'un visitant soit une morgue de pantins, soit, après un combat, le champ d'une défaite. L'œuvre où s'épand une clarté diffuse est délicatement peinte, les étoffes sont flottantes et légères, l'atmosphère jolie. Elle contraste et voisine, dans l'atelier de l'artiste, avec les Masques singuliers (1892) mis en rangs, comme s'ils s'attendaient à être passés en revue par les soudards Kès ou Pruta. Ils reviennent, Dieu sait de quelle parade, les vêtements lâches et veules, mais gardant encore on ne sait quelle fierté vague. Le plus grand de tous porte un chapeau militaire dont la frange se détache lugubrement. En cette toile, presque tous les tons sont forts, puissants, hardis. Ils réalisent comme une gamme descendante et ne deviennent fins et subtils qu'autour d'un Pierrot boursouflé qui dissimule, en des blancheurs roses, sa carcasse falote. Oh la piteuse mascarade et comme la détresse d'une gloire abolie et d'une gaieté défunte s'y marque! Fini l'orgueil, le triomphe, la gloire. Toute fanfare s'est tue. On rit et l'on est triste. Acteurs flétris d'un drame chimérique, les fantoches sont là n'ayant plus même un bout de bâton pour simuler un vague: portez-armes.
Maintenant voici les Masques devant la mort (1888) et les Squelettes voulant se chauffer (1889) et le Squelette dessinant (1889) et les Squelettes se disputant un pendu et les Masques regardant une tortue (1894) et un Duel de masques. Le drame morne ou féroce commence à se préciser. Dans les Masques voulant se chauffer une impression de néant s'affirme. Rien de plus pauvre, de plus navrant, de plus lugubre que cette idée de chaleur et de bien-être évoquée devant ces êtres flasques et vides. Ils s'approchent, se pressent, s'inquiètent autour de ce feu inutile, de cette flamme sans vertu, de ce foyer qui les raille et qui n'est pas. Les Masques regardant une tortue angoissent tout autant. L'écaille qui couvre l'animal contemplé est, elle aussi, une sorte de masque dissimulant le mouvement et la vie. Ce rapprochement baroque suffit à faire comprendre pourquoi les étranges spectateurs semblent comme s'étudier eux-mêmes en voyant bouger lentement et pesamment la bête torpide et douce. Enfin dans un Duel de masques l'idée de lutte, de fureur et de férocité est raillée à son tour.
Toutes ces petites toiles sont franches, sincères, nerveuses. L'ostéologie des squelettes est amoureusement étudiée. Parfois sur leur crâne lisse se distinguent des lignes pareilles à celles des cartes de géographie et l'on peut croire que le peintre se plaît à inscrire le monde sur l'os d'un front. Le trou des yeux est approfondi. On y surprend, dans le vide, on ne sait quelle fixité qui donne l'illusion d'un regard. Ce n'est certes plus le squelette tel que le comprenait le moyen-âge. C'est plutôt celui qui sort des cabinets d'anatomie, des laboratoires et des hôpitaux. Il ne fait pas songer à tel macabre philosophe qui moralise dans la danse de Holbein ou dans les fresques de la Chaise-Dieu; il n'est pas chrétien. Il s'est renouvelé; il est de notre temps. Il représente non plus les croyances, mais les idées et les sentiments.
Même dans ses Tentations de Saint-Antoine, Ensor ne prétend ni prêcher ni évangéliser. Le tohu-bohu de ces apparitions charme presque et devient, en ce sujet légendaire, quasi bon-enfant. Le peintre adore y semer des corps de femmes grosses et cocasses, des diables fluets et malins, des monstres improbables et ridicules. Le pittoresque de ce cauchemar chrétien le tente plus que son horreur. Et c'est en dilettante de l'impossible qu'il s'y affirme et non pas en vengeur du vice ou en champion de la vertu. Il cultive l'angoisse, ailleurs. Il la cultive en lui-même. Dans le Portrait du peintre entouré de masques (1899), appartenant à M. Lambotte, d'Anvers, il s 'affuble d'un costume étrange, il se couronne de plumes et de fleurs, il se déguise lui-même comme pour donner plus congrûment audience au peuple entier de ses fantômes. L'œuvre est haute en couleur; toute la palette ardente et sonore est employée; la joie s'affiche; on songe à un triomphe et pourtant que de cris poignants, que de violence et de fureur ces faces impassibles n'expriment-elles pas? Tel visage morne et blême rappelle une tristesse passée, tel autre une inquiétude présente; celui-ci, avec ses joues pesantes, avec ses yeux comme pincés en des étaus de graisse, rit d'un malheur qui viendra; celui-là, bonasse et rougeaud, détaille quelque farce funèbre ou pavane sa santé gonflée et balourde au-devant de la maladie qu'il annonce. Tous les sentiments humains se laissent deviner. Le plaisir, le chagrin, l'audace, la peur, l'espoir, la transe, l'orgueil, le doute, la force, l'abattement, la roublardise, la ruse, l'ironie, la détresse, le dégoût. C'est un formidable bouquet dont les fleurs seraient des bouches, des nez, des fronts, des yeux et qui toutes, ou presque toutes, malgré leur beauté et leur éclat seraient capiteuses et empoisonnées. Chacune a une signification nette et un langage précis quoique muet. Et les masques surgissent de partout: à droite, à gauche, du haut, du bas. Le champ tout entier de la toile en est comme encombré: ils se pressent, se tassent, s'enfièvrent. Il faut qu'ils assiègent le peintre, qu'ils le dominent, le hantent et l'hallucinent, qu'ils se moquent des roses et des plumes que sa tête arbore, qu'ils lui crient leur inanité et la sienne et lui fassent comme la leçon terrible de la mort. Lorsqu'Ensor introduisit en sa peinture un tel peuple étrange et tragique de masques, peut-être ignorait-il lui-même qu'à un certain moment ils lui fausseraient à tel point la notion du réel qu'il ne verrait plus qu'eux de vraiment vivants sous le soleil et qu'un jour il prendrait place parmi leur multitude comme s'il était lui-même quelqu'un de leur lignée et de leur race. Car il ne se peut pas qu'il n'ait subi, à certaines heures, une telle illusion dominatrice et qu'il n'ait fini par voir, avec ses yeux ouverts en plein jour à la lumière, l'humanité entière comme un ensemble de grotesques et de fantoches. Son art terrible et rêveur a dû l'affoler à ce point, fatalement.
Ensor a nettement distingué dans son œuvre le dessin du peintre et le trait du dessinateur. J'en donnai les raisons: elles me semblent plausibles. Pointe et pinceau ne furent jamais à ses yeux des instruments identiques.
Nous voici en présence d'un nombre infini de pages où le fusain, la plume et le crayon se sont appliqués à fixer la vie ou le rêve. On les peut diviser aisément en catégories: les croquis; les dessins de caractère; les dessins atmosphérés; les dessins à lignes pures et les dessins ornementaux. Il est certes piquant de constater que c'est précisément celui parmi nos grands artistes qu'on accuse peut-être le plus de négliger le dessin qui surtout le cultive. S'il rassemblait tous ceux qu'il a faits, ils formeraient une bibliothèque.
Je sais des notations où quatre à cinq traits nettement placés expriment l'enveloppe, la masse et l'attitude momentanée d'un personnage; voici, d'un coup de crayon, la marche, l'inclinaison, la vitesse d'une jambe traduites; le mouvement d'un dos, l'affalement d'une hanche, le bondissement d'une croupe, la tension d'un cou reproduits. Tout cela est preste, vivant, soudain. Sur une seule page, cinquante petits bonshommes se meuvent, s'agitent, passent, viennent, s'arrêtent, s'assoient, s'affalent et le crayon Conté note, détail par détail, leurs particularités et leurs manières d'être et compose comme une faune amusante des passants de la rue moderne. Je connais tels croquis où James Ensor, profitant des menus défauts du grain ou de la trame d'un papier, a composé une Chute des anges rebelles en tenant compte de ces accidents de matière. Des mouvements inattendus se devinent, des grappes de muscles et de chairs pendent et se contractent, une cataracte de dos, de ventres et de têtes se précipite, une impression de ruée est merveilleusement rendue et tout cela n'est que du hasard souligné par un crayon, dites combien habile et preste?
Le jour où le peintre s'intéressa à l'existence des marins et des gens du port—plus tard ils lui fourniront et ses pouilleux et ses masques—ce fut par des études au fusain qu'il manifesta son enthousiasme. Il possède toute une suite de dessins supérieurement conduits où s'offrent en leurs attitudes quotidiennes les vieilles à mantelets, les mousses en vareuses, les vieux pêcheurs échoués comme leurs barques au long des quais et les gars solides et râblés qui demain s'en iront vers la mer. Puis se caractérisent encore les ouvriers, les petits musiciens, les poissardes mélancoliques, les mangeurs de soupe, toute une population de déjetés et de miséreux. Toutes ces pages témoignent d'une sagesse et d'une sûreté indéniables. Dès que le peintre le veut, il réalise aussi bien que quiconque la correction du dessin et la proportion des diverses parties d'un corps humain. Je ne puis m'enlever du souvenir tel Gamin en casquette aux lèvres grosses, au nez compact, à l'œil légèrement triangulaire, ni cette ferme et précise étude de Main tendue où l'ossature des doigts dans la peau détendue et les bosses des muscles apparaissent si nettement, ni ce Vieux cheval noueux, maigre, efflanqué et comme diminué qui se tient avec peine debout entre deux brancards, ni surtout cette adorable tête d'Enfant endormi dont la bouche entr'ouverte est d'une vie si vraie et dont l'œil est si délicieusement clos. Comme on sent le sommeil et non la mort!
Rendre la matière, scrupuleusement, fut la tâche qu'Ensor s'assigna dans tels dessins: ferrailles, armoires, clefs, rideaux, étoffes, lustres, coffrets. Il y réussit, sans se tromper jamais. Son crayon fouille, comme un outil sûr, les fibres et les nœuds du bois ou rend avec bonheur l'usure des bosses et des reliefs. On pourrait deviner si tel meuble est en chêne ou en noyer. Assurément—tant l'exactitude est grande—s'aperçoit-on s'il est plaqué d'acajou. Les ornements d'acier ou de cuivre sont creusés dans leurs ombres ou caressés sur leurs lueurs; un rinceau, une courbe, une volute est rendue avec dextérité. Autant le pinceau est léger et souple à fleur de toile, autant la pointe est insistante et vigoureuse sur le champ des feuillets. De même l'ampleur lourde et molle d'un rideau de laine qu'une grosse cordelière retient est offerte au toucher et semble pouvoir renfermer en ses plis jusqu'aux mites et aux poussières. Bien plus. Ces dessins, encore que littéraux, sont doués d'une vie ample. Ils n'ont rien d'industriel. Si pour James Ensor certains meubles sont hantés, tous les objets frissonnent, bougent, sentent. La cruauté séjourne dans le couteau, la discrétion dans la clef et le fermoir, le repos et la sécurité dans le bois. Rien n'est mort, complètement. Chaque matière renferme en elle sa tendance, sa volonté et son esprit. Elle est créée pour un but. Elle doit donc avoir comme une âme qui tend à une fin et c'est précisément cette âme qui seule nous intéresse dans l'inanimé et qui seule constitue, aux yeux d'un artiste, la beauté des choses les plus quelconques. A côté de ces dessins très écrits, James Ensor en a réussi d'autres entièrement baignés d'atmosphère. Un modelé frêle les distingue. Ils participent plus que les autres à la vie universelle, aux variations de l'heure. Pour les réussir il faut un tact spécial. Ils sont d'un grain menu et d'une fragilité choisie. Certains apparaissent comme faits avec de la poussière rassemblée dans les ombres et dispersée dans les clairs. Des gris tendres savamment distribués en constituent la beauté précieuse. Voici le Portrait de Madame Rousseau. Elle est assise à l'avant-plan, parmi des meubles familiers, non loin d'un bas-relief. Le jour est tamisé; tout est en infimes nuances et en atténuation. Il en résulte une impression de douceur et de calme si grande qu'une mouche survenant la troublerait, malencontreusement, du simple bruit de ses ailes.
Mon père mort est conçu dans le même esprit. La page est solennelle, sobre, émue. On aperçoit seulement la tête posée parmi les draps que légèrement quelques tons blancs rehaussent. A traits fins, la barbe et les cheveux sont rendus. Le crayon Conté et le crayon gras out introduit le jeu de leurs différentes accentuations dans les parties sombres. L'ombre s'anime, mais uniquement afin d'éviter qu'elle ne soit opaque: il faut que la seule sérénité règne dans l'étude entière. Le dessin est du reste irréprochable. Le nez, les yeux et le front sont nets sans dureté, les chairs sont admirablement apâlies quoique consistantes encore.
Cette même manière de nuancer un dessin sans l'affadir ni le banaliser se retrouve dans le Portrait de ma mère, appartenant à M. Goldschmidt, et dans les Squelettes musiciens. Devant une armoire où s'étale un crâne sans mâchoire, apparaît un squelette introduisant le bec d'une clarinette dans sa bouche sans dents. Un manche de violoncelle s'élève non loin de lui. Ces deux crânes sont étudiés avec un art parfait. Chaque relief, chaque méplat, chaque partie osseuse avec ses stries et ses méandres est rendu comme un artiste gothique se serait plu à les traduire. Faire attentif, serré, scrupuleux. Impossible de pousser plus loin l'attention minutieuse, ni la probité appliquée. Et quelle aisance, quelle apparente facilité, quelle ductilité et quelle flexibilité prestigieuse des doigts. Et combien tout est sûr et savant!
La ligne même, la ligne pour elle-même, la ligne simple et jolie, la ligne belle et enveloppante séduisit à son tour la main chercheuse de James Ensor. Et voici la Vénus à la coquille dont le corps souple, limité par un trait gracieux et flexible, surgit, avec, entre ses doigts, une pomme. Les jambes, le torse, le ventre et les bras sont suffisamment modelés pour qu'ils donnent la sensation d'exister vraiment et n'être pas uniquement des blancs sur un papier. Mais c'est l'arabesque sinueuse séparant la Déesse de l'ambiance qu'on admire surtout et qui étonne par sa souplesse. On songe à quelque fleur délicate et haute.
Les sujets ornementaux, avec leur fantaisie violente et leur parodie épique ont tenté à maintes reprises le crayon d'Ensor. L'histoire, la légende, les coutumes lui fournissent leurs thèmes. Il les transforme selon son humeur, son caractère, sa nature. Ils ne sont pour lui que des sortes de tremplins sur lesquels sa verve et sa raillerie bondissent. Les batailles surtout le requièrent. Grâce aux coups donnés, aux plaies reçues, grâce aux déhanchements du corps qui frappe et aux chutes des corps qui succombent, grâce aux contorsions qu'il suppose et aux pirouettes qu'il imagine, un combat se présente à lui avec délices. L'horreur réelle en est supprimée au profit de la truculence et du pittoresque. Ou bien encore c'est dans quelque décor moyen-âgeux, sur une place meublée de maisons hautes et pointues, quelque drame violent: Sorcière qu'on brûle, Patrons de cathédrale, Vierges aux navires, Soudards entrant en des cités étranges. Ou bien encore, dans un site d'hiver quelque folâtre et compliquée scène de Patinage ou bien enfin quelque Parade dans une arène de cirque. Celle-ci amuse immédiatement par la gymnastique baroque des clowns et les sauts invraisemblables des paillasses. On croirait assister à quelque liesse d'escargots, à quelque fête de chenilles. Des êtres contournés, girouettants, tire-bouchonnés permettent au dessinateur de réaliser, par des volutes charmantes et placées chacune à quelque endroit précis et heureux de la page blanche, une ornementation inédite qui charme l'œil immédiatement, sans examen, et divertit l'esprit sitôt qu'il s'attarde.
Toutefois le motif le plus célèbre est traité dans la Bataille des Éperons d'or. Les communiers flamands sont rangés à droite, coiffés de casques inusités, armés de massues buissonneuses et présentant des «goedendags» pareils à des reptiles. Courtrai avec ses tours, ses remparts et ses moulins, se devine, là-bas. Ils la défendent et leurs lignes rangées et pointues s'étendent devant elle, comme une succession de haies où flotteraient, ci et là, des drapeaux. Le lion noir de Flandre orne la plus haute bannière.
A gauche, mais à l'arrière-plan, apparaissent les chevaliers français sur leurs chevaux rapides et ployés en arc de cercle. Cimiers, panaches, lances, épées, bannières, tout flotte ou se dresse au vent. Derrière eux un incendie s'allume et l'horizon est peuplé de nuages capricieux et tourmentés.
Au milieu la bataille: foulons, tisserands, bouchers assaillent et désarment les ducs et les barons. Des jambes, des têtes, des bras encore armés de fer et d'acier gisent à terre. On a coupé les corps comme aux abattoirs. Un cheval est tombé pattes en l'air, une flèche fixée au gras de sa croupe. Voici un communier pendu à la queue d'un coursier; un autre se soulage et fait un pied de nez aux charges qui approchent. Les chevaux ruent, s'effrayent, s'abattent. Une mêlée grotesque s'éparpille en mille actions non pas d'éclat, mais de gaieté baroque et de risée. L'invention est spontanée, abondante, joyeuse. On assiste à une dépense de jovialité narquoise et d'humeur pavoisée. Les drapeaux qui flottent, les armes qui se dressent, les rayons du soleil, les banderoles des nuages ne sont présentés à la vue que comme décors fictifs et lignes ornementales. La Bataille des Éperons d'or est une kermesse où l'on tuerait pour s'amuser, où l'on tomberait pour se distraire, où l'on mourrait pour avoir le plaisir de faire une grimace. Le Triomphe romain s'apparente à la Bataille des Éperons. La composition en est moins originale et les lignes dominantes moins inattendues. Toutefois peut-on se réjouir à voir les licteurs présenter leurs faisceaux comme des seringues et ceux qui portent les aigles arborer ces dernières comme de vulgaires oiseaux abattus par des archers, dans quelque village flamand. Il conviendrait d'insister encore sur la Mort d'un théologien, sur la Multiplication des poissons, sur les Soudards Kès et Pruta, sur Iston, Pouffamatus, Cracozie et Transmouff, sur les Diables menant le Christ aux Enfers. Je me bornerai à présenter la plus importante des Tentations de Saint-Antoine, grande composition qui ne fut exposée, après un premier refus, qu'aux XX, en 1888.
Elle est divisée par étages. Au rez-de-chaussée, l'anachorète gros et geignant se présente à nous et sa bonasse figure, que de grosses larmes humectent, regarde le ciel, sans trop de désespoir. Au-dessus de lui trône une femme qui se dévêt même de la feuille de vigne. Elle est grande, belle, élancée, et son impudeur est triomphante. En haut, tout en haut, apparaît une admirable tête de Christ, prise à quelque maître gothique flamand. Il semble consoler Antoine et pleurer lui aussi sur l'amas des vices et des péchés montrés.
Dans la vie des Saints par Alban Stolz, docteur en théologie et conseiller ecclésiastique, il est dit d'Antoine: «Un jour qu'il venait d'être tenté plus que de coutume, il lui sembla que Notre Seigneur lui apparaissait rayonnant de lumière. Il lui dit en soupirant: «Bon Jésus où donc avez-vous été? Pourquoi n'êtes-vous pas plutôt venu me secourir». Et il lui fut répondu: «Pendant que vous combattiez j'étais auprès de vous, car sachez que je vous assisterai toujours.» Ce texte commente nettement le fourmillant dessin d'Ensor. Il composa du reste ce poème par morceaux, appliquant sur une grande toile, maint carré de papier qui continuait sans interruption la partie de scène traduite sur le carré voisin.
En plus, si l'œuvre se divise, dans le sens de la hauteur, par étages, elle se complique aussi, dans le sens de la profondeur, par couches. Presque partout quelque motif en saillie en cache un autre d'un relief plus atténué et plus fondu. Il en résulte une abondance et comme une fermentation étrange, car dans cette large page tout est traité: religion, histoire, morale, vice, vertu, terreur, angoisse, rire, ricanement, folie. On se croirait en présence de quelque œuvre indoue qui nous propose une explication du monde. Et voici les cultes anciens ridiculisés par une Minerve grotesque debout au fronton des temples et voici les mille inventions modernes traitées fantastiquement: trains, ballons, navires; et voici des écorchés dont des femmes enlèvent la peau et voici des crucifiés dont des femmes enlèvent le cœur et voici les péchés capitaux qui apparaissent avec leurs violences et leurs affres et qui tournent autour de la luxure centrale.
Dans le bas se déroulent des cortèges. Des mimes, des masques et des clowns, portant des pancartes folâtres se poussent vers saint Antoine comme pour lui présenter la pétition goguenarde de l'universelle démence humaine.
Oh, le multiple et terrible cauchemar enluminé! Il arrête surtout par ses détails minutieux et innombrables, mais l'ensemble en est toutefois large et imposant. Celui qui le conçut est quelqu'un dont l'intelligence, le cœur et l'imagination travaillent et fournissent avec angoisse leur pensée et leur rêve aux mains patientes et laborieuses.
C'est dans son travail d'aquafortiste plus encore que dans son œuvre de peintre que l'imagination d'Ensor s'est débridée. Bien des cuivres reproduisent certains de ses tableaux et tel de ses dessins est traduit en gravure. Toutefois, quand le burin à la main il conçoit quelque composition encore inédite, le vent de la fantasmagorie plus que jamais violent lui souffle sur le cerveau. Je craindrais de rééditer certaines analyses déjà faites si je présentais, ici, toutes les diableries et mascarades traitées à la pointe. Je ne veux appuyer que sur leur excessive audace, sur leur extrême cocasserie, sur leur insurpassable outrance. L'impudeur, l'indécence, la scatologie même apparaissent. Mais—disons le en y insistant—rien n'est malsain, trouble, louche, ambigu; tout au contraire est franc, sincère, féroce, brutal. Il n'y a pas de sous-entendu. Il y a étalage. On sait immédiatement qu'il faut ou fermer ses yeux si l'on craint pour ses prunelles innocentes, ou se boucher le nez si l'on possède des muqueuses trop délicates. Le haut-le-cœur est soudain ou ne se produit pas. Ceux qui l'évitent se complairont à suivre alors, en tous leurs méandres, les fleuves de verve tumultueuse et de raillerie agitée que l'artiste charrie à travers ses œuvres, avec leurs boues frappées de soleil, leurs folles herbes tournoyantes et leurs charognes magnifiques. Vienne, Zürich, Liège, Barcelone, Milan, Venise, Ostende, Dresde, Paris possèdent, en leurs collections publiques mainte eau-forte du graveur. M. Eugène Demolder en une critique pénétrante et renseignée, M. Coquiot das sa préface au livre des masques, M. Vittorio Pica, là bas, en Italie, dans les revues et Jean Lorrain, dans le roman étrange, précieux et faisandé de M. de Phocas, ont longuement et ardemment célébré tels ou tels cuivres du peintre. Voici ceux qui ont le plus souvent sollicité la critique.
La Cathédrale (1886). Serrée, compacte, myriadaire, une multitude s'avance moins avec ses jambes, ses bras, son corps qu'avec ses visages, vers on ne sait quel but. Elle bouge non pas individuellement, mais totalement, d'un énorme mouvement d'ensemble et c'est comme si la masse humaine entière s'ébranlait. Au milieu d'elle une église avec ses grandes tours, avec l'élancement de ses ogives, avec ses toits et ses clochetons, une église légère, triomphante, aérienne est plantée et domine. Au loin se devinent d'autres architectures, des surgissements de flêches, des hampes géantes et des drapeaux. On songe à une colossale fête séculaire, à quelque anniversaire prodigieux. Le spectacle est épique.
Et cette impression est donnée non pas avec force, mais avec légèreté et délicatesse. Le burin fourmillant a creusé partout mais jamais sa pointe ne fut rude ni acharnée. On dirait le travail d'un clan de mouches ou d'une ruche d'insectes. Une atmosphère joyeuse, transparente, fine, légère, baigne la page entière et si le mot chef-d'œuvre vole sur les lèvres de celui qui la regarde, ce mot y semblera bien à sa place comme est à sa place sur le cuivre chaque trait d'ombre et chaque surface de lumière.
La grande vue de Mariakerke (1887) est d'une qualité d'art aussi haute que la Cathédrale. Les petites maisons du village west-flamand sont groupées autour de son clocher, avec leurs toits comme des ailes abaissées, avec leurs maigres enclos, avec leurs dunes poudreuses et leurs verdures aiguës. Un ciel admirable de nuages volants le surmonte et le grandit. On sent la mer proche. Les herbes de l'avant-plan sont ployées par le vent du large. Elles forment comme une barrière d'ombre qui éloigne et approfondit le sujet principal. Un air abondant circule. Une correspondance exacte, une interinfluence scrupuleusement observée et rendue existe entre le ciel et la terre. Les plans sont partout minutieusement fixes et leur accord partant des bords du cadre jusques à l'horizon prouvent quel œil sûr Ensor possède qu'il s'agisse du trait ou de la couleur.
Et l'Hôtel de ville d'Audenarde (1888) et surtout les Barques échouées (1889) confirment encore en nous cette conviction. Dans la première planche, l'ombre des galeries du rez-de-chaussée est rendue avec une justesse merveilleuse et tout le haut de l'édifice semble comme vibrer dans la lumière; dans la seconde, grâce à la disposition oblique des deux lignes principales, celle du rivage lointain et celle des bateaux sur le quai, l'approfondissement du paysage est admirablement rendu, tandis que la volute large et ample du nuage, déroulant sa portée dans la même direction que le rivage de droite et les barques de gauche, concourt à cette même illusion d'étendue. Souvent, le jeu subtil des lignes ne fut guère favorable aux compositions de James Ensor, mais ici les plus malveillantes critiques ne peuvent avoir de prise et son œuvre est irréprochable. Ceux qui le chicanent sur la trop fameuse perspective, n'ont qu'à examiner les Barques échouées. Ils conclueront que si le peintre viole parfois telle ou telle sacro-sainte règle, tant en ses tableaux qu'en ses dessins, ce n'est ni par ignorance, ni par impuissance mais par réflexion et par volonté. L'art doit sacrifier à chaque instant les préceptes et les enseignements qui le gênent dans ses recherches et ses découvertes. Un vrai artiste trouve en lui-même la justification de ses excès. Ce qui s'est fait avant lui ne lui est qu'un conseil; ce ne peut jamais lui être un ordre, ni une sorte d'ultimatum. L'art est libre, libre, libre! s'écrie quelque part James Ensor. Il n'y a que les médiocres qui ne comprennent pas et ne comprendront jamais la profondeur et la sincérité d'une telle revendication ardente. Heureusement que les routes supérieures de l'humanité en marche sont plantées de grandes œuvres qui l'affirment et la crient à leur tour.
Le Christ calmant la tempête (1886), les Sorciers dans les bourrasques (1888), l'Ange exterminateur (1889), sont des compositions magnifiques d'ampleur et de simplicité. La première est comme solennelle. On a la sensation d'un miracle qui éclate et du surnaturel qui rayonne. Les deux autres baignées—dites de quelle vaste ou féerique lumière—propagent un mouvement fou tout au long de leurs lignes. L'énorme Sorcier de la bourrasque fait songer à quelque Caliban céleste. Il est grotesque et puissant à la fois. L'ange exterminateur a beau nous apparaître comme une sorte de croquemitaine et les foules qui le voient passer s'accroupir en des poses affolées, l'apparition est magnifique et inoubliable de splendeur. Le trait menu et comme tremblant, le trait minuscule et rompu doue le cheval et son cavalier galopant dans les nues, comme d'une vitesse frémissante.
Les sept péchés capitaux, que précéda dès 1888: Peste dessus, peste dessous, peste partout, nous offrent comme une œuvre cyclique où le grotesque le dispute à la férocité. Une eau-forte liminaire en prépare l'impression étrange. Elle figure une Mort ailée—dites quelles ailes misérables et déplumées le squelette entr'ouvre!—abritant sous elle des personnages divers dont chacun semble être une indication rapide des sept vices à fustiger.
La Luxure (1888) occupe le centre de l'œuvre. Un jeune homme dont le corps est à demi dissimulé, semble ramper, sur un lit, vers une femme énorme qui détourne la tête et n'étale qu'une chair ballonnée impudique et monstrueuse. Le temps, sinistre et glabre vieillard, le temps aux mains et aux ailes crochues menace d'une faux énorme le couple lubrique, tandis que voltige dans l'air une manière de gnome cornu et que dans un cadre, près d'un rideau, de vagues nudités apparaissent. Dessin rapide, traits menus, facture fine et délicate. Page de blondeur et de jeunesse où seule la faux levée trace un lugubre éclair. Elle voisine avec l'Avarice (1904)—ici, la pointe du burin appuie, griffe, devient comme méchante—et l'on voit un terrible bonhomme, en casque-à-mèche compter son argent sur une table et quelque démon hérissé remuer, avec lui, les pièces rondes et frémissantes. Soudain surviennent deux assassins qui assaillent et saignent le cynique avare. Le sang éclabousse sa figure et s'écoule de son flanc. L'Envie (1904) s'éclaire de l'apparition d'une jeune mère tenant un nouveau-né entre ses bras. Elle est heureuse. Un jeune gars l'embrasse. Une paix, une douceur, une tendresse est répandue. Des rayons partent du milieu de la page, baignant le front de la femme et se projetant jusqu'au bord du cadre. Mais voici la contradiction qui se lève: vieilles filles au nez féroce, bigotes tirant la langue, hommes graves et bilieux, crétins faisant des pieds-de-nez et ci et là des squelettes voltigeant comme pour annoncer la maladie et le trépas et affirmer combien toujours la mort est suspendue sur la vie.
L'Orgueil (1904). Solennel, ponctuel, grave, rogue, ridicule, avec de tombantes bajoues, avec un front étroit, carré, abrupt, avec une tête trop volumineuse pour son corps étriqué, quelque vague notaire ou commerçant ou bourgmestre de province se présente à la foule des quémandeurs, des humiliés et des pauvres qui lui baisent les mains. Un squelette lui pose une couronne sur la tête. Un coq, les plumes hérissées, crie vers lui comme s'il claironnait de fureur. Un âne regarde. Quelque morne sacristain lit un discours; quelque minable vieille tend un bouquet. La mort, armée de sa faux, promène ses doigts d'os dans la perruque d'une femme acariâtre—peut-être la compagne du notaire, du commerçant ou du bourgmestre—et lui cherche sa vermine. La scène est d'une observation cruelle et folâtre. Tout est piteux, morose, grotesque dans ce triomphe. La petite ville y est raillée et bafouée. Ensor se venge.
La page la moins réussie nous représente la Colère (1904). Au fond d'un lieu quelconque—appartement d'ouvrier ou grenier bourgeois—homme et femme, avec des couteaux et des crochets, luttent et se blessent. Leur chat, le poil dressé, assiste à la bataille. Des êtres singuliers interviennent et la camarde semble faucher le vide au-dessus des combattants. On croirait que le cuivre est griffé au moyen d'un clou. Toute autre est l'abondante et grasse et croupissante et savoureuse Gourmandise (1904). Bien que les deux personnages assis vomissent leur nourriture et que la Mort leur serve un homard et qu'un chien, sur le dossier d'une chaise, compisse l'un d'eux et qu'une tête coupée s'étale sur un plat, le petit drame gastronomique se caractérise par une jovialité amusante. Un tableau pendu au mur réjouit par son dessin preste: il représente des porcs qu'on tue, dans un village sur la place, et certes les deux bâfreurs assis ou plutôt affalés à leur table ne se doutent point qu'ils méritent un semblable trépas. L'énorme cochon qui se hisse dans un coin, la langue pendante, semble seul distraire le plus gros des convives et son œil oblique s'en va vers le groin tendu ou vers le homard que la mort apporte, presque amoureusement. Enfin la Paresse (1902) représente deux dormeurs, un homme et une femme, enfoncés dans leur couche. Un lutin ricaneur chatouille l'œil de la dame. Un squelette détraque une horloge et enlève une aiguille. Par la fenêtre, on aperçoit des paysans qui moissonnent, des ouvriers qui brouettent, des valets qui bêchent, des gens de peine qui transportent des fardeaux, des soldats à l'exercice, des trains qui roulent et tout au loin une ville énorme dont les usines s'acharnent et fument sous le riant soleil. Dehors il fait grand jour, mais les dormeurs baîllants se calfeutrent et de lents escargots rampent sur leurs draps. Un petit démon, sur la table de nuit, éteint, d'un pet, la bougie.
Cette suite de sujets renseigne—et que d'autres petites planches l'affirment comme elle—sur l'inépuisable fantaisie de James Ensor. On la croit au bout de sa trépidation et toujours et encore elle recommence. Elle est véloce et incessante comme le tic-tac d'une montre. Elle s'agite jour et nuit. La moindre observation faite au hasard la remonte comme le petit tour de clef quotidien redonne la vie aux ressorts distendus.
Pour saisir mieux encore cette folâtre imagination il faudrait la suivre jusque dans sa descente vers la caricature et la montrer aux prises avec les Cuisiniers dangereux[1] et les Mauvais médecins (1895).
Les Cuisiniers dangereux sont les critiques. On y distingue telles personnalités que J. Ensor redoutait. Elles servent un étrange repas à quelques-uns de leurs confrères et sur les plats présentés s'étale la tête même du peintre flanquée d'un sauret. Les Mauvais médecins opèrent avec une férocité délurée, s'empétrant parmi les intestins qu'ils retirent des ventres comme des câbles et taillent dans les chairs de larges crevasses par où s'évadent les entrailles. Le patient tend un poing vers le ciel, est retenu par une corde qui l'étrangle tandis que la mort sinistre, avec un geste préceptoral, apparaît.
[1] Les Cuisiniers dangereux sont un panneau (1896).
Vie banale somme toute, mais en lutte avec un caractère spécial, étrange, infiniment impressionnable et ombrageux.
Ensor naquit à Ostende. Il a 48 ans. Il grandit dans une maison de négoce, avec sa boutique achalandée s'ouvrant sur la rue, à côté de la chambre de famille. Aux jours où la mer est calme on envoie l'enfant sur la plage se distraire dans le sable, avec des coquillages. Il ne connaît point encore le pittoresque quartier des pêcheurs plein de voiles et de bateaux, plein de gamins hâves qui jouent parmi des charettes à bras, dépiotent de leurs doigts prestes les crevettes tombées des paniers de la marée et se poursuivent parmi les cordes tendues de poteau en poteau et les ancres abandonnées dans les terrains vagues. Ce n'est que plus tard qu'il se mêlera, poussé par son art, à la vie des matelots et des mousses.
Il ne suit les classes que pendant deux ans. Lui même emmagasine quelques connaissances variées dans sa jeune tête. Ses livres d'images le hantent. Les romans à naïfs dessins le sollicitent. Après avoir admiré les gravures il lit le texte. Mais déjà mainte tentation lui vient de rendre les tons et les lignes qu'il voit. Il griffonne et barbouille. Détail à noter: ce sont les couleurs qu'il traduit avant même qu'il dessine les objets. Il a quatorze ans.
On lui donne comme professeurs deux vagues aquarellistes ostendais: Dubar et Van Kuyck. Leurs conseils lui sont légers. Il les écoute et oublie leurs paroles. Il n'est inquiété que par ce qu'il voit. Il ne peint que d'après nature et les sites marins et les dunes et les paysages des environs d'Ostende sont ses premiers modèles. Louis Dubois, le beau peintre solide et puissant, rencontrant un jour, au cours d'un villégiature sur la côte, les quelques pages auxquelles James Ensor, presque enfant, confiait ses primes essais, s'enthousiasma et vivement s'intéressa à ses débuts.
En 1877 le voici à Bruxelles. De 1877 à 1880 il fréquente l'Académie. Il y eut pour compagnons: Fernand Khnopff, Charlet et Duyck. Et pour maîtres: Portaels, Stallaert, Robert et Van Severdonck.
Plus tard, sorti de cette école, il appréciera et critiquera l'enseignement de ses maîtres, en ce caractéristique monologue:
«TROIS SEMAINES A L'ACADÉMIE
Monologue à tiroirs
La scène est dans la classe de peinture.
Personnages: Trois professeurs, le directeur de l'Académie, un surveillant; personnage muet: un futur membre des XX.
Nota: La vérité des menus propos qui suivent est garantie.
1re Semaine: M. le professeur Pilstecker.
Vous êtes coloriste, Monsieur, mais sur 100 peintres il y a 90 coloristes.
Le flamand perce toujours chez vous, malgré tout. Je trouve les artistes français très forts; dans une exposition, on les distingue de suite de leurs voisins; ils sont très forts en composition.
Il ne faut pas croire que le professeur abîme l'étude en la corrigeant; quand j'avais votre âge, je le croyais aussi, maintenant je vois bien que le professeur avait raison.
Vous n'avancez pas! ça n'est pas modelé! (montrant l'étude d'un autre élève). En voici un qui va bien! Malheureusement il est trop paresseux.
Vous cherchez déjà l'air ambiant, au lieu d'attendre que vous soyez assez fort en dessin; songez que vous avez encore deux classes d'antiques à faire! après celà, vous aurez bien le temps de vous occuper d'air ambiant, de couleur et de tout le reste.
Vous ne voulez pas apprendre; peindre comme celà, c'est de la folie ou de la méchanceté.
Je suis forcé de vous complimenter sur votre dessin; mais pourquoi faites-vous des dessins contre l'Académie?
2e Semaine: M. le professeur Slimmevogel.
Vous avez fait votre fond au lieu de faire la figure; ça n'est pas difficile de faire un fond.
Vous faites le contraire de ce qu'on vous dit. Au lieu de commencer par vos vigueurs, vous commencez par les clairs. Comment pouvez-vous juger votre ensemble. Il faut faire vos vigueurs avec du noir de vigne et de la terre de Sienne brûlée.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air ici; jamais je n'ai vu la classe de peinture comme cette année. Je serais honteux si un étranger entrait ici.
Je ne vois rien là dedans. Il y a de la couleur, mais ça ne suffit pas.
Ça manque de vigueur. Vous empâtez trop. Vous avez l'air de bien chercher cependant. Vous avez assez cherché maintenant.
Est-ce M. Pilstecker qui a corrigé votre étude? Ça n'est pas sa semaine, pourtant. C'est embêtant, ça!
3e Semaine: M. le professeur Van Mollekot.
Qu'est-ce que c'est que ça! C'est beaucoup trop brun, vous savez. Est-ce M. Slimmevogel qui vous a corrigé?
C'était si bien commencé. Vous dessinez si bien, mais vous abîmez tout ce que vous faites.
Croyez-moi, c'est dans votre intérêt que je vous le dis. Mettez votre étude à côté du modèle. Vous avez peur de peindre.
Il faut peindre avec des brosses plates, en pleine pâte, mais il faut faire attention de ne pas blaireauter.
Vous n'empâtez pas assez. Je sais bien que vous savez le faire, mais il faudrait le montrer aux autres.
Vous faites du paysage, c'est de la farce, le paysage!
M. le Directeur.
Vous dessinez en peignant, mauvais! mauvais! Vous allez vous noyer.
C'est le sentiment qui vous perd, vous n'êtes pas le seul.
La semaine passée, vous avez fait un bon dessin, maintenant, c'est encore une fois la même chose; vous avez mal à l'œil peut-être? Un sculpteur serait bien embarrassé, s'il devait faire quelque chose d'après votre dessin.
Est-ce M. Slimmevogel qui a retouché ça?
Le Surveillant.
M. le Directeur et M. Pilstecker sont très fâchés contre vous, à cause de votre concours d'esquisse peinte. Si vous voulez me promettre de changer de manière, j'en parlerai à M. le Directeur, et vous pourrez entrer à la classe de nature.
Moralité: L'élève quitte l'Académie et se fait Vingtiste.
Moralité ultérieure: On refuse toutes ses toiles au Salon.»
Ce monologue porte. Il est jovial et juste. Il résume, d'un style leste et ironique les tares de l'enseignement officiel. Les personnages représentés se reconnaissent. Leurs jolis noms empruntés au langage populaire donnent au morceau entier, une savoureuse couleur locale. Ensor ne pouvait être un bon élève. Sa nature s'y opposait; il était destiné à devenir un bon peintre. Il remporta toutefois le deuxième prix de dessin de tête antique.
Revenu à Ostende il se forme lui même. Toutefois restent suspendues au mur de son atelier deux compositions faites à l'Académie: Oreste tourmenté par les Furies et Judas lançant l'argent dans le Temple. On comprend que d'authentiques professeurs se soient étonnés devant ces peintures. Le ton y est déjà très particulier. Les personnages baignent dans une lumière argentée; aucun trait n'est sec ni maigré. Aucun geste conventionnel, ni appris. La scène n'est point soulignée par la présentation à l'avant-plan du protagoniste principal, soit Judas, soit Oreste. C'est le groupe qui intéresse; c'est l'ensemble; c'est l'action totale. Des rouges sonnent sur un fond d'argent. Les défroques sont plutôt romantiques que classiques ou bibliques. Le dessin académique est tout entier mangé par la couleur. Ces deux toiles sont déjà de la vraie peinture ensorienne.
L'année 1880 fut une année admirable pour James Ensor. Son vrai début date de ce temps. Il lit beaucoup. La littérature n'a jamais ému les peintres belges. En ce temps là, surtout, leur ignorance se dressait monumentale. Ils avaient peur d'orner leur esprit pour ne point courir le danger de sacrifier à l'imagination. On sait ce que cette crainte puérile a produit. Au dernier Salon d'automne (1907) à Paris, le principal grief qu'on fit à notre exposition rétrospective fut de manquer d'intellectualité ou plutôt d'intelligence.
Je n'ignore point qu'un peintre littéraire est un peintre dévoyé. Je sais qu l'œil et non pas l'esprit doit dominer dans les arts plastiques. Nul plus que moi ne s'est fait un devoir de signaler combien il importait de voir, de regarder, de constater afin de bien traduire soit la ligne, soit la couleur, soit la lumière. Toutefois il ne faut pas qu'un peintre se prévaille de cette vérité qui peut apparaître, à juste titre, comme une manière de dogme esthétique, pour s'opposer à toute culture générale et se complaire à n'être volontairement qu'une brute qui peint. Il faut, au contraire, que tout artiste s'affine et s'éduque. Or, c'est la littérature seule, prise dans son sens large, qui lui peut donner cet affinement. Il doit tendre à son développement complet, à l'exaltation de sa personnalité totale; il doit comme fourbir le faisceau entier de ses facultés. Rien n'est perdu et, mystérieusement, tout sert. A l'heure des chefs-d'œuvre, c'est tout l'être humain, avec ce qu'il contient de puissance latente et emmagasinée dans son cerveau, dans ses sens, dans ses muscles, dans ses nerfs, qui apparaît et qui se hausse, par sa création soudaine mais combien lentement préparée, au plan des dieux.
Les maîtres que lisait Ensor étaient évidemment ceux que sa nature d'exception lui désignait: Edgar Poe et Balzac. Pourtant, avant eux, il avait cultivé Rabelais (on s'en aperçoit en ses écrits); il goûtait le Roland Furieux, de l'Arioste, et Don Quichotte et les Mille et une Nuits. J'ai trouvé également dans sa bibliothèque «l'Enfer» du Dante.
Quant aux peintres qu'il entoure de son culte pieux ce sont et Rembrandt et Delacroix et Chardin et Watteau. Il ne lui déplaît pas de louer également—il ne serait pas James Ensor s'il n'appréciait l'antithèse—le «Virgile lisant l'Enéide» (fragment) du vieil Ingres.
Il englobe encore dans son admiration Pierre Breughel et Jérôme Bosch. Mais il ignore Rowlandson et Gillray auxquels il ressemble. Et Goya ne lui est nullement familier.
Ses voyages furent très rares. En 1892 il ne s'attarda que quatre jours à Londres; il fut à deux ou trois reprises à Paris; il se divertit dans un voyage en Hollande, avec son ami Vogels, et les musées d'Amsterdam et de Haarlem le retinrent longtemps entre leurs murs.
Sa vie s'est écoulée, à Ostende, presque tout entière. Il y a subi l'interminable et ensevelissant ennui de la province qui tombe sur l'âme comme une poussière sur le corps; il y a connu la moquerie et la haine; le potin et la risée; il y a rencontré les contrariétés domestiques, l'incompréhension inévitable, la dérélection. Les heures noires lui ont fait cortège au long des jours gris, maussades, monotones. Sa sensibilité fine comme le grain d'un bois rare et précieux a subi les coups de rabot de la bêtise. Il s'est senti foulé, meurtri, brisé.
Les rares joies qui flambaient autour de lui étaient de pauvres joies provinciales. Il en prit, certes, sa part ne fût-ce que par tristesse. Une société Le Rat Mort le comptait et le compte encore au nombre de ses membres. Ce cercle où des médecins coudoient des avocats, où des échevins serrent la main à des notaires, où des musiciens —quelques-uns de vrai talent—introduisent le culte d'un goût surveillé, inscrit à son programme le rire et l'entrain pour essayer de vaincre la torpeur ambiante. Y réussit-il? Et sa joie n'est-elle pas uniquement réglementaire?
Quand James Ensor fut nommé chevalier par le Roi on lui ménagea quelque fête cordiale et tapageuse. J'en connais l'ordonnance. Elle fut consignée dans une brochure que rédigea et qu'illustra le peintre. Des discours sont prononcés, des strophes battent des ailes et des brabançonnes inédites voient le jour. La fête fut, paraît-il, charmante et folle. Je le crois, bien que le souvenir que j'en ai entre les mains ne me communique plus, à cette heure, ni charme ni folie. Mais il est juste d'ajouter que la carcasse d'un feu d'artifice tiré est chose lamentable et funèbre.
Ensor écrit assez volontiers. On sait que la plume est entre ses mains une arme—certes contournée, fantasque, chimérique—mais qu'elle est toutefois aiguë et pointée comme un couteau et qu'elle blesse souvent. Il s'est plu, dans le Coq Rouge, à la diriger—malencontreusement à mon avis—contre Alfred Stevens; dernièrement encore dans l'Echo d'Ostende, il égratigna maint critique. Il agit alors comme s'il tenait entre les mains une molle pelotte, qu'il traverse d'épingles et qu'il jette, dès qu'elle en est pleine, comme un espiègle, vers le public. Les traits portent, les allusions sont transparentes; ceux qui sont au courant de la vie d'Ensor comprennent. Les autres s'étonnent. Lui, dès son geste fait, redoute qu'on se fâche, s'excuse presque d'avoir aussi abondamment garni sa pelotte, d'avoir effilé trop vivement ses pointes, mais, quoiqu'il en ait, il n'a pu s'empêcher de la lancer. Sa phrase est surabondante d'adjectifs pittoresques et cocasses, de substantifs soudains et inventés; elle est folle, amusante, superlificoquentieuse; elle écume et bouillonne; elle monte et s'écroule en cataracte. Lorsqu'une bouteille d'ardent champagne se débouche et que le fourmillement des bulles gazeuses s'élève myriadaire et pétille vers le goulot pour se répandre et se résoudre en mousse, je songe au style fermenté de James Ensor.
Ostende ayant repoussé son art, loin des murs nus de ses monuments, le peintre, dès que l'occasion s'en offrit, malmena ses édiles. Il s'agissait d'élever une statue à M. Van Iseghem, bourgmestre. Voici le morceau. Je l'emprunte à la Ligue Artistique.
UN BRONZE OSTENDAIS A PLACER
«Resignalons allègrement les évolutions sardinéennes de nos bourgmestres vacillants ou édiles impénétrables, travaillés par des voix. Contemplons caricaturalement les entrechats effrénés de certains administrateurs ventripotents: singulières gambades agrémentées de culbutes désopillantes, subtiles ruades de grisons affolés, tiraillements aigres-doux de fonctionnaire non fonctionnant ruminant son bronze, maître coup de gaffe d'adroit manœuvrier manœuvrant, discussion spongieuse de batracien encornichonné coassant, effondrement subit de mache-brique imprévoyant, grossissement anormal de cucurbitacé triomphant.
«Lançons quelques pierres dans cette mare aux marmousets et enveloppons d'un voile épais les échantillons artistiques de nos esthètes tremblotants pataugeant en sourdine dans les vases de barbotine ou d'élection.
«Ces mêlées de moules et contre-moules et d'asticots asticotés me laissent indifférent: le contribuable ostendais a d'autres singes à fouetter. Mais une grosse question divise nos esthètes mercurisés.
«L'érection de la statue de Jan Van Iseghem s'impose, clament nos édiles en mal de bronze! Pschykoriaminikrolobrédibréraxispipipi! expectorent péniblement nos vieux barbons du littoral; «une réunion de conseillers de l'Huîtrisie Heureuse s'indique», fafouent nos scaphandriers désossés, prudents immergeurs de vesses traîtresses.
«Après vives discussions hérissées de bourdes solennelles, sauts de carpe, torgnioles, plamussades, nasardes fraîches, faux horizons de narquoisie, momeries variées, arlequinades de haute lisse, péroraisons limaçonnes, jérémiades de tritons essoufflés, volées oratoires de grand effet, miaulement suraigus, grognements agressifs, gloussements inarticulés et bredouillements confus dignes d'une assemblée de vieilles lavandières échaudées ou marchandes des quatre saisons coquemardées, nos orateurs mollusqueux, égosillés et contents se réfugièrent prestement entre de jolies valves nacrées et perlières, et il ne fut plus question de la statue du plus pelliculé des bourgmestres passés, présents et à venir.»
La musique l'a tenté autant que la littérature. Il compose et improvise. Blanche Rousseau fut, un jour, témoin de la façon dont il railla avec des notes ceux qui le raillaient avec des paroles.
«A un dîner de noces où se trouvaient un grand nombre de bourgeois, Ensor, pâle et muet, se laissait taquiner, mais avec des sourires contraints, des regards dédaigneux où s'allumait parfois l'éclair fugace d'une colère ou d'une ironie effrayantes. Non loin de lui, je l'observais et j'avais presque peur. Tout à coup, quelqu'un l'interpelle: «De la musique, James, de ta musique.» On rit, il résiste, on insiste.... Alors, il se lève tout à coup, marche au piano, et fait éclater une fanfare discordante, un tumulte de sons bousculés, mais si moqueurs, si violents, d'une si imprévue et tragique ironie ... une sorte de marche des bourgeois où les cris d'animaux se mêlent au vacarme du tam-tam, et brisée dans un long hurlement sinistre. Il revint à sa place, sans que, pourtant, sa figure eût changé—mais les autres ne riaient plus».
La musique autant que la littérature lui sert donc à des manifestations irritées tout autant que certains dessins et certaines caricatures. Quand sa sensibilité est trop foulée et comprimée par l'hostile ambiance elles lui sont comme deux soupapes qu'il ouvre tout à coup et par lesquelles il se libère de sa mauvaise humeur.
Mais quelquefois aussi elles lui apparaissent comme de réelles expressions d'art, surtout la musique, qu'il aime et cultive, avec délices et pour laquelle, me dit-on, il se sent né tout autant ou peut être plus encore que pour la peinture.
«L'étrange musique, écrit encore Blanche Rousseau. Elle ne ressemblait à aucune autre; elle ne ressemblait à rien au monde. Elle était sourde et voilée—rapide comme un souffle, aussi légère—ou bruyante soudain—dure, heurtée, diabolique.... Les sons couraient, agiles, ailés, s'égouttaient en jet d'eau ou s'écroulaient en poudre.... Ils se relevaient, s'envolaient en soupirs vers les nues idéales et retombaient à terre avec des grimaces et des contorsions. C'était pour moi, petite fille, des troupeaux d'anges et de démons tournoyant entre ciel et terre, des chutes et des essors, et les merveilleuses ascensions d'un mélange bizarre de figures dont prédominaient tour à tour les unes, sublimes, ou les autres, grimaçantes et horribles.... Et quand, brisant soudain une mélodie, Ensor entonna le Miserere d'un voix vacillante, effrayante dans l'ombre, la voix exacte d'un curé cynique et rapace devant un cercueil entouré de cierges—tandis qu'on riait dans la chambre éclairée—mon cœur se glaça d'horreur et je me crus vieille à treize ans».
Il suffit d'avoir approché Ensor à certains jours, d'avoir écouté, attentivement, ce qu'il ne disait pas pour se convaincre qu'il est à la fois timide et téméraire, très simple et très complexe, que le soupçon habite en lui, qu'il se croit volontiers honni, trahi, persécuté même, qu'il est plein d'ironie et de goguenardise. Son silence et son rire sont, presque au même titre, inquiétants. Il a la haine de la bêtise; il la sait dure et coriace: il faut de temps en temps qu'il la morde. Pourtant la méchanceté lui est étrangère.
Au fond, très au fond de lui, séjourne certes la bonté; mais cette source profonde il ne la montre qu'à de très chers regards. Sa petite nièce l'a vu certes se répandre. Pour les autres gens, il demeure un être fermé et énigmatique. On ne le saisit jamais entièrement. La vie lui apprit à être défiant. On ne lui a point rendu toute justice. Son art n'est point encore, à cette heure, situé où quelque jour il se campera. Mais qu'importe! l'ascension sera d'autant plus sûre qu'elle aura été lente et contrariée.
Le caractère n'explique évidemment pas toute une œuvre. Ce sont les dons fonciers que le peintre porte en lui qui la déterminent, l'entretiennent, la nourissent et la développent.
Toutefois le caractère de l'homme influence l'œuvre, si j'ose dire, latéralement. Il est comme les vents d'est, d'ouest, du sud et du nord qui assiègent une plante magnifique, la courbent, la redressent, la baignent d'air chaud ou d'air froid, l'épanouissent ou la dessèchent. Ensor est un supra-sensible.
La mobilité, l'inquiétude, la vacillation de sa nature expliquent à la fois les recherches fièvreuses, les pas en avant, les pas en arrière, les brusques progrès et les soudains reculs, en un mot tous les changements et aussi toutes les inégalités de son art. Après un tableau clair, il rétrograde vers un tableau sombre; après un dessin de caractère il commence un dessin atmosphéré, après une eau-forte toute en délicatesse il burine un cuivre comme avec des clous. Il est tumultueux et abrupt dans mainte composition; le développement continu ou symétrique des lignes ne l'inquiète guère; il procède par à coups; il étonne plus souvent qu'il ne charme. Il fait preuve de maladresse et il est loin de bannir de son art le dérèglement et le chaos. Il ne tient jamais en place et souvent il ne tient pas même sa place. Les œuvres inférieures voisinent avec les œuvres excellentes. Au cours de cette étude je n'ai insisté que sur ces dernières: elles seules comptent dans la vie d'un maître.
Son caractère explique encore son amour immodéré pour le masque, la défroque, la mort, la laideur. Pendant les dures, moroses et adverses années de sa vie, quand il se croit abandonné de tous, quand des idées de persécution hantent sa tête, il met comme une ardeur noire à dénaturer, à déformer, à calomnier la vie. Quelques-unes de ses toiles sont féroces. Les deux squelettes se disputant un hareng-saur mettent une âpreté telle dans leur lutte à mâchoires voraces et terribles qu'on songe vaguement à deux cruels ennemis du peintre s'acharnant sur lui. Le jour qu'il campa devant son poêle de fonte le gras et narquois pouilleux et que les premiers masques vinrent surprendre et attirer son attention, ce fut le pittoresque et la saveur des guenilles et des oripeaux qui certes le sollicitèrent. Il découvrit en eux l'ironie et la farce quasi joviales; mais plus tard l'ironie et la farce firent place au sarcasme, à la détresse et à la violence. Et le rire devint ricanement. Bien plus. Peut être s'est-il fait que le découragement a remplacé, à point nommé, la colère et que certaines années mauvaises et mornes, les années vides d'enthousiame, ne sont imputables qu'à un fléchissement de volonté. Car—et je ne veux point éluder ce problème moral—il est vraiment incompréhensible qu'aux heures pleines de l'adolescence et de la maturité commençante Ensor se soit comme retiré de la lutte, alors qu'une abondance de gestes et d'œuvres marque chez les artistes doués comme lui l'entrée triomphale dans la quarantaine.
Est ce la veule et torpide province, la solitude trop complète, l'éloignement trop prolongé ou la critique injuste qui ont amené cet alentissement? Quelle brisure intérieure a lézardé une muraille déjà si haute?
Ou bien les ennuis quotidiens et domestiques, les tracas mesquins et rongeants le condamnèrent-ils quelque temps au silence?
L'explication nette et unique se dissimule sous l'amas des conjectures. Peut être un jour jaillira-t-elle simple et probante. En attendant, je ne crois pas errer en affirmant que c'est dans le caractère du peintre et non pas en son art lui-même qu'il la faut chercher. Les rares dernières œuvres qui n'ont point encore quitté son atelier affirment que son œil est autant que jamais subtil, vivant et frais et que peut-être un dernier rajeunissement est à la veille d'éclore. Mais quel que soit l'avenir, l'œuvre telle qu'elle est, avec sa série de toiles depuis longtemps victorieuses, n'est indigne d'aucune des louanges que nous lui avons, au cours de ces pages, prodiguées.
La place de James Ensor dans l'art de son temps apparaît belle et nette. Le recul nécessaire pour la fixer se fait et ce jugement émis par ses admirateurs n'est déjà plus un jugement horaire.
Un fait esthétique notoire domine la peinture du XIXe siècle: la découverte de la lumière. D'où la recherche nécessaire d'harmonies nouvelles, de relations autres, de valeurs et de juxtapositions de tons insoupçonnées jadis. D'où encore un renouveau du sentiment pictural lui-même, la joie et la vie intronisées à la place de la morosité et de la routine, l'œil éduqué non plus à l'atelier mais dans les jardins, les bois et les plaines, les pratiques anciennes abandonnées au profit de la surprise et de la découverte rencontrées à chaque coin de route, à chaque angle de carrefour. C'est la nature, bien plus que les musées, qui forma les peintres novateurs. Elle leur imposa directement leur vision et modifia leur technique. Même elle renouvela toute leur palette. Ils n'ont consulté qu'elle: c'est d'après ses leçons ingénues et profondes qu'ils se sont formés, se sont découverts et se sont exaltés à l'heure des chefs-d'œuvre.
Dans cette conquête de la clarté, l'effort et la vaillance de James Ensor compteront. Son geste demeurera insigne, non seulement dans l'école de son pays, mais, un jour, dans l'art occidental tout entier. Car une mise au point exacte de la victoire impressionniste se prépare partout. L'Europe entière y collabore. Certes y conservera-t-elle son rôle d'initiatrice et de propagatrice la belle et grande France. Mais la Hollande, mais l'Angleterre, mais l'Espagne, mais la Belgique s'adjugeront également, à bon droit, quelques magnifiques rayons de la gloire artistique toujours renouvelée et sans cesse voyageuse, qui s'est, jadis, presque fixé chez elles, puis s'en est allée, puis revenue pour y séjourner à nouveau.
L'histoire de l'impressionnisme ne fut tentée, pourrait-on dire, qu'au point de vue parisien. Les marchands s'y sont intéressé plus encore que les critiques. Les dithyrambes ont monté d'après les prix de vente. On put croire, à tel instant, qu'une toile était moins une œuvre d'art, qu'une valeur financière. Degas, Renoir, Monet, Cézanne et Sisley avaient leurs courtiers comme le sucre, le café, la margarine et le cacao. Tout peintre étranger admis à la côte parisienne devenait peintre et maître à son tour.
On ne le jugeait plus d'après ses origines, mais d'après les qualités qui l'apparentaient aux maîtres français. Ainsi faussait-on maint jugement. La critique met en valeur les différences entre peintres et non pas les ressemblances ou les similitudes. Les écoles nationales sont nécessaires à l'évolution complète d'une même théorie ou d'une même formule. Une même idée conçue par des peuples différents, un même principe d'art appliqué par des groupes étrangers les uns aux autres acquiert une diversité précieuse et riche. La totalité des résultats peut être atteinte ainsi.
Au reste, les peintres venus d'ailleurs conservent, même à Paris, d'une manière souveraine, leurs qualités autochtones. Jongkind, Van Gogh, Whistler, Anglada Van Rysselberghe en témoignent. Ils restent fidèles à leurs origines superbement. Ils possèdent—j'en excepte Whistler—moins de goût que les Français, ils voient moins subtil et moins fin, mais ils apportent, les uns certains dons de robustesse, d'âpreté, les autres certains sentiments d'intimité et de naïveté, qu'on ne rencontre qu'en Espagne, qu'en Hollande et qu'en Flandre.
Pour situer de tels talents, il ne faut point les rejeter hors de leur milieu natal. Au contraire, il les y faut ramener, les mettre en leur vrai jour, les relier à leurs contemporains directs par les inévitables sympathies de race et d'instinct. Qu'on signale les principes nouveaux qu'ils apportent, mais qu'on étudie avant tout comment ils les adaptent à leur nature.
A toutes les périodes de l'histoire, ces influences de peuple à peuple et d'école à école se sont produites. Jadis l'Italie dominait profondément les Floris, les Vænius et les De Vos. Tous pourtant ont trouvé place chez nous, dans notre école septentrionale. Plus tard Pierre Paul Rubens s'en fut à son tour là-bas; il revint italianisé mais ce fut pour renouveler tout l'art flamand.
Bien plus, il se fait que souvent au pays même des peintres émigrés, il se lève des artistes qui trouvent, sans quitter la terre natale, ce que leurs émules s'en vont chercher au loin. Ensor peut se ranger parmi ceux-ci. Déjà Pantazis et Vogels s étaient signalés. Ils s'étaient posés le problème de la lumière et l'avaient élucidé si pas résolu. Vogels surtout s'était affirmé avec une audace violente et spontanée. Il avait des dons admirables d'improvisateur; il possédait la fougue et l'éclat. Ses ciels tumultueux, ses paysages tragiques s'affranchissaient de toute convention stérilisante. Il eût été un grand peintre, si l'insuffisance de son métier ne l'avait desservi.
Ensor plus dominateur en son art, avec une vision plus aiguë et plus fine, avec un instinct magnifiquement développé, avec une invention plus large et plus abondante, cultiva le même champ que Pantazis et Vogels, mais il y suscita des fleurs de lumière d'une beauté plus rare, plus rayonnante et plus subtile. Lui ne ressemble à personne. Ses premières œuvres contiennent déjà en puissance toute sa force future. On ne les confond avec nulles autres. Elles s'imposent d'elles mêmes. Elles sont indépendantes, fières, libres.
Au temps où elles éclatèrent, avec soudaineté et presque avec insolence, Manet occupait activement la critique d'avant-garde. Aux Salons triennaux de Bruxelles, d'Anvers et de Gand, la toile intitulée Au Père Lathuille avait ameuté autour d'elle toute l'ignorance et la raillerie publiques. Il était séant qu'on s'en scandalisât. Le rire et le sarcasme étaient exigés comme un gage d'honnêteté bourgeoise et de bon goût provincial. Certes, eût-on détérioré l'œuvre, si l'aventure judiciaire à courir et l'amende à payer n'eussent arrêté les mains bien pensantes et les couteaux croyant à l'idéal.
Les fureurs grinçant des dents contre Manet se tournèrent à point nommé contre James Ensor. Autant que le peintre des Batignolles il fut accusé d'instaurer en art une sorte de Commune et d'inscrire sa doctrine esthétique aux plis d'un drapeau rouge. Bien plus: sans égard pour les dates d'antériorité qui marquaient les toiles du peintre d'Ostende, on les proclamait dépendantes et vassales de celle de Manet, on leur refusait tout mérite jusqu'à celui d'être des sujets de scandale inédits. L'erreur persista longtemps et persiste encore. On s'entêta et l'on s'entête à ranger James Ensor parmi les élèves de Manet. Rien n'est plus faux. Les deux maîtres n'ont qu'un point de contact: tous les deux peignent à larges touches et tous les deux étudient la lumière frappant mais surtout modifiant le dessin et le ton local des objets.
Mais que de différences immédiatement s'accusent! Manet reste, somme toute, un peintre de tradition et d'enseignement. Les Espagnols l'ont formé: Velasquez et surtout Goya. Le jour que son Olympia fit son entrée au Louvre, elle se plaça, naturellement, en son milieu. La rampe l'attendait. Elle voisina, sans déchoir, avec les toiles d'Ingres et de Delacroix. Sa victoire fut même trop belle: l'Odalisque du vieil Ingres se sentit atteinte dans son rayonnement de chef-d'œuvre soi-disant parfait. Jamais elle n'apparut plus sèche, plus figée ni plus froide. En outre, Manet compose ses toiles. L'Olympia, le Christ aux anges, le Déjeuner sur l'herbe, Maximilien, sont des œuvres dont la mise en page est faite d'après des recettes connues. Bien qu'il soit un peintre admirable, encore n'évite-t-il pas les sécheresses et les duretés. Il ignore l'abondance et la richesse prodiguées. La réflexion et le raisonnement le guident plus que l'instinct ne le pousse. Il a une main très experte, très habile. Il fait preuve d'esprit, parfois de virtuosité. Son intelligence surveille son art et le raffine. Il pense autant et plus encore qu'il ne voit. Quand, séduit par les visions fraîches et hardies de Claude Monet, il se décida à modifier les couleurs de sa palette et à traduire le plein air vrai et la clarté prismatique et vivante, ce fut par une suite de tâtonnements réfléchis qu'il y parvint. Il cherchait sans trouver, du coup. Ce fut une lutte avant tout intelligente. Il lui fallut non seulement des qualités d'œil, mais des qualités de caractère. Son esprit, son jugement, son obstination, sa probité, tout son être moral et pensant agit: ce fut un triomphe laborieux.
James Ensor, lui, n'est purement qu'un peintre. Il voit d'abord, il combine, arrange, réfléchit et pense après. Il ne doit rien ou presque rien aux maîtres du passé. Il est venu en son temps pour ne recevoir que les leçons des choses. Certes, sa mise en page le préoccupe, mais ses compositions évitent de rappeler celles que les musées enseignent. L'esprit qu'il met dans ses toiles et ses dessins est plutôt grossier et populaire. Son trait de pinceau est appuyé; il ne glisse pas. Il n'est pas adroit. Toutefois sa couleur n'est jamais commune. En chaque œuvre le ton rare et riche, violent et doux, prismatique et soudain, installe sa surprise et son harmonie. On dirait qu'Ensor écoute la couleur tellement il la développe comme une symphonie.
Jamais ne s'y mêle la moindre fausse note. Il a l'œil juste comme est juste l'oreille d'un musicien. A le voir peindre, comme au hasard, on craint qu'à chaque instant la gamme profonde et rayonnante des couleurs ne se fausse. Or jamais aucun accroc n'a lieu. L'instinct, le guide le plus sûr des artistes, bien qu'il paraisse un conducteur aveugle, l'assiste sans qu'il s'en doute et le décide, quand à peine il prend le temps de le consulter. Avant de poser un ton, il est sûr que ce ton sera d'accord avec les autres. Il le sent tel, à travers tout son être. A quoi bon examiner, discuter, raisonner, si l'examen, la discussion et le raisonnement se sont faits, préalablement, sans qu'on le sache, avec la promptitude que met un éclair à traverser le ciel. L'aptitude en art n'est jamais un acquis, mais un don. Elle est subconsciente et sourde. Celui qui naît sans qu'elle habite en lui à l'instant même qu'il voit, entend, flaire, goûte et touche, ne sera jamais un artiste authentique. Aucune étude ne la lui apportera. Des races privilégiées la transmettent à leurs différentes écoles, à travers les siècles. L'une de ces races est l'admirable race des Pays-Bas.
Il s'en faut pourtant que leur instinct merveilleux soit l'unique don des peintres septentrionaux. Ils n'auraient pas donné à l'art ces artistes universels qui out nom Rubens, Van Dyck, Jordaens et avant eux Van Eyck, Memling, Van der Goes, Van der Weyden et Metsys si l'intelligence, le sentiment, la raison et la volonté leur eussent été refusés.
Je n'ai insisté sur leur qualité foncière: l'instinct, que pour la montrer pareille au tronc massif et souterrain sur lequel se entent, comme des branches, toutes les autres vertus esthétiques.
James Ensor est plus purement un peintre que Manet, mais ce dernier est évidemment un maître et un artiste d'une plus large et plus souveraine envergure. Il est un chef d'école magnifique, définitif et complet. Il commande à un des carrefours de l'art où les routes bifurquent et gagnent des contrées vierges et inconnues.
Je n'ai, au surplus, mis en parallèle les deux peintres que pour défendre James Ensor contre des accusations d'imitation. Qu'on fasse voisiner n'importe laquelle de ses toiles avec l'Olympia, le Déjeuner sur l'herbe, le Père Lathuille, Argenteuil, Pertuiset et l'originalité des deux créateurs d'œuvres marquantes s'imposera indiscutable.
Mais un autre rapprochement s'indique. Les récents intimistes français, les Vuillard et les Bonnard s'attachent aujourd'hui à certaines recherches qu'autrefois tenta James Ensor. Tels éclairages de salon ou d'appartement, telles lueurs argentées et discrètes, tels gris, tels bruns font songer à l'atmosphère de la Coloriste ou à la Musique russe. Il n'est pas jusqu'au dessin vacillant et brouillé qui n'établisse un parentage entre les deux manières. Je veux bien qu'il n'y ait que rencontre fortuite. Il est piquant toutefois de noter ceci: Si James Ensor rappelle quelque peintre, c'est parmi ses cadets, parmi ceux qui innovent et préparent l'avenir et non point parmi ses aînés qu'il le faut chercher. Il n'est pas de ceux qui imitent; il est de ceux qui découvrent. Il est plutôt d'accord avec ceux qui viennent, qu'avec ceux qui sont venus. Si bien que ses toiles qui datent de vingt-cinq ans recèlent toute la fraîcheur et la surprise des œuvres d'aujourd'hui. Il les peut exposer avec orgueil. Aucune ne déchoit. Quelques-unes serviront peut-être à renflouer les vieilles carènes de l'École d'Anvers où de tout jeunes peintres Navez et Crahay travaillent avec le souvenir de l'œuvre d'Ensor présente à leur esprit.
Preuve évidente de force profonde et souterraine! Quelqu'un qui reste aussi durablement jeune ne vieillira jamais. Il porte en lui la résurrection incessante. Il vit de lui-même, mystérieusement. Déjà il ne connaissait plus la mode, voici qu'il ignore le temps.
Il n'importe que James Ensor soit ignoré en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Amérique. Il est classé en Belgique et à cette heure on le classe en France. Or, c'est Paris qui, depuis un siècle, assume l'honneur d'auréoler les noms des vivants insignes. Il est la postérité qui s'éveille; il désigne les routes par où passe la gloire; il semble d'accord avec une volonté lointaine et encore inconnue. En son pays la renommée de James Ensor grandit d'année en année. Ceux qui le méconnaissaient autrefois sont morts ou sont vaincus. On ne relègue plus ses envois dans les oubliettes des salons triennaux: ils s'étalent à la cimaise, aux places d'honneur. Les musées des grandes villes s'en enrichissent: Liège, Anvers, Bruxelles. Les mécènes qui villégiaturent à Ostende, l'été, visitent l'atelier du peintre et leurs galeries se décorent de ses toiles. Les prix atteints sont élevés. L'heure est déjà loin où les œuvres du peintre s'échangeaient contre une obole. Certes l'art ne se pèse pas au poids d'argent. L'or donné ne représente que ce fait: l'admission d'un peintre dans une compagnie de choix et la place élue qu'on lui assigne dans une école. L'auteur de la Coloriste, de l'Après-midi à Ostende, du Salon bourgeois, du Lampiste et de la Mangeuse d'huîtres, des Enfants à la toilette, des Masques devant la mort, de Adam et Eve chassés du paradis et de la Dame sombre peut avec tranquillité voir se passer les années: il est sûr de la durée.
TOILES ET DESSINS
1879
Portrait de l'artiste.
L'amie de l'artiste.
Judas lançant l'argent dans le temple.
Oreste tourmenté par les Furies.
L'artiste peignant.
DESSINS.
Le chant de Noël.
Les trouvères.
Les buccins.
1880
Le Lampiste.——Appartient au Musée de Bruxelles.
La coloriste.——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
La mare.——à M. Guillaume Charlier, Bruxelles.
Nature-morte.——id., id.
Poissons.——à M. Paul Buéso, Bruxelles.
Le chou.——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Chinoiseries.——id., id.
Accessoires.
Musique russe.——à Mlle Anna Boch, Bruxelles.
Dame au châle.
Petites chinoiseries.——à M. C. Franck Anvers.
Le cardeur.——id., id.
Estacade.——à M. A. Lambotte, Anvers.
Chinoiseries.——id., id.
Les bouteilles——Appartient à M. E. Demolder, Essonnes.
Effet de neige——à M. F. Franck, Anvers.
Vases——id. id.
Le flacon bleu——à M. A. Lambotte, Anvers.
Nature-morte——à M. F. Fuchs, Bruxelles.
Pommes——à M. E. Labarre, Bruxelles.
Mer grise——à M. F. Franck, Anvers.
Trois esquisses——id., id.
Sous bois.
Nuage rose.
Dame au brise-lame.
A l'atelier.
Le parasol——à M. A. Lambotte, Anvers.
Mer agitée.
Portrait de l'artiste.
Le peintre.
AQUARELLE.
Gamin——à M. F. Franck, Anvers.
DESSINS REHAUSSÉS.
Retour des champs.
Tête (sanguine)——à M. Samuel, Bruxelles.
DESSINS.
Le maçon.
Le rétameur.
Gamin assis——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Le paysan triste.
Vieux pêcheur.
Gamin.
La sœur du peintre.
L'homme au chaudron.
Les mangeurs de soupe.
Jeune fille.
Vieux paysan.
Pêcheur de crevettes.
La femme au balai.
Laveuse.
Garçon lisant.
L'homme à la blouse.
Jeune fille à l'éventail.
Pêcheur au panier——Appartient à M. Deprez, Liège.
Le roi peste.
La mort mystique d'un théologien.
1881
Viandes——au Musée d'Ostende.
Salon bourgeois en 1881——à M. E. Rousseau, Bruxelles.
Salon bourgeois, esquisse——à M. F. Franck, Anvers.
La dame sombre——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Le rouget——à M. Edouard Hannon, Bruxelles.
La convalescente——à M. Bourgeois, Liège.
Tête d'étude——à M. W. Finch, Helsingfors.
Accessoires——à M. F. Buelens, Ostende.
Dame en rouge——à M. A. Crespin, Bruxelles.
Dame à l'éventail.
Le père de l'artiste.
Portrait d'homme——à M. F. Buelens, Ostende.
Etude de fruits——à M. Theo Hannon, Bruxelles.
La mare aux peupliers——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Marine, effet de soleil.
Les braconniers——à M. Delory, Calais.
La rue de Flandre à Ostende.
Les lampes.
Canal——à M. Ch. Mendiaux, Anvers.
Eventails.
Marine, effet de soir.
Marché à Ostende——à M. Buelens, Ostende.
Intérieur au poêle——à M. A. Lambotte, Anvers.
La dune noire.
Etoffes et éventails.
Une après-dînée à Ostende.
DESSINS REHAUSSÉS.
Pêcheur au manteau jaune——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Petits musiciens.
Pêcheur au panier.
La sœur de l'artiste.
Gamin (sanguine)——Appartient à M. C. Ganesco, Paris.
DESSINS.
Vieux songeur.
L'homme au foulard.
Garçon au bonnet.
Le violon.
Le lustre.
Clefs.
La lectrice.
L'homme au panier.
1882
Huîtres——au Musée d'Anvers.
Le pouilleux——au Musée d'Ostende.
Nature-morte——au Musée de Liège.
Lièvre et corbeau——à M. Greiner, Seraing.
La dame en détresse.
Portrait de Théo Hannon——à M. Théo Hannon, Bruxelles.
Dans les dunes——à M. Murdoch, Anvers.
Marine——à M. A. Rassenfosse, Liège.
Portrait de femme——à M. F. Buelens, Ostende.
La mangeuse d'huîtres.
Dame au châle bleu.
Roses.
Portrait du peintre W. Finch.
Fleurs——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
La petite chaise——à M. Lambotte, Anvers.
Pommes——à M. F. Franck, Anvers.
Fleurs et porcelaines——à M. Lambotte, Anvers.
La mère de l'artiste.
Etoffes.
Petites tasses.
Le brise lame.
La dune au nuage blanc.
Marine.
Maisonnettes dans les dunes.
AQUARELLE.
Le mannequin——Appartient à M. F. Franck, Anvers.
DESSINS.
Ostendaise.
L'homme à la bêche.
Ouvrier du port.
Pêcheur de crevettes.
Cadre (croquis)——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Croquis——à M. Alfred Verhaeren, Bruxelles.
Croquis——à M. Théo Hannon, Bruxelles.
Croquis.
1883
Les pochards——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Les masques scandalisés.
Pommes rouges——à M. O. François, Bruxelles.
Les houx——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Portrait de l'artiste.
Pivoines et pavots——à M. L. Franck, Anvers.
Sur la plage——à M. Vince, Bruxelles.
Canal.
Coquillages——à M. L. Franck, Anvers.
Dans les blés.
Le Rameur——à M. F. Buelens, Ostende.
Forêt de Soignes.
Fleurs et vases.
La dame en blanc.
Dunes, panorama.
Dunes et mer.
L'horticulteur.
Le violon——à M. Maurice des Ombiaux, Bruxelles.
La barque jaune.
Marine, après-midi.
DESSIN.
Le pochard——à M. Albert Neuville, Liège.
La sorcière——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Portrait de Richard Wagner——Appartient à M. Gustave Kéfer, Paris.
Les joueurs.
L'escrimeur.
La clarinette.
Zélandaise.
Masques scandalisés.
Croquis——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
1884
Marine——à M. Gustave Kéfer, Paris.
Enfant à la poupée.
Portrait du peintre Dario de Regoyos.
La dune.
Les toits à Ostende——à M. F. Franck, Anvers.
Intérieur——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Grande vue d'Ostende.
Barques.
Le nuage blanc.
AQUARELLE.
Accessoires.
DESSINS.
Gamin (sanguine).
Enfant dormant.
Portrait de l'artiste——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Au piano.
Le cœur révélateur.
Les misérables.
1885
Vue de Bruxelles——au Musée de de Liège.
Le meuble hanté——au Musée d'Ostende.
Jardin à Watermael——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Marine——Soleil couchant.
Le Christ marchant sur la mer.
Fanfare en rouge.
Vue du phare à Ostende.
Squelettes regardant chinoiseries.
Le boulevard à Ostende.
Les indécises. (Série d'études.)
PASTEL.
Les amoureux——Appartient à M. Ern. Rousseau, Bruxelles.
DESSINS.
Combat de soudards.
Vases.
Démons me turlupinant.
Promeneurs——à M. Blatter, Paris.
Descente de croix.
Portrait——à M. Johanida.
1886
Etudes de lumière.
Enfants à la toilette——à M. A. Lambotte, Anvers.
Lisière du bois d'Ostende——à M. R. Goldschmidt, Bruxelles.
Etudes locales.
Fleurs et fruits.
Squelette et pierrots.
Nature morte.
Les lilas.
DESSINS REHAUSSÉS.
Le cauchemar.
Le rêv——
DESSINS.
Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière.
La gaie: L'adoration des bergers.
La crue: Jésus montré au peuple.
La vive et rayonnante: L'entrée à Jérusalem.
La triste et brisée: Satan et les légions fantastiques tourmentent
le Crucifié.
La tranquille et sereine: La descente de croix.
L'intense: Le Christ montant au ciel.
Le Christ veillé par les anges.
FANTAISIES ET GROTESQUES.
Quatre portraits de l'artiste.
Enfant dormant.
Profils.
1887
Adam et Eve chassés du Paradis terrestre.——Appartient à M. A.
Lambotte, Anvers.
Le feu d'artifice.
Tribulations de Saint Antoine.
Fruits——à M. Storm de 's Gravesande, Hollande.
Nature-morte.
Adoration des bergers——à M. E. Deman, Bruxelles.
Ville à contre soleil.
Jardin en plein soleil.
Intérieur.
Vision claire.
DESSINS.
La tentation de Saint Antoine.
Josué arrêtant le soleil.
Combat des pouilleux Désir et Rissolé.
Petits supplices persans.
Mon père mort.
La paresse.
L'apparition.
Les diables Dritss et Hihahox conduisant le Christ aux
enfers.
1888
L'entrée du Christ à Bruxelles.
Fruits——à M. Jules Cordeweiner, Bruxelles.
Les masques devant la mort——à M. E. Rousseau, Bruxelles.
Jardin d'amour.
Carnaval à Bruxelles.
Mon portrait déguisé.
Foudroiement des anges rebelles.
Études locales.
A Ostende, le boulevard.
Nature-morte.
Le Christ tourmenté——à M. E. Royer.
DESSINS REHAUSSÉS.
Suzanne au bain——Appartient à M. Max Hallet, Bruxelles.
Masques nous sommes——à M. Edm. Picard, Bruxelles.
La rixe.
Jeanne d'Arc.
Peste dessous——Peste dessus. Peste partout.
DESSINS.
Squelettes musiciens.
La dormeuse.
La mort poursuivant le troupeau des humains.
Portraits bizarres——à M. Jules Cordeweiner, Bruxelles.
1889
Squelettes voulant se chauffer——à M. Léon de Lantsheere, Bruxelles.
Fleur et vase bleu——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Le théâtre des masques ou bouquet d'artifice.
La petite travailleuse——à M. Cwalosinsky, Bruxelles.
Théâtre des masques et pierrot.
Fleurs——à M. Guillaume Charlier, Bruxelles.
Attributs des Beaux-Arts——à M. Buelens, Ostende.
Etonnement du masque Wouse.
Coquillages.
Poires, raisins, noix.
DESSINS REHAUSSÉS
Le dernier carré à Waterloo——à M. Storm de 's Gravesande, Hollande.
La revanche des condamnés——à M. Vittorio Pica, Milan.
Squelette dessinant.
DESSINS.
Portrait de Madame E. Rousseau.
Le vieux meuble.
Vénus à la coquille.
La mère de l'artiste——à M. R. Goldschmidt, Bruxelles.
Les adieux de Napoléon.
Etudes de plantes.
1890
Le domaine d'Arnheim——Appartient à M. Emile Verhaeren, St. Cloud.
Fruits——à M. Ganesco, Paris.
L'intrigue——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Homard et crabes——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Le pot bleu——à M. Philipps, Bruxelles.
Les choux——à M. Labarre, Bruxelles.
La tour de Lisseweghe——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Chaloupes.
Ecce-Homo.
Vue prise en Phnosie, ondes et vibrations lumineuses.
Petits masques.
L'assassinat.
DESSINS REHAUSSÉS.
Jardin aux masques.
Clowneries.
DESSINS.
Masques.
La vieille au portrait——à M. C. Ganesco, Paris.
Napoléon à Waterloo.
La sensibilité en 1890 et la vivisection.
La sensibilité en 1590 et la roue, le bûcher, etc.
Etudes sentimentales.
Bourgeois indignés sifflant Wagner en 1880 à Bruxelles.
1891
Le Christ apaisant la tempête.
Squelettes se disputant un pendu——à M. Cwalosinsky, Bruxelles.
Les bons juges——à M. Camille Laurent, Charleroi.
Portrait d'Emile Verhaeren——à M. Emile Verhaeren, St. Cloud.
Les musiciens terribles——à M. Félix Fuchs, Bruxelles.
L'autodafé——à M. Félix Fuchs, Bruxelles.
Le jardin d'amour——à M. Maurice des Ombiaux, Bruxelles.
Masques regardant des crustacés——à M. Breckpot, Bruxelles.
Baptême des masques.
Réunion de masques.
Le prêche.
Fraises——Appartient à Mme Ninauve, Bruxelles.
Squelettes au hareng.
Squelette arrêtant masques.
Chinoiseries, étoffes——à M. F. Franck, Anvers.
Ecce-Homo.
La peureuse.
DESSINS REHAUSSÉS.
La bataille des Éperons d'or.
Les bains d'Ostende——à M. Charles Vos, Bruxelles.
Les cuirassiers à Waterloo.
DESSINS.
Le Christ aux Enfers.
Vieux augures.
Apparition——à M. Emile Verhaeren, St. Cloud.
Portrait et fantasmagorie.
Grotesques.
1892
La vierge consolatrice.
Ma chambre préférée.
Les masques singuliers.
Pierrot jaloux.
Barques échouées——à M. B. Ganesco, Paris.
Poissardes mélancoliques——à M. F. Buelens, Ostende.
Les gendarmes.
Les soudards Kès et Pruta entrant dans la ville de Bise——à M. G.
Serigiers, Anvers.
Les mauvais médecins——à M. Van der Velde, Bruxelles.
Nature-morte.
Roses——à M. Robert Goldschmidt, Bruxelles.
DESSINS REHAUSSÉS.
Supplice de Jeanne d'Arc.
Triomphe romain.
Réunion de masques.
DESSINS.
Les soudards débandés.
Le Christ tourmenté.
Grotesques.
La couturière——Appartient à M. Blatter, Paris.
1893
Le coq mort——à M. Leuring, La Haye.
La raie——à M. Ernest Rousseau. Bruxelles.
Les choux——à M. F. Franck, Anvers.
Coquillages——à M. R. Goldschmidt, Bruxelles.
L'homme de douleurs.
L'exécution.
Soudards pénitents dans une cathédrale.
Nature-morte.
DESSINS REHAUSSÉS.
Le tournoi——à M. R. Goldschmidt, Bruxelles.
Cortège comique.
DESSINS.
La vierge aux navires.
Masques.
Sorcières dans la bourrasque——à M. R. Goldschmidt, Bruxelles.
Le Christ aux mendiants——id. id.
Croquis——id. id.
1894
Crevettes.
Masques regardant une tortue.
Vase bleu.
Nature-morte——Appartient à M. F. Pleyn, Ostende.
Crustacés.
Nature-morte.
Portrait d'Eugène Demolder——à M. E. Demolder, Essonnes.
DESSINS REHAUSSÉ.
Au théâtre.
DESSINS.
Le combat——Appartient à M. G. Virrès, Lummen.
Têtes bizarres.
Crétins regardant les étoiles.
1895
Poissons——à M. Rouffard. Bruxelles.
Coquillages.
Portrait de M. Culus.
Fleurs.
Nature-morte——à M. F. Pleyn, Ostende.
Jeux de lumière.
DESSIN.
Femme cousant.
Monstre tourmentant Saint Antoine——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Intérieur d'église.
Bouquet.
1896
Fleurs——à M. R. Goldschmidt, Bruxelles.
Mariakerke——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Les ballerines——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
Duel de masques——id.
Squelette peintre——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
La vengeance de Hop Frog.
Les cuisiniers dangereux——à M. Camille Laurent, Charleroi.
Nature-morte.
Fleurs et légumes——à M. Ernest Rousseau, Bruxelles.
DESSINS.
Grotesques.
La pendule.
Masques et trognes.
Monstres.
Diableries.
1897
Les chaloupes.
La mort et les masques——Appartient à M. Vandeputte, Bruxelles.
Masques et potiches.
Fruits.
Poissons.
L'éclaircie.
Fleurs.
DESSIN REHAUSSÉ.
Projet de chapelle à dédier à St. Pierre et Paul à Ostende.
DESSINS.
Gens de mer.
Sur la plage.
Masques.
Vieilles.
Musiciens drôlatiques.
Fantaisies.
1898
Le grand juge.
Nature-morte.
Vue d'Ostende——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
Squelettes travestis——à M. Pleyn, Ostende.
Nature-morte——à M. Jungers, Bruxelles.
Nature-morte.
DESSINS REHAUSSÉS.
Affiche pour l'exposition de «la Plume» à Paris.
Composition pour «la Plume».
1899
Portrait du peintre entouré de masques——à M. A. Lambotte, Anvers.
Nature-morte.
Pierrot aux masques.
Nature-morte.
Intérieur.
Nuages.
AQUARELLE.
La petite chinoise.
DESSINS.
Rue à Ostende.
Chiens.
Coin de cuisine.
Feuilles.
Papillons.
Enfants.
1900
Le juge rouge——Appartient M. Yseux, Anvers.
Squelette à l'atelier——à M. Max Hallet, Bruxelles.
Nature-morte.
Plage.
Barques échouées——à M. Jungers, Bruxelles.
Vue du port d'Ostende.
DESSIN REHAUSSÉ.
La servante——à M. Edgar Picard, Jemeppe.
DESSINS.
Vieux meubles.
Accessoires.
Lampes.
Etoffes.
Livres.
Les marchands chassés du Temple.
Portrait.
1901
Canal——à M. Berthelot, Paris.
Echauffourée de masques——à M. Cnudde, Ostende.
Nature-morte.
Chinoiseries.
Vue de Mariakerke——à M. Philippson, Bruxelles.
Coquillages.
Fleurs.
DESSINS
Le Christ secourant Saint Antoine.
Vieilles.
Chaises.
Enfants.
Moulin.
Combat de soudards.
1902
L'amateur d'art.
Les joueurs.
Nature-morte.
Accessoires——Appartient à M. Crick, Bruxelles.
Plage.
Nature-morte.
Au Conservatoire.
Fleurs.
DESSINS REHAUSSÉS.
Entrée de Jeanne d'Arc à Domremy.
Orgueil.
Avarice.
Envie.
Gourmandise.
Colère.
Paresse.
DESSIN.
Encadrement pour un livre de Vittorio Pica.
1903
Coquillages et draperie bleue.
Fleurs.
Figures au soleil.
Petits masques.
Promeneurs.
Nature-morte.
Nature-morte.
Chinoiseries.
DESSINS REHAUSSÉS.
Histoire du billard à travers les âges. Cinq compositions
——Appartient à M. Haardt, Bruxelles.
Squelette au billard——à A. Lambotte, Anvers.
Vases.
Vieilles choses.
Coins d'ombre.
Fantasmagories.
Jardin d'amour.
Roses.
1904
Nature-morte.
Bassin à Ostende.
Nature-morte.
Fruits.
Vierge aux donateurs masqués.
Nature-morte.
Crustacés.
DESSINS REHAUSSÉS.
Neuf compositions pour illustrer Marmontel——à M. Serruys, Ostende.
Carnaval à Ostende.
DESSINS.
Coin de table.
Bêtes bizarres.
Plage de la Panne.
Barques échouées.
1905
Pierrot et squelette——à M. A. Lambotte, Anvers.
Fleurs.
Intérieur.
Nature-morte.
Fruits.
Intérieur.
Coquillages.
DESSINS.
Repas comique (sanguine)——App. à M. Haardt, Bruxelles.
Le tir à l'arc.
Pêcheurs.
Sirène abandonnée.
Arlequinades.
Cortèges carnavalesques.
Dunes et plaines.
1906
Nature-morte.
Accessoires.
Les toits à Ostende.
Portrait——à M. F. Duhot, Bruxelles.
Chinoiseries.
Vue du théâtre à Ostende.
Nature-morte.
DESSINS REHAUSSÉS.
La chute des anges rebelles.
Masques.
Baigneuses.
DESSINS.
Vieux meubles.
Poêles.
Silhouettes.
Marines.
1907
Fruits.
Nature-morte.
Chinoiseries——à M. Robert Goldschmidt, Bruxelles.
Masques.
Nature-morte.
Pêcheurs.
Portrait de Madame L.
Masques et squelettes——à M. L. Prager, Munich.
Chinoiseries.
DESSINS REHAUSSÉS.
La belle Impéria.
Henri de Groux jouant au billard——Appartient à M. A. Lambotte, Anvers.
Vieux murs.
Coins d'appartements.
Bouquets.
Cortèges.
Femmes surprises.
1908
Fruits et légumes.
Chinoiseries.
Squelettes musiciens.
DESSINS REHAUSSÉS.
Squelettes——à M. Blatter, Paris.
Types drôlatiques.
Jeune rousse.
Buveurs.
Jeune fille luttant.
Hommage à la femme.
DESSIN.
Encadrement pour Emile Verhaeren.
EAUX-FORTES ET POINTES-SÈCHES
1886
Le Christ insulté.
Verger.
Vieillard.
Portrait de l'artiste.
Le Christ apaisant la tempête.
Iston, Pouffamatus, Cracozie et Transmouff, célèbres
médecins persans examinant les selles du roi Darius après
la bataille d'Arbelles.
La cathédrale.
La flagellation.
1887
La Madeleine.
Cortège infernal.
Portrait d'Ernest Rousseau. (Pointe-sèche.)
Le pisseur.
Grande vue de Mariakerke.
Estacade. (Pointe-sèche.)
La dormeuse. (Pointe-sèche.)
Petite vue de Mariakerke.
Rue à Bruxelles. (Pointe-sèche.)
Buste. (Pointe-sèche.)
1888
Combat des pouilleux Désir et Rissolé.
Maison du boulevard Anspach. (Pointe-sèche.)
Réverbère.
Le meuble hanté.
La lutte des démons.
L'acacia. (Pointe-sèche.)
La chimère.
La crypte. (Pointe-sèche.)
Lisière du petit bois d'Ostende.
Hôtel de Ville d'Audenarde.
Crânes et masques.
Vue de Nieuport.
Candélabres et vases.
Paysage à la charette.
Prise d'une ville étrange.
Mon portrait en 1860.
Mon père mort. (Pointe-sèche.)
L'archer terrible.
Les cataclysmes.
L'assassinat.
Vue du port d'Ostende.
Vue d'Ostende à l'Est.
Bouquet d'arbres.
Ferme flamande.
Musiciens fantastiques.
Chaloupes.
Le grand bassin à Ostende.
Les insectes singuliers. (Pointe-sèche.)
Le coup de vent à la lisière.
Sentier à Groenendael.
Barques échouées.
Chaumières.
Les éléphants furieux.
Sorciers dans la bourrasque.
Petites figures bizarres.
Maisonnettes à Mariakerke.
Les gendarmes.
Le cimetière.
L'écorché.
Adoration des bergers. (Vernis mou.)
La luxure.
La tentation du Christ.
Le jardin d'amour.
Le denier de César.
Sous bois à Groenendael. (Pointe-sèche.)
1889
Bateaux à vapeur.
Les patineurs.
Boulevard à Ostende.
Mon portrait squelettisé.
Ferme à Leffinghe.
Le pont du bois.
L'orage.
Le moulin de Mariakerke.
La fête au moulin.
Le fantôme.
La mare aux peupliers.
Le bal fantastique.
Pont rustique.
L'ange exterminateur.
Triomphe romain.
1890
Alimentation doctrinaire.
Portrait de Hector Denis.
La musique à Ostende.
1891
Moulin à Slykens.
Multiplication des poissons.
Assemblée dans un parc.
1892
Autodafé.
1894
Les bons juges.
Les petites barques.
1895
Les diables Dzitss et Hihahox conduisant le Christ aux enfers.
Pouilleux indisposé se chauffant.
Les joueurs.
Belgique au XIXe siècle.
Démons me turlupinant.
Le Christ tourmenté par les démons.
Fridolin et Graga Pança d'Yperdam.
Bataille des Éperons d'or.
Alimentation doctrinaire.
Les mauvais médecins.
Squelettes voulant se chauffer.
Masques scandalisés.
Le roi-peste.
Le Christ aux mendiants.
Les vieux cochons.
Le Christ descendant aux enfers.
1896
La mort poursuivant le troupeau des humains.
Cathédrale.
Le vidangeur.
Le combat.
Menu E. Rousseau.
Menu Charles Vos.
1897
Les adieux de Napoléon.
1898
La vengeance de Hop-Frog.
Le Christ dans la barque.
L'entrée du Christ à Bruxelles.
1899
Les bains d'Ostende.
1900
Fragment de la tentation de Saint Antoine.
Petite vue de Mariakerke.
Pêcheur d'Ostende.
1902
Paresse.
1903
Les toits d'Ostende.
1904
Colère.
Orgueil.
Avarice.
Gourmandise.
Envie.
Les péchés capitaux dominés par la mort.
Peste dessous. Peste dessus. Peste partout.
Masques intrigués.
Plage de la Panne.
Plage de la Panne.
Eaux-fortes aux Musées et Galeries d'estampes de Barcelone, Bruxelles, Dresde, Liège, Milan, Ostende, Paris, Venise, Vienne, Zürich, etc. etc.
Camille Lemonnier. Histoire des Beaux-Arts en Belgique. 1887, Bruxelles.
Eugène Demolder. James Ensor. 1892, Bruxelles.
Pol de Mont. De schilder en etser James Ensor. (De Vlaamsche School,
1895, Anvers.)
Eugène Demolder. James Ensor. (La Libre Critique, 1895, Bruxelles.)
Eugène Georges. James Ensor. (La Libre Critique, 1896, Bruxelles.)
Camille Lemonnier. James Ensor peintre et graveur. (La Plume, 1898,
Paris.)
Edmond Picard. James Ensor. (Id.)
Emile Verhaeren. Une facette du talent d'Ensor. (Id.)
Camille Mauclair. James Ensor, aquafortiste. (Id.)
Octave Maus. James Ensor. (Id.)
Blanche Rousseau. Ensor intime. (Id.)
Georges Lemmen. James Ensor. (Id.)
Maurice des Ombiaux. James Ensor. (Id.)
Christian Beck. Réflexions sur la Cathédrale de James Ensor. (Id.)
Jules du Jardin. A propos de James Ensor. (Id.)
Pol de Mont. James Ensor. (Id.)
Louis Delattre. L'enfance d'Ensor, peintre de masques. (Id.)
Octave Uzanne. James Ensor, peintre et graveur. (Id.)
Eugène Demolder. James Ensor. (La Revue des Beaux-Arts et des Lettres,
1899, Paris.)
Gustave Coquiot. James Ensor.(La Vogue, 1899, Paris.)
Jules du Jardin. L'art flamand. Bruxelles.
Vittorio Pica. James Ensor. (Minerva, Rome.)
Pol de Mont. Koppen en busten.
Horrent. James Ensor.
Vittorio Pica. (Emporium, Bergame.)
Monod. James Ensor.
Camille Mauclair. Les peintres belges. (La Revue Bleue, 1905, Paris.)
Vittorio Pica. Attraverso gli albi e le cartelle.
ID. La moderna scuola di pittura del Belgio.
Camille Lemonnier. L'École belge de peinture 1830-1905. 1906, Bruxelles.
Vittorio Pica. L'arte mondiale a Venezia nel 1907.
ID. La galeria d'arte moderna a Venezia.
Albert Croquez. James Ensor, peintre et graveur. (La Flandre Artiste,
déc 1908, Courtrai.)
TABLE DES ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE
Le Christ veillé par les anges (1886)
Croquis
Squelettes Musiciens (1888)
Croquis
Les Soudards débandés (1892)
Croquis
La Vierge aux Navires (1893)
Croquis
Croquis
Bataille des Éperons d'or. Eau-forte (1895)
Portrait de James Ensor en 1875 (frontispice).
La Femme au balai (1880)
Le Chou (1880)
Gamin (1880)
Vieux Pêcheur (1881)
La Dame sombre (1881)
Lampiste (1880)
Musique russe (1880)
Le Salon bourgeois (1881)
Dame en détresse (1882)
Pouilleux indisposé se chauffant (1882)
Le Terrassier (1882)
La Sorcière (1883)
Dame au châle bleu (1882)
La Mère du peintre
Les Pochards (1883)
Enfants à la toilette (1886)
Mon Père mort (1887)
La Mère du peintre. Dessin (1889)
Vénus à la coquille. Dessin (1889)
Projet de chapelle à dédier à S.S. Pierre et Paul (1887)
La Cathédrale. Gravure à l'eau-forte (1886)
Le Christ apaisant la Tempête. Gravure à la pointe-sèche (1886)
Barques échouées. Gravure à l'eau-forte (1888)
Ernest Rousseau. Gravure à la pointe-sèche (1887)
Le Théâtre des masques ou bouquet d'artifice (1889)
L'Intrigue (1890)
Masques devant la mort (1888)
La Raie (1892)
La Mort poursuivant le troupeau des humains. Gravure à l'eau-forte (1895)
La Danse (1896)
Mariakerke (1896)
Entrée du Christ à Bruxelles. Gravure à l'eau-forte (1898)
Vengeance de Hop-Frog. Gravure à l'eau-forte (1898)
Ostende (1898)
I. Le milieu.
II. Les débuts
III. Les toiles
IV. Les dessins
V. Les eaux-fortes
VI. Vie et caractère
VII. La place de James Ensor dans l'art contemporain
Catalogue de l'œuvre de James Ensor
Bibliographie
Table des illustrations dans le texte
Table des planches hors-texte