
The Project Gutenberg EBook of L'île des rêves, by Louis Ulbach
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: L'île des rêves
Aventures d'un Anglais qui s'ennuie
Author: Louis Ulbach
Illustrator: Rouargue frères
Release Date: August 6, 2006 [EBook #18995]
Language: French
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ÎLE DES RÊVES ***
Produced by Chuck Greif, Carlo Traverso and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)


Paris.—Imprimerie P.-A. Bourdier et Ce, rue Mazarine, 30.
Tous droits réservés
Le Cyclope était un magnifique navire, appartenant à MM. Poussin et Cie, armateurs au Havre. Il n'avait pas été lancé à la mer un vendredi, ni à la date du 13. Rien ne lui avait donc porté malheur; et depuis une quinzaine d'années qu'il naviguait, il faisait la fortune de son propriétaire, la joie des matelots qui le servaient, et l'orgueil du capitaine Michel qui le commandait.
Le capitaine Michel passait pour un véritable loup de mer. Cela ne veut pas dire qu'il fût plus féroce qu'un mouton, et que le Petit Chaperon-Rouge eût couru avec lui d'autres dangers que celui de voir manger sa galette; car on sait que les loups de mer ressemblent aux loups de terre comme les veaux marins ressemblent aux veaux de la prairie, et même aux veaux de M. Troyon. Le capitaine était donc un brave homme de loup; il avait, à quelque distance du Havre, dans une jolie petite maison, aux trois quarts payée par ses économies, laissé la louve, sa femme, sous les traits de la meilleure mère de famille. Madame Michel élevait deux filles dans la crainte de Dieu et de l'Océan; et le capitaine aspirait après le moment où il placerait la dot de ses héritières, les véritables patrons qui le fissent naviguer. Jusqu'à ce jour-là, il faisait son métier honnêtement, ponctuellement. Personne ne surveillait mieux que lui la manœuvre. Rigide envers les matelots, toujours le front plissé quand il commandait, il s'enfermait dans sa cabine pour baiser les lettres de sa femme et les petites pattes de mouche de ses filles. On ne l'avait jamais vu pâlir devant une tempête; mais il savait bien, lui, pourquoi ses cheveux avaient grisonné si vite, et, malgré sa reconnaissance tempérée pour la mer, il s'était bien juré, s'il avait jamais un fils, de lui interdire les voyages au long cours.
Le ciel, qui entretenait des intelligences secrètes avec la bonne madame Michel, n'avait pas voulu mettre le marin dans le cas de tenir un serment injurieux pour sa profession; aussi ne lui avait-il envoyé que des filles. Mais le capitaine Michel, pour ne pas en avoir le démenti, avait juré alors que jamais ses filles n'épouseraient un marin. C'était une façon indirecte de persister dans son serment et dans cette rancune obligée que nous avons tous, plus ou moins, contre notre plus chère profession.
Encore quelques voyages, et le capitaine inaugurait enfin, pour ne plus la quitter, une de ces belles paires de pantoufles que la sollicitude des demoiselles Michel lui brodait inutilement pour chaque anniversaire solennel. Plus de séparation, plus de hasard lointain; il s'enracinait dans son petit jardin, il s'incrustait dans son fauteuil, il ne jurait plus que pour rire et pour faire peur à la vieille servante. Sans doute, il lui en coûterait bien un peu de quitter le Cyclope, qui filait si gentiment ses douze nœuds à l'heure, et qui se garait tout seul des écueils, comme s'il avait eu deux yeux tout ouverts. Mais le capitaine avait pris depuis longtemps ses précautions; la séparation ne devait pas être absolue, complète, et l'effigie du Cyclope, puissamment coloriée pour résister à l'action du soleil, bravait les regards et défiait l'oubli dans la salle à manger future du capitaine.
Il ne désespérait pas non plus d'avoir un jour (mais c'était là presque une folie!), pour le guéridon de marbre de son salon, un modèle microscopique en bois du cher Cyclope, avec tous ses gréements, et un petit bonhomme d'un sou, placé au pied du grand mât, le bras tendu, pour rappeler toujours à M. Michel le capitaine Michel. C'était une surprise qu'il se ménageait à lui-même. Il ne se sentait pas d'aise à la pensée de ce petit joujou, naviguant sous un globe de pendule, au milieu des douze tasses à café et du sucrier de madame Michel.
En attendant ces joies délicates qu'il savourait par avance, le capitaine naviguait en réalité vers la Nouvelle-Guinée. Qu'allait-il vendre, échanger, acheter? cela importe peu au récit.
Retiré dans sa cabine et soigneusement verrouillé, Michel avait défendu qu'on le dérangeât. Il était si gravement occupé! Il écrivait à sa femme et à ses filles, donnait à la première ses instructions précises pour la plantation de quelques petits arbres et le dessin d'une pelouse dans son jardin, et rédigeait pour les secondes son journal quotidien, légèrement poétisé par excès de tendresse paternelle. Il cherchait dans des livres de voyages les descriptions pittoresques des parages qu'il allait aborder, et qu'il avait explorés trop souvent pour s'être jamais donné la peine de les étudier. Mais bien qu'il n'eût aucune sérieuse prétention littéraire, et qu'il ne s'avouât pas les motifs de cette érudition d'emprunt, le capitaine cédait au besoin instinctif de la couleur locale.
Un récit de voyage sans descriptions est comme le dessert redouté de Brillat-Savarin, et la jolie femme à laquelle il manque un œil. Or le capitaine, en fait de cyclopes, n'admettait que son vaisseau.
A l'heure où nous faisons connaissance avec lui, loin des regards civilisés et hors de toutes les latitudes de la politesse, nous pouvons avouer que par précaution contre la température et peut-être aussi par une sorte de loi réaliste, qui poussait la couleur locale jusqu'à l'illusion, le brave Michel n'était guère plus vêtu, dans sa chambre, qu'un souverain des îles de la Sonde, le jour de son couronnement.
Alfred de Musset a vanté la supériorité des costumes primitifs pour la solitude; mais je dois cependant avouer que le capitaine était plus habillé qu'un discours d'académicien. Cette simplification des accessoires du commandement entrait peut-être pour quelque chose dans la consigne sévère donnée par Michel. Certain de ne pas déchoir à ses propres yeux, et s'estimant pour la réalité et non pour l'apparence, il était beaucoup moins sûr de conserver son prestige, s'il était surpris dans ce négligé.
Voilà pourquoi, sans doute, quand il entendit frapper deux coups, puis trois, puis quatre, puis un nombre considérable à la porte de sa cabine, le capitaine proféra tout haut un formidable juron, et se hâta de reprendre une apparence plus conforme aux exigences des relations européennes.
—Qui est là? demanda-t-il, quand il fut presque habillé et en renouvelant son juron.
Notons, en passant, que le capitaine ne jurait jamais tout bas et pour lui seul.
—C'est moi, capitaine, Pharamond!
—Que me veux-tu? animal! Qu'y a-t-il?
Le capitaine ouvrit sa porte. Pharamond était un vieux matelot du même pays que lui, dont la figure et la chevelure inculte répondaient bien à son nom héroïque.
C'était une âme damnée, un séïde, un de ces êtres qui poussent le dévouement jusqu'à la persécution, et qui vous servent en vous grondant, comme s'ils vous en voulaient de ne pas tomber à l'eau, à toutes les heures, pour leur fournir l'occasion de vous en retirer.
—Eh bien! parle, dit le capitaine en laissant entrer son confident et en refermant la porte, qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui?
—Parbleu! aujourd'hui comme toujours, j'ai découvert que vous étiez trop bon, que le premier Anglais venu vous enfonçait, quoi! et que, si on vous laissait faire, tout irait bientôt à la dérive.
—Allons! explique-toi!
—Eh bien! voilà: vous avez reçu à bord ce satané goddam qui s'est embarqué pour aller où nous irions, sans savoir seulement si nous n'avions pas affrété pour la lune.
—Sir Olliver! où est le mal? Il paye bien.
—Il paye trop; je veux dire qu'il n'a pas besoin de rôder autour des gens de l'équipage, comme il le fait, de leur offrir des cadeaux, de les régaler à toute occasion. Capitaine, je ne vous dis que cela: cet Anglais est un espion. Je n'aime pas les espions, moi.
—Dis plutôt que tu n'aimes pas les Anglais. Ce n'est pas du tout la même chose.
—Dans ce temps-ci, c'est possible! mais autrefois! enfin, suffit. Ce que je viens vous dire, c'est que ce sir Olliver est un drôle de sire; qu'il cherche à ameuter l'équipage contre vous. Je l'ai surpris tout à l'heure, baragouinant je ne sais quelles promesses. Qu'est-ce qu'il promet et qu'est-ce qu'il veut acheter?
—Au fait, tu vois bien, tes craintes sont absurdes. Quel intérêt peut-il avoir à troubler la discipline? Nous ne sommes pas en guerre avec les Anglais.
—Non, puisque nous sommes leurs amis, ce qui est plus dangereux et ce qui rapporte moins. On sait à quoi s'en tenir avec un boulet de canon; cela entretient la franchise. Mais, des amis! ce sont des jaloux qui vous ont désarmés d'avance.
—Tu parles comme un philosophe, mais tu ne penses pas de même. Voilà tes rancunes qui t'emportent!
—Moi! mille millions de sabords! peut-on dire que je m'emporte! s'écria Pharamond, rouge de colère et d'indignation. Je suis calme, très-calme, et vous me mettriez hors de moi en en doutant.
—Ah ça! vas-tu finir? dit le capitaine en fronçant le sourcil.
—Oh! j'ai tout fini! Défiez-vous de l'Anglais! voilà ce que j'avais à vous dire; ce n'est pas long. Ces gens-là en veulent à la marine française. Après tout, je sais bien que c'est votre affaire de vous compromettre, de vous exposer; moi, je connais ma consigne, je vous sauverai malgré vous et malgré ce goddam!
—Je te défends de lui manquer de respect; il est mon hôte, reprit le capitaine avec fermeté.
—C'est bon, c'est bon, on ménagera le requin; mais vous vous en repentirez.
—Pas autant que de t'écouter.
Et le capitaine Michel poussa doucement Pharamond dehors et lui envoya la porte dans le dos.
Cette amicale brutalité fit grommeler le vieux matelot.
—Je me vengerai, dit-il en serrant ses grosses lèvres comme pour mordre déjà à sa vengeance, mais, en réalité, pour mordre à une pincée de tabac qu'il venait de se glisser sous les dents.
Il est bien entendu que la vengeance dont parlait Pharamond ne pouvait être qu'un service à sa manière rendu au capitaine, malgré lui. Ce fut ainsi que Michel le comprit, et il se remit à sa table pour continuer sa lettre, en riant doucement.
—Bon Pharamond! serait-il heureux de mettre la main sur un coquin! S'aviser de soupçonner sir Olliver! un si parfait gentleman. Je sais bien qu'au premier abord cet Anglais a quelque chose de bizarre, d'excentrique... Bah! comme tous les Anglais! A quoi vais-je songer? Voilà que je tombe dans les sottes idées de mon matelot. N'y pensons plus.
Et après cette résolution fermement prise, le capitaine continua à y songer plus que jamais. Sans accorder à Pharamond aucune autorité morale, il lui reconnaissait, avec la superstition des marins, des voyageurs, des isolés, une sorte d'instinct de dévouement infaillible, une perspicacité canine, en quelque sorte, qui flairait bien les périls.
—Mais quel danger peut venir de cet Anglais? C'est absurde, c'est incroyable, se dit presque à haute voix le brave capitaine. Oui; mais c'est possible. Je vais aller trouver sir Olliver.
Et achevant de donner à sa toilette la correction qui implique l'idée de sévérité et de dignité, le capitaine Michel monta sur le pont du navire où l'Anglais se promenait de long en large, regardant le ciel qui, ce jour-là, était d'un bleu azuré, le plus rassurant du monde pour un navigateur.
—Si c'est avec l'horizon qu'il complote, se dit en souriant le brave Michel, je crois qu'il est trahi par son complice.
Et, sur ce mot, le capitaine fit trois pas en avant, toussa de façon à arracher doucement l'Anglais à sa méditation, et le salua avec la courtoisie la plus terre ferme qu'il put évoquer.
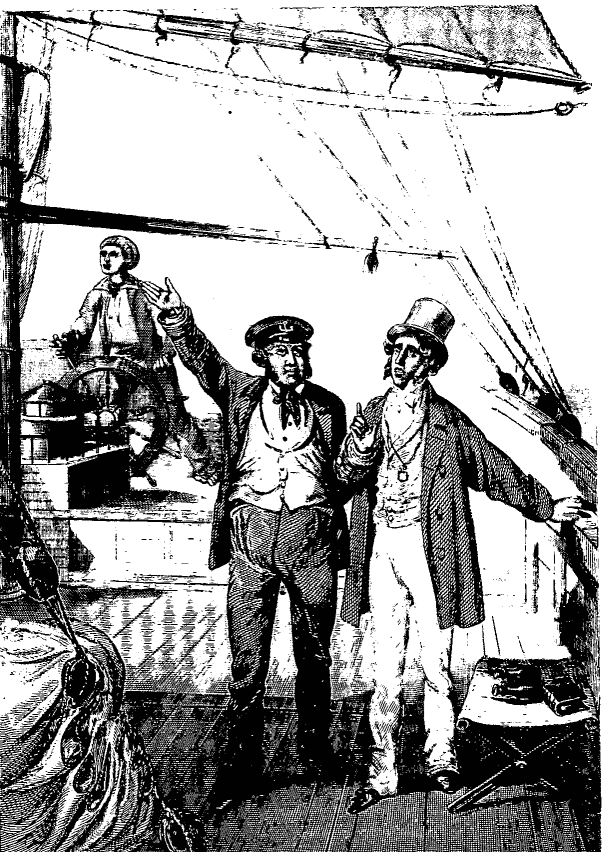
Sir Olliver paraissait avoir trente-cinq ans. Il attestait, par la pureté de son teint, la valeur souvent mise en doute de l'hygiène britannique.
Ses yeux étaient moins bleus que le ciel qu'ils contemplaient; mais ils eussent pu passer pour des beaux yeux d'azur parmi des yeux de faïence. Ses favoris et ses cheveux étaient blonds en Angleterre et rouges sur le continent. Assez bien fait, doué d'une jolie prestance que ses vêtements étaient loin de laisser voir, il n'avait rien extérieurement qui pût alarmer l'observateur le moins optimiste. Il fallait, à coup sûr, les préventions et les préjugés de Pharamond pour soupçonner des embûches dans l'esprit paisible de ce voyageur mis à la dernière mode.
Michel eut presque honte de sa démarche, et ce fut de l'air le plus cordial qu'il interpella l'Anglais.
—Eh bien! milord, vous ne vous plaindrez pas; voilà un beau temps.
—Oui, le temps est fort beau, répondit l'Anglais avec un soupir.
—On dirait que cela vous contrarie? Nous ne sommes pas à Londres ici; il ne faut pas voir d'insulte dans un ciel un peu clair.
—Je suis habitué aux contrariétés, répliqua sir Olliver d'un ton languissant.
—Est-ce que vous vous seriez embarqué, par hasard, pour assister à une tempête?
—Oh! oui, à une tempête et à autre chose encore!
—Eh bien, milord, j'en suis fâché pour vous, continua le capitaine en raillant et en se frottant les mains; mais nous n'aurons pas le plus petit grain, d'ici longtemps peut-être.
—D'ici longtemps! murmura l'Anglais avec abattement.
—Quel original! se dit Michel.
Un petit silence suivit ce premier abordage. Persuadé qu'il avait affaire à un maniaque sans danger, le capitaine allait se retirer, quand sir Olliver redressa tout à coup la tête, et reprit avec fermeté:
—Monsieur le capitaine, combien coûterait une tempête, au plus juste prix?
La question était bouffonne, faite surtout dans ce français anglaisé et avec cet accent que nous ne cherchons pas à noter, afin de laisser au récit toute sa clarté. Michel revint sur ses pas.
—Une tempête! vous voulez rire.
—Je ne ris jamais, moi, je suis toujours sérieux.
En effet, c'était avec le plus imperturbable sang-froid que ces singuliers propos étaient tenus.
—Ma foi, milord, vous auriez beau y mettre le prix, il me serait impossible de vous procurer aujourd'hui ce que vous demandez.
Michel, qui s'efforçait de rester poli, sentait un rire goguenard l'étouffer.
—Oh! si vous le vouliez, demanda l'Anglais.
—Comment diable m'y prendrais-je?
—Je veux dire, continua sir Olliver, une petite tempête sans orage, un joli naufrage par le beau temps. Ce serait terrible et délicieux!
L'œil de l'Anglais s'alluma d'une singulière convoitise.
—Décidément, il est fou, se dit presque à demi-voix le capitaine Michel.
—Oui, continua sir Olliver avec une animation tout intérieure, pour ainsi dire, et sans que la vivacité de ses paroles ébranlât son corps immobile, fît frémir ses favoris soigneusement peignés, ébranlât le contour inflexible de son col de chemise; oui, je voudrais voir ce beau navire se tordre, se rouler et disparaître dans les flots. Quelle scène, ô Shakspeare!
Il y avait, dans ce souhait sinistre, un côté vraiment comique. Ce fut celui-là qui parut tout d'abord à l'imagination du capitaine, qui s'appuya aux bastingages pour supporter le poids de son hilarité. Mais sir Olliver ne riait pas; il trouvait, au contraire, l'hilarité du capitaine fort injurieuse, et il arrêtait sur lui son regard froid et dédaigneux, comme s'il eût attendu des excuses. Michel ne songeait guère à s'excuser. Il défaisait le nœud de sa cravate pour ne pas étrangler.
—Il faut convenir que vous êtes un homme bien aimable, disait le bon capitaine; vous prenez votre plaisir d'une singulière façon. Ah! il vous faudrait, pour vous seul, la représentation d'un naufrage. Vous n'êtes pas dégoûté; mais vous ne l'aurez pas.
—Oh! si, je l'aurai, dit d'un ton sec l'Anglais fort mécontent.
—Je vous en défie bien. Regardez-moi le ciel! est-il disposé à flatter vos manies? Regardez cette coquille? hein! est-elle faite pour la lame?
—Oui, ce vaisseau est très-confortable, répondit sir Olliver; mais un petit trou dans la calle me donnerait ce que je demande.
—Heureusement que nous sommes deux à vouloir, repartit rudement Michel qui essayait de couper court à la plaisanterie.
—Mais, moi, je veux plus que vous, continua l'Anglais.
—Il s'agit bien de notre volonté à tous les deux! Suis-je fou de vous écouter! Et Michel, en haussant les épaules, fit un pas pour se retirer.
—Oh! oui, il s'agit de nous deux, dit sir Olliver en se plaçant avec un beau sang-froid devant le capitaine; car je puis, si vous me refusez ce plaisir, vous brûler la cervelle.
Et le parfait gentleman tira de sa poche un élégant revolver qu'il montra à Michel.
Le vieux marin ne broncha pas; mais la patience lui échappait.
—Savez-vous bien, monsieur, dit-il à l'Anglais, qu'il n'appela plus milord, que je pourrais vous faire descendre à fond de cale; mais, pour vous empêcher d'y pratiquer la petite ouverture que vous désirez, je vous mettrais des menottes et un boulet au pied. Je suis le maître ici. Ce navire est ma maison, et, comme nous n'avons pas de médecin pour les fous, c'est moi qui rédige les ordonnances et qui les applique.
—Je ne demande pas mieux, répondit sir Olliver qui remit languissamment son revolver dans sa poche, et qui tendit les deux poignets au capitaine. La prison, c'est toujours quelque chose!
Et le malheureux soupirait en tournant vers le ciel les yeux de faïence dont il a été parlé plus haut.
Pour le coup, Michel fut désarmé. Sa colère ne voulut pas être en reste de politesse avec le revolver. Il reprit sa bonne humeur, et s'adressant à l'Anglais avec cette autorité amicale qui s'impose, en dépit des caractères:
—Milord, lui dit-il, en donnant à ce mot de milord la grâce avenante d'une offre de réconciliation, nous ne nous entendons pas. Pourtant j'ai vu des caractères de toutes les nuances, des fantaisies de tous les calibres. S'il vous plaisait de causer un peu et de m'expliquer vos idées; eh bien, je m'y ferais, je m'y habituerais, et il n'y aurait plus de contradiction entre nous.
Michel s'était fait le raisonnement que suggère toujours l'obstination d'un fou.
—Cédons, s'était-il dit, ou plutôt ayons l'air de céder, et promettons-lui la lune et le soleil, s'il tient absolument à les avoir.
Il prit, en conséquence, avec une familiarité dont l'Anglais ne fut pas trop choqué, le bras de sir Olliver, entraîna celui-ci à l'écart, s'assit et le fit asseoir à côté de lui; puis, comme un père qui va recevoir la confession de l'enfant prodigue:
—Voyons, milord, lui dit-il, vous avez eu des chagrins; racontez-les-moi, je ne suis pas insensible. Nous autres, vieux loups de mer qui ne quittons jamais l'eau salée, nous en avons quelquefois sous les paupières. Je vous promets de pleurer s'il le faut; c'est gentil cela, hein?
—Vous êtes bon, repartit sir Olliver en tirant de sa poche des gants qu'il mit avec le plus grand soin, et vous allez tout savoir. Ce que j'ai à dire, d'ailleurs, peut se résumer dans un seul mot: je m'ennuie.
—Je connais cela, interrompit Michel, et je le respecte; c'est votre point d'honneur national.
—Oh! je m'ennuie plus que tous les Anglais à la fois. Quand j'étais tout petit enfant, je m'ennuyais déjà dans les bras de ma nourrice. Je suis entré dans le monde en bâillant. J'étais riche, j'ai essayé de tous les genres de guérison. J'ai voyagé, j'ai aimé, j'ai étudié; j'ai payé très-cher des tableaux, des livres, des chevaux, des femmes, des chiens, des coqs. Les coqs m'ont amusé huit jours, et puis ils avaient une telle ardeur à combattre que j'en suis devenu jaloux, et que je leur ai fait tordre le cou. J'ai eu des duels; pas un ne m'a été funeste. Je suis allé dans l'Inde, et j'ai fait le siége de Delhi avec ma cravache; les balles des révoltés avaient de si grands égards pour moi que je n'avais plus même l'émotion du danger. J'ai eu pendant toute une nuit la tentation de m'enrôler parmi les insurgés et de courir la chance d'être mis à la gueule des canons. Mais si je m'ennuyais d'être Anglais, j'étais en même temps trop fier de ce titre pour me compromettre avec les scélérats que nous allions châtier. Je suis revenu en Europe. J'ai habité Paris pendant deux ans, et je n'ai eu que deux heures de gaieté, un jour, à une séance de l'Académie française où tout le monde dormait, même les orateurs. Malheureusement ces représentations somnambuliques sont rares. Les théâtres m'ont porté au suicide; il ne suffit pas de savoir le français pour y aller: il faut savoir le calembour. Je n'ai jamais pu le comprendre. J'ai cru que l'amour me guérirait; mais l'amour n'est que l'ennui partagé, et je me piquais de trop de générosité pour ne pas prendre la part de celle que j'aimais. J'ai songé à me précipiter du haut de la colonne Vendôme; mais je suis parent de feu lord Wellington, et le choix de ce monument, pour finir mes jours, eût été un manque d'égards pour la statue de mon illustre cousin. J'avais essayé de la vie parisienne; j'ai voulu interroger la mort. Je suis allé, un jour, au Père-Lachaise, bien décidé à causer, comme Hamlet, avec les fossoyeurs; mais ces messieurs avaient des uniformes, lisaient le journal et manquaient complétement d'humour. Cette désillusion m'a guéri même de la pensée de la mort; on doit bien s'ennuyer au Père-Lachaise en si plate compagnie. On ne me laissa toucher à rien dans le cimetière. Tous les morts sont sous clef. Pauvre Yorick!
J'avais un bel appartement; je donnai des fêtes et d'excellents dîners; j'invitai des artistes; ils mangèrent bien, mais m'égayèrent mal. J'entendis parler d'un bandit qui dévastait la campagne aux environs de Rome. Je partis pour l'Italie, mais je ne trouvai personne pour me présenter à ce chef de brigands; lorsque, surmontant les règles de la bienséance britannique, je voulus me présenter moi-même, le coquin avait fait sa soumission et accepté un grade dans la gendarmerie du pape. Il tenait à ses économies.
—En vérité, vous n'aviez pas de chance, interrompit le bon Michel, qui gardait son sérieux.
—N'est-ce pas? Comme je regagnais le Havre, incertain de ce que je devais tenter, j'aperçus votre fringant navire; il me plut. Sa légèreté me fit penser qu'il ne devait pas être très-solide. J'entendis raconter que vous partiez pour un long voyage; vous deviez toucher aux îles de la Sonde. L'occasion des aventures me séduisit; mais ce que vos matelots m'ont dit des efforts tentés pour adoucir les mœurs de ces peuplades m'a refroidi. J'ai peur de trouver les insulaires de la Polynésie en train de lire la Bible. Je ne saurais attendre plus longtemps. Ma patience est à bout; c'est ici que je dois ressentir enfin les émotions si vainement espérées. Je guettais une tempête; je n'ai plus que la ressource d'un naufrage; mais j'y tiens. Capitaine, je vous l'ai dit, je suis riche, j'ai sur moi de quoi payer cette coquille, toute la cargaison et l'équipage par-dessus le marché. Voyons, monsieur Michel, faites-moi le plaisir de couler bas ce vaisseau; nous ne sommes pas éloignés d'un archipel; partez sur un bateau. Laissez-moi seul, je me charge de tout. C'est convenu, n'est-ce pas?
—Diable! vous êtes bien pressé, dit Michel en se levant et en ruminant dans sa tête quelque prétexte pour donner le change à la fantaisie de son passager.
—Dépêchez-vous, car je m'ennuie, répéta langoureusement sir Olliver.
—Et moi aussi, vous m'ennuyez, dit le capitaine.
—J'avais bien songé, continua l'Anglais, à susciter une révolte de l'équipage, à me faire nommer capitaine; mais vous êtes un brave homme; je serais désolé de vous faire violence.
—C'est là un procédé dont j'apprécie toute la délicatesse, reprit Michel, et pour n'être pas en reste, je ne vous ferai pas attacher avec un boulet au pied et jeter à la mer.
—Ce serait pourtant une péripétie.
—Eh bien! si le cœur vous en dit, ne vous gênez pas; sautez par-dessus bord.
Sir Olliver parut réfléchir.—Non, je ne veux pas, je sais trop bien nager, je me sauverais.
—Ah! vous prenez la chose au sérieux? Quel farceur intrépide! Mais savez-vous bien que si vous n'avez pas d'émotions, vous êtes joliment fait pour en donner! Voyons, milord, êtes-vous arrivé sérieusement à cet excès d'ennui que rien, pas même une bonne action à accomplir, ne puisse vous distraire?
—Les bonnes actions, dit sir Olliver, oh! j'en ai essayé. Mais les remercîments de ceux que j'obligeais m'ont dégoûté de la bienfaisance.
—Eh bien, vous aviez les ingrats pour vous consoler.
—Oui, je sais, l'ingratitude serait piquante, si elle n'était pas banale.
—Sacrebleu! s'écria le capitaine, j'y perdrais mon latin, si je l'avais jamais su. Vous êtes un homme difficile à amuser. Avez-vous essayé du jeu?
—Le jeu? quelle ironie! D'ailleurs je n'avais pas de chance en jouant, je gagnais toujours.
—Ah ça, au lieu de l'eau salée à prendre par bain ou par gorgée, si vous essayiez du vin? voilà un genre de consolation qui n'a rien d'antinational.
—L'ivresse! ce n'est pas l'émotion; c'est le suicide! Boire pour se distraire n'est pas d'un gentilhomme; il faut boire tout au plus pour mourir.
—Tiens! voilà une issue. Tuez-vous!
—Non. La mort n'est peut-être que l'ennui pétrifié, et je ne pourrais pas m'y soustraire, une fois le pacte conclu. Le sommeil est un plaisir négatif.
—Allons, vous ne voulez pas en démordre, il vous faut un naufrage.
—Oui, mais complet!
—Laissez-moi, du moins, le temps de la réflexion, parbleu! jusqu'à ce soir; je ne peux pas m'engager à la légère.
—Jusqu'à ce soir, onze heures, dit sir Olliver qui tira sa montre. Mais il est bien entendu que si vous refusez, capitaine, nous sommes déliés l'un envers l'autre, et j'aurai le droit de vous contraindre par tous les moyens.
—Le droit! le droit! c'est une question. Mais enfin je consens à vous laisser libre du choix de vos distractions, si je ne vous distrais pas à ma manière.
—A ce soir, monsieur Michel.
—A ce soir, milord.
Et le capitaine se leva pour rompre l'entretien. L'Anglais resta assis, poussa quelques soupirs, sortit enfin d'un étui breveté le plus odorant cigare qui ait jamais aromatisé des lèvres masculines, et se mit à le fumer avec une sensualité qui prouvait bien qu'il n'était pas complétement guéri des joies de ce monde, et que la vie lui offrait encore quelques petites douceurs.
Michel n'était pas sans inquiétude: la folie de sir Olliver était dangereuse. Le brave capitaine ne redoutait pas la mort; quoiqu'on puisse avouer, sans honte, que s'il est glorieux de s'exposer au péril pour une grande cause, il est ridicule d'être tué stupidement, par un insensé, sans profit moral pour soi et pour ses héritiers. Mais ce que Michel craignait bien réellement, c'était la nécessité de recourir à des mesures de rigueur, à des précautions violentes. Pharamond ne s'était guère trompé. Sir Olliver avait tenté de corrompre l'équipage. Jusqu'où le mal était-il descendu? et comment faire pour se préserver des tentatives de cet homme devenu féroce et implacable à force d'ennui?
Pharamond avait suivi du coin de l'œil l'entretien. Quand il vit le capitaine se diriger, tout soucieux, vers sa cabine, il s'avança:
—Ah! c'est toi, mon brave, dit Michel.
La familiarité de cet accueil fit comprendre au matelot que le capitaine rendait hommage à sa perspicacité. Il n'abusa pas de cette découverte et triompha avec modestie.
—Eh bien! avais-je raison ce matin? demanda-t-il de l'air soumis d'un homme qui avoue un tort.
—Tu avais raison de m'avertir; mais tu avais tort de soupçonner dans sir Olliver un espion; ce n'est qu'un fou.
—Merci; je connais les douches qu'il leur faut, à ces fous-là.
—Encore une fois, pas d'imprudence, Pharamond; viens causer; j'ai à te consulter.
Pharamond rougit jusqu'aux oreilles. Les condescendances du capitaine étaient les plus grands triomphes qu'il pût ambitionner. Il suivit donc Michel, et resta deux heures avec lui, enfermé. Le problème était difficile; mais Michel était rusé. Que fut-il décidé dans ce tête-à-tête mystérieux? c'est ce que nous saurons bientôt. Constatons seulement qu'avant de se quitter, les deux marins eurent un accès de rire qui fit vibrer les cloisons de la chambre. Pharamond riait à faire peur; Michel riait à faire envie.
—Ah! la bonne farce, disait le matelot en se tapant sur l'estomac, pour digérer son contentement.
—Comme ce sera amusant à raconter à ma femme et à mes filles, disait le capitaine; surtout, mon brave, pas un mot!
—Moi parler à ce lord Spleen! merci, je n'ai jamais flatté les Anglais, et ce n'est pas à mon âge que je commencerai.
—Qu'il ne se doute de rien!
—N'ayez donc pas peur! on sera muet comme une femme morte. Mais êtes-vous bien sûr, capitaine, que l'affaire ne ratera pas?
—J'en réponds! Assure-toi de quelques hommes pour le moment décisif; prépare tout ce que je t'ai dit, et, à minuit, attends-moi.
—Comptez sur moi, monsieur Michel.
Pharamond quitta le capitaine dans un état indescriptible. Il murmurait entre ses dents:
—Ah! goddam, tu veux nous faire chavirer! on t'en donnera du naufrage! Ah! il te fallait pour rire, simplement, nous voir frétiller dans la mer! Eh bien! voilà un divertissement de notre façon que tu pourras savourer à loisir. A-t-il de l'imagination ce capitaine! quel homme! mais moi, à sa place, j'aurais fait tout bonnement boire milord l'altéré à la grande tasse. Au lieu de lui mitonner une mystification de premier ordre, je l'aurais guéri de l'ennui des fièvres chaudes. Enfin, le capitaine aime mieux nous faire rire; on rira, voilà tout!
Et après une interruption consacrée au tabac, Pharamond reprit en riant:
—Ah! l'on rira, et crânement encore, et on dansera même, quand ce commissionnaire en ennui ne sera plus à bord! Pour l'argent qu'il a donné et les petits cadeaux qu'il a faits, plus tard ils serviront à payer la noce.
Et, les deux mains ouvertes sur les hanches, Pharamond exécuta un mouvement des pieds, qui passe, dans certains ports de mer, pour un entrechat.
Sir Olliver était loin de se douter du complot tramé contre lui; il perdait encore une joie, en ignorant ce danger; l'appréhension lui eût donné peut-être le semblant d'une émotion. Il fumait, grave comme un Turc, et peut-être bien ne réfléchissait-il pas plus qu'un disciple de Mahomet. Cette tristesse sans cause dont il avait fait son régime, sa température morale, lui paraissant sans issue et sans remède, il ne se fatiguait pas toujours à la combattre, et avec un abandon qui était, tout bien considéré, une petite volupté méconnue par lui, il se laissait aller au bercement de son ennui.
Pharamond avait des démangeaisons horribles de distribuer des coups de poing; mais il craignait de trahir sa joie. Il allait parler aux matelots dont il était sûr, et montrait dans sa démarche une légèreté, une allégresse de jambes qui faisait trembler le navire. Il ne manquait jamais dans ses promenades de passer devant l'Anglais, et de lui envoyer un regard sournois, en fredonnant l'air national: Bon voyage, monsieur Dumollet!
L'or de l'enfant d'Albion n'avait pas fait beaucoup de traîtres, à en juger par l'empressement que tous les matelots, discrètement interrogés, mirent à entrer dans un complot contre sir Olliver. C'étaient des rires entrecoupés, des commentaires énergiques, des paroles à faire frémir. Si on leur eût abandonné le programme du divertissement, les hommes de l'équipage eussent volontiers suspendu l'Anglais, par les pieds, à une vergue, pour lui faire rendre la mauvaise humeur qui l'obsédait. Les plaisants du Cyclope suggéraient des raffinements de Polyphème.
—La couleur de ses cheveux me déplaît, disait l'un; j'ai envie de les teindre en noir.
—Ils sont si rouges qu'ils pourraient bien brûler, disait un autre.
—Alors, brûlons-les.
Le capitaine Michel avait donné des instructions dont on ne devait pas se départir, et Pharamond, l'imprésario du petit acte annoncé, réprimait le zèle des vieux par de gros jurons, et le zèle des jeunes par de gros coups de poing. On acceptait les uns et les autres en riant.
Le soir vint; un soir parsemé d'étoiles. Le diable n'avait pas fait du ciel une écritoire, comme dit le poëte; mais on eût dit qu'il avait semé des perles dans un écrin d'azur, pour mettre en campagne tous les amoureux sublunaires.
Le Cyclope s'avançait doucement vers cette terre inconnue qu'on appelle la Nouvelle-Guinée. La fortune du capitaine Michel tenait précisément à des voyages hardis et quelquefois dangereux, dans ces parages peu explorés, mais que les Anglais commencent à regarder avec attention. On n'était pas loin du groupe des îles Arrou.
Michel, accoudé sur le bastingage, regardait au loin et paraissait aspirer des parfums. Si familiarisé qu'il fût avec l'aspect de l'Océan, si blasé qu'il parût sur les effets de la lune, il pensait qu'un si joli temps serait délicieux à admirer dans son petit jardin, sous sa tonnelle, entre sa femme et ses deux filles, et il s'imaginait que la brise lui apportait des odeurs de réséda et de chèvrefeuille. Quand il aurait bien humé l'air dans son petit jardin, de là-bas, des antipodes, sa femme viendrait lui frapper sur l'épaule et l'avertir de rentrer, pour ne pas attraper de rhumes; car bien sûr, rendu à la vie civilisée, il s'enrhumerait, il participerait à ces bienheureuses infirmités des gens sédentaires, qui ont le loisir de se soigner.
Hélas! le capitaine se disait que, pour jouir immédiatement, il lui faudrait percer la terre de part en part et descendre chez lui, comme on sort d'un puits. Il s'amusait même, par la réflexion, à discuter le problème de savoir s'il sortirait, le cas échéant, la tête la première ou les pieds en avant.
Pendant qu'il s'égarait de digression en digression, oubliant un peu la Papouasie et ses vilains habitants, auxquels il allait donner des verroteries françaises pour ajouter à leur laideur, il se sentit toucher à l'épaule. Michel se retourna brusquement. Il n'eût pas été trop surpris de se trouver nez à nez avec madame Michel, les désirs et les rêves ayant supprimé la distance.
Mais c'était Pharamond qui, l'œil brillant et la bouche béante, lui dit:
—Eh bien! capitaine, vous oubliez l'heure. Il est temps de souper. Milord a de l'appétit.
—Ah! ah! c'est vrai. Tout est-il préparé?
—Vous verrez!
—Je ne suis pas sans inquiétude, Pharamond. Ce diable d'original n'aurait qu'à faire quelque coup de sa tête! et si je veux lui donner une petite leçon, je ne tiens pas à l'exposer à un danger sérieux. Au surplus, il ne s'agit que de quelques jours d'épreuve!
—Soyez donc tranquille, capitaine; milord Spleen se trouvera là comme un coq en pâte. Aimez-vous mieux qu'il se livre à quelque sottise dont nous souffririons tous, le Cyclope tout le premier?
—Le Cyclope! qu'il y touche!
—Il y touchera, si vous ne trinquez pas ce soir avec lui.
—Je trinquerai; n'aie pas peur. Tu vois, le ciel nous vient en aide!
—Voilà un temps délicieux pour les promenades. A-t-il de la chance cet animal-là!
—Et dire qu'il méconnaît son bonheur! Comprends-tu, mon vieux Pharamond, qu'il est millionnaire, ce coquin-là!
—Mille millions de tonnerres, et il se plaint! je vous le dis, capitaine, il est incorrigible!
—C'est pour cela qu'il est amusant d'essayer de la correction.
Et Michel, qui dans sa belle humeur se départait, sans y penser, de sa dignité de commandant, donna une poignée de main à son matelot, et le quitta pour aller rejoindre sir Olliver. L'Anglais n'avait pas bougé. Quand il vit venir le capitaine, il leva la tête.
—Il n'est pas onze heures?
—Pas encore, milord; mais je suis beau joueur, et je viens m'acquitter.
—Vous consentez?
—Je consens à vous donner les émotions que vous cherchez, répondit Michel, qui ne voulait pas se livrer d'avance, ni mentir tout à fait.
—Enfin voilà donc un homme qui me comprend, dit l'Anglais d'un ton glacial et en serrant avec force la main du capitaine.
Cette façon d'épancher sa reconnaissance en glaçons fit sourire Michel.
—Oui, milord, reprit-il, je consens; je mets une seule condition, c'est que nous viderons ensemble quelques bouteilles d'excellent vin, que je ne me soucie pas de voir noyer. La mer boit mal.
—C'est parfaitement raisonné. Monsieur le capitaine, permettez-moi de vous offrir un cigare.
—Je n'en fume guère, j'ai l'habitude de la pipe; mais puisque c'est la dernière fois que nous fumons ensemble.....
Et Michel, qui avait beaucoup de peine à garder son sérieux, prit un des blonds cigares de sir Olliver, et le mit à ses lèvres.
Tout était préparé dans la chambre du capitaine pour un souper. Une certaine élégance, celle qui tient surtout à l'harmonie des formes entremêlées de bouteilles bien choisies, étonna sir Olliver. La partie solide laissait à désirer; mais le capitaine s'excusa.
—Je n'ai pas eu le temps d'écrire à Paris et de prévenir Chevet, dit-il en montrant un jambon, du fromage et quelques fruits secs.
—Nous n'avons besoin de rien de plus, répliqua courtoisement l'Anglais qui comptait les bouteilles; le prétexte pour boire est suffisant.
—Eh bien! à table; et faisons peur à vos chagrins! Pourvu qu'ils ne sachent pas nager, s'écria Michel qui ne se sentait pas d'aise.
—Je ne comprends plus, demanda sir Olliver.
—Parbleu! c'est bien simple: s'ils ne savent pas nager, ils vont être noyés.
Et le capitaine éclata de rire.
L'Anglais ouvrit la bouche, comme si une douleur aiguë la faisait se contracter. C'était son sourire à lui.
Les deux convives s'attablèrent. On commença par interroger une bouteille de tokay.
—Il eût été dommage de perdre un si bon vin, dit l'Anglais, en reposant son verre vide.
—Il est toujours dommage de perdre l'occasion de trinquer avec un si charmant buveur, reprit Michel qui flattait sir Olliver.
—Je suis ravi de vous voir revenu à de meilleurs sentiments, monsieur le capitaine.
—Oh! vous n'êtes pas au bout!
—Vraiment! que me ménagez-vous encore?
—Plus d'émotion que vous ne pouvez en rêver!
—Ne vous gênez pas, j'ai de l'appétit. Ainsi, capitaine, vous m'abandonnez votre vaisseau?
—Il faut bien faire quelque chose pour vous, dit avec une feinte soumission le brave Michel qui débouchait sa quatrième bouteille. L'Anglais était sans défiance. Il tendit son verre, et porta un toast à madame Michel, à sa famille et aux beaux jours passés du Cyclope. Le capitaine, qui guettait depuis quelques moments l'effet de ces épanchements réels et symboliques, paraissait enchanté du tour que prenait l'humeur de sir Olliver. Il se renversa sur sa chaise, alluma sa pipe avec le tison du cigare, et continua à s'éclairer sur le véritable caractère de la mélancolie anglaise.
—Ah çà! milord, demanda Michel, dites-moi donc un peu comment vous vous y prendriez pour le naufrage en question.
—Comment je m'y prendrai? oh! rien de plus simple; vous l'avez dit vous-même, un trou dans la cale! l'eau montera; je monterai avec elle, et quand le navire sera près de disparaître...
—Vous disparaîtrez aussi?
—Non, je sauterai dans la barque, sur le radeau que j'aurai eu la précaution de construire, et je me dirigerai au plus tôt vers une des îles voisines; car nous sommes tout près d'un archipel.
—Ah! bah, s'écria Michel, véritablement stupéfait, vous savez que nous sommes près des îles.....
—Oh! certainement, c'est pour cela que j'ai voulu faire naufrage.
—Eh bien, vous êtes un farceur de précaution! vous vous assurez contre l'entraînement du plaisir. Pourquoi ne pas faire naufrage dans une baignoire? c'eût été encore plus prudent.
—Je suis prudent, c'est vrai, répondit l'Anglais avec ce sang-froid fantastique qui signale souvent les commencements de l'ivresse, parce que je n'aime pas que l'on se moque de moi. D'ailleurs, je veux l'émotion du débarquement après l'émotion du naufrage.
—Vous l'aurez, milord, vous l'aurez.
—J'emporte toujours avec moi l'histoire de Robinson Crusoé, que j'ai beaucoup lue et que j'aime beaucoup, continua sir Olliver d'un ton horriblement lugubre.
—Je voudrais bien vous voir, milord, vous installant dans votre île et construisant votre habitation.
—Oh! j'ai une habitation toute faite, un petit chalet démonté que j'ai acheté avant de partir et que je mettrai sur le radeau.
—Vous serez fort beau allant à la chasse et cherchant votre nourriture dans les bois.
—Sans doute, mais j'ai quelques caisses de provisions...
—Que vous mettrez encore sur votre radeau. Je parie que vous avez aussi une cargaison de vêtements.
—Pouvais-je, mon cher capitaine, m'exposer au costume primitif?
—Diable, vous perfectionnez Robinson. Est-ce que par hasard vous auriez oublié un nègre, le fidèle Vendredi?
—Je n'aime pas les nègres et j'aime la solitude.
—Je vois que toutes vos mesures sont bien prises. Buvons à votre heureux débarquement.
L'Anglais, dont la parole devenait de plus en plus brève, tendit son verre, le fit emplir, et le vida en silence. Michel jasait pour deux. Le brave capitaine s'amusait délicieusement. Il n'avait jamais été à pareille fête. Mystifier un Anglais qui allait si volontiers au-devant du piége, c'était un double triomphe, et, tout en étudiant l'effet des toasts réitérés, Michel le provoquait encore.
—Milord, je bois à votre île déserte! milord, je bois à Robinson Crusoé! milord, je bois à vos caisses de provision.
Une béatitude singulière troublait le regard de l'Anglais. Il semblait bien près de faire naufrage dans le monde idéal. Une sorte de roulis balançait sa tête, et des bâillements faisaient pressentir l'instant où sa raison allait tomber dans les rêves. Michel dégageait de sa pipe une fumée de plus en plus opaque, comme s'il avait voulu joindre des nuages palpables aux nuées invisibles qui flottaient autour du front de sir Olliver. La figure du capitaine, si douce et si calme, s'animait d'une vivacité malicieuse. Par une pente naturelle dont nous avons déjà constaté les effets, Michel se départait de l'étiquette à mesure que l'Anglais paraissait s'endormir. Il déboutonna son gilet au premier bâillement; au second, il ôta sa veste; au troisième, il ne lui eût fallu qu'un geste pour qu'il se retrouvât dans la toilette sommaire du matin. Mais ce n'était pas l'heure de prendre ses aises. Quand il vit l'Anglais profondément endormi, le capitaine entr'ouvrit la porte.
—Pharamond, demanda-t-il à voix basse, tout est-il prêt?
—Oui, mon capitaine.
—Appelle deux hommes, et en route!
—Deux hommes! allons donc! je suffis bien à moi tout seul!
Et le matelot entra dans la cabine.
—Dort-il bien, dit-il en regardant l'Anglais sous le nez. Il y met une complaisance! Je suis sûr que si on le pinçait il ne s'éveillerait pas.
—Pas de bêtise, Pharamond!
—Pas si bête! mon capitaine.
Et, soulevant l'Anglais endormi, Pharamond le prit dans ses deux bras, et le porta sur le pont.
—Le bon vin rend léger, dit sentencieusement le matelot. Ce goddam-là est une plume; je le porterais au bout du monde.
Quelques minutes après, Pharamond, toujours chargé, ou plutôt toujours orné de son précieux fardeau, passait par-dessus le bord, descendait à l'échelle et déposait sir Olliver dans un canot préparé pour l'expédition. Le capitaine était déjà installé; toutes les caisses, tous les bagages de l'Anglais, placés sur un radeau construit à la hâte, étaient amarrés au canot.
On s'éloigna du Cyclope. La lune répandait sur la mer comme un sable d'argent que les rames agitaient. La solennité de la nuit impressionna de nouveau le capitaine. Les natures les moins sensibles, en apparence, à la poésie, subissent des bouffées d'idéal. Michel eut un éclair de charité généreuse: il craignait de blasphémer, en mystifiant une chétive créature par cette nuit splendide.
—Le pauvre fou! dit-il avec compassion, j'ai bien envie de me contenter de l'enfermer.
—Pourquoi pas, capitaine, l'engager aussi à nous faire sombrer? répliqua Pharamond.
—Je ne sais pas jusqu'à quel point je respecte le droit des gens.
—Ah çà! est-ce qu'il voulait le respecter, lui, tout le premier?
—Il va courir des dangers.
—Quels dangers? celui de s'enrhumer, tout au plus; mais il est connu que les Anglais ne s'enrhument pas: ils enrhument les autres.
Michel sourit, et regarda sir Olliver, qu'on avait douillettement placé sur une couverture. Il dormait comme dans le lit le plus confortable.
—De quoi se plaindra-t-il, demanda Pharamond; n'avons-nous pas pour lui toutes les précautions imaginables?
Le capitaine n'avait pas, au fond, de remords bien sérieux. Il lui eût plus coûté de renoncer à son projet qu'il ne lui en coûtait de le poursuivre. Le calme profond avec lequel dormait sir Olliver était même pour Michel un encouragement indirect. Le trouble de son hôte l'eût fait hésiter; mais par un raisonnement, ou plutôt par une absence de raisonnement assez ordinaire, il se dit que, puisque le sommeil de l'Anglais ne protestait pas, il n'y avait pas lieu de s'alarmer.
Michel semblera sans doute un logicien médiocre. Il eût pourtant fait honneur à certaines écoles philosophiques de nos jours, qui ne discutent pas autrement et qui prennent le sommeil de leurs auditeurs pour une adhésion.
Le canot s'avançait vers la terre; on était à quelques brasses d'une des plus petites îles de l'archipel Arrou, de ce paradis que les Hollandais voudraient bien ne pas laisser perdre, et qu'ils s'efforcent en conséquence d'acquérir prochainement.
—Sera-t-il heureux là dedans! dit Pharamond, en grommelant, avec une grimace, qui était un sourire, comme le mouvement de ses jambes était une danse.
—Ah ça! dit tout à coup Michel, si l'île n'était plus déserte!
—C'est un trop beau pays pour que les hommes songent à l'habiter, répliqua Pharamond, qui s'élevait parfois à de grandes hauteurs humoristiques.
Des senteurs embaumées venaient du rivage. L'île, baignée de cette lumière enchanteresse de la nuit, avait des contours indécis et paraissait un caprice des nuages. Des bruits harmonieux, des murmures d'oiseaux se faisaient entendre à distance.
—Vous verrez qu'il aura des rossignols pour le bercer, dit Pharamond, en haussant les épaules.
Le canot toucha la rive; on sauta à terre, on amarra les embarcations, et l'échouage de l'Anglais sur le bord fut entrepris avec les plus grandes précautions.
On choisit à quelque distance du rivage le gazon le plus fin, le moins humide qu'on put trouver. Pharamond avait bien proposé qu'on laissât quelques cailloux égarés dans l'herbe, mais Michel les enleva lui-même. On déposa doucement le dormeur; on lui mit un oreiller sous la tête; on rangea près de lui les caisses de provisions, tout l'attirail indispensable à la mise sur pied du chalet; on déboucla un nécessaire de toilette. Pharamond voulait même pousser la gentillesse jusqu'à donner un petit coup aux rasoirs; mais le capitaine savait bien que le coup serait donné si fort que l'Anglais devrait laisser pousser sa barbe.
Quand on eut tout rangé, tout disposé pour la plus grande surprise de sir Olliver, le capitaine tira de sa poche une lettre qu'il mit dans les doigts du dormeur, et donna le signal du départ. Avouons franchement que le bon Michel avait le cœur un peu gros. La plaisanterie était violente. Tous les hommes regagnaient le canot, quand Pharamond poussa une exclamation et revint sur ses pas.
—Mille millions de tonnerres, s'écria-t-il, j'oubliais...
—Quoi donc? demanda brusquement le capitaine.
—De lui donner un baiser, répondit Pharamond, qui, en effet, se mit à genoux devant l'Anglais, et lui posa le moins brutalement qu'il put, et avec des contorsions comiques, ses deux grosses lèvres sur le front.
—Adieu, mon chéri, dit le matelot; dors, ne fais pas de mauvais rêves; sois bien sage; et ne t'avise pas de faire sombrer la jolie petite île que nous t'avons choisie.
Les marins s'amusèrent de ces adieux de sentiment. Pharamond révélait un côté, inconnu jusque-là, de son caractère. On le savait brutal, on appréciait sa jolie façon de donner des coups de poing, mais on ne soupçonnait pas ses autres agréments. Il faisait preuve de lousticité; c'était une ressource. Seulement, il lui fallait un Anglais à mystifier pour qu'il fût en belle humeur, c'était une difficulté.
Le canot s'éloigna de la rive. Après quelques hésitations, Michel, qui voulait d'abord laisser le radeau utilisé pour le transport des provisions, se ravisa, et le fit rattacher à l'embarcation.
—Il n'aurait qu'à vouloir s'en servir pour nous rejoindre, se dit le capitaine, il se noierait.....
—Nous lui avons laissé un couteau et une fourchette, ajouta, en matière d'interruption, le spirituel Pharamond, qui devenait formidable, quand il abordait l'ironie. Il pourrait se blesser, le malheureux!
—Avouez, mes enfants, continua gaiement Michel qui, en somme était assez content de son expédition, que nous n'avons pas trop mal choisi. Sera-t-il bien, là!
—Le gueux! s'écria Pharamond, qui changea brusquement d'humeur, et qui en voulait peut-être à l'Anglais de l'insuccès de sa dernière plaisanterie; le gueux! il est mieux que l'empereur à Sainte-Hélène.
—C'est pourtant vrai! s'écria un vieux marin, ancien soldat de l'empire, qui n'avait pas encore songé à cet absurde rapprochement; ah! le scélérat!
—Capitaine, si nous retournions le réveiller et lui demander une réparation? dit Pharamond.
—Allons, silence, et manœuvrons bien; nous avons déjà perdu trop de temps pour cette plaisanterie.
Le canot rejoignit bientôt le Cyclope. Les marins remontèrent. Michel essaya, avec sa longue-vue, d'apercevoir encore, dans le brouillard argenté de cette nuit éclatante, l'île où il abandonnait sir Olliver; puis le navire reprit sa route, laissant l'Anglais continuer son sommeil sous les baisers de la lune, qui donnait au front de sir Olliver, en s'y jouant à travers les branches d'arbres, la grâce et la pâleur d'un Endymion.
Quelques heures après les événements que nous venons de raconter, au moment où l'aurore passait ses doigts roses mais un peu froids sur les paupières de l'enfant d'Albion, un bruit singulier interrompit le chant des oiseaux. On eût dit que les colibris, les bengalis et les perroquets de toute espèce s'interrogeaient entre eux sur cette note inconnue et baroque qui rompait l'harmonie de leur gai charivari.
Un silence solennel, un silence de jury musical pesa sur l'île; puis, comme le bruit mystérieux se fit de nouveau entendre, les oiseaux rassurés recommencèrent leurs caquetages; ils semblaient se dire les uns aux autres:
—N'ayez pas peur! ce n'est rien! ce n'est qu'un homme qui éternue!
C'était, en effet, sir Olliver qui, malgré les paternelles précautions du capitaine Michel, ressentait la fraîcheur du matin et inaugurait son réveil de cette façon bruyante.
L'éternument est, à coup sûr, une des joies délicates de la vie. Je n'invoque pas le témoignage des priseurs, qui ont abusé de cette volupté jusqu'à en faire un inconvénient. Mais je m'en rapporte à tous ceux qui, usant modérément de toute chose, secouent de temps à autre les fardeaux de la tête, les migraines, le sommeil et l'ennui, par ces brusques mouvements sonores et grotesques comme la gaieté, et qui sont les éclats de rire du nez.
Je sais bien que la délicatesse même de cette joie la fait confondre avec la douleur. Mais les augures heureux qu'on tire à tout âge de l'éternument révèlent sur ce point la conscience même de l'humanité. Les nourrices voient un signe de croissance dans l'éternument d'un enfant. Aristote, (non pas pourtant dans le chapitre des chapeaux) s'est occupé de la question de savoir pourquoi on salue les gens qui éternuent. Les Grecs leur disaient: vivez! les Romains: portez-vous bien! Nous, nous disons: à vos souhaits! ou: Dieu vous bénisse! Mais, quels que soient l'origine de ces politesses et le sens des mots employés, il n'en est pas moins vrai que la croyance universelle reconnaît un homme heureux, ou en passe de le devenir, dans l'homme qui éternue.
Cette pensée ne fut pas la première qui s'offrit à l'esprit de sir Olliver. Il eut peur tout prosaïquement d'être enrhumé, et il allait se lever pour fermer la porte ou la fenêtre de sa chambre et interdire le passage aux courants d'air, quand il s'aperçut que sa porte et sa fenêtre étaient démesurées comme l'infini, et qu'on eût fatigué l'éternité à vouloir les clore tant soit peu.
Le lecteur s'imagine sans doute que la stupeur, que l'ébahissement va enfin donner à sir Olliver l'émotion qu'il a toujours vainement souhaitée. Erreur! un Anglais ne s'étonne pas si facilement. Sir Olliver, quand il fut tout à fait éveillé, se crut endormi.
—C'est un songe, murmura-t-il, le songe d'une nuit d'été.
Mais un second et un troisième éternument, accompagnés d'une légère douleur dans les reins, le ramenèrent à la réalité. C'était le moment de s'étonner; ce fut le moment du désappointement.
—Hélas! ce n'est même pas un songe, se dit-il, je suis bêtement éveillé!
Et il regarda autour de lui d'un air défiant, comme une victime déjà mystifiée. La lettre déposée par Michel lui frappa les yeux; il l'ouvrit et lut ce qui suit:
«Milord,
«Nous ne pouvions plus naviguer ensemble. Vous m'excuserez d'avoir pris mes précautions pour défendre le Cyclope. Vous vouliez un naufrage; vous l'avez eu; seulement, dans le vin et non sur l'eau. Ce n'est pas la coque du navire qui a chaviré, mais la cervelle de Votre Seigneurie. Je m'empresse d'ajouter, milord, que vous avez été vaincu, sans que vous puissiez recevoir un reproche. Le vin était bon, mais il n'était pas pur. J'avais ajouté aux bouteilles qui vous concernaient un narcotique dont j'espère avoir bien ménagé les doses. Je serais désolé de m'être trompé et de vous procurer un sommeil sans réveil. Le cas de légitime défense ne m'autorisait pas suffisamment; mais comme si ce malheur était arrivé, vous ne liriez pas ma lettre, et comme vous ne pourriez par conséquent m'entendre que du séjour des bienheureux, où le Dieu des Français tolère quelques Anglais, je n'aurais pas à perdre mon temps et mon papier en excuses.
«Heureusement, milord, cette supposition est une plaisanterie. Je viens de contempler le sommeil de Votre Grâce, et jamais l'innocence et la bonne santé ne ronflèrent avec une tranquillité plus parfaite.
«Vous vous éveillerez dans une île charmante, coquette, à peine meublée de serpents, mais, en revanche, complétement dépourvue d'hommes. C'est le paradis terrestre sans Adam, et par conséquent aussi sans Ève. J'ose espérer que milord me saura gré du soin avec lequel je lui ai ménagé cette surprise, et des égards de tout l'équipage pour sa personne.
«Si milord, malgré ces attentions, était mécontent de son logement, il pourrait mettre un drapeau au sommet de la petite montagne qui partage l'île en deux portions; je ne doute pas qu'à moins de brouillards et de mauvaise volonté, les navires qui passeront à distance n'aperçoivent ce signal; et comme dans quelques jours le Cyclope sera un de ces navires, je promets à milord de bien essuyer les verres de ma lunette.
«Milord verra qu'on n'a rien oublié de ce qu'il avait embarqué avec lui. Si j'avais pu penser qu'un compagnon lui fût agréable, je lui aurais laissé le matelot Pharamond; mais les façons détestables de ce marin, qui croit avoir toujours à se plaindre des Anglais, auraient pu faire souhaiter la solitude à milord, et je tiens trop à combler les souhaits de milord pour ne pas le laisser seul.
«Je préviens milord qu'il devra se défier de certain fruit, vermeil, charmant à l'œil, agréable au goût, mais mortel, qui croît en abondance dans cette île. C'est la pomme de ce paradis terrestre; mais milord ne sera pas tenté puisqu'il n'aura pas de tentatrice, et il prend d'ailleurs trop de soins de sa santé pour terminer par un suicide une existence dévouée à l'imprévu.
«J'ai eu soin de régler la montre de milord, pour qu'en s'éveillant il puisse savoir l'heure exacte et apprendre, par comparaison, à mesurer le temps sur l'ombre des arbres, ainsi que cela se pratique dans Robinson Crusoé. Milord me saura-t-il gré de toutes ces petites gâteries, et voudra-t-il bien reconnaître qu'en lui procurant des émotions, sans m'exposer à en ressentir moi-même, j'ai agi avec prudence, et j'ai allié, dans la mesure convenable et discrète, les devoirs de l'hospitalité à ceux de ma profession?»
A bord du Cyclope,
MICHEL,
capitaine au long cours.
Sir Olliver ne put s'empêcher de sourire à la lecture de cette lettre. La pensée qu'il avait causé assez de terreur à quelqu'un pour qu'on machinât contre lui toute une embûche sérieuse ne lui fut pas désagréable. Pourtant l'ironie du capitaine le choquait dans sa vanité:
—Milord! milord! pourquoi m'appelle-t-il milord? il me traite, dans cette lettre, comme on traite les Anglais dans une caricature française. Ah! quand je sortirai de cette île, je me vengerai du capitaine.
Sir Olliver se leva, et ne voyant devant lui que la mer calme et unie, sans le plus léger vestige de barque ou de radeau, il comprit tout de suite que le départ ne devait pas être aussi facile que l'arrivée. Mais, résigné à tenter l'expérience de la solitude, puisque la fréquentation des humains ne lui avait pas réussi, il accepta résolûment le sort qui lui était fait.
—Ces insolents matelots ne verront jamais mon drapeau flotter sur la montagne, dit-il. Je vivrai ici; je m'empare de cette île, je n'en sors plus; elle est désormais mon domaine.
Je n'oserais pas avancer que l'Anglais songeait à peupler son royaume. Il avait de trop bonnes raisons pour ne pas faire ce rêve-là. Mais il pensa que bien des souverains gouvernent des solitudes, et que si celles-ci ont l'inconvénient de rapporter très-peu d'impôts, elles ont, en revanche, l'avantage d'être facilement gouvernables, et, par ce dix-neuvième siècle qui court, cet avantage n'est pas à dédaigner.
En conséquence, s'avançant jusqu'aux bords de la mer, et se retournant pour contempler l'île avec solennité, sir Olliver déclara à haute voix, et d'un ton respectueux, qu'il prenait possession de cette terre inconnue, au nom de Sa très-gracieuse Majesté la reine Victoria. Et ce devoir patriotique accompli, l'île fut baptisée du nom d'île des Rêves, l'intention de sir Olliver étant de passer sa vie à peupler au moins d'illusions et de fantômes de son imagination cette solitude charmante qu'il ne pouvait peupler autrement.
Une bonne conscience est un apéritif, et rien ne prédispose aux fonctions gastronomiques comme le sentiment du devoir rempli. Sir Olliver avait si bien agi qu'il se sentit affamé. Il toucha pourtant avec discrétion à la caisse d'approvisionnement, et sut gré au capitaine Michel de ce que celui-ci n'avait pas voulu lui procurer des émotions trop vives en lui coupant les vivres. Il éprouva même quelque satisfaction à retrouver son portefeuille intact et avec le même embonpoint; c'était là, on en conviendra, une satisfaction bien désintéressée dans le cas présent, et qui prouvait que sir Olliver aimait le superflu à l'égal du nécessaire.
Il fallait choisir un gîte, dresser son chalet, emmagasiner ses provisions, aborder enfin la partie technique du rôle de Robinson. Mais sir Olliver, pleinement rassuré sur l'état de la température, pensa qu'il avait tout le loisir nécessaire pour cette installation définitive, et ne se pressa pas de faire œuvre de ses mains. Il résolut, avant toute chose, de prendre connaissance de son île, d'en étudier la topographie, les ressources, et de choisir pour son domaine privé l'emplacement le plus agréable et le mieux abrité.
Mais comme il n'est pas convenable qu'un souverain passe l'inspection de ses États sans avoir commencé par s'inspecter lui-même, sir Olliver, qui ne partageait pas sur le chapitre de la toilette, non plus que sur les autres points, les idées tolérantes du capitaine Michel, sir Olliver crut indispensable de réparer le désordre de son costume. Il se mit en mesure de faire les choses en conscience, et chercha, à cet effet, un bosquet mystérieux, un sanctuaire sous les arbres, où sa pudeur britannique n'eût pas à souffrir; scrupule naïf, mais rassurant peut-être pour les illusions de notre naufragé. Il trouva ce cabinet de toilette, comme si une fée anglaise l'eût préparé d'avance. Un petit rocher, convenablement abrité par des arbres à longues feuilles, offrait à la fois un siége, un lit de repos ou une table.
Sir Olliver transporta là toutes les pièces de son nécessaire et préluda ensuite, avec le sang-froid le plus imperturbable, à la toilette la plus correcte. Il se rasa méthodiquement, se vêtit avec le soin religieux qu'un parfait gentleman doit apporter à cette œuvre capitale, et après avoir allumé un cigare il sortit pour sa promenade de découverte.
Un touriste moins blasé (en supposant que ces deux termes ne soient pas toujours synonymes) fût tombé en extase devant les splendeurs de végétation, devant les caprices de verdure, les somptuosités de fleurs qui se révélaient à chaque pas. L'île de Calypso, avec son printemps éternel, n'eût été qu'une Sibérie monotone à côté de cette île enchantée. On pouvait y acclimater toutes les invraisemblances physiques et idéales. Sir Olliver crut s'apercevoir que les fleurs et les fruits s'envolaient d'eux-mêmes des arbres par un raffinement de grâce qui rendait les récoltes faciles. Il allait même consigner ce singulier phénomène sur ses tablettes, quand il reconnut que ces fleurs et ces fruits avaient des plumes, et n'étaient pour les arbres que des ornements postiches. L'île était une volière. Chaque arbre ressemblait à un de ces monuments domestiques que les naturalistes affectionnent, et qui portent sur leurs branches des oiseaux empaillés. Comme il allait entrer dans une prairie, un objet, assez semblable à un chapeau de paille d'Italie, orné de plumes, s'élança tout à coup, comme si un tourbillon l'eût enlevé de la tête d'une élégante lady, et disparut dans les airs. Sir Olliver, mis en défiance et commençant à douter de tout, n'osa pas écrire ce qu'il avait vu, et s'en félicita quelques instants après, quand il eut acquis la preuve que ce soi-disant chapeau était un véritable oiseau de paradis, hôte ordinaire et merveilleux de l'archipel Arrou.
Un ruisseau traversait la prairie; l'Anglais, mis en humeur poétique, lui donna le nom de ruisseau d'Ophélie, et, après en avoir avalé quelques gouttes puisées dans le creux de sa main, il trouva une petite saveur salée à cette eau limpide, et décida qu'il installerait, sur ses bords hygiéniques, un petit établissement thermal pour lui tout seul.
Par une hallucination, au moins aussi étrange que celle dont il avait été dupe quelques instants auparavant, sir Olliver crut remarquer, dans le courant du ruisseau, un petit objet brun et oblong, qui ressemblait à s'y méprendre à un cigare de la Havane. Mais l'invraisemblance était trop choquante, pour qu'un esprit, ennemi du fantastique, s'arrêtât à la discuter. Sir Olliver continua donc sa promenade, sans mentionner que les ruisseaux de cette île charriaient des cigares.
Il marchait au milieu d'un concert; les oiseaux chantaient; et, quoiqu'ils ne commissent aucune faute d'harmonie, l'Anglais prenait plaisir à les écouter et les admirait autant que s'ils eussent chanté faux. Il crut distinguer pourtant une note étrange et presque humaine dans ce concert. Quelque chose d'assez semblable à un éclat de rire s'élevait par intervalles.
—Encore une illusion! pensa sir Olliver, qui se mit à chercher quel instrument ailé le gratifiait de cette note fantastique, de ce rire en dièse ou en bémol. Il remarqua un magnifique perroquet qui se dandinait dans un hamac naturel formé par une liane entre deux arbres, et il fit honneur à cet artiste de l'éclat de rire en question.
—C'est bizarre, dit l'Anglais; les perroquets imitent, mais ne devinent pas; qui donc a pu révéler à celui-ci, dans cette île déserte, les secrets du rire, et du rire européen, car je ne suppose pas que les insulaires du voisinage se permettent de rire comme des Anglais, et même comme des Français? Voilà du moins un fait curieux et bon à noter. Aussitôt, tirant ses tablettes, sir Olliver écrivit à la première page: «Les îles de l'archipel Arrou produisent des perroquets d'une espèce toute particulière, dont le cri ressemble, à s'y méprendre, à l'éclat de rire humain.»
Voici une note dont mon savant ami, sir John Simpson, membre de la Zoological society, saura faire son profit.
Et, enchanté de cette première conquête dans son île, plaçant avec respect ses tablettes dans une poche de côté tout près de son cœur, sir Olliver se livra aux méditations philosophiques qui suivent d'ordinaire les grandes victoires.
Est-ce le perroquet qui imite l'homme, ou bien est-ce l'homme qui a imité le perroquet? se demanda-t-il. Grave question! L'homme est la synthèse de tous les animaux. Par tous ses instincts et par toutes les variétés de ses formes, il peut ressembler à tous les êtres de la création. Il est la seule créature qui ait autant de types que d'individus. Le rire aura été une imitation de sa part. Mais est-ce bien le perroquet plutôt qu'un autre oiseau qu'il a imité? Le rire! autre problème! Les pleurs sont logiques; ils soulagent ceux qui ont le bonheur de pleurer. Mais le rire est absurde et contre nature; il peut faire mal, et rarement il fait du bien. On meurt de trop rire; on ne meurt pas de trop pleurer. Le rire est méchant comme il est malsain. Les idiots, les enfants, les fous rient toujours. L'homme bon transige et sourit seulement. Les poëtes comiques sont presque toujours des misanthropes. Machiavel était un poëte comique. Le rire est la marque de la déchéance humaine. Les Grecs, qui avaient le culte de la beauté, le sentiment de la dignité extérieure, ne faisaient jamais rire le marbre: ils savaient que le rire est une grimace. Les Français, qui sont plus méchants et qui ont moins de dignité que les Anglais, rient toujours. Moi, je ne ris jamais, et.....
Sir Olliver, absorbé dans ses méditations humoristiques, lesquelles étaient aussi complétement dépourvues de sentiers, de lignes droites, de chemins tracés que les solitudes vierges de son île, s'égarait doublement, et, la tête baissée, marchait au hasard dans les grandes herbes, quand il lui sembla que, par un phénomène au moins aussi extraordinaire que celui du rire entendu dans les arbres, son ombre projetée au loin et détachée de lui s'avançait gravement à sa rencontre.
Ai-je oublié de dire que sir Olliver était trop au courant de la mode pour n'avoir pas la vue un peu basse, et pour ne pas ajouter, dans les cas pressants, un appendice vitré à son œil? Mais, pendant qu'il cherchait cet appendice, il avait eu le temps de s'imaginer que c'était peut-être un habitant méconnu de cette île trop peu déserte qui venait au-devant de lui. Un coup d'œil rectifié par son lorgnon dérangea cette conjecture: l'ombre en question avait une apparence européenne.
Sir Olliver n'était pas curieux. Il redoutait d'ailleurs des déceptions. Il tourna le dos au phénomène pour n'avoir pas à le juger. Mais voici que l'ombre se mit à courir après lui, enjambant les hautes herbes, et le bruit de sa course détruisant toute supposition d'impalpabilité, force fut à sir Olliver de se retourner brusquement d'un air furieux pour demander compte de cette poursuite.
L'Anglais se trouva nez à nez avec un charmant jeune homme, au teint un peu pâli, aux yeux un peu retirés dans l'orbite, à la figure intelligente et fine, vêtu d'un costume de voyage qui manquait plutôt de fraîcheur que d'élégance.
Ce nouveau venu, s'il était un indigène, ne pouvait avoir germé dans cette île qu'après un vent invraisemblable, qui avait transporté de Paris et du boulevard des Italiens un échantillon de la fleur des pois français sur la terre des antipodes.
—Que me voulez-vous? demanda sir Olliver, du ton le plus froid et le plus dédaigneux qu'il put trouver.
—Rien qu'un peu de feu pour allumer mon cigare, repartit le jeune homme en souriant, et dans le plus pur idiome français.
Pour le coup, il faut le confesser, sir Olliver ressentit quelque chose qui ressemblait à une émotion. Mais ce qui le surprit profondément, ce ne fut pas cette rencontre dans une île de l'archipel Arrou, à quelque distance de la Nouvelle-Guinée, d'un Parisien, d'un naufragé comme lui; il se prémunissait trop contre les grands efforts pour en sentir l'atteinte; mais son stoïcisme, son flegme britannique étaient vaincus par ce Robinson rival, qui, au lieu de courir à lui, dans les transports de rigueur en pareille circonstance, de l'embarrasser d'une embrassade, et de lui jouer la scène de sentiment qu'il attendait, le saluait, comme s'il l'eût abordé sur l'asphalte et lui demandait du feu.
Sir Olliver, je le répète, s'avoua à lui-même qu'il n'était pas indifférent à ce détail; mais il ne voulut pas être en reste d'originalité, et, secouant la cendre de son cigare, il offrit en silence du feu, et attendit, sans desserrer les dents, que le cigare de l'inconnu fût allumé, reprit le sien, salua, tourna le dos, et continua sa route.
A peine avait-il fait quelques pas, qu'il entendit derrière lui un éclat de rire à roulades fort semblable à celui qu'il avait noté sur ses tablettes.
—Voilà mon perroquet, se dit sir Olliver un peu confus; je comprends aussi pourquoi les ruisseaux de mon île charrient des cigares. Est-ce qu'au lieu d'être à quelques brasses des Papous, je serais dans un bosquet de Mabille?
Le Français avait rejoint l'Anglais.
—Pardon, monsieur, lui dit-il, en continuant à rire, je ne vous laisserai pas me quitter de cette façon-là. Nous sommes destinés à vivre ou à mourir ensemble; il serait bon de nous entendre.
—Je ne vous connais pas, dit sir Olliver avec le plus beau sang-froid.
—Je le sais bien; c'est précisément pour cela que nous devons faire connaissance. Quant à vous, monsieur, je vous connais.
—Vous me connaissez!
—Oui, vous êtes un Anglais; vous voyagez pour votre désagrément; vous avez fait naufrage, et vous attendez l'omnibus, je veux dire un navire pour continuer vos excursions.
Sir Olliver fut profondément surpris. Il eût bien voulu répliquer par une réponse aussi pénétrante; mais, outre qu'il se sentait embarrassé pour formuler un jugement sur l'inconnu, il éprouvait quelque répugnance à prolonger l'entretien avec une personne qui ne lui avait pas été officiellement présentée. L'étranger sembla deviner ce qui se passait dans l'âme de l'Anglais.
—Monsieur, lui dit-il, permettez-moi de vous présenter, dans ma personne, Stanislas Robert, un peintre de paysage, dont le talent n'est pas encore assez connu pour avoir franchi les mers. Vous m'excuserez de ne recourir à aucun introducteur. Mais si vous voulez m'en indiquer un dans cette île qui ait quelque crédit auprès de vous, je m'empresserai de mettre sous sa garantie l'amitié que je vous offre.
Le jeune homme, en parlant ainsi, saluait d'un ton demi-sérieux qui eût désarmé l'Anglais le plus entêté.
Sir Olliver jugea qu'il avait fait aux convenances tous les sacrifices nécessaires, dans une position tellement excentrique. Il se résigna donc à accepter le compagnon que le sort lui envoyait, et ce fut avec galanterie qu'il lui tendit la main. Sir Olliver avait ressenti d'ailleurs une émotion, et, quelle qu'elle fût, il lui devait de la reconnaissance. C'était pour la témoigner qu'il se montrait facile dans ses relations.
—Eh bien! monsieur Stanislas Robert, dites-moi par quel hasard vous êtes dans mon île? demanda sir Olliver avec une dignité de cacique, tempérée par un sourire de gentleman.
—Votre île! pardon, monsieur; mais il faudrait savoir quel fut le premier occupant.
—Oh! oh! nous ne sommes que deux, nous ne nous connaissons que depuis une minute, et voilà déjà une guerre entamée. Horrible humanité!
—Une guerre qui finira bientôt sans effusion de sang, mais avec effusion d'amitié, si vous voulez bien accepter des arbitres pour vider le débat.
—Comment? des arbitres! demanda sir Olliver.
—Sans doute, reprit le jeune Français, nous ne sommes pas seuls dans cette île.
—Nous ne sommes pas seuls? s'écria l'Anglais véritablement ému; puis après un silence:
—J'aurais dû m'en douter, continua-t-il avec découragement. Je n'ai pas de chance; et la seule île déserte que je découvre est une île peuplée.
Je puis affirmer que sir Olliver en voulait beaucoup au capitaine Michel dans ce moment, et s'il avait pu quitter l'île immédiatement, il n'eût prolongé ni l'entretien ni la promenade. Mais, bien qu'il fût excellent nageur, sir Olliver ne pouvait raisonnablement songer à s'échapper à la nage. Comment d'ailleurs s'y fût-il pris pour emmener ses provisions et son chalet? Or, il lui paraissait aussi impossible de renoncer à ses espérances de confort, qu'il lui semblait dur de renoncer à ses espérances d'émotion.
Nous allons voir que sir Olliver calomniait le hasard, en lui reprochant de gâter ses impressions de voyage!
—A quel chiffre monte la population de l'île? demanda l'Anglais avec un effort visible.
—Oh! rassurez-vous, monsieur, reprit Stanislas Robert, il n'y a pas encore d'encombrement: vous serez le septième personnage et le quatrième homme de la colonie.
—Comment! il y a des dames?
—Oui, monsieur, et comme aucune d'elles ne m'a donné le droit d'avoir de la modestie pour son compte, je puis avouer qu'elles sont toutes les trois fort jolies.
—Quelle île déserte! murmura sir Olliver.
—Ayez un peu de patience, nous ne sommes pas ici pour longtemps. Un accident arrivé au vaisseau qui nous transportait vers l'Australie a contraint le capitaine à nous déposer pour quelques jours dans cette île charmante; mais il doit nous envoyer chercher, et vous pourrez, monsieur, reprendre le cours de vos méditations solitaires.
L'Anglais comprit qu'affecter l'amour de la solitude quand il devenait impossible d'en jouir, c'était fournir un prétexte à des railleries. Il avait déjà été mystifié par le capitaine Michel. S'exposer à de nouvelles épigrammes, c'était évidemment justifier le guignon qui s'acharnait après lui; d'ailleurs, la pensée que des dames, fort jolies, comme le disait le jeune peintre qui devait s'y connaître, partageaient son sort, et étaient obligées de mettre aussi en action la morale de Robinson Crusoé, le faisait sourire.
—Eh bien, monsieur, dit-il presque gaiement à son interlocuteur, veuillez me présenter à ces dames et à ces messieurs.
—Très-volontiers, reprit Stanislas, qui s'empara du bras de l'Anglais et le conduisit vers un point du rivage que sir Olliver n'avait pas encore eu le temps d'explorer.
Sur une pelouse qui datait sans doute du premier printemps de la terre, mais qui n'en était pour cela ni moins verte, ni moins jeune, ni moins touffue, et qui, ayant échappé à la culture des hommes, avait toutes les perfections désirables; à l'ombre de beaux arbres, dont je me dispenserai (pour cause) de vous donner les noms scientifiques, et qui n'avaient peut-être pas de noms, puisqu'ils semblaient une grâce, un privilége exclusif de cette île enchantée, les naufragés annoncés par le jeune peintre étaient installés d'une façon pittoresque, et composaient un tableau, une sorte de Décaméron sur l'herbe qui, fort heureusement, échappera au pinceau de M. Winterhalter, mais qui, hélas! a peut-être inspiré M. Stanislas Robert.
Trois jeunes femmes, bien différentes de physionomie, mais ayant toutes les trois cette douce analogie de la jeunesse et de la beauté, étaient assises dans des attitudes rêveuses.
L'une, modestement vêtue, paraissait en deuil, et effeuillait des fleurs qu'elle jetait ensuite sans leur demander un oracle. Une autre, qu'à la figure brunie et à la flamme de ses yeux on reconnaissait pour une Espagnole, semblait absorbée par quelque important calcul. Le menton dans la main, et le coude appuyé sur le genou, elle regardait devant elle avec une fixité presque terrible. Quant à la troisième, elle n'était pas si plongée dans sa mélancolie qu'elle n'eût assez de sang-froid pour employer ses loisirs à l'occupation la plus étrange qu'on pût attendre d'une naufragée. J'ai honte de l'avouer, elle chiffonnait des dentelles et se préparait un bonnet.
Des écharpes, des ombrelles, des chapeaux de paille étaient jetés à quelque distance, et des débris attestaient, non loin de là, que les nouveaux habitants de l'île n'avaient pas encore eu besoin, pour leur nourriture, de recourir aux procédés sommaires des sauvages.
Près du groupe des trois femmes, deux jeunes gens s'entretenaient à demi-voix, en fumant, l'un dans une énorme pipe de porcelaine, et l'autre une cigarette.
—Voilà, monsieur, toute la population de l'île, dit le peintre en montrant de loin ces cinq personnes.
Sir Olliver avait pris un lorgnon et regardait avec le sang-froid d'un amateur de tableaux, légèrement blasé.
—Il ne nous manque absolument qu'un échantillon des habitants du voisinage pour que la collection soit complète, continua Stanislas. Voici la sentimentale Allemande, la brune Espagnole, la piquante Française, comme dans les gravures d'auberge. Vous avez dû rencontrer ces trois portraits-là partout.
—Oui, mais je ne m'attendais pas à les trouver ici.
—Ne vous plaignez pas, et avouez qu'on ne saurait les mettre dans un plus joli cadre. Quant à ces deux messieurs, l'un, celui qui a une casquette de toile cirée, est un blond enfant de la blonde Allemagne; il regrette la bière, mais vous saurez plus tard pourquoi il prend son mal en patience. L'autre est un Italien qui avait si peur des présents de l'Autriche, qu'il les fuyait jusqu'en Australie. Maintenant, monsieur, permettez-moi de vous présenter.
L'aspect de deux personnes, au lieu d'une seule qu'on attendait, fit pousser une exclamation en chœur aux cinq naufragés. Mais avant que leur étonnement eût pu se manifester par des questions, Stanislas s'était avancé et avait pris la parole.
—N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, dit-il en riant; monsieur était un peu sauvage, mais je l'ai apprivoisé.
Les trois dames s'étaient levées, les deux fumeurs s'étaient rapprochés; on se salua avec des sourires; les circonstances de la rencontre étaient si extraordinaires, qu'on eût passé volontiers par-dessus les formules de la présentation officielle; mais Stanislas connaissait son Anglais.
—Mesdames, reprit-il avec la gravité d'un chambellan, je vous présente le roi de cette île; c'est à lui que vous devez l'hospitalité.
—J'ai abdiqué, interrompit sir Olliver.
—Oh! vous avez des droits et nous les respectons, continua le peintre; d'abord, vous êtes Anglais: toute île nouvellement découverte doit vous appartenir. Et puis, vous êtes seul de votre parti: vous avez au moins l'unité de vues et d'action. Nous, nous sommes une bigarrure; je craindrais l'anarchie: c'est nous qui abdiquons, n'est-ce pas, mesdames?
L'Allemande ne paraissait pas comprendre la plaisanterie.
L'Espagnole souriait avec une petite coquetterie fière et dédaigneuse.
Quant à la Française, elle répondit:
—Il faudrait d'abord savoir quelle constitution monsieur veut nous donner.
—Voilà bien une échappée de Paris, s'écria Stanislas sur le ton d'une indignation comique. Je vous préviens, belle dame, qu'il n'y a pas ici de principes de 89.
—Qu'en savez-vous? repartit la Française, en riant aux éclats.
—Au fait, il ne serait pas plus invraisemblable de les trouver affichés au coin d'un bois, qu'il ne l'était de rencontrer monsieur.
—Et puis je tiens à savoir si les rois de cette île ne sont pas des anthropophages.
—Oh! pas si anthropophages que vous, belle coquette, repartit lestement le peintre. Monsieur est un souverain constitutionnel; quand il lui arrive de croquer ses sujets, c'est par respect pour l'opinion autant que par galanterie pour ce qui est à croquer.
—Prenez garde à vous, madame, dit sir Olliver qui s'amusait de la plaisanterie.
—Maintenant, sire, permettez-moi, continua Stanislas, de vous présenter vos sujets par province: voici l'Allemagne avec deux députés, madame Carolina Brenner, jeune veuve de vingt ans qui a été piquée par une aiguille à tricoter de madame Ida Pfeiffer, et qui fait le tour du monde pour utiliser son veuvage, et instruire M. Frantz, ici présent. Voici la plus loyale et la plus candide figure de philosophe allemand qui ait jamais apparu à travers les nuées du tabac. Ne rougissez pas, Frantz; et vous, sire, quand vous aurez besoin d'un ministre de la logique ou de l'esthétique, prenez monsieur. Voici madame Julie Vernier, autre veuve, mais Française, dont l'esprit vous a déjà sauté aux yeux et à la gorge. Madame a un grand défaut que j'ose confesser en son nom: elle dépoétise les rossignols, et chante de façon à les humilier. Elle sera la prima donna de votre théâtre royal. J'ignore le nom que Votre Majesté a donné à cette île.
—Je l'ai appelée l'île des Rêves.
—Joli nom!... mais qu'il faut changer contre celui d'île des Veuves, car madame Dolorida Mendez est aussi une veuve...
—Pas encore! interrompit l'Espagnole avec un singulier soupir.
—Oh! comme vous avez bien dit cela! mais ce pas encore prouve toute la justesse de mes paroles. Vous êtes veuve par les élans du cœur, señora, et par la distance. Je me souviendrai de votre pas encore! Voici mon ami Ottavio. Celui-là est un proscrit volontaire; il subit le plus dur, le plus cruel des exils, celui dont on ne peut pas revenir, et que la conscience impose; il est veuf, mais sa fiancée n'est pas morte, n'est-ce pas, mon Roméo? Elle l'attend silencieuse, dans sa prison, dans son tombeau; quelque jour peut-être, une épée française se glissera sous ce marbre et le soulèvera. J'irai à ta noce, mon ami Ottavio, ajouta Stanislas d'une voix émue et en serrant la main de l'Italien.
—Je ne comprends pas, dit l'Anglais.
—Ce sont les traités de 1815 qui vous empêchent de comprendre, s'écria la jeune veuve française avec un petit air mutin le plus charmant du monde.
—Quelle jolie déesse de la liberté vous faites! dit Stanislas en saluant madame Vernier; vous, monsieur, ajouta-t-il avec gravité, vous comprendrez Ottavio quand vous l'aimerez, c'est-à-dire dans une heure. Voici donc la présentation au complet. Quant à vous, monsieur, je vous ai deviné, n'est-ce pas? Anglais convaincu de spleen! Soyez le bienvenu dans notre colonie. Nous sommes tous, plus ou moins, des naufragés du vieux monde; chacun de nous est à la recherche d'une espérance, et porte le deuil d'une illusion. Vous avez bien nommé cette île; nous y rêverons à la fortune, à l'amour, à la liberté! Nous allions en Australie, le pays de la réalité; mais notre vaisseau s'est égaré et avarié en flânant en route; le capitaine a mieux aimé nous déposer ici qu'au fond de la mer. C'est une attention délicate que vous n'apprécierez peut-être pas, mais dont nous sentons tout le prix. Dans cinq ou six jours, on revient nous prendre. Vous serez libre alors de nous suivre; jusque-là vous représenterez l'Angleterre dans ce naufrage universel; et quand l'heure des confidences sera venue, vous nous direz vos chagrins si vous en avez; car les plus malheureux sont souvent ceux qui n'ont rien à pleurer.
—Je vous remercie, dit l'Anglais. Si je pouvais être guéri, je vous choisirais comme médecin.
—Bah! il n'y a pas de médecin ici; il n'y a que des malades. Nous nous guérirons mutuellement, et, pour commencer, je vous ordonne de dresser votre tente à côté de la nôtre; nous allons procéder à votre emménagement.
Sir Olliver était subjugué, moins par la rondeur un peu familière de l'artiste que par l'excentricité de la situation. Qui sait même si un magnétisme dont il n'avait pas conscience ne commençait pas à agir? Ces trois jeunes femmes avaient chacune un charme différent, qui empruntait à la liberté de la solitude une rapidité et une puissance d'action décisives.
L'Allemande, avec sa candeur pensive, avec sa douce tristesse, était peut-être, des trois fées, la moins redoutable pour le repos futur de sir Olliver. Mais l'Espagnole, avec ses grands yeux jaunes, avec ses lèvres de pourpre, avec ses dents blanches, avec l'accent dramatique qu'elle avait mis à dire son fameux: pas encore; mais la Française, avec son esprit, sa vivacité, ses reparties, ses provocations politiques, avec ses yeux pleins d'étincelles et son rire sonore, semblaient défier l'ennui, et sir Olliver, s'il aimait à s'ennuyer, aimait aussi à recevoir des défis.
Les préliminaires de la connaissance une fois terminés, les renseignements une fois échangés sur les ressources que chacun pouvait offrir à la communauté, il fut convenu que le chalet de sir Olliver serait dressé et offert à ces dames comme un sanctuaire; que ces messieurs dormiraient à la belle étoile; et qu'on ne ferait pas à cette île des Rêves l'injure de se plaindre des réalités blessantes qu'une connaissance un peu plus approfondie pourrait faire découvrir. On avait des provisions, des costumes et du beau temps; que pouvait-on souhaiter?
Les six voyageurs étaient arrivés deux jours avant sir Olliver. La topographie de l'île n'avait donc plus rien d'inconnu pour eux, et ils se hâtèrent, à force de renseignements, d'ôter toute envie à l'Anglais de continuer ses promenades de découvertes. La journée se passa dans des projets. On eût dit que des années devaient s'écouler dans l'Archipel. Chacun arrangeait, attifait le paysage à sa guise. C'était à qui baptiserait d'une épithète la montagne, la prairie, l'arbre de droite, le buisson de gauche. On adopta officiellement le nom d'île des Rêves, quoiqu'il parût légèrement prétentieux au peintre et à la jeune Française, peu enclins, par nature et par profession, à la mélancolie. Tous les idiomes payèrent leur tribut. On proposa d'élever un monument, d'entailler les arbres, de graver les noms sur le roc; on se proposa tant de choses, on voulut songer à tant d'entreprises, que, vers le soir, le chalet seul était dressé. Mais alors on reconnut avec stupéfaction que cette maison était une simple guérite, et qu'il était impossible d'y loger plus d'une personne.
—Ce sera le palais du roi, dit Stanislas; sir Olliver, nous vous le rendons.
—Je refuse, repartit l'Anglais; j'y mets seulement les archives et les provisions du royaume.
La nuit vint, une nuit de féerie; les étoiles semblaient rire dans le ciel; la lune chuchotait de mystérieuses harmonies. Les dames disparurent derrière les arbres, qui parurent s'ouvrir pour les reprendre, comme des dryades échappées. Les hommes ne s'endormirent que très-tard. Une confiance sereine, une simplicité touchante veillaient sur cette société si divisée, mais qu'un accident inouï condamnait à la vie en commun.
—O Icarie! s'écria le peintre avant de croiser ses bras pour se coucher sur l'herbe, voilà ton paradis! Je me sens chaste et heureux comme dans une utopie.
—Oh! si le capitaine Michel pouvait me voir! dit sir Olliver, qui se sentait prendre par cette intimité décente et complète.
L'Allemand ne s'étonnait pas. L'Italien soupirait. Ce beau pays désert le faisait penser à sa belle patrie.
—Dormez, mon bon Ottavio, dit le peintre en lui serrant la main. Vos amis de là bas vous attendent dans le sommeil.
L'Italien secoua la tête et s'enroula dans son manteau.
Le lendemain, chacun s'éveilla avec gaieté. Sir Olliver lui-même se creusa la tête pour être triste, et fut désolé de ne pas trouver le moindre prétexte de mauvaise humeur. Il y avait dans l'atmosphère, dans l'entourage, dans la société elle-même, une bonne volonté de vivre, un épanouissement de jeunesse, un hymne de santé, qui dispersaient les papillons noirs, les brumes de la Tamise, les mélancolies du Rhin, la mal'aria romaine. L'étrangeté de la situation non-seulement autorisait toute infraction aux habitudes européennes, mais semblait même imposer l'obligation, le devoir de ne rien faire qui établît une opposition choquante, inharmonieuse entre la liberté qu'on respirait dans l'île et les allures des nouveaux habitants.
—Qu'allons-nous faire aujourd'hui? demanda le peintre en abordant les dames qui sortaient de leurs bosquets de nuit.
—Nous allons, pour notre part, faire un peu de toilette, répondit madame Julie Vernier.
—Je m'y oppose, répliqua Stanislas, parce qu'alors sir Olliver mettra des gants, Frantz des manchettes, Ottavio un jabot, et que je perdrai mon rang de citoyen dans une société si raffinée. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que nous sommes encore trop vêtus pour la mode du voisinage.
—Mais nous ne suivons pas la mode, répliqua la Française.
—Ne suivons donc pas les usages, repartit le peintre. Mesdames, j'ai une proposition solennelle à vous faire. Il est de tradition classique que des naufragés se racontent leurs aventures. Depuis l'Odyssée, Télémaque, Robinson Crusoé, aucun échappé de l'onde amère n'a failli à cette loi essentielle. Jurons tous de nous y conformer.
—Pour un homme qui veut rompre avec les usages, voilà une singulière proposition, dit Frantz le sentencieux.
—Mon cher philosophe, je suis homme, et aucune contradiction ne m'est étrangère. D'ailleurs, il s'agit d'une tradition poétique et excentrique, et non pas d'un usage banal des peuples civilisés qui se disputent et ne racontent plus.
—Monsieur, vous êtes un indiscret, dit la señora Dolorida, c'est une façon de nous demander des confidences.
—On sera libre d'inventer; et, pour ma part, je jure de mentir.
—Mesdames, je vous avertis que M. Stanislas a une histoire à nous raconter, dit la jeune Française.
—Il devait le déclarer tout de suite, reprit la señora Dolorida.
—J'avoue, avec la candeur que cette île autorise, que j'ai en effet une histoire manuscrite...
—Un manuscrit! murmura Ottavio qui écoutait en souriant; c'est grave!
—C'est une préméditation, ajouta l'Anglais.
—Un manuscrit! Voyez-vous Camoens sauvant son manuscrit du naufrage! repartit l'Espagnole.
—Je crois que nous n'avons guère la ressource d'échapper à la lecture du manuscrit, dit Frantz.
—Est-elle amusante votre histoire? demanda la Française.
—Est-elle courte? demanda l'Anglais.
—Est-elle émouvante? demanda l'Espagnole.
—Est-elle véridique? demanda l'Allemande.
—Mesdames et messieurs, elle est tout cela, et plus encore; elle est morale, authentique, mais légèrement ornée de mensonges d'ailleurs, de dimension supportable. Je ne vous dissimulerai pas que j'attache d'autant plus de prix à vos suffrages que, si j'obtiens un succès, j'exigerai que chacun s'exécute comme je me serai exécuté. Si, au contraire, je surprends le plus léger bâillement, je vous mettrai au défi de m'amuser à votre tour.
—De sorte que, de toutes les façons, nous n'échapperons pas à l'impôt? demanda madame Vernier.
—C'est un Décaméron forcé, reprit en riant le jeune peintre.
—Mais je consens à poser cette condition: on ne sera pas forcé d'entendre plus d'une histoire par jour.
—Et quand chacun de nous aura débité son histoire? dit Ottavio.
—Eh bien, repartit Stanislas, chacun de nous recommencera à son tour, jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau.
—Vous allez me faire désirer le retour du Cyclope, s'écria sir Olliver.
—Oh! monsieur, vous êtes méchant!
—Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi.
—J'ai bien envie, sir Olliver, de faire violence à votre modestie et de vous contraindre à commencer?
—Oui! oui! sir Olliver, commencez, dit-on de toutes parts.
—Rien ne manque à ma royauté, répondit l'Anglais en souriant gravement, voici déjà les insurrections. J'attends qu'on me détrône.
—Vous savez bien qu'on ne peut pas vous chasser hors du royaume, dit l'énergique Dolorida.
—C'est vrai! aussi je cède et je promets...
—Ah! ah! une histoire! Une histoire! s'écrièrent tous les sujets en sextuor.
—Je promets solennellement de me rendre aux vœux des populations quand le moment sera venu, et quand les vœux me sembleront librement exprimés.
—Ce n'est pas cela!
—Vous trichez!
—C'est une perfidie!
—Non! c'est une promesse constitutionnelle!
—Alors, s'écria Stanislas, nous agirons comme si vous n'aviez rien promis; mais nous voulons que l'archipel soit témoin de ce faux serment. Vous jurez?
—Je jure!
—C'est bien, vous êtes digne de régner sur nous. Plus tard, nous vous renverserons. Quant à moi, je suis prêt à commencer mon récit... Il reste à savoir s'il vaut mieux que vous m'écoutiez avant qu'après la sieste.
—J'aimerais mieux pendant la sieste, dit l'Espagnole.
—Ce serait une lutte inégale pour moi. Déjeunons, dormons, et quand l'ombre des tamarins s'allongera dans la prairie, comme disent les historiens de la nature, je vous convoquerai et je vous lirai mon histoire.
—Votre histoire? demanda l'Anglais.
—Je veux dire, sir Olliver, l'histoire que j'ai écrite, mais dont je ne suis pas le héros.
On convint de l'heure et du lieu du rendez-vous; et cette grave affaire délibérée, la colonie se livra aux soins poétiques de son ménage idéal. Puis, quand le soleil fut aux deux tiers de sa course, on se réunit, non loin de la mer, sous de frais ombrages. Les dames, sans se concerter, avaient apporté chacune un peu de coquetterie dans leur toilette. Le regard a des distractions pendant une longue lecture, et madame Julie Vernier avait déjà remarqué que sir Olliver la regardait souvent.
La señora Dolorida s'était livrée aux mêmes réflexions touchant Stanislas Robert, et elle avait mis dans ses cheveux une fleur d'un rouge admirable, qui devait inquiéter et interrompre le lecteur. Quant à madame Carolina Brenner, elle s'était couronnée de longues herbes qui lui donnaient l'aspect d'une muse ou d'une naïade.
On se coucha sur le gazon. La mer, bleue et unie, s'étendait au loin. Par un regard rapide, dont nul ne fit confidence à son voisin, chacun des assistants plongea dans l'horizon, mais n'eut pas l'air désappointé de n'y distinguer aucune voile.
Stanislas Robert, plus hardi que les autres, osa seul exprimer tout haut le sentiment secret des assistants.
—Ah ça! personne ne viendra m'interrompre, dit-il, et faisant à son regard un abri avec sa main il examina la mer et tous les sommets de l'île.
—Nous sommes bien seuls, je puis commencer.
Un grand silence se fit; Ottavio roula une cigarette; sir Olliver mit son lorgnon dans l'œil pour mieux entendre, et le peintre déroula son manuscrit.
—Je vous épargne la préface, dit-il. Je ne vous dirai pas encore pourquoi j'ai écrit cette histoire. Supposez, si vous voulez, que la crainte de mal vendre en Australie mes tableaux champêtres m'a fait choisir pour mes voyages une profession accessoire qui n'exige fort heureusement ni étude, ni préparation, ni patente, et que, pensant trouver des journaux dans cette mine d'or où l'on commence à se faire la guerre, j'ai préparé en route ce roman qui traite de la question financière et de la question de sentiment, pour plaire aux lectrices de ce vilain monde.
—Mais c'est une préface en règle que vous nous débitez là, s'écria madame Vernier.
—Parbleu! puisque je vous prévenais que vous n'en auriez pas.
—Et une préface sournoise, qui ne dit pas la vérité...
—Comme toutes les préfaces.
—Ah! traître, vous êtes un écrivain!
—Suspendez votre jugement jusqu'à la fin de mon histoire.
Et Stanislas toussa trois fois, prépara sur ses genoux les feuillets de son manuscrit, et d'une voix flûtée, insinuante, qui voulait capter l'auditoire, il commença ainsi:
Si l'on refaisait la carte du Tendre, il faudrait aujourd'hui placer la route de la Californie ou de l'Australie entre les villages de Billets doux et de Petits soins. La crise monétaire est la seule crise de sentiment qui fasse vibrer les nerfs de la génération actuelle.
Peut-être bien que Chatterton, s'il était égaré dans la cohue de nos boulevards, ne viderait plus aujourd'hui la fiole vengeresse, parce que le lord-maire lui offrirait une place de valet de chambre. Il n'y a plus aujourd'hui de sot métier; seulement, Chatterton aimerait beaucoup mieux servir un financier qu'un magistrat; il aurait beaucoup plus de chance d'être initié au grand œuvre contemporain, et il pourrait s'exercer à quelques petites opérations, que les poëtes de la génération courante ne dédaignent pas absolument. Quant à la livrée, elle n'offense plus personne; beaucoup de gens en portent sans s'en porter plus mal.
L'amour honnête, décent; l'amour, cette folie des vieux, cette sagesse des jeunes, a-t-il du moins échappé à la contagion? Reste-t-il un coin du ciel bleu où l'oiseau divin puisse déployer ses ailes et chanter? Rien n'est perdu, si l'amour est sauf. Je crois, à parler sans exagération, que tout est compromis, mais que rien n'est désespéré, parce que rien ne peut l'être.
Si Roméo cherche à voir dans le porte-monnaie de Juliette, si une question de chiffres sépare et rapproche les Montaigus et les Capulets, si la lune des amours est argentée par le procédé Ruolz, si une défiance est au fond de toutes les expansions, une vénalité au fond de la plupart des services, une raillerie sous la plupart des joies, ces misères, ces folies, ces ridicules, ces préjugés, passeront, comme toutes les imperfections humaines; l'amour et l'idéal ne passeront point.
Ces réflexions, que vous trouverez un peu solennelles, ne sont pas éloignées de celles que faisait un vieillard, arrêté, par un beau soir d'automne, au milieu des ruines de l'ancien château de Bade.
Assis sur l'une des marches d'un escalier interrompu, adossé au tapis de lierre qui montait le long de la muraille, ce vieillard, pâle et malade, promenait ses regards sur les magnificences de végétation qui envahissaient les débris. Il semblait envier cette persistance de la vie, qui jaillissait et s'épanouissait au sein de la mort, et, tendant quelquefois sa main momifiée aux rayons du soleil, il se disait, en hochant la tête, que l'homme, avec la conscience de l'immortalité, avait la cruelle certitude de sa destruction.

Il contemplait devant lui, à ses pieds, la ville de Bade, où tant de fous, atteints de la maladie de l'ennui, viennent essayer de guérir et risquer de se tuer; les plaines riantes, les montagnes parées d'autres ruines; dans le lointain, rampant sur l'herbe, ce serpent gigantesque qui s'enroule et se déroule si souvent autour du caducée, le Rhin, allemand ou français, et plus loin encore, à l'extrémité de l'horizon, il apercevait vaguement une aiguille, un fil, une ligne qui n'était rien de moins que la cathédrale de Strasbourg.
Cette contemplation était un adieu. Ce vieillard se sentait mourant; mais il avait horreur des moyens qui conservent la vie, autant que de la mort; et plutôt que de s'enfermer au milieu des remèdes, et de disputer ses derniers jours à l'agonie, il allait, il se traînait, il rampait sur la terre, aimant le soleil jusqu'à son dernier soupir, saluant la nature jusqu'à son dernier regard. Il y avait des caresses, des adorations, des sensualités dans la façon dont il buvait la brise. Cet homme était un grand voluptueux, et toutes ses amours se trouvaient résumées dans cette suprême étreinte, dans cette aspiration ardente, avec laquelle il eût voulu pénétrer ses veines de quelques-uns des rayons de l'automne, et sentir battre sur son cœur le cœur du monde.
Comme il était absorbé dans son adoration, il n'entendit pas venir un jeune homme et une jeune femme qui visitaient les ruines, et qui, engagés dans la galerie à l'extrémité de laquelle il était assis, s'arrêtèrent à deux pas de lui, avec respect, n'osant le prier de se déranger, et attendant qu'il tournât la tête de leur côté.
Le soleil tira les promeneurs d'embarras. Comme il baissait à l'horizon, il étendit l'ombre du beau couple sur les genoux du vieillard. Celui-ci fut surpris, regarda les nouveaux venus, balbutia quelques paroles d'excuse, et essaya de se lever. Mais ses forces le trahirent; l'engourdissement du repos avait paralysé ses jambes; il chancela et faillit tomber. Le jeune homme laissa le bras de sa compagne pour offrir le sien au vieillard; la jeune femme elle-même mit sa main finement gantée sous le coude de l'inconnu.
—Merci, murmura ce dernier, en saluant avec émotion.
—Nous ne vous quitterons pas, monsieur, dit la jeune femme.
—Nous vous aiderons à descendre, ajouta le jeune homme.
—Ah! si j'étais poëte, reprit le vieillard avec un sourire, et en levant les yeux au ciel, je croirais à une vision de ma jeunesse! Je rêvais, monsieur, à l'âge où j'étais comme vous, promenant avec orgueil ma joie et mon amour à travers les ruines; à l'âge où j'avais aussi à mes côtés un ange, une fée.....
La jeune femme rougit et baissa les yeux; le jeune homme pâlit.
—Vous ne m'avez pas éveillé, vous avez complété l'illusion de mon souvenir. J'ai presque peur que vous ne me quittiez; on dit que les dieux se font voir à ceux qui vont mourir.
Tout en parlant ainsi, le vieillard s'appuyait sur le couple, descendait, soutenu par lui, l'escalier au sommet duquel il s'était assis.
On fit halte au bas des ruines. Un domestique attendait le vieillard. Celui-ci, malgré les offres du jeune homme et de la jeune femme, voulut quitter leurs bras.
—Ce serait une profanation que de continuer ainsi, dit-il. C'était bon là-haut, dans les décombres; mais vous avez d'autres promenades à faire; je vous ai séparés trop longtemps. Les bras de vingt ans ne sont pas faits pour servir de béquilles. Adieu, madame; au revoir, monsieur.
Les deux jeunes gens insistèrent.
—Non, non, c'est inutile, dit le vieillard. Fritz est assez robuste pour me porter au besoin. Je lui avais défendu de me suivre, j'avais voulu gravir seul ces ruines où j'ai gambadé autrefois. J'ai bien fait, puisque Dieu m'avait ménagé la surprise de votre rencontre; mais aller plus loin avec vous serait abuser. D'ailleurs, je ne voudrais peut-être plus vous quitter... les tombes s'habituent aux fleurs... laissez-moi. Je voudrais seulement (ne vous moquez pas trop) vous demander de me bénir. Dans le monde, on croit que la bénédiction de ceux qui n'ont plus rien à attendre, rien à donner, rien à promettre, peut porter bonheur. On fait bénir l'avenir par le passé. Je crois que c'est aller contre l'harmonie de la nature. Mes jeunes amis, vous qui êtes la beauté, la joie, l'amour, bénissez-moi; j'ai eu de folles et belles années. Il m'est resté, à travers bien des orages, le parfum des premières tendresses: vous, qui êtes l'espérance, bénissez le souvenir.
Le jeune homme et la jeune femme se regardaient attendris, et peut-être un peu honteux des termes dans lesquels s'épanchait l'émotion du vieillard. Pour toute bénédiction, ils lui serrèrent la main, et la jeune femme lui tendit le front.
—Vous n'avez pas peur que mes lèvres gèlent les roses, dit l'inconnu en donnant un baiser paternel.
On se sépara. Le vieillard, appuyé sur son domestique et tournant la tête à chaque pas, regagna la ville.
—Ah! Fritz, disait-il, la belle rencontre! la belle soirée!
Le couple avait repris en silence sa promenade. Il semblait que cet incident eût dérangé quelque chose de son bonheur. Comme on sortait de l'allée qui conduit au vieux château:
—Ce bonhomme est un peu fou, dit la jeune femme avec un accent ironique.
—Pourquoi? parce qu'il a parlé de notre amour? demanda le jeune homme avec un sentiment d'inquiétude.
—Oh! non; car je confesse, Gérard, que vous avez toute l'apparence d'un amoureux.
—Doutez-vous de ma tendresse, madame?
—Allons! encore des reproches! Vous avez l'Allemagne mélancolique, mon cher!
—Et vous, Angèle, vous l'avez bien froide.
—Mais enfin, Gérard, puisque je suis là, à vos côtés, puisque j'ai mon bras sur le vôtre, puisque je dois être votre femme!... N'est-ce pas une preuve, cela?
—Oui, votre présence est incontestable; mais vous n'attendez peut-être qu'une occasion pour repartir. Oui, votre bras est sur le mien; mais c'est à peine si vous vous appuyez. Oui, vous avez tout quitté; mais vous regrettez tout!
—Gérard! Gérard!
—Ah! laissez-moi parler, Angèle, car je souffre cruellement. Il ne sait pas le mal qu'il nous a fait, ce vieillard, en admirant notre joie, notre amour, notre bonheur. J'étais un pauvre artiste; vous m'avez applaudi, accueilli, encouragé; vous étiez, par votre fortune, par votre position, une grande dame, riche, titrée. J'ai pris votre intérêt pour de l'affection. Vous m'avez laissé espérer votre main, par orgueil peut-être, pour défier ce monde qui nous provoquait. Dieu m'est témoin que j'étais bien heureux. Mais, depuis quelques jours, je surprends dans votre amour des scrupules étranges. Vous êtes rêveuse. Un ennemi invisible, mais effroyable, s'est glissé entre nous. J'aurai le courage de le nommer, Angèle, c'est l'ennui; vous vous ennuyez.
—Peut-être! mais seulement quand vous parlez ainsi. Vous êtes fou, Gérard!
—Oui, comme ce vieillard, n'est-ce pas?
—Non, comme un enfant, au contraire. Vous autres, artistes, vous empruntez aux femmes leurs nerfs et leurs vapeurs. Vous êtes d'une coquetterie, d'une susceptibilité incroyables. Vous parlez d'orgueil! le mien baisse pavillon devant le vôtre. Qu'est-ce qui me retient auprès de vous, mon ami? Je suis veuve, je suis libre, j'ai une fortune qui me rend indépendante. Je brave la méchanceté. Si je vous ai suivi, c'est que je vous aimais; si je reste, c'est que je vous aime.
—Est-ce bien vrai, Angèle, ce que vous dites là?
—Non, j'ai menti! Je ne vous aime pas. Allons, Gérard, taisez-vous!
Et la jeune femme mit sa main sur les lèvres du jeune homme. Celui-ci retint vivement cette main, qu'il couvrit de baisers.
Quelques promeneurs aperçurent ce geste.
—Voilà des amoureux, disait-on.
—Que c'est donc bon de s'aimer ainsi!
—Sont-ils mariés?
—Vous voyez bien que non!
Gérard avait besoin de croire aux douces et moqueuses paroles de son enchanteresse.
—Se peut-il qu'on cesse de s'aimer? reprit-il en serrant avec force le poignet de la jeune femme.
Celle-ci poussa un cri.
—Vous m'avez fait mal; vous m'avez écorchée avec le bouton de ma manchette.
—Pourquoi, aussi, portez-vous des diamants au poignet? dit Gérard en embrassant la place meurtrie.
—Le reproche est singulier!
—Pourquoi souriez-vous, Angèle?
—Parce que vous m'avez fait horriblement mal.
—Non, je devine. Vous vous dites que je suis bien ridicule de blâmer un luxe que je ne sais pas donner.
—Ah! mon ami, ce n'est plus à moi que vous pensez en parlant ainsi!
—Laissez-moi m'expliquer, Angèle; d'ailleurs, c'est là le secret de ma jalousie, de ma douleur, de mes doutes incurables! Je suis pauvre, vous êtes riche. Vous, baronne, veuve d'un millionnaire, vous avez quitté un hôtel élégant, des domestiques habiles, un luxe raffiné, pour courir les hasards de l'hospitalité vénale. Je souffre de vous voir ainsi, et j'ai peur que vous ne regrettiez Paris dans les auberges des bords du Rhin!
—Vous êtes jaloux du confortable!
—Je suis jaloux de tout ce que vous méritez et de ce que je suis forcé de vous refuser. Si vous vouliez me permettre, Angèle, de donner un concert...
—Et je recevrais les billets à la porte, n'est-ce pas? interrompit avec fierté la baronne. Ne vous inquiétez pas de ces vulgarités, mon ami. Ce pays est charmant; les hôtelleries y sont propres; je m'y trouve à l'aise; ne souhaitez rien de plus. Nous avons nos deux cœurs; toutes les chaumières peuvent nous suffire.
—Ces vulgarités, mon Angèle, mettent bien des cailloux sous nos pas. Vous n'osez jamais vous plaindre; mais je devine des privations. Ah! pourquoi ne suis-je pas riche!
—Ne vous plaignez donc pas d'un défaut qui m'attache à vous! D'ailleurs, si je vous coûte un peu cher, c'est votre faute: cotisons-nous.
—Encore! ne renouvelez jamais ces propositions, Angèle, je me trouverais déshonoré le jour où votre main, en se posant dans la mienne, y mettrait de l'or.
—Cependant, mon cher, dit la baronne avec un petit sourire, je ne peux pas me ruiner pour vous épouser.
Gérard rougit, garda quelques instants le silence et reprit:
—Pourquoi prenons-nous plaisir à gâter notre bonheur par des défiances?
—Allons, vous voilà raisonnable, répondit Angèle, qui souriait toujours. Qu'importe le reste, quand les cœurs sont unis?... Irons-nous ce soir au bal, mon ami?
—Encore la foule, le bruit.
—Je ne crois pas que la solitude absolue nous réussisse, Gérard!
—Soit! allons à ce bal!
—Et pour vous prouver, mon ami, que je n'ai pas oublié mes habitudes de femme coquette, j'exige un beau bouquet!
—Vous l'aurez.
—Promettez-moi aussi de n'être pas d'une assiduité trop farouche pendant le bal. Ne compromettez pas trop celle qui doit être votre femme.
—Je vous admirerai de loin, mon amie. Mais nous ne sommes pas encore au bal, Dieu merci.
La promenade se continua quelque temps encore; mais une rêverie douce avait succédé aux tendres reproches. La mélancolie du bonheur semblait précéder ce couple charmant et éloigner de lui tout regard indiscret, tout bruit discordant. Le coucher du soleil mettait de l'or à la pointe des herbes que foulaient nos chastes amoureux; la nature coquette des environs de Bade se revêtait de solennité. C'était l'heure des extases et de la poésie universelle. Angèle et Gérard paraissaient subir le charme enivrant de cette soirée.
Or, voici ce que se disait tout bas la baronne:
—Certainement, j'aime beaucoup Gérard. C'est un artiste d'un grand talent. Il a une belle figure, et je crois qu'on en ferait un mari enviable; mais sa trop grande sentimentalité m'est suspecte. Il me parle si souvent de sa misère et de ma fortune, que je tremble qu'il ne songe trop à m'épouser, et pas assez à m'aimer toujours. Les artistes enrichis sont insupportables. Je veux encore éprouver sa sincérité avant de consentir à lui donner un million.
Et la baronne se serrait contre Gérard, et levait sur lui des yeux languissants. De son côté, l'artiste murmurait dans la profondeur de son âme:—Certainement, j'adore Angèle; je donnerais ma vie pour elle; mais je n'ai pas le moyen de soupirer toujours après sa main. Ce soir, le bal va me coûter encore quelques louis, presque mes derniers; dans cinq ou six jours, je n'aurai plus le sou. Accepter son aide, c'est déchoir. Je ne crois pas faire injure au sentiment loyal que j'ai pour elle en désirant l'épouser promptement. Elle est très-riche, je pourrai l'aimer à mon aise, sans être obligé de la quitter tous les jours pour travailler. Mais si, décidément, elle craint de se mésallier, je ne veux pas voler ou mendier pour lui acheter des bouquets...
Et Gérard, en pressant dans son gousset les dernières pièces d'or qu'il eût à dépenser, regardait Angèle d'un œil enivré d'amour et brûlant de supplication.
Le soir de cette promenade de sentiment, la baronne Angèle de Bligny entrait dans la salle de bal de la maison de Conversation, avec une toilette qui évoquait Paris, et un bouquet dont le pauvre Gérard savait le prix.
La baronne était fort belle, de cette beauté singulière et toute française qui n'a rien à démêler avec l'art grec, avec les symétries de la statuaire, mais qui se compose d'un agencement gracieux des lignes, de la vivacité des traits, de l'éclair du sourire, du vague caressant des regards, de ce je ne sais quoi qui déconcerte l'analyse précise.
Il y a des femmes à la physionomie placide et tout extérieure qu'on ne regarde bien qu'en face; il en est d'autres qu'on n'ose jamais regarder, mais qu'on entrevoit de côté, qui vous parlent toujours comme à la dérobée, dont le charme pénétrant et indécis échappe à une observation fixe, qui miroitent, et qui laissent dans le cœur une sensation violente et imparfaite d'où naît une curiosité sans fin et sans assouvissement.
La baronne était une de ces créatures moirées, si j'ose ainsi dire. On ne pouvait arrêter sa figure dans un contour net et immobile. Jamais aucun portrait d'elle ne lui avait ressemblé, parce que son visage n'existait pas sans le rayonnement de ses prunelles battues par les paupières, comme par un éventail qui les attisait; parce que sa peau transparente, qui laissait compter les veines, avait des lueurs fugitives; parce que sa grâce était un arome; parce que la voir, sans en être vu et sans qu'elle parlât, ce n'était pas la voir. Il n'était pas jusqu'à la nuance de ses cheveux qui ne participât à cette harmonie vague. Était-elle brune? Était-elle blonde? c'était une question sans cesse agitée, jamais résolue. Angèle, en un mot, était le type le plus complet de la Parisienne. Elle avait le secret de la coquetterie et de l'élégance. Spirituelle, frondeuse, mais effleurant l'épiderme, sans avoir le mauvais goût provincial de déchirer, parlant de tout avec vivacité, n'approfondissant rien, passionnée jusqu'à la passion exclusivement, poétique jusqu'à la poésie, évaporée avec un fond inaltérable de bon sens pratique, elle possédait toutes les vertus mondaines, c'est-à-dire tous les défauts des Parisiennes.
Elle avait ce soir-là une toilette de tulle qui semblait accumuler les nuées autour de ses épaules et de sa taille. Gérard l'admirait de loin avec amertume. Fidèle à ses exigences, il n'osait rester trop assidûment près d'elle; mais il était remplacé, selon l'échange célébré dans les romances, par son magnifique bouquet, et c'était peut-être bien à lui, autant qu'aux fleurs elles-mêmes, que s'adressaient les petits baisers, ou, pour mieux dire, les petits mordillements d'Angèle.
Veuve et riche, madame de Bligny avait été persécutée le lendemain de l'enterrement de feu M. le baron, son époux, par les adorations de plusieurs cousins qui se disputaient la faveur de ne pas laisser sortir de la famille une fortune qui s'y était augmentée. Mais l'encens de ces héritiers manquait de délicatesse; et la jeune veuve avait l'odorat susceptible. Elle fut blessée jusqu'au plus profond de sa vanité, je veux dire de son âme, et jura de se venger. Quoi! c'était pour sa fortune qu'on la courtisait, et sa main fine et blanche, aux fossettes délicieuses, aux ongles roses, n'était sollicitée qu'à cause des gros et vilains sacs d'écus qu'elle était capable de dénouer! C'était à rassasier des hommes et de la fortune. La baronne eut le courage de se résigner à la richesse, mais elle ne pardonna pas à ses cousins, et le dépit excitant sa sensibilité, l'amour-propre froissé portant un défi à l'amour, elle en vint à rêver une union disproportionnée, dans laquelle toute sa fortune servirait à récompenser une tendresse désintéressée, un dévouement sincère, une âme d'élite. Tout homme soupçonné de posséder quelques belles rentes solides, lui devint odieux. Elle essaya de s'apitoyer sur un jeune homme d'excellente famille qui venait de se ruiner au jeu; mais quand on lui eut donné la preuve que cette union était une faillite, et qu'il y avait de la spéculation mal avisée dans ce désordre apparent de la passion, elle chercha ailleurs.
Gérard passa, un soir qu'elle était triste et fiévreuse, dans un coin de salon, regardant de jeunes héritiers faire la roue devant de jeunes héritières, et écoutant de petits ambitieux baragouinant le langage de l'amour à de jeunes coquettes qui voulaient se marier pour porter des cachemires.
Angèle, que cette spéculation universelle désespérait, reçut à cet endroit du corps, inconnu en physiologie, où naissent les sentiments, une commotion électrique, quand elle vit les grands yeux rêveurs de l'artiste, ses joues un peu maigres et suffisamment pâles, ses cheveux inspirés. Mais quand elle l'entendit chanter, et lancer dans le plafond des notes qui ne devaient s'arrêter qu'au ciel, la baronne faillit s'évanouir; elle ferma les yeux devant son idéal, qui l'éblouissait. Elle apprit que Gérard était pauvre, qu'il vivait avec sa mère; qu'il avait un grand talent de compositeur et de chanteur; qu'il était dévoré d'ambition, et qu'il voulait faire un chef-d'œuvre ou mourir. Pour le coup, l'instrument de la vengeance était forgé par Dieu même. Madame de Bligny eût manqué à tous ses devoirs envers elle-même et envers l'amour, en ne faisant pas à Gérard l'honneur qu'elle refusait à ses avides cousins de tous les degrés. Elle pleura des vraies larmes, en écoutant s'épancher, avec des dièses et des bémols à la clef, l'âme mélodieuse du musicien. Elle s'en fit remarquer; et, huit jours après cette première rencontre, ils déchiffraient ensemble un duo, qu'ils n'avaient pas encore appris au bout d'un mois, et dont ils avaient oublié le nom deux mois après.
Gérard fut sincère dans ses transports. L'amour d'une grande dame, veuve, riche, lui donna des mouvements fiévreux de reconnaissance. Il jura de devenir illustre pour couronner tant d'abnégation. Il voulut s'élever à la hauteur du sacrifice. Il y eut vraiment, dans les premiers temps de cette liaison, qui resta d'ailleurs dans les bornes du respect le plus ardent, des heures sublimes, dignes des poëtes, et à faire envie aux nigauds éternels qui ont inventé l'amour extatique. Angèle se vengea avec luxe. Gérard eut du génie. Ces deux beaux jeunes gens, elle séduisante et rayonnante, lui pâle d'émotion et de joie, tous deux jaloux de se venger du monde, qui les trouvait, lui trop pauvre, elle trop riche, ces deux incompris qui se comprenaient si bien eurent des appétits de bonheur à ruiner le ciel. Ils s'aimèrent en cachette, en public, à l'Opéra, à l'église, en riant, en pleurant, en priant, de toutes les façons; et ils s'aimèrent comme il faut s'aimer, en ne pensant qu'à l'amour, en oubliant, par intervalles, lui son ambition, elle son dépit.
Ce fut une orgie divine dont le monde parisien devina et admira les joies, puisqu'il s'empressa de les calomnier. Au premier sifflement des couleuvres, Angèle tressaillit, non pas qu'elle se repentît de son bonheur, mais les méchancetés du dehors la rappelèrent à son rôle.
—Puisque l'on continue à me provoquer, se dit-elle, je les pousserai à bout; je leur montrerai qu'il n'y a pas de caprice dans notre amour.
L'imprudente, en effet, voulut y mettre de la logique, de la raison. Ce fut sa folie, son fruit défendu, auquel naturellement elle fit mordre Gérard.
—Je serai ta femme, lui dit-elle.
—Hélas! tu étais ma muse! dit le pauvre musicien, auquel ce mot rappela qu'il n'avait plus à obtenir de la grande dame que ses millions; cette pensée, en le mettant en présence d'une convoitise d'argent, l'attrista et le blessa d'abord. Puis, l'un et l'autre, ils s'habituèrent à cette idée du mariage, et, en s'y habituant, ils l'étudièrent.
Il se fit une déchirure dans le ciel qui les enveloppait et qui les cachait. Par ce trou, on aperçut la vie positive, et l'on sentit passer un vent glacial.
—N'est-ce pas me déshonorer, se demanda tout d'abord et tout héroïquement notre artiste, que d'épouser une femme si riche? On ne voudra jamais croire que je l'aime pour elle; on dira que je l'aime pour son argent.
De son côté, madame de Bligny, quand elle songea qu'un contrat de mariage, rédigé sur papier timbré, allait consacrer et immobiliser son bonheur, se sentit prise, non pas d'un doute pour Gérard, mais d'un besoin instinctif de veiller à la sûreté de son rêve. Puisqu'elle portait un défi aux soupirants de sa bourse, il fallait être bien certaine que Gérard ne chantait pas pour ses écus; et non-seulement cette conviction devait lui être acquise, mais il était d'obligation, de bon goût, de la faire entrer dans la conscience de tous.
Dès lors, la nécessité d'une épreuve réciproque désenchanta un peu l'avenue que parcouraient nos deux amants. On s'observa, on se commenta, et, si pur qu'on fût disposé à se trouver, on se soupçonna capable de petits défauts.
—Je saurai bien si Gérard m'aime absolument et sans arrière-pensée, se dit madame de Bligny. Je le contraindrai de quitter Paris, ses succès, ses triomphes, et je le mettrai à l'épreuve du désintéressement.
—Je saurai bien si Angèle veut m'épouser, dit à son tour Gérard, qui ne se souciait pas d'être pris seulement pour expérience et par vengeance. Je la suivrai jusqu'au bout du monde.
Et c'est ainsi que, voulant attester la solidité de leur amour, ils coururent la chance de l'ébranler, et résolurent de quitter Paris pour aller se promener sur le Rhin. Hélas! il faut se défier des sentiments qui ont besoin de changer d'air et de climat. Ils usent des moyens désespérés de la médecine, et sont bien près de leur fin.
L'amour de Gérard et d'Angèle n'était pas au dernier degré, mais il avait des déchirures dans le poumon, et il était pris de l'inquiétude de ceux qui se sentent menacés par la mort.
Gérard, nous l'avons dit, était pauvre. Fils naturel d'un père resté très-inconnu, il vivait avec sa mère, ancienne actrice, autrefois célèbre, et qui avait changé son glorieux nom de théâtre contre le nom de Gérard, qui lui semblait, dans ses scrupules maternels, plus pur et plus digne de son fils.
Madame Gérard n'avait rien gardé de toutes les fortunes que ses caprices avaient gaspillées. Devenue sage en devenant vieille mère, elle prenait soin de l'intérieur, ne vivait que pour son fils et qu'en lui. Elle était fière de ses succès, peut-être encore plus de ceux qu'il obtenait dans le monde que de ceux qui l'accueillaient en public. L'amour de madame de Bligny, qu'elle avait deviné et que Gérard avait fini par lui raconter, lui semblait le plus heureux coup du sort. Aussi, quand elle vit son fils se préparer à un voyage:
—Va! lui dit-elle en l'embrassant, et reviens millionnaire.
—Oh! ce n'est pas la fortune que j'envie, répondit avec empressement Gérard, offensé de ce conseil pratique.
—Puisqu'elle est riche, il faut bien passer sur ce défaut-là, répliqua sa mère, qui savait par expérience que ce défaut est une vertu.
L'artiste fit deux parts de son argent; il en laissa une à sa mère et emporta l'autre. Il avait fièrement posé les conditions à la baronne, et avait juré qu'il ne partirait pas, si Angèle ne s'en reposait pas absolument sur lui pour les dépenses de la route.
Madame de Bligny s'était docilement soumise à cette exigence, dans laquelle tout d'abord elle vit un noble mouvement, et qu'elle avait ensuite considérée avec défiance, redoutant un calcul dans cette affectation. Nous savons aujourd'hui à quel point ils en sont venus. Le doute est entre eux; ils s'aiment toujours, ou plutôt ils veulent encore s'aimer. Toutefois, la baronne s'irrite en secret, et par intervalles, des doléances de Gérard, qui lui semblent des sommations, et Gérard, dont la bourse s'épuise, trouve qu'on abuse de son désintéressement, et qu'il n'y aurait que justice à le récompenser.
Ils sont aussi sincères que des créatures humaines peuvent l'être. Ils ne mentent qu'à leur propre conscience, ce qui n'est presque rien, dans la confusion des hypocrisies, et la nécessité qui les pousse à se faire réciproquement des reproches est la dernière illusion d'une tendresse qui croit vivre, parce qu'elle accuse.
Madame de Bligny avait un grand succès au bal. Tout le monde connaissait ou soupçonnait son engagement avec Gérard; mais personne n'en paraissait scandalisé. La décence de ce sentiment, le respect qu'on semblait avoir pour le monde, suffisaient pour que celui-ci fût indulgent. Il rembourse avec la monnaie dont on le paye et feint de pardonner à qui feint d'avoir peur de lui.
Pendant que madame de Bligny, belle et souriante, dansait, valsait et flairait son bouquet avec ses lèvres, Gérard, adossé à l'angle d'une porte, se disait tout bas:
—Je n'ai plus que cinquante francs à dépenser pour elle. Que vais-je faire? Lui demander de m'épouser, parce que je n'ai plus d'argent, c'est hideux! accepter ses offres, c'est m'avilir. Je n'ai d'autres ressources que de fuir, de voler ou de travailler. La quitter, c'est le comble de la lâcheté; donner des concerts, c'est l'humilier. Je suis entre le crime et une bassesse. Quoi que je fasse, je perds son amour. Plutôt la mort mille fois! Ah! que nous sommes fous, nous autres artistes, de nous attacher à ces impitoyables coquettes! Un jour, une heure d'amour, c'est tout, c'est trop; puis chacun retourne à son devoir. Mais pourquoi me suis-je habitué à cette pensée qu'elle pouvait être, qu'elle devait être ma femme? N'est-ce pas elle qui m'a donné cette ambition, qui l'a entretenue dans mon cœur?... Oui, je me rappelle toutes ses paroles: serais-je coupable de les lui rappeler?
Et le pauvre Gérard la cherchait des yeux, lui souriait de loin, lui envoyait un baiser des lèvres, quand la valse la faisait passer devant lui, puis il reprenait ses douloureuses réflexions.
—Cinquante francs! se disait-il; ce n'est pas même le prix du voyage pour la fuir. Je suis obligé de vaincre ou de mourir ici.
Et comme il cherchait parmi tous ces valseurs quelqu'un à qui, en désespoir de cause, il pût s'adresser pour un emprunt, il aperçut un journaliste parisien en quête d'émotion pour un keepsake dont il dépensait d'avance le produit.
Gérard l'aborda, renouvela connaissance et présenta sa requête, en s'excusant sur un retard de la poste.
—Parbleu! mon cher monsieur, dit le journaliste, je vous demande deux heures de répit. J'ai quelque idée que la chance me sera favorable aujourd'hui, et je mets d'avance mon gain à votre disposition.
—Vous allez jouer?
—Oh! je suis un observateur consciencieux. J'ai promis une imprécation contre la fièvre du trente et quarante; je veux m'inoculer le mal, afin de le mieux juger... Si vous ne craignez pas la contagion, venez avec moi.
—Volontiers; c'était pour jouer moi-même que je voulais emprunter ces quelques louis, reprit Gérard, qui se voyait obligé de mentir pour cacher son embarras, et qui, depuis son arrivée à Bade, tout entier aux spasmes de son amour, n'avait jamais songé au tapis vert.
Les deux jeunes gens quittèrent la salle de bal et allèrent dans les salons où la roulette et le trente et quarante tiennent leurs assises.
Gérard eut une émotion profonde en entrant; il sentit un frisson lui parcourir le dos. Une voix lui disait à l'oreille:
—Ici on laisse tout amour! Vous qui entrez n'en espérez plus!
Il regarda les croupiers impassibles, les joueurs aux sensations diverses: les uns feignant l'insolence pour intimider le sort; les autres pâles, muets, agitant leurs mains convulsives dans leur poitrine. Il se rappela les vers d'Alfred de Musset (car, bien que musicien, Gérard était instruit et avait de la littérature). Il chercha les Fils de la Forêt-Noire; il en vit quelques-uns.
Gérard ne poussa pas l'exclamation du poëte:
Mais il envia plus d'un de ces paysans dont la roulette multipliait l'enjeu, et il jeta sur la table, avec un serrement de cœur, dissimulé dans le plus faux sourire qui ait jamais brillé sur des lèvres humaines, un de ses derniers louis, tiède encore d'un long contact, d'une étreinte désespérée.
Nous n'abuserons pas de la situation dramatique pour peindre les émotions de la circonstance. Ce qui importe, c'est de savoir que Gérard dut s'estimer très-heureux en amour, car son malheur au jeu fut complet. Il eut bientôt perdu ses cinquante francs.
—Vous ne jouez plus? dit le journaliste, qui perdait déjà la valeur du keepsake, et qui songeait à un second volume.
—Je ne suis pas en veine ce soir, répondit Gérard, dont les jambes tremblaient, et qui avait peur de s'évanouir.
Il se dégagea de la foule, et, au lieu de rentrer dans la salle de bal, il sortit et alla s'asseoir sous les arbres de la promenade, se cachant des groupes qui venaient écouter l'orchestre de la danse; là, il faut bien l'avouer, notre héros n'eut plus de courage. Le dépit, l'amertume, le sentiment de sa défaite l'étouffèrent: il pleura.
Les larmes sont une satisfaction que l'on s'accorde à soi-même, et si l'on doit proclamer heureux tous ceux qui pleurent, ce n'est pas parce qu'ils sont consolés, mais c'est parce qu'ils se consolent eux-mêmes. Les pleurs sont une revanche et un certificat d'innocence que l'homme accablé se décerne. Je suis bien à plaindre, se dit-il, puisque je pleure! et si je suis à plaindre, c'est que je mérite d'être consolé. De là, à s'estimer plus que les autres, en raison même de sa douleur, il n'y a pas loin, et Gérard ne manquait pas à cette loi égoïste. Il en voulait à Angèle de ce qu'il pleurait pour elle. Il avait des mouvements haineux d'amour.
—Oh! je la forcerai bien à m'épouser, se disait-il. Il serait par trop ridicule d'avoir tout quitté pour la suivre, et d'être laissé là parce que je me suis ruiné pour elle. Mais comment oser lui dire... que je n'ai plus un sou... pas même de quoi faire l'aumône? Oh! ce jeu, quelle sottise à moi de lui demander un aide! Après tout, l'amour et la roulette se devraient plus d'égards. Si j'osais, je mendierais... Je comprends le vol! Qu'y a-t-il, à cette heure où je souffre, entre une mauvaise action et moi?... La seule distance que remplirait une occasion.
Et Gérard, froissé dans ses espérances les plus vives et les plus douces, se sentant à la discrétion de la femme qu'il aimait, n'ayant aucun moyen de la contraindre, rougissant de lui devoir quelque chose, perdant d'un seul coup cette égalité apparente que son indomptable fierté d'artiste lui avait conquise, Gérard se mordait les poings, poussait des exclamations étouffées, et s'animait d'une formidable colère contre lui-même, contre la destinée, contre la baronne.
Après une heure d'épanchement dans la solitude, il se crut plus calme, et résolut de rentrer. Madame de Bligny avait remarqué son absence; elle était inquiète et un peu jalouse. Mais quand elle le vit, elle comprit à sa pâleur qu'il souffrait, et, dans un regard expressif, elle lui demanda pardon de l'avoir accusé.
—Qu'avez-vous, mon ami? lui dit-elle en allant vers lui.
—Rien... la fraîcheur de la nuit m'a saisi.
—Gérard, vous me cachez quelque chose.
—Moi, que puis-je vous cacher?
—Je ne sais, une mauvaise nouvelle, un duel.
—Un duel! reprit Gérard avec un peu d'ironie, oh! ce n'est pas le duel que vous supposez, madame, je me suis battu contre votre amour, et j'ai été vaincu.
—Vous êtes fou, mon ami! dit la Parisienne avec une compassion railleuse.
—C'est possible.
—Ah! je devine! s'écria Angèle, qui reconnut la vérité à certaine flétrissure des mains, à ce petit désordre des manchettes que causent toujours le maniement de l'argent et l'action du jeu. Vous avez joué, et...
—Et j'ai perdu, c'est exact; mais excusez-moi, mon amie, cette perte est insignifiante. Pourtant la persistance du sort m'a irrité. Je suis un mauvais joueur, je n'aime pas perdre. Voilà le motif de ma pâleur et de mon émotion.
—Je crois que vous me cachez quelque chose, dit Angèle en lui serrant les mains, et vous avez tort. Si quelque dette...
—Je ne dois rien... Ne parlons plus de cela, et dansons, si vous voulez.
—Non, je me sens fatiguée; je veux rentrer.
—Permettez que je vous reconduise.
Madame de Bligny était rêveuse. Cette douleur de Gérard lui semblait facile à interpréter; elle ne doutait pas qu'il n'y eût une question d'argent au fond de ce désespoir. L'épreuve touchait à son terme. Décidément l'artiste avait triomphé. Son orgueil qui n'avait jamais fléchi, son amour qui avait eu recours à toutes les luttes plutôt que d'accepter un bienfait, tout attestait le désintéressement de la passion.
—Gérard, lui dit-elle avec une sorte de gravité, laissez-moi vous dire que je vous aime plus que jamais. J'ai été cruelle envers vous peut-être; mais c'était pour mieux vous prouver mon estime. Venez me chercher demain matin. Nous aurons une longue conversation ensemble; nous avons tout notre bonheur à assurer.
Gérard ne put que répondre:
—A demain!
Il mit sur le front d'Angèle un respectueux baiser, et il la quitta brusquement.
—Elle m'a pris en pitié, se disait-il, j'ai lu dans ses yeux la compassion. Demain elle va m'offrir sa fortune avec sa main: c'est là mon rêve! Et pourtant je voudrais que cette offre ne vînt pas si justement à l'heure où j'en ai besoin; elle saura plus tard que je n'étais plus en mesure de refuser. L'humiliation pour moi sera complète.
Les scrupules de Gérard devenaient absurdes, et sa délicatesse était surtout de l'orgueil. Mais de toutes les tâches, la plus difficile pour l'homme est celle d'accepter simplement son bonheur. Il perd un temps précieux à minauder avec lui, et il a parfois des accès de fierté chevaleresques et pervers, dans lesquels il prétend mériter les bienfaits qui lui tombent du ciel. Gérard traversait une de ces crises folles. Il n'avait qu'à passer cette nuit-là dans l'enchantement, dans l'espérance; il aima mieux la consumer dans des enquêtes pénibles sur sa situation, sur la dépendance que sa pauvreté allait lui imposer.
Après avoir dit adieu à madame de Bligny, il revint à la Maison de conversation. Le bal n'était pas fini; on dansait et on jouait encore. L'artiste n'osa pas rentrer, mais il regarda les fenêtres du salon de la roulette, comme si l'une d'elles dût s'ouvrir, et comme si quelque joueur privilégié dût lui jeter de là tout une fortune, dont il avait grand besoin, pensait-il.
Personne n'ouvrit de fenêtre; il ne tomba aucune aumône, et Gérard, fort ému par avance de l'entretien qu'il devait avoir le lendemain, rentrait chez lui en baissant la tête, quand il remarqua, au détour d'une rue, une ombre masculine attachée à ses pas avec une persistance singulière. Nous ne commettrons pas la mauvaise plaisanterie d'affirmer que Gérard, ce soir-là, ne redoutait pas les voleurs. Il se retourna brusquement, vint droit à son ombre, et lui frappant sur l'épaule:
—Que me voulez-vous? lui demanda-t-il résolûment.
—Rien, si vous n'êtes pas celui que je cherche, répondit l'ombre avec un fort accent germanique; ce qui prouvait par surcroît, après le témoignage sensible du contact, que cette ombre n'était pas celle de l'artiste lui-même.
—Et, qui faut-il être pour vous satisfaire?
—Un jeune homme de bonne tournure qui se promenait tantôt dans les ruines du vieux château, en compagnie d'une charmante dame.
—Et si j'étais ce jeune homme? demanda Gérard.
—En ce cas, monsieur, j'affirmerais que je ne me suis pas trompé en croyant vous reconnaître, et je vous prierais de venir parler en toute hâte à mon maître, qui désire vivement vous entretenir.
—Quel est ton maître?
—Le baron Walter, un vieillard bien malade, que vous avez rencontré dans les ruines.
—Quoi! ce bonhomme un peu fou!
—Je ne sais pas si mon maître est fou, reprit gravement Fritz; mais je sais qu'il veut vous voir et qu'il m'a chargé de vous amener à lui en toute hâte.
—Mais je ne le connais pas du tout, dit Gérard d'assez mauvaise humeur, et comme je ne suis ni notaire, ni médecin, je n'ai rien à faire au lit d'un moribond.
Fritz garda le silence, il attendait un refus plus formel.
—A moins que ce ne soit pour me nommer son héritier, continua l'artiste, qui mêlait ses préoccupations d'argent à cet incident bizarre, et qui riait à moitié; auquel cas, mon cher, je te suivrais avec empressement.
—C'est peut-être pour cela, en effet, répliqua Fritz, qui s'inclina et qui passa devant, comme pour indiquer la route.
—Au surplus, la nuit est bonne pour les aventures, continua Gérard, je ne dormirai pas; allons visiter les mourants, c'est une œuvre méritoire.
A quelques pas de là, Gérard s'arrêta tout à coup.
—Es-tu bien sûr, demanda-t-il à Fritz, que ton maître soit un vieillard?
L'Allemand ne parut pas comprendre le sens de cette interrogation.
—Il me le semble, balbutia-t-il.
—C'est que si, par hasard, tu me menais à quelque jeune ou respectable dame, reprit l'artiste avec fatuité, je l'avoue, mon cher, que par égard pour ta maîtresse, il vaudrait mieux me laisser en route.
Fritz sourit et répondit avec dignité:
—Je suis père de famille, monsieur, et mon maître n'est pas une femme.
—Que peut-il me vouloir? se demanda Gérard, qui continua son chemin.
Le baron Walter occupait un appartement, meublé très-confortablement, à l'hôtel d'Angleterre. Gérard fut introduit dans un salon, où on le laissa seul pendant quelques minutes; puis, Fritz, qui avait été prévenir le malade, revint chercher notre héros, qu'il conduisit à la chambre du baron.
Gérard se laissait aller aux chances de cette aventure avec l'enthousiasme ironique d'un homme qui vient d'être profondément atteint et qui méprise le surcroît des petites misères humaines. La curiosité qui naissait en lui s'aiguisait en sarcasmes.
—Parbleu! se disait-il, je veux savoir quelle sotte mésaventure la chance qui m'a trahi au jeu me réserve encore!
Le vieillard essaya de se soulever sur son séant quand il le vit entrer; mais ses efforts furent vains, sa tête retomba sur l'oreiller.
Fritz s'approcha pour l'aider.
—Non, merci, murmura le baron, je n'ai pas besoin de toi, nous avons à causer, laisse-nous.
Fritz avança un fauteuil pour Gérard au pied du lit, ranima le feu dans le foyer, jeta un coup d'œil aux diverses potions ordonnées par le médecin et se retira.
—Monsieur, dit le mourant, en s'interrompant presque à chaque syllabe, je vous remercie d'être venu; vous m'enlevez une grande inquiétude de l'esprit; et si, comme je l'espère, vous voulez bien accepter la tâche que je prends la liberté de vous confier, je mourrai sans remords.
—Mais, monsieur, interrompit Gérard, vous ne me connaissez pas!
—Si, je vous connais bien, dit le moribond, en essayant de sourire et en secouant la tête, vous êtes la jeunesse, l'amour, l'illusion, par conséquent la candeur, la bonne foi, l'honneur. Oh! je vous connais bien!
—Mais tout cela n'est pas sur mon passe-port, dit Gérard. Avant de recevoir des confidences qui sont peut-être le résultat d'une prévention trop favorable, et par cela même dangereuse, j'ai besoin, monsieur le baron, de vous dire qui je suis: Je me nomme Gérard, je suis musicien; je ne vous assurerai pas que j'ai du talent, mais j'ai l'honneur d'avoir quelques ennemis qui travaillent à ma réputation.
—Artiste et amoureux! vous êtes complet, mon ami, dit le malade, et cette belle dame...
—Sera ma femme dans quelques jours, monsieur le baron, dit Gérard avec fierté.
—Oh! le beau rêve! Tâchez, mon ami, de ne pas vous éveiller, je ne pouvais choisir mieux, et je vous ai bien deviné! Moi, je suis le baron Walter, un vieil Allemand sentimental qui va faire bientôt son dernier voyage dans le bleu! J'ai aimé l'art et les artistes; j'ai aimé tout ce qui est aimable; maintenant il me faut aimer la mort. Après une existence assez orageuse, pendant laquelle j'essuyai bien des tempêtes, sans faire beaucoup de naufrages; je vais quitter la terre, en laissant une dette à payer... Oh! cette dette-là est sacrée. Je l'ai oubliée longtemps, mais le malheur m'a frappé et m'a averti. J'avais un fils légitime que j'aimais ardemment... Je l'aimais trop: c'était le témoignage d'une union heureuse et courte. Il y a quelques mois on m'apporta le cadavre de mon enfant blessé mortellement dans un duel... Je ne vous dirai pas combien je pleurai... mais je vous dirai que je meurs de sa mort. Après quelque temps d'un désespoir que la pensée d'une réunion prochaine finit par adoucir, comme j'allais prendre des dispositions pour distribuer ma fortune entre les diverses sociétés chorales de mon pays, je me demandai si je n'avais personne à frustrer, et si j'avais bien réellement le droit de disposer ainsi de mon bien. Cette question fut salutaire. Je me souvins alors que, parmi les orages d'une existence dont la passion était la boussole, j'avais abandonné, il y a quelque trente ans, une charmante femme, parce qu'elle m'attribuait avec obstination la paternité d'un enfant, dont je ne consentais pas à m'avouer le père. Un scrupule contraire à celui que j'avais ressenti autrefois me saisit. J'aimai cet enfant entrevu et repoussé, j'eus une vision de cette jeune mère si belle... Et puis c'était un péché de jeunesse que j'allais revoir... et j'ai eu une jeunesse dont les cendres sont encore chaudes. Je résolus de me mettre à la recherche de cet enfant et de lui léguer mon bien. Un de mes amis, auquel je donnai des instructions et qui avait plus de santé que moi, s'est mis en campagne. Il m'a écrit qu'il était en bonne voie, qu'il espérait m'amener mon fils dans quelques jours... Par malheur, je ne serai plus là, monsieur, quand cet héritier viendra frapper à la porte du père prodigue... Je sens que je meurs. Cette promenade de tantôt m'a achevé. J'ai voulu aspirer la vie. C'est une boisson désormais trop forte; elle m'a enivré, elle m'a tué. J'ai besoin de quelqu'un à qui je puisse confier mes dernières volontés. J'ai horreur des gens de loi, je ne les aime qu'en costume et dans des cortéges de féeries. Comme je cherchais dans mon esprit à qui je pourrais m'adresser, votre pensée m'est venue. Les amoureux, tant qu'ils aiment, ont toutes les vertus; ils sont chevaleresques et dévoués: un artiste surtout a des fiertés et des tendresses qui le rendent incapable d'une félonie... Monsieur, je vous le demande avec l'ardeur et l'insistance d'un mourant, voulez-vous accepter un dépôt? Si je meurs cette nuit ou demain, vous entrerez en possession de tous mes papiers, de tous mes effets; j'ai ma fortune là, réalisée dans ce portefeuille, prenez-la pour la remettre à mon fils. Il viendra, amené par mon ami Rosenheim; dites-lui que je le prie de me pardonner, et tâchez d'en faire votre ami.
Gérard s'était levé pâle et ému.
—Monsieur, dit-il, ce que vous me demandez là est impossible, je n'ai ni la liberté ni le temps d'accepter ce fidéicommis.
—Oh! vous serez libre demain soir, peut-être, ou dans deux jours. Rosenheim ne peut tarder; il devrait être ici, j'étais venu au-devant de lui jusqu'à Bade; mais je ne peux aller plus loin.
—Pourquoi ne pas confier ce dépôt à votre valet, à ce Fritz, qui me paraît dévoué?
—Fritz m'est dévoué, mais... je ne veux pas le tenter.
Gérard voulait s'écrier:
—Pourquoi me tentez-vous, moi?
Une secrète pudeur retint ce cri; il se borna à dire:
—Attendre un jour ou deux n'est pas une si longue tentation.
—D'ailleurs, reprit le vieillard, j'ai mon idée, et la voici:
—Il se peut que Rosenheim, malgré ses espérances, revienne seul, que mon fils soit mort ou introuvable; dans ce cas, je veux que ma fortune serve à des gens dignes du bonheur. Vous la garderez, monsieur, vous en distrairez une part que j'ai indiquée pour mon ami Rosenheim; une seconde part pour Fritz, qui retournera dans son pays, et une troisième part, destinée aux sociétés chorales. Je veux que tous les ans on donne, en mémoire de moi, un petit concert dont l'écho me viendra sans doute à travers la tombe.
—Monsieur, dit Gérard, qui faisait de grands efforts pour dissimuler un tremblement dans la voix, je ne puis accepter, moi, inconnu, des chances pareilles... ma conscience...
—Quoi! votre conscience vous interdit de me rendre service? de me permettre un peu de repos à mes dernières heures... de me donner l'appui de votre probité... Allons, monsieur, n'ayez pas d'orgueil, c'est une bonne action que je vous offre, cédez à la tentation, je suis convaincu que celle que vous aimez vous conseillerait d'accepter.
—Soit! alors j'accepte, monsieur, dit Gérard, qui se sentait le front humide. Mais, permettez-moi de vous donner ma parole d'honneur que je remettrai fidèlement ce dépôt.
—A quoi bon jurer? interrompit le vieillard; si je ne me suis pas trompé, le serment est inutile; si vous devez me trahir, que vous importerait un parjure? Puisque vous le voulez, donnez-moi votre main; voici la mienne; Dieu nous voit et scelle entre nous un contrat dont il est le seul témoin et le seul juge. Maintenant, mon ami, prenez dans ce secrétaire-là ces deux portefeuilles, et causons.
Gérard obéit; mais, sans qu'il pût dire pourquoi, il était pâle, il tremblait, et il acceptait cette bonne action comme s'il se fût disposé à commettre un crime.
Le baron Walter mourut dans la nuit. Il avait remis à Gérard les titres de tous ses biens, et il avait dit à Fritz:
—Monsieur est le maître ici; obéis-lui comme tu m'obéirais, il saura récompenser ton zèle.
Fritz s'inclina sans étonnement. Le baron l'avait habitué aux surprises. Quand le vieillard fut mort, Gérard, debout au pied de son lit, le regarda longtemps. On eût dit qu'il interrogeait ce cadavre, voulant savoir si l'âme ne se cachait point quelque part pour le guetter et pour reparaître en l'accusant, s'il ne suivait pas les instructions reçues.
Il était grand jour. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Ils savaient la mort d'un Allemand mélomane, et ils voulaient l'honorer par un petit oratorio. Gérard, brisé d'émotion, de fatigue, plus pâle que le drap blanc sur lequel reposait le vieux baron, songea à aller se reposer.
—Veille bien auprès de ton maître, dit-il à Fritz; je reviendrai pour ordonner le service funèbre. S'il arrivait d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de France, ou de je ne sais où, un ami de ton maître qui s'appelle Rosenheim, avec un jeune homme, fais-moi prévenir.
Gérard rentra chez lui; mais il ne put dormir. Il avait la fièvre. D'ailleurs, il lui restait beaucoup de choses à faire dans la journée même. Son rôle de fidéicommissaire l'obligeait à des soins envers le défunt; et puis Angèle l'attendait. Angèle! Pourquoi la pensée de la baronne de Bligny venait-elle se présenter comme un danger, comme une menace, depuis sa visite au baron de Walter? Il redoutait maintenant de revoir celle qu'il aimait et qui lui avait paru dans de si tendres dispositions à son égard. Il eût été ravi d'apprendre qu'elle était devenue invisible pour quelques jours seulement. C'est qu'au fond de lui, en dépit de lui, malgré tous les raisonnements, tous les efforts de son cœur, une voix terrible, inexorable, retentissante, une voix métallique, la voix des écus de l'Allemand lui chantait, lui criait:
Si M. Rosenheim revient seul, ou ne revient pas, tu hérites.
Il était, au premier abord, invraisemblable que M. Rosenheim ne revînt pas. Mais il était possible qu'il revînt seul; et alors Gérard se trouvait à la tête d'un bon gros million; il devenait aussi riche que la baronne, son égal, il pouvait l'épouser. Si, au contraire, l'héritier inconnu se présentait, il ne restait au pauvre artiste que l'âcreté d'une convoitise inutile, que l'amertume d'une terrible déconvenue.
Cette tentation, qui arrivait à l'heure la plus critique de son existence, le jetait dans de grandes perplexités. Fallait-il avouer tout à la baronne, l'associer à ses espérances, se ménager près d'elle des consolations, en cas de désappointement? Fallait-il lui dire: Attendez deux jours avant de m'accorder votre main! dans deux jours, je pourrai devenir votre mari sans que vous me fassiez l'aumône? Ou plutôt ne valait-il pas mieux accepter dès maintenant, enchaîner Angèle par sa promesse, et lui ménager la surprise d'un million comme une récompense?
Quand il descendait au fond de ses perplexités, Gérard se trouvait en présence de ces deux questions. Fallait-il confier à la baronne ses chances de fortune? Et quelle était la valeur réelle de ces chances? Ce dernier point, le plus sérieux, dominait et réglait tous les autres. Si les chances étaient nulles ou de peu de poids, il devenait inutile de les confier. Gérard, dans l'entretien suprême de la nuit, n'avait eu, relativement à la mission de l'ami Rosenheim, que de vagues confidences. Le baron Walter n'avait pu ou n'avait rien voulu lui dire de précis.
L'héritier allait-il venir? Les recherches seraient-elles infructueuses?
Il parut tout simple, en dehors de toute chicane de sa conscience, à Gérard, de souhaiter que l'ami Rosenheim ne rencontrât personne. Il fit des vœux insensés pour que cet enfant, peut-être abandonné, peut-être délaissé parmi les enfants trouvés, fût introuvable. Puis, quand il avait honte de cette ardeur, il revêtait hypocritement sa convoitise de prétextes plausibles. Il se disait que, chargé de la volonté expresse du baron, il avait besoin d'apporter un soin extrême, des scrupules rigoureux dans la remise de sa fortune. Il faudrait qu'on lui prouvât jusqu'à l'évidence, jusqu'à la démonstration la plus éblouissante, le lien du sang. Car, enfin, ce bon ami Rosenheim pouvait être un coquin, un intrigant, d'accord avec le premier venu, et il ne souffrirait pas, lui, Gérard, qu'on le frustrât d'un si bel héritage, ou plutôt qu'on manquât ainsi à la mémoire du baron, etc., etc.
Sur cette pente, et toujours poussé par la rage de la justice, Gérard en vint à ne plus admettre que comme une hypothèse invraisemblable l'arrivée de l'héritier et de l'ami Rosenheim. Il se trouvait si digne lui-même et investi si bien à propos de cette énorme fortune, que son imagination inventait tous les prétextes pour n'avoir pas à la rendre.
Cependant il fallait aller chez la baronne, qui l'attendait et qui avait promis de se prononcer.
Angèle attribua l'étrange pâleur et l'éclat des yeux de son ami à l'animation, peut-être à la fatigue du jeu. Mais elle ne parut ni alarmée, ni choquée; au contraire, elle sourit, et lui tendant les deux mains:
—A quelle église nous marierons-nous, Gérard?
Une larme parut dans les yeux du musicien.
—Angèle! Angèle! s'écria-t-il, vous êtes trop bonne pour moi. Avez-vous réfléchi à la détermination que vous prenez?
—Oui, et à moins que vous ne me refusiez, je persiste.
—Mais, voyez quelle disproportion de rang, de fortune!
—Gérard, si vous me poussez à bout, je vais me ruiner d'un coup, et me faire si pauvre que vous serez obligé de me faire l'aumône.
—Gardez-vous-en bien, Angèle! Laissez-moi plutôt devenir riche!
—Combien de temps vous faut-il pour cela? demanda la baronne en souriant, mais réellement froissée de l'insistance avec laquelle Gérard parlait fortune, quand elle parlait mariage.
—Je ne vous demande qu'un jour ou deux.
—Vous êtes fou, mon ami; je ne veux pas que vous retourniez au tapis vert.
—Il ne s'agit pas du jeu...
—Quoi! fabriqueriez-vous de la fausse monnaie? ou bien feriez-vous partie d'une bande de voleurs?
—Angèle, reprit Gérard, je suis fier, et je me sens pénétré d'une reconnaissance infinie quand je songe à votre amour. Cette main que vous m'offrez, c'est mon ambition, c'est ma gloire. Mais excusez des scrupules de délicatesse, ridicules et insensés. Il se passe dans ma vie quelque chose d'étrange. Une fortune m'est promise. Permettez-moi quelques jours d'attente. Si je deviens riche, j'accourrai déposer cette fortune à vos pieds. Si la fatalité veut que je reste pauvre, je serai vaincu et je viendrai vous demander pardon d'avoir eu un peu d'orgueil. Mais, au nom même de cet orgueil dont l'agonie commence et qui sera mort peut-être dans deux jours, accordez-moi un délai.
—Eh! mon cher, dit la baronne un peu piquée, prenez votre temps! je n'allais vite que pour vous!
—Soupçonnerait-elle ma détresse présente? se demanda Gérard. Dans ce cas, plus que jamais, je tiendrais à l'arrivée de M. Rosenheim.
—Angèle, reprit-il, j'ai votre amour: c'est le seul bien que je ne pourrais attendre patiemment. Ce qui me manque maintenant, ce n'est plus que votre fortune; je puis, je veux attendre cet accessoire.
—En vérité, pensa Angèle, il est incorrigible, il tient trop à m'humilier avec mon argent.
—Vous vous rappellerez, Gérard, que je n'ai plus de consentement à vous donner; je serai votre femme quand il vous plaira de m'accorder cet honneur.
—Ah! si je pouvais hâter les événements!
—Seulement, mon ami, ajouta la fine Parisienne avec un peu d'ironie, prenez garde de devenir trop riche. Ce serait moi qui rougirais à mon tour et qui n'oserais pas me marier.
—Raillez-moi, moquez-vous de moi, Angèle; un jour, vous saurez ce que j'ai souffert et vous m'estimerez plus.
—Vous tenez trop à l'estime, mon ami, et pas assez à l'amour.
—L'un ne vit pas sans l'autre.
—Vous êtes fou, dit la baronne en haussant les épaules et avec un rire un peu forcé.
Gérard eut peur; il se demanda s'il ne lâchait pas la proie pour l'ombre; si la vanité de se présenter avec un million, qui était d'ailleurs fort hypothétique, ne le poussait pas à froisser, à blesser un cœur aimant et à ajourner une dot considérable. Le million de madame de Bligny était là; il brillait dans ses yeux, il rayonnait sur sa main. Gérard n'avait qu'à s'incliner pour le prendre; un mot, un baiser, un regard et tout était dit.
La tentation était grande; mais la fatuité et l'orgueil murmurèrent de leur côté:
—Tu lui diras tout dans trois jours. Si tu restes pauvre, elle t'adorera pour tes scrupules; si tu deviens riche, elle trouvera ta surprise de fort bon goût. D'ailleurs elle cède peut-être à un accès de pitié. Elle a soupçonné tes pertes au jeu. Montre-lui que tu es supérieur à cet échec, et qu'elle ne soit pas ta femme par charité. Aie la coquetterie de la pauvreté; prends tes précautions pour n'être jamais humilié.
Gérard se croyait bien sage, en raisonnant ainsi, le pauvre fou! Il ne raconta pas à Angèle tous les incidents de la dernière partie de la nuit précédente; mais il parla de la mort du baron, de la confiance singulière que le vieil Allemand avait eue en lui, des devoirs que cette confiance lui imposait envers la mémoire du défunt, et de la possibilité d'un testament qui lui ferait des avantages.
Mais de ce malencontreux Rosenheim, et du plus malencontreux héritier, il ne dit mot. Je ne sais quelle force secrète paralysa sa langue toutes les fois qu'il fut tenté d'entrer dans ces détails. La baronne, encore une fois, fut choquée de le voir suspendre son mariage jusqu'à l'ouverture prétendue du testament. Elle lui dit assez froidement qu'il n'avait pas à se distraire de ses fonctions d'ordonnateur des pompes funèbres pour l'accompagner dans sa promenade, et elle le quitta, afin d'aller bouder seule, et en grande toilette, dans l'allée de Lichtenthal.
—Est-ce que je serais un imbécile? se demanda pour la seconde fois notre musicien. Ne risqué-je pas tout mon bonheur en prenant trop de précautions pour l'amour?
Mais cette réflexion, ce remords, au lieu de faire courir Gérard sur les pas de madame de Bligny, le cloua davantage à la place où il méditait, profondément absorbé dans ses calculs; s'attachant d'autant plus étroitement à l'idée d'hériter du baron, que cette espérance de fortune s'était jetée au travers de ses rêves et avait dérangé les plans de sa petite comédie d'amoureux; il devenait impatient de savoir à quoi s'en tenir.
Dix fois dans la journée il alla à l'hôtel d'Angleterre demander si quelque voyageur n'était pas arrivé. Il faisait des suppositions sur la figure probable de M. Rosenheim, et dans chaque physionomie inconnue il croyait le reconnaître.
—Jusqu'à quand me faudra-t-il l'attendre? se demandait-il, car enfin, il peut se faire que M. Rosenheim ne revienne pas: un accident, une mort subite peut interrompre son voyage. Le baron ne m'a pas dit l'âge de son ami; mais pour qu'il y eût entre eux une si grande intimité, une confiance si absolue, il fallait nécessairement qu'ils fussent contemporains. Or, voyager à cet âge-là, c'est imprudent. Du moins, je ne serai pas chargé d'enterrer M. Rosenheim. Mais encore, faut-il que je sache s'il est mort.
Et Gérard revenait sur ses pas, questionnait Fritz.
Fritz ne savait rien. M. Rosenheim lui était peu connu. Il n'était entré lui-même que depuis quelques années au service du baron. Il avait entendu vaguement parler du voyage, mais il ne pouvait pas dire si c'était pour l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la France ou l'Amérique que M. Rosenheim était parti. Le baron avait brûlé ses lettres. Cet original avait pris une sorte de plaisir à remettre tout le dénoûment posthume de son existence aux mains de Gérard, sans indications, sans notes, sans une seule trace qui pût venir en aide à la bonne foi de son exécuteur testamentaire.
Toute la journée fut un tressaillement perpétuel. Gérard allait, venait, passait dans l'allée de Lichtenthal, saluait Angèle, lui parlait précipitamment de son amour, de son bonheur, puis la quittait brusquement pour courir au-devant d'un vieillard qu'il croyait être Rosenheim, ou d'un jeune homme qui lui paraissait ressembler vaguement, c'est-à-dire filialement au baron Walter. Ce fut une anxiété croissante qui menaçait d'atteindre au supplice.
Pour surcroît de douleur, Gérard, dont les rêveries avaient ordinairement une pente musicale, ne pouvait plus songer qu'à son fantastique million. Il l'entendait carillonner à ses oreilles. Les pièces d'or ou d'argent grimpaient dans sa tête, comme des notes, à des échelles de gammes. Il ne pouvait s'empêcher de calculer ce que cette énorme fortune, ajoutée à celle de la baronne, lui assurerait de beaux revenus. Soyons juste toutefois, l'artiste ne se laissait jamais étourdir par ce cauchemar; c'était pour procéder plus facilement à des chefs-d'œuvre qu'il calculait, et Angèle brillait toujours, au milieu de ces splendeurs rêvées, comme la reine, comme la raison de tout ce luxe.
La journée finit. Tous les courriers étaient arrivés. Aucun Rosenheim n'avait paru. Il sembla à Gérard qu'on lui enlevait un fardeau d'un million de la poitrine. Il respira, le sang circula plus librement, et ce fut alors qu'il s'aperçut qu'il avait remué, en imagination, des tas d'or, sans avoir un sou dans sa poche. Il alla à l'hôtel. Fritz, préparait les malles, tout en veillant avec décence sur la dépouille du vieux baron. Le fidèle valet devait partir le lendemain, après la cérémonie. Il osa réclamer sa part; mais avec tant d'ingénuité qu'on ne pouvait s'en fâcher.
—C'est juste, dit Gérard, en soupirant, tu n'attends personne, toi!
Fritz s'inclina.
—Pourquoi ne restes-tu pas avec moi? Je te prendrais à mon service.
Fritz avoua qu'il avait, là-bas, à quelques lieues de la forêt Noire, une cousine aux joues roses, aux mains potelées, aux yeux de myosotis, qui l'attendait. Il avait désormais une dot et de quoi manger de la choucroûte.
Gérard ne fit aucune objection. D'ailleurs Fritz était un témoin. Et, sans savoir pourquoi, il aimait à se retrouver seul pour penser à son million, pour le contempler des yeux de la foi, et l'embrasser des lèvres de l'espérance. Sa fortune tout entière, en effet, gonflait deux gros portefeuilles. L'emprunt que leur fit Gérard pour acquitter le legs convenu envers Fritz diminua à peine leur embonpoint.
Ne sachant comment échapper aux idées singulières dont il se sentait obsédé, mordu par des désirs dont il avait honte, Gérard prit une résolution vraiment héroïque, mais qui prouvait, par son caractère même, le chemin que la gangrène de l'or avait fait en lui.
—Je passerai la nuit, se dit-il, seul, face à face avec le mort. Je veux que cette veillée austère me purifie et me débarrasse de mes agitations indignes.
En conséquence, Fritz alla dormir, en rêvant à sa cousine, et aux choux gigantesques que sa nouvelle position lui permettait de convoiter, et Gérard s'installa devant le visage bleu et grimaçant du baron Walter.
Mais cette faction courageuse devant la mort, après avoir, pendant la première heure, refroidi, glacé, contrarié les idées profanes de Gérard, finit, au contraire, par les alimenter: le besoin instinctif de se soustraire à cette contemplation, qui ne pouvait être pour son cœur la source d'émotions pieuses, le poussa dans des divagations de toutes sortes.
Il pensa plus que jamais à ses millions; et quand l'aurore fit glisser ses premiers rayons sur le front du musicien, aussi blême que le front du mort, voici à quelles pensées, presque criminelles, Gérard en était arrivé.
—Je suis maître absolu de cette fortune. Il dépend de moi seul que l'héritier hérite ou n'hérite pas. S'il arrive bientôt, je le soumettrai à une enquête sévère, et il faudra qu'il justifie bien de sa parenté pour que je me dessaisisse. D'ailleurs, je ne puis pas l'attendre indéfiniment. Si le baron Walter m'avait rencontré avant d'expédier son ami Rosenheim, il est probable qu'il n'eût pas songé à ce fils inconnu. Cette fortune m'est bien réellement destinée. Je ne m'en laisserai certainement pas dépouiller par le premier venu. Je déposerai ici en main sûre la part de M. Rosenheim; puis, je m'en irai. Angèle, qui ne comprend rien à mon retard, à mon hésitation, s'impatiente; je ne puis pas compromettre indéfiniment mon bonheur pour des gens que je ne connais pas, dont je n'ai pas de nouvelles, qui sont peut-être morts, etc., etc.
Bref, Gérard était presque convaincu qu'il pouvait toucher au million. Il ne pensait plus à l'arrivée de M. Rosenheim que comme à une injustice effroyable du sort, qu'il lui était permis, dans une certaine mesure, de conjurer.
Les obsèques du baron Walter furent dignes de la reconnaissance de Gérard. Celui-ci fit bien les choses, et tout le monde le loua hautement. On ne savait pas que le défunt payait et avait réglé ces détails avec lui. Le bruit se répandit bientôt dans Bade que le musicien français héritait. Fritz, qui réglait les dépenses, au nom de l'artiste, et qui l'avait vu toucher au portefeuille, raconta l'étrange caprice du baron. On causa de cette bizarre aventure. Personne ne parla des cohéritiers attendus; car personne ne connaissait ce revers cuisant de l'éclatante médaille.
Quand Gérard en grand deuil revint de l'enterrement, il remarqua qu'on le saluait avec déférence. Le journaliste au keepsake vint lui serrer la main.
—Bravo! mon cher, lui dit-il, je vous fais mon compliment. Ce vieux bonhomme si sec avait du bon. Vous gagnez plus avec les osselets qu'avec la roulette.
Les dames s'informèrent du héros du million. Elles le trouvèrent adorable, et Angèle qui apprit par la rumeur publique ce prodigieux événement envoya chercher Gérard en toute hâte, comme si elle avait eu peur qu'on le lui enlevât.
Gérard secoua de ses bottes la terre blanchâtre du cimetière, et s'empressa d'accourir, après avoir demandé encore une fois d'une voix tremblante si aucun étranger n'était arrivé. On lui répondit que non.
—Parbleu! se dit-il en route, si c'était une ironie! un piège, une malice de ce baron! Si ce Rosenheim n'existait pas! Fritz était bien vague sur ce point, quand je l'ai interrogé. Je lui en reparlerai ce soir.
Et, bien qu'il sût que le soir même Fritz ne devait plus être à Bade, puisqu'il avait reçu ses adieux, il se dit:
—C'est cela! j'interrogerai Fritz ce soir même!
En attendant, il alla répondre aux questions d'Angèle.
La baronne de Bligny avait appris les fastueuses proportions de l'héritage attribué à Gérard au moment même où le dépit qu'elle ressentait de l'étrange conduite de son compagnon de voyage lui conseillait presque une rupture. Elle était humiliée de ses hésitations, et trouvait que la mésalliance perdait de son charme vengeur si Gérard délibérait ainsi.
Son amour, composé de tous les éléments en discorde, n'avait pas les vertus évangéliques qui font tout souffrir, parce qu'on est disposé à tout pardonner.
—Je veux savoir, se dit-elle, si la prospérité le changera. Voilà une merveilleuse occasion d'éprouver son amour. Sa fierté excessive m'était suspecte; il n'a plus maintenant à faire le dédaigneux, ni à essayer le rôle de généreux; nous sommes égaux.
Et elle l'attendit avec son plus séduisant sourire, le cœur agité d'une émotion véritable, se préparant à lire son sort dans les premiers regards de Gérard.
Mais Gérard, pour des raisons que nous connaissons, n'avait pas le regard intelligible. Il sentait la rougeur et la pâleur se succéder sur son front, il écoutait avec des distractions perpétuelles, et répondait, au milieu d'une sorte de cliquetis intérieur qui l'assourdissait:
—Eh bien! mon ami, lui dit la baronne avec une grâce enchanteresse, il paraît que décidément nous n'aurons pas une chaumière, et que nous pouvons prétendre au palais d'une fée.
—Quoi! on vous a dit déjà?... balbutia Gérard.
—Oui, monsieur, j'ai appris par tout le monde ce que vous n'auriez pas dû me cacher; mais il paraît que monsieur hérite pour lui seul. Oh! le vilain avare!
—J'hérite! mais cela n'est pas encore sûr!
—Comment? est-ce que vous n'êtes pas investi? Est-ce qu'il y aurait des collatéraux? des cousines, peut-être, comme moi j'avais des cousins? Oh! je vous plaindrais alors!
—Non! non! je suis bien maître absolu, se hâta de reprendre Gérard, qui n'eût jamais consenti à parler de Rosenheim.
—Comme vous dites cela avec tristesse, mon ami! Il semble que ce bon vieillard qui voulait se faire bénir par nous, a, de son côté, porté bonheur à notre amour. Vos scrupules, vos fiertés n'ont plus de prétextes. Allons, riche vertueux, ayez le courage de votre fortune, et résignez-vous à m'apporter une grosse dot, si vous consentez toujours à m'épouser.
—Ah! Angèle, pourquoi raillez-vous? Je suis bien malheureux!
Et des larmes s'échappèrent des yeux de Gérard; c'était le dernier effort de sa probité qui râlait.
—Vous malheureux, quand vous acquérez l'indépendance envers le monde et envers moi-même; car je puis bien vous l'avouer maintenant que vous voilà riche, quelquefois, mon ami, je me demandais s'il n'y avait pas de l'imprudence dans nos projets de mariage. Je ne parle pas des calomnies, je les bravais volontiers; mais vous pouviez, à mon insu, vous sentir blessé. Je vous ai vu si prompt à repousser mes offres, que je redoutais, de votre part, de terribles accès de repentir. Notre mariage devient moins romanesque; mais il acquiert des chances positives de bonheur immuable. Je n'aurai pas à me défendre d'une mésalliance, ni vous d'une ambition d'argent.
—Quoi! madame, s'écria Gérard d'une voix étranglée, nous pouvions entendre ces accusations?
—Encore une fois, mon ami, je les aurais bravées. Mais vous pouviez en souffrir, tandis que maintenant nous nous résignerons, vous à ma fortune et moi à la vôtre.
—Ah! j'aimais mieux ma pauvreté, dit Gérard qui mentait, mais qui cherchait un prétexte aux soupirs et aux sanglots qui l'étouffaient.
—Moi aussi, peut-être, ajouta la baronne en souriant; mais que voulez-vous! ce sont là les coups du sort. Notre amour se prouvait par le désintéressement; il lui faudra trouver une autre façon de s'affirmer.
Gérard fut tenté de dire:
—Je renonce à la fortune, j'abandonne ce million pour rester pauvre.
Mais cette bouffée d'héroïsme se dissipa. Il réfléchit que répudier ce qui n'était pas encore à lui, c'était de l'exagération et du mauvais goût; il valait mieux le conserver.
—Quand serez-vous libre? lui demanda la baronne qui ne comprenait rien à ses silences, à ses interjections, et qui, voulant le pousser à bout, avait hâte de lui arracher un engagement.
—Libre! mais je le suis, dit Gérard.
—Ainsi, rien ne vous retient plus à Bade?
—Rien, ou peu de chose.
—Quel est ce peu de chose?
—Des comptes à régler, des dispositions à prendre pour satisfaire à la volonté du baron.
—Je croyais que toute votre fortune était en portefeuille, et que vous n'aviez qu'à l'emporter avec vous, dit négligemment madame de Bligny, comme s'il se fût agi d'une bagatelle.
—Sans doute, répondit Gérard, qui se laissait entraîner sur une pente fatale, mais qui ne se croyait pas coupable en s'imaginant qu'on lui ôtait la volonté.
—Eh bien! alors, puisque vous portez, heureux Bias, tout avec vous, enlevez-moi par surcroît et allons nous marier!
Angèle était d'une grâce irrésistible en parlant ainsi. Elle avait dans les yeux cet éclair à demi voilé de la provocation mutine.
Gérard fut vaincu. Comme M. Rosenheim n'avait pas donné signe de vie, il en conclut subitement qu'il était mort. Il lui était si facile de tuer son mandarin! Quant à l'héritier, pouvait-il le connaître? l'aller chercher?
—Vous avez raison, Angèle, s'écria-t-il avec force, comme s'il eût craint qu'on ne l'entendit pas; mais, en réalité, pour ne pas entendre les derniers et timides chuchotements de sa conscience. A quoi bon différer un bonheur qui ne dépend que de nous! partons. Je vais commander les chevaux. Dans une heure, nous serons en route; demain, si vous le voulez, nous serons mariés.
—On m'a indiqué, dit la baronne, tout près d'ici, une charmante retraite, un château à louer; c'est là que nous nous arrêterons, mon ami.
—Pourquoi ne pas rentrer en France, et pourquoi ne pas voyager encore?
—Parce que le voyage était un prétexte, et que nous n'avons plus besoin de courir les chemins; nous sommes arrivés.
—Angèle, demanda solennellement Gérard, m'aimez-vous?
—Votre question manque d'à-propos, répliqua la baronne; il me semble que je ne vous offre pas une preuve d'indifférence.
—M'aimez-vous, répéta Gérard, à ce point de tout braver pour moi?
—Que faut-il faire pour vous mériter? dit Angèle avec ironie.
—J'ai peur, ajouta Gérard en hésitant, que vous ne m'estimiez plus que je ne vaux. Si vous découvriez un jour...
—Quoi donc, mon ami? que vous avez tué ou volé? Je deviendrais alors une héroïne si intéressante, une victime de la perfidie humaine si digne de compassion, que je vous pardonnerais peut-être vos torts, en faveur des mérites qu'ils me donneraient. Mais ne parlons pas de ces enfantillages, Gérard, et partons.
—Dans une heure, je reviens vous prendre, s'écria l'artiste qui partit comme un fou.
D'abord, il erra dans les rues, sans savoir au juste où il allait; puis la réflexion lui vint, il courut à l'hôtel d'Angleterre, et demanda, en bégayant presque, si M. Rosenheim n'était pas arrivé.
—Je crois que oui, répondit un monsieur tout de noir habillé, un maître d'hôtel qui, habitué à tout promettre et à répondre affirmativement à toutes les questions, n'admettait pas qu'on dût rebuter un client.
Gérard se sentit défaillir; il s'appuya au mur, et voulut continuer ses questions; mais sa langue resta collée à son palais.
—Est-il seul? murmura-t-il avec un effort pénible.
—Je ne saurais trop vous le dire, répliqua le maître d'hôtel infaillible.
—Jacques, demanda-t-il à un garçon qui passait, quand et avec qui M. Rosenheim est-il arrivé?
—Rosenheim? je ne connais pas ce nom-là; nous n'avons pas de voyageur qui se nomme ainsi.
Gérard put respirer.
—Il me semble pourtant, reprit le maître d'hôtel, que j'ai entendu prononcer plusieurs fois ce nom-là!
—C'est peut-être par moi, insinua Gérard; voilà, depuis deux jours, la dixième fois que je viens le demander.
—C'est cela, sans doute, qui a fait confusion dans mon esprit. En ce cas, je ne crois pas maintenant que M. Rosenheim soit arrivé.
—Au diable l'important! se dit tout bas Gérard dont les dents claquaient.
—Toutefois, monsieur, nous allons regarder sur le livre des voyageurs, ajouta le maître d'hôtel.
Gérard consentit. On chercha sur le livre. M. Rosenheim n'y figurait pas.
—Je me suis trompé, monsieur, dit avec une modestie pleine d'assurance le majordome en habit noir. Mais puisque ce monsieur est attendu, il ne tardera sans doute pas. Je puis garantir qu'il sera ici par le premier courrier. J'ai remarqué, en effet, que les personnes ainsi annoncées...
Gérard était déjà dans la rue, laissant le maître d'hôtel continuer en monologue son raisonnement.
—Sauvé! sauvé! s'écriait le malheureux artiste. Je suis libre, je puis partir. Il n'arrivera pas, il n'arrivera plus. Quoi! si j'étais resté pauvre, Angèle n'eût cédé qu'à la pitié en m'épousant. Elle l'a avoué. Maintenant, nous sommes égaux; mon mariage n'est plus un calcul; le sien n'est plus une déchéance. Je pourrai donc braver ces insolents qui me toisaient tous les jours avec tant de mépris. Je suis riche, je suis millionnaire. Qui osera dire que cet argent n'est pas à moi? personne. Le baron Walter m'a désigné, dans son cœur, comme héritier, et les réserves qu'il a faites en faveur d'un inconnu sont soumises à mon appréciation. C'est moi qui suis seul juge. D'ailleurs, tant pis pour eux, je ne puis pas m'immobiliser ici. Ils sont en retard; je suis forcé de partir.
Et s'étourdissant ainsi par des sophismes, s'aveuglant par des lueurs chimériques, pour mieux dissimuler la route dans laquelle il s'engageait, Gérard n'admettait plus la possibilité d'une restitution. Le sort en était jeté; la fortune était à lui.
Il mit sous enveloppe la part réservée à M. Rosenheim, la confia au propriétaire de l'hôtel d'Angleterre, et, comme il fait bon prendre des précautions envers des gens que l'appât d'une grosse somme pourrait tenter, Gérard se fit donner un reçu.
Une heure après, il était, à côté de madame de Bligny, dans une berline de voyage qui les emportait avec rapidité. A mesure qu'on s'éloignait de Bade, Gérard, d'abord soucieux, inquiet, fiévreux, reprenait sa gaieté. Le remords s'évanouissait avec les tourbillons de poussière qui s'envolaient derrière chaque roue de la voiture. Il ne voyait plus que comme dans un brouillard la figure du vieux baron; et, comme il n'avait jamais vu M. Rosenheim, il ne pouvait pas s'imaginer ce revendicateur hypothétique.
La réalité, pour lui, était cette femme charmante, enlevée à ses préjugés, qui le nommait son mari; c'était ce luxe dont il croyait avoir acquis le droit d'user et de jouir. La réalité, c'était son rêve de fortune et de gloire; car les mélodies lui revenaient à l'esprit; il se sentait de l'inspiration.
Je sais bien que quelquefois un spasme l'étreignait à la gorge, que quelque chose de semblable à un sanglot se tordait dans sa poitrine et montait jusqu'à ses lèvres; mais c'étaient là des mouvements nerveux, sans raison et sans conséquence, dont il était le premier à se moquer, et qui échappaient à Angèle.
La baronne prenait son bonheur avec plus de calme. Quelque chose lui déplaisait dans ce mariage. Elle avait voulu une union disproportionnée, et voilà que son héros ne lui laissait pas le mérite de l'enrichir. Il avait été pauvre, il est vrai; elle avait pu apprécier son courage, son désintéressement, son amour. Mais enfin il était désormais un millionnaire!
Le mariage fut contracté selon la loyale promesse de la baronne dès qu'il se trouva un moyen légal et expéditif de conclure. La lune de miel, c'est-à-dire ce qui en restait, s'écoula dans un charmant château, loué pour la fin de la saison, à dix lieues de Bade. Les premiers temps de ce séjour furent un apaisement réciproque.
Angèle n'avait plus à choisir; elle n'avait qu'à s'arranger, pour être heureuse, avec le mari de son choix. Gérard se voyait préservé et défendu par son mariage. Il lui semblait que son bonheur le rendait inviolable, et que ce Rosenheim tant redouté, s'il se montrait, reculerait et s'attendrirait devant une union pareille. Il osa, dans les premiers jours, se laisser aller avec insouciance, avec oubli, aux charmes de sa vie nouvelle. Des promenades, de longues causeries insensées et sublimes, des improvisations au piano dans lesquelles Gérard épanchait son cœur, des coquetteries à huis-clos, tous les enfantillages, toutes les piétés, toutes les gourmandises du bonheur occupèrent les premiers jours.
Une fois pourtant, Angèle, qui se promenait au bras de Gérard, lui dit en bâillant un peu:
—Je voudrais bien savoir ce qui se passe.
—Ne le sais-tu pas? répondit Gérard qui était, ce matin-là, un peu rêveur; le monde n'a pas changé depuis notre retraite. Est-ce que la solitude te pèse?
—Non; mais enfin il est bon de ne pas vivre en ermites. Si nous retournions à Bade?
—Pourquoi faire?
—C'est là, mon ami, que nous nous sommes juré d'être l'un à l'autre; c'est là que tu as rencontré un bienfaiteur.
—Un bienfaiteur! s'écria Gérard qui bondit comme si ce mot eût été une injure. Oh! je ne lui demandais pas son bienfait; il pouvait le garder.
—Tu ne le lui demandais pas, sans doute; tu étais trop généreux, trop désintéressé. Mais enfin tu l'as reçu, et j'avoue que, pour ma part, je ne suis pas ingrate. On est fou quand on rêve une chaumière. Il n'y a pas d'assez beau palais pour le bonheur. J'ai toujours trouvé impossible qu'on s'estimât heureux d'un grenier, surtout quand on a vingt ans! Remercions Dieu, mon ami; il nous a protégés, et ce vieillard nous a bénis.
Gérard était taciturne. Il pensait que cette femme adorable, qui l'estimait pour son désintéressement, le repousserait avec horreur si elle savait la vérité, et ne verrait plus en lui qu'un escroc de la plus basse espèce. Il avait violé la parole donnée à un mourant; il avait manqué à sa propre conscience.
—Angèle, dit-il en essayant de sourire, si le baron Walter s'était trompé en me laissant cette fortune, si je découvrais qu'il m'a pris pour un autre!
—Eh bien, il faudrait te dépouiller pour cet autre; mais quelle vraisemblance! il ne s'est pas trompé!
—Aussi n'ai-je rien à craindre, conclut Gérard.
Un silence suivit cet échange de paroles. Peu de temps après, Angèle reprit:
—Je suis en train de te découvrir un défaut, Gérard.
—Oh! si tu n'en vois qu'un, tu ne vois rien.
—C'est que celui-là est capital. Tu aimes l'argent.
—Moi! s'écria l'artiste qui sentit le froid de la peur le pénétrer jusqu'aux os.
—Oui, tu es avare. Je remarque que tu dépenses avec peine, et que tu enfouirais volontiers le million du bonhomme Walter pour n'y pas toucher.
—Quelle plaisanterie! dit Gérard. Je le jetterais bien plutôt par les fenêtres, ce million-là.
—Ne le jetons pas et ne l'enfouissons pas, mais profitons-en, mon ami.
Ces entretiens se renouvelaient fréquemment. Angèle s'étonnait et riait parfois des allures embarrassées de son mari en présence de sa nouvelle fortune. Elle attribuait à une inexpérience, à une sorte de pudeur de nouvel enrichi ce qui tenait à d'autres sentiments. Elle en riait; mais parfois elle s'en alarmait: elle se demandait si cette âme d'artiste n'était pas tout simplement une âme de thésauriseur. Ses craintes, à cet égard, au lieu de diminuer, augmentèrent encore quand elle vit, au bout de quelque temps, que Gérard affectait dans sa toilette, dans tout ce qui tenait à lui personnellement, une simplicité, une sorte d'abandon, réservant tout le luxe pour sa femme; et quand elle remarqua, parmi ses papiers de musique, des chiffres, des calculs qui lui prouvaient qu'au lieu d'user ses revenus, son mari les capitalisait et se livrait à des placements, entretenant avec des agents de change de Paris une correspondance fort active.
L'humeur de Gérard changeait aussi beaucoup. Plus d'abandon, de douce intimité. Il paraissait inquiet, toujours aux aguets. Les sonnettes le faisaient bondir. Il prétendit que c'était à cause de leur timbre criard qui agitait ses nerfs artistiques; mais on eut beau changer, le timbre n'y faisait rien.
Après trois mois, ce couple si gracieux, si touchant, si digne d'envie quand le baron Walter lui demandait sa bénédiction, eût fait pitié. Angèle, triste, fière dans ses désillusions, cachant ses blessures et ne laissant pas paraître de repentir pour un mariage qu'elle avait voulu, en était arrivée à craindre pour la raison de Gérard, tant elle trouvait d'agitation, de fièvre continue dans celui-ci. Le musicien pliait sous le remords. Il avait honte de lui et, en même temps, il se sentait attiré, fasciné par cette fortune dont il n'osait se séparer. Il avait résolu de la doubler en peu de temps par des spéculations, s'imaginant qu'il aurait la conscience plus libre s'il rendait le million intact, tout en l'ayant préalablement utilisé pour s'enrichir lui-même; mais ses spéculations n'étaient pas toujours heureuses. Il perdait au lieu de gagner, et alors à l'angoisse de se sentir contraint de restituer à la première apparition de Rosenheim se joignait l'horreur de penser qu'il ne pourrait pas même rendre intacte une fortune qu'il avait intentionnellement volée.
Tels étaient la situation d'Angèle et de Gérard, et le supplice de ce dernier quand, un beau jour, il résolut d'en finir avec ses remords et, au besoin, avec la vie.
Le courage manquait à Gérard, précisément à l'heure où il semblait logiquement devoir lui rester. Car enfin, puisque M. Rosenheim avait eu devant lui le temps nécessaire pour aller en Amérique et en revenir, et qu'il n'était pas revenu d'une simple excursion en Europe; puisque Gérard n'avait pas reçu la visite de l'héritier, et que sa retraite à lui, Gérard, dont il n'avait pas fait un mystère impénétrable, n'avait pas encore été troublée, tout portait à croire que l'héritage lui était bien et dûment acquis, et qu'il n'aurait plus de comptes à rendre.
Pourtant jamais l'existence ne lui avait paru si odieuse. Sa sensibilité excitée, irritée par la pensée perpétuelle de l'acte honteux qu'il avait commis, était arrivée à un paroxysme qui le précipitait dans des abattements et dans des désespoirs terribles au moindre choc extérieur. Angèle avait peur de lui. Hâve, les cheveux en désordre, les vêtements négligés, craignant de dépenser, pour se vêtir, la fortune indûment acquise, errant tout le jour, n'osant tenter aucune démarche pour se dépouiller de cet héritage et ne voulant pas le garder, Gérard se sentit au fond de l'abîme, quand, un soir, il remarqua dans les yeux d'Angèle un vague effroi mêlé d'un peu de mépris.
C'était à la fin du dîner; les deux époux étaient silencieux l'un devant l'autre. Gérard comptait sur ses doigts. Angèle soupirait en le regardant.
—Que peut-il avoir? se demandait-elle. Quel mystère? Est-ce un crime? une faiblesse? mon ami, lui dit-elle enfin, est-ce que tu composes?
—Non, je calcule.
—Je n'ai pas épousé un artiste, se disait-elle avec découragement, mais un banquier.
—Vous avez épousé un millionnaire, madame, dit gravement et bêtement Gérard.
—Eh! qui vous parle de votre million? qui songe à vous le disputer? En vérité, mon ami, on dirait que vous m'avez fait trop d'honneur en m'associant à votre fortune.
Ces mots furent prononcés avec une ironie stridente.
Gérard, si absorbé qu'il fût, ne s'y trompa point.
—Pardon, Angèle, répliqua-t-il avec douceur, je suis bien malheureux. Je ne suis pas habitué à manier une fortune pareille...
—Prenez un intendant, mon ami, un comptable, qui vous voudrez; débarrassez-vous de tous ces ennuis qui vous rendent fort maussade. Ou bien, si vous ne pouvez pas porter le fardeau de nos deux fortunes, prenez la vôtre, laissez-moi la mienne, et séparons-nous.
—Nous séparer! c'est vous, c'est toi, Angèle, qui as prononcé ce mot pour la première fois!
—Parce que c'est moi, monsieur, qui ai commis la faute de vous forcer presque à m'épouser. Il est bien juste que vous ayant enchaîné, je vous délivre.
—Me délivrer! tu ne sais pas ce je ferais de ma liberté.
—Vous ne pouvez pas en faire un plus mauvais usage que celui que vous faites aujourd'hui de votre prison.
—Vous êtes cruelle, madame.
—Moi! je suis juste. On dirait, mon ami, que nous jouons un proverbe: le Savetier et le Financier. Depuis que vous avez un trésor vous ne chantez plus. A votre place, j'irais rendre au financier son argent dont je ne sais que faire. Je vous aimais mieux au temps de vos chansons. Elles n'étaient pas toujours gaies, mais du moins leur tristesse n'était pas sans charme. Tandis que cette hypocondrie du million!... c'est à faire périr d'ennui. Ce baron Walter est un esprit satanique, un personnage d'Hoffmann. Il a vu deux êtres qui paraissaient ou qui voulaient s'aimer.—Vite, a-t-il dit, troublons cette joie!—Il a réussi. Dites donc, Gérard, est-ce que le baron n'aurait pas laissé par mégarde quelque héritier auquel vous pourriez repasser l'héritage?
Gérard ne voulut pas en entendre davantage. Il se leva comme un fou et sortit de la salle. Angèle ne put retenir une larme en le suivant des yeux.
—Je sens que je l'aimais bien, se dit-elle...
Quant au malheureux musicien, il courut dans le jardin.
—C'est fini! c'est fini! répétait-il à chaque pas, je n'ai plus qu'à mourir. Le mépris de moi-même, le mépris d'Angèle, c'est trop. Je ne veux plus de la vie au prix de cette torture.
Quand la course l'eut un peu calmé, il monta dans sa chambre, s'y enferma, et se tenant la tête dans les deux mains, il essaya de réfléchir.
—Avant de mourir, se dit-il, il faut que je répare ma faute; mais comment? Où trouver cet insaisissable Rosenheim? Et quand je l'aurai trouvé, où rencontrer l'héritier véritable, s'ils ne se sont pas vus? Ah! qu'importe? je ne veux plus de cette fortune, pas même de la part que m'a faite cet infernal baron. Je vais emporter tout à la maison de jeu. Je jouerai tout. Si je perds, c'est bien! Je n'aurai qu'à me tuer. Si je gagne, je dépose intacte toute la somme que j'ai reçue, j'envoie le reste à ma mère, et je meurs. Dans les deux cas, la mort est au bout... Mais Angèle! écrivons-lui d'abord la vérité. Quand je serai mort pour l'honneur, elle excusera peut-être le crime commis pour l'amour. Gérard, un peu calmé par cette résolution, écrivit, en effet, une longue lettre à sa femme. Il lui raconta tout dans les plus entiers détails; il n'omit rien de ses tentations, de ses troubles, de ses remords. Quand il eut achevé cette lettre humide de ses larmes, froissée par ses baisers, il la cacheta, la plaça sur la cheminée, d'une façon apparente, prit une paire de pistolets, un portefeuille rempli des valeurs de la succession, et sortit.
En passant sous les fenêtres d'Angèle, il vit de la lumière.
—Elle pleure peut-être, dit-il, va! tu deviendras libre, tu seras veuve encore une fois; j'aurai été un mauvais rêve dans ta vie. Mais on sort des rêves. La réalité seule ne cède qu'à la mort. Adieu! adieu!
Et il envoyait les baisers les plus ardents à la fenêtre éclairée.
Il n'était que huit heures du soir. Gérard se rendit à la station voisine, et à neuf heures le chemin de fer le déposait à Bade. Il se précipita vers la maison de conversation, entra, en heurtant tout le monde, chercha une place autour du tapis vert; puis, dans sa préoccupation, voulant mettre devant lui son portefeuille, il chercha dans la poche de droite, au lieu de puiser dans la poche de gauche, et tira un de ses pistolets qu'il plaça sur la table.
—Prenez donc garde, monsieur, vous vous trompez, lui dit à l'oreille un de ses voisins.
—Vous croyez, répondit Gérard, qui remit avec le plus beau sang-froid son pistolet dans sa poche, et tira, sans se tromper de nouveau, le portefeuille qui renfermait sa fortune.
—Diable! il paraît que vous êtes en fonds aujourd'hui, s'écria une voix derrière lui.
Gérard tressaillit, se retourna, et reconnut le journaliste au keepsake.
—Vous ici? demanda-t-il.
—Parbleu! vous y êtes bien! La saison n'est pas finie; nous avons encore au moins huit jours. Je viens tenter la chance avec le prix d'un second volume que j'ai promis. Mais, si je perds, je suis bien décidé à m'en tenir là, d'autant plus que les éditeurs commencent à se blaser sur les souvenirs des eaux.
—Eh bien, mon cher ami, dit Gérard, mettez-vous à côté de moi et tentons la fortune de concert.
—Oh! vous! vous pouvez perdre, reprit le journaliste en s'attablant, car il paraît que vous vous noyez dans le Pactole! Avez-vous lu le beau feuilleton que j'ai fait sur votre mariage, sans vous nommer tout à fait, bien entendu? car moi je ne suis pas de ces chroniqueurs comme il y en a tant; je suis discret. Je ne nomme jamais les héros des histoires que je raconte.
—Eh bien, si vous restez jusqu'à la fin de la nuit, je vous promets une histoire fort intéressante pour votre prochain courrier, dit Gérard en souriant.
—Ah! bah! un scandale?
—Non, une expiation! vous verrez. Mais, silence! laissez-moi faire mon jeu!
Et Gérard prit quelques billets de mille francs qu'il déposa devant lui.
—A propos, lui dit encore le journaliste, j'étais tantôt à l'hôtel d'Angleterre, quand on vous a demandé. Le maître de l'établissement était d'abord fort embarrassé pour donner votre adresse. Mais il s'est rappelé que vous aviez loué le château de X*** pour passer votre lune de miel, heureux gaillard!
Gérard avait pâli affreusement. Par un mouvement rapide, il amena à lui les billets de banque qu'il éparpillait sur la table, comme s'il eût craint que les regards des assistants ne les missent en feu.
—Ah! on m'a demandé! balbutia-t-il en cherchant sa salive et comme s'il étranglait.
—Oui, deux voyageurs.
—Deux voyageurs! un Allemand peut-être!
—Ma foi, oui, un Allemand; il s'est nommé, je crois; il s'appelle Ros...
—Rosenheim, s'écria Gérard en se dressant tout à coup.
—C'est, en effet, ce nom-là!... Mais, qu'avez-vous donc? Eh bien, vous ne jouez pas?...
Gérard écartait la foule et sortait du salon sans entendre. Quand il fut dehors, il chancela et fut obligé de s'asseoir sur les marches du perron.
—Il est arrivé, disait-il; voilà l'expiation! Eh bien, j'aime mieux qu'il en soit ainsi. Je serai plus libre de mourir, quand j'aurai tout restitué.
Après quelques minutes de repos, il rassembla tout son courage et parvint en se traînant, en s'arrêtant à chaque pas, en s'appuyant aux murailles, jusqu'à l'hôtel d'Angleterre. Le même maître d'hôtel, qui lui avait donné, quelques semaines auparavant, une si violente émotion, vint encore, avec le même sourire, au-devant de lui.
—M. Rosenheim! hurla Gérard qui s'était préparé, pendant toute la route, à articuler ce nom.
—Il est ici, monsieur, répondit l'infaillible maître d'hôtel.
—Conduisez-moi vers lui, murmura le pauvre artiste qui craignait de tomber raide mort.
—Ah! M. Rosenheim! ce voyageur arrivé de France! Je confondais avec un autre, reprit le prototype du maître d'hôtel. Il était ici il y a une demi-heure; mais comme il a appris que M. Gérard, son ami, n'habitait plus Bade, il a pris le premier convoi du chemin de fer, et maintenant il doit être arrivé à X..., où ils avaient hâte d'arriver.
—M. Rosenheim n'était pas seul, n'est-ce pas?
—Non, monsieur, ils étaient deux.
—C'est bien cela, se dit Gérard qui se dirigeait vers la porte. Il avait avec lui un jeune homme?
—Je n'ai pas vu ce jeune homme, mais j'ai vu une dame... peut-être madame Rosenheim!
—Une femme! c'était une femme que je volais et que je ruinais, pensa le pauvre artiste avec un mouvement d'horreur. Je suis souffrant, monsieur, et je crains de n'avoir pas la force de me rendre à la station; veuillez me faire conduire.
—Précisément, monsieur, voilà les voyageurs qui partent.
Quelques minutes après, Gérard était à la station, et prenait le chemin de fer qui le ramenait chez lui.
Quand il eut quitté le convoi, au village de ***, et quand il aperçut de loin le château où M. de Rosenheim l'attendait sans doute, le courage, qui semblait l'abandonner, lui revint tout à coup comme par enchantement.
—Soyons un homme, se dit-il. J'ai commis une lâcheté, mais je vais la réparer. Probablement l'arrivée de ces étrangers a tout appris à Angèle, si la curiosité ne l'a pas conduite dans ma chambre, et si elle n'a pas lu ma lettre. Quand j'aurai remis à ce Rosenheim et à cette femme la fortune qui leur revient, je demanderai pardon à Angèle, et j'accomplirai ma résolution. Mais la seule façon de lutter contre le mépris, c'est d'être inflexible envers moi-même, et de ne pas craindre de m'humilier par un aveu... Avouer? est-ce que je puis faire autrement? Ah! j'éprouve, à l'approche de l'expiation, un bien-être, un apaisement! L'honnêteté est donc quelque chose!
Tout en parlant, Gérard s'avançait à grands pas. Il regardait avec attendrissement cette maison où il avait pensé trouver tant de bonheur, où toute sa vie, toute son ambition étaient concentrées. Il lui semblait que la nuit mettait des ombres plus obscures sur la façade, comme si elle la couvrait déjà de deuil.
—Ce deuil, se disait-il, qui le portera? Angèle, oui, pendant quelque temps, parce qu'elle m'a aimé et qu'elle me plaindra. Et puis parce que le noir lui va bien! Mais peu à peu, elle m'oubliera. Qui sait? elle se remariera encore! Je ne resterai plus dans son souvenir que comme quelques mois de cauchemar ou de maladie. On dira: Il méritait d'être un honnête homme, mais la vanité en fit un coquin! Et ce sera tout. Personne ne me pleurera, excepté, là-bas, ma mère.
Il était devant une barrière en bois qui fermait l'entrée du parc.
—Allons, dit-il, je ne repasserai plus par ce chemin.
Il arriva, par une allée couverte, jusqu'au château. La fenêtre d'Angèle n'avait plus de lumière.
—Ne les aurait-elle pas vus? se demanda-t-il. Aurait-on respecté sa retraite? ou plutôt, n'est-elle pas dans ma chambre occupée à lire ma lettre de ce soir? Après tout, il est bien tard; Rosenheim n'a peut-être pas voulu nous déranger à minuit; il pensait bien que je ne lui échapperais pas... C'est cela! on ne sait rien encore. Rentrons; et, au point du jour, j'irai trouver Rosenheim.
—D'où venez-vous donc, mon ami? lui demanda tout à coup une voix argentine, au-dessus de sa tête.
Gérard leva les yeux. Angèle était à sa fenêtre. Elle avait éteint la lumière, afin de le mieux guetter sans doute. Il trouva, aux douces paroles de sa femme, un effroyable accent d'ironie.
—D'où je viens? dit-il: de me promener.
—Pourquoi sortir si longtemps, si tard, et nous exposer à des inquiétudes? continua Angèle avec la même douceur. En votre absence, il nous est venu des hôtes.
Gérard sentit son sang lui monter au cerveau:
—Je vais être frappé d'apoplexie, pensa-t-il; tant mieux, cela évitera toute explication.
—Eh bien, vous ne répondez pas, monsieur, continua Angèle. Hâtez-vous, car nos voyageurs sont fatigués, et je crains bien que dans quelques minutes vous ne puissiez plus leur parler; je les ai laissés dans la bibliothèque.
Gérard ne s'appartenait plus. Il n'avait plus de volonté. Une force invincible le poussait: il entra, gravit l'escalier comme un automate en faisant retentir les marches sous ses pas, et il arriva devant la porte de la bibliothèque; là, il se dit tout bas:
—Dieu ne veut pas que je meure avant la honte. Que sa volonté soit faite!
Puis, poussant la porte entr'ouverte, il entra.
Une exclamation joyeuse et un cri retentirent à la fois. Une femme se précipita dans ses bras:
—Gérard! mon enfant! comme tu as tardé! lui dit-elle.
—Ma mère! vous ici? s'écria Gérard, qui sentit ses cheveux se dresser sur sa tête.
—Oui, moi, qui ai voulu accompagner M. Rosenheim.
A ce nom, Gérard baisa convulsivement le front de sa mère, et se tourna vers le terrible M. Rosenheim.
C'était une honnête figure d'Allemand, au menton carré, aux joues rondes, aux cheveux grisonnants, aplatis sur les tempes. Si jamais la vengeance eut un aspect paterne, ce fut bien quand elle prit un masque pareil. Gérard voulut s'avancer, il était blême, ses lèvres s'agitèrent sans qu'il pût dire un mot.
—Remettez-vous, mon cher monsieur, dit M. Rosenheim, en lui serrant les deux mains. Nous commencions à craindre de ne pas vous embrasser ce soir. Ah! vous pouvez vous vanter de m'avoir fait faire un terrible voyage... d'autant plus que mon voyage était inutile. Ah ça! expliquez-moi donc par quel moyen miraculeux mon vieil ami Walter a découvert que vous étiez son fils...
—Son fils, dit Gérard, qui se sentit touché par une étincelle électrique, et qui ne sut pas s'il devait crier ou rire.
—Oui, son fils, ajouta madame Gérard en s'avançant. Tu ne m'as jamais parlé de ton père, mon enfant; tu ne voulais pas me faire rougir. Moi j'avais changé mon nom de théâtre, celui que je portais quand je jouais à Francfort. Je croyais que le passé était à jamais derrière nous. Je ne pensais guère qu'un jour on viendrait me le remettre sous les yeux, en me demandant mon nom. Mais je ne m'en plains pas, puisque tu trouves une fortune... Mais comment as-tu su que le baron Walter?...
—Je n'en sais rien, le hasard, quelque chose de mystérieux; mais je suis bien son fils, n'est-ce pas ma mère? n'est-ce pas, monsieur?
Le vieux Rosenheim sourit sans répondre; il semblait dire: demandez à votre mère. Madame Gérard renouvela ses protestations, et en quelques mots mit son fils au courant. Quant à celui-ci, écrasé, épuisé d'émotions, il avait peur maintenant de mourir de joie, de suffoquer. Il faisait des efforts inouïs pour retrouver son sang-froid.
—C'est égal, dit le vieil Allemand, c'est mal à vous, mon ami, de n'avoir pas écrit à votre mère que vous saviez tout, que monsieur Walter était mort, et que vous héritiez. Vous me laissez ma part dans un coin, et puis bon voyage! Vous partez sans me dire où vous allez. Ah! les amoureux! les beaux égoïstes! Mais nous vous pardonnons. Savez-vous, mon ami, que j'ai eu toutes les peines du monde à trouver madame votre mère, et que sans un feuilleton qui racontait votre aventure avec le baron, en vous désignant presque, je n'aurais jamais été sur la voie: je m'informai, je questionnai; j'eus votre nom, votre adresse. Je trouvai madame votre mère; elle m'avoua tout, et nous voilà.....
—Ah! mon ami! ah! ma mère! si vous saviez quelle joie! Pourquoi ma femme n'est-elle pas là?
—Ta femme, mon fils, je t'en parlerai; elle se plaint un peu de toi; elle t'a cherché dans toute la maison, dans ta chambre.....
—Dans ma chambre? interrompit Gérard qui se souvint de sa lettre d'adieu. Il courut comme un fou, et faillit mourir de joie en retrouvant sur la cheminée la lettre non ouverte, le cachet intact.
—Dieu soit loué, dit-il en tombant à genoux et en joignant les mains avec ferveur, elle ne saura rien. Le secret de ma honte restera dans mon cœur.
Il se releva comme un ressuscité. La vie, une vie nouvelle l'envahissait par tous les pores. Après avoir embrassé mille fois sa mère, causé et fumé avec M. Rosenheim, il alla doucement frapper à la porte de sa femme.
—Qui est là? dit Angèle.
—Un coupable, un suppliant qui est à genoux, et qui va se tuer si tu ne pardonnes pas au plus sincère repentir.
Il entendit un bruit de verrou. Angèle ouvrit la porte, et, à demi vêtue, se jeta dans ses bras.
—Tu es guéri, lui demanda-t-elle, bien vrai?
—Regarde! et il essuyait ses yeux pleins de larmes avec les jolis doigts de sa femme.
Le lendemain, comme un gai rayon du soleil entrait dans la chambre:
—Voyons, dit la jeune femme, me raconteras-tu le sujet de ta mélancolie passée, de ta sombre humeur?
—C'est impossible, balbutia Gérard.
—Pourquoi? Il n'y a qu'une infidélité que tu ne puisses pas m'avouer.
Gérard eut une vision. Il lui sembla que le moyen de racheter sa faute et de s'attacher invinciblement à jamais le cœur d'Angèle, c'était de tout lui avouer. Il eut la noble confiance de lui raconter tout.
—Ce n'est que cela, dit Angèle qui avait pourtant pâli un peu à ce récit. Comment! je pouvais te perdre! comment! cette nuit même! Oh! tu ne m'aimais pas. Si, au contraire, je te pardonne ta vilaine action, parce que tu m'aimais et que tu voulais mourir. Va! ne crains pas que je te reproche jamais cette faute; tu as souffert, tu as lutté; c'était moi qui, par mes coquetteries, te poussais à l'abîme.
Et Angèle attendrie serra avec force son mari contre son cœur. Quelques instants après:
—A quoi tient la vertu? reprit-elle en souriant. Dire que je pouvais être la femme d'un coquin!

—Dites la veuve!
Gérard et Angèle furent-ils heureux? eurent-ils beaucoup d'enfants? Je l'ignore; mais je le présume. Il y a quelques semaines, Angèle, m'a-t-on affirmé, disait avec la coquetterie d'une Parisienne ennuyée d'être heureuse à une de ses amies qui vantait les mariages d'argent:
—Ah! la vie est une série de déceptions; il n'y a pas de joie complète. On croit faire la fortune d'un pauvre artiste sans le sou, et on épouse un millionnaire!
Je connais beaucoup de femmes à Paris et ailleurs qui ne craindraient pas d'affronter cette déception.
Stanislas Robert, en finissant, crut devoir s'incliner avec modestie, comme s'il eût voulu récuser d'avance l'explosion des bravos. Mais le succès avait été trop réel, et chacun des auditeurs était trop vivement préoccupé de l'idée de chercher un sens, un secret, un aveu, dans ce récit, pour donner place aux applaudissements vulgaires. Personne ne battit des mains, chacun interrogea à son tour:
—Êtes-vous bien certain qu'Angèle ait angéliquement pardonné à son mari? demanda madame Julie Vernier. Pour moi, j'en doute.
—Et moi je n'en doute pas, interrompit la señora Mendez: la passion vraie purifie tout.
—Pour ma part, insinua sir Olliver, je ne crois pas à la passion des artistes ni au pardon des dames.
—S'il y avait eu moins de vanité et par conséquent plus d'amour réel dans cette union, dit Frantz, les tentations ignobles n'auraient pas effleuré votre héros. Tout le monde peut aimer, même les artistes, et l'amour vrai ne conseille jamais de bassesse.
—Vous êtes sévère, dit le peintre.
—Que t'importe? reprit Ottavio, tu nous as déclaré que ce n'était pas là ton histoire.
—Sans doute, mais j'en suis l'historien; et si la moralité vous en semble immorale, je deviens complice.
—Et vous, que pensez-vous de votre héros? demanda vivement l'Espagnole.
—Oh! vous ne m'embarrassez guère. J'en pense du mal. Mais je crois que, pendant son intervalle de coquinerie, il fut un escroc naïf. Les subtilités de raisonnement prouvent la profondeur de ses remords et son honnêteté primitive.
—Décidément, il y a de l'indulgence dans votre sévérité, reprit la Française.
—Je vois, mesdames et messieurs, dit le peintre en souriant, que si vous ne me soupçonnez pas d'être à la fois mon historien et mon héros, vous êtes disposés à croire que j'ai prêté quelque chose de moi à mon personnage. Eh bien, je l'avoue, je lui ai prêté... ma bourse. Je lui ressemble par le désir de la fortune et de la gloire. Quant au reste, l'analogie n'est pas saisissante. Je ne suis pas marié, je n'ai pas hérité de millions, et la femme qui doit me tendre le rameau d'or est encore inconnue. Mais il y a des rêves qui ont la violence des souvenirs. Je me suis souvent demandé si la grande probité qui gesticule pour cent mille francs offerts en public, et qui se livre à des mouvements d'Hippocrate refusant les présents d'Artaxercès, pour quelques billets de banque, n'avait pas plus d'héroïsme quand elle se cramponnait seule, dans le silence et dans le secret de la conscience, à quelques dernières branches de la vertu. J'ai voulu, avant de m'embarquer pour l'Australie, me raconter la maladie du million. Cette histoire n'est pas authentique, et pourtant elle est vraie. Je ne sais pas si le musicien en question n'est pas un peintre ou un littérateur; mais je sais qu'il y a tous les jours, à toute heure, quelque part, un malheureux, affamé de joie, ivre d'orgueil, qui fait les yeux doux à un coffre-fort, et qui adore d'un amour platonique les petites images de la Banque. La limite exacte de l'intérêt et de la passion désintéressée; le point où le sentiment n'est plus un calcul, et où le calcul devient un sentiment; voilà la véritable terre inconnue. C'est un petit essai de géographie morale que j'ai voulu tenter. Ne voyez pas autre chose dans mon récit.
—Tant pis! dit en soupirant la belle Dolorida.
—Voilà un tant pis que je place dans mon cœur avec le pas encore d'hier matin, répondit en riant Stanislas Robert. Je suis bien désolé de n'avoir aucune peccadille honteuse à confesser. Mais l'occasion m'a peut-être manqué, et si vous voulez bien m'honorer d'une mauvaise opinion!.....
—Mais si ce n'est pas votre histoire que vous nous avez racontée, nous n'avons pas fait assez honneur à votre imagination. Applaudissons, mesdames, dit madame Vernier.
—Hourra! s'écria l'Anglais.
Tout l'auditoire applaudit; Stanislas se leva et fit un grand salut.
—Je suis on ne peut plus sensible à cette marque désintéressée d'approbation que vous attendez sans doute aussi de moi, et que je promets de rendre à chacun de vous à l'occasion.
—Le traître! Il doute de tout, dit en souriant le mélancolique Frantz.
—Vous voyez bien que non, puisque je crois tout possible, au contraire.
—Vous ne doutez pas du moins de la puissance de l'or? demanda l'Espagnole.
—Je ne doute pas non plus, madame, de la puissance de l'amour.
—Mais, qui l'emporte du cœur ou de l'argent?
—Parbleu! vous me posez là, en plaisantant, la grande question moderne. Voilà, au fond, tout le problème social. On se dispute dans toutes les langues, et l'on s'égorgille sous toutes les latitudes, pour savoir qui l'emportera, ou du cœur, qui s'appelle, à l'occasion, la patrie, la justice, la liberté; ou de l'argent, qui s'appelle communément l'égoïsme, la tyrannie, l'orgie. Il n'y a pas de questions politiques; il n'y a que des questions sentimentales. Aimer ou haïr! voilà l'alternative des peuples et des rois.
—Enfin, êtes-vous pour l'amour ou pour la haine? demanda encore l'Espagnole.
—Je vous dirai volontiers ce que Figaro écrivait sur ses tablettes, en changeant seulement les termes:
—J'entends, repartit gaiement madame Vernier, vous vous inclinez devant la richesse, et l'amour s'incline devant vous. Vous voulez être à la fois don Juan et le marquis de Carabas.
—Je n'ai pas dit cela; c'est Beaumarchais qui m'a trompé par sa comparaison. Je voulais faire comprendre que l'amour et l'argent sont deux pouvoirs, et que je suis pour l'équilibre des pouvoirs.
—L'argent est la chambre des lords, dit sir Olliver avec un accent qui faisait de sa plaisanterie un calembour, et l'amour est la chambre des communes.
—L'amour, dit Ottavio avec un peu d'ironie, n'est souvent qu'une chambre étoilée; on y débite de beaux discours et de plates homélies; on y rend des sentences despotiques; on y condamne à mort; et l'argent est la prison où l'amour met ses victimes.
—Prenez garde d'embrouiller le débat par des définitions, reprit la jeune Française. L'amour se prouve et ne se définit pas.
—Nous n'avons pourtant rien de mieux à faire qu'à définir, dit le peintre.
Les dames sourirent.
—L'amour, dit l'Allemande en levant ses beaux yeux au ciel, mais de façon à rencontrer le regard de Frantz, c'est l'Ile des Rêves; on y aborde parfois, comme dans un naufrage, mais les fleurs y sont plus belles, la verdure y est plus douce que partout ailleurs. On y vit par l'espérance.
—Et on court aussi le risque d'y mourir de faim, ajouta sir Olliver, qui n'avait encore fait que deux repas depuis le matin.
—Complétez l'image par ce détail: on y écoute des histoires saugrenues, et on y rêve des histoires merveilleuses, repartit Stanislas.
—Vous êtes modeste, monsieur, dit la señora Mendez.
—Nous verrons à la fin. A ce propos, j'ai donné bravement l'exemple; qui veut me suivre?
Il se fit un profond silence.
—Sir Olliver n'avait-il pas promis?..... demanda Ottavio, après quelques minutes.
—Je promets toujours, dit l'Anglais.
—Ottavio, mon ami, tu t'es trahi, reprit Stanislas. Invoquer la complaisance de sir Olliver, c'est offrir la sienne.
—Je veux bien, répondit Ottavio; mais je ne sais pas d'histoires sentimentales.
—Eh bien, les histoires tristes ne font pas peur aux beaux yeux, n'est-ce pas, mesdames? Tu as toute la nuit pour réfléchir et pour préparer ton improvisation, à moins que, comme moi, tu n'aies pris la précaution d'un manuscrit.
—Dieu m'en garde!
—Ainsi, voilà qui est convenu, demain, à pareille heure, nous nous réunissons pour entendre Ottavio.
Le rendez-vous donné était le signal qui dispersait les habitants de l'île. Sir Olliver put aller, sans scandale, se livrer à une collation qui lui manquait. Madame Vernier le vit partir et devina ses projets:
—Bon appétit, lui dit-elle en riant.
Sir Olliver rougit, mais envoya un salut amical à la jeune Française qui l'avait compris, et, s'il l'eût osé, il lui eût offert une part de son goûter.
Ottavio resta couché sur l'herbe, et rêva jusqu'à la nuit.
Frantz et Carolina se mirent en quête de myosotis. Quant à la señora Mendez, elle s'approcha de Stanislas.
—Vous êtes joueur! lui dit-elle avec vivacité.
—Je l'ai été.
—Vous avez perdu beaucoup?
—Et souvent! oui, señora.
—Suis-je indiscrète en vous demandant la confidence de quelques-unes de vos émotions?
—En aucune façon. Et Stanislas lut dans les yeux ardents de l'Espagnole une curiosité presque fébrile. Est-ce que, vous aussi, señora, vous avez joué?
Dolorida poussa un profond soupir.
—Tenez, lui dit-elle, je suis Espagnole, c'est-à-dire catholique fervente. J'ai aimé Dieu avec passion; eh bien, j'en étais arrivée à le prier, d'une façon sacrilége, sur ce chapelet.
Et la belle madame Mendez tira de son sein un chapelet en ivoire dont chaque grain était formé d'un dé à jouer.
—Combien de fois, dit-elle, tandis que, d'une main, je touchais les cartes ou les enjeux, n'ai-je pas serré, de l'autre, ce chapelet contre ma poitrine, mêlant des prières folles à des calculs, invoquant tout bas, avec des supplications grotesques, le Dieu que j'offensais en croyant l'adorer! Oui, j'ai joué beaucoup; et je jouerais encore si..... Mais je vous dirai cela plus tard. Je veux que vous m'estimiez un peu avant de tout savoir.
—Vous estimer? ce n'est rien, dit Stanislas avec une galanterie empressée; je veux.....
—Oh! pas de fadeurs, monsieur le Français; je vous parle sans coquetterie; parlez-moi sans compliments. Je vous étudie depuis que le naufrage nous a réunis dans cette île. J'ai confiance en votre caractère. J'ai pensé qu'un artiste saurait comprendre les bizarreries, les excentricités qui feraient peur à nos campagnons..... Voilà pourquoi je vous demande des confidences.
—Rien de plus naturel, reprit le jeune peintre en souriant. Écoutez-moi donc.
Nous n'avons pas les mêmes raisons que la señora pour nous initier, plus que nous ne l'avons fait jusqu'ici, aux secrets de M. Stanislas Robert; et nous n'avons pas besoin d'écouter son récit pour apprendre plus tard les aventures de la belle Espagnole. Laissons donc les nouveaux amis à leur promenade, et revenons au rendez-vous général pris pour le lendemain.
Ce fut avec empressement que la petite colonie se réunit sur l'herbe. Le Décaméron devenait la vie normale. Ottavio ne se fit pas prier.
—Je ne vous raconterai pas, dit-il, quand il vit tous les auditeurs assemblés, une histoire sentimentale ou dramatique; c'est un conte, si vous le permettez, un véritable conte, absurde, fantasque, que je veux vous offrir. J'ai fait un pacte avec l'invraisemblable; je mourrais de la vie réelle; je vis de la vie de l'imagination; d'ailleurs, ce conte peut devenir de l'histoire.
—Espérons-le pour l'histoire! dit Stanislas. Tu es dans ton droit, mon cher Ottavio. Arioste et Boccace sont tes ancêtres.
—Prends garde, mon ami, tu vas me faire tort auprès de ces dames.
—Ottavio, tu abuses de la préface.
—C'est toi qui m'as donné l'exemple.
—Moi, c'était bien différent; je commençais; mais toi, qui viens après moi, tu avais un point de comparaison favorable; je nie ton excuse.
Ottavio ne voulut pas prolonger ce petit assaut de modestie; il se mit en mesure de tenir son engagement, et il débuta ainsi.
Il y avait une fois un prince, nommé Bonifacio, qui était bien le meilleur des hommes et le plus détestable des princes.
Je ne veux médire ni de l'humanité ni du pouvoir; mais il est certain que les vertus privées du prince Bonifacio nuisaient à ses vertus publiques, et qu'étant doué d'une bonté fabuleuse, il ne voulait pas qu'on forçât ses sujets à payer l'impôt, les voleurs à qui la prison pourrait être malsaine à rester sous les verrous, les soldats qui avaient affaire chez eux à rester sous les armes; et que, par suite de ces concessions, l'administration des finances, celle de la justice et celle de l'armée étaient dans un fâcheux état.
Or, tout le monde sait que, sans argent, les princes italiens n'ont pas de Suisses, et que tous les princes de la terre n'ont pas de serviteurs dévoués. Il est également constant que la justice a besoin d'être administrée, ne serait-ce que comme on administre les coups de bâton, et il n'est personne qui ignore qu'une armée est aussi indispensable à un ministre de la guerre qu'un lièvre pour faire un civet.
Mais le prince n'était pas un rigoureux observateur des formes monarchiques. Il en prenait à son aise, et tolérait qu'on agît de la même façon à son égard. Ses sujets ne le chicanaient pas à propos d'une vieille charte octroyée jadis par un de ses ancêtres, et lui, de son côté, se fût reproché amèrement de réclamer de ses apathiques administrés ce qu'il était en droit strict d'en obtenir. Une tolérance mutuelle confondait les devoirs, et les rênes du gouvernement formaient un écheveau assez embrouillé, que personne ne songeait à dévider.
Avec un pareil système, le prince Bonifacio était fort endetté, et il était obligé de recourir à de nombreux emprunts pour faire réparer les cheminées de son château. Le peuple n'était guère plus riche; l'argent qui ne circulait pas s'entassait dans les coffres de quelques financiers; les petits bourgeois se plaignaient du mauvais état des chemins qui conduisaient de la capitale aux guinguettes des environs, sans faire cette réflexion, que les belles routes se font avec de bons impôts autant qu'avec de bons cailloux.
Mais cet axiome était inconnu dans la principauté. Les ponts et chaussées n'avaient pas de représentants, et c'étaient les piétinements des passants qui traçaient les chemins.
Le prince Bonifacio XXIII se croyait néanmoins le bienfaiteur de son peuple, mais il n'en tirait pas vanité. Il demandait tous les matins à son surintendant de la police si tout le monde faisait ses quatre repas par jour; c'était là pour lui un scrupule de conscience. Le surintendant, dont la table était bien pourvue, rassurait le prince, et celui-ci, enchanté de réaliser à si peu de frais l'utopie de la poule au pot, digérait sans trouble et s'endormait sans cauchemar. On a pu dire de lui sur son épitaphe (la seule épitaphe princière véridique) qu'il ne cessait de rêver au bonheur de son peuple. Le sommeil étant en effet l'état le plus ordinaire du prince, les rêves étaient le seul travail de son intelligence; encore ne rêvait-il que parce qu'il ne pouvait s'empêcher de rêver, et ce travail était-il involontaire.
J'ai oublié de vous dire que les États du prince Bonifacio sont depuis longtemps effacés de la carte d'Italie. C'est donc un vieux conte que je vous débite, et les amateurs de synchronismes pourraient placer le règne du souverain en question parallèlement à l'histoire du roi d'Yvetot.
Tout allait donc mal dans la principauté. Cette négligence, en mettant l'incurie dans le gouvernement, mettait le désordre dans la société, non pas un désordre tumultueux, les habitants étant d'un naturel paisible, mais un désordre silencieux, pacifique, qui inclinait doucement, doucement la principauté vers la hideuse banqueroute.
Quelques esprits un peu plus vigoureusement trempés, des fils de famille qui avaient été élevés dans de grandes capitales, à Monaco, par exemple, ou qui avaient humé l'air vivifiant de quelque puissante république, comme celle de San-Marin, essayaient bien de susciter de l'opposition. Ils voulurent fonder un journal. Personne ne les empêcha. Mais la liberté étant poussée à ses dernières limites, et ce qu'on pouvait écrire restant toujours inférieur à ce qu'on pouvait dire, personne n'éprouvait le besoin de se déranger pour lire une feuille mal imprimée. Les fondateurs du journal n'eurent qu'un abonné payant, le prince Bonifacio; encore payait-il mal, et était-on obligé de lui présenter vingt fois la quittance avant d'en obtenir le montant.
Le parti de l'avenir était désespéré. Susciter une révolution, c'était un moyen fort cruel, qui répugnait aux mœurs douces de ces bons jeunes gens; d'ailleurs, il n'y avait pas de garde nationale dans la principauté. Et puis, pour avoir l'apparence d'un combat sérieux, il eût fallu recourir aux procédés en usage dans les pièces militaires, faire servir les mêmes figurants à représenter l'armée du prince et l'armée de la révolution. Or, ce moyen, excellent pour l'illusion du regard, est détestable dans la pratique révolutionnaire.
On avait bien essayé de mettre dans les intérêts du progrès le ministre de la cuisine du prince. Mais ce haut fonctionnaire ne voulait pas changer de régime, et redoutait les gens de l'opposition, comme s'ils eussent dû imposer le brouet noir, universel.
Bonifacio XXIII, averti de ces murmures de quelques-uns de ses plus jeunes sujets, prenait plaisir à ces velléités insurrectionnelles; il regretta beaucoup le journal, quand celui-ci, pour satisfaire à la demande de ses nombreux abonnés, cessa de paraître; surtout à cause des charades que cet organe de l'avenir avait cru devoir publier à la fin de chaque numéro, pour stimuler le zèle des abonnés et des patriotes. Mais il ne vint pas à l'idée du prince qu'il pouvait y avoir quelque satisfaction à accorder à ces jeunes gens.
Bonifacio était un homme d'habitudes; il voulait mourir dans son pli. Depuis vingt-cinq ans, il avait les mêmes ministres et la même garde-robe. Il lui était impossible de changer de mode.
—Après moi, disait-il, mon fils fera ce qu'il voudra.
Cela valait mieux que de dire: après moi le déluge. Mais Bonifacio parlait ainsi pour se débarrasser de toute réflexion; car il était, au fond, très-éloigné de l'idée de mourir et de laisser la place à son fils. Il aimait trop ce dernier, pour lui souhaiter un deuil aussi cuisant que le deuil d'un père, et il dormait trop bien sur son trône, pour songer à aller dormir sur le froid oreiller de ses ancêtres.
Quand je parle du trône, c'est par pure fiction. Bonifacio avait, depuis longtemps, prêté son trône classique, pour augmenter les accessoires du théâtre de la capitale, et le siége royal était une figure de rhétorique, absolument comme le fauteuil d'un académicien.
Bonifacio, je viens de vous le dire, avait un fils; il n'en avait jamais eu qu'un. Le ciel avait eu égard à l'apathie du prince, et n'avait pas voulu compliquer le gouvernement de ses États du gouvernement d'une famille un peu nombreuse. D'ailleurs, la princesse mère était morte quelques jours après la naissance de l'héritier présomptif, à la suite du repas des relevailles, qui avait été trop copieux.
Bonifacio avait pleuré sa femme comme un homme qui n'a pas l'habitude de pleurer, c'est-à-dire abondamment, bruyamment. Puis, il s'était consolé tout à coup, en vertu de cette loi de dynamique qui nous remet promptement en équilibre quand un brusque accident nous a dérangés, et qui fait que les caractères soumis à l'habitude en reviennent toujours à leurs antécédents. L'habitude du prince étant d'être heureux, il le redevint promptement.
Satisfait d'avoir un fils, de ne pas craindre que son sceptre tombât en quenouille, le prince s'en tenait à cet héritage légitime, et dérogeait à la dignité de son rang sur ce point, qu'il ne voulait pas de bâtards. Libre de la compagne qu'il conduisait de la main droite, il ne songea pas à embarrasser sa main gauche, et il mit ses deux mains dans ses poches, ou les croisa sur son ventre, avec la béatitude du meilleur des hommes, dans la meilleure des positions terrestres.
Lorenzo, le jeune prince, avait vingt ans. Il était beau comme un prince de conte de fées; ce n'était pas du tout le portrait de son père. Élevé jusqu'à l'âge de douze ans sous des habits de fille, pour économiser à la liste civile la dépense d'un précepteur, il avait eu une institutrice française qui s'était plu à développer en lui les sentiments tendres. Elle ne lui avait rien dit des devoirs constitutionnels d'un souverain, et si elle lui avait lu Télémaque, le jeune héritier s'était beaucoup moins préoccupé des sentences de gouvernement que de l'histoire de la nymphe Eucharis. Il connaissait tous les romans français, et ne demandait pas mieux que d'en faire à son tour en réalité.
Lorenzo était aussi libre que tous les sujets de son père, et les loisirs infinis que lui laissait l'absence de toute profession, ou même de tout semblant de profession sociale, il les employait à rêver, à se promener mélancoliquement, et à passer sous une certaine fenêtre de la ville, à certaines heures de la journée. Je n'affirmerais pas que Lorenzo ne commît point en secret des petits vers; je crois même, à parler franchement, qu'il était d'une certaine force sur l'art d'Apollon; mais il n'osait confier à personne, j'entends à personne de son sexe, les essais de sa muse. Son Altesse Bonifacio XXIII eût éclaté de rire et se fût bien moquée de ces goûts romanesques.
Le jeune prince aimait son père; mais on peut avouer qu'il eût voulu aimer un père un peu moins gras, un peu moins comique, un peu moins insoucieux des choses célestes et des choses terrestres, d'une majesté plus sévère, d'une bonté plus grave.
Le pauvre Lorenzo était un insuffisant convive; il n'entendait rien aux dés ni aux cartes. Comme le conseil des ministres se tenait à table et qu'on délibérait des affaires de l'État entre la poire et le fromage, Lorenzo voulait toujours dîner seul, à l'écart, par respect pour les secrets d'État. Quelquefois Bonifacio regardait en soupirant la place vide de son héritier présomptif, et disait, en faisant emplir son verre par son premier ministre:
—Lorenzo me désole; il n'entend rien à la politique!
La désolation du prince nécessitait quelques rasades; et c'est ainsi que Lorenzo faisait à la fois le malheur et le bonheur de son père.

Le parti des mécontents, qui se réunissait dans une hôtellerie médiocrement fournie, et qui, par conséquent, paralysé dans son essor par l'insuffisance de la carte et la mauvaise qualité des vins ne pouvait pas s'élever jusqu'à la conspiration, le parti des jeunes avait voulu enrôler Lorenzo et s'en faire un chef, c'est-à-dire un instrument. Mais Lorenzo avait décliné cet honneur par devoir; seulement, il avait cru bon d'essayer plusieurs fois d'exciter dans l'esprit de son père quelque activité, quelque désir de progrès.
—Ta! ta! ta! répondait Bonifacio, que me demandes-tu? Que je crée à mes sujets d'autres besoins que ceux qu'ils satisfont? Ce serait courir la chance de les rendre malheureux. Est-ce que je les tyrannise?
—Non, mon père; mais la sollicitude...
—Ne veux-tu pas, d'un autre côté, que je me mette la tête à l'envers pour leur procurer des distractions? Je les laisse tranquilles; qu'ils agissent de même à mon égard; et vive la liberté!
Lorenzo quittait son père avec découragement. Cette liberté des nonchalants qu'il entendait si plaisamment évoquer était l'ironie, la parodie de cette belle et forte liberté qui a l'initiative et l'activité, et il rougissait de honte en pensant que son pays n'occupait qu'un rôle ridicule dans l'histoire, et en voyant le vide se faire peu à peu dans les finances, et le trouble dans les esprits.
Ce n'est pas, je le répète, que monseigneur Lorenzo eût des idées de gouvernement. Mais il avait du cœur, et il y a toujours dans la tendresse, quelle qu'elle soit, une sorte d'illumination qui porte bonheur à la prévoyance. Le jeune prince eût été fort embarrassé de soumettre ses plans de réforme, mais il sentait confusément qu'il y avait autre chose encore à faire qu'à ne rien faire, et que l'abandon n'est pas un principe.
D'ailleurs, il avait des idées accessoires. Ainsi il n'était pas belliqueux, mais il voulait une petite armée:
—Nous l'emploierions à des carrousels, disait-il au ministre de la guerre pour l'exhorter à appuyer ses projets.
Or, le ministre n'avait aucune raison pour préférer le travail à une sinécure, et il n'appuyait pas le moins du monde les propositions de Lorenzo.
—Développons alors les arts de la paix, essayait de dire le poëte Lorenzo; créons une académie, des jeux Floraux.
Mais le ministre des beaux-arts et des belles-lettres était un joyeux compère qui n'aimait pas l'ennui et qui, sous prétexte de bibliothèque, faisait collection de toutes les œuvres grivoises de l'Italie.
Enfin, quand il avait échoué dans toutes les propositions de l'ordre moral, Lorenzo finissait par demander à son auguste père qu'au moins on fît balayer et éclairer les rues.
Car, j'ai honte de le dire, la capitale de la principauté était un cloaque, et, la nuit, on s'y fût heurté à toutes les murailles, si les gens dévots n'avaient eu l'idée d'allumer de petites veilleuses devant les statues de la bonne Vierge, nichées à tous les coins de rues. Grâce à ce système, qui pouvait servir à repousser le reproche d'obscurantisme que les gens sans foi se permettent encore, on pouvait rentrer chez soi sans courir le risque d'être plus d'une heure à trouver sa porte.
Mais Bonifacio XXIII ne voulait pas qu'on balayât les ordures; il fallait, disait-il, songer à tout le monde; et les chiens errants ne méritaient pas qu'on les privât des restes amoncelés auprès des bornes. Quant aux réverbères et aux lanternes, il les considérait comme des inventions funestes. Voici son raisonnement:
—La nuit, tous les honnêtes gens doivent dormir chez eux; or, quand on dort, on n'a pas besoin de lumière. Si je laissais éclairer les rues, je ne pourrais pas empêcher qu'on s'y promenât; or, en s'y promenant, on pourrait faire du bruit et éveiller ceux qui dorment.
Il semblait que le sommeil fût le but de la vie, et que le prince Bonifacio n'eût d'autre tâche que de veiller à ce que personne ne veillât.
Lorenzo était bien triste de cette résistance passive, d'autant plus triste qu'il était dans cette disposition d'âme où l'on veut faire le bien, non-seulement pour le bien, mais pour la beauté.
Lorenzo avait la faiblesse qui n'épargne pas toujours les princes: il était amoureux.
Ce n'était ni d'une bergère, ni d'une princesse que Lorenzo était épris. Sous ce rapport, il manquait à la fois à son éducation romanesque et à sa position d'héritier présomptif. Je sais bien qu'il ne tenait qu'à lui de prier sa divinité d'endosser le costume de bergère: les métamorphoses n'étaient pas plus difficiles que cela. Mais Lorenzo n'eût pas osé exprimer ce vœu, et Marta n'y eût peut-être pas accédé. Il eût été plus facile encore de devenir une princesse; mais je dois déclarer que dans la sincérité de son culte Lorenzo ne songeait ni au charme des inégalités, ni au prestige du rang.
Il aimait Marta, parce qu'il l'aimait. Cette raison est péremptoire en amour. Toutes les subtilités ne prévaudront jamais contre elle.
Un jour qu'il se promenait dans les champs, guettant des rimes, il rencontra la jeune fille qui cueillait des simples. Le sort de Lorenzo fut instantanément fixé. Le doux rayon des yeux noirs de Marta, la façon chaste et fière dont elle fit la révérence, en saluant l'héritier de son souverain, le petit sourire compatissant qu'elle laissa voir au beau jeune homme un peu pâli par l'ennui, tout charma et conquit Lorenzo. Se jeter aux pieds de Marta, lui déclarer sa flamme, et la menacer de se passer dans l'estomac une petite épée mignonne qui faisait joujou à son côté, c'était là le conseil que lui donnaient ses lectures et les souvenirs de son institutrice française. Mais le véritable amour rend indépendant. Lorenzo fut lui, pour exprimer des sentiments loyaux et sincères. Il aborda simplement la jeune fille, et fut simplement accueilli. La botanique les fiança, sans qu'ils se fussent avoué qu'ils s'aimaient, et quand l'un voulut le dire, et l'autre l'avouer, il se trouva que la déclaration était inutile. Ils se regardèrent, rougirent et échangèrent leurs deux cœurs dans une pression de main.
Marta était la fille d'un savant, maître Marforio. Elle avait perdu sa mère à l'âge où Lorenzo avait perdu la sienne.
Les deux orphelins se trouvaient une parenté dans ce deuil dont ils n'étaient pas encore consolés. L'un et l'autre se sentaient aussi libres que s'ils eussent été seuls au monde, le savant se montrant aussi négligent de ses devoirs de père que le prince Bonifacio.
Marta et Lorenzo faisaient de longues promenades, et Dieu sait qu'aucun amour plus innocent ne refléta jamais l'azur du ciel; mais, au bout d'un mois, Lorenzo demanda à sa fiancée le droit de lui rendre visite dans la maison paternelle, et jura solennellement, sur la dernière touffe de fleurs qu'ils avaient cueillie ensemble, qu'il aimerait mieux renoncer au trône que de renoncer à l'espoir d'avoir Marta pour femme.
La jeune fille était trop ignorante des choses de ce monde pour apprécier à sa juste valeur le serment naïf de Lorenzo, et pour se dire que le prince ne s'engageait peut-être pas à grand'chose, le trône de ses pères étant fort vermoulu et passablement exposé. Elle reçut de bonne foi cet engagement de bonne foi et promit à Lorenzo d'obtenir l'agrément de son père.
Je commence mon récit précisément le jour où Marta doit traiter cette délicate question avec le moins délicat des confidents.
Maître Marforio passait, aux yeux de quelques personnes, et surtout aux siens, qu'il croyait infaillibles, pour le plus grand savant de l'Italie. Je ne contredirai pas sa mémoire; et je suis disposé, après que je vous aurai raconté ses erreurs et ses folies, à admettre qu'il fut en effet un grand savant, un de ceux qui ne doutent de rien et qui n'admettent le bon Dieu que pour prendre plaisir à lui dérober ses secrets.
Maître Marforio avait tout scruté, tout analysé, tout fait passer par l'alambic de son laboratoire, et tout fait réduire dans la cornue de son intelligence. Mais cet abus de l'investigation ne lui avait pas porté malheur, comme au docteur Faust. Il était, au fond, d'un assez aimable caractère. Bien différent de quelques-uns des savants de son temps, et de beaucoup de savants qui l'ont suivi, il n'était pédantesque et sentencieux qu'à ses heures, quand il plongeait dans quelque problème difficile; mais sa bonne humeur surnageait toujours, comme l'arche de Noé sur les abîmes. Un mécompte le stimulait sans l'irriter. D'ailleurs, pouvait-il admettre des mécomptes? Sa barbe avait blanchi, mais sans que son front se fût sillonné de rides trop profondes. Le travail sédentaire l'avait engraissé; et il est de notoriété académique que lorsqu'un savant prend du ventre, il est sauvé de l'hypocondrie et de toutes les influences malsaines.
Maître Marforio passait pour sorcier; et tout en riant de cette renommée qui n'était peut-être pas sans danger en Italie, il n'était pas éloigné de croire qu'il avait le don des miracles.
—Qui sait? disait-il parfois, je n'ai jamais essayé.
Sur ce point, maître Marforio se trompait; il avait fait un miracle: Marta était bien l'œuvre la plus prodigieuse de ce savant infaillible.
Comment cette jolie créature, si douce, si simple, si bien prise dans sa taille et d'une âme si candide, comment cette harmonieuse statue de l'innocence pouvait-elle le nommer son père? C'était là un problème à confondre, mais qui ne confondait pas maître Marforio, parce qu'il n'y songeait guère. D'ailleurs, lui qui avait trouvé le secret de faire fleurir des roses sans rosiers, il n'eût pas été embarrassé pour revendiquer ce parterre embaumé de toutes les vertus, fleuri de toutes les grâces. Sa fille était classée, dans la série de ses œuvres, entre une expérience de chimie ou d'alchimie et une opération de physique.
Le cabinet du docteur Marforio eût réjoui un peintre et épouvanté un commissaire-priseur. Tout s'y trouvait entassé, confondu, c'était le chaos. Des squelettes couchés sur des livres, comme la mort sur la vie; des fleurs pêle-mêle avec des monstres empaillés, des réchauds et des télescopes, et au milieu de tout cela ces ensevelisseuses infatigables, les araignées, couvrant de leurs sombres suaires les livres, les fleurs, les instruments, tous les débris, comme l'ironie du progrès qui efface et qui nivelle les instruments du passé.
A côté de ce sanctuaire officiel, dans lequel il donnait ses audiences, le docteur Marforio avait un mystérieux réduit dans lequel personne, j'ose dire personne de vivant, n'était entré. Ce qui se passait dans ce laboratoire, nul n'a pu le dire. C'était, pour l'innocente Marta, comme le cabinet de la Barbe-Bleue. La jeune fille ne croyait pas qu'il y eût des femmes méchamment mises à mort par son père, mais elle savait que pour une œuvre étrange, inouïe, dont le secret ne lui avait pas été confié, maître Marforio faisait commerce avec le fossoyeur, et que celui-ci entrait et ressortait quelquefois avec de lourds fardeaux.
Au reste, l'œuvre, quelle qu'elle fût, ne donnait aucun remords au savant; il était même, après chacune de ces visites passablement sinistres, d'une gaieté étourdissante. Il se frottait les mains, il se tapait sur le ventre, il se tiraillait la barbe:
—Bravo! bravo! murmurait-il, tout va bien! l'humanité marche à son cycle de rénovation. Paracelse n'était qu'un niais; la pierre philosophale n'est qu'un caillou. Isaac le Hollandais, Basile Valentin, et tous ceux qui ont prétendu faire vivre l'humanité au delà du terme, voudront ressusciter pour jouir de ma découverte. L'homunculus était une chimère. L'homme ne crée pas, mais il peut conserver; il ne donne pas la vie, il la garde. C'est le feu sacré.
Un jour donc, au beau milieu d'un de ces monologues qui se renouvelaient quotidiennement, avec quelques variantes, le docteur Marforio entendit frapper à la porte de son cabinet.
—Entrez, dit-il.
Marta, le sourire sur les lèvres, et un peu de rougeur sur le front, apparut, sans oser franchir le seuil.
—C'est toi, ma fille, demanda le savant avec un véritable étonnement et un petit ton solennel. Qu'y a-t-il de nouveau? quel motif si grave?
—Mon père, je voulais d'abord vous embrasser. Depuis quelque temps vous ne me regardez plus, vous ne songez plus à moi!
—J'ai tort, je le confesse, dit le docteur en entr'ouvrant sa barbe blanche pour laisser passer un baiser. La vue de l'innocence est un bon conseil et une précieuse inspiration. J'ai tort, ô mon étoile! Virgo virginea! Albert le Grand ordonne aux humains de vivre loin des hommes; il n'a pas dit loin des jeunes filles. Je te permets de venir me dire bonjour tous les matins, miroir du firmament, et tous les matins je te bénirai.
En parlant ainsi avec sa volubilité ordinaire, le docteur Marforio avait attiré Marta et lui déposait, avec componction, le plus banal des baisers paternels sur son beau front, entre les bandeaux de ses longs cheveux noirs.
—Eh bien! es-tu contente, fillette? lui demanda-t-il après cette faveur, et en faisant mine de la congédier.
Marta hésitait à parler. Il lui semblait sacrilége de livrer le pur et cher secret de son âme, qu'un éclat de rire accueillerait sans doute. Elle restait au milieu du cabinet, immobile, courbant la tête, et traçant avec son doigt des lignes bizarres et impossibles dans la poussière qui couvrait un gros livre placé près d'elle sur un bahut.
Fort heureusement, le docteur Marforio, s'il n'entendait pas grand'chose à l'art de provoquer des confidences, était d'une loquacité commode pour les auditeurs timides; il leur donnait le temps de se remettre et de ressaisir leurs idées. Les savants ont parfois de ces utilités de circonstance.
—Que veux-tu de moi? dit-il à sa fille; tu n'es pas encore à l'âge où l'on a besoin de refaire l'écrin de la nature. Te faudrait-il un élixir pour garder, conserver ta chevelure? Les savants à venir, les chimistes allemands ou français s'épuiseront en vains efforts pour trouver l'eau ou la pommade qui arrête la chute des cheveux. J'emporterai ce secret avec moi. Te faut-il de l'émail pour tes dents? du vermillon pour tes joues? Je t'en demanderais plutôt, charme de ma vie. Parle: je puis t'ouvrir l'infini; car je dispense la beauté éternelle, immuable! Ah! j'avoue qu'il m'en coûterait pourtant, continua le docteur, en devenant pensif, d'essayer sur toi certaine opération. La main me tremblerait peut-être... Marta, as-tu confiance en ton père? es-tu persuadée, comme il convient de l'être, qu'il est le plus grand savant de la principauté, un des plus grands savants de l'Italie, et par conséquent un des plus grands savants du monde? Si je te disais: Ma mignonne, je vais, avec un petit instrument dont il ne faut pas t'effrayer, te faire là, au front, une incision légère, dont il ne faut pas prendre souci; donner avec une jolie petite scie un ou deux petits coups à ton joli crâne; dis, mon étoile, aurais-tu peur?
Marta ouvrait de grands yeux et regardait son père: elle avait peur réellement, mais d'être obligée de reconnaître que son illustre père était fou. La pauvre enfant n'entendait rien à la science, ni aux savants.
—Mais il ne s'agit pas de cela, balbutia-t-elle.
—De quoi donc alors s'agit-il? C'est vrai, j'ai tort, primavera! T'offrir de la jeunesse, c'est souhaiter des zéphyrs pour le printemps et des roses pour le mois de mai. Que veux-tu? Ton cœur soupirerait-il après quelque rêve impossible? Si ce n'est que cela, tu l'auras. Ou bien, fille d'une mortelle, te faudrait-il seulement l'amour d'un mortel, et viendrais-tu, pauvre fleur modeste, invisible aux regards, me demander un philtre, pour être vue et pour être aimée?
Marta ne put s'empêcher de sourire; son père effleurait son secret; mais la jeune fille ne venait pas chercher de philtre; son regard était un assez puissant alchimiste qui avait fait la besogne.
—Ah! ah! dit le docteur Marforio, qui vit le sourire de son enfant, j'ai deviné! Euréka! A nous autres savants rien n'échappe. Tu veux un philtre, Marta? c'est une grande imprudence, il ne faut pas jouer avec les philtres. Heureusement que je suis toujours là, pour te guérir, pour te sauver; et il ne me déplaît pas que tu coures un danger, pour mieux prouver combien je suis infaillible.
—Mais, mon père, je n'ai plus besoin de philtre.
Et la jeune fille, riant et rougissant à la fois, appuya sur le mot plus, pour aider son secret à sortir.
Le docteur Marforio, bien que savant, n'était pas absolument étranger aux choses de ce monde. Il avait des instants lucides; c'était un reste d'infériorité. Hélas! qui peut se flatter d'être parfait? D'ailleurs, il avait peut-être été jeune aussi. A l'âge où la science est une muse et n'est pas encore une épouse acariâtre et exclusive, il avait peut-être expérimenté quelque chose d'analogue à l'amour. Il comprit donc la réclamation de sa fille, et faisant un mouvement de surprise qui n'attestait pas une profonde stupéfaction:
—Ah! ah! tu t'es permis?... au fait, pourquoi pas? te l'avais-je défendu?... Alors, explique-moi ce que tu viens me demander.
Marta, sensiblement rassurée par ces façons qu'elle trouva paternelles, avoua le nom de Lorenzo et exposa le vœu timide de l'héritier présomptif.
—Un prince, s'écria le docteur avec un gros rire, ce n'est qu'un prince! J'avais peur que ce ne fût Apollon en personne. Tu méritais mieux que cela, ma fille. Je sais bien qu'il eût été difficile de trouver quelque chose de mieux dans la principauté.
—Mon père, murmura la jeune fille, avec un geste suppliant, vous vous moquez de moi!
—Eh bien! ne rions plus, reprit le joyeux savant. Que veux-tu faire de ton petit prince, ma petite fille? et que veux-tu que j'en fasse? Il craindrait peut-être d'humilier sa dynastie, vouée par tradition à l'inutilité, s'il soufflait mes fourneaux. D'ailleurs, Albert le Grand, dans son huitième précepte, dit expressément: «L'homme qui rêve au grand œuvre évitera d'avoir aucun rapport avec les princes et les seigneurs.» Est-ce que tu voudrais me faire échouer si près du port?
Marta n'y songeait guère; elle avait bien envie d'interrompre son père pour lui faire remarquer qu'il ne s'agissait pas de lui, mais d'elle seule; que Lorenzo n'adorait pas le savant, mais la fille du savant, et qu'elle ne venait pas demander l'office de souffleur pour son héros. Mais la jeune fille, sans être à même de s'avouer que les savants en général ont un égoïsme implacable, savait par expérience filiale que le docteur Marforio avait une façon toute particulière de juger les événements quotidiens, et que c'était peine perdue de vouloir l'intéresser longtemps à autre chose qu'à son laboratoire. Elle soupira donc et continua d'écouter:
—Il est gentil, ton oiseau de romance, n'est-ce pas, ma mignonne? Eh bien! il ferait une triste figure au milieu de mes hiboux empaillés. Lâche le fil qui le retient par les ailes. Laisse-le s'envoler, Marta, et je te trouverai un beau savant qui se fera mon élève, et qui épousera ma doctrine en même temps que ma fille.
Marta ne savait plus trop si elle devait rire ou pleurer. Elle était fort émue.
—J'aime Lorenzo et je n'aimerai jamais que lui, dit-elle enfin.
—Paroles de jeune fille, feuilles légères qu'emporte le vent! comme dit Ovide.
—Lorenzo m'aime aussi, mon père. Et d'ailleurs, s'il est prince, il n'en est pas plus ignorant pour cela.
L'amour est l'école de la diplomatie; la dernière république française l'avait bien prouvé en créant une école d'administration. Marta devenait habile.
—Que sait-il, ton beau prince? demanda le docteur avec une raillerie qui n'était pas exempte de curiosité.
—Oh! nous n'avons pas causé de science, repartit Marta; mais nous avons causé de vous, mon père, et Lorenzo vous admire.
L'encens ne perd jamais son parfum. Le docteur Marforio sourit. Mais on ne l'avait pas encore assez flatté.
—Eh bien! s'il admire ton père, je n'admire pas le sien, moi. Son Excellence Bonifacio XXIII est une brute dont les fourneaux ne servent qu'à la cuisine. Ah! s'il avait compris les savants! quel prince! et quelle principauté! avec lui j'aurais pu expérimenter en grand mon système. Et tu veux que le fils d'un pareil prince, d'un bouffon qui ne s'occupe pas de moi, tu veux que l'héritier de la sottise soit autre chose qu'un sot! un joli sot, si tu veux, mais un sot.
—Je ne veux rien, mon père, dit Marta, qui se rassurait depuis quelques minutes et qui entrevoyait le triomphe. Je n'entends rien à la politique; mais je suis certaine que Lorenzo a de l'esprit, et qu'il aime assez la science pour faire aimer les savants par son père, s'il veut s'en donner la peine.
—Ne dirait-on pas qu'il faudrait un Cicéron pour prouver ce que je vaux? reprit le docteur en haussant les épaules; mais tu crois sérieusement, ma fille, que ton prince, s'il voulait...
—Il est irrésistible, mon père.
—Pour les jeunes filles? soit; mais pour le prince Bonifacio?
—Les bons pères n'ont rien à refuser à leurs enfants, dit Marta en appuyant son front avec câlinerie contre l'épaule du docteur.
—Bonifacio est donc un bon père? demanda maître Marforio en riant. Eh bien, alors, c'est la seule vertu qu'il ait oublié de laisser perdre. Tu peux dire à Lorenzo que ma maison lui est ouverte.
—Merci, mon père, dit Marta avec effusion.
—Tu seras princesse, à la condition que ton prince est ou deviendra savant. C'est peut-être le grand alchimiste des cœurs qui a préparé tout ce petit roman sentimental, pour que je sois mis à même de présider aux destinées de cette principauté; il y a une femme au début de toutes les grandes choses; mais ce serait manquer d'égards à la fortune que de lui céder sur un point. Tu ne seras princesse que le jour où je serai premier ministre de Bonifacio.
—Vous m'effrayez, mon père!
—C'est bon signe! Tant pis pour toi, ma mignonne, si tu me rends ambitieux. J'ai aussi mon amour en tête. Tu as ton prince, je veux avoir le mien.
Marta soupira et sourit. Lorenzo pouvait venir; voilà ce qui la ravissait; mais ces conditions burlesques, mais ces prétentions du savant lui paraissaient gâter ou compromettre le joli poëme qu'elle sentait vivre et chanter dans son cœur.
Quant au docteur, il était d'une gaieté à faire trembler un médecin d'aliénés. Il voyait distinctement son étoile s'élever à l'horizon. Et, bien qu'il fût pénible de n'être premier ministre que d'une principauté microscopique, il était impatient d'entendre sonner l'heure où la principauté, chétive comme État, deviendrait un gigantesque laboratoire, où les habitants seraient ses sujets d'analyse, le ministère son réchaud et le prince Bonifacio son soufflet de forge. Quant à l'ambition d'avoir pour gendre le prince héréditaire, il n'y songeait guère; et quant au bonheur pur et simple de sa fille, il n'y songeait pas.
Le docteur Marforio était un trop grand savant pour s'abaisser à ces sentiments vulgaires.
Lorenzo fut prévenu des dispositions favorables du docteur, et, aussi ému que s'il se fût agi d'entrer, botté, éperonné, cravache en main, dans le parlement pour lui dire: Messieurs, l'État, c'est vous! il endossa son plus bel habit, se fit poudrer, parfumer, dévalisa les joyaux de la couronne afin de trouver une épingle passable, et s'étudia pendant une heure à gâter ses charmes naturels.
J'ai remarqué souvent combien la nécessité des relations sociales, en intervenant dans un poëme, expose au ridicule les héros les mieux intentionnés.
C'est ainsi que Lorenzo était un bon jeune homme, plein de cœur et d'esprit. Si le ciel, au lieu de le faire naître prince héréditaire d'une couronne compromise, lui avait permis d'avoir un état utile et productif, il n'est pas douteux qu'il n'eût fait son chemin. Dans ses promenades de sentiment, que nul ne surveillait, il avait agi avec toute la délicatesse souhaitable, et Marta ne pouvait pas imaginer pour lui de plus beau costume que l'habit de soie gris perle, un peu usé, qu'elle lui voyait dans leurs rencontres de tous les jours. Mais l'inspiration, le sentiment de l'harmonie extérieure qui ne faisait jamais défaut au prince, dans les rôles d'amoureux, sembla l'abandonner, quand il eut à préméditer son entrevue avec le docteur. Il sortait de son cadre. Comme il allait se mesurer avec les prétentions de la sottise, je me trompe, de la science, il crut nécessaire de mettre de la vanité dans son extérieur. Il voulut se faire très-beau, et conséquemment il se fit très-laid. Le séraphin se travestit en élégant râpé. Il emprunta des manchettes et un jabot à la garde-robe de son père, et il mit les jarretières du couronnement pour séduire maître Marforio.
Cette absence de goût est assez ordinaire chez les gens d'imagination et de beaux sentiments; je n'en veux pour preuve que l'affublement grotesque de toutes les muses contemporaines. Mais, au fond, elle n'était pas aussi hors de propos qu'on pourrait le croire. Si Marta devait souffrir des travestissements de son amoureux, le docteur devait en ressentir un très-vif mouvement d'orgueil; et comme il s'agissait moins de séduire la jeune fille que son père, il pouvait bien se faire que Lorenzo fût un fin connaisseur de l'âme humaine, au lieu d'être simplement un amoureux naïf, naïvement endimanché.
Quelle belle dissertation je pourrais entamer ici sur la dignité, l'opportunité, l'éloquence du costume, même du costume le plus laid! On ne sait pas assez combien il y a de prestige dans un habit de cérémonie. Un général gagnerait-il une bataille en robe de chambre? Les plaideurs se trouveraient-ils bien jugés par un juge qui n'aurait pas sa robe, et par un Minos qui garderait son bonnet de nuit?
Les proverbes, qui sont à la vérité ce que les remèdes de bonnes femmes sont à la grande médecine, les proverbes sont des mensonges spécieux. Mais de tous le plus faux est assurément celui qui prétend que l'habit ne fait pas le moine. L'inventeur de cet axiome ne connaît pas l'Italie en particulier et ne connaît pas l'humanité en général. Quelle différence entre un fonctionnaire et un administré, si ce n'est le costume? Et combien de diplomates qui seraient reconnus incapables si on leur refusait un habit chamarré pour la foule et de bons cuisiniers pour leurs collègues!
Maître Marforio n'était pas très-rigoureux sur l'étiquette; mais il était trop de fois académicien pour ne pas tenir à une certaine pompe artificielle. Quand il vit Lorenzo lui faire trois saluts, et se présenter à lui avec un estomac chargé de dentelles, des mains chargées de bijoux et le dos voûté sous un habit de gala, le savant s'épanouit; il eut presque une velléité de coquetterie à son tour. Mais comme il savait bien que son génie était sa plus belle parure et que sa gloire répandait des lueurs sur son costume, il ne s'inquiéta pas autrement de réparer le désordre de sa toilette, et il fit trois pas au-devant du prince pour le recevoir.
Marta, la pauvre enfant, s'était enfuie. Son amoureux lui déplaisait ce jour-là. Il ressemblait au prince Bonifacio, et elle ne retrouvait plus dans sa cravate empesée les lignes charmantes de ce joli cou flexible qui s'inclinait avec tant de grâce de côté, quand ils marchaient seuls, ensemble, par les petits chemins verts de la campagne. Les mains de Lorenzo, si mignonnes, si déliées du poignet, dont elle se moquait toujours, tant elle les trouvait jolies, les mains disparaissaient gauchement sous de gros parements enjolivés de guipures, et le malheureux, qui n'avait rien respecté de lui-même ce jour-là, avait glissé à ses doigts de grosses bagues de prélat qui achevaient de le déformer. Sa bouche seule, n'étant pas couverte, n'avait pas changé et gardait toujours dans la sinuosité de deux lèvres d'une bonne grosseur, mais d'un irréprochable dessin, ce faible et adorable sourire qui poursuivait Marta dans ses rêveries et surtout dans ses rêves. Sans cette bouche-là, elle l'eût pris en horreur; mais le moyen d'en vouloir à ce sourire qui lui demanda pardon et auquel elle pardonna?
Lorenzo avait affiché tant de respect dans sa toilette gothique et officielle, il était si ému en abordant le docteur, que celui-ci oublia tout à coup le motif de l'entrevue et traita l'héritier présomptif comme un simple bachelier qui vient solliciter la faveur d'un grade universitaire ou d'un examen. Il ne lui laissa pas le temps de balbutier les quelques paroles d'introduction et d'excuse que le prince avait récitées tout le long de la route, pour mieux s'habituer à les dire et pour n'en pas manquer l'effet, et il le questionna ex abrupto sur ses connaissances physiques, sur ses prédispositions à la chimie, voire à l'astronomie.
Lorenzo ne s'attendait guère à cette épreuve; je crois même que, s'y fût-il attendu, l'épreuve aurait été la même. Le peu que le jeune prince avait appris de physique ne valait pas la peine d'être retenu, et le peu qu'il avait retenu d'astronomie ne valait pas la peine d'être répété. Sa science, sa vraie science, c'était celle qui commence par les invocations et les extases, qui parle aux choses, mais ne les interroge pas, qui dit aux fleurs, aux herbes, aux horizons, aux étoiles:—Je vous aime!—mais non pas:—Qui êtes-vous? d'où venez-vous? Lorenzo arrivait, le cœur gonflé dans son vieil habit de cérémonie, pour dire au docteur:—Laissez-moi adorer Marta! et voici que le docteur lui demandait son opinion sur la transmutation des métaux, sur les frères de la Rose-Croix, sur le microcosme, sur tout, excepté sur l'état de son cœur.
Lorenzo avoua modestement qu'il ne savait rien; que, destiné au pouvoir, on avait voulu le préserver des systèmes, des partis pris, des préjugés, et le rendre inaccessible à l'erreur, en lui défendant de chercher la vérité, mais qu'il ne demandait pas mieux que de courir le danger d'apprendre.
—Ah! jeune homme! lui dit familièrement le docteur, que cette démarche vous honore! Les sciences ne sont point ingrates. On les croit maussades et rechignées; mais elles sont comme ces vieilles sorcières des légendes qui veulent être domptées par la force, et qui livrent ensuite au vainqueur une jeune et blanche fiancée.
Au mot de fiancée, Lorenzo rougit. C'était peut-être une allusion à l'objet de sa visite. Il voulut tenter un effort, et prononça le nom de Marta. Mais Marforio était en selle sur son hippogriffe et continuait à galoper.
—Vous règnerez un jour, jeune homme, vous aurez charge d'âmes, il vous faudra combiner des milliers de volontés, et vous ne savez pas combiner ensemble deux éléments inertes! Vous aurez des finances en mauvais état à administrer, et vous ne savez pas faire de l'or! Vous enverrez peut-être des hommes à la guerre; au moins une fois dans votre règne, vous ferez tuer de braves gens qui ne demanderont pas mieux que de vivre, pour satisfaire le tempérament de quelques conseillers bilieux, ou pour amuser les enfants qui aiment les tambours et les défilés, et vous ne savez pas comment on peut empêcher de mourir et faire peur à la mort! Dérision! dérision! Qu'est-ce qu'un prince qui peut troubler l'ordre moral et qui n'a pas de droits sur l'ordre physique? qui prend la responsabilité du bonheur de tout un peuple et qui ne sait ni prévoir une famine, ni empêcher une tempête? Ah! jeune homme, jeune homme, pourquoi êtes-vous prince?
Lorenzo aurait pu répondre:—Parce que mon père est prince et s'appelle Bonifacio XXIII.—Il n'y a pas de meilleure raison que celle-là, et les enfants légitimes sont le principe et les garants de la légitimité.
Mais Lorenzo fut d'autant moins tenté de répondre que le docteur, qui l'interrogeait toujours, ne lui laissait pas le loisir de placer un mot. Au bout d'une heure de cette conversation, Marta, qui attendait, pleine d'anxiété et de trouble, le résultat de la conférence, et qui avait cru devoir, par un sentiment de respect et de pudeur, s'abstenir d'y assister, et même de l'écouter, Marta, qui ne trouvait pas Lorenzo assez laid pour qu'elle renonçât à l'espoir de le trouver beau le lendemain, se décida à venir frapper hardiment à la porte du laboratoire; et comme personne ne répondait et qu'elle entendait son père discourir, elle tourna la clef dans la serrure et entra pour mieux entendre.

Le docteur, la tête rejetée en arrière, la bouche ouverte, un pied placé sur un escabeau, tenant en main un bocal dans lequel s'agitaient d'horribles monstruosités, expliquait au pauvre Lorenzo, qui n'osait pas bâiller, comment ce vase renfermait peut-être le véritable homunculus, le génie familier de Joseph, François Borri le Milanais, qui avait été arrêté jadis par la sainte inquisition de Rome, pour avoir fait de la pierre philosophale, et qui mourut en prison pour avoir refusé d'en faire au profit de ses juges.
Lorenzo, triste, comme s'il eût écouté la lecture d'un poëme élégiaque, renversé dans son fauteuil, regardait le docteur et se demandait tout bas à quel moment il pourrait parler de son amour.
Heureusement pour lui, son amour incarné poussa vivement la porte, et la jeune fille, riant d'un rire mutin, entra tout d'un coup dans le laboratoire:
—Êtes-vous d'accord? dit-elle.
—D'accord! s'écria Marforio. Est-ce que par hasard, prince, vous voudriez susciter, encourager une opposition, une cabale contre mon grand système? parlez, dites-le!
—Moi! murmura Lorenzo, je viens vous demander le droit d'aimer Marta.
—Tiens! c'est vrai, répliqua le docteur Marforio, en replaçant le bocal pour prendre la main de sa fille, je l'avais oublié. Vous me parlez du droit? il me semble que vous l'avez un peu usurpé, mon prince. Sans rancune. Mais la fille du docteur Marforio ne peut pas être la femme du prince Lorenzo.
—Oh! je foule aux pieds les préjugés de ma naissance, dit Lorenzo d'un petit air révolutionnaire.
—Parbleu! et moi aussi, repartit le savant; mais j'entends que Marta soit la récompense de l'homme de génie qui me comprendra, et qui m'aidera à appliquer mon système au gouvernement des États.
Lorenzo pâlit; le bon jeune homme avait des scrupules. Il croyait que les sujets de son père ne lui appartenaient pas sans condition, et qu'il manquerait peut-être à ses devoirs d'héritier présomptif, en promettant de les livrer. On le voit, Lorenzo avait été mal élevé et ne connaissait pas ses droits, en s'exagérant ses devoirs.
—Monsieur le docteur, répondit-il gravement, ne faisons pas d'une question de bonheur intime une question de politique. Les destins de la principauté me sont chers; mais nous n'en sommes pas seuls les arbitres. Réglons ce qui nous intéresse personnellement; plus tard, nous verrons.
—Non, non, je ne me laisse pas leurrer repartit le docteur. Marta m'est tout aussi chère que peut l'être pour vous la principauté. D'ailleurs, vos affaires ne vont déjà pas si bien, mon prince, et je ne vois pas le grand sacrifice que vous auriez à faire, en me faisant agréer par Son Altesse Bonifacio. Soyez donc tranquille. Cela ne peut pas aller plus mal.
—Monsieur!...
—Quoi! n'est-il pas bien connu que vous payez vos fonctionnaires avec des petites images qui représentent de l'argent, mais qui n'en donnent pas; qu'une moitié de votre armée garde le lit, pour permettre à l'autre moitié de paraître en uniforme; que vous faites vendre au marché les légumes de la couronne, pour acheter des gants, et si je voulais faire le prophète, je vous prédirais l'écroulement prochain d'une monarchie sans argent, sans vigueur, sans talent, qui ne peut ni payer de la police pour les coquins, ni payer des spectacles pour les honnêtes gens.
—Mais, encore une fois, monsieur, qu'a de commun l'état de l'opinion avec mon amour?
—Comment! vous ne comprenez pas, jeune homme, repartit majestueusement le docteur, que je ne veux pas donner ma fille au premier prince venu? Je veux un gendre solide qui m'offre des garanties; et puis, enfin, je n'ai que cette occasion-là, une occasion superbe, unique, d'expérimenter en grand ma merveilleuse découverte, et vous voulez que j'y renonce! Ah! vous n'êtes qu'un égoïste.
Lorenzo regarda la fille du docteur d'un air navré. Il souffrait de ce débat ridicule, comme elle avait souffert déjà; mais il se mêlait à sa douleur un remords. Il pensait qu'à travers ces reproches grotesques, il y avait des vérités vraies, et qu'il était en effet un prince bien chétif, fils d'un père bien imprudent. Tout à coup, une autre idée fit diversion à celle-là. Lorenzo vit comme dans un éclair, le docteur Marforio, premier ministre du prince Bonifacio, et malgré le respect auquel son titre de prince du sang l'obligeait pour le chef de sa maison, il jugeait si bien son père, et le trouvait si parfaitement appareillé avec un compagnon comme maître Marforio, qu'en dépit de lui-même, un sourire effleura ses lèvres, sourire ironique et douloureux encore, et qu'il se sentit vaincu et prêt à toutes les concessions pour son amour.
Après tout, tant pis pour les habitants de la principauté; les peuples ont toujours les gouvernements qu'ils méritent; et puisqu'ils se laissaient mal administrer par Bonifacio XXIII, c'est qu'ils ne voulaient pas être mieux administrés. Leur donner Marforio pour premier ministre, c'était donc aller au-devant de leurs vœux et compléter le pouvoir.
Lorenzo avait laissé pendant au moins cinq minutes son bonheur en balance avec le bonheur de ses futurs sujets. C'était plus qu'un prince ordinaire n'eût tenté, et il avait bien acquis le droit maintenant de faire pencher le plateau du côté qui lui plairait; d'ailleurs, on voulait des réformes dans la principauté. Le docteur Marforio paraissait d'humeur à en faire de toutes les nuances et de tous les calibres. On pouvait essayer. Le parti des jeunes serait peut-être satisfait. Malgré ses folies, ce savant n'était pas un ignorant. Il avait émis une opinion dont la profonde justesse avait frappé Lorenzo. Soyez tranquille, avait-il dit, cela ne peut pas aller plus mal.—Cette considération, qui n'est pas toujours admissible dans les projets humains, était de nature à rassurer le prince héréditaire. C'est la raison qui fait essayer des remèdes de bonnes femmes. On pouvait essayer de l'utopie du bonhomme.
Et puis, enfin, Marta valait toutes les couronnes, toutes les principautés. Pour être le mari de la fille du docteur, le prince Lorenzo eût donné toute la gloire à laquelle il pouvait prétendre. Qui sait si, tout au fond de son âme, une petite voix ne chantait pas la chanson qui console d'avance de toutes les peines, de toutes les chutes, la chanson qui conseille d'aimer et d'être heureux, avant d'être riche et de régner?
Qu'importe que le vieux trône à clous dorés tombe en lambeaux et ne donne plus asile aux vers, pourvu qu'il puisse impunément, s'asseoir, le tendre poëte, le prince charmant, sur la mousse des grands bois, à côté de sa bien-aimée et lui dire: Oublions l'univers à condition que l'univers nous oublie? Qu'importe qu'il ne mette pas à son front la couronne héraldique, pourvu que personne ne l'empêche de cueillir la fleur des champs, de la respirer, de la mettre à sa boutonnière?
Lorenzo était né troubadour. Il n'y a plus aujourd'hui que très-peu de princes qui aient cette vocation; mais avant M. de Metternich, les cabinets européens offraient d'assez nombreuses variétés de cette espèce.
Lorenzo n'essaya donc pas de lutter plus longtemps. Il promit tout ce qu'on voulut, et risqua le bonheur de son peuple pour avoir le droit de venir répéter tous les jours à Marta combien il l'aimait. Il y a tous les jours des princes qui commettent la même imprudence, sans avoir le même prétexte. Le docteur promit en retour sa bénédiction. Marta ne promit rien; mais elle laissa prendre un baiser qui valait bien une province.
Quand l'héritier présomptif eut fait ses trois saluts, et quand la porte de la maison se fut refermée sur ses pas, maître Marforio eut un soupir de triomphe:
—Eh bien! dit-il à sa fille, es-tu contente?
Marta tomba dans les bras de son père.
—Il est bien, ton petit prince, reprit le docteur, il est surtout très-élégant. Quel bel habit! mais en revanche, il ne sait rien, tu m'avais trompé; il est ignorant comme un mouton.
Marta ne voulut pas contredire doublement son père; mais elle trouvait que Lorenzo en savait assez et que son habit lui allait mal. Ce dernier point, surtout, lui tenait au cœur; elle soupira.
—Va! console-toi, repartit le savant qui se trompa une fois de plus à ce soupir, je lui donnerai des leçons.
Marta se promit bien, au contraire, de préserver son fiancé des leçons paternelles. Elle suffirait à l'instruire de ce qu'il ignorait, c'est-à-dire de la meilleure façon de porter les dentelles, et de faire accommoder sa chevelure; à ces conditions-là son prince était parfait.
Ah! si les peuples n'étaient pas plus exigeants que la fille du docteur, on n'aurait besoin pour les mettre à la raison que de se servir du fer, j'entends du fer à papillotes!
Le prince Bonifacio XXIII ne se doutait guère du madrigal qui l'attendait, ni des visées ambitieuses du docteur Marforio. Je sais bien que comme il ne payait personne pour surveiller son fils, il avait les plus grandes chances d'être parfaitement renseigné. Pourtant, il ne le fut pas. Un jour, toutefois, un de ses chambellans se hasarda à lui dire qu'il croyait le jeune Lorenzo amoureux.
—Tant mieux! s'écria Bonifacio, avec le contentement d'un bon père et d'un bon roi, l'art d'aimer enseigne l'art de régner!
Cette parole méritait d'être recueillie, commentée par le journal officiel de la principauté, et de prendre place un jour dans la collection des bons mots et des réponses célèbres de Son Altesse. Mais Bonifacio n'aimait pas qu'on entretînt le public de ses affaires intimes, pas plus des plaisanteries échappées à sa bonne humeur que de sa santé; et quand il avait des indigestions, il ne mettait pas son point d'honneur à les raconter à ses sujets. La postérité devait donc ignorer les facéties débitées et les médecines prises par Son Altesse; et l'histoire de cette principauté eût été difficile à écrire, par suite de la réserve des journaux officiels, si le parti des jeunes dont j'ai déjà parlé n'avait suppléé à la négligence, à la modestie, ou au calcul du prince, par des notes secrètes, des mémoires et des pamphlets.
Bonifacio, en prince économe, aimait bien mieux une amourette pour les distractions de son héritier, que quelque autre passion qui eût exigé de la monnaie. Il savait qu'un des priviléges des princes, c'est de faire ou de promettre un si grand cadeau, en leur personne, qu'ils sont ensuite dispensés d'en faire d'autres; et il ne s'inquiétait en aucune façon de savoir le but et la raison des promenades quotidiennes de Lorenzo.
Un jour, Son Altesse était retirée dans son appartement, pour un travail secret avec son premier ministre, quand Lorenzo, résolu à remplir ses engagements envers le docteur, se décida à obtenir une audience.
On comprend, d'après les détails que j'ai donnés sur les finances et le peu d'étiquette en usage dans la cour, que les laquais n'encombraient pas les antichambres, et que si l'on s'attendait à y trouver des huissiers, c'étaient des huissiers pour saisir le mobilier de la couronne et non pas pour introduire les visiteurs.
Lorenzo ne vit personne qui pût l'annoncer, et après avoir gratté à plusieurs portes, et visité plusieurs chambres, il arriva à la salle dite du conseil, où Bonifacio XXIII, afin de ne rien laisser échapper des secrets de l'État, s'était retiré avec son ministre, en ayant soin d'ôter la clef de la serrure.
Mais les précautions excessives ont leur imprudence. Par le trou de la serrure, débarrassée de la clef, Lorenzo aperçut son auguste père, attablé devant son premier ministre, et sur le tapis du conseil étalant des cartes, qui par leur dimension pouvaient bien suffire à la topographie de la principauté, mais qui, en réalité, étaient des cartes à jouer.
Lorenzo, au lieu d'admirer la délicatesse infinie de ce bon prince, qui s'enfermait plutôt que de donner un mauvais exemple, se sentit pâlir de honte, et s'attrista de surprendre son père dans cette récréation. Je sais que le père Daniel assure que les cartes sont une école de diplomatie, et que le jeu de piquet, entre autres, enseigne l'art de gouverner les hommes; mais Lorenzo n'avait peut-être pas lu le père Daniel, et puis ce n'était peut-être pas le piquet que jouait son père. D'ailleurs, par les actes Lorenzo jugeait la théorie, et ne l'estimait guère. Il soupira tristement et se dit, au fond du cœur, qu'il venait proposer sans doute une autre folie pour guérir son père de celle-là. Le docteur Marforio jouerait bien à un autre jeu que celui des cartes, et Lorenzo n'était pas sans appréhension sur l'effet du grand système du docteur.
Bonifacio ne se livrait pas seulement à l'oubli des grandeurs terrestres en consentant à jouer avec son ministre; nous verrons qu'il avait son calcul. Le soir le jeu est une élégance; le jour c'est un abandon. Ne nous étonnons donc pas si Son Altesse, dans le huis clos absolu qu'elle s'assurait, se laissait aller à un débraillé de costume et d'allure que le terrible parti des jeunes eût flétri en termes énergiques, s'il l'eût connu; mais jusque-là le secret n'avait pas encore transpiré, et on ne savait pas que Bonifacio XXIII, dans la salle même où ses aïeux avaient si fièrement levé la tête et tenu leur rang, restait en simple veste de basin, sans poudre et sans cravate, pour donner audience à des rois qui s'appelaient: David, Alexandre, César, Charles et à des reines qui avaient nom Judith, Argine, Rachel et Pallas.
Mais, je le répète, ce jeu n'était pas seulement pour le prince une débauche, c'était aussi un principe d'économie politique; et son rêve, vu la pénurie des finances, était de regagner à ses ministres les maigres appointements qu'il était contraint de leur donner, quand il ne pouvait plus se borner à les leur promettre. Ce système financier, que je livre pour ce qu'il vaut, ne réussissait pas dans l'application, et précisément à l'heure où Lorenzo regardait par le trou de la serrure, Bonifacio s'alarmait intérieurement des charges énormes que son ministère imposait au budget, et se demandait s'il ne pourrait pas se passer de ministres, ces fonctionnaires étant un objet de luxe destiné aux représentations officielles, et la besogne qu'ils ne faisaient pas pouvant tout aussi bien être négligée sans eux.
Le premier ministre avait une chance bien irrespectueuse, et le prince n'était pas éloigné de croire qu'il possédait un chef de cabinet expert dans l'art de donner de bons yeux au hasard aveugle. Accuser ce fonctionnaire de haute tricherie, c'était une extrémité à laquelle le prince n'osait descendre sans avoir des preuves. En attendant, et bien qu'il ne fût pas de la famille de Henri IV, il faisait lui-même de vains efforts pour introduire quelque intelligence dans la répartition des atouts, et comme ses procédés étaient naïfs et inexpérimentés, le premier ministre les devinait et les déjouait, sans paraître les avoir soupçonnés; ce qui dépitait une fois de plus Bonifacio.
Lorenzo lut distinctement par le trou de la serrure les sentiments empreints sur la physionomie paternelle. Son Altesse n'était plus sérénissime; des plis orageux s'amassaient au-dessus de ses gros sourcils, et pour que rien ne manquât à l'image de la tempête, des gouttes énormes pleuvaient du front.
Bonifacio XXIII perdait avec une incroyable persistance; son premier ministre lui coûtait aussi cher que tous les autres à la fois; aussi jamais le sang n'était-il monté avec une fureur plus apoplectique à la tête du souverain. Il battait les cartes, dans le vrai sens du mot, les frottant avec une colère qui équivalait à une gourmade; comme il invoquait à son aide toute les ressources du savoir ou du hasard, Son Altesse empruntait au tabac à priser des excitations factices qui ne profitaient ni à son jeu, ni à son nez, ni à son jabot.
Le premier ministre était d'un embonpoint analogue à celui de son maître. D'une figure moins colorée, mais aussi joufflue, il faisait le digne pendant. L'un et l'autre eussent été complets, si par un coup de baguette une fée malicieuse, sans rien changer à leur corpulence, les eût changés eux-mêmes en porcelaine de la Chine. On eût dit deux monstrueux objets d'étagère descendus de leur place.
Lorenzo jugea le moment opportun. Son auguste père n'osait pas par dignité jeter les cartes au nez de son premier ministre, mais il devait être enchanté d'une distraction.
En conséquence, le prince héréditaire frappa quelques petits coups respectueux; les joueurs s'arrêtèrent, comme si un fil de marionnette les eût retenus brusquement par le bras. Bonifacio, qui était en train de distribuer les cartes, resta la main levée, la bouche béante; le ministre, après quelque hésitation, repoussa son fauteuil et vint demander par le trou de la serrure qui était là, et qui se permettait de troubler les délibérations du conseil intime.
Je dois avouer que pendant cette interrogation, le prince Bonifacio, avec une prestesse qui dénotait certaines aptitudes politiques, essaya de tourner le roi; mais tout en parlant, le premier ministre regardait son souverain; le geste compromettant fut surpris. Bonifacio jura bien qu'il ne pardonnerait jamais ce regard sournois et conçut une haine violente contre son adversaire, dont la perte fut résolue.
Lorenzo se nomma et demanda la permission d'entrer. Décidément le moment était bien choisi. En apprenant que l'importun était son fils, Bonifacio ramassa vivement les cartes et les enjeux et les glissa dans sa poitrine:
—Chut! pas un mot, dit-il à son ministre, vous me répondez du silence sur votre tête!
La menace était évidemment exagérée. Bonifacio ne tenait pas plus à la tête de son premier ministre, que le personnage de certaine comédie ne tenait au nez d'un marguillier. L'échafaud était aboli depuis longtemps dans la principauté, sans que personne (pas même parmi les voleurs) s'en fût trouvé plus mal et en eût réclamé la restauration. Mais il y a des formules banales, exagérées, qui existent ainsi depuis le commencement du monde, et qui sont à la disposition des princes et des sujets. C'est ainsi qu'on aime à faire jurer les gens sur leur tête, et à jurer soi-même sur son honneur. Cela ne prouve rien, cela n'engage pas; il semble que le parjure soit rendu plus facile par l'exagération ou par l'inanité de la caution du serment.
Le ministre prit donc la menace pour ce qu'elle valait. Il mit le doigt sur ses lèvres et promit le silence.
—J'espère que Votre Altesse sera plus heureuse une autre fois, murmura le courtisan, en s'inclinant devant son maître.
Ce compliment de condoléance fut une dernière goutte de vinaigre; Bonifacio redressa la tête et congédiant tout haut son ministre:
—C'est bien! c'est bien! lui dit-il, nous reparlerons de cela, j'examinerai l'affaire, et je vous ferai savoir ma volonté.
Le ministre sourit et se retira à reculons jusqu'à la porte. Quand il fut dehors, il osa rire aux éclats, en se couvrant la bouche pour cacher sa gaieté séditieuse; dans tous les pays du monde les murs des palais ont des oreilles; en Italie, même dans la principauté la plus débonnaire, ils peuvent avoir des yeux.
—Tout va bien, disait l'éminent fonctionnaire; jamais il ne pourra se rattraper. Si cela continue, je gagne un demi-siècle de ministère. A-t-il eu peur quand son benêt de fils est entré! en voilà un qui n'entend rien aux cartes et avec lequel le pouvoir sera sans profit!
Et sur cette réflexion qui consolidait son dévouement au prince régnant, le ministre rentra chez lui, où son secrétaire l'attendait avec des dés, pour refaire une partie analogue à celle qui venait d'être interrompue. Le chef du cabinet appliquait à ses subordonnés le système que le prince appliquait à son égard; et il payait ceux-là de la façon qu'il était payé par celui-ci. C'était peut-être là une des occasions où l'esprit de justice trouvait le plus facilement à se satisfaire.
Pendant ce temps, le prince Bonifacio, étanchant la sueur qui mettait à son front une couronne fluviale, et se rajustant un peu, interrogeait son fils.
—Qu'est-il donc arrivé de si grave, Lorenzo, que vous soyez venu m'interrompre au milieu de mes occupations les plus sérieuses?
Lorenzo ne broncha pas; il n'eut ni rougeur, ni sourire, et s'excusa d'avoir eu la témérité d'interrompre les travaux de son père.
—Oh! ce n'est pas que je sois embarrassé pour remettre à demain cette affaire et bien d'autres, dit le prince Bonifacio en souriant, mais quand on est en train!...
—Mon père, dit Lorenzo avec gravité en prenant le fauteuil laissé vacant par le ministre, j'ai à vous parler de deux choses qui vous sont chères, mon bonheur et le bonheur de vos sujets.
—Diable, l'entretien ne sera pas gai; allons, parle, mon fils, tu as des dettes et tu veux de l'argent, mais je n'en ai pas. J'expliquais précisément tout à l'heure à Colbertini un nouveau système de banque destiné à m'en fournir.
—Je ne vous demande pas d'argent, mon père, reprit Lorenzo avec un certain embarras, je ne veux pas être une charge pour le trésor.
—Une charge? quelle charge! ah ma foi, tu es bien bon, s'écria le prince saisi d'un accès de gaieté, tu ménages le trésor! il ne t'en sait pas gré, et ne profitera guère de ces bonnes dispositions. Tu n'as que des vertus inutiles, mon cher Lorenzo. Le beau mérite d'être économe à côté d'une caisse vide! ainsi, tu n'as pas des petites dettes? quand même ce seraient des dettes... de jeu, tu pourrais me les avouer. Je ne suis pas farouche, va!
Lorenzo savait bien que son père n'était pas farouche; mais comme pour ajouter un commentaire à ces paroles encourageantes, le prince tira vivement la main de sa poitrine, et la tendit à son fils. Ce geste violent et parfaitement inutile, puisqu'il n'apprenait rien que Lorenzo ne connût déjà, eut pour effet de remuer les cartes et les jetons dans leur retraite, et Bonifacio vit avec effroi une cascade de piques, de cœurs, de trèfles et de carreaux tomber de sa poitrine sur la table. C'était plus d'effusion qu'il n'en voulait d'abord laisser paraître.
Mais le joyeux prince n'était pas homme à rester abattu, ni à se déconcerter pour si peu.
—Tu vois précisément, mon fils, dit-il avec une certaine solennité, les pièces qui servaient, il y a un instant, à ma démonstration économique. Ne va pas croire au moins que ces instruments de plaisir.....
—Mon père, interrompit Lorenzo, presque malgré lui et avec un accent de doux reproche, je ne vous demande pas les secrets de l'État.
Il y avait dans ces paroles une ironie tempérée par le respect, qui alla droit au cœur du prince Bonifacio. Il s'élança de son fauteuil comme un ballon qui prend son essor.
—Au diable! s'écria-t-il, les réticences et le décorum! j'ai bien le droit de me montrer tel que je suis à mon enfant, à mon héritier, puisque je fais déjà cet honneur à des étrangers, à ce Colbertini, par exemple, que je déteste. Cet homme-là est depuis bien des années mon premier ministre, on le croit la clef de voûte de mon cabinet. Eh bien, entre nous, c'est un âne. Il m'assomme; sans compter que je le crois un peu fripon. Imagine-toi que tantôt, pour nous égayer, et pour régler un petit compte, nous avons joué aux cartes. Ne le dis à personne! le scélérat m'a gagné avec un acharnement, une persistance!.... Il y a des moments, Lorenzo, où je regrette de n'être pas un prince cruel; j'aurais du plaisir à faire souffrir ce Colbertini, à le tenailler, à le pincer jusqu'au sang. Mais on ne refait pas son caractère. Je suis pacifique, je suis bon, cela me ferait de la peine de trouver du plaisir à ces cruautés, voilà pourquoi je me contiens; mais si je pouvais lui jouer un bon tour à cet insupportable ministre!....
—Précisément, mon père, je viens vous demander sa place.
—Pour toi? c'est impossible! tu ne peux pas être mon ministre. Ce serait plus économique, j'en conviens; mais ce serait contraire aux usages, et je crois que cela écorniflerait la constitution. Or, tu comprends que je n'ai pas envie d'attenter à une constitution à laquelle je n'ai jamais touché.
—Je n'ai pas l'ambition des affaires, reprit Lorenzo; ce n'est pas pour moi que je sollicite.
—Ce n'est pas pour toi? tant mieux. Tu as un ministre à me proposer? soit, je l'accepte; je le nomme; tiens, voilà du papier, une plume; c'est Colbertini qui a taillé la plume. J'écris: «Moi, Bonifacio XXIII, etc., etc., je nomme par ces présentes le seigneur...» Comment s'appelle-t-il mon futur ministre?
—Marforio!
—Un joli nom! Je n'ai que des ministres en i, cela me changera. Je signe, j'applique mon cachet, l'affaire est faite; il est nommé. Que c'est donc beau la toute-puissance! une feuille de papier, une plume arrachée à une oie, une goutte d'encre, et on a un ministre. Il n'est pas si facile d'avoir un bon cuisinier! Ah ça, que fait-il cet homme d'État?
—Comment, mon père, vous ne connaissez pas le célèbre Marforio, la gloire de votre règne, le plus beau fleuron de votre couronne?
—Ma foi, non, je ne le connais pas. On est riche comme cela, sans s'en douter. J'ignorais que j'eusse cette merveille. Est-ce un chanteur, un danseur, un écuyer?
—C'est un savant, mon père, le plus grand savant...
—De la principauté? merci! cela ne veut pas dire grand'chose. Mais je n'en veux pas de ton savant. J'aime mieux mon imbécile de Colbertini. Il ne manquerait plus que cela pour être ennuyé! Rends-moi mon papier; j'annule la nomination. Un savant dans mon conseil! cela ferait disparate.
—Cependant, mon père, si vous connaissiez le docteur Marforio.
—Je ne veux pas le connaître! Un savant! il me brouillerait avec mon clergé, avec mon ministre de l'instruction publique. Et puis, il lui faudrait de l'argent, n'est-ce pas? des dotations, des colifichets, des cordons de toutes les nuances? Les savants ne vivent plus comme des anachorètes, et tu n'ignores pas, mon pauvre enfant, que j'ai les finances un peu délabrées. Si, du moins, il savait faire de la fausse monnaie, ton savant!...
—Il sait mieux que cela, mon père; il vous servira gratis. Il ne vous demande que le droit d'expérimenter sur quelques-uns de vos sujets un système de perfectionnement physique et moral dont il attend les plus grands résultats. Du reste, le docteur Marforio est gai; ce n'est pas un pédant, au contraire: c'est un homme aimable, spirituel, candide, un vieillard de bonnes manières.
—Alors, tu te trompes, ce n'est pas un savant. Mais un point me touche: il me servira pour rien. Voilà les bons serviteurs, les vrais, ceux qu'on ne saurait payer trop cher! Un ministre sans appointements! voilà une merveille! Sais-tu, d'ailleurs, que cela me donnerait un fameux lustre dans l'histoire; et quoique je me soucie peu, au fond, de cette muse bavarde, je ne serais pas fâché de savoir ce qu'elle dira de moi un jour: «Le grand prince Bonifacio XXIII avait su résoudre le problème de régner avec peu d'impôts et de se faire servir pour rien.» Entre nous, c'est tout juste ce que vaut le travail; mais puisqu'il serait mesquin de se priver de ministres, que c'est la mode d'en avoir, je me résigne à en supporter quelques-uns, pourvu qu'ils ne me coûtent pas cher et qu'ils aient de la tournure. A-t-il de la tournure, ton savant?
—Vous verrez, mon père.
—Eh bien! j'aime mieux, après tout, avoir quelques beaux ministres apparents et n'avoir pas à payer. Ah! Lorenzo! Lorenzo! puisses-tu n'apprendre que très-tard, n'apprendre jamais quels soucis donne le pouvoir suprême! Avec ton docteur Mar... Marfur...
—Marforio! mon père.
—Un joli nom! avec le docteur Marforio, j'ai résolu d'un coup le fameux problème économique que je m'épuisais à chercher avec ce traître de Colbertini. Puisque je ne le payerai pas, je n'aurai pas à lui jouer ses appointements aux cartes. C'est bien simple. Je suis décidé. Va me chercher mon nouveau ministre.
—Oui, mon père, j'y cours, dit Lorenzo, ravi du dénoûment de sa démarche.
—A propos, s'écria le prince, comment as-tu fait la connaissance de ton docteur Marforio?
Lorenzo, qui allait sortir, s'arrêta et rougit.
—Ceci, mon père, est la seconde partie de mon secret, celle qui tient à mon bonheur personnel. Puisque les intérêts de l'État sont réglés, je puis vous parler des miens. Le docteur a une charmante fille. Quand vous aurez vu Marta, mon père...
—Je suis plus bête que Colbertini! s'écria le bon prince en retombant dans son fauteuil avec un gros éclat de rire. Comment! je n'ai pas deviné tout de suite que tu me tendais un piége d'amoureux! Ah! mon gaillard, tu seras un grand politique! Ah ça, est-elle aussi jolie que son père est savant, la belle Marta?
—Mon père, vous la verrez, et je ne doute pas que quand vous aurez admiré sa candeur, ses grâces ingénues...
—Assez, assez! je connais la nomenclature. C'était déjà la même de mon temps. Mais ce n'est pas un ministre que tu me proposes, c'est toute une famille!
—Si vous le voulez bien, mon père, ne parlons aujourd'hui que du ministre.
—N'en parlons plus, au contraire, puisque c'est une chose convenue, bâclée. Après tout, j'en ai bonne opinion de ton savant, puisqu'il a l'esprit d'avoir une jolie fille. Porte-lui sa nomination, et dis un mot à l'office. Je donne un grand dîner. Le budget peut bien me faire ce petit cadeau sur les économies que je lui procure.
Lorenzo sortit et courut en toute hâte porter la grande nouvelle au docteur Marforio. Pendant ce temps, le prince Bonifacio continuait à s'essuyer le front et répétait:
—Quelle journée! quel travail! et l'on croit que je ne fais rien! Un ministère changé, un encouragement public donné à la science dans son personnage le plus éminent, Colbertini foudroyé, une économie réalisée, mes pertes au jeu glorieusement vengées! Que de choses en un jour! Si l'opposition n'est pas contente, elle aura tort.
Le prince Bonifacio avait raison. Les événements de la journée pouvaient réjouir l'opposition à plus d'un titre.
—Mais, se dit le prince au bout de quelques minutes, Colbertini ignore sa disgrâce. Hâtons-nous de la lui annoncer.
En conséquence de cette résolution qui n'était pas exempte de malice, le meilleur des hommes et le plus ingrat des princes écrivit à son adversaire de la matinée:
«Mon cher comte,
«Je n'ai eu jusqu'ici qu'à me louer de vos services, et j'éprouve une très-réelle satisfaction à vous donner ce témoignage, au moment où de graves considérations me forcent à vous laisser aller vers cette retraite que votre âge et vos travaux réclament impérieusement.
«Je n'oublierai jamais que vous avez été le confident de mes pensées les plus intimes. Souvenez-vous-en aussi.
«P.S. C'est le malheur des princes de rester insolvables envers ceux qui les ont le mieux servis. Je ne puis m'acquitter, mon cher comte. Mais je veux que le poids de ma dette me soit une occasion de penser toujours à vous.
«Sur ce, etc., etc.
Signé: BONIFACIO XXIII.
—Comprendra-t-il bien ce post-scriptum? demanda le prince Bonifacio avec une certaine inquiétude qui ressemblait à un remords. Je ne peux pas lui demander grâce pour la somme que j'ai perdue. Je la lui payerai, bien certainement, sur mes économies, quand j'en ferai. Mais s'il s'avise de me la réclamer, je le décrète d'accusation. Aux termes de la constitution, il est responsable de mes bévues; j'en trouverai bien quelques-unes d'assez solides pour le faire pendre. Voilà, d'ailleurs, un jeu de cartes qui commence le trésor des pièces à conviction.
Et pleinement rassuré par ces raisons d'État dont il ne sentait pas l'improbité, Son Altesse fit porter le fatal message et passa dans son cabinet de toilette pour se préparer à recevoir dignement le plus grand savant de sa principauté.
L'entrevue du docteur et du prince mériterait les honneurs de la comédie. Bonifacio, malgré le sentiment de sa dignité personnelle et de sa dignité officielle, était un peu ému à la pensée d'avoir pour ministre un savant, un vrai savant. Ces diables de gens qui discutent du ciel et de la terre ont quelquefois envers les puissances de ce bas monde des familiarités et des dédains que le prince redoutait. Si son premier ministre allait devenir son maître! Je sais bien qu'après tout la question des émoluments pesait d'un grand poids dans l'esprit de Son Altesse, et que la perspective d'être servi gratis donnait à l'apparition du docteur Marforio le charme d'une délivrance. Sans appointements! ces deux mots rayonnaient comme le: sans dot! aux yeux de l'avare.
Marforio, de son côté, avait l'émotion d'un artisan du Grand Oeuvre qui touche au but suprême, et qui n'a plus qu'à tirer un léger rideau pour recevoir l'entier éblouissement de la vérité. Le ministère n'était qu'un moyen; la science était sa seule ambition. Peu lui importait d'être appelé Excellence, et de monter dans le vieux carrosse détraqué de Son Altesse. Pour lui, l'essentiel, c'était la possibilité de trouver des sujets d'expérience, de faire la nique aux préjugés, et de poser le pied sur le front d'airain de l'ignorance.
Jamais l'orgueil, la joie de participer aux choses divines n'avait mis plus de lueurs dans les yeux et sur le front d'un mortel. La perspective du triomphe avait attendri le cœur du docteur; il était devenu presque sentimental. Quand Lorenzo l'eut quitté, en lui recommandant de se hâter d'aller au palais, Marforio sentit ses jarrets s'amollir; il s'assit.
—Marta, ma fille, viens m'embrasser, dit-il à son enfant; et il lui donna un vrai baiser paternel.
—Allons, mon père, songez à votre toilette, répondit Marta, dont le cœur battait bien fort.
Le docteur endossa son plus bel habit, et regretta pendant quelques instants d'avoir négligé jusque-là le soin de sa personne.
—C'est un habit bleu de ciel brodé d'argent que je devrais avoir, se dit-il, un habit couleur du firmament. A partir d'aujourd'hui, j'entre au service de l'Être suprême, et le costume est un symbole.
Maria craignait que les honneurs ne rendissent son père un peu fou. La pauvre enfant était indulgente pour le passé. Elle voulut arranger elle-même la perruque de cérémonie sur les beaux cheveux gris de son père. Elle cousit les dentelles au jabot et les manchettes aux poignets, tout en accumulant les recommandations.
—Savez-vous comment on salue un prince? disait-elle, en époussetant le chapeau du docteur.
—Parbleu! je le saluerai en latin, en grec, en hébreu, dans toutes les langues passées, présentes, et j'oserai dire, futures.
—Ce n'est pas cela, mon père. Il y a une révérence à faire.
—Ne veux-tu pas que je prenne un maître à danser?
—Mon bon père, soyez patient et prudent. Le prince Bonifacio n'a jamais reçu de savants à la cour; il pourra manquer à ce qu'il vous doit; ne le rebutez pas!
—Sois tranquille, mon enfant, je sais quelle indulgence il faut avoir pour les grands du monde. Je l'épargnerai d'autant plus que ce n'est pas un aigle, ce bon Bonifacio!
—Surtout, mon père, ne répétez pas tout haut cette opinion-là, à la cour!
—Oh! j'imagine qu'elle doit y être répandue, et que Bonifacio lui-même ne s'aveugle pas à cet égard.
—Mais, s'il s'aveuglait, par hasard, mon bon père, ne lui ouvrez pas les yeux!
—Ne crains rien! As-tu encore quelque recommandation, petite prêcheuse?
—Ne soyez pas trop distrait. Il vous arrive de puiser dans la tabatière de votre interlocuteur, plus que celui-ci ne le voudrait; prenez garde à cela. Et puis, enfin, ne m'oubliez pas; et quand vous serez installé, pensez que vous avez laissé au logis votre enfant toute seule.
—Et mon laboratoire aussi; ne crains rien: si Bonifacio me comprend, dès demain j'installe tous mes instruments, et tu viens me rejoindre.
—Oh! non, mon père, moi je n'irai pas; je ne dois pas aller à la cour, répliqua vivement la jeune fille, en rougissant beaucoup.
—Sournoise, tu ne veux pas y aller encore? mais, quand tu seras princesse, tu ne pourras plus refuser d'y venir.
—Princesse! reprit la jeune fille avec effroi, ce mot-là me fait peur; pourvu que je sois toujours aimée, je bénirai Dieu.
—Et ton père, n'est-ce pas, qui t'aura conquis une couronne par son génie? Allons, adieu; je te raconterai ma visite, et je promets de te rapporter des bonbons de la cour; car on doit en manger à tous les repas.
Quand on vint annoncer à Son Altesse Bonifacio que le docteur Marforio l'attendait, le prince se cambra démesurément, fit ouvrir à deux battants les portes du salon où il donnait ses audiences, et s'avança avec majesté, en levant le pied et en tendant la jambe.
Le docteur ne voulait pas paraître ému devant un souverain dont il jugeait sévèrement les capacités publiques et privées; mais l'effort même qu'il fit pour rester calme donna à sa contenance une raideur et un embarras que Bonifacio interpréta précisément dans le sens de cette émotion. Il voulut se montrer courtois devant un savant si modeste.
—Parbleu! docteur, je suis enchanté de vous voir et de faire votre connaissance. Mon fils m'a dit qu'il vous était agréable de prendre une part du lourd fardeau du pouvoir. Je n'ai rien à refuser à mon fils, vous êtes ministre. Asseyons-nous et causons comme de vieux amis.
—J'avoue, prince, qu'en songeant au ministère, répondit Marforio, j'ai moins ressenti le puéril orgueil de gouverner les hommes, que l'ambition de doter le monde de mon système.
—Ah! oui, vous avez un système, une idée fixe. Nous allons en reparler. Je ne contrarie jamais mes ministres, moi; je les laisse libres d'agir et de faire ce qu'ils veulent, à la seule condition qu'ils ne m'ennuieront pas davantage. Taillez, rognez, amusez-vous; mais ne me demandez pas d'argent. Quant au gouvernement des hommes, entre nous, c'est bien peu de chose! avec deux ou trois leçons, vous en saurez autant que Machiavel! Ah! si les peuples avaient le temps de réfléchir, ils auraient des tentations de se passer de nous! Tenez! moi qui vous parle, je ne suis que le fils de mon père, Bonifacio XXII; eh bien, si je voulais m'en donner la peine, je pourrais jouer, tout comme un autre, mon rôle de grand homme; ce n'est pas la mer à boire. Seulement, j'avoue que c'est fatigant; et puis, cela rapporte si peu à l'artiste et au spectateur, que j'aime autant la lueur paisible de mon règne. Cela n'éblouit pas, mais cela suffit à éclairer.
—Vous êtes un philosophe, dit Marforio.
—Et vous, mon cher ministre, vous êtes un flatteur, ce qui prouve une première aptitude pour le métier de courtisan; je vous fais mon compliment. On dit que vous avez une jolie fille?
—Et vous, prince, vous avez un aimable fils.
—Oui, il est gentil, un peu timide; c'est la faute de son institutrice. Heureusement, je n'ai pas besoin de lui. Il fait les yeux doux à votre héritière, mon héritier.
—Prince, croyez que je ne suis pour rien...
—Parbleu! vous êtes un savant! Vous regardez sans doute les étoiles avec une grande lunette et vous ne voyez pas ce qui se passe à votre nez. C'est toujours comme cela.
—Si Votre Altesse daignait m'instruire des devoirs de ma charge, demanda le docteur, un peu décontenancé par les persiflages du prince.
—Vos devoirs? c'est de parapher les ordonnances que je signe, et, soyez tranquille, j'économise le papier, je n'en signe guère. C'est de s'asseoir à côté de moi, à table, d'être toujours de mon avis, excepté quand je suis du vôtre; car alors il faut avoir l'air de se résigner et de se courber, vaincu, sous le poids de mes raisons; et puis... Ma foi, j'ai oublié le reste. Mais le premier garçon de bureau du ministère vous dira cela. Règle générale, une seule condition est indispensable pour être mon ministre, la nomination. Puisque vous l'avez en poche, vous êtes un ministre aussi parfait que vos collègues. Il ne vous manque que le costume. Je vais le réclamer à Colbertini. Bien qu'il serve depuis vingt-cinq ans, je le crois encore mettable. Maintenant, mon cher docteur, que nous voilà liés l'un à l'autre, dites-moi donc, entre nous, là, franchement, ce que c'est que la science.
—Ce que c'est que la science? monseigneur! s'écria le docteur qui croyait trouver une occasion d'enfourcher son dada.
—Oui, je devine ce que vous allez me débiter. Des grands mots, des grandes phrases! Mais, nous autres, dont le métier est d'en apprendre et d'en réciter, nous ne sommes pas dupes de cette rhétorique. Je m'imagine que la science c'est comme le pouvoir, l'art de vivre du respect des autres et de s'en faire un joli petit édredon. Mais, vraiment, qu'est-ce que vous savez de plus que moi, par exemple?
—Il faudrait que Votre Altesse me renseignât sur ce qu'elle a étudié.
—Moi, je n'ai rien étudié, je m'en vante. J'ai joué autrefois très-agréablement de la viole; je ne suis pas sans adresse au bilboquet, et je manie les cartes sans trop de désavantage, excepté quand on me triche, ajouta Bonifacio avec amertume.
—Je ne sais rien de tout cela, moi, reprit avec fierté le pauvre docteur, qui trouvait son prince encore inférieur à la mauvaise opinion qu'il en avait; mais je connais l'origine du monde, je sais décomposer les éléments, combiner des forces inconnues.
—Et puis après? Connaissez-vous une meilleure façon de brûler le café, de donner moins de mélancolie aux heures qui suivent le repas? Avez-vous trouvé l'eau de Jouvence? Tant que la science ne pourra pas prolonger d'une heure le plaisir de vivre, ni ajouter une jouissance à la somme des prétendues félicités terrestres, elle sera, comme le pouvoir, le pis aller des ignorants.
—Eh bien! monseigneur, dit enfin le docteur Marforio, en redressant sa taille, en s'efforçant de se faire très-grand, pour se faire très-imposant, moi, votre ministre, je vous apporte précisément cette jouissance que vous regrettez. Cette eau de Jouvence que les jolies femmes désirent encore plus que les laides et dont bien des hommes chercheraient à s'abreuver, je l'ai fait jaillir et je vous l'offre; ce sera le payement de ma bienvenue.
—Vous pouvez rajeunir les gens? demanda Bonifacio avec une curiosité qui n'était pas désintéressée.
—Je n'efface pas les rides du front, et je ne fais pas refleurir les roses dans la neige, répliqua le docteur Marforio; mais je sais l'art, ou plutôt la science d'alléger le vol des années, d'empêcher toute action dévastatrice de la pensée sur le corps. Je prolonge la vie en la conservant. Cette flamme qui brûle en nous, je l'empêche de nous brûler.
—Parbleu! je serais curieux de voir cela, interrompit Bonifacio, qui ne comprenait pas bien, et qui se rendait à lui-même cette justice que jamais la pensée n'avait fatigué son corps.
—Le problème de vivre est le seul problème intéressant, continua le docteur. Chacun l'a abordé. Les uns ont inventé des philtres; d'autres ont prétendu rajeunir par des évocations et des sortiléges. Ma science est moins empirique; elle repose sur la philosophie la plus judicieuse; elle a puisé ses éléments dans la connaissance du corps et dans l'étude de l'âme. Un de mes confrères, un de ces demi-savants comme l'Allemagne en propose pour modèle à la France, le docteur Florentius ne prétend-il pas qu'il suffit de boire frais, de manger avec discernement, d'user modérément de toute chose pour vivre jusqu'à deux cents ans, terme extraordinaire, et jusqu'à cent cinquante ans, terme moyen?
—Deux cents ans! c'est joli, murmura Bonifacio.
—Bah! qu'est-ce que cela, repartit Marforio, si je vous donnais l'éternité?
—Je l'accepterais, mais à la condition que ce fût toujours gratis, dit en riant le prince.
—Si je supprimais d'un seul coup les querelles, les disputes, les guerres, qui sont des agents de destruction?
—Bravo! ce serait une économie pour mon budget et un grand sujet de joie pour mon ministre de la guerre, qui est d'un caractère très-pacifique. Mais, mon cher Marforio, si les hommes ne mouraient plus, est-ce qu'ils continueraient toujours à se multiplier? Je craindrais l'encombrement: la terre est petite.
—J'ai prévu le cas, continua gravement le docteur; il y a des esprits si mal faits qu'ils ne sont jamais contents de rien. Ceux-là commenceraient à s'impatienter de la vie vers quatre-vingt-dix-neuf ans, et se tueraient à cent vingt-cinq ans. D'ailleurs, je donne la possibilité de ne pas mourir, mais je n'impose pas la vie.
—Oui, je comprends, on est toujours libre de ne pas boire de l'élixir. Quant à moi, mon cher docteur, ne craignez rien, j'ai le caractère bien fait, l'âme robuste. Je m'accommodais de l'existence mesquine et bornée que je menais déjà. Je ne me lasserai jamais de l'existence sans bornes et sans limites que vous me promettez. Quand déboucherons-nous la bienheureuse fiole?
—L'incomparable mérite de mon système tient précisément à ceci, continua Marforio; je ne me sers ni de fiole, ni de pommade, ni de philtre. Je n'emploie que les seules ressources de l'humanité banale. Il suffira que je vive assez longtemps pour laisser des élèves, et que je trouve quelqu'un pour me faire jouir à mon tour du bienfait que j'aurai donné. Le salut du monde est à ce prix.
—Per Bacco! vous allez devenir un ministre précieux.
—J'ai remarqué, reprit le docteur, que le sommeil, qui passe généralement pour le repos de l'âme et du corps, est bien souvent pour celle-là une fatigue qui influe sur celui-ci, la plus dangereuse, la plus traître de toutes les fatigues, puisque nous n'en avons pas conscience au moment même, et que nous ne pouvons ni y faire diversion, ni la suspendre.
—Je m'en étais toujours douté! s'écria Bonifacio. Je me réveille quelquefois la tête lourde, l'estomac pesant; les rêves troublent la digestion. Ah! si l'on pouvait dormir sans rêver!
—Vous touchez au point délicat, au pivot de mon système.
—Mon cher ministre, cette pénétration m'est habituelle. Faites-moi le plaisir de ne plus vous en étonner.
—Supprimer les rêves, continua Marforio, faire que le sommeil soit réellement ce qu'il devrait être, le repos, l'anéantissement de la pensée: ce serait doubler, tripler l'existence humaine. Combien de fois de pauvres dormeurs ne se sont-ils pas couchés avec des cheveux noirs et éveillés avec des cheveux blancs! Ils avaient vieilli de vingt ans dans un rêve. Remarquez, d'ailleurs, que les rêves sont des reflets des pensées du jour précédent ou des projections des pensées du jour qui doit suivre. Mais, d'ordinaire, ils sont inutiles au passé et à l'avenir; et on a regardé comme des miracles, comme des visitations célestes, tous les rêves qui ont eu un sens, qui ont contenu un avertissement logique. L'humanité a donc tout à gagner à ne plus rêver.
—Je ne verrais plus comme dans un cauchemar ce scélérat de Colbertini me gagnant sans cesse! soupira Bonifacio. Mais les rêves sont souvent des remords. Vous supprimez la conscience, mon bon Marforio?
—D'abord, ce serait assez commode aux hommes d'État, et je ne les engagerais pas à s'en plaindre, riposta Marforio; et puis qu'importent les remords, si je supprime les criminels?
—Vous avez raison, les remords seraient du superflu. Mais comment vous y prendrez-vous?
—Parbleu! c'est tout simple: l'homme ne vivant plus dans une excitation continuelle, et se reposant complétement la nuit de l'humanité qui lui pèse le jour, n'aura plus de tentations fâcheuses. Supprimer l'obstination, l'acharnement de la pensée, c'est supprimer les écarts, les excès, les ivresses, les vertiges de l'imagination.
—Hum! dit le prince en respirant, comme un homme qu'on a contraint pour la première fois de faire un plongeon et qui cherche à prendre de l'air, je ne vois pas trop comment vous ferez.
—Le cerveau est l'instrument de la vie intellectuelle et morale, continua le docteur; j'ai découvert qu'il n'est pas l'agent principal de la vie physique.
—Je m'en suis toujours douté, interrompit Bonifacio en croisant les mains sur son estomac.
—En conséquence de cette découverte, reprit Marforio, je crois que si l'on pouvait refuser momentanément au cerveau les instruments qu'il fait agir, il ne travaillerait plus, et il laisserait le corps dans une immobilité profitable à l'organisme entier et au cerveau lui-même. Fort de cette conviction, j'ai expérimenté et voici mon résultat. Au moyen d'un délicat instrument, qui trancherait le fer comme un fruit, je pratique une incision circulaire dans la boîte osseuse, de manière à ce que le sommet du crâne puisse s'enlever comme un couvercle.
—Comme une tabatière qu'on ouvre, dit le prince, en saisissant une pincée de tabac dans une boîte d'écaille.
—Votre Altesse comprend parfaitement. Avec une cuiller faite d'un métal composé par moi, et après que j'ai paralysé par un narcotique les résistances de la volonté, j'enlève délicatement la cervelle; je laisse le cervelet qui suffit à la vie bestiale, et je dépose dans l'eau la plus limpide cette pauvre cervelle qui se baigne tout à son aise, et se pénètre de fraîcheur.
—C'est ainsi que nos fermiers font rafraîchir le beurre, dit Son Altesse qui avait un faible pour les comparaisons.
—Sans doute, repartit Marforio. Je laisse toute la nuit la cervelle se reposer de cette façon. Le corps, pendant ce temps, ne vit que d'une vie végétative. Le matin, au premier chant du coq, je pêche la cervelle dans le vase de cristal où je l'ai déposée; je la replace dans le crâne; je referme le couvercle, et l'homme se réveille et agit, pense, travaille, complétement délassé, rajeuni, sans aigreur, sans les influences fâcheuses que laissent les mauvais rêves et les sommeils pénibles.
—Voilà qui est prodigieux, s'écria Bonifacio. Mais croyez-vous le procédé infaillible?
—Infaillible.
—Je pensais qu'on ne touchait pas impunément à la cervelle.
—Autrefois, c'est possible, parce qu'on s'y prenait mal. Mais maintenant on a trouvé le moyen de manier et de pétrir les cerveaux comme on veut.
—Quel précieux ministre j'ai là! dit Bonifacio en riant.
—Vous comprenez qu'avec un pareil système, j'allonge la vie de toute la quantité qui se perdait dans le sommeil. C'est une lumière que je souffle tous les soirs et que je rallume tous les matins.
—Au lieu d'emprisonner les gens, demanda le prince, ne pourrait-on pas à l'avenir se contenter de leur prendre la cervelle pour un jour ou deux?
—Parfaitement.
—C'est fabuleux! c'est fabuleux! mon cher ami, votre système m'enchante, il est peut-être absurde, mais il doit être amusant. Nous verrons s'il n'offre pas des difficultés dans l'application. Mais sur qui avez-vous fait des expériences?
—Jusqu'à présent, je me suis contenté des morts...
—Ah bah! s'écria Son Altesse, en bondissant sur son siége; mais alors vous ne répondez pas des vivants?
—Au contraire, monseigneur, ceux-ci ont une complaisance qui facilite les expériences; d'ailleurs, j'allais ajouter que j'ai aussi expérimenté dans les maisons de fous, et les résultats obtenus dépassent toutes les prévisions de la science. C'est à confondre l'entendement.
—Vous avez guéri les fous?
—Oh! non, monseigneur! Si je les avais guéris, j'étais vaincu, puisque je changeais les conditions de vie morale de leur cervelle. J'ai remarqué que non-seulement ils étaient le lendemain aussi fous que la veille, mais qu'il y avait même une petite recrudescence, un progrès.
—Voilà qui est tout à fait péremptoire, dit le prince: vous me montrerez ces bienheureux fous, assez sages pour ne pas guérir. Mais sur qui allons-nous opérer?
—Je pensais que monseigneur serait enchanté de dormir sans mauvais rêves et de donner le bon exemple à ses sujets.
—Sans doute, sans doute; mais je ne serais pas fâché non plus d'avoir vu l'opération réussir sur mes ministres d'abord; je vous les abandonne.
—Monseigneur sera content.
—Eh bien, mon cher Marforio, je ne m'étais jamais douté que le dernier terme du progrès et le dernier mot de la science était de fêler les crânes! Je suis curieux de vous voir à l'œuvre; quand commençons-nous?
—Quand il plaira à Votre Altesse.
—Il faut que je prépare mon ministère à l'opération; ces gaillards-là n'auraient qu'à vouloir garder leurs cervelles intactes.
—Ah! monseigneur, croyez bien qu'ils ne tiennent pas à si peu de chose! Donnez-leur un titre, un hochet, et vous aurez toutes les cervelles de la principauté.
—Quel homme vous êtes! Vous franchissez d'un bond tous les échelons de la politique.
—Et vous, monseigneur, tous les abîmes de la science.
—Nous sommes faits pour nous entendre, mon bon Marforio.
—J'en ai l'espoir, monseigneur.
—Il ne me reste plus qu'à juger votre capacité à table. Mais j'ai de la confiance.
—Je la justifierai, monseigneur, dit Marforio qui ne se sentait pas d'aise, et qui, malgré la gravité des engagements pris par lui, eût dansé une sarabande au milieu du salon, s'il eût osé. Après tout, Richelieu dansait bien.
Bonifacio XXIII passa dans la salle du festin et présenta son nouveau ministre à ses collègues.
Marforio comprit du premier coup d'œil qu'il aurait facilement raison de ces excellentes gens. Ils n'avaient pas résisté à une vingtaine d'années de pouvoir et quelques-uns florissaient dans cet épaississement physique et moral qui était comme le but et la récompense des hautes fonctions exercées dans la principauté.
—Hein! dit Bonifacio tout bas à son premier ministre, quelles bonnes têtes!
Le docteur s'assit avec appétit. Mais en lui voyant manier avec vivacité son couteau qui jetait des étincelles, le prince se demanda si l'aimable docteur pensait à son système ou au somptueux dîner que le budget lui donnait.
Le dîner fut gai. Le docteur, je l'ai dit, n'était pédant qu'à son heure, et l'heure était passée ce jour-là. Il tint tête au prince Bonifacio et à tout le ministère. Or, les collègues de Marforio n'étaient pas des gens incapables. Le ministre de la guerre notamment, qui se croyait obligé de représenter à lui seul toute la force militaire de la principauté, était une espèce de colosse, rouge comme un pivoine, orné de moustaches terribles, et buvant avec une intrépidité supérieure. Il ne dissimulait pas son dédain pour le savant, et, après avoir laborieusement cherché une plaisanterie, il finit par lui demander s'il avait inventé la poudre.
Cette facétie, qui se produisait avec des rires effroyables, se renouvela de minute en minute. Mais Marforio était d'une douceur admirable, et du coin de l'œil il prenait la mesure du crâne de son collègue et se disait tout bas:
—Au lieu de faire nager sa cervelle dans de l'eau, si je la plongeais dans le vin! ce serait son élément.
Le ministre de l'instruction publique était le plus modeste. Il avait peur de laisser voir son ignorance et ne soufflait mot.
Le ministre des finances calculait, à chaque plat nouveau qu'il voyait apporter, les dépenses du festin, et songeait à la banqueroute.
Il n'y avait pas de ministre des travaux publics, le prétexte même pour cet emploi ayant toujours manqué.
Le ministre de la justice était un pauvre gentilhomme ruiné qui s'était emparé, avec l'agrément de Bonifacio, du glaive de la loi pour n'en être point frappé, et qui n'avait trouvé d'autre moyen d'échapper aux procureurs et aux huissiers que de se faire leur général en chef. Il était inviolable, et ne destituait pas ceux qui n'essayaient pas de le poursuivre.
C'est ainsi qu'on trouvait dans toutes les branches du gouvernement un petit système de compensation et d'équilibre qui faisait que la machine, sans marcher réellement, paraissait se mouvoir.
Marforio, dans la conversation, glissa quelques mots de son système. Toutes Leurs Excellences ouvrirent de grands yeux. Chacun porta la main à son front, mais personne n'offrit sa tête. Bonifacio fut outré de cet égoïsme.
—Je ne prétends pas que ce soit des têtes sans cervelle, dit-il tout bas au docteur; car alors ils nous seraient inutiles; et ils auraient raison de nous refuser. Mais je vous affirme que ce sont des ingrats. Et on s'étonne qu'avec de pareils instruments je ne fasse pas des merveilles!
—Grisons-les, répliqua laconiquement Marforio.
—Ce sera difficile. Ils se sont tous exercés, comme Mithridate, à ne pas redouter le poison.
Marforio multiplia les rasades. Peut-être bien trouva-t-il le moyen de mêler quelque breuvage auxiliaire aux vins versés. Quoi qu'il en fût, sur la fin du repas, le ministre de la guerre pencha sa forte tête sur son assiette et ronfla comme un canon. Les autres ministres subirent à leur tour l'effet de la contagion, et bientôt il ne resta plus d'éveillés que le prince et le docteur.
—Enfin le moment est venu! s'écria à voix basse Son Altesse qui s'essuyait le front avec sa serviette.
Marforio aiguisait son instrument. Il fit monter une caisse mystérieuse qu'il avait eu soin d'apporter en venant prendre possession du ministère, et, après avoir verrouillé les portes, il fit les derniers préparatifs.
La scène était étrange. Bonifacio pâlissait.
—J'aurais dû demander l'expérience avant le dîner, murmura-t-il.
Marforio, calme, solennel, radieux comme un prophète, versait de l'eau dans des grands vases de cristal et mettait des petites étiquettes pour les reconnaître.
—Voici le ministre de la guerre, disait-il, voilà Son Excellence de l'instruction publique. Ce bocal est pour M. le ministre des finances.
—Dépêchez-vous, dépêchez-vous, disait Bonifacio avec une sérieuse émotion et d'une voix entrecoupée qui démontrait suffisamment que le dîner avait été une imprudence de Son Altesse.
—Voilà! je suis prêt! répondit Marforio en faisant étinceler devant les bougies le fameux instrument qui ouvrait les crânes.
—Par qui commencerai-je? demanda-t-il.
—Je n'en sais rien, répliqua Bonifacio dont la bonne âme ressentit tout à coup des scrupules. Si vous alliez leur faire du mal, mon cher ami!
—Je réponds du contraire, monseigneur.
—Il sera bien temps de vous contredire, quand vous les aurez tués ou rendus idiots!
Marforio sourit; il trouvait la dernière crainte par trop chimérique.
—J'offre ma vie pour caution, pour garant, dit-il fièrement.
—Allons! j'ai promis, répondit le prince en se résignant.
—Qui Votre Altesse veut-elle m'indiquer?
Bonifacio promena un regard mélancolique sur son ministère. Au fond, il se souciait aussi peu de l'un que de l'autre, et il les avait tous en fort médiocre estime; pourtant il ne voulait pas les sacrifier à la légère:
—Commencez par le ministre des finances, balbutia-t-il; c'est celui auquel je tiens le moins et que je remplacerai le plus aisément.
Marforio s'avança vers son sujet; mais, au moment de pratiquer l'incision circulaire, et pendant que Bonifacio, véritablement tremblant, se couvrait les yeux pour ne pas voir cet acte de haute témérité, le docteur s'arrêta:
—Prince, nous n'avons pas fait nos conditions. Je vous donne le secret de vivre. Croyez-vous que le sot orgueil d'être votre ministre suffise pour me récompenser?
—Qu'est-ce qu'il va me demander? se dit le prince. Je croyais, mon bon Marforio que tout cela était fait gratis?
—Aussi, n'est-ce pas pour moi que je stipule. Monseigneur, si je réussis, permettez au prince Lorenzo d'épouser ma fille.
—Ce n'est que cela! s'écria Bonifacio en dégonflant sa poitrine; j'ai eu peur. Je vous donne ma parole, mon cher docteur, que Lorenzo est libre; d'ailleurs, il régnera si tard, si tard, s'il règne jamais, que je n'offense guère mes aïeux en permettant cette mésalliance.
—J'accepte votre parole, dit Marforio, qui fit sauter lestement la perruque de son collègue des finances, et qui traça avec la pointe de son instrument une ligne autour du front.
Tremblant, agité, Bonifacio plongeait la tête dans sa serviette. Au bout de quelques secondes, n'entendant aucun bruit, il osa regarder et resta confondu du spectacle étrange qui s'offrit à lui. Le ministre des finances souriant et dormant du sommeil le plus profond était étendu dans son fauteuil. Son crâne était ouvert, une partie relevée permettait de voir qu'il était vide.
Marforio déposait avec les plus grands égards la cervelle de son collègue au fond du vase de cristal qui lui était destiné.
Un frisson d'admiration qui participait aussi de l'épouvante parcourut Son Altesse depuis les pieds jusqu'à la tête.
—C'est inouï! c'est inouï! répéta-t-elle plusieurs fois. Si je ne le voyais pas, je ne pourrais pas le croire.
—Votre Altesse peut s'assurer que son ministre est intact, et quand on lui referme le crâne, il n'a absolument rien de changé extérieurement.
Et Marforio donna un petit coup sec à la boîte osseuse dont le couvercle retomba avec un léger bruit.
—Il vit toujours? demanda Bonifacio.
—Tâtez son pouls! Écoutez sa respiration! Voyez même comme sa figure est embellie! Depuis que je lui ai retiré la pensée, il ne fait plus la grimace. Je suis convaincu, monseigneur, que votre ministre avait du chagrin!
—Pauvre Manfredi! cela serait-il possible? Est-ce qu'il prendrait à ce point mes intérêts? Il faudra lui enlever ce chagrin-là, mon cher Marforio.
—N'ayez aucune inquiétude! il le laissera au fond de l'eau.
—Si nous en restions là pour aujourd'hui?
—Impossible, monseigneur, demain mes collègues hésiteraient peut-être à boire et à bien dîner. J'ai hâte d'ailleurs de vous convaincre tout à fait.
La même opération fut donc renouvelée sur le ministre de la guerre, sur le ministre de la justice et sur le ministre de l'instruction publique. Marforio montra au prince que la vie n'avait pas été attaquée, et que ces éminents fonctionnaires, débarrassés du fardeau de leur pensée, prenaient dans le sommeil un air de béatitude incroyable. Bonifacio était vraiment jaloux du calme, de la bonne mine qu'ils avaient pendant leur repos, d'autant plus jaloux que lui n'était pas tranquille; s'il l'eût osé, il se fût offert tout de suite pour l'expérience; mais il réfléchit que l'expérience ne pourrait être complète et décisive à ses yeux que quand il aurait assisté au réveil; et il avait tout d'abord grand besoin de savoir comment on se trouvait le lendemain d'une opération si capitale.
—Mon cher Marforio, dit-il, vous êtes un grand homme. Vous illustrerez mon règne; et je désire apprendre au plus vite votre façon d'endormir les gens, pour vous rendre à mon tour le service que vous avez rendu aujourd'hui à mes pauvres ministres et que vous me rendrez demain.
—A quand le mariage de nos enfants, monseigneur, demanda Marforio?
—Quand vous voudrez. Arrangez cela avec Lorenzo.
Marforio s'inclina. Il triomphait modestement. L'immense orgueil qui dilatait sa poitrine craignait de se manifester devant ce prince ignorant. Il fut convenu que les cervelles des ministres seraient enfermées dans la salle du trésor. C'était une pièce inutile, dans laquelle personne n'entrait jamais. Il y avait pourtant un grand honneur dans cette assimilation des objets répandus dans l'eau avec les joyaux de la couronne. La clef de cette première retraite fut soigneusement retirée. Les corps furent transportés sur des lits. Aucun valet ne s'inquiéta au château des précautions prises par Bonifacio XXIII envers les ministres. Ce n'était pas la première fois qu'ils s'endormaient à table; mais c'était la première fois que, dans un cas pareil, ils dormaient ailleurs que sous la table. Bonifacio, en voyant partir le docteur, lui renouvela encore l'expression de son admiration sincère. Il était impatient de rajeunir à son tour, d'avoir une mine aussi fraîche, aussi reposée que celle de ses ministres.
Marforio, lui, était si gonflé qu'il avait la légèreté d'un ballon. Il revint à pied chez lui; c'était une dernière concession qu'il faisait à l'humanité, avant de s'élever définitivement au-dessus d'elle. Marta l'attendait sur le seuil de la maison. Je dois avouer qu'elle n'était pas seule à l'attendre, et que Lorenzo lui tenait compagnie.
—Réjouissez-vous, mes enfants, dit le bon Marforio, en embrassant sa fille. Marta, tu seras princesse, quand il plaira au joli prince que voici. Son Altesse a consenti au mariage; et moi, je suis, à partir de cet heureux jour, le plus grand savant du monde.
—Quoi! mon père n'a pas résisté? demanda Lorenzo, qui s'inquiéta fort peu de savoir si le système avait été mis à l'épreuve et si l'expérience avait réussi.
—Lui, me résister! repartit Marforio qui pensait trop à son récent succès pour s'apercevoir qu'on n'y pensait pas. Venez demain au château, mon ami Lorenzo, et vous verrez comment la science acquiert les titres de noblesse.
Sur ce, Marforio, qui avait fait un sacrifice suffisant aux émotions de famille et aux détails intérieurs, entra dans son laboratoire pour savourer tout à son aise la joie qui le débordait. Je respecterai ces épanchements inutiles à mon récit, et nous resterons, si vous le voulez bien, en compagnie des deux amoureux.
—Est-ce un rêve? Marta, demanda le sentimental Lorenzo.
—Je suis bien heureuse, murmurait la jeune fille, en remerciant du regard la lune et les étoiles.
—O Marta! je vous aime! et j'eusse sacrifié l'espoir d'une couronne à l'espoir d'être votre époux.
—Non, monseigneur, vous vous devez au bonheur de la principauté, et Dieu ne veut pas que j'aie besoin d'être égoïste pour vous aimer.
—Si vous saviez, Marta, comme ce titre de prince me semble presque ridicule avec cette autorité dérisoire et au milieu de ces oripeaux fanés! Au lieu de vous conduire à la cour, je voudrais la fuir avec vous.
—Je n'ai pas ces frayeurs, et comme je n'ai pas d'ambition, reprit Marta, avec un sourire qui éclairait jusqu'au fond de son cœur, je veux être princesse, puisque vous êtes prince, et je veux vous soutenir et vous donner confiance. Allons, mon ami, ne redoutons pas le bonheur. Puisqu'il vient, prenons-le!
—Marta, vous êtes la sagesse, comme vous êtes la beauté, dit Lorenzo, en appuyant ses lèvres sur les mains de la jeune fille.
—Adieu! mon prince, répondit-elle en s'échappant; sachez bien que quand je serai princesse, je détesterai les flatteurs.
Lorenzo ne protesta pas; il sourit et rentra au palais paternel, dont il avait toujours une clef sur lui.
Par suite des dispositions plus que tolérantes que j'ai mentionnées en commençant, Son Altesse Bonifacio XXIII n'avait pas de gardes pour veiller aux barrières de son Louvre. Il dormait tranquillement, sans avoir besoin qu'on fît sentinelle à sa porte; et comme il voulait que chacun chez lui se conformât à cette habitude, dès que le prince avait soufflé sa bougie, l'obscurité éteignait toutes les fenêtres, à tous les étages; depuis le grenier jusqu'à la loge du portier, tout le monde se mettait en mesure de dormir. Ceux qui avaient, par exception, le droit d'entrer ou de sortir de ce palais narcotisé, étaient obligés à porter constamment avec eux une clef particulière.
Ce détail, vous allez le voir, n'est pas étranger à mon récit; car, au moment où le prince Lorenzo introduisait son passe-partout dans la serrure, il sentit qu'à l'intérieur un autre passe-partout rencontrait et contrariait le sien. Quelqu'un cherchait à sortir de la même façon qu'il cherchait à entrer. Comme le résultat demandé par ces deux mouvements contradictoires était le même pour tous les deux, et qu'il s'agissait en définitive d'entrer et de sortir, et que, pour ce faire, l'ouverture de la porte était nécessaire, la porte s'ouvrit.
Une ombre, assez robuste pourtant pour qu'on la sentît au passage, essaya de se glisser entre la muraille et le prince Lorenzo.
—Qui êtes-vous? demanda résolûment notre héros.
Il savait bien que les voleurs n'avaient pas plus affaire la nuit que le jour dans le palais.
L'ombre, tenue en respect par la main fine et nerveuse du prince, parut décidée à garder le silence.
—Prenez garde, reprit ce dernier, je vais appeler, faire venir de la lumière, et je saurai bien, malgré vous...
—Monseigneur, ne faites pas de bruit, se hasarda enfin à répondre l'ombre en question.
—Quoi! c'est vous, Colbertini!
—Hélas! oui, monseigneur, c'est moi, reprit avec un soupir et un accent piteux le président du conseil dépossédé. C'est moi!
—Que faites-vous ici à pareille heure? demanda le prince.
—Mais, vous le voyez, monseigneur, je m'en vais comme un serviteur qu'on a chassé! Ah! voilà le prix de vingt-cinq années de bons services! Les princes sont des ingrats.
Lorenzo sourit et fut tenté de répondre:—Et les ministres, donc! On a toujours fait plus pour eux qu'ils n'ont fait pour le prince ou pour l'État.
Mais le prince héréditaire ne voulut pas entamer une discussion de philosophie politique.
—Il me semble, monsieur le comte, dit-il à Colbertini, que vous vous en allez bien tard. Tout le monde dort au château; de qui donc avez-vous pu prendre congé à cette heure?
—J'avais oublié quelques petits objets, murmura Colbertini.
Lorenzo fut frappé de l'embarras de l'ex-premier ministre. Il sentit un mystère. Bien que le palais de Bonifacio XXIII n'eût pas de chances pour devenir jamais un volcan, et bien que Colbertini, un peu machiavélique quand il tenait les cartes, ne le fût plus guère, lorsqu'il s'agissait seulement d'idées, Lorenzo craignit un complot, ou du moins une intrigue.
—Il se passe quelque chose, demanda-t-il vivement à l'ancien ministre et en essayant de le regarder en face; manœuvre que l'obscurité rendait fort difficile, mais qui réussit parfaitement, à cause du peu d'héroïsme de Colbertini.
—Sans doute, monseigneur, il se commet d'effroyables folies dans le château, et j'ai bien peur qu'avant peu un conseil de régence ne soit nécessaire à Son Altesse Sérénissime.
—M. le comte! dit sévèrement Lorenzo.
—Excusez-moi, monseigneur; mais, en vérité, c'est à faire douter de la raison en général et de celle qui préside aux destinées de l'État en particulier. Si vous saviez les horreurs, les abominables sorcelleries que l'on pratique. Ah! j'ai eu bien tort, quand j'étais ministre, de refuser l'établissement d'une inquisition dans la principauté. J'aurais le moyen de me venger.
—Vous venger, de qui donc? demanda Lorenzo avec hauteur.
—Oh! je n'accuse pas Son Altesse, se hâta de répliquer Colbertini, dont la première émotion se dissipait peu à peu. On a méconnu mes services, c'était un droit. Mais j'ai bien à mon tour le droit de haïr ce faux savant, ce sorcier, qui m'a remplacé à force d'intrigues, et qui aura tué avant quinze jours la moitié de la principauté, si on le laisse faire?
Lorenzo sourit et haussa les épaules. Comme il ignorait les premiers éléments du fameux système de Marforio, il n'admettait pas les intentions féroces attribuées à celui-ci.
—Vous êtes injuste, reprit-il. Le docteur vous remplace, mais ne vous a pas supplanté. Et je puis vous avouer que c'est moi qui, sans nourrir contre vous de sentiments hostiles, ai sollicité en sa faveur. Quant à ses prétendues cruautés...
—Ah! c'est vous, monseigneur, repartit Colbertini d'un ton aigre. Je souhaite que vous ne vous repentiez pas un jour de l'imprudence que vous avez commise. Mais comme je ne veux pas que vous m'accusiez de calomnie, venez, venez, je vais vous montrer les premiers actes du nouveau ministre.
Lorenzo ne comprenait rien à la vivacité de Colbertini; je veux dire que tout en admettant le dépit, le ressentiment du ministre évincé, il ne soupçonnait rien des prétextes que celui-ci mettait en avant pour colorer sa vengeance. Tout le monde, je l'ai dit, dormait dans le palais. Lorenzo et l'ex-ministre marchèrent quelque temps à tâtons; puis l'héritier présomptif trouva une cachette, où son domestique avait la précaution de lui placer tous les soirs un briquet et un flambeau, et bientôt les deux interlocuteurs purent se regarder tout à leur aise.
—Comme vous êtes pâle! dit Lorenzo à Colbertini.
—Monseigneur va le devenir autant que moi, répliqua le ministre d'un air pincé.
On monta vers les appartements solennels. Quand on fut arrivé à la salle du trésor, Colbertini tira d'une de ses poches une petite clef qu'il introduisit rapidement dans la serrure.
—Entrez, monseigneur, dit-il.
Lorenzo se demanda s'il allait constater un déficit dans les joyaux de la couronne; mais la présence d'un trésor l'eût beaucoup plus étonné que son absence. Il regarda et ne vit rien que quelques vases de cristal emplis d'eau.
—Eh bien? demanda-t-il.
—Eh bien, monseigneur, voici tout ce qui reste de mes anciens collègues. Et Colbertini montrait les cervelles qui blanchissaient dans l'eau.
Lorenzo s'approcha avec sa bougie, et lut les inscriptions placées par Marforio au bas de chaque bocal.
—Qu'est-ce que cela veut dire?
—Cela veut dire, monseigneur, reprit d'un ton hypocritement lamentable l'ancien président du conseil, que vous avez livré le sort de la principauté à un fou, à un démoniaque, et que sa première œuvre a été ce meurtre sacrilége.
—C'est impossible!
—Impossible, dites-vous! Je n'invoque que le témoignage de mes yeux. Justement alarmé pour le bien public de la destitution qui me frappait, je venais présenter à Son Altesse les humbles suppliques des administrés qui me connaissent, quand j'appris que monseigneur Bonifacio s'était retiré et enfermé avec son ministère. Une curiosité fort désintéressée, je vous le jure, et qui ne songeait qu'au bonheur de tous, me suggéra l'idée de regarder par le trou de la serrure.
—Tiens! dit Lorenzo, il paraît que c'est ainsi qu'on observe les ministres. C'est par le trou de la serrure que je vous ai aperçu ce matin travaillant avec mon père, vous savez?
Colbertini rougit un peu.
—Nos occupations du moins étaient inoffensives, reprit-il avec un mouvement d'orgueil. Monseigneur sait bien que si des ministres ne s'enfermaient jamais avec leur souverain, le vulgaire n'aurait pas confiance dans le pouvoir. Cela fait partie de l'art de régner. Mais jugez de mon épouvante quand j'ai vu, comme je vous vois, monseigneur, cet abominable savant mutiler les fronts de mes anciens collègues, leur ouvrir le crâne et en retirer ces cervelles qu'il destine sans doute à quelque œuvre diabolique.
Lorenzo regarda tour à tour Colbertini et les bocaux et se sentit fort troublé. Il y avait, dans ce mystère, un mélange de grotesque et d'horrible qui répugnait à la raison, mais qui n'était pas incompatible avec les extravagances du docteur.
—Où sont les cadavres, demanda le prince?
—Vous doutez encore, reprit l'ancien ministre qui conduisit Lorenzo vers le lit de repos sur lequel les membres du conseil étaient couchés.
—Regardez cette ligne sanglante autour du crâne, dit Colbertini; voilà la trace du meurtre.
Lorenzo se sentit pris de vertige; il eut pourtant l'effroyable courage de toucher à un de ces crânes vides et de l'entrouvrir. Colbertini triomphait; un forfait inouï dans les fastes de la principauté avait été commis de complicité par son père et par son futur beau-père. L'honneur, l'amour, la puissance, tout croulait à la fois, et c'était lui, qui, dans l'intérêt égoïste de sa passion, avait facilité ce meurtre.
Ce pauvre jeune homme, qui avait sur le pouvoir des idées romanesques, et qui s'imaginait que l'inviolabilité de la vie humaine était le premier, le plus sacré des devoirs d'un souverain, ce pauvre cœur de vingt ans éclata tout à coup en sanglots; il se laissa tomber dans un fauteuil.
—Tout est perdu! murmura-t-il, ah! Colbertini, qu'ai-je fait?
Il faut être juste envers l'ancien président du conseil, cette douleur le désarma complétement; et il n'eut plus que le ferme désir de tirer le prince et la principauté de l'embarras dans lequel les mettait cette sauvage expérience. Comme sa rentrée au pouvoir était tout naturellement un des moyens les plus efficaces, on ne s'étonnera pas qu'il y eût songé immédiatement.
—Non, tout n'est pas perdu... encore, monseigneur, dit-il à Lorenzo avec un accent d'humble compassion. Il n'y a de moins que quelques personnages peu essentiels à l'équilibre de l'État. La mort de ces bonnes gens est un malheur sans doute; mais un malheur dont ils sont les premières, et je devrais dire les seules victimes. Que le secret demeure entre nous et qu'on dise au public qu'ils ont été frappés à table d'apoplexie, le public le croira. Nous ferons comprendre à votre auguste père que les jeux de cartes sont des jeux plus inoffensifs; nous mettrons Marforio dans la maison des fous, et si vous le voulez, prince, nous obtiendrons de Son Altesse Bonifacio XXIII qu'elle abdique entre vos mains: nous administrerons alors la principauté pour la plus grande gloire du règne de Lorenzo; et cet accident est le point de départ d'une ère de rénovation.
Lorenzo hochait la tête et paraissait approuver; mais il n'avait pas entendu, ni par conséquent compris un seul mot de tout le discours du ministre. Il pensait à son amour compromis et pleurait tout bas la perte de sa fiancée, beaucoup plus que la perte des hauts fonctionnaires.
—J'attends vos ordres, monseigneur, dit enfin Colbertini.
—Mes ordres, répondit le prince en sortant de sa rêverie, que voulez-vous que j'ordonne? D'ensevelir ces cadavres; de faire disparaître ces horribles vestiges. La nuit nous protége au moins; réveillez, dans le château, quelque serviteur dévoué, faites-vous aider par lui, et demain, je me charge de tout auprès de mon père. Monsieur le comte, vous êtes dévoué à la dynastie: jurez-moi le secret.
Colbertini hésita un peu à jurer. Mais comme c'était un esprit faux, il pensa qu'un serment politique n'engage que ceux qui le reçoivent et nullement celui qui le prête; en conséquence il promit tout haut d'ensevelir dans sa mémoire les mystères de cette nuit; mais il se promit tout bas de les révéler à l'occasion, si l'on ne se hâtait pas de lui rendre son portefeuille et de l'inviter à reconstituer un conseil.
Lorenzo était candide; il reçut le serment et y crut; il avait hâte de se soustraire au vilain spectacle que la salle du trésor lui offrait dans ce moment; il se retira bien triste, inconsolable, plein de remords, s'accusant de tous ces sortiléges et voyant la douce figure de Marta s'éloigner et disparaître dans des nuages sanglants.
J'affirme que le prince héréditaire fit un cruel apprentissage du rang suprême dans cette nuit-là; il ne se coucha pas, il resta jusqu'au point du jour accoudé à sa fenêtre, laissant tomber ses larmes sur le pavé de la rue et se lamentant comme fils, comme prince, comme amant, avec une ardeur qui eût provoqué l'enthousiasme du parti de l'avenir, s'il avait pu voir cette pieuse et sainte douleur.
—Que dira-t-on demain quand on saura que tout le ministère est mort et enterré? se demandait vingt fois par heure le pauvre prince. Croira-t-on à cette fausse apoplexie? Comment mon père, lui si doux, si humain, a-t-il consenti à cette boucherie? Comment le docteur l'a-t-il demandée? Pauvre Marta! Que va-t-elle devenir? Qu'ai-je fait en réclamant le ministère pour Marforio? Voilà donc son système! des pratiques superstitieuses qui rappellent les époques les plus barbares. Oh! la science! Elle ne vaut pas un simple élan du cœur, et l'inspiration quotidienne de la conscience. Quel bonheur que Colbertini se soit trouvé là, juste à point pour m'avertir! Mais pourquoi était-il là? Il y a là-dessous un mystère que j'éclaircirai. Pourvu qu'il trouve quelqu'un de discret pour l'aider!... Je n'ai pas osé rester là, j'avais peur de ces cadavres qui ont servi de jouet. Dans quelques heures ils seront enterrés; je fonderai une messe expiatoire, j'irai trouver mon père; mais Marta! que va-t-elle devenir?
Au fond de ses remords, de ses agitations, c'était toujours le nom de sa fiancée qu'il retrouvait comme la pointe la plus aiguë, comme le glaive le plus acéré qui pût entrer dans sa poitrine!
Vers le matin, brisé par cette nuit d'insomnie, Lorenzo se regarda dans un miroir, et se fit peur à lui-même, tant il se trouva pâle.
—Colbertini avait raison, j'ai plus pâli que lui; je prends mon visage de prince. Oh! le bonheur des autres, quel pesant souci!
Ce jeune et charmant égoïste oublia d'ajouter à cette réflexion: que le bonheur des autres est surtout une tâche difficile, quand le bonheur individuel s'y mêle, et s'en mêle, c'est-à-dire, le contrarie. Ajoutons que le bonheur de la principauté et même le salut des âmes que Lorenzo croyait mises à mort par le procédé de Marforio, le préoccupaient beaucoup moins que la question de savoir si son mariage avec la fille du docteur n'était pas à jamais compromis; on trouve toujours et partout des ministres en y mettant le prix. Mais l'amour, qui peut le remplacer?
—Heureusement, dit en soupirant Lorenzo pour résumer toutes ses méditations et toutes ses angoisses de la nuit, heureusement que les morts sont enterrés, que Colbertini sera discret et que j'ai réparé tout le mal.
Je puis, sans anticiper sur les faits, assurer que le prince se trompait au moins sur deux points; il avait tout aggravé et n'avait rien réparé; quant à Colbertini, sa discrétion était plus que problématique, et peut-être bien qu'en jurant de garder le silence, il avait suivi les instructions du révérend père Sanchez, lequel assure qu'on peut se dispenser de tenir un serment, en estropiant les mots, quand on jure; en disant, par exemple: uro, je brûle, au lieu de juro, je jure. Il est hors de doute que s'il avait dit qu'il brûlait, Colbertini était dans la vérité la plus exacte; car il brûlait de ressaisir le pouvoir.
Pour ce qui est de l'ensevelissement des morts, nous verrons comment il s'était acquitté de cette tâche. En attendant, je puis bien vous avouer que la présence du ministre à une heure assez avancée de la soirée, dans le palais du prince, tenait au désir immodéré de Colbertini de savoir au juste ce qu'il avait mal appris par le trou de la serrure; et quand le hasard lui fit rencontrer Lorenzo, il partait en ruminant une effroyable vengeance, à laquelle rien ne pouvait évidemment l'avoir fait renoncer.
Lorenzo avait été plusieurs fois tenté, dans la nuit, de s'échapper du palais, de courir chez le docteur et de lui dire:
—Fuyez, disparaissez avec vos mains teintes de sang; ne touchez pas à votre fille et laissez-la-moi.
Mais pour parler au docteur avant l'heure de son lever, il fallait le réveiller, faire du bruit, causer peut-être le scandale qu'on voulait empêcher. Lorenzo était timide devant l'esclandre; il resta décemment chez lui jusqu'à l'heure où Bonifacio permettait qu'on remuât et qu'on donnât signe de vie dans le palais. Mais dès qu'il entendit demander le premier déjeuner de Son Altesse, laquelle faisait plusieurs déjeuners, Lorenzo descendit en toute hâte et courut vers la demeure du savant.
Il le rencontra à moitié chemin, radieux, superbe, plus endimanché que jamais, ayant sur la figure cette illumination particulière aux fous et aux hommes de génie, qui fait souvent confondre les uns avec les autres. Benvenuto Cellini raconte, dans ses Mémoires, qu'arrivé au point culminant de sa carrière, il portait autour du visage une auréole parfaitement distincte dans l'ombre. Il assure que ses amis ne s'y trompaient pas. Les ennemis, bien entendu, n'y voyaient goutte.
L'auréole du docteur Marforio pouvait éblouir ses ennemis eux-mêmes. Lorenzo était loin de compter parmi les détracteurs du savant, bien que sa foi se sentît considérablement ébranlée. Il vit cette lueur et soupira.
Marforio tendit les bras au jeune prince; il eût voulu pouvoir étreindre l'univers entier, tant son triomphe lui dilatait l'âme.
—Ah! jeune homme, lui dit-il, le jour qui commence datera dans les fastes de la principauté.
—Hélas! soupira Lorenzo qui ne savait comment entamer la série de ses reproches et de ses recommandations.
—Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, continua le docteur; une si grande émotion, à mon âge!
—Je n'ai pas dormi non plus, reprit Lorenzo.
—En effet, monseigneur, le clair de lune a déteint sur votre visage. Douce insomnie que celle des amoureux! Allez raconter vos soupirs à ma fille; quant à moi, je suis pressé.
—Où allez-vous?
—Parbleu! au palais!
—Au nom de votre honneur et de Marta, je vous en conjure, n'y allez pas.
—Pourquoi donc?
—Vous me le demandez, docteur, après les étranges folies dans lesquelles vous avez entraîné mon père? Ah! le premier coupable, c'est moi, qui vous ai écouté, qui vous ai recommandé; mais nous nous repentirons, nous expierons ensemble, n'est-ce pas, docteur?
—Expier? mais quoi? Nous repentir? de quoi donc?
—Ah! docteur! vous, un homme si bon, si doux, si inoffensif!
—N'allez-vous pas ajouter si bête! Voyons, quel crime ai-je commis?
—Et le meurtre d'hier au soir! dit Lorenzo d'une voix vibrante à l'oreille du docteur.
Celui-ci haussa les épaules. Cette insouciance était un signe de folie. Lorenzo essaya pourtant de faire entrer le remords dans le cœur sanguinaire de Marforio.
—Se peut-il que la science pousse au mépris des lois les plus saintes de la nature? Vous, docteur, tuer de sang-froid!
—Mais qui ai-je donc tué? demanda le docteur en souriant et en continuant d'avancer malgré les efforts de Lorenzo qui le retenait doucement par le bras.
—Qui vous avez tué? Et les ministres de mon père?
—Ah! ah! vous croyez que je les ai tués? Eh bien! venez avec moi, mon jeune ami, et je vous ferai voir des merveilles!
—Docteur, je vous en conjure, n'allez pas au palais. Fuyez, quittez la ville; la rumeur publique sera prompte à vous accuser; je crains que le secret n'ait pas été gardé aussi religieusement que je l'avais espéré. Épargnez-nous la douleur de vous voir accusé, convaincu de meurtre.
—Ah! que vous êtes plaisant, mon prince, avec votre mine effrayée. J'avais bien raison de dire que vous étiez un ignorant! Mais sachez donc que vos précieux ministres ne courent aucun risque.
—Hélas! je le sais, ils n'en courent malheureusement plus aucun.
—Comme vous dites cela! Venez les voir dans leur bon sommeil, et vous m'en direz des nouvelles.
—Encore une fois, il est inutile, docteur, que nous allions au palais. Vous n'y trouverez plus rien.
—Comment?
—J'ai fait disparaître les preuves de vos sinistres erreurs.
—Quoi? que voulez-vous dire?
—Que j'ai fait respectueusement enterrer les ministres...
—Est-ce possible? s'écria Marforio qui bondit sur lui-même avec une fureur dont on ne l'eût jamais cru capable. Triple fou que j'étais de me confier à des princes! Mais l'assassin, c'est vous! mais le meurtrier, c'est vous! Ah! ah! mon Dieu! vous avez raison, je suis perdu! une si belle expérience!
Et Marforio, agitant les bras, tirant sa barbe, se livrant à un désordre de gestes qui dénotait la tempête, marchait en toute hâte vers le palais. Lorenzo s'efforçait de le suivre, essayant de le calmer et de le ramener à des sentiments moins barbares.
—N'avez-vous pas de honte, docteur, de ne regretter que l'expérience, quand vous avez tué...
—Mais je n'avais tué personne! Ils vivaient, ils dormaient; vous les avez enterrés tout vifs.
—Pourtant, dit Lorenzo que cette assurance étonnait sans le troubler, ces crânes ouverts, ces cervelles retirées?
—Ne voilà-t-il pas une preuve? Est-ce qu'on meurt parce que la tête a une fêlure? Est-ce que leur cervelle était indispensable? Pour l'usage qu'ils en faisaient!
—Vous osez rire, docteur?
—Moi! mais regardez donc si je ris, répliqua brusquement Marforio en forçant Lorenzo à se mettre devant lui face à face et en laissant voir ses yeux pleins d'éclairs et pleins de larmes. Vous m'avez déshonoré, prince, et vous avez tué ceux que j'allais sauver!
—Pourtant, balbutia le prince qui se sentit pris de terreur, j'ai bien vu... Et Colbertini, de son côté...
—Ah! Colbertini! c'est lui, le traître, qui pour se venger a tout fait! Ces pauvres collègues! enterrés! Que faire? on ne voudra pas me croire!
Lorenzo marchait, tout haletant, à côté de Marforio qui avait pris sa course. Enfin, n'y tenant plus et suffoqué, le prince s'arrêta. Mais les jarrets et les poumons du docteur n'étaient pas à bout. La crainte de voir échouer son expérience, et, d'un autre côté, un espoir d'autant plus ardent qu'il était plus illusoire, plus insensé, le précipitaient vers le château. Il tenait son chapeau d'une main, dénouait de l'autre sa cravate et courait à belles enjambées. Tout à coup il s'arrêta, et se retournant vers Lorenzo:
—Si vous leur aviez tâté le pouls! cria-t-il d'une voix étranglée.
Lorenzo soupira et ne put s'empêcher de s'avouer à lui-même qu'il avait en effet oublié de tâter le pouls aux ministres en question; mais comment supposer qu'il n'était pas superflu de tâter le pouls à des gens dont on venait de voir les cervelles nager dans l'eau!
L'indignation du docteur, la singulière assurance qu'il avait mise à protester jusqu'au bout de l'innocuité de son système, frappèrent Lorenzo.
—Mon Dieu! se dit tout à coup le bon jeune homme, si j'avais été le meurtrier! si par un phénomène improbable, mais possible, cette opération n'avait pas eu les conséquences que Colbertini m'avait fait entrevoir! Et maintenant ils sont en terre! Quel horrible châtiment le ciel inflige à mon égoïsme! C'est parce que j'ai voulu faire passer la raison de mon amour avant la raison d'État, c'est parce que j'ai voulu que Marforio fût ministre, que tout ce désordre est dans la principauté. Ah! Marta, ange d'innocence! pourras-tu me regarder sans horreur?
Lorenzo exagérait un peu; car son imprudence, à lui, partait du plus généreux et du plus religieux mouvement du cœur. Il ne pouvait avoir eu que le tort de faire enterrer un peu trop tôt des gens véritablement exposés. Le seul coupable, c'était toujours le docteur. Colbertini, s'il avait tâté le pouls, n'était pas sans reproche. Mais lui, Lorenzo, que pouvait-il avoir sur la conscience? la responsabilité d'une inhumation trop précipitée, tout au plus. Mais outre qu'il n'existait probablement pas dans la principauté de règlements sur les délais légaux à accorder aux sépultures, il en était du soin de différer l'enterrement comme de la précaution de tâter le pouls. Soins superflus, précaution dérisoire!
Lorenzo, pour un prince, attachait donc trop d'importance à des détails secondaires. Il était louable sur un seul point, louable sans restriction, sans réserve: il n'avait pas une joie, pas un chagrin qu'il ne fît tout aussitôt une invocation à Marta. Son amour était le pôle immuable vers lequel toutes ses pensées se tournaient, et il était impossible d'obéir plus complétement aux exigences de sa dignité d'amoureux.
Mais si l'amour satisfait la conscience, il n'a jamais eu dans les rapports sociaux et dans les rapports politiques la valeur d'un principe. L'on comprend, par exemple, que dans un intérêt d'ambition, d'orgueil, un prince écorne la loi morale: cela s'appelle un acte vigoureux qu'on applaudit s'il réussit, qu'on blâme s'il échoue; les peuples ont l'enthousiasme facile pour les événements engendrés par la cupidité et la soif des honneurs. Mais qu'un joli petit prince, comme Lorenzo, s'avise de prendre l'amour pour inspiration et pour guide; qu'il subordonne sa conduite à ce sentiment naturel, humain, sublime, personne ne comprendra; parce qu'il est bien convenu que le cœur n'a rien à voir, n'a rien à dire dans le maniement des hommes, et que l'art de régner, quoi qu'en disait le bon Bonifacio qui ne s'y connaissait guère, n'est pas du tout la même chose que l'art d'aimer.
Lorenzo avait donc un grand poids sur le cœur, et sentait peser sur lui toute la terre amoncelée sur les pauvres ministres. Que dirait-on dans la principauté quand on saurait les événements étranges de la veille? à qui en appeler? devant qui défendre son père, Marforio et lui-même?
Le prince s'était assis sur un banc de pierre dans une rue déserte, et là il méditait douloureusement. Il était entre le palais et la maison du docteur, à peu près comme l'âne biblique entre les deux picotins. Ce n'était pas, grand Dieu! que dans les circonstances ordinaires l'attrait fût égal des deux côtés; mais si les doux yeux de Maria l'appelaient à gauche, du côté du cœur, l'honneur, le devoir l'appelaient à droite. Que faire? Il y avait bien un troisième parti, le parti des poltrons, que les grands politiques eussent recommandé au prince: c'était de n'aller ni à droite, ni à gauche, mais de marcher devant lui et de s'en aller à l'aventure. Lorenzo, âme droite et candide, répugnait à ce moyen, et après bien des soupirs, bien des hélas! bien des défaillances et des éblouissements, il résolut de marcher droit au danger, d'affronter tout ce péril, et d'aller d'ailleurs prêter un peu d'aide à son père et au docteur, que l'escapade de Colbertini avait mis dans le plus terrible embarras.
Lorenzo n'osait regarder de loin le palais paternel, il en avait horreur; il fut tout surpris, quand il ne fut plus qu'à dix pas, de n'entendre aucune rumeur. Un cuisinier, qui plumait une volaille sur le seuil de la porte principale, chantait, en faisant envoler le duvet de sa victime. Je ne sais trop dire pourquoi, mais la vue de la chair blanche du poulet donna la chair de poule à Lorenzo. Était-ce en évoquant le souvenir des ministres? ou bien était-ce seulement parce que ces préparatifs de gala (on ne plumait pas tous les jours dans la maison de Bonifacio XXIII) concordaient mal avec le deuil du prince? Quoi qu'il en fût, Lorenzo, blanc comme ses manchettes, franchit le seuil avec un battement de cœur terrible, et gravit l'escalier en se tenant à la muraille.
Comme il atteignait le premier étage, il entendit un cri, puis deux, puis trois; puis une porte s'ouvrit avec violence dans la galerie à laquelle aboutissait l'escalier, et le docteur Marforio, les habits en désordre, la perruque rejetée en arrière, passa devant Lorenzo, et entra dans l'appartement de Son Altesse.
—Il est fou! le désespoir l'a achevé, pensa le prince.
Au même instant, par la porte qui venait de donner passage à Marforio, un homme sortit. Était-ce un homme? un spectre? une apparition? Lorenzo ne put le dire. Mais tout son sang se figea dans ses veines; il se crut changé en statue. Le ministre de la guerre, ou l'ombre du ministre de la guerre, s'avançait lentement, gravement, marquant le pas en quelque sorte. Derrière lui venaient ses collègues; pas un ne manquait; tous, le visage frais, un sourire sur les lèvres, une petite ligne rouge au milieu du front, défilaient et pénétraient dans l'appartement de Bonifacio.
Lorenzo n'osa pas adresser la parole à ces apparences de ministres; et, quand elles eurent disparu, il essuya son visage, soupira, leva les yeux au ciel, cherchant dans l'air une solution, un renseignement qui lui permît de décider qui était fou, de lui ou de Marforio.
Il n'était pas sorti de sa stupeur quand une voix se fit entendre à son oreille:
—Gardez-vous de rien dire, monseigneur. Tout est pour le mieux!
C'était Colbertini qui, lui aussi, avait assisté au défilé, et qui, sans être moins surpris que Lorenzo, dissimulait davantage.
—Ah! c'est vous, répondit le prince avec un soupir d'allégement. Expliquez-moi cette vision: les cadavres de cette nuit?
—N'étaient point des cadavres, monseigneur; je m'en suis aperçu au dernier moment. Je n'ai pas abusé de la facilité qui m'était donnée pour me venger. J'aurais pu profiter du prétexte et faire enterrer dans l'état où je les trouvais mes anciens collègues.
—Quelle horreur!
—O prince! en politique, on se tue souvent pour moins que cela et d'une façon plus cruelle. Mais j'ai réfléchi. S'il y a quelque sorcellerie, pourquoi ne l'aiderais-je pas à se montrer? Maître Marforio empiète sur les droits de la Providence. Grand bien lui fasse! ce n'est pas moi qui l'empêcherai, et je suis curieux de voir jusqu'où il ira.
Colbertini se frottait les mains avec une satisfaction mesquine, qui prouvait que, chez cet homme d'État, les passions ne s'élevaient jamais à des hauteurs impersonnelles.
—Ainsi, demanda Lorenzo stupéfait, ils sont bien vivants?
—Sans aucun doute, monseigneur, je leur ai parlé, et je vous atteste qu'ils n'ont rien de changé, je puis ajouter: malheureusement pour eux!
—C'est étrange! murmura le prince héréditaire que ce phénomène jetait dans des tourbillons et qui ne savait que dire et que penser.
Colbertini s'inclina et se hâta de descendre l'escalier du palais. Il se croyait suffisamment dégagé du serment de discrétion. Il avait promis de ne pas révéler la mort des ministres; mais il n'avait pas juré de taire l'état singulier dans lequel il les trouvait; et pour faire germer sa vengeance, il n'était pas fâché de semer partout dans la ville l'annonce des prodiges accomplis par son successeur; c'était à la fois donner une preuve apparente de générosité et créer des impossibilités futures pour le pauvre Marforio. Un ministre obligé de gouverner par des miracles continuels ne peut rester longtemps au pouvoir; s'il n'est pas crucifié, il est bafoué. Et l'une et l'autre des deux alternatives plaisaient à Colbertini.
—Allons, dit enfin Lorenzo dès qu'il fut seul, ne réfléchissons pas; vivons au milieu de ces sortiléges; ne discutons rien! La raison est exposée à de grandes erreurs. Le cœur seul est infaillible. N'écoutons, ne suivons que mon cœur. O Marta! dans cet océan de doutes où me jettent des événements si bizarres, si inexplicables, tu es mon phare de salut, mon étoile!
Et après cette invocation qui résumait et complétait toujours les diverses opérations de son esprit, Lorenzo voulut se donner le spectacle complet des ministres ressuscités; il aimait mieux les appeler ainsi, croyant plutôt au miracle de la résurrection qu'à celui de la vie sans cervelle. On riait, on parlait à haute voix dans les appartements de Bonifacio. Quand Lorenzo entra, Marforio était dans les bras de son souverain; et comme ces deux obésités ne pouvaient pas facilement s'étreindre, elles se rapprochaient par le haut du corps, en s'éloignant par la base.
—Viens, mon fils, dit l'excellent prince, salue dans ton père le monarque le plus heureux de l'Italie, et dans ton beau-père le savant le plus infaillible.
Lorenzo eut un frisson en pensant à Colbertini et à l'idée d'enterrer les ministres.
Ceux-ci, un peu abasourdis de l'étonnement dont ils étaient l'objet, comprenant à grand'peine ce qui s'était passé et ce qu'on s'obstinait à leur raconter, ne sachant pas s'ils devaient se fâcher ou se réjouir, étaient là, béats et béants, tournant de temps en temps la tête pour s'assurer qu'elle était bien fermée.
Le ministre de la guerre, moins calme que les autres, se secouait un peu.
—Ce n'est rien, ce n'est rien, lui disait Marforio pour le rassurer. Il sera entré un peu d'eau dans le crâne; je m'y prendrai mieux demain. Colbertini leur avait tâté le pouls, ajouta le docteur à demi-voix, en marchant vers Lorenzo. Chut! ne parlez pas de nos terreurs, ils s'en épouvanteraient.
Et se redressant, comme s'il n'eût pas craint de se heurter au firmament, Marforio exhalait un orgueil, resplendissait d'une joie qui échappent à toute analyse. Bonifacio cherchait des formules, des exclamations.
—O renversement de toutes les lois humaines! ô glorieuse usurpation des droits de la Providence! Marforio, mon ami, je t'autorise à te laisser tutoyer par moi; tu es plus que mon ministre, tu es mon ombre, mon satellite, mon alter ego, le surintendant de ma cervelle. Je vais créer tout exprès un ordre, une décoration, et tu en seras le premier, le seul décoré. Je veux que les populations de ma principauté se ressentent de l'heureux événement qui vient de s'accomplir. Qu'elles me demandent ce qu'elles voudront et je le leur donne immédiatement. Si une constitution peut leur faire plaisir, je leur en donne une ou deux de plus. Je veux être prodigue, pour signaler un phénomène si étourdissant. Mon bon Marforio, tu m'ouvriras le crâne quand tu voudras, et celui de Lorenzo.
—Mon père, je n'ai pas d'ambition, dit Lorenzo, qui ne se souciait que médiocrement de mieux dormir et qui tenait trop à ses rêveries pour ne pas tenir également à ses rêves.
—A l'âge de Lorenzo et quand on est amoureux, répliqua d'un petit air miséricordieux le bon Marforio, on ne songe guère à économiser la vie et le repos. Plus tard, il y songera.
Les ministres écoutaient ce débordement d'expansion de leur souverain et de leur collègue sans s'y mêler autrement que par un faible sourire. Ils n'avaient pas une conviction bien assise; et, je le répète, ils passaient avec des petits gestes furtifs et inquiets leurs doigts autour du front pour s'assurer que la fermeture était hermétique.
—Oh! c'est solide, disait Marforio.
—Vous vous rappelez, n'est-ce pas, nos conversations d'hier? demandait Bonifacio, pour s'assurer que la mémoire n'avait pas changé.
Et les complaisants ministres, répondant aussitôt, répétaient, dans les mêmes termes, les opinions qu'ils avaient exprimées la veille.
—C'est merveilleux! merveilleux! ne cessait de dire Bonifacio.
—Est-ce que cela recommencera tous les soirs? demanda le ministre de la guerre.
—Certainement, reprit Marforio, vous en trouvez-vous mal?
—Jusqu'à présent, non; j'ai dormi comme à quinze ans, mais j'ai quelque léger embarras.
—Oui, oui, je sais, un peu d'eau! ce n'est rien... Une première fois, vous comprenez, on ne prend pas toutes les précautions.
Cette remarque judicieuse fit trembler tout le ministère. En effet, on ne prend pas bien ses précautions une première fois, et ils auraient pu courir des risques autrement sérieux.
En somme, le système du docteur fut jugé, acclamé. Il y eut fête au palais, mais une fête dont on ne voulut pas dire trop haut le motif. Marforio craignait les contrefacteurs maladroits, et il eut été dangereux de mettre à la portée du premier venu un moyen d'endormir, qui fournissait en même temps le meilleur moyen d'empêcher le réveil.
On but à la santé des ministres. Ceux-ci, ménageant leur cerveau et excitant leur cervelet, tinrent tête à l'ovation. Je vous fais grâce des plaisanteries qui égayèrent le repas. Marforio fut étouffé d'embrassements. Il n'est pas jusqu'à Lorenzo qui, contraint de se rendre à l'évidence, n'eût son petit mot louangeur et son grain d'encens.
Colbertini, qui n'avait pas de raison d'être discret, était allé colporter partout la nouvelle de ce prodigieux événement. Le soir tout le monde sut que Marforio avait dérobé les secrets de Dieu. Une manifestation populaire, qui tourna à l'honneur de la science, fut immédiatement organisée. Le parti des jeunes, irrité de longue date contre Colbertini, fut enchanté d'exalter son successeur. D'ailleurs, il y avait, au premier aspect, dans l'application de la science et de la physiologie au gouvernement des États, la réalisation d'une grande idée. Ce n'était plus l'influence du nom, la prépondérance de la fortune qui décidaient de l'aptitude aux affaires, c'était la science, dans son expression la plus élevée. Et quelle science! celle qui touchait à l'instrument de l'intelligence lui-même, qui en modifiait les ressorts, qui prenait en pitié les fatigues, les consomptions de l'esprit.
Quelques bonnes gens, habitués, par suite de leur costume, à voir tout en noir, hochèrent la tête et crièrent au matérialisme. On les laissa crier; mais on opposa ce miracle au miracle de saint Janvier. Personne ne douta de la possibilité de déplacer les cervelles. Le fameux parti des jeunes décida que l'invraisemblable était le vrai; que le progrès se manifestait par des coups pareils; qu'il n'y avait pas lieu de douter; et, je le répète, personne ne douta. On poussa le fanatisme jusqu'à déclarer que les ministres avaient bien mérité de la patrie.
Des poëtes composèrent des cantates sans être payés, ce qui ne se voit qu'en Italie. Des chanteurs les chantèrent sans y être contraints. Ce fut un beau jour pour les États de Bonifacio XXIII.
Si vous me demandez mon opinion personnelle sur le prétendu sortilége, je ne serai pas éloigné de croire, comme les gens bien pensants de la principauté, que ce merveilleux résultat était logique. Il rentre dans la catégorie des phénomènes dont il ne faut plus se moquer, par ce seul prétexte qu'ils sont moquables. Il n'était pas plus absurde de croire à ce sommeil forcé qu'à des tables tournantes, valsantes, parlantes; et Marforio devait-il paraître beaucoup plus fou aux sceptiques de son temps en se vantant de faire vivre et prospérer des gens sans cervelle, que s'il avait prétendu leur faire lire un grimoire par l'épigastre, ou s'il avait évoqué Satan, Socrate, Platon et les ancêtres de Bonifacio, et fait passer leur âme dans une cruche ou dans une cuvette?
C'est par égard pour le bon sens que les savants ne nous en font pas voir de toutes les couleurs; et puis c'est qu'ils perdent quelquefois à étudier le temps qu'ils pourraient utiliser à enseigner. Mais tout le monde est d'accord en principe qu'ils font de l'univers entier ce qu'ils veulent, et il était ridicule autrefois de leur contester un seul miracle. Aussi ne perdait-on pas le temps à les réfuter, et quand leurs miracles n'étaient pas au goût du jour, aimait-on mieux les mettre à mort et les torturer que les chicaner.
L'adoucissement des mœurs a détruit cet argument; et si messieurs les savants ne trébuchaient pas au seuil des académies et n'aimaient pas les croix, les pensions, les titres, comme de simples ignorants, ils deviendraient bien vite les dispensateurs de la pluie, du beau temps, de la chaleur et du froid. Fort heureusement pour la liberté du vulgaire, l'ambition du ridicule compense dans l'esprit des hommes de science l'ambition de la vérité; et ils rétablissent, sans le vouloir, l'égalité entre eux et les imbéciles, précisément quand ils deviennent de très-grands personnages.
Qui sait à quelle autorité morale Marforio aurait pu prétendre, s'il eût pu consentir à ne point avoir d'autorité positive! Un homme qui avait fait une si grande révolution dans la physiologie et donné une si furieuse entorse à la routine pouvait découvrir, avec un peu d'effort, la navigation aérienne et le moyen d'aborder dans la lune. Mais les délices de Capoue attendaient Marforio, et le progrès ne fut pas accéléré dans sa marche autant qu'on aurait pu l'espérer ou le craindre.
L'union du jeune Lorenzo et de la belle Marta était une conséquence si naturelle de la pleine réussite du fameux système, qu'il n'y eut plus qu'à commander les cierges et les violons. Bonifacio tenait beaucoup plus à l'existence qu'à la naissance. Il ne craignit pas d'humilier ses aïeux en bénissant dans sa bru la fille d'un académicien. Il pensa que cette mésalliance serait agréable à son peuple.
Je dois avouer qu'elle ne lui fut pas désagréable, car il n'y songea que tout juste assez pour voir passer le cortége et admirer la grâce et l'éclatante jeunesse des époux. Les ministres à la cervelle mobile furent l'objet de l'examen, de l'attention publique. On ne se lassait pas de leur trouver bon air, bonne façon; ils causaient, comme des personnes naturelles; les gens à imagination vive prétendaient même qu'ils avaient acquis de l'esprit. Mais Marforio lui-même n'allait pas si loin dans son enthousiasme.
—A moins, disait-il, que l'eau pure n'ait des qualités qu'on n'a pas encore soupçonnées! Car il est impossible que ces messieurs acquièrent, en réfléchissant moins, des vertus spirituelles qui leur ont toujours fait défaut, quand ils avaient, nuit et jour, le libre exercice de leurs facultés.
Trois jours après les noces de l'héritier présomptif, Bonifacio XXIII, qui voyait que ses ministres engraissaient, rajeunissaient et n'éprouvaient aucun ennui, consentit à confier son auguste front au bistouri du docteur.
—Surtout, lui dit-il, avant d'avaler le narcotique nécessaire, ne sois pas trop ému; oublie la dignité de mon front, et dis-toi bien que ton souverain n'est plus que ton sujet.
Marforio n'était pas ému. Il scalpait avec une dextérité incroyable; la cervelle de Son Altesse alla dans l'eau comme les autres; la seule distinction que le docteur lui accorda fut un vase un peu plus orné que les autres; mais pour la dimension, la couleur, la pesanteur, la cervelle de Bonifacio XXIII n'avait absolument rien qui pût la faire trouver différente de celle du premier crâne venu.
—O égalité! dit Marforio en voyant baigner dans l'eau l'instrument des pensées de son prince.
Le lendemain de son premier sommeil, Bonifacio fut ravi et se promena dans sa capitale, pour bien montrer à ses sujets qu'il était un illustre exemple de la supériorité du système de son premier ministre, et qu'il ne reculait devant rien pour encourager les sciences, accélérer le progrès et ajouter aux éléments de bonheur et de civilisation de la principauté.
Mais sur ce dernier point le doute commençait à naître; et le parti des jeunes, perfidement excité par Colbertini, qui en était devenu l'âme, après en avoir été pendant si longtemps la terreur et la bête noire, le parti des jeunes commençait à murmurer, et à se demander si, de toutes les utopies, celles de la science n'étaient pas les plus vaines, et s'il y avait d'autres moyens empiriques de faire le bonheur des peuples que de les laisser libres et de les aimer avec intelligence.
Je vais vous montrer par quelles manœuvres Colbertini voulait prendre sa revanche et faire expier à Marforio sa gloire et son ambition.
Les ministres de Bonifacio et Bonifacio lui-même se trouvaient fort bien de l'opération subie; ils s'éveillaient sans fatigue; à peine si quelquefois un petit peu d'air s'infiltrant dans le crâne mal fermé les faisait souvenir de leur fêlure. Marforio prenait les plus grandes précautions pour qu'il ne restât pas une goutte d'eau dans les interstices de la masse cérébrale; la salle du trésor était un sanctuaire qui préservait admirablement les bocaux sacrés; personne, excepté Colbertini, n'avait de clef de cette retraite. Nous verrons que l'exception était fâcheuse et combien Lorenzo eut à se repentir de n'avoir pas réclamé cette clef, lors de sa rencontre avec l'ancien premier ministre.
Un jour, un véritable et sérieux danger menaça le gouvernement: un chat fut subrepticement introduit dans le palais, et fut trouvé miaulant et grattant à la porte de la salle du trésor. Marforio frémit en songeant au péril que les augustes cervelles auraient pu courir. Des précautions furent prises en conséquence, sans qu'il fût possible d'en expliquer le motif. Les passions mauvaises n'auraient pas manqué de profiter du renseignement; et le régicide, mis à la portée des chats, serait devenu un instrument d'opposition formidable.
On se contenta de charger la police de distribuer des boulettes malsaines dans tous les coins du palais, et l'on fit griller les fenêtres de la salle du trésor.
Ces dangers violents n'étaient pas, au surplus, le seul ni le plus grand inconvénient du système; on ne tarda pas à constater le singulier phénomène que voici:
Le cerveau, interrompant brusquement le petit travail de la réflexion par une mort apparente de quelques heures, revenait, en reprenant ses fonctions, au point de départ de la veille. La mémoire ne souffrait pas de cette interruption violente; mais la mémoire seule lui survivait, la mémoire stérile, sans acquisition nouvelle. On s'aperçut (quand je dis on, je pense à Lorenzo comme observateur bienveillant, et à Colbertini comme espion), on s'aperçut peu à peu que les ministres et le prince en gagnant du repos avaient perdu ce privilége commun à tous et qui fait découvrir instantanément au réveil l'idée vainement cherchée avant la nuit.
Marforio avait supprimé la fatigue, cela était incontestable; mais il avait aussi supprimé le travail.
Le ministre de l'instruction publique était, au jour où il subit l'opération, en train de rédiger une circulaire à ses administrés pour leur recommander un abécédaire qui venait d'être publié, après quinze années de préparation, par une académie du voisinage. L'infortuné ministre s'était arrêté, avant d'aller souper, à une phrase très-difficile, dans laquelle il cherchait à expliquer, ce qu'il n'avait jamais bien su, l'utilité de la lecture. Quand le lendemain Son Excellence, reposée, calmée, rafraîchie, voulut continuer sa phrase, il lui fut impossible de trouver autre chose que ce qui était déjà. Il s'était fait un temps d'arrêt dans son intelligence.
Cette circulation incessante de la sève intellectuelle qui accumule dans le sommeil les forces que l'activité dépensera dans le réveil, était interrompue et ne pouvait plus se rétablir. Il recommençait tous les jours la même besogne et tous les jours il la quittait de la même façon, au même endroit, avec le même mot.
Le ministre de la guerre donna un exemple tout pareil. Il examinait, pour en doter la musique de l'année, un système de mirliton fort ingénieux; mais l'intraitable ministre n'avait voulu autoriser cet instrument qu'après avoir appris à en jouer lui-même; il paraît même qu'il avait fait jusque-là des progrès assez rapides. Après l'opération en question, il s'obstina à chantonner le même refrain, sans pouvoir en sortir.
Les autres ministres et Bonifacio XXIII éprouvèrent le même effet de cette lacune volontaire qu'ils creusaient dans leur existence morale. Le plus petit effort de l'esprit leur devenait inutile; on les eût dits attachés à une œuvre de Pénélope; toutes les nuits un lutin défaisait le dessin tracé le jour et il fallait le recommencer.
Lorenzo, inquiet de ce résultat, demanda un remède à Marforio. Mais son beau-père se mit à rire; il s'était déclaré infaillible, et la meilleure preuve qu'il pût donner de son infaillibilité, c'était de ne pas consentir à reconnaître une erreur.
—De quoi te mêles-tu? jeune homme, dit-il à son gendre. Ai-je jamais prétendu qu'ils auraient tous plus d'esprit après l'opération qu'ils n'en avaient auparavant. Ils étaient bêtes; ils le sont restés. Le respect m'empêche de te dire que ton père n'était guère plus fort. Trouve-moi un homme d'esprit qui consente à se laisser opérer, et s'il devient stupide ton objection aura de la valeur.
Cette réponse était préremptoire. Où trouver en effet un homme d'esprit qui consentît à se laisser manier la cervelle?
L'héritier présomptif, qui n'avait jamais eu d'enthousiasme pour l'utopie de son beau-père, croyait de son devoir de garder le secret le plus absolu sur les observations critiques auxquelles il se livrait, et de veiller en même temps à ce que l'insuffisance des hommes du gouvernement ne transpirât pas trop au dehors. Il assistait aux rares séances du conseil; s'il y avait un décret à rendre, une mesure à prendre, il s'efforçait d'enlever une décision aux tâtonnements des ministres et du souverain.
Le public ne se fût jamais aperçu de l'immobilité intellectuelle qui résultait du fameux système, si Colbertini n'avait pris soin de la faire remarquer au parti des jeunes, et si ce parti ne s'était empressé de s'en étonner et de s'en indigner tout haut. La foule, qui voyait la mine florissante de Bonifacio et qui ne se sentait pas plus gênée dans ses allures qu'auparavant, admirait l'adresse de Marforio et ne réclamait rien.
Peu lui importait cette paralysie organisée; on n'augmentait pas les impôts; et si on ne faisait rien pour elle, on ne lui demandait rien. Mais vous savez que l'opinion publique ne se manifesterait jamais avec force, s'il n'y avait pas des gens de précaution pour l'éveiller, la mettre sur la route des protestations, et pour lui trouver un mot d'ordre, une formule. C'était précisément là la mission du parti des jeunes. Il allait stimuler l'apathie des habitants, et leur démontrait qu'au lieu de se trouver heureux, ils devaient se croire très-malheureux, puisqu'ils étaient très-mal administrés.
Cette propagande utile fut un peu lente à agir, et peut-être n'eût-elle jamais abouti, sans un singulier renfort qui lui vint de France dans la personne d'un cabaretier. Il s'établit une hôtellerie nouvelle, dont les vins et la bonne chère, en accélérant la vie dans les jeunes cervelles, donnèrent plus d'accent et plus de feu aux remontrances. La mauvaise humeur que l'on conçut contre les anciens restaurants monta jusqu'au pouvoir.
Il est de la fatalité des gouvernements absolus (fussent-ils paternels, comme croyait l'être le gouvernement de Bonifacio XXIII) d'être responsables de tout, du mauvais temps et des épidémies, comme de la misère et des souffrances morales. Visant au rôle de la Providence, ils en assument les charges, en voulant en recueillir les profits. N'excitant pas, n'encourageant pas l'initiative individuelle, ils sont comptables envers chaque individu de sa part d'activité et de son libre arbitre. Il est injuste, selon les lois éternelles, de leur en vouloir de la grêle, de la pluie, de la peste; mais il est logique de leur demander raison du peu de secours moral ou matériel que chacun trouve en soi pour résister au fléau ou s'en consoler.
Je vous demande pardon de cette petite boutade un peu solennelle pour l'histoire de la principauté en question. Mais l'histoire a des principes immuables, et c'est surtout dans un conte qu'il faut les invoquer.
Le parti des jeunes faisait donc de superbes dîners et d'éloquentes protestations. Il fulminait contre l'engourdissement séculaire du pays, et parlait avec irrévérence du fameux système de Marforio qu'il avait d'abord acclamé, et des têtes fêlées du ministère dont il se moquait. Les murs étaient couverts de caricatures où l'opération des cervelles était commentée et traitée de la belle manière.
Je vous laisse à juger si Lorenzo était triste de cette opposition qui grossissait de jour en jour. Accordons-lui cette justice, que son mariage ne l'avait pas rendu égoïste. Retiré dans un coin du palais paternel, il vivait dans une extase quotidienne, et il ne s'interrompait de répéter à Marta les plus doux noms et les plus doux vers qu'il pût imaginer, que pour la serrer tendrement sur son cœur, en bénissant Dieu de l'avoir béni. Mais une douleur aiguë se mêlait à cette ivresse. Lorenzo pensait parfois que son bonheur était la récompense et le résultat des utopies de Marforio, et il craignait toujours quelque catastrophe. Aussi, bien qu'il n'eût pas le moindre goût pour le pouvoir, et surtout pour un pouvoir impuissant et ridicule, il essayait, comme je l'ai dit plus haut, de s'occuper un peu des affaires dont personne ne s'occupait, et chaque soir, avec Marta, qui n'était pas de mauvais conseil, il causait à la belle étoile, sur une terrasse du château, du malheur irréparable d'être l'héritier présomptif d'une révolution imminente.
Son brave homme de père et de souverain se trouvait le plus heureux des monarques, et éprouvait un contentement inouï quand Marforio lui avait remis le matin sa cervelle en place. Lorenzo essayait vainement de faire entrer une idée ou l'ombre d'une idée dans cette pauvre tête. L'intelligence, qui reprenait chaque jour son mouvement, son tic-tac, comme un moulin arrêté pendant la nuit, n'avait plus d'élan, plus de force; elle n'avait plus ce mystérieux travail de la nuit qui est peut-être le seul véritable, le seul profitable. Lorenzo reconnaissait que le sommeil n'est pas le réparateur, mais l'initiateur solennel et tout-puissant, et il conjurait Marforio et les têtes fêlées de vouloir bien renoncer au bain d'eau froide. Mais le savant ne voulait pas en démordre, et les sujets de l'expérience s'accommodaient trop bien de l'inactivité pour y renoncer.
Un jour l'opposition en corps sollicita une audience de Bonifacio XXIII, et vint lui exposer respectueusement ses griefs. Le prince reçut avec le plus charmant sourire la députation; il était entouré de ses ministres, et jamais la béatitude n'eut des représentants plus frais, plus roses, plus convaincus.
Bonifacio ne comprit pas un mot de tout ce qu'on lui débita; il prit avec son inaltérable bonne humeur la pancarte qu'on lui tendit et qui, rédigée dans la fameuse hôtellerie française dont j'ai parlé plus haut, avait, d'un côté, le menu du dernier dîner de l'opposition, et, de l'autre, les demandes les plus urgentes du parti des jeunes.
L'éclairage, le balayage des rues, la mise en vigueur d'une constitution un peu délaissée, quelques idées de réforme aussi simples que modérées, formaient tout le programme. Bonifacio promit d'en délibérer en conseil, et, en effet, il en délibéra; mais, par une erreur bien excusable, il avait pris la pancarte du mauvais côté, et ce fut sur le menu du dîner qu'il disserta congrûment avec ses ministres, sans pouvoir tomber d'accord. Je dois ajouter que Marforio n'assistait jamais au conseil. Il avait trop de choses à étudier pour cela, et Lorenzo, espérant que des griefs aussi plausibles et aussi faciles à satisfaire pouvaient être discutés même par des cerveaux fêlés, voulant d'ailleurs s'assurer une dernière fois de ce qu'il y avait à attendre de son père et de ses ministres, s'abstint de cette délibération.
Le lendemain et les jours suivants, la députation se représenta; on la reçut avec le même sourire, on lui fit dans les mêmes termes les mêmes promesses, on recommença les mêmes délibérations, pour arriver au même néant. C'en était fait; l'opposition se disposa à agir énergiquement, et Lorenzo comprit que s'il n'intervenait pas, la couronne de son père était menacée.
Le jeune prince ne tenait guère au pouvoir pour le pouvoir; mais s'il avait des goûts modestes, il avait aussi le sentiment d'un double devoir; comme héritier présomptif et comme fils, il devait défendre les droits de Bonifacio. Il eût été bien heureux, l'innocent troubadour, de quitter le palais en serrant sous son bras le bras charmant de Maria et d'aller avec sa douce compagne oublier, dans quelque poétique retraite, la méchanceté des gouvernés et la sottise des gouvernants. Il ne connaissait pas cette formule que les philosophes de la romance n'avaient pas encore inventée: Une chaumière et un cœur, mais il en avait le sentiment, je devrais dire le pressentiment.
Ah! si par un miracle dont il eût été reconnaissant envers Marforio, la principauté avait pu s'évanouir dans l'air, comme s'évanouissent les châteaux des fées; s'il avait pu se retrouver seul, avec sa chère Marta, sous les ombres de quelque retraite comme celles que l'Arioste a dépeintes, quelle vie poétique! quel madrigal en duo! Mais son rêve devait demeurer blotti dans son âme, comme un papillon qui n'a pas de fleurs; et il lui fallait s'occuper de ces personnages grotesques, Marforio et les ministres, sans oublier que son auguste père ne se séparait pas assez dans son esprit des caricatures de son entourage.
Lorenzo eut une conférence avec le chef du parti des jeunes. Il promit d'user de toute son influence pour que les espérances de progrès ne fussent pas toujours déçues; il s'engagea, au nom du gouvernement, à produire quelque chose de nouveau qui satisferait la curiosité publique et qui ne tromperait pas l'attente des patriotes.
Lorenzo sentait la témérité de ses engagements; mais depuis le jour fatal où, n'écoutant que son amour, il avait introduit Marforio chez son père, il se disait solidaire du bien et du mal qui se commettaient dans la principauté; d'un autre côté, si peu prince qu'il voulût être, il l'était encore trop pour ne pas tomber dans le défaut des princes et pour ne pas promettre plus qu'il n'osait et qu'il pouvait tenir.
Un événement extraordinaire sembla le tirer d'inquiétude et donner ample satisfaction au parti des jeunes.
Marforio venait tous les matins très-ponctuellement visiter les bocaux confiés à ses soins, en retirer le mieux qu'il pouvait les cervelles de Son Altesse et de Leurs Excellences, et les replacer toutes dans leurs boîtes respectives. C'était la seule occasion qu'il voulût conserver de fréquenter ses collègues.
Un jour, le docteur s'était acquitté de sa tâche avec l'attention accoutumée, et après avoir hermétiquement fermé les têtes des éminents fonctionnaires dont il réglait les mouvements intellectuels, il était rentré dans son laboratoire pour continuer une série d'expériences fort curieuses, quand Lorenzo, essoufflé, courut après lui et vint frapper à sa porte.
—Eh bien! qu'y a-t-il encore? demanda le savant, surpris de l'émotion de son gendre.
—Oh! rassurez-vous, murmura Lorenzo naïvement, Marta n'est pas malade.
Le pauvre prince s'imaginait que le premier cri du père était pour sa fille; il oubliait que le père était un savant.
—Il ne s'agit pas de ma fille. Est-ce qu'on aurait voulu encore enterrer mes sujets?
—Non, répliqua Lorenzo; mais êtes-vous bien sûr, docteur, de ne pas vous être trompé ce matin en remettant chaque cerveau dans sa boîte?
—Très-sûr; les précautions que je prends me garantissent contre toute surprise.
—Alors il se passe un phénomène inexplicable et que je vous conjure de venir voir. Mon père et ses ministres ont des idées toutes nouvelles, des goûts différents de leurs goûts habituels.
—C'est tout simple, interrompit Marforio, rougissant d'orgueil, le progrès est accompli. Vous doutiez de la rénovation de l'intelligence; je savais bien, moi, qu'à un moment donné, l'instrument reposé aurait des accents différents de ceux qu'il rendait autrefois.
—Il n'est pas possible, docteur, qu'une flûte, parce qu'elle aura dormi quinze jours, vous joue des airs de violon!
—Ouais! Vous devenez railleur, mon gendre! Il vous sied bien de vous moquer de ce que vous ne comprenez pas!
—Oh! je ne me moque pas, je vous jure, j'ai trop peur, dit Lorenzo.
—Peur de quoi?
—Peur de cette activité qui succède à cette atonie.
—Bah! je vous démontrerai que tout cela est logique.
Lorenzo secoua la tête et revint au palais avec Marforio.
Il se passait en effet une scène fort étrange et que toute la science du docteur allait peut-être se trouver impuissante à expliquer.
Quand j'ai parlé des sinécures constituées au profit de chaque ministre de Bonifacio, je n'ai pas exagéré; mais il est bien évident que cette inaction n'empêchait pas qu'il y eût une organisation, des bureaux, des employés, du papier et des plumes et que chaque ministre eût à recevoir les compliments de ses subordonnés au jour de l'an, et à leur donner des semonces de temps en temps pour faire croire à un travail. Bonifacio n'eût pas demandé mieux, cela ressort assez de ce récit, que de congédier tous les ministres et tous les employés du ministère. L'équilibre du budget était un idéal insuffisant pour lui. Il en poursuivait la légèreté absolue, la volatilisation, en quelque sorte. Mais si disposé qu'il fût aux économies et à la simplification du pouvoir, le prince était contraint à un décorum officiel envers ses voisins. Le respect humain, je devrais dire le respect souverain, l'obligeait à des complications dispendieuses dont il gémissait.
C'est une des particularités de l'Italie, que chaque État peut y aspirer individuellement à la liberté, mais ne peut s'affranchir de l'obligation de rendre des comptes à la curiosité du voisin. La terre où fleurit l'oranger est contrainte à l'humiliation de mettre ses fleurs sous le nez des étrangers pour que ceux-ci règlent leur bonne humeur sur le plus ou moins de parfum qui s'exhale. On n'a jamais su pourquoi, mais ce pays des fées est continuellement exposé aux accidents qui poursuivent les princes charmants dans les féeries; quand il veut s'asseoir, quatre ou cinq bras tiraillent son siége sous le prétexte de s'assurer de sa solidité. Veut-il manger; avant qu'il ait porté un morceau à ses lèvres, quatre ou cinq bras se lèvent et retiennent la bouchée, sous le prétexte que l'Europe est intéressée à la bonne digestion du convive. C'est sans doute pour que l'Italie soit maîtresse chez elle qu'il s'est formé des sociétés de charbonniers. On sait que le charbonnier n'aime pas en général qu'on commande chez lui.
Du temps de Bonifacio XXIII, les charbonniers n'avaient pas encore noirci l'horizon; mais la curiosité des voisins était déjà excessive, et c'était déjà pour la satisfaire que le père de Lorenzo gardait ses ministres. On l'eût contraint par la violence à faire comme les autres petits potentats du voisinage et à avoir des ministres allemands, s'il n'en avait pas eu d'italiens. Les formes et les formules, voilà un des grands principes de l'équilibre européen! Bridoison y entendait quelque chose. Quant au sentiment, il n'a jamais rien à voir. Bonifacio pouvait tailler, rogner, scalper les ministres et les sujets; mais il devait avoir des ministres. C'était déjà bien assez qu'on lui passât sa jovialité, sa tolérance de bonne humeur. Depuis longtemps on l'eût contraint à la tristesse, si un judicieux prélat, en tournée diplomatique dans la principauté, n'avait fait remarquer que la bonhomie de Bonifacio, au lieu de profiter à la liberté, comme on le craignait, faisait les affaires de la licence, ce qui était bien différent.
En effet, la liberté, parmi tous ses inconvénients, a celui d'être d'un fâcheux exemple; elle ne justifie pas non plus toujours une intervention. La licence, au contraire, a cela d'avantageux qu'elle met les États de celui qui en est atteint à la disposition du premier redresseur de torts du voisinage, en goût de conquête. Les qualités aimables de Bonifacio n'effarouchaient donc pas les tyrans du voisinage; l'ordre par le travail, l'activité par la liberté les eussent mis dans d'autres dispositions à son égard.
Je ne m'étends sur ces considérations qui retardent le dénoûment de mon histoire que pour faire comprendre comment Bonifacio, obligé d'avoir des ministres, avait par conséquent des employés de ministères, et comment ces derniers furent très-surpris un certain jour du changement qui s'était opéré dans les idées de chacun de leurs ministres.
Le ministre de la guerre, qui commençait tous les matins ses prétendus travaux par des études sur le fameux modèle de mirliton, demanda ce jour-là pourquoi les abécédaires n'étaient pas distribués. Il y eut une stupéfaction profonde dans les bureaux. Distribuer des abécédaires à l'armée! Vouloir que les soldats sussent lire, et probablement écrire. Quelle innovation! Quel progrès! Créer des baïonnettes intelligentes! quelle idée hardie, mais imprudente!
Un quart d'heure après, le bruit s'était répandu dans la ville que le gros ministre de la guerre cachait un esprit fort alerte dans son épaisse enveloppe et qu'il déployait une prodigieuse activité.
Un phénomène en sens inverse, mais également extraordinaire avait lieu au ministère de l'instruction publique. Le ministre était entré en fredonnant des couplets galants, qui constituaient l'air national de la principauté, et s'était informé auprès des inspecteurs de l'état des mirlitons. Là il n'était plus question d'abécédaires, mais de ces curieux instruments à pelure d'oignon qui devaient donner une musique agréable et économique à la principauté.
Les employés se regardaient en ouvrant des yeux démesurés; ils pensèrent que la musique allait prendre sans doute dans le programme de l'éducation une importance méconnue jusque-là, et un chef zélé expédia tout aussitôt une circulaire aux écoles de la principauté pour recommander l'étude du mirliton avant toutes choses, la volonté de Son Excellence étant expresse à cet égard.
Le ministre de la justice ne parlait que de sommes à toucher, ce qui alarma et scandalisa d'abord un peu ses employés, lesquels eurent la crainte que la vénalité du ministre ne se décelât par ces propos financiers. Mais ils finirent par penser qu'il s'agissait plutôt d'augmenter leurs appointements, et cette nouvelle manière d'envisager la question changea en enthousiasme les premières défiances. Encore un ministre dont les dispositions furent publiées, commentées, et, quand on le pouvait, énergiquement prônées!
Le ministre des finances, lui, si attristé d'ordinaire par le problème insoluble de son budget, se trouva d'une gaieté charmante. Il fit venir son trésorier et lui parla pendant une heure, le rire sur les lèvres, de corde, de pendaison, de prison, de gendarme; si bien que le trésorier s'imagina qu'on allait faire rendre gorge à tous les détenteurs de deniers, aux financiers qui profitaient de la détresse du prince et des embarras du peuple, et que ce bruit répandu rapidement, s'il fit pâlir quelques traitants, suscita dans la foule une explosion de bravos.
Le parti des jeunes, qui était bien jeune, se laissa prendre à ces rumeurs.
—Enfin, disait-il, voilà le gouvernement qui va marcher; ce n'est pas sans peine! Comme l'opposition atteint toujours son but! Décidément Marforio est un grand savant!
Lorenzo ne fut pas le dernier à entendre parler des résolutions toutes nouvelles des ministres de son père. Il alla trouver celui-ci. Bonifacio était, comme d'habitude, frais, rose, souriant, assis près d'une fenêtre, occupé à regarder des petits poissons rouges s'ébattre dans l'eau. Par une affinité singulière et qu'il ne s'expliquait pas, depuis quelque temps il s'était pris d'une belle passion pour l'eau claire et pour les bocaux.
Lorenzo interrogea; mais le prince ignorait tout. Un conseil des ministres fut immédiatement convoqué. Les Excellences arrivèrent avec une allure qui ressemblait à l'ivresse. Elles sautillaient et secouaient toutes la tête, comme si, avec la cervelle, on eût enfermé une ruche dans chacun des crânes.
—Eh bien! qu'y a-t-il? demanda Bonifacio; vous avez des façons singulières aujourd'hui, mes chers amis; calmez-vous et causons.
Lorenzo, par faveur spéciale, était souvent admis à l'honneur, d'assister au conseil. Tous les ministres prirent alors la parole à la fois, et la confusion la plus étrange, la plus comique, en même temps que la plus effrayante, signala cette conférence. Le ministre de la guerre croyait administrer l'instruction publique. Le ministre de l'instruction publique parlait de la guerre. Le ministre des finances ne voulait entendre parler que de la justice, et le ministre de la justice cherchait querelle à Bonifacio pour ses dépenses de table.
Non-seulement les rôles semblaient intervertis et les personnalités paraissaient changées, mais chacun des ministres n'avait pas tellement abdiqué son ancien caractère, qu'il ne restât quelque chose, soit dans le geste, soit dans les allures, soit dans les paroles, de son état primitif, et ces restes d'habitude ajoutaient au désordre et à la cacophonie.
—Qu'est-ce qu'ils ont donc? se demandait Bonifacio, dont la placidité se maintenait avec peine au milieu de ce tohu-bohu.
—J'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque chose pendant la nuit, disait Lorenzo, qui ne voulait pourtant pas trop alarmer son père sur les inconvénients du système de Marforio.
—J'ai envie de les destituer tous, reprenait Son Altesse. Ils m'ennuient avec leurs bourdonnements et leurs façons d'empiéter sur les devoirs les uns des autres.
—Attendez, mon père, jusqu'à l'arrivée du docteur; lui seul peut expliquer et guérir la fièvre qui les agite.
Nous savons comment Lorenzo, plus ému qu'il ne l'avait laissé croire à son père, alla chercher Marforio; comment celui-ci le suivit en raillant les terreurs du jeune prince; mais nous devons ajouter que le savant lui-même fut un peu abasourdi du tumulte au milieu duquel il tomba.
Les ministres piétinaient en se promenant et ne tarissaient pas; c'était un flux de paroles qui grossissait toujours, comme ces horloges dont le ressort se brise et dont on entend le mouvement se dérouler avec bruit; toutes ces cervelles détraquées avaient un mouvement rapide, bruyant, qui finissait par se communiquer au corps. Les figures étaient pourpres; la sueur perlait sur tous les fronts. Évidemment la folie marquait et prenait ses victimes.
Marforio, en dépit de sa confiance, ressentit quelque crainte. Je dis qu'il eut peur, je ne dis pas qu'il ressentit l'ombre d'un remords. Il tâta le pouls aux différents ministres, essaya de comprendre quelque chose à leurs discours interminables et confondus.
—Quelqu'un est entré dans la salle du trésor, dit-il enfin après avoir réfléchi.
—Personne, dit Bonifacio.
—Et moi, dit Lorenzo, je suis de l'avis du docteur, et je crois, en effet, qu'un imprudent et un traître a osé toucher aux bocaux.
—Si je savais son nom! s'écria Son Altesse.
Lorenzo, par prudence ou par un reste de pitié, n'osa pas livrer encore le nom de Colbertini.
—Qu'est-ce qu'on leur a fait? demanda Bonifacio sérieusement inquiet et en portant les deux mains à son front.
—Parbleu! on a changé les étiquettes et on m'a exposé à changer les cervelles de maîtres.
—Quelle horreur! s'écria le prince; et ce malheur pouvait m'arriver!
—Heureusement qu'il n'y avait personne contre qui l'on pût échanger la cervelle de Votre Altesse.
Cette réponse, que Bonifacio interpréta comme une flatterie, le calma un peu.
—Il faudrait aviser, dit-il.
—Sans doute, répliqua Marforio, quoique au fond, en y réfléchissant, je ne sois pas absolument fâché de l'expérience nouvelle qui m'est offerte.
—Hum! mon cher premier ministre, vous expérimentez trop.
—Laissez faire, monseigneur, il n'y a pas de danger. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est qu'ils vivent.
—Sans doute.
—Eh bien! les gaillards m'ont l'air robuste.
—Oui, mais cette fièvre?
—Bah! quand ils parleraient un peu trop! ils gardent depuis tant d'années le silence.
—Sans doute, mais ce charivari?
—Bouchez-vous les oreilles. D'ailleurs, est-ce que Votre Altesse a l'habitude de les écouter?
—Je n'en sais rien; ils n'ont jamais rien dit. Mais comment ne pas les entendre? Et puis, que pensera le public?
—Ce que pensera le public! repartit Marforio, qui avait parfois des accès de pénétration. Il sera enchanté; il vous accusait de gouverner avec des muets; il ne pourra, certes, plus en dire autant. Le public prend le tumulte pour le travail, les paroles pour des faits; il n'aime au fond que le changement, et se soucie fort peu du progrès, pourvu qu'on lui renouvelle de temps en temps ses affiches, ses programmes. C'est un maniaque dont l'estomac ne peut manger qu'une nourriture, mais qui veut qu'on lui change fréquemment les assiettes.
—Hein! Lorenzo, dit le prince ravi de cette boutade, quel homme d'État que ton beau-père!
—Mais que prétendez-vous obtenir? demanda Lorenzo, qui n'était pas aussi prompt que son père à avoir confiance et à se distraire de son inquiétude.
—Je n'en sais rien, répliqua Marforio; mais j'augure bien. Si mon système allait prendre un développement auquel je n'avais pas songé d'abord! Le hasard est le grand initiateur, comme il est souvent le grand secret des triomphes. Est-ce que vous croyez qu'il me serait impossible de donner au même homme plusieurs intelligences à la fois? Du moment que la cervelle consent à n'avoir plus l'importance exclusive que les ignorants de savants lui attribuaient autrefois, pourquoi ne pourrait-elle pas, en voyageant à travers différents crânes, acquérir des idées? Ce sont là des conjectures, mais des conjectures qui reposent sur l'expérience.
—Je ne tiens pas, pour ma part, à apprendre quelque chose, dit Bonifacio.
—Mais, objecta Lorenzo, comment la cervelle, en occupant des places vides, peut-elle acquérir des idées?
—J'attendais cette remarque, dit Marforio. Mon cher, l'intelligence se modifie selon l'espace, l'air et la configuration de la boîte qui l'enferme. Le crâne est le cabinet d'étude, et tout le monde sait que, selon qu'on peut s'étendre, bâiller, se remuer à droite, à gauche, un cabinet vous inspire plus ou moins. Il y a d'ailleurs des habitudes du corps, des dispositions du cervelet qui influent à leur tour sur la cervelle.
—Mais s'ils allaient devenir fous? dit Lorenzo en montrant le ministère tout entier, qui chuchotait, s'agitait, se démenait, en parlant à tort et à travers.
—Il sera toujours temps de les calmer s'ils vont trop loin, dit Marforio.
—Ainsi, mon cher, demanda le prince, votre avis?...
—Mon avis est qu'ils sont bien comme cela, qu'il faut les laisser, que la Providence, en permettant cette confusion, m'a mis sans doute sur la trace d'une nouvelle découverte, et que j'aurai là une nouvelle occasion d'ajouter à la gloire de votre règne et au prestige de la principauté.
Lorenzo, voyant que son père allait consentir à prolonger cette dangereuse comédie, voulut intervenir; mais Bonifacio ne le laissa pas parler.
—Puisque l'expérience est commencée, autant vaut la laisser achever, dit-il. Mon bon Marforio, prends-y garde. Ne donne pas trop d'idées à mes ministres. Ils sont assez amusants dans cette ivresse qui les tient; mais ils font bien du bruit.
—Cela se calmera, répondit Marforio avec autorité; ils ne sont pas encore habitués à ce changement de cervelle.
Lorenzo s'était enfui. Le malheureux prince avait peur de perdre la tête.
—Ah! dans quel cabanon me faut-il vivre? murmurait-il en levant les bras au ciel. O Marta! se peut-il que l'amour le plus pur et le plus loyal ait eu des conséquences si odieuses et si grotesques?
Nous savons déjà que Lorenzo faisait du nom de Marta sa première et sa dernière invocation dans l'embarras; mais, fidèle aux sentiments qui l'avaient fait aspirer à la main de la fille du docteur, le plus délicat des princes et le plus malheureux des héritiers présomptifs ne songeait point à regretter son amour. Il déplorait seulement que le bonheur de la principauté ne fût pas une conséquence de son bonheur intime, et que sa pastorale eût un si fâcheux dénoûment.
Il sentait bien d'ailleurs qu'il n'était pas au bout de ses épreuves. Marforio était infatigable et intraitable. Le docteur devait trouver toujours, même dans les échecs, la confirmation de son infaillibilité. Jusqu'où Lorenzo verrait-il descendre la majesté souveraine dans la personne de son père? Et c'était lui, lui seul, lui Lorenzo, qui avait voulu qu'on donnât le ministère à Marforio! C'était lui qui avait indirectement causé tout ce désordre! Il ne pouvait s'en prendre à personne; et il n'avait, hélas! personne sur qui il pût se venger. Pourtant, en y réfléchissant un peu, Lorenzo se dit que Colbertini, si c'était réellement lui qui avait changé les étiquettes des bocaux, avait une terrible responsabilité à assumer; et comme il fallait que quelqu'un payât pour tout le monde, et même pour Lorenzo, par une logique assez ordinaire de la vie et faite particulièrement pour l'usage des princes il fut convenu que Colbertini recevrait un châtiment exemplaire.
Colbertini, qui avait été pendant plus de vingt-cinq ans ministre, n'ignorait pas la façon de raisonner des souverains; il avait prévu que Lorenzo, quoique parfait relativement, ne renoncerait pas au plaisir de lui faire expier les torts, c'est-à-dire les imprudences du château. En conséquence, après avoir joué à Marforio le tour que nous venons de voir, il s'était prudemment caché, et avait mis en sûreté la fameuse clef de la salle du trésor que l'héritier présomptif avait eu la maladresse de ne pas lui réclamer.
Je sais bien que Lorenzo aurait pu conseiller à son père de faire changer la serrure de la salle en question. Mais on ne s'avise jamais de tout, et si les princes étaient infaillibles, il n'y aurait jamais de dynastie en péril, de catastrophe, de révolution, de restauration, et le monde s'ennuierait bien.
Colbertini se réservait de se montrer au moment critique. Il espérait bien que les sortiléges de Marforio ne prévaudraient pas toujours contre la politique traditionnelle. Il avait rendu par ses intrigues le parti des jeunes fort exigeant, et il pensait que le ministère et Bonifacio lui-même ne résisteraient pas toujours aux exigences de cette opposition. Quant à l'opposition, Colbertini, en fait de nouveautés, pensait lui offrir les vieux programmes et la bercer des vieux contes d'autrefois, rajeunis pour l'occasion; d'ailleurs, rien ne calme et ne désarme un parti comme le triomphe, et on n'en a jamais vu un seul qui ait persisté dans l'inflexibilité de sa ligne après avoir été admis à participer aux affaires.
Tel était le calcul de Colbertini. Pour manquer de grandeur et de générosité, il ne manquait pas de certaines chances; mais, par une inexplicable illusion du pays, par un de ces mirages qui ravissent les peuples, par une de ces utopies qui dépassent toutes les probabilités, le piége tendu à Marforio servait à sa gloire, et le fameux bouleversement des cervelles déterminait une explosion d'espérance et d'enthousiasme dont Colbertini était stupéfait.
Les distinctions à établir entre le génie et la folie sont difficiles dans tous les temps, sous toutes les latitudes et avec tous les caractères; mais dans une principauté comme celle de Bonifacio, elles étaient impossibles; les termes de comparaison manquaient pour le génie, et ils étaient trop fréquents pour la folie: on n'y faisait plus attention. C'est pourquoi les extravagances du ministère, au lieu d'épouvanter le parti de la jeunesse, lui donnaient confiance. On ne parlait que des innovations, des améliorations introduites par les différents ministres.
Tous les soldats se promenaient, un cahier à la main, en épelant leurs lettres. Les factions, déjà si rares, étaient définitivement remplacées par des heures d'étude; et quand les défenseurs de la patrie s'arrêtaient à la porte d'un cabaret, ce n'était que pour le plaisir, purement intellectuel, de déchiffrer l'enseigne.
Les professeurs de l'université (ai-je dit qu'il y avait une université? Je ne sais pas; en tous cas, vous serez bien aise de l'apprendre), les professeurs de l'université se coiffaient sur l'oreille et prenaient des petits airs conquérants les plus belliqueux du monde. On ne rencontrait plus les étudiants que rangés par pelotons, et défilant avec des mirlitons gigantesques. Le mirliton était devenu l'instrument d'Apollon. Le ministre de l'instruction publique avait inventé un mirliton rayé dont l'éclat se faisait entendre à une très-grande distance.
Les financiers, depuis que leur ministre avait troqué sa cervelle contre celle du ministre de la justice, étaient encouragés à l'étude des lois, et cette disposition causait un grand émoi dans la population. Les uns prétendaient que les hommes d'argent trouveraient dans l'arsenal législatif des moyens d'augmenter leurs perfidies et leurs ressources; les autres, au contraire, assuraient que l'étude des lois était l'enseignement le plus moral et le plus utile. Mais ce débat était lui-même un symptôme de progrès; et si les usuriers avaient diminué, l'avantage eût été incontestable; mais c'était déjà beaucoup pour la réalité qu'on pût le contester.
Quant au ministre de la justice, il n'était préoccupé que de la question financière. Il ne voulait pas que les plaideurs payassent les épices, et il contraignait les avocats à indemniser leurs clients du temps qu'ils leur faisaient perdre, de l'ennui qu'ils leur causaient, et du mal qu'ils faisaient penser d'eux en en disant trop de bien. Le peuple applaudissait à ce système; mais les procureurs étaient furieux. Une excentricité fort bouffonne, et qui dépassait réellement le but, était celle-ci: toutes les fois qu'un magistrat dénonçait et poursuivait un délinquant, il était obligé de déposer une grosse somme d'argent, pour que le prévenu, dans le cas où il aurait été injustement poursuivi et où il aurait été victime de dénonciations calomnieuses ou d'un zèle maladroit, fût largement indemnisé.
Le peuple, bien entendu, battait des mains à ce système de précaution et de responsabilité; mais les vieux jurisconsultes hochaient la tête et prétendaient que le métier devenait impossible, et que la justice cessait d'exister du moment qu'on lui imposait l'obligation de n'être jamais injuste.
Mais les murmures, les critiques disparaissaient dans le chœur général. Comme on remuait beaucoup de questions, on paraissait en résoudre beaucoup. Le parti des jeunes était dépassé. Il avait de la peine à coordonner ses idées et à se faire une opinion précise sur ces réformes qui attaquaient tout à la fois; car je ne parle là que des points principaux, et il est bien évident que les ministres touchaient à tout.
Bonifacio s'amusait; il ne se fatiguait pas la tête à comprendre, à prévoir; il regardait, riait des mécontents, souriait aux flatteurs, faisait tous ses repas avec la ponctualité accoutumée, avait supprimé les conseils des ministres depuis qu'il était impossible de s'entendre et de se concerter, et passait précisément aux yeux de ses sujets pour travailler un peu, depuis qu'il avait renoncé à l'ombre même du travail.
Marforio étudiait, et se félicitait chaque jour de cette nouvelle expérience.
—Comment ne l'avais-je pas prévu? se disait-il tous les matins, en remettant les cervelles dans les crânes désignés par Colbertini.
Au bout de quelques jours, quand il fut bien établi que les changements de domicile étaient sans danger pour les cerveaux, et quand la fièvre des ministres se fut en quelque sorte régularisée, le docteur prit plaisir à bouleverser les étiquettes, ou plutôt à les supprimer et à laisser au hasard la distribution des organes qu'il plaçait et déplaçait. Ce fut l'apogée du triomphe pour le savant, le signal d'une recrudescence incendiaire pour l'activité des ministres, et par suite pour la civilisation de la principauté. Les décrets, les mesures, les changements se multipliaient, se succédaient, se contredisaient avec une rapidité vertigineuse.
—Nous allons trop vite, disait parfois Bonifacio.
—Ce n'est que le commencement, répondait Marforio enivré.
Et toute la principauté paraissait piquée de la tarentule. Comme les cerveaux des ministres ne faisaient que transporter les idées dont ils étaient imprégnés, mais ne les augmentaient pas, le mouvement n'était en définitive qu'un déplacement continuel. Ainsi les mirlitons, après avoir été ordonnés aux professeurs, l'étaient aux magistrats qui rendaient la justice sur des airs de tontaine et tonton. Puis, les collecteurs d'impôts venaient à leur tour percevoir les deniers publics en s'accompagnant de ces mélodieux instruments. Chaque ministre, au hasard de la distribution des cervelles, ordonnait, défendait, révoquait ce qu'un autre semblait avoir ordonné, défendu, révoqué la veille. Quelquefois les crânes rentraient en possession de leurs cerveaux légitimes; ces jours-là étaient des jours de repos; mais on eût dit que Marforio s'arrangeait pour qu'ils fussent rares.
Pendant qu'une sorte de délire remuait les destins de la principauté, Lorenzo triste, et ne trouvant pas dans son bonheur l'oubli de ses inquiétudes politiques, ne cessait de demander au ciel, avec de ferventes extases auxquelles Marta s'associait, le retour ou plutôt la venue du bon sens et de la raison. Prière superflue que le ciel ne devait pas exaucer!
On eût dit que la Providence se plaisait à cette débauche de gouvernement et qu'elle encourageait avec ironie cet imbroglio sans issue logique.
Colbertini était le seul qui ne fût pas dupe. Il s'impatientait dans sa retraite, et se mordait les poings à la pensée de voir accepter comme un progrès, comme une marche ascendante, ce piétinement des administrateurs et des habitants de la principauté. Je vais vous raconter par suite de quelle imprudence, en croyant ouvrir les abîmes, il ferma toutes les crevasses du volcan révolutionnaire, et de quelle façon, en voulant se rendre nécessaire, il se rendit inutile. Ce sera d'ailleurs le dénoûment hypothétique, j'allais dire l'apothéose de ce conte instructif et moral.
Je dis le dénoûment hypothétique, parce qu'il est bien constant que rien ne se dénoue dans la vie, et que l'histoire d'un État, si minime que soit ce dernier sur la carte du monde, change, se modifie, mais ne se fixe pas dans un sort invariable. La principauté n'existe plus telle que Bonifacio XXIII l'avait reçue de Bonifacio XXII, et elle a subi bien des destinées contraires; mais le sol y est aussi riche qu'autrefois; les femmes y sont belles comme jadis; on y trouve encore le parti des jeunes et le parti des anciens; mais le parti des jeunes a vieilli, il ne se contente plus des apparences; il n'a plus besoin d'un cuisinier français pour vouloir et pouvoir, et la lutte est beaucoup plus sérieuse qu'au temps passé. Il y aurait donc encore des drames à raconter, si ce récit était une série d'annales, au lieu d'être un épisode; c'est donc pour obéir à une pure hypothèse que je vais terminer par l'exposé de la dernière catastrophe du ministère.
Tout allait donc sur un rhythme violent dans la principauté; mais l'illusion, loin de décroître, allait en augmentant, et la popularité de Bonifacio avait atteint des limites qui défiaient l'ingratitude. Quant à Marforio, il commençait à vouloir ménager le bon Dieu, dans ces expériences, et se promettait toujours de ne plus tant empiéter sur ses priviléges, dans la crainte d'exciter à la fin son dépit. Ce sentiment était si naïf de la part du bon docteur, qu'on ne saurait y voir un blasphème.
Hélas! Marforio ne se doutait guère que l'impuissance et la vanité de la science allaient lui être démontrées d'une façon terrible par un ignorant!
Un matin, le docteur venait de pénétrer, avec l'air radieux qui ne le quittait plus, dans la salle du trésor, pour procéder à ses importantes fonctions, quand tout à coup il en sortit en poussant un grand cri, et il vint tomber à la porte des appartements de Lorenzo.
L'héritier présomptif, dont le mariage n'avait pas augmenté les occupations et qui avait toujours beaucoup de loisirs, se préparait à sortir avec Marta pour une exploration botanique; il continuait à se perfectionner dans l'étude des simples; comme si ce dût être le meilleur moyen d'apprendre à gouverner les hommes!
Le docteur était étendu par terre sans mouvement. Marta l'aperçut la première et se précipitant sur lui essaya de le soulever, de lui faire respirer des sels, tout en pleurant et en interrogeant par des paroles entrecoupées Lorenzo, qui n'en savait pas plus qu'elle.
—Mon père, mon père, disait-elle en sanglotant, qu'avez-vous? Que vous est-il arrivé?
Marforio se remit peu à peu, et comme Lorenzo avait appelé des valets pour le transporter, il fit signe à son gendre qu'il voulait être seul avec lui. Quand tout le monde se fut éloigné:
—Ah! mon cher Lorenzo, lui dit-il en soupirant, mon dernier jour est arrivé.
—Que s'est-il donc passé? Est-ce une disgrâce?
—Vous l'avez dit, une disgrâce, mais la plus cruelle, la plus inattendue, la disgrâce de la science; je suis déshonoré, je n'ai plus qu'à mourir.
—Vous m'effrayez, dit Lorenzo, qui pensa au fameux système, parlez vite.
—Eh bien! mon enfant, oh! je n'y survivrai pas! Un horrible complot a été tramé contre le prince, contre le ministère et contre moi. On était jaloux de ma gloire.
—Parlez! docteur, parlez!
—Je viens d'aller, selon l'obligation que je me suis imposée, et à laquelle, vous le savez, je n'ai jamais manqué, pour placer les cervelles dans les crânes. J'avais pour aujourd'hui un si beau projet!
—Eh bien! demanda Lorenzo, tout haletant d'impatience!
—Eh bien! je trouve comme d'habitude la porte hermétiquement fermée, rien extérieurement n'annonce l'horrible découverte... J'entre.
—Après! Voyons! Dépêchez-vous.
—Je vais droit à la table où se trouvent les bocaux et...
—Quoi donc? mon Dieu!
—Et je ne trouve plus rien; les bocaux sont vides.
—Même celui...
—Oui, même celui qui avait l'honneur de contenir la cervelle de Son Altesse.
—Vous avez peut-être mal vu, balbutia Lorenzo, qui se sentait pris d'épouvante et qui se retenait au bord de l'abîme.
—Oh! j'ai bien cherché! Alors j'ai compris que c'en était fait de ma gloire, et j'ai cru que j'allais mourir! Oh! mon ami, continua Marforio en tombant dans les bras de son gendre, on va croire que j'étais un charlatan. Voilà mon expérience manquée, mon système devenu la risée des ignorants.
Lorenzo n'osait mesurer toute la profondeur du gouffre que ce vol insigne creusait sous ses pieds. Il entraîna le savant vers la salle du trésor. On fouilla dans toutes les armoires. Les bocaux étincelants, mais vides, semblaient rire, sous les rayons du soleil, aux angoisses des visiteurs. Lorenzo sentit ses genoux trembler; ce bon petit prince héréditaire pleurait sincèrement Bonifacio, et ne songeait guère à inaugurer son règne.
—Mon père, mon pauvre père, dit-il, en se couvrant le visage!
—Hélas! reprit piteusement Marforio, il ne se doute pas du malheur qui lui arrive.
La remarque avait un caractère si affreusement grotesque que Lorenzo surpris et choqué regarda son beau-père.
—Oui, continua le savant, il dort là bien tranquille, sans savoir qu'il ne retrouvera pas sa cervelle au réveil.
—Il dort, balbutia Lorenzo, c'est vrai.
—Parbleu! croyez-vous qu'il soit mort? repartit Marforio, qui trouvait dans cette faible contradiction un petit élément de réconfort.
—Mais s'il vit, tout est sauvé, s'écria le bon prince, qui ne songeait qu'à ses craintes filiales.
—Il vit, tous les ministres vivent; mais ne leur demandez ni réflexion, ni pensée, ni même une parodie d'intelligence; ils vivent comme des automates, sans parole distincte; ils vivront ainsi, quelques mois ou quelques années, je ne sais au juste; car je n'avais jamais pu faire cette dernière expérience.
—Venez! venez! Marforio, dit le jeune prince avec animation, tout n'est peut-être pas perdu.
On se rendit dans la salle où les ministres et le souverain avaient l'habitude de goûter leur sommeil sans conscience. En ouvrant la porte, on entendit un grondement sourd et rhythmé qui attestait l'ardeur avec laquelle les augustes personnages s'acquittaient de leur tâche et faisaient honneur au savant qui les endormait. Lorenzo soupira; ce ronflement candide était l'image de la confiance et de l'innocence. Bonifacio souriait: il s'était probablement endormi avec le sourire qu'il ne devait plus quitter.
Marforio et Lorenzo debout, graves, recueillis, réfléchissaient.
—Il me vient une idée, dit le docteur.
—J'en ai une aussi, ajouta Lorenzo avec un soupir: voyons la vôtre.
—Eh bien, tout peut encore se réparer. Mais quelques sacrifices sont nécessaires. Nous savons par les phénomènes qui se produisent depuis peu que les cervelles convenablement enlevées servent indistinctement aux premiers corps venus. Je vais aller trouver quelques pauvres diables que la pensée importune, des ambitieux qui visent au pouvoir, des philosophes qui rêvent le gouvernement. Je leur offrirai, moyennant une récompense, la possession de la puissance et des honneurs. Je leur ouvrirai le crâne, et j'apporterai ici des cervelles toutes neuves qui seront peut-être bien dépaysées d'abord, mais qui introduiront du moins de la variété dans le conseil.
—Oh! voilà assez d'expériences, dit Lorenzo. Voilà assez de tentatives et de tentations sacrilèges.
—Ah! mon gendre, reprit avec animation Marforio exalté par la perspective d'une nouvelle lutte scientifique, vous doutez de votre beau-père! Vous faites injure à son système!
Lorenzo aurait pu répondre qu'il y avait bien de quoi; mais il suivait avec trop d'attention un projet qui naissait et se développait en lui, pour attacher de l'importance aux récriminations et aux offres de Marforio.
—Pensez donc, mon prince, à l'immense avantage de cette nouvelle combinaison, disait le savant. Les ministres deviennent des passe-partout. Nous leur donnons les idées, je veux dire les intelligences nécessaires au bonheur de la principauté. Le gouvernement devient bien réellement le représentant de l'opinion, puisque, selon les circonstances, nous transvasons dans le crâne des ministres les cervelles des chefs de l'opinion, si ceux-ci consentent, bien entendu. Dès qu'une cervelle aura produit ce qu'on en attendait, on la rendra à son premier possesseur. L'État, pour peu que la mode de ce système prospère un peu, se fonde sur la participation de tous au pouvoir. Mais comme le peuple a besoin de s'habituer aux visages de ceux qui le gouvernent, et pour éviter la confusion des physionomies, autant que pour garder un décorum invariable, les cervelles passeront, mais les ministres ne passeront point.
Marforio, déjà consolé, se frottait les mains devant cette perspective et se voyait déjà le dispensateur de la vie sociale dans la principauté. Son bistouri devenait un sceptre.
Lorenzo, nous l'avons dit, suivait son idée et n'écoutait pas le docteur. Il pensait à Marta, et se rappelant les conseils que cette chère âme, que cette bonté vaillante lui avait donnés souvent, il concevait un projet hardi, qui mûrissait dans sa tête et qui le rendait de plus en plus grave, à mesure que la réalisation lui paraissait vraisemblable. Comme Marforio ne recevait pas de réponse et ne trouvait pas dans son gendre l'enthousiasme sur lequel il croyait pouvoir compter, il lui toucha le coude.
—Eh bien! qu'en pensez-vous? lui demanda-t-il.
—Je pense, dit Lorenzo avec une douce fermeté et un effort visible, que Dieu ne veut pas qu'on empiète davantage sur son domaine. En permettant qu'un ennemi attente à votre œuvre, il nous avertit d'interrompre ces opérations, cette boucherie...
—Boucherie! s'écria Marforio indigné. Ah! mon gendre, vous ne méritiez pas ma fille!
—Excusez-moi, dit Lorenzo, je suis ignorant. Mais j'ai des devoirs à remplir comme prince et je veux les remplir. Tant que mon père a paru agir de sa propre volonté, j'ai dû m'incliner devant ses fantaisies, tout en les regrettant peut-être. Aujourd'hui je crois qu'il est de mon honneur et de l'intérêt de la principauté de me substituer à la pensée morte.
—Dites à la pensée absente et perdue; car enfin on les trouvera peut-être ces cervelles! Si nous les faisions afficher!
—Oh! Colbertini (car c'est lui qui a fait le coup, sans aucun doute), Colbertini doit avoir pris ses précautions. Le traître se sera vengé. Pourquoi ai-je oublié de lui demander la clef?
—Avouez aussi, mon prince, qu'on ne laisse pas la clef de sa maison à l'ennemi qu'on a chassé; vous voulez régner et vous débutez ainsi!
—J'ai eu tort, c'est vrai. Mais le moment est venu de tout réparer, et je sens que je suis à la hauteur de ma tâche. Marforio, promettez-vous de me seconder en toute chose, de garder le plus inviolable secret?
—Et je devrai renoncer à mes expériences? dit le savant avec tristesse.
—N'êtes-vous pas contraint d'y renoncer? De qui obtiendriez-vous l'autorisation de poursuivre vos épreuves? Si vous ne m'aidez pas, je laisse la curiosité, l'indignation publique s'informer et suivre leur cours. Et avec la perte de votre système, c'est l'honneur que vous perdez.
—Oh! sauvons l'honneur de la science avant tout! s'écria Marforio. Que faudra-t-il faire?
—Je vous l'ai dit: me garder le secret et m'aider à entretenir la principauté dans une illusion qui, j'en ai l'espoir, ne sera pas préjudiciable à ses intérêts.
—Oh! oh! l'appétit du pouvoir vous viendrait-il, mon gendre?
—Dites l'appétit du dévouement. Vous m'assurez que les corps étendus là peuvent vivre encore?
—Sans doute; puisqu'ils dorment, ils peuvent s'éveiller.
—Et en s'éveillant?
—Ils auront la même figure, la même allure qu'à l'ordinaire; seulement ce seront de belles têtes, sans cervelles. Pour quelques-uns, ce changement sera insignifiant.
—Et vous croyez qu'à moins de regarder dans la tête, on ne s'apercevra pas de... ce qui manque.
—Pourvu qu'on ne les interroge pas, le vide ne sera pas constaté.
—Eh bien, Marforio, réveillez-les; je penserai, j'agirai pour eux. Mais prenez bien garde que jamais personne ne se doute de la vérité. Il y va de notre honneur, peut-être aussi de la vie.
—Ma foi, mon gendre, cette nouvelle manière d'utiliser la péripétie que ce diable de Colbertini nous a ménagée me plaît assez. Vous allez voir si je suis à la hauteur de votre rôle. Par le Grand Albert, je jure de garder le secret.
Marforio s'approcha des ministres et de Bonifacio, et interrompit leur sommeil. Alors il se passa une chose effrayante, dont Lorenzo garda toujours une terreur profonde. Les corps se levèrent, s'habillèrent, marchèrent, bâillèrent, sourirent, se dilatèrent, ouvrirent la bouche comme pour parler, mais sans prononcer de parole. Le prince voulut prendre la main de son père; Bonifacio se laissa faire et sourit. Par un instinct machinal, le ministère se mit à la suite de son souverain, et ce cortège silencieux, marchant à pas comptés, en frappant les dalles de marbre de la galerie, se rendit à la salle à manger. C'était le premier travail ordinaire de la journée. Comme celui-là rentrait dans l'instinct animal, il fut ponctuellement rempli. Le déjeuner fut grave. Les valets regardaient et ne comprenaient rien à ce silence inaccoutumé. Depuis quelque temps surtout les réunions étaient fort bruyantes. Lorenzo, assis à la droite de son père, commençait sa comédie de prince et mentait pour la bonne cause; il se penchait respectueusement vers Bonifacio, paraissait en recevoir des ordres qu'il transmettait immédiatement.
Vers la fin du repas, une rumeur monta de la rue. Le peuple, secrètement soulevé par Colbertini et ses agents, demandait à voir son souverain. Le bruit avait couru qu'il était malade, mort peut-être, et que les manœuvres de Marforio avaient compromis les jours d'un prince et d'un ministère qui étaient en train de conquérir la popularité.
Lorenzo prit son père par le bras, fit un signe à Marforio et se leva. Tout le ministère, mû comme par un ressort, se leva aussitôt. Les deux princes, suivis des ministres, s'avancèrent vers le balcon. Des acclamations frénétiques les accueillirent. Dès qu'un peu de silence put s'établir, Lorenzo demanda la parole.
—Chers amis, dit-il à la populace, mon père est trop ému de votre touchant témoignage de sympathie pour parler; il me charge de vous remercier en son nom, et de vous annoncer que tous vos vœux seront comblés.
Un frémissement de joie courut dans la foule. Marforio, placé derrière Bonifacio, le poussa légèrement par le haut du corps, et Son Altesse se pencha et salua. Immobiles et roulant de grands yeux, les ministres tenaient la droite et la gauche de leur souverain.
—Oui, continua Lorenzo, les réformes, longtemps ajournées, seront aujourd'hui même exécutées. Les rues vont désormais recevoir un éclairage qui fera du jour le clair de lune de la nuit. (Applaudissements.) Plus d'ordures sur le pavé! Les impôts sur les objets de consommation seront l'objet d'un examen, et tout fait espérer qu'ils seront incessamment abolis.
Les cris de Vive Bonifacio se firent entendre; Marforio lui-même fut violemment acclamé. Quant à Lorenzo, on avait remarqué dans son accent, dans son attitude, une contrainte, un chagrin, qu'on interpréta comme du dépit, et l'on se dispensa de l'associer aux témoignages de gratitude dont le pouvoir était l'objet. Le jeune prince accepta ce premier mécompte comme un augure favorable.
—Tant mieux, dit-il, ils seront plus faciles à tromper.
Le cortège quitta le balcon et se dirigea vers la salle du conseil. Là chacun prit la place qui lui était habituelle. Lorenzo veilla à ce que les ministres ne manquassent de rien, et sortit avec Marforio, en fermant soigneusement la porte, et en ayant soin encore d'emporter la clef. Il poussa même la précaution plus loin. Il tâcha de faire trouver dans une caserne quelques soldats qui n'eussent pas oublié le maniement des armes et qui n'eussent pas vendu les fourniments de l'État, pour acheter des rubans à leurs fiancées; il les fit venir et leur dit:
—Son Altesse travaille et travaillera longtemps. Elle ne veut pas être dérangée; en conséquence, elle vous enjoint de poser une sentinelle à la porte de la salle du conseil. Vous devez empêcher par tous les moyens possibles, même par les armes, qui que ce soit de pénétrer dans l'appartement. Colbertini sera bien fin, ajouta-t-il intérieurement, s'il déjoue ces précautions.
Colbertini n'y songeait guère. La police fut mise à ses trousses; mais il ne faudrait pas conclure de l'inutilité des recherches qu'il se cacha avec, beaucoup de soin. Il avait suivi la manifestation quasi séditieuse dont il était l'instigateur. L'apparition de Bonifacio et de ses ministres au balcon du palais le terrassa.
—Décidément, se dit-il, il y a là-dessous du sortilège.
Il n'osa pas avouer la coupable spoliation qu'il avait commise. C'était un gros attentat, et il pouvait payer de sa tête la cervelle de Bonifacio. Il jugea plus prudent de devancer la justice du peuple, et il partit immédiatement pour la frontière, où l'attendait un capucin de ses amis, auquel il avait promis une part dans le maniement des affaires, si la trame qu'il avait ourdie aboutissait. Il avait eu soin d'envoyer en partant un petit paquet à Marforio. C'était une lettre avec une clef.
«Traître, disait la lettre, tu l'emportes! mais pas pour longtemps! Je vais armer contre toi toutes les foudres célestes. Prie le diable qui t'inspire de te faire échapper à la sainte inquisition.»
Marforio rit beaucoup de ce billet.
—Le sot! dit-il, il se prétend un homme d'État, et il se fâche! il s'avoue vaincu.
Lorenzo, brisé d'émotion, s'était empressé d'aller tout raconter à Marta.
—J'ai menti à la face de Dieu et des hommes, lui dit-il en la voyant, voilà mon métier qui commence. Ah! tu m'aideras de ta sagesse et de tes conseils.
—Je t'aiderai de mes prières et de mon amour, répondit Marta.
La lutte si courageusement entreprise par le prince héréditaire se continua le lendemain et les jours suivants, Dieu sait avec quelles terreurs, quelles précautions infinies, non-seulement sans que rien trahît l'effort généreux de Lorenzo, mais encore avec un succès qui dépassa ses espérances. Il levait, il couchait, il faisait boire et manger son père et les ministres; puis, quand il les avait tous convenablement mis sous clef, il travaillait avec Marta et, suivant les inspirations de leurs deux cœurs, il administrait.
Qu'il commît quelques fautes et que les illusions généreuses de son âme le fissent continuellement tomber dans des pièges et dans des erreurs énormes, je l'admets; mais il y avait une bonne volonté si active et une intention si droite que les fautes portaient en elles leur remède, et que le bien se produisait toujours. Lorenzo, bien entendu, laissait toute la gloire à son père, et le peuple continuait à ne lui savoir gré de rien, au contraire.
Une ère de prospérité commença pour les États de Bonifacio XXIII. Ce fut le plus glorieux moment de son règne. Ce fut à partir de cette époque que ses ministres et lui acquirent les titres dont l'histoire n'a jamais voulu rendre le dépôt. On trouvait à ces hommes sans cervelle tout le génie, toute la maturité qu'on leur eût refusés quelques semaines auparavant. La parfaite dignité avec laquelle ces automates de chair et d'os figuraient dans les cérémonies, ce qu'ils gagnaient en éloquence depuis qu'ils ne parlaient plus, et en sagacité depuis qu'ils ne pensaient pas, combla les vœux du parti des jeunes. Il s'était réjoui de la période bruyante, agissante; il se réjouit davantage encore de cette taciturnité. Bonifacio devint un politique, supérieur à Machiavel. Des sentences, auxquelles Lorenzo n'était pas étranger, commencèrent à circuler. Les uns affirmaient que l'empire du monde appartient aux flegmatiques; les autres se réjouissaient de ce que le règne des bavardages avait cessé. Comme Bonifacio était inabordable et comme il marchait toujours au milieu d'une haie de serviteurs dévoués, il devenait impossible de lui parler. Pourtant des mots profonds et sublimes lui furent attribués. Lorenzo se mettait l'esprit à l'envers pour les inventer.
Sans qu'on touchât à une seule des libertés dont le peuple avait cru jouir jusque-là, parce qu'il les avait gaspillées, l'ordre s'établit peu à peu. Une émulation singulière se manifesta entre le prince et ses sujets. Chacun voulut travailler, puisque le chef de l'État travaillait. Au bout de six mois, Bonifacio passait la revue d'une jolie petite armée, équilibrait les budgets autrement qu'en se servant de quelques belles phrases comme balanciers, encourageait les affaires sans faire tort aux travaux intellectuels, et réalisait... tout ce qu'il n'avait jamais rêvé.
Cette prospérité emplissait de joie et d'un secret orgueil le cœur de Lorenzo.
—Mon gendre, vous êtes un grand homme, lui disait Marforio, un peu moins présomptueux depuis sa déconvenue.
—Que je suis heureuse de t'aimer! lui disait Marta.
—Et quand je pense que le public attribue tout cela aux gros corps qui digèrent là-bas, reprenait le savant.
—Tant mieux, ajoutait Lorenzo en souriant. J'ai tous les profits du pouvoir sans en avoir les inconvénients; je fais le bien et je n'ai pas de louangeurs à récompenser.
Marforio était plus ménagé que Lorenzo par l'ingratitude. On allait même jusqu'à lui attribuer, sinon tout le bien qui s'accomplissait, du moins l'initiative féconde dont on recueillait maintenant les résultats. Mais peu à peu, à mesure que la satisfaction publique s'augmentait, Bonifacio devenait le seul objet d'estime et d'amour. Ce bon roi, si paternel et si recueilli, cette pensée mystérieuse, qui se manifestait par des bienfaits, était l'objet d'un culte qui variait ses formes sans s'épuiser jamais. Les monuments en l'honneur du souverain, les statues, avec ou sans robinets d'eau, décorèrent la capitale.
Quant à Lorenzo, c'était à peine si l'on se rappelait son existence. On n'en parlait que comme d'un jeune prince naïf qui avait fait un sot mariage. Car les peuples les plus démocrates pour eux-mêmes adorent l'aristocratie des unions princières, et sont humiliés d'une mésalliance de leurs chefs, faite souvent pour leur gloire. Ce bon jeune homme, si pur et si poétique, passait pour un nigaud. Il en riait et trouvait une satisfaction véritable et piquante dans cette injustice qu'il avait cherchée. Sa piété filiale, qui n'avait pas de dédommagement à recevoir du côté de son père, s'excitait et s'alimentait encore; et n'ayant ni flatteurs pour corrompre ses inspirations, ni rivaux pour défier son zèle et le porter aux prouesses dangereuses, il continuait à faire le bien tranquillement, loyalement, saintement, pour la seule joie de faire aimer son père et d'être aimé de Marta qui, de son côté, ne restait pas étrangère à l'accroissement de la population et à la consolidation de la dynastie.
Les bons rois devraient être immortels. Mais c'est une question de savoir si la perpétuité ne corrompt pas les plus précieuses vertus, et si les peuples qui se fatiguaient d'Aristide ne se révolteraient pas à la fin contre un souverain immuable dans sa justice comme dans sa durée. Les nations ont un faible et une tendresse pour les princes qui sont bons diables; on n'a jamais entendu dire qu'elles en aient choyé, sous le prétexte qu'ils étaient bons dieux.
Bonifacio XXIII semblait assuré de vivre longtemps, surtout depuis qu'il ne vivait plus, je veux dire depuis que le souci de son intelligence n'effleurait plus l'ombre de son corps; mais, et c'est ici que la fragilité de la science se montre avec éclat, toutes les conjectures de Marforio furent déjouées, et l'on remarqua avec stupeur dans l'intimité du château que la santé de Son Altesse et la santé de Leurs Excellences les ministres déclinaient rapidement. Rien n'était pourtant changé dans la régularité des fonctions automatiques de ces illustres personnages: ils faisaient leurs quatre ou cinq repas par jour avec la même abondance et la même exactitude. Leur sommeil et leurs promenades n'étaient point troublés; ils végétaient dans cette locomotion somnambulique, sans chagrins, sans douleurs. Mais, en dépit de l'excellente hygiène à laquelle ils étaient soumis, on vit leurs yeux s'entourer d'un cercle de bistre, leurs joues devenir creuses, leur taille se courber, leur démarche se ralentir. Marforio crut d'abord à un malaise passager. Mais il comprit bientôt que la mort allait le vaincre, et que sa présomption scientifique était sur le point de recevoir un conseil de modestie.
Lorenzo pressentit ce dénoûment sans douleur; non pas que l'ambition de succéder à son père altérât ses sentiments de tendresse filiale; mais depuis longtemps il portait le deuil secret de Bonifacio, et cet automate sans parole et sans amitié, qui buvait et qui mangeait à côté de lui, lui paraissait une effigie de son père, mais n'était plus son père.
Tout ce qu'on peut déployer de ressources ingénieuses pour prolonger la vie, Marforio l'essaya en faveur du prince et de ses ministres.
—C'est monstrueux, disait-il, ces coquins-là ont fait un pacte avec Colbertini. Puisqu'ils ne pensent plus, de quoi diable peuvent-ils mourir?
Ils mouraient précisément de ne plus penser, et c'était là ce que ne voulait pas reconnaître Marforio. Il avait peine à admettre que la matière, pour s'épanouir et pour durer, eût besoin de l'intelligence; il ne comprenait pas qu'il y a dans l'idée, dans la vie morale, un foyer, la vie même; et de même qu'on voit des corps chétifs se maintenir et persister longtemps au seuil de la tombe, parce que l'énergie de la volonté ou de l'imagination fait peur en quelque sorte à la matière et à la mort, de même on voit les corps les plus robustes s'affaisser et dépérir quand la flamme intérieure ne les soutient et ne les illumine pas.
Bonifacio n'était qu'un cadavre animé, un de ces sépulcres blanchis et mis à neuf dont parlent les Écritures. Ses ministres ne valaient pas mieux.
Marforio se désolait et se démenait; dans les rares circonstances où l'exhibition publique du gouvernement était une nécessité, on fardait Son Altesse et Leurs Excellences; mais ce petit mensonge, ce masque était une ironie de plus et n'empêchait pas l'active décomposition de s'attaquer à ces hauts et puissants personnages.
Le peuple, quand il apercevait son souverain, criait à tue-tête: Vive Bonifacio. Mais si la voix du peuple est la voix de Dieu, elle n'était pas, en tout cas, la réponse du ciel aux questions que s'adressait le docteur.
Au bout de quelques mois, tous les fards, tous les cosmétiques furent impuissants à dissimuler les ravages de la décrépitude. Lorenzo, qui craignait que dans le premier moment de sa douleur la nation ne se portât à quelques excès contre Marforio, faisait répandre le bruit de l'indisposition, puis de la maladie du prince. Les églises furent alors assiégées. On brûla des cierges à tous les saints du calendrier, ce qui n'était pas trop. On fit des pèlerinages à quelques endroits de plaisance où des industriels avaient établi de pieuses guinguettes. Des charlatans s'offrirent avec des remèdes héroïques. On supplia dans des adresses éloquentes le père du peuple de moins travailler. Le parti de l'avenir, qui s'était un peu débandé, se réorganisa et lança contre Lorenzo des brochures et des manifestes, en accusant ce jeune homme égoïste de laisser tout le soin des affaires à son père.
—Ah! les nigauds, disait Marforio, dont l'humeur s'aigrissait visiblement et qui jurait de ne pas survivre à l'échec de son système, ils ne savent pas ce qu'ils disent, et quand ils sauront que c'est vous, mon gendre, qui avez tout fait, tout gouverné!
—Ils ne le sauront jamais, répondait Lorenzo; puis-je avouer, pouvons-nous avouer que nous les avons trompés?
Un matin, les cloches sonnèrent un glas funèbre. C'étaient de belles cloches neuves qui venaient d'être installées et qui passaient pour un cadeau de Bonifacio. Tous les habitants éclatèrent en sanglots et ne remarquèrent le doux son des cloches que pour dire avec désolation que leur souverain ne les entendrait pas.
Quelques heures auparavant, Son Altesse était passée de vie à trépas, sans douleur. Le cadavre était hideux à voir, tant la matière se hâtait de se dissoudre. Mais Bonifacio fut enterré, avec son sourire qui ne l'avait plus quitté.
Les ministres ne valaient guère mieux. Il en mourut un en même temps que le prince; les autres suivirent dans la semaine, comme des serviteurs fidèles. On n'annonça qu'en plaçant des intervalles entre chaque décès cette fin du gouvernement modèle.
Je ne vous décrirai pas les magnificences relatives des funérailles qui furent faites à Bonifacio. Ce fut une date mémorable, et comme les grandes douleurs ne vont jamais sans de grands tiraillements d'estomac, il y eut des repas splendides qui faisaient croire, au premier aspect, que la principauté célébrait une noce.
Lorenzo, pâle et triste, comme jamais prince héréditaire ne le fut au convoi de son prédécesseur (ce dernier fût-il son père), conduisait le sinistre cortège. Marforio, comme premier ministre, était contraint d'y assister; mais, à vrai dire, ce fut ce jour-là que sa charge lui pesa le plus, ou, pour mieux dire, qu'elle lui pesa véritablement. Car c'était quelque chose de plus qu'un prince, fût-il Alexandre, ou César, ou Bonifacio XXIII, qu'il voyait enterrer, c'était tout l'effort de la science, toute la découverte, toute l'œuvre de son génie. Le pauvre savant se disait bien en manière de consolation:
—Si l'infâme Colbertini n'avait pas enlevé les cervelles, peut-être eussent-ils vécu!
Mais il y avait dans ce regret la condamnation même de son système. Car, du moment que les cervelles soutenaient le corps, elles n'en étaient plus l'agent destructeur et pernicieux.
Lorenzo ne fit pas sentir à son beau-père la contradiction formelle qui existait entre ses théories et ses soupirs; il était lui-même aux prises avec de sérieuses difficultés qui allaient mettre encore une fois son courage à l'épreuve.
Le lendemain des funérailles, des placards séditieux furent trouvés apposés au coin des rues, entre les images de la bonne Vierge qui étaient au-dessus et les tas d'ordures qui étaient au-dessous. Dans ces affiches on protestait contre l'élévation de Lorenzo au trône occupé par ses pères. On ne proposait pas à la principauté de se passer de souverain; c'eût été un moyen trop radical et qui ne pouvait venir à la pensée du parti de l'avenir fortement imbu du passé; mais, selon la mode antique des petits États d'Italie, on proposait d'aller patriotiquement offrir l'argent, les récoltes, les soldats et tous les autres biens de la principauté à un vieux souverain étranger, qui, n'ayant absolument aucun droit à l'héritage de Bonifacio, se montrerait sans doute reconnaissant de celui qu'on lui accorderait.
Colbertini était pour quelque chose dans la rédaction de ce programme. Depuis qu'il était tombé du pouvoir, cet homme d'État était regardé comme infaillible; cette erreur est assez commune. Ajoutez qu'il était émigré, et que les peuples, sans pitié pour l'exil, ont une assez grande considération pour la fuite. Le traître se vengeait de ses successeurs et du prince. Il n'osa pas réclamer le payement de la dette contractée envers lui par feu Bonifacio; mais il pensait bien se la faire payer par le prince désigné dans les proclamations.
Lorenzo eût été bien heureux de quitter le palais, d'abdiquer les honneurs; mais il avait des devoirs à remplir, un héritage à réclamer et à défendre; il essaya de résister pacifiquement, de faire des promesses. Mais quelles promesses pouvait-il faire qui ne fussent au-dessous de la réalité dont son père avait si libéralement comblé ses peuples? Quand il parlait d'agir de son mieux, on lui riait au nez, en lui disant qu'il était incapable d'agir mieux et aussi bien que Bonifacio XXIII, dont l'exemple avait été stérile pour lui; il l'avait bien prouvé.
On sait tout ce que ce modèle des fils et des princes modestes, en même temps que des héritiers, aurait pu répondre; mais c'était précisément son silence qui faisait à ses propres yeux sa gloire et son mérite. Il ne voulait pas régner en flétrissant son père. Comment d'ailleurs dire au peuple qu'on l'avait trompé, et l'initier à cette horrible et sinistre comédie que Lorenzo avait jouée? Comment lui prouver que tous ces ministres morts ou mourants étaient des marionnettes?
Lorenzo essaya de lutter en prince; il envoya nettoyer les murailles des placards séditieux qui les couvraient; la révolte armée n'attendait que ce signal. On cria à la tyrannie. Les instincts de ce jeune voluptueux (on l'appelait ainsi parce qu'il s'était hâté de se marier légitimement, au lieu de se contenter des folles amours permises à son âge), les instincts du jeune voluptueux se montraient enfin dans toute leur perversité; et alors, les réverbères que Lorenzo avait fait mettre dans chaque rue furent arrachés et furent lancés comme des projectiles contre son palais; on se servit pour la première fois contre lui des beaux fusils tout neufs qu'il avait fait distribuer à la garde civique. Le sang eût coulé, si Lorenzo, suffisamment édifié sur les sentiments de reconnaissance de la principauté envers son père, n'eût pas renoncé à se faire convaincre davantage des services qu'il avait rendus lui-même sous le nom de Bonifacio XXIII. Il comprit la difficulté du pouvoir monarchique et s'avoua humblement qu'il n'était pas assez ambitieux pour commencer par canonner ses sujets, afin de les forcer au bonheur qu'il se sentait capable de leur procurer.
—Les scélérats! disait Marforio, qui n'était pourtant pas enveloppé dans la disgrâce, je voudrais les pendre tous.
—Ou leur enlever la cervelle, n'est-ce pas? ajoutait Lorenzo.
Non, docteur, continuait-il, ils sont logiques. Les peuples ne se payent pas de conjectures, d'hypothèses; ils ont une ingratitude qui est la condition de leur indépendance; et s'ils subissaient toute une dynastie d'imbéciles, en souvenir d'un bienfait rendu, ils seraient toujours sous le joug. On les dompte par la force, on les séduit par la pompe, on leur plaît par la ruse; mais on les ennuie par la bonne volonté sans apparat. Je ne suis pas un conquérant; j'ai des goûts simples, et je ne peux ni ne veux les tromper. Il est donc juste qu'ils s'imaginent perdre tout à la mort de mon père, dont les œuvres sont récentes, et qu'ils se défient de moi qui ne ressemble pas à mon père.
—Mais, mon gendre, puisque c'est vous qui régniez si bien!
—Ah! voilà ce qu'il ne faut pas leur dire; est-ce qu'ils me croiraient d'ailleurs? Allons! Marforio, prenons-en notre parti. Un acte de violence, un crime d'État, excusable aux yeux de l'histoire, odieux pour ma conscience, pourrait me maintenir. Je ne suis pas assez certain d'être infaillible pour commettre cet attentat.
Le bon Marforio ne comprenait pas ces subtilités.
—Vous ne parlez pas en prince, dit-il, véritablement indigné.
—Je parle en citoyen.
—Tu parles en honnête-homme, dit Marta, en se jetant au cou de son mari.
C'était en effet un très-honnête homme que le prince Lorenzo. Fallait-il attribuer à l'éducation reçue de l'institutrice française, à la lecture de Télémaque ou à sa vocation poétique le développement de ces instincts de candeur et de bonne foi? C'est ce que je ne pourrais affirmer, dans la crainte de suggérer un moyen inefficace aux princes tentés d'être honnêtes. Ce que je puis dire, c'est qu'il aima mieux renoncer au pouvoir que de le revendiquer par la force, et qu'il quitta la principauté sans laisser une goutte de sang derrière lui.
Dès qu'on apprit le départ de ce prince incapable, un hourra salua la délivrance. La générosité même de Lorenzo lui fut imputée à crime. Les peuples révoltés chassent d'ordinaire les princes qui leur résistent et méprisent ceux qui ne leur résistent pas. Un prince qui ne savait pas défendre sa couronne ne méritait pas de la porter. Son horreur de la guerre civile passa pour de la pusillanimité. On alla offrir le pouvoir au souverain étranger dont il a été question. Celui-ci s'empressa de gratifier ses nouveaux sujets d'une partie de ses dettes, et fit peu de jours après son entrée dans la capitale.
Il fut reçu, complimenté par Colbertini, qu'il nomma son premier chambellan, les ministres ayant été supprimés par une mesure radicale qui dut faire tressaillir Bonifacio dans sa tombe; si bien que l'infâme Colbertini eut le droit de porter suspendue à un cordon cette fameuse clef de la salle des trésors qui lui avait permis enfin d'accomplir sa vengeance.
Quant au parti de l'avenir, le nouveau souverain qui lui devait sa couronne s'empressa de le disperser et de le menacer du carcere duro s'il se reformait jamais.
Comme il avait mal agi par pur patriotisme, il dut sans doute se déclarer satisfait de cette récompense.
Lorenzo était exilé; mais il avait avec lui l'amour et la liberté, et cela suffisait pour lui redonner une patrie idéale. Il emmena le bon Marforio et vint en France, où le sol est particulièrement hospitalier pour les princes exotiques. Au surplus, ce titre de prince, Lorenzo le laissa sommeiller; il était pauvre et avait besoin de travailler: les prétentions héréditaires n'étaient plus de mise. Il étudia, devint en quelques mois un naturaliste des plus distingués, publia plusieurs mémoires, concourut dans des luttes scientifiques et conquit plusieurs fois des couronnes qui ne changeaient rien à l'équilibre européen. Il ne faut pas croire, toutefois, qu'en quittant la principauté, Lorenzo eût renoncé à son affection pour elle. Il sembla, au contraire, qu'il l'aimait mieux depuis qu'il l'avait perdue. Il y songeait nuit et jour, et s'il s'efforçait de s'instruire, s'il appliquait toute son âme à former le cœur de ses enfants, c'est qu'il pensait qu'en cas de retour il fallait rendre à son pays des citoyens dévoués qui eussent tout oublié et tout appris.
Marforio continua de poursuivre des chimères; mais il remarqua que le sol de la France les rend plus fugitives; il renonça à expérimenter sur les cervelles, les Français préférant de beaucoup les fêlures naturelles du crâne à celles que le docteur pouvait pratiquer; il se résigna à de moindres problèmes et borna son ambition à la quadrature du cercle et à la pierre philosophale.
Lorenzo vécut heureux. La patrie absente donnait à son bonheur domestique cette mélancolie, cette tristesse qui met au frais, pour ainsi dire, les parfums de l'âme et les empêche de s'évaporer. Il eut des enfants beaux comme Marta et bons comme lui. Il s'appliqua à leur donner une conscience droite et inflexible, le sentiment de l'honneur et la passion du devoir; il leur apprit qu'ils étaient princes, et leur raconta son histoire, pour les préserver des vaines ambitions. Peut-être eut-il un tort que je dois confesser pour lui, et dont il ne se repentit pas en mourant: il éleva ses fils dans des utopies et leur persuada, par exemple, que les peuples sont les maîtres de leurs destinées, que les princes ne sont pas indispensables à la prospérité des États, et que la justice et la liberté sont plus nécessaires que le pain et les fêtes du cirque. Ces paradoxes, qui faisaient doucement calomnier Lorenzo par son entourage et l'accuser de républicanisme, ont malheureusement porté leurs fruits et semblent condamner les enfants de Lorenzo à un bien long exil, car ils ont juré de ne rentrer dans leur pays que quand l'Italie serait libre des Alpes jusqu'à l'Adriatique.
C'est ainsi, conclut Ottavio en soupirant, que se termine l'histoire du prince Bonifacio.
—Mon cher ami, dit aussitôt Stanislas Robert, je ne m'occuperai pas du plus ou moins de talent que tu as déployé dans ton récit; nous ne sommes pas ici pour nous faire des compliments ou des critiques de style; je tiens seulement à te déclarer que tu as fait beaucoup de concessions à ton auditoire et que je ne trouve pas dans ce conte l'âpreté des opinions et la fougue du patriote italien auquel j'ai voué une amitié éternelle.
—Je n'aime pas beaucoup cette absurde opération des cervelles, ajouta sir Olliver en bâillant un peu.
—L'épisode de Marta est trop abrégé, dit l'Allemande.
—Sans compter, ajouta madame Vernier, que vous prenez un plaisir odieux à vous moquer du parti de l'avenir. Ne voilà-t-il pas une belle épigramme: ce restaurateur français, ces jeunes gens qui se font berner! J'ai failli vous interrompre plus d'une fois et protester.
—Et vous, madame, demanda Ottavio à l'Espagnole, quel grief avez-vous contre mon récit?
—Aucun, monsieur, répondit madame Mendez avec un petit ton dédaigneux qui démentait ses paroles. Je reconnais aux auteurs le droit de tout dire et de se moquer de tout. Vous bafouez le pouvoir légitime, vous pouvez bien bafouer le jeu et les cartes.
—Y a-t-il encore quelqu'un pour m'accuser? demanda Ottavio en souriant.
—Moi je me lève pour ne pas rester seul indifférent ou complaisant, dit Frantz; je vous accuse de railler la science et l'utopie.
—Eh bien, mesdames et messieurs, je vais essayer de me disculper, reprit Ottavio. Je pourrais vous dire: L'air est doux, le soleil de cette île porte à la gaieté, j'ai commencé, pour vous plaire, sans bien savoir ce que je disais. Ce serait là l'excuse banale de la plupart des conteurs et des romanciers contemporains. Mais je puis bien vous avouer que je ne suis pas un auteur de profession. Mon conte est absurde et suffit à m'excuser au point de vue artistique; mais il a une intention, et cette intention-là me tient au cœur. Tu dis, mon cher peintre, que j'ai caché la fougue du patriote sous les indulgences du narrateur. Oh! c'est qu'à plusieurs milliers de lieues de la patrie l'amour du pays s'idéalise et court la chance de se débarrasser de la haine. Nous sommes des naufragés, et moi je suis le plus naufragé de vous tous. Je me fais humble, peu exigeant, soumis envers le ciel, gracieux pour les moindres brises qui passent, afin qu'une barque, qu'un radeau, qu'une planche me prenne en pitié et me ramène. Je ne veux pas qu'on dise de moi, et je ne voudrais pas qu'on dît de tous ceux qui sont comme moi, que l'exil nous donne des préjugés et des colères d'émigrés.
—Assez, assez, dit Stanislas Robert, qui voyait les yeux d'Ottavio s'allumer d'un éclair rempli de larmes, et qui craignait d'avoir blessé le cœur de son ami. Je comprends tout; tes raisons me suffisent.
—Je n'ai encore rien dit, répliqua Ottavio en riant. Tu y mets de la bonne volonté. Quant à vous, milord, vous n'aimez pas les cervelles. Cela dépend des goûts. Il vous est permis, d'ailleurs, de ne voir là qu'une fiction; et l'image d'une cervelle humaine n'est pas plus révoltante pour la délicatesse de nos instincts que l'image du cœur invoqué à chaque page des livres, à chaque ligne des prières. Quand vous offrez votre cœur à une dame, milord, lui offrez-vous bien cet affreux lambeau tout sanglant qui palpite dans votre poitrine, ou plutôt ne lui offrez-vous pas la quintessence de vos pensées? Les peintres qui représentent dans les tableaux de sainteté le cœur tout pantelant, tout dégouttant, couronné de ronces ou d'épines, font une chose extrêmement agréable à la piété des dames. Je suis convaincu que la señora Mendez a des images de cœurs découpées dans ses livres de prières. Pourquoi la cervelle, qui est le vrai cœur humain, puisqu'elle est l'instrument authentique de l'intelligence, et puisqu'on n'a jamais dit que les grandes pensées vinssent de la poitrine et de l'organe qui est placé sous les poumons, pourquoi la cervelle ne jouirait-elle pas des mêmes priviléges que cette masse charnue?...
—Assez, assez! dirent avec horreur toutes les dames à la fois.
—C'est pourtant du cœur que je parle. Mais il paraît qu'on ne me laissera pas me défendre aujourd'hui. Je proteste et je continue mon plaidoyer. Vous m'en voulez, madame la Française, de ce que je n'ai pas eu suffisamment de respect pour le parti de l'avenir. Prenez garde de m'accuser de blasphémer contre les idées! Les hommes sont des hommes, et toutes les faiblesses, toutes les ambitions, toutes les défaillances peuvent les atteindre. Il est donc permis de douter des hommes. J'en ai tant vu naître et tant vu mourir, des partis de l'avenir! Tous composés de héros qui, tous, individuellement, eussent donné leur sang, leur honneur même pour le triomphe de leur cause, et qui, réunis, avaient des heures d'oubli et de faiblesse incroyable! Les idées sont infaillibles, les partis ne le sont pas; et de même qu'on ne peut pas dire: Le parti des honnêtes gens! à l'exclusion des autres; de même on ne peut pas dire: Le parti qui ne se trompe jamais!
—Je viens te prêter main forte, mon cher Ottavio, interrompit Stanislas Robert. Je crois qu'il faut traiter les partis comme on traite les nations, c'est-à-dire les juger, les gronder, les avertir au besoin, les tourner même en ridicule; mais les aimer, les servir et s'en servir!
—D'ailleurs, ajouta Ottavio avec un peu de fierté, moi seul ici ai le droit d'être sévère: je paye de l'exil ce droit-là. Quant à mes plaisanteries sur le jeu, dont la señora Mendez a été blessée...
—Moi, en aucune façon; je me plaignais pour ne pas applaudir.
—Est-ce un compliment? dit Ottavio en riant. On m'a reproché aussi d'abréger les scènes d'amour. C'était par respect pour ceux d'entre nous qui ont aimé, qui aiment ou qui aimeront.—Et le jeune Italien promenait son regard doucement railleur sur l'assistance. D'ailleurs, les plus beaux propos en ce genre sont ceux qu'on rêve; et quand j'aurais multiplié la poésie, je serais encore resté bien loin des murmures qui ont dû charmer ou qui charmeront vos oreilles, mes belles dames. Quant à vous, mon cher monsieur Frantz, vous avez pris la défense des savants: je ne crois pas les avoir attaqués. Marforio ne fait tort à personne, et ses folies n'empiètent sur le domaine de qui que ce soit. Pour ce qui est de l'utopie, je l'ai maudite, comme celui qui maudit à jeun le vin dont il s'enivre à chaque repas. Moi, railler l'utopie! mais c'est elle qui me fait attendre un vaisseau, c'est elle qui m'empêche d'aller me plonger dans ces vagues azurées, plus sûres pour y enfouir un cœur que les vagues du ciel. Les vieux poëtes prétendaient qu'on ne pouvait aimer sa maîtresse sans la châtier. Je châtie l'utopie. Elle me fait assez souffrir, la chère infidèle!
Ottavio avait un rire mélancolique qui allait attrister l'auditoire.
—La cause est entendue! dit Stanislas Robert; te voilà suffisamment disculpé, mon cher rêveur; nous pouvons maintenant, mesdames et messieurs, l'applaudir en toute sûreté de conscience.
—Sans compter, dit madame Vernier, que monsieur Ottavio nous a fait la galanterie d'improviser, et qu'il n'avait pas de manuscrit en poche!
—Ceci, madame, m'a tout l'air d'une épigramme à mon adresse, reprit le peintre. Mais vous avez raison: Ottavio est un poëte; je ne suis qu'un misérable feuilletoniste.
—Il est tard, dit aussitôt sir Olliver.
—A votre montre, milord? demanda l'Espagnole.
—Non, repartit l'impitoyable Française, à l'estomac de Sa Seigneurie.
Sir Olliver rit de bon cœur. Il prenait goût aux épigrammes de madame Vernier sur son compte.
—Quand vous diriez vrai, où serait le mal? demanda-t-il solennellement. Le plaisir de manger, qui n'est qu'une fonction dans les pays peuplés, devient ici un devoir et presque un acte héroïque. Quand nous n'aurons plus de provisions et quand l'heure de nous entre-dévorer sera sonnée à tous nos estomacs, rirez-vous autant, ma belle Française?
—Oui, je rirai, pour mieux vous montrer mes dents et vous faire peur, repartit madame Julie Vernier.
—A table donc! dit le peintre. Ne bougez pas, mesdames, vos esclaves vont vous servir. Cueillons des feuilles!
Il nous importe peu de savoir comment la petite colonie s'acquitta d'un problème qui, pendant quelque temps encore, ne devait pas être difficile, et nous laisserons les habitants de l'île des Rêves commenter à la belle étoile la longue histoire du prince Bonifacio.
Le lendemain, quand on fut au rendez-vous général, sur la pelouse, on s'aperçut que personne n'avait pris d'engagement.
—Sir Olliver, dit le peintre, voilà l'occasion décisive. Exécutez-vous: racontez!
—Après ces dames, répondit l'Anglais.
—Comme nous vous détrônerons, reprit Stanislas Robert, quand nous le pourrons! A-t-on jamais vu un monarque plus entêté? Sir Olliver, je demande votre mise en jugement immédiate.
—Réservez-moi pour les moments critiques, dit l'Anglais avec un admirable sérieux; quand vous vous ennuierez il sera temps de m'accorder la parole.
—Pour nous distraire?
—Non, pour vous ennuyer jusqu'à la mort.
—Il me semble, dit le peintre, qui ne tenait que médiocrement aux contes et aux histoires de sir Olliver, que la présomption masculine a eu sa part suffisante. La modestie de ces dames pourrait se risquer.
Un grand silence accueillit cette insinuation.
—Je ne doute pas, continua Stanislas Robert, que la señora Mendez ne donne l'exemple à ces deux dames.
Dolorida, qui regardait beaucoup le jeune peintre, et qui paraissait lui avoir accordé une entière confiance depuis la promenade qu'ils avaient faite ensemble, Dolorida sembla réfléchir:
—Soit, dit-elle au bout de quelques minutes, je vous raconterai mon histoire. Je suis peu experte en matière d'allusions et de symboles; j'ai une franchise qui va droit au but. Mon récit ne sera donc ni long, ni compliqué.
—Est-ce pour moi, señora, que vous parlez ainsi? dit Ottavio.
—Est-ce pour moi, plutôt? demanda le peintre.
—C'est pour moi-même, messieurs, si vous le voulez bien. Vous avez fait vos préfaces, laissez-moi faire la mienne. Je sais qu'il s'est établi un système littéraire qui supprime les agréments du style comme superflus, et les agréments de l'idée comme inutiles. Voilà l'école à laquelle je veux appartenir. Un des avantages de l'art moderne, c'est qu'il a des combinaisons, des théories pour toutes les impuissances. M. Robert appartient à l'école sentimentale, M. Ottavio à l'école ironique. J'ai de la faiblesse pour l'école réaliste; c'est celle du premier venu littéraire qui écrit comme il parle, qui parle sans se gêner.
—Messieurs, je vous préviens que la señora est la plus habile d'entre nous, et que sa préface est la meilleure.
—Maintenant, écoutons son histoire, dit madame Julie Vernier.
La señora Mendez passa la main sur son front, pâlit un peu, regarda devant elle, en fronçant ses beaux sourcils, et commença ainsi:
Je ne vous dirai pas que j'appartiens à une illustre famille et que je descends en droite ligne du soleil. Mon père était un soldat, ma mère seule était de race. Mais les guenilles, qui vont assez bien aux hommes, vont mal aux femmes, et ma mère se trouvant orpheline, sans ressources et sans autre perspective que celle de mourir de faim, en pensant à des aïeux qui avaient regorgé d'or et de toutes choses, ma mère épousa un capitaine qui lui donna du pain... et des coups. Seulement, la pauvre âme mit sa fierté dans le silence, subit son sort et ne se plaignit jamais.
Se vengea-t-elle? Peut-être. Je voudrais, par piété filiale, vous laisser croire que ma mère était une sainte et que je ne lui ressemble pas. Mais je suis obligée, au contraire, de vous laisser supposer que le capitaine eut à se plaindre d'elle. Pourtant, comme il ne pouvait la battre sans cesse, il s'escrimait avec d'autres, et j'ai entendu dire que le deuil porté par ma mère n'était pas seulement une fantaisie de mode, une économie de toilette, mais aussi une muette et énergique protestation contre l'emploi de l'autorité conjugale portée jusqu'au meurtre. Il est bien convenu que le capitaine n'était pas un assassin, mais un duelliste.
Je fus le seul enfant de cette union orageuse. J'aurais pu en être la réconciliation, car mon père et ma mère m'adoraient également, et entreprirent l'un et l'autre mon éducation. Mais, hélas! au lieu de m'épanouir dans l'harmonie, je fus battue par tous les vents. Je me sers du mot battue avec intention.
Le capitaine m'emmenait quelquefois à la caserne, me faisait passer les troupes en revue et me disait:
—Quel dommage que tu ne sois pas un homme! ma petite Dolorida. Promets-moi au moins de n'être pas une femme, et de n'être ni frivole, ni coquette!
Je promettais à mon père tout ce qu'il voulait, tant j'avais de joie de toucher à son épée ornée de glands en or, tant j'étais fière d'être saluée par les soldats du capitaine.
Quand je rentrais auprès de ma mère, elle me dépouillait bien vite de tous mes habits, sous prétexte qu'ils sentaient le tabac. Elle me parlait de ses ancêtres, qui eussent rougi de voir leur petite-fille donner des poignées de main à des factionnaires, et elle me disait:
—Quel bonheur que tu sois une femme! Jure-moi, ma Dolorida bien-aimée, que tu porteras haut ton cœur, et que tu seras une femme digne de ce nom.
Je promettais à ma mère le contraire de ce que j'avais promis à mon père, mais avec une entière bonne foi. Tiraillée en sens contraire, forcée, malgré la plus invincible répugnance, de me mentir à moi-même, je sentais se développer en moi des forces contradictoires, pour ainsi dire; et à quinze ans j'étais la créature la plus passionnée, mais tout à la fois la plus rigide; complaisante pour les défauts de mon père, pleine de tendresse pour la résignation de ma mère.
Quand je parle de résignation, je n'entends pas par ce mot la soumission humble et discrète aux misères de ce monde; je n'entends pas l'immolation de la volonté, du caractère; j'entends ce pacte conclu par les âmes fières, qui jurent de boire leurs larmes, de cacher leurs douleurs sous un sourire, et de ne pas donner à la méchanceté, à la sottise humaine, le triomphe d'une intelligence élevée s'abîmant dans la douleur.
Telle était la résignation de ma mère. Elle se repentait d'avoir eu peur de la misère et de n'avoir pas eu peur du capitaine; mais si elle ne dissimulait pas à celui-ci son mépris et sa haine, si elle trouvait une joie sauvage à l'accabler de ses sarcasmes dans l'intimité, devant le monde elle souriait, ne permettait pas qu'on la plaignît et semblait prendre plaisir à faire admirer ma parfaite ressemblance avec mon père.
Celui-ci n'était pas un méchant homme. C'était un soldat plein d'honneur, c'est-à-dire décidé à mourir plutôt que de trahir son drapeau, mais ne se piquant pas d'une fidélité à toute épreuve dans l'accomplissement des engagements de l'ordre civil. C'est ainsi que je reconnus, à l'âge de raison, qu'il ne payait pas ses dettes et qu'il dissipait dans le jeu la meilleure partie de son revenu.
Le capitaine avait aimé ma mère, c'est-à-dire qu'il l'avait trouvée fort belle, qu'il avait été charmé de son grand air, de son attitude de reine, au milieu de sa pauvreté, et qu'il avait été ravi d'empêcher la descendante d'une vieille et noble famille de l'Estramadure de faire des ménages, ou de faire pis que cela.
Mais ma mère, après l'élan de reconnaissance pour le procédé du capitaine, n'avait pas pu tenir à ces habitudes de garnison, à ce pittoresque continu de langage et d'allures. Elle avait essayé d'abord de n'y pas songer; mais l'odeur de la pipe la poursuivait jusque dans sa chambre; mais les propos grossiers ne se laissaient pas intimider par elle, et quand elle voulut faire acte d'autorité, on lui répondit par des actes de tyrannie.
Que se passa-t-il alors? Il n'est pas rigoureusement du devoir d'une fille de vous le dire. J'ai entendu raconter depuis des histoires scandaleuses et dramatiques qui expliquent l'air de sombre résignation qui ne quittait pas ma mère, et, ainsi que je vous l'ai dit, le deuil qu'elle a constamment porté.
Ma mère était instruite et voulut m'instruire; mon père, qui me trouvait sinon jolie, du moins en passe de le devenir, prétendait qu'avec du jarret et des éclairs dans les yeux je pourrais être, sur un des théâtres de Madrid, de Londres ou de Paris, une piquante danseuse; que c'était un état productif, même en le faisant consciencieusement, et que, comme il n'avait pas de dot à donner à sa fille, il n'entendait pas qu'elle eût des prétentions.
Ma mère répondait que si à l'âge où l'on se marie je ne trouvais pas un honnête homme qui voulût de moi, je devais entrer dans un couvent, et qu'il était bon de m'orner l'esprit et la mémoire pour m'aider à accepter la réclusion.
J'étais tour à tour de l'avis de mon père et de l'avis de ma mère. Je dansais à ravir, j'écoutais avec des palpitations infinies le récit des fêtes qui attendent les grandes artistes, et quand, les joues enflammées, le regard brillant, je retournais auprès de ma mère, celle-ci me lançait dans des extases, dans des prières qui prolongeaient l'exaltation et finissaient par m'enivrer.
Vous croyez sans doute que, dans cet intérieur bizarre, avec ces tendresses hostiles qui se disputaient mon cœur, en n'étant d'accord que pour développer mon imagination, je dus me pervertir? Détrompez-vous. Cette gymnastique violente me donnait des appétits; mais une idée qui naquit de bonne heure et qui s'incrusta dans ma cervelle pour n'en plus sortir, me préserva de l'abîme qui attend les femmes élevées comme je le fus. Ma mère me répétait si souvent le conseil d'être fière, et mon père me recommandait si souvent d'être un homme, que je devins femme sans avoir été jeune fille et sans avoir passé par ces rêves qui amollissent l'âme et conseillent l'amour.
La plus étrange corruption, la plus inouïe, me défendit contre toutes les autres. Les livres me devinrent odieux, parce qu'ils parlaient tous du drame de deux cœurs invinciblement attirés l'un vers l'autre et empêchés longtemps de s'unir. Il me semblait que tous les mariages devaient ressembler à celui de mon père et de ma mère; et, si cela était, je jurais bien de ne jamais me marier.
En grandissant, je recherchais plus volontiers la société de mon père que celle de ma mère, non pas que j'aimasse moins celle-ci! Je crois, au contraire, que s'il eût fallu lui donner une grande preuve d'affection, j'aurais dépensé pour elle tout ce trésor, toute cette fureur de tendresse que je sentais vaguement s'amasser en moi. Le capitaine m'associait à des distractions bruyantes. Avec lui je n'étais jamais tentée de réfléchir, de méditer, et je n'étais pas exposée aux piéges du sentiment. Nous montions à cheval pendant toute la journée, et le soir je venais m'accouder au coin d'une table et regarder jouer mon père.
Cela peut vous sembler étrange, et vous allez concevoir de moi une idée bien défavorable; mais le jeu remplaçait tout et me préservait de tout: une passion sans objet qui me donnait la fièvre se satisfaisait par les dés et par les cartes. Ma mère essaya de lutter: elle fut vaincue. Lorsqu'elle me conseillait d'utiliser autrement mes soirées, je lui répondais que l'amour platonique du roi de carreau et du roi de trèfle devait la rassurer sur l'effet de ces heures, et je la conjurais de me laisser me préserver à ma manière des malheurs qui l'avaient accablée.
—Je n'aimerai jamais personne, lui disais-je; laissez-moi aimer quelque chose.
Mon père était ravi de m'avoir pour complice. Il était joueur effréné. Combien de nuits n'ai-je point passées à regarder les cartes tomber une à une sur le tapis! Mes mains aimaient à remuer les jetons. Peu à peu, je remplis des vides, je devins utile quand un partenaire manquait, et le capitaine, qui mettait une petite bourse à ma disposition, fit de moi un sujet distingué.
Toutes les parties n'avaient pas lieu à la maison. Le capitaine passait quelquefois des nuits dehors. Ces nuits-là je ne dormais pas et j'avais d'effroyables insomnies, dont je me consolais en entendant, le matin, le récit des prouesses ou des malheurs de la veillée. Je conjurais mon père de m'emmener avec lui.
—N'ayez pas peur, lui disais-je: je suis un homme, un page; je ne m'offusquerai pas des jurons que je pourrai entendre, et j'imagine que je vous porterai bonheur.
Je ne sais pas si ce fut cette dernière raison qui triompha des scrupules du capitaine. Mais je sais bien qu'il finit par consentir, qu'il me donna un costume d'homme, et que je le suivis dans les cabarets illustres et dans les cercles où il allait jouer.
Oh! les douces jeunes filles qui n'ont jamais quitté l'œil maternel et qui, gardées par une tendresse vigilante, s'épanouissent saintement à l'ombre du foyer domestique, les jeunes filles auxquelles l'amour et la piété du ménage sont révélés dans de chastes leçons sont bien heureuses, et n'ont pas plus tard ces âpres souvenirs qui dessèchent et troublent la vie! Mais j'ai besoin de vous le répéter souvent, pour ne pas vous faire horreur: je devenais une joueuse, sans que ma pureté implacable se sentît menacée sur d'autres points; je mettais un certain héroïsme de jeune fille dans le culte de cette passion, qui me préservait des autres.
J'allais donc partout avec mon père; je ne sais pas s'il me fallait traverser d'autres scandales que celui du jeu, et si je ne coudoyais pas d'autres vices dans ces tripots; mais je sais bien que je ne voyais que les cartes, et que, quand j'évoque ces effroyables souvenirs, j'ai l'éblouissement des bougies éclairant les enjeux, les mains flétries, les visages pâles, et que je n'aperçois rien au delà du cercle des joueurs penchés sur le tapis vert.
Ma mère n'essaya pas de lutter; elle avait un sombre désespoir. Elle se demandait s'il valait mieux que je fusse ainsi qu'exposée aux entraînements dont elle ne s'était pas assez bien défendue. Quant au mariage, j'en semblais fort éloignée, lorsqu'une catastrophe vint me mettre plus tôt que je ne le redoutais face à face avec la vie et avec le devoir.
Une nuit, dans un des cercles où mon père avait établi son quartier général, je remarquai que la veine se déclarait avec une persistance fâcheuse contre le capitaine: il perdait plus que d'habitude, et il perdait trop pour lui, pour ses maigres appointements, pour ses ressources possibles. Malgré moi, et bien que tous mes instincts me portassent à soutenir, à encourager fièrement la lutte, j'exhortai mon père à s'arrêter, à remettre la revanche à une autre nuit.
—Reculer, dit-il avec fureur, jamais! va te coucher, rassure ta mère, pauvre colombe effarouchée, si ce spectacle viril te fait peur.
Je m'étais levée, pâle et frémissante, pour fuir et pour entraîner mon père. Son sarcasme me défiait. Je craignis de paraître lâche; je me rassis en comprimant les battements de mon cœur, et j'assistai avec angoisse à cette partie, à ce duel dont je pressentais vaguement l'issue fatale.
Ce que le capitaine perdit sur parole, sur son honneur, comme on dit, je ne me le rappelle plus bien; mais ce que je sais, c'est qu'il lui était impossible de payer, en abandonnant même pendant vingt ans toute sa solde. Son adversaire était un certain capitaine de cavalerie nommé Lopez, qui, dit-on, se vengeait sur la bourse du mari de son échec auprès du cœur de la femme. Mon père se sentit perdu. Au fond de l'abîme, une lueur de raison traversa son ivresse, il voulut se disposer à partir.
—Déjà, dit en raillant le capitaine Lopez.
—Je n'ai plus rien à jouer, et vous n'êtes pas le diable pour accepter mon âme comme enjeu, répondit mon père.
—Fi! je suis trop bon chrétien pour vouloir disputer une âme, repartit Lopez; mais, si vous le voulez, je vous joue tout ce que vous avez perdu contre le joli petit page que vous avez là.
Le capitaine me désignait en parlant ainsi. Je me dressai avec une inexprimable colère; mais mon père, moins par horreur peut-être de cette cynique provocation que pour satisfaire sa rancune, avait jeté les cartes au visage de son adversaire, en oubliant, je crois, de retirer sa main.
Le capitaine Lopez devint horriblement pâle.
—Vous n'êtes qu'un escroc, dit-il à mon père; car de toutes les façons maintenant vous me faites banqueroute, soit que je vous tue, ou soit que ma mort vous donne quittance. Je devrais, pour vous punir, n'accepter un duel qu'après que vous vous serez acquitté.
—Lâche! si tu faisais cela, je t'assassinerais! rugit mon père.
—Allons! je suis trop bon, répondit Lopez en se levant, demain vous recevrez mes témoins.
—Non pas demain, à l'instant même!
—Vous êtes pressé! je veux bien encore; quoique les cartes m'aient fatigué le poignet; où sont vos témoins?
—Je n'en veux pas d'autre que Dolorida, dit mon père, qui avait les lèvres pleines d'écume.
—Vous êtes fou! un enfant, une jeune fille!
—Regardez-la, misérable, et voyez si le cœur doit lui manquer.
Je vous avouerai, mes amis, qu'en effet j'étais muette et droite comme une statue, et qu'on eût pu faire honneur à mon courage de ce qui venait surtout de ma surprise et de mon effroi. Je n'ai jamais eu ces petites faiblesses qui se trahissent par des cris ou qui se résolvent en évanouissements. La singulière éducation que j'ai reçue m'a un peu bronzée: en tout cas, je faisais un appel si désespéré à ma volonté et à mon énergie, qu'il n'est pas tout à fait étonnant que j'eusse assisté avec une apparente impassibilité à la scène rapide qui venait de se passer.
Les autres personnes qui jouaient dans le cercle voulurent s'interposer; mais il était difficile d'éviter une rencontre entre deux soldats, et il était impossible d'amener l'un ou l'autre à des excuses. Mon père se prétendait l'offensé, à cause du défi grossier de Lopez, défi qui était, disait-il, une injure à sa fille et à lui. Lopez montrait sa joue considérablement rouge et ne voulait pas concéder qu'il eût des torts à se reprocher.
Il faut bien le dire, d'ailleurs, il n'y avait pas dans ce tripot un seul homme d'assez de sang-froid ou d'une autorité morale assez sérieuse pour faire entendre le langage du bon sens. Le duel fut convenu, et on décida qu'il aurait lieu sur l'heure. Je ne fus pas le témoin de mon père; on lui en donna deux, malgré lui, et l'on offrit de me reconduire chez ma mère; mais j'insistai en termes si nets, si brefs, si absolus, que l'on me permit d'assister au combat.
Ces mœurs sont étranges, et il paraît sinon impossible, du moins fort peu croyable qu'une jeune fille joue un pareil rôle dans un drame qui met en jeu la vie de son père; mais je vous répète que mon caractère avait reçu une empreinte qui n'était pas banale, et je me hâte de vous faire remarquer que la passion du jeu déprave vite et change les conditions normales de la vie. Dans cette atmosphère embrasée, les préjugés ou les convenances du monde n'ont plus d'espace ni d'air. Le jeu nivelle les âges, les sexes et les rangs. Les dés et les cartes sont les plus énergiques égalitaires. Jamais, jusqu'à l'insulte du capitaine Lopez, ma fierté de jeune fille n'avait eu à rougir dans ce milieu équivoque, où les passions de mon père et ma passion naissante m'entraînaient chaque soir. Il est bien évident que j'aurais pu entendre un langage qui n'était pas toujours correct ni décent; mais je venais là pour voir jouer et non pour écouter. On ne faisait donc pas attention, ordinairement, à cette jeune fille déguisée en homme; et les mœurs excentriques que donne le jeu autorisaient ma présence à côté d'une table et sur le terrain.
On alla dans un jardin, derrière la maison. La nuit touchait à sa fin. Le ciel se décolorait à l'horizon; mais comme c'était pendant une des plus belles nuits de l'été, on eût pu se battre à la clarté de la lune.
Quand je vis tirer les épées de leurs fourreaux et choisir le terrain; quand le capitaine Lopez et mon père eurent mis bas leurs habits, l'impénétrable cuirasse que je portais autour du cœur parut s'entr'ouvrir; une émotion tendre me pénétra; un spasme, un sanglot me vint aux lèvres. Je joignis les mains avec ferveur et je priai de toutes les ardeurs de mon âme pour la vie de mon père. Je l'aimais bien alors!
Je n'ai jamais grimacé les sentiments que je ne ressentais pas, et il n'existe pas sous le ciel une créature qui puisse me reprocher d'avoir dissimulé la haine ou l'amitié. Je puis confesser que jusqu'à cet incident je me plaisais dans la compagnie de mon père, sans m'être jamais demandé si je l'aimais; il était pour moi plutôt un camarade, un instituteur de jeu qu'un tuteur respectable et sacré. Je lui en voulais de ses brutalités envers ma mère; je lui en voulais aussi peut-être des vices qu'il me donnait, et je n'avais jamais éprouvé pour lui de véritable tendresse.
Mais au moment où je le vis ramasser une épée pour défendre sa vie, j'eus un élan, un soulèvement de tout mon être; quelque chose de tendre, de doux, d'inconnu, se dilata dans mon cœur. J'eus l'intuition rapide des douleurs et des miséricordes de la femme; je me sentis bien réellement la fille de l'homme qui allait se battre, et je jure Dieu que mon oraison fut dite avec des larmes secrètes qui ne vinrent sans doute pas à mes yeux, mais qui m'inondèrent le cœur.
Je priais des lèvres et de l'âme; mais je regardais avidement. Mon père, après quelques passes heureuses dans lesquelles il avait blessé son adversaire, chancela et porta la main à sa poitrine.
Je courus à lui.
—Je ne t'ai pas vengée! murmura-t-il en tombant.
Je crois que le premier instinct de ma douleur, ou plutôt de ma colère, eût été de me précipiter sur l'épée et de m'en servir pour assassiner le capitaine Lopez; mais le sang qui couvrait la poitrine de mon père me pénétra d'horreur. Je me mis à genoux devant lui, j'essayai avec mes mains de fermer la plaie, j'appelai au secours. J'étais seule dans le jardin; les témoins, des soldats familiarisés avec des scènes de ce genre, étaient allés chercher un médecin. Quant au capitaine Lopez, il s'était approché et avait regardé sa victime avec un regard de curiosité triste; peut-être avait-il pensé que son tour viendrait aussi, et il était parti en soupirant.
Je ne pleurais pas: j'ai les larmes rebelles. Je n'ai jamais d'ailleurs lutté beaucoup dans aucune circonstance pour les faire couler. Au rebours d'une héroïne de Lope de Vega, je n'ai pas les yeux enfants. J'arrachai l'herbe autour de moi; je la posai comme une première compresse sur la blessure, et avec mon mouchoir j'essayai d'arrêter le sang.
Mon père était évanoui; au bout de quelques instants il revint à lui.
—Tu as du courage, Dolorida, me dit-il en s'interrompant à chaque mot pour respirer. Ah! si tu étais un homme!
—Que me demanderiez-vous?
—De jouer et d'acquitter mes dettes, reprit le capitaine: les dettes de sang et les dettes d'honneur; quoique j'aie peut-être assez payé!...
—Ne pensez pas à cela, mon père.
—A quoi donc veux-tu que je pense? A Dieu, n'est-ce pas? Tu as raison, je ne l'offenserai plus; je vais m'efforcer de rentrer en grâce.
Le médecin arrivait et trouva mon père qui essayait de joindre les mains et de balbutier des prières.
—Allons, vous vous êtes conduit en brave et vous mourez en chrétien, dit-il.
Le jour était venu; il éclairait cette scène de mort. On voulut faire un brancard; mais mon père s'y opposa.
—Je ne veux pas qu'on dise que je suis mort dans mon lit. Ceci est mon champ de bataille. Docteur, vous reconduirez cette enfant. Et toi, ma fille, prends garde de t'enrhumer. Tu m'excuseras auprès de ta mère; tu lui diras que je me serais battu pour elle, comme je me suis battu pour toi. Vous me ferez une petite place dans vos oraisons.
Le médecin, qui avait examiné la blessure, défendit à mon père de parler; mais celui-ci, dont le visage se contractait horriblement, fit signe que la défense devenait inutile et qu'il ne pourrait bientôt plus rien dire. En effet, un quart d'heure environ après ces paroles, qui furent les dernières prononcées, mon père s'efforça de se retourner sur le côté et rendit le dernier soupir.
Pour déjouer les premières informations de la police, on cacha le cadavre, et le médecin me ramena vers ma mère.
Celle-ci n'était pas couchée, ou plutôt elle était debout depuis les premières lueurs. Elle ne s'opposait pas à ces sorties dans lesquelles j'accompagnais mon père. Elle savait que la résistance à cet égard eût attisé les passions qu'elle redoutait. Mais quand je rentrais épuisée, fatiguée, pleine de ce dégoût que laisse toujours une nuit de jeu, elle me caressait, et s'efforçait toujours de profiter de ma lassitude pour me donner des conseils.
Ce matin-là, je ne sais quel pressentiment l'agitait; aussi, quand elle m'aperçut avec mes mains rougies elle ne m'interrogea pas; elle tomba à genoux, comprenant qu'elle était veuve et que j'étais orpheline.
Je me suis souvent demandé depuis si, malgré elle, en priant pour son mari, ma mère n'adressa pas quelque discrète action de grâces au ciel. Cette mort la délivrait d'un esclavage horrible et lui donnait le droit et le devoir de m'aimer seule, à son aise, tout entière. Le soir de ce jour, mes travestissements d'homme étaient brûlés, et il ne restait plus une carte dans toute la maison. Hélas! il ne restait pas non plus beaucoup d'argent, et quand on eut payé des cierges pour l'église, acheté une robe de deuil pour moi, il se trouva quelques pauvres pièces pour le pain d'une semaine.
J'avais eu l'intention, dans le jardin, sur le cadavre de mon père, de faire le serment de ne jamais me laisser tenter par le jeu. Je ne sais quel incident m'empêcha, dans ce moment, d'accomplir cet acte solennel. Depuis, j'y songeai bien, mais je craignis d'attacher trop d'importance, trop de gravité à une résolution morale; et il y eût eu dans ce serment, pris par moi contre moi, une défiance de ma force que je ne consentais pas volontiers à subir.
Notre situation n'était pas brillante. La misère nous apparaissait si proche, que l'épouvante paralysait toute notre volonté. Ma mère parla de travail: je la laissai dire. Je prévoyais cette épreuve; mais le travail répugnait à ma fierté et me faisait l'effet d'une prison. Il n'y avait pourtant pas à choisir; l'alternative était rigoureuse: ou le pain du labeur pénible et quotidien, ou le pain du vice et de la charité. Le premier paraissait trop dur, le second me semblait hideux; je ne voulais ni me courber ni m'avilir. Une indomptable fierté remplaçait dans mon cœur toutes les vertus qu'on avait craint de développer. Ma mère me supplia; mais je m'obstinai, muette et résignée, à attendre.
Qu'attendais-je? Un hasard, un coup du ciel, une fortune; l'instinct de la joueuse se montrait en moi: je comptais sur la chance; c'était de la folie. Mais l'éducation que j'avais reçue me donnait des forces insurmontables, pour me roidir dans une détermination.
Ma mère n'essaya pas de lutter; mais elle s'y prit de la meilleure façon pour que je cédasse. Elle chercha de l'ouvrage pour elle, en trouva, et sortit un matin pour le rapporter à la maison. Quand je vis que, sans m'adresser un reproche, un seul mot de blâme, une exhortation, la pauvre femme travaillait pour nous deux, je rougis et je jurai de me tuer.
Tout ce que je vous raconte là doit vous sembler absurde, mais c'est ma vie. On s'était appliqué à faire de moi un être qui restait femme par la persistance de la volonté, et qui n'avait plus les douces résignations, les tendresses de la femme.
J'avais jusqu'à présent une seule passion: l'amour de la richesse, de la puissance. Je me considérais comme déchue de mon rang et j'aspirais à y remonter. Mais comme les souverains infatués de leur droit, qui comptent sur un miracle, sur une coopération du ciel, j'aspirais par mes rêves, sans agir; et, comme je vous l'ai dit, une souillure m'eût semblé payer trop cher toutes les richesses et toutes les couronnes du monde.
Je n'étais pas avare; je ne l'ai jamais été; j'ai remué avec frénésie des piles d'or et des diamants. Eh bien, j'ai eu des convoitises qui me serraient les dents et me crispaient les poings; mais je voulais la richesse pour la dépenser et non pour l'enfouir. Le travail ne m'eût promis que le pain de chaque jour et la médiocrité; voilà pourquoi je ne voulais pas du travail. Mais comme il ne m'était pas possible de demander ma splendeur à autre chose, je me considérai comme vaincue, et à dix-huit ans, avec toute ma beauté (laissez-moi convenir que j'étais belle), sans avoir aimé, sans avoir eu de remords, et sans avoir de fautes à effacer; pure, mais obstinément attachée à mon rêve, je résolus de mourir.
Profitant d'un moment où ma mère était sortie, je quittai la maison; je traversai Madrid, et dépassant les portes de la ville, je me dirigeai vers le Mançanarez, bien décidée à m'y jeter. Je ne me demandai pas si le fleuve aurait la complaisance ce jour-là d'avoir assez d'eau pour me noyer. Je marchai résolûment, ne craignant rien dans l'obscurité, et ne regrettant rien de la vie; mon affection pour ma mère, quoique réelle, ne me sollicitait pas et ne me retenait pas. Mon Dieu, je puis l'avouer, je n'aimais peut-être personne!
Comme il n'était pas convenable de mourir sans avoir fait ma prière du soir, j'entrai dans une église, qui se trouva sur ma route, et je demandai à Dieu la permission d'aller plus tôt vers lui qu'il ne paraissait me l'avoir ordonné. Je lui demandai en même temps de ne pas trop souffrir et d'être préservée des regards indiscrets quand je serais morte. L'idéal pour moi, c'était de disparaître sans être retrouvée.
J'étais dévote, et mes prédispositions de joueuse me poussaient à la superstition. Il ne me suffisait pas d'avoir prié; je voulais une réponse, un oracle en quelque sorte.
Dans une chapelle devant laquelle je m'étais agenouillée, quelques petits cierges se consumaient et faisaient de leur mieux pour enfumer un magnifique tableau qui était au-dessus, et auquel on attribuait une vertu miraculeuse. Je remarquai un des cierges, celui qui touchait à sa fin, et je me dis: S'il s'éteint avant que ma prière soit dite, c'est que Dieu me permet de me tuer. Je ne trichai pas, je dis loyalement les prières que j'avais l'habitude de dire; mais avant que la dernière fût terminée, il se fit un vide dans les étoiles de la chapelle, et un petit filet de fumée, plus opaque que les autres, monta entre les blancs cierges. C'était ma réponse. Je crus voir mon âme s'exhaler et se perdre dans le sein de Dieu. Mon parti était irrévocablement pris; je n'avais plus ni à hésiter, ni à reculer, ni à m'effrayer. Le bon Dieu était pour moi.
Croisant donc ma mante avec une résolution énergique, je sortis de l'église et je continuai ma route, le cœur entièrement allégé, aspirant l'air avec force, et marchant à la mort comme à la réalisation de mes plus beaux rêves.
Le Mançanarez n'a pas des bords engageants. Cette nuit-là, la lune, éclairant comme un soleil anglais, me montrait toute l'aridité du rivage, et je voyais distinctement, au fond du fleuve, les gros cailloux sur lesquels se briserait ma tête. Je me promenai quelque temps, cherchant un endroit un peu moins à sec, et attendant qu'un nuage voilât la lune dont l'opiniâtre espionnage me gênait beaucoup. Enfin, je parvins à un endroit où un petit murmure annonçait de l'eau, et me tenant debout au bord du fleuve, rejetant ma mante, les bras croisés, j'attendis le signal que devait me donner l'obscurité. Au moment où, profitant d'une légère éclipse, j'allais m'élancer, je me sentis retenue par le bras. Je me retournai brusquement et me trouvai face à face avec un homme encore jeune qui me regardait avec compassion.
Je n'attendis pas qu'il m'interrogeât:
—De quel droit me retenez-vous? Passez votre chemin, dis-je rudement à l'inconnu.
—Un peu de patience, señorita, me répondit-on avec une voix légèrement railleuse. Je vous laisserai continuer votre... promenade, quand j'en connaîtrai le motif.
—Vous êtes bien curieux?

—Non, je suis journaliste, et demain, en annonçant à Madrid le suicide d'une jeune et jolie jeune fille, je devrai, pour l'enseignement de la foule et pour son amusement, expliquer les raisons, donner la généalogie de la victime. Veuillez m'excuser, señorita, je suis l'esclave des faits divers.
Le sang-froid poli avec lequel ces propos étaient débités me fit sourire:
—Et si je consens à vous donner ces détails, monsieur, me laisserez-vous libre? continuai-je, en raillant à mon tour.
—Quel droit ai-je sur vous, señorita? Vous serez parfaitement libre.
—Eh bien, monsieur, répliquai-je, je viens chercher la mort, parce que je suis pauvre et que je ne veux pas mendier.
—Vous tuer pour si peu! jolie comme vous l'êtes! demanda mon interlocuteur.
—C'est précisément parce que je suis jolie que je me tue. L'argent serait trop dur à gagner.
Je parlai sans doute avec une énergie sincère; le jeune homme en fut frappé et garda quelques instants le silence.
—Êtes-vous satisfait, monsieur? lui demandai-je.
—Encore une ou deux questions, señorita, et je me retire.
—J'écoute.
—La misère vous répugne, je le conçois; on n'est pas maître absolument de ses instincts. Vous préférez l'honneur à la richesse; c'est là un sentiment fier et tout-puissant. Mais il y a autre chose que les guenilles et que la honte, pardon de vous dire cela: il y a le travail.
—Et si le travail me fait peur! si je me sens faite pour autre chose que pour l'esclavage des artisans! si avec des aspirations vers la fortune et vers la gloire, j'aime mieux la mort que le dégoût d'une existence manquée ou que la flétrissure d'une lutte inégale!
—Il y a des batailles, señorita, qui se perdent faute d'alliés et qu'on peut gagner lorsqu'on est deux!
Je regardai le jeune homme qui me parlait ainsi: la lune, un instant obscurcie, éclairait en plein son visage. Sans être beau, cet inconnu avait un air d'intelligence et de courage qui me frappa. Je prenais plaisir à causer avec lui.
—Vous me parlez d'alliés; je n'en veux pas, répondis-je; les alliés se payent et je suis pauvre.
—Vous n'êtes pas pauvre d'amour, señorita, puisque vous venez jeter toutes vos économies dans le fleuve; et un peu de monnaie suffirait.
Je souris, sans être offensée. Cette plaisanterie était un hommage.
—J'ai peur de l'amour comme du travail, monsieur.
—Alors vous avez raison, señorita; vous n'êtes bonne à rien sur la terre; je vous fais mes adieux et j'assiste à votre départ.
Ce persiflage me provoquait à la riposte.
—C'est un plaisir cruel, monsieur, que d'assister à l'agonie, à la mort d'une jeune fille; puisque vous avez promis de ne pas me sauver, continuez votre chemin.
—C'est précisément pour être bien sûr que vous ne vous sauverez pas que je reste, dit le jeune homme sur le même ton. Si le Mançanarez ne veut pas de vous, j'ai un autre genre de suicide à vous proposer.
—Quel est-il? Nommez-le tout de suite. Je le préférerai peut-être.
—C'est le mariage!
—Monsieur, vous vous moquez de moi.
—Dieu m'en garde, señorita, puisque je m'expose à être pris au mot.
—Le mariage, dites-vous, et c'est vous sans doute...
—Oui, señorita, c'est moi qui me porte en concurrence avec le Mançanarez! Oh! je le vaux bien, pour la pauvreté!
—C'est possible, répondis-je avec un peu de gaieté; mais vous ne me briserez pas la tête et vous ne me débarrasserez pas de ma misère.
—Peut-être!
—Comment?
—Tenez, señorita, reprit le jeune inconnu, je ne vous connais que depuis cinq minutes; je ne vous ai jamais vue, et je puis même convenir qu'en ce moment encore je vous vois fort mal. Eh bien, je crois que le hasard, la Providence, si vous voulez, nous a mis sur la route l'un de l'autre. Vous avez de l'ambition et moi aussi; vous avez de la fierté, je ne suis pas d'une humilité parfaite; vous êtes pure, moi je me souviens avec plaisir que je l'ai été. Associons-nous honnêtement, en mariant nos deux misères. J'ai du pain, c'est déjà beaucoup; j'aurai quelque chose de plus dans quelque temps, car je travaille, soit dit sans reproche, et la politique me fait de belles promesses. Consentez, ou du moins réfléchissez.
Il y avait dans cette brusque déclaration une allure romanesque qui me plaisait. Je n'avais jamais aimé et je ne sentais rien en moi qui pût m'assurer que j'aimerais ou que je pourrais aimer cet inconnu, mais son esprit, sa résolution prompte me tentaient. Et puis, en définitive, le Mançanarez était toujours là, à quelque distance de Madrid; il ne fallait pas une heure pour s'y rendre; je restais toujours libre de m'y jeter mariée, aussi facilement que je me fusse noyée jeune fille. Mes instincts de joueuse s'éveillèrent. C'était un jeu que me proposait cet inconnu, un jeu de grand hasard sans doute. Mais j'aurais eu horreur de la vie arrangée mesquinement, d'un mariage prosaïque. A vrai dire je n'avais jamais songé au mariage. Si j'avais pu traverser la vie, m'y mêler, comme une amazone, seule, sans amour, vierge de tout sentiment, j'eusse repoussé bien loin toute proposition de mariage, toute parole d'amour. Mais j'avais conscience de ma faiblesse sociale qui raillait si cruellement mon ambition, et je me disais que ce jeune homme était peut-être un ami, un partenaire prédestiné.
Pourtant je ne voulus pas faire céder ma résolution devant des paroles. Je pris encore le hasard pour arbitre. J'avais au cou une médaille bénite. Je l'ai encore, elle ne m'a jamais quittée. Je l'enlevai rapidement.
—Monsieur, dis-je à l'inconnu, permettez-moi de me recueillir avant de vous répondre.
Il salua et s'éloigna de quelques pas.
Je tenais et je retournais la médaille en question dans ma main:—Si c'est l'effigie de la madone que j'aperçois d'abord, je refuse, me dis-je intérieurement, si c'est la légende, j'accepte!
Mon cœur battait. Je n'osais pas prier. J'ouvris la main toute grande; la lune qui mit un rayon sur la pièce me fit lire distinctement le verset de psaume qui y était gravé. J'avais perdu; du moins j'interprétais ainsi le sort.
Je m'avançai vers le jeune homme.
—J'accepte, monsieur, lui dis-je, en principe, l'offre que vous m'avez faite.
—En principe?
—Oui, je me réserve d'y renoncer si les détails d'application laissaient quelque chose à désirer.
—C'est-à-dire que dans le cas où vous découvririez que je suis un coquin, un aventurier et que je vous ai indignement trompée, vous en reviendriez à votre première idée.
—Vous avez de la pénétration, repris-je en riant. Oui, vous dites vrai, je suis fiancée avec le Mançanarez et avec vous dès ce moment.
—Je ne crains pas mon rival, dit l'inconnu.
—Revenons à Madrid; ma mère doit être inquiète.
Le jeune homme m'offrit son bras avec respect, s'abstint pendant la route de toute espèce de propos galants, et se conduisit comme s'il eût eu la reine d'Espagne à son bras. Comme nous rentrions dans la ville par la porte de Ségovie:
—Vous ne m'avez pas demandé mon nom? dis-je à l'inconnu.
Il sourit.
—C'est une façon indirecte de me demander le mien, señorita. Je me nomme Alonzo Mendez.
—Mais je vous connais, monsieur, vous avez un nom déjà célèbre.
En effet, M. Mendez s'était acquis par la littérature et par la politique un commencement de réputation; c'était un journaliste honnête, habile, ambitieux, qu'on redoutait pour sa raillerie, qu'on estimait pour sa probité, mais qu'on n'aimait pas. Mon père, qui avait des opinions de soldat, c'est-à-dire très-hostiles aux hommes de plume et d'intelligence, s'était exprimé plusieurs fois sur le compte de M. Mendez avec une brutalité qui me revint en mémoire et qui m'avait rendue parfois très-curieuse de connaître cet écrivain tant discuté.
Ma mère était rentrée, et était dans une horrible inquiétude. En ne me trouvant plus au logis, elle n'avait pas pensé au suicide; mais elle avait cru que ma répugnance pour le travail et mes goûts de luxe et d'indépendance m'avaient emportée pour jamais loin de sa pauvre chambre. Elle priait et pleurait quand je frappai.
—C'est toi, Dolorida? demanda la pauvre femme d'une voix étranglée par les larmes, à travers la porte:
—Oui, c'est moi, ouvrez, ma mère.
Elle fut surprise de me trouver en compagnie d'un jeune homme; mais il y avait tant de convenance et de dignité dans l'attitude de M. Mendez, je portais le front si haut, que ma mère eut un cri de joie.
—Merci, mon Dieu! dit-elle en joignant les mains; j'avais calomnié mon enfant. D'où viens-tu donc, Dolorida?
J'allais avouer que je revenais du Mançanarez, quand je compris que ma fuite avait été bien cruelle et bien ingrate; je ne voulus pas ajouter une douleur aux tortures que ma mère avait subies.
—Je viens de chercher un mari, répondis-je en souriant. Ma mère, je vous présente M. Alonzo Mendez, qui sollicite l'honneur d'entrer dans notre famille.
—Qu'est-ce que cela veut dire? demanda ma mère en fronçant le sourcil.
—Rien que la vérité la plus exacte, reprit M. Mendez en s'inclinant. Au surplus, c'est assez que la première rencontre ait eu lieu ce soir; je me borne à vous prier, madame, d'autoriser des visites dont vous connaissez le but loyal.
Ma mère ne savait trop que permettre; elle autorisa la recherche de M. Mendez; et quand il fut parti, elle voulut savoir dans les plus grands détails tout ce qui s'était passé. Je fis ce récit.
—Hélas! dit ma mère quand j'eus fini, tu as un orgueil qui t'a sauvée aujourd'hui, qui demain peut-être te perdra.
—Me perdre! repartis-je avec éclat. Si vous entendez par ce mot la vie avec la honte, je puis vous assurer que je ne cours aucun danger; si vous voulez parler de la mort, il est possible, en effet, que je me perde, un jour ou l'autre.
—Dolorida, reprit ma mère, je ne te demande qu'un serment: jure-moi sur le Christ, jure-moi sur ton salut éternel que si tu épouses M. Mendez, tu lui seras fidèle et que tu resteras jusqu'à la fin une honnête femme.
—Je le jure, dis-je en levant la tête: si j'épouse cet honnête homme, je vivrai comme une honnête femme; si je me trompe, je jure de mourir plutôt que de déchoir à mes yeux.
—C'est assez, mon enfant; tu ne mens pas et tu ne mentiras jamais; j'accepte la caution de ta franchise.
Je n'aimais pas M. Mendez. J'avais été surprise de sa rencontre; j'avais été touchée de ses offres; mais je ne ressentais pas pour lui cette affection enthousiaste qui doit être l'amour. Il revint le lendemain; je le retrouvai, comme la veille, poli, discret, doucement ironique. Il m'expliqua sa vie; au bout de quelques jours, il me laissa comprendre que ce n'était pas non plus pour obéir à l'entraînement d'une passion irrésistible qu'il m'avait demandée en mariage. Ambitieux et résolu à parvenir, il s'effrayait parfois de se trouver seul dans la mêlée. L'idée d'une compagne lui était venue, comme l'idée d'une alliance pour son cœur et pour son esprit. Mais il ne voulait donner son nom qu'à un caractère éprouvé, qu'à une conscience droite. Il s'était dit au premier aspect que j'étais sans doute tout cela, et il m'avait fait la singulière proposition que je vous ai rapportée, encouragé surtout par l'étrangeté de la rencontre et par la solennité de l'heure.
Je sus gré au journaliste de sa confiance. Un grimacier de paroles galantes m'eût fait horreur. Ce prétendant de sang-froid, qui m'estimait, me parut un homme digne d'estime. Après une semaine de visites, je consentis, ou plutôt je ratifiai mon premier consentement, et, un mois après ma rencontre au bord du Mançanarez, je me mariai.
M. Mendez était modeste quand il parlait de sa pauvreté. Comparée à la nôtre, sa misère était relativement du luxe. J'entrai dans un appartement convenablement meublé: j'atteignis tout d'un coup à une espèce de rang. Les relations de mon mari, en attirant chez lui des hommes politiques, me permettaient de faire les honneurs d'un salon. J'eus un jour de réception; je sus bientôt dire mon mot sur les événements quotidiens, sur les crises ministérielles; et plus d'un pronunciamento s'écrivit sur mon guéridon. J'étais naturellement entourée d'hommages. Quelques-uns même prirent un accent assez tendre pour que j'eusse le droit de les repousser et de m'en moquer.
Quand nous nous retrouvions seuls, mon mari et moi, nous nous amusions de ces galanteries. Mendez me conseillait de ménager celui-ci, de rudoyer impitoyablement celui-là. Bien assuré de mon honneur et de ma loyauté, mon mari voulait que j'eusse de la prudence dans la vertu, et que sans m'exposer personnellement, je n'exposasse pas tout à fait son influence.
Ce petit calcul me fit sourire d'abord; peu à peu il me donna quelque impatience; car je le retrouvais partout et sous toutes les formes, et c'est ici l'occasion de définir M. Alonzo Mendez et d'apprécier au juste le bonheur et la paix de mon ménage.
Mon mari était ambitieux, sans lâcheté; il n'avait pas fait sur ma beauté d'ignobles calculs, et je crois qu'il était aussi honnête qu'un homme peut l'être; mais il avait pensé qu'une femme jeune et se révélant à ses côtés l'aiderait sans doute à faire meilleure figure dans le monde et lui donnerait un prestige que son talent et son esprit ne suffisaient pas toujours à lui garantir. Il avait peut-être cru trouver en moi la promesse d'une de ces muses de la politique qui savent embellir les questions de portefeuille et idéaliser par un sourire le trafic des votes électoraux; car il est bien évident que la probité de M. Mendez ne l'empêchait pas de manœuvrer, selon l'usage, dans l'intérêt de son parti.
Quoi qu'il en fût de tous les calculs décents et avouables, après tout, de mon mari, il est certain qu'il m'avait épousée pour plusieurs motifs, parmi lesquels l'amour n'entrait pour rien. Je ne dis pas qu'une pitié, qui lui fit illusion, ne lui suggéra pas ses premières paroles, et qu'une fois engagé, il ne voulut pas reculer. Ce que je tiens à bien vous faire comprendre, c'est que notre intimité fut douce, mais resta froide; que je n'eus jamais le pressentiment d'une tendresse plus vive que la reconnaissance; et que lui, de son côté, courtois, affable, égal, ne fit jamais un effort pour me donner ou pour se donner à lui-même les illusions de l'amour.
Notre mariage avait été un mariage de curiosité réciproque, de défi loyal et chevaleresque; notre ménage fut dans les premiers temps un échange d'estime.
Ah! Dieu vous préserve d'estimer quelqu'un, mesdames! et vous, messieurs, Dieu vous préserve d'être seulement estimés! Rien d'horrible pour une âme jeune, ardente, neuve, comme la mienne, que cette estime qui coupe les ailes à tout enthousiasme, qui fait vivre loin du ciel, sur le terrain battu où tout le monde marche. Je suis née pour les passions. L'influence de mon père, les douleurs de ma mère m'avaient fait comprendre les orages, et m'en avaient préservée; mais j'avais au fond de l'âme un besoin d'ivresse, d'émotions, que les devoirs de la vie mondaine irritaient jusqu'au dégoût. Ce terre-à-terre élégant, ce petit vol à mi-côte, ces ambitions subtiles que je voyais se machiner et s'écrouler à côté de moi, commencèrent par me distraire et finirent par me lasser. Au bout d'un an, dans la position la plus enviée, épouse d'un mari qui faisait son chemin et qu'on désignait comme un des futurs orateurs de la nouvelle chambre; mais épouse sans enfants, condamnée à l'oisiveté, m'ennuyant des livres qui m'affamaient sans me rassasier, j'étais plus malheureuse que la nuit où j'étais allée fièrement m'offrir à la mort.
M. Mendez était trop intelligent, trop perspicace pour ne pas s'apercevoir de cette disposition; il m'en parla franchement, doucement, comme un médecin qui cause avec sa malade.
—Vous vous ennuyez? me dit-il.
—C'est vrai.
—Mais que voulez-vous de moi?
—Rien. Je préfère mon ennui à toutes les distractions que vous pourriez m'offrir.
M. Mendez souriait tristement, m'accusait d'être une mauvaise tête, allait à ses affaires et me rapportait une loge pour le théâtre, un livre nouveau; quelquefois, quand il était le plus mal inspiré, une parure, un bijou que je jetais dans un coin.
Je vous raconte mon cœur, je ne prétends pas vous l'expliquer ni vous en déduire logiquement les raisons et les principes; ce que je sais, c'est que j'avais en moi un volcan qui s'exhalait en fumée et qui voulait se répandre en lave, et que, me débattant dans cette implacable prison des convenances mondaines, j'aspirais après je ne sais quelle liberté turbulente dont il m'était impossible de dire le nom.
Je me confesse et je dois tout dire: j'eus des tentations; quelquefois je m'approchais de l'abîme pour en mesurer la profondeur et je me demandais si le désordre, en me faisant oublier, en m'enlevant à la régularité de la vie, ne me rendrait pas plus heureuse; mais ces faiblesses passaient vite. Je mettais mon point d'honneur à garder le serment que j'avais prêté. J'avais juré d'être une honnête femme et de rester fidèle à M. Mendez; je n'ai pas failli à cet engagement, je n'ai pas même songé sérieusement à y manquer.
Mon mari fut nommé député; sa fortune financière, secondée par sa fortune politique, s'était accrue; les modestes réceptions que j'avais présidées jusque-là devinrent des soirées élégantes où l'on entendit des artistes, où l'on joua.
La première fois que je vis dresser une table de jeu, un frisson m'agita; quand j'entendis remuer de l'or, j'eus un éblouissement et je pensai à la mort de mon père. M. Mendez crut remarquer en moi de la répugnance pour ces distractions:
—Il le faut bien, me dit-il, le monde devient un tripot; je vous ai fait votre caisse de jeu, Dolorida, il est convenable que vous présidiez.
—Prenez garde! monsieur, lui dis-je, moitié riant, moitié épouvantée, je suis la fille d'un joueur.
—Oh! je connais votre volonté! D'ailleurs, la femme de M. Mendez a trop le sentiment de l'honneur pour faire jamais d'un plaisir un vice et d'une distraction une passion.
Quand on en appelait, dans ce temps-là, à ma fierté, on était toujours sûr de me convaincre. Je m'imaginai, en effet, que le jeu serait sans danger pour moi, et ne voulant pas me redouter moi-même plus que ne me redoutait mon mari, je laissai jouer, ou plutôt je commençai à faire jouer chez moi.
Ces parties, forcément contenues par le monde, circonscrites d'ailleurs dans leur durée, me mirent en appétit sans me corrompre, et elles eussent été sans péril si tout s'était borné aux tables de jeu qu'on dressait et que je présidais chez moi.
Rappelez-vous que j'avais dans l'âme, ou simplement dans les veines, une ardeur sans but, une flamme sans aliment; qu'épouse, sans enfants d'un homme que j'estimais seulement, j'avais besoin de vivre, de tromper mon inquiétude, d'aimer enfin quelque chose. La politique m'avait tentée, mais je la trouvai mesquine; la religion m'attira; mais elle ne suffit pas à me consoler de l'inconnu; et la dévotion, exaltée, fiévreuse, qui me faisait courir aux églises, avait une impatience bien éloignée du recueillement. Je ne cherche pas à m'excuser; j'explique les causes d'une indomptable passion. Il me fallait un désordre; la régularité m'étouffait; la vie normale, paisible, m'eût poussée au suicide. J'avais juré de rester fidèle à mon mari; je tins mon serment en trompant l'amour sans cause qui me consumait, et en m'éprenant d'une tendresse folle, insensée, pour les grâces du roi de carreau, du roi de trèfle et du roi de pique.
Il semble que la frénésie du jeu soit une exception dans le cœur de la femme. J'ai reconnu souvent la preuve du contraire. Le jeu est une passion féminine que les hommes nous empruntent. La mobilité des sensations, leur âpreté, la futilité des prétextes qui les font naître, sont des mirages décisifs pour la femme qui fuit l'ennui et qui n'a pas devant elle, pour l'arrêter, quelque infranchissable barrière, comme le berceau d'un enfant.
Je me sentis devenir joueuse, d'abord avec effroi, puis avec un indicible mouvement de triomphe. Je comprenais, au début de cette vilaine passion, que j'avais un tort d'improbité en quelque sorte envers mon mari; puis peu à peu les joies farouches, les terreurs convulsives, les spasmes que donne le jeu, me firent tout oublier, tout méconnaître; je me laissai aller au torrent, au vertige, ne discutant plus avec ma conscience et l'étouffant sous ce sophisme: M. Mendez doit être bien heureux que je lui sois infidèle seulement pour les cartes!
Le jeu du monde ne me suffit bientôt plus. Je veux dire le jeu du monde décent et officiel dans lequel la position de M. Mendez me donnait droit d'entrée et droit de préséance. Je me laissai inviter par quelques femmes de cette société intermédiaire qui sert de transition entre la bonne et la mauvaise société. Dans ces salons, où j'entrai en rougissant un peu et où mon mari me vit aller avec peine, je fis des connaissances qui m'amenèrent à descendre encore plus dans l'échelle des concessions; et, au bout de trois mois, j'avais franchi toute la distance qui sépare le grand monde des tripots les plus suspects.
Vous comprenez que j'abrége. Je ne vous initie pas, détails par détails, à tout ce drame de ma chute. Mon mari, indulgent d'abord pour les distractions qu'il avait autorisées, qu'il avait demandées même, souriait à mes premières ardeurs.
—Si vous abordiez la politique avec cette passion, me disait-il, vous seriez une femme de génie.
Je souriais aussi et je me sentais flattée; j'étais fière de dépenser pour mon plaisir une activité et un talent que je dédaignais d'employer pour mon ambition ou pour ma vanité.
Quand M. Mendez comprit que j'étais entraînée, il eut sans doute des remords, et il me présenta, avec une bienveillance sensée, avec une amitié ferme et respectueuse, des observations qui me firent plaisir en me donnant le sentiment de la peur que mes passions pourraient inspirer. Mon mari devenait riche et ne me mesurait pas l'argent. J'usai de cette faculté; je perdis beaucoup, je perdis trop. M. Mendez alors eut l'imprudence de me parler avec plus d'autorité. Il voulut faire appel à son droit. Il évoqua la nuit de notre rencontre et me convainquit d'ingratitude.
Ces reproches, trop fondés pour être adressés à une âme orgueilleuse, loin de me ramener à la soumission, m'irritèrent et m'affranchirent. L'autorité me contraignit à la révolte; je subissais mal un patronage, une tutelle bienveillante: l'idée d'une lutte me séduisit. Dès ce moment, commença pour moi l'existence horrible, haletante, qui a décidé de mon sort et qui a fini par un double naufrage.
Le jeu est comme l'ivresse: il ne garde pas longtemps des précautions hypocrites, et il faut qu'il s'exerce à la face du ciel. Je ne me contraignis pas, puisque mon mari, le seul qui eût le droit de se plaindre, s'était plaint et ne m'avait pas convaincue. Je fis du jeu mon occupation, ma mission, mon but.
—La société m'ennuie; les intérêts chétifs ou menteurs qu'on y discute me révoltent, disais-je à mon mari. Vos succès d'homme politique ne suffisent pas à me donner l'ivresse. Je suis une créature maudite: j'avais à choisir entre l'exemple de mon père et celui de ma mère. J'ai fait comme le capitaine; mais je tiendrai le serment que j'ai fait à ma mère.
Quelquefois M. Mendez hochait la tête et semblait croire que je m'abaisserais jusqu'à mentir à ce serment lui-même. Ses doutes m'exaspéraient.
—Quand vous m'aurez ruiné et déshonoré, madame, me disait avec un superbe sang-froid M. Mendez, je crois que nous ferons bien de retourner ensemble, bras dessus bras dessous, au Mançanarez.
La ruine, je n'y croyais pas; l'autre déshonneur, je ne pouvais pas le redouter, et je haussais les épaules.
—Ne craignez rien, monsieur, répondais-je à M. Mendez; le jour où vos prédictions sinistres devraient avoir raison, je vous épargnerai une scène pathétique, et vous pourrez porter mon deuil.
Les ressources personnelles devinrent bientôt insuffisantes pour alimenter le jeu. J'eus recours aux emprunts, aux trafics, à la mise en gage, à la vente de mes bijoux, à de petits vols conjugaux. Je connus et je bus jusqu'à la lie cette humiliation d'aller frapper à la porte des usuriers, des complices de nos passions cachées. Je vécus de privations: je n'avais plus le sentiment du luxe, de la toilette; d'ailleurs, je vendais tout à l'occasion et je me contentais d'oripeaux fanés qui eussent rebuté des mendiants. Me reprochant le pain que je mangeais dans le domicile conjugal, je subissais de gaieté de cœur la faim et ses tortures, comme si ces macérations, souffertes par fierté, dussent me rendre la chance favorable! Ah! les superstitions des joueurs, je les ai toutes connues, toutes pratiquées. Des cierges brûlés aux églises, des auspices tirés des moindres incidents, les dates, les chiffres cabalistiques, les jours de telle ou telle semaine, la façon de m'asseoir, de toucher aux dés ou aux cartes, tout prit pour moi une importance énorme. J'allais quelquefois, avec des transports de piété sacrilége, me jeter à genoux devant un crucifix, lui demandant la réussite de combinaisons insensées, et mêlant des actes de foi à d'odieux calculs. On me procura des dés fameux par les gains énormes qu'ils avaient rapportés. J'en fis un chapelet; je devins folle, tant j'adorais réellement les figures peintes sur les cartes; toutes les manies, tous les enfantillages me devinrent habituels.
Ma mère essaya de m'arrêter sur cette pente. Je lui répondis avec vivacité, en faisant allusion aux torts qu'elle avait eus autrefois envers son mari, et que je n'aurais pas envers le mien. La pauvre femme prit un prétexte pour quitter Madrid, et peu de temps après se retira dans une communauté.
Le désordre que cette passion introduisit dans mon ménage, la réputation singulière que j'acquis dans le monde furent un coup sensible, le plus terrible peut-être qu'il put recevoir, pour M. Mendez. Cet homme d'esprit et de bon sens, ambitieux, avait compté que je serais l'élément romanesque, sentimental, poétique de sa vie; mais il s'épouvanta de l'abîme que je creusais sous ses pas. Il craignit de recourir aux moyens extrêmes, d'employer la violence légale; il attendit l'occasion de me faire un piége de ma passion elle-même, et de me sauver par l'orgueil qui m'avait perdue. En conséquence, il s'abstint de tout reproche, il n'essaya pas de lutter, et parut prendre son parti de ma conduite. D'ailleurs, si l'on parlait dans Madrid de ma passion pour le jeu, si la position de mon mari rendait la curiosité plus impitoyable, la médisance me savait et me reconnaissait inattaquable sous d'autres rapports, et l'étrangeté de ce vice, adopté par l'amour exclusif de lui-même, me donnait une sorte de prestige qui n'était pas exempt de consolation pour M. Mendez, et qui me permettait de lever la tête.
Je ne vous fais pas un cours de morale; je n'insisterai donc pas sur les nuits que je passais au jeu dans des maisons que les honnêtes femmes ne fréquentaient sans doute pas et où j'étais peut-être la seule qui n'eût rien autre chose que le jeu en vue et qui allât jouer pour le seul plaisir de perdre ou de gagner. Combien de fois ne suis-je pas rentrée vers l'aurore, pâle, enfiévrée, mais jurant de me venger, concevant des jalousies meurtrières pour un joueur plus heureux que moi! La probité peut résister au jeu, mais la probité de fait seulement. Il y a une improbité d'intention ou de circonstance qui déprave intérieurement le joueur. Je veux dire qu'on se considérerait comme un lâche de tricher manifestement, mais qu'on pactise volontiers avec certaines exigences; et celui qui se met devant un tapis pour courir la chance de perdre ce qu'il n'a pas, en essayant de gagner à un autre ce qu'il a, suscite une lutte inégale pour son adversaire, trop avantageuse pour lui-même, et manque évidemment à l'honneur étroit, à l'inflexible probité.
Tous ces beaux sentiments, toutes ces belles sentences me sont revenues depuis à l'esprit. A cette époque, je n'analysais pas philosophiquement mes sensations. Je jouais, sans vouloir penser à autre chose qu'au jeu.
L'hiver dernier, le carnaval fut brillant à Madrid. Jamais on ne donna tant de bals, et jamais on n'eut tant d'empressement à s'amuser. Les travestissements surtout, les travestissements rigoureux, furent à la mode, et l'on remit en honneur l'habitude de se masquer et le respect des masques. Il suffisait que le maître de la maison sût à peu près à quoi s'en tenir sur l'identité des personnes, pour que les conviés eussent le droit absolu de s'habiller et d'agir à leur aise et à leur fantaisie.
J'allai dans le monde. Mon mari fut d'une docilité charmante pour m'y conduire, et d'une complaisance plus grande encore pour m'y laisser longtemps, toutes les fois qu'il put constater que je ne m'y ennuyais pas. Mes moyens de combattre l'ennui, pour n'être pas variés, n'en étaient pas moins très-infaillibles: je jouais.
Une nuit, le duc de R... donnait une grande fête, d'autant plus superbe, qu'il s'agissait de dissimuler des intrigues électorales et de faire danser les invités sur le petit volcan d'une crise ministérielle. Mon mari était un homme politique trop important pour ne pas assister à ce bal, et il tenait trop à cacher le motif de sa présence pour ne pas m'y amener. Le costume était obligatoire. Je me souviens que j'étais déguisée en bohémienne et que j'avais des sequins d'or dans les cheveux.
—Prenez garde, me dit, avec un peu d'ironie, M. Mendez au moment de monter en voiture; n'allez pas jouer toute votre parure.
J'essayai de rire.
—Vous êtes une énigme, monsieur, répondis-je, et il y a des moments où je ne sais pas au juste si je dois me réjouir ou m'offusquer de votre façon d'agir.
—Señora, je suis un mari modèle, repartit d'un ton singulier M. Mendez.
Mon mari était costumé en officier du temps de Philippe II. Il portait une petite dague suspendue à son pourpoint de velours noir.
—Vous êtes tout à fait beau et terrible dans cette toilette, lui dis-je.
—N'est-ce pas? j'ai l'air farouche. Voici le poignard pour me venger de l'infidèle.
J'éclatai de rire, mais je trouvai un insupportable accent de malice à mon époux. Nous nous masquâmes en montant l'escalier du duc de R..., et après quelques tours dans les galeries où l'on dansait, M. Mendez dégagea doucement mon bras du sien, me salua et me dit:
—Je reconnais là-bas le futur président du conseil; j'ai à lui parler. Permettez-moi de vous laisser libre, Dolorida.
Vous comprenez, n'est-ce pas, que le premier usage que je fis de ma liberté fut d'aller vers la salle de jeu. Sur le seuil, j'ôtai mon masque; on me reconnut. Je trouvai là des amies, des camarades des deux sexes que je rencontrais un peu partout; chacun avait fait comme moi, et il n'y avait pas d'incognito pour les joueurs.
Une demi-heure après mon arrivée, j'étais engagée dans une furieuse partie de lansquenet, et j'avais déjà gagné une somme formidable. Je remuais avec dédain le tas d'or que j'avais devant moi, et je trouvais pourtant à ce bruissement une harmonie délicieuse.
—Qui veut jouer tout cela? demandai-je d'un ton superbe de défi, mais avec le secret désir de n'être point prise au mot, et de pouvoir conserver, pour réparer des brèches toutes récentes, ce gain prodigieux, devenu bien rare depuis quelques semaines.
Un domino noir, qui était debout devant la table et qui me regardait jouer depuis quelques instants, répondit:
—Je tiens le jeu.
Je tressaillis; non pas que la voix de cet inconnu, dissimulée et dénaturée par le masque, me rappelât rien, mais parce que, précisément depuis qu'il était arrivé, ce domino m'inquiétait et me troublait. Les joueurs ont des pressentiments. Sans savoir au juste qu'il lutterait directement avec moi, je redoutais dans ce domino un adversaire neuf pour la veine, et par conséquent plus dangereux pour moi que ceux que j'avais déjà vaincus.
—Vous tenez tout cela? balbutiai-je.
—Tout, dit l'inconnu.
—Eh bien, alors, j'attends que vous mettiez votre enjeu.
J'avais remarqué, en effet, que le domino ne se pressait pas d'avancer son argent.
—Je joue sur parole, reprit mon adversaire.
Je respirai et je souris; j'étais bien libre de ne pas m'exposer avec un masque qui ne payait pas d'avance. Un petit murmure avait accueilli la réponse du domino.
—Nous jouons à visage découvert, monsieur, dit un de mes voisins; et si madame veut vous faire crédit sur votre mine, il faut au moins qu'elle puisse la voir.
—Oh! madame me connaît bien, dit l'homme masqué.
Je me sentis frissonner; pourtant je voulus faire bonne contenance:
—Je vous connais, dites-vous? Je ne crois pas.
—Est-ce que la señora Dolorida a oublié le capitaine Lopez?
Les cartes que j'avais prises s'échappèrent de ma main; j'eus peur. Cet homme, que j'avais vu couvert du sang de mon père et qui m'était apparu un jour comme le châtiment, revenait-il pour exiger de moi une expiation? Devais-je bien réellement acquitter la dette paternelle? Est-ce que pour moi aussi l'heure solennelle avait sonné? Pour les joueurs, il n'y a rien d'insignifiant ni d'ordinaire dans la vie. Ils sont superstitieux jusqu'à la puérilité.
Don Juan était surtout un fat et un voluptueux; à ce titre, les émotions violentes lui plaisaient, et il a pu recevoir, sans trembler, la statue du Commandeur. Si don Juan avait seulement été un joueur, il se fût évanoui au premier coup frappé à sa porte, et il fût mort en apercevant son convive.
Tout le monde autour de moi me regardait et s'étonnait de mon émotion; je voulus échapper à ce spectacle et me roidis de toutes mes forces.
—Certes, répliquai-je, je connais le capitaine Lopez, et nous avons, je crois, un compte à régler ensemble.
—Comme il vous plaira, dit le domino.
—Ainsi vous me tenez toute cette somme?
L'homme masqué s'inclina en signe d'assentiment. Je tournai les cartes; elles étaient lourdes à manier. J'étais convaincue que j'allais perdre. En effet, il suffit de cinq ou six cartes pour que j'amenasse celle du capitaine; il avança la main comme pour prendre possession du tas d'or amoncelé devant moi, mais il ne toucha pas à une pièce.
—Je vous offre une revanche, me dit le capitaine Lopez. Puisque nous avons un petit compte, l'occasion est bonne.
Tout le monde entendit cette proposition. Je pouvais parfaitement bien la décliner. Les joueurs ont le droit d'être capricieux. Mais refuser, c'était avouer que je redoutais un échec, c'était entamer la brillante réputation que je m'étais faite par mon audace et par mon impassibilité.
—J'accepte, murmurai-je.
Toutefois, il me parut impossible de permettre à tant de spectateurs de savourer mes angoisses.
—Messieurs, dis-je en essayant de sourire à ceux qui nous entouraient, permettez-nous de rester seuls en tête à tête. C'est la revanche d'un duel que j'ai à demander au capitaine, mais d'un duel sans témoins.
Il paraît que ma voix avait un éclat inaccoutumé; les assistants se regardèrent avec surprise, saluèrent et sortirent sans insister. On respectait les caprices des joueurs. Quand nous fûmes seuls:
—Eh bien, monsieur, que voulez-vous? demandai-je au domino.
—Continuons, s'il vous plaît, señora, la partie commencée.
J'avais un peu d'or sur moi: je fis deux parts, et j'avançai la première.
—Voilà ma réponse, dis-je en m'efforçant de sourire.
Le capitaine avait les cartes, il tailla, et retourna deux cartes semblables: j'avais perdu.
—A mon tour! m'écriai-je, en saisissant les cartes.
Je gagnai le premier coup, je perdis au troisième.
Comme le capitaine, qui s'était assis près de moi, se levait et faisait mine de se retirer:
—Vous ne voulez plus jouer? lui dis-je.
—Puisque vous n'avez plus rien, señora...
—Mais je joue sur parole.
Le masque remua la tête:
—J'avais joué sur parole avec votre père, et vous savez, señora, que mal m'en a pris. Votre père m'a fait banqueroute.
Je me levai, la pâleur de la honte me couvrait le front, la rage de la défaite m'emplissait le cœur. Devais-je fuir, accepter le conseil, la leçon qui m'était si brutalement donnée, ou bien fallait-il relever fièrement, témérairement le défi de cet homme?
Je pris le parti le plus audacieux:
—Monsieur, répondis-je à mon adversaire, je ne vous ai pas donné le droit de m'insulter.
—C'est un droit qui s'est transmis par héritage, dit le masque.
—Il me semble que vous avez plus d'esprit qu'autrefois, capitaine Lopez.
—C'est pour cela sans doute, señora, que je veux jouer au comptant.
—Eh bien, alors, nous ne jouerons pas, dis-je pour l'éprouver, mais bien persuadée qu'après ses insultes le capitaine accepterait sans doute ma partie.
—A moins, reprit le masque, que nous ne reprenions le jeu de votre père, à l'endroit où il l'a si maladroitement interrompu.
—Que voulez-vous dire?
—Je veux dire, señora, que le capitaine m'a fait tort de l'argent que je lui gagnai, parce qu'il n'a pas voulu m'accorder un autre enjeu.
—Je me souviens, en effet, dis-je avec ironie.
—Eh bien, la señora Mendez ne peut-elle relever le défi?
—Quoi! monsieur, vous osez.....
—Oui, señora, repartit le masque, j'ose proposer à la joueuse la plus vaillante de Madrid, une partie, un duel digne de son courage. Fi! l'argent salit les jolis doigts des dames. Je suis convaincu que la clef de votre chambre est un délicieux ouvrage de serrurerie; c'est ce chef-d'œuvre que je veux jouer et que j'espère gagner.
Je ne saurais vous dire quelle sourde et formidable colère s'agitait en moi; j'eus l'idée du meurtre. L'humiliation de cette offre; ce hideux souvenir du dernier jeu de mon père; cette insultante façon de traiter une femme que la calomnie avait du moins épargnée sur un point; la pensée que c'était un châtiment que le hasard m'imposait, tout me révolta, et pourtant tout me décida à ne pas reculer.
—Si j'acceptais, monsieur, que mettriez-vous en balance avec cette clef?
—Hélas! señora, nous autres hommes nous sommes bien forcés de parler d'argent, c'est notre infériorité.
—Ah! quelle horreur! dis-je en riant avec effort.
—Que voulez-vous, señora? ma clef ne vaut pas la vôtre.
—Votre argent, votre or, ne vaut pas non plus ma clef, repartis-je. Ce n'est pas un jeu que j'ai accepté, monsieur, c'est un duel, vous l'avez dit. Je me bats et je ne joue pas. Si je perds, c'est-à-dire si je suis vaincue, vous aurez ce que vous demandez; mais si je gagne, à mon tour, j'exige plus que cet argent qui salit les doigts et qui me laisserait une tache ineffaçable.
—Que voulez-vous donc? demanda gravement mon adversaire.
—Je veux que notre duel soit un duel à mort... Je veux que vous mouriez, si vous êtes vaincu. Faisons un pacte; engagez-vous par serment à vous tuer, sur un mot, sur un signe de moi, si vous perdez; et moi, je m'engage sur mon honneur, sur mon salut éternel, à vous donner cette clef si vous la gagnez.
—Mais la clef n'est qu'un gage.
—Croyez-vous donc que je n'aie pas bien compris, dis-je avec emportement, et est-il nécessaire de me faire penser à cette honte, avant de savoir si j'aurai à la subir? Me promettez-vous, monsieur, sur votre honneur de soldat, d'exécuter loyalement de votre côté l'engagement que vous aurez pris?
—Sur mon honneur de soldat; et aussi vrai que je me nomme Lopez je l'exécuterai.
—Si vous perdez, vous vous tuerez?
—Si je perds, je me tue!
—Bien! moi aussi, dans le même cas je m'acquitterai; mais Dieu ne voudra pas que je perde.
—C'est ce que nous allons voir, dit le capitaine.
Ne me demandez pas quels sentiments m'agitaient. Ce n'était plus le délire, la fièvre: c'était une folie devenue sérieuse, froide; il semblait qu'une volonté fatidique dirigeât mes mouvements. J'avais une lucidité parfaite, une conscience absolue de tout ce que je disais et de tout ce que j'entendais, mais en même temps une résolution irrévocable. Le capitaine et moi nous étions bien condamnés! Si je gagnais, j'étais résolue à le tuer, dans le cas où il aurait voulu se soustraire à l'obligation de son serment. Quant à moi, vous saurez ce que j'avais résolu.
Je pris les cartes. Le hasard voulut que ce fût à moi à commencer. Je tournai, et en six cartes je décidai de mon sort; le capitaine avait gagné. Une sueur glaciale me mouilla le front; je devais être livide.
—Eh bien! me demanda le domino.
—Eh bien, monsieur, j'ai perdu et je payerai, dis-je.
Je crus entendre un éclat de rire dissimulé. Ma fierté ne put tenir à cet outrage.
—Otez donc votre masque, m'écriai-je, que je puisse voir le visage d'un homme qui rit lâchement du désespoir d'une femme.
Le domino dénoua lentement les cordons et jeta sur la table le masque détaché. Je poussai un cri! j'étais victime d'une cruelle plaisanterie; j'avais joué avec mon mari.
—Vous! monsieur, c'est vous, murmurai-je avec stupeur. Ah! c'est infâme.
—Je ne sais pas, señora, si vous devez vous plaindre de n'avoir point eu affaire au capitaine Lopez; mais avouez que, pour ma part, j'ai bien quelque raison de m'en féliciter.
—Vous, monsieur, descendu à ce misérable espionnage!
—Oui, c'est moi, qui n'abuserai pas, bien entendu, de ma victoire. La partie est nulle, señora; vous ne serez pas contrainte à payer; nous avons joué pour l'honneur, et il me suffit que vous ayez perdu.
Mendez, en parlant ainsi d'un ton dégagé, s'était assis devant moi et me regardait avec raillerie.
Je fus pendant quelques minutes accablée; la colère me rendait muette. Je m'étais prise à un piége grossier, j'avais donné le droit à mon mari de me mépriser.
—Eh bien, señora, reprit M. Mendez, qu'en pensez-vous?

—Je pense, monsieur, que vous avez agi déloyalement, et qu'il n'est guère généreux de vous targuer d'une victoire qui vient d'une embûche.
—Oh! je suis modeste, señora, je sais bien que vous n'auriez pas consenti à perdre avec moi ce que vous avez perdu avec le capitaine Lopez.
—Mais, demandai-je, comment avez-vous eu l'idée de cette comédie?
—Je vous expliquerai cela plus tard, señora, quand vous serez tout à fait remise de votre émotion. Vous m'aviez raconté autrefois l'aventure du capitaine Lopez; j'ai pensé que le carnaval autorisait la supercherie à laquelle j'ai eu recours; vous-même, m'avez aidé, en voulant bien me laisser croire que vous ne reconnaissiez pas le son de ma voix.
—Après tout, repris-je en relevant la tête et en regardant mon mari en face, comme vous le disiez, tout est pour le mieux; j'ai eu une fausse peur, voilà tout, et vous aussi, car je n'aurais pas exigé votre mort, en cas de gain.
—Vous auriez peut-être eu tort, señora, dit gravement mon mari, c'eût été une revanche complète; mais je vous fais mon compliment, vous êtes une joueuse exacte, et je ne doute pas que vous n'eussiez remis au capitaine la fameuse clef qu'il avait gagnée.
—Je l'aurais remise, monsieur, mais j'aurais fait comme Lucrèce, je serais morte après avoir payé.
—Oui, le Mançanarez! Il n'a guère plus d'eau aujourd'hui qu'autrefois, et ses bords ne sont pas assez solitaires pour qu'on puisse s'y jeter sans être vu.
—Vous abusez de votre triomphe, monsieur.
—Je n'abuse de rien, mais j'use et je prétends user. Écoutez-moi, señora, continua mon mari après une pause: Quand vous avez consenti à porter mon nom, à devenir la femme d'un homme pauvre, mais ambitieux, je ne vous ai pas posé de condition, je vous ai seulement demandé de m'être fidèle; vous avez fait à cet égard les plus solennels serments; je n'en demandais qu'un et je me suis contenté de votre parole. Je ne vous reprocherai pas l'ennui, la lassitude que notre ménage vous a procurée, la faute en est peut-être à moi; j'avais compté sur l'énergie, sur le conseil, sur l'inspiration d'une compagne ambitieuse comme moi, fière comme moi, associée à mes efforts; je me suis trompé et je ne peux pas vous accuser de mon défaut de perspicacité. Vous avez cherché dans les cartes, dans les dés, dans tous les jeux des émotions factices, pour suppléer à celles que le devoir et la vie ne savaient pas vous donner; vous avez gaspillé le fruit de mon travail, joué, perdu pièce à pièce, tout ce que je gagnais péniblement. Quand je vous ai avertie de prendre garde aux tripots que vous fréquentiez et à mon nom que vous emportiez là-bas, vous m'avez répondu fièrement que je devais m'estimer bien heureux de vous voir ce vice-là, qu'il vous préservait d'un autre; il m'a bien fallu accepter ce bonheur relatif; mais je croyais à votre bonne foi, sans croire à ses effets, et je tenais à vous prouver qu'involontairement, en vous mentant à vous-même, vous m'aviez menti. Le jeu ne pouvait pas garder longtemps mon honneur: si j'avais été le capitaine Lopez, dites-moi, madame, ce que fût devenu votre serment?
—J'étais vaincue, écrasée; je pouvais pourtant me défendre; je pouvais, en recourant aux subterfuges, dire à mon mari que je l'avais reconnu et que j'avais joué la comédie de cette partie sérieuse pour le punir; mais c'eût été m'avilir par un mensonge. Je pouvais, avec plus de raison, lui reprocher le piége véritable qu'il m'avait tendu; sa mise en demeure signifiée au nom de mon père, ce défi jeté à la superstition du jeu. Mais non, j'avais reçu une atteinte directe dans ma fierté; j'avais été surprise en flagrant délit de félonie conjugale, je n'avais plus le droit de me vanter de mon serment; j'étais une parjure. Quel parti, monsieur, prétendez-vous tirer de vos avantages, demandai-je froidement à mon mari?
—Je n'en demande qu'un: l'aveu sincère que vous êtes dans votre tort.
—J'ai déjà fait cet aveu. Après, qu'en conclurez-vous?
—Vous avez trop de raison, trop de logique pour ne pas comprendre qu'ayant mal usé de votre liberté, il est de bon goût de consentir à quelques restrictions.
—Ah! c'est la tyrannie que vous voulez obtenir de moi.
—Je reconnais bien là le langage de l'opposition, dit en riant M. Mendez. Je suis un défenseur du régime constitutionnel et des libertés tempérées. Est-ce que j'ai des allures de Barbe-Bleue?
—Si je me soumets, si je m'incline sous votre tutelle, que ferez-vous de moi, monsieur?
—J'essayerai d'en faire une femme du monde intelligente et noble, ayant l'ambition des idées et n'ayant plus l'ambition des cartes; se passionnant pour le devoir, pour les intérêts du ménage.
—Je vous arrête à ce mot, dis-je à mon mari, je ne me passionnerai jamais pour vos candidatures ministérielles et pour vos ambitions parlementaires.
—Alors, madame, si j'échoue, vous redeviendrez libre de chercher le capitaine Lopez pour acquitter la dette paternelle; j'aurai fait mon devoir.
—Je serai libre, dites-vous?
—A coup sûr, libre jusqu'au Mançanarez, et au delà.
—Vous raillez, monsieur; mais je ne resterai pas au-dessous de votre bonne humeur. J'accepte, mais je jure bien.....
—Oh! ne jurez pas, dit mon mari; les serments vous portent malheur.
Je soupirai, je courbai la tête sous cette dernière épigramme. Je voulais être belle joueuse et ne pas chicaner la chance mauvaise.
—Allons, monsieur, si vous n'avez plus à vous travestir, sortons du bal.
—Pas avant d'y avoir figuré avec vous, señora, reprit ironiquement M. Mendez.
Je me levai et donnai le bras à mon mari.
Il était resté sur le tapis vert un monceau d'or, toute la somme gagnée d'abord et perdue par moi.
—Vous n'emportez pas votre gain? dis-je à M. Mendez.
—Cet argent-là n'est pas à moi, il est au capitaine Lopez; vous ne l'auriez pas risqué contre votre mari.
—Est-ce que le capitaine est ici?
—Non, et vous avez raison, il vaut bien mieux que j'emporte ces restes, trop abondants pour les valets.
Je souris à la pensée que cette somme considérable allait entrer vertueusement dans le ménage, et que, voulant me faire perdre, M. Mendez m'avait fait gagner.
Il devina le sens de mon sourire.
—Señora, nous irons demain matin déposer dans le tronc des pauvres cet argent qui n'a pas de propriétaire légitime.
La dernière leçon que me donnait mon mari avait son mérite. Il n'était pas indifférent à notre budget d'accepter ou de repousser cette somme; l'héroïsme de M. Mendez me toucha.
—Vous vous vengez trop! lui dis-je, et vous allez me donner des remords.
—Je manquerais mon but, Dolorida; je ne veux que vous donner des regrets.
Si l'amour avait été possible entre nous, cette minute eût décidé de ma destinée; mais je ne dépassais jamais l'estime dans mes élans de ferveur conjugale, et d'ailleurs j'emportais un vif ressentiment.
Débarrassé de son domino, mon mari me donna le bras et se promena quelque temps à travers le bal; puis nous rentrâmes, sans que le long de la route, un mot, un reproche, ou une tentative de réconciliation eût remué les douloureuses réflexions que chacun de nous portait en soi.
En rentrant, M. Mendez laissa tomber le petit poignard qu'il portait à sa ceinture et qu'il avait détaché.
—Vous avez manqué à l'obligation du costume, monsieur, m'empressai-je de lui dire. Ce poignard vous fait un reproche. Il fallait tuer l'infidèle.
—Je suis un jaloux du dix-neuvième siècle dans un déguisement du temps du duc d'Albe, répondit mon mari: la ruse m'était aussi recommandée.
—Allons! vous prévoyez tout et vous répondez à tout.
J'allai m'enfermer dans ma chambre; j'avais hâte de me trouver seule. En posant la main sur cette fameuse clef symbolique de mon appartement, je tressaillis et je pensai que je serais morte s'il eût fallu remplir l'engagement pris envers le capitaine Lopez.
Ce que j'éprouvais ne saurait se définir en un mot, à moins que la colère ne serve à désigner et à résumer les sensations multiples et confuses. Oui, je débordais de fureur: fureur contre moi, qui m'étais prise à un piége; fureur contre mon mari, qui m'avait exposée à une humiliation; fureur contre le jeu, et contre la vie plate et régulière qui ne pouvait fournir d'aliment à l'activité de mon cœur. Si le suicide ne m'eût pas semblé une lâcheté et l'aveu solennel que je me déclarais vaincue, j'aurais été, non pas me jeter dans ce fleuve lointain qui m'avait refusée déjà une fois, mais chercher un poignard ou du poison.
Mais la mort ne tente pas les véritables joueurs. J'avais voulu me tuer quand je ne voulais plus jouer; maintenant, le problème de ma vie m'intéressait, me donnait une âpre curiosité. Je résolus de lutter d'abord contre moi, puis, si je me sentais invincible, de retourner mes armes contre mon mari, ou plutôt contre l'existence nouvelle qu'il voulait m'imposer.
Oui, je luttai contre moi. J'essayai de reprendre au démon du jeu ce cœur qui ne pouvait se rassasier ni du ménage, ni de la politique, ni des hommages vulgaires.
J'imaginai d'aimer mon mari; c'était m'y prendre un peu tard. L'estime froide que j'avais professée pour lui jusque-là ne donnait guère de prétextes à une passion, et lui-même ne m'aida pas dans cette tâche. Je pensai que la religion étoufferait, noierait cette fièvre sans but et sans cause: je fréquentai les églises, je me livrai aux pratiques les plus minutieuses; mais je n'étais pas d'une nature mystique. Il y avait en moi une ardeur des veines que les rosées divines n'éteignaient pas.
Je n'essayai même pas de m'intéresser à la politique. J'eusse volontiers conspiré; j'aurais joué à l'ambition, si l'enjeu eût valu une couronne au vainqueur, ou l'échafaud au vaincu. J'aurais suivi un bandit dans les montagnes, et mâché les balles pour un partisan. J'avais en moi une force, une énergie qui eût convenu également à l'héroïsme et au brigandage! Mais la compagne d'un député constitutionnel devait faire trop de chemin pour rencontrer un héros ou un bandit. Les exploits d'antichambre ministérielle ne pouvaient me ravir.
Les soins du ménage, quand je m'efforçais d'en faire un calmant, me semblaient un suicide. J'étais trop fière de souffrir, trop fière de ces élans qui m'égaraient dans le vague pour préférer le repos absolu d'une ménagère! Quelles tortures! quel invincible ennui j'eus à combattre! Le jeu laisse dans le souvenir de ceux qu'il a corrompus une soif d'acides, un besoin d'émotions rapides qui me manquaient toujours.
Quand je vis que je ne pouvais me vaincre et que j'avais assez lutté contre moi, je songeai à mettre M. Mendez en mesure de tenir sa promesse et à lutter contre lui.
Il ne me laissa pas le temps de lui confesser l'état de mon cœur.
—Vous avez bravement et loyalement combattu, madame; mais je vois bien que vous ne suffirez jamais à vous guérir.
—Alors, monsieur, que prétendez-vous pour ma guérison?
—Le jeu était la distraction forcée du ménage; quand vous étiez enfermée dans les tristes devoirs conjugaux, vous remplaciez la liberté absente par un mouvement fébrile. Je vous rends la liberté. Je fais plus, je vous l'impose.
—Que voulez-vous dire?
—Hélas! j'aurais peut-être agi plus sagement pour votre repos en ne contrariant pas votre résolution lugubre, la nuit de notre rencontre. J'en parle sans crainte, parce que je sais qu'il n'y a plus de danger. Mais je veux réparer autant qu'il est en moi cette maladresse. Vous êtes libre, à partir de cette heure, libre de me quitter, d'agir de toutes façons, excepté sur un seul point: vous n'êtes plus libre de rester avec moi.
—Alors vous me chassez!
—Dieu me préserve d'une pareille violence. J'avais pris sur vous des droits que j'abdique. Nous nous rendions réciproquement malheureux. Allez jouer votre jeu, laissez-moi jouer le mien, puisque nous n'avons pas pu nous associer dans la même partie... J'ai fait quelques économies pour vous. Soyez assez brave, assez orgueilleuse pour les accepter. Si je vous avais laissé faire, dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être nous étions ruinés. Je ne veux plus qu'un pareil danger me menace. C'est donc hors de l'Espagne que vous tenterez la chance.
—La liberté que vous m'offrez, c'est un exil.
—Non; c'est une distraction. Vous n'avez pas essayé des voyages: goûtez-en. Si vous restiez en Espagne, il arriverait à coup sûr quelque événement qui exposerait une fois de plus ou mon nom, ou mon honneur, ou mon argent. Je serais obligé alors d'agir comme un mari brutal qui invoque la loi et la force, ou bien comme un mari sans intelligence et sans volonté, qui tend le cou et subit les malheurs qu'il pouvait empêcher. Je m'efforce de donner à cette crise un dénoûment spirituel. Je vais répandre le bruit que vous êtes partie pour la France, l'Angleterre, l'Amérique même, si vous voulez, afin de recueillir une succession. Je serai très-heureux de recevoir de vos nouvelles. Vous emporterez la clef de cette chambre que le capitaine Lopez ne viendra pas vous réclamer. Je m'en rapporte à votre probité de joueuse. Quand vous vous sentirez guérie radicalement, et prête à subir la vie régulière, j'annoncerai votre retour et j'irai au-devant de vous avec joie. Si vous vous trouvez incorrigible, alors vous me le direz encore pour que je puisse, sur mes économies, sur mon travail, thésauriser votre bourse de jeu. Je tiens à ce que, partout où vous serez, vos dettes soient exactement payées. Si, enfin, car il faut tout prévoir, la passion sans cause et sans idéal qui vous torture rencontrait un prétexte, ou un idéal, ne m'écrivez pas; car ces confidences sont toujours pénibles et choquantes à faire. Renvoyez-moi seulement la clef de votre chambre. Je saurai ce que cela veut dire. A partir de ce jour-là, je serai veuf. Vous serez affranchie de tout scrupule et je porterai votre deuil, en annonçant votre mort.
—Monsieur, vous êtes un honnête homme et un mari spirituel.
—C'est précisément pour rester l'un et l'autre que je prends envers moi et envers vous ces précautions. La patience aurait pu me trahir un jour. De cette façon-là, je puis jurer qu'elle me restera.
—J'accepte toutes les conditions, dis-je à mon mari. Je pourrais vous laisser cette clef que vous me tendez comme un reproche, peut-être comme une menace; mais je l'emporte comme le gage et la preuve de ma liberté.
Deux jours après, je quittais Madrid. Je vins en France. J'avais entendu dire que les femmes, du moins, y étaient libres. Je trouvai Paris fort ému par l'apparition d'un livre où l'on discutait les égards qu'un mari doit aux amants de sa femme. Les théâtres étaient devenus des succursales de modistes où le monde honnête allait prendre modèle sur le monde qui ne l'est pas. Tout le monde jouait, mais avec avarice et sans passion. Les femmes qui jetaient un billet de banque sur un tapis songeaient à leurs épargnes et à payer leurs dettes. Les jeunes filles remuaient les cartes pour trouver une dot. Les hommes jouaient à la Bourse. J'aurais été une monstruosité, dans cette élégante cohue, où des demi-vices suffisaient pour équilibrer des demi-vertus. Les ménages que je pus étudier me rendirent fière de M. Mendez. En France, le mariage a de fréquentes analogies avec mes fiançailles sur le bord du Mançanarez. Il n'est pas besoin de se rencontrer cinq minutes pour se lier indéfiniment; et il semble que la délicatesse des mœurs et le raffinement tiennent surtout à unir des gens qui ne se sont jamais parlé ni jamais vus.
Je m'ennuyai de cette société, qui n'a ni le charme austère de la vertu, ni l'étourdissante ivresse de la corruption. Ce désordre hypocrite et mesquin me fatigua et me révolta. Je serrai ma clef avec force. J'aurais été désespérée de la laisser tomber au milieu de cette foule si bien gantée. Ils se seraient mis deux ou trois pour la ramasser.
J'allais passer en Angleterre, non pas, grand Dieu, pour y trouver plus de distraction, mais pour boire tout de suite l'ennui jusqu'à la lie, quand, au Havre, l'idée me vint de m'embarquer sur le navire où vous étiez déjà, mesdames et messieurs. Les voyages lointains, l'inconnu, les dangers pouvaient me plaire, m'occuper.
—Essayons, me disais-je, de faire entrer la nature et l'infini dans ce cœur vide.
Je ressentis un effet bizarre de ce remède. Quand je quittai l'Europe, quand je me trouvai au milieu de l'Océan; la solitude morale dans laquelle j'avais vécu jusque-là m'apparut plus distincte, plus poignante. La mer a reçu la première larme que j'eusse encore versée. Quoi! je partais, j'allais dans un monde barbare, sauvage, chercher des émotions qui ne fussent pas les vieux penchants et les vieilles passions de l'Europe, et personne, au départ, ne m'avait adressé d'adieux; personne ne souffrait de mon absence; personne n'était avec moi pour partager mes dangers, pour m'embrasser devant la mort, si le vaisseau qui me portait devait s'engloutir.
Les amours humaines que j'avais traversées et coudoyées m'avaient éloignée de l'amour. La solitude de l'Océan m'initia tout à coup. Ah! vous ne savez pas ce que j'ai dévoré d'angoisses, ce que j'ai souffert d'insomnies pendant les longues nuits de la traversée. Je me sentais inutile sous le ciel; je me disais que cette flamme de mon cœur me dévorerait vainement, et que je ne trouverais peut-être jamais l'emploi de ces facultés précieuses que j'avais trompées jusque-là par le jeu et par les superstitions. Je pensais à ma mère, qui se mourait peut-être au fond d'un couvent d'Espagne, et je me sentais des tendresses de fille et des ardeurs maternelles.
—Elle me pleure! m'écriais-je. Ah! si j'avais des enfants à pleurer et à attendre!
Mon mari ne se doute guère du supplice auquel il m'a condamnée. S'il m'était apparu tout à coup, je me serais jetée dans ses bras, en le conjurant de m'aimer. Le devoir me luisait comme un mirage; je trouvais des joies dans le sacrifice, dans l'immolation de tous mes instincts, au bonheur d'une famille, à la gloire d'un ménage.
Un jour, vous vous le rappelez, des matelots qui jouaient se prirent de querelle, et, pour une misérable question de carte, s'assassinèrent entre eux. J'étais là, j'avais suivi la partie, je vis tirer les couteaux et je vis jaillir le sang. La passion du jeu m'apparut dans sa manifestation la plus grossière, la plus naïve, la plus sincère. J'eus horreur de moi et des cartes, et quand je pensai à tous les mouvements de haine que j'avais parfois ressentis, je faillis sauter par-dessus le bord et me jeter dans l'Océan, comme complice de ces joueurs féroces.
Je ne sais pas pourtant si je suis guérie, et si la frénésie qui m'a dévorée me torturerait encore; mais je sais bien que j'ai place maintenant dans mon cœur pour d'autres sentiments. Je pourrais être encore joueuse; je ne serais plus la joueuse exclusive et égoïste qui n'aimait rien. Mon cœur s'est amolli; ce qu'il y avait de viril dans ma nature a disparu. L'influence de mon père a cessé; c'est au tour maintenant de ma mère. Elle voulait que je fusse une femme; je le deviens; je veux aimer.
La señora Mendez avait fini, elle se tut; mais ses regards animés et sa lèvre qui frémissait doucement semblaient assez dire qu'elle aurait pu continuer quelque temps encore le commentaire qui intéressait si fort son auditoire.
Le plus ému des auditeurs était sans contredit Stanislas Robert, quoique sir Olliver eût laissé échapper plusieurs fois des petites exclamations qui trahissaient un assez vif plaisir. L'Anglais avait peut-être pensé que la compagnie de la señora Mendez devait être un puissant remède contre la monotonie de l'existence; mais pour avoir le droit d'accompagner fructueusement la belle Espagnole, il fallait obtenir d'elle le soin de cacheter le paquet qui renverrait la clef symbolique à M. Mendez, et sir Olliver ne se sentait pas des dispositions assez énergiques à cet égard; il doutait d'ailleurs de l'accueil qui pouvait être fait à ses hommages.
Stanislas Robert, qui avait déjà reçu dans ses promenades la primeur des confidences de la belle naufragée, était plus vaillant et ressentait un enthousiasme plus actif.
Un silence de quelques secondes suivit le récit de la señora Mendez. Ce fut madame Vernier qui le rompit:
—Le naufrage a-t-il modifié vos dispositions poétiques? demanda-t-elle avec un sourire plein de malice.
—Le naufrage les a interrompues, répliqua l'Espagnole. Mais je m'interroge sévèrement depuis quelques jours, et j'hésite à continuer cette course à travers le monde. Le but n'est peut-être pas devant moi; il est peut-être resté en Espagne.
—Ainsi, dit Ottavio, à son tour, avec une curiosité compatissante, M. Mendez ne recevra pas la clef?
Dolorida ne put s'empêcher de rougir; elle regarda le jeune peintre français à la dérobée, et reprit avec une mélancolie qu'on n'eût pas soupçonnée quelques jours auparavant:
—Je ne suis pas assez guérie de la passion du jeu pour ne pas m'en rapporter, dans une certaine mesure, aux hasards des événements. Je n'ai pas dit que j'étais prête à aimer mon mari. Je ressens même parfois contre lui des mouvements de rancune et de haine qui me prouvent bien que mon sang ne s'est pas encore refroidi dans ce bain de l'exil. Je doute, j'attends, mais j'espère.
—Vous avez raison, dit à son tour le docteur Frantz, espérez! l'amour trompe moins que le jeu.
—Mesdames et messieurs, se hâta de dire Stanislas Robert, qui craignait qu'on n'exerçât une pression fatale à ses intérêts sur l'âme de la señora Mendez, ne soyons pas indiscrets; prenons l'histoire qui vient de nous être racontée, comme nous avons accueilli le conte bleu de mon ami Ottavio, pour une histoire de fantaisie, et ne forçons pas l'auteur à nous en dire plus qu'il n'a voulu en laisser voir.
—Sans doute, repartit madame Vernier; puisque nous sommes le public, nous n'avons pas le droit de savoir toute la vérité. Mais alors je demande qu'on dégage la moralité du conte.
—A une condition, s'écria Stanislas, c'est qu'on ne prétendra pas que l'histoire de la señora Mendez prouve les inconvénients du jeu. Ce serait une moralité trop banale et trop facile à trouver.
—Moi, je pense, dit sir Olliver, qu'il faut conclure de ce récit que l'ennui est dans tout et partout. La señora n'a pris les cartes que pour échapper au spleen.
—Au spleen ou au mariage? dit Ottavio.
—Ces deux défauts se comprennent et s'engendrent tour à tour, répliqua Stanislas.
—Pourquoi M. Mendez eut-il l'idée d'empêcher la señora de se jeter dans le Mançanarez? reprit l'impitoyable madame Vernier, qui entrait décidément en hostilité légère contre l'Espagnole.
—Par humanité, dit Ottavio.
—Par amour, dit Frantz.
—Par caprice, dit sir Olliver.
—Par tout cela à la fois, dit Dolorida. Homme de tête et d'imagination, le señor Mendez se dit sans doute que je valais la peine d'être conservée, que je pourrais être une très-agréable épouse de journaliste et de député. Il est excusable de m'avoir sauvée: je ne le suis pas, moi, de l'avoir écouté. J'ai ajouté l'ingratitude à la collection des petits défauts que je lui apportais en dot.
—Vous n'avez pas été ingrate, dit avec feu Stanislas Robert. Vous n'aimiez plus le jeu quand vous l'avez épousé. C'est lui qui vous a donné le prétexte, et c'est lui, d'ailleurs, qui n'a pas su fournir d'aliment assez actif à l'ardeur de votre esprit, à la flamme de votre cœur.
—N'en dites pas trop de mal, dit la señora Mendez en souriant, vous iriez contre votre but. Je suis redevenue joueuse parce qu'il n'y avait pas au monde un état, une position qui pût m'empêcher de le redevenir. Un enfant peut-être m'eût préservée; mais ni le ménage, ni la politique, ni le monde ne pouvaient me garantir.
—Je ne vois toujours pas poindre la morale, dit avec insistance la jeune Française.
—Eh, mon Dieu! répondit avec impatience Stanislas Robert, la morale, ce sera, si vous voulez, le conseil donné à toutes les femmes d'être coquettes, frivoles, de tromper et d'amoindrir leur esprit par des petits commérages, par des petits soins de toilette, quand elles veulent rester honnêtes, plutôt que de s'exposer aux orages des passions.
—La morale, dit Frantz, c'est de ne se marier que quand on s'aime, et c'est de préférer la mort au mariage sans amour.
—A moins, repartit Ottavio, que ce ne soit la recommandation expresse de faire faire deux clefs à la porte de sa chambre.
—La morale, je vais la donner, moi, interrompit la señora Mendez: c'est d'élever les enfants dans l'amour du travail et du devoir; et si cette morale ne vous satisfait pas, de grâce, ne m'en demandez pas une autre et n'en cherchez pas d'autre. Je vous ai fait passer une heure sans trop d'impatience; ce triomphe me suffit. Ne me le gâtez pas par vos questions et par vos épigrammes.
—Voilà qui est parfaitement conclu, dit Stanislas Robert, et je crois que madame Vernier voudra bien venger demain les Françaises des reproches que la señora leur a adressés en passant.
—Moi, monsieur, je ne raconte pas ma vie, riposta d'un air mutin la jeune veuve.
—Vous aimez mieux, sans doute, la méditer, n'est-ce pas?
—Non, répondit gaiement la Française, je n'ai pas eu de sombres aventures. Je me suis mariée de propos délibéré, et je n'en ai pas agi plus sagement pour cela. Mais comme mon mari n'était pas farouche, je lui riais au nez, pour exhaler mon dépit, et je le faisais doucement enrager, pour me venger sur lui de ma maladresse. Mon ménage fut une comédie bourgeoise entremêlée de couplets. M. Vernier est seul coupable du dénoûment un peu lugubre; il est mort tout naturellement; mais ma famille et nos amis ne m'eussent jamais pardonné de ne l'avoir pas pleuré. D'ailleurs mon tyran était un brave homme. Je perdais avec lui un interlocuteur commode: je le regrettai donc en conscience. Ma fortune fut compromise par les timides spéculations de mon mari. Il n'était pas joueur et il considérait la Bourse comme un endroit malhonnête. Si bien qu'en refusant de se livrer aux chances hasardeuses qui décuplaient et centuplaient la fortune de nos voisins, mon mari fut obligé de s'en tenir aux affaires timides et parfaitement sûres. Je n'ai jamais bien compris comment il se fit que toutes les affaires sûres devinrent mauvaises, et comment l'argent honnêtement placé fut maladroitement perdu. Il paraît que tout cela est logique. Je me trouvai veuve et à demi ruinée. Je voulus essayer de redevenir riche à moi seule. Je n'avais pas de liens qui me retinssent en France. Je n'avais ni donné, ni vendu, ni prêté les clefs de mes appartements.
—Oh! oh! voici une allusion, interrompit Stanislas Robert.
—Soit, et de mauvais goût, si vous voulez, ce qui vous prouve que je n'ai pas la science du récit. Je partis pour les pays les plus extravagants. On m'assurait qu'il était facile, avec une jolie voix et quelques talents inutiles, d'y refaire fortune; je m'embarquai. Je n'ai pas trop à me plaindre jusqu'ici. J'ai vu la mer beaucoup mieux que je ne l'avais vue à Dieppe ou au Havre. J'ai eu un joli naufrage; je suis tombée dans une île où les indigènes brillent par leur absence. Je n'ai pas encore été contrainte à manger quelque chose de mes compagnons d'infortune. Tout est donc pour le mieux, et je ne réclame pas. Mais vous voyez qu'à moins de vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant ou l'Oiseau bleu, je n'ai absolument rien dans mes souvenirs qui puisse vous émouvoir ou vous attendrir.
—Hum! dit Stanislas Robert, qui s'efforçait de venger la señora Mendez des petites flèches que lui avait décochées madame Vernier, voilà un récit bien succinct, bien écourté. Il est impossible qu'une existence de Parisienne n'ait pas plus d'épisodes.
—Les épisodes! ce sont les friandises qu'on garde pour les amis, reprit madame Vernier.
Une réclamation générale et bruyante accueillit cette nouvelle boutade.
—Nous sommes tous vos amis! nous avons tous fait un pacte! s'écria le peintre. Madame, vous introduisez la discorde.
—Oh! je m'entends, répondit la jeune veuve; et sans méconnaître la parfaite courtoisie de ces messieurs, l'obligeance de ces dames, je puis faire mes réserves quant aux sentiments spontanés et volontaires. Nous sommes amis par nécessité.
—Parbleu! c'est la bonne, c'est la plus solide amitié! dit Ottavio.
—Sans aucun doute; mais excusez-moi, mes bons et chers amis, ce n'est pas à cette amitié-là que j'entends raconter les petits mystères de mon existence peu mystérieuse.
—Ainsi, vous me blâmez, madame, demanda fièrement la señora Mendez.
—Non, certes, madame. Je vous remercie, au contraire; seulement, nous autres Parisiennes, nous avons la coquetterie des réticences, et je ne suis pas assez certaine de ne plus revoir le monde civilisé pour m'en départir.
—Il est impossible pourtant que vous manquiez aux engagements pris envers la communauté, dit Stanislas. Chacun de nous a solennellement promis une histoire ou un conte.
—Eh bien! moi, je m'engage pour un intermède; quand chacun aura payé sa dette, nous verrons.
—Allons! je ne m'étonne plus de vos instincts politiques. Vous êtes habile à tourner autour d'un serment. Heureusement que sir Olliver est là pour donner l'exemple de la fidélité à la foi jurée. C'est à votre tour, milord. Préparez-vous pour demain.
—Oh! oui, je me préparerai; mais j'ai besoin de beaucoup de préparation.
—Alors, mon cher monsieur Frantz, je ne vois plus que vous qui puissiez nous tirer d'embarras.
—Je ne me défendrai pas, répondit l'Allemand avec un sourire. J'acquitterai ma dette, à une condition, c'est que je paierai pour deux, et que madame, ajouta-t-il en désignant sa compagne, sera libérée par mon récit.
—Quel dévouement! dit en riant madame Vernier. Ce n'est pas vous, sir Olliver, qui offririez de payer pour moi?
—Donnez-moi ce droit-là, madame, et je me charge de toutes vos dettes.
La jeune veuve regarda l'Anglais avec un coup d'œil de côté et un sourire plein d'épisodes; mais elle ne répliqua pas.
—Nous consentons, mon cher Frantz, à l'arrangement proposé, dit Stanislas Robert. Heureuse la femme qui peut rester muette, parce que tous les rêves de son cœur sont devinés et traduits par un interprète.
—Vous voyez que je fais bien de ne pas parler, interrompit madame Vernier.
—Et j'ai eu tort sans doute de raconter mon histoire? demanda la señora Mendez.
—En aucune façon, mesdames. J'excuse, j'approuve le mutisme, mais à la condition d'un interprète. Quel est le vôtre, madame Vernier? En aurez-vous un, señora?
Au lieu de répliquer et de prolonger cette petite chicane, les deux dames se levèrent, la jeune veuve avec une sorte de dépit, l'Espagnole avec une mélancolie souriante. Puis chacun devint libre et l'on se dispersa.
Sir Olliver était allé au buffet. Ottavio et Stanislas Robert restèrent seuls un moment.
—J'imagine, dit l'Italien, que c'est toi qui renverras la clef?
—Bah! répondit Stanislas en rougissant un peu et en haussant les épaules, peut-on savoir au juste ce qui se passe dans ce cœur profond? J'ai peur de lui parler d'amour, à cette femme étrange, car elle serait capable de profiter du conseil pour aimer son mari.
—Cela ne prouverait pas en faveur de ton éloquence.
—Cela prouverait, au contraire, que je suis trop persuasif. Il y a en elle une lutte du devoir et de la passion qui finira par un accord harmonieux de l'un et de l'autre.
—Il faudrait, dit Ottavio avec un petit soupir complaisant pour son ami, qu'elle devînt veuve.
—Ah! mon cher, tu souhaites tout simplement l'idéal.
—A propos de veuve, reprit gaiement Ottavio, à qui donc en veut madame Vernier?
—Si ce n'est pas à sir Olliver, c'est à toi, répondit le peintre.
—Oh! moi, je n'ai rien de galant à dire, et je n'ai rien de rassurant à offrir. L'Italie, cette terre des amoureux et des nouveaux époux, est la seule terre qui me soit fermée. Quant à l'avenir, qui peut le connaître? Madame Vernier est une Parisienne, et le goût du romanesque ne s'étend pas pour elle au delà des excentricités d'un Anglais fort honnête et fort riche. C'est elle qui désennuiera sir Olliver. Quant à moi, tu sais bien à qui je suis fiancé et quelles sont mes amours.
Stanislas serra la main de son ami, et comme il voyait la señora Mendez se promener seule, il pensa que le moment était opportun pour s'assurer de la vérité des prévisions d'Ottavio ou de la réalité de ses craintes personnelles. Ottavio le suivit du regard.
—Ils sont heureux, ces Français! murmura-t-il; ils peuvent aimer plusieurs choses à la fois. C'est pourtant un bon patriote que Stanislas Robert!
Et le pauvre exilé s'en alla tout seul le long du rivage; mais il n'y fut pas longtemps sans rencontrer madame Vernier, qui essayait de se faire une lorgnette avec ses deux jolies petites mains arrondies en tube et placées l'une au bout de l'autre, et qui regardait vainement à tous les coins de l'horizon.
—Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? demanda Ottavio.
—Vous connaissez vos auteurs, dit madame Vernier. Hélas! non, monsieur, je ne vois rien.
—Quelle impatience vous avez de quitter cette île?
—Il ne faut pas abuser de la poésie, répliqua la veuve; c'est une crème qui plaît comme dessert, qui ne suffit pas comme aliment solide. Or, je vous avoue que le Décaméron sentimental que nous avons entrepris finit par me lasser. Je voudrais des émotions plus solides.
—C'est singulier! vous paraissiez si résolue avant que madame Mendez n'entamât son histoire?
—Me croiriez-vous par hasard jalouse du succès littéraire de l'Espagnole?
—De son succès littéraire? non.
—Est-ce qu'elle en a d'autres? demanda madame Vernier en riant beaucoup trop pour rire de bonne humeur.
—Avouez que vous n'aimez pas madame Mendez?
—Oh! mon Dieu! je serai franche, et...
—Les Françaises le sont toujours quand il s'agit de haine.
—Merci du compliment. Eh bien, je le mériterai. Je ne nie pas que cette belle dame aux grands yeux jaunes, qui mêle la dévotion, le jeu, à je ne sais quelle vague aspiration, m'irrite un peu les nerfs. Avez-vous entendu comme elle traitait les Françaises?
—Ah! ah! c'est par esprit national que vous ne l'aimez pas!
—Par esprit national et par esprit particulier. J'avais envie, quand on cherchait la moralité de son histoire, de regretter tout haut que le señor Mendez n'eût pas usé envers la señora des arguments qui avaient rendu si humble et si résignée la mère de Dolorida.
—Ah! madame, vous auriez manqué alors à l'esprit de votre sexe.
—Que voulez-vous? Cette dame n'y manque-t-elle pas, elle qui n'a vécu jusqu'ici que pour l'amour du roi de trèfle et l'amour du valet de carreau?
—Mais si elle se repent?
—Eh bien, alors, je me repentirai.
Ottavio s'amusa beaucoup des scrupules philosophiques de madame Vernier. Quand il l'eut quittée et quand il l'eut laissée sur la plage de l'île, regardant toujours l'horizon, il se dit à lui-même:
—Si nous restons ici huit jours encore, la guerre civile est déclarée! Pauvre île des Rêves, tu ne nous auras pas même donné l'illusion de la paix parmi sept naufragés! Il est vrai que, dans ce nombre, il y a trois femmes, et la proportion est bien forte pour l'harmonie.
Pendant que le jeune Italien se livre à ces réflexions et retrouve dans un désert un motif de désenchantement que la foule lui a fourni souvent, Stanislas Robert, qui a rejoint la belle Dolorida, cherche à espérer.
—Señora, j'ai une curiosité à satisfaire, bien bizarre et bien puérile.
—Laquelle, monsieur?
—Ne pourrais-je pas voir un instant, contempler pendant quelques minutes cette fameuse clef dont il a été question?
—En effet, dit la señora Mendez, la curiosité est enfantine; mais on ne refuse rien aux enfants: voici cette clef.
—Ah, mon Dieu! comme la serrurerie est peu avancée en Espagne! Elle est horrible et pesante, cette clef-là. Et vous portez ce joyau-là sur vous?
—Il ne me quitte pas.
—Vous quittera-t-il?
—Je n'en sais rien; mais que vous importe?
—Il m'importe beaucoup, reprit avec chaleur le jeune peintre, qui se mit à plaider une cause dans laquelle il était évidemment trop intéressé pour être impartial.
Parvint-il à persuader? C'est ce que je ne saurais dire, ici et c'est ce que nous apprendrons peut-être avant de quitter les divers habitants de l'île des Rêves.
Le lendemain, on se réunit à l'endroit accoutumé pour entendre le récit de Frantz. On s'attendait à une histoire assez langoureuse, le jeûne Allemand devant parler en son nom et au nom de sa compagne. Nous allons savoir si l'attente universelle fut déçue.
Frantz était ému. Il regarda madame Carolina Brenner, comme un poëte regarderait sa muse, si l'invention des Muses n'était pas une hypothèse psychologique tombée depuis longtemps en désuétude et à laquelle les poëtes ont renoncé; puis il commença ainsi:
Permettez-moi de donner aux héros de mon histoire des noms de fantaisie; non pas que je redoute les indiscrétions; mais il me semble que je serai plus libre dans mes allures, quand je n'aurai plus devant moi des visages réels, et quand, en me servant de fausses dénominations, je pourrai m'imaginer que j'invente ce que je vous raconte.
Ne craignez rien; loin d'y perdre, la vérité du récit gagnera à ce changement. Si je ne redoutais pas de vous ennuyer trop tôt, je vous expliquerais, par des démonstrations de la plus pure esthétique, que le réalisme est l'ennemi de la réalité, et qu'il faut toujours un petit vernis de mensonge aux événements les moins incontestables pour les faire accepter. Mais cette preuve nous entraînerait trop loin, et je la réserve à ceux qui prétendraient contester le mérite de ma théorie.
Je suis forcé de convenir que l'action se passe en Allemagne, puisque mes héros sont Allemands. Ce n'est pas une raison pour que je les fasse parler en alsacien, comme cela se pratique dans les vaudevilles français. Ils agissaient en allemand, ils parlaient en allemand; et je traduis.
Dans une ville d'Allemagne, ou plutôt, à la porte de la ville, vivait avec sa fille un bon bourgeois que je nommerai Arnold. Ancien négociant, retiré des affaires, M. Arnold avait vendu pendant trente ans du drap de toutes les couleurs, et il faut croire qu'il l'avait vendu bon teint, car il avait laissé dans le commerce la réputation la plus intacte. Pourtant il s'était enrichi; du moins il s'était retiré avec une aisance qui faisait peut-être des jaloux, mais qui ne faisait pas d'envieux, tant la bonté, la probité, les mœurs douces de l'ancien marchand de draps lui avaient concilié l'estime universelle. Son enseigne: Aux Balances d'or, était le plus parfait symbole de son exactitude commerciale et de la pureté de sa conscience.
Maître Arnold, comme l'appelaient ses voisins, bien qu'il ne fût maître en aucune Faculté et qu'il fût tout au plus maître chez lui; maître Arnold serait sans doute resté toute sa vie derrière son comptoir, s'il n'avait pas eu le malheur de perdre sa femme. Tout le monde sait que le mariage, qui est un lien nécessaire dans la société, en général, est souvent une condition indispensable d'ordre et de prospérité dans le commerce en particulier. Madame Arnold tenait les livres, surveillait les commis, et portait, suspendue à une longue chaîne d'acier, avec une paire de ciseaux, la clef de la caisse. Quand la chère dame se fut endormie du dernier sommeil, maître Arnold se trouva bien embarrassé. Il essaya d'écrire lui-même, chaque soir, la vente de la journée. Mais, habitué à une vie active et à rester debout une partie du jour, il avait des éblouissements et des vertiges, quand il lui fallait, pendant une heure ou deux être, immobile dans son vieux fauteuil à faire les comptes et à mettre au net les écritures. Il lui arriva plus d'une fois de laisser tomber sa tête sur le grand-livre, vaincu par la fatigue; et plus d'une fois, en retrouvant la grosse écriture carrée de madame Arnold, de s'arrêter, de jeter sa plume et de déposer deux grosses larmes sur le papier, au lieu des griffonnages nécessaires.
Prendre un caissier, c'était une profanation à laquelle le pauvre homme ne pouvait pas songer. A quelle heure eût-il trouvé le moment de s'entretenir avec un mercenaire de ses achats, de ses bénéfices? Or, pendant trente ans, les chastes oreillers du ménage avaient entendu les confidences des deux époux. Maître Arnold ne récapitulait ses profits et ne les balançait avec ses pertes que dans le silence de l'alcôve. S'il prenait un caissier, il lui fallait nécessairement changer cette habitude; mais s'il n'en prenait pas, le désordre pouvait s'introduire dans la comptabilité. Je sais bien que l'honnête marchand de draps avait une fille. Mais le rêve du père et de la mère de mademoiselle Gertrude avait été précisément de la tenir éloignée à jamais de l'obscure boutique et du bureau plus obscur encore. Voir les jolis doigts roses de sa fille toucher aux in-folio, armés de coins en cuivre, c'était une idée qui révoltait la délicatesse de maître Arnold.
Il aima mieux renoncer au commerce, dire adieu aux Balances d'or, et se retirer dans la jolie petite maison que sa femme avait choisie elle-même à la porte de la ville. Ce fut à coup sûr un grand chagrin que de quitter la boutique; mais comme maître Arnold s'imaginait habiter la campagne, depuis qu'il n'habitait plus une rue étroite, il n'éprouvait naturellement de plaisir à se promener que quand il visitait son ancien quartier, quand il disait bonjour aux voisins, et quand il entrait s'asseoir pour causer avec son successeur, et s'informer si l'on avait enfin vendu une pièce de drap qui avait été son tourment pendant les dernières années.
D'un autre côté, ce fut une grande douleur pour l'excellent mari que d'habiter veuf la retraite préparée avec tant d'orgueil par madame Arnold. Toutes les fois qu'il goûtait à un raisin de son jardin, il soupirait et disait à Gertrude:
—Ah! si ta pauvre mère était là, elle qui aimait tant les fruits!
Et maître Arnold regardait tristement à ses pieds, se rappelant toujours qu'il avait vu sa femme descendre dans la terre; Gertrude, elle, levait les yeux au ciel, pensant que sa mère y était bien plutôt.
La maison paraissait trop vaste à Philémon sans Baucis. Au rez-de-chaussée, la cuisine était séparée de la salle à manger par un couloir qui allait de la rue au jardin. Bien qu'on eût meublé un petit salon, derrière la salle à manger, de fauteuils en drap amarante brodés par madame Arnold, on n'entrait dans cette pièce qu'aux jours solennels. C'était avec la plus grande répugnance que maître Arnold se résignait à s'asseoir sur ces souvenirs, qu'il avait peur de faner. Il se tenait d'habitude dans la salle à manger, quand il faisait mauvais, à côté de Gertrude, qui filait ou tricotait. Pendant l'été, un berceau du jardin, meublé d'une table et de bancs rustiques, servait de retraite; et l'hiver, pour fumer sa pipe, le bon M. Arnold, qui n'était pas fier, venait s'installer dans la cuisine et causer avec la vieille Marguerite, qu'il avait à son service, depuis l'heureux jour où il était devenu à la fois le propriétaire du magasin des Balances d'or et l'époux de madame Arnold.
Au premier étage, la maison comprenait quatre chambres. M. Arnold en gardait deux pour les amis et occupait les deux autres avec sa fille. Au second, couchait Marguerite; et on louait à un jeune homme, dont il sera question tout à l'heure, deux fort belles pièces qui avaient été retranchées du grenier, sans offense pour le grenier ni pour personne.
Si je vous décris la maison de maître Arnold, c'est qu'elle était en si parfaite harmonie avec le caractère et les mœurs de ses habitants, qu'on se sentait tout heureux, tout consolé, tout rasséréné, dès qu'on en avait franchi le seuil. C'était bien là le séjour de l'honnêteté, de la bonne foi, de la candeur à tous les degrés et à tous les âges, depuis le front ridé et courbé de la vieille Marguerite, jusqu'au front lisse et blanc de Gertrude, en comptant la figure calme et reposée de maître Arnold. La vigne tapissait, du côté du jardin et du côté de la rue, ce paradis abrité d'un toit d'ardoise. La propreté luisait à l'intérieur, comme la conscience sans tache d'une maison patriarcale. Le poêle à triple étage de la salle à manger chantait, l'hiver, une petite chanson douce et gaie qui donnait de bonnes digestions et de bons sommeils. Les casseroles de Marguerite étincelaient, comme si elles eussent été du métal prétendu des balances de l'enseigne. Les carreaux du couloir, hebdomadairement nettoyés avec du sable et de l'huile, ravissaient l'œil par la perspective d'un damier irréprochable. Le jardin était soigneusement entretenu; les espaliers étaient l'objet d'un culte tout particulier. Il manquait pourtant un ornement que M. Arnold, dans sa modestie, n'avait pas encore osé acheter, mais après lequel il soupirait tout bas, c'est-à-dire deux belles statues peintes et vernissées représentant, l'une un berger, l'autre une bergère, avec leurs attributs. En attendant, maître Arnold avait placé au beau milieu du jardin une de ces grosses boules ingénieuses qui forment des tableaux circulaires, et il s'amusait à amener Gertrude devant ces miroirs convexes, pour qu'elle vît ses jolies petites joues démesurément aplaties et élargies.
Ai-je besoin de vous décrire maître Arnold? Soixante ans; un léger embonpoint, un visage où les années s'étaient doucement appliquées, comme des hirondelles qui viennent faire leurs nids, en portant bonheur à leur hôte; des rides sommaires, pour ainsi dire (les soucis n'ayant pas multiplié ces sillons où roulent et que creusent les larmes); des cheveux qui s'argentaient tous les jours; une tenue décente; la prétention d'avoir toujours du drap solide et de belle apparence: tel était maître Arnold. La mort de sa femme avait été son plus grand chagrin, non pas son premier; car il avait perdu plusieurs enfants, avant de garder et d'élever Gertrude. Mais il les avait perdus si jeunes, et sa fille était l'aurore d'un si riant avenir, que, sans être barbare, M. Arnold ne pensait plus aux petits anges envolés. Il pensait toujours à sa femme; il agissait dans cette préoccupation, comme si elle eût été toujours là. Quand il devait prendre quelque grande détermination, il allait se mettre devant le portrait de la défunte, qui faisait de son salon un sanctuaire, et là, il délibérait à demi-voix avec lui-même, comme si la toile eût pu entendre et lui souffler un bon conseil.
—Est-ce comme cela que vous auriez fait, ma chère femme? demandait-il en concluant.
Le silence du portrait passait pour une approbation, et maître Arnold, parfaitement rassuré, agissait sans trouble et ne se sentait plus responsable. Nous saurons si ce pieux système lui porta toujours bonheur et suffit à le préserver.
Je n'ose vous peindre mademoiselle Gertrude. A dix-huit ans, avec la beauté de l'innocence et l'innocence de la beauté qui s'ignore, elle allait et venait dans la maison du faubourg, comme un ange du ciel mis en cage. Son sourire était un poëme, ses soupirs un cantique. Non pas, je puis le dire sans l'offenser, qu'elle eût la moindre prétention à l'esprit, et qu'elle fît un effort pour atteindre à la grâce; non pas que les vertus lui missent une auréole dont sa modestie eût souffert; c'était tout bas et tout près, dans le silence de cette maison, que son âme parlait doucement et naïvement, c'était dans l'ombre qu'elle rayonnait.
Gertrude aidait le matin Marguerite. Elle cueillait les fleurs pour les grands vases de faïence de la salle à manger; elle préparait le déjeuner de son père, elle excellait à mélanger le lait dans le café, et maître Arnold s'extasiait toujours sur la façon dont elle divisait le sucre, de manière à ne jamais lui en donner trop ou trop peu.
—On voit bien que tu es née à l'enseigne des Balances d'or, disait le bon père tous les matins.
Toute la journée Gertrude travaillait, ou bien lisait à haute voix le journal à son père. C'est une grande joie pour ceux qui n'ont jamais eu les loisirs de la lecture que d'entendre lire; c'est une initiation qui les fatigue moins et qui ménage leurs yeux. Quand le temps était très-beau, Gertrude donnait le bras à son père et l'accompagnait dans ses promenades. Jamais elle n'avait mis le pied sur le seuil d'un théâtre; tout au plus allait-elle au concert. D'ailleurs, elle avait dans sa chambre une cage pleine d'oiseaux, et elle préférait tous ces gazouillements aux combinaisons harmoniques du génie de l'homme.
Quelquefois maître Arnold, qui n'était pas un égoïste, ou qui du moins avait la bonne volonté de ne pas l'être, interrogeait sa fille pour savoir si elle s'ennuyait; Gertrude répondait que non, se déclarait très-heureuse, et l'était en effet.
Le bonheur est-il donc possible à si peu de frais? De tous les secrets que la science a cherchés, voilà le plus difficile, le secret d'être heureux! La bonne conscience ne suffit pas; il faut de plus, et par-dessus tous les efforts personnels, une grâce spéciale. Gertrude avait cette grâce: elle était heureuse, sans savoir comment, sans savoir pourquoi, sans même se demander si ce bonheur devait durer toujours.
Que l'on ne soit pas malheureuse à dix-huit ans, c'est là un phénomène ordinaire et fort concevable; mais que la solitude avec son père et la protection de la vieille Marguerite ne laissassent rien à désirer à Gertrude, voilà ce qui peut paraître plus difficile à admettre.
Ce problème au surplus n'inquiétait personne, pas même l'hôte de M. Arnold, le locataire du second, qui, lui aussi, par un charme inhérent sans doute à la maison, se trouvait très-heureux, ne songeait pas à changer quelque chose à son sort, eût voulu immobiliser sa vie dans cette paisible retraite, dans le voisinage familier de son propriétaire, de la fille du propriétaire et de la vieille servante.
Ce jeune locataire, que nous appellerons Wolff, était étudiant; mais il avait passé tous les examens possibles; il avait dans son tiroir tous les diplômes, et il ne paraissait pas le moins du monde empressé d'aller répandre sa science dans le public. On eût dit qu'il se défiait des connaissances acquises, qu'il voulait ne jamais cesser d'étudier, et que la maison de M. Arnold renfermât toute son ambition. Cependant je puis vous l'avouer, il était ambitieux.
Wolff était, je crois, un honnête homme. Élevé par une mère pieuse et par un père tolérant, qui s'étaient unis pour le former, sans se contrarier et sans se nuire, il avait la conscience en équilibre. Sa figure, sa tournure n'avaient rien qui pût le distinguer; il gardait un défaut qui faisait rire ses camarades, mais dont il ne s'est pas encore corrigé au moment où je vous parle, il était timide. Wolff ne connaissait pas de plaisirs terrestres et ne rêvait pas de plaisirs célestes qui valussent à ses yeux le séjour dans la maison de M. Arnold et la fraîcheur gaie de cette retraite. Lui aussi, était heureux de peu de chose: d'entendre la vieille Marguerite remuer ses casseroles; de voir M. Arnold arroser ses tulipes; de rencontrer Mlle Gertrude et de lui demander des nouvelles de ses oiseaux. Tous les habitants de cette maison étaient si contents à bon marché, et si sages, qu'on les eût pris pour des fous.
Wolff sortait pour aller aux cours, pour visiter les bibliothèques, mais dès qu'il était rentré, il approchait sa table de la fenêtre qui donnait sur le jardin; il allumait sa pipe, laissait la fumée monter sur le toit et rêvait ou travaillait. Quelquefois, du jardin, M. Arnold l'interpellait.
—Eh! mon ami Wolff, vous qui êtes un savant, comment appelez-vous cette plante, cette fleur, en latin?
Wolff disait le mot, s'il le savait, et le cherchait dans son dictionnaire, s'il l'ignorait. C'étaient là ses grands triomphes d'érudition.
Quand un des oiseaux de Gertrude était malade, la jeune fille attendait le jeune docteur dans le couloir.
—Monsieur Wolff, lui disait-elle, vous seriez bien aimable de me donner un remède pour ce pauvre oiseau.
Wolff quittait tout pour l'amour d'un serin; s'il était embarrassé, il courait la ville, feuilletait les livres d'histoire naturelle; et quand l'oiseau était sauvé, il se sentait heureux, comme s'il avait eu charge d'âme.
Marguerite à son tour demandait des petits services à son voisin; elle lui faisait écrire ses lettres à sa famille et déchiffrer les réponses. Ce n'était pas là le travail le plus facile; mais Wolff était si bon, qu'après s'être mis en quatre pour trouver le nom d'une fleur ou guérir un serin, il estimait sa journée bien remplie, s'il avait contenté Marguerite. Tout le monde était donc lié par la reconnaissance envers Wolff, et lui, était lié envers tout le monde. M. Arnold, en effet, n'eût pas entamé le soir un broc de bonne bière, sans appeler son ami Wolff. Gertrude lui tricotait des petits objets parfaitement inutiles dont il se servait beaucoup; quant à la vieille Marguerite, elle ne se levait et ne se couchait jamais, sans écouter à la porte s'il dormait paisiblement, et elle lui préparait des friandises que Wolff affectait de dévorer le plus gloutonnement possible.
On aurait donc pu écrire sur le fronton de la maison de M. Arnold ces simples mots: «Ici l'on aime! Gens qui haïssez, passez votre chemin.» Quand je dis que l'on s'aimait, je parle de cette affection naïve et chaste, qui ne connaît ni âge, ni sexe, qui n'attend rien que le plaisir de se dévouer, et qui se satisfait d'une parole, d'un serrement de main, d'un sourire, parce qu'elle porte en elle l'infini. Si l'on eût osé dire que Wolff était amoureux, on l'eût fait pâlir de honte; Gertrude eût rougi comme d'une offense pour elle et pour leur ami; Marguerite se fût mise en colère, et maître Arnold en fût tombé malade.
Hélas! quelqu'un devait prononcer ce mot fatal, troubler ce bonheur, dissiper cette innocence, et faire entrer le malheur dans cette maison qui semblait à jamais prédestinée aux douces quiétudes de l'amitié.
M. Arnold avait parmi ses amis un ancien commerçant, comme lui, retiré plus tôt que lui des affaires et dont l'activité trouvait encore à s'occuper, en plaçant de l'argent, en faisant fructifier les capitaux restés disponibles, après la liquidation de son fonds de commerce.
M. Gottlieb était un ancien joaillier. Il avait vendu pendant vingt ans des bagues à tous les fiancés des campagnes, des bijoux à toutes les belles dames de la ville. Bon vivant, aimable compagnon, il se croyait très-instruit, parce qu'il avait étudié six mois pour être médecin, et il ne doutait jamais de rien. Aussi, marchait-il la tête haute, faisant admirer le beau diamant qui étincelait entré les plis de son jabot et la bague merveilleuse qu'il portait au petit doigt de la main droite. M. Gottlieb ne s'était jamais marié; il n'avait jamais trouvé de femme qui méritât l'honneur de porter son nom.
Il était peu probable, à première vue, que les relations intimes et quotidiennes de M. Gottlieb et de M. Arnold tinssent à des raisons d'affaires; mais un observateur se fût demandé pourtant ce qui attirait l'ancien joaillier dans cette maison. Marguerite croyait avoir deviné, et disait quelquefois à son petit ami Wolff:
—Cet homme-là a trop vendu d'épingles; il aime à piquer. Depuis qu'il s'est aperçu qu'il nous ennuyait, il est très-assidu. Il faudrait le bien recevoir pour le dégoûter de revenir.
Wolff, qui n'avait pas de soupçon, hochait cependant la tête et ne se laissait pas convaincre par la vieille servante.
Une seule personne dissimulait et faisait de son mieux pour attirer M. Gottlieb: c'était le bon M. Arnold, qui était cependant sa victime perpétuelle.
—Mon cher Gottlieb, lui disait-il en le reconduisant le soir jusqu'au seuil de sa porte, s'il vous plaisait de goûter demain d'une bouteille que j'ai gardée depuis la naissance de Gertrude, je vous attendrais pour dîner.
Ou bien encore:
—Mon cher Gottlieb, j'irai vous prendre demain, et nous ferons ensemble une grande promenade.
M. Gottlieb acceptait tout, les dîners plutôt que les promenades, et on le voyait arriver, de jour en jour, de meilleure heure. Dès que sa grosse voix joviale retentissait dans la maison, Wolff devenait triste, Gertrude rêveuse et Marguerite grondeuse. Alors, la malice de l'ancien joaillier s'exerçait avec une verve bruyante qui étourdissait les échos de cette maison, d'ordinaire silencieuse.
—Ah! ah! je fais peur à votre voisin, disait-il, à votre studieux M. Wolff. Quand donc aura-t-il fini d'apprendre? Est-ce que vous lui enseignez le jardinage, Arnold? ou l'histoire naturelle, Gertrude?
Puis, traversant le couloir et entrant dans le jardin, M. Gottlieb se faisait un porte-voix de ses deux mains réunies et appelait le jeune locataire:
—M. Wolff! lui criait-il, on vous demande.
Wolff n'ouvrait pas sa fenêtre; alors M. Arnold montait, quatre à quatre, jusqu'à la chambre de son ami.
—Travaillez-vous, mon cher enfant? disait-il à travers la porte. Mon ami Gottlieb est en bas qui voudrait bien vous voir; ma fille et moi nous vous prions de descendre.
Wolff ne résistait jamais à cette démarche, il descendait; et des railleries accueillaient son entrée dans la salle à manger ou dans le jardin.
—Le voilà! le voilà! criait l'impitoyable Gottlieb. Il a tout quitté pour venir trinquer et discuter avec moi. Vous vous fatiguez trop, jeune homme! la science ne vaut pas ce qu'elle coûte. Ah! de mon temps, je n'aurais pas ouvert un livre dans une maison où j'eusse trouvé de si jolis yeux pour y lire.
—Gottlieb! Gottlieb! murmurait M. Arnold avec un ton d'affectueux reproche.
Gertrude s'éloignait. Wolff rougissait, et l'ancien joaillier prenait une pincée de tabac dans une boîte en or. Quand il faisait beau, on s'asseyait sous un berceau du jardin, on buvait la bière et l'on causait, ou plutôt M. Gottlieb entremêlait les anecdotes, les médisances de la ville de discussions saugrenues. Il prétendait rompre des lances avec Wolff sur le terrain de la métaphysique, et il lui poussait des arguments d'une violence et d'une énormité telles, que Wolff ne savait bien souvent que répondre et s'avouait vaincu.
Les triomphes de M. Gottlieb étaient capables d'armer un saint. Il riait, il s'épanouissait, il tapait sur son gousset où l'argent résonnait toujours, et racontait invariablement comment, s'il eût continué ses études, il serait devenu un des plus grands médecins de l'Allemagne.
—Mais, ajoutait-il en terminant, j'aurais été moins longtemps que vous à devenir savant, mon cher monsieur Wolff. Ah çà! vous nous quitterez bientôt; il va falloir que M. le docteur aille professer ou exercer ailleurs. Ce sera un grand vide, un bien grand vide dans cette maison.
—Oh! oui! disait maître Arnold en soupirant.
—Ce bon M. Wolff! quel dommage qu'il ne puisse pas toujours rester ici!
Ces méchancetés mettaient Wolff au supplice, et il ne se sentait guéri que quand, le soir, très-tard, après la retraite du bourreau, M. Arnold lui disait:
—J'espère bien que Gottlieb s'est trompé! Hein? vous ne nous quitterez pas de sitôt?
—Pourquoi donc, mon père, M. Gottlieb prend-il plaisir à tourmenter nos amis? demandait Gertrude.
—Que veux-tu! il a l'humeur plaisante; mais, au fond, il nous aime bien tous. Va! si tu savais comme il parle de toi!...
Un soir, pendant l'hiver, on causait, on fumait, après souper, dans la salle à manger de M. Arnold, et une apparente concorde désarmait M. Gottlieb et rendait Wolff plus patient. Gertrude et Marguerite travaillaient dans une autre pièce.
Il faisait froid, le vent soufflait au dehors, et, à chaque rafale, maître Arnold, se frottant les mains, se félicitait tout haut et tout naïvement, d'être chez lui, près d'un bon poêle, entre deux bons amis, en face d'un bon pot de bière, et de n'avoir pas à courir les chemins.
Ces actes d'amour envers son domicile finirent par impatienter M. Gottlieb, qui s'écria d'un ton aigre-doux:
—Savez-vous bien, Arnold, que vous n'êtes guère charitable?
—Comment?
—Oui, vous êtes un égoïste. Vous vantez les douceurs du poêle, et de la table et de la bonne compagnie, devant moi qui vais être obligé de m'en aller, seul, à pied, par la neige.
—Eh bien, mon cher Gottlieb, voulez-vous rester ici? nous vous ferons un lit.
—Et que dirait Gudule, ma gouvernante, si demain, en m'apportant mon café au lait, elle ne trouvait personne dans ma chambre? Diable! j'ai ma réputation à garder, et autre chose encore. C'est une nuit bonne pour les voleurs.
—Hum! Crésus! vous avez les soucis de la richesse, dit en riant M. Arnold. Je vous prêterai mon manteau.
—Et une lanterne, reprit avec un peu de vivacité M. Gottlieb.
—Les réverbères ne sont pas éteints.
—C'est égal, j'aime à voir très-clair.
—Gottlieb! est-ce que vous seriez peureux?
—Moi, peureux! Ah! par exemple! repartit M. Gottlieb en se renversant sur sa chaise; vous me prenez pour une jeune fille.
—Hum! je me rappelle, continua M. Arnold, qu'un certain soir, nous revenions ensemble et que vous m'avez serré le bras très-fort, en passant devant une sentinelle que vous aviez prise pour un voleur.
—Quel conte faites-vous là? demanda M. Gottlieb de plus en plus gai, mais avec une animation dans le visage qui trahissait un secret mécontentement.
Wolff eut la tentation d'une action mauvaise, et il y céda; il crut s'apercevoir que M. Gottlieb, l'esprit fort, le savant, était un poltron, et il voulut s'amuser.
—Il ne faudrait pas vous défendre, mon cher monsieur Gottlieb, dit-il avec calme, d'une délicatesse de nerfs qui est toujours une distinction. Avoir peur d'un autre homme, le jour, en plein midi, dans la rue, c'est le fait d'un lâche. Mais avoir peur, la nuit, dans l'obscurité, des revenants, des ombres, de tous les mystères enfin qui comblent l'intervalle de la vie à la mort, ce n'est là qu'un fait ordinaire, et tout homme d'imagination peut l'avouer.
—Allons donc, murmura M. Gottlieb, vous voulez rire!
—Moi! oh! je ne ris jamais de ces choses-là! La peur est un sentiment respectable. Vous savez que les anciens la supposaient fille de Mars et de Vénus.
—Oui, oui, je sais cela, balbutia M. Gottlieb qui ignorait complétement ce détail.
—On lui donnait de singuliers parents, dit M. Arnold avec un gros sourire, et ne sachant pas trop si son ami Wolff parlait sérieusement ou se moquait de son autre ami Gottlieb.
—Pourquoi vous étonner? reprit Wolff, la peur est la conséquence d'un vrai courage, de celui qui tient compte de toutes les influences; elle est aussi le produit des sentiments tendres. Oui, Mars et Vénus sont bien ses parents, et il est constant que la plupart des héros ont sacrifié à la peur.
—Oh! oh! vous allez trop loin, dit M. Gottlieb qui ne tenait pas absolument à passer pour un héros.
—Du tout, l'histoire est là pour le prouver. Thésée, qui n'était pas un poltron, vous en conviendrez, monsieur Gottlieb...
—J'en conviens.
—Eh bien, Thésée, qui s'exposait à rencontrer dans ses courses des monstres effrayants, fit un sacrifice solennel à la Peur. Alexandre le Grand...
—Comment! Alexandre, lui aussi? ne put s'empêcher de crier M. Gottlieb.
—Sans doute. Alexandre, l'ignoriez-vous donc?
—Oui, oui, je le savais, mais je l'avais oublié.
—Alexandre, avant la bataille d'Arbèles, rendit honneur à la fille de Mars et de Vénus. Rome avait un temple pour la Peur et pour la Pâleur.
—Pour la Pâleur aussi? voilà qui est trop fort! dit le bon M. Arnold qui ouvrait de grands yeux pour mieux entendre tout ce qui se disait. N'est-ce pas, mon cher Gottlieb? Tiens, est-ce que vous seriez malade, mon cher ami? vous avez mauvaise mine.
—C'est la pipe ou c'est la bière, murmura M. Gottlieb; je ferai bien de m'en aller.
—Attendez encore un peu, dit Wolff qui n'avait jamais été si tendre pour son ennemi, l'ouragan va s'apaiser. D'ailleurs, il n'est pas minuit, et c'est à minuit, vous le savez, mon cher monsieur Gottlieb, que les démons, les fantômes et les gnomes font leurs apparitions.
—Oui, oui, ce sont les bonnes femmes, les commères qui disent cela; mais je n'y crois guère, moi, aux fantômes, aux vampires, à tous les sortiléges! Et en parlant ainsi avec une animation presque fébrile, M. Gottlieb prenait des airs fanfarons les plus comiques du monde: C'est que je suis un esprit fort, moi! dit-il comme conclusion et en appuyant ses deux poings sur ses genoux pour regarder Wolff, bien en face.
—Alors, je suis sans doute un esprit faible, reprit Wolff; car je crois tout, ou plutôt je ne nie rien. Oui, j'imagine et j'aime à penser qu'il y a au-dessus de nous, autour de nous, un monde que nous ne connaissons pas, que nous ne pénétrons pas par les yeux de la chair, mais qui peut, dans certaines circonstances extraordinaires, se laisser entrevoir. Il y a des visions bien constatées et qu'on ne peut révoquer en doute.
—Je ne suis pas visionnaire, moi, dit M. Gottlieb dont la voix perdait son assurance.
—Vous n'en savez rien, mon cher monsieur Gottlieb, repartit doucement Wolff. Je vous crois trop instruit et de trop bonne foi pour nier l'évidence. Vous ne croyez pas aux visions parce que vous n'en avez pas encore vu.
—C'est possible, après tout, répondit M. Gottlieb qui se laissait aller insensiblement à la pente qu'on lui ménageait.
—Est-ce qu'il n'est pas évident que les âmes de ceux qu'on a bien aimés reviennent parfois nous visiter, et vivent, après la vie, dans l'air que nous respirons?
—C'est évident, dit M. Arnold qui se rangeait d'ordinaire à l'opinion de Wolff.
—C'est évident, répéta M. Gottlieb.
—Et les âmes de ceux qu'on a tourmentés, torturés, ne reviennent-elles pas aussi se plaindre et tourmenter leurs bourreaux?
—Oui, oui, balbutia M. Gottlieb qui regarda la grosse horloge et qui s'aperçut qu'il était bientôt minuit.
—Si nous le voulions tous les trois fermement, continua Wolff, qui s'amusait beaucoup de son expérience, nous pourrions évoquer, par la puissance de notre volonté, la personne que nous aimons ou que nous haïssons le plus.
—Moi, je ne hais personne, dit M. Gottlieb, qui chercha du regard son chapeau et sa canne.
—Ni moi non plus, dit M. Arnold.
—Mais vous aimez, peut-être? dit Wolff en souriant et en regardant l'ancien joaillier avec un petit air d'interrogation sardonique.
M. Gottlieb, qui était assez pâle, rougit beaucoup et retomba sur son siége.
—Pourquoi m'interrogez-vous? demanda-t-il.
—Allons, mon cher monsieur Gottlieb, invoquez, évoquez le fantôme de l'objet aimé; moi je vais en faire autant, pour ma part, en conscience.
Et Wolff, qui n'avait jamais été d'une gaieté pareille, affecta de mettre la tête dans ses deux mains, comme s'il méditait. Les deux vieux amis ne savaient plus trop s'ils devaient rire ou prendre la conversation au sérieux. Ils se regardaient tour à tour et regardaient devant eux. Comme on avait fumé pendant toute la soirée, l'atmosphère avait de la lourdeur et ces bonnes gens étaient dans des nuages authentiques.
Tout à coup, au beau milieu du silence qui s'était établi, et tandis qu'on n'entendait que le ronflement du poêle et le bruit du vent qui frappait au dehors, la porte s'ouvrit, une femme s'avança lentement, étendant les mains et écartant la fumée, qui formait comme un voile vaporeux, semblable à celui qui accompagne d'ordinaire les féeries.
M. Gottlieb, dont les deux yeux rougis sortaient de leur orbite, comme des escarboucles qui tombent de l'écrin, poussa un cri. Arnold répéta l'exclamation. Wolff regarda à son tour et tressaillit. Tous les trois, ils avaient fait mentalement la même évocation, et tous les trois, ils étaient stupéfaits.
—Mademoiselle Gertrude! dit le jeune homme.
—Tiens, c'est Gertrude, répéta maître Arnold.
—Gertrude! balbutia comme un écho le pauvre M. Gottlieb, qui essayait de raffermir son courage et qui se sentait bien, dans ce moment, le petit-fils de Mars et de Vénus.
—On dirait que je vous ai fait peur, dit la jeune fille, qui s'était avancée jusqu'à la table.
—Peur! s'écria Gottlieb. Ah bien oui!
—Peur! répéta Arnold, toi, mon enfant!
—En effet, mademoiselle, vous nous avez fait peur, dit Wolff simplement; nous parlions d'apparitions célestes, sans y croire beaucoup; vous êtes venue, et nous y avons cru tous les trois.
Gertrude regarda M. Wolff, en ouvrant ses grands yeux étonnés. C'était la première fois que leur ami hasardait quelque chose qui ressemblât à une galanterie; elle en conçut plus de tristesse que de joie.
—Je venais vous avertir de l'heure, dit-elle; il est minuit; c'est bien tard, monsieur Gottlieb, pour vous retirer.
—Vous croyez qu'il est si tard que cela? répondit M. Gottlieb, qui ne connaissait que trop l'heure exacte et qui n'avait pas cessé de regarder de temps en temps l'horloge.
—Encore une fois, voulez-vous rester, mon cher ami, dit le bon M. Arnold?
—En effet, ajouta Wolff, si vous avez peur de rentrer.
—Peur! qui vous a dit que j'avais peur?
—Je juge d'après moi-même; je ne serais pas rassuré, moi, tout seul, dans les rues, par ce temps-là. Il neige, il fait un vent épouvantable.
—Vous croyez que je ferais bien de rester? demanda M. Gottlieb, qui désirait qu'on lui fît violence.
—Certainement, répéta-t-on en chœur.
—Eh bien, je reste.
Gertrude sortit pour aller donner des ordres à Marguerite.
—Mais j'y pense, reprit l'ancien joaillier, ma vieille Gudule sera inquiète: je me rappelle qu'elle devait m'attendre; elle ne se couchera pas et croira qu'il m'est arrivé malheur.
—Si vous le permettez, dit Wolff, je m'offre pour aller l'avertir.
—Oh! je craindrais d'abuser.
Mais Wolff ne laissa pas à M. Gottlieb le temps de refuser; il prit sa casquette, courut à la porte, et deux minutes après, on l'entendait dans la rue marcher en fredonnant.
—Le bon jeune homme! dit Arnold avec admiration.
—Ah çà, reprit au bout de quelques instants M. Gottlieb, puisqu'il avait si peur, lui aussi, de la nuit et de la neige, pourquoi donc s'en va-t-il seul, avec cet empressement?
—C'est qu'il se dévoue, répondit M. Arnold.
—Oh! c'est plutôt qu'il s'est moqué de moi, le traître! Il a voulu me faire passer pour un poltron. Je me vengerai.
—Bah! à quoi allez-vous songer? Couchons-nous, il est tard.
—Ce Wolff est un brigand! Je vous en avertis, Arnold.
—Lui! bonté du ciel! un agneau, doux comme une femme!
—C'est cela même: doux, mais malin comme une femme. Je me vengerai, je me vengerai!
—Allons nous coucher, Gottlieb.
Gertrude et Marguerite parurent avec des flambeaux. La double apparition était prévue et ne fit peur à personne.
Une demi-heure après, tout le monde dormait dans la maison. Quand Wolff rentra, il était fort tranquille; et ce fut avec une lenteur qui donnait raison à M. Gottlieb et qui excluait toute idée de pusillanimité, qu'il ouvrit la porte. Mais si Wolff s'était amusé, M. Gottlieb se vengea réellement.
Puisque Wolff, qui était un garçon timide, peu rompu à toutes les finesses de la méchanceté humaine, s'était émancipé jusqu'à faire sortir de sa cachette la vilaine poltronnerie de M. Gottlieb, il eût dû s'en tenir à la satisfaction de sa conscience de Machiavel, et ne pas vouloir un hommage et un aveu public de sa victime.
Le lendemain, l'ancien joaillier, dès qu'il fut debout, monta dans la chambre de son persifleur.
—Avez-vous bien dormi? lui demanda-t-il brusquement.
—Sans doute, répondit Wolff.
—La joie de vous être moqué de moi ne vous a pas donné d'insomnie?
Wolff devait évidemment garder un grand sérieux à cette insinuation; il commit, au contraire, la faute de rire aux éclats:
—C'est bien! c'est bien! jeune homme, riez, riez, dit M. Gottlieb en se frottant les mains; c'est de votre âge. Eh bien! moi, je vous en avertis, mon philosophe, je vous ferai pleurer.
—Vous croyez? demanda Wolff plus imprudent que jamais.
—Oui, je vous ferai pleurer, mon jeune ami, des vraies larmes qui tomberont de vos yeux, et que vous essuierez à deux mains. Ah! vous avez voulu savoir si je suis peureux! Eh bien, je prends de la peur pour moi, c'est vrai, mais j'en donne aussi aux autres: vous verrez!
Le bonhomme Gottlieb était vraiment formidable en parlant ainsi, avec un petit rire sardonique; il laissa Wolff assez surpris de cette menace, et il descendit pour savourer la tasse de café à la crème que maître Arnold lui avait fait servir. Que se passa-t-il entre les deux amis, quelles mystérieuses paroles furent échangées avant le départ de M. Gottlieb, voilà ce que Wolff eût bien voulu apprendre, quand il remarqua la contenance embarrassée de M. Arnold envers lui; mais voilà ce qu'il n'apprit que bien plus tard.
Ce qui lui parut évident à la première rencontre, ce fut l'attitude contrainte, triste de son hôte. Le père de Gertrude avait un secret pénible. Wolff n'osa pas interroger; il attendait discrètement les confidences, et il se fût reproché un mot qu'on eût pu interpréter dans le sens de la curiosité. Pourtant, il fit un signe à Marguerite, et quand celle-ci monta pour se coucher, elle vint frapper à la porte du jeune homme.
—Qu'y a-t-il, demanda la vieille servante? est-ce que, vous aussi, vous auriez votre idée fixe?
—N'est-ce pas, ma bonne Marguerite, M. Arnold a un chagrin?
—Sans doute, demain ce sera le tour à notre chère demoiselle. Ah çà! qu'est-il donc arrivé?
—C'est précisément ce que je voulais savoir, Marguerite. M. Gottlieb n'a rien dit devant toi.
—Rien; cependant je l'ai entendu grommeler quelque chose en s'en allant.
—Que disait-il?
—Des choses extravagantes, par exemple: «On me prend pour un âne dans cette maison, mais je ne suis pas encore bâté, et je brouterai bien des jolies petites fleurs.»
—Cela ne m'apprend rien, soupira Wolff.
M. Gottlieb ne revint pas de la journée ni de la soirée; il laissa probablement grossir et s'envenimer la piqûre qu'il avait faite à son ami. Wolff, qui resta aux aguets, n'entendit aucun bruit; il remarqua seulement qu'en baisant sa fille au front, avant d'entrer dans sa chambre, M. Arnold avait poussé un gros soupir.
Cette situation étrange se prolongea pendant deux jours; M. Gottlieb était devenu invisible; mais bien que son absence fût en réalité une délivrance, son souvenir, sa pensée pesait comme une menace.
Au bout des deux jours, Wolff n'y tint plus; il voyait M. Arnold si triste, si abattu qu'il résolut de lui venir en aide.
—J'ai tant d'amitié pour lui qu'il me permettra peut-être de pénétrer son secret, dit-il.
Dès les premiers mots, maître Arnold laissa échapper un véritable sanglot.
—Ah! mon ami, je suis le plus malheureux des hommes! et j'allais précisément monter pour vous consulter.
—Disposez de moi, monsieur Arnold, comme d'un fils.
—Bon Wolff! ce n'est pas vous, n'est-ce pas, qui songeriez jamais à enlever une fille à son père?
—Comment! mademoiselle Gertrude!
—Oui, ma fille, mon bonheur, vous, cette maison, Gottlieb en veut à tout cela! et..... je ne sais comment lui résister.
—Mais en lui retirant votre amitié s'il en abuse, en lui fermant votre porte s'il vous manque d'égards.
—Ah! mon ami, vous ne savez pas ce que vous me conseillez là! c'est précisément l'impossible. Chasser Gottlieb! quand c'est lui!... Non, non, je n'ai qu'à mourir, cela vaudrait bien mieux, pour moi, pour elle, pour tout le monde.
Et l'excellent M. Arnold se couvrait le visage de ses deux mains.
—Montons chez moi, dit Wolff en passant son bras sous celui de son vieil ami.
Quand on fut dans la chambre du jeune homme, l'ancien drapier s'essuya le front, et d'une voix émue, en se renversant dans le fauteuil que Wolff lui avait offert:
—Je vais vous faire ma confession, mon ami. Vous allez savoir ce que tout le monde ignore dans la ville. On me croit riche, ou du moins dans une aisance qui enlève tout souci à l'avenir; c'est là une erreur. J'ai des dettes, de grosses dettes. Je dois à Gottlieb; et Gottlieb veut être payé.
—Ainsi la rumeur publique ne se trompe pas, ce faux ami est un usurier! s'écria Wolff.
—Ne dites pas cela, ne dites pas cela, reprit M. Arnold avec vivacité. Gottlieb est un ancien commerçant très-expérimenté et très-habile; il veut faire rapporter à ses capitaux, en les plaçant, ce qu'ils lui rapportaient dans le détail, voilà tout. Mais laissez-moi vous raconter par ordre l'origine de mes chagrins. Ah! mon cher Wolff! il n'y a pas de plus grand malheur pour un bon mari que de perdre sa femme. Si vous aviez connu madame Arnold! Gertrude a toutes les qualités du cœur; mais ma femme, à toutes celles-là, joignait celles de la tête. On m'a toujours fait honneur de la prospérité de notre maison. Entre nous, cette prospérité, plus apparente que réelle, d'ailleurs, était l'œuvre de ma chère femme. Moi, je me connaissais en draps; je savais mieux que personne juger de la qualité, du tissage et du teint. Je faisais les emplettes, et je crois que, sans mentir jamais, j'étais assez adroit dans l'art de persuader les acheteurs. Mais ma femme! C'était elle qui enregistrait les recettes, qui dressait l'inventaire, qui était le génie financier de la maison! Voyant que je me fatiguais, elle avait voulu, la chère et tendre amie, me donner une maison hors la ville; celle-ci, monsieur Wolff. Par malheur, nous n'étions pas assez riches pour payer comptant. Ma femme s'avisa d'emprunter à Gottlieb. Elle était certaine de rembourser: elle avait fait ses calculs, et en dix ans tout devait être payé, et nous nous serions trouvés riches et heureux. Mais dix ans! c'est l'infini dans le commerce. Ma pauvre femme devint malade, et je suis certain que le chagrin de me laisser des embarras fut pour beaucoup dans sa mort prompte. Si vous saviez, mon bon Wolff, avec quelle sollicitude, dans sa maladie, elle essayait de m'instruire de ce que j'aurais à faire! Elle est morte la main étendue sur le livre de caisse. Le bon Dieu est juste; et puisqu'il nous frappe, c'est qu'il a ses raisons. Je me courbai donc sous la terrible épreuve qu'il m'envoyait. Après avoir pieusement et chrétiennement enterré ma femme, je me relevai avec courage:—Allons, maître Arnold, me dis-je à moi-même, tu as ta fille à élever, à aimer, à doter: travaille!—Ce n'est pas la bonne volonté, ce n'est pas le courage qui m'a manqué, c'est l'inspiration. Le bon Dieu devrait faire mourir à la fois les deux époux, quand il frappe des commerçants. Je ne pouvais pas suffire aux achats, à la vente, à la caisse. J'achetai trop vite, mal à propos. Je vendis à perte des marchandises dont je m'étais encombré, et je ne sus pas calculer avec assez de soin les comptes d'intérêt. Bref, au bout de quelques mois, je m'aperçus que j'allais vers un abîme. La dette envers Gottlieb, que ma femme avait commencé à diminuer, et qui eût été éteinte, s'était considérablement accrue. Je vendis à la hâte mon établissement: il me fallut subir un rabais énorme sur des marchandises que mon successeur traitait de désavantageuses. Je vins m'installer ici avec ma fille et Marguerite. Chez moi? non, chez Gottlieb, car les petits à-compte donnés sur le prix de la maison ne me donnent pas le droit d'en revendiquer la propriété. J'espérais, à force d'économie, en utilisant des créances que j'avais gardées, et avec l'argent provenant de la vente de ma maison, m'acquitter peu à peu; mais d'abord, ces créances, pour en tirer parti, il fallait attendre, profiter des occasions. Gottlieb me les racheta, mais me fit perdre beaucoup. Les affaires allèrent mal: mon successeur, au lieu de me payer régulièrement, me demanda du temps et me fit des billets: l'ami Gottlieb escompta ces billets. Vous le voyez, mon ami, ma situation est bien loin d'être aussi avantageuse que le public la supposait. Cependant Gottlieb, qui n'est pas un méchant homme, me laissait tranquille, et, je le crois, aurait pris patience jusqu'à ma mort, si, tout à coup, il ne s'était mis en tête que nous nous étions moqués de lui.
—Hélas! s'écria Wolff, c'est moi, monsieur Arnold, qui, par mon étourderie, suis la cause de vos chagrins. Je ne m'en consolerai jamais.
—Non, mon ami. Gottlieb, je l'ai découvert, avait un plan. Il a été tenté de le démasquer plus tôt qu'il ne voulait, pour se venger. Mais tôt ou tard, mon bon Wolff, j'aurais été sa victime.
—Que veut-il? que demande-t-il? cet infâme usurier, ce Shylok!
—Ne lui dites pas d'injures, mon bon Wolff, même en son absence; il trouverait moyen de les entendre: c'est un homme si fin! Ce qu'il veut? Parbleu, il veut tout! moi, ma maison, ma fille!
—Votre fille! vous! parlez, expliquez-vous!
—Eh bien! voilà: Il y a deux jours, il m'a pris à part, et il m'a dit:—Mon cher Arnold, j'aurais besoin de tout mon argent, parce que je songe à me marier.—J'ai voulu rire; car si Gottlieb est un peu plus jeune que moi, il ne l'est pas assez pour prétendre me traiter en vieillard et se traiter en jeune homme.—Et avec qui songez-vous à vous marier, compère? lui ai-je demandé.—Alors, mon ami, Gottlieb m'a regardé dans le blanc des yeux, et j'ai eu peur; et il m'a dit:—Avec mademoiselle Gertrude, votre fille, si vous voulez bien le permettre.
Wolff sentit une lame glacée lui entrer dans le cœur: il bondit sur sa chaise.
—Et qu'avez-vous répondu?
—Je n'ai rien répondu d'abord, mon ami. J'ai baissé la tête.—Je vous donne trois jours pour réfléchir, pour préparer Gertrude à voir en moi son futur mari, a ajouté Gottlieb, et il est parti, me laissant navré, désespéré.
—Il faut refuser, monsieur Arnold, il faut refuser.
—Croyez-vous que je vous demanderais un conseil, mon bon ami, s'il ne s'agissait que de suivre le mouvement de mon cœur. Oh! certainement, que je refuserais. Je m'étais fait à l'idée de ne jamais quitter mon enfant. Nous étions si bien dans cette maison, vivant tous ensemble! Mais, si je refuse, il me faut partir. Où aller? Le peu qui me restera suffira à peine à meubler une chambre. De quoi vivrons-nous? Je n'ai plus la force de travailler. Gertrude ne sait pas d'état. D'ailleurs, je mourrais plutôt que de lui devoir un morceau de pain... Oh! mon cher Wolff, je suis bien malheureux!
Wolff était tenté de dire à ce père au désespoir:
—Donnez-moi votre fille: je travaillerai, moi, pour vous tous.
Mais Wolff était très-pauvre. Ses parents, d'honnêtes cultivateurs, avaient fait d'énormes sacrifices pour l'aider dans ses études. Il devait se passer sans doute encore quelques années, avant qu'il eût un état, une place productive. D'ailleurs, Wolff ne voulait pas profiter de la détresse de la maison, pour prétendre à la main de Gertrude.
—Ne renoncez pas à tout espoir, dit-il à M. Arnold, en faisant un effort sur lui-même pour parler.
—Je n'ai pas tout dit, reprit M. Arnold en sanglotant. Gottlieb ne vous aime pas. Il prétend que vous avez juré de le rendre ridicule. Il m'a dit que votre présence ici nous faisait du tort à tous et...
—Et il exige que je m'en aille, n'est-ce pas? dit le pauvre jeune homme qui s'étonnait d'avoir le courage d'entendre ces cruelles confidences.
M. Arnold fit un signe de tête qui équivalait à une réponse affirmative.
—Eh bien, je m'en irai, mon vieil ami, mais quand je serai convaincu que je n'ai plus d'autre service à vous rendre. Avez-vous interrogé mademoiselle Gertrude?
—Je n'ai pas osé encore, et si vous vouliez...
—Que je lui parle de cet horrible projet? moi!
—Oui, vous, mon ami, pourquoi pas? demanda simplement M. Arnold; vous êtes avec moi et Marguerite son ami le plus cher. Elle vous dira tout à vous.
Wolff, dont le premier mouvement avait été de refuser, se ravisa tout à coup.
—Pourquoi pas? se dit-il aussi à lui-même; de quel droit hésiterais-je à lui parler? Est-ce que j'ai un intérêt?
—Mon cher monsieur Arnold, c'est une mission bien délicate et bien pénible que vous réclamez de moi, dit-il en passant la main sur son front pour en essuyer la sueur; mais je la remplirai. Ce soir, si vous le permettez, je descendrai; vous me laisserez seul avec mademoiselle Gertrude, et je serai digne, par les conseils que je lui donnerai, de votre amitié et de la sienne.
Le pauvre M. Arnold, sinon consolé, du moins tiré d'un embarras relatif, remercia Wolff du fond du cœur, essuya les grosses larmes qui roulaient sur ses joues, et promit d'avoir du courage, quelle que fût l'épreuve à laquelle il était réservé.
Quant à Wolff, dès qu'il se retrouva seul dans sa chambre, il s'enferma, prit sa tête à deux mains, et, avant toute délibération, soulagea son cœur et pleura comme un enfant.
—Il avait raison, cet homme horrible et grotesque, répétait-il, il avait raison, je pleure. Mon Dieu! que vais-je devenir et que deviendront-ils tous?
Wolff n'était pas un présomptueux, ni un égoïste. S'il eût suffi de broyer son cœur, de se condamner à un malheur et à des regrets éternels pour sauver ses amis, il n'eût pas hésité. Mais son devoir lui apparaissait plus difficile et plus obscur.
Le reste du jour s'écoula dans cet entretien suprême; quand la nuit vint, Wolff n'était pas plus avancé: il avait les mêmes doutes, les mêmes hésitations.
—Dieu m'inspirera, dit-il, en se préparant à descendre.
Gertrude tricotait dans la salle à manger. Marguerite filait auprès d'elle, et M. Arnold, penché sur une gazette, paraissait absorbé dans sa lecture et dans le commentaire de nouvelles politiques dont il n'avait pas déchiffré le premier mot; mais, en réalité, le pauvre homme écoutait son cœur battre, et n'osait prononcer un mot, de peur de laisser voir l'anxiété qui le torturait.
Wolff entra, résolu, grave, décidé à tout subir, mais ne sachant trop ce qu'il allait dire. Dès que M. Arnold l'aperçut:
—Marguerite, dit-il, viens dans ma chambre, j'ai à te parler.
—Mon père, dit aussitôt Gertrude qui laissa son ouvrage pour se lever, seriez-vous malade?
—Ne t'inquiète pas, ma fille, et reste là. Tiens compagnie à notre ami Wolff.
Gertrude, étonnée de ce refus, allait insister; mais elle se trouva en présence de leur hôte qui lui dit aussi:
—Restez, mademoiselle Gertrude. Monsieur votre père me permet de vous entretenir.
Gertrude avait rougi, et instinctivement elle avait porté la main à sa poitrine, tant elle était surprise et troublée. M. Arnold se hâta de sortir, suivi de Marguerite.
Wolff prit une chaise et parla ainsi.
—Mademoiselle Gertrude, je voudrais, avant de commencer, vous persuader de toute l'amitié sincère et profonde que j'ai pour vous.
—J'y crois, monsieur Wolff, répondit la jeune fille qui reprit son ouvrage et qui trembla de la peur d'entendre dire du bien d'elle.
—Croyez-vous que j'ai pour votre père l'affection d'un fils, pour vous le dévouement d'un frère?
—Je le crois, monsieur Wolff.
—Vous promettez donc de me parler comme à un ami, comme à un frère?
—Comme à un ami, répliqua Gertrude, comme à un frère, ajouta-t-elle assez surprise de la solennité de ce début.
—Vous n'avez pas remarqué depuis deux jours la tristesse de ce bon M. Arnold, et, dans ce moment, Gertrude, vous ne voyez pas ce que je souffre?
—En effet, monsieur Wolff, répondit la jeune fille qui releva vivement la tête, au risque de laisser voir la rougeur de son front, mon père était triste et vous êtes pâle.
—C'est qu'un grand malheur nous menace, mademoiselle Gertrude.
—Un malheur! vous nous quittez!
—Oh! ce n'est pas cela, reprit Wolff qui sourit tristement à la pensée des promesses contenues dans l'effroi de Gertrude, ce n'est pas seulement cela.
—Qu'est-ce donc, alors?
—Mademoiselle, votre père est ruiné; il n'a plus rien à lui.
Gertrude regarda Wolff en face, on eût dit qu'elle voulait savoir ce qui se passait dans la conscience du jeune homme.
—Mon père est ruiné, répéta-t-elle lentement. Eh bien! nous serons pauvres, voilà tout.
—Vous parlez comme une sainte, mademoiselle; mais cette misère, qui ne fait pas peur à votre courage, épouvante votre père. Il s'est habitué aux douceurs du repos, qu'il a bien mérité par trente ans de travail; s'il quitte cette maison, il mourra.
—Oh! je ne veux pas qu'il meure! Nous le sauverons, monsieur Wolff, nous le sauverons.
—Vous le sauverez, mademoiselle, et c'est précisément pour vous entretenir d'une chance de salut que je suis descendu.
—Parlez! parlez, balbutia Gertrude, qui n'osait pas prévoir les confidences de Wolff.
—Eh bien, dit le jeune homme en affermissant sa voix, votre père doit tout ce qu'il possède à un seul homme, à M. Gottlieb.
—Tant mieux! nous sommes sauvés, alors.
—Peut-être; mais savez-vous à quelle condition? M. Gottlieb ne chassera pas son vieil ami de cette maison; il ne laissera pas sur le pavé le compagnon de sa jeunesse, si.....
—Achevez.
—Si vous voulez bien devenir madame Gottlieb.
—Mon Dieu! s'écria Gertrude, qui porta la main à son front et qui devint plus pâle qu'une morte.
—Voilà ce que j'avais à vous dire, mademoiselle, murmura Wolff, qui craignait de s'évanouir.
Il y eut un silence. Gertrude essayait de comprendre le coup qui la frappait; mais elle le sentait et elle en mourait, sans en avoir la conscience bien nette. Elle releva peu à peu la tête, et regardant le jeune homme avec une pénétration que celui-ci n'eût jamais soupçonnée:
—Et que me conseillez-vous? balbutia-t-elle.
—Moi!
Wolff était au bord de l'abîme qu'il avait prévu. Mais il y a dans la jeunesse un besoin d'héroïsme qui triomphe des plus grandes défaillances du corps. L'étudiant n'osa pas soutenir ce regard, plein de feu, d'innocence et de foi (car le mot d'amour serait ici profane); il ferma à demi les yeux.
—Je vous conseille, Gertrude, si M. Gottlieb est impitoyable, d'épouser M. Gottlieb.
—Sincèrement, vous me le conseillez, mon ami? demanda la jeune fille dont la voix se raffermissait.
—Sincèrement je vous le conseille. Si Dieu permet ce sacrifice, vous devez immoler au bonheur, au repos de votre père, votre repos, votre bonheur. Je ferais cela pour mon père, vous devez le faire pour le vôtre.
—Merci, dit avec émotion Gertrude en lui serrant la main: vous avez répondu comme je le voulais; vous n'avez pas trompé mon amitié.
Wolff était au supplice; chaque parole rapprochait de lui l'âme de Gertrude.
—Vous en mourrez, mademoiselle.
—Je le sais bien, dit-elle avec un triste et religieux sourire; mais il n'y a pas autre chose à faire, n'est-ce pas?
Wolff hésita; il sentit un aveu frissonner sur ses lèvres; mais il eut honte du bonheur qu'il pouvait réclamer; puisque Gertrude devinait la mort et lui souriait, pourquoi aurait-il refusé sa part du calice?
—Il n'y a pas autre chose à tenter, Gertrude, je vous le répète, M. Gottlieb est inflexible. Votre père, qui vous aime, n'essayera pas de vous contraindre; mais la misère à son âge, mais le chagrin de quitter cette maison le tueraient; le devoir de le sauver est un devoir absolu.
—Je vous estime plus que je ne puis dire, monsieur Wolff, dit Gertrude avec un commencement d'exaltation. Vous faites bien de parler de devoir; c'est le mot des grands cœurs. O ma mère! ajouta-t-elle en soupirant, quel bonheur que vous ayez fait de moi une chrétienne; je puis et je sais me dévouer. Mais pourvu que j'en meure, mon ami!
Wolff garda le silence; s'il eût parlé, il eût peut-être fait le même vœu.
—Maintenant que nous sommes d'accord, reprit Gertrude avec une sérénité de martyre, racontez-moi donc ce qui s'est passé.
Wolff transmit tous les détails qu'il avait reçus de M. Arnold. Quand il eut fini:
—Vous avez raison, mon ami, dit la jeune fille. Mon pauvre père ne pourrait pas quitter la maison. Monsieur Wolff, vous me promettez de le consoler si je meurs bientôt.
—Ah! Gertrude! vous vivrez!
—Prenez garde, monsieur Wolff, vous allez mentir, dit avec un sourire angélique la pauvre enfant. Mais ne laissez jamais supposer à mon père que j'ai pu sacrifier quelque chose à son bonheur. Je paye assez cher son repos pour qu'aucun remords ne vienne le troubler. C'est tout ce que vous avez à me dire, n'est-ce pas?
—Tout.
—Eh bien! vous voyez, cela ne demandait pas tant de préparation. Bonsoir, monsieur Wolff, ajouta Gertrude qui se mit à enrouler son ouvrage, et qui, pour la première fois, ne tendit pas la main à son voisin.
Le pauvre Wolff comprit cette réserve. La jeune fille se sentait déjà fiancée à un autre. Il se leva, salua et se dirigea lentement vers la porte. Comme il allait sortir:
—Monsieur Wolff, dit Gertrude d'une voix qui, malgré ses efforts, se voilait de larmes, je devrais vous dire adieu, car vous partez demain, sans doute.
L'étudiant se retourna, et joignant les mains avec ferveur:
—Merci, Gertrude, merci de me laisser partir, merci surtout de vouloir que je parte.
Il embrassa dans un regard rapide le doux tableau qu'il voyait pour la dernière fois: Gertrude assise et éclairée par la lampe, cette table où si souvent il s'était accoudé, cette salle où tous les meubles attestaient les longs soirs passés en famille et les beaux rêves qu'il avait faits tout bas; puis, ouvrant la porte, il regagna sa chambre en s'appuyant au mur. M. Arnold l'attendait au passage.
—Eh bien! mon ami?
—Eh bien! mademoiselle Gertrude consent; elle vous le dira elle-même. Ce mariage ne lui déplaît pas.
—Il ne lui déplaît pas. Pauvre enfant!
Wolff craignit d'être obligé de répondre à d'autres questions; il se hâta de serrer la main à M. Arnold et de rentrer chez lui.
Quand il fut seul, les larmes séchées depuis le matin reparurent plus violentes, plus insensées. Une heure après il entendit frapper à sa porte, il courut ouvrir. C'était Marguerite.
—Eh bien! et vous aussi? dit-elle en lui voyant essuyer ses yeux.
—Comment? est-ce que Gertrude?...
—Ah! mon cher monsieur, quand je suis descendue dans la salle à manger, je l'ai trouvée étendue sur le carreau, comme morte; je l'ai prise dans mes bras, je l'ai presque portée dans sa chambre; et là, bonne sainte Vierge! elle a eu la première, la seule attaque de nerfs que je lui aie jamais vue. J'ai cru qu'elle allait rejoindre sa mère. Enfin elle s'est calmée, c'est-à-dire qu'elle a pu pleurer. Pauvre enfant! c'était bien la peine de lui économiser les larmes, pour qu'elle les répandît toutes à la fois. Quel chagrin! Elle en mourra. Oui, je vous le dis, et vous souffrez cela?
—Marguerite, prenez bien garde! ne laissez rien deviner à M. Arnold. Je partirai demain matin.
—Déjà!
—Oui, il n'est pas convenable que je reste. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas le courage de me taire. Marguerite, jurez-moi, sur votre salut, que vous ne quitterez par Gertrude.
—La quitter! pourquoi donc la quitterais-je? Ah! il faudra pourtant bien, car je suis bien vieille, et un jour ou l'autre...
—Jurez-moi, Marguerite, si elle était malheureuse, si elle souffrait... (Mais il est bien évident qu'elle sera malheureuse et qu'elle souffrira!) Jurez-moi, si elle était malade, de me faire prévenir par un mot; vous saurez toujours mon adresse. Je ne vivrai pas loin d'elle.
—Je vous promets, monsieur Wolff, dit la vieille bonne qui pleurait à son tour.
—Allons, Marguerite, dites-moi adieu et embrassons-nous.
—Ah! mon Dieu! mon Dieu! moi qui rêvais tant de vous servir et de vous appeler mon maître.
—Vous ne m'appellerez que votre ami, Marguerite.
—Qu'est-ce que nous allons devenir? Jésus! Marie!
Et la vieille servante se jeta en sanglotant dans les bras de Wolff, qui fut obligé de la consoler et de lui renouveler ses instructions. Au point du jour, sans avoir revu personne et en laissant un mot d'excuse et d'adieu pour M. Arnold, Wolff quitta la maison. Il fut tout surpris de ne pas sentir son cœur se déchirer plus profondément quand il franchit le seuil. L'amour invincible qu'il emportait lui laissait, en dépit de tous les événements et de toutes les conjectures, une espérance qui rayonnait tout au fond de son cœur, même à travers la pensée de la mort et du tombeau.
M. Gottlieb devait venir dans la journée chercher la réponse. Il fut exact. Marguerite, en lui ouvrant la porte, le regarda d'un air si farouche, que l'ancien joaillier en conçut bon espoir. M. Arnold, un peu embarrassé, ne sachant trop s'il devait se réjouir ou se désoler de la soumission de sa fille, triste d'ailleurs du départ de son ami Wolff, s'avança au-devant de son débiteur:
—Bonjour, Gottlieb.
—Bonjour, Arnold. Eh bien! quelles nouvelles?
—Elles sont ce que vous désirez qu'elles soient.
—Comment! vous me payerez?
—Oui, je vous donne ce que j'ai de plus précieux, de plus cher au monde.
—Quoi! mademoiselle Gertrude!
—Elle consent.
—Et votre voisin, notre ami Wolff, que dit-il?
—Wolff est parti pour ne plus revenir.
M. Gottlieb parut fort étonné de la prompte conclusion d'une affaire dans laquelle sa malice se réservait sans doute plus d'une occasion de se faire sentir. Il voulut entendre de Gertrude elle-même la confirmation de son bonheur.
La jeune fille, très-pâle, mais impassible en apparence, descendit.
—Est-il vrai, mademoiselle, que vous consentez à devenir ma femme? demanda Gottlieb.
—Oui, monsieur, si mon père le permet, voici ma main.
—C'est librement que vous me la tendez?
Gertrude hésita, comme si une protestation pouvait attendrir et désarmer l'usurier! Mais elle pensa que Wolff était parti, qu'elle ne le verrait plus, que M. Gottlieb réclamait sa proie, qu'il fallait s'immoler, en épargnant des remords à son père.
—C'est librement, répondit-elle.
On eût dit qu'à son tour l'ancien joaillier ressentait quelque hésitation. Craignait-il un piége? ou bien, ce tyran qui, après tout, n'était pas un monstre, mais un simple égoïste, était-il touché et plus ému qu'il ne voulait le laisser paraître de ce sacrifice? En dépit des vraisemblances, je pencherais pour cette dernière opinion.
—Mademoiselle, dit-il le plus gracieusement qu'il put à Gertrude, j'apprécie toute la bonté, toute la générosité de votre cœur. Je ne serai pas un ingrat. Mon vieux camarade, cette maison vous reste; et vous, Gertrude, vous aurez à ma mort toute ma fortune. Je m'arrangerai pour vivre le moins longtemps possible.
Gertrude eut un pâle sourire, qui revendiquait sans doute le droit de mourir la première. Gottlieb ne vit que le mouvement des lèvres, il n'en devina pas le sens. Il s'inclina, remercia encore; et tout fut dit pour ce jour-là sur ce sujet.
Le mariage s'accomplit. Il y eut des gens pour l'envier. Gertrude ne démentit pas un instant l'engagement qu'elle avait pris. Pâle, mais trouvant le courage de rassurer son père, elle s'efforça de ne pas penser à Wolff en recevant l'anneau de M. Gottlieb. Elle pria avec ferveur; et il lui sembla que sa mère dans le ciel tressaillait à la vue de son sacrifice et lui promettait bientôt une place auprès d'elle.
M. Gottlieb, il faut le reconnaître, remplit très-exactement sa promesse; il déchira ou rendit à M. Arnold tous les billets qu'il en avait reçus, et ce dernier, en rentrant dans sa maison, put se dire qu'il en était bien véritablement le propriétaire. Toutes les preuves de sa dette avaient été anéanties. Il faut avouer que la satisfaction ressentie par M. Arnold contribua à dissiper les derniers doutes et les quelques scrupules qui lui restaient encore. Décidément Gottlieb était un honnête homme et sa fille devait être heureuse. Cet ancien marchand faisait entrer la probité commerciale en ligne de compte pour le bonheur.
Gertrude ne chercha pas à détruire cette illusion; mais sa pâleur, sa morne sérénité étaient de terribles confidents pour un père ingénieux. M. Arnold ne l'était pas; il voyait l'apparence, et parce qu'il ne sentait pas de larmes dans les yeux de sa fille, quand il l'embrassait sur les yeux, il s'imaginait qu'elle ne pleurait pas. Comme si les larmes les plus douloureuses n'étaient pas celles qui s'égouttent silencieusement au dedans de nous et qui ne vont pas chercher des consolations en se faisant voir au dehors!
Deux personnes n'étaient pas dupes de cette résignation, Gottlieb et Marguerite. L'ancien joaillier aimait Gertrude; il n'avait voulu sérieusement l'épouser que pour se venger de la cruelle plaisanterie de M. Wolff. Sans cet incident, il se fût peut-être contenté de la joie paternelle de la voir tous les soirs, de lui sourire, de l'embrasser au front. Mais, bafoué par son rival, il usa et il abusa des armes terribles qu'il avait; et, sans en éprouver de repentir, il se sentait un peu confus de sa victoire. Aussi, par tous les moyens possibles, s'efforçait-il de prouver sa reconnaissance. Mais la seule chose, hélas! qu'il ne pût donner, c'était la seule qui pût sauver Gertrude. La pauvre femme dépérissait. Sans hâter autrement que par ses vœux l'heure de sa mort et de sa délivrance, elle jouissait de se sentir menacée, et elle constatait avec une joie profonde chaque symptôme qui l'approchait du but.
Marguerite était dans le secret.
—Vous n'êtes pas raisonnable! disait-elle à sa jeune maîtresse.
—Il s'agit bien de raison! répliquait Gertrude en levant les yeux au ciel.
Marguerite n'osait pas parler de M. Wolff. Elle comprenait, avec l'instinct de son dévouement, que la pensée de son ami ne rattacherait pas Gertrude à la vie; au contraire. Du reste, la vieille servante en voulait moins à M. Gottlieb qu'à M. Arnold. N'était-ce pas ce dernier qui avait causé tout le mal? Comme un jour le père de Gertrude se plaignait seul à Marguerite du ton rogue qu'elle affectait envers lui, le cœur de celle-ci déborda tout à coup; elle se vengea, en devenant parjure.
—Ah! monsieur, vous vous étonnez de ma mauvaise humeur, vous devriez dire de ma rancune!
—Que t'ai-je donc fait, Marguerite?
—A moi? rien. Mais à votre fille?
—A ma fille! N'est-elle pas heureuse?
—Heureuse, elle, la pauvre âme! Vous êtes donc aveugle? vous ne voulez donc rien voir? Comment! vous ne vous apercevez pas qu'elle meurt, qu'elle languit, et que vous la pleurerez bientôt, vous qui n'avez pas su vous sacrifier pour elle?
—Tu es folle, Marguerite. Gertrude paraît heureuse. Ce mariage, c'est elle qui l'a voulu. Je ne l'ai pas forcée.
—Oui, vous ne lui avez pas mis le couteau sur la gorge. Vous ne lui avez pas dit: Meurs, pour que je vive à mon aise! Mais vous avez gémi devant elle, et pour vous conserver la maison que vous aimiez, les habitudes que vous aviez prises, elle s'est jetée tête baissée dans le mariage.
—C'est impossible! dit M. Arnold avec stupeur.
—Impossible! demandez à M. Wolff qui s'est en allé le désespoir dans l'âme! demandez à ces pauvres enfants qui se sont aperçus qu'ils s'aimaient, quand leur séparation est devenue fatale! Est-ce que je ne l'ai pas rapportée morte dans sa chambre, le soir où M. Wolff lui a conseillé de se sacrifier pour vous? Est-ce que je n'ai pas entendu M. Wolff pleurer toute la nuit? Vous avez fait le malheur de ceux que vous aimiez, et vous voulez que je ne vous garde pas rancune! Mais si je ne vous aimais pas, monsieur, j'aurais été capable de vous tuer.
M. Arnold réfléchit et comprit. Il tomba sur un siége et se couvrit le visage de ses deux mains:
—Oh! malheureux que je suis! J'ai été lâche! Et ma femme, qui a vu cela dans le ciel, comme elle a dû me mépriser!
Quand il rencontra sa fille, M. Arnold l'attira à l'écart:
—Pardonne-moi, ma bonne Gertrude, lui dit-il en fléchissant le genou, j'ai été aveugle et sourd, je n'ai rien vu, je n'ai rien deviné. Tu souffres pour moi, pardonne-moi, car je ne me pardonnerai jamais.
Gertrude essaya de le calmer, et fit mentir son regard, n'osant pas mentir elle-même.
—Marguerite m'a tout dit, ajouta Arnold, et je vois clair maintenant. Tu aimais notre...
Gertrude l'interrompit.
—Je n'aime que vous, mon père, et vous me ferez de la peine si vous êtes triste encore.
—Vois-tu bien, s'écria assez spirituellement M. Arnold, vois-tu bien que tu n'aimes pas ton mari!
Gertrude lui mit la main sur les lèvres et l'empêcha de continuer. Marguerite fut sévèrement grondée; mais la pauvre femme serait morte de ne pas parler; elle éprouvait une bien insuffisante consolation des reproches adressés à M. Arnold. Toutefois, il lui semblait juste que le père de Gertrude connût bien toute la violence de la tendresse de sa fille. Hélas! à cet égard la conviction de M. Arnold fut complète. Ce pauvre vieillard avait reçu un coup mortel. Il s'enferma dans sa maison, ne sortit plus, passa les journées entières à pleurer, et s'éteignit au bout de six mois.
Heureusement, pour la conscience de Marguerite, les médecins ne croient pas aux maladies morales. Ils trouvèrent des raisons si plausibles de la mort de M. Arnold, que l'on fut convaincu, et que Marguerite resta persuadée, au contraire, que, sans le sacrifice de sa fille, le pauvre homme, miné par la maladie et le désespoir, serait mort six mois plus tôt.
Quant à l'opinion de Gertrude à cet égard, nul ne la connut jamais. Elle voulait si bien mourir, qu'elle porta le deuil de son père comme une espérance, et qu'elle pleura M. Arnold, comme s'il partait sans elle pour un rendez-vous auquel ils étaient attendus l'un et l'autre. M. Gottlieb essaya de la distraire; mais il ne put la guérir: un mal mystérieux la dévorait. Au bout d'un an, des évanouissements qui faisaient craindre à chaque fois qu'elle ne rendît le dernier soupir devinrent très-fréquents. Tous les médecins de la ville furent consultés; ils crurent à une maladie de cœur, à un anévrysme, et M. Gottlieb fut prévenu du danger qui menaçait sa femme. Il devait s'attendre à la voir un jour tomber morte entre ses bras.
Cette perspective, qui menaçait l'ancien joaillier comme un châtiment, ne contribua pas peu à assombrir son humeur. Il craignit que sa présence ne hâtât ce moment fatal. Il vécut désormais seul, à l'écart, laissant Gertrude à ses longues mélancolies. Un jour, en rentrant d'une visite qu'il avait été faire au cimetière à son vieil ami Arnold, il entendit un grand cri. Il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête; ses jambes fléchissaient; il tomba à genoux sur les premières marches de l'escalier et essaya de prier; sa femme était morte.
M. Gottlieb, dont nous connaissons d'ailleurs le courage, n'osa pas monter dans la chambre de celle qu'il avait tuée. Il se rendait justice. Quand Marguerite, levant les bras et jetant de grands cris, descendit lui confirmer le cruel événement:
—Adieu, adieu, dit-il.
Et, effaré, grelottant, comme s'il eût été poursuivi, il vint dans la maison de M. Arnold, restée déserte depuis la mort de ce dernier, s'enfermer, pleurer, ou plutôt mugir, en proie à tous les remords et à toutes les épouvantes.
Marguerite resta seule, chargée de rendre à la fille les tristes devoirs qu'elle avait rendus à la mère. La pauvre femme n'oublia pas, dans sa douleur, la promesse qu'elle avait faite à Wolff: elle le fit prévenir en toute hâte. Il n'était pas loin. Caché dans une petite chambre de la ville, depuis quelques jours, il usait son courage à combiner les moyens de soustraire celle qu'il aimait à une mort certaine. Mais par une pusillanimité qui tenait à de pieuses idées de famille, dont je n'ai pas à le défendre, chaque fois qu'il voulait intervenir résolûment, du droit de son amour, et enlever Gertrude à la captivité qui l'étouffait, un scrupule l'arrêtait court. Gertrude était mariée; Gertrude était la femme d'un autre: il la déshonorait pour la sauver. Je sais bien que ces craintes et ce respect eussent fait sourire en France. Dans la petite ville d'Allemagne dont je parle, elles faisaient hésiter le cœur honnête et rigide qui craignait d'entacher d'une honte involontaire la renommée de Gertrude.
Pourtant il était résolu à agir, à contraindre M. Gottlieb, quand le sinistre message vint lui donner tous les droits.
—Elle est bien à moi maintenant! s'écria-t-il, dans le premier transport d'une douleur farouche, et il accourut à la maison mortuaire.
Sur le seuil, il s'arrêta. Des sanglots se faisaient entendre. Marguerite, après avoir habillé Gertrude comme pour le jour de ses noces, n'avait pas pu soutenir plus longtemps le fardeau de son chagrin, et, entourée de voisines et de servantes, elle s'écriait vers Dieu, lui demandant un miracle, et se reposant de son courage dans son désespoir.
Wolff se sentit pénétré de cette foi sublime qui fait contempler l'éternité à travers la tombe.
—Rien ne nous séparera plus, dit-il; son âme m'attend, et je la rejoindrai bientôt.
Refoulant ses larmes, il monta, comme un martyr qui gravit le bûcher. A sa vue, les pleurs et les cris de la pauvre Marguerite redoublèrent.
—Je vous l'avais bien dit, lui cria-t-elle, qu'elle en mourrait!
Wolff sourit, mais d'un sourire à faire peur pour sa raison; il vint droit au lit où Gertrude reposait dans sa blanche parure, et, prenant la main de la morte, il en arracha l'anneau nuptial, s'agenouilla, et déposa sur cette main décolorée le premier baiser qu'il eût encore osé donner à Gertrude.
Tous les assistants comprirent, par une pudeur touchante, qu'il ne fallait pas intervenir entre Dieu, l'amour et la mort, et se retirèrent. Quand Wolff se vit seul, il prit un flambeau et contempla avec une volupté navrante ce beau visage qui lui souriait dans ses rêves:
—Comme elle est changée! murmura-t-il; je ne pourrai jamais me souvenir de cette pâleur et de ces yeux caves, je la verrai toujours avec ses joues roses et son lumineux sourire; mais qu'importe le souvenir! ne serai-je pas bientôt avec elle?
Pendant quelques minutes, les idées les plus folles, les plus sauvages lui traversèrent l'esprit. Il fut tenté de mettre le feu aux rideaux, de provoquer un incendie et de se laisser brûler, en tenant Gertrude entre ses bras. Mais cette chaste amie se défendait par la mort, comme elle s'était défendue vivante, par son innocence et par sa candeur. Il n'osait pas la prendre; il eût craint de la profaner, en la soulevant de ce lit nuptial, redevenu son lit de fiancée.
Pendant qu'il la dévorait des yeux, à travers toutes les extravagances qui assiégeaient son cerveau, il se mêla je ne sais quel vague souvenir poétique à sa douleur. Il est faux de croire que les grands chagrins soient toujours simples; ils cherchent instinctivement des termes de comparaison, des hyperboles. Wolff pensa qu'il était comme Roméo devant la tombe de Juliette; mais Juliette n'était pas morte, et elle avait pu recevoir dans un baiser le dernier soupir de son amant. Juliette n'était pas morte! Gertrude l'était-elle donc? Cette froideur était-elle bien celle du cadavre? Une illusion, une folie, un souhait impossible lui fit regarder avec plus d'attention; il mit son oreille sur ce sein qui avait cessé de battre depuis quelques heures à peine; il lui sembla qu'un mouvement persistait encore; il s'éloigna irrité de lui-même, mais il revint poser la main sur le front et crut sentir une moiteur.
—Mon Dieu! mon Dieu! s'écria-t-il, ne me faites pas devenir fou!
Il courut décrocher un petit miroir, le plaça sur les lèvres de Gertrude. O miracle, le miroir se couvrit d'une légère vapeur.
—Elle vit! elle vit! s'écria-t-il.
Et soulevant sa bien-aimée, réchauffant ses mains dans les siennes, improvisant, avec les fioles laissées dans la chambre, un breuvage qui pouvait être un poison, mais dont Dieu permit qu'il fît un cordial, il entr'ouvrit les lèvres contractées par une sorte de catalepsie, versa quelques gouttes et attendit.
Gertrude n'était pas morte; cette longue syncope avait trompé Marguerite. Aucun médecin n'avait encore été prévenu, et le miracle que demandait et que crut obtenir Wolff, n'était qu'un phénomène tout naturel qui se fût produit sans doute quelques minutes plus tard.
On a tant abusé de ces résurrections que je me permettrai d'abréger les détails de celle-ci; tout le monde peut suppléer par ses souvenirs.
En revenant à la vie, Gertrude fut d'abord étonnée, et n'eut pas conscience de ce qui se passait; elle regarda autour d'elle sans voir et balbutia:
—Marguerite!
—Elle va venir, répondit doucement Wolff.
Cette voix fit tressaillir madame Gottlieb; on eût dit que son cœur recevait une atteinte; l'intelligence embarrassée dans les brumes se dégagea soudainement:
—Wolff, c'est vous!
—Oui, c'est moi, Gertrude, moi, votre ami.
—Vous! Comment êtes-vous ici? pourquoi suis-je là? quelle est cette toilette?
—Gertrude, vous nous avez fait bien peur! la pauvre Marguerite s'est imaginé que je pouvais venir.
—On m'a crue morte, n'est-ce pas?
Wolff répondit d'un mouvement de tête; il commençait à songer que la vie lui enlevait Gertrude.
—Où est mon mari? demanda celle-ci.
—Il a eu peur, il a eu honte sans doute, il se sera enfui.
—Morte! morte! voilà donc comment on meurt! murmura la pauvre femme en laissant retomber sa tête sur l'oreiller.
—Chassez ces idées funèbres, Gertrude, vous vivrez; Dieu ne veut pas que vous mouriez encore.
—Hélas! je n'ai donc pas assez souffert.
—Mais Dieu ne veut pas que vous souffriez davantage, reprit Wolff, avec une résolution qui frappa madame Gottlieb. Tout le monde vous croit morte, Gertrude, restez morte pour tout le monde et ne vivez que pour moi!
—C'est impossible, Dieu ne m'a pas déliée de mon serment.
—Mais ce lâche abandon de votre mari?
—Mon honneur ne dépend pas de mon mari; il dépend de moi seule.
—Marguerite nous gardera le secret; fuyons.
—Ah! monsieur Wolff, pourquoi êtes-vous venu? dit d'un ton de supplication touchante Gertrude effrayée. J'avais gardé de votre courage et de votre fidélité au devoir un si bon souvenir! Ne gâtez pas notre passé de confiance et de joie pure. Retirez-vous, mon ami. Vous avez cru venir dans la chambre d'une morte; vous ne pouvez pas rester dans la chambre de madame Gottlieb.
Tout cela fut dit d'une voix douce et ferme, avec une simplicité adorable. Wolff se sentait dominé par cette innocence; il se tut pendant quelques instants, se consulta; l'orage qui grondait en lui s'apaisa sous sa volonté; il fut jaloux de Gertrude, et élevant son sacrifice à la hauteur de celui de la jeune femme:
—Vous avez raison, madame, lui dit-il avec tristesse, nous n'avons pas encore assez souffert, la mort nous unissait, la vie nous sépare. Adieu.
Il fit un pas pour sortir; mais s'arrêtant tout à coup:
—C'est pourtant un plus grand sacrilége de vous abandonner à une existence odieuse! Ah! si Gottlieb était là, je le prendrais pour juge entre lui et moi!
—Eh bien, dit Gertrude, avec une énergie placide qui étonnait, après la longue syncope dont elle sortait à peine: conduisez-moi à mon mari.
—Quoi! vous voulez?...
—Je veux qu'il sache que pendant qu'il m'abandonnait, vous me sauviez; que, quand il fuyait, vous accouriez, et que pouvant fuir ensemble, nous avons respecté les droits d'un homme qui ne les respectait plus lui-même, et fait notre devoir, quand même.
—Gertrude, y songez-vous?...
—Je ne veux pas que M. Gottlieb apprenne par d'autres que par moi ce qui s'est passé. Je veux que dans la solennité de cette nuit, mon cœur soit compris par vous et par lui. Après..... je pourrai mourir. Monsieur Wolff, appelez Marguerite.
Wolff alla chercher la vieille servante.
—Croyez-vous aux miracles, lui dit-il?
—Je crois en Dieu, répondit-elle.
—Eh bien, entrez et voyez.
Marguerite fut éblouie comme par une vision, en apercevant Gertrude debout, au milieu de la chambre, dans sa toilette de mariée. Elle crut à un mirage, à un sortilége, mais quand elle sentit dans les siennes les mains de la jeune femme; quand elle put l'embrasser; alors il fallut bien se rendre à l'évidence et remercier Dieu.
—Ah! je savais bien que j'avais trouvé les bonnes prières pour attendrir le ciel, s'écria la pauvre femme, dans un accès de pieux orgueil.
Wolff sourit.
—Ma bonne Marguerite, dit Gertrude, une autre fois, ne sois pas si prompte à me croire morte.
—Vous l'étiez! n'est-ce pas, monsieur Wolff? répliqua Marguerite.
—Eh bien! je pourrais l'être encore, de la même façon, sans que ce fût pour toujours. J'ai le secret de ressusciter. Marguerite, où est M. Gottlieb?
—Dans la maison du faubourg, sans doute.
—C'est bien, dit Gertrude; c'est là, en effet, que doit avoir lieu notre première rencontre. Venez, monsieur Wolff.
Et madame Gottlieb, s'enveloppant du voile qui avait été placé sur sa tête, fit quelques pas pour sortir.
—Où allez-vous ainsi, à pareille heure et dans ce costume? demanda Marguerite.
—Je vais retrouver mon mari, répondit Gertrude. Je vais le consoler, ajouta-t-elle en souriant.
—Mais vous êtes si faible.
—M. Wolff m'accompagnera jusque-là. Ne sois pas inquiète, Marguerite, et attends-nous!
Marguerite n'essayait plus de comprendre. Les émotions de la journée et celle qu'elle venait de ressentir par surcroît l'étourdissaient et l'accablaient. Elle tomba dans un fauteuil, et dit avec un soupir de lassitude:
—Jésus, Marie! que vais-je encore voir cette nuit!
Madame Gottlieb, affermissant son pas, descendit l'escalier et sortit de la maison, appuyée au bras de Wolff. La nuit était belle et douce, on était au printemps; la lune éclairait, et répandait comme une tenture argentée au-devant de Gertrude; une brise légère soulevait les extrémités de son voile et les faisait flotter comme des ailes.
—L'air des vivants a encore des douceurs pour moi, dit la jeune femme. Je respire plus à l'aise: je crois, monsieur Wolff, que je suis guérie!
Wolff ne répondit rien. Il pensait que la route n'était pas longue à parcourir; qu'ils seraient bientôt arrivés à la maison du faubourg; que M. Gottlieb reprendrait son bien, et qu'il se retrouverait seul, lui, avec son amour et ses regrets.
—Voyez donc, monsieur Wolff, comme les étoiles sont éclatantes! disait Gertrude; quelle nuit! Dans quelle étoile serais-je allée, si j'étais morte? Vous qui êtes un savant, vous me direz cela.
Wolff cherchait vainement des mots. Il regardait les étoiles avec Gertrude et soupirait. Son cœur battait dans sa poitrine; encore quelques minutes, et il devait laisser échapper pour jamais le rêve qu'il escortait.
On arriva à la petite maison du faubourg.
—M. Gottlieb dort peut-être, dit Wolff avec ironie; nous allons le réveiller.
—Ne le calomniez pas, répondit Gertrude avec douceur; lui aussi souffre beaucoup, je le sais.
—Eh bien! voilà une visite qui va le consoler, reprit Wolff avec un accent dans lequel on sentait une fureur sourde. Et saisissant le marteau de la porte, il frappa deux coups avec violence.
—Vous frappez comme pour réveiller un mort, dit Gertrude.
—Je frappe au nom d'une morte et à la porte d'un tombeau.
Gertrude ne répondit rien. Des pas se faisaient entendre; on vit briller une lumière par le trou de la serrure.
—Il hésite à ouvrir, murmura Wolff; il a peur.
Mais comme s'il eût voulu démentir cette assertion, M. Gottlieb, qui en effet avait peur et se consultait, ouvrit résolument la porte, en avançant sa bougie, sans doute en guise d'arme offensive, au moins, contre les visions et les fantômes.
A la vue de sa femme, qu'il croyait étendue dans son cercueil, M. Gottlieb poussa un cri sourd; sa figure se contracta; jamais l'épouvante ne mit une empreinte plus rapide, plus énergique sur un visage. Il voulut parler, recula jusqu'au milieu du couloir, en agitant ses mains, et tout à coup tomba foudroyé.
Gertrude s'élança; Wolff ramassa la bougie échappée aux mains de M. Gottlieb. L'ancien joaillier étendu sans mouvement râlait sur le carreau.
—Un médecin! s'écria Gertrude, qui souleva la tête de son mari.
Wolff courut réveiller un médecin dans le voisinage. Celui-ci vint en toute hâte et fut assez surpris de trouver M. Gottlieb dans le couloir de sa maison, la tête appuyée sur les genoux de madame Gottlieb, couronnée comme au jour de ses noces et vêtue de blanc. Il tenta une saignée sans résultat, et porta avec l'aide de Wolff le corps de l'ancien joaillier sur un lit.
Le lendemain, tout le monde sut dans la ville que M. Gottlieb était mort de peur et qu'il croyait aux revenants.
—C'est étonnant! disait-on; lui, un esprit fort!
Il est vrai que c'était M. Gottlieb qui avait répandu sur lui-même cette opinion, à laquelle il donna lui-même un éclatant démenti.
Wolff n'eut pas de remords. Gertrude en ressentit de véritables; mais elle n'avait pas besoin de faire absoudre ses intentions, qui avaient été pures, et comme, en définitive, les actes ne sont pas responsables, aux yeux de la morale, des conséquences qui se produisent contrairement aux intentions, la conscience de madame Gottlieb finit par s'apaiser.
Gertrude et Wolff ne sont pas mariés; mais ils le seront dès leur retour, car ils voyagent. La vieille Marguerite les attend dans une jolie maison qu'on prépare pour eux. Ils ne veulent pas habiter la maison où Gertrude a failli mourir, ni la maison où M. Gottlieb est mort. C'est déjà bien assez pour leur délicatesse d'user de la fortune du joaillier, qui se trouva léguée à sa veuve par un testament en bonne forme.
—Telle est, dit Frantz en terminant, la véridique histoire d'un jeune homme qui ne s'appelle pas Wolff, avec une jeune femme qui ne s'appelle pas Gertrude. Excusez les fautes du narrateur. Il est bien fâché que son récit ait de l'analogie avec Roméo et Juliette et avec toutes les histoires de mortes ressuscitées; mais il se flatte que, sur un point pourtant, on voudra bien reconnaître de l'originalité à son histoire; c'est sur le respect du devoir, au détriment de la passion, respect qui, heureusement pour la morale, trouva sa récompense dans la fin dramatique de M. Gottlieb, qui porte, bien entendu, un autre nom dans la réalité, c'est-à-dire sur son épitaphe.
—Ce dernier trait est cruel, dit Stanislas Robert. C'est bien assez de la pierre qui clôt le sommeil de monsieur... Gottlieb, sans ajouter cette épigramme.
Pendant le récit de Frantz, madame Carolina Brenner avait tenu les yeux baissés; et une rougeur très-vive couvrait son visage.
—Ainsi, dit madame Vernier, les héros de l'histoire en question sont...
—Je m'oppose, s'écria Ottavio, à ce qu'on insiste pour forcer la modestie de M. Frantz à des détails et à des aveux qu'il a bien le droit de se réserver. Nous sommes ici pour raconter et non pas pour nous confesser.
—Je me suis bien confessée, moi! dit madame Mendez.
—Croyez-vous que la confession soit complète? demanda sir Olliver à la belle Espagnole.
—Oui, monsieur; que manque-t-il à votre curiosité?
—Rien, ou peu de chose: je voudrais savoir ce que vous pensez de l'histoire de la belle Gertrude et du jeune Wolff?
—Je vous comprends. Vous voulez savoir si la femme qui a sacrifié le devoir à ses passions sait rendre justice aux âmes héroïques qui sacrifient les passions au devoir rigoureux? Eh bien! soyez satisfait. Je m'incline, je m'avoue dépassée. M. Frantz aura achevé d'éclairer ma conscience.
—C'est un service que personne ne lui demandait, dit madame Vernier, avec un petit sourire ironique et en regardant Stanislas Robert.
—Qu'en savez-vous, madame? reprit la señora Mendez, avec un incomparable accent de fierté.
—A quoi bon ce débat! dit vivement le peintre; l'histoire de notre ami Frantz est fort touchante et passablement morale. J'y trouve cette vérité: c'est que l'amour est agréable à la Providence et que le mariage a souvent tort, aux yeux même de l'éternelle sagesse.
—Voyez-vous ce que c'est que le sophisme! dit Frantz en se récriant; M. Robert va nous prouver le contraire de ce que j'ai démontré.
—C'est que tout est vrai dans les histoires du cœur, dit Ottavio, et que chacun y trouve ce qu'il y met.
—En somme, dit sir Olliver, ce conte nous démontre une fois de plus l'inconvénient des inhumations trop précipitées.
—C'est-à-dire, ajouta madame Vernier, que ceux qui ont la fatuité de se croire morts vivent souvent fort bien.
—Prenez garde, milord, dit Stanislas Robert, dont l'humeur s'aigrissait sensiblement, ceci me semble une allusion directe, et une flèche à l'endroit de la cuirasse de pierre que vous portez sur l'estomac.
Sir Olliver sourit.
—Ne serait-ce pas l'occasion d'obtenir de milord l'accomplissement de sa promesse? reprit Ottavio. Nous nous sommes tous exécutés. Je propose de mettre sir Olliver en accusation, s'il hésite un jour de plus à remplir les engagements qu'il a pris envers ses sujets.
—Mes sujets sont de mauvais sujets, répondit l'Anglais en souriant. S'ils me forcent à remplir mon programme, je déclare le gouvernement impossible, et j'abdique.
—Soit, interrompit madame Vernier, abdiquez; mais alors, vous retombez dans la foule, et vous devez le payement de l'impôt, au profit de la communauté.
—Allons, je vois que je n'échapperai pas, reprit l'Anglais. A demain donc, mesdames, le récit assez peu circonstancié de mes aventures.
Sur ces mots, chacun se leva pour la promenade. Il n'était personne qui ne fût ému. Frantz et Carolina avaient sans doute à repasser entre eux, à vérifier et à rectifier les détails du récit du jeune Allemand. Ottavio marchait toujours avec son rêve. Madame Julie Vernier, qui, sans en parler à personne, s'était mise à la recherche des quelques mots anglais qu'elle eût appris autrefois, avait besoin de solitude pour étudier sa leçon, avant de demander un examen et une interrogation à sir Olliver. Ce dernier, qui perdait de jour en jour de sa misanthropie et qui commençait à trouver que la vie avait encore quelques bonnes promesses à faire, était allé mesurer et écorner les provisions. Stanislas resta seul avec Dolorida Mendez.
—Ne vous éloignez pas, madame, lui dit-il avec émotion.
—Est-ce que vous auriez un récit particulier à me faire? demanda l'Espagnole. Ce serait un vol à la communauté, je vous en préviens.
—Non, madame, répondit le jeune peintre; je n'ai rien à vous dire que vous n'ayez deviné. Est-ce pour flatter cet Allemand sentimental que vous lui avez avoué votre prétendue conversion?
—Je hais trop les flatteurs pour aimer la flatterie, repartit Dolorida. J'ai dit, comme toujours, la vérité.
—Ainsi, vous retournerez en Espagne?
—Probablement, monsieur.
—Pourquoi dites-vous probablement?
—Parce qu'il est possible que nous ne sortions jamais de cette île, ou bien que, sortant, nous soyons exposés à d'autres naufrages plus dangereux. L'onde est perfide.
—C'est ce que Shakspeare disait aussi de la femme.
—Shakspeare avait raison; mais je ne vois pas ce que son épigramme peut avoir à trancher ici.
—Vous feignez de ne pas comprendre, Dolorida?
—Eh, monsieur! laissez-moi feindre, repartit résolûment l'Espagnole. Mais non, puisque vous m'y contraignez, parlons sans parabole. Vous êtes un honnête et loyal compagnon d'infortune. Vous avez du cœur, de l'intelligence; je ne doute pas que vous n'ayez un grand talent. Mais que prétendez-vous? tromper cette inquiétude qui m'agite et qui m'a suivie sur cette terre lointaine? donner un indestructible aliment à ce feu qui me consume? Vous voulez, parce que vous avez aussi brûlé vos lèvres à quelques-unes des passions qui me dévorent, vous charger de mon repos? Ce serait une téméraire entreprise, mon ami, qui ne profiterait à aucun des deux. Vous gagneriez mon mal, et la paix que vous m'offrez ne me tente pas assez. Oh! ne m'interrompez pas. Je pourrais peut-être vous aimer; mais cet amour deviendrait pour tous deux le châtiment de notre imprudence. D'abord, si peu que je tienne à M. Mendez, c'est, croyez-le bien, un fâcheux et inquiétant souvenir que celui d'un honnête homme qu'on a quitté parce qu'il a été généreux, et qu'on abandonne, parce qu'il a été confiant. J'ai cru que l'oubli était possible. Mais je sens que le remords peut devenir pour moi une passion à laquelle je m'intéresserai comme au jeu. Ne troublons pas davantage le cours de nos deux existences. Vous êtes jeune, vous reviendrez en France, mûri par les voyages, fortifié, bronzé par l'expérience, et j'aurai été peut-être une goutte d'acide dans le bain de cuivre que votre âme aura subi. Moi, je retournerai en Espagne, je me soumettrai humblement au devoir. Ces deux amoureux naïfs m'ont donné un bon conseil. Si le devoir me pèse trop, c'est que décidément j'aurai été mal élevée et que je ne mérite ni l'estime, ni le pardon d'un honnête homme; alors, j'irai dans un cloître, ou bien je verrai s'il a plu dans le Mançanarez.
—Ah! quel amour serait le vôtre! s'écria Robert.
—Voilà une exclamation que je voudrais entendre proférer par mon mari, dit Dolorida avec un superbe sourire.
—Se peut-il que vous l'aimiez un jour! dit le peintre.
—Je ne sais si cela se peut; mais je souhaite que cela se puisse.
—Je vous suivrai, madame.
—Vous aurez tort, mon ami; car ma porte, là-bas, en Espagne, ne ferme pas seulement à clef, elle ferme aussi à deux verrous.
—Mais hier, mais les jours précédents, vous sembliez m'encourager.
—Des reproches? reprit avec hauteur Dolorida. Si j'ai été coquette, j'ai eu tort et je vous en demande pardon. Allons, monsieur Robert, donnez-moi la main; soyons amis; c'est la seule façon de nous revoir un jour. Mais ne nous aimons pas autrement. Je mets ma fierté à rentrer chez mon mari la tête haute.
—Vous n'y resterez pas, je vous en préviens.
—Que vous importe! vous savez où j'irais en sortant. Assez sur ce point, mon ami. Cette île est déjà trop peuplée et les médisances commencent à y courir. On va dire du mal de nous dans le voisinage, si nous continuons.
Stanislas Robert vit bien que tout était fini; qu'il se fatiguerait vainement à insister; il soupira, salua l'Espagnole et alla confier ses chagrins à son ami Ottavio.
Les aventures de sir Olliver alléchaient vivement la curiosité; aussi, le lendemain, mit-on un empressement, plus grand encore que les jours précédents à se trouver à l'endroit ordinaire du Décaméron.
—Voyez, mesdames, quelle coquetterie l'île des Rêves déploie pour écouter son souverain, dit madame Julie Vernier. Jamais les arbres n'ont été si verts, et il me semble que les perroquets font silence.....
—Alors, taisons-nous, interrompit assez brusquement madame Mendez qui sympathisait de moins en moins avec la jeune Française.
Madame Vernier ne répliqua pas; mais elle regarda madame Mendez avec cet indéfinissable sourire de dédain qui sera toujours la meilleure revanche et la plus spirituelle réponse des Parisiennes.
—Mesdames, dit sir Olliver qui s'était habillé et ganté comme s'il eût dû monter à la tribune du parlement, je vais vous raconter sans réticences.....
—Diable! il faudrait peut-être des réticences, dit Stanislas Robert, qui ne s'amusait plus du Décaméron.
—On n'interrompt pas l'orateur, s'écria madame Vernier, laissez parler sir Olliver. Milord, continuez.
—Mesdames, je vais vous raconter sans réticences.....
A ce moment, une formidable détonation fit tressaillir tout l'auditoire.
—C'est le canon! un navire! un navire!
Et tout le monde de courir vers le rivage. Sir Olliver ne bougea pas; il mit seulement son lorgnon dans l'œil et essaya d'apercevoir quelque chose à travers les branches.
—Eh bien! vous ne venez pas, milord? lui dit Ottavio, en se disposant à rejoindre toute la colonie.
—Non; je veux savoir auparavant si c'est le capitaine Michel; car si c'était le capitaine Michel, mon capitaine, à moi, je ne partirais pas.
—Espérons que ce n'est pas lui, milord; et Ottavio descendit vers la plage.
Ce n'était pas le Cyclope, mais bien le navire qui avait, quelques jours auparavant, déposé dans l'île, pour cause d'avarie, les personnages de ce récit, moins sir Olliver. Je ne peindrai pas les cris, les acclamations qui accueillirent le canot du capitaine.
—Enfin! disaient Frantz et madame Carolina Brenner, qui pensaient à l'Allemagne.
—Quel bonheur! murmurait Stanislas Robert, qui voulait appeler l'île des Rêves l'île des Déceptions.
—Dieu soit loué! répétait la señora Mendez qui trouvait dans l'arrivée du vaisseau l'avantage d'affermir plus rapidement dans sa résolution.
Ottavio ne disait rien, mais il dévorait l'étendue, comme s'il eût suffi d'un regard pour arriver à l'extrémité de l'horizon.
—Sauvés, mon Dieu! sauvés, répétait à chaque instant la Française.
—Eh bien, comment va la santé? demanda le capitaine à ses naufragés.
—Mais vous voyez que nous n'avons pas dépéri, répondit madame Vernier.
—Nous nous sommes même multipliés, ajouta Robert. Vous nous avez débarqués six, vous nous reprendrez sept.
—Comment? dit en riant le capitaine.
—Il paraît que l'île produit des Anglais. Vous l'ignoriez donc?
—Farceur!
—Demandez plutôt à ces dames!
Tout en discourant, on était avancé un peu dans l'île. Sir Olliver apparut alors, assis au même endroit, impassible, lorgnant toujours, la bouche encore ouverte par les mots qu'il avait laissés passer.
—C'est ma foi vrai, dit le capitaine. Quel est ce monsieur?
—Le roi de cette île, comme nous avons l'honneur de vous le dire, capitaine.
—Il n'a pas l'air féroce.
—Oh! nous l'avons apprivoisé.
—Comment?
—En lui racontant des histoires.
Le capitaine aimait à rire; il en profita pour rire à grands éclats.
—Ah ça! messieurs et mesdames, dans une heure nous nous embarquons. Vous ne vous êtes pas trop ennuyés, hein?
—Non! non! répondit-on de toutes parts, avec une petite moue un peu douteuse.
—Ma foi, capitaine, il était temps que vous vinssiez, dit Ottavio; les rapports devenaient fort diplomatiques, et un peu plus, conflagration générale! Quant au vieux monde, il nous a paru à tous beaucoup moins laid, depuis que nous y avons songé dans la solitude; chacun de nous le reverra avec plaisir.
On s'était approché de sir Olliver.
—Milord, dit Ottavio, ce n'est pas le capitaine Michel.
—Alors je pars, répondit l'Anglais en se levant.
Au bout d'une heure, tous les préparatifs d'embarquement étaient terminés; les approvisionnements et les ustensiles de sir Olliver furent soigneusement emballés par lui; quand il eut fini, l'Anglais tira Stanislas Robert à l'écart:
—Je voudrais vous demander un conseil.
—Parlez, milord.
—Je voudrais bien épouser madame Vernier.
—Tout de suite? c'est impossible. Avant l'arrivée du capitaine, je n'aurais pas dit non; mais, maintenant, la société officielle est représentée, il faut plus de formalités.
—Vous plaisantez; je veux seulement dire que je l'épouserai quand nous serons en Angleterre ou en France.
—Eh bien! alors, pourquoi m'en parlez-vous maintenant?
—C'est pour avoir votre avis.
—Mais il me semble que celui de madame Vernier importe davantage.
—Non, vous êtes de bon conseil.
—Pour les autres, peut-être, répondit avec un peu de mélancolie le jeune peintre; mais pour moi, non. Eh bien! milord, si le cœur vous le dit, épousez madame Vernier.
—Oh! je suis bien aise que vous soyez de cet avis.
—Et si je n'avais pas été de cet avis?
—J'aurais agi de même, mais j'en aurais été contrarié.
—Je m'en doutais! milord, vous cessez d'être excentrique; vous faites comme tout le monde.
—Et vous croyez que madame Vernier consentira?...
—J'en suis sûr. Au surplus, vous allez être fixé.
Sir Olliver et Stanislas Robert se rapprochèrent des dames.
—Madame Vernier, demanda le peintre, allez-vous toujours en Australie?
—Je n'en sais rien, répondit la Française, cela dépend...
—Est-ce que vous n'aimeriez pas mieux vous perfectionner dans la langue anglaise? voilà milord qui vous offre...
—Des leçons?
—Non, sa main.
—Vous avez une façon de brusquer les dénoûments, reprit en riant madame Vernier.
—Ne nous avez-vous pas dit que votre existence avait été un vaudeville jusqu'ici? Eh bien! nous la terminerons comme un vaudeville.
Madame Vernier sourit et tendit son ombrelle à sir Olliver:
—Tenez, milord, portez-moi cela!
C'était un aveu; sir Olliver devint aussi rouge que ses cheveux.
Stanislas s'approcha de madame Mendez:
—Vous le voyez, lui dit-il à demi-voix, Frantz et Carolina, sir Olliver et madame Vernier, deux couples! quatre heureux! il n'y a qu'à nous que l'île des Rêves n'aura pas porté bonheur.
—Ingrat! N'est-ce donc rien que l'amitié? répondit Dolorida.
—Tu te plains! Et moi, dit d'une voix profonde Ottavio, qui avait entendu, que dirai-je donc? moi que personne n'attend, moi qui nourris dans mon cœur un amour impossible, une chimère, moi qui n'ai plus de patrie, même dans mon pays!
—Oh! toi, tu as l'espoir de te faire tuer, un de ces jours, pour la liberté!
—Eh bien! nigaud, fais de même et viens avec moi! Cette passion en vaut bien une autre!
Sir Olliver tenait à laisser de ses nouvelles au capitaine du Cyclope. Il se fit donc aider par le jeune peintre, et il plaça dans l'endroit le plus apparent du rivage une perche avec une enveloppe gigantesque à l'extrémité.
Tout le monde descendit dans le canot, et quelques instants après, le Décaméron, avec armes et bagages, s'installait sur le navire.
—Dites donc, monsieur le capitaine, demanda madame Vernier, il ne nous arrivera plus d'accidents en route, j'espère? Votre coquille est solide?
—J'en réponds, madame.
—Tant mieux! dit madame Vernier; car vous portez mon cœur et sa fortune!
—Tant pis! dit sir Olliver; je ne serais pas fâché d'avoir l'émotion d'un second naufrage.
—Si ce sont des émotions qu'il vous faut, milord, je vous en donnerai, n'ayez pas peur, répondit la jeune veuve.
Milord, complétement rassuré par cette menace, qui comblait ses vœux, daigna rire tout à fait. Le vaisseau leva l'ancre, et bientôt l'île des Rêves disparut à l'horizon.
Le lendemain, presque à la même heure, un autre navire s'approcha de la côte, mais sur un point différent. Il ne donna pas de signal, il ne tira pas le canon. C'était le Cyclope.
—Mes enfants, dit le capitaine Michel, pas de brutalité: essayons de surprendre doucement milord dans ses méditations.
Bientôt, un canot dans lequel Michel, Pharamond et quatre matelots prirent place, se détacha du navire et vint s'amarrer aux grands arbres qui plongeaient leurs branches dans l'Océan. L'équipage sortit avec précaution, se glissa dans l'île, qu'il se mit à explorer avec soin. Mais sir Olliver était invisible. Bientôt des traces se firent remarquer.
—Dites donc, capitaine, il est venu de la société ici, dit Pharamond. Si ce sont des voisins en visite, sir Olliver a dû passer un mauvais quart d'heure.
Michel pâlit.
—Allons donc! c'est histoire de rire, ce que je dis là. Ah ça! il s'est donc enterré, s'il s'est tué, cet animal d'Anglais!
Et Pharamond, autorisé à faire du bruit, se mit à rivaliser de son mieux avec le chant du coq ou le bêlement du mouton. Mais les échos seuls répondirent aux accents de Pharamond.
—Est-ce qu'il serait devenu sourd? dit le matelot.
Michel était triste; il craignait que sa mystification n'eût eu un dénoûment plus sérieux qu'il ne l'avait prévu. Comme on s'approchait du rivage, la perche dressée dans le sable, avec son papier, se révéla aux regards.
—Capitaine, voilà un renseignement, dit Pharamond.
On enleva la lettre, qui portait pour suscription: Au capitaine Michel. Voici ce qu'elle contenait:
«Sir Olliver Brandon, etc., etc., etc. (Suivaient deux lignes de titres et de dénominations), a l'honneur de vous faire part de son mariage avec madame veuve Louise Vernier.
«P. S. Sir Olliver est désolé de ne pouvoir inviter tout l'équipage du Cyclope à son repas de noce. Il regrette notamment de ne pouvoir donner au matelot Pharamond, dont il a pu apprécier la gentillesse et les bonnes manières, une boîte de bonbons. Il compte bien se dédommager à la première rencontre.»
—Qu'est-ce que cela veut dire? demanda Michel assez surpris.
—Cela veut dire qu'il se moque de vous, grommela Pharamond.
—Allons! en route et ne perdons pas de temps, dit Michel. Puisqu'il est parti, bon voyage! Mes amis, ma femme et mes filles m'attendent: ne laissons pas refroidir la soupe.
Jamais le capitaine n'avait été si familier: tout l'équipage en fit la remarque. Mais il était évident que c'était une façon de dissimuler sa mauvaise humeur. Le Cyclope déploya ses voiles, leva ses ancres, et prit sa course pour le vieux monde, c'est-à-dire pour le monde toujours nouveau, toujours renouvelé.
Un auteur bien appris, comme un gouvernement bien réglé, a une excellente police à ses ordres et doit compte au public de la destinée de tous les héros qu'il a mis en scène. Réglons donc ce compte, qui n'embarrasse pas notre conscience.
Pour commencer par les derniers venus, nous dirons que le matelot Pharamond navigue toujours et n'a pas gagné sous le rapport du bon ton et de l'aménité. Il déteste les Anglais, et il n'est pas étranger aux bruits de guerre et de descente en Angleterre qui circulent de temps en temps.
Le capitaine Michel est au comble de ses vœux. Il a la goutte. Il emploie les loisirs de sa retraite à découper en papier les profils des plus fameux monuments qu'il a contemplés, dans le cours de ses diverses navigations. Il tient plus que jamais à bien marier ses filles. Voilà pourquoi celles-ci continuent à honorer sainte Catherine.
Sir Olliver voyage toujours; mais maintenant c'est afin de s'ennuyer un peu. Sa femme lui donne trop d'émotions, et il se plaint d'être trop heureux. Quand on se rappellera que le bonheur de sir Olliver a toujours consisté à souffrir et à éprouver des mécomptes, personne ne l'enviera plus. Milady est toujours charmante, piquante, réjouie. Elle sait assez l'anglais et elle apprend l'italien. Est-ce en souvenir d'Ottavio?
Stanislas Robert a suivi le conseil d'Ottavio. Ils ne sont pas morts; mais ils se sont déjà battus pour leur cause et ils se battront sans doute encore.
Frantz et sa femme vivent en Allemagne, qu'ils ne songent plus à quitter. Je ne sais combien d'enfants ils ont déjà fait baptiser, mais à coup sûr ils n'en sont plus à leur premier.
Quant à la señora Mendez, elle est en Espagne. Elle a résolu le problème de la paix et de la concorde dans le foyer conjugal. Elle a rendu son mari joueur, mais en donnant à leur passion un caractère plus moderne et plus décent: c'est à la Bourse qu'ils jouent tous les deux!
End of the Project Gutenberg EBook of L'île des rêves, by Louis Ulbach
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ÎLE DES RÊVES ***
***** This file should be named 18995-h.htm or 18995-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/1/8/9/9/18995/
Produced by Chuck Greif, Carlo Traverso and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
file was produced from images generously made available
by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
http://gallica.bnf.fr)
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card
donations. To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
*** END: FULL LICENSE ***